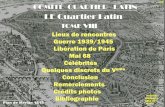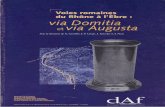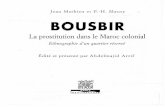Découverte de deux nouvelles tombes du Haut-Empire dans le quartier Hoche-Sernam à Nîmes (Gard).
Transcript of Découverte de deux nouvelles tombes du Haut-Empire dans le quartier Hoche-Sernam à Nîmes (Gard).
221
ReVue ARCHéOLOGIQue De nARBOnnAIse, tome 45, 2012 RAN 45 – pp. 221-246
– Marie Rochette – Sébastien Barberan– Valérie Bel– Anne Bouchette †– Vianney Forest– Yves Manniez– Richard Pellé– Stéphanie Raux
Découverte de deux nouvelles tombes du Haut-Empire dans le quartier Hoche-Sernam à Nîmes (Gard)
1. LE CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE DES DÉCOUVERTES (m. R.)
Le projet de requalifi cation urbaine de l’ancien hôpital de Nîmes au nord-est de la ville, dans le quartier de Hoche-Sernam, ouvre depuis 2008 une nouvelle fenêtre archéologique à la périphérie immédiate de la cité antique, dans un secteur encore peu exploré
(Rochette 2008, Rochette 2010, Rochette 2011).
Le site de Hoche-Sernam se situe en bas de pente, à l’est du Mont Duplan et de la ville antique. Le secteur est enserré par deux itinéraires anciens : au nord à l’approche de l’aggloméra-tion, où l’entrée de la voie reliant Uzès se fait dans l’enceinte nîmoise en franchissant une porte située à la convergence des rues de la Biche, de Calvas, Edmond-Rostand et de Bonfa (Fiches, Veyrac dir. 1996, p.459-470). Plus au sud, un second axe (Fiches, Veyrac dir. 1996, p.471) contourne le Mont-Duplan. Son tracé connu uniquement par les points de découvertes funéraires passe à l’ouest par le sud de la rue d’Aquitaine et à l’est par les casernes d’artillerie. On peut supposer que cet axe rejoignait d’un côté la ville à la porte d’Auguste et d’un autre côté la route d’Uzès. La rue de Sully, suivant un axe nord-ouest/sud-est, complète ce dispositif marquant le possible tracé fos-sile d’un ancien axe de circulation nord/sud, reliant les reliefs collinaires à la plaine du Vistre.
◤ Résumé :De récents diagnostics d’archéologie préventive réalisés par les équipes de l’Inrap dans le quartier nîmois de Hoche-Sernam ont livré deux tombes du Haut-Empire ainsi que quelques fosses contenant des fragments de mobiliers funéraires. L’article présente les deux tombes découvertes en 2010, et notam-ment l’une, particulièrement riche, qui a entre autre livré des vases, de la vais-selle en verre et du matériel de filage. Ces données apportent des informations nouvelles sur un secteur funéraire situé au nord-est de la ville antique, connu jusqu’à présent uniquement par des découvertes anciennes.
◤ Mots-clés :Crémation, Haut-Empire, fosses, sépultures, végétaux, faune, vaisselle en céramique, vaisselle en verre, parure, petit mobilier, filage, monnaie.
◤ Abstract:Recent diagnoses of preventive archeology made by Inrap teams in the Hoche-Sernam Nîmes’s district delivered two graves of Early Roman Empire and some pits containing fragments of grave objects. The article presents two graves discovered in 2010, including one particularly rich, who among other things delivered vases, glass tableware and weaving equipment. This data provides new information on the funeral industry located in the northeastern ancient city, known until now only by ancient discoveries.
◤ Keywords:Graves, Early Roman Empire, pits, seed, wildlife, vases, glass tableware, costume, weaving equipment, small artefact, coin.
À la mémoire d’Anne Bouchette
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
222 – mARIe ROCHette ET AL.
ReVue ARCHéOLOGIQue De nARBOnnAIse, tome 45, 2012
Les abords de route d’Uzès, au nord, ont été marqués par le développement d’une vaste zone funéraire d’époques antique et médiévale. L’axe sud reliant la porte d’Auguste aux casernes d’artillerie est égale-ment ponctué de points de découvertes (fi g. 1).
Ainsi rue d’Aquitaine, au n° 23, à l’est de la rue (Fiches, Veyrac dir. 1996, notice 559, p. 471) :
- découverte en 1870 d’une stèle à fronton triangu-laire orné d’un décor de rosace et portant une épi-taphe, C.I.L. XII 3928, datée du IIe s. de n. è.
- découverte d’une bague en bronze avec une tête de serpent.
- découverte en 1873 de tessons de céramique.
Rue Vincent Faïta (Fiches, Veyrac dir. 1996, notice 563, p. 472) :
- découverte de la partie supérieure d’une stèle à fron-ton triangulaire (complément de celle mise au jour en 1870)
Rue Fulton, au n° 1 bis (Fiches, Veyrac dir. 1996, notice 560, p. 471) :
- découverte en 1884 d’une tombe en coffre conte-nant une urne en céramique non tournée à petit col et bord à lèvre déversée, une cruche à pâte claire à une anse, un petit vase caréné à deux anses, un bal-samaire fusiforme en céramique, un gobelet à paroi fi ne, un plat tourné en terre grise, un biberon, une poupée en terre cuite dont les jambes sont articulées et les chevilles serrées par de bracelets de bronze, une monnaie d’argent, un objet en os percé, quatre coquillages, un objet en coquillage. L’ensemble de ce mobilier a été estimé de la fi n du Ier s. av. n. è.
Rue Fulton, au nord de la rue (Fiches, Veyrac dir. 1996, notice 561, p. 472) :- découverte en 1890 d’un fragment d’inscription se rapportant probablement à une épitaphe.
Et chemin d’Uzès, hôpital (Fiches, Veyrac dir. 1996, notice 562, p. 472) :
0 1000 m
N
découvertes anciennes
découvertes de tombes issues de diagnostics
découvertes de fosses issues de diagnostics
emprise des diagnostics
proposition de restitution de voie
562
acqueduc
SP1001SP1002 FS1005
FS1004
FS1003
FS1001
562561560
563
559
Figure 1Localisation des
découvertes réalisés dans le quartier Hoche-Sernam.
Infographie M. Rochette.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
223DéCOuVeRte De DeuX nOuVeLLes tOmBes Du HAut-empIRe DAns Le QuARtIeR HOCHe-seRnAm À nÎmes (GARD)
RAN 45 – pp. 221-246
Y=6306000
Y=6306050
Y=6306100
Y=6306150
X=
810000
X=
810050
X=
810100
Y=6306000
Y=6306050
Y=6306100
Y=6306150
X=
810000
X=
810050
X=
810100
Y=6306200
Y=6306250
Y=6306200
Y=6306250Y=6306250Y=6306250
Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200
Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100
X=
810000
X=
810000
Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050
Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100
Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200
Y=6306150Y=6306150Y=6306150Y=6306150
Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200
Y=6306150Y=6306150Y=6306150Y=6306150Y=6306150Y=6306150Y=6306150Y=6306150
Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050
Y=6306150Y=6306150Y=6306150Y=6306150Y=6306150Y=6306150
X=
810100
X=
810100
X=
810100
X=
810100
X=
810100
X=
810100
Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100
Y=6306250Y=6306250
Y=6306150Y=6306150
Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue
HocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHocheHoche
lala
BicheBicheBicheBiche
Y=6306000Y=6306000
X=
810050
X=
810050
X=
810100
X=
810100
Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200
Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100Y=6306100
X=
810100
X=
810100
X=
810100
X=
810100
X=
810100
X=
810100
X=
810100
X=
810100
X=
810100
X=
810100
X=
810100
X=
810100
X=
810100
X=
810100
Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050Y=6306050
33
444444555555
222222
11
SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001
SP1002SP1002
1003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-1004
10051005
regard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréSD PFSD PF
SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001
SP1002SP1002SP1002SP1002
1003-10041003-1004
10051005
SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001SP1001
SP1002SP1002SP1002SP1002SP1002SP1002SP1002SP1002
1003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-1004
10051005100510051005100510051005
regard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carréregard carré
1003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-10041003-1004
NMHSM03Hoche-Sernam 2, phase 2
NMHSM02Hoche-Sernam 2, phase 1
NMHSM01Ancien hôpital, rue Sully
0 50m
FS1003
FS1005
FS1004
N
Y=6306250Y=6306250
Y=6306200Y=6306200Y=6306200Y=6306200
SP1001
SP1002
FS1005
Figure 2Plan cumulé des trois opérations de diagnostic et localisation des vestiges funéraires. Levé topographique A. Farge ; infographie M. Rochette.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
224 – mARIe ROCHette ET AL.
ReVue ARCHéOLOGIQue De nARBOnnAIse, tome 45, 2012
- découverte dans le jardin de l’hôpital de mascaron d’applique sur anse de vase, de style archaïque.
- découverte d’une stèle à fronton triangulaire portant une épitaphe datée du IIe s. de. n. è.
- découverte d’une inscription près de l’hôpital.- découverte en 1865 d’une urne cinéraire en verre.
Récemment en 2010 et 2011, deux diagnostics archéologiques réalisés par l’Inrap sur une emprise de 9 000 m2 ouverte sur 1 170 m2, ont mis au jour sur les parcelles très perturbées de l’ancien hôpital Doumergue deux sépultures, SP1001 et SP1002, et quatre fosses dont la datation a été estimée du Haut-Empire (FS1003, FS1004, FS1005 en 2010 et FS1005 en 2011) (fi g. 2).
La fosse FS1003 a été mise au jour à 54,08 m d’alti-tude, le niveau d’ouverture et le sol associé ne sont pas conservés. Le creusement de la fosse est circu-laire, mesurant 0,80 m de diamètre. Son profi l pré-sente des bords peu évasés et un fond plat. La partie ouest est profonde de 0,05 m, la partie orientale est surcreusée sur une profondeur de 0,15 m. Le comble-ment de la fosse est caractérisé par un limon argileux brun mêlé de quelques cailloux issus de l’encaissant, ainsi que de fragments de charbon de bois. Il a éga-lement livré un fragment d’amphore gauloise à pâte sableuse, cinq fragments de céramique sabl-r, trois fragments de céramique cl-rec, deux petits frag-ments de verre fondu, un fragment de four à cloche mobile en terre cuite (tanour). L’estimation chronolo-
gique de cette fosse, basée sur l’amphore gau-loise, se situe entre -25 et 300.
La fosse FS1004 a été mise au jour à proximité de la structure FS1003. Elle a été dégagée à 54,15 m d’altitude. Le niveau d’ouverture et le sol associé à la structure ont été tronqués par les aménagements postérieurs. Le creusement de la fosse est circulaire mesurant 0,80 m de diamètre. Son profi l profond d’une quinzaine de centimètres présente des bords peu évasés et un fond quasi plat. Le comblement limono-argileux brun verdâtre de la fosse a livré cinq fragments osseux brûlés d’une masse totale de 2,6 g. On identifi e un fragment de crâne (0,5 g) de teinte blanche et des fragments de diaphyse d’os long (2,1 g) de teinte blanche à gris noir, ces pièces de petite taille (moins de 15 mm) pouvant appartenir à un sujet humain de taille adulte d’après l’épaisseur de la corti-
cale des os longs. Outre un coquillage, une épingle et une tige plate en bronze de 0,05 m de long, la fosse FS1004 a livré cinq fragments de céramique cl-rec, un fragment de céramique mort-c, un fragment de céramique à vernis rouge pompéien, un frag-ment d’amphore gauloise calcaire, deux fragments
de céramique sabl-r, trois fragments de céramique sabl-o, 1 fragment céramique non tournée, 1 frag-ment de céramique campanienne A, 2 fragments de céramique sigillée sud gauloise dont un bord (fi g. 3). On dénombre également la présence d’une épingle en bronze, d’une baguette plate en bronze (quatre fragments), de quatre fragments de tuile, d’un frag-ment de torchis, d’un fragment de torchis vitrifi é, d’un éclat de silex, de deux fragments de coquillage. L’estimation chronologique de cette fosse, proposée entre 40 et 200, est basée sur le bol Drag. 33.
La fosse FS1005 reconnue en 2010 a été observée uni-quement en coupe. Elle s’ouvre à 54,30 m d’altitude NGF et mesure 0,56 m de large pour une profondeur de 0,08 m. Son creusement présente un profi l à bords peu évasés et un fond plat. Dans la coupe, son com-blement apparaît limono-argileux brun-rouge avec des tâches orangées qui pourraient correspondre à de la rubéfaction. Elle a livré trois petits fragments d’os brûlés indéterminés d’une masse inférieure à 0,1 g et d’une taille inférieure à 3 mm. On identifi e deux fragments de diaphyses d’os longs d’espèce indéter-minée. Ces fragments sont de couleur blanche ou gris bleu à noir.
Enfi n la fosse FS1005, fouillée en 2011 a été mise au jour au nord des présentes, à 55,28 m NGF. De plan quadrangulaire d’axe nord/sud, elle mesure 0,75 m de longueur par 0,42 m de largeur. Son creusement présente un profi l en cuvette profond d’une dizaine de centimètres, avec un fond relativement plat, sans trace de rubéfaction. Le comblement de la structure est constitué d’un limon argileux brun-noir contenant de très nombreux charbons de bois, assez gros. On relève la présence de tiges de clous en fer et d’une tête de clou de sandales en bronze, de fragments de verre fondu et non fondu. On relève également la présence d’un fragment d’amphore de Tarraconaise, d’un frag-ment d’amphore gauloise à pâte claire, d’un fragment de céramique de l’Uzège (intrusif), d’un fragment de tuile, d’une tête de clou de sandale, de vingt frag-ments de tiges ou clous, d’une scorie, de neuf petits fragments de verre dont au moins quatre fondus. La datation proposée pour cette fosse est le Ier s. de n. è.
La fonction de ces quatre structures excavées reste à discuter : elles pourraient être interprétées comme des structures agraires qui percutent le niveau aujourd’hui disparu de la nécropole. Cela explique-rait la nature des comblements (traces de rubéfaction ou de charbons de bois pour au moins deux d’entre elles) et le mobilier retrouvé. Mais à l’inverse, il pourrait s’agir pour certaines d’entre elles de struc-tures funéraires, de type dépôts secondaires ou fonds de bûchers, tronqués par les dérasements et aména-gements postérieurs.
2
3
4
1
0 10 cm
Figure 3FS1004 : céramique à pâte
claire calcaire (n° 2-3) ; commune à pâte sableuse
cuite en mode A (n° 4) ; igillée sud-gauloise (n° 5).
Dessins S. Barberan.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
225DéCOuVeRte De DeuX nOuVeLLes tOmBes Du HAut-empIRe DAns Le QuARtIeR HOCHe-seRnAm À nÎmes (GARD)
RAN 45 – pp. 221-246
2. LA SÉPULTURE SP1001
2.1. Présentation de la structure (M. R.)
La sépulture SP1001 a été mise au jour en 2010 le long de la rue Ferdinand Girard (fi g. 1 et 2), et déga-gée à une altitude de 54,23 m NGF dans un paléosol limoneux brun-rouge. Elle a été fouillée lors du dia-gnostic de manière exhaustive.
Le creusement de la tombe est de forme oblongue globalement orienté est/ouest, il mesure 1,06 m de long par 0,75 m de large (fi g. 4). Son profi l est très évasé sur les cinq premiers centimètres alors que sur les vingt-cinq centimètres restant, les parois sont verticales. Le fond, aménagé dans le substrat, est quasi plat. Il présente cependant un léger pendage vers l’ouest. Dans le quart nord/est de la structure, ont été déposés directement sur le fond deux balsamaires entiers non brûlés, une tige en verre déformée par l’action du feu et un coquillage. Le bon état de conserva-tion de ce mobilier indique une action de dépôt. Ce dépôt est recouvert par une couche de limon brun (Us 1007) noirci par une forte quantité de charbon de bois, marqué par une représentation élevée en esquilles d’os brûlés. Dans le quart nord-nord/ouest de la structure, un autre dépôt a été observé au sommet de la couche de limon brun noir. Il se caractérise par une dizaine de céramiques fragmentées mais entières : petites cruches, assiettes, cou-pelles, pots. Quelques fragments d’élé-ments en verre, déformés par le feu, ont également été reconnus. L’ensemble du dépôt est scellé par un sédiment limono-argileux (Us 1001) présentant une forte concentration de charbon de bois. On relève la présence de résidus carbonisés d’au moins trois planches de bois mesu-rant en moyenne 0,20 x 0,10 x 0,10 m, ainsi que de nombreux éléments de mobi-lier archéologique : tessons de céramique, tabletterie, verre, métal, monnaie.
2.2. Os humains brûlés (V. B.)
La structure SP1001 a livré 404,9 g d’os-sements humains brûlés issus des com-blements charbonneux Us 1001 (237,4 g) et Us 1007 (12,5 g) et du balsamaire Us 1012 (0,4 g) (fi g. 5). Les comblements ont été entièrement prélevés et tamisés (150 litres) en quatre secteurs (40 litres par
secteur à l’exception du secteur A au nord-ouest : 30 litres). Les os proviennent des refus de tamis de la maille de 4 mm. Les refus des mailles 1 et 0,5 mm ont été conservés mais n’ont pas été triés.
Les fragments conservés peuvent être attribués à au moins un sujet adulte d’après le stade de matura-tion des os (épiphyse distale de fémur) et des dents
1007
1001
1007
1001
1007
1007
1008
1008
1008
charbon de bois et sédiment charbonneuxfragment de céramique
métal, monnaie et clous
verre
S N O E
54,20
54,15
54,20 altitude en NGF
54,10
coquillage
53,99
0 1 m
N
N
N
Ech. 1/20
A B
C D
A B
C D
Figure 4Relevé en plan et en coupe de la tombe SP1001. Dessin Y. Pascal, infographie M. Rochette.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
226 – mARIe ROCHette ET AL.
ReVue ARCHéOLOGIQue De nARBOnnAIse, tome 45, 2012
(3 racines avec apex fermé), ainsi que l’épaisseur de la corticale des os longs et du crâne. Le sexe ne peut être déterminé, mais on note que les os sont plutôt graciles.
La masse d’ossements conservée est très inférieure aux fourchettes de valeurs théoriques établies (pour les sujets adultes) à partir de l’étude de cré-mations modernes (Lenorzer 2009, p.81 ; Bel et al. 2008, p. 243). Ces valeurs sont comprises entre 970 et 2 630 g selon Hermann 1976, entre 876 g et 3784 g selon Warren, Maples 1997 ou entre 1 001,5 g et 2 422,5 g selon Mac Kinley 1993. Ce défi cit peut être en partie attribué à la disparition du sommet de la couche charbonneuse Us 1001.
Les os sont pour la plupart de couleur brun noir cor-respondant à une température de 250-300°C avec quelques éléments blancs ou gris clair témoignant de température plus élevée (supérieure à 500°C). La fragmentation des pièces est assez importante (les esquilles représentent 22 % du lot). Les fragments ont une taille inférieure à 60-70 mm mais des col-lages permettent de reconstituer des segments de diaphyse de fémur ou de tibia de 130 et 140 mm de longueur. Les pièces les plus brûlées présentent des fi ssures parallèles et transverses et des déformations caractéristiques d’une crémation à l’état frais.
Le taux de détermination est néanmoins particuliè-rement faible (environ 38 %), ce qui réduit la portée des données obtenues. Les indices pondéraux par région anatomique montrent une sous-représentation du crâne et du tronc (fi g. 6).
Les restes osseux sont concentrés dans la couche charbonneuse supérieure (Us 1001). La répartition par secteur ne fait pas apparaître de regroupement, les lots étant assez comparables. La répartition par région anatomique montre néanmoins une meilleure représentation du crâne au sud-est de la fosse et une présence plus marquée des os des membres infé-rieurs au nord-est (fi g. 6). Compte tenu du faible taux de détermination, ces différences ne peuvent être considérées comme signifi catives.
2.3. Restes carpologiques et fauniques (A. B.)
Plusieurs restes carpologiques, composés de frui-tiers, céréales et plantes sauvages, ont été mis en évidence dans les couches Us 1001 et 1008 (fi g. 7) 1. Les premiers sont représentés par le noisetier (Cory-lus avellana), le fi guier (Ficus carica), l’amandier (Prunus dulcis) et la vigne (Vitis) ; les seconds, par le blé nu (Triticum aestivum/durum) et l’avoine ; les troisièmes, par la petite luzerne (Medicago minima), l’héliotrope commun (Heliotropium europaeum), un
Tombe/os 1001 1007 1012 TOTAL Tot.Rég %ident. %Tot. POIDS
Crâne 38,3 0,9 39,2 Mandibule 0,0 Dents sup. 0,0 Dents inf. 0,0 Dents indet. 5,7 5,7 Os hyoïde 0,0 Osselets oreille 0,0 Cartilage calcifi é 0,0
Tête 44,0 0,9 0,0 44,9 29,0 11,1Atlas 0,0 Axis 0,0 Vert. C3-C7 0,6 0,6 Vert. thoraciques 0,0 Vert. lombaires 0,0 Vert. indet. 7,1 7,1 Sacrum 0,0 Coccyx 0,0 Côtes 3,7 0,1 3,8 Sternum 0,0
Tronc 11,4 0,1 0,0 11,5 7,4 2,8Clavicule 0,0 Scapula 0,0 Humérus 4,6 0,1 4,7 Radius 0,0 Ulna 1,8 0,2 2,0 Carpe 0,4 0,4 Métacarpe 0,0 Phalanges main 0,2 0,2 Diaph. membre sup. 0,5 1,5 2,0
Mb.sup. 7,5 1,8 0,0 9,3 6,0 2,3Coxal 2,5 2,5 Fémur 28,0 7,5 35,5 Patella 0,0 Tibia 9,9 9,9 Fibula 0,3 0,3 Tarse 1,0 0,9 1,9 Métatarse 2,0 1,4 0,4 3,8 Phalanges pieds 0,1 0,3 0,4 Sésamoïde 0,0 Diaph. membre inf. 30,1 30,1
Mb.inf. 73,9 10,1 0,4 84,4 54,6 20,8 MTC,MTT,Pm,Pp 3,1 1,4 4,5 4,5 2,9 1,1 Total déterminé 139,9 14,3 0,4 154,6 154,6 100,0 38,2 Os plat 2,9 1,8 4,7 Os court ou épiphyse 52,8 1,8 54,6 Diaphyses indet. 94,2 4,9 0,3 99,4 39,2Esquilles 87,5 4,0 0,1 91,6 22,6 Total indéterminé 237,4 12,5 0,4 250,3 250,3 61,8 TOTAL 377,3 26,8 0,8 404,9 404,9 100,0
Figure 5Tableau des données pondérales des ossements brûlés de la crémation SP1001.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
227DéCOuVeRte De DeuX nOuVeLLes tOmBes Du HAut-empIRe DAns Le QuARtIeR HOCHe-seRnAm À nÎmes (GARD)
RAN 45 – pp. 221-246
carex (Carex) et une graminée (Poaceae). Un frag-ment d’aiguille appartenant peut-être au genévrier commun (cf. Juniperus communis) a également été identifi é. L’état de conservation de la plupart des restes, en particulier ceux des fruitiers, est très frag-mentaire. Quelques morceaux de tissus et fi bres textiles carbonisés ont été aussi observés ainsi que plusieurs éléments de matière organique dont trois portent des traces d’or. Si une certaine concentration semble se dessiner en termes de fragments dans le carré C, elle est surtout due aux restes de fi gues, les coques de noisette et fragments de pépins de raisin étant représentés dans l’ensemble de la sépulture.
On notera que le comblement Us 1001 (secteur C) a également livré 3 g d’ossements brûlés de faune.
2.4. Le mobilier
2.4.1. Le mobilier céramique de la tombe SP1001 (S. B.)
2.4.1.1. Catalogue
• Dépôts primaires en céramique (fi g. 8)
1. Assiette Drag. 36 incomplète en sigillée sud-gauloise produite à partir des années 60-70 de n. è. (Genin 2007, p.337) ou seulement à partir du début de la période fl a-vienne (Genty 1984). Vase en onze fragments brûlé après avoir été brisé ou cassures anciennes liées à l’action du feu. Vernis mat peu écaillé. Décor de feuilles d’eau. État de conservation : 85 % du bord ; 25 % du fond ; 60 % du vase. Localisation : Us 1008, carré A.
2. Petite assiette Herm. 5 entière et partiellement vernie en sigillée sud-gauloise produite probablement à partir du milieu du Ier s. de n. è. (Genin 2007, p.336). Vase assimi-lable à une soucoupe par sa taille, dont un tiers environ de la surface a subi l’action du feu. Vernis mat peu écaillé. Localisation : Us 1008, carré A.
3. Bol Drag. 33 presque complet en sigillée sud-gauloise produit à partir de 40 de n. è. (Genin 2007, p.328-329). Vase en dix-sept fragments brûlé après avoir été brisé. Sur une partie de la paroi, on observe une altération différentielle des surfaces et des tranches d’un fragment à l’autre, un tes-son étant nettement plus brûlé que ceux qui l’environnent. Vernis mat peu écaillé. Estampille partiellement lisible [OF( )CI] dans un cartouche rectangulaire aux angles arrondis. État de conservation : 95 % du bord ; 100 % du fond ; 90 % du vase. Localisation : Us 1008, carré A.
4. Petit bol Drag. 27b ou c complet en sigillée sud-gauloise produit aux Ier-IIe s. de n. è. (Genin 2007, p.325-326). Vase en six fragments brûlé après avoir été brisé ou cassures anciennes liées à l’action du feu. Vernis mat bien conservé.
Estampille illisible dans un cartouche rectangulaire aux angles arrondis. Localisation : Us 1008, carré A.
5. Coupelle Drag. 35 incomplète en sigillée sud-gauloise produite à partir des années 60-70 de n. è. (Genin 2007, p.329) ou seulement à partir du début de la période fl a-vienne (Genty 1984). Vase en cinq fragments brûlé après avoir été brisé ou cassures anciennes liées à l’action du feu. Vernis mat peu écaillé. Décor de feuilles d’eau. État de conservation : 70 % du bord ; 100 % du fond ; 70 % du vase. Localisation : Us 1008, carré A.
6. Petite coupelle Drag. 35 complète en sigillée sud-gau-loise. Vase en deux fragments brûlé après avoir été brisé ou cassures anciennes liées à l’action du feu. Vernis mat bien conservé. Décor de feuilles d’eau. Localisation : Us 1008, carré A.
SP10010%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Référence théorique
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
A B C D
masse totale (en g)
SECTEURS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A B C DSECTEURS
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
us 1001 us 1007 us 1012
TêteTroncMbsupMbinfMbind
Figure 6Indices pondéraux par région anatomique des restes humains brûlés de la crémation SP1001.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
228 – mARIe ROCHette ET AL.
ReVue ARCHéOLOGIQue De nARBOnnAIse, tome 45, 2012
7. Cruche/olpé du type cl-rec 1f presque complète en céra-mique à pâte claire calcaire produite à partir du milieu du Ier s. de n. è. (Py in Py dir. 1993, p.223). Vase en onze frag-ments brûlé après avoir été brisé ou cassures anciennes liées à l’action du feu. Une portion du col et du bord sont manquantes. À cet endroit, les tranches des tessons sont concrétionnées, au même titre que la quasi-totalité de la surface du récipient. Capacité de remplissage estimée à 0,38 litre jusqu’au resserrement interne maximal du col. État de conservation : 20 % du bord ; 100 % du fond ; 95 % du vase. Localisation : us 1008, carré A.
8. Cruche/olpé de type indéterminé incomplète en céra-mique à pâte claire calcaire. Vase en vingt-trois fragments brûlé. Cassures fraîches. Surface concrétionnée. Capacité de remplissage minimale estimée à 0,64 litre jusqu’à la cassure. État de conservation : col et une partie de l’anse manquants ; 30 % du fond ; 40 % du vase. Localisation : Us 1008, carré C.
9. Pot/gobelet à une anse incomplet en céramique com-mune à pâte sableuse cuite en mode B assimilable à une imitation de gobelet à parois fi nes (forme Mayet 42 ; Passelac in Py dir. 1993, p.520-521). Modèle à notre connaissance inédit en Languedoc oriental susceptible d’être aussi comparé au pot, parfois de petit module, sabl-or A2 dépourvu d’anse (Raynaud in Py dir. 1993, p. 549). Vase en sept fragments brûlé après avoir été brisé ou cas-sures anciennes liées à l’action du feu. Enlèvements en écaille de la surface du récipient occasionnés probable-ment par la chaleur. Vase concrétionné et fi ssuré. Pré-sence d’un surplus d’argile au sommet de l’anse que le potier n’a peut-être pas jugé utile d’enlever (vase à voca-tion funéraire ?). Capacité de remplissage estimée à 0,25 litre jusqu’au resserrement interne maximal du col. État de conservation : 100 % du bord ; 100 % du fond ; 95 % du vase (lacunes dans la paroi seulement). Localisa-tion : Us 1008, carré B.
Sépulture 1001 1002 Us 1001 1001 1001 1001 1001 1008 1002 1002 1002 1002 1009 1009 Carré A B C* C D B A B C D A C Taxons Etat Nom françaisCéréales Triticum aestivum/durum, rachis carb. . . . . . 1 . . . . . . Blé dur/tendreAvena, fgt arête carb. . 5 . . . . . . . . . . AvoineAvena, fgt grain carb. . 2 . . . . . . . . . . AvoineCerealia carb. . . . . . . . 1 . . . . Céréales Fruitiers Corylus avellana, fgt coque carb. 8 1 1 12 . . 1 . . . . . Noisetiercf. Juglans regia, fgt coque carb. . . . . . . . . . 1 . . cf. Noyer royalFicus fi caria, pépins carb. . . 1 24 . . . . . . . FiguierFicus fi caria, fgt fruit avec pépins carb. . . 19 150 1 . . . . . . . FiguierOlea europea, fgt noyau carb. . . . . . . . . . . . 1 OlivierPruus dulcis, fgt coque carb. . 5 . . . . . . . . . . AmandierVitis, fgt pépin carb. 8 . 2 8 7 . 3 . 3 4 2 . Vigne Plantes sauvages Lolium temulentum carb. . . . . . . . 1 . . . . Ivraie enivranteJuniperus communis, graine carb. . . . . . . . . . . . 1 Genévrier communcf. Juniperus communis, fgt aiguille carb. . 1 . . . . . . . . . . cf. Genévrier communMedicago minima carb. . 6 . . . . . . . . . . Petite luzerneMedicago/Melilotus carb. 1 1 . . 1 . . . . . . . Luzerne/MélilotHeliotropium europaeum carb. . 1 . . . . . . . . . . Héliotrope communCarex bicarpellat carb. . . . . . 1 . . . . . . Carex bicarpelléPoaceae carb. . . . 1 . . 1 . . . . . Graminées Divers Fragment de tissus carb. 1 . . . 1 . . . . . . . Fibres textiles carb. . . 1 1 . . . . . . . . Matière organique, fgt carb. . . . . . 20 . . . . . . Matière organique avec dépôt d’or, fgt carb. . . . 3 . . . . . . . .
Figure 7Données carpologiques de la sépulture SP1001.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
229DéCOuVeRte De DeuX nOuVeLLes tOmBes Du HAut-empIRe DAns Le QuARtIeR HOCHe-seRnAm À nÎmes (GARD)
RAN 45 – pp. 221-246
10. Pot/gobelet incomplet en céramique commune à pâte sableuse cuite en mode B assimilable probablement lui aussi à une imitation de gobelet à parois fi nes du même type que le précédent. Vase en huit fragments brûlé après avoir été brisé ou cassures anciennes liées à l’action du feu. Surface concrétionnée. État de conservation : 20 % du bord ; 25 % du vase ? Localisation : 1 bord et 2 panses (Us 1008, carré A) ; 3 panses (Us 1001, carré D) ; 2 panses (Us 1008, carré C).
- Éclats brûlés (4) de sigillée sud-gauloise qui n’ont pas pu être associés à l’un des dépôts céramiques. Localisa-tion : 1 fragment (Us 1007, carré A) ; 1 fragment (Us 1008, carré C) ; 2 fragments (Us 1001, carré D).
• Dépôt primaire incertain en céramique (fi g. 8)
11. Bord et panses brûlés (surface et tranches) de pot à gorge interne en céramique à pâte claire calcaire, peut-être du type cl-rec 12d (Py in Py dir. 1993, p. 236). Fragments concrétionnés. État de conservation : 10 % du bord ; moins de 10 % du vase. Localisation : 1 bord (Us 1001, carré D) ; 2 panses (Us 1001, carré B).
- Fragments informes brûlés (3) de céramique à pâte claire calcaire qui n’ont pas pu être associés à l’un des dépôts céramiques sûrs ou incertain. Localisation : 2 fragments (Us 1001, carré D) ; 1 fragment (Us 1008, carré C).
10
11
87
9
4
6
1
532
0 10 cm
Figure 8SP1001 : sigillée sud-gauloise (n° 1-6 ; estampilles à l’éch. 1/1) ; céramique à pâte claire calcaire (n° 7-8 et 11) ; commune à pâte sableuse cuite en mode B (n° 9-10). Dessins S. Barberan.
Sépulture 1001 1002 Us 1001 1001 1001 1001 1001 1008 1002 1002 1002 1002 1009 1009 Carré A B C* C D B A B C D A C Taxons Etat Nom françaisCéréales Triticum aestivum/durum, rachis carb. . . . . . 1 . . . . . . Blé dur/tendreAvena, fgt arête carb. . 5 . . . . . . . . . . AvoineAvena, fgt grain carb. . 2 . . . . . . . . . . AvoineCerealia carb. . . . . . . . 1 . . . . Céréales Fruitiers Corylus avellana, fgt coque carb. 8 1 1 12 . . 1 . . . . . Noisetiercf. Juglans regia, fgt coque carb. . . . . . . . . . 1 . . cf. Noyer royalFicus fi caria, pépins carb. . . 1 24 . . . . . . . FiguierFicus fi caria, fgt fruit avec pépins carb. . . 19 150 1 . . . . . . . FiguierOlea europea, fgt noyau carb. . . . . . . . . . . . 1 OlivierPruus dulcis, fgt coque carb. . 5 . . . . . . . . . . AmandierVitis, fgt pépin carb. 8 . 2 8 7 . 3 . 3 4 2 . Vigne Plantes sauvages Lolium temulentum carb. . . . . . . . 1 . . . . Ivraie enivranteJuniperus communis, graine carb. . . . . . . . . . . . 1 Genévrier communcf. Juniperus communis, fgt aiguille carb. . 1 . . . . . . . . . . cf. Genévrier communMedicago minima carb. . 6 . . . . . . . . . . Petite luzerneMedicago/Melilotus carb. 1 1 . . 1 . . . . . . . Luzerne/MélilotHeliotropium europaeum carb. . 1 . . . . . . . . . . Héliotrope communCarex bicarpellat carb. . . . . . 1 . . . . . . Carex bicarpelléPoaceae carb. . . . 1 . . 1 . . . . . Graminées Divers Fragment de tissus carb. 1 . . . 1 . . . . . . . Fibres textiles carb. . . 1 1 . . . . . . . . Matière organique, fgt carb. . . . . . 20 . . . . . . Matière organique avec dépôt d’or, fgt carb. . . . 3 . . . . . . . .
Figure 7Données carpologiques de la sépulture SP1001.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
230 – mARIe ROCHette ET AL.
ReVue ARCHéOLOGIQue De nARBOnnAIse, tome 45, 2012
• Mobilier céramique considéré comme résiduel ou intrusif
- Fragment informe brûlé de céramique commune à pâte sableuse cuite en mode A ou d’amphore gauloise à pâte sableuse. Localisation : Us 1001, carré C.
- Fragment d’imbrex brûlé (70 mm de longueur maximale). Localisation : Us 1007.
2.4.1.2. Observations sur la vaisselle en céramique
La tombe SP1001 contient dix dépôts céramiques brûlés correspondant à deux assiettes, deux bols et deux coupelles en provenance des offi cines de la Graufesenque, deux cruches/olpés et deux pots/gobe-lets d’origine régionale. S’y ajoute peut-être un pot de plus grand module en céramique à pâte claire calcaire également brûlé et mal conservé (bord seulement).
2.4.2. La vaisselle en verre de la tombe SP1001 (S. R.)
2.4.2.1. Catalogue
• Mobilier de verre brûlé
12. UnguentariumVerre naturel bleuté, souffl é à la volée, d’aspect fi landreux et bulleux. Fond plat, panse piriforme à bulbeuse, col haut et étroit, lèvre éversée triangulaire formée par repli vers l’intérieur. Ht. : 137 mm ; Ø max. : 76 mm ; Ø ouv. : 31 mm. État de conservation : Vase complet, en fragments mul-tiples jointifs, dispersés au sein des trois contextes Us 1001, 1007 et 1012 ; le vase a été volontairement mutilé : un frag-ment de bord / col désolidarisé (Us 1007) est déformé et partiellement fondu et la lèvre présente sur un côté de la cassure les traces d’une exposition à la chaleur ; le reste du vase est fragmenté mais non brûlé. Localisation : Us 1001 carré A, B et D (5 fr. non brûlés) ; Us 1007 carré D (1 fr. de bord brûlé) ; Us 1012 carré B (15 fr. non brûlés). Type : proche Isings 28b ; AR 140 / Isings 82A1.
13. BalsamaireVerre naturel bleuté, souffl é à la volée, d’aspect fi landreux. Fond légèrement concave, panse tronconique, col haut et étroit séparé de la panse par un étranglement, lèvre éva-sée en corolle à bord adouci au feu. Ht. restit. : 80 mm ; Ø max. : 37 mm ; Ø ouv. : 14 mm. État de conservation : Vase incomplet, en multiples fragments plus ou moins jointifs ; la panse et le col ont été désolidarisés et n’ont pas subi le même traitement avant dépôt dans l’Us 1001, seule la partie supérieure ayant été exposée au feu. Localisation : Us 1001 carré B (17 fr. de panse non brûlée et 2 fr. de col et bord déformés par le feu) ; Us 1001 carré D (2 fr. de panse, non brûlés). Type : Isings 28b.
14. GobeletVerre incolore, souffl é à la volée, légèrement bulleux. Fond concave, panse cylindrique soulignée de registres de lignes horizontales gravées, embouchure légèrement éva-sée surmontée d’un bord droit découpé au ciseau. Ht. res-tit. : 110 mm ; Ø panse : 54 mm ; Ø ouv. : 63 mm. État de conservation : Vase a priori complet, en fragments mul-tiples, brûlés et déformés. Localisation : Us 1001 carré A (1 fr. de bord) ; Us 1001 carré C (25 fr.) ; Us 1001 carré D (1 fr. de panse) ; Us 1007 carré A (1 fr. de panse). Type : AR 36, Isings 30.
• Mobilier de verre non brûlé
15. UnguentariumVerre naturel bleuté, souffl é à la volée, d’aspect fi lan-dreux et bulleux. Fond plat, panse piriforme, col haut et étroit, lèvre arrondie formée par repli vers l’intérieur. Ht. : 111 mm ; Ø max. : 64 mm ; Ø ouv. : 26 mm. État de conser-vation : Vase complet, en trois fragments jointifs, dispersés au sein des Us 1007 et 1012 ; le vase a été volontairement mutilé : le bord n’est conservé que sous forme d’un frag-ment (1/8e) désolidarisé du reste du vase (Us 1007) ; aucun fragment n’est brûlé. Localisation : Us 1007 carré A (1 fr. de bord) ; Us 1012 carré B (2 fr. jointifs correspondant au vase, sans le bord). Type : proche Isings 28b; AR 140 / Isings 82A1.
16. Fragment découpé de gobelet peintVerre incolore légèrement opacifi é, souffl é à la volée. Frag-ment de forme pentagonale, s’inscrivant dans un carré de 3 cm de côté, découpé dans une panse de gobelet peint ; la fi guration préservée est une tête d’Horus surmontée du disque solaire ; motif émaillé sur gravure préalable ; cou-leurs conservées : bleu, vert, blanc et jaune. Localisation : Us 1001 carré C. Type : Isings 12.
17. Fragment de col de fl aconVerre naturel bleuté, souffl é à la volée. Non attribuable aux individus précédents ; non brûlé. Localisation : Us 1007 carré D. Type : Indéterminable.
2.4.2.2. Observations sur la vaisselle en verre déposée en offrande dans la tombe SP1001
• Les récipients
Ils sont au nombre de quatre (fi g. 9). Les vases n° 12, 13 et 15 sont en verre naturel souffl é fi landreux et bulleux, de même qualité.
L’unguentarium n° 12 est proche du type Isings 28b (Isings 1957) avec une panse bulbeuse, ou encore du type AR140 (Rütti 1991a) ou Isings 82A1 qui appa-raît dans le troisième quart du Ier s. de n. è. et est de consommation courante des Flaviens à la fi n du IIe s. de n. è. Des exemplaires identiques sont disponibles
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
231DéCOuVeRte De DeuX nOuVeLLes tOmBes Du HAut-empIRe DAns Le QuARtIeR HOCHe-seRnAm À nÎmes (GARD)
RAN 45 – pp. 221-246
dans la vallée du Rhône : dans la nécropole tricas-taine du « Valladas » par exemple, dans un contexte funéraire de la fi n du Ier et début du IIe s. de n. è. (Bel et al. 2002, fi g. 189) ; dans les collections du musée d’Arles où ce type est daté par l’auteur de la fi n du Ier et du IIe s. (Foy 2010, n° 318 à 320). Il s’agit d’une production occidentale, voire régionale. De profi l plus tronconique que le précédent, le vase n° 15 peut cependant lui aussi être considéré comme une des variantes d’Isings 28b ou 82A1.
Ces deux unguentaria ont subi le même traitement dépositionnel : les bords ont été partiellement cas-sés, les corps ont été déposés ensemble au fond de la fosse (Us 1012, carré B) puis recouverts par le pre-mier comblement contenant des résidus de créma-tion et les fragments de bords désolidarisés (Us 1007, carrés A et D) ; dans le cas du vase n° 12, le fragment de bord montre une déformation liée à l’exposition à la chaleur ; le fait que les corps soient fragmentés peut être accidentel.
Le vase n° 13 est un balsamaire en verre naturel de même qualité que les deux précédents, de type Isings 28b. Il est daté génériquement de la période clau-dienne à 120 de n. è. voire jusqu’au milieu du IIe s. 2. En dépit de son état de conservation lacunaire, il semble avoir été déposé en deux parties, dans la moi-tié est du comblement supérieur (Us 1001 carrés B et D) : la panse et le col ont été désolidarisés et seule la partie supérieure a été exposée au feu lors du dépôt.
Le vase n° 14 correspond à un gobelet de type AR 36 / Isings 30, à panse cylindrique ornée de lignes hori-zontales gravées et à bord droit découpé au ciseau. Il
apparaît sous les Flaviens et sera consommé jusque vers 120 de n. è. Il a été prélevé majoritairement dans le comblement supérieur de la sépulture, sous forme de fragments multiples, brûlés et dispersés (Us 1001, carrés A, C et D) et, pour un fragment, dans le com-blement inférieur (Us 1007, carré A).
Seul le gobelet n° 14, dédié au service des liquides, semble avoir été offert sur le bûcher funéraire tan-dis que les trois autres, contenant des parfums ou onguents, ont été déposés dans la tombe mutilés, mais sans les stigmates d’une exposition volontaire à la chaleur : ils n’ont été partiellement déformés que par un contact avec les résidus de crémation encore brûlants.
• Un fragment de gobelet peint
Un petit fragment de gobelet Isings 12 en verre inco-lore, portant un décor peint (n° 16), a également été déposé en offrande au sein de la sépulture (fi g. 10). Il a été volontairement découpé et est de forme penta-gonale, inscrite dans un carré de 3 cm de côté.
Le motif réservé correspond à la tête du dieu égyp-tien Rê-Horakhty, de profi l tourné vers la droite. C’est la représentation la plus répandue du dieu Rê, alors assimilé à Horus, à tête de faucon et coiffé du disque solaire couronné de l’uræus ; il porte tradi-tionnellement le signe ankh et le sceptre ouas (res-pectivement hiéroglyphe de la vie et symbole du pouvoir) qui associés représentent l’énergie du soleil ; Rê-Horakhty illustre le dieu solaire Rê à midi, lors de sa gloire terrestre mais est aussi le dieu du soleil levant à Héliopolis (Horus de l’horizon).
12 15 13 140 5 cm
Ech. 1/2
Figure 9Vases en verre déposés en offrande dans la tombe SP1001.Dessins et infographie S. Raux.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
232 – mARIe ROCHette ET AL.
ReVue ARCHéOLOGIQue De nARBOnnAIse, tome 45, 2012
La « peinture » a été réalisée par application sur la panse du verre souffl é de poudre de verre et de pig-ments, en suivant un tracé préparatoire incisé ou meulé, que l’on distingue en particulier sur le pour-tour du disque solaire ; le vase a ensuite été repassé au feu afi n que les couleurs soient fi xées sur la sur-face par une légère fonte : il s’agit donc en réalité d’une technique d’émaillage à chaud, plutôt que de peinture au sens strict du terme. Les oxydes employés ici ont permis l’obtention des couleurs blanche (antimoine), verte (magnésium, cuivre et/ou zinc), bleue (fer, cuivre ou cobalt) et jaune (manga-nèse en faible teneur).
La majorité des vases peints répertoriés à ce jour sont des gobelets de type Isings 12 3 : ce sont des bols apodes à panse hémisphérique, à bord légè-rement rentrant découpé au ciseau, en verre souf-fl é à la volée ; des rainures horizontales obtenues par meulage, généralement disposées sous le bord et à mi-hauteur rythment la surface externe 4. Ce type est le plus usité des verres à boire au Ier s. de
notre ère. D’origine italienne, il apparaît vers - 30 mais le modèle est repris massivement par les ate-liers régionaux et on les rencontre encore régulière-ment jusqu’à la fi n du Ier s., avec un pic de fréquence entre 30 et 70 de n. è. dans l’ensemble des provinces romaines. Ils sont essentiellement produits en verre naturel et incolore mais aussi, notamment au début de la période, en verre coloré bleu cobalt, vert éme-raude ou encore jaune ambré.
Le dernier inventaire publié fait état d’environ 75 fragments de gobelets de ce type ayant reçu un décor peint : ils sont particulièrement présents dans le sud de l’Angleterre, en Allemagne et en Suisse le long du Rhin, en Egypte et Israël et étonnamment peu illus-trés en Méditerranée occidentale. Les occurrences en Gaule sont au nombre de dix, disséminées sur le territoire sans concentration particulière (Rütti 2003, p. 357 et fi g. 6).
Les décors les plus fréquents sont composés de motifs végétaux (feuilles de vigne, guirlandes fl o-
tracé de la gravure sous-jacente encore visible
B
A : paroi externe du vase ; B : paroi interne ; C : restitution graphique
0 2,5 cm
A
0 5 cm
C
Rê-Horakthy
Figure 10Fragment de gobelet Isings 12 en verre peint, à iconographie
égyptisante (n° 16). Dessins et infographie S. Raux.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
233DéCOuVeRte De DeuX nOuVeLLes tOmBes Du HAut-empIRe DAns Le QuARtIeR HOCHe-seRnAm À nÎmes (GARD)
RAN 45 – pp. 221-246
rales, fruits) et d’animaux (oiseaux, poissons, ani-maux marins, gazelles, chevaux) ; une étoile ou rosace est souvent apposée sous le fond comme marque ou signature du peintre (Rütti 1991b). La défi nition de divers centres de production ainsi que leur localisation fait aujourd’hui encore polémique : trois ateliers pourraient cependant être distingués, en fonction du motif décoratif qu’ils utilisent de manière privilégiée : feuilles de vigne pour l’un, ani-maux marins pour le deuxième, guirlandes pour le dernier ; ils seraient à situer en Italie du Nord et/ou dans la région syro-palestinienne. L’hypothèse la plus récente fait état d’une seule aire de production, italienne (Rütti 2003).
Un exemplaire complet de gobelet Isings 12 à décor peint a été mis au jour à Nîmes à la fi n du XIXe s. Il fait partie des collections du musée du Louvre et a été plusieurs fois publié 5. Il est en verre translucide vert émeraude et porte un décor dont le sujet est à ce jour un unicum sur verre, représentant dans un envi-ronnement végétal un combat entre deux pygmées casqués armés de lances et de boucliers et trois grues aux ailes déployées se défendant à coups de bec 6. Le fond porte une rosace à huit pétales, inscrite dans un cercle de points. Les couleurs conservées montrent l’emploi du jaune, du rose orangé et de l’ocre. Il a a priori été importé depuis l’Italie du Nord et est daté de manière générique des trois premiers tiers du Ier s. de n. è. (Arveiller-Dulong, Nenna 2005, p. 38).
Le fragment déposé dans la sépulture fait lui aussi appel à une iconographie tout à fait particulière, et à ce jour inédite sur ce genre de support. On en connaît cependant des représentations dans le monde romain comme le Rê-Horakthy accompagné d’une sphinge, peints sur l’enduit mural d’une villa de Campanie (De Vos 1980, fi g. 2 p. 4).
Les attestations d’iconographie égyptisante ne sont pas rares à Nîmes, comme dans l’ensemble du triangle bas-rhodanien, à commencer par le symbole même de la Colonia Nemausus, un crocodile enchaîné à la palme. Bien que située légèrement en marge de la Provence qui bénéfi cie par le Rhône de voies com-merciales privilégiées avec la Méditerranée, la ville de Nîmes entretient des relations indéniables avec l’Egypte, pour des raisons qui ne sont à ce jour pas encore clairement établies : la colonie a pu être fon-dée par des vétérans ayant servi au cours de la guerre d’Egypte ; des émigrants orientaux ont pu, à la chute d’Alexandrie, venir s’installer en Narbonnaise nou-vellement conquise ; des échanges commerciaux et des circulations d’objets se sont de plus établis par le biais de fonctionnaires gallo-romains voyageant en Egypte (Aufrère 1985). On note en conséquence une forte présence d’objets et d’inscriptions se rap-
portant à l’Egypte dans la Cité nîmoise, objets de la vie quotidienne notamment des intailles et camées 7
et des objets liés à la pratique de cultes dans des lieux consacrés aux dieux issus du panthéon égyptien, en particulier le trio isiaque 8. On citera dans ce dernier cas : des inscriptions lapidaires, autels et dédicaces à Isis ainsi que des fragments de statues d’Isis, Séra-pis et Harpocrate aujourd’hui conservés au musée archéologique de Nîmes (Carrier 2008-2010) ; une tombe de prêtre d’Isis a été mise au jour avenue Maréchal-Juin, contenant des attributs liturgiques, sistres et ornements vestimentaires en bronze doré en forme d’épis et de croissant (Fiches, Veyrac dir. 1996, notice 508 p. 443).
Concernant les rites funéraires, les lampes à huile en terre cuite 9 à caractère isiaque ont souvent une vocation d’accompagnement du défunt. Il est pos-sible qu’elles traduisent une préférence portée aux dieux égyptiens par rapport au traditionnel Hadès gréco-romain, concernant leur rôle chtonien. On note également la présence dans certaines tombes de Provence romaine, notamment aux IIIe et IVe s. de n. è., de statuettes issues de la culture égyptienne, les oushebtis ou serviteurs funéraires censées remplir dans l’autre monde, à la place du mort, les travaux agricoles obligatoires et/ou, comme une adaptation gallo-romaine des croyances égyptiennes, favoriser son voyage jusqu’à Osiris (Aufrère 1985) : l’une de ces statuettes est attribuée à une tombe nîmoise, non datée (Fiches, Veyrac dir. 1996, notice 698).
Plusieurs pistes s’offrent donc à nous pour tenter d’interpréter la présence d’une représentation de Rê-Horakhti dans une tombe nîmoise de la fi n du Ier s. de n. è. Le fragment a-t-il été préservé pour son affi liation à Horus et, par son intermédiaire, aux cultes isiaques ou pour sa représentation du dieu solaire Rê à son zénith ? Est-il un attribut du défunt signifi ant qu’il était d’origine égyptienne ou joue-t-il le rôle d’intermédiaire entre le monde des vivants et des morts ? Autant de questions qui resteront posées mais qui viennent incrémenter le dossier des objets à caractère égyptisant déjà bien présents sur le terri-toire de la cité de Nîmes.
2.4.3. Le petit mobilier de la tombe SP1001 (Y. M. et V. F.)
2.4.3.1. Catalogue (Y. M)
• Petit mobilier brûlé
18. 1 quenouille en os de type Béal A XLI ; L. : 235 mm ; diam. maxi : 10,5 mm ; diam. mini : 6,6 mm. Tige de sec-tion cylindrique dont le sommet est orné d’une moulure en forme de balustre et dont le diamètre diminue en direc-
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
234 – mARIe ROCHette ET AL.
ReVue ARCHéOLOGIQue De nARBOnnAIse, tome 45, 2012
tion de la base. Objet complet cassé en 10 fragments après passage au feu. Domaine : économique. Localisation : Us 1001 carré A
19. 1 fusaïole en os ; diam. : 21 à 21,4 mm ; H. : 10,8 mm ; diam. trou : 3,8 mm (sommet) à 5,1 mm (base) ; masse : 3,93 g. Objet en forme de bouton hémisphérique perforé en son centre qui a été noirci après passage au feu. Domaine : économique. Localisation : Us 1001 carré B
20. 1 fuseau en os de type Béal A XVIII,2 ; L. act. : 109,3 mm ; L. rest. : env. 130 mm ; diam. maxi : 5,6 à 6,6 mm. ; diam. près de la cassure : 4,3 à 4,8 mm. Objet de facture sommaire en 6 fragments jointifs blanchis après passage au feu. Tige dont le diamètre diminue de haut en bas. Près du sommet irrégulier, en calotte, se trouve une encoche oblique destinée à arrêter le fi l. Domaine : écono-mique. Localisation : Us 1001 carré A
21. 1 épingle en verre (?) ; L. act. : env. 65 mm. Tige trans-lucide en deux fragments jointifs tordue par l’action du feu présentant une extrémité en pointe torsadée. Près de l’autre extrémité manquante, on observe une excroissance naviforme. Domaine : i ndéterminé. Localisation : Us 1001 carré D
22. 1 fragment de fût d’objet indéterminé en os brûlé ; L. act. : 16,2 mm. Domaine : indéterminé. Localisation : Us 1001 carré B
23. 3 fragments de fût d’objet indéterminé en os noirci ; L. act. : 21 mm. L. act. : 15,5 mm. L. act. : 5,8 mm. Domaine : indéterminé. Localisation : Us 1001 carré C
24. 1 fragment de fût d’objet indéterminé en os ; L. act. : 40,8 mm. Objet noirci en deux fragments jointifs. Collage avec le fragment suivant. Domaine : indéterminé. Locali-sation : Us 1001 carré D1 fragment de fût d’objet indéterminé en os ; L. act. : 22,1 mm. Collage avec le fragment précédant. Domaine : indéterminé. Localisation : Us 1001 carré C
25. 1 épingle en verre (?) ; L. act. : 73 mm. Tige translu-cide torsadée et déformée après passage au feu. À l’une des extrémités, on observe un appendice triangulaire. Domaine : indéterminé. Localisation : Us 1007
• Petit mobilier ne portant pas de trace de feu
26. 1 fusaïole en lignite ; diam. : 20,7 mm ; H. : 9,6 mm ; diam. trou : 3,1 mm ; masse : 3,92 g. Rondelle épaisse, vaguement bitronconique, perforée en son centre (fi g. 1, n° 3). Domaine : économique. Localisation : Us 1007
27. 1 fusaïole en bronze ; diam. : 17,2 mm ; H. : 9 mm ; diam. trou : 3,1 mm ; masse : 5,98 g. Bouton conique orné d’une
gorge en V latérale et dont la base concave présente trois moulures (fi g. 1, n° 4). Domaine : économique. Localisa-tion : Us 1007 carré D
28. 1 aiguille en os de type Béal A XIX, 6 (variante) ; L. act. : 43,6 mm. Fragment de fût de section ovale cassé à la base du chas (fi g. 1, n° 2). Domaine : économique. Locali-sation : Us 1001 carré A
29. 1 aiguille en os de type indéterminé ; L. act. : 44,7 mm. Fragment brûlé cassé à la base du chas. Objet dont la sec-tion ovale s’aplatit au niveau du chas. Domaine : écono-mique. Localisation : Us 1001 carré A
30. 1 bague en bronze ; diam. : 17,8 à 19 mm. Anneau fi n. Domaine : personnel. Localisation : Us 1001 carré D
31. 1 fi bule en oméga ou penannulaire de type Feugère 30a en bronze ; L. : 30 mm ; l. : 29 mm. Anneau ouvert de sec-tion losangique, orné sur sa partie supérieure d’une nervure ondée ; terminaisons bouletées munies chacune d’un petit disque. Domaine : personnel. Localisation : Us 1001 carré D
32. 1 pyxide en bois ; H : act. : 21,8 mm. Fragment carbo-nisé de petite taille présentant à l’une de ses extrémités un ressaut destiné à recevoir un couvercle. Domaine : indéter-miné. Localisation : Us 1001 carré B
33. 1 perle en verre de type Kempten ; diam. : env. 25 mm. Exemplaire incomplet en 6 fragments bleu marine à fi lets spiralés blancs (fi g. 1, n° 9-10). Domaine : personnel. Localisation : Us 1001 carré D
34. 1 perle en verre de type Kempten ; diam. : indéter-miné. Exemplaire incomplet en 5 fragments verdâtres (fi g. 1, n° 9-10). Domaine : personnel. Localisation : Us 1001 carré D
35. 1 fragment de fût d’objet indéterminé en os ; L. act. : 46,5 mm. Domaine : indéterminé. Localisation : Us 1001 carré A
36. 1 fragment de fût d’objet indéterminé en os ; L. act. : 27,6 mm. Us 1001. Domaine : indéterminé. Localisation : carré C
37. 1 fragment de fût d’objet indéterminé en os ; L. act. : 15,2 mm. Domaine : indéterminé. Localisation : Us 1001 carré A
38. 1 fragment de fût indéterminé en os. Domaine : indé-terminé. Localisation : Us 1007 carré D
39. 2 fragments de fût d’objet indéterminé en os ; L. act. : 13 mm. Fragment fuselé situé près d’une des extrémités. Domaine : indéterminé. Localisation : Us 1007 carré B
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
235DéCOuVeRte De DeuX nOuVeLLes tOmBes Du HAut-empIRe DAns Le QuARtIeR HOCHe-seRnAm À nÎmes (GARD)
RAN 45 – pp. 221-246
40. 1 valve de bucarde tuberculée probablement utilisée comme récipient. Domaine : divers. Localisation : Us 1012.
- 1 petit clou en fer à tête plate ; diam. tête maxi : 9,5 mm. Domaine : indéterminé. Localisation : Us 1001 carré A
- 1 clou en fer à tête plate ; L. act. : 65,1 mm, soit à peu près la taille d’origine. Domaine : divers. Localisation : Us 1001 carré B
- 1 clou en fer à tête plate ; L. act. : 20,4 mm. Domaine : divers. Localisation : Us 1001 carré B
- 6 petits clous en fer à tête plate non mesuré. Domaine : indéterminé. Localisation : Us 1001 carré B
- 7 clous en fer à tête plate ; L. act. : 67,7 mm. L. act. : 20,8 mm. L. act. : 43 mm. L. act. : 39 mm. L. act. : 15,5 mm. L. act. : 11,5 mm. L. act. : 12 mm. Domaine : divers. Loca-lisation : Us 1001 carré C
- 4 petits clous en fer à tête plate. Domaine : indéterminé. Localisation : Us 1001 carré C
- 1 clou en fer à tête plate ; L. act. : 55,4 mm. Exemplaire cassé près de la pointe. Domaine : divers. Localisation : Us 1001 carré D
- 1 clou en fer à tête plate ; L. act. : 62,6 mm. Exemplaire très corrodé. Domaine : divers. Localisation : Us 1001 carré D
- 2 clous en fer à tête plate ; L. act. : 41,5 mm. L. act. : 27,2 mm. Domaine : divers. Localisation : Us 1001 carré D
- 5 petits clous en fer à tête plate. Domaine : indéterminé. Localisation : Us 1001 carré D
- 1 clou en fer à tête plate ; L. act. : 15,8 mm. Exemplaire de petit module cassé près de la pointe. Domaine : divers. Localisation : Us 1001 carré D
- 4 lots de fragments de fer informes. Domaine : indéter-miné. Localisation : Us 1001 carrés A, B, C, D
- 20 tiges en fer. Domaine : indéterminé. Localisation : Us 1001 carrés A, B, C, D
- 1 petit clou en fer à tête plate. Domaine : indéterminé. Localisation : Us 1007 carré A
- 1 petit clou en fer à tête plate. Domaine : indéterminé. Localisation : Us 1007 carré D
- 3 tiges en fer. Domaine : indéterminé. Localisation : Us 1007 carré A
- 4 lots de fragments de fer informes. Domaine : indéter-miné. Localisation : Us 1007 carrés A, B, C, D
2.4.3.2. Observation sur le petit mobilier accompagnant le défunt de la tombe SP1001 (Y. M.)
Le petit mobilier découvert dans la tombe SP1001 sur le site Hoche-Sernam comprend 124 artefacts dont une valve de coquillage qui a vraisembla-blement servi de récipient. Sur les 124 éléments antiques, les 4/5 sont en fer et les clous, probable-ment en relation avec les contenants funéraires, constituent le groupe dominant (49 individus). Le mobilier de la tombe SP1001 (fi g. 11), la seule à livrer des éléments de la vie quotidienne, constitue un dépôt primaire ayant accompagné le défunt sur le bûcher et, de ce fait, présente de nombreux stig-
mates de crémation. Il ne correspond probablement qu’à la partie conservée d’un lot plus important qui a été détruit par le feu.
• Les objets personnels
Se rattachent à cette catégorie la bague en bronze (fi g. 11 n° 30), les perles en verre (fi g. 11 n° 33 et 34), une fi bule en forme d’oméga (fi g. 11 n° 31) apparte-nant au type Feugère 30a. Elle est concrétionnée et privée de son ardillon.
Une cartographie des objets comparables trouvés sur le territoire national proposée par le site Arte-facts (FIB-4525) est basée en grande partie sur une étude de P. Galliou. Elle révèle une concentration de ces fi bules dans le Centre-Est de la Gaule, entre les vallées de la Meuse et de la Seine durant la période 150-250 ap. J.-C, ce qui amène à supposer que ce modèle pénannulaire est originaire des régions sep-tentrionales. L’exemplaire nîmois apparaît comme le plus précoce de la série et permet de rajeunir la date d’apparition de ce type de fi bule, jusqu’alors inconnu dans les contextes méditerranéens.
Quant aux perles en verre, elles se rapportent toutes deux au type Kempten que M. Feugère considère comme un objet personnel ayant fonction d’amulette. Ces objets, originaires d’Europe de l’Est, apparaissent au Ier s. de notre ère. À Augst, un des exemplaires provient d’un contexte de la période Claude-Néron (Feugère 1992, p. 148). On retrouve des parallèles à Nîmes sur deux sites fouillés récemment : celui du parking Jean-Jaurès (Us 5322 et 8380) (Manniez à paraître) et celui de Saint-André de Codols (objets inédits inv. 012 et 013). Il convient par ailleurs de noter que ces perles ont parfois été assimilées à des fusaïoles (Sternini 1991, p. 188, n° 824).
• Les objets du domaine économique
Le premier élément est la longue tige en os dont l’extrémité supérieure est en forme de balustre (fi g. 11 n° 18). Cet objet, complet mais cassé en plu-sieurs fragments et abîmé après son passage sur le bûcher, est une quenouille appartenant à un type déjà attesté à Nîmes, à trois reprises, dont un mis au jour dans une tombe au 53, route de Beaucaire (Béal 1984, p. 85 et pl. 17 ; Fiches, Veyrac dir. 1996, p. 402-403). Un exemplaire approchant est conservé au Landes-museum de Mayence (Mikler 1997, pl. 39 n° 1). Un autre, interprété comme une épingle, a été mis au jour à Bordeaux dans un niveau daté 100-150 de n. è. (Raux, Termignon coll. 2008, p. 262 et p. 265 n° 19). Un dernier, considéré comme un manche d’outil, a été découvert à Autun (Rodet-Belarbi, Chardron-Picault 2005, p. 32 fi g. 13).
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
236 – mARIe ROCHette ET AL.
ReVue ARCHéOLOGIQue De nARBOnnAIse, tome 45, 2012
0 5 cm
Ech. 1/1
18
19 26
27
31
25 21
20
33-34
28 29
30
Figure 11Petits objets de la tombe
SP1001. Photographies, dessins et infographie Y. Manniez.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
237DéCOuVeRte De DeuX nOuVeLLes tOmBes Du HAut-empIRe DAns Le QuARtIeR HOCHe-seRnAm À nÎmes (GARD)
RAN 45 – pp. 221-246
Le deuxième élément est un fuseau, en os lui aussi, qui bien que brûlé et très fragmenté, a pu être remonté. Cet instrument appartient à un type particulier, doté à son extrémité la plus large d’une encoche et dont les parallèles connus sont tous issus de sites de l’arc méditerranéen 10.
D’autres objets semblent se rapporter à l’artisanat du textile : les fusaïoles en os (fi g. 11 n° 20), en lignite (fi g. 11 n° 26) et en bronze (fi g. 11 n° 27) ainsi que deux fragments d’aiguilles en os (fi g. 11 n° 28 et 29). Quatre fûts en os, qui n’ont pu être rattachés à ces instruments de couture, pourraient être des vestiges d’un second fuseau. On note en effet que le diamètre inférieur d’un de ces éléments s’adapte parfaitement à celui de l’élément hémisphérique en os. Ces fusaïoles de petit module devaient être placées sur des fuseaux de petite taille qui ne nécessitaient pas des volants d’inertie trop lourds. Des exemplaires, dont le dia-mètre varie entre 20 et 22 mm, sont attestés en os et semblent être une spécialité nîmoise (Béal 1984, p. 80 n° 334 et 337) à l’instar des fuseaux de type Béal A XVIII, 7. Jean-Claude Béal envisage que de tels ins-truments aient pu servir pour le traitement d’un fi l spécial (Béal 1984, p. 41-42). On constate que les deux fusaïoles non métalliques ont une masse prati-quement équivalente (3,92 g et 3,93 g). La restitution de leur position sur une tige effi lée, comparable à celle d’un fuseau (fi g. 12 et 13), amène à supposer qu’elles ont pu être associées sur un même support. Celle en bronze, plus lourde (5,98 g), a pu être utilisée seule. Dans une inhumation des Martres-de-Veyres, la que-nouille était associée à un fuseau de bois ayant gardé « son peson de bois » et à deux autres fusaïoles en bois (masse : 3 g, 4 g et 7 g) ainsi qu’à une quatrième en pierre (masse : 14 g) (Audollent 1923, p. 33-34). Un tel ensemble semble confi rmer que la panoplie de la fi leuse comprenait parfois plusieurs fusaïoles adap-tables sur un seul et même fuseau, probablement en fonction du type de fi l à fabriquer. Il est intéressant de noter que dans la tombe du 53, route de Beaucaire, publiée initialement par A. Vigne, fi guraient aussi parmi les objets de tabletterie, dont la quenouille évoquée plus haut, « un fuseau pourvu de son disque, encore en place » (Vigne 1896-1898, p. 229).
• Une valve de coquillage
Une valve de bucarde a été mise au jour dans l’Us 1012 de la sépulture SP1001. Les dépôts de coquille unique sont fréquents et il ne semble pas qu’ils cor-respondent à des offrandes alimentaires, d’autant plus lorsque les valves appartiennent à des espèces qui n’étaient pas consommées à l’époque romaine. Ainsi le vernis fauve (Callista chione) associé à la coquille Saint-Jacques dans les sépultures de l’Anti-quité tardive servait probablement de lampe à suif.
Seul, il a pu être utilisé comme ustensile ou comme contenant (Manniez 2005, p. 229-230 et pl. 108). Il en est vraisemblablement de même pour le coquil-lage qui nous intéresse.
L’analyse chimique du sédiment conservé au contact de la paroi interne a, en effet, révélé des traces de matières grasses d’origine animale et végétale que l’on retrouve dans certains coquillages utilisés comme lampes mais qui pourraient témoigner ici de la présence d’un onguent (Garnier 2012).
• Objets indéterminés
Deux tiges torsadées en verre translucide, apparte-nant peut-être à deux objets distincts, n’ont pu être identifi ées. Celle qui possède une extrémité poin-tue et une excroissance (tête ?) en noyau d’olive res-semble assez à une épingle. Or de tels instruments en verre sont peu courants et les rares exemplaires dont le fût est torsadé sont en fait des quenouilles ( Arveiller-Dulong, Nenna, p.305) qui copient des modèles en os (Anderes 2008, p.271). Peut-il s’agir ici aussi d’éléments d’une quenouille ou bien d’un fuseau ? Le mauvais état des tiges ne permet pas de le savoir.
2.4.3.3. Étude archéozoologique (V. F.)
La grande quenouille de l’Us 1001 a été élaborée à partir d’une longue baguette osseuse rectiligne. Elle paraît mordre légèrement dans de la matière osseuse spongieuse d’après l’aspect alvéolé de petits arcs des deux disques apicaux. Par ailleurs, cette partie proxi-male présente un très léger aplatissement : 10,6 mm dans le grand diamètre, de 9,2 à 10,2 mm (épaule-ment) dans le plus petit diamètre. Celui-ci passe par la zone éventuellement spongieuse. La forme ovoïde de la partie proximale aurait pu être une adaptation au manque de matière dans la zone où a été tournée la partie apicale. La taille et la forme de la baguette osseuse, longue et rectiligne, ne peuvent être retrou-vées que dans des parois de très rares organes squelet-tiques longs et droits (radius, fémur, tibia, métacarpe, métatarse) appartenant à de grands mammifères. Dans un premier temps, la longueur utile de matière osseuse et la rectitude nous ont orienté uniquement vers le bord médial de la diaphyse de radius d’équidé, parmi les os des grandes espèces de Narbonnaise que sont le bœuf, les équidés, le cerf, l’ours. Le radius originel aurait atteint une longueur que seul un animal d’une hauteur au garrot d’au moins 1,55 m aurait pu fournir d’après notre estimation. Or une telle taille aurait été assez exceptionnelle pour la période romaine. Nous n’avons donc pas exclu une fabrication à partir d’espèces animales étrangères à la Narbonnaise comme l’élan, plus septentrional, ou
0 5 cm
Ech. 1/2
0 5 cm
Ech. 1/2
Figure 12Restitution de la position sur des fusaïoles non métalliques (n° 19 et 28). Photographies Y. Manniez
Figure 13Restitution de la position sur de la fusaïole métallique (n° 29).Photographies Y. Manniez
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
238 – mARIe ROCHette ET AL.
ReVue ARCHéOLOGIQue De nARBOnnAIse, tome 45, 2012
le chameau, moyen-oriental. En conséquence, nous avons procédé à un sondage de comparaison parmi les squelettes référentiels de la collection d’ostéologie du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Nous avons testé seulement l’adéquation en longueur et rectitude de l’objet n° 18 aux organes squelettiques. L’épaisseur des parois osseuses, d’au moins une quin-zaine de millimètres pour autoriser la pratique du tournage de l’objet, ne pouvait être abordée puisqu’il aurait fallu découper les organes. Les causes d’ex-clusion sont exposées dans la fi gure (fi g. 14). Le chameau et la girafe sont les seuls à posséder des organes dont la morphologie correspondrait à celle de l’objet. Le grand ruminant d’Europe occidentale qu’est l’élan ne paraît pas concerné comme le cerf, autre cervidé plus petit. Demeure l’aurochs, abordé par extrapolation des organes de bœuf domestique à défaut d’avoir encore pu manipuler un squelette de référence ; ce bovin sauvage survivait encore dans le nord de la Gaule 7. Enfi n, un cheval mâle de race boulonnaise (de trait) du XIXe s. dont la hauteur au garrot avoisinait 1,65 m, a montré que la légère angu-lation latérale de la zone proximale du bord médial du radius s’accentuait avec la taille de l’animal. À moins que la paroi osseuse soit suffi samment épaisse en interne pour escamoter la rupture de direction de la face externe, notre idée initiale ne serait donc pas confi rmée. Pour l’instant, nous ne pouvons donc nous prononcer sur l’organe squelettique et l’espèce dont provient l’objet n° 18. Cet exemple montre que le retour de l’objet en matière osseuse à sa source ani-male n’est pas un automatisme ; les approches sont encore balbutiantes et nécessitent un vaste défriche-ment ostéologique.
Le coquillage de l’Us 1012 est une valve gauche de bucarde tuberculée, Acanthocardia tuberculata. Cette valve, fragmentée ultérieurement à son dépôt et non nettoyée lors de l’examen, est entière. La paroi est plutôt épaisse. L’animal originel était adulte ; la hauteur de la valve est d’environ 57 mm. L’ensemble des reliefs saillants de la face externe (côtes) et des bords (dents) ne sont pas nettement usés. L’état
d’épave est le plus probable lors du ramassage de la valve sur le bord de mer ; l’emploi ultérieur par l’homme n’a pas altéré l’organe.
2.4.4. La monnaie de la tombe SP1001 (R. P.)
41. Un as de Claude a été retrouvé dans le comblement Us 1001 de la tombe SP1001.
As de Claude (24/01/41-13/10/54) (fi g. 15)Droit :TI CLAUDIUS CAESAR AUG PM TRP IMP Tiberius Claudius Cæsar Augustus Pontifex Maximus Tribunicia Potestate Imperator (Tibère Claude césar auguste grand pontife, revêtu de la puissance tribunitienne empereur)Tête nue à gauche Revers :CONSTANTIAE – AVGVSTI (À la Constance de l’auguste).S C dans le champ.Constantia (la Constance) debout à gauche, casquée et vêtue militairement, levant la main droite et tenant un sceptre long de la main gauche.Frappé à Rome entre 41-50Cuivre, module 27,42 mm, épaisseur 3,09 mm, poids 9,77 g, axe des coins 6 h(Mattingly et al. 1927-1984, tome 1, p.127, n° 95)
État de conservation : beau portrait sur un fl an légè-rement court, bien centré au droit et au r evers. Jolie patine vert noir. Usure très faible, plus prononcée sur le revers pour la légende. Altération superfi cielle malgré un coup d’outil porté au droit. Poids assez léger pour cet as.
2.5. Datation
La présence de deux coupelles Drag. 35 et d’une assiette Drag. 36 suppose que la constitution de ce dépôt intervienne au cours de la période fl avienne, du moins au plus tôt à partir de 60-70 de n. è. Les dépôts céramiques ne permettent pas de fi xer une limite
espèce organe radius fémur tibia métacarpe métatarsecheval boulonnais courbe ? - courbe court courtbœuf domestique court court/courbe courbe court courtaurochs + + ? courbe ? court + ?ours brun Ursus arctos courbe court court/courbe - -cerf (mâle jeune) Cervus elaphus court/courbe court/courbe court/courbe court/courbe court/courbeélan (mâle jeune) Alces alces courbe courbe courbe court/courbe épaisseur paroichameau Camelus (bactrianus) courbe ? court/courbe ? + court +girafe Giraffa sp. (giraffa) + courbe + + +
Figure 14Tableau des organes squelettiques testés comme source de l’objet n° 18.
Légende des causes de rejet : ? : pourrait être effacée par l’épaisseur de la paroi osseuse. + : possible (à confi rmer). - : impropre.
0 2 cm
Ech. 1/1
Figure 15As de Claude (n° 44).
Photographies et infographie R. Pellé.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
239DéCOuVeRte De DeuX nOuVeLLes tOmBes Du HAut-empIRe DAns Le QuARtIeR HOCHe-seRnAm À nÎmes (GARD)
RAN 45 – pp. 221-246
chronologique basse fi able, dans la mesure où les formes de sigillée sud-gauloise déposées dans cette sépulture sont encore diffusées en Languedoc orien-tal jusqu’au milieu du IIe s. de n. è., voire dans le cou-rant de la seconde moitié de ce siècle (formes Drag. 35/36, Drag. 33, Drag. 27, peut-être aussi Herm. 5).
Les informations chronologiques livrées par les ver-reries situent, pour leur part, l’ensevelissement des restes du bûcher entre 70 et 120.
Concernant l’analyse de la monnaie, il apparaît que malgré le poids inférieur au poids théorique des as, la qualité de la gravure des coins confi rme qu’il s’agit de l’atelier monétaire romain et non pas d’une imi-tation locale. La date de frappe s’étale sur 9 années, avant l’acquisition par Claude de la titulature PP (Pater Patriae, ajoutée à partir de 50).
L’usure très peu conséquente indique une circulation monétaire de courte durée, probablement entre 5 et 10 ans. N’étant pas une monnaie destinée à la thé-saurisation, son enfouissement peut être daté de la décennie 50-60 de n. è. et fournir ainsi un cadre de datation restreint à la sépulture qu’elle accompagne en offrande.
L’ensemble des mobiliers fournit ainsi une datation centrée autour de 60-80 de n. è.
2.6. Interprétation
La présence d’ossements humains brûlés suggère d’interpréter cette structure comme une crémation appartenant à un sujet adulte, qui pourrait être une femme au regard du dépôt d’objets liés à l’artisanat du textile. Les données disponibles ne permettent pas de préciser à quel type de crémation on a affaire et malheureusement l’étude des restes osseux n’est d’aucun secours.
Si la morphologie du creusement évoque un bûcher en fosse, l’absence de trace de rubéfaction, la taille de la fosse et surtout la présence, sur le fond, sous les résidus charbonneux et les restes de vases, d’un dépôt de verre non brûlé ne s’accordent guère avec cette hypothèse.
Toutefois, ces arguments ne sont pas déterminants. En effet, la rubéfaction des parois ou du fond n’est pas toujours observée et le verre pourrait avoir été isolé de la chaleur du bûcher par la couche de char-bon de bois. À Saint-Paul-Trois-Châteaux (Bel et al. 2002, p.421) par exemple, un balsamaire en verre intact a ainsi été retrouvé sur le fond de fosse rubé-fi ée d’un bûcher, sous les résidus. La fosse pourrait correspondre au creusement aménagé sur le fond
d’un bûcher de plus grandes dimensions à l’instar des bûchers à creusement central reconnus dans le Biterrois, sur le site de la Courondelle à Béziers (Buffat et al. 2008) et sur celui des Cresses-Basses à Montblanc (Jung dir. 2012). Dans cette hypothèse, l’amas de vases brûlés Us 1008 repéré au nord-ouest de la fosse pourrait résulter d’un affaissement de la couche de résidus de crémation en place (Us 1007), la couche Us 1001 correspondant au regroupement des restes du bûcher après la crémation. On serait alors en présence d’une tombe bûcher avec dépôt secondaire de résidus.
Si l’hypothèse d’une crémation in situ n’est pas rete-nue, la structure doit être interprétée comme un dépôt secondaire de crémation constitué de résidus et de vases brûlés mis en place après un dépôt de vases non brûlés. L’arasement du dépôt ne permet pas de discuter de la présence d’un possible ossuaire installé sur les résidus charbonneux.
3. LA SÉPULTURE SP1002
3.1. Présentation de la structure (M. R.)
La sépulture SP1002 a été dégagée dans un paléosol limoneux brun-rouge à une altitude de 54,20 m NGF, le long de la rue Ferdinand Girard (fi g.1). Lors du diagnostic, elle a été fouillée de manière exhaustive.
La tombe SP1002 se situe au nord de la tombe SP1001. Elle présente un creusement très arasé, conservé sur une dizaine de centimètres de profondeur, avec un plan proche du rectangle mesurant 0,80 de long par 0,63 m de large (fi g. 16). Le comblement de la fosse est constitué d’un sédiment (Us 1002 et 1009) très chargé en charbons de bois, contenant des tessons de céramique, des esquilles d’os brûlés et quelques pierres.
3.2. Os humains brûlés (V. B.)
La structure SP1002 a livré 367,3 g d’ossements humains brûlés issus des Us 1002 et 1009 qui consti-tuent le comblement charbonneux de la fosse (fi g. 17). Ces résidus ont été entièrement prélevés et tamisés (110 litres) en quatre secteurs (30 litres par secteur à l’exception du secteur D au nord-est : 20 litres). Les os proviennent des refus de tamis de la maille de 4 mm. Les refus des mailles 1 et 0,5 mm ont été conservés mais n’ont pas été triés.
Les restes osseux appartiennent à, au moins, un sujet adulte. Cette attribution est suggérée par la présence de 25 racines de dents à apex fermé, l’épaisseur de la corticale des os longs et celle du crâne et la présence d’un axis adulte. Le sexe ne peut être déterminé.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
240 – mARIe ROCHette ET AL.
ReVue ARCHéOLOGIQue De nARBOnnAIse, tome 45, 2012
La masse d’ossements conservée est très inférieure aux fourchettes de valeurs théoriques établies (pour les sujets adultes) à partir de l’étude de crémations modernes (cf. supra). Ce défi cit est toutefois peu signifi catif dans la mesure où la couche charbon-neuse était incomplètement conservée.
Les os présentent une coloration gris clair ou gris bleu avec quelques éléments blancs ou gris-noir. Ces observations témoignent d’une exposition à une tem-pérature de plus de 500 °C. Les pièces les plus expo-sées à la chaleur comportent des fi ssures transverses et des déformations caractéristiques d’une crémation à l’état frais.
Les ossements conservés sont fragmentés : la taille des éléments est inférieure à 40 mm et la masse des esquilles inférieures représente près de 30 % du lot. Cette fragmentation explique le faible taux de déter-mination (45,3 %).
Les indices pondéraux par région anatomique mon-trent par ailleurs une sur-représentation des os du crâne et un défi cit des os du tronc d’après les valeurs indiquées par Lowrence et Latimer (1957) (fi g. 18).
Les os proviennent majoritairement de la partie sud de la fosse, ce qui peut être attribué à un arasement plus important de la partie nord, à un prélèvement des os dans ce secteur, ou encore à un regroupement des restes au sud. La répartition par région anato-mique (calculée sur 363,6 g d’os) fait apparaître une présence plus forte des os du crâne au nord de la fosse et une concentration des os des membres infé-rieurs au sud-est. En raison de la faible quantité d’os conservés, cette répartition différentielle ne consti-tue pas un argument suffi sant pour affi rmer que l’on a affaire à une crémation in situ avec un sujet placé la tête au nord-ouest et les pieds au sud-est. Cette hypothèse ne peut être cependant totalement rejetée.
pierre
charbon de bois
fragment de céramique
os
O E S N
altitude en NGF
54,24
54,17
54,20
0 1 m
54,24
N
N
1002
1009
10091002
10091002
Ech. 1/20
Figure 16Re levé en plan et en coupe
de la tombe SP1002. Dessin et infographie M. Rochette.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
241DéCOuVeRte De DeuX nOuVeLLes tOmBes Du HAut-empIRe DAns Le QuARtIeR HOCHe-seRnAm À nÎmes (GARD)
RAN 45 – pp. 221-246
3.3. Restes carpologiques (A. B.)
La sépulture SP 1002 a livré très peu de vestiges carpologiques (fi g. 7). Ces derniers sont compo-sés pour l’essentiel de restes fruitiers très fragmen-tés. La vigne (Vitis), l’olivier (Olea europea), le
noisetier (Corylus avellana) voire le noyer royal (cf. Juglans regia) sont ainsi attestés (tab.). Les autres taxons identifi és sont formés du genévrier commun (Juniperus communis), représenté ici sous forme de graine, de l’ivraie enivrante (Lolium temulentum), d’une graminée (Poaceae) et d’une céréale (Cerea-
Tombe/os 1002 1002-1009 TOTAL Tot.Rég %ident. %Tot. POIDS
Crâne 0,8 92,4 93,2 Mandibule 3,6 3,6 Dents sup. 0,0 Dents inf. 0,0 Dents indet. 6,4 6,4 Os hyoïde 0,0 Osselets oreille 0,0 Cartilage calcifi é 0,0
Tête 0,8 102,4 103,2 62,0 28,1Atlas 1,1 1,1 Axis 1,8 1,8 Vert. C3-C7 6,3 6,3 Vert. thoraciques 1,1 1,1 Vert. lombaires 0,0 Vert. indet. 4,7 4,7 Sacrum 0,0 Coccyx 0,0 Côtes 2,1 2,1 Sternum 0,0
Tronc 1,8 15,3 17,1 10,3 4,7Clavicule 0,0 Scapula 2,0 2,0 Humérus 14,9 14,9 Radius 0,0 Ulna 9,7 9,7 Carpe 0,6 0,6 Métacarpe 0,0 Phalanges main 0,9 0,9 Diaph. membre sup. 0,0
Mb.sup. 0,0 28,1 28,1 16,9 7,7Coxal 0,4 0,4 Fémur 14,5 14,5 Patella 0,0 Tibia 0,0 Fibula 0,0 Tarse 1,1 1,1 Métatarse 0,2 0,2 Phalanges pieds 0,0 Sésamoïde 0,0 Diaph. membre inf. 0,0
Mb.inf. 0,0 16,2 16,2 9,7 4,4 MTC,MTT,Pm,Pp 1,8 1,8 1,8 1,1 0,5Total déterminé 2,6 163,8 166,4 166,4 100,0 45,3Os plat 9,7 9,7 Os court ou épiphyse 26,6 26,6 Diaphyses indet. 0,5 61,6 62,1 26,8Esquilles 102,5 102,5 27,9Total indéterminé 0,5 200,4 200,9 200,9 54,7TOTAL 3,1 364,2 367,3 367,3 100,0
Figure 17Tableau des données pondérales des ossements brûlés de la crémation SP1002.
TêteTroncMbsupMbinfMbind
SP10020%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A B C DSECTEURS
Référence théorique
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
A B C D
masse totale (en g)
SECTEURS
Figure 18Indices pondéraux par région anatomique des restes humains brûlés de la crémation SP1002.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
242 – mARIe ROCHette ET AL.
ReVue ARCHéOLOGIQue De nARBOnnAIse, tome 45, 2012
lia). Si les fruitiers sont fréquemment observés dans les incinérations gallo-romaines, en particulier en Gaule méditerranéenne, la présence d’autres taxons comme le genévrier commun ou l’ivraie enivrante, l’est moins. Les données carpologiques issues de ces deux sépultures offrent une certaine originalité. Elles permettent également d’étoffer le spectre taxi-nomique des diverses offrandes végétales identifi ées jusqu’à présent dans les incinérations gallo-romaines nîmoises. La détermination de plusieurs plantes sau-vages dans les deux sépultures peut cependant être accidentelle ou relever d’intrusions.
3.4. Catalogue du mobilier de la tombe SP1002 (S. B., S.R., Y.M.)
1. Bord brûlé de petite cruche ou d’olpé du type cl-rec 1f (fi g. 19) produite entre 50 et 250 de n. è. (Py in Py dir. 1993, p. 223). État de conservation : 20 % du bord ; moins de 10 % du vase. Localisation : Us 1009 carré C.
2. Bord brûlé de probable petit pot à deux anses du type cl-rec 8 (non dessinable). État de conservation : 10 % du bord ; moins de 10 % du vase. Localisation : Us 1002 carré A.
- Panse brûlée de céramique commune à pâte sableuse cuite en mode A. Localisation : Us 1002, carré D.
- Panse probablement brûlée de céramique à pâte claire calcaire engobée cuite en mode A. Localisation : Us 1002, carré C.
- Panse brûlée de céramique à pâte claire calcaire. Locali-sation : Us 1002.
- Panse brûlée de céramique commune à pâte sableuse cuite en mode B. Localisation : Us 1002.
- Panse probablement brûlée de céramique non tournée. Localisation : Us 1002.
- Fragment de verre brûlé.- 2 clous en fer à tête plate ; L. act. : 25,7 mm. L. act. : 25,7 mm. Us 1002. Domaine : divers. Localisation : carré D.
3.5. Datation
La datation proposée par l’analyse du dépôt céra-mique, suggère la seconde moitié du Ier s. de n. è./courant du IIe s.
3.6. Interprétation
La présence de restes osseux brûlés, appartenant à un sujet adulte, fait penser que l’on est en présence d’une crémation. Les dimensions réduites de la fosse et l’absence de traces de rubéfaction des parois ne plaident pas en faveur d’une utilisation de la struc-ture comme bûcher en fosse destiné à un sujet de taille adulte. Comme on l’a vu plus haut, ces argu-ments ne sont toutefois pas déterminants. La rubé-faction des fonds de bûchers n’est pas systématique. La fosse conservée pourrait en outre correspondre à un creusement central aménagé au fond d’un bûcher de taille plus importante selon un type d’agencement attesté au Ier s. dans la région de Béziers (cf. supra) et qui n’est toutefois pas connu à ce jour à Nîmes. La forme oblongue de la fosse, le caractère très charbon-neux du comblement sont en outre compatibles avec l’hypothèse de bûchers. Celle-ci n’est ni contredite ni confi rmée par l’étude des restes osseux brûlés. Enfi n, l’arasement de la structure ne permet pas de discuter de l’absence de dépôt secondaire d’ossements.
4. CONCLUSION
À l’occasion des récentes opérations de diagnos-tic d’archéologie préventive réalisé en 2010 et 2011 sur les terrains de l’ancien hôpital de Nîmes, quatre fosses et deux crémations datées de la seconde moi-tié du Ier s. de n. è. ont été mises au jour et attestent de la densité de l’occupation, malgré l’importance des perturbations contemporaines effaçant les ves-tiges et limitant la lecture du sous-sol. Si leur état de conservation ne permet pas toujours leur identifi ca-tion précise et l’analyse des gestes funéraires, leur seule présence permet d’appréhender l’occupation funéraire de ce secteur.
La fouille exhaustive de ces structures et l’étude des données récoltées offrent, en particulier pour la tombe SP1001, un mobilier abondant, varié et origi-nal, aux productions locales ou importées de régions plus lointaines (verre d’origine italienne à décor égyptisant, fi bule originaire des vallées de la Meuse et de la Seine). Les dépôts notamment de cette tombe qui pourrait appartenir à une femme adulte au regard de l’analyse anthropologique et du type de mobilier (fusaïoles, quenouille, aiguilles, éléments de parure), sont constitués autour de 60-80 de n. è. et plus large-ment à la fi n du Ier-IIe s. de n. è.
0 10 cm
Figure 19SP1002 : céramique
à pâte claire calcaire. Dessin S. Barberan
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
243DéCOuVeRte De DeuX nOuVeLLes tOmBes Du HAut-empIRe DAns Le QuARtIeR HOCHe-seRnAm À nÎmes (GARD)
RAN 45 – pp. 221-246
Ces nouvelles données ajoutées aux découvertes anciennes, faites notamment rues d’Aquitaine, Vin-cent Faïta et Fulton, illustrent la topographie d’une vaste zone funéraire durant le Haut-Empire dans ce secteur suburbain de la ville, enserré par des itiné-raires anciens. L’alignement des structures nouvelle-ment mises au jour ainsi que celui des découvertes anciennes semblent tracer deux axes sud-ouest/nord-est, plus ou moins parallèles, l’entraxe ayant pu être occupé par un chemin, qui depuis la porte d’Auguste rejoignait la route d’Uzès dont le tracé se situe plus au nord.
Marie RochetteInrap Méditerranée
Sébastien BarberanInrap Méditerranée, UMR 5140 « Archéologie des sociétés méditerranéennes », équipe TP2C
Valérie BelInrap Méditerranée, UMR 5140 « Archéologie
des Sociétés Méditerranéennes », équipe TESAM
Vianney ForrestInrap Méditerranée, UMR 5608 TRACES, Toulouse
Yves ManniezInrap Méditerranée, UMR 5140 « Archéologie
des Sociétés Méditerranéennes »
Richard PelléInrap Méditerranée, USR 3155, Institut de
recherche sur l'Architecture antique
Stéphanie RauxChargée d’étude, Inrap Méditerranée, UMR 5140 « Archéologie des sociétés
méditerranéennes », équipe TP2C
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
244 – mARIe ROCHette ET AL.
ReVue ARCHéOLOGIQue De nARBOnnAIse, tome 45, 2012
◤ Notes de commentaire
1. Pour des raisons de temps et de résultats, l’étude carpologique n’a porté que sur la fraction 2mm.
2. Au « Valladas », les balsamaires Isings 28b constituent une offrande courante entre 60 et 120 ap. J.-C. (Bel et al. 2002, fi g. 189).
3. On note également pour le Ier s. ap. J.-C. les gobelets coniques (type AR44) du trésor de Begrâm (Afghanistan), aux fi gurations multiples : gladiateur combat-tant, chasseurs et pêcheurs, scènes isiaques et de mythologie gréco-romaine (Slitine 2005, p. 101) et le bol orné de poissons du site égyptien de Berenike (Nicholson, Price 2003 : fi g. 1a/1b. L’amphorisque de Kertch (Ukraine), com-plet, constitue un très bel exemplaire de forme fermée : la panse est ornée de feuilles de vignes et est surmontée au niveau de l’épaulement d’une couronne de feuilles laurées (Rütti 2003, fi g. 2). La pratique de l’émail sur d’autres supports que les vases est attestée par un portrait de jeune homme découvert à Pompéi, « peint » sur une pastille de verre de forme ovale (2x2,3 cm) et convexe (Beretta, Di Pasquale (dir.) 2006, p. 313. Aux IIe et IIIe s., le décor peint est pratiqué sur des vases de types variés : on citera entre autres occurrences : un fragment de bol de type Isings 85 trouvé à Rouen, portant une figure de gladiateur (Arveiller-Dulong et al. 2003, p. 150 et fi g. 13) et un fragment de panse de vase indéterminé orné d’une panthère et d’une antilope (Colombier 2008), attribués aux productions de la fi n du IIe s. et de la première moitié du IIIe s. ap. J.-C. du Nord de l’Angleterre ou de Cologne ; des fragments d’un fl acon du IIIe s. mis au jour à Arles, portant des motifs géométriques disposés en registres séparés de bandes horizontales, sans doute de production occidentale (Foy 2010, n° 532) ; une cruche à scène mythologique et un gobelet orné d’oiseaux et de guirlandes fl orales d’origine égyptienne trouvés à Kertch ou dans ses environs (Slitine 2005, p. 100-101, Arveiller-Dulong, Nenna 2005, n° 871).
4. Type Isings 12 (Isings 1957) mais aussi AR34 (Rütti 1991a), AV V 42 (Bonnet-Borel 1997), Trier 30 (Goethert-Polaschek 1977).
5. Caron 1990, fi g.2 ; Rütti 1991b, pl. XXXV, fi g. 24 et 26b ; Foy, Nenna 2001, n° 108 ; Arveiller-Dulong, Nenna 2005, n° 16.
6. Ce thème serait parfois représenté sur des vases grecs (Stiline 2005, p. 100).
7. Un contexte du site des Hespérides daté de la phase 4 (de 70/80 à 130/140 ap. J.-C.) a livré un fr. de camée en pâte de verre bleu foncé et blanc, au motif de profi l féminin tourné vers la droite, portant une coiffure égyptienne, non préci-sée (Hervé 2000, n° 39 p. 130) ; présence dans l’environnement de l’Augusteum près de la Fontaine d’une intaille en cornaline gravée du taureau Apis (Fiches, Veyrac dir. 1996, notice 136, p. 268) ; mention d’un fragment de camée en cal-cite représentant une tête féminine coiffée de la couronne d’Hathor (Guiraud 1996, p. 66).
8. Le culte d’Isis et de Sérapis a été rendu offi ciel à Rome par Caligula (37-41) et a atteint son apogée dans tout l’Empire au IIIe s. ap. J.-C.
9. Les médaillons de lampe portent un décor moulé sur lequel peuvent être repré-sentés Anubis, Isis, Sérapis, Harpocrate, Jupiter Ammon (Bémont, Chew 2007, D98 à D103).
10. Un exemplaire au musée de Nîmes provenant du site des Claparèdes à Baron (Gard), un à Fréjus, un à Draguignan et deux autres mis au jour en Ligurie, à Luni et Vintimille (Béal 1983, 161 note 14 ; Béal 1985, 81, pl. 16, n° 335).
11. D’après nos connaissances, l’autre bovin sauvage, le bison, Bison bonasus, n’atteignait probablement pas une taille suffi sante en Europe occidentale pour être une des sources de l’objet.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
245DéCOuVeRte De DeuX nOuVeLLes tOmBes Du HAut-empIRe DAns Le QuARtIeR HOCHe-seRnAm À nÎmes (GARD)
RAN 45 – pp. 221-246
◤ Références bibliographiques
Anderes 2008 : ANDERES (C.) – La collection de tabletterie du Musée romain de Nyon (CH). In : BERTRAND (I.) dir. – Le travail de l’os, du bois de cerf et de la corne à l’époque romaine : un arti-sanat en marge ? Monographie Instrumentum, 34. Montagnac, 2008, 269-274.
Arvei l ler-Dulong et al . 2003 : ARVEILLER- D U L O N G ( V. ) , S E N N E Q U I E R ( G . ) , VANPEENE (N.) – Verreries du Nord-Ouest de la Gaule : Productions et importations. In : FOY (D.), NENNA (M.-D.) dir. : Echanges et com-merce du verre dans le monde antique. Actes du colloque de l’A.F.A.V. (Aix-en-Provence et Marseille, 7-9 juin 2001), Monographie Instru-mentum 24, 2003, p. 147-160.
Arveiller-Dulong, Nenna 2005 : ARVAILLER-DULONG (V.), NENNA (M.-D.) – Les verres antiques du Musée du Louvre, II : vaisselle et contenants du Ier siècle au début du VIIe siècle ap. J.-C., Musée du Louvre éd. Paris, 2005.
A r ve i l l e r - D u l on g , Ne n na : ARVEILLER-DULONG (V.), NENNA (M.-D.) – Les verres antiques du musée du Louvre, III, Parures, ins-truments et éléments d’incrustation. Paris : Somogy – Louvre éditions, 2011.
Audollent 1923 : AUDOLLENT (A.) – Les tombes gallo-romaines à inhumation des Martres-de-Veyres (Puy-de-Dôme). Mémoires de l’Acadé-mie des Inscriptions et Belles Lettres, XIII, 1923, p. 275-384.
Aufrère 1985 : AUFRERE (S.) – Quelques survi-vances de l’Egypte ancienne en Provence gallo-romaine. In : FOISSY-AUFRERE (M.-P.) dir., Egypte et Provence : civilisation, survivances et « cabinets de curiosité », Musée Calvet, Avignon, 1985, p. 146-169.
Béal 1983 : BÉAL (J.-Cl.) – Catalogue des objets de tabletterie du musée de la civilisation gallo-romaine de Lyon. Centre d’Études Romaines et Gallo-romaines de l’Université Jean-Moulin de Lyon III, nouvelle série, n° 1, Lyon, 1983, 421 p. 71 pl.
Béal 1984 : BÉAL (J.-Cl.) – Les objets de tablette-rie antique du musée archéologique de Nîmes. Cahiers des musées et monuments de Nîmes, 2, 1984, 120 p., 22 pl.
Bel et al. 2002 : BEL (V.), BUI THI MAI, FEUGERE (M.), GIRARD (M.), HEINZ (Chr.), OLIVE (Cl.) – Pratiques funéraires du Haut-Empire dans le Midi de la Gaule. La nécropole du Val-ladas à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Lattes, CNRS, 2002 (Monographies d’Archéolo-gie Méditerranéenne ; 11), 539 p.
Bel et al. 2008 : BEL (V.), BLAIZOT (Fr.), DUDAY (H.) – Bûchers en fosses et tombes bûcher : pro-blématiques et méthodes de fouille, in : SCHEID (J.) dir. - Pour une archéologie du rite, Nouvelles perspectives de l’archéologie funéraire. Rome, 2008 (Collection de l’École Française de Rome ; 407), p. 233-247.
Bemont, Chew 2007 : BEMONT (C.), CHEW (H.) – Lampes en terre cuite antiques. Musée d’Archéo-logie Nationale de Saint-Germain-en-Laye, 2007.
Beretta, Di Pasquale (dir.) 2006 : BERETTA (M.), DI PASQUALE (G.) dir. – Arts et Sciences. Le verre dans l’Empire romain. Catalogue d’expo-sition, Paris, 2006.
Bonnet Borel 1997 : BONNET BOREL (F.) – Le verre d’époque romaine à Avenches – Aventi-cum. Typologie générale, Documents du Musée Romain d’Avenches, 3, 1997.
Buffat et al. 2008 : BUFFAT (L.), BOUVARD (E.), ROPPIOT (V.), BENEZET (J.) avec la colla-boration de GRANIER (G.), CHARPENTIER (T.), MASBERNAT-BUFFAT (A.), LEROY (L.), SEVIN (C.), TROUILLOT (E.) – La Cou-rondelle 2. Occupation protohistorique et gallo-romaine dans la périphérie de Béziers (34). Acter, SRA Languedoc-Roussillon, Saint-Estève, 2008.
Caron 1990 : CARON (B.) – Note sur l’origine d’un groupe de gobelets peints. Annales de l’Associa-tion Internationale pour l’Histoire du Verre, 11 (Bâle 1988). Amsterdam, 1990, p. 61-69.
Carrier 2008-2010 : CARRIER (C.) – Isis à Nîmes. Bulletin de l’École Antique de Nîmes, n° 28, 2008-2010, p. 93-103.
Colombier 2008 : COLOMBIER (A.). – Deux frag-ments de verre peint trouvés à Flacé (Saône-et-Loire), au nord de Mâcon. Bulletin de l’A.F.A.V., 22e Rencontres de Rennes, 2008, p. 54.
De Vos 1980 : DE VOS (M.) – L’egittomania in pit-ture e mosaici romano-campani della prima età imperiale. Leiden, 1980.
Feugère 1992 : FEUGÈRE (M.) – Les perles de type Kempten en Gaule méridionale. Archéologie en Languedoc, 16, 1992, p. 149-148.
Fiches, Veyrac dir. 1996 : FICHES (J.-L.), VEY-RAC (A.) dir. – Nîmes, Carte Archéologique de la Gaule, 30/1. Pré-inventaire archéologique publié sous la responsabilité de PROVOST (M.). Paris, 1996, p. 471-472.
Foy, Nenna dir. 2001 : FOY (D.), NENNA (M.-D.) dir. – Tout Feu, Tout Sable. Mille ans de verre antique dans le Midi de la France, Musées de Marseille, édisud (éd.). Aix-en-Provence, 2001.
Foy 2010 : FOY (D.) – Les verres antiques d’Arles. La collection du Musée départemental Arles antique, Errance, 2010.
Garnier 2012 : GARNIER (N.) – Analyse organique du contenu de coquillages. Sites : Nîmes Hoche-Sernam et Amélie-les-Bains. Février 2012, 8 p.
Genin 2007 : GENIN (M.). – La Graufesenque (Mil-lau, Aveyron). Volume II, sigillées lisses et autres productions. Éditions de la Fédération Aquitania, 2007, 589 p.
Genty 1984 : GENTY (P.-Y.). – La Sigillée d’Italie et du sud de la Gaule, première partie. Le Cour-rier archéologique du Languedoc-Roussillon, 17. Montpellier : ADAL, 1984.
G o e t h e r t - Po l a s c h e k 19 7 7 : GOETHERT-POLASCHEK (K. von) – Katalog der römischen Gläser des Rheinischen Landesmuseums Trier. Mainz, 1977.
Guiraud 1996 : GUIRAUD (H.) – Intailles et camées romains. Paris, 1996.
Hermann 1976 : HERMANN (B.) – Neuere Ergeb-nisse zur Beuteilung menschlicher Brand-knochen, Z. Rechtmedizin 77, 1976, p. 191-200.
Hervé 2000 : HERVE (M.-L.) – Le petit mobilier du site des Héspérides, In : GARMY (P.), MON-TEIL (M.) dir., Le quartier antique des Bénédic-tins à Nîmes (Gard). Découvertes anciennes et fouilles 1966-1992, Documents d’Archéologie Française, 81. Paris, 2000, p. 127-133.
Isings 1957 : ISINGS (C.). – Roman glass from dated fi nds. Groningen, 1957.
Jung dir. 2012 : JUNG (C.) dir. – Autoroute A75, Section Béziers-Pézenas, Hérault, Montblanc, Les Cresses-Basses, Rapport fi nal d’opération de fouille archéologique. Inrap Méditerranée, 2012.
Lenorzer 2009 : LENORZER (S.) – La crémation dans les sociétés protohistoriques du sud de la Gaule. Lattes, 2009, 282 p. (Monographies d’Archéologie Méditerranéenne, 25).
Lowrence, Latimer 1957 : LOWRANCE (E. W.), LATIMER (H.B.) – Weights and Linear Meas-urements of 105 Human Skeletons from Asia, The American Journal of Anatomy, 101, 3, 1957, p. 445-459.
Manniez 2005 : MANNIEZ (Y.) – Les lampes à huile dans les sépultures romaines tardives du Languedoc méditerranéen. In : CHRZANOVSKI (L.). Actes du 1er Congrès international d’études sur le luminaire antique, Lychnological Acts 1. (Nyon-Genève, 29.IX-4.X.2003). Montagnac, 2005, p. 227-231 (Monographie Instrumen-tum, 31).
Manniez à paraître : MANNIEZ (Y.) – Le petit mobilier. In : BREUIL (J.-Y.) dir. Rapport de fouille Parking Jean-Jaurès à Nîmes, Rapport fi nal d’opération de fouille archéologique. Inrap Méditerranée, à paraître.
Mattingly et al. 1927-1984 : MATTINGLY (H.), SYDENHAN (E.-A.), SUTTHERLAND (C.), CARSON (R.), KENT (J.) – Roman Imperial Coinage, tome I à X, Editions diverses. London, 1927-1984.
McKinley 1993 : MC KINLEY (J. I.) – Bone frag-ment size and weights of bone from modern british cremation and the implications for the interpretation of archaeological cremations, International Journal of Osteoarchaeology, vol. 3, 1993, p. 283-287.
Mikler 1997 : MIKLER (H.) – Die römischen Funde aus Bein im Landesmuseum Mainz. Monogra-phie Instrumentum, 1. Montagnac, 1997, 173 p., 69 pl. hors texte, 6 plans.
Nicholson, Price 2003 : NICHOLSON (P.T.), PRICE (J.) – Glass from the port of Berenike,
fichier EDITEUR destiné à un usage privé
246 – mARIe ROCHette ET AL.
ReVue ARCHéOLOGIQue De nARBOnnAIse, tome 45, 2012
Red Sea Coast, Egypt. In : FOY (D.), NENNA (M.-D.) dir. : Echanges et commerce du verre dans le monde antique. Actes du colloque de l’A.F.A.V. (Aix-en-Provence et Marseille, 7-9 juin 2001), Monographie Instrumentum 24, 2003, p. 389-394.
Py dir. 1993 : PY (M.) dir. – Dictionnaire des Céra-miques Antiques (VIIe s. av. n. è. – VIIe s. de n. è.) en Méditerranée nord-occidentale (Provence, Languedoc, Ampurdan). Lattes : ARALO, 1993, 624 p. (Lattara ; 6).
Raux, Termignon coll. 2008 : RAUX (S.), TER-MIGNON (S.) – Les objets de tabletterie. In : SIREIX (Ch.) dir. - La Cité judiciaire. Un quar-tier suburbain de Bordeaux antique. Aquitania, suppl. 15, 2008.
Rochette 2011 : ROCHETTE (M.) – Phase 2 du dia-gnostic des parcelles ouest de l’ancien hôpital Doumergue à Nîmes (Gard), Rapport fi nal d’opé-ration de diagnostic archéologique. Inrap Médi-terranée, 2011, 38 p.
Rochette 2010 : ROCHETTE (M.) – Un espace funé-raire du Ier siècle après J.-C. à Nîmes (Gard), Rapport fi nal d’opération de diagnostic archéo-logique. Inrap Méditerranée, 2010, 54 p.
Rochette 2008 : ROCHETTE (M.) – Rue Sully, Hoche-Sernam 1 à Nîmes (Gard), Rapport fi nal d’opération de diagnostic archéologique. Inrap Méditerranée, 2008, 58 p.
Rodet-Belarbi, Chardron-Picault 2005 : RODET-BELARBI (I.), CHARDRON-PICAULT (P.)
– L’os et le bois de cerf à Autun-Augustodunum (Saône-et-Loire) : productions et consommation d’un instrumentum », Revue archéologique de l’Est, 54, 2005, p. 149-209.
Rütti 1991a : RÜTTI (B.) – Die Römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst. Katalog und Tafeln, Forschungen in Augst, 13, 1991.
Rütti 1991b : RÜTTI (B.) – Early Enamelled Glass. In: NEWBY (M.), PAINTER (K) ed., Roman Glass : Two centuries of Art and Invention. The Society of Antiquaries of London Occasional Papers XIII. Londres, 1991, p.122-136.
Rütti 2003 : RÜTTI (B.) – Les verres peints du Haut Empire romain: centres de production et de dif-fusion. In : FOY (D.), NENNA (M.-D.) dir. : Echanges et commerce du verre dans le monde antique. Actes du colloque de l’A.F.A.V. (Aix-en-Provence et Marseille, 7-9 juin 2001), Mono-graphie Instrumentum 24, 2003, p. 349-357.
Sternini 1991 : STERNINI (M.). – La Verrerie romaine du musée archéologique de Nîmes, 2e partie. Nîmes, 1991.
Slitine 2005 : SLITINE (F.) – Histoire du verre. L’Antiquité. Massin éd., Paris, 2005.
Vigne 1896-1898 : VIGNE (A.) – Découverte d’un tombeau et d’un bûcher gallo-romains à Nîmes (Gard). Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Beaux-Arts de Cholet et de l’arron-dissement, 15e, 16e et 17e années, 1896, 1897 et 1898, p. 227-234.
Warren, Maples 1997 : WARREN (M. W.), MAPLES (W. R.) – The Anthropology of Con-temporary Commercial Cremation, Journal of Forensic Science, 42, 3, 1997, p. 417-423.
fichier EDITEUR destiné à un usage privé