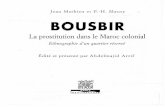« L’hôpital dans son quartier. L’exemple de Paris à l’époque moderne »
-
Upload
paris-sorbonne -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of « L’hôpital dans son quartier. L’exemple de Paris à l’époque moderne »
L’hôpital dans son quartier
L’exemple de Paris à l’époque moderne
Isabelle Robin-Romero
(Paris IV-Sorbonne)
In Images et pratiques de la ville, vers 1500-vers 1840, de l’université de Saint-Étienne, mai
2002, Presses universitaires de Saint-Étienne, 2003, p. 137-153.
La ville moderne se caractérise bien souvent par son hétérogénéité sociale qui rend
complexe l’identification, si l’on reprend la double fonction sociale et culturelle que les
contemporanéistes ont donnée du quartier, d’espace distinct marqué par une culture propre à
un milieu social donné. Dans cette définition, l’espace vécu est essentiel que l’on prenne en
compte les relations de toutes sortes établies entre les habitants du quartier ou le regard des
étrangers. Malgré les problèmes posés par les sources, les historiens modernistes, persuadés
de l’existence de quartiers dans les villes, ont su trouver des documents et des démarches pour
cerner cette entité si souvent insaisissable1. Dans un article, A. Cabantous cite parmi les
situations à l’origine d’un espace vécu spécifique la présence d’une profession ou bien de
plusieurs activités économiques complémentaires, d’une minorité, toutes choses qui
contribuent à lui donner sa couleur particulière, ou bien d’une « institution assurant une
fonction essentielle ». Il entend ainsi évoquer le cas d’une halle, de sièges de confrérie ou de
métier, on pourrait ajouter et ce faisant poser le problème de l’installation d’un hôpital.
Tel que le mot s’entend à l’époque, il s’agit d’une institution charitable qui abrite une
population nombreuse, mais pas forcément très homogène, rassemblée par la misère, la faim
et la maladie. On la dit enfermée à l’époque moderne et a priori sans contacts avec l’extérieur,
position à nuancer évidemment, mais qui ne laisse pas présager d’un grand rayonnement.
Cependant tout hôpital entretient une chapelle où l’on dit au moins la messe et les heures
canoniales ce qui peut attirer les fidèles résidant aux environs comme le font les couvents
dans certaines villes2. Ces maisons où on enferme ne peuvent vivre en autarcie et doivent
multiplier les échanges avec la ville, et elles peuvent exercer une influence sur leurs
environs les plus proches. La puissance d’attraction d’un hôpital est-elle mesurable ? Quel
territoire est concerné ? Peut-on le mesurer ? Peut-on penser qu’une institution hospitalière
puisse générer « son quartier », non pas seulement s’inscrire dans une paroisse ou une vaste
agglomération urbaine mais aussi agir dans un espace limité ? Le mot quartier est pris dans le
sens d’espace proche, de voisinage. Pour cela, il faut étudier les échanges entre l’hôpital et ses
voisins, les institutions les plus proches géographiquement ou dont il dépend, la population
citadine qui vit aux alentours.
Pour tester la pertinence du questionnement, j’ai choisi l’exemple des hôpitaux pour
orphelins de Paris les plus importants. La Trinité, le Saint-Esprit, les Enfants-Rouges et les
Cent-Filles étaient parmi les plus anciens, puisqu’ils ont été fondés au XVIe siècle pour les
1 M. Garden en 1977 avait lancé une enquête sur le sujet dont il donne les lignes de recherches dans « La vie de
quartier », Bulletin du centre d’histoire économique et sociale de la région lyonnaise, 1977, n°3 ; p. 17-28bis ;
A. Cabantous a présenté une synthèse des diverses approches dans « Le quartier, espace vécu à l’époque
moderne », H.E.S., 1994, pp. 427-439. 2 D. Garrioch le note à Paris à la fin du XVIIIe siècle, dans la paroisse sainte Marguerite, la chapelle des Enfants-
Trouvés et celle du couvent de Madeleine de Trenelles reçoivent de nombreux fidèles le dimanche. D. Garrioch,
Neighbourhood and Community in Paris, 1740-1790, Cambridge University Press, 1986, p. 158.
trois premiers et au début du XVIIe (1623) pour le dernier, et de ceux qui accueillaient un
grand nombre de pensionnaires, sans atteindre le gigantisme des maisons de l’Hôpital-
Général. On trouve mention de 100 à 200 enfants au Saint-Esprit, de 70 à 300 à la Trinité
entre XVIe et XVIIIe siècles, avec de fortes variations dues aux aléas de leur histoire, et des
maxima atteints au milieu du XVIIe siècle. L’hôpital de la Miséricorde a dû son surnom des
Cent-Filles au nombre de places offertes mais a vu ses effectifs un peu réduits au XVIIIe
siècle. La fondation des Enfants-Rouges, quant à elle, est toujours restée un petit
établissement, moins de 50 enfants y résidaient au XVIe siècle à peine plus au XVIIIe. Il
s’agit donc de populations relativement nombreuses mais surtout homogènes : des enfants,
âgés de 5 à 15 ans, orphelins de père ou de mère ou bien orphelins complets étaient leurs
pensionnaires. A l’adolescence se posait la question de leur mise en métier ce qui peut avoir
un intérêt pour l’étude du quartier. De plus, ils étaient tous des petits parisiens, issus des
milieux très modestes de la ville comme des couches moyennes du monde de l’artisanat et de
la boutique. Ces hôpitaux étaient surtout installés sur la rive droite de la Seine. Seules les
Cent-Filles, de création plus tardive, étaient implantées dans le quartier de l’université3.
L’examen des relations de l’hôpital avec son environnement urbain, le bâti, la vie religieuse
autour de l’hôpital et la relative ouverture d’une maison réputée lieu clos, constitue une
première approche de la vie de l’hôpital dans son quartier. Dans un second temps, l’exemple
de l’hôpital de la Trinité, sis rue Saint-Denis, permettra de mettre en lumière un cas
particulier.
1. L’hôpital, un lieu clos : de la théorie à la pratique
Le dedans et le dehors Les hôpitaux pour orphelins sont conçus comme des maisons d’éducation pour des
enfants déjà un peu autonomes, qui séjournaient parfois pendant de longues années, mais que
l’on ne gardait pas indéfiniment. Bien souvent ils quittaient les murs de l’institution charitable
autour de 14-15 ans quand ils entraient en métier et restaient sous tutelle jusqu’à leur majorité.
Pendant le temps de leur séjour, l’hôpital leur assurait le logement, la nourriture, les
vêtements et le blanchissage ainsi que l’éducation religieuse et l’instruction scolaire. Pour
protéger les enfants et mener à bien sa mission, l’hôpital établissait une clôture. Dans l’enclos,
les enfants vivaient en collectivité sous la surveillance d’un personnel nombreux et vigilant.
La clôture créait une distinction nette entre le dehors et le dedans, entre les personnes
extérieures, protecteurs-protectrices et fondateurs et tous les autres citadins, et celles du
dedans qui résidaient dans la maison, personnel et pensionnaires. Ce choix de la séparation
constituait une réponse aux problèmes posés par la pauvreté. Le combat contre l’oisiveté, la
mendicité, la débauche et le vice devait être mené dans un établissement pensé comme un
asile de pureté où on évitait le plus possible les contacts avec les gens du dehors. Au XVIe
siècle, on présentait cette opposition dedans/dehors de façon très concrète. Pour sauver les
orphelins de la pauvreté, de l’errance et de l’oisiveté, le Saint-Esprit et la Trinité dispensaient
des soins dans leurs murs à de pauvres enfants sans parents4. Au temps de la réforme
catholique, un discours militant contre la débauche s’est de plus en plus focalisé sur l’idée de
séparation nécessaire.
Les enfants étaient jugés particulièrement fragiles car, non seulement la nature
humaine les portait au péché, mais de plus, sans expérience ni discernement, ils étaient
incapables de sauver leur âme sans le secours des autres. Toutefois, les responsables des
orphelins placés savaient bien qu’ils n’étaient mis à l’écart du monde que pour un temps. Il
3 Voir la localisation des hôpitaux Annexe 1.
4 Voir par exemple, les lettres patentes de décembre 1574 dans Reglemens, statuts, privilèges de la Trinité, 1682
(Archives de l’Assistance Publique (A.A.P.), B110).
leur fallait donc en profiter pour leur faire pratiquer l’humilité, l’obéissance, la modestie, et
acquérir l’amour du travail. Les fondateurs et administrateurs plaçaient leur espoir dans la
séparation du monde et la transmission des principes de la foi. Ce n’est qu’une fois atteint
l’âge de vingt-cinq ans que les orphelines de la Miséricorde étaient jugées aptes à se guider
seules dans le monde et qu’elles quittaient la tutelle de l’hôpital. Les deux autres institutions
faisaient de même en théorie, mais en après la mise en métier, vers quinze ans, le suivi des
orphelins se relâchait quelque peu. La séparation impliquait en partie un éloignement des
parents dont les visites étaient très surveillées et même parfois jugées néfastes. Dans la
seconde moitié du XVIe siècle, les administrateurs de la Trinité critiquaient leur influence sur
les jeunes pensionnaires, montrant par là que les principes de l’hôpital ne correspondaient pas
forcément à ceux des couches de la population urbaine dont étaient issus les enfants. Aux
Cent-Filles comme à la Trinité, on associait avec force l’intérieur à la pureté et l’extérieur au
vice. En 1637, le règlement des Cent-Filles énonce cette idée ainsi : « les filles admises dans
cet hôpital doivent souvent rendre grâce à Dieu de leur avoir ouvert cet azile où elles sont
élevées dans sa crainte, et loin des dangers auxquels elles auroient été exposées par la
pauvreté de leurs familles, et par la corruption qui règne dans le monde… »5. Tous les
témoignages concordants datent du XVIIe siècle ou des premières décennies du XVIIIe siècle
et montrent que le renouveau de la ferveur catholique a, on le voit, profondément marqué les
conceptions des administrateurs et l’assistance dans son ensemble en renforçant l’opposition
entre le dedans et le dehors.
Concrètement, la clôture de la maison signifie que toutes les issues devaient être
contrôlées. Les clefs et les portes faisaient donc l'objet de nombreuses recommandations et
étaient placées sous la responsabilité conjointe d'un portier et de la gouvernante ou du
« maître des enfans » selon la maison. La Miséricorde avec son unique porte sur la rue
Censier employait un portier et une portière. Lui était posté à l’entrée sur la rue pendant
qu’elle veillait au guichet de la cour6. La surveillance des issues était autrement plus
complexe à la Trinité7. On y disposait de quatre issues donnant sur la rue et d’un seul portier
8.
La grande porte qui s’ouvrait sur la rue Greneta ou Darnetal, permettait d’accéder au bâtiment
des enfants et aux cours des artisans, les autres entrées se trouvaient dans la rue Saint-Denis.
Il y avait la grille de la chapelle et les deux passages vers les cours des artisans. On peut noter
qu’il n’y avait ni porte ni façade de l’hôpital sur la rue Saint-Denis même qui était occupée
par des maisons particulières. Toutes ces entrées étaient soigneusement fermées le soir à 20
heures ou 21 heures, selon la saison, et pendant les offices auxquels assistaient tous les gens
de l’hôpital, même le portier. Les jours fériés ou jour de visite, une porte de la rue Saint-Denis
restait ouverte. Bien qu’en retrait de la rue, les cours des artisans étaient facilement
accessibles et la circulation continue pendant la journée. Quant aux orphelins pensionnaires de
l’hôpital, ils étaient doublement isolés de la rue d’une part, et des cours des artisans qui
communiquaient avec leurs bâtiments par une porte où veillait un autre gardien, d’autre part.
Au portier installé du côté de la rue Greneta, on recommandait la plus grande assiduité. Les
issues secondaires comme la grille de l’église ou de la sacristie restaient le plus souvent
closes. Les fuites étaient pourtant possibles et deux commis du bureau, qui prêtaient serment
devant le Châtelet et portaient le titre de sergent, étaient chargés de retrouver les fuyards9. Le
5 B.N., Ms. fr. 18607, Institution, ordre et reglement des Cent-Filles, 1637, chap. XIII.
6 B.N., Ms. fr. 11365, Statutz et reglemens de l’Hospital Nostre Dame de la Miséricorde fondé par Messire
Anthoine Séguier, 1672, chap. 9 ; A.N., LL1696, Registre des Cent-Filles, Directoire pour la gouvernante pour
les jours ouvriers, art. 11. 7 Voir le plan de Gobin en 1766 : Annexe 2.
8 A.A.P., B1199, Reglement général de l’hospital de la Très-sainte Trinité établi à Paris, rue St Denis, 1737,
chap. XII : « des devoirs du portier » et chap. III, art. 14, VIII, art. 23. 9 Ordonnance royale de septembre 1557 dans Reglemens, statuts et privilèges de l’hôpital de la Trinité, op. cit.,
1682, , p. 31 ; Reglement général, op. cit., 1737, chap. I, art. 8.
plan des Enfants-Rouges au XVIIIe siècle montre lui trois issues : la porte de la rue de la
corderie, le passage de la rue Portefoin et l’entrée proche de l’église10
. On peut penser en
l’absence de texte réglementaire que l’organisation était proche de celle des autres hôpitaux.
La séparation entre l’intérieur que l’on cherche à préserver et le reste de la ville se lit
d’abord dans les discours d’intention. Malgré la clôture désirée, l’hôpital était partie prenante
de la ville et de la vie urbaine.
L’inscription dans la ville
Sur les plans anciens de Paris, les hôpitaux pour orphelins se distinguent surtout par
leur emprise en surface. Les édifices ne sont peut-être pas toujours imposants par leur
architecture très proche des constructions particulières11
, mais ils sont vastes et contrastent
avec les parcelles longues et étroites de Paris. On remarque aisément sur le plan Truschet du
XVIe siècle l’enclos des Enfants-Rouges qui touche celui du Temple. Les deux cours de la
Trinité se détachent bien également sur les plans qui mentionnent l’hôpital de la Trinité12
.
Dans la rue, les façades de la chapelle de la Trinité, rue Saint-Denis, ou les piliers du Saint-
Esprit donnant sur la place de Grève signalent les établissements aux passants et marquent le
paysage. Mais il apparaît surtout que ces institutions sont imbriquées dans le tissu urbain au
point d’être peu visibles au premier coup d’œil. On trouve ainsi trois maisons locatives en tout
dans l’espace occupé par l’hôpital des Enfants-Rouges, dont une que l’on ne peut rejoindre
qu’en pénétrant par la porte de l’hôpital, rue Portefoin13
. L’enclos n’est donc pas si
strictement fermé et ne sépare pas autant que l’on pourrait le croire le dedans et le dehors. Au
Saint-Esprit, on connaît le même enchevêtrement des constructions hospitalières et
particulières. Sous les piliers de la place, des maisons appartenant à l’hôpital sont louées,
l’une d’entre elles est même le siège du Grand Bureau des pauvres de la ville. Entre la cour
des filles, les bâtiments de l’hôpital et la maison du Grand Bureau des pauvres, une enclave
est occupée par une « hostellerie ». Pour pénétrer dans cette auberge, il faut emprunter l’un
des deux passages, celui de rue de la Tisseranderie, ou bien celui de la place de Grève14
. Les
bâtiments hospitaliers sont noyés dans le bâti urbain, irrémédiablement imbriqués dans celui-
ci. Il est même difficile de concevoir un isolement dans les quartiers nouvellement construits,
du moins à long terme, car même si l’hôpital s’installe aux champs au moment de sa
fondation, il est vite rattrapé par la croissance de la ville. C’est ce qui est arrivé à l’hôpital de
la Trinité dès le XIVe siècle ; cet hôpital, fondé hors de la ville au lieu dit la porte aux
peintres, fut inclus dans l’enceinte érigée par Charles V15
. Les Cent-Filles, pour lesquelles M.
Séguier avait choisi un cadre enchanteur en 1623, étaient au XVIIIe siècle perdues dans un
quartier presque entièrement bâti, où les artisans étaient très nombreux, surtout les tanneurs et
les teinturiers et où s’était installée une tuerie de cochon. Toutes ces activités empuantissaient
l’air et souillaient la Bièvre qui coulait au fond du jardin des orphelines16
. Il était désormais
impossible d’échapper à la ville et à ses pires incommodités : le manque de place, encore
relatif dans cette zone de la rive gauche, et la pollution industrielle.
10
Voir le plan de M. Payen en 1772 : Annexe 3. 11
J. Imbert, « L’évolution de l’architecture hospitalière : piété, salubrité, bien-être », Bull. de la soc. Française
d’hist. des hôpitaux (B.S.F.H.H.), 1984, n°48, p. 25-38. 12
Voir par exemple, le plan de Paris de Bullet et Blondel. 13
Voir le plan en Annexe 3. 14
Plan général de l’hôpital du Saint-Esprit au XVIIIe siècle , lavis conservé par la B.N., un fac-similé est exposé
au Musée de l’Assistance Publique. 15
B.N. Cinq cents de Colbert 159, folio 21-23, Extrait de la fondation et établissement de l’hospital de la Saincte
Trinité. 16
B.N. Joly de Fleury 1243, folio 104-113, Mémoire pour la communauté des Cent-Filles de Mr Cosnier docteur
régent de la faculté de médecine et médecin de cette communauté, 1775.
Il est difficile dans ces conditions d’envisager de s’agrandir et de gagner du terrain.
Parmi les plus anciens hôpitaux pourtant cela a pu être possible. A la Trinité, l’existence d’un
cimetière mitoyen depuis 1350 a facilité l’extension. Au XVIe siècle, les administrateurs
réclamèrent du terrain aux échevins et proposèrent d’échanger une partie du cimetière de la
Trinité contre un autre lieu. Ils se plaignaient également de la proximité du cimetière néfaste à
la santé des enfants17
. La municipalité approuva et ratifia l’accord qui devait permettre la
construction de nouveaux bâtiments pour les enfants. Rien ne se fit avant la fin du XVIIe
siècle lorsque le cimetière fut supprimé et transféré à Clamart18
. Les achats de maisons
particulières mitoyennes de l’hôpital contribuèrent aussi au gain d’espace de la Trinité. Dans
les années 1670, trois maisons joignant la porte des artisans à la Trinité furent acquises et
transformées selon les besoins de l’institution19
.
La chapelle de l’hôpital, centre de vie religieuse
Parce qu’un hôpital dispose d’une chapelle et fait dire la messe quotidiennement, les
relations avec la paroisse dans laquelle est érigé l’établissement réclament des accords
préalables pour éviter les querelles de préséance et d’autorité entre les clercs. En 1363, quand
on fonda une chapelle et un chapelain perpétuel pour dire la messe à l’hôpital du Saint-Esprit,
le curé de Saint-Jean en Grève, qui céda ses droits paroissiaux, fut dédommagé avec 200 écus
d’or et 10 livres de rente annuelle pour lui et sa fabrique20
. Un curieux partage fut organisé :
les unions des enfants de l’hôpital devaient se conclure à Saint-Jean-en-grève et le chapelain
disait la messe dans sa chapelle. Avant qu’un problème de préséance ou de jalousie ne se
pose, l’hôpital des Cent-Filles et le prieur-curé de Saint-Médart préférèrent aussi s’entendre21
.
Dès 1626, Le bénéficier de la cure reçut un droit d’approbation sur le choix du chapelain, une
priorité pour prêcher les jours de fête à l’hôpital, et le droit de venir dire la messe quand cela
lui plaisait. De plus, il recevait une offrande des Cent-Filles le jour du saint patron de sa
paroisse. Lors des célébrations quotidiennes, les enfants et tout le personnel étaient tenus
d’assister et constituaient le premier public de fidèles de la chapelle auquel s’ajoutaient, en
particulier le dimanche, des voisins qui préféraient entendre la messe dans l’hôpital plutôt que
dans leur paroisse.
Une chapelle de l’hôpital peut aussi être le siège d’une confrérie. Outre les trois autels
dédiés à la Trinité, Saint Louis et Saint-Jean-Baptiste22
, deux confréries s’installèrent à la
Trinité en 1672. Une confrérie de Saint-Roch et de Saint-Sébastien se déplaça depuis l’église
des pères religieux de Saint-Martin-des-champs et une de Saint-Anne depuis le Temple. Les
raisons du transfert sont rapidement énoncées dans l’acte notarié concernant la première. On y
explique qu’il s’agit d’un retour aux sources car « il se trouve que antiennement ladicte
Confrairye a estée érigée » à la Trinité ( ?) et que l’on quitte Saint-Martin des champs sur un
désaccord, on leur refusait là-bas l’exposition du saint-Sacrement23
. La chapelle comme les
confréries amenaient des fidèles, étrangers à l’hôpital, à fréquenter les lieux régulièrement
dans un espace relativement ouvert. A la différence des gens du quartier, les confrères
17
Dr. Vimont, Histoire de la rue Saint-Denis, Paris, 1936, p. 197. 18
Idem, p. 309-310. 19
A.N., M.C., étude LXIX, 415, acquisition d’une maison « tenant à l’hôpital » le 14 juin 1672. On décide de la
faire rebâtir avec trois autres « depuis celle qui sera acquise jusques et joignant la grande porte de l’entrée des
artisans » ; de nombreux devis et quittances de travaux suivent : 1er et 6 juillet, 6 octobre par exemple de la
même année. 20
A. N., L 423, n° 32, mémoire de 1562 sur un différend entre le chapelain perpétuel et les gouverneurs du
Saint-Esprit, 25 p. 21
A. N., LL 1696, folio 35-39, Articles accordez par Messieurs du conseil de Monseigneur l’illustrissime et
révérendissime Archevesque de Paris du consentement des parties cy dessous mentionnées. 22
Dr. Vimont, op. cit., p. 247. 23
A. N., M. C., etude LXIX 415, contrat du 12 janvier 1672.
pouvaient venir de toute la ville et assuraient la renommée de l’hôpital. On accueillait tous les
laïcs qui le désiraient ainsi que les prêtres chargés de dévotions particulières. Cette animation
continuelle était largement tolérée au Saint-Esprit. Voici ce qu’on en dit en 1537 :
« Salut est sonné de la petite cloche à 5 heure en tout temps excepté au fort de l’yver,
que l’on avance à raison de la multitude des gens qui y viennent par chacun jour, et
seroit trop tard quand il fait noir et obscur pour eulx s’en retourner (...) chaque jour et
plus beaucoup au lundi que les autres jours grande multitude de peuple par singuliaire
devocion qui font dire par les orphelins plusieurs anthiennes, hymnes, oraisons et
suffrages » 24
.
On le voit les administrateurs se réjouissaient de cette affluence et avaient même pensé
à adapter les horaires pour ces fidèles. Au siècle suivant, dans l’élan de ferveur des
catholiques, les messes basses se multiplièrent. En 1611, la chapelle de l’hôpital du Saint-
Esprit était très souvent choisie par les Parisiens pour faire dire leurs messes, au point que
l’on en vint à dénoncer le fait. Elle était, semble-t-il, devenue un lieu de « désordres et
schandales (...) à cause de la multitude et affluence des ecclésiastiques qui y concourent pour
y satisfaire à la dévotion du peuple »25
. Ces prêtres sans bénéfice entraient et sortaient en
permanence, discutaient dans les travées entre deux dévotions commandées et, surtout,
racolaient des clients aux portes de l’église. L’archevêché voulut rapidement y mettre bon
ordre en imposant une approbation personnelle des prêtres par le chapelain et les autorités du
diocèse, en instaurant un tableau passage et en rappelant quelques règles fondamentales de
bienséance à ces clercs qui ne devaient surtout plus aller au devant des fidèles mais se tenir
modestement, tous ensemble, dans un coin de l’église26
. Ces petits écarts témoignent de
l’intérêt suscité par les chapelles d’hôpital où l’on entre et l’on sort toute la journée venant du
dehors comme de l’intérieur de l’institution. Cependant la fréquentation d’une église est bien
difficile à mesurer, et au fond, on la pressent plus qu’on ne la démontre27
. La chapelle de
l’hôpital peut constituer un pôle de vie religieuse annexe dans une paroisse très peuplée et
renforcer les liens entre l’hôpital et son voisinage.
Entrées et sorties
Le monde, malgré toutes les préventions que manifestaient les administrateurs,
pénétrait dans leur institution. Aux chrétiens qui fréquentaient la chapelle, il faut ajouter les
visiteurs introduits par les administrateurs et les employés ou bien par les enfants eux-mêmes.
Les fournisseurs se présentaient chaque jour pour livrer leur marchandise. En 1647-1648, le
mercredi et le samedi, Claude Verdier, maître boulanger, livrait son pain, et « chaque jour
gras à deux heures de relevées », Jean Certelet, marchand boucher, faisait porter la viande
nécessaire aux pensionnaires et employés de la maison28
. La gouvernante des Cent-Filles ne
refusait pas l’entrée aux amis des administrateurs, aux dames de qualité et bourgeoises venues
avec des intentions charitables, ainsi qu’aux parents des filles29
. La visite des bâtiments et
lieux où vivaient les orphelines renforçaient la bonne renommée de l’institution dans Paris et
24
A.A.P., D190, Addition faicte en l’an 1537, folio VIxxXIX verso et VIIxx recto (copie datant de 1882 d’un
manuscrit de la B.N. -Ms. fr. 11778- faite par M. Bougenot, élève de l’école des Chartes) 25
A. N., L 423, n° 33, Reglement faict par Monseigneur Henry de Gondy evêque de paris pour l’église du sainct
Esprit de Paris, le 28 septembre 1611 26
Le travail de la réforme étant à l’œuvre déjà dans ces années on ajoute qu’ils doivent être correctement vêtus
de la soutane longue, la barbe et la tonsure soigneusement taillées et rasées « pour honorer leur ministère ».
Idem. 27
D. Garrioch, op . cit., p. 151-158. 28
A.N., M.C., étude III, 582 et 583, marchés de boulangerie du 2 juillet 1647 et du 7 juillet 1648, celui du
boucher est du 31 mars 1648. 29
A.N., LL1696, Directoire pour la Gouvernante, art. divers 29 ; Institution, ordre et reglement, op. cit., 1637,
chap. XIX et XX.
pouvait également apporter des dons. C’est une considération que les bureaux des
administrateurs n’oubliaient jamais.
Les enfants et les adultes qui résidaient dans les établissements pour orphelins étaient
enfermés au sens où ils n’étaient pas libres de sortir à tout moment, mais il leur arrivait très
souvent de passer la porte. Outre les visites dans leur famille, des enfants de la Trinité allaient
et venaient chaque jour pour vaquer à leurs occupations ou pour les loisirs qu'on leur
réservait. Reconnaissables à leur robe bleue, on pouvait les voir suivre, à la demande des
testateurs, les enterrements aux côtés des Enfants rouges et des enfants gris (de la Pitié),
courir les rues pour livrer les marchandises et les produits de leur travail30
ou suivre leur
maîtresse en promenade31
. Les garçons rendaient aussi des services à la communauté en
aidant sur le port au chargement et au transport du blé et du bois pour la maison32
. Il est vrai
que les enfants de la Trinité avaient certainement plus d’occasions de sortie que les autres
orphelins placés à cause des activités religieuses et artisanales de l’établissement33
. Le Saint-
Esprit et les Cent-Filles envoyaient cependant leurs pensionnaires en promenade à la
campagne34
. Mêmes les pupilles de ces établissements ne pouvaient vivre sans contact avec
l’extérieur.
Les maisons pour orphelins se constituent et se pensent en monde clos, pourtant les
allées et venues, qui touchent aussi bien des pensionnaires que des adultes résidants ou bien
venus de l’extérieur, sont nécessaires et font vivre la maison. Il n’y a pas d’autarcie possible,
ni de véritable isolement ou même enfermement ; toutefois les administrateurs essayent dans
la mesure du possible de filtrer les entrées et sorties. La préservation de la pureté élève des
barrières entre le monde et l’intérieur mais elles restent assez symboliques et n’empêchent en
rien les échanges avec la ville. Ces échanges quotidiens et nombreux créent une agitation
autour de l’hôpital et témoignent de sa force d’attraction. Hormis les allées et venues
quotidiennes et banales liées aux livraisons, aux visites et au travail, la vie religieuse autour de
la chapelle constitue certainement un élément important de la vie de l’hôpital dans son
quartier. Il est des jours (de fête ou le dimanche peut-être) de plus grande affluence. On
aimerait, pour tenter de définir l’aire d’attraction de l’hôpital, savoir si les fidèles qui
fréquentent la chapelle viennent surtout des maisons et rues les plus proches. Pour ce qui est
des fournisseurs connus du Saint esprit, le boulanger et le boucher ne sont pas à proprement
parler des voisins, l’un est domicilié au Marché Neuf, paroisse saint-Germain le vieil, et
l’autre Place aux veaux à Saint-Jacques de la Boucherie. On voit par là que les relations d’un
tel établissement s’inscrivent peut-être dans un voisinage et aussi nécessairement dans
l’ensemble de la ville.
2. Un exemple particulier : l’hôpital de la Trinité
Outre les points déjà évoqués qui font de cet hôpital un exemple parmi d’autres, il
semble constituer un cas original à cause de sa formule de mise en métier des enfants qui tient
à plusieurs privilèges anciens.
30
Lettres patentes du 2 juin 1578 dans Reglemens, statuts, privilèges, op. cit., 1682. 31
Reglement général, op. cit., 1737, chap. IX, art. 25. 32
Idem, chap. VIII, art. 20. 33
Le Saint-Esprit envoie parfois des enfants aux convois, mais cette activité est moins importante que pour la
Trinité et de plus n’a pas laissé d’autres témoignages que les vœux formulés dans les testaments des Parisiens.
Pierre Chaunu, La mort à Paris, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, Paris, 1978. 34
L. Brièle, Inventaire sommaire des archives hospitalières antérieures à 1790, Paris, 1886, tome 3, p. 218 ;
A.A.P., Fosseyeux 168, registre des rentes des Cent-Filles, 1777-1792.
Les privilèges des hommes et du lieu
L'instruction professionnelle est un des grands soucis des maisons pour orphelins. Le
texte réglementaire L'Institution de la Trinité en 1545 évoquait déjà cette difficile question du
placement des orphelins35
. Dès ce moment, un premier privilège fut concédé à la maison qui
lui permit d'organiser une partie de l'apprentissage dans son enceinte. Quatre-vingt maîtres
furent invités à venir enseigner leur art aux enfants36
. Mais il fallait avant tout attirer de bons
ouvriers enseignants. En 1553, on autorisa les maîtres parisiens à prendre un apprenti
supplémentaire, s'ils le choisissaient parmi les orphelins, et ce, quels que soient les statuts de
leur métier37
. L'année suivante, le privilège que la Trinité offrait aux artisans qui voulaient
bien instruire ses orphelins prit sa forme définitive :
« Et outre, pour donner occasion à ceux qui par les Administrateurs seront et ont esté
appellez pour l'instruction desdits pauvres Enfans, de mieux s'acquitter de la charge
qui leur sera et a esté commise, et de les en recompenser, et donner plus de cœur
ausdits pauvres Enfans de suivre ce qui leur sera enseigné et montré, et induire l'un
l'autre par espoir de gain et profit de se rendre chacun en son Art plus expert et
excellent, et à enseigner les uns aux autres l'Art qu'ils auront appris : Avons d'abondant
voulu, statué et ordonné, Voulons, statuons et ordonnons, Que ceux qui, comme dit
est, seront et ont esté appellez pour l'instruction desdits Enfans, apres avoir à ce faire
vacqué par six ans, ou qui par autre temps suffisant seront trouvé avoir bien montré et
enseigné leur art ausdits Enfans, pourront estre par lesdits Administrateurs dudit
Hospital, et leurs successeurs audit Gouvernement et administration, presentez à nôtre
Prevost de Paris, et nostre Procureur au Chastelet, comme idoines, suffisans et
capables pour estre faits Maistres Iurez au métier et art, auquel ils auront vacqué et
instruit lesdits Enfans ; A laquelle Maistrise Nous voulons qu'à la présentation et
certification d'iceux Maistres et Administrateurs ils soient par eux receus sans faire
autre chef-d'oeuvre, banquets, ou faire autres dons et frais en tels cas accoustumez, et
jouïssent des Privilèges, franchises et libertez du métier auquel ils seront receus, ainsi
que jouïssent les maistres dudit métier, et que le semblable se fasse desdits Enfans,
apres qu'ils auront atteint l'âge de vingt-cinq ans, ou autre temps qui leur ait apporté
l'expérience, art et industrie requise au métier auquel ils auront esté appliquez et
instituez, et qu'ils aurront aussi fait et employé leur temps à l'instruction et
enseignement des autres leurs compagnons, et servy en ladite Maison après leur
apprentissage l'espace de six ans. De toutes lesquelles choses Nous avons chargé et
chargeons les honneurs et consciences d'iceux Administrateurs. »38
La maîtrise ainsi obtenue conférait tous les droits et avantages des maîtrises et avait
une valeur reconnue à l’extérieur de l’hôpital. Les ouvriers, une fois leur temps écoulé,
devenaient maîtres et pouvaient exercer partout dans la ville39
. Après avoir travaillé loin des
regards et des inspections des jurés des métiers, ils obtenaient l'ultime récompense, une
maîtrise en bonne et due forme qui ne leur coûtait pas un sou. Un engagement ou bail signé
35
A.A.P., B110, L’Institution des Enfans de l’Hospital de la Trinité, Avec la forme du gouvernement et
ordonnance de leur vivre de 1545, composé de 38 articles, imprimé en 1682 à la suite de Reglemens, statuts et
privilèges, op. cit. 36
Dr. Vimont, op. cit., p. 252. 37
Lettres patentes du 12 février 1553, in Réglemens, Statuts et privilèges, op. cit., 1682, p. 16 et suiv. 38
Lettres patentes de juin 1554, in Reglemens..., 1682, p.23-24. 39
Ceci les différencie des privilèges d’autres hôpitaux. Ainsi, les compagnons chirurgiens de l’Hôtel-Dieu de
Marseille devenaient maître après avoir exercé dans la maison, mais ne pouvaient pas envisager de jamais
pratiquer leur art hors de ses murs. François Olivier Martin, L’organisation corporative de la France, Paris,
1938, p. 392.
avec les administrateurs et les contrats successifs établis avec les enfants servaient de
justificatifs après les six années pour leur candidature à la maîtrise40
.
Institués d'abord pour encourager les ouvriers41
et les enfants, ces privilèges
concouraient aussi à faire de l'enceinte de la Trinité, où les artisans s'installaient dans les
ateliers et boutiques des vastes cours aménagées à cet effet, une zone de travail libre, hors de
portée des jurés des métiers. Malgré ses dimensions, cet espace des deux cours fut vite
surpeuplé. Les ateliers ou boutiques étaient rangées autour d’une place centrale laissée vide au
XVIIe siècle. Pour utiliser au mieux ces lieux, on a ajouté au XVIIIe siècle dix-huit nouveaux
locaux au milieu du terre-plein de la première cour et onze autres le long du mur du fond de la
deuxième. Ils correspondent aux ateliers n° 87 à 104 et 76 à 86 sur le plan de 1766. Au total,
cent quinze ateliers étaient disponibles dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les ouvriers
formateurs des orphelins étaient donc des volontaires attirés par les privilèges, par la main
d’œuvre gratuite et par l’obtention d’un local gratuit dans la cour42
.
Des effets inattendus sur le voisinage
La présence de ces deux cours et des ouvriers et apprentis a considérablement accru le
va-et-vient entre l’enclos et les alentours. Les enfants pensionnaires de l’hôpital entraient et
sortaient à toute heure du jour, on l’a dit, mais, avec les apprentis et leurs formateurs, on
assistait à de véritables mouvements pendulaires. Les ouvriers gagnants maîtrise, tout en
travaillant dans l'hôpital, demeuraient hors de ses murs car, comme le précise le plan de
Gobin de 1766, on ne trouve aucun logement dans la cour. Le matin, vers 5 ou 6 heures, selon
la saison, les ouvriers et leurs apprentis arrivaient en masse puis, le soir venu, quittaient tous
obligatoirement les lieux, à 20 ou 21 heures, au moment de la fermeture des portes pour la
nuit43
.
Le système de formation propre à cet hôpital avait un autre curieux effet. Les ouvriers
gagnant maîtrise étaient majoritairement domiciliés autour de l’hôpital, si l’on en croit les
contrats d’apprentissage des orphelins. Pour étudier le recrutement de ces hommes, il est
nécessaire de comparer avec un autre établissement afin de faire apparaître la spécificité de la
Trinité. Deux échantillons d’actes du Minutier central ont permis ce travail. Le premier
provient de l’étude avec laquelle le Saint-Esprit a travaillé pendant tout le XVIIe siècle et se
compose des 609 contrats d’apprentissage datés de 1645 à 1691. Le second regroupe les 328
contrats passés par la Trinité chez Me Pierre Gary, entre 1664 et 167544
.
Tableau n° 1 : le recrutement des maîtres formateurs pour les orphelins de deux hôpitaux dans
la seconde moitié du XVIIe siècle à Paris.
Trinité Saint-Esprit
Nombre de contrats d’apprentissage 328 609
Nombre d’adresses d’ouvriers 304 569
Nombre total de rues citées 93 267
Nombre d’adresses inconnues 5 42
Nombre de paroisses 18 43
40
. Des exemples d’ouvriers devenus maîtres sont repérables par exemple dans le Journal des noms et demeures
des marchands orfèvres joailliers tireurs et batteurs d’or, 1777 (A.N., T*1490/28). 41
La justification garde tout son sens encore au XVIIIe siècle, les lettres patentes du 17 mars 1762 ne défendent-
elles pas encore les privilèges en expliquant qu'« il est juste de les maintenir, pour exciter lesdits maîtres par des
récompenses proportionnées aux charges » (B.N., Joly de Fleury 1240, folio 212 et suiv.) 42
Tous les ouvriers gagnant maîtrise n’ont pas droit à un atelier. Certaines professions n’en ont que faire, et les
ouvriers qui aimeraient bénéficier de cet avantage sont plus nombreux que les ateliers dans les cours. 43
A.N., M.C., étude LXIX, voir les baux des ouvriers établis par Me Pierre Gary, notaire, entre 1664 et 1675. 44
A.N., M.C., étude III, 577 à 759 et étude LXIX, 293 à 425.
Les maîtres qui se présentent au Saint-Esprit viennent de toute la ville, y compris la
rive gauche de celle-ci, alors que ceux qui se portent volontaires à la Trinité sont plus
rassemblés dans un tout petit nombre de paroisses et de rues de la ville. On compte une
mention de rue pour trois contrats ou ouvriers à la Trinité, une pour deux au Saint-Esprit.
Seules quatre adresses de la Trinité sont situées sur la rive gauche dans la paroisse Saint-
Sulpice et la représentation de la Cité est à peine supérieure (cinq adresses). La concentration
des ouvriers de la Trinité sur la rive droite est flagrante. On privilégie même les paroisses les
plus proches : Saint-Laurent, Saint-Sauveur, Saint-Nicolas-des-champs, Saint-Leu-Saint-
Gilles, Saint-Eustache regroupent un bon tiers des contrats. A l’inverse l’institution du Saint-
Esprit semble beaucoup plus ouverte au recrutement.
Tableau n° 2 : Répartition des principales adresses des ouvriers de la Trinité
(cinq mentions et plus)
Domicile des ouvriers Total Employant
des Garçons
Employant
des Filles
Rue Saint-Denis 25 15 10
Rue Saint-Sauveur 5 4 1
Rue du Huleu 10 9 1
Rue Greneta 66 65 1
Rue Bourg l’abbé 42 40 2
Rue Saint-Martin 21 18 3
Total 171 153 18
Total des adresses 328
En descendant au niveau de la répartition par rue, certains noms dans les actes de la
Trinité reviennent sans cesse. Ce sont tout d’abord ceux de deux grandes artères de la ville,
comme la rue Saint-Denis et la rue Saint-Martin qui passent de part et d’autre du pâté de
maisons où se trouve la Trinité. D’autres sont plus étonnants. La rue du Huleu est une voie
étroite et courte, transversale à la rue Saint Denis, qui abrite entre 1664 et 1675 une dizaine
d’ouvriers travaillant à la Trinité. Rappelons que les portes de l’institution donnent sur la rue
Greneta et la rue Saint-Denis, que la rue Bourg l’abbé débute rue Greneta en face de l’entrée
principale de l’hôpital. On comprend que ce recrutement est des plus curieux. Toutes les voies
citées dans ce tableau n° 2 sont voisines de l’hôpital, distantes de quelques centaines de
mètres tout au plus.
Est-ce bien une politique consciente de l’hôpital ? Faut-il en conclure que la Trinité
favorise en premier lieu les artisans et marchands de son quartier, ou bien que les ouvriers
s’installent dans les environs pour travailler dans les cours à la formation des orphelins ? La
comparaison des adresses déclarées dans les baux établis entre les ouvriers et l’hôpital et
celles inscrites dans les premiers contrats d’apprentissage signés avec des enfants apporte une
réponse. Les années 1672-1675 ont été retenues pour faire le relevé des baux et ensuite du
premier apprentissage confié à chaque maître. La règle veut que le premier engagement
vienne assez vite, entre six mois et un an après l’engagement par bail de l’ouvrier, sinon celui-
ci perd son contrat. Quelques cas chaque année prouvent que l’engagement n’était pas
toujours suivi jusqu’au bout par certains. De plus, l’interruption en 1675 de la collaboration
avec Me Pierre Gary empêche de suivre correctement certains ouvriers baillés. Toutefois les
deux tiers peuvent être suivis à la trace dans Paris.
Tableau n° 3 : Les actes notariés des ouvriers de la Trinité
Années Nb. baux d’engagement
d’ouvriers
Nb. contrats de ces
ouvriers avec un apprenti
1672 24 17
1673 30 26
1674 22 15
1675 24 10
Total 100 68
4 ouvriers sont connus par deux contrats et non un seul dans les 4 années
Tableau n° 4 : Comparaison des domiciles déclarés par les ouvriers lors du bail et lors de leur
premier contrat d’apprentissage avec un enfant bleu.
Déménagement 31
Eloignement 1
Rapprochement, dans les rues avoisinantes 26
Rapprochement, dans une paroisse plus proche 4
Stabilité 39
Même adresse, dans une rue avoisinante 13
Même adresse, dans une paroisse limitrophe 11
Même adresse, dans une paroisse lointaine 15
Ouvriers sans apprentis 32
Total 102
(Deux ouvriers qui ont eu deux apprentis deux années différentes, et ont déménagé ou non
entre les deux apprentissages, sont comptés deux fois.)
Parmi tous les ouvriers repérés, un seul s’est éloigné, quoique cela soit très relatif. Il
s’agit d’un certain Louis Piquefeu, ouvrier vitrier, qui a quitté la rue Saint-Denis pour élire
domicile rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, à quelques rues vers l’ouest de la Trinité45
.
Sinon la grande majorité des hommes concernés a choisi de se rapprocher de la rue Saint-
Denis. Pierre Philibert, teinturier en toile fil laine et soie, habitait rue du faubourg saint
Antoine, paroisse saint Paul, lors de la signature de son bail ; on le retrouve déclarant une
adresse rue Greneta, paroisse saint Sauveur, peu de temps après quand il prit son premier
apprenti46
. Pour Pierre Lefebvre, ouvrier serrurier, le déménagement n’intervint pas
immédiatement. Dans son bail du 18 janvier 1673, mais aussi dans son premier contrat
d’apprentissage, il fît inscrire une adresse dans rue Saint Martin, paroisse Saint-Médéric. En
1674, lorsqu’un deuxième contrat fut passé, il s’était installé au plus près rue Greneta47
. Le
bail incitait, dès le départ, les ouvriers à déménager, en exigeant une présence assidue « sans
intermission ne chomage pour chacun jour ouvrable, audit hôpital ». Pour réduire leur
déplacement professionnel entre leur domicile et la cour de l’hôpital où ils travaillaient, ils
avaient tendance à se trouver un logement le plus près possible de la rue Greneta, soit
immédiatement après leur bail, soit, il faut aussi l’envisager, avant même que celui-ci ne soit
signé.
Au contraire des métiers qui se rassemblaient par rue, au Moyen Âge et ensuite encore
à l’époque moderne, et donnaient ainsi naissance à des quartiers reconnus, l’hôpital de la
Trinité ne crée pas une homogénéité professionnelle dans ses alentours. Le quartier Saint-
45
A.N., M.C., étude LXIX, 416, bail du 24 mai 1672 ; 418, apprentissage du 24 janvier 1673. 46
A.N., M.C., étude LXIX, 417, bail du 24 octobre 1672 ; 418, apprentissage du 25 avril 1673. 47
A.N., M.C., étude LXIX, 418, bail du 18 janvier 1673 ; 419, apprentissage du 28 juin 1673 ; 421,
apprentissage du 26 janvier 1674.
Denis était d’ailleurs une zone très commerçante et sans domination particulière d’une
profession au départ. Les ouvriers du voisinage qui travaillaient pour lui appartenaient à des
métiers très variés. On en compte plus d’une centaine au milieu du XVIIIe siècle48
. Cependant
le statut commun d’ouvriers gagnants maîtrise de l’hôpital, joint à une installation souvent
récente au plus près des portes de l’institution, et à l’usufruit d’un atelier dans le même enclos
pour certains constituaient tout de même une identité de voisinage susceptible d’imprimer sa
marque dans le voisinage. Ces nombreux hommes et quelques femmes, lingères de leur état,
résidaient près de la Trinité au moins le temps de leur bail, mais ensuite ? Il serait intéressant
de savoir s’ils quittaient les lieux une fois leur maîtrise en poche pour laisser la place à
d’autres. De même, on pourrait aussi émettre l’hypothèse que les maisons louées dans les rues
adjacentes de l’hôpital étaient sa propriété et qu’il les mettait à la disposition des ouvriers
venus enseigner aux enfants49
.
Conclusion
L’hôpital ne donne ni un sens, ni un cœur à un vaste portion du territoire urbain dans
les exemples présentés. Il est un des points de repère d’un espace social et urbain dans lequel
il est parfaitement inséré. Il contribue à la vie de quartier en développant des lieux de
rencontre et d’activité, en offrant des services, comme la chapelle et la cour de la Trinité le
prouvent. Cette influence reste cantonnée au voisinage le plus proche et ceci pas seulement
parce que les hôpitaux choisis sont de taille moyenne si l’on compare avec les géants des
hôpitaux généraux. Il n’est pas certain qu’une très grande institution puisse susciter plus de
vie et d’échanges autour d’elle, car très rapidement les relations d’un hôpital se mesurent à
l’échelle de la cité toute entière. Ce qui gêne certainement l’analyse du voisinage et des
relations entretenues par un hôpital, outre le problème des sources, c’est que l’hôpital en tant
qu’institution charitable, ou en tant que communauté de vie de nombreux résidents, ne peut se
limiter à son environnement urbain le plus proche. Il est obligé de le dépasser et de superposer
plusieurs cercles de relations. Celui de son recrutement d’enfants, ou de pensionnaires en
général, dépasse en général le cadre étroit d’une paroisse ou d’un quartier de la ville pour
permettre à tous les Parisiens de profiter de ses secours50
. Celui de l’approvisionnement met
également en jeu des professionnels éloignés, voire non urbains ou des institutions
spécialisées, comme la maison de Scipion qui fournit en viande toutes les succursales de
l’Hôpital-Général de Paris et, ce faisant, les Enfants-Rouges et le Saint-Esprit après leur
réunion à celui-ci en 1680. Celui des généreux donateurs, des administrateurs aussi ne peut
s’en tenir aux alentours.
48
B.N. Joly de Fleury 1249, folio 263-270 état le 23 mai 1742, folio 272-273 état le 1er
janvier 1751. En 1665,
on comptait déjà 32 métiers autorisés (arrêt du parlement du 13 juin 1665 dans Reglemens, statuts, privilèges, op.
cit., 1682, p. 92 et suiv.). 49
Il faudrait vérifier auprès du centre d’étude de la topographie parisienne au CARAN actuellement fermé. 50
On a vu au XVIIIe siècle des tentatives pour créer des hôpitaux de quartier, ainsi pour rester dans les secours
donnés aux orphelins, l’hospice de M. Beaujon fondé en 1783 réserve en priorité ses vingt-quatre places aux
orphelins de la paroisse du Roule. I. Robin-Romero, Les établissements pour orphelins à Paris, XVIe-XVIIIe
siècles, doctorat, université de Paris IV, 1997, 2 volumes.
Annexe 1. Localisation des quatre hôpitaux pour orphelins à Paris au début du XVIIe
siècle (carte établie à partir de celle de J. Depauw dans Spiritualité et pauvreté à Paris au
XVIIe siècle, La Boutique de l’Histoire, 1999, p. 312)
Annexe 2 : Plan général de l’hôpital de la sainte Trinité établi par M. Gobin en 1766.
(Musée de l’Assistance Publique, tiré des fonds de s Archives de l’Assistance Publique)



















![[2012] « La cour de France, fabrique de normes vestimentaires à l’époque moderne »](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631cac175a0be56b6e0e50f9/2012-la-cour-de-france-fabrique-de-normes-vestimentaires-a-lepoque-moderne.jpg)