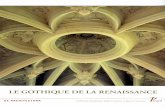Colloque Tunis
Transcript of Colloque Tunis
1
Titre « Politique budgétaire et croissance : Référence au cas d’un pays rentier ». Toufik HAMDAD, Maitre assistant, Doctorant, Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion, Université Tizi-Ouzou, Algérie.
Résumé : L’objectif de cette contribution est de montrer, à travers la conduite de la politique
budgétaire en Algérie, les grandes orientations et les moyens mis en place pour sa
concrétisation en vue de mesurer son impact sur la croissance économique. Nous tacherons
une importance particulière à la période allant de 1990 à 2010.
Le débat théorique autour des effets des dépenses publiques et de la fiscalité sur la
production constitue sans doute un des sujet de controverse entre grandes écoles : les
keynésiens et post keynésiens qui insistent sur les effets de relance d’une intervention de
l’Etat par l’instrument budgétaire notamment en phase de récession économique. la remise en
cause des vertus des idées keynésiennes fut par les monétaristes, sous l’égide de Friedman M.
et puis par Lucas. Les principaux arguments développés consistent en l’ « équivalence
ricardienne » formulée par Barro R. montrant la neutralité de la politique budgétaire. En effet,
l’emprunt d’aujourd’hui est synonyme des impôts futurs, la rationalité des agents les mènent à
prendre des précautions pour faire face aux remboursements des emprunts par la fiscalité. Un
autre courant plus radical, développe la « Théorie antikeynésienne des finances publiques,
montre que la politique budgétaire n’est pas seulement neutre, mais anticyclique.
Sur le plan empirique, beaucoup d’études ont été menées. Certaines concernent des
échantillons de pays, notamment suite au développement par Barro de la méthodologie
d’analyses transversales sur des bases de données macroéconomiques internationales, d’autres
contributions sont orientées vers l’analyse de cas.
Beaucoup d’études testent l’influence de plus en plus de facteurs sur la croissance
économique , education, infrastructure, capital humain… à ce sujet, Sala-i-Martin intitule un
de ses papiers « I just ran two million regressions ».
En effet, si la décennie 2000-2010 est caractérisée par l’ampleur des dépenses
budgétaires engagées à travers les plans de relance économiques successifs mis en place, la
décennie qui l’a précédée était plutôt marquée par une austérité budgétaire du fait du plan
d’ajustement structurel mis en place.
En Algérie, ces dépenses publiques ne sont plus financées par l’emprunt ni par la
fiscalité ordinaire mais plutôt par la fiscalité pétrolière budgétisée et le concours du Fonds de
2
régulation des recettes créé en 2000, pour stabiliser les recettes de la fiscalité pétrolière
budgétisée.
La succession de plans initiés suite à la flambée des prix de pétrole sur les marchés
internationaux de matières premières, nous amène à formuler l’hypothèse selon laquelle, ces
plans n’ont pas réussi à enclencher la dynamique souhaitée de l’activité économique.
L’absence de véritable « compte rendu » établi par les institutions indépendantes1, notamment
les organes de contrôle budgétaires a priori nous analysons les données communiquées par la
Direction de la prévision du ministère des finances. Le traitement des données porte tant sur
les prévisions budgétaires que sur les réalisations. Une telle analyse permet de rendre compte
des objectifs arrêtés par la politique économique et de montrer les états consommations des
budgets et de recouvrements des recettes.
Question principale
Pourquoi la politique budgétaire menée en Algérie depuis 2000 n’arrive-t-elle pas à
assurer une croissance économique consolidée indépendante du secteur des hydrocarbures ?
Introduction
La plupart des analyses théoriques traitant de l’efficacité des politiques budgétaires et
de leurs répercutions sur les économies des pays qui les adoptent ne prennent pas en
considération le financement par les ressources naturelles des dépenses engagées. D’une part,
ces études donnent un rôle premier aux dépenses, à leur ampleur, à leur structure et à
l’importance des déficits qui se manifestent. D’autre part, les financements sont supposés être
assurés par une fiscalité présente et/ ou future lorsqu’il s’agit de faire recours à l’emprunt
public.
Ainsi, Auty R. (2007) mentionne que les modèles de la croissance économique
néoclassiques sont limités du fait qu’ils ne prennent pas en considération le capital naturel
(Sachs et Warner, 1995) et le capital social (Acemoglu et al., 2002). Ces deux facteurs
contribuent fortement à différencier les pays sur le plan de la croissance économique2.
Ce constat nous pousse à poser des questions fondamentales :
D’abord, peut-on parler de politique budgétaire dans un « pays rentier », dès lors que le
financement déroge à l’impôt ordinaire et à l’emprunt ?
Ensuite, la volatilité des prix du pétrole sur les marchés internationaux rend la gestion des
recettes pétrolières délicate. Ce constat avait amené la plupart des pays exportateurs du 1 En Algérie, la loi de règlement budgétaire, n’est pas établie par la cour des comptes, conformément à la loi cadre des lois de finances. 2 Auty R. (2007), « Natural resources, capital accumulation and the resource curse », Ecological economics, Elsevier, N° 61, P. 628.
3
pétrole à se doter de fonds pétroliers notamment de stabilisation pour faire face à certains
chocs. De ce fait, il y a lieu de mentionner que la gestion des recettes pétrolières n’est pas
aisée, notamment, lorsqu’il s’agit d’effectuer un arbitrage entre des objectifs de stabilisation
immédiate et altruisme intergénérationnel. Dans ce sillage, une question mérité d’être posée :
comment les pays déterminent-ils le prix de référence du pétrole ? Autrement dit, quel est le
niveau de recettes à consommer et quel est le niveau de ces revenus à épargner et/ ou à
investir ?
Enfin, l’Algérie est l’un des pays qui à récemment mis en place un « Fonds de régulation des
recettes ». Quel en est le contexte de sa mise en place et quels sont les principaux objectifs qui
lui ont été assignés ? Quels sont les mécanismes de son fonctionnement ?
1- Défis de la politique budgétaire dans les pays exportateurs des hydrocarbures
1-2- La dépendance énergétique
La dépendance énergétique3 touche aussi bien les pays importateurs (caractérisés par
des économies fortement industrialisées et par de très hauts niveaux de revenus et pour
lesquelles les hydrocarbures constituent un input incontournable) que les pays exportateurs
(principalement en développement si l’on excepte la Russie et la Norvège) et dont les revenus
sont pour la plupart intermédiaires4. Toutefois, il demeure entendu que la dépendance des
pays exportateurs des hydrocarbures est plus ancrée que celle des pays importateurs. En effet,
selon le Fonds monétaire international, la flambée des prix de pétrole caractérisant la période
2002-2005, s’est soldée par une augmentation de seulement 1,24% du PIB mondial, alors que
les exportations des hydrocarbures se sont accrues de 33,2%5.
A cette dépendance se greffe un problème majeur que les pays exportateurs doivent
prendre au sérieux. Ce problème, découlant du caractère même de la ressource exploitée, est
désigné sous le vocable de « crise de l’énergie »6 qui désigne la raréfaction des gisements du
pétrole. Les politiques de production de pétrole conduisent à l’épuisement des ressources7. En
effet, les pays africains producteurs du pétrole possèdent 10% des réserves mondiales et
exportent 12% des exportations totales mondiales d’hydrocarbures. En effet, ce rythme
d’exportation plus élevé désigne une surexploitation des gisements par ces pays et fait, par
3 Parmi les indicateurs utilisés pour montrer cette dépendance, « le déficit fiscal non pétrolier » désignant la part des dépenses budgétaires payée par les revenus pétroliers plutôt que par des revenus non pétroliers. Voir Mitchell J. et Rochefort D. (2006), « L’autre face de la dépendance énergétique », Politique étrangère, 2006/2, Eté, P.265. 4 Selon la classification de la Banque mondiale base sur le critère du PNB/habitant 5 FMI, World Economic Outlook, Avril 2006, Chapitre 2, Tableau 2.1 6 Werrebrouk J.C. (1979), « Contribution à la théorie de la rente pétrolière », Revue d’économie industrielle, Vol. 9, 3ème trim., P. 118. 7 Mitchell J. et Rochefort D. (2006), « L’autre face de la dépendance énergétique », Politique étrangère, 2006/2, Eté, P.260.
4
voie de conséquence, chuter la durée moyenne des réserves estimée à seulement une trentaine
d’années. Soit, une durée inférieure de 10 ans à la moyenne mondiale estimée à 40 ans8.
En Algérie, ces proportions sont encore plus graves. En effet, sa part de la production
de pétrole représente 2% de la production mondiale alors que les réserves prouvées ne
représentent que 0,9 % des réserves totales mondiales prouvées9.
La théorie du « syndrome hollandais » montre les effets macroéconomiques négatifs d’un
boom du secteur pétrolier : « substitution des importations à la production de biens de
consommation, volatilité des recettes fiscales, faible intégration de cette industrie dans le reste
de l’économie et impacts négatifs des revenus tirés de l’exploitation pétrolière sur la qualité
de la gouvernance et des institutions »10
Beaucoup d’études empiriques montrent que les pays dotés d’importantes ressources
naturelles affichent un certain retard en termes du rythme de croissance économique réelle à
long terme. Une des analyses menée sur une quinzaine de pays exportateurs des
hydrocarbures pour la période allant de 1960 à 200011, montre que ces pays avaient enregistré
un taux de croissance moyen bas comparativement aux pays en développement et aux pays
non exportateurs d’hydrocarbures (Phénomène attribué au « Deutch disease » ou au
« Paradoxe de l’abondance »). Toutefois, l’auteur montre que pour la décennie 1970 (marquée
par une augmentation marquée des prix de pétrole suite aux deux « chocs pétroliers »), les
taux de croissance enregistrés par ces pays exportateurs de pétrole, sont en moyenne plus
élevés que ceux des économies en développement.
Les mêmes conclusions sanctionnent une analyse portant sur une période- plus récente- allant
de 1981 à 2007. Cette dernière montre que le taux moyen de croissance économique des pays
exportateurs d’hydrocarbures est de 2,6 % par an alors que ce taux est de 4,2% pour les
économies émergentes12.
Une des explications les plus solides de « la malédiction des ressources » est celle qui
repose sur des approches d’économie politique qui recherche comment la richesse en
ressources naturelles peut influencer de manière négative les politiques économiques et être à
l’origine d’échecs politiques et institutionnels13.
8 Gacem B. (2007), « La rente pétrolière en Afrique : Bénédiction ou malédiction ? », Finance & bien commun, De Boeck Université, 2007/3, N° 28-29, P. 115. 9 BP statistical review of world energy, Juin 2011, P. 6-8 10 Massayeau B. et Dorbeau-Falchier D. (2005), « Gouvernance pétrolière au Tchad : La loi de gestion des revenus pétroliers », Afrique contemporaine, De Boeck Université, N° 216, 2005/4, P.140. 11 El Anshasy A., « Oil prices and economic growth in Oil exporting countries », Collage of business and economics, United Arab Emirates University, P.1 12 Strum M. et al. (2009), « Fiscal policy challenges in oil-exporting countries: A review of key issues », European central Bank, Occasional paper series, N° 104, June, P.9. 13 Tompson W. (2007), « Un Venezuela du froid ? La « malédiction des ressources » et la politique russe », Politique étrangère, 2007/5, Hors série, P. 114.
5
Les conclusions des analyses portant sur des données concernant un échantillon de
pays, révèlent les tendances générales qu’il convient parfois de prendre avec prudence, de
détecter les données qui influencent la tendance, ou bien tout simplement à montrer quelques
différences significatives entre les pays. En effet, si les ressources de la rente sont corrélées à
la croissance, El Anshasy A.14, montre en effet que des différences significatives existent
entre les pays. Ces dernières s’expliquent par la manière avec laquelle les gouvernements
consomment leurs surplus pétroliers et la manière avec laquelle ils ajustent leurs dépenses en
périodes de chute des prix.
1-2- Les défis de la politique budgétaire dans les pays exportateurs des hydrocarbures
Dans les pays exportateurs des hydrocarbures, la politique budgétaire se heurte à
plusieurs défis spécifiques liés principalement aux caractéristiques des ressources servant le
financement des dépenses budgétaires et à leur poids dans l’économie.
En effet, les revenus des hydrocarbures constituent les principales ressources des Etats
dans la plupart des pays. Ces ressources sont par ailleurs épuisables, volatiles, incertaines et
largement dépendantes de la demande externe. Ce sont ces caractéristiques qui posent les
défis majeurs dans les horizons temporels du long terme ou du court terme. A long terme, les
défis se posent en termes d’équité intergénérationnelle et de soutenabilité budgétaire15. Tandis
qu’à court terme, les défis à relever concernent la stabilisation macroéconomique et la
planification budgétaire.
2-1-1- Les défis de stabilisation : conciliation d’objectifs contradictoires à court terme
En période de boum, comme c’est le cas pour la décennie 200016, des effets
macroéconomiques favorables sont enregistrés en termes de croissance économique prospère,
des excédents budgétaires et des paiements courants. Toutefois, si dans les décennies
précédentes, les pays exportateurs avaient enregistré une faible inflation, comparativement
aux pays émergents, et des pays en développement en général17, la hausse des pressions
inflationnistes est apparue comme un défi croissant dans la plupart des pays exportateurs des
hydrocarbures durant cette période de boom.
14 El Anshasy A., « Oil prices and economic growth in Oil exporting countries », Collage of business and economics, United Arab Emirates University, P.16. 15 Le cas de la Norvège peut être cité comme exemple. En effet, l’épuisement des ressources à l’horizon 2025, pose le problème de financement des retraites et de la difficulté de la soutenabilité des finances publiques, bien que ce pays dispose d’un fonds souverain des plus transparents et des plus importants. Voir à ce sujet, l’étude de l’OCDE, 16 Même si les prix avait connu une baisse très significative sous l’effet de la crise financière des subprimes à la mi-2008, les cours de pétrole ont repris, par la suite, leur mouvement d’ascension. 17 Strum M. et al. (2009), « Fiscal policy challenges in Oil exporting countries: A review of key issues », European Central Bank, Occasional paper series, N° 104, June, P.14.
6
La plupart des pays exportateurs, face à cette situation avaient utilisé une partie des
excédents budgétaires pour mener des politiques budgétaires expansionnistes. Or contenir
l’inflation nécessite des politiques économiques (monétaire et budgétaire) plutôt restrictives.
Les explications de cette orientation de politique économique trouvent leur fondement dans :
les pressions pour redistribuer immédiatement les revenus des recettes des hydrocarbures à la
population (consciente de la conjoncture prospère) ; les besoins de dépenses liées au
développement (dépenses en infrastructures) et enfin les considérations internationales qui
font que les revenus pétroliers sont recyclés dans un contexte de déséquilibre global.
2-1-2- Les défis à long terme
A long terme, les restrictions budgétaires et l’accumulation des actifs financiers ; c'est-
à-dire, l’épargne des excédents de revenus, peut constituer une garantie pour une soutenabilité
budgétaire et une équité intergénérationnelle, alors que la conduite de la diversification de
l’économie dans beaucoup de pays requiert des investissements publics en infrastructure et en
éducation, par exemple.
Une des voies possibles dans un contexte de hausse des prix des hydrocarbures étant
l’amélioration de la structure des dépenses publiques (en privilégiant les dépenses
d’investissement et en contenant les dépenses courantes). Par ailleurs le rééquilibrage de la
politique mix-macroéconomique par le resserrement de la politique monétaire dans les
moments de croissance économique prospère peut aider à éviter la surcharge de la politique
budgétaire par des objectifs contradictoires.
Ceci requiert la modification des régimes de taux de changes prédominants par l’adoption de
régimes de change flexibles. La plupart des pays exportateurs sont confronté à la volatilité et
au « Dutch Disease » qui incitent les autorités monétaires à l’adoption de régimes de change
plus flexibles, en particulier du fait de la cotation du prix de pétrole en dollar américain18.
2- problématique de la gestion des recettes pétrolières
2-1- la création des fonds d’épargne et de stabilisation
Les réponses institutionnelles pour les défis spécifiques pour la politique budgétaire
dans les pays exportateurs de pétrole entrainent la fixation des budgets sur la base des prix de
pétrole prévisionnels prudentiels et plus récemment, l’établissement des fonds de stabilisation
et d’épargne explique dans peu de cas les règles fiscales. Lorsque chaqu’une des réponses a
ses mérites et ses inconvénients. Aucune n’est la solution pour redresser les défis à court
18 L’appréciation des taux de change réel des économies exportatrices peut être expliquée par une dépréciation de la valeur du dollar (monnaie de facturation des exportations du pétrole) du fait des de la balance des transactions courantes américaine lourdement déficitaire.
7
terme et à long terme. Elles peuvent être des outils qui aident, mais les effets désirés ne
peuvent être réalisés que si la qualité des institutions de l’Etat et le niveau de gouvernance en
général conduisent à la responsabilisation de la conduite budgétaire.
En raison de l’irrégularité frappant les revenus des exportations du pétrole, les pays
exportateurs des hydrocarbures avaient profité des périodes de boom19 pour créer des fonds
dans le but de promouvoir l’efficacité de la politique budgétaire par :
- une offre de protection, contre la volatilité des prix des hydrocarbures, par
l’encouragement de l’épargne dans les périodes de boom.
- La stabilisation des dépenses publiques en assurant leur conduite en fonction des
objectifs de moyen terme définis au lieu des disponibilités de revenus à court terme.
- L’investissement des surplus accumulés pour concilier les besoins des générations
futures.
Les stratégies des pays divergent en termes de gestion de surplus pétroliers. Si la Norvège, le
Koweït et Abu Dhabi ont mené une politique d’investissement à l’étranger, l’Algérie, l’Iran et
le Venezuela ont plutôt opté pour la création de fonds de réserves.
La faible croissance durant la décennie 1980-1990 (soit après le second choc pétrolier de
1979), montre à quel point la volatilité des prix des hydrocarbures pouvait influencer la
croissance économique. En effet, la raison de la récession observée en Algérie pour cette
période était la combinaison de deux facteurs : d’une part la forte croissance démographique
et d’autre part la chute des prix des hydrocarbures. La poussée démographique avait poussé
l’Algérie à adopter un programme de maîtrise de la croissance démographique en 1983 ;
programme dit de « planification familiale » qui repose principalement sur l’espacement des
naissances. L’indice de fécondité passe dès lors de 7,1% en 1980 à 4,61% en 199020. De leur
côté, les prix des hydrocarbures avaient connu un rebondissement au début de la décennie
1990 suite à l’invasion du Koweït par l’Irak. D’autres événements impactent la croissance
économique dans les pays principalement exportateurs des hydrocarbures21. En effets les
crises financières successives impactent négativement la sphère économique réelle et
entraînent un ralentissement de la croissance économique mondiale. Par conséquent la faible
demande de l’énergie fait baisser les prix de ces inputs sur les marchés internationaux des 19 Principalement, deux vagues principales de création de fonds peuvent être distingués, ceux apparu suite aux chocs pétroliers, dans une optique plutôt d’épargne, et ceux créés au début de la décennie 2000 avec une orientation vers l’objectif de stabilisation. 20 Hemal A. et Haffad T. (1999), « La transition de la fécondité et politique de population en Algérie », Revue sciences humaines, N° 12, Université Mentouri, Constantine, P. 65. 21 L’Algérie figure parmi les dix pays pour lesquels les exportations d’hydrocarbures comptent pour plus de 40% du total des exportations. Ces pays sont : Algérie, Iran, Koweït, Lybie, Nigeria, Norvège, Russie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unies, Venezuela.
8
matières premières. Les crises asiatique en 1998, a fait chuté le prix de pétrole au deçà de la
barre des dix dollars le baril. Plus récemment, la crise des subprimes a mis une fin au cycle de
croissance des prix de pétrole entamé depuis le début de la décennie 2000, sous l’effet de la
forte croissance enregistrée par la Chine22.
2-2- Fiscalité budgétée et problème de fixation du prix de référence
Une des réponses institutionnelles23 à la volatilité des prix des hydrocarbures consiste
en la formulation de prévisions prudentielles des prix des hydrocarbures. Cette solution
comporte désormais certains avantages mais aussi des inconvénients.
En effet, l’avantage de cette pratique réside dans le fait qu’une sous évaluation des
prix prévisionnels du pétrole (servant de base pour la projection des engagements budgétaires)
constitue un signe de prudence budgétaire. Elle est motivée le plus souvent par des
considérations de d’économie politique. Budgétiser sur la base des prix des hydrocarbures
aide à contenir les dépenses et faire apparaitre de faibles excédents budgétaires, ce qui atténue
les pressions de dépenses pour les autorités.
L’inconvénient majeur de cette pratique réside dans le fait que les prévisions
prudentielles réduisent la transparence et accroissent la marge de manœuvre des pouvoirs
exécutifs. En fait les gouvernements ont souvent infligé une grande discrétion quant à
l’utilisation des surplus des hydrocarbures.
En Algérie, la fixation du prix de référence se fait une fois tous les dix ans. Le prix
adopté est arrêté sur la base de la moyenne arithmétique simple des prix enregistrés durant la
décennie écoulée. Ainsi, pour la période 1998 jusqu'à 2007, le prix de référence servant de
base pour l’élaboration du budget de l’Etat ainsi que des objectifs des lois de finances était 19
dollars le baril. Ce prix a été révisé par les dispositions de la loi de finances complémentaire
de 2007. Pour 2008, le budget étant établi sur la base de 37 dollars le baril du pétrole. Soit le
prix moyen effectif nominal enregistré durant la décennie 1998-2007.
Pour la décennie 1998-2007, il apparait que les objectifs des lois de finances étaient
sous estimés du fait que les prix de pétrole moyen représente presque le double du prix
prévisionnels sur lesquels ces budgets ont été arrêtés.
Les prix moyens enregistrés durant cette période sont donnés dans le tableau ci-dessous :
22 La Chine est le deuxième pays consommateur de l’énergie après les Etats Unies d’Amérique. En 2010, sa part dans la consommation mondiale du pétrole représente 10,6%, selon les statistiques de British petroleum, voir « BP statistical review of world energy », juin 2011, P.9. 23 En plus de la prudence dans la fixation des prix de référence, les pays exportateurs d’hydrocarbures ont créé des fonds de stabilisation et/ou d’épargne et la plupart des pays ont instauré des règles budgétaires plus au moins strictes. Voir occasional paper series N° 104, juin 2009, European central Bank, op.cit, P.42.
9
Tableau N° : Evolution du prix moyen du pétrole pour la période 1988-1997
Année 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Moy
Prix
moyen
14.92 18.23 23.73 20.00 19.32 16.97 15.82 17.02 20.67 19.09 18.58
Source : Brent dated statistiques publiées sur le site internet de British Petroleum
Au courant de cette décennie, l’évolution des cours du pétrole nominaux a connu trois
phases : entre 1988 et 1990, les cours ont passé de 14,92 dollars le baril au niveau record
enregistré durant la décennie soit 23,73 $, soit une augmentation d’à peu près 60%. De 1991 à
1994, les prix avaient chuté passant de 20 $ à seulement 15,82 $ le baril. Ces chutes de prix
accentuaient les tensions de l’austérité budgétaire dictée par le Plan d’ajustement structurel. A
partir de 1995, les prix avaient connu une reprise avant de finir avec une légère baisse en 1997
(conséquences de la crise financière asiatique et du ralentissement de la croissance
économique mondiale).
Tableau N° : Evolution du prix du pétrole pour la période 1998-2007
Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Moy
Prix
moyen
12.72 17.97 28.50 24.44 25.02 28.83 38.27 54.52 65.14 72.39 36.78
Source : Brent dated, statistiques disponibles sur le site internet de British Petrolium
Excepté les années 1998 et 1999, où les prix de baril étaient inférieurs aux prévisions,
les prix avaient connu une accélération à partir de 2000 avec un léger ralentissement en 2001
et 2002. Entre 1998 et 2007, les prix ont passé de 12.72 $ à 72.39 $ le baril soit une
augmentation de 560 %. Cette envolée des prix s’explique par la demande croissante de
l’énergie de la Chine.
L’Algérie constitue en fait l’un des pays pour lesquels la politique de prévision est très
prudentielle mais aussi la règle budgétaire appliquée pour la détermination des prix
prévisionnels est rigide puisqu’elle ne change qu’au bout d’une décennie.
Le tableau ci après montre les prix de référence adoptés par quatre pays exportateurs
des hydrocarbures pour deux années 2008 et 2009 montrant ainsi la réaction des autorités
quant à la chute drastique des prix de pétrole24 suite à la crise financière des subprimes et la
récession économique conséquente.
Tableau N° : Prix de référence du baril de pétrole
24 Les prix de pétrole avaient chuté d’environ 30% selon……entre …. Et…..
10
Algérie Nigéria Russie Arabie Saoudite
2008 37 $ 59 $ 74 $ 50 $
2009 37 $ 45 $ 41 $ 45 $
Source : D’après « occasional paper series », BCE, op.cit. P.46
D’après ce tableau, il apparait que la Russie mène la politique la moins prudentielle parmi ces
pays, ces prévisions en période de boom avaient atteint le seuil des 95 $ par baril avant d’être
revues à la baisse en 2009 à 41 $.
3- Le Fonds de régulation des recettes (FRR) principal instrument de la politique budgétaire
Le Fonds de régulation des recettes est créé en 200025 dans le but de :
- restaurer le matelas des actifs externes, qui avaient précédemment chutés ;
- entretenir le stock de la dette publique ;
- lisser le profil des dépenses à long terme ;
Le Fonds de régulation des recettes est un sous compte de l’Etat auprès de la Banque
d’Algérie. C’est un compte en Dinars qui agit comme un compte de stabilisation. Il n a pas un
objectif explicite de transfert intergénérationnel. Depuis 2004, ses ressources sont divisées en
une petite part « liquide » et une large gamme de sécurités des revenus fixés. Les bénéfices
sur réserves sont, en fin de compte, transférés au budget sous forme de dividendes de la
Banque centrale. Les caractéristiques opérationnelles du Fonds laissent une marge de
discrétion considérable. Les actifs sont utilisés pour financer les investissements
d’infrastructure intérieurs, étant le besoin important des infrastructures incluant les logements
sociaux, mais aussi le financement des subventions accordées26 pour les biens de base afin de
protéger les consommateurs des prix élevés sur les marchés internationaux. Les revenus
excédant les prévisions sont déposés dans le Fonds pour lequel le solde a atteint près de 50
milliards de dollars à la fin 200727 et à peu près 65 milliard de dollars28.
Dans ce point, un intérêt est porté sur les répercussions sur la gestion des finances
publiques et la conduite de la politique budgétaire ainsi que la transformation de ses objectifs
induits par la mise en place du Fonds de régulation des recettes en 2000.
3-1- contexte de création
Le contexte de la création du Fonds de régulation est marqué par l’envolée du prix de
l’énergie sur les marchés internationaux (grâce à l’importante demande d’énergie induite par
l’affirmation de nouvelles puissances économiques dans le monde tels que la Chine et le
25 Loi de finances complémentaire, JORADP, N° du portant…..P. 26 Mouhoubi S. (2011), affirme que 30% de la rente pétrolière vont aux subventions, Revue l’Eco, N° 31, Octobre 2011, P. 28. 27 Strum et al. (2009) op.cit., P.44 28 Nos calculs d’après les données de la DGPP et de la Banque d’Algérie.
11
Brésil) mais aussi en raison de la deuxième invasion d’Irak. Cette conjoncture a permis la
capitalisation d’importantes ressources dans le Fonds de régulation dont la mission originelle
était le lissage des dépenses publiques et faire ainsi face à la procyclicité de la politique
budgétaire qui est principalement axée sur la fiscalité pétrolière.
Il faut dire que les difficultés budgétaires auxquelles caractérisant la fin de la décennie
1990 avec la chute considérable du prix de pétrole en 199829 suite à la crise asiatique
constitue sans doute un mobile pour la création des fonds pétroliers dans beaucoup de pays30.
En Algérie, les bouleversements entrainés par le « contre choc pétrolier » de 1986, qui s’est
soldé par un Plan d’ajustement structurel31, corollaire d’une austérité budgétaire dans le but de
stabilisation macroéconomique qui avait marqué le début de la décennie 1990 accentuant ainsi
la dépendance de l’économie envers les créanciers extérieurs. Vers la fin de cette décennie, le
ralentissement de la croissance économique mondiale, suite aux difficultés financières et
économiques des pays Sud asiatiques, confirme la fragilisation de l’économie algérienne.
3-2- Financement des déficits budgétaires par le FRR
Face à la demande mondiale de l’énergie (montée de nouvelles puissances) et au
rétrécissement de l’offre (politiques de quotas de l’OPEP mais aussi invasion de l’Irak32), et
avec la mise en place du Fonds de régulation des recettes, s’est substitué à une politique
d’austérité budgétaire une politique budgétaire expansionniste qui s’est matérialisé
principalement par la mise en place de trois plans de relance économique successifs.
Désormais, l’ampleur des plans de relance et face aux prévisions prudentielles du prix
du baril lors de l’élaboration des budgets de l’Etat, a vite (au bout de six années de
fonctionnement du Fonds de régulation des recettes) amener les pouvoirs publics à utiliser les
ressources du Fonds pour le financement des déficits budgétaires et du Trésor public.
A partir de 2008, et face aux demandes sociales, il y a une révision du prix
prévisionnel du baril servant à l’élaboration du budget de l’Etat.
29 En 1998, le prix moyen du baril de pétrole n’était que de 12,72 $ contre 19,09$ en 1997 soit une baisse d’un tiers selon les données de British petroleum. 30 Venezuela, Qatar, Kazakhstan, Azerbaïdjan et Algérie ont tous procédé à la création de Fonds pétroliers. C’est peut être l a deuxième génération de fonds après ceux créés principalement suite aux chocs pétroliers des années 1970. La plupart de ces fonds ont affichés des objectifs plutôt de stabilisation (face à la fréquente récurrence des crises), alors que la première génération de fonds sont créés dans des optiques d’épargne. 31 Le PAS, inspirés du courant théorique dominant de la Théorie anti keynésienne des finances publiques (voir chapitre 1 supra) est axé autour de trois éléments : austérité budgétaire, privatisations et libéralisation économique. 32 A la fin des années 1990, l’Irak compte à peu près 10% des réserves de pétrole mondiales prouvées.
12
Graphique N° Evolution des soldes budgétaires primaires prévisionnels depuis 1990
Déficits
-4000
-3500
-3000
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
100019
90
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Déficits
Source : D’après les lois de finances initiales et complémentaires
L’évolution des recettes et des dépenses budgétaires entraine un impact sur le déficit
et/ ou excèdent budgétaire. Le graphique montre que pour toute la décénnie 1990, les soldes
budgétaires prévisionnels étaient excédentaires. Au début de la décennie 1990, les excèdents
budgétaires représentaient près de 40% des dépenses prévisionnelles et près de 30 % des
recettes prévisionnelles inscrites aux budgets de l’Etat. Ces proportions s’expliquent par
l’austérité engendrée par le Plan d’ajustement structurel qui vise la compression des dépenses
budgétaires. Vers la fin de la décénnie 1990, une certaine stabilité des finances publiques a été
retrouvée. Ces proportions ont été ramenés à environ 10%. La décennie 2000, quant à elle, a
été marqué, d’une part par, par des soldes budgétaires prévisionnels très imprtants, comme le
montre le graphique avec l’écartement significatif des deux courbes et d’autre part, par le
signe du solde budgétaire qui apparait dans le graphique par le recoupement des deux courbes.
En termes relatifs, les excédents budgétaires enregistrés pour la période 2000-2002,
représentaient à peu près 30% des dépenses budgétaires et plus de 20% des recettes
budgétaires prévisionnelles. Cette situation peut s’expliquer soit par une sous estimation des
dépenses budgétaires soit par une surestimation des recettes. A partir de 2003, il y a eu un
retournement de situation. En effet, les soldes budgétaires prévisionnels sont plutôt
déficitaires. Une aggravation considérable des déficits budgétaires est obsérvée à compter de
2006. Ces derniers passent alors de 315 milliards de dinars en 2005 à 3626 milliards de
dinars en 2011. à compter de 2006, les déficits budgétaires prévisionnels représentent plus de
13
40 % des dépenses budgétaires prévisionnelles (ils dépassent parfois les 50%). Ces déficits
rapportés aux recettes budgétaires prévisionnelles dépassent souvents les 100%.
L’analyse de ces seuls chiffres, peut nous amener à un raisonnement de type keynésien
envisageant ainsi une relance économique par le levier des dépenses publiques. Or, la
spécificité de l’économie algérienne consiste justement en le caractère « exceptionnel » d’une
part importante de ces recttes budgétaires, tirées du produit de la fiscalité pétrolière. De ce
fait, il y a lieu de mentionner que c’est grace au Fonds de régulation des recettes crée en 2000
que ces déficits sont comblés.
Graphique N° :
Emplois du FRR
25%
6%
24%
45% DETTE PUBLIQUE
AVANCE BADEFICIT TRES
RELIQUAT
Source : D’après les données de la DGPP
Le graphique montre que près de la moitié des ressources cumulées du Fonds de
régulation des recettes est utilisée pour le remboursement de la dette publique et le
financement des déficits du Trésor publique. Le Fonds n’a épargné que 45% des reliquats de
la fiscalité pétrolière. En l’espace de cinq ans (de 2006 à 2010), près d’un quart des recettes
du Fonds avaient servi à la résorption des déficits du Trésor public.
3-3- Le poids des déficits budgétaires prévisionnels dans le PIB
Un des indicateurs utilisés souvent pour exprimer le poids de la politique budgétaire
d’une économie est le solde budgétaire rapporté au PIB. En Algérie, et dans les principales
économies exportatrices d’hydrocarbures, un autre indicateur peut également etre calculé. Il
s’agit du ratio Solde budgétaire/PIB hors hydrocarbures.
Tableau N° : Ampleur des déficits budgétaires prévisionnels
14
Années
Solde
budgétaire
prévisionnel PIB
Solde
budg/PIB PIB HH
PIBHH
/PIB
Solde
budg/PIB
HH
2000 360,6 4123,5 8,74% 2507,2 60,80% 14,38% 2001 455 4227,1 10,76% 2783,8 65,86% 16,34% 2002 446,9 4522,8 9,88% 3045,7 67,34% 14,67% 2003 -333 5252,3 -6,34% 3383,4 64,42% -9,84% 2004 -392 6149,1 -6,37% 3829,3 62,27% -10,24% 2005 -315 7562 -4,17% 4209,1 55,66% -7,48% 2006 -1862 8514,8 -21,87% 4632,6 54,41% -40,19% 2007 -2116 9366,6 -22,59% 5277,3 56,34% -40,10% 2008 -2119 11090 -19,11% 6092,5 54,94% -34,78% 2009 -2296 10034,3 -22,88% 6925,2 69,02% -33,15% 2010 -2779 12049,5 -23,06% 7869,1 65,31% -35,32%
Sources: Lois de finances et données de la DGPP
Le tableau ci-dessus montre l’évolution de deux indicateurs prévisionnels exprimant
l’objectif de la politique budgétaire. Nous pouvons tirer ces quelques conclusions de l’analyse
de ce tableau :
- Le PIB nominal a presque triplé entre 2000 et 2010 passant de 4123,5 Milliards de DA
à 12049 milliards de DA. Le PIB hors hydrocarbures à plus que triplé durant la même
période.
a- Le ratio Solde budgétaire/PIB a évolué d'une manière significative pour la période considérée,
En effet, la période 2000-2002 a connue des excédents budgétaires prévisionnels, avoisinant les 10
% du PIB, sous l’effet de la sous estimation des dépenses budgétaires. A partir de 2003, les soldes
budgétaires prévisionnels sont désormais déficitaires. Nous distinguons:
- La période 2003-2005 dont les déficits budgétaires prévisionnels sont
modérés (entre 4 et 7 % du PIB)33.
- La période 2006-2010 qui a connu des déficits budgétaires prévisionnels plus
importants (dépassant les 20% du PIB), sans doute, pour répondre aux besoins
de financement des grands chantiers publics mais aussi des dépenses de
fonctionnements qui avaient connu des hausses spectaculaires en raison des
33 Selon les critères de Maastricht, les pays membres de l’Union européenne doivent avoir un déficit ≤ 3% du PIB et une dette publique ≤ 60% du PIB.
15
augmentations de salaires et des multiples transferts (subventions et
dégrèvements…).
b- Le ratio solde budgétaire/PIB HH : Hors activités hydrocarbures, les déficits budgétaires sont
plus conséquents, ils ont dépassé les seuils de 40 % du PIB pour les exercices 2006 et 2007.
Des efforts importants ont été déployés notamment pour résorber la dette publique,
toutefois est il sensé de tolérer de financer les déficits conséquents prévisionnels par le recours
aux recettes du Fonds de régulation des recettes en prenant un risque d'endettement à long et
Moyen terme en cas de non décollage de croissance économique escomptée et de détérioration
des prix du pétrole sur les marchés internationaux ?
Graphique N° Evolution comparative des écarts de dépenses et de recettes budgétaires
-1800
-1600
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
2000
2002
2004
2006
2008
2010
*
Années
Mo
nta
nts
ECART recettes
ECART dépenses
Source : D’après les données du tableau ci dessus
Ce graphique illustre en effet, l’importance des écarts de gestion budgétaire ainsi que
leur évolution pour la période allant de 2000 à 2010. Nous pouvons dès lors distinguer trois
phases d’évolution des écarts :
La période allant de 2000 jusqu'à 2002, se caractérise par une certaine divergence des
deux courbes. Le graphique montre que cet espacement s’explique seulement par la courbe
mettant en relief les écarts sur recettes budgétaires. L’explication de cette situation étant la
surestimation des recettes budgétaires contenues dans les indicateurs de cadrage servant à
l’élaboration des lois de finances pour ces exercices.
16
La période allant de 2003 à 2005 montre le rapprochement des deux courbes. Les
écarts enregistrés durant cette période sont plus modérés. Ceci s’explique par la révision à la
baisse des prévisions de recettes budgétaires, qui passent ainsi de 2049,3 milliards de dinars
en à 1451 milliards de dinars courants en 2003 (soit une baisse de 29,2%)
La période allant de 2006 à 2010 montre le creusement caractérisé des écarts négatifs
enregistrés en dépenses, malgré le maintien des écarts de gestion des recettes budgétaires à
des niveaux assez bas. Cette situation traduit l’importance des dépenses engagées notamment
celles liées au Plan de consolidation et de croissance économique, alors que les réalisations
font état de reliquats très importants qui peuvent éventuellement trouver une explication
éventuelle dans les retards liés à l’exécution des programmes d’équipement inscrits aux
budgets, aux réévaluations des coûts de réalisations. Face à l’importance de ces dépenses tant
prévisionnelles que réelles entreprises et les déficits budgétaires qui en découlent, le Fonds de
régulation des recettes semble se démarquer de sa d’épargne et/ou stabilisation, pour devenir
un instrument garantissant la conduite d’une politique budgétaire expansionniste.
Conclusion
Les pays exportateurs de pétrole sont donc face à deux défis majeurs : le premier défi
consiste à protéger la capacité du pays à importer. Durant la décennie 2000-2010 ce défi est
relevé puisque les pays avaient réussi à rembourser leurs dettes extérieures mais aussi à
constituer une épargne importante en accumulant des actifs externes ; le second défi, à long
terme, consiste à réduire la dépendance des comptes courants vis-à-vis de l’exportation du
pétrole. En effet, les pays exportateurs devront diversifier leurs économies et se préparer à
l’éventuel déclin des profits qu’ils tirent de l’exploitation du pétrole en développant leurs
économies hors hydrocarbures.
Une chute soudaine des prix des hydrocarbures entraîne, à court terme des difficultés,
liées notamment la continuation des programmes de dépenses déjà initiés34. La plupart des
pays exportateurs des hydrocarbures se trouvent actuellement dans des situations confortables
puisqu’ils ont amené à des niveaux bas leurs dettes publiques et ont accumulé d’importants
actifs externes. Ces actifs peuvent permettre de se prémunir temporairement de la baisse des
prix des hydrocarbures et éviter la procyclicité de la politique budgétaire. Le défi majeur de la
politique budgétaire dans les pays exportateurs des hydrocarbures, étant un imprévisible
retournement des prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux. En effet, si les prix
chutent, ces pays devront ajuster leurs politiques budgétaires :
34 Le « contre choc pétrolier » de 1986, avait entrainé l’abandon de plusieurs projets d’équipement public : métro d’Alger, infrastructures routières… qui ont été reconduits à l’occasion de la hausse des prix des hydrocarbures.
17
- Soit en réduisant les dépenses courantes exagérées et les dépenses marginales
d’investissements publics afin de ne pas entraver les perspectives de croissance à long terme
ou les efforts de diversification.
- soit en augmentant les taux d’imposition. L’accroissement des revenus basés sur le
développement d’un système fiscal efficient peut être bénéfique à moyen terme, puisqu’il
permet de réduire la dépendance des budgets aux recettes pétrolières et accroit le contrôle des
autorités sur les revenus publics, qui plus loin sont largement au delà de leur contrôle.
En Algérie, la conduite de la politique budgétaire expansionniste, à partir de 2000, à
entrainé une forte inflation (5,4% en 2009) et un taux de croissance économique de
seulement 2,1%35 pour la même année. Ces performances mitigées de la politique de relance
enclenchée durant la décennie 2000, découlent du non respect des conditions de relance
keynésienne, notamment celle de l’élasticité de l’offre qui réagit à toute demande effective
supplémentaire. La faiblesse du tissu industriel et l’ouverture de l’économie algérienne36,
voire sa dépendance envers l’extérieur (notamment sur le plan alimentaire) mais aussi une
dépendance des exportations hydrocarbures représentant 98% du total des exportations, font
qu’alimenter les effets d’éviction international et la poussée inflationniste.
La voie de consolidation de la croissance et du développement économique est
étroitement liée aux investissements en capital humain et à la diversification des industries
locales et leur protection.
35 Données du FMI. 36 Le degré d’ouverture de l’economie algérienne est de