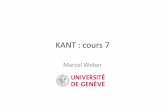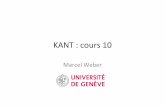Christianisme épistémologique et philosophie morale
Transcript of Christianisme épistémologique et philosophie morale
CHRISTIANISME ÉPISTÉMOLOGIQUE ET PHILOSOPHIE MORALE Ronan Sharkey Editions du Cerf | Revue d'éthique et de théologie morale 2009/1 - n°253pages 101 à 126
ISSN 1266-0078
Article disponible en ligne à l'adresse:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-d-ethique-et-de-theologie-morale-2009-1-page-101.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sharkey Ronan, « Christianisme épistémologique et philosophie morale », Revue d'éthique et de théologie morale, 2009/1 n°253, p. 101-126. DOI : 10.3917/retm.253.0101--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Editions du Cerf.© Editions du Cerf. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
101
C H R I S T I A N I S M E É P I S T É M O L O G I Q U E . . .
REVUE D ’ É TH IQUE ET DE THÉOLOG I E MORALE | N • 2 5 3 | MAR S 2 0 0 9 | P . 1 0 1 - 1 2 6
R o n a n S h a r k e y
CHR I S T I AN I SMEÉ P I S T ÉMOLOG IQUE
E T PH I LO SOPH I E MORA L E
Dans un article récent"ë qui entreprend de défendre la religionen général, et le christianisme en particulier, contre une séried’attaques d’inspiration néo-darwinienne"í, Jean-Pierre Dupuydéfinit sa propre position comme celle d’un « chrétien intellec-tuel ». Par ce terme, il entend se démarquer des « intellectuelschrétiens » – tels Gabriel Marcel ou G."K. Chesterton – qui écrivent« à la lumière de [leur] foi »"; un chrétien intellectuel est, aucontraire, quelqu’un dont le christianisme est essentiellementépistémologique :
[...] j’en suis venu à croire [dit-il] que le christianisme consti-tuait un savoir sur le monde humain, non seulement supérieurà toutes les sciences humaines réunies, mais source d’inspirationprincipale de celles-ci. Et cependant, je ne suis pratiquant d’aucunedes dénominations qui composent le christianisme.
C’est principalement à la lecture de et à son amitié avec RenéGirard que Jean-Pierre Dupuy doit d’avoir découvert ce savoir.Pour Girard, en eöet, le christianisme représentait – jusqu’à soninclusion dans Des choses cachées depuis la fondation du monde(1978) – la pièce manquante au dispositif qu’il développe etenrichit depuis les années 1960, afin d’expliquer le rôle joué parl’imitation et la violence dans la genèse et la décomposition descultures humaines : alors que la culture est toujours et partout
1.\J.-P. DUPUY, « La religion, nature ou surnature"? », à paraître in Intellectica (2008).2.\L’article prend position en particulier à l’encontre des thèses de Richard DAWKINSdans The God Delusion (Bantam Press, 2006), mais évoque également ceux de DanielC. DENNETT, Darwin’s Dangerous Idea (Harmondsworth, Penguin, 1995"; trad. P. Engel,Darwin est-il dangereux"?, Paris, Odile Jacob, 2000) et de Pascal BOYER, Et l’hommecréa les dieux. Comment expliquer la religion (Paris, Gallimard, « Folio essais », 2006).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
102
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 3
fondée sur le sacré, c’est-à-dire la sacralisation d’une victime dontl’identification et la mise à mort rituelle permettent de retrouverl’unité et la paix, la théologie chrétienne"ì révèle son innocenceet met à jour le mensonge collectif fondateur des institutionssociales. La pensée judéo-chrétienne ne serait pas à proprementparler une pensée religieuse, autrement dit une fonctionnalité,une exploitation mensongère mais hautement eúcace, du sacré :c’est au contraire la vérité sur les rapports non seulement entreDieu et les hommes, mais (surtout) entre les hommes eux-mêmes.Rompant avec l’unanimisme caractéristique de la logique sacrifi-cielle, le message du Christ divise, permet la dissonance, et parlà laisse échapper une vérité qui est extérieure au social, et quipermet donc de fonder la société sur une justice qui transcendeet corrige la vengeance spontanée. Voilà pourquoi et Girard etDupuy parlent du christianisme comme la science de l’hommepar excellence, c’est-à-dire comme la condition de possibilitéd’une connaissance objective et transparente des aöaires hu-maines. L’erreur commise par les adversaires néo-darwiniensde la religion, comme Dawkins et Christopher Hitchens"î, quiattribuent à la religion l’origine de la violence dans le monde,est donc une erreur scientifique.
Comme le dit Dupuy"ï :
Ce qui vient en premier, ce véritable universel de la violencefondatrice, c’est la dynamique spontanée de la foule persécutrice.C’est sur cette base que le religieux, ensuite, procède à son travaild’interprétation, de symbolisation et de ritualisation"ñ.
Au moment – aujourd’hui, certes, un peu derrière nous –où l’idée même d’une science de l’être humain fut décriée,non pas à cause des insuúsances propres à l’empirisme positi-viste"ó, mais parce que (pour reprendre l’expression consacrée)« l’homme n’existe plus », René Girard aúrmait avec une
3.\En cela comme la théologie juive de l’Ancien Testament, en particulier dans lafigure de Joseph.4.\Christopher HITCHENS, God Is Not Great. The case against religion, Atlantic Press,2007. Voir le compte rendu jubilatoire de cet ouvrage par Dawkins lui-même : « Biblebelter », Times Literary Supplement, 7 September 2007, p. 3-5.5.\En l’occurrence, à propos de la mise à mort atroce de deux soldats israéliens parune foule palestinienne en 2001.6.\J.-P. DUPUY, Avions-nous oublié le mal"?, Paris, Bayard, 2002, p. 66.7.\Voir Peter WINCH, The Idea of a Social Science, Routledge, 1958.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
103
C H R I S T I A N I S M E É P I S T É M O L O G I Q U E . . .
étonnante confiance qu’« aucune question n’a plus d’avenir,aujourd’hui [1978], que la question de l’homme"ò ».
Cette aúrmation a évidemment trouvé un écho extrêmementfavorable dans les milieux intellectuels où le poststructuralismen’avait jamais pris racine, et en particulier chez des chrétienssoucieux d’aúrmer l’épaisseur et la liberté de l’être humain. Maispour ce qui est de la culture séculière et universitaire contem-poraine, il faut bien se rendre à l’évidence que la prédiction deGirard s’est révélée fausse : fausse, bien sûr, dans les domainesinfluencés de près ou de loin par la biologie évolutionniste (cequi, pour le coup, rend un peu mystérieuse la virulence deDawkins et de ses amis), mais fausse aussi dans les disciplinesqui intéressent de près Jean-Pierre Dupuy, en particulier lessciences de la société, l’éthique et la philosophie politique. Celame paraît également vrai en ce qui concerne la philosophieanalytique, que Dupuy a tant fait pour introduire dans les habi-tudes intellectuelles françaises, et qu’il oppose, quand il en parle,à l’antihumanisme structuraliste et poststructuraliste. On ne peutpas (encore) dire que la philosophie analytique ait enterré l’êtrehumain"; il faudrait plutôt dire qu’elle l’a ignoré, comme uneprésence encombrante et métaphysiquement embarrassante. Eton peut soutenir que, dans le cas de philosophes analytiquesqui ne présupposent pas une sorte d’arrière-plan humaniste fort(et parmi ceux-ci figurent évidemment des philosophes chré-tiens, dont certains seront mentionnés par la suite), l’épaisseuret la spécificité de l’humain se trouvent réduites à une peau dechagrin par la technicité et l’aúnement même de ces disciplinesqui s’eöorcent de comprendre ce que sont la rationalité, l’action,la politique, et la pensée et l’évaluation morales.
Dans la maîtrise de cette technicité, Jean-Pierre Dupuy n’a passon égal, puisque, à la diöérence de la plupart des philosophesanalytiques, il ne s’est pas contenté de s’illustrer dans un seulde ces domaines, mais parvient – tout en travaillant à la pointedes recherches les plus spécialisées – à en explorer plusieursà la fois (philosophie de l’esprit et de l’action, philosophie dessciences sociales, philosophie morale et politique), toujours avecla volonté de faire l’unité entre elles. On peut cependant se
8.\R. GIRARD, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris, Grasset, 1978,p. 15.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
104
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 3
poser la question de savoir si le prix à payer pour tant devirtuosité n’a pas été, pour Dupuy, de s’être éloigné de l’espritde cette interrogation girardienne et de l’humanisme qui lasous-tend, tout en en respectant la lettre. L’œuvre de René Girards’est développée à partir d’une intuition unique et au fond trèssimple : le caractère triangulaire et mimétique du désir. Sa foichrétienne complète, enrichit et donne sens à cette premièreintuition, mais ne la modifie pas en profondeur. C’est dans lecadre de cette intuition, en amont de tout engagement ouattachement à la foi des fidèles, que se situe son humanisme.Pour autant que je puisse en juger, Dupuy partage intégralementcette intuition, l’enrichit avec l’apport considérable de sesconnaissances dans les sciences de la nature et de la société,et l’illustre dans ses écrits – avec une admirable liberté, peuhexagonale – à grand renfort d’exemples tirés de la Bible. Maisil est d’abord et surtout un rationaliste"ô"; et si la raison ne s’op-pose pas frontalement au savoir, elle ne saurait pourtant seconfondre avec lui. L’humanisme girardien est à l’origine unsavoir, mais son enrichissement et son approfondissement re-lèvent de quelque chose qui est plus diúcile à identifier, encoremoins à quantifier. Dupuy, suivant rigoureusement le chemin duphilosophe rationaliste, s’eöorce par tous les moyens d’harmo-niser l’intuition girardienne avec la raison « calculante ». Il n’estpas sûr que les deux soient toujours intégralement compatibles.C’est ce que je vais essayer de montrer en prenant l’exemple dela philosophie morale.
L ’ U T I L I T A R I S M E E T L E S A C R I F I C E
Comme beaucoup d’autres, j’ai découvert les écrits deJean-Pierre Dupuy au moment où, vers la fin des années 1980et grâce à des traductions françaises dont il était lui-même enpartie l’artisan, la philosophie française commençait à s’inté-resser sérieusement à la pensée politique « libérale » nord-américaine, en particulier à celle de John Rawls et de Robert
9.\Un « extrémiste rationaliste » selon son mentor à Polytechnique, Jean Ullmo. Dupuyraconte cette anecdote avec un évident plaisir dans Pour un catastrophisme éclairé.Quand l’impossible est certain, Paris, Seuil, « Points », 2002, p. 24.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
105
C H R I S T I A N I S M E É P I S T É M O L O G I Q U E . . .
Nozick dans les deux livres « phares » que sont Théorie de lajustice et Anarchie, État et Utopie. Ce que ces deux livres onten commun, en dépit de diöérences considérables de sensibilitépolitique et de style d’argumentation, est la conviction selonlaquelle c’est la tâche d’une pensée authentiquement libérale deproposer une alternative à l’utilitarisme, la philosophie qui afourni – et continue de fournir – le cadre principal de la réflexionen philosophie morale dans les pays anglo-saxons. L’utilitarisme,comme on le sait, formalise l’intuition – en apparence impecca-blement démocratique – selon laquelle, dans un monde sécula-risé, seul possède une valeur incontestable le bonheur (ou lasatisfaction) mesurable des sujets considérés ensemble, c’est-à-dire comme un tout. En partant d’un fondement individualiste,celui des préférences individuelles (« Everyone to count for one,no one for more than one », disait Bentham), on aboutit ainsià une forme d’anti-individualisme d’autant plus exacerbée queles préférences ou désirs des individus qui n’auront pas été prisen compte ne comptent moralement pour rien (ce qui, pourle coup, est une parfaite illustration de la remarque de LouisDumont – faite à propos des régimes totalitaires – selon la-quelle « l’individualisme est d’une part tout-puissant et de l’autreperpétuellement et irrémédiablement hanté par son contraire"ëê »).Dans la « théorie de la justice comme équité » rawlsienne, cerefus de l’utilitarisme passe par une priorité absolue donnée au« juste » sur le « bien », c’est-à-dire aux principes définissant demanière rigoureusement impartiale la répartition des droits,libertés, possibilités, etc., sur le contenu de, et l’attachement desdésirs individuels à ces biens. Dans la théorie libertarienne deNozick, l’être humain est défini d’emblée comme un détenteurde droits et de libertés inaliénables : par conséquent, aucunepolitique de redistribution – utilitariste, rawlsienne ou socia-liste – ne saurait porter atteinte à ces droits.
L’originalité des travaux que Jean-Pierre Dupuy a consacrésà ces deux auteurs consiste à les lire comme une réponseantisacrificielle à l’utilitarisme, cet avatar moderne et laïque del’unanimisme tribal et païen pour lequel les normes moralesqui, d’ordinaire, assurent l’inviolabilité de l’individu n’ont aucunpoids devant l’impératif de l’amélioration de la condition hu-
10.\Louis DUMONT, Essais sur l’individualisme, Paris, Seuil/Esprit, 1983, p. 28.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
106
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 3
maine. Afin d’illustrer la pertinence de ce rapprochement, Dupuycite Helvétius, père spirituel de Bentham :
Cette utilité est le principe de toutes les vertus humaines, et lefondement de toutes les législations. Elle doit inspirer le législateur,forcer les peuples à se soumettre à des lois"; c’est enfin à ce prin-cipe qu’il faut sacrifier tous ses sentiments, jusqu’au sentimentmême de l’humanité [...]. L’humanité publique est quelquefoisimpitoyable envers les particuliers. Lorsqu’un vaisseau est surprispar de longs calmes, et que la famine a, d’une voix impérieuse,commandé de tirer au sort la victime infortunée qui doit servir depâturage à ses compagnons, on l’égorge sans remords : le vaisseauest l’emblème de chaque nation"; tout devient légitime et mêmevertueux pour le salut public"ëë.
Nous avons aöaire ici, comme le fait justement remarquerDupuy, au choix de Caïphe (« Il vaut mieux qu’un seul hommemeure pour le peuple et que la nation ne périsse pas touteentière » [Jn 11, 49-50]), choix dont on trouve une variante,version « lynchage dans le Tennessee », dans le livre de Nozick"ëí.Celui-ci, à la diöérence de Rawls, emploie eöectivement le mot« sacrifice » à propos de l’utilitarisme, et manifeste (commel’atteste l’exemple du lynchage) une appréciation réelle del’importance d’une mise à distance de la violence dans les so-ciétés humaines"ëì. Tout autre est le cas de Rawls, pour qui ilne s’agit pas, avec l’utilitarisme, de la désignation unanimisted’une victime expiatoire, mais simplement, dans l’eöacementdes droits de l’individu, de la non-prise en compte de ses pro-jets : l’utilitarisme serait insensible à la singularité de la vie dusujet, au fait que personne d’autre ne peut et ne doit choisir,s’engager, accepter une quelconque souörance ou privation àsa place. Le dispositif extrêmement abstrait de la « théorie dela justice comme équité » plane benoîtement au-dessus de laconflictualité et de la violence humaines et trahit, jusque dansson langage même, la diúculté de son auteur à saisir et à
11.\De l’esprit (1758), cité par Dupuy in Éthique et philosophie de l’action, Paris, Ellipses,1999, p. 48-49.12.\Cité in DUPUY, Éthique et philosophie de l’action, p. 23.13.\Ce n’est pas pour autant que la violence est absente de la société minimalistenozickienne où, comme le dit Charles Taylor, on peine à identifier les conditions,pourtant essentielles, d’une socialisation, et donc d’une formation de la consciencemorale, de l’individu : Charles TAYLOR, « Atomism », in Philosophy and the HumanSciences : Philosophical Papers II, Cambridge, 1985.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
107
C H R I S T I A N I S M E É P I S T É M O L O G I Q U E . . .
apprécier celles-ci"ëî. D’ailleurs, les développements ultérieursque Rawls apporte à sa théorie révèlent et entérinent uneasymétrie avec le principe d’utilité qui rend un peu dérisoire lacritique rawlsienne : la théorie de la justice comme équité neserait pas, comme l’est l’utilitarisme, une philosophie morale ausens complet du terme, un raisonnement philosophique visantà sous-tendre la normativité en tant que telle, mais seulementune théorie politique à portée très restreinte, avec une pertinencepour les seules sociétés démocratico-libérales. Ainsi, comme ledit Dupuy, « l’utilitarisme est accusé de favoriser le sacrifice dansdes contextes que la justice comme équité exclut de son proprechamp"ëï ».
MO R A L E E T C O N S É Q U E N T I A L I S M E
C’est donc sur le terrain de la philosophie morale, en tant quedomaine distinct de (tout en recoupant) celui du débat démo-cratique et politique, qu’il convient de situer la critique del’utilitarisme. Celui-ci se décompose, comme on sait, en deuxéléments distincts : une téléologie eudémoniste, selon laquellela fin visée par l’action humaine doit être l’« utilité » mesurable(selon le cas, le bonheur ou la satisfaction des préférences detous ceux que l’action concerne)"; et un raisonnement pratiquede type conséquentialiste qui évalue l’acte lui-même, non selonles intentions de l’agent, mais selon le résultat, ou les consé-quences, produits par l’acte, en l’occurrence l’utilité. On voitaussitôt que les conséquences d’un acte ne doivent pas for-cément se limiter à la production du plaisir ou du bonheur ouutilitariste, mais peuvent viser toute fin susceptible d’être me-surée"; et que le conséquentialisme est donc logiquement dé-tachable de la philosophie morale utilitariste et représente unraisonnement pratique autonome, l’utilitarisme en étant unevariante. Or, c’est précisément le conséquentialisme qui poseun problème pour ce que Dupuy nomme « la morale de sens
14.\Les écrits récents de Dupuy attestent sa désaöection avec Rawls"; voir, en parti-culier, Avions-nous oublié le mal"?, p. 78 s., et « Les béances d’une philosophie duraisonnable », Revue de philosophie économique n• 7, 2003, p. 33-59.15.\J.-P. DUPUY, Le Sacrifice et l’envie, Paris, Calmann-Lévy, 1992, p. 159.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
108
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 3
commun » (kantienne ou chrétienne), puisque il n’y a, dans laperspective conséquentialiste, aucun acte, aussi radicalementmauvais soit-il du point de vue de cette morale de sens commun,qui ne saurait, le cas échéant, être cautionné si ses conséquencess’avèrent moins mauvaises que tout autre acte possible pourl’agent. Le philosophe catholique Elizabeth Anscombe, à qui nousdevons d’avoir inventé ce terme, voyait dans le conséquentia-lisme (dont elle disait qu’il était devenu le dénominateur communde toute la philosophie morale anglaise depuis Sidgwick à la findu XIX§ siècle) l’eöacement pur et simple de l’héritage judéo-chrétien en matière de morale. Car, dans l’interdiction de certainsactes comme intrinsèquement mauvais (catégorie dans laquelleelle inclut surtout « la condamnation juridique de celui qui estinnocent » et le choix de « tuer l’innocent afin de réaliser un bien,quel qu’il soit »"ëñ), la morale judéo-chrétienne entend exclurela possibilité que l’agent se trouve « tenté par la crainte ou l’espoirdes conséquences"ëó » de ces actions. À l’inverse, dit-elle :
[Le conséquentialisme] aboutit à une situation où il estimpossible d’identifier le mal d’une action en dehors de sesconséquences anticipées. Mais si cela est le cas, alors vous devezévaluer le mal [de votre action] à la lumière des conséquencesque vous anticipez"; il s’ensuit que vous serez en mesure de vousdisculper des conséquences réelles des actions les plus infâmesaussi longtemps que vous pouvez prétendre que vous ne les avezpas prévues. Je soutiens, au contraire, qu’un homme est respon-sable pour les mauvaises conséquences de ses mauvaises actions,mais qu’il n’a, en revanche, aucun mérite pour les bonnes";inversement, il n’est pas responsable pour les mauvaises consé-quences d’actions qui sont bonnes"ëò.
Ce que dénonce ici Elizabeth Anscombe est le scepticismedésastreux à propos de l’action juste que produit l’hégémonieconséquentialiste contemporaine : à propos de n’importe quelleaction bonne ou juste (protéger l’innocent, être tempérant,manifester un courage exceptionnel dans des circonstances
16.\« Modern Moral Philosophy », in G."E."M. ANSCOMBE, Ethics, Religion and Politics.Collected Philosophical Papers, Vol. III, University of Minnesota Press, 1981, p. 34.17.\Ibid.18.\Ibid., p. 35-36. C’est cette dernière position qui autorise ce qu’on appelle la « doc-trine de l’acte à double eöet ». Pour une synthèse utile et éclairante, voir Peter BYRNE,« Double eöet », in Monique CANTO-SPERBER (dir.), Dictionnaire d’éthique et dephilosophie morale, Paris, PUF, 1997.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
109
C H R I S T I A N I S M E É P I S T É M O L O G I Q U E . . .
dangereuses), on peut – et si le conséquentialiste a raison, ondoit – se poser la question de savoir si cette action est vraimentjuste"; et aucune réponse ne sera satisfaisante pour le conséquen-tialiste qui ne montre que les conséquences probables de l’actionchoisie seront au moins aussi bonnes que celles de toute autreaction possible. En écrivant ces lignes (en 1958), Anscombe avaità l’esprit les raisonnements qui avaient servi à justifier les bom-bardements de civils dans les villes de Dresde et de Hambourgau printemps 1945, puis l’utilisation de la bombe atomique surles villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki dans le mois d’aoûtde la même année. La justification donnée par le colonel PaulTibbets, le pilote du bombardier Enola Gay qui a largué lapremière bombe atomique sur Hiroshima le matin du 6 août 1945,et qui vient de mourir à l’âge de 92 ans sans avoir jamais perduune nuit de sommeil ou ressenti le moindre remords, peut servirde modèle du raisonnement conséquentialiste : « Ma mission,disait-il, ne me posait aucun problème. Je savais que nous allionstuer beaucoup de gens, mais Dieu sait que nous allions aussisauver beaucoup de vies"ëô ». Sans le savoir, Tibbets donneexpression ici au rapprochement, constaté et commenté à maintsendroits par Dupuy, entre le conséquentialisme et la théodicéeleibnizienne selon laquelle le mal serait le moyen par lequel Dieuparvient à la réalisation du meilleur des mondes possibles. Dieule sait, sans aucun doute, répond l’anti-conséquentialiste, maisjustement nous ne sommes pas Dieu : voilà pourquoi nous avonsbesoin d’interdits absolus.
L’article d’Elizabeth Anscombe, par son intransigeante dénon-ciation de l’extension du raisonnement conséquentialiste dansla société comme dans la philosophie morale, est aujourd’huireconnu comme un « classique ». Mais pour beaucoup de noscontemporains, ce style de raisonnement en termes d’interdits« absolus » appartient à un autre âge. Bien plus connu un autretexte, discuté à plusieurs reprises par Jean-Pierre Dupuy, deson collègue de Cambridge, Bernard Williams, qui analyse etcritique la structure du conséquentialisme à l’aide d’un exemplecélèbre"íê : il s’agit d’un Américain, Jim, égaré lors d’une expé-
19.\Le Monde, 7 novembre 2007.20.\B. WILLIAMS, « Une critique de l’utilitarisme », in J."J."C. SMART et Bernard WILLIAMS,L’Utilitarisme. Le pour et le contre, trad. H. Poltier, Genève, Labor et Fides, 1997, p. 90-91.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
110
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 3
dition botanique dans un village sud-américain. Arrivé à lagrand-place, il se trouve confronté à une foule attroupée autourd’un peloton d’exécution qui s’apprête, sous le commandementd’un certain Pedro, à fusiller une vingtaine des leurs afin deconvaincre les autres des bienfaits de ne pas se révolter contrele gouvernement. Or, quand Pedro a fini par comprendre quiest Jim et pourquoi il se trouve là, il voit dans cette situationun moyen de s’en tirer à bon compte, sans que les villageoisle gardent dans leur mémoire collective uniquement commele bourreau de leurs fils et de leurs maris : il oöre à Jim le« privilège » de tuer lui-même un de ces Indiens"; s’il accepte,les autres auront la vie sauve"; s’il refuse, alors ils mourront tous.Williams conclut son exemple par la question : « Que doit-ilfaire"? ».
Rapprochant ce dilemme d’autres « cas » qui font entrevoir unraisonnement analogue – le grand prêtre Caïphe, le milicien PaulTouvier qui a fait tuer un grand nombre de juifs sous prétextequ’en agissant ainsi il a pu en sauver plus encore (et, nouspouvons ajouter, le Colonel Tibbets) –, Dupuy conclut que tous« font le choix conséquentialiste et, malgré la puissance del’argumentation rationaliste qui le sous-tend, nous sommesfortement enclins à le réprouver"íë ». Le rapprochement occultecependant un élément essentiel : Caïphe, Touvier et Tibbetspartagent le fait d’avoir raisonné de manière conséquentialiste(dans le cas des deux derniers, de façon ex post facto)"; pourl’instant, Jim est simplement confronté à un dilemme tragique(tragique au sens des grandes tragédies de la littérature, grecqueou shakespearienne), où l’agent n’a pas d’issue qui lui laisseraitla conscience tranquille, et où l’action horrible est en quelquesorte inéluctable. Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’une autreforme de raisonnement moral aboutirait à un résultat diöérent,démonstration qui serait, après tout, paradoxale étant donné qu’ils’agit d’une critique du conséquentialisme"; ni simplement dedeviner ce que fera Jim. À travers une situation où la décisionprise a de bonnes chances d’être la même, quelle que soit lanormativité à laquelle nous faisons appel, Williams veut nous fairecomprendre que, pour le conséquentialiste, ce choix s’impose,non comme un moindre mal, mais comme une évidence. Le
21.\J.-P. DUPUY, Éthique et philosophie de l’action, p. 23 (je souligne).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
111
C H R I S T I A N I S M E É P I S T É M O L O G I Q U E . . .
conséquentialisme, à la diöérence de la morale dite « tradition-nelle », ne laisserait aucune place au doute à propos de la bonnedécision"íí. Étant une simple théorie de la décision rationnelledéguisée en théorie morale, il ne saurait non plus, selon Williams,accorder une place à des considérations extradécisionnelles– aux regrets, au remords, à l’angoisse, etc., bref, à l’émotion –et, opérant un raccourci vers les seuls eöets de l’action, passeraitoutre la subjectivité dans laquelle s’enracine notre liberté. Leconséquentialiste peut dire, non seulement que Jim doit surmon-ter sa répugnance et assassiner le malheureux devant lui, nonseulement qu’il n’a pas le choix, mais que les scrupules qu’iléprouve n’ont strictement aucune valeur dans une quelconquepartie de la prise de décision. A contrario, la plupart d’entre nousconcevons les choix moraux, à plus forte raison quand il s’agitde choix graves ou susceptibles d’entraîner des conséquencestragiques, comme relevant d’une dimension de notre être quidemeure, alors même qu’il peut être pertinent de dire « Je n’aipas le choix », fondamentalement indéterminée.
L E S R A I S O N SD U C O N S É Q U E N T I A L I S M E
Présenté ainsi, il est bien diúcile de comprendre l’attrait d’unethéorie normative qui compte pourtant de nombreux partisansparmi les philosophes contemporains de la morale. C’est pour-quoi il est important de saisir les raisons qui les amènent à ladéfendre et à la développer : ces deux tâches, en réalité, n’enfont qu’une, le conséquentialisme étant une sorte de chantierouvert en permanence, développant des variantes de plus enplus sophistiquées. Je voudrais identifier deux de ces raisons,mais avant de le faire, je m’arrête brièvement sur le fait que,si la critique par Bernard Williams du conséquentialisme estprofonde et subtile, il faut bien reconnaître qu’en tant quephilosophie morale elle s’écarte nettement de la perspectiveanscombienne selon laquelle le conséquentialiste transgresse,parce qu’il est incapable de les reconnaître, les interdits absolus
22.\Il faut noter que, pour B. WILLIAMS, le conséquentialisme partage ce trait avec lekantisme : voir son livre Moral Luck, Cambridge, 1981, en particulier le chapitre 1.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
112
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 3
de l’éthique judéo-chrétienne. De sa propre position, Williamsdit qu’elle
ne signifie nullement que le refus du conséquentialisme entraînela nécessité d’accepter que, indépendamment des conséquences,il y a des actions que l’on doit toujours faire, ou encore qu’il yen a que l’on ne doit jamais faire [...]. Bien sûr, on peut toujourspenser qu’il y a des actions qui satisfont cette condition"; pourtant,je ne vois pas comment on pourrait se fier à une liste d’actionsde cette sorte si on ne suppose pas qu’elle a un garant surnaturel[a supernatural warrant]"íì.
Il ajoute que l’un des facteurs qui rendent le conséquentialismeinacceptable est sa propension, comme il dit, à « penser l’im-pensable », à aborder avec les outils du choix rationnel dessituations qui sont
si monstrueuses que l’idée même qu’un travail de la rationalitémorale puisse y apporter une réponse est dépourvue de sens :ce sont des situations dont l’énormité dépasse à tel point la capacitéhumaine de délibération morale que, d’un point de vue moral, iln’importe plus de savoir ce qui se passe [...]. Penser l’impensable[...] n’est pas une demande incontestable de rationalité que l’ondevrait opposer au refus lâche ou paresseux de suivre jusqu’aubout ses pensées morales [...]. La rationalité est une exigence quis’impose, non seulement à [soi], mais également à la situation danset à propos de laquelle [on] doit penser"; et à moins que sonenvironnement se révèle pourvu d’un minimum de sens, il estinsensé d’y apporter sa seule apparence"íî.
Critiquons le conséquentialisme, dit en somme Williams, maisrestons loin des fanatiques de tout bord, moralistes intransigeantspartisans d’une « whatever the consequences position"íï », commerationalistes à outrance capables d’émousser notre sensibilitéet notre imagination morales en inventant des dilemmes aussifarfelus que terrifiants. La formulation de Williams a le mérited’attirer notre attention sur le fait que la fonction des interditsabsolus est de mettre fin aux raisonnements moraux. Il est
23.\B. WILLIAMS, « Une critique de l’utilitarisme », p. 84.24.\Ibid., p. 86. Williams parle ici à la troisième personne, mais il semble évident qu’ilexprime sa propre répugnance à l’égard d’un extrémisme rationnel, qu’il renvoie dosà dos avec l’extrémisme moral.25.\La phrase est de Williams : « Une critique... », p. 84"; elle a servi de titre à un articlecélèbre de Jonathan BENNETT dénonçant l’intransigeance morale de Anscombe :« Whatever the Consequences"? », Analysis (1966), réimpr. in SINGER et KUHSE (éd.),Bioethics : an anthology, Blackwell.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
113
C H R I S T I A N I S M E É P I S T É M O L O G I Q U E . . .
profondément erroné, selon l’« absolutiste » éthique (Anscombe),de faire appel à cette « casuistique des urgences"íñ » qu’est leconséquentialisme"; ce que l’on n’a pas le droit de faire est claircomme le jour. « Devrions-nous faire le mal pour qu’en sorte lebien"? », demande saint Paul (Rm 3, 8) : le mal, au moins, estconnu. Si, pour Williams, les raisonnements s’arrêtent, ce n’estpas parce que l’action humaine a besoin de limites, mais parceque l’imaginaire moral en a besoin : la discussion et la déli-bération morales doivent avoir un cadre traduisant une impres-sion minimale de réalité.
Le problème, comme Dupuy nous le montre avec beaucoupde force dans ses livres récents"íó, c’est que « l’impensable » aune fâcheuse tendance à devenir non seulement pensable, maisprobable. L’exclusion, chez Williams, aussi bien de toute trans-cendance que d’une morale qui raisonnerait en termes de choix« apocalyptiques » le rapproche, sans doute malgré lui, de ces« béances d’une philosophie du raisonnable"íò » que Dupuydénonce vigoureusement chez John Rawls. Faisons de la phi-losophie morale, mais seulement à condition de pouvoir dis-cuter de ce qui est possible et raisonnable.
Devant la représentation du conséquentialisme comme unenormativité qui serait incapable de reconnaître la spécificité etl’indétermination propres au raisonnement moral, on peut ré-pondre, comme le fait le philosophe américain Peter Railton"íô,qu’il n’y a pas un seul conséquentialisme, mais deux : selon leconséquentialisme subjectif, on doit non seulement raisonnerconformément à la logique qui vise à produire un état de chosessupérieur moralement à tout autre possible, mais on doit le faire,comme dit Dupuy, « par esprit conséquentialiste"ìê ». En revanche,ce qui intéresse le conséquentialisme objectif, ou « sophistiqué »,
26.\David WIGGINS, « Truth, Invention and the Meaning of Life » (1976), in Needs, Values,Truth, Oxford, Clarendon Press, 1998"; trad. fr. : « La vérité, l’invention et le sens dela vie », in R. OGIEN (dir.), Le Réalisme moral, Paris, PUF, 1998.27.\Principalement : Pour un catastrophisme éclairé (2002), Avions-nous oublié le mal"?(2002) et Petite métaphysique des tsunamis (2005).28.\« Les béances d’une philosophie du raisonnable. Sur John Rawls », art. cit., reprenantcertains passages qui figurent dans : Avions-nous oublié le mal"?29.\Peter RAILTON, « Alienation, Consequentialism and the Demands of Morality », inS. SCHEFFLER (éd.), Consequentialism and its Critics, Oxford, 1988, p. 113 s.30.\J.-P. DUPUY, « Sur la logique du détour », Revue de philosophie économique n• 1,2000, p. 7-32.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
114
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 3
c’est le seul résultat, ce qui rend possible la prise en comptedes états intérieurs de l’agent, car ceux-ci comptent aussi dansl’état de choses qu’on s’eöorce de réaliser. Le conséquentialismeobjectif ne serait donc pas coupable de négligence à propos desétats subjectifs anti- ou non conséquentialistes.
Cette réponse « humienne », comme d’autres qui séparentla raison de ce qui donne sens et épaisseur à la vie humaine,n’est en réalité pas très satisfaisante. Dupuy fait remarquercombien est incommode la position du conséquentialiste sophis-tiqué, lui qui doit intégrer dans sa perspective ultra-rationalistedes éléments hétérogènes sous prétexte qu’une adaptation per-manente aux impératifs du calcul des conséquences serait dé-létère pour la personnalité de l’agent, et donc que les consé-quences seront globalement moins mauvaises si celui-ci s’entient aux impératifs de sa conscience. Ce qu’il dit ensuite mérited’être cité in extenso :
On mesure l’abîme, dit Dupuy, qui sépare ce conséquentialismesophistiqué d’une doctrine déontologique insistant sur le caractèreabsolu, et absolument moral, de l’interdit [...]. [M]ême dans le casoù il est absolument clair que violer la règle globalement lameilleure a de meilleures conséquences que de la respecter, l’agentn’a pas nécessairement l’autorité d’en juger – de la même façonqu’un juge n’est pas libre de ne pas appliquer la législationexistante, même s’il lui paraît évident que, dans le cas précis, lesobjectifs mêmes qu’elle poursuit seraient mieux servis. Après tout,il n’y a pas de norme possible sans une certaine extériorité outranscendance, ce qui exclut que quiconque, à n’importe quelmoment, puisse décider, même avec les meilleures raisons, de larespecter ou de la rejeter. Celui qui en juge autrement se place,précisément, en situation de transcendance. Décidant de qui doitvivre et de qui va mourir, il joue à être Dieu"ìë.
La citation aurait pu venir d’Anscombe, à un détail près, quej’ai volontairement supprimé : Dupuy persiste (ou persistaitdernièrement) à appeler sa propre philosophie morale consé-quentialiste, « une position conséquentialiste plus intéressante etsubtile », disait-il"ìí, que les vaines tentatives des conséquentia-listes « sophistiqués ». Nous en venons donc à la question :
31.\Ibid.32.\« Counterfactual Consequences », Journées de philosophie morale, GRISE/ÉcolePolytechnique (juin 1999), non publié.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
115
C H R I S T I A N I S M E É P I S T É M O L O G I Q U E . . .
« pourquoi"? ». Je crois que la réponse doit être que, pourDupuy comme pour beaucoup de philosophes moralistes, onn’abandonne le conséquentialisme intégralement qu’au prix d’unabandon de la raison en morale. La question se pose alors desavoir si la raison nous impose, comme le croit Dupuy, desauver le conséquentialisme"; ou bien si le problème et lesparadoxes du conséquentialisme ne révèlent pas plutôt la plu-ralité de formes de raison au service de la morale.
L ’ É T H I Q U E E T L ’ A V E N I R
Le conséquentialisme exprime, dans une forme relativementpure, la rationalité moyens-fins, la Zweckrationalität wébé-rienne : ce ne sont pas les fins humaines qui sont susceptiblesd’une évaluation rationnelle, comme le disait déjà John Stuart Milldans Utilitarianism (1863), mais seulement l’adaptation desmoyens que l’on choisit en vue d’atteindre ces fins. Commentalors justifier une action morale si celle-ci n’a aucune chance deproduire un meilleur résultat qu’une action alternative et, dansbien des cas, risque au contraire de contribuer à une nettediminution de la satisfaction des personnes concernées"? Danscette perspective, la « common morality », la morale de senscommun, sera forcément un plaidoyer désespéré pour unecertaine irrationalité. Comme le dit Dupuy :
Le conséquentialisme prescrit à chacun de toujours agir de façonà contribuer à la maximisation d’une grandeur globale qui faitintervenir l’ensemble des intérêts concernés, indépendamment del’identité des personnes dont ce sont les intérêts. [Le conséquentia-lisme aúrme que], s’il est mal pour un agent de commettre unmeurtre et s’il est bien d’honorer ses promesses, le monde serad’autant meilleur que le nombre d’agents commettant des meurtressera moins élevé et celui des agents qui tiennent leurs engage-ments, plus fort. C’est là une exigence de rationalité maximisatricequi, en soi, n’est pas morale, qui est même antérieure à etindépendante de toute moralité, mais qui, greöée sur nosconvictions concernant le bien et le mal, engendre le principeconséquentialiste : il faut viser à accroître le bien et diminuer lemal, globalement, dans le monde"ìì.
33.\Pour un catastrophisme éclairé, p. 41-42"; voir aussi « Le détour et le sacrifice »,p. 33-34.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
116
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 3
Or, dans un contexte de réchauöement climatique, de pénuried’énergies fossiles et d’instabilité des marchés mondialisés, oùnous savons que les actions les plus insignifiantes sont suscepti-bles, dans certaines circonstances, de déclencher des événementscatastrophiques à la chaîne, comment ne pas être conséquentia-liste"? Comment justifier le recours à une morale qui ne possèdepas cet argument décisif : as-tu amélioré le sort du monde"? Leconséquentialisme apparaît aujourd’hui, aux yeux de certainsphilosophes (Dupuy cite en particulier Samuel Scheõer) commela seule perspective morale possible pour le XXI§ siècle : selonceux-ci, ce dont nous avons besoin n’est pas l’Évangile nousincitant à tendre l’autre joue et à délibérer dans les profondeursde notre conscience (l’« éthique de la conviction » wébérienne)";c’est un décentrement de cette conscience, voire un retourne-ment – comme on retourne un pull-over afin que l’intérieur setrouve à l’extérieur – afin de tenir compte des eöets lointainsde nos actions et des dispositifs techniques qui multiplient defaçon exponentielle leurs eöets. Face aux maux qui assaillent lemonde, en particulier le réchauöement planétaire, il est diúcile,si nous ne sommes pas conséquentialistes (l’« éthique de laresponsabilité » wébérienne) d’échapper à l’accusation d’aveu-glement éthique, d’irresponsabilité.
L’interpellation wébérienne reste, pour le chrétien, qu’il soitphilosophe ou non, consternante : l’éthique évangélique, dit ensomme Weber"ìî, appartient à la sphère de la seule conscienceprivée"; sur la place publique, la seule éthique susceptible d’êtredéfendue rationnellement est l’éthique de la responsabilité, uneéthique proprement causale, susceptible de changer le monde.Le trait du conséquentialisme qui explique l’absence d’incertitudeest donc son causalisme : ce ne sont pas les actions en tant quetelles qui manifestent de la valeur – autrement dit, leur valeurn’est pas intrinsèque –, mais seulement leur propension, par lebiais de la causalité, à produire des états de choses valables"ìï.Dans l’esprit de Williams, le causalisme serait inséparable duconséquentialisme, et suúrait à le condamner. Car si l’éthiqueest une simple aöaire de choix mécanique déterminé par sa
34.\Max WEBER, « Le métier et la vocation de l’homme politique », in Le Savant et lePolitique, tr. fr. J. Freund, Paris, 10/18, 1959, p. 206-207.35.\WILLIAMS, p. 79"; je souligne.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
117
C H R I S T I A N I S M E É P I S T É M O L O G I Q U E . . .
propension à produire une certaine valeur, alors, quelle que soitla valeur qu’on prétende produire, l’essentiel – la libertéinconditionnée du sujet – est absent. Dans un texte de 1999(« Counterfactual Consequences »), Dupuy va dans le même senset soutient que, si le causalisme est pris au sérieux, une moralede type kantien ou sartrien, qui accorde un primat à l’autonomiede l’individu et à sa liberté de se donner ses propres normes,apparaît comme une sorte de folie : la morale comme la raisonseraient intégralement déterminées. Mais il ajoute en mêmetemps – nous l’avons déjà vu – qu’un rejet sans nuance duconséquentialisme serait une erreur. Car il est possible, encoreselon Dupuy, de séparer la substance du conséquentialisme dupoison qu’est le causalisme et, ce faisant, de rendre le consé-quentialisme compatible avec des perspectives morales qui luiseraient a priori étrangères, notamment la liberté sartrienne etl’universalisme kantien. Pour comprendre son argument, il fautregarder de plus près les rapports, discutés en particulier dansle livre Éthique et philosophie de l’action, entre rationalité ettemps.
Dupuy cite l’économiste Maurice Allais, pour qui : « En matièrede rationalité, la maxime fondamentale est : seul compte l’avenir ».Puisque nous ne sommes pas en mesure de récupérer le passé,nous devons le faire passer par pertes et profits : « En matièrede choix rationnel, et contrairement aux pratiques comptables,toute dépense doit être considérée comme amortie au momentmême de son eöectuation"ìñ. » Or, c’est exactement ce que, dansbeaucoup de cas, nous répugnons à faire, complices que noussommes d’une illusion nommée the sunk cost fallacy (que Dupuytraduit habilement par « sophisme de l’amortissement »). Lesophisme consiste à croire que la seule volonté de me servir,par exemple, d’un téléviseur dernier cri, dont il est évidentsitôt après l’achat que je n’en ai et n’aurai jamais besoin, mepermettra d’amortir son coût. Alors je reste, soir après soir, àme remplir la tête d’émissions aussi débiles qu’ennuyeuses. Ladécision rationnelle est de se rendre à l’évidence de la futilitéde l’achat et, comme on dit en anglais, « to cut one’s losses » :même si je laisse l’appareil au ramassage des objets encom-brants, je ne serai pas perdant, car la perte appartient au passé";
36.\J.-P. DUPUY, Éthique et philosophie de l’action, p. 317.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
118
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 3
je suis même gagnant, car je ne regarde plus les émissionsstupides et j’ai donc plus de temps. En somme, tournons la page.Mais si, du point de vue de la pure rationalité, ce comportements’impose, la réalité du comportement humain est à mille lieuesde cela : Dupuy cite les travaux de son collègue de Stanford, lepsychologue cognitif Amos Tversky, qui montrent non seulementque les violations de la rationalité sont fréquentes, mais queces violations sont systématiques, que l’irrationalité fait système.Au cas où l’exemple cité s’apparente trop à une simple aöairede marchandise, prenez celui de quelqu’un qui est follementamoureux, qui s’est exténué (cadeaux, fleurs, déclarations) àconvaincre la bien-aimée qu’ils sont faits l’un pour l’autre, et quidécouvre un beau jour que celle-ci s’est envolée avec un autre :disons qu’ils se sont mariés et que (hypothèse improbable) lemariage ne permet pas de retour en arrière. Le choix rationnelimpose de tourner la page. Mais peu d’entre nous seraient àmême de s’exécuter avec autant de facilité : nous sommesrationnels, mais nous ne sommes pas que rationnels. « Cuttingone’s losses », comme le terme le suggère, équivaudrait à se faireune violence inouïe"; il faut un temps d’adaptation, de guérisonqui, compte tenu de l’investissement aöectif, sera ponctué pardes moments où le sujet se berce dans la douce illusion quela bien-aimée est encore disponible et l’attend. Et on peutmultiplier les exemples de la même veine : deuils, etc. Dupuyconclut, cependant, que ces travaux (et a fortiori mon exemple)n’ont pas, dans la perspective d’Allais, de pertinence pour laquestion de ce que la rationalité doit être. On ne tire pas d’unfait une norme : est rationnel un comportement qui s’attache àcalculer, en termes de coûts et de bénéfices, ce qu’il faut fairedésormais. Allais, en bon rationaliste, se place « sur le plan dela raison [...] et non sur celui de la psychologie"ìó ».
L E T E M P S E T L E R É E L
Le sophisme de l’amortissement s’oppose au principe d’Allais,selon lequel seul l’avenir compte rationnellement. Le passé nesaurait être changé"; mais dans l’avenir tout (ou presque) est
37.\Ibid., p. 313.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
119
C H R I S T I A N I S M E É P I S T É M O L O G I Q U E . . .
possible. Or, Dupuy récuse la métaphysique qui, implicitement,sous-tend le principe d’Allais, ce principe qui fait du passéquelque chose auquel nous n’avons plus accès. S’inspirant enpartie de la métaphysique des mondes possibles du philosopheaméricain David K. Lewis, Dupuy soutient la réalité de ce qu’ilappelle le « temps du projet ». Le « temps du projet » s’opposeau « temps de l’histoire », car celui-ci est linéaire et progressif,alors que celui-là (le projet) est récursif : le temps fait une bouclede telle sorte que « l’événement annonciateur [apparaît] commel’inscription dans le passé du futur contingent qu’il annonce"ìò ».Ce « temps du projet, dit-il, correspond à l’une des formes queprend l’expérience humaine du temps"ìô ». Quelle expérience"?Celle, sans doute, de savoir que l’horizon de l’avenir n’est pas– contrairement à ce que prétendent le principe d’Allais et larationalité qui sous-tend le temps de l’histoire – aussi ouvertque cela"; qu’il est même passablement bouché. Qu’on songe iciaux perspectives que Dupuy évoque lui-même, en particulier lapossibilité d’un meltdown économique (et donc politique), celled’une catastrophe climatique (qui fait déjà partie de notre présent)et celle d’une guerre nucléaire. Face à cet avenir sous menaceet en partie fortement déterminé, il faut, selon Dupuy, penserle temps, et notre rationalité face au temps, d’une toute autremanière : une manière qui reconnaît, contrairement à la méta-physique de la temporalité que nous adoptons spontanément,que le futur possède une certaine réalité déjà. Voilà pourquoiDupuy récuse le fameux Principe de précaution. Ce principeprend pour fondement de l’action présente l’incertitude radi-cale quant à l’avenir : parce que nous ne pouvons savoir leseöets à long ou à moyen terme de l’emploi de telle ou telletechnologie, mieux vaut être précautionneux. Mais, répondDupuy, cette incertitude est marginale par rapport à tout cequ’on sait de l’avenir, tout ce qui est déjà tracé. La question quise pose est donc celle de la liberté de l’être humain face à uneapparente surdétermination de son futur. Si cette liberté n’est pasen rapport avec l’avenir, où se situe-t-elle"? Or, cet avenir touttracé, cet horizon figé, c’est nous qui l’avions créé, nous l’avonsfait avec les mêmes ressources de l’agir rationnel qui nous
38.\Ibid., p. 349.39.\Ibid., p. 334.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
120
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 3
permettent de croire à présent en notre souveraine liberté de lechanger. Que pouvons-nous faire maintenant"? Dans son article« Counterfactual Consequences » Dupuy cite Lewis, et je reprends(en la traduisant) sa citation :
Ce que nous pouvons faire afin de « changer le futur » (pourainsi dire) est d’agir de telle sorte que le futur se présente ànous comme il sera réellement, plutôt que comme une des autrespossibilités qui auraient pu se réaliser si nous agissions diöé-remment dans le présent. Cela ressemble réellement à un chan-gement. Nous pesons dans la balance [we make a diöerence].Mais il ne s’agit pas d’un changement au sens littéral, puisque ladiöérence eöectuée par nous est celle qui distingue la réalité[actuality] d’autres possibilités, et non celle qui distingue entre desréalités qui se succèdent. La vérité au sens littéral est ceci : le futurdépend contrefactuellement du présent. Cela dépend, en partie,de ce que nous faisons maintenant"îê.
D’autres philosophes, à part Lewis, et sans avoir recours auxmondes possibles, ont soutenu que le temps linéaire, le « tempsde l’histoire », est bien plus rempli de paradoxes que nous nevoudrions le croire. Le logicien anglais Michael Dummett, dansses conférences Dewey, publiées sous le titre de Truth and thePast"îë, montre comment une métaphysique du temps qui relèved’une perspective similaire à celle présupposée par la maximede Maurice Allais aboutirait à la thèse selon laquelle le passén’a d’existence que dans le présent. Qu’en est-il alors de lavaleur de vérité d’énoncés à propos du passé"? Si nous aúrmonsqu’ils ne portent que sur le présent, nous nous trouvons devantle paradoxe suivant : un énoncé vrai à propos d’un événementpassé aurait été vrai au moment de l’événement, mais ne seraitplus vrai maintenant. Allons-nous admettre un tel conditionne-ment temporel de notre notion de vérité : le faire équivaudraità abandonner toute possibilité de parler du passé dans des termes
40.\David K. LEWIS, « Counterfactual Dependence and Time’s Arrow », PhilosophicalPapers II, Oxford, 1986"; cité in J.-P. DUPUY, « Counterfactual Consequences ».41.\Michael DUMMETT, « Truth and the Past », The Journal of Philosophy, vol. C, n• 1,janvier 2003, p. 5-53. Une version assez largement remaniée de ces articles a étépubliée plus récemment dans un livre, Truth and the Past, Columbia University Press,2004"; toutes les références vont cependant à la première version. Dummett revientdans ces textes à des thématiques traitées dans la première partie de sa carrière,notamment dans « Can an eöect precede its cause"? » (1954), « Bringing about the past »(1964) et « The reality of the past » (1969)"; les trois articles ont été réunis dans sonrecueil : Truth and other Enigmas, Duckworth, 1978.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
121
C H R I S T I A N I S M E É P I S T É M O L O G I Q U E . . .
objectifs. Une métaphysique cohérente requiert par conséquentla réalité métaphysique du passé.
À propos du temps futur, le philosophe anglais C. D. Broadsoutenait, dans son livre Scientific Thought de 1923 (tout commele rationaliste de la maxime d’Allais), que le futur ne peut avoird’existence réelle, puisque nous ne pouvons avoir aucunevérification dans le présent à propos d’un énoncé portant surle futur : lorsque nous aurons cette vérification, le temps quipour nous, maintenant, est le futur sera le présent. Il y a, pourBroad comme pour beaucoup de personnes, une asymétrieradicale et indépassable dans le rapport entre temps passé ettemps futur. Or, comme le dit Dummett, cette asymétrie n’est pas« trouvée » dans le temps, passé ou futur : elle est introduite parle langage dans lequel nous parlons du temps. La connaissanceque nous avons du temps est conditionnée par une asymétriesémantique, donnant l’impression que le passé est fixe et le futurfluide"; sinon, nous ne saurions changer le futur, de la mêmefaçon que nous ne pouvons changer le passé. Mais cette pers-pective relève causalement, selon Dummett, d’une illusion selonlaquelle la vérité présente doit déterminer l’action future. Enréalité, la vérité à propos de l’avenir « agit » dans le sens contraire :une proposition faite maintenant à propos de ce que je vais faireest vraie en vertu de mon action future. Notons qu’elle est vraie :le futur apporte une confirmation, mais une confirmation quin’enlève rien ni à ma liberté présente ni, étrangement, à lavérité présente de la proposition. La prédiction de Jésus à proposdu reniement de Pierre n’a pas contraint Pierre de renier"; laprédiction était vraie parce que Pierre l’a renié. C’est pourquoiDummett peut dire :
Si des énoncés à propos du futur acquièrent une valeur devérité seulement au temps sur lequel ils portent, les valeurs devérité seront relatives, non seulement au temps où les énoncéssont faits, mais au temps de l’évaluation"îí.
Il en va de même pour la prophétie de Jonas, à laquelle Dupuyconsacre de très belles pages dans Pour un catastrophismeéclairé : la prophétie était vraie au moment où Jonas traversaitla ville en criant « encore quarante jours... » Le fait que le peuple
42.\M. DUMMETT, p. 50.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
122
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 3
se couvre de cendres et se repente de ses péchés, et que Dieuse détourne de son intention de détruire la ville, n’enlève rienà la vérité de la prophétie. Et cela n’est pas un cas particulier,propre aux prophéties. Comme le dit Dummett, « le réel ne faitpas de distinction entre passé et futur"; dans le réel, il n’y a pasde maintenant"îì ». J’en conclus que la relativisation du temporelrecherchée par Dupuy ne doit pas forcément dépendre de lamétaphysique modale lewisienne, métaphysique qui soutientque les mondes possibles sont aussi réels que celui que nousconnaissons, et que prétendre le contraire c’est commettreessentiellement la même erreur que le solipsiste qui estime que,parce qu’il parle à la première personne (employant « je »), lemot « je » n’aurait d’autre dénotation que lui-même"îî. Les thèsesde Lewis ont toujours divisé les philosophes analytiques, en dépitde leur admiration pour l’évidente brillance de Lewis lui-même,qui disait de son système qu’il avait suscité « beaucoup de re-gards incrédules, mais peu d’eöorts de réfutation ».
CON C L U S I O N S
La question à laquelle je m’eöorce d’apporter une réponse estcelle-ci : un raisonnement en termes de mondes contrefactuel-lement possibles est-il à même de « sauver » le conséquentia-lisme du causalisme"? Si, comme le croit – ou croyait – Dupuy,la réponse est oui, le conséquentialisme est « sauvé », mais à laseule condition que Dupuy ait raison d’avoir identifié le problèmedans le causalisme"; car, comme je le crois, un autre élément duconséquentialisme peut être à l’origine des diúcultés que connaîtla doctrine. Et dans ce cas, la métaphysique déroutante desmondes possibles n’est d’aucune aide.
Selon Philippa Foot"îï, les adversaires du conséquentialismese font piéger par des interrogations du genre : « Est-il moralementjustifiable d’agir de telle sorte que les eöets de mon actionproduiront une situation moins bonne (avec moins de bonheur,
43.\Ibid.44.\Frédéric NEF, Qu’est-ce que la métaphysique"?, Paris, Gallimard, « Folio », 2004,p. 674 s.45.\Philippa FOOT, « Utilitarianism and the Virtues », Mind, 94, 1985, in S. SCHEFFLER (éd.),Consequentialism and its Critics, Oxford University Press, 1988.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
123
C H R I S T I A N I S M E É P I S T É M O L O G I Q U E . . .
contenant plus de souörance, etc.) que si j’avais agi autrement"? »Mais l’idée qu’il y ait des situations qui sont moralement bonnesou mauvaises ne va pas de soi. Pourtant, le nier équivaudrait,semble-t-il, à « nier que la bienveillance est une vertu » et quele bonheur peut faire partie de la morale. « Le pas subtil maiscrucial de l’utilitariste, dit Philippa Foot, est de prendre labienveillance pour la vertu tout entière », et de supposer quela perfection dans cette seule vertu conduit inévitablement àadmettre la justesse « de toute action dont on peut dire qu’il esthautement probable qu’elle augmentera la somme du bonheurhumain"îñ ». Une telle perspective place le critère de l’évaluationmorale des actions humaines à l’extérieur de l’agir comme safinalité et son achèvement, alors que l’idée du bien-être a uneplace limitée, mais légitime, à l’intérieur de la morale. « Leconséquentialisme, sous une forme ou l’autre, découle de laprémisse selon laquelle la morale serait un dispositif en vue dela réalisation d’une certaine fin partagée"îó. »
Je souscris entièrement à cette analyse, et je pense que Dupuyconviendra que sa propre position, qu’il ait pu ou non se dé-barrasser du causalisme, relève de l’idée que la morale existe« en vue d’une certaine fin partagée ».
Dupuy dénonce, à juste titre, les philosophies morales quise contentent d’aúner leurs principes à application restreinte(aux seules sociétés démocratiques, ou aux seuls groupes homo-gènes, nations, Églises ou communautés), alors que les mauxqui assaillent le monde deviennent plus eörayants chaque jour.Rawls, comme Michael Walzer"îò, prétend qu’à l’échelle mondialela morale sera nécessairement thin (mince, sans réelle substance),et certains arguments soutenus par Williams dans son livreessentiel Ethics and the Limits of Philosophy"îô vont dans le mêmesens. Faux, répond Dupuy : « le point de vue moral universel,c’est que partout il y a des victimes, et c’est sur cette base qu’ilfaut bâtir une éthique forte et néanmoins acceptable par tous.
46.\Ibid., p. 237.47.\Ibid., p. 241.48.\Michael WALZER, Thick and Thin : Moral Argument at Home and Abroad, NotreDame University Press, 1999.49.\B. WILLIAMS, Ethics and the Limits of Philosophy, Harvard University Press, 1985";trad. fr. M.-A. Lescourret, L’Éthique et les limites de la philosophie, Paris, Gallimard,1990.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
124
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 3
Car, comme déjà Hobbes l’avait compris, s’il existe une pluralitéirréductible de conceptions du bien, il n’existe qu’une concep-tion du mal radical"ïê ».
Comment alors parvenir à « une éthique forte et néanmoinsacceptable par tous »"? La réponse de Dupuy est en gros cellede Hans Jonas : on doit la bâtir, non pas sur un fondementeudémoniste (aristotélicien, chrétien ou utilitariste), mais sur soncontraire, une « heuristique de la peur"ïë » susceptible de nousguider d’un pas, sinon sûr, du moins suúsamment prudent pouréviter la catastrophe. Autrement dit, c’est le mal qui va devoirêtre, si je puis dire, notre « lumière » ou notre « boussole » dansla détermination de nos actes, dans le choix de nos conduiteset dans l’évaluation de notre succès, dans le but, précisément,de l’éviter. Alors que le bien dans notre monde contemporainse fait discret, le mal, comme disait déjà Dupuy dans un articlede mai 2001, « il faudrait être aveugle pour ne pas le voir"ïí ».Un sceptique pourrait répondre, dans un esprit humien, que lemal ne se laisse pas saisir par des évidences : la dague est plantéedans le dos de la victime, qui gît par terre dans une flaque desang"; il y a des maux (pour sa veuve, son fils, les employés dela société qu’il dirigeait), mais où est le mal"? Je crois que laréponse de Dupuy consisterait à nous renvoyer, d’abord, avecJonas"ïì, à notre relative impuissance éthique devant les mauxqui demain – aujourd’hui"! – rendront dérisoires nos délibérationsà petite échelle à propos de nos droits, devoirs et vertus"; ensuite,avec Ivan Illich, au fait que ces maux sont le fruit du « détourde production » capitaliste et industriel dont nous refusons encorede reconnaître la profonde irrationalité"ïî"; et enfin, avec RenéGirard, au fait que nous ne sommes pas encore, deux mille ansaprès la mort du Christ, conscients des pièges que nous tend laviolence humaine.
50.\« Les béances d’une philosophie du raisonnable. Sur John Rawls », p. 15.51.\Hans JONAS, Le Principe Responsabilité, Paris, Éd. du Cerf, « Passages », trad.J. Greisch, 1990.52.\J.-P. DUPUY, « Le détour et le sacrifice. Ivan Illich et René Girard », Esprit, mai 2001,p. 29.53.\« La technique moderne, dit Jonas, a introduit des actions d’un ordre de grandeurtellement nouveau, avec des objets tellement inédits et des conséquences tellementinédites, que le cadre de l’éthique antérieure ne peut plus les contenir » (Le PrincipeResponsabilité, p. 24).54.\J.-P. DUPUY, Pour un catastrophisme éclairé, chapitre 2.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
125
C H R I S T I A N I S M E É P I S T É M O L O G I Q U E . . .
L’explication de l’attachement de Dupuy aux mondes pos-sibles se trouve dans une certaine vision de la liberté humainequi est, en quelque sorte, « solidaire » de la rationalité scienti-fique. Les philosophes qui partagent cette perspective – et ilfaudrait sans doute compter Popper parmi eux – peuvent êtrequalifiés (comme Popper le disait de lui-même"ïï) de partisansd’un « naturalisme méthodologique » : ils considèrent (et je croisque Dupuy considère) que les sciences de l’homme, et en par-ticulier la tâche d’expliquer et d’évaluer l’action humaine, fontpartie intégrante de la science tout court. Un savoir est évaluéselon les mêmes critères, qu’il s’agisse de quarks et de galaxiesou de ce que Dupuy appelle « nos dérisoires querelles de fa-milles, fussent-elles l’unique bois dont l’humanité se chauöe"ïñ ».Personnellement, je suis bien plus proche de la position défenduedans plusieurs endroits par Charles Taylor. Taylor, commeHeidegger, estime que le problème avec cette « tradition épis-témologique » est qu’elle oublie que nous sommes des corps dansle monde, qu’il y a une sorte de background, d’arrière-plan, dela connaissance et de la rationalité, qui ne saurait être réintégrédans le raisonnement philosophique après coup. Cela peut pa-raître paradoxal d’accuser Dupuy de raisonner en philosophe« désengagé », lui qui fait des pieds et des mains pour que nousprenions conscience des dangers qui menacent le monde. Maisle problème ne se situe pas dans la perception des dangers, oude quoi que ce soit d’ailleurs : le problème est d’avoir « penséla pensée » à partir d’un modèle, celui de la raison calculante.Taylor lui oppose la notion heideggérienne de Lichtung ou« éclaircie », qu’il définit comme « le fait pur et simple que toutapparaît, ou vient à la lumière ». Il ajoute : « ce phénomènecentral de l’expérience ou de ”l’éclaircie“ n’est pas rendu intel-ligible par la démarche épistémologique, ni sous sa varianteempiriste ni sous sa variante rationaliste"ïó ». Je ne suis pasheideggérien, mais je me risquerai à un rapprochement entre
55.\Karl R. POPPER, The Poverty of Historicism, Routledge, 1961.56.\J.-P. DUPUY, Éthique et philosophie de l’action, p. 429.57.\Charles TAYLOR, « Le dépassement de l’épistémologie », in J. POULAIN (dir.), Critiquede la raison phénoménologique, Paris, Éd. du Cerf, « Passages », 1991, p. 124. L’articlede Taylor est essentiel à la compréhension de l’emprise du modèle épistémologiquesur nos raisonnements, aussi bien « pratiques » que « théoriques » : dans une phraseétonnante, il incite à « en venir aux mains avec l’épistémologie ».
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf
126
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 3
cette notion et celle de l’intuition fondamentale girardienne aveclaquelle j’ai commencé : l’intuition du désir mimétique. S’il s’agitlà d’un savoir – ce dont je n’ai pas le moindre doute –, il mesemble que ce savoir vient d’une profonde perception pré-épistémologique de la vérité. Il me semble qu’un christianismecompatible avec le naturalisme méthodologique ne peut êtrequ’un christianisme épistémologique. Ce n’est pas à moi dedécider s’il s’agit ou non du « vrai » christianisme"; je crois, detoute façon, qu’une telle question ne saurait recevoir une ré-ponse cohérente. Mais il est légitime de se demander si unephilosophie morale qui découle de cette perspective pourrait êtreintégralement compatible avec la morale chrétienne, ou si, aucontraire, elle risque de ne se démarquer du conséquentialismeque de façon marginale"ïò.
R o n a n S h a r k e yEnseignant en éthique à la Faculté de philosophie,
Institut catholique de Paris
58.\Je tiens à remercier Yann Schmitt pour sa bienveillante lecture critique du présentarticle.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- SH
ARKE
Y R
onan
- 92
.142
.225
.145
- 11
/06/
2013
22h
04. ©
Edi
tions
du
Cer
f D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - SHAR
KEY Ronan - 92.142.225.145 - 11/06/2013 22h04. ©
Editions du Cerf