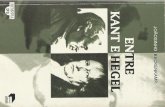Philosophie moderne : Kant 7
Transcript of Philosophie moderne : Kant 7
La dialectique transcendantale
Le but de la logique transcendantale consistait à élaborer une théorie de la connaissance et à montrer comment la sensibilité et l'entendement peuvent conjointement produire ou prouver des jugements empiriques ainsi qu'a priori.Pourquoi le projet critique de Kant ne s'arrête-t-il pas là ?
La dialectique transcendantale
Jusqu'ici, Kant n'a guère parlé de l'erreur et de la fausseté. Or, il est clair que l'échec de la connaissance est possible. Kant s'en rend compte et traite de l'erreur (ou de certaines sortes d’erreur) dans la dialectique transcendantale.Il définit la dialectique comme la « logique du faux-semblant » (Logik des Scheins).
La dialectique transcendantale
Dans le contexte de son analyse des conditions de la possibilité de l'expérience, cette logique doit donc considérer comment les facultés qui sont capables de reconnaître des vérités empiriques ainsi qu'a priori peuvent aussi produire des faussetés.
La dialectique transcendantalePour commencer cette enquête, Kant nous rappelle que « [t]oute notre connaissance débute avec les sens, passe de là à l'entendement et se termine par la raison » (332).La raison (Vernunft) est définie comme « le pouvoir des principes » tandis que l'entendement (Verstand) est « le pouvoir des règles ».Ici, « principes » est effectivement une traduction de « Prinzipien » et non pas de « Grundsätze » (= principes de base) comme dans la logique transcendantale.
La dialectique transcendantale
Quelles erreurs peuvent se produire ?Kant : différentes sortes d'erreur- au niveau des sens il n'y a pas d'erreurs parce qu'il
n'y a pas de jugements- l'entendement peut bien produire de faux
jugements (jugements empiriques)- au niveau de la raison il y a des erreurs
systématiques et inévitables (des jugements synthétiques a priori qui sont faux ou indécidables)
La dialectique transcendantale
Kant ne traite pas de façon systématique des erreurs produites par l'entendement, c'est-à-dire par l'application des catégories. Le seul cas qu'il discute brièvement est l'illusion d’optique, qu'il caractérise comme une « influence inaperçue de la sensibilité sur l'entendement » (300).
La dialectique transcendantale
Les erreurs produites par la raison font l'objet de la dialectique transcendantale. Kant montrera que la raison s'embourbe dans certaines fautes de raisonnement et même dans des contradictions de manière systématique et inévitable. Ce faisant, Kant présente une critique probante de toute métaphysique existante (voir l’article Kant’s Critique of Metaphysics dans la Stanford Encyclopedia)
La dialectique transcendantale
Il convient de rappeler le but explicite de la CRP, à savoir l’élaboration de réponses justifiées aux questions :Comment les mathématiques pures sont-elles possibles ?Comment la science naturelle pure est-elle possible ?Comment la métaphysique est-elle possible ?
La dialectique transcendantale
Les réponses kantiennes : - Les mathématiques pures (synthétiques, a
priori) sont possibles grâce aux formes de l’intuition originairement subjectives, l’espace et le temps (voir l’esthétique transcendantale)
- La science naturelle pure (synthétique, a priori) est possible grâce aux principes de l’entendement pur (voir l’analytique des principes dans la logique transcendantale)
La dialectique transcendantale
Les réponses kantiennes : - La métaphysique est impossible parce que
toute tentative de prouver des principes synthétiques a priori ne génère que des sophismes (à montrer dans la dialectique transcendantale)
Afin de prouver cela, Kant analyse trois idées transcendantales (non-empiriques), à savoir les idées de l’âme, du monde et de Dieu
La dialectique transcendantale
Kant procède dans la dialectique de façon parfaitement analogue à la logique transcendantale : le point de départ est la forme logique de certains jugements. Ensuite, il montre que chacune de ces formes correspond à un concept a priori, une idée de la raison pure. Mais par contraste aux concepts purs de l'entendement, ceux de la raison n'ont pas d'objet.
La dialectique transcendantale
D’abord, Kant veut montrer qu’il existe exactement trois idées transcendantales que l’on peut comprendre comme des concepts a priori de la raison pure.Ces concepts sont différents par rapport aux concepts a priori de l’entendement pur, qui voit ses capacités complètement épuisées et mesurées par la table des catégories.
La dialectique transcendantale
Les concepts de la raison pure sont le résultat d’une application des catégories hors du domaine du sensible, à savoir à l’unité même de la conscience donnant le concept de l’âme, à la totalité des phénomènes donnant le concept du monde et à la totalité des conditions d’existancedonnant le concept de Dieu.
La dialectique transcendantale
« Sur le même modèle [celui de l'analytique transcendantale, M.W.] nous pouvons espérer que la forme des raisonnements, si on l'applique à l'unité synthétique des intuitions selon la norme fournie par les catégories, contienne la source de concepts particuliers a priori que nous pouvons nommer concepts purs de la raison ou Idées transcendantales, et qui détermineront, d'après des principes, l'usage de l'entendement dans la totalité de l'expérience considérée dans son entier. » (347)
Les idées transcendantales
« J'entends par Idée un concept nécessaire de la raison auquel aucun objet qui lui corresponde ne peut être donné dans les sens. Ainsi nos concepts purs de la raison, à l'examen desquels nous procédons actuellement, sont-ils des Idées transcendantales. » (350)
Les idées transcendantales
« Or, bien que force nous soit de dire, à propos des concepts transcendantaux de la raison : ils sont simplement des Idées, nous n'aurons pourtant nullement à les considérer pour superflus et vains. » (351)
Les idées transcendantales
Kant commence comme d'habitude en considérant les différentes formes de jugement possibles. Ensuite, il vise à montrer qu'à chacune correspond exactement un concept a priori.
Les idées transcendantales
« De la relation naturelle que l'usage transcendantale de notre connaissance, aussi bien dans les raisonnements que dans les jugements, doit entretenir avec l'usage logique, nous avons déduit qu'il n'y aura que trois sortes de raisonnements dialectiques. » (354)
Les idées transcendantales
Question : Qu'est-ce que Kant entend par « l'usage transcendantal » ici ?C'est un usage qui « s'étend au delà des limites de l'expérience » (331)Cet usage semble être caractérisé par une certaine relation avec « l'usage logique »
Les idées transcendantales
Donc, comme d'habitude, Kant part d'un principe logique. En considérant la méthode de déduction (syllogisme), il note que la raison a tendance à toujours compléter un raisonnement en ajoutant des prémisses.
Les idées transcendantales
Exemple (pas de Kant ) :Tous les êtres humains sont mortels.Tous les philosophes sont des êtres humains.Donc tous les philosophes sont mortels. Pourrait être complété par :Tous les philosophes sont des savants, et tous les savants sont des êtres humains.etc.
Les idées transcendantales
Exemple (pas de Kant ):Tous les êtres humains sont mortels.Tous les philosophes sont des êtres humains.Donc tous les philosophes sont mortels. Ou encore :Tous les êtres humaines sont des animaux et tous les animaux sont mortels.etc.
Les idées transcendantales
Pour chaque condition pensée dans un jugement, la raison cherche une autre prémisse (=explication) jusqu'à ce qu'elle arrive à l'inconditionné (=l'inexplicable).
Les idées transcendantales
Or, Kant propose qu'il y a trois relations que les jugements de premier ordre peuvent entretenir :(1) au sujet(2) au divers des objets dans le phénomène(3) à toutes choses en général
Les idées transcendantales
La première relation contient « l'absolue (inconditionnée) unité du sujet pensant » et correspond au jugement catégoriqueLa deuxième « l'absolue unité de la série des conditions du phénomène », correspondant au jugement hypothétiqueLa troisième « l'absolue unité de la condition de tous les objets de la pensée en général », correspondant au jugement disjonctif
Les idées transcendantales
Kant propose que la première unité contient l'idée de l'âme et donc constitue la base d'une psychologie rationnelle.La deuxième contient l'idée du monde (la totalité des phénomènes) et peut servir de base à une cosmologie rationnelle.La troisième contient l'idée d'un « être de tous les êtres » et donc la base d'une théologie rationnelle.
Les idées transcendantales
Donc peut-être ce que Kant veut dire c'est que les concepts de l'âme, du monde et de Dieu sont les concepts les plus fondamentaux qui ne peuvent pas être expliqués par d'autres concepts. Toute série d'explications doit s'arrêter là. C'est dans ce sens que les idées transcendantales sont "inconditionnées". Mais cependant elles n'ont pas d'objet parce qu'elles n'ont aucun rapport à la sensibilité.
La dialectique
La dialectique de la raison pure consiste en trois types de sophismes :Les paralogismes concernent l'idée de l'âme.Les antinomies concernent l'idée du monde.L'idéal de la raison pure concerne l'idée de Dieu.Tous les sophismes sont le résultat d’une application des catégories hors du domaine de la sensibilité.
La dialectique
La dialectique de la raison pure consiste en trois types de sophismes :Les paralogismes concernent l'idée de l'âme.Les antinomies concernent l'idée du monde.L'idéal de la raison pure concerne l'idée de Dieu.Tous les sophismes sont le résultat d’une application des catégories hors du domaine de la sensibilité.
Les paralogismes de la raison pure
Le paralogisme logique : « la fausseté formelle d'un raisonnement, quel qu'en puisse être par ailleurs le contenu » (360)Le paralogisme transcendantal : « possède un fondement transcendantal qui incite à produire des conclusions formellement fausses » (360).
Les paralogismes de la raison pure
Des paralogismes sont à la base d'une psychologie rationnelle (qui est fausse !) dont le seul principe est :Je pense.
Les paralogismes de la raison pure
Quel est le résultat si les catégories sont appliquées au « Je pense » (ou tout simplement au « Je »)?NB: Le « Je » n'est formellement pas un concept mais « une simple conscience accompagnant tous les concepts » (362).
Les paralogismes de la raison pure
Quel est le résultat d'une application des catégories au « Je (pense) » ?Kant propose qu'une telle application produit quatre principes :
Les paralogismes de la raison pure
Quel est le résultat d'une application des catégories au « Je (pense) » ?Kant propose qu'une telle application produit quatre principes :
Les paralogismes de la raison pure
1. L'âme est substance
2. Qualitativement simple 3. À travers les divers temps où elle existe, numériquement identique
4. En rapport avec des objets possiblesdans l'espace
1. Le paralogisme de la substantialité
Prémisse : « Ce dont la représentation est le sujet absolu de nos jugements, et par conséquent ne peut être utilisé comme détermination d'une autre chose, est substance »Prémisse : « En tant que pensant, je suis le sujet absolu de tous mes jugements possibles, et cette représentation de moi-même ne peut pas être utilisée comme prédicat d'une quelconque autre chose »Conclusion : « Donc, en tant qu'être pensant (âme), je suis substance » (364)
2. Le paralogisme de la simplicité
Prémisse : « La chose dont l'action ne peut jamais être considérée comme le concours de plusieurs choses agissantes est simple. » (366)Prémisse : « Or, l'âme, autrement dit le Moi pensant, est une telle chose »Conclusion : l'âme / le Moi pensant est simple
3. Le paralogisme de la personnalité
Prémisse : « Ce qui possède une conscience de l'identité numérique de soi-même en différents temps est, comme tel, une personne. » (372)Prémisse : « Or, l'âme, etc. »Conclusion : l'âme / le Moi pensant est une personne
4. Le paralogisme de l'idéalité
Prémisse : « Ce à l'existence de quoi il ne peut être conclu que comme à celle d'une cause intervenant pour des perceptions données possède une existence seulement douteuse. » (375)Prémisse : « Or, tous les phénomènes extérieurs sont de telle sorte que leur existence ne peut être perçue immédiatement, mais qu'il ne peut qu'y être conclu comme à la cause de perceptions données. »Conclusion : « Donc, l'existence de tous les objets des sens externes est douteuse. »
L'invalidité formelle des paralogismes
Kant pense que cet argument est formellementerroné. Où est donc l'erreur logique ?
L'invalidité formelle des paralogismes
Kant montre que les paralogismes sont tous des instances d'une faute logique qui s'appelle sophisma figurae dictionis (aussi : quaternioterminorum)
L'invalidité formelle des paralogismes
« Si on veut donner un intitulé logique au paralogisme compris dans les raisonnements dialectiques de l'âme, en tant qu'ils ont tous des prémisses justes, on peut l'apprécier comme un sophisma figurae dictionis, où la majeure fait de la catégorie, par rapport à ses conditions, un usage purement transcendantal, alors que la mineure et la conclusion font de la même catégorie, relativement à l'âme qui est subsumée sous cette condition, un usage empirique. » (396)
L'invalidité formelle des paralogismes
La forme logique du paralogisme de la substantialité :Tous les sujets absolus de mes jugements sont des substances.Je suis le sujet absolu de mes jugements.Donc je suis une substance.(Le sujet absolu : ce qui ne peut pas être dit d'une autre chose)
Le sophisme figurae dictionis
Exemple :Les hommes sont les seuls animaux rationnels.Les femmes ne sont pas des hommes.Donc les femmes ne sont pas rationnelles.Ici, « homme » est un homonyme pour l'espèce Homo sapiens et le mâle de cette espèce.Donc il y a vraiment quatre termes au lieu de trois (=quaternia terminorum) ; il s'agit d'un sophisme.
Le sophisme figurae dictionis
Où est l'ambiguïté dans le paralogisme de la substantialité ?C'est le terme « substance » qui est utilisé dans deux sens différents dans le paralogisme :(1) Dans un sens transcendantal dans la
première (majeure) prémisse(2) Dans un sens empirique dans la deuxième
(mineure) prémisse