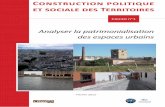À la recherche d’un nouveau regard : le Canada s’expose à Paris, 1900
Transcript of À la recherche d’un nouveau regard : le Canada s’expose à Paris, 1900
1
This is the original manuscript (preprint) of a book chapter published by CTHS and Presses de
l’Université Laval in Regards croisés sur le Canada et la France in 2007
http://cths.fr/ed/edition.php?id=4261
To cite:
Guillaume Evrard, « À la recherche d’un nouveau regard : le Canada s’expose à Paris, 1900 »,
in Regards croisés sur le Canada et la France, directed by Paul Guillaume and Laurier
Turgeon (Paris: Editions du CTHS; Québec: Presses de l’Université Laval, 2007), 329-346
A la recherche d’un nouveau regard : le Canada s’expose à Paris en 1900
Guillaume Evrard
Pour commencer, je souhaite faire appel à l’imagination de chacune et chacun d’entre vous en
vous invitant à visualiser mentalement la première image qui vous vient à l’esprit lorsque est
prononcé le mot « Canada ». Des frondaisons polychromes ? Les Rocheuses ? Le Saint-
Laurent ? La grande plaine ? La colline du Parlement, à Ottawa ? Des images mentales qui
peuvent nous venir en référence à une réalité existante, et ainsi nous faire nous évader, nous
faire voyager ; c’est ce dont il est question dans cet article, dans le cadre de ce colloque
annuel du CTHS placé sous le thème « Voyages et voyageurs » et, plus spécifiquement, de ce
colloque franco-canadien. Entre la recherche et la découverte : le voyage, le regard.
Maintenant, voyageurs que nous sommes, transportons-nous dans le temps, il y a cent
cinq ans exactement. L’Exposition universelle internationale de 1900 à Paris vient d’ouvrir.
L’affluence est grande. Le long du quai d’Orsay, la rue des nations fait sensation. Elle est
décrite avec enthousiasme comme « le plus magnifique bouquet monumental, la plus belle
anthologie d’architecture, le plus glorieux et le plus éblouissant qu’on puisse imaginer1 ».
Que leurs motivations soient politiques ou économiques, éducatives ou ludiques, les
Expositions sont, de manière générale, l'occasion d'une présentation, et donc, d'une mise en
scène qui vise à séduire et à convaincre le public. Dans ce contexte, les pavillons nationaux
qui représentent chaque pays participant deviennent progressivement un élément structurant.
En 1900, la tendance se confirme : la plupart des pays souverains proposent leurs pavillons
nationaux sur la rive droite de la Seine tandis que les colonies sont regroupées sur les pentes
de la colline de Chaillot.
A cette occasion, le Canada souhaite faire valoir ses atouts et améliorer son image,
dans l’esprit de ses participations aux Expositions internationales antérieures. Autrement dit,
le Canada est à la recherche d’un nouveau regard, tout spécialement à Paris, en 1900. Les
idées et les arguments voyagent de part et d’autre de l’Atlantique, pour, à leur tour, inciter des
hommes et des femmes au voyage transatlantique.
Dans une première partie, pour bien comprendre les enjeux dont il est question, il est
nécessaire de rappeler la situation internationale et diplomatique particulièrement défavorable
au Canada pour assurer convenablement sa représentation et la communication de son
message. Cette situation est défavorable aussi bien en règle générale que dans le contexte de
l’Exposition. Pourtant, dans une seconde partie, lorsqu’elle retient l’attention, la participation
canadienne parvient à se faire remarquer, de deux façons, soit dans un esprit de continuité,
soit grâce à la nouveauté ou à l’originalité de son contenu.
1 A. Carraud, Guide bleu du Figaro à l’Exposition de 1900, Paris, Le Figaro, Taride, 1900, p. 26.
2
I. Une situation politique et diplomatique défavorable au Canada
D’abord marqué de l'empreinte culturelle française, passé ensuite sous le pouvoir de la
Grande-Bretagne, puis menacé par les visées impérialistes des États-Unis, le Canada tente,
depuis l'Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867, de se forger sa propre identité.
D’une manière générale, le Canada subit les conséquences de sa position de « pays
semi-périphérique2 ». Il reste le sujet d’une influence majoritairement britannique puis
américaine et le destinataire « de formes économiques, de connaissances, de traditions et de
technologies3 » diffusées par ces deux puissances centrales – core societies
4.
Nouveau Premier ministre en juin 1896, Wilfrid Laurier a confirmé Lord Strathcona
comme chief emigration agent for Canada à Londres. Il doit y gérer les intérêts financiers du
Canada, encourager l’émigration, resserrer les liens entre le Dominion et la Grande-Bretagne,
et faire des comptes-rendus des questions intéressant Ottawa5. Tous les deux souhaitent
l'établissement d'une identité canadienne forte sur la scène internationale alors même que
l'impérialisme britannique reprend une certaine vigueur, à la fois favorable – dans la politique
d'incitation à l'émigration européenne vers le Canada – et défavorable aux intérêts du
Dominion – par exemple, en 1903, dans les accrochages entre le Canada et les États-Unis, sur
la frontière du Yukon. Le 19 juillet 1897, Wilfrid Laurier, invité à porter un toast lors d’une
réception à la chambre de commerce britannique à Paris, explique ainsi sa vision de l’avenir
canadien – en français : « A l’heure présente, nous sommes satisfaits de notre situation, de
notre rang ; mais il est évident que les relations présentes, si satisfaisantes qu’elles soient dans
le moment, ne sauraient toujours rester ce qu’elles sont. Un jour viendra où, par le seul effort
du développement de la colonie, le lien colonial si ténu, si léger qu’il soit, paraîtra lourd ; un
jour viendra où, par le seul effet de notre développement comme nation (car déjà nous
sommes une nation) nous aspirerons à quelque chose de plus6 ! »
Sans surprise, en cette fin de XIXe siècle, pas plus que lorsqu’il s’agit de gérer les
relations internationales quotidiennes du Dominion, les moyens et les initiatives du Canada ne
sont libres lorsqu’il est question d’organiser une Exposition universelle à Paris.
Depuis 1867, les projets que le Canada formule pour sa représentation lors des
Expositions internationales successives, en Europe comme aux Etats-Unis, sont bridés par le
contrôle exercé et les décisions prises par Londres. Plus largement, c'est non seulement la
Grande-Bretagne mais aussi l'ensemble de l'organisation coloniale britannique qui freinent les
initiatives du Canada.
Le 13 juillet 1892, le gouvernement français a publié un décret annonçant
l'organisation d'une Exposition à Paris, du 15 avril au 15 octobre 1900, sous la responsabilité
du Ministère du Commerce7. Le Canada ne figurait pas officiellement au nombre des
« cinquante-trois gouvernements priés de concourir à l'Exposition8, » mais le 24 avril 1897, le
gouvernement du Canada a annoncé son intention de participer officiellement à l'Exposition9,
2 H. H. Hiller, Canadian society: a macro analysis, Scarborough, Ont., Prentice Hall Canada Inc., 1996, p. 55.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 D. McDonald, Lord Strathcona: A biography of Donald Alexander Smith, Toronto et Oxford, Dundurn Press,
1996, p. 403. 6 Arch. nat., F
12 4238, Exposition universelle de 1900 à Paris, « Grande-Bretagne – Premiers pourparlers »,
British Chamber of Commerce in Paris, Monthly circular, Circular No. 32, Special Number, July 1897, p. 4. 7 R. Mandell, Paris 1900 : The Great World's Fair, Toronto, University of Toronto Press, 1967, pp. 30-32.
8 Décret du 4 août 1894, cité dans A. Picard, Rapport général administratif et technique, Paris, Imprimerie
nationale, Tome Premier, 1902-1903, p. 247. 9 Archives nationales du Canada (désormais ANC), RG72, Vol. 197, Dossier 103028-1.
3
probablement informé de l'invitation française par le Secrétariat d'État aux Affaires
coloniales, à Londres. En fait, le Ministère français des Affaires étrangères savait depuis le
mois d’octobre 1896 que Wilfrid Laurier était favorable à la participation canadienne, par un
courrier confidentiel reçu du Consul général de France à Montréal, M. Kleczkowski10
. Il est
intéressant de noter le rapport qu’a produit le diplomate sur la possibilité d’une participation
canadienne. Il notait : « […] les articles que le Canada serait susceptible d’exposer à Paris ne
constitueraient pas un ensemble très considérable. L’industrie du pays étant relativement peu
développée, les articles agricoles, forestiers et miniers composeront la presque totalité de
l’exposition canadienne. Quant aux beaux-arts, ils ne pourraient être représentés que par les
œuvres du petit nombre de peintres et sculpteurs canadiens dont la plupart ont fait ou
complété leurs études en France11
. »
Cependant, la décision du gouvernement britannique de participer à l'Exposition n'a
été transmise qu'en janvier 189812
. Le 17 février suivant, le prince de Galles a créé un Comité
colonial (Colonial Committee) pour coordonner les participations des colonies britanniques et
assurer le dialogue avec les organisateurs de l'Exposition. Le Canada a nommé Lord
Strathcona pour représenter le Dominion.
Conformément aux instructions des organisateurs, les expositions coloniales ont été
réunies dans les jardins du Trocadéro13
. Dès le mois de février 1898, 60 500 pieds carrés –
soit environ 5 620 mètres carrés – ont été réservés par la Grande-Bretagne aux colonies
britanniques, sur des terrains de l'Exposition14
. Le Canada a alors eu le choix de participer à
une exposition générale de l'Empire britannique avec les autres colonies et territoires, en
participant aux frais au pro rata de la surface d'exposition occupée, ou de construire, à ses
frais, un pavillon particulier. Mais le Dominion a dû attendre la décision du gouvernement
indien pour formuler auprès de la Commission royale ses demandes en matière de superficie
d'exposition15
.
En fait, avant même que ne se posât la question de la décision des autorités indiennes,
la superficie accordée aux colonies n’a pas satisfait les désirs du Ministère de l'Agriculture
canadien, qui aurait souhaité 60 000 pieds carrés pour sa seule participation. Dans de telles
conditions, des doutes ont été émis quant à la possibilité de présenter une exposition
satisfaisante des produits canadiens. Les autorités canadiennes considéraient avec envie les
300 000 pieds carrés alloués à la seule Grande-Bretagne16
. Lors des réunions du Comité
colonial, Lord Strathcona a même évoqué à plusieurs reprises l’absence du Canada s’il n’était
pas possible de présenter une exposition digne de sa position et de ses ressources17
.
Le 7 avril 1898, il a presque été conclu que le Canada n'obtiendrait qu'environ 12 000
pieds carrés – environ 1 100 mètres carrés, soit un peu plus d'un cinquième de ce qu'il
demandait, superficie pouvant s'étendre si des territoires d'Australasie – Australie, Nouvelle-
Zélande et Nouvelle-Guinée – n'exposaient pas18
. Le 18 avril, le colonel Herbert Jekyll,
10
Arch. nat., F12
4238, Lettre confidentielle du Ministère des Affaires étrangères adressée au Ministre du
Commerce le 28 octobre 1896, reçue par le Commissariat général de l’Exposition universelle le 23 décembre
1896. 11
Ibid. 12
Anonyme, « 1900. Great Britain and the Paris Exhibition. The part we shall play in it. », The Daily Chronicle,
19 janvier 1898. 13
Collectif, Report of His Majesty's Commissioners For the Paris International Exhibition 1900 To The King's
Most Excellent Majesty, London, William Clowes & Sons, Limited, 1901, pp. 64-65. 14
ANC, RG72, Vol. 196, Lettre de Lord Strathcona à Sydney Fisher, ministre de l'Agriculture, 5 mars 1898. 15
Ibid. 16
ANC, RG72, Vol. 196, Lettre de Sydney Fisher, à Lord Strathcona, 14 mars 1898. 17
ANC, RG72, Vol. 196, Lettre de Lord Strathcona à Sydney Fisher, 31 mars 1898 : « I went so far as to state at
the last Meeting, that if Canada was not enabled to make an exhibit worthy of her position and her resources, it
might be a question for consideration whether we should exhibit at all. » 18
ANC, RG72, Vol. 196, Lettre de Lord Strathcona à Sydney Fisher, 7 avril 1898.
4
secrétaire de la Commission royale, a fait parvenir au gouvernement canadien un premier plan
accompagné du montant des surfaces accordées à chaque territoire de l'Empire : le Canada
disposerait, de 11 000 pieds carrés – soit un plus de 1 000 mètres carrés – dans un pavillon
colonial partagé avec l'Australasie, les Colonies de la Couronne et l'Afrique du Sud, tandis
que l'Inde profiterait de 15 000 pieds carrés – soit presque 1 400 mètres carrés – dans un
pavillon qui lui serait entièrement consacré19
.
Le gouvernement du Dominion n’a perdu aucune occasion pour améliorer sa
situation dans l’Exposition. Le 6 mai 1898, Lord Strathcona envoyait une lettre à
Chamberlain, sous-secrétaire d’état aux colonies à Londres, pour plaider en faveur d’une
représentation du Canada et des autres colonies « auto-administrées » dans le Comité exécutif
de la Commission royale pour mettre un terme aux négociations difficiles en cours au sein du
sous-comité colonial20
. La démarche a porté ses fruits puisque le Canada a été invité, quelques
jours plus tard, à siéger au sein du Comité exécutif, aux côtés de l’Afrique du Sud et de
l’Australie21
. Au plus haut niveau, Wilfrid Laurier a été impliqué aux côtés du ministre de
l'Agriculture, pour plaider la cause canadienne auprès des autorités françaises au début de
mai22
. Mais la démarche est restée vaine. Au début de juillet 1898, le Ministère des Affaires
étrangères a rappelé au Ministère du Commerce le contenu de l’article 12 du Règlement
général de l’Exposition : « le Délégué officiel de chaque pays est seul chargé de traiter avec le
Commissaire général, les Directeurs généraux et les Directeurs, les questions qui intéressent
ses nationaux, notamment celles qui sont relatives à la distribution des espaces, etc.23
» Par
courrier du 28 juillet 1898, le Consulat de France à Montréal a transmis la réponse française
directement à Laurier, réponse qui soulignait notamment, sans détours, que « le
Gouvernement du Dominion n'est, pour l'Exposition de 1900, qu'un exposant particulier avec
lequel, conformément à l'article 12 du règlement général, l'administration ne peut
correspondre24
. » En mettant implicitement sur le même rang, par exemple, un exploitant
forestier de l'Ontario et le gouvernement du Dominion, cette réponse en disait long sur la
position du Canada et ses possibilités de diffuser le message qu'il souhaitait, dans les
meilleures conditions, sans avoir à passer par les arbitrages britanniques.
A l’automne 1898, la situation a connu un nouveau rebondissement avec une nouvelle
lettre du Consul général de France à Montréal, dont le contenu était résumé par une note
marginale : « Le Canada à l’Exposition de 1900. Urgence d’étendre la superficie accordée25
. »
Le diplomate plaidait en faveur du Canada auprès de l’administration centrale à Paris après la
publication, dans les premiers jours d’octobre, d’un télégramme dans le Courrier des Etats-
Unis, télégramme reproduit intégralement dans le courrier du Consul. En substance, il était
question d’un accroissement d’un quart de la superficie accordée aux Etats-Unis par le
Commissariat général de l’Exposition26
. Le Consul général expliquait : « La surface de douze
mille pieds carrés accordée à un pays qui en demandait soixante mille, paraît tellement
insuffisante que le gouvernement du Dominion n’est pas éloigné de renoncer à toute
participation à l’exposition. J’espère encore qu’il n’en viendra pas à cette extrémité. Mais ne 19
ANC, RG72, Vol. 196, Lettre de Herbert Jekyll à Lord Strathcona, 18 avril 1898. 20
ANC, RG72, Vol. 196, Lettre de Lord Strathcona à Chamberlain, sous-secrétaire d’état aux colonies à
Londres, 6 mai 1898. 21
ANC, RG72, Vol. 196, Lettre de Lord Strathcona à Sydney Fisher, 18 mai 1898. 22
ANC, RG72, Vol. 196, Lettre de Lord Strathcona à Sydney Fisher, 10 juin 1898 ; Arch. nat., F12
4238, Lettre
de Kleczkowski, Consul Général de France à Montréal, au Ministère des Affaires étrangères, à Paris, 14 octobre
1898. 23
Arch. nat., F12
4238, Projet de lettre du Ministre des Affaires étrangères au Ministre du Commerce, préparé
dès la mi-mai 1898, prête à être envoyée le 2 juillet 1898. 24
ANC, RG72, Vol. 196, Lettre de Duchastel, gérant du Consulat général de France à Montréal à Wilfrid
Laurier, 28 juillet 1898. 25
Arch. nat., F12
4238, Lettre de Kleczkowski, au Ministère des Affaires étrangères, à Paris, 14 octobre 1898. 26
Ibid.
5
ferons-nous aucun effort pour lui donner au moins une preuve de notre bonne volonté ? Sir
Wilfrid Laurier […] me presse d’agir auprès de Votre Excellence pour qu’un traitement
meilleur soit réservé au Canada. […] Le premier ministre est dans ce sentiment q’un pays que
tant de souvenirs rattachent à la France a droit à un traitement privilégié. Nous n’avons pas à
décourager une telle manière de voir27
. »
Il aura finalement été nécessaire d'attendre le 1 janvier 1899 pour que les superficies
fussent définitivement réparties : dans le pavillon colonial, 27 100 pieds carrés ont été
réservés au Canada28
. Ce processus a mis en évidence la sujétion du Dominion à l'égard de la
Grande-Bretagne pour les moindres détails de relations internationales – qu'est-ce qu'une
Exposition rapportée à l'ensemble du contenu des relations diplomatiques ? Retenons, de
manière significative, que le Canada a obtenu à peine la moitié de la surface souhaitée depuis
l'annonce de l'Exposition.
II. Malgré les difficultés, une certaine réussite de la participation canadienne
Le gouvernement du Dominion poursuit sa politique de communication par l'intermédiaire
des Expositions en présentant les produits canadiens dans l'ensemble des édifices thématiques.
Il souligne à nouveau l'importance et la qualité de ses productions céréalières : elles sont
l'élément central des expositions rassemblées dans le pavillon du Trocadéro. Les visiteurs y
sont accueillis par une statue monumentale du sculpteur québécois Philippe Hébert
représentant la reine Victoria qui tend au Canada, « représenté par une Canadienne gracieuse
et solide, la charte que lui confère ses droits29
». La Canadienne donne en échange une
couronne de laurier tandis qu'un lion symbolise « la force et le courage que le peuple canadien
emploie à défendre les libertés qu'on lui octroie30
». L'intérieur de l’édifice a été décoré par
Joseph-Omer Marchand (1872-1936), premier artiste canadien diplômé de l'École des Beaux-
arts de Paris. Les arcades cintrées en anse de panier dénotent l'influence de la Renaissance
française31
. Les compagnies de chemin de fer – le Canadien Pacifique et, pour la première
fois, le Grand Tronc – sont mises à contribution, et mettent en valeur la géographie
canadienne pour favoriser l'immigration et le tourisme32
. L'édifice au centre de Paris est
complété par un « pavillon des instruments agricoles », situé dans le Bois de Vincennes.
La participation du Canada à l'Exposition de 1900 est organisée par le Ministère de
l'Agriculture du Dominion. Elle peut donc être considérée comme l'un des instruments au
service de la politique d'immigration menée par le Canada depuis l'arrivée au pouvoir du
gouvernement libéral de Wilfrid Laurier et de Clifford Sifton, ministre de l'Intérieur,
responsable de cette politique et de la colonisation des terres des Prairies. Avocat et
journaliste, Sifton dynamise l'administration dont il a la responsabilité pour réussir enfin la
colonisation que les trente précédentes années du Dominion n'ont pu réaliser : l'objectif est de
faire venir dans les provinces centrales du Canada des agriculteurs et des ouvriers agricoles
capables de mettre en valeur les milliers d'hectares de terres arables encore disponibles,
27
Ibid. 28
Department of Agriculture, Canadian Commission for the Paris Exhibition, 1900: regulations and general
classification of exhibits, Ottawa, Government Printing Bureau, 1899, pp. xiii-xvi. 29
Charles-Bernard, "Le Canada à l'Exposition", Paris - Canada. Organe Bi-mensuel des intérêts canadiens et
français, vol. 18, No. 12, 15 juin 1900, p. 1. 30
Charles-Bernard, "Le Canada à l'Exposition VII - L'exposition artistique", Paris - Canada. Organe Bi-mensuel
des intérêts canadiens et français, vol. 18, No. 23, 1 décembre 1900, p. 1. 31
Ce motif se retrouve notamment à la façade des loges du château de Blois. 32
Charles-Bernard, "Le Canada à l'Exposition V", Paris - Canada. Organe Bi-mensuel des intérêts canadiens et
français, vol. 18, No. 17, 1 septembre 1900, p. 2.
6
notamment au moyen de publicités alléchantes33
. A cette fin, la présentation canadienne se
donne pour but, à travers l’ensemble de l’Exposition, de faire découvrir de nouveaux produits
ou de maintenir la réputation d’articles déjà connus. Elle se doit donc, dans l’esprit de ses
organisateurs, « de faire preuve d’un caractère national, d’être caractéristique des produits,
arts et manufactures, de la Puissance toute entière, sans considération du lieu d’origine34
. »
Les regards portés sur la participation canadienne adoptent soit un parti qui souligne
l’idée de continuité, soit un parti qui en met en valeur la nouveauté.
L’Exposition donne l’occasion au Canada d'affirmer une identité propre, distincte de
celle de la Grande-Bretagne. Cependant, c'est le drapeau de la puissance impériale qui flotte
au-dessus de l'entrée du bâtiment et non pas le drapeau du Dominion. Et les commentateurs
expriment une certaine confusion des sentiments : « Le pavillon canadien a une originalité
propre. On sent le lien politique avec l'Angleterre, mais aussi l'autonomie de l'œuvre
commune35
. » L'édifice est d'un intérêt esthétique assez limité. Abritée dans un édifice de
charpente et de staff au style officiellement dit « Renaissance anglaise36
», la présentation
canadienne pâtit du contraste défavorable créé par la proximité des autres colonies,
représentées de façon beaucoup plus pittoresque et exotique. Pour cette Exposition de 1900,
les organisateurs ont semblé ne pas imposer de contrainte esthétique particulière pour la
construction des pavillons nationaux et coloniaux37
. Pourtant, leur refus d'un premier projet de
pavillon canadien au printemps 1898 donne des indices sur leurs « ambitions architecturales »
: des pavillons de petites dimensions sont préférés à de grosses structures qui écrasent le
visiteur, vraisemblablement pour multiplier les styles architecturaux et ainsi augmenter les
dimensions pittoresque et exotique38
.
En matière de continuité, il faut souligner l’indifférence à l’égard de la participation du
Dominion, que les divers plans de l’Exposition expriment bien graphiquement. Sur le plan
général de l’Exposition universelle proposé à la fin du Guide bleu du Figaro à l’Exposition, le
Canada n’est pas du tout mis en valeur puisque son pavillon est réuni avec le pavillon indien
sous le vocable « Colonies anglaises »39
. A proximité, vers l’est, on trouve un restaurant
français, le pavillon de l’Egypte, au nord, les édifices des Indes néerlandaises, du Transvaal,
et immédiatement à l’ouest, l’ensemble dédié à l’Algérie.
Du côté du contenu éditorial des guides, maintenant. Dans L’Exposition pour tous, qui
veut « prendre le visiteur par la main et le promener partout dans l’Exposition, non à la façon
d’un guide aride, mais comme un compagnon aimable, soucieux de renseigner sans fatiguer,
de faciliter les moyens de tout voir et de bien comprendre tout ce qu’on voit, de donner une
attachante vue d’ensemble des choses, tout en signalant au passage les objets les plus dignes
33
V. Knowles, Strangers at our gates. Canadian Immigration and Immigration Policy, 1540-1990, Toronto et
Oxford, Dundurn Press, 1992, pp. 58-62. 34
Department of Agriculture, Op. cit., p. xvi. 35
Anonyme, Exposition universelle de 1900 : les plaisirs et les curiosités de l'exposition, Paris, Chaix, [1900], p.
278. 36
Arch. nat., F12
4238, « Grande-Bretagne – Renseignements statistiques, Questionnaire B. République
française. Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes. Exposition universelle
internationale de 1900. Direction générale de l’exploitation. – Installations générales. Renseignements
statistiques demandés. Pavillons Isolés, constructions et annexes dans les parcs et jardins, Puissance du
Canada. » 37
J. Allwood, The Great Exhibitions, Londres, Studio Vista, 1977, p. 101. 38
Coll., Report of His Majesty's Commissioners For the Paris International Exhibition 1900... Op. cit., p. 68 : «
[The desire of the French authorities] was that the ground should be occupied by a number of small pavilions
similar to those erected by Tahiti, Réunion, and Martinique, and that they should be as light and ornamental as
possible. » 39
A. Carraud, Op. cit.
7
d’attention40
, » les pentes de la colline de Chaillot sont décrites comme un « heureux mélange
de parcs élégants et de pittoresques constructions41
» mais il n’est fait absolument aucune
mention de la participation canadienne, pas même du pavillon qui l’abrite. Idem dans Le
Guide rapide illustré de l’Exposition42
.
Le Canada participe donc bien au « grand rendez-vous colonial43
» sur la colline de
Chaillot mais ce n’est pas lui qui retient l’attention : « Le groupe colonial de la Grande-
Bretagne comprend trois pavillons : indien, australien et canadien […]. Mais c'est le pavillon
indien qui frappera tout particulièrement la curiosité des visiteurs44
. » Le pavillon indien est
« la fidèle reproduction d’un palais hindou avec ses précieuses ornementations, ses boiseries
sculptées, ses vérandas45
. » A proximité immédiate, le contexte de la présentation canadienne
ne provoque pas l’enthousiasme : « Le palais [australo-canadien] relève d’un style qu’on est
convenu d’appeler style colonial et dans lequel on vise moins à l’élégance qu’au
confortable46
. »
Dans le registre de la continuité, on peut considérer tous les développements qui
soulignent le lien entre la colonie et sa métropole. La représentation canadienne est ramenée
au stéréotype habituellement attribué à la puissance coloniale, « le confortable anglais 47
».
L’emphase placée sur les éléments de continuité avec le passé ou de cohérence avec les
préjugés des visiteurs-lecteurs permet aux commentateurs d’abréger les développements
relatifs au Canada, pour se concentrer sur des présentations jugées symboliquement plus
importantes. Ce que fait, par exemple, le guide Paris et l’Exposition qui signale très
succinctement que « le Canada expose ses produits les plus beaux : échantillons agricoles,
fourrures, etc.48
» La description fait appel aux connaissances présumées du lecteur en
rappelant des informations supposées connues.
Par ailleurs, d’autres commentateurs se font fort de rappeler les liens historiques qui
unissent la France et le Canada, « ce pays qui nous a appartenu et où la littérature française est
toujours cultivée49
». La nostalgie, le regret ne sont pas absents de ces références historiques :
« C'est par l'abondance et l'extrême variété des produits exposés que la section canadienne
s'impose à l'attention. On éprouve une impression d'amère ironie en constatant la richesse de
ce beau pays lorsqu'on se souvient du mot de Voltaire : « quelques arpents de neige... » Qui
donc disait récemment que le Canada était actuellement la plus florissante de nos colonies ?
Colonie perdue, demeurée en partie française, et qui se souvient toujours de son ancienne
métropole50
. »
Et Quantin d’expliquer dans son guide de visite, L’Exposition du siècle : « Nombre de
Canadiens d’origine française ont gardé pour nous des sentiments d’affection. Mais il ne leur
est plus permis de servir la France sans agir en rebelles. Leur désir n’est pas de redevenir
Français, mais de rester Canadiens. Il ne faut pas s’hypnotiser dans des regrets stériles, et
nous ne pouvons que souhaiter aux Canadiens de savoir profiter pour eux-mêmes du
40
Anonyme, L’Exposition pour tous : visites pratiques à travers le palais : vue d’ensemble, les nouveaux palais
des Champs-Elysées, le pont Alexandre III et les palais de l’Esplanade des Invalides, Paris, Montgredien, 1900,
p. 6. 41
Ibid., p. 74. 42
Anonyme, Le Guide rapide illustré de l’Exposition, Paris, E. Cornély, 1900. 43
A. Carraud, Op. cit., p. 85. 44
Exposition universelle de 1900 : les plaisirs et les curiosités de l'exposition, Op. cit., p. 278. 45
A. Carraud, Op. cit., p. 103. 46
H. Lapauze, M. de Nansouty, A. da Cunha et alii, Le guide de l’Exposition de 1900, Paris, E. Flammarion,
1900, p. 344. 47
A. Carraud, Op. cit., p. 103. 48
Anonyme, Paris et l’Exposition, Paris, Impr. Cerf-Lévy, Guide H. Dorville, [1900], p. 251. 49
Exposition universelle de 1900 : les plaisirs et les curiosités de l'exposition, Op. cit., p. 279. 50
L. Meillac, « Canada », dans Collectif, Le Livre d’or de l’Exposition de 1900, Paris, E. Cornély, 1900, p. 314.
8
magnifique avenir promis à leur pays51
. »
L’exposition du Dominion se distingue finalement des autres pays par les « merveilles
de la faune et de la flore52
» qu’elle présente aux visiteurs, tout comme le fait l’exposition de
l’Australie. Les têtes de cerfs, de bisons, de rennes, d’élans et d’ours exposées incitent les
commentateurs à rappeler que « le Canada est le pays des grandes chasses53
. »
Dans le registre de la nouveauté, la transformation du regard porté sur le Canada déjà
observée à l’Exposition internationale de Chicago, en 1893, semble se poursuivre en 1900,
auprès du public européen, si l’on en croît le ministre canadien de l'Agriculture : « Pour la
première fois, depuis nombre de générations, on a définitivement mis au rancart et relégué
dans le domaine des fables du passé l'opinion surannée qui voulait que le Canada ne fût que
quelques arpents de neige. Aujourd'hui le Canada est connu comme une terre où le lait et le
miel coulent en abondance, et les peuples européens apprécient notre pays à sa juste
valeur54
. » Cette impression officielle est confirmée par Quantin. Il est formel : « Quant aux
‘arpents de neige’ dont parlait Voltaire pour se consoler de la perte du Canada, ils ont été, par
l’étalage de leur puissance productive, un des étonnements de l’Exposition55
. »
Henry de Varigny propose une description relativement détaillée du contenu de la
participation canadienne au Trocadéro : « […], le bâtiment consacré à l'exposition canadienne
est bien fait pour donner l'idée d'un pays étendu, de ressources variées, et prospère dans ses
entreprises56
. » Ses remarques sont soutenues par des références aux performances
économiques de chaque filière d’activité : les chasses et les pêches, l’extraction et la
transformation des minerais, l’agriculture, l’industrie du bois et du papier, etc. Dénuée de
préjugés et de clichés, et probablement largement inspirée par le contenu informatif de la
participation canadienne elle-même, la description analytique de Varigny est l’un des rares
comptes-rendus de visite à inciter le lecteur à consacrer une partie de son précieux temps et de
son énergie au pavillon du Canada au cours de son voyage immobile à travers l’Exposition :
« Il faut du reste visiter de très près le pavillon ; il est plein de renseignements et de faits ; des
tableaux et des photographies superbes l'ornent avantageusement, et par la multiplicité et la
variété des objets, il donne beaucoup à réfléchir ; il est très instructif, et c'est avec un plaisir
tout particulier qu'un Français le parcourt jusque dans ses moindres recoins, en admirant
l'ingéniosité et l'activité de ses frères d'outre-mer. Souvent même, il a le droit – si ce n'est le
devoir – de les envier…57
» Au détour de ses descriptions, Varigny démonte quelques
préjugés, favorisant la formation d’un nouveau regard porté sur le Canada. Soulignant d’abord
qu’ « il y a beaucoup de choses à voir dans le pavillon canadien58
», il remarque « une
industrie agricole locale qui n'est pas sans importance59
».
Je souhaitais analyser la transformation du regard porté sur la participation
canadienne : dans un premier temps, la recherche du Canada pour imposer ses vues et son
51
A. Quantin, L’Exposition du siècle, Paris, Le Monde moderne, [1900], p. 203. 52
A. Carraud, Op. cit., p. 103. 53
Exposition universelle de 1900 : les plaisirs et les curiosités de l'exposition, Op. cit., pp. 278-279. 54
Discours de Sydney Fisher, devant la Chambre des Communes à Ottawa repris dans Paris - Canada. Organe
Bi-mensuel des intérêts canadiens et français, vol. 19, No. 8, 15 avril 1901, p. 2. 55
A. Quantin, Op. cit., p. 202. 56
Henry de Varigny, « Le Canada et son Exposition », dans Collectif, L'Exposition de Paris (1900) publiée avec
la collaboration d'écrivains spéciaux et des meilleurs artistes, Paris, Librairie Illustrée, Montgredien et Cie, vol.
3, [1900], p. 206. 57
Ibid. p. 208. 58
Ibid., p. 206. 59
Ibid., p. 207.
9
image propre ; dans un second temps, la diversité des regards portés sur la participation du
Dominion.
Les tergiversations sur les superficies d'exposition accordées au Dominion, le manque
d'influence du gouvernement fédéral sur les conditions de sa propre présentation,
l'impossibilité de communiquer directement d'égal à égal avec les organisateurs de
l'Exposition, sont autant d'arguments – non exhaustifs – en faveur d'une plus grande
autonomie du Canada lors des Expositions internationales tant dans la phase de conception
que pendant l'évènement lui-même. Le statut colonial bride le Canada dans son expansion et
limite la communication de son message.
On comprend ainsi la création en 1901 de la Commission des expositions du
gouvernement canadien qui doit littéralement mettre en scène les produits canadiens de
manière plus efficace et plus frappante tandis que Laurier déclare que « le Canada est une
nation60
. » La création de cette Commission, révélatrice de l’émancipation progressive du
Dominion, porte ses fruits au niveau quantitatif : en 1915, lors de l’Exposition de San
Francisco, le pavillon canadien est le deuxième plus grand après celui de la Californie ; au
niveau qualitatif, lors de l’Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne
à Paris, en 1937, le Canada est libre de choisir une parcelle en bord de Seine, aux côtés de la
Grande-Bretagne et de la Belgique. Sur cette parcelle, au pied de la tour Eiffel, le
gouvernement canadien poursuit la promotion du tourisme au Canada et attire les regards par
un pavillon en forme de silo à grain.
La participation canadienne en 1900 s’inscrit dans le mouvement d’émancipation du
Dominion et, dans le regard des visiteurs, permet d’estomper ses arpents de neige à la faveur
de son potentiel agricole, industriel et touristique.
Résumé
Depuis que la Puissance du Canada a été constituée, elle a participé à de nombreuses
Expositions internationales, en Europe comme en Amérique. Promouvoir les produits
canadiens, stimuler l’économie et la démographie canadiennes, tels sont les objectifs
prioritaires traditionnellement choisis par Ottawa dans le cadre de sa participation, malgré les
difficultés engendrées par ses liens avec la puissance britannique.
En 1900, le Canada participe à l’Exposition universelle internationale de Paris. Encore
dépendant de la Grande-Bretagne, le Canada expose ses produits dans un pavillon installé
dans les jardins du Trocadéro. Ainsi, le Dominion figure sur l’itinéraire du voyage fictif à
travers le monde que rend possible l’Exposition internationale, sans sortir de Paris.
La participation canadienne en 1900 s’inscrit dans le mouvement d’émancipation du
Dominion et, dans le regard des visiteurs, permet d’estomper ses arpents de neige à la faveur
de son potentiel agricole, industriel et touristique.
Archives
Archives nationales, F12
4238, Exposition universelle de 1900 à Paris, « Grande-Bretagne –
Premiers pourparlers ».
60
Cité par H. Fabre, « Le Canada à l'Exposition », Paris - Canada. Organe Bi-mensuel des intérêts canadiens et
français, vol. 18, No. 6, 15 mars 1900, p. 1.
10
Archives nationales du Canada, RG72, Vol. 196-7. Paris Exhibition 1900 – Report of the
Canadian Commission at Paris, List of Awards made to Canada, Estimates, General File
Paris 1900, Claims, Plans, etc. (Exposition universelle de Paris, 1900. Rapport de la
Commission canadienne à Paris, Liste des récompenses décernées au Canada, Estimations,
Dossier général sur l’Exposition, Plaintes, Plans, etc.).
Bibliographie
Anonyme, L’Exposition pour tous : visites pratiques à travers le palais : vue d’ensemble, les
nouveaux palais des Champs-Elysées, le pont Alexandre III et les palais de l’Esplanade des
Invalides, Paris, Montgredien, 1900.
Anonyme, Exposition universelle de 1900 : les plaisirs et les curiosités de l'exposition, Paris,
Chaix, [1900].
Anonyme, Le Guide rapide illustré de l’Exposition, Paris, E. Cornély, 1900.
Anonyme, Paris et l’Exposition, Paris, Impr. Cerf-Lévy, Guide H. Dorville, [1900].
Anonyme, « 1900. Great Britain and the Paris Exhibition. The part we shall play in it. », The
Daily Chronicle, 19 janvier 1898.
Allwood, John, The Great Exhibitions, Londres, Studio Vista, 1977.
Carraud, Alexis, Guide bleu du Figaro à l’Exposition de 1900, Paris, Le Figaro, Taride, 1900.
Collectif, L'Exposition de Paris (1900) publiée avec la collaboration d'écrivains spéciaux et
des meilleurs artistes, Paris, Librairie Illustrée, Montgredien et Cie, vol. 3, [1900].
Collectif, Le Livre d’or de l’Exposition de 1900, Paris, E. Cornély, 1900.
Collectif, Report of His Majesty's Commissioners For the Paris International Exhibition 1900
To The King's Most Excellent Majesty, London, William Clowes & Sons, Limited, 1901.
Department of Agriculture, Canadian Commission for the Paris Exhibition, 1900: regulations
and general classification of exhibits, Ottawa, Government Printing Bureau, 1899.
Hiller, Harry H., Canadian society: a macro analysis, Scarborough, Ont., Prentice Hall
Canada Inc., 1996 (Troisième édition).
Knowles, Valerie, Strangers at our gates. Canadian Immigration and Immigration Policy,
1540-1990, Toronto et Oxford, Dundurn Press, 1992.
Lapauze, Henri, M. de Nansouty, A. da Cunha et alii, Le guide de l’Exposition de 1900, Paris,
E. Flammarion, 1900.
McDonald, Donna, Lord Strathcona: A biography of Donald Alexander Smith, Toronto et
Oxford, Dundurn Press, 1996.
Mandell, Richard D, Paris 1900 : The Great World's Fair, Toronto, University of Toronto