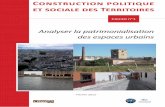TAZ 3D - Regard sur les Zones Autonomes Temporaires à l'Ere du Digital
Transcript of TAZ 3D - Regard sur les Zones Autonomes Temporaires à l'Ere du Digital
TAZ 92137536987
95
Stay Hungry Stay Foolish
E Mare Liberta
E Crypto Liberta
I’ll Be Back
3D
Références
11«La TAZ est comme une insurrec-tion sans engagement direct contre l’État, une opération de guérilla qui libère une zone (de terrain, de temps, d’imagination) puis se dissout, avant que l’État ne l’écrase, pour se refor-mer ailleurs dans le temps ou l’es-pace.»
C’est de cette façon, laissant volontairement place à une large interprétation (et se gardant bien de la définir), que Peter Lamborn Wislon défi-nit le concept de Zone Autonome Temporaire, abré-gé TAZ. D’origine New-Yorkaise mais ayant étudié le soufisme en Iran, écrivain, poète, se qualifiant lui-même d’ «anarchiste ontologique» il publie-ra en 1997 son essai éponyme sous le pseudonyme de Hakim Bey («Bey» ayant pour sens «Le Sage» en arabe et «Juge» en turc), dans l’idée d’une bou-teille à la mer, d’un «essai [...], une sugges-tion, presque une fantaisie poétique».
Zone Autonome Temporaire. Une notion que l’auteur veut équivoque.
Son propos prend comme base les utopies pirates ayant vu le jour durant l’âge d’or de la pira-terie. Quand les circonstances étaient propices - découverte d’une «planque», soustraction au regard de l’Autorité, bref, contexte spatio-tem-porel adéquat - il était fréquent que des navires fassent halte sur des îles, désertes ou non, et que les pirates y établissent leur démocratie, leur mode de vie, se mélangeant aux éventuelles coutumes locales et créant de toutes pièces ou presque un nouveau monde à leur image, qui vi-vrait le temps qu’il pourrait, le temps qu’il de-vrait. Ce monde s’éteindrait à la suite du rappel
BEY, Hakim. TAZ - Zones Autonomes Temporaires. Editions de l’Eclat, 1997
13à l’ordre des forbans par l’Autorité ou de sa dé-sagrégation, rongé par le temps et la lassitude. Micro-sociétés hédonistes, autarques, hors-la-loi par nature, elles se constituaient et se défai-saient donc d’elles mêmes, vivaient un temps puis cessaient d’être, les pirates préférant une vie brève et heureuse au fardeau de la servitude.
C’est en se basant sur ce phénomène que Bey jus-tifie, bien qu’il se refuse à le définir, l’idée de TAZ. Sorte de soubresaut dans un continuum es-pace-temps, il s’agit d’un croisement de condi-tions qui permet que, à un certain moment, à un certain endroit, et en réponse à un certain contexte, «quelque chose» échappe au quotidien, se soustraie au cours normal des choses, au «cor-rect» et à l’Autorité. Une idée germe, neuve et prometteuse, gorgée d’énergie. Une entité qui, par accident ou par intention, mais dans tous les cas en réaction à la force des choses, refuse d’être absorbée par la narration dominante.
La TAZ est volatile, éphémère. Sa finalité n’est pas d’exister pour exister: elle instigue quelque chose de nouveau, subversif, révolutionnaire (ces mots sont à prendre dans leur sens le plus large) et doit se désagréger une fois sa «mission» rem-plie. Une fois que l’idée s’est fait sa place, la zone qui l’a fait naître perd sa raison d’être et doit accepter de s’évanouir, quitte à refaire sur-face dans et face à un contexte différent, mais à nouveau neuve et combative. Ce n’est pas une ré-volution, mais un soulèvement spontané; en effet, chaque révolution amène à une nouvelle stablili-té, ce qui n’est pas le rôle de la TAZ: celle-ci cherche à exister autrement, ailleurs.
Elle voit donc le jour en réponse à un climat global. «Je suis le fruit de mon environnement, pas le fruit du hasard», paroles de l’auteur Sé-rigne Mbaye semble être ce qui résume le mieux ce principe: la TAZ se forme en réaction à quelque chose, elle est le fruit du refus d’une idée domi-nante. Elle tend, volontairement ou non, à faire comprendre les enjeux qui y sont relatifs. Si ce contexte évolue, et qu’elle n’a pas été éradiquée jusque là par l’Autorité, la TAZ doit se réinven-
14ter ou disparaître, les raisons premières de son existence n’étant plus. Mais l’idée subsistera.
Pour subsister le temps voulu, elle doit être le moins visible possible; La TAZ germe pour elle-même, par rapport aux autres, mais pas pour les autres; elle le refuse . C’est une accélération du quotidien, une façon de s’ancrer dans la réa-lité en faisant la nique à ce paradigme que Guy Debord définit comme «Société du Spectacle». Elle exploite les failles du système, trouvant refuge dans des coins mal définis (au sens propre comme au figuré), afin d’échapper au joug de la société, afin de ne pas être localisable et définissable par la cartographie du Contrôle. Comme Bey le dit lui même:
«Métaphoriquement, elle émerge de la dimension fractale invisible pour la cartographie du Contrôle»
Pour illustrer le concept de TAZ, on peut tout d’abord le rapprocher de celui de biotope. En écologie, un biotope est un milieu défini par des caractéristiques physiques et chimiques stables et abritant une communauté d’êtres vivants (ou biocénose). Le biotope et sa biocénose consti-tuent un écosystème. On comprend donc mieux que la TAZ est une sorte de micro-biotope face à un macro-biotope; par exemple, le biotope sombre et frais prenant place sous une souche humide, trou-vant sa raison d’être par rapport à un milieu extérieur sec et lumineux où la vie de tel ou tel insecte ne serait peut-être pas possible. Ou, pour se recentrer sur l’être humain (les animaux n’agissant que par instinct de survie et pas en fonction de leur libre arbitre - mais ça, c’est un autre sujet), une rave party dans un champs perdu au milieu de nulle part, en réaction à un contexte de répression globale.
BEY, Hakim. TAZ - Zones Autonomes Temporaires. Editions de l’Eclat, 1997
15L’essai de Hakim Bey, qui avouera plus tard avoir sous-estimé la portée potentielle de ses écrits, servira de fer de lance à toute la génération techno et lui permettra de se définir comme mou-vement contreculturel. «Fight for your right to party». Combattre par la fête, pour la fête, faire valoir une zone de liberté totale l’espace d’une nuit ou moins, si l’Autorité parvient à dé-loger les participants et rétablir l’ordre. Mais celui-ci n’est qu’apparent car, quelques kilo-mètre plus loin, la même jeunesse à la conquête du bonheur hic et nunc aura fait ressurgir la rave, mobile, insaisissable, jusqu’au petit matin où elle se désagrègera d’elle-même.
Nous avons donc pu avoir un aperçu de ce qui fait l’essence d’une TAZ, ses caractéristiques, sa na-ture, ainsi qu’un exemple d’application terre-à-terre. Nous avons pu constater que ces zones sont définies notamment par deux dimensions: un espace (physique, analogique) et une durée (temporelle).
Supposons que l’on remplace la dimension ana-logique par une dimension numérique, digitale. Qu’en est-il?
Bey est un grand amateur de cyberpunk (mouve-ment qui, par ailleurs, accueillera l’essai de Bey comme une bible). Ou au moins l’est-il des promesses et perspectives futures que celui-ci véhicule. Bien qu’il admette humblement ne pas prendre pleinement conscience du stade d’avance-ment du digital à son époque, dans son essai, il fait référence à un livre qui le conforte quant à l’implémentation de TAZs dans un espace digital: il s’agit d’Islands in the Net, de Bruce Ster-ling. Dans cette fiction, l’agonie des systèmes politiques donne naissance à une prolifération éparse de modes de vie nouveaux, expérimentaux, temporaires et reliés par un réseau, le Net. Une nouvelle carte, pratiquement vierge, à découvrir et occuper, avec ses zones sombres, libres, ses recoins, dans lesquels les TAZs se nourissent du chaos de l’information et des ingérances de la société de Contrôle.
16Un discours qui rappelle celui de Michel Serres et qui prend tout son sens quand on pense à la nature du réseau: vaste, impalpable, exponentiel et horizontal (du moins tel qu’il est pensé à la base), rapide, permettant l’ubiquité, des unités maillées les unes aux autres. C’était du moins l’utopie que projetait la perspective du Net. A l’heure actuelle, le Net est lui aussi (moins que l’espace analogique, mais tout de même) contrô-lé, hiérarchisé, et la TAZ en est un parasite qui exploite ses failles pour trouver des espaces d’existence.
Mais dans ses propos, Bey met également le doigt sur un point crucial: d’après lui, l’application de son concept au digital ne doit surtout pas se suffire à elle-même. C’est à dire que sa finalité ne doit pas être digitale mais physique. Le digital est un vecteur, un outil qui doit permettre des répercussions dans le monde analogique, et éviter à tout prix la cybergnose, une fuite en avant afin de se soustraire au monde «réel» et trouver re-fuge dans le digital. Bey illustre son propos de la manière suivante:
«Disons que pour des raisons à la fois politiques et personnelles, je dé-sire une bonne nourriture [...] et pour compliquer le jeu, imaginons que la nourriture que je désire ardemment soit illégale[...] en bref, supposons que j’en ai plein le dos de la pure information, du fantôme dans la ma-chine. [...] Alors, où sont mes na-vets?»
BEY, Hakim. TAZ - Zones Autonomes Temporaires. Editions de l’Eclat, 1997
18Qu’en est-il du Net? Le digital n’est il qu’une illusion, qu’un outil ayant pour but d’amélio-rer l’analogique comme l’entend Bey? La TAZ peut-elle exister dans le Net et se soustraire aux contraintes de l’analogique, à une une époque de surveillance de plus en plus golbale?
C’est à ces questions que nous allons tenter d’apporter des réponses, ou du moins des éléments de réflexion, à travers ce mémoire. Celui-ci sera composé de deux feuillets.
Dans le feuillet principal, nous réfléchirons au concept de TAZ et au postulat de Bey quand à la nature des TAZ «digitales» à travers trois implé-mentations modernes qui, à l’heure du numérique, me semblent pertinentes et apportent chacunes leur lot d’éléments d’analyse à différent niveau. Nous tâcherons d’en dégager les contextes et les enjeux.
Le second feuillet n’est pas à proprement par-ler «second» dans le sens de lecture, mais il est annexe, à consulter en parallèle du premier. Son contenu y est détaillé dans les premières pages.
23C’est avec ces mots que Stewart Brand, alors tout juste âgé de 30 ans, conclut la première édition du Whole Earth Catalog, en 1968. Et il ne se doute pas de ce qu’il est en train de mettre en place, ni de l’ampleur que sa parution va prendre.
La décénie précédant cet insant a vu la remise en question de la plupart des valeurs fondamentales de la société américaine. La fin d’une guerre pour entrer dans la suivante (Vietnam), l’assassi-nat de plusieurs personnages politiques éminents (JFK, MalcomX, ML King) ont révolté une part im-portante de la population, notamment la jeunesse, qui se désintéresse globalement de la politique de son pays, convaincue que celui-ci ne s’inté-resse plus à elle. La naissance de la société de consommation, du superficiel, la conforte dans son désir de retourner à de vrais valeurs, humaines, réelles, et elle réagit à l’avalanche de violence qui l’entoure par un refus massif de tout ce qui peut s’y apparenter. Le Spectacle prend une place de plus en plus importante dans les medias, qui tendent à s’incruster de manière croissante dans la vie de l’Homme.
Vu que la génération Baby Boom n’a plus foi en la façon dont l’Etat applique son pouvoir, elle décide de prendre les choses en main. De pe-tites communautés s’établissent ainsi, en autar-cie revendiquée, pour revenir à des valeurs plus simples et hédonistes, à échelle humaine. Elles rejettent les valeurs de la famille nucléaire traditionnelle, privative et limitante, au pro-fit de la bande, réunie par l’affinité, les idées, le dessein commun. Elles travaillent la terre et, face à l’hyper-spécialisation qui fait foi dans l’éducation américaine, les jeunes pionniers re-vendiquent la pluridisciplinarité comme moteur de la libération personnelle, persuadés que savoir un peu tout faire est plus constructif que de maîtriser un domaine sur le bout des doigts. Ils veulent réapprendre à «s’apprendre à soi-même», redevenir et faire à nouveau partie d’un tout co-hérent, de façon à devenir seuls arbitres de leur destin.
24Stewart est un peu plus vieux. Après des études de photographie au SF State college, il partici-pera à une étude légale menée à Menlo Park visant à tester les effets du LSD sur le comportement humain. Le verdict est sans appel: l’un des ef-fets du LSD est un profond sentiment d’empathie, une impression de connexion à la fois physique et mentale avec les individus environnants, l’impres-sion de faire partit d’un tout. Brand fait ainsi pour la première fois l’expérience d’un réseau sans interface, ou chacun est connecté à tous les autres, dans une sorte d’état de conscience glo-bale, supérieure. Dans cet état d’esprit, il lan-cera une campagne de pression sur la Nasa ayant pour but de faire paraître une photo de la Terre depuis l’espace, dans l’espoir qu’elle permettra de faire réaliser au plus grand nombre le destin commun de l’humanité.
Cette sensation de connexion, de faire partie d’un tout «plus grand», ne quittera jamais Brand. Ce qui l’amènera à nourrir un très fort intérêt et enthousiasme dans l’informatique naissante et ceux qui la pratiquent, l’expérimentent, l’amé-liorent; les hackers. En 1968, il assistera à la «Mother of All Demos» de douglas Engelbart et, au détour d’une conférence, tombera sur deux jeunes gens en pleine partie de Space Wars, l’un des tout premiers jeux vidéos de tous les temps. Ce que Brand ressentit à ce moment là fut foudroyant:
«Ce que j’ai vu était une interaction sur ordinateur au moins aussi intense que tout ce que j’avais pu voir, que ce soit les drogues ou quoi que ce soit d’autre. Les gens jouaient «en dehors de leur corps». Il m’a semblé à ce moment là que les ordinateurs
25faisaient absolument tout ce que la drogue faisait également. Sauf que la drogue était limitée à l’individu; les hackers avaient trouvé mieux que la drogue.»
Il prend alors conscience du potentiel des ordi-nateurs en réseau, et entrevoit déjà le futur de l’informatique et du Net à travers la démocrati-sation des ordinateurs personnels, qui utilisés à bon escient, permettraient de construire un monde éthéré, alternatif. Il prend alors également conscience du potentiel libérateur de la techno-logie, et que l’être humain n’atteindra pleinement l’autonomie que quand il aura appris à se servir des outils mis à sa disposition. Il fait alors de ce principe son cheval de bataille, bien décidé à faire passer le message au sein du mouvement hip-pie, à priori réfractaire à la technique (du moins telle qu’elle est employée à grande échelle).
Le désir de retourner à la terre, le désir de «devenir Indien» comme le décrirait Bey, concerne à cette époque 10 milions d’américains. Mais dans ce désir de retour à un mode de vie plus authen-tique, plus juste se cache malgré tout un manque de connaissances pratiques évident nécessaire au bon établissement de ces communautés, résumé par Brand: «the willing was high, but the skills were weak», illustrant ainsi le contraste entre l’ar-dent désir de construire un monde à son image et le manque de compétences ou d’outils qui pour-raient le permettre. De plus, les moyens de com-munications étant très limités, les communautés peinent à communiquer entre elles et à s’entrai-der.
DIRCKSEN, Kirsten. Whole Earth Catalog revisited: Steve Job’s Google of the 60s. http://faircompanies.com/videos/view/whole-earth-catalog-revisited-steve-jobs-google-60s/
26C’est dans ce contexte que Brand sillonne la Cali-fornie avec sa femme à bord du Whole Earth Truck. Magasin ambulant, librairie alternative, il roule de communauté en communauté, cherchant à prodi-guer à leurs habitants les outils nécessaires à leur auto-suffisance. Il terminera finalement sa course à Menlo Park et deviendra un magasin fixe (Whole Earth Store). C’est à ce moment que Brand réalise qu’il doit faire évoluer son offre afin qu’elle ait un impact plus large. Il prend alors conscience qu’il serait plus simple et efficace de rassembler toutes les références des articles, qu’il estime pertinents, au sein d’un grand in-dex distribué pour trois fois rien. De cette fa-çon, il toucherait aussi bien un public d’inités que de nouveaux adhérents, et pourrait atteindre les communautés les plus recluses sans avoir à se déplacer. La presse indépendante étant en plein essor, le prix dérisoire des impressions finissent de le convaincre. La publication prendrait la forme d’un grand catalogue, contenant toutes les informations nécessaires pour se procurer les ou-tils.
Le premier numero du Whole Earth Catalog paraît donc en 1968, sous-titré «Access to Tools». Brand met à disposition de ses lecteurs une base de donnée d’outils dont il est le curateur et à la-quelle n’importe qui peut accéder afin de se ren-seigner sur les moyens de s’établir en autarcie, et de les mettre en pratique tout en étant confor-té par le fait qu’ils ont été «validés». Le Ca-talogue met en avant l’interdisciplinarité et le potentiel libérateur de la science et de la tech-nique à petite échelle, et introduit l’idée que la technologie, à échelle humaine et bien appli-quée, peut devenir une réelle force contre-cultu-relle et permettre l’émancipation et l’autonomie de l’individu.
Il est composé de diverses sections recoupant un vaste nombre de domaines. Parmis celles-ci, «com-prendre le système» tend à apporter un regard philosophique et intelligent sur l’écologie, tout en y apportant des notions issues de la cyberné-tique, entre autres. «Abris et utilisation des terres» fait l’ôde du retour à l’autarcie et à
28l’intégration la plus juste de l’être humain dans son environnement. Elle présente entre autres les Dômes Géodésiques de Buckminster Füller (que Brand avait rencontré quelques années auparavant et qui est une de ses plus grandes sources d’inspira-tion) et leurs applications. Le chapitre «commu-nication», quant à lui, présente par exemple le premier ordinateur personnel (un ordinateur HP à 4000$) comme outil cybernétique d’accès à l’in-formation et à l’ «apprendre soi-même». Des Dômes aux ordinateurs en passant par des articles de survie, le catalogue met l’appui sur le potentiel libérateur de la technologie et les ressources qui sommeillent en chacun, qui ne peuvent être exploitées pleinement qu’à travers l’interdisci-plinarité. Ce qui deviendra un des leitmotivs de la publication:
«We are as gods, and might as well get good at it»
Signifiant par ce biais que le potentiel résidant en chacun, l’être humain est déjà à la hauteur des dieux dans la mesure où il est pleinement maître et responsable de son destin. Il est libre et a le pouvoir de vivre comme bon lui semble, mais il est également garant de sa liberté et de ce qui en découle.
Dès sa sortie, le Whole Earth Catalog connaît un succès fulgurant et est très rapidement adopté par la communauté naissante de hackers et autres bricoleurs. Il deviendra rapidement un point de référence de la contreculture, sorte d’hypertexte au format papier dans lequel les outils sont re-groupés par section et parfaitement documentés, mais tous présents dans le même but. D’aucun le compareront à une «Encyclopédie contre-cultu-relle», et Steve Jobs, lui aussi jeune hacker de la région à cette époque, en fera plus tard men-tion comme de la première tentative d’un système
BRAND, Stewart. Purpose. The Whole Earth Catalog, n°1, 1968
29de référencement, bien avant google:
«When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the bibles of my generation. It was sort of like Google in paperback form, 35 years before google came along: it was idealistic, and over-flowing with neat tools and great no-tions»
Bien qu’initialement édité par Stewart Brand en personne, une foule de lecteurs désireux de par-tager leur savoir feront parvenir des idées et des suggestions dont Whole Earth Catalog pourrait faire mention, dans le but d’étoffer et complé-ter le plus justement ce «noyau dur» auquel elle se rattache, se sent apartenir, et dont elle se sert au quotidien pour atteindre ses objectifs idéologiques. De ces interventions spontanées et de ce sentiment d’appartenance naîtra très vite une section «correspondance» pour que les uti-lisateurs du Whole Earth Catalog puissent faire part de leur avis à l’ensemble des lecteurs et/ou communiquer avec d’autres communautés éloignées. Grâce à la contribution de ses lecteurs, la pu-blication passera de 21 pages à son lancement, à 448 pages lors de sa dernière réédition.
JOBS, Steve. Text of Steve Jobs’ Commen-cement address (2005). http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html
31Par ce biais, le Whole Earth Catalog introduisit avec son public une nouvelle façon d’échanger, communautaire, «open source»,horizontale et par-ticipative, à l’opposé du média de masse et de la transmission de savoir, verticale en général. Brand aura en quelque sorte réussi à faire avec un catalogue ce qu’il entrevoyait dans l’infor-matique naissante: créer un réseau mental rendu possible par le sentiment d’appartenance, de com-munauté, généré par la possession d’un artefact. Les membres qui le constituent partagent une vi-sion commune, se comprennent et communiquent par le biais du papier et de sa distribution.
Au fil du temps, l’élan de retour à un mode de vie autonome se tarit et, en 1972, le Whole Ear-th Catalog signe son dernier numéro, sa «mission» étant désormais accomplie: avoir donné à une idéologie les outils dont elle avait besoin pour s’établir et avoir généré une communauté active, une conscience commune.
Dissout car les circonstances favorables à sa création n’étaient plus, le Whole Earth Catalog resurgira au fil des années, sous d’autres noms, des refontes (telles que Co-Evolution Quarterly), avec des objectifs et contenus différents, mais toujours dans la même lignée et sur la base du même public qui y retrouvera toujours les thèmes fédérateurs. Dans les années 80, Brand fondera, en partenariat avec avec Larry Brilliant, le Whole Earth ‘Lectronic Link, d’après lui et avec une pointe d’humour, pour «tous les rescapés des 70’s qui avaient encore quelque chose à dire». Conçu à la base comme une sorte d’expérience visant à tester les limites de l’interaction sociale dans le «cyberspace», et avec comme sujets d’étude les «anciens du Whole Earth Catalog», le WELL sera l’un des premier réseaux sociaux en ligne, l’une des premières «Island in the Net», encore ac-tif aujourd’hui. Initialement centré autour de la baie de San Francisco, il génèrera vite un en-gouement sans précédent.
32Brand aura finalement mis en pratique ce qu’il espérait voir arriver: l’existence en réseau, dans le net, en dehors de son corps, dans une conscience collective où tout le monde est connec-té.
Aux yeux de la Taz, et de ce que nous avons dé-veloppé en introduction, il y a un certain nombre de points intéressants que l’on peut dégager.
Tout d’abord, le Whole Earth Catalog est une sorte de «TAZ à TAZ». Dans un premier lieu, il s’agit d’une TAZ dans sa dimension communautaire et contre culturelle, bien qu’il ne s’agisse pas d’une zone physique mais bien d’une zone mentale, fédératrice, commune à tous les adhérents à la publication. Elle se cristalise autours du cata-logue qui est en quelque sorte, un point de ra-liement, une valeur stable et partagée, produite par elle et pour elle. Dans un second lieu, elle aura permi la création ou la consolidation de dizaines d’autres TAZ: les communautés autonomes éparpillées à travers l’ouest américain.
Celles-ci, tout comme la publication par laquelle elles ont été fédérées, se dissolvent progressi-vement à mesure que les raisons qui les ont pous-sé à exister disparaissent; la TAZ est par na-ture contestataire et, de ce fait, éphémère. En effet, si les causes ayant entraîné une réaction disparaissent, la TAZ n’a plus de raison d’être. Elle n’existe qu’en opposition à un contexte. Elle laisse derrière elle des traces de son pas-sage, des idées qui resteront gravées dans l’in-conscient collectif; dans le cas du Whole Ear-th Catalog, l’idée qu’une vie autonome et libre est possible à travers l’interdisciplinarité, la soif de connaissance et la maîtrise des outils de quelque nature soient-ils. L’idée aussi que nous faisons partie d’un tout auquel nous sommes in-consciemment connectés.
34Il est également intéressant de constater, à tra-vers les refontes du Whole Earth Catalog et fi-nalement son implémentation sur le Net, que la TAZ resurgit, en rapport à des contextes légère-ment différents. Elle est insaisissable, indéfi-nissable, occupe les zones (mentales, physiques) vacantes, échappant au Contrôle - pas par illéga-lité, mais par dissimulation. Car celui-ci ne s’y intéressant pas, la TAZ en profite alors naturel-lement pour y faire naître ses idées, mouvantes, passagères, appuyant encore la principale devise du Whole Earth Catalog:
«Stay hungry. Stay Foolish.»
La TAZ ne doit pas être stable. Elle doit être en renouvellement perpétuel, amener du conte-nu nouveau - même s’il peut sembler invraisem-blable, qui ne tente rien n’a rien - et ne peut pas se satisfaire de ses acquis. Elle doit cher-cher à «pousser le bouchon», à explorer les zones sombres, jusqu’à ce que son objectif soit at-teint ou que sa raison d’être ne soit plus. Elle s’éteint, libre de réapparaître ou de laisser son empreinte derrière elle.
Mais le point le plus intéressant par rapport au Whole Earth Catalog est le fait qu’à travers un objet physique, Brand soit parvenu à créer une communauté mentale, une idée si forte que même après la fin de la publication, ce réseau soit resté vivant, et conscient de son existence et de sa force.
BRAND, Stewart. Purpose. The Whole Earth Catalog, n°1, 1968
39Telle est la devise qui orne fièrement le blason de Sealand. Patrie de la liberté offerte par la mer. Au matin du 2 septembre 1967, sous le vent glacé de la mer du Nord qui martèle les flancs de l’an-cienne plateforme anti-aérienne de Fort Roughs, le roi Roy Bates hisse son drapeau et proclame l’indépendance de sa nation.
La radio, telle que nous la connaissons à l’heure actuelle, apparaît sur les ondes dans les an-nées 20. Elle ammène à la société un concept jusqu’alors inédit et qui changera la face du monde: le broadcast, c’est à dire que toute per-sonne équipée d’un matériel récepteur est en me-sure d’accéder à l’information transmise par l’émetteur. Cette nouvelle technique, relati-vement facile d’accès, et qui une fois mise en place permet à tout un chacun de diffuser ce qui lui plait connait un énorme engouement. En peu de temps, de nombreux émetteurs apparaissent dans le paysage radiophonique.
Très rapidement, cette technologie de nature démo-cratique se heurte à un gros problème: en effet, chaque fréquence ou longueur d’onde n’est utili-sable que par un seul émetteur. Si deux emetteurs ou plus utilisent la même fréquence, les deux si-gnaux se confondent et ne sont plus «écoutables».
C’est l’Etat qui règlera le litige, de manières très différentes en fonction des pays. Aux Etats-Unis, selon un modèle capitaliste, il sera pos-sible de réserver une fréquence en achetant une patente offrant le droit de l’exploiter, ce qui donnera naissance à divers grands groupes radio-phoniques privés (NBC, CBF, FCC). En Angleterre, un tout autre mode de fonctionnement sera adopté: la radio devient un service publique et l’état le seul émetteur légal de ce qui est diffusé sur les ondes. Ceci amènera au monopole de la BBC.
Face à la différence des solutions mises en place pour régler le problème du «chaos dans l’éther», la conséquence sera la même partout: l’individu qui, à son échelle, avait la possibilité d’émettre du contenu comme bon lui semblait, se retrouve de facto hors-la-loi. Relégués à l’illégalité, et
40encore désireux de faire valoir leur opinion, au nom de la liberté d’expression, ces individus se fédèreront en petits groupes, organisant une vé-ritable résistance face au monopole des grands groupes/de l’état. Ainsi la solution à un pro-blème en fit surgir un autre: les radios pirates.
Quarante ans plus tard, en Angleterre, la situa-tion «technique» n’a toujours pas évolué. En re-vanche, les mentalités ont évolué. Les boulver-sements de la société dans les années 60 créent un fossé entre les auditeurs et l’émetteur. Des accords passés avec les maisons de disque et le statut de radio culturelle de la BBC la limitent à la diffusion de quelques heures de musique par jour. Mais cela ne suffit pas: l’audimat en a assez des émissions culturelles à longueur de temps. La jeunesse, attisée par le vent de renouveau souf-flant en provenance des Etats-Unis, veut entendre les derniers tubes de rock’n roll à la mode. Elle est lasse des programmes qui semblent ignorer complètement son existence, principalement desti-nés à la classe moyenne adulte anglaise, confor-miste de surcroit. Elle revendique le droit à un contenu approprié, et tout simplement le droit d’avoir le choix de ce qu’elle veut écouter.
Bien que le phénomène des radios pirates ne soit pas nouveau, c’est à ce moment là qu’il devient populaire et explose. En effet, celles-ci jouent sur le décalage entre l’audimat et la BBC et dif-fusent de la musique non-stop, entrecoupée d’émis-sions en complet accord avec le public-cible. Elles ont chacune leur touche personnelle, un style propre, une marque de fabrique.
Dans les années 20 en Angleterre, la surveillance anti radio pirate était assurée par des fourgo-nettes banalisées qui patrouillaient à la re-cherche de signal suspect. Mais face à l’ampleur du phénomène dans les 60’s, le gouvernement est amené à voter une série de lois, de plus en plus restrictives, interdisant formellement à qui-conque d’émettre sur le sol anglais et dans une limite de 3 miles au delà des côtes.
42C’est à ce moment là que les radios pirates re-prennent leurs lettres de noblesse: en effet, si elles veulent continuer à émettre sans tomber sous le joug de la Loi anglaise, elles doivent ne plus se situer sur le sol anglais. Des équipages se forment, des bateaux sont affrêtés, contenant tout le necessaire pour une vie en quasi autar-cie, et les pirates trouvent refuge en mer d’où ils émettent alors.
Roy Bates, la quarantaine, est à la tête d’une de ces radios pirate. En cherchant à sauver sa «Radio Essex» et en qualité d’ancien major de l’armée britannique, il commence à s’intéresser à d’anciennes plateformes offshore, au large de l’estuaire de la Tamise, initiallement conçues pour la défense anti-aérienne lors de la seconde guerre mondiale, puis désarmées et laissées à l’abandon au départ des garnisons.
Il s’installe sur une première plateforme, dont il s’avèrera malheureusement qu’elle se situe sous la juridiction britannique. Il est reconnu cou-pable de «radio illégale» et écope d’une amende.
Mais Roy est bien déterminé à dénicher un lieu sûr où implanter sa radio. A peine remis de son démêlé avec la justice, il jette son dévolu sur une autre plateforme, Fort Rough, après avoir soigneusement vérifié qu’elle se situe bien hors de portée du droit anglais. Mais il y a une ombre au tableau: la plateforme est déjà occupée par une radio pirate concurrente.
Il entreprend donc de la déloger de la plate-forme, avec succès. Il y transfère tout son maté-riel, désormais à l’abri du joug britannique, et reprend l’émission de Radio Essex, l’esprit tran-quille.
Un soir, alors qu’il discute avec des amis, une idée lui vient à l’esprit. Etant donné que lui et sa famille sont les seuls résidents de la plate-forme, que celle-ci se situe dans les eaux inter-nationales et qu’ils vivent en quasi-autarcie, pourquoi ne pas considérer la plateforme comme un pays? Il se placerait ainsi définitivement à
43l’abri des lois de quelque pays que ce soit, et serait en mesure d’énnoncer les siennes, en ac-cord accord avec ses valeurs, et de créer une na-tion à son image.
Le 14 août 1967 est voté par les autorités britan-niques le Marine Broadcasting Offences Act, qui représente la ratification du «European Agreement for the Prevention of Broadcasts Transmitted from Stations outside National Territories». Comme son nom l’indique, dans les faits, cela signifie que toute émission, de toute nature non aprouvée par l’Etat, est déclarée illégale. Roy doit réagir.
Après avoir consulté un certain nombre d’avocats et de spécialistes du droit maritime, il réalise qu’en théorie, absolument rien ne l’empêche de déclarer l’indépendance de Fort Roughs, celui-ci ne tombant sous la juridiction d’aucune nation.
C’est ainsi que le 2 septembre 1968, en présence du peuple de l’île (sa femme et son fils), il pro-clame la naissance de Sealand, nation souveraine et Etat de droit. Légitimé par le principe qu’un citoyen mécontent des interdictions et lois qui le régissent, a le droit moral (et dans la majo-rité des démocraties, le devoir) de faire séces-sion. Sealand est né de la réaction d’un patriote déçu, décidé à fonder un espace à son image plu-tôt que de devoir se soumettre à un état qui ne le représente plus.
Bates se rendra vite à l’évidence que construire une nation de toutes pièces n’est pas de tout repos, et Radio Essex cessera donc rapidement d’émettre. Ainsi, la raison première de son en-treprise disparaîtra, au profit d’une revendica-tion qu’il jugera plus profonde: démontrer qu’il est possible de vivre libre, autrement.
La nation ne sera jamais reconnue officiellement, seulement «de facto» à travers diverses alterca-tions avec d’autres états. Les institutions bri-tanniques tenteront à plusieurs reprises de re-prendre la plateforme, pour des raisons diverses et variées. Ainsi, dès le début du règne de Bates, prétextant la destruction des anciens forts Maun-
45sell (du nom de leur concepteur) dont Fort Roughs fait partie, des frégates seront envoyées pour tenter d’évacuer Roy et sa famille. Ils seront chaleureusement accueillis à coups de carabines et cocktails Molotov, les occupants défendant féro-cement leur patrie et leur indépendance légitime. L’affaire sera relayée au Tribunal, celui-ci ac-cusant Bates de détention illégale d’armes à feu, les charges seront finalement abandonnées, devant l’évidence que Sealand était dans son bon droit et qu’attaquer une nation souveraine est punis-sable par le droit international.
Les années qui suivent sont, pour notre étude, d’un intérêt très maigre (à part éventuellement un coup d’état en 1975, dont découlera la reco-naissance de facto du pays par l’Allemagne) car la situation se stabilisera rapidement, le pou-voir en place étant trop occupé par la survie et la légitimation de sa nation «dans les règles de l’art». Ainsi, c’est 30 ans plus tard, en 2000, que nous la reprendrons, avec l’implatantion de la compagnie HavenCo à Sealand, qui constituera un tournant majeur dans l’histoire de la nation. Nous verrons ceci dans un second temps.
Dans le contexte de notre démarche, il y a un certain nombre de points intéressants à dégager de la création de Sealand. Le statut de TAZ de Sealand est néanmoins discutable sur 2 points:
Le premier, c’est que Sealand n’est pas à propre-ment parler autonome. En effet, la situation géo-graphique de Fort Roughs, conséquence plutôt que choix, ne permet pas d’assurer une autarcie. Par la suite, la principauté passera le plus clair de son énergie à chercher (et ne pas trouver) des moyens de se financer et s’entretenir, contrainte à l’échange et au commerce, et il en résultera une lente agonie de l’utopie crée par Bates.
Ce qui ammène au second point: Sealand s’est dé-tourné des raisons qui ont amené à la fonder. En effet, elle répondait à un contexte d’oppression mais, Roy Bates abandonnant rapidement Radio Es-sex pour mieux se consacrer à la légitimation de sa jeune nation, elle perdit presque aussi rapi-
47dement sa raison d’être. Il en résulte un coup d’éclat remarquable, un fantastique pied de nez au Contrôle, suivi de 30 années de survie achar-née, obsessionnelle, sans lieu d’être. Comme pour illustrer ceci, Michael Bates, héritier du trône Sealandais, déclarera en 2008:
«On possède l’île depuis 40 ans, mais maintenant mon père est agé de 85 ans. Peut-être que le temps est venu d’un rajeunissement.»
Car comme nous avons pu le voir précédemment, la TAZ ne vise pas la stabilité mais à faire passer une idée, quelque chose de nouveau. De ce point de vue, on pourrait donc considérer que Bates a fait ce qu’il n’aurait absolument pas du faire: fonder un état, symbole ultime d’une recherche de stabilité établie, conçu pour durer. D’un autre point de vue, on pourrait dire qu’il s’agit de la réaction la plus appropriée face aux circons-tances: en effet, le meilleur moyen de s’opposer à l’état ne serait-il pas d’en employer les mé-thodes et, ultimement, d’en devenir l’égal? C’est du moins l’idée générale qui ressort de Sealand.
Un point intéressant dont on peut faire mention est la cohabitation des différentes radio-ba-teau pirates. En effet, bien qu’ayant chacune leurs spécificités, elles répondent toutes au même contexte. Ces TAZ sont donc parfois, par conflit d’intérêts, amenées à entrer en collision. De la même façon dont une espèce animale déloge une autre espèce occupant sa niche écologique, Bates boutta hors de Fort Rough les membres de la ra-dio pirate qui s’y trouvaient, et fonda Sealand de façon à ne pas risquer de se retrouver dans la même situation.
BN, avec agnces. Le «plus petit Etat» du monde à vendre. http://www.liberation.fr/actualite/2007/01/08/le-plus-petit-etat-du-monde-a-vendre_9147
48Sealand peut nous amener deux éléments d’analyse cruciaux, à mettre en rapport direct avec la pi-raterie, celle dont Bey fait mention dans son es-sai, et ce pour deux raisons.
Les pirates, lorsqu’ils l’étaient ou le deve-naient, cherchaient avant tout à s’affranchir du joug d’un état, d’une servitude.Au regard des droits de l’Homme, «devenir pirate» revient à revendiquer son statut d’homme libre, de conscience et de choix. Ils devenaient hors-la-loi en sortant de la narration dominante de l’Etat sur ses citoyens, par refus d’une appli-cation du pouvoir qui ne leur correspondait plus. C’est en revendiquant ce droit au libre arbitre, la force de la volonté de l’individu, du potentiel de l’humain, que les républiques pirates furent fondées, hors d’atteinte (physiquement comme lé-galement) des juridictions qui les opressaient. Ils décidèrent donc de construire des mondes à leur image, fidèles à leurs idéaux à l’écart d’une cartographie qui se dessinait encore petit à pe-tit à l’époque - la TAZ avait alors l’avantage d’avoir une longueur d’avance sur le Contrôle.
Mais à l’heure actuelle, fonder une nation carac-térisée par une population, un territoire et un dessein commun relève du rêve romantique. De ma-nière croissante, il n’existe plus un centimètre carré de terre qui ne soit connu et possédé par les Etats, rendant ainsi de plus en plus difficile l’établissement de TAZs, la réaction de l’Etat ayant parfois même une force d’anticipation sur celles-ci, par la surveillance et l’observation de plus en plus poussée du monde visible. Il est d’ailleurs intéressant de constater que pour la TAZ, les zones les plus sécurisées ne sont pas forcément les mieux cachées, comme le démontre Sealand, qui apparaît comme un affront contre lequel aucune action ne peut légalement être en-gagée, l’Etat étant à la merci des lois qu’il a lui-même créées. Mais il n’en reste pas moins que ces zones susceptibles de devenir TAZs sont de plus en plus restreintes.
49Comme une réponse à cette saturation de l’espace, c’est à ce point précis qu’intervient l’invention de l’émission radiophonique. Premièrement, par la possibilité individuelle d’émettre de l’informa-tion, elle chamboule la relation préétablie entre les medias, la connaissance et le publique dans la société moderne. Ce n’est pas la technique de l’invention qui est révolutionnaire, mais son principe et ses enjeux. Le broadcasting offre, pour la première fois dans l’histoire, la possi-bilité d’une transmission d’information parfaite-ment horizontale. Il remettra aussi en perspec-tive la place de l’expérimentation individuelle dans la société, et on en revient à la probléma-tique développée dans le chapitre précédent: par la maîtrise d’une technique, l’être humain est en mesure de s’émanciper et d’accéder à de nou-veaux horizons. La radio remettra complètement en branle la place de la culture et de l’information dans la société.
Il était donc prévisible que, comme tout élément qui rétablit un pied d’égalité (ce qui est, rap-pelons-le, le principe de base d’une démocratie, du moins au sens premier du terme) et remet en cause la nature et la souveraineté d’un état, la radio soit muselée, arrangée - sous prétexte de régulation et de performances techniques - plaçant de facto certains individus dans l’illégalité. La TAZ telle qu’elle aparaît dans ce cas de figure est donc une conséquence, qui une fois digérée deviendra un choix et une position. On conçoit le phénomène de radio pirate (on devrait dire media) comme un détournement de media de masse: mais c’est oublier le fait que la radio est par nature un media de masse, mis à disposition de l’indivi-du. Démocratique, il permet la diffusion de don-nées à tous, et permet également la réception de toutes les données. Chaque émetteur/récepteur est l’égal des autres et est connecté à tous ceux-ci. Ceci laisse, dès les années 20, présager des réseaux digitaux tels qu’ils seront implémentés au cours du siècle et les problèmatiques qui les accompagneront.
50Le deuxième rapprochement à la piraterie repose sur la revendication de la mer comme une zone de liberté inaliénable. En opposition à la Terre, milieu naturel de l’Homme avec un contour déter-miné et donc légiférable, la mer est un échapa-toire, vaste, ouvert, libre. Pour les hommes qui décidaient de partir en mer comme pour Roy Bates (le slogan de la jeune nation sera «E mare Liber-ta», en référence directe), celle-ci résonnait comme une promesse de liberté, d’aventure, un espace inconnu, mouvant, difficilement définissable où l’Homme n’avait pas la maîtrise de la totalité des paramètres, le Contrôle n’avait pas la même mainmise, les mêmes facilités et possibilités d’action. Souvent, ces hommes prenaient la mer à la recherche de quelque chose, dans le cas des Pirates, d’aventure et de mondes nouveaux. Et si ce monde nouveau, ce n’était pas justement la mer elle-même?
«Claiming “Jus Gentium” over a part of the globe that was Terra Nullius.»
Quoi qu’il en soit, cette revendication fait naître l’idée qu’il existe encore des zones inat-teignables par le Contrôle, soit lui en lui échap-pant, soit en existant dans des configurations dont il n’a pas conscience. Et c’est précisément ce sur quoi l’émission radiophonique et plus lar-gement le «Broadcast» ont débouché, l’Homme ayant acquis les capacités techniques lui permettant de s’abstraire du réel: il existe d’autres types d’espaces. Des espaces plus libres, moins légi-férés, encore exempts de l’emprise du Contrôle, limitées à l’espace physique. Ceux-ci sont donc d’une nature différente, invisible, comme un ter-ritoire imperceptible superposé au monde tan-gible, mesurable.
Site officiel de la principauté de Sealand. http://www.sealandgov.org/about
51Néanmoins, pour exister et être perceptibles, ces espaces se rattachent nécessairement à des arte-facts physiques. En effet, difficile d’imaginer entendre un signal radio ou en émettre un sans les outils appropriés. Et ces intermédiaires, par leur nature physique, sont destructibles, confis-quables, censurables: ils sont à la merci du Contrôle. C’est ce qui poussera Roy Bates à ins-taller son matériel d’émission sur Fort Roughs, à l’abri des lois anglaises: pour permettre à Radio Essex, sa TAZ immatérielle, d’exister dans le pay-sage radiophonique, il doit assurer la pérennité de son attache physique. Comme nous le verrons par la suite, c’est la même raison qui poussera l’entreprise HavenCo à s’installer à Sealand.
55C’est en 1998 à Anguilla, à l’occasion d’une conférence sur la cryptographie financière que Ryan Lackey et Sean Hastings se rencontrent. Jeune homme à l’esprit indépendant qui a laissé tom-bé le MIT pour l’un, programmeur travaillant pour une société de paris en ligne pour l’autre, tous deux se sentent concernés par la liberté de l’in-dividu face au Contrôle grandissant de l’Etat, et sont convaincus de l’intérêt de la cryptographie dans le maintien de celle-ci. Aventuriers du Net (Lackey, 21 ans, se définit lui-même comme étant un «crypto-hacker/crypto-anarchiste qui s’enfuit du MIT»), ils projettent donc d’établir ensemble un datahaven, le moins restrictif possible.
Déjà à cette époque, le concept de datahaven n’est pas nouveau. Dès les années 70, les Etats présen-taient les problèmes relatifs aux données person-nelles liés aux bases de données naissantes. Ils commencèrent à énoncer des lois ayant pour but de donner un cadre à ces bases de données dans leurs juridictions. Un certain nombre d’entreprises, en réponse à ces restrictions, déplacèrent purement et simplement leur matériel de stockage dans des pays plus propices, moins légiférés dans ce do-maine: c’est ainsi que germa le concept de data-haven.
Le Contrôle s’est progressivement imiscé dans le Net, le légifère et le cadre petit à petit, comme il l’a fait pour la radio. Lackey et Hasting sont bien conscients de l’état de surveillance globale dans lequel le monde et le Net s’embourbent pro-gressivement. Ils souhaitent donc offrir à leurs clients la promesse d’un refuge sécurisé, ano-nyme, à l’abri des juristes, avocats et autres gêneurs, sans pour autant être hors-la-loi, ce qui les amène à la conclusion qu’il leur faut une loi qui leur soit adaptée.
Anguilla, ex-colonie anglaise située dans les Ca-raïbes, membre du Commonwealth, se dessine comme un datahaven naissant, et attire différentes en-treprises dès le milieu des années 90, hébergeant principalement des plateformes de paris en ligne, interdites sur le sol Américain. Néanmoins, Lackey et Hastings sont unanimes. Corruption, pornogra-
56phie illégale, fermeture d’entreprises sur mandat des autorités: Anguilla n’est pas aussi liber-taire qu’ils l’auraient souhaité. Ils se mettent donc en quête de la zone susceptible d’accueillir leur datahaven.
C’est à travers ces pérégrinations qu’ils tombent sur un livre intitulé «How to Start Your Own Country», par lequel ils aprennent l’existence de Sealand, qui semble réunir toutes les conditions requises à la création d’un datahaven. Sans hé-siter, ils montent alors un dossier et entament les négociations avec la famille royale, qui se montre tout se suite particulièrement intéressée. Sealand avait déjà offert l’asile à Napster lors de ses déboires avec la justice, et le prince Bates perçoit à travers les idéaux des deux en-trepreneurs-aventuriers le même genre de raisons qui ont poussé son père à déclarer l’indépendance de sa nation 30 ans auparavant. De plus, Sea-land étant devenu au fil des années un véritable gouffre financier, le vent semblait enfin tourner et annoncer un avenir radieux, en accord avec son temps.
La société porterait le nom évocateur de Haven-Co (pour HavenCo-location), et serait dirigée par Sean, Ryan, ainsi que deux entrepreneurs du Web courronnés de succès, Avi Freedman et Joichi Ito, qui comptent parmi les mécènes du projet (qui sou-lèvera d’ailleurs un financement impressionnant). Tout semblait indiquer la percée du premier vrai paradis internet offshore, les investisseurs as-surant leur enthousiasme quant à la visée idéolo-gique du projet, espérant voir celui-ci titiller les limites des économies géo-politiques, et per-suadés que les pays qui encouragent et favorisent la communication seront prospères.
HavenCo offrirait à ses clients une infrastructure de pointe et une marge de manoeuvre extrêmement large, s’appuyant sur le fait que selon Lackey et Hastings, le libre flux d’information ne peut pas être considéré comme un crime en soi. Sachant per-tinemment que la majeure partie du contenu héber-gé sur les serveurs mis à disposition des clients serait de nature controversée, HavenCo promet un
58environnement extrêmement sécurisé, cryptographié (comme son slogan l’indique), de telle sorte que personne, pas même les employés de HavenCo, ne puissent intervenir dans les échanges de données. Il était prévu que les serveurs soient surveil-lés 24/24 par des gardes armés et qu’en cas d’at-taque, ceux-ci soient éteints, voire détruits, et que les clients soient remboursés.
Néanmoins, HavenCo ne serait pas une zone de non-droit absolue. Régie malgré tout par les lois sealandaises (et donc par le bon vouloir du pou-voir royal), tous les types de contenus ne se-raient pas tolérés: par exemple, sur conseil des investisseurs, le blanchiement d’argent, les opé-rations de spamming et autres ne seraient pas admis. Sous prétexte de ne pas vouloir s’attirer les foudres du droit international faisant foi en la matière, HavenCo se réserve donc malgré tout le droit de fermer un serveur qui menacerait son accès à internet (bien que des solutions semblent avoir été prévues dans ce cas là). D’après Lackey et Hasting, le client-type n’aurait de toute fa-çon pas ce profil et ne serait probablement qu’une entreprise de stockage de données cherchant à trouver un refuge à l’abris des lois.
Pourtant, les pronostics financiers sont eux aus-si prometteurs; 65 millions de dollars de chiffre d’affaire en 3 ans. Un lancement en grande pompe en 2000, un article flatteur et optimiste dans Wired: tout le monde semblait s’attendre à ce que l’alliance Havenco/Sealand, l’union d’une TAZ mourrante et de ce qui tendait à en assurer la renaissance, occupe brillament la zone grise se situant quelque part entre ce qui est légal et ce qui est possible. Finalement, le seul réel pro-blème qui pouvait survenir était une mésentente entre la famille royale et HavenCo. Ce qui, en plus d’autres ingérances, ne manqua pas de se produire.
En 2003, Ryan Lackey déclare lors de sa présen-tation à la Defcon, sous les yeux ébahis de l’au-dience, l’échec total de HavenCo.
59Parmi les raisons de celui-ci, l’amateurisme avoué des fondateurs; victime du succès du lan-cement, la majeure partie du temps était occupée par les relation avec la presse, et HavenCo per-dit purement et simplement la trace de plusieurs clients potentiels. Le crach de la bulle dot-com en 2000 obligea à baisser les prix d’accès au serveur, et la compagnie leur fournissant l’accès internet haut-débit fit faillite pour la même rai-son, entraînant des baisses importantes de débit et remettant en cause la sécurité du datahaven. On était bien loin des promesses de serveurs der-nier cri rutilants évoquées au départ. Celles-ci n’étaient d’ailleurs qu’un mythe. Presse et visi-teurs n’étaient pas admis dans le pilier gauche de la plateforme sensé abriter les serveurs non pas pour des raisons de sécurité, mais parce qu’il n’y avait rien à voir. Le nombre total de clients sur les serveurs de HavenCo n’excèda en effet qu’à de très rares occasions la douzaine (principalement des sites de pari en ligne, loin des idéaux libertaires et révolutionnaires) de Lackey et Hastings, limitant l’entreprise dans l’achat de matériel plus puissant.
Bien loin des prévisions économiques fructueuses, HavenCo ne put ainsi jamais rembourser sa dette à l’égard de ses créanciers, parmi lesquels le gou-vernement de Sealand; les relations se dégradèrent dès 2001. En 2002, une plateforme de streaming video se pésenta pour louer un espace sur les ser-veurs. Lackey, seul aux commandes (Hastings, pour des raisons personnelles, quitta l’entreprise dès 2000) souhaita les accueillir à bras ouverts, y apercevant l’opportunité de se refaire. Mais Mi-chael Bates refusa catégoriquement, car le site ne respectait pas son éthique concernant le res-pect du droit d’auteur. Dégouté, Lackey se retira progressivement de son entreprise et finalement, Sealand décida de nationaliser HavenCo. Dès lors, la politique de l’entreprise changea drastique-ment, interdisant clairement l’accès à quelque client que soit dont la conduite serait contraire à l’éthique, refusant ainsi bon nombre d’offres. Les interdiction se durcirent encore: pas d’at-teinte au copyright, pas de contenu obscène... si bien qu’en 2008, HavenCo disparut.
61La chute de HavenCo montre à quel point il est difficile d’outrepasser les lois. Paradoxalement, en cherchant à se placer hors de portée de gou-vernements aux politiques restrictives et en ayant pour raison d’être la promesse faite à ses utilisateurs de pouvoir faire de même, HavenCo s’était placé sous le joug d’un seul état: celui de Sealand.
Le but de Sealand était de rendre au Net ce qui lui revient de droit, en accord avec son optique initiale: une liberté totale du flux d’informa-tion, horizontale, sans censure. Rendre au Net ce qui appartient par ailleurs aussi à la mer, ce qui aura poussé Roy Bates à y fonder Sealand: une zone libre, où chacun est responsable, mais sans contrainte.
Dès qu’un Etat est en place (même s’il s’agit en l’occurence d’une TAZ mourrante), la liberté to-tale est une chimère. En effet, la nature même de celui-ci est la restriction des libertés de l’individu dans le but d’assurer la cohésion de la société. Ainsi malgré les intentions les plus louables qui soient, HavenCo n’a jamais eu autant de marge de manoeuvre qu’elle aurait souhaité, jusqu’à être annexée par l’état, encore pire que tout ce que les fondateurs du projet cherchaient à fuir à tout prix. La solution aurait peut-être été, comme Bates le fit 30 ans auparavant, de bout-ter hors de la zone les résidents actuels pour s’affranchir à jamais d’une quelconque opposi-tion. Google semble à l’heure actuelle travailler sur un prototype de datacenter flottant en eaux internationales, en autarcie complète, générant son énergie des courants marins et puisant l’eau nécessaire au refroidissement de ses serveurs. Peut-être aurait-ce été la solution, bien qu’im-possible à mettre en oeuvre à petite échelle... Mais au delà ce ça, quels éléments permettent d’expliquer l’échec d’une projet si prometteur, révolutionnaire, et qui a suscité un si grand in-térêt à son lancement?
62Premièrement, on est en mesure de se poser la question de l’utilité d’un lieu si contraignant pour du matériel informatique alors que la tota-lité des données étaient de toute façon cryptées. En effet, qui s’intéresse à savoir où sont si-tuées les données, tant qu’elles ne peuvent pas être déchifrées? Des logiciels tels que Tor ou PGP auront fait bien plus pour la protection des données que Sealand et sa vaste entreprise roma-nesque. C’est d’ailleurs ce qui poussera HavenCo à la faillite: l’offre n’était pas à la hauteur de la concurrence. Débit risible pour un tarif qui ne l’était pas, les clients potentiels firent vite leur choix.
Néanmoins la cryptographie amène un point inté-ressant: le choix volontaire de ne pas être com-pris pour être libre. Par le refus d’utiliser le langage commun, on se prémunit de la compréhen-sion par des tiers et donc également de la réac-tion qu’elle peut entraîner. Cela ramène à l’es-sai de Bey et son refus par la TAZ d’utiliser les codes du Spectacle afin de ne pas attiser sa cu-riosité à son égard. En somme: vivre incompris, vivre heureux.
L’autre raison que l’on peut dégager, et qui est plus intéressante en rapport avec notre démarche, est l’hypothèse que HavenCo n’est pas arrivé au bon moment. Le contexte de surveillance globale était certes une réalité, mais bien moindre com-parée à la compare à la situation future.
En effet, après le 11 septembre 2001, invoquant la protection du pays contre d’éventuelles at-taques terroristes, les Etats-Unis d’Amérique votent un long texte de loi visant à accentuer la surveillance de l’Etat sur ses citoyens. Por-tant le nom de Patriot Act, il donne notamment le droit à tout service assurant la sécurité de la Nation, sans en informer les utilisateurs et sans autorisation préalable, d’accéder aux données in-formatiques détenues par les particuliers ou les sociétés.
64Dans ce contexte, chaque citoyen américain est donc considéré comme un terroriste potentiel. Mais ce qui pourrait être un problème à l’échelle nationale va bien au delà des frontières du pays de l’oncle Sam, tout en restant sur le terri-toire américain. En effet, depuis les années 2000 et de manière exponentielle, les internautes du monde entier utilisent des plateformes en ligne (vantées comme sûres) pour naviguer sur le Net, effectuer des recherches, communiquer, échanger des fichiers, des avis, bref, tout et n’importe quoi grâce aux popriétés fabuleuses du Net. Le problème, c’est qu’une écrasante majorité de ces services en ligne (Dropbox, Facebook, Google... la liste est longue) est basée aux Etats Unis et que la majeure partie de ceux-ci sont également légalement propriétaires du contenu échangé par les utilisateurs. Ce contenu est donc stocké dans d’immenses serveurs, regroupés dans ce que l’on nomme des datacenters. Seulement, étant situés sur le sol américain, ils tombent sous le joug du Patriot Act et peuvent être perquisitionnés sans préavis; ainsi, l’état Américain peut, parfaite-ment légalement, examiner les données échangées via un service par n’importe quel individu sur la planète, sans que celui n’en soit averti.
On comprend donc que, dans ce contexte de sur-veillance d’un Etat sur le monde d’une étendue inouïe, une plateforme offshore ayant la possi-bilité d’abriter des données sans les contrôler, mais bien gardées et à l’abri de loi nationales restrictives, aurait effectivement été la réponse la plus appropriée. HavenCo serait donc arrivé trop tôt dans le paysage, les raisons ayant pous-sé à son implémentation n’étant pas assez pré-sentes. C’est la conviction de ses instigateurs qui a permis l’établissement de HavenCo, plus que la réaction à un contexte. C’est l’une des rai-sons de sa chute et de l’oubli dans lequel il est tombé peu après son lancement pourtant si média-tisé.
65Ce qui explique aussi le manque de clients, c’est qu’à l’époque de l’ouverture de HavenCo, ceux-ci ne sont pas encore dissidents aux yeux du Contrôle. La TAZ n’a donc pas de quoi se nour-rir, sa matière première, ce qui fait sa raison d’être n’ayant pas encore vu le jour. La corréla-tion de circonstances nécessaires à sa justifi-cation n’était pas au rendez-vous, mal faite, et la réaction de ses instigateurs trop hâtive. Le concept est bien là, révolutionnaire et promet-teur, mais il n’est pas logé dans le bon croise-ment spatio-temporel; or, comme nous avons pu le voir précédemment, la TAZ fonctionne quand toutes les conditions sont réunies.
L’idée est néanmoins restée, quoiqu’émaciée, d’un «internet land», dans l’idée qu’il peut y avoir des zones physiques suffisament hors de portée du Contrôle, garantissant une liberté totale d’explo-ration des espaces numériques. Des refuges suffi-samment à l’abri pour se permettre d’investiguer l’espace digital en toute sécurité, loin des lois physiques en contraignant l’accès. Mais encore plus intéressant, c’est l’idée que tout un chacun puisse prendre part à cette TAZ depuis les 4 coins du monde. La problématique est sensiblement la même que celle que nous avons pu dégager de Sea-land, à un détail près: la Radio Essex était émise d’un point central à une multitude, alors que les serveurs d’HavenCo sont mis à disposition d’une multitude qui en fait ce que bon lui semble. Par la nature du digital, et l’ubiquité qu’il permet, faire partie d’une TAZ n’est plus une question d’où elle est située par rapport à ceux qui la peuplent, mais d’où elle est située par rapport à qui veut y nuire. L’espace digital créé apparait comme une nouvelle zone à peupler, libre, déter-ritorialisée car accessible de partout mais rat-tachée à un lieu physique, supperposée à la carte du monde. Cela revient à rendre la géographie obsolète: tant que la TAZ digitale est maintenue par l’intégrité de son pendant physique, l’arte-fact à laquelle elle se rattache, les propriétés du Net permettent de s’abstraire des contraintes physiques par la création d’une zone fluctuante, définie elle aussi, comme un pays, par ceux qui la peuplent; mais elle est d’une toute autre nature.
66Comme pour corroborer ces propos, Lackey déclare-ra, enthousiasmé par la fondation de HavenCo:
«Freedom is the next killer App»
mettant clairement en mots l’importance de cette irréfutable quête de liberté qui caractérise l’humanité, et qui à l’ère d’une surveillance globale de plus en plus intrusive, à travers des espaces digitaux, ouvre des perspectives infinies et inexplorées et des problématiques qui ne ces-seront d’évoluer.
Cette fuite de l’emprise du Contrôle entrainera Wikileaks, en 2012, à faire une offre à Sealand pour obtenir son asile, qui lui sera refusé pour des questions d’éthique. Mais avant Wikileaks, en 2007 est refusé pour la même raison The Pirate Bay, le site de peer-to-peer suédois qui tente de racheter Sealand (qui a été mis en vente par la famille royale) au terme d’une collecte de fonds qui aura permis d’amasser pas moins de 20000 dol-lars. Mais The Pirate Bay ne s’est pas inquié-tée pour autant de cette campagne, à la limite de la blague de mauvais goùt: ele a toujours eu une longueur d’avance.
GARFINKEL, Simson. Welcome to Sealand Now Bugger Off. WIRED, n°8.07, 2000
71Le 9 décembre 2014, le site de peer-to-peer The Pirate Bay est hors-ligne. La presse internatio-nale confirme la rumeur qui affole le Net: des serveurs ont été confisqués suite à une descente de police chez Bahnof AB, un datacenter construit sous la montagne de Nacka, dans la banlieue de Stockholm. Les forces de l’ordre indiquent que la perquisition «est en rapport avec la violation du droit d’auteur». Serait-ce la fin définitive du site?
Pas plus de deux semaines suivant cette interven-tion, le domaine du site, thepiratebay.se, est de nouveau en ligne, son contenu n’étant toutefois pas accessible. En revanche, il est affublé d’un compte à rebours annonçant un retour en bonne et due forme fixé au 1er février 2015. Entre autres changements, un phoenix stylisé orne la page d’accueil du site, en référence évidente à la fa-culté de renaître de ses cendres qui est attribué à l’oiseau légendaire.
Pour couronner l’annonce d’un retour imminent du site, et pour adresser à l’industrie du film hol-lywoodienne une cinglante boutade, se trouve dans le code source de la page web une chaîne de ca-ractères qui semble être cryptée.
Elle a récemment été décryptée; elle renvoit à un lien youtube, lequel est une compilation de scènes de Terminator dans lesquelles Arnold Schwarze-negger, fervent défenseur des droits d’auteur, prononce une phrase éloquente et qui a grande-ment contribué à construire sa célébrité: I’ll be back.
The Pirate Bay fut créée en même temps que le Pi-ratbyrån, en 2003. Basé en Suède, celui-ci est un groupe de réflexion dédié à la remise en question du droit d’auteur et plus globalement au partage et à l’accès libre et sans concession de l’in-formation et de la culture. Initié en réaction ironique à l’Antipiratbyrån suédois, ses membres fondateurs estimant avec humour qu’il n’a pas lieu d’être sans la présence d’un Piratbyrån, se nom-mant donc ainsi par suppression de la préposition «Anti». Il recevra par ailleurs un Award of Dis-
72tinction de la fondation Ars Electronica en 2009, félicité pour son approche large de la remise en question du copyright, innovante, expérimentale et souvent humoristiques, mais aussi avec des moyens plus conventionnels. Il donnera naissance à un dogme en 2005, le Kopimisme (en référence à Ibi Kopimi Botani, son créateur, et à la sonori-té proche de l’anglais «copy me», littéralement «copie-moi»), qui sera reconnu comme une religion par les autorités suédoises. Basé sur les mêmes idéaux, il se rattache entre autre au Saint Sa-crement «CTRL-C CTRL-V» et a donné naissance à une licence à l’opposé du copyright, qui une fois apposée à un produit donne le droit et incite le consommateur à le copier et le diffuser.
The Pirate Bay est conçu comme un système de ser-veurs permettant le transfert de fichiers en peer-to-peer au moyen du protocole de communication BitTorrent, dont un «tracker» permettant de les indexer. Chacun est libre, s’il possède un fichier qu’il souhaite partager avec la communauté, de poster un lien (dénomé «magnet» pour le protocole BitTorrent) avec un descriptif, permettant à qui-conque de venir télécharger le ficher sur son ordi-nateur. Ainsi, le site n’offre qu’une plateforme, un espace permettant le recensement de fichiers téléchargeables, un vaste index, dans lequel il est possible de naviguer au moyen d’un moteur de recherches. Aucune donnée n’est donc hébergée sur les serveurs de The Pirate Bay, qui ne sert que d’intermédiaire, de grand catalogue permettant l’accès aux ressources, en quelque sorte à la ma-nière d’un Whole Earth Catalog en son temps.
Le Piratbyrån se détachera rapidement de The Pi-rate Bay, en 2004, lui donnant l’élan nécessaire à son émancipation. Rédigé en suédois, et initia-lement conçu pour un usage local, le site gagnera vite en popularité et en notoriété. Ce phénomène se repercutera rapidement sur le Net et à travers le monde, à tel point qu’à un moment en 2004, 70% du contenu de The Pirate Bay est en espagnol. Parmis les fichiers les plus téléchargés figure un ensemble de leçons visant à enseigner le suédois, utilisé par les internautes pour mieux appréhen-der le site d’une part et lui faire honneur de
73l’autre. Ceci fera prendre conscience à ses trois fondateurs, Gottfrid Svartholm, Fredrik Neij et Peter Sunde, de l’ampleur du mouvement qu’ils ont initié et qui semble répondre à un réel besoin d’une frange des cybernautes (bien que le peer-to-peer ne soit pas un phénomène nouveau, mais bien le fonctionnement du Net tel qu’il était pensé à ses origines). Le site sera donc traduit en plusieurs langues, et connaîtra une ascension fulgurante au point de représenter, en 2006 déjà, 80% du volume du partage BitTorrent, qui lui-même représente environ 60% du volume total des don-nées sur le Net. Ce qui revient grossièrement à dire que The Pirate Bay représente à elle seule la moitié du trafic internet.
La nature des fichiers échangés via The Pirate Bay est très majoritairement de l’ordre du divertis-sement, principalement des films et de la musique. Ce qui ne manquera pas de se répercuter sur les ventes correspondantes dans les modes tradition-nels de distribution et de susciter les foudres des entreprises concernées. De nombreux mails de menace sont ainsi envoyés aux fondateurs de The Pirate Bay, les exhortant à mettre hors-ligne sur le champs des liens en rapport avec les fichiers concernés. La réponse sera systématiquement, et à juste titre, que The Pirate Bay n’est pas respon-sable de la nature du contenu qui est échangé sur ses serveurs, qui ne sont que mis à disposition des utilisateurs. Ceux-ci, en revanche, le sont: et il conviendrait donc de les contacter directe-ment pour demander le retrait du lien.
Les premières réponses à ces entreprises (la plu-part du temps basées aux Etats-Unis) seront de nature courtoise et diplomatique. Mais devant l’incompréhension répétée de bon nombre d’entre elles, l’équipe de The Pirate Bay répondra sou-vent avec humour ou cynisme. Ainsi, à certaines menaces proférées par différents magnats du ciné-ma hollywoodien pour atteinte au droit d’auteur, le mail de réponse sera une photo de petit ours blanc, nonchalament sous titré d’un «hey! Nous ne vivons pas en Amérique, nous vivons en Suède. Des ours polaires nous courrent après pour nous man-ger: c’est un problème. Les droits d’auteur n’en
74sont pas un». Une plainte de Linotype, une socié-té propriétaire de typographies, exigeant éga-lement la mise hors-ligne des liens, recevra le même mail en retour, rédigé uniquement avec les fontes Linotype et déclarant que le directeur de la société s’engage à aider au financement de The Pirate Bay. Et au delà d’un certain seuil de pa-tience, les réponses à ces menaces prendront sou-vent la forme d’un chaleureux et cordial «Would you please go sodomize yourself, Sweden is not a state of the US. Your laws don’t apply here. Po-lite as usual», confirmant ainsi l’intransigeance de The Pirate Bay par rapport au respect de ses idéaux.
«Dans ta gueule, Hollywood.»
Cette irrévérence face aux menaces de puissantes sociétés américaines, aux demandes desquelles quiconque se plierait, fera partie intégrante du succés de The Pirate Bay. Ce qui ne manquera évi-demment pas de provoquer une violente réaction de la part des entreprises concernées. Ainsi, les fondateurs de The Pirate Bay seront accusés d’»assistance à la mise à disposition de contenu protégés par le droit d’auteur» et les serveurs du site seront confisqués en 2006, la Motion Pic-ture Association of America ayant fait pression sur la Suède et l’ayant menacée de sanctions. Mais 3 jours plus tard, le site est de nouveau en ligne, affublé d’une image donnant à voir le na-vire du logo original du site suédois tirer des boulets de canon sur le fameux signe en lettres capitales «HOLLYWOOD.» A compter de cette date et tirant des leçons de cette expérience qui au-rait pu mal finir, The Pirate Bay fera toujours en sorte d’avoir plusieurs copies du site de secours hébergées dans différents endroits à travers le monde.
NEIJ, Fredrik. TPB AFK - The Pirate Bay Away From Keyboard, 2008
76En 2009, les fondateurs de The Pirate Bay se-ront condamnés par la justice suédoise, victime du chantage exercé par l’industrie du film améri-caine, à un an de prison ferme et 3 milions d’eu-ros d’amende pour assistance à atteinte au droit d’auteur. La peine sera finalement diminuée sur ap-pel, mais les 3 fondateurs se retireront du site. En 2010 ,celui-ci sera à nouveau mis hors-ligne à cause d’une plainte déposée contre leur four-nisseur de bande passante, mais sera de nouveau accessible très rapidement, jusqu’à cette saisie récente des serveurs par la police suédoise, le 9 décembre 2014.
The Pirate Bay est le dernier exemple à l’ana-lyse duquel nous nous attelons et il soulève de nombreuses problématiques qui appuient notre dé-marche.
En tant que TAZ, The Pirate Bay véhicule une idée forte: l’idée d’un partage libre et sans conces-sion ni censure de la culture et de l’information. Par le fait qu’elle permet la libre distribution à échelle mondiale de fichiers protégés par droit d’auteur, elle invite à une reflexion à propos de celui-ci; elle ne cherche pas à l’abolir par la force, mais à ouvrir une discussion sur sa nature et les modalités de son usage en invitant à une réflexion sur ses origines. La notion de proprié-té intellectuelle, dans l’histoire de l’humanité, existe depuis que l’être humain est en mesure de créer. La société s’est construite sur les inno-vations amenées par des individus, qui ont permis le bond en avant de la civilisation, encore accé-léré dès la Révolution Industrielle. Le progrès était récompensé et c’est ce qui a permis d’en-tretenir la soif d’inovation et de recherche de l’Homme (Stay Hungry, Stay Foolish...). C’est de cette reconnaissance de la nouveauté amenée par l’effort de l’individu qu’est né le droit d’au-teur.
Ce que The Pirate Bay remet en cause, c’est l’utilisation du droit d’auteur comme outil de contrôle, comme une façon pour des entreprises milliardaires de s’assurer des rentrées d’argent toujours plus colossales et du Pouvoir en tant
77que détenteur de la culture et du savoir. Ces industries ont toujours émis une grande méfiance et prudence face aux différents modes d’émission créés au cours du siècle. L’industrie musicale a cru que l’arrivée de la radio signerait son arrêt de mort: elle a finalement su rebondir en y diffu-sant son contenu, touchant des dividendes quand celui-ci était diffusé. Il en va de même pour l’industrie cinématographique et l’apparition de la télévision dans les foyers. Cassettes, CD, DVD: à chaque nouvelle technique de diffusion, ces industries ont donc su trouver une réponse en utilisant le media à leur avantage... sauf le Net. Par sa nature incontrôlable, mouvante, et surtout non-physique et donc beaucoup plus diffi-cilement contrôlable, l’industrie n’a jamais su s’assurer pleinement le contrôle de ce media qui lui échappe, ce media d’ampleur mondiale aux va-leurs démocratiques auquel chacun participe et dont les racines sont le partage d’égal à égal et le libre flux d’information. De peur (suscitée comme souvent pas une incompréhension) de perdre son monopole et de voir ses recettes diminuer, l’industrie n’hésite alors plus à intenter des actions en justice envers les contrevenants avé-rés, et à tenter de remettre le publique sur le droit chemin en gagnant sa sympathie à travers diverses campagnes rappelant que «pirater, c’est voler».
The Pirate Bay n’est pas anti-copyright, mais elle souhaite voir celui-ci appliqué comme récompense d’une recherche et d’une inovation constante, qui fasse avancer le monde, et donner la possibilité à petits projets de voir le jour sans la crainte de tomber dans l’oubli de la narration dominante. Comme pour appuyer cette direction, Peter Sunder lancera en 2010 Flattr, un système de micropaie-ment visant à financer des projets indépendants sur le Net. Une icône à l’effigie du système sera apposée à côté de ceux-ci; l’utilisateur de Flat-tr, de son côté, verse chaque mois une somme de son choix au service. A chaque fois qu’il trouve un projet intéressant, l’utilisateur peut cliquer sur l’icône Flattr et à la fin du mois, la somme qu’il a investie se retrouve divisée entre tous les projets qu’il a aimés.
78Aux yeux du concept de TAZ, il y bien d’autres aspects à mettre en avant:
Comme nous avons pu le voir, la TAZ digitale aura eu un énorme impact physique; ce que The Pirate Bay a mis en place a eu un impact mondial et a contribué, comme la radio le fit en son temps, à remettre en question la place de la culture dans la société en réponse à un contexte de commer-cialisation et de privatisation croissantes de l’information. Comme pour appyuer cette remise en cause, on peut constater le partage de fi-chiers par protocole BitTorrent n’a pas diminué avec la fermeture récente de PirateBay: 100 mi-lions d’adresses IP par jour sont impliquées dans l’échange de fichiers en peer-to-peer. De plus, il a été démontré que la lutte contre le piratage coûtait plus cher à Hollywood que les pertes gé-nérées par celui-ci. Cela soulève alors un cer-tain nombre de questions . Quelle est la place de la culture dans la société? Comment la consom-mons-nous? Quelle est la valeur de l’information? Veut-elle être libre ou avoir un prix, comme Stewart Brand interroge? Faut-il accepter le pi-ratage (qui ne date d’ailleurs pas d’hier, comme le rappelle le motif qui orne la voile du bateau du logo de The Pirate Bay: le logo d’une campagne anti-piraterie des années 80, «Home Taping is Kil-ling Music») comme un composant du système qui ne peut être éradiqué? Le droit d’auteur tel qu’il est appliqué aujourd’hui est-il sur le point de mourir? Si oui, qu’est-ce que cela implique pour la culture?
81«We don’t like that (IRL - In Real Life) expression. We say AFK - Away From Keyboard. We think that the internet is for real.»
déclarera Peter Sunde, bien placé pour rappe-ler l’impact que sa TAZ digitale a eu sur la vie «réelle». Nous ne prétendons pas apporter de ré-ponses à ces questions ici, mais tout l’intérêt réside dans le fait qu’elles on été posées, et ce à tous les internautes. Le groupe de discussion du Piratbyrån aura finalement fini par s’étendre au monde entier...
Un autre point intéressant que l’on peut soule-ver en rapport à la TAZ, c’est la capacité de réapparition de The Pirate Bay. Tout d’abord par sa nature virale: elle prend certes la forme d’un système de serveurs, mais n’hébergeant au-cun contenu, elle est surtout un index de lien réplicable extrêmement facilement. Aux yeux de la piraterie telle que Bey la décrit, The Pirate Bay devrait plutôt s’appeler The Pirate Map. Zone digitale qui permet la création d’une communau-té impressionante, elle est surtout la carte d’un vaste réseau de trésors, superposable à la carte du monde à proprement parler, car le principe du peering est de mettre les fichiers à disposition depuis son ordinateur, qui a une matérialité, vers lesquels les cybernautes sont redirigés. Impos-sible de ne pas faire la comparaison avec le Whole Earth Catalog; on pourrait sous titrer The Pirate Bay «access to culture» ou «access to files» pour la forme de catalogue de liens qu’il lui emprunte 30 ans plus tard. Par son statut d’intermédiaire également: l’auteur du projet ne fait qu’offrir une zone où les individus sont libres d’aller chercher des références comme bon leur semble. Les créateurs ne sont ainsi pas responsables mais ne jouent ainsi que le rôle de catalyseur d’un mouvement. Ils se dégagent de toute repsonsabi-
SUNDE, Peter. TPB AFK - The Pirate Bay Away From Keyboard, 2008
82lité en prenant comme postulat que l’être humain agit selon son libre arbitre, sait pertinemment distinguer le bien du mal et est responsable de ses actions. Si le phénomène se produit, c’est qu’il s’inscrit dans la logique des choses.
La capacité de réaparition de cette TAZ tient donc à sa nature virale et un projet du nom de OpenBay, lancé en soutien à la fermeture récente de The Pirate Bay par un autre site de peer-to-peer du nom de Isohunt, le confirme allègrement. En effet, celui-ci propose à tout un chacun, sous la forme d’un tutoriel très simple, de récupérer la totalité des magnets d’une sauvegarde de The Pirate Bay et de créer une instance personnelle du site suédois. Ce qui sonne d’ailleurs comme une mise en abîme: copier une plateforme de co-pie...
Cette faculté de disparaître, réapparaître, se faire coincer, être partout à la fois et tout le monde et personne à la fois (idée qui donnera naissance à un logo alternatif pour le site, «the Hydra Bay», en référence aux têtes de la créature légendaire qui repoussent quand on les coupe). Cette avance technique sur les lois qui régissent le monde, The Pirate Bay l’entretien avec cy-nisme et ironie, véritable pied de nez arrogant à la face du monde du droit d’auteur, une fraî-cheur qui contraste avec le poids des questions qu’elle soulève. Avec humour, le Piratbyrån dé-clera d’ailleurs considérer The Pirate Bay comme une performance artistique à long terme...
Trop long terme, justement? C’est la question qu’on est en droit de se poser au regard d’une propriété de la TAZ que nous avons pu voir: la capacité de savoir être éphémère pour ne pas tom-ber en décadence ou en désuétude. C’est du moins l’avis de Peter Sunde, selon qui The Pirate Bay aurait trop duré et ce pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, le fait que le site à tendance à faire ressortir ce contre quoi il se bat: le manque d’innovation. En effet, le site n’est plus développé mais continue à grossir, est plein de bugs et se charge d’un nombre croissant de publi-cités afin de se financer. Il rappelle d’ailleurs
83que l’idée de base était de fermer The Pirate Bay le jour de son dixième anniversaire, comme la conclusion d’une expérience qui en susciterait d’autres. Il est heureux de savoir The Pirate Bay hors-ligne, mais se déclare juste déçu de la façon dont ça s’est fait, un retrait dans les règles de l’art aurait pu donner à la communauté les bons fondements pour initier quelque chose de mieux.
Cette TAZ digitale a donc eu un énorme impact physique et comme celles que nous avons pu voir jusqu’ alors, elle nécessite une assise physique pour exister. Il en résulte une déterritoriali-sation poussée à l’extrême: via cette zone digi-tale, dont l’artefact physique est situé en Suède (ou ailleurs?), des individus du monde entier ont la possibilité d’aller chercher l’information là où elle se trouve, peu importe sa position géo-graphique. Nous avons évoqué en parlant de Haven-Co le fait de rendre la géographie obsolète; The Pirate Bay semble en être le meilleur exemple. Le Net, par l’ubiquité quasi instantanée qu’il per-met, fait allègrement la nique aux lois connues de la physique. Ainsi, un internaute peut regar-der après quelque minutes de téléchargement un film qu’il est allé chercher au bout du monde.
Cela semble répondre à la question de Bey quand à sa peur de la cybergnôse et lui amener ses na-vets, d’autant plus depuis que The Pirate Bay a ouvert dans son catalogue la section «Physibles». Elle référence en effet une myriade de plans d’objets, que n’importe quel popriétaire d’impri-mante 3D est en mesure de télécharger et d’im-primer. Avec la démocratisation de celle-ci, le futur serait-il dont de pouvoir rematérialiser chez soi des objets dont l’original se situerait à l’autre bout de la terre? Mais ça, c’est une autre histoire...
The Pirate Bay a tout de même besoin de son as-sise physique, sans laquelle elle ne peut exis-ter. Une fois en ligne, rien ne semble pouvoir l’arrêter, pas même les blocages mis en place par les fournisseurs d’accès internet. En effet, The Pirate Bay a récemment lancé un navigateur inter-net répondant au nom de Pirate Browser (littéra-
84lement «le navire pirate») qui est en fait une version boostée du navigateur Firefox utilisant la technologie Tor pour contourner les blocages.
Si ses serveurs sont arrêtés physiquement, la zone digitale disparait. Mais The Pirate Bay peut compter sur sa nature extrêmement virale pour renaître. «Ça fait partie du jeu», admet Sun-de. Bien que mise hors-ligne pour le moment, rien n’indique qu’elle ne réapparaitra pas encore, narquoise par sa solubilité, visible mais parfai-tement incoercible.
M.A.J.: Nous sommes le 1er février au matin. Je retourne sur thepiratebay.se pour vérifier si le compte à rebours annonçant son retour a pris fin en la voyant renaître.
The Pirate Bay est de retour en ligne.
89A travers ces 5 exemples, nous avons un aperçu de différentes formes que peuvent peut prendre la TAZ de l’ère digitale, avec des particulari-tés et des lacunes. Chacune à leur manière, elles apparaissent en réponse à un contexte spécifique qu’elles refusent. Par leur nature controversée, elles soulèvent des thématiques et des questions pertinentes face à la situation et proposent des alternatives, solutions et idées nouvelles. Vi-sibles aux yeux du Contrôle mais difficiles à mettre hors d’état de nuire car forte de divers subterfuges, dont l’avance de la technologie sur les lois.
Nous avons également pu mettre en branle le concept de cybergnose évoqué par Bey. En effet, à travers tous ces cas de figure, il ressort que la plupart de ces zones digitales naissent en réponse à une problématique physique, mais toutes ont des répercussions réelles, chacune à son niveau.
En conclusion, en plus des éléments précités, on peut dire que la TAZ analogique se rattache sur-tout à deux dimensions: la temporalité dans la-quelle elle s’inscrit, plus ou moins longue et justifiée et l’espace physique, tangible, determi-né par un territoire.
La TAZ digitale ne répond pas aux mêmes lois. Son espace est d’une toute autre nature: par la maî-trise de technologies et de leur potentiel libéra-teur, l’Homme a pu lui donner naissance et de ce fait la possibilité de l’occuper, de l’interfa-cer, d’y naviguer. Ces espaces, mouvants, fluides, impalpables, ces «Islands in the Net» semblent se superposer au monde que nous percevons, comme le prédit Bey dans son essai:
«Prenez une carte du territoire, [...]po-sez là-dessus une carte du Net [... ] et enfin, par-dessus, la carte à l’échelle 1:1 de l’imagi-nation créatrice, de l’esthétique et des valeurs. La grille ainsi obtenue prend vie, animée de tourbillons et d’afflux d’énergie, de coagulations de lumière, de passages secrets, de surprises.»
90Néanmoins, et c’est là toute la condition de ces zones, leur existence tient à des créations de l’être humain, qui sont par conséquent maté-rielles, quel que soit leur degré d’avancement technologique. Ce qui signifie que si ces créations sont, pour une raison ou une autres, abîmées, dé-truites ou mises hors d’état de nuire/donner vie à la zone digitale, celle-ci s’évanouit. C’est parce qu’elles ont été créées qu’elles peuvent être détruites.
En partant de ce postulat on comprend donc que si la zone digitale veut exister, être autonome, son attache physique doit être placée en lieu sûr, cachée des entités mal intentionnées. Pour résu-mer: pour que la TAZ numérique existe, son ar-tefact, son «générateur» dans le monde physique, doit être une TAZ à part entière également.
C’est ce que nous avons pu constater tout au long de l’analyse de ces différents exemples, et ce qui nous a aussi été confirmé par le résultat de l’enquête sur les vestiges du projet d’Aram Bar-tholl: en effet, si le support physique est in-terfaçable, on peut constater dans ces Dead Drops le bouillon de culture qui y a pris forme, le monde qui s’est formé. Si le support physique est endomagé, plus aucun espoir d’y accéder.
En somme, les TAZs digitales sont définies par trois critères: leur zone digitale, l’intégrité de leur assise physique, et la temporalité dans laquelle elles prennent place.
Les TAZs digitales sont donc des TAZs en trois dimensions: des TAZs 3D.
La seule zone digitale qui peut prétendre se pas-ser d’une assise physique indestructible (dans un certain sens), c’est l’esprit. Bien que limité à l’individu, il existe car l’être humain EST, c’est sa nature intrinsèque. «Je pense donc je suis». L’esprit est une TAZ créée par l’homme sans même que celui-ci ne s’en rende compte.
92Néanmoins l’esprit humain est limité à l’indivi-du. La seule façon de dégager de nouvelles zones numériques qui puissent subsiter par elle-même serait donc qu’elle fasse partie intégrante de l’humain et qu’elles ne soient pas une création externe.
En tant qu’amateur de culture cyberpunk, il me paraît à ce propos intéressant de mentionner ici une théorie qui, bien que fantasque, suscite à ce sujet mon plus vif intérêt. Elle est développée par Douglass Rushkoff dans la série d’animation Serial Expermients Lain, parue en 1998:
En gravitation autour du soleil, la Terre est par-courue d’ondes electromagnétiques. Entre la io-nosphère et la surface de la Terre, il existe une résonnance constante, d’une fréquence de 8hz et donc imperceptibe, qui porte le nom de résonnance Shuman. L’impact de ces ondes qui parcourent en permanence l’atmosphère et leur éventuel effet sur le cerveau humain sont pour l’instant impos-sibles à quantifier et demeurent un mystère. Mais il est sûr est certain que tout le monde la per-çoit, même s’il ne l’entend pas.
Si tous les humains sur terre étaient capables de percevoir d’une façon ou d’une autre cette réson-nance, la conscience de la Terre s’éveillerait et les individus constitueraient alors les maillons d’un immense réseau, à l’image du Net.
A méditer...
PS: dans le cadre de ce mémoire, et pour récon-cilier approche théorique et pratique physique, une Dead Drop a été cimentée dans le sous-sol de l’écal. Elle porte le nom de mon mémoire, et est répertoriée dans l’index officiel du site du pro-jet. Elle contient la totalité des fichiers récu-pérés aux quatres coins d’Europe, le manifeste d’Aram Bartholl, ainsi qu’un exemplaire pdf du texte dont vous achevez la lecture. Bonnes re-cherches!
BECKETT, Andy. The dark side of the internet. http://www.theguardian.com/technology/2009/nov/26/dark-side-internet-freenet
Références
DELEUZE, Gilles. Pourparlers 1972-1990. Les éditions de Minuit, 1990
DEBORD, Guy. La Société du Spectacle. Gallimard, 1992
DEBORD, Guy. Commentaire sur La Société du Spectacle. Editions Gérard Lebovici, 1988
ABBAS, Yasmine. Neo-nomadism. http://videos.liftconference.com/video/1169165/yasmine-abbas-neo-nomadism
BEY, Hakim. TAZ - Zone Autonome Temporaire. Editions de l’Eclat, 1997
BRAND, Stewart. Spacewar. Rolling Stone, n°123, 1972
BENNETSEN, Henrik. From Counterculture to Cyberculture: The Legacy of the Whole Earth Catalog. https://www.youtube.com/watch?v=B5kQYWLtW3Y
DIRCKSEN, Kirsten. Whole Earth Catalog revisited: Steve Job’s Google of the 60s. http://faircompanies.com/videos/view/whole-earth-catalog-revisited-steve-jobs-google-60s/
Article du MoMA à l’occasion de la retrospective sur le Whole Earth Catalog. http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2011/AccesstoTools/
96
GRIMMELMANN, James. Sealand, HavenCo, and the Rule of Law. University of Illinois Law Review, Volume 2012 n°2, 2012
Interview de Stewart Brand par Big Think. https://www.youtube.com/watch?v=iV3PBfmnI4I
FOUCAULT, Michel. Les Hétérotopies - Le Corps Utopique. Éditions Lignes, 2009
GARFINKEL, Simson. Welcome to Sealand Now Bugger Off. WIRED, n°8.07, 2000
HODGKINSON, Thomas. Notes from a small island: Is Sealand an independent ‘micronation’ or an illegal fortress? http://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/notes-from-a-small-island-is-sealand-an-independent-micronation-or-an-illegal-fortress-8617991.html
JOHNS, Adrian. Piracy as a Business Force. Culture Machine, n°4, 2009
FARIVAR, Cyrus. Evasive action: How The Pirate Bay four dodged Swedish justice. http://arstechnica.com/tech-policy/2012/10/evasive-maneuvers-how-the-pirate-bay-founders-dodged-swedish-justice/
KLOSE, Simon. TPB AFK - The Pirate Bay Away From Keyboard. 2008
LACKEY, Ryan. HavenCo: what really happened. https://www.youtube.com/watch?v=aJ6ByBaTxms
DRAGONA, Daphne. Netless Dead Drops. Neural, n°38, 2011
97MEARIAN, Lucas. Dead Drops offline P2P file sharing network goes global. http://www.computerworld.com/article/2597815/data-center/dead-drops-offline-p2p-file-sharing-network-goes-global.html
Site officiel du projet Deaddrops. https://deaddrops.com/
Site officiel du Whole Earth Catalog. http://www.wholeearth.com/
MASSIE, Craig. The Pirate Bay Case: A Critique of Marxist Perspectives in Music File Sharing Discourse. Edinburgh Napier University, 2012
PANDEYA, Hans. Thoughts about The Pirate Bay. http://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2009/08/manifest.pdf
SUNDE, Peter. The Pirate Bay down, forever?. http://blog.brokep.com/2014/12/09/the-pirate-bay-down-forever/
SUNDE, Peter. Peter Sunde’s talk at Wired 2011. http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-10/14/peter-sunde-wired-11-flattr-pirate-bay
SPANGLER, Todd. Pirate Bay Shutdown Has Had Virtually No Effect on Digital Piracy Levels. http://variety.com/2014/digital/news/pirate-bay-shutdown-has-had-virtually-no-effect-on-digital-piracy-levels-1201378756/
SELLARS, Simon. Hakim Bey - Repopulating the Temporary Autonomous Zone. Journal for the Study of Radicalism Volume 4, n°2, 2010
98Tumblr officiel du projet Deaddrops. http://deaddrops.tumblr.com/
TURNER, Fred. From Counterculture to Cyberculture - Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism. University of Chicago Press, 2006
VOGEL, Peter. Will Data Localization Kill the Internet?. http://www.ecommercetimes.com/story/79946.html
WARK, McKenzie. A Hacker Manifesto. Harvard University Press, 2004
YOUNG, Michelle. An Interview with Aram Bartholl, founder of the Dead Drops Project. http://untappedcities.com/2011/02/22/an-interview-with-aram-bartholl-founder-of-the-dead-drops-project/