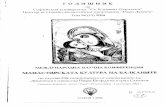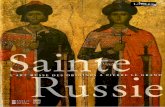« Archéologie du décor mural : un nouveau regard sur le programme ornemental en stuc de...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of « Archéologie du décor mural : un nouveau regard sur le programme ornemental en stuc de...
Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII, 2012 Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON 147
ARCHÉOLOGIE DU DÉCOR MURAL :
la redécouverte du programme ornemental
de stucs et d’enduits peints dans
l’ancienne église Sainte-Marie d’Alet-les-Bains
Bénédicte Palazzo-BertholonCentre d’Études Médiévales d’Auxerre (UMR 5594),
Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale (CESCM-UMR 7302) de Poitiers.
INTRODUCTION
Le monastère bénédictin de Sainte-Marie d’Alet fut fondé probablement au cours du XIe siècle1. Sa première mention date de 993. Les bâtiments du haut Moyen Âge furent remplacés par l’abbaye romane que nous connaissons aujourd’hui, bien qu’elle soit actuellement à l’état de ruine. De cette époque subsistent l’abside, une partie des murs gouttereaux, quelques piliers qui divi-saient les trois vaisseaux de la nef et la façade occidentale. La datation de cette église abbatiale pose un certain nombre de problèmes en raison du caractère original de son décor inspiré de l’Antiquité, qui trouve peu de comparaisons datées dans le contexte architectural médiéval.L’ensemble conserve néanmoins de belles sculptures notamment sur les baies et les chapiteaux. L’abside quant à elle conserve une corniche sculptée et de beaux chapiteaux aux extrémités nord et sud. Les arcatures ouvrant sur les absidioles (1 à 5) et les chapiteaux intermédiaires apparaissent lisses dans leur état actuel, mais ils étaient à l’origine recouverts de stucs et ce décor constitue un des rares vestiges de stucs médiévaux en France conservés in situ. L’état fragmentaire des reliefs et leur chute progressive en raison des intempéries et des dégradations dues aux pigeons, ont précipité l’intervention conjointe des archéologues et des restaurateurs, a!n de préserver avant l’hiver 2010 ce qui restait de ce précieux témoignage artistique (ill. 1). L’abside de l’ancienne église Sainte-Marie d’Alet présente une phase homogène de construction, comprenant cinq absidioles. L’absidiole axiale comporte un arc sensiblement plus haut que les autres, dont l’arcature est simple et non double comme à l’entrée des quatre autres absidioles latérales (deux au nord et deux au sud). La pierre employée pour le parement de l’abside – comme pour le reste de l’église d’ailleurs – est un grès jaune qui se désagrège aujourd’hui en surface.
1. Pour la description de l’église abbatiale, les problèmes de datation et la bibliographie, voir G. Mallet, « Stucs préromans et romans des vallées de l’Aude et du Roussillon », Stucs et décors de la fin de l’Antiquité au Moyen Âge (Ve-XIIe siècles), Bibliothèque de l’Antiquité Tardive, 10, dir. Ch. Sapin, Turnhout, 2006, p. 239-247.
Cuxa 2012.indb 147 15/05/2012 10:33:08
148 Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII, 2012
Sa surface rugueuse a sans doute favorisé l’adhérence de l’enduit peint et des stucs lors de leur mise en œuvre. Son érosion accélérée est due aux agressions atmosphériques directes, car le vent entre frontalement dans l’espace de l’ab-side, et aux pigeons qui y nichent et dégradent les parements (ill. 2). L’érosion de surface provoque la dislocation du grès et la perte de liant dans la pierre, qui alors se délite. L’e�ritement des pierres du parement a très certainement précipité la chute du décor.
Le présent article rassemble les résultats de l’étude du décor mural conduite dans l’abside de l’ancienne église d’Alet-les-Bains2. La première partie sera consacrée à l’étude archéologique des vestiges de stucs et d’enduits peints, partiellement conservés in situ. La seconde partie présentera les aspects techniques de ces vestiges, à partir de la caractérisation des matériaux : stucs, enduits et couches picturales.
2. L’étude archéologique a été conduite dans le cadre du Centre d’Études Médiévales d’Auxerre, que nous remercions pour son soutien. Cette étude conjointe archéologie & restauration n’aurait pas vu le jour sans le montage et le soutien du projet assurés par Anne Rebière, ni l’autorisation et le financement accordés par le CRMH - DRAC Languedoc-Roussillon en la personne de Mme Delphine Christophe CRMH et de Mr. Jean-Marie Baroy, Ingénieur du Patrimoine. Nos remerciements s’adressent également à : - Heike Hansen pour les relevés architecturaux, qui est intervenue en urgence sur le site ; - Agata Dmochowska-Brasseur et Édouard Torres, restaurateurs de l’atelier Jean-Loup Bouvier, pour la collaboration scientifique et les échanges fructueux que nous avons eus sur le chantier ; - François Rassineux de la société ERM (Études, Recherches, Matériaux) pour les analyses au MEB ; - Gilles Fèvre (CEM Auxerre) pour les restitutions graphiques qui valorisent les résultats de cette étude.
2 - Archivolte 1 (côté nord), usure éolienne de la corniche sculptée.
2.00 m
0.00 m
4.00 m
6.00 m
8.00 m
10.00 m
2.00 m
0.00 m
4.00 m
6.00 m
8.00 m
10.00 m
0 1 2 3 4 m
secteur :
date : site :Janvier 2012
Relevé architectural: H. HANSEN
raccord et mise en forme: G. FEVRE Ancienne église Sainte-Marie
ALET -LES-BAINS
CENTRE D'ÉTUDES MÉDIÉVALES d'AUXERRE
Abside Développé des arcatures 1 à 5
N
54
3
21
54321
1 - Vue générale de l’archivolte 5 avec les stucs 1 et 2 originaux en place.Crédits photographiques pour les clichés : B. Palazzo-Bertholon.
3 - Développé des arcatures 1 à 5. Relevé architectural : Heike Hansen et mise en forme : Gilles Fèvre, CEM Auxerre.
Cuxa 2012.indb 148 15/05/2012 10:33:12
Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII, 2012 Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON 149
La synthèse des résultats en�n, permettra sur la base des reconstitutions graphiques, d’illustrer l’intérêt du décor disparu et de le replacer dans le contexte technique et artistique du stuc au Moyen Âge.
I- L’ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE DES VESTIGES IN SITU
A. Les stucsOn conserve trois fragments de stucs en place sur les arcatures, du côté sud de l’abside (ill. 3). Le premier vestige (stuc 1) est situé sur l’arcature 5 à l’extré-mité sud-ouest de l’abside, le deuxième à la jonction des arcatures 5 et 4 (stuc 2) et le troisième sur l’arcature 4 (stuc 3). Les fragments 1 et 3 sur les arcatures sont ornés de motifs végétaux di#érents, incisés dans l’épaisseur du stuc en faible relief et les motifs sont bordés par un contour soulignant l’arête de l’arcature. Le stuc 1 est composé de palmettes entourées de tiges sinueuses formant des rinceaux à entrelacs. Les folioles, taillées à la lame et les trous réa-lisés au foret, marquent l’incision et le relief du dessin. Le stuc 3 qui se déve-loppe sur le chanfrein de l’archivolte 4, présente quant à lui, un motif plus simple de palmettes. Le fragment 2, plus imposant, est constitué du départ des deux arcatures stuquées liées entre elles par un chapiteau dans l’écoinçon. Ce dernier porte un décor de feuilles lancéolées qui occupent parfaitement l’espace de l’écoinçon évasé vers le haut. Sur la partie sommitale du chapiteau de stuc, apparaissent deux pieds, abîmés mais en haut relief, d’un personnage et le bas d’un long vêtement qui tombe dessus. À l’arrière de ces pieds, la partie basse d’un madrier de bois de section carrée (environ 10 cm de côté et conservé sur 25 cm de haut) est ancrée entre les retombées des archivoltes en pierre. Cette pièce de bois verticale, partiellement conservée, est noyée dans le stuc : il s’agit d’une âme de bois qui structurait et soutenait une �gure en haut relief, dont seuls les pieds subsistent aujourd’hui (ill. 4).
B. Les négatifs : témoins des stucs disparusL’étude des élévations de l’abside permet de collecter d’autres informations en lien avec les vestiges de stuc encore en place. Ainsi, entre les arcatures 3 et 4, un trou pratiqué dans la corniche conserve les restes d’un madrier de bois circulaire �xé verticalement dans la pierre (ill. 5). À la jonction des autres arcatures, les madriers de bois ont disparu, mais les trous dans la corniche sont conservés : ces trous sont circulaires et de petite dimension (7,5 cm), placés à chaque retombée. Comme nous l’avons évoqué plus haut, la jonction des archivoltes 4 et 5 se distingue par la présence d’un madrier, non pas circulaire
4 - Stuc 2 à la jonction des archivoltes 4 et 5. Les pieds du personnage disparu (soulignés en noir) reposent sur le rebord du chapiteau en stuc.
5 - Jonction des archivoltes 3 et 4, madrier circulaire de bois conservé dans la corniche, cheville de bois et coulures blanches sur l’appareil.
Cuxa 2012.indb 149 15/05/2012 10:33:15
150 Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII, 2012
mais de forme carrée et plus large (10 cm). L’existence côté nord (arcatures 1-2) d’un creusement dans la corniche, de même taille et de même forme, indique qu’un dispositif analogue était présent à l’origine en symétrie (ill. 6).Dans l’axe vertical de chaque madrier de bois circulaire disparu, se trouve une cheville en bois �xée dans un joint de l’appareil et scellée avec un mortier blanc. Ces chevilles appartiennent au système de maintien des reliefs de stucs sur la paroi, dont les madriers de bois constituent l’armature. Les chevilles étant placées à mi-hauteur entre les deux corniches, les hauts reliefs se déve-loppaient verticalement, jusqu’à la base de la corniche en pierre sculptée.
C. Les aspects techniques de la mise en œuvre du décorLes stucs appliqués sur le chanfrein des archivoltes sont constitués de deux couches superposées : une première strate d’accrochage (environ 1 cm d’épaisseur) est appliquée sur l’appareil de grès, puis une seconde application est ajoutée à la surface de la première pour être ensuite directement sculp-tée, à frais, à l’aide d’un couteau et d’une pointe. Les couches, de 1 à 2 cm d’épaisseur sont appliquées directement sur la pierre et elles adhèrent grâce à l’irrégularité de surface du grès et par la pénétration du stuc dans le joint entre les claveaux. La dépose de ces deux reliefs pour restauration a permis d’étudier le revers de chacun d’eux, ainsi que la surface du support (ill. 7 et 8). Aucun mode de �xation supplémentaire n’a été repéré (ni piquetage, ni gri"ure d’accrochage), de sorte qu’en l’absence des quelques vestiges sub-sistants sur le côté sud de l’abside, il serait impossible de soupçonner la pré-
6 - Localisation en plan des madriers de bois et de leur négatif à la jonction des archivoltes. Relevé architectural : Heike Hansen et localisation : B. Palazzo-Bertholon.
Cuxa 2012.indb 150 15/05/2012 10:33:16
Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII, 2012 Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON 151
sence d’un décor de stuc sur les archivoltes. On aurait imaginé, il y a quelques années encore, que les arca-tures avaient été laissées nues, en pierre apparente, ou bien qu’elles avaient été recouvertes d’un enduit peint, le cas échéant, mais rien ne laisse soupçonner la pré-sence de reliefs épais sculptés. Lorsque le relief est plus saillant, la �xation des stucs est renforcée par quelques chevilles de bois, comme on le voit à la base du chapi-teau de stuc et à la jonction des archivoltes, à l’aplomb des madriers.
D. Les enduits peintsL’étude du parement intérieur de l’abside a permis d’identi�er deux états d’enduits, associés chacun à une mise en couleur di!érente.Le premier enduit appliqué sur le parement est conservé essentiellement sur le côté sud de l’abside et de manière très lacunaire du côté est (arcature 4). Il est couvert en surface par un décor géométrique, dont seuls les fonds ont été conservés. Les archivoltes et la frise sculptée qui délimitent l’espace peint sont surlignées de trois bandes successives rouge, bleu clair et jaune. Les rehauts qui soulignaient la limite des bandes ont pratiquement tous disparu avec l’érosion de surface. Seuls de rares témoignages subsistent dans les lacunes récentes de l’enduit rose qui recouvre cet état ancien. La technique picturale employée semble être une technique mixte, avec une application à fresque des fonds, qui sont bien conservés et l’ajout des rehauts (plus fragiles) après le premier séchage de l’enduit. Par ailleurs, contrairement aux stucs, aucun badigeon préparatoire n’est visible en stratigraphie, entre l’enduit et les couches picturales (ill. 9).Le second enduit peint conservé en stratigraphie est un enduit rose que l’on trouve en di!érents endroits de l’élévation de l’abside. Il subsiste dans les zones protégées de l’extrados des archivoltes où il est appliqué sur l’enduit peint antérieur. En outre, cet enduit rose est utilisé en réparation autour du stuc 2 (ill. 10), comme bouchage dans le parement, ou pour recouvrir les voûtes des absidioles et les parements de l’abside.
7 - Stuc 3 conservé sur l’arcature 4, avant dépose. 8 - Emplacement du stuc 3 sur l’arcature 4 après dépose du relief de stuc.
9 - Archivolte 5, enduits peints résiduels.
10 - Archivolte 4, réfection en bordure du stuc 2 avec l’enduit rose.
Cuxa 2012.indb 151 15/05/2012 10:33:22
152 Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII, 2012
E. Les polychromies1- Le premier état de polychromieLes stucs étaient peints dès l’origine avec un décor polychrome. On trouve des traces de cette mise en couleur initiale principalement sur le chapiteau central et de manière plus résiduelle sur les reliefs des arcatures (ill. 11). La palette du peintre comprend : le rouge, le jaune, le orange et le bleu et l’enregistrement des restes de pigments in situ permet de proposer une res-titution graphique sur la base de la reconstitution archéologique (ill. 12)3. Le noir qui apparaît sur les photographies (ill. 11) résulte de l’oxydation du minium, mais la couleur initiale du pigment était un orange vif, comme on a pu le véri"er dans le creux des stucs, protégé sous une couche picturale plus tardive (turquoise).La limite entre les stucs et l’enduit couvrant l’appareil conserve également une couche picturale jaune et rouge contemporaine, dont les motifs sont tou-tefois peu lisibles. Aussi, les stucs et les enduits constituaient un décor peint homogène qui ornait l’ensemble des murs de l’abside.
3. Cette reconstitution de l’état 1 a été réalisée par Gilles Fèvre (CEM Auxerre).
11 - Jonction des arcatures 4 et 5, chapiteau en stuc et polychromie.
12 - État 1 de la polychromie sur le chapiteau en stuc. Restitution Gilles Fèvre, CEM Auxerre.
13 - État 2 de la polychromie sur le chapiteau en stuc. Restitution Gilles Fèvre, CEM Auxerre.
Cuxa 2012.indb 152 15/05/2012 10:33:26
Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII, 2012 Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON 153
2- Le second état de polychromieLa polychromie initiale fut ensuite recouverte par un second état de couleur, contemporain de la restauration réalisée avec l’enduit rose. Les couleurs sont alors réduites au turquoise et au blanc, ce dernier étant employé soit en sous couche (sous le turquoise), soit en couche picturale de surface. La restitu-tion graphique rend compte de l’esthétique des stucs dans ce second état du décor (ill. 13)4.
II. LA CARACTÉRISATION CHIMIQUE DES MATÉRIAUX
L’étude archéologique des vestiges en place et des témoins de leur disparition a été complétée par l’analyse du décor et de sa mise en œuvre. La caractérisa-tion des matériaux a porté sur les reliefs de stuc, certains enduits, les coulures et les mortiers de scellement conservés sur le parement, à l’arrière des stucs disparus. De plus, les couches picturales ont été analysées et les pigments identi#és pour chacun des états de décor.
A. La composition des supports Les résultats d’analyses correspondants sont regroupés dans un tableau syn-thétique des compositions chimiques (ill. 14)5.*L’enduit lissé à la base des arcatures (Alet 13), correspondant en stratigra-phie à l’enduit peint du premier état, est constitué d’un mortier tradition-nel à chaux et à sable. L’analyse élémentaire de la fraction #ne du mortier, qui contient le « liant » ajouté au sable, indique une composition combinant le calcium (51,7 %) et le magnésium (32,6 %) : il s’agit donc d’une chaux magnésienne.*Le stuc, en revanche, n’est pas composé de chaux comme on le trouve gé-néralement dans l’Antiquité6, mais de plâtre blanc sans mélange, associé à peu d’impuretés naturelles (Alet 08). Les analyses chimiques réalisées sur un corpus de stucs compris entre le Ve et le XIIIe siècle permettent d’inscrire la composition des reliefs d’Alet dans le cadre d’une production médiévale pos-térieure au IXe siècle7.*Le scellement d’une cheville (Alet 21) placée dans un joint du parement à l’aplomb du madrier de bois, présente la même composition de plâtre que le stuc employé pour les reliefs sculptés. Ce résultat indique que le même maté-riau (plâtre seul) a été utilisé pour les stucs et la #xation des chevilles, autre-ment dit, qu’ils appartiennent tous deux à la mise en œuvre du même décor.*Des coulures blanches verticales, antérieures à l’application des stucs sont visibles en parties hautes sur le parement de l’abside. Ces coulures, mal iden-ti#ées lors de l’étude in situ, pouvaient correspondre à la mise en œuvre soit du parement, soit du décor de stuc (ill. 5). L’analyse élémentaire d’une cou-lure blanche (Alet 10) indique qu’elle est composée de chaux légèrement magnésienne (Mg 1,6 %), permettant ainsi d’a/rmer qu’elle relève bien de la mise en œuvre de l’appareil de l’abside (dont la chaux est également magné-sienne) et non du décor de stuc (composé de plâtre quant à lui). Ces coulures blanches correspondent donc à l’exsudation de l’excédent liquide du mortier de pose (eau + chaux) de l’appareil lors de la construction de l’abside.*L’enduit rose (Alet 09 et 16), qui appartient à la restauration accompagnant le second décor de l’abside, est constitué d’un mélange de plâtre et de chaux, dont le rapport varie selon les échantillons, entre 40 %, 70 % et 85 % de plâtre pour le reste de chaux. Sa coloration en rose est due à la présence de sables argileux rouges très #ns, qui sont mélangés au liant (cet enduit rose ne contient pas de tuileau). Il s’agit donc d’un mortier « bâtard » coloré par des sables argileux.
4. Cette reconstitution de l’état 2 a été réalisée par Gilles Fèvre (CEM Auxerre).5. Les analyses chimiques ont été réalisées au laboratoire Études, Recherches, Matériaux (ERM) de Poitiers.6. M. Frizot, Stucs de Gaule et des provinces romaines. Motifs et techniques, Dijon, 1977 et les travaux récents de Nicole Blanc (AOROC - UMR 8546, CNRS-ENS). 7. B. Palazzo-Bertholon « La nature des stucs entre le Ve et le XIIe siècle dans l’Europe médiévale : confrontation de la caractérisation physico-chimique des matériaux aux contextes géologiques, techniques et artistiques de la production », Stucs et décors de la fin de l’Antiquité au Moyen Âge (Ve-XIIe siècles), dir. Ch. Sapin, Turnhout, 2006, p. 13-42. Cl. Allag, N. Blanc, B. Palazzo-Bertholon, « Le décor de stuc en Gaule (1er-VIIIe siècle) », Aquitania, suppl. 20, 2011, p. 509-523.
Cuxa 2012.indb 153 15/05/2012 10:33:27
154 Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII, 2012
Abs
ide
de S
te-M
arie
d’A
let-
les-
Bai
ns (A
ude)
: co
mpo
siti
on é
lém
enta
ire
de la
frac
tion
fine
des
mat
éria
ux d
u dé
cor
(a
naly
ses
: B. P
alaz
zo-B
erth
olon
et F
ranç
ois
Ras
sine
ux, l
abor
atoi
re E
RM
Poi
tier
s)
Éch
anti
llon
Des
crip
tion
du
prél
èvem
ent
Na2
OM
gOA
l2O
3Si
O2
SO3
Cl
K2O
CaO
MnO
FeO
Cu
TiO
2To
tal
AL
ET
13
en
du
it lis
séE
nd
uit
lis
sé s
ur
la c
orn
ich
e en
pie
rre
(con
tre
la p
ierr
e p
oin
tue)
1,2
53
2,5
72
,12
7,6
11
,25
1,95
0,60
51,7
20,
9410
0,00
0
ALE
T 3
0 ac
croc
hage
Bad
igeo
n é
pai
s su
r la
cor
nic
he,
ap
pli
qu
é SO
US
le s
tuc
(pré
levé
ap
rès
dép
ose)
1,4
45
,07
1,4
24,
921,
801,
650,
5382
,00
0,94
0,22
100,
000
ALE
T 1
0 co
ulur
eC
oulu
res
bla
nch
es v
erti
cale
s, s
itu
ées
sur
l’ap
par
eil et
SO
US
le s
tuc.
0,6
41,
595,
7512
,49
0,83
0,58
76,7
61,
3510
0,00
0
ALE
T 9
mat
rice
En
du
it r
ose
app
liqu
é SU
R la
cou
che
d’e
nd
uit
pei
nt.
0,3
71
,32
4,1
21
1,3
63
0,2
00
,80
50
,38
1,3
70,
0910
0,00
0
ALE
T 9
sup
port
En
du
it r
ose
app
liqu
é SU
R la
cou
che
d’e
nd
uit
pei
nt.
0,39
1,28
2,60
6,93
23,6
30,
6462
,94
0,12
1,34
0,12
100,
000
ALE
T 9
sup
port
cha
uxE
nd
uit
ros
e ap
pli
qu
é SU
R la
cou
che
d’e
nd
uit
pei
nt.
0,5
11
,54
0,7
71
,76
2,4
80
,31
91,6
11,
010,
0010
0,00
0
ALE
T 1
6 m
atri
ce 3
En
du
it r
ose
+ c
p t
urq
uoi
se d
essu
s.0
,27
0,6
42
,35
6,6
14
9,6
20
,71
38
,25
0,0
01
,19
0,2
90
,08
10
0,0
00
AL
ET
16
gra
inE
nd
uit
ros
e +
cp
tu
rqu
oise
des
sus.
0,4
40
,73
1,8
84
,67
47
,46
0,5
33
8,5
70
,01
2,5
93
,07
0,0
51
00
,00
0
AL
ET
16
mat
rice
2E
nd
uit
ros
e +
cp
tu
rqu
oise
des
sus.
0,4
20
,81
3,4
08
,34
50
,26
0,8
23
3,0
00
,04
1,1
21
,74
0,0
51
00
,00
0
AL
ET
7 m
orti
er r
ose
Mor
tier
ros
e d
u b
ouch
age.
0,8
01
,34
3,6
49
,45
41
,05
0,5
34
2,0
40
,07
1,0
80
,00
10
0,0
00
AL
ET
08
mat
rice
Stu
c co
nse
rvé
auto
ur
du
mad
rier
de
boi
s d
ans
le t
rou
.0
,35
1,2
81
,00
3,0
25
7,3
53
6,9
70
,02
10
0,0
00
AL
ET
21
mat
rice
2Sc
elle
men
t en
stu
c d
e la
ch
evil
le d
e b
ois
pla
cée
dan
s u
n j
oin
t d
e l’a
pp
arei
l.0
,38
0,3
30
,56
0,9
85
9,5
40
,09
37
,55
0,2
20
,25
0,0
81
00
,00
0
AL
ET
21
mat
rice
Scel
lem
ent
en s
tuc
de
la c
hev
ille
de
boi
s p
lacé
e d
ans
un
joi
nt
de
l’ap
par
eil.
0,5
00
,30
0,4
30
,57
61
,85
0,0
23
6,2
20
,11
10
0,0
00
14
- T
able
au s
ynth
étiq
ue
de
la c
omp
osit
ion
élé
men
tair
e d
es m
atér
iau
x.
Cuxa 2012.indb 154 15/05/2012 10:33:27
Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII, 2012 Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON 155
8. Comme les matériaux de support, les couches picturales ont été caractérisées au MEB couplé à une microsonde.9. D. Floréal, B. Laborde, A. Mounier, E. Coulon, « Le pigment d’aérinite dans deux peintures murales romanes du Sud-Ouest de la France », Archéo-sciences, 32, 2008, p. 83-91.10. P. Perego, Dictionnaire des matériaux du peintre, Paris, 2005, p. 765-768.
Les proportions de composition entre les minéraux argileux (Si, Al, Fe), le plâtre (S) et la chaux (Ca) permettent de montrer que les �nes argiles sont associées non pas à la chaux mais au plâtre : soit elles sont associées à l’état naturel dans le gisement de gypse, soit elles sont ajoutées volontairement lors de la mise en œuvre. Or, la �nesse des particules et leur identi�cation en tant que sable, et non en tant que tuileau, permettent de privilégier l’hypothèse d’un sable argileux associé au gypse à l’état naturel dans le gisement exploité (plâtre rose).
B. La caractérisation des couches picturales L’analyse chimique des couches picturales8 a porté sur de très petits prélève-ments réalisés sur les stucs en place et replacés en stratigraphie dans chacun des décors superposés.
1. Les pigments identifiés dans le premier décor Une couche préparatoire au décor a été identi�ée sur un des échan-tillons (Alet 15). En e"et, sous la polychromie (tonalités de bleu et blanc) une sinopia a été identi�ée sous la forme d’une couche de blanc de chaux (carbonate de calcium) associée à un tracé à l’ocre rouge (argiles + fer).
Par ailleurs, cinq pigments di"érents ont été identi�és à partir des échan-tillons dans le premier décor (ill. 15) :*La couleur rouge orangé employée sur les stucs est un vermillon (ou cinabre) (Alet 18 et 19), c’est-à-dire un sulfure de mercure facilement identi�able au MEB et employé en peinture dès l’Antiquité. *Le orange vif employé dans ce premier décor est un minium, un oxyde de plomb également bien identi�able. Il reste peu de couleur orange visible sur les vestiges de stucs (Alet 14), et ce, pour deux raisons : le premier décor a été largement dissimulé sous la couche de peinture postérieure (état 2) et les zones restées à l’air libre se sont dégradées et ont noircit. *Le blanc de plomb a été identi�é comme pigment seul (Alet 15) mais aussi en mélange, pour produire di"érentes tonalités de bleu (Alet 15, Alet 14).Un pigment vert a été identi�é par l’analyse chimique comme étant une terre verte (argiles). On la trouve soit associée à un liant de chaux (Alet 18), soit mélangée avec du chlorure de cuivre et du blanc de plomb (Alet 14).*Les teintes de bleu retrouvées de manière lacunaire dans les interstices sont en e"et à base de chlorure de cuivre. On le trouve mélangé au blanc de plomb pour réaliser di"érentes tonalités de bleu, bleu clair, bleu gris (Alet 15) ou bien additionné de terres vertes pour en modi�er la teinte (Alet 14). Le pig-ment à base de chlorure de cuivre n’a pas été identi�é précisément au MEB : il faudrait pour cela avoir recours à d’autres techniques telles que la spectro-métrie Raman. Di"érents composés à base de cuivre, naturels ou synthé-tiques, sont employés en peinture murale au Moyen Âge. L’aérinite est un pigment connu pour l’époque romane en Catalogne et il a déjà été identi�é dans le sud-ouest de la France9, mais le vert de gris et ses dérivés constituent une autre hypothèse possible10.
2. Les pigments identifiés sur le second décorUn second décor recouvrait à la fois le premier décor sur les stucs et l’enduit rose, lui même appliqué sur le premier enduit peint. Il est représenté par une couche picturale turquoise associée à du blanc de plomb employé, soit en sous-couche, soit comme couche picturale à part entière sur les arêtes du stuc (ill. 15). La couche turquoise présente une composition constante de chlo-rure de cuivre associé à du blanc de plomb (Alet 14bis, 16, 19).
Cuxa 2012.indb 155 15/05/2012 10:33:27
156 Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII, 2012
Par ailleurs, une couche de blanc de plomb utilisé seul et appartenant à ce second décor turquoise, est également conservée en stratigraphie (Alet 14 et 18). Le blanc recouvrait semble t-il les arêtes des stucs pour accentuer la profondeur des reliefs (ill. 13).
Certains pigments sont caractéristiques du premier décor, tels que les terres vertes, le minium et le cinabre. On trouve toutefois le blanc de plomb et le chlorure de cuivre employés dans le premier comme dans le second décor.
Échantillon Stratigraphie Couleur de la couche picturale
Éléments représentatifs
Identification des pigments
Alet 14
État 2 cp blanche Pb carbonate de plomb
État 1
cp orange vif Pb minium
cp verte + gris ClCu + Pb + argiles pigment à base de cuivre + terres vertes
stuc
Alet 18
État 2 cp blanche (Pb) Pb carbonate de plomb
État 1
cp rouge orangé HgS vermillon ou cinabre
verte Ca + argilesterres vertes +
carbonate de calcium (= chaux)
stuc
Alet 15 État 1
cp bleue, bleu-gris, bleu clair et cp
blanche ClCu + Pb
pigment à base de cuivre + carbonate de
plombSINOPIA = bad blanc
et tracé rougeCa + Mg et argiles
+ Fecarbonate de calcium
+ ocre rougestuc
Alet 14bis État 2
cp vert turquoise ClCu + Pbpigment à base de
cuivre + carbonate de plomb
cp jaune argiles + Fe carbonate de calcium + ocre jaune
enduit rose
Alet 16 État 2 cp vert turquoise ClCu + Pb
pigment à base de cuivre + carbonate de
plombenduit rose
Alet 19
État 2 cp vert turquoise ClCu + Pbpigment à base de
cuivre + carbonate de plomb
État 1cp orange-rouge HgS vermillon ou cinabre
stuc
3. Synthèse des résultatsL’étude archéologique des élévations et la caractérisation des matériaux per-mettent ensemble de reconstituer le décor mural de l’abside d’Alet-les-Bains. Les arcatures étaient couvertes de stucs en bas relief modelés de rinceaux et de motifs végétaux en bas relief. La jonction des archivoltes était ornée de chapiteaux en stuc, décorés eux aussi de motifs végétaux d’après l’exemple conservé. Entre la base des arcatures et la corniche en pierre sculptée, des éléments de stuc plus saillants étaient appliqués verticalement contre la paroi. Ainsi, prenant appui sur le chapiteau, on conserve en haut relief – voire en ronde bosse – les pieds d’un personnage entre les arcatures 4 et 5. Bien que
15 - Stratigraphie des couches picturales et identification des pigments.
Cuxa 2012.indb 156 15/05/2012 10:33:27
Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII, 2012 Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON 157
les stucs aient entièrement disparu sur le côté nord de l’abside, on conserve le négatif d’un madrier de bois de section carrée à la jonction des arcatures 1 et 2, témoignant d’une disposition symétrique de deux �gures très saillantes entre les archivoltes et la corniche en pierre sculptée. À la jonction des autres arcatures (retombées ouest des arcatures 1 et 5, arcatures 2-3 et 3-4, soit quatre négatifs) des éléments plus légers mais en haut relief néanmoins, étaient également appliqués verticalement contre la paroi. Une âme de bois circulaire et plusieurs négatifs dans la corniche, témoignent de ce dispositif (ill. 6). Les reliefs de stuc étaient peints à l’origine avec des couleurs vives (rouge orangé, jaune, bleu-vert, orange, blanc), et non pas réservés en blanc : ils participaient donc pleinement à la mise en valeur colorée de l’abside.Les parties hautes de l’élévation, comprises entre les archivoltes et la cor-niche, étaient recouvertes d’un enduit orné d’un décor géométrique souli-gnant l’architecture. L’intrados des arcatures, quant à lui, ne semble pas avoir été stuqué mais simplement recouvert d’un enduit peint de jaune et de rouge. En l’absence de liaison stratigraphique conservée, il n’est pas possible d’assu-rer que le premier enduit peint est contemporain du décor de stuc, mais plusieurs arguments nous invitent à privilégier cette hypothèse. En e�et, l’ab-sence de couche stratigraphique intermédiaire entre l’enduit peint et l’appa-reil, comme l’aspect intact du parement (non piqueté où l’enduit peint a dis-paru) nous invitent à les placer dans la même phase chronologique. De plus, une partie des couleurs utilisées dans le premier état des stucs se retrouve également sur l’enduit (rouge, jaune, bleu clair) et l’on ne peut exclure que certains rehauts malheureusement disparus aient été réalisés sur l’enduit avec de l’orange, par exemple (ill. 16 et 17).
arc 4 arc 5
0 1 2 m
16 - Restitution du décor de stucs et polychromies de l’état 1, sur les archivoltes 4 et 5. Restitution Gilles Fèvre et relevé architectural Heike Hansen.
Cuxa 2012.indb 157 15/05/2012 10:33:28
158 Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII, 2012
Par ailleurs, nous n’avons pas d’indice archéologique permettant de prou-ver que les stucs sont contemporains du décor sculpté sur pierre, comme la corniche supérieure et les chapiteaux placés aux deux extrémités de l’abside. Cependant, le premier enduit peint (état 1) vient mourir proprement sur le bord de la corniche, en connexion avec elle (ill. 9). De plus, les motifs végétaux développés sur les arcatures en stuc présentent des similitudes avec les décors sculptés de l’église abbatiale, que Géraldine Mallet avait déjà sou-lignés11. On peut en e�et rapprocher la sculpture de la baie conservée sur le mur extérieur sud de la nef et le motif en stuc de l’arcature 5. De la même façon, les feuillages sculptés sur le chapiteau ouest du portail extérieur percé sur le �anc sud de la nef sont très proches du motif gravé dans le stuc sur l’arcature 4 de l’abside (ill. 18 et 19). En l’absence d’étude archéologique précise de l’église abbatiale, il serait hasardeux de proposer une chronologie relative entre les stucs de l’abside et les éléments sculptés du mur extérieur sud de la nef.Ce décor initial de l’abside (état 1) a été ensuite repris lors d’une réparation ancienne, marquée par l’emploi d’un enduit rose identi�é en divers points 11. G. Mallet 2006 (op. cit. note 1), p. 241.
arc 4 arc 5
2.00 m
0.00 m
4.00 m
6.00 m
8.00 m
10.00 m
2.00 m
0.00 m
4.00 m
6.00 m
8.00 m
10.00 m
0 1 2 m
secteur :
date : site :Janvier 2012
D’après relevés architecturaux de H. HANSEN
restitution: G. FEVRE Ancienne église Sainte-MarieALET -LES-BAINS
CENTRE D'ÉTUDES MÉDIÉVALES d'AUXERRE
AbsideArcatures 4 et 5
Restitution du décor de stucs et polychromies
N
54
17 - Restitution du décor des archivoltes 4 et 5, stucs et enduits peints dans l’état 1, détail. Restitution Gilles Fèvre, CEM Auxerre.
Cuxa 2012.indb 158 15/05/2012 10:33:29
Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII, 2012 Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON 159
des élévations et à divers usages (état 2). Cet enduit rose, composé de plâtre et de chaux mélangés en proportions variable selon les échantillons, a été utilisé en reprise de surface, sur les enduits comme sur les stucs (ill. 10). Il a été ensuite recouvert d’une couche de turquoise et de blanc, appliqués pour homogénéiser les parties anciennes et les réparations après les travaux et bien sûr rafraîchir le décor.
4. Comparaison du décor de stuc d’Alet avec d’autres exemples médiévauxLa comparaison d’Alet avec d’autres exemples médiévaux peut s’appuyer sur les aspects techniques regroupant la composition et la mise en œuvre du décor. Ainsi, ces stucs sont composés exclusivement de plâtre, à l’instar des autres exemples analysés pour l’époque romane12. Leur mise en œuvre est conforme aux procédés employés à l’époque médiévale pour les reliefs de plâtre : le stuc est appliqué en deux à trois couches successives, puis la dernière couche est sculptée à la lame directement sur le support avant son séchage complet13. L’emploi d’une âme de bois comme structure est une technique couramment utilisée pour les reliefs saillants, dont on conserve un exemple à Arles-sur-Tech (Pyrénées Orientales) pour l’époque romane14.Du point de vue formel, le décor d’Alet peut être rapproché de celui de Saint-Jean-de-Maurienne ("n XIe), qui associe également stucs, enduits et peintures15. Les personnages en stuc, réalisés en ronde bosse, sont connus tout au long du Moyen Âge en Europe, à partir d’exemples rares mais signi-"catifs de la continuité de cette pratique héritée de l’Antiquité16, tels que Vouneuil-sous-Biard (Vienne VIe s.), Cividale (VIIIe s.), Corvey (Allemagne XIe s.), les Vierges à l’enfant de Brescia (Italie IXe s.), Arles-sur-Tech (XIIe s.) Gandersheim ou Clus (XIIe s.). La facture est variée, mais ces exemples té-moignent, tous à leur manière, de l’usage du stuc pour modeler des person-nages qui se détachent de leur support, à l’instar de la statuaire de pierre17. Ils comportent pour la plupart une armature de bois, comme à Alet et sont tous réalisés en plâtre, en raison des qualités mécaniques de ce matériau par-faitement adapté aux nécessités de prise rapide, de modelage et d’incision à la lame des surfaces.
12. Palazzo-Bertholon 2006 (op. cit. note 7) et Palazzo-Bertholon, « Le décor de stuc autour de l’an Mil : aspects techniques d’une production artistique disparue », Cahiers de Saint-Michel de Cuxà, XXXIX, 2009, p. 285-298.13. B. Palazzo-Bertholon « Confronti tecnici e decorativi sugli stucchi intorno all’VIII secolo ». L’VIII Secolo : un secolo inquieto, dir. V. Pace, Cividale, 2010, p. 298-309. On emploie une technique similaire à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) pour réaliser le décor de stucs trouvés en fouille. Voir Ch. Sapin, « Les stucs de Saint-Jean-de-Maurienne », Cahiers archéologiques 43, Paris, Picard, 1995, p. 67-100.14. Mallet 2006 (op. cit. note 1), p. 242-246, Palazzo-Bertholon 2009 (op. cit. note 12) et Le stuc, visage oublié de l’art médiéval, dir. Ch. Sapin, Paris, 2004, p. 198-201.15. Le stuc, visage oublié..., 2004, p. 207-213 et Sapin 1995 (op. cit. note 13).16. Allag, Blanc, Palazzo-Bertholon 2011 (op. cit. note 7).17. Notices correspondantes dans Le stuc, visage oublié..., 2004 (op. cit. note 14).
18 - Baie en pierre sculptée située sur le mur extérieur sud de la nef.
19 - Chapiteau ouest du portail situé sur le mur extérieur sud de la nef.
Cuxa 2012.indb 159 15/05/2012 10:33:33
160 Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII, 2012
Le décor de stuc de Sant Saturní de Tavèrnoles (Catalogne – seconde moitié du XIe s. ?), bien que restauré de manière drastique, témoigne, comme à Alet, de l’emploi conjoint du stuc pour les �gures en haut relief des anges et pour les frises végétales qui soulignent les éléments architecturaux18. Le personnage de Sainte-Marie d’Alet, dont seuls les pieds subsistent, était saillant de plus de dix centimètres sur la paroi et son association à l’orne-mentation des arcatures en bas relief trouve des comparaisons avec notam-ment la voûte de la chapelle Saint-Ulrich à Mustaïr (Suisse – seconde moi-tié du XIIe s.)19.
CONCLUSION
Les fragments de stucs originaux de l’abside ont été déposés en no-vembre 2010 et seront conservés dé�nitivement à l’abri des intempéries après restauration20. Des fac-similés ont, par bonheur, été réalisés et replacés dans l’abside, a�n de ne pas priver les visiteurs du privilège qu’ils ont de voir ces rares témoignages de décor en relief dans leur contexte architectural. L’aspect lisse des parements de pierre recevant les reliefs sur les archivoltes montre qu’il est di!cile d’identi�er un décor de stuc en relief en l’absence de ves-tiges en place. Combien d’églises médiévales nous sont parvenues sans décor sculpté et sans peintures conservées, qui ont pu être ornées cependant de reliefs peints n’ayant laissé aucun témoignage sur les parois ? Les arcatures nues et lisses comme les chapiteaux simplement épannelés de nos églises ont pu recevoir dans certains cas un décor de stuc, en bas ou en haut relief : l’exemple de Saint-Rémi de Reims21 illustre comme Alet cette ré#exion sur la présence au Moyen Âge de nombreux décors apposés sur l’architecture, dont on ne conserve que peu d’exemples attestés.Le décor de stucs d’Alet-les-Bains ornait une grande partie des élévations de l’abside : les reliefs couvraient les arcatures des absidioles et leur jonction était garnie de chapiteaux. Des éléments en haut relief, dont on conserve peu de vestiges mais beaucoup de négatifs, décoraient chaque jonction d’arcature avec probablement deux personnages en pied qui se faisaient face, au nord et au sud. Chacun des autres angles de l’abside était équipé d’un ornement en haut relief maintenu à la verticale par un madrier de bois amarré au pa-rement par des chevilles de bois. On ne conserve malheureusement aucun indice nous permettant d’identi�er ces éléments de décor, mais l’hypothèse de colonnettes nous parait plausible compte tenu de la section circulaire des madriers et de leur �xation dans la paroi à mi-hauteur ; les colonnettes uni-raient, dans cette éventualité, la corniche sculptée et les archivoltes, souli-gnant l’architecture de l’abside. Espérons toutefois que de futures recherches dans les sources écrites permettront d’identi�er les personnages représentés et de mieux connaître l’iconographie complémentaire du décor disparu. Ce programme de grande envergure était à la mesure de l’église et des nombreux éléments sculptés dans la pierre qui nous sont parvenus.Du point de vue technique, les stucs d’Alet s’inscrivent pleinement dans la continuité de cette production artistique, depuis les sources antiques vers la Renaissance, à la fois par les registres décoratifs appliqués sur les archivoltes, que par les éléments en haut relief. Leur fabrication en plâtre et leur sys-tème d’accrochage, comme le façonnage de la surface (incisions), illustrent un savoir-faire pleinement maîtrisé et abouti à cette époque. Leur traitement largement coloré et le choix de pigments employés traditionnellement dans la peinture murale médiévale montrent que ces reliefs faisaient partie intégrante du programme peint de l’abside, en lien étroit néanmoins avec la sculpture sur pierre, par le registre décoratif choisi.
18. X. Barral I Altet, « Le décor monumental en stuc de Saint-Sernin de Tavèrnoles et l’art roman », Stucs et décors... (op. cit. note 1), p. 257-268.19. Le stuc, visage oublié... 2004 (op. cit. note 14), p. 214-215. Voir également les travaux de Jürg Goll.20. La présentation des stucs originaux après restauration fait actuellement l’objet d’une recherche de financement pour la muséographie destinée au public.21. Le stuc, visage oublié... 2004 (op. cit. note 14), notice de Ch. Sapin, p. 204.
Cuxa 2012.indb 160 15/05/2012 10:33:33
Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII, 2012 Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON 161
L’ensemble, d’une richesse remarquable, associe en e�et la sculpture sur pierre, le stuc et les peintures pour réaliser conjointement un décor en relief et en couleur recouvrant les élévations de l’abside. Ce décor monumental illustre la persistance des grands décors en stuc au Moyen Âge central, témoin de l’héritage antique de cette technique ornementale. Le registre antiquisant, relevé dans certains motifs ornementaux tels que les chapiteaux monumen-taux sculptés à l’entrée de l’abside, semble souligner en �ligrane la �liation et la référence délibérée à l’antique. La richesse exceptionnelle de cet ensemble, mieux appréhendée avec les restitutions graphiques, nous rappelle toutefois que l’ancienne église Sainte-Marie d’Alet, malgré son rayonnement au Moyen Âge, ne fait pas encore l’objet d’une étude archéologique globale de grande envergure. Cette perspective permettrait pourtant de la replacer avec justesse et justice parmi les grands chantiers de l’époque romane en France.
Cuxa 2012.indb 161 15/05/2012 10:33:33