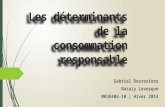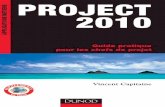4 CAHIER4 Realisation projet type VF (1)
Transcript of 4 CAHIER4 Realisation projet type VF (1)
GRANDE OFFENSIVE AGRICOLE POUR LA NOURRITURE ET L’ABONDANCE
Révision : 16/07/08 Impression : 17/07/08
MINISTERE DE L’AGRICULTURE Avenue Léopold Sédar Senghor Building Administratif, 3ème étage, Dakar Sénégal Tél. (221) 338.49.75.77 – Fax (221) 338.23.32.68 Web www.agriculture.gouv.sn
APIX S.A. PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT ET GRANDS TRAVAUX 52-54, rue Mohamed V, BP 430, CP 18524, Dakar Sénégal Tél. (221) 338.49.05.55 – Fax (221) 338.23.94.89 Web www.apix.sn ou www.investinsenegal.com
CAHIER D’UN PROJET D’INVESTISSEMENT
Données techniques et économiques d’un projet type
CAHIER D’UN PROJET D’INVESTISSEMENT
CAHIER D’UN PROJET D’INVESTISSEMENT 2
TYPE DE DOCUMENT
Présentation de données techniques et économiques pour des projets d’investissement dans la production rizicole irriguée au Sénégal
VERSION # 1.0
OBJET Fournir aux investisseurs potentiels des paramètres décisionnels qualitatifs et quantitatifs pour l’évaluation et la planification de leur projet d’investissement sur la base de l’exemple de la filière riz irrigué
CONTENU 1. Données techniques pour des projets d’investissement dans la production rizicole irriguée
2. Données économiques pour un plan d’affaires : projet sur 20, 100 ou 1000 hectares
DESTINATAIRES Tout investisseur potentiel privé de taille moyenne (PME) et agro-industrielle qui souhaite implanter un projet d’investissement dans la production rizicole visant le marché national
1 Données techniques pour des projets d’investissement dans la production rizicole irriguée
CAHIER D’UN PROJET D’INVESTISSEMENT 3
SYSTÈME DE PRODUCTION ADAPTÉ
Deux systèmes de production du riz existent au Sénégal : le riz pluvial, traditionnellement cultivé en Casamance, au Sénégal Oriental ainsi que dans certaines zones du Sine Saloum, et le riz irrigué, typique des aménagements hydro-agricoles de la Vallée du Fleuve Sénégal (VFS) et du Bassin de l'Anambé. La culture du riz pluvial s'apparente à une culture vivrière traditionnelle, demandant peu d'investissements, utilisant essentiellement de la main d'œuvre familiale et présentant des rendements de l'ordre de 1 t/ha. La culture du riz irrigué exige de lourds investissements en termes d'aménagements, associe généralement travaux manuels et mécanisés et permet d'atteindre des rendements de 4 à 6 t/ha pouvant atteindre 9 t/ha dans la VFS. En irrigué, deux cycles de culture par année sont réalisables au Sénégal. Selon la taille et le type d'exploitation, les moyens financiers et la stratégie de production de l'exploitant, le rapport entre le niveau de mécanisation et celui des travaux manuels peut être très variable. De plus, les choix techniques à adopter dépendent largement du mode d'organisation de l’exploitation : adhésion ou non à un système collectif d'irrigation (grands périmètres publics / GPP destinés à plusieurs usagers de type organisations paysannes, périmètres irrigués villageois / PIV destinés aux producteurs d'un même village ou périmètres irrigués privés / PIP plus indépendants par rapport à l'eau). Les différentes données techniques et économiques présentées dans ce document visent à fournir aux investisseurs potentiels des paramètres décisionnels (qualitatifs et quantitatifs) pour l’évaluation et la planification de leur projet d’investissement dans la filière riz irrigué (projet sur 20, 100 et 1000 ha). Dans ces données, l’exploitation est considérée comme étant totalement autonome en matière d'irrigation. En d’autres termes, elle n’est pas liée à un système collectif si ce n’est aux exigences et redevances légales du FOMAED (SAED), de l’OMVS ou de la SODAGRI. Toutefois, les exemples de partage de certaines ressources (eau, machines, etc.) sont très nombreux. Ils sont complexes à décrire de façon exhaustive et l'adaptation des données au cas par cas sera à faire par les investisseurs une fois le site de production totalement identifié. RÉHABILITATIONS OU CRÉATIONS
Il existe près de 50 000 ha de périmètres aménagés abandonnés dans la Vallée. Le coût de réhabilitation de périmètres rizicoles est de l'ordre de 300 000 F CFA/ha. Les raisons de l’abandon des terres ainsi que les coûts effectifs de leur réhabilitation devront être étudiés au cas par cas avant la prise de décision d’investissement sur un site donné. Si des raisons techniques de qualité de l'aménagement sont invoquées (planage, dimensionnement des canaux, taille des parcelles, voiries, qualité des ouvrages, etc.), le coût peut être bien supérieur car il faudra les corriger. Les coûts de création de périmètres rizicoles se situent dans une fourchette de 1 750 000 à 3 000 000 F CFA/ha selon les conditions de terrain mais aussi de réalisation des chantiers. Le coût des grands aménagements publics est toujours très supérieur à celui des aménagements privés ce qui devrait promouvoir ces derniers. Cependant, il faut s'assurer que ces aménagements privés sont conformes et durables. Il semble bien que cela n'ait pas toujours été le cas et que c’est ce qui aurait été à la base du fort taux d'abandon des terres. Les mauvaises pratiques d’aménagement, considérées comme gaspilleuses de sols et d'eau, ont été à la base de l'élaboration de la Charte du Domaine Irrigué (CDI) par la SAED qui fait désormais partie du cahier de charge de tout investisseur dans la Vallée. L'identification des zones favorables pour l'implantation de nouveaux périmètres passera par une analyse approfondie des zones identifiées utilisant essentiellement les POAS des Communautés Rurales pour lesquelles ce plan existe. Dans la négative, des enquêtes auprès de la SAED, des responsables de sites voisins existants, des Communautés Rurales et de tous les acteurs susceptibles de disposer d’informations pertinentes seront nécessaires. Le PACR, financé par l'AFD, a pour objectif la création d'un cadastre rural destiné à résoudre le problème récurrent de la sécurisation juridique des aménagements hydro-agricoles de la VFS. Les aspects à étudier pour la décision d'implantation sont essentiellement techniques et devront analyser en profondeur les conditions topographiques, logistiques, hydrauliques, etc. Toutefois, les aspects administratifs, légaux et sociaux, de même que la durée de toutes les procédures associées doivent être pris très au sérieux et incorporés dans les calendriers et plans d'action du projet.
1
CAHIER D’UN PROJET D’INVESTISSEMENT 4
MAÎTRISE DU PLAN D’EAU
Dans un objectif d'intensification, la maîtrise totale du plan d'eau est obligatoire : la conduite de la culture du riz exige une maîtrise du plan d'eau des rizières à quelques centimètres près selon le stade de la plante et des opérations culturales à réaliser. Il faut être en mesure de relever le plan d'eau par les adducteurs (canaux d'irrigation) ou le baisser par les émissaires (canaux de drainage). Dans la VFS les pentes sont faibles en raison de la topographie de la zone. L’efficacité des deux réseaux (adducteurs et émissaires) dépend étroitement de la qualité des études techniques préalables aux aménagements et du professionnalisme de l'entreprise qui les réalise. Une bonne capacité de drainage est encore plus importante à partir du moment où les terres de culture sont salées. Les deux opérations (adduction et drainage) nécessitent, dans la plupart des cas, un relevage de l'eau par pompage. Dans le VFS, le risque d'inondation lié à une crue doit aussi être pris en compte. Une digue de contour peut s'avérer nécessaire et son coût n’est pas négligeable. L'accès au périmètre en saison des pluies pose souvent aussi un problème si les voiries n'ont pas été stabilisées. Après une forte averse, les terres de la Vallée ne permettent plus le passage des véhicules pendant plusieurs jours. COÛT DE L’IRRIGATION
La consommation d'eau nécessaire pour un cycle de 1 ha de riz est de l'ordre de 10 000 m3. La majorité des périmètres irrigués (85%) nécessitent un relevage de l'eau d'irrigation de l'ordre de 1,5 m qui se fait par pompage. Le coût de l'eau (sur la base du gasoil à 750 F CFA/l) est alors de 3 à 5 F CFA/m3, selon le système utilisé (privé isolé, collectif, efficience, etc.). Il a été fixé à 6 F CFA/m3 dans les calculs économiques pour incorporer les frais d'entretien et de maintenance. Quelques rares périmètres (15%) peuvent être irrigués sans pompage en profitant du plus haut niveau du plan d'eau atteint par le fleuve et du niveau plus bas d'un émissaire ou drain. Cependant, la majorité des périmètres nécessitent aussi un drainage par relevage, c'est-à-dire un 2ème relevage de la fraction d'eau à drainer. DURÉE DU CYCLE ET DOUBLE CULTURE
Bien qu'il existe, comme pour toute espèce cultivée, des relations complexes entre les variétés et les périodes de plantation, on peut retenir que le riz repiqué nécessite un séjour de 3 semaines en pépinière et 100 jours au champ. En cas de semis direct, la durée du cycle est légèrement inférieure à la somme des 2 phases grâce à l'absence de rupture. Pour réaliser une double culture, il faut bien choisir variétés et dates de mise en place pour garantir l'adéquation aux conditions climatiques. D'un point de vue climatique, la contrainte majeure est liée aux minima de température (nocturne) qui, en dessous de 18°C empêchent la fécondation de se produire. Au Sénégal, il faut donc que la floraison n'ait pas lieu pendant les périodes potentielles de basses températures nocturnes qui s'étalent de mi-novembre à mi-mai. SEMENCES ET VARIÉTÉS
Des variétés performantes existent (SAHEL) et la recherche propose régulièrement de nouvelles variétés, incluant des croissements de variétés locales résistantes et de variétés asiatiques performantes (NERICA). Le meilleur choix reste toujours la prudence et les nouvelles introductions sont à incorporer progressivement dans un programme. Le riz est typiquement une culture qui permet la réutilisation d'une partie de la récolte comme semences. Il faut cependant s'assurer d'avoir un stock de départ le plus performant possible. SEMIS DIRECT OU REPIQUAGE
Les techniques d'intensification passent par le repiquage, peu courant au Sénégal mais dominant en Asie et surtout au Mali voisin. Le choix entre semi direct et repiquage est cependant fait par rapport à plusieurs aspects qui peuvent parfois militer en faveur du semis direct : type de sol, niveau de mécanisation, niveau d'intensification recherché. Les meilleurs rendements sont atteints via le repiquage qui permet aussi la mécanisation des opérations d'entretien, qu'elles soient manuelles (petite houe rotative) ou mécanisées.
1
CAHIER D’UN PROJET D’INVESTISSEMENT 5
NIVEAU DE MÉCANISATION ET TAILLE DES PARCELLES
La mécanisation de toutes les étapes est possible. La taille et la forme des parcelles doivent être adaptées. La mécanisation est difficile si les parcelles, séparées par des diguettes ou des canaux, sont trop petites. En cas de choix de mécanisation intensive, le design de l'aménagement doit privilégier les parcelles longues. A titre d'exemple, la rizière traditionnelle asiatique est souvent une parcelle d'un demi à un hectare. La culture intensive du riz dans les pays développés se pratique fréquemment dans des parcelles de grande taille avec planage du sol au laser, semis et applications agrochimiques par avion et récolte mécanisée. En Australie, un seul riziculteur peut gérer une ferme rizicole de 20 à 30 hectares (Source : IRD). CULTURES ASSOCIÉES
La riziculture permet des associations intéressantes à analyser car elles améliorent la rentabilité et participent au résultat agronomique (lutte contre les adventices, fertilité). Sans entrer dans les détails, il faut citer des exemples d'associations très positives avec la pisciculture, la culture d'Azolla et l'élevage de canards ou de porcs qui ne nécessitent que des petits aménagements complémentaires et permettront une diversification très positive des activités de la ferme, qu'elle soit familiale ou industrielle. PROTECTION DE LA CULTURE
Au Sénégal, la riziculture souffre de peu de maladies. La seule grande menace permanente est la présence d'oiseaux granivores. Cette menace augmente en cas de succession de plusieurs cycles de culture sur une période prolongée (reproduction accrue grâce à une nourriture abondante). Une façon d'échapper au risque oiseau est d'être le premier à récolter. Toutefois avec les nouveaux investissements dans la production rizicole irriguée et la superposition de nombreux cycles de cultures qui en découlera, cela sera de plus en plus difficile. L’exploitant doit donc s'assurer que des mesures préventives de lutte sont en place et y participer. RÉCOLTE DU RIZ
Avant la récolte, la parcelle est mise à sec. Cette opération non seulement contribue à la maturation groupée des grains mais permet aussi le travail de récolte. Celui-ci peut être entièrement réalisé à la main ou entièrement mécanisé. Pour de grandes surfaces, l'utilisation d'une moissonneuse batteuse est inévitable. Cette machine agricole représente à la fois un lourd investissement et une permanente préoccupation en matière de réglages, d'entretien et de pièces détachées qui justifient certainement la disponibilité d'un atelier équipé et la présence d'un technicien formé de bon niveau. La paille de riz, pourtant de faible qualité nutritive pour le bétail, n'est pas utilisée en litière au Sénégal mais bien comme fourrage d'appoint dans les systèmes d'embouche de plus en plus nombreux en zone périurbaine. Une lieuse fabriquant des ballots de taille appropriée à la clientèle sera un investissement vite rentabilisé. STOCKAGE DES RÉCOLTES
Le riz paddy se stocke assez bien lorsqu'il a atteint l'humidité idéale de 12 à 14%. Le stockage doit néanmoins être réalisé dans un entrepôt adéquat, propre et bien protégé de la pluie à raison de 1 à 2 t/m². Pour un stockage prolongé, toutes les mesures devront être prises pour éviter les dégâts causés par la vermine : rongeurs, oiseaux, insectes. L’espace nécessaire est vite important : une production sur 1000 ha avec un rendement de paddy de 6 t/ha nécessite 3000 à 6000 m² de zone de stockage si celui-ci est fait en sacs ! De grosses unités permettant de stocker le paddy plusieurs mois seront de toute façon indispensables à partir du moment où le pays deviendra autosuffisant. Actuellement les importations sont réalisées en continu et les volumes importés sont adaptés à la consommation. Lorsque ce ne sera plus le cas, le volume nécessaire à la consommation de mi-décembre à mi-juin devra obligatoirement être stocké puisque aucune nouvelle récolte n'est plus possible durant cette période. Tablant sur une consommation de 80 000 t par mois, il y aurait 480 000 t de riz à mettre en conservation à la fin des récoltes d'hivernage. Un gros producteur doit envisager cette opération qui représente aussi une opportunité économique si le travail d'usinage est réalisé dans la foulée. Les grosses unités sont complètement équipées et disposent de hangar ou de silos de conservation avec séchoirs, ventilateurs et contrôles de la température et de l'humidité en continu, d'équipements d'ensachage, de palettes, d'engins de manutention, de transport par vis, etc.
1
CAHIER D’UN PROJET D’INVESTISSEMENT 6
USINAGE
Le paddy doit être usiné pour devenir le riz blanc comestible. La 1ère opération est le décorticage, c'est-à-dire la suppression des enveloppes. Le riz débarrassé de ses enveloppes (glumes et glumelles) est appelé riz cargo. Le sous-produit issu du décorticage est la balle de riz. Le riz est alors blanchi par abrasion pour retirer le péricarpe coloré, les téguments et le germe du grain. De cette opération sont issus le riz blanc comestible qui peut encore être poli et le son de riz. La balle a peu de valeur mais le son est recherché en alimentation animale. Les usines de traitement sont artisanales ou industrielles. Le passage par l'usinage est indispensable et lie indissociablement cette opération à la production. Le rendement d'usinage moyen est de 2/3 mais peut varier assez fortement selon la qualité du produit brut ou le type de produit final recherché et selon la qualité des équipements et leurs réglages : humidité, taux d'impuretés, taux de brisures, homogénéité, etc. COMMERCIALISATION DU RIZ BLANC
Le riz blanc produit est destiné à la commercialisation. Selon la qualité du produit usiné (variété, dimensions, propreté, homogénéité, absence d'attaques de parasites, etc.), différents marchés peuvent être ciblés avec des prix variables. L'usine peut décider de commercialiser en sacs de 50 kg ou en conditionnement familiaux, selon les opportunités identifiées. Au Sénégal, beaucoup de familles achètent encore par sac de 50 kg vu l'économie que cela procure et la grande consommation d'une famille sénégalaise. Les plus petits conditionnements plus ou moins attractifs font aussi leur apparition. RIZ BRISÉ – RIZ ENTIER
Le riz importé au Sénégal a toujours été en grande majorité du riz brisé. Il s'agit d'un sous-produit des usines de traitement asiatiques. Les consommateurs se sont habitués à ce type de riz et le passage au riz entier est difficile même si cette mutation devient perceptible avec le riz produit et consommé dans la Vallée. La production en usine de riz - volontairement - brisé réduit trop le rendement d'usine et risque de rendre l'opération non rentable. Le riz doit être commercialisé entier. La préparation du plat familial devra inclure une opération qui peut être réalisée par broyage au pilon ou le consommateur devra s'adapter au riz entier.
Repiquage du riz Bonne reprise des plants Bon rendement assuré
Concurrence entre les unités industrielles et les unités artisanales Cela peut paraître contradictoire, mais dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, la part de riz paddy traitée artisanalement dépasse sensiblement celle traitée industriellement. Le secteur de l'usinage artisanal y est donc en plein essor. Même si des facteurs externes expliquent cette évolution, le caractère rémunérateur de l’usinage pour le paysan ouest africain en a certainement été l'un des principaux facteurs. En effet, grâce à une autonomie en matière de transformation du produit brut, le groupe de producteurs s'approprie la plus-value des opérations de stockage et de transformation. Ajoutant à cela que la majorité commercialise eux-mêmes le produit fini, ils conservent aussi la marge issue de la commercialisation. Cette situation, tout à l'honneur des producteurs entreprenant, n'a pas que des avantages : la qualité du travail artisanal reste souvent médiocre et il reste des efforts à produire en matière d'amélioration du rendement mais aussi de la qualité du produit fini (homogénéité, "goût de sac", etc.) qui dérange les consommateurs urbains habitués au riz importé. Mais le plus gros désavantage est le frein que cela induit face à la création de grosses unités de traitement, qui seules, pourraient réellement jouer un rôle prépondérant dans la substitution des importations. Beaucoup d'entrepreneurs se méfient des paysans qui, soit voudront vendre trop cher, soit ne vendront pas ! Et les investissements dans les usines de traitement sont faibles, les promoteurs craignant de ne pas pouvoir les faire tourner à plein régime et ne pas pouvoir couvrir les importants frais généraux et d’amortissements. La cohabitation est pourtant obligatoire vu la taille potentielle du marché. La situation antérieure où la production locale était marginale par rapport aux importations est en passe d’être révolue. La production locale devra s'industrialiser au moins dans une large proportion si elle veut assurer son rôle. Pour garantir ses écoulements, un gros producteur devrait aussi investir dans une unité industrielle de transformation, dont la capacité, évolutive, s'adaptera progressivement à la capacité d'achat de paddy qui viendra compléter sa propre production. Inversement, un industriel transformateur devrait aussi investir dans la production. Les chances de succès d'investissements simultanés dans la production et la transformation seront beaucoup plus grandes pour les promoteurs. Finalement, besoins en financements encore plus élevés, joint venture entre producteurs et transformateurs, etc., la conjoncture actuelle, quoi que l'on en pense, laisse la place à de très belles opérations d'envergure.
2 Données économiques pour un plan d’affaires : projet sur 20, 100 ou 1000 hectares
CAHIER D’UN PROJET D’INVESTISSEMENT 7
Pour illustrer l'opportunité économique que représente la production de riz irrigué, des données économiques sont présentées aux pages suivantes pour des exploitations (projets type d’investissement) de taille croissante : exploitation de type producteurs regroupés ou gros producteur (surface de 20 ha), PME de 100 ha et grosse exploitation agro-industrielle de 1000 ha avec usine de traitement. Pour faciliter la lecture et l’analyse des données économiques, des regroupements de charge ont été réalisés et des hypothèses de base et réalistes ont été formulées. L'objectif de ces données est de présenter une situation globale pour chaque type d’exploitation qui sera à adapter au cas par cas par les investisseurs potentiels. Ces données viennent compléter celles déjà bien paramétrées d’exploitations de plus petite taille (5 ha et moins). Actuellement, ce type d’exploitation constitue le système de production majoritaire visant principalement l’autoconsommation et la transformation artisanale destinée à des circuits de commercialisation existants. Dans le cadre de la GOANA, l’État du Sénégal a prévu de reconduire ou de prendre de nouvelles mesures d’accompagnement pour le développement de l’agriculture céréalière et vivrière. Ainsi, comme pour d’autres cultures, la production rizicole sera soutenue grâce à des subventions d'une partie des coûts de production : 50% sur les aménagements hydro-agricoles et sur la majorité des équipements agricoles (tracteurs, charrues, remorques, moissonneuses, pompes et unités de décorticage). Les engrais sont subventionnés à 70% en contre saison chaude et 50% en saison des pluies. Les produits de protection sont également subventionnés à 50%. Des incitations fiscales et douanières viennent s'ajouter à ces mesures et concernent l'exonération des droits de douane et de la TVA pour les acquisitions de matériel et de l'impôt sur les revenus des nouvelles exploitations agricoles (voir Mesures d’accompagnement prévues par l’État dans le Cahier d’Orientations Stratégiques). Le tableau récapitulatif ci-dessous présente pour chaque projet type (20, 100 et 1000 ha) les comptes d’exploitation prévisionnels (niveau de charges et marge brute annuelle). Les données sont fournis avec ou sans subventions de l’État. Comme le montre le tableau, les subventions se traduiront pour les exploitations essentiellement par une réduction de charges. L'impact des subventions sur le résultat apparaît beaucoup plus important pour les exploitations de taille modeste.
Coût des charges et marge brute par type d'exploitation avec et sans subventions de l'État ( F CFA)
Taillede l'exploitation
Coût des charges réelles
Coût des charges avec subventions
Marge brute réelle
Marge bruteavec subventions Ratio
20 ha 35 482 000 31 102 000 1 317 632 5 697 632 4,32100 ha 174 966 000 147 566 000 9 032 160 36 432 160 4,03
1000 ha 1 290 460 000 1 078 460 000 549 521 600 761 521 600 1,39 Finalement, il convient d’indiquer que, même depuis le renchérissement du prix du riz importé au Sénégal, la marge brute par ha de riz irrigué local reste assez faible comparée à celle des produits horticoles. Il faut donc atteindre un niveau élevé de production pour être en mesure de couvrir les charges fixes d’exploitation. La production rizicole en tant qu'agro-industrie s'adresse donc à des projets de grande surface, de l'ordre plusieurs centaines d'ha au minimum. Le niveau d'investissement est donc toujours très important car les aménagements et les infrastructures se chiffrent à plusieurs millions par ha et le coût des cultures est de l'ordre du ½ million par ha à préfinancer. Des investissements de cette taille ne peuvent être réalisés que par des structures qui ont à la fois la capacité financière et la capacité de gestion de grosses unités de production avec toute l'expérience et la rigueur que cela requière.
Exemple de matériel de récolte mécanisé Exemple de silo de stockage grande capacité Exemple de ligne de décorticage complexe
2.1 Données pour une production de riz irrigué sur 20 ha
CAHIER D’UN PROJET D’INVESTISSEMENT 8
INVESTISSEMENTS (coûts et amortissements en F CFA)Type Unité Quantité Coût unitaire Coût total Taux AmortissementAménagements hydro-agricoles ha 0 2 000 000 0 0,05 0Bâtiment gestion équipés m² 12 120 000 1 440 000 0,1 144 000Hangar agricole m² 24 30 000 720 000 0,1 72 000Hangar stockage m² 60 80 000 4 800 000 0,1 480 000Bâtiment techniques équipés m² 20 200 000 4 000 000 0,1 400 000Tracteurs agricoles un 1 25 000 000 25 000 000 0,1 2 500 000Véhicules un 1 10 000 000 10 000 000 0,2 2 000 000Mécanisation repiquage un 0 4 000 000 0 0,2 0Mécanisation entretien un 0 3 000 000 0 0,2 0Mécanisation récolte un 0 60 000 000 0 0,2 0Mécanisation transport un 1 3 500 000 3 500 000 0,2 700 000Station de pompage 1 500 m3/h un 1 5 000 000 5 000 000 0,2 1 000 000Usine décorticage 5 t/j un 1 6 000 000 0 0,1 0TOTAL INVESTISSEMENTS 54 460 000 7 296 000
FONCTIONNEMENT ANNUEL (coûts en F CFA)Personnel permanent Unité Quantité Coût unitaire Coût totalResponsable d'Entreprise un 1 3 000 000 3 000 000Responsable Administratif et Fin. un 2 000 000 0Responsable Ressources Hum. un 2 000 000 0Responsable de Production un 2 500 000 0Chefs de chantier un 1 2 160 000 2 160 000Conducteurs un 960 000 0Chauffeurs un 1 960 000 960 000Irrigateurs un 1 900 000 900 000Gardiens un 1 900 000 900 000Autres un 1 900 000 900 000Frais générauxCommunications Forfait 1 1 200 000 1 200 000Frais de bureau Forfait 1 600 000 600 000Assurances Forfait 1 500 000 500 000Déplacements Forfait 1 1 000 000 1 000 000Pièces détachées Forfait 1 900 000 900 000Petit matériel Forfait 1 500 000 500 000TOTAL FONCTIONNEMENT 13 520 000
FRAIS DE CULTURES (coûts en F CFA)
Type Unité Quantité Coût unitaire Coût totalSemences kg 125 250 31 250Engrais kg 350 200 70 000Protection Forfait 1 30 000 30 000Irrigation m3 10 000 6 60 000Travaux manuels ou mécanisés Forfait 7 18 000 126 000Redevances eau au volume m3 10 000 1,5 15 000Redevances eau à la surface ha 1 14 400 14 400MO diverses un 10 2 000 20 000TOTAL FRAIS DE CULTURE PAR HA 366 650
PARAMÈTRES ET HYPOTHÈSES
Investissements ▪ Aménagements non comptabilisés :
existants ou réhabilitations financées par l'État
▪ Coût des bâtiments estimés sur base de constructions locales et basiques
▪ Véhicule de type camionnette non tout terrain
▪ Équipement de mécanisation limité à un tracteur et une remorque
▪ Décorticage sous-traité
Fonctionnement ▪ Équipe de 6 permanents avec frais
généraux minima
Frais de culture ▪ Travaux manuels ou mécanisés selon le
type de travaux avec personnel journalier ou prestataire pour sous-traitance (labour, planage, moissonnage, etc.)
RÉSULTATS ▪ L'impact des salaires est très important
(24% du C.A.). La marge est faible (2% de l'investissement)
▪ Les investissements de cette taille sont à réaliser dans un objectif social ou familial
DONNÉES DE BASE (coûts en F CFA)Type Unité Quantité Coût unitaire RemarquesRendement paddy t / ha 6Rendement usine 0,667Coût moyen usinage F CFA / t 15 000Coût moyen transport F CFA / t 20 000Prix riz blanc grossiste rendu DK F CFA / t 265 000Nombre d'hectares un 40 Double cultureTOTAL VENTES PAR HA (F CFA) 1 024 989
COMPTE D'EXPLOITATION (valeurs en F CFA)Rubrique Unité Quantité Valeur unit. TotalRECETTES t 160 230 000 36 799 632
AMORTISSEMENTS total / an 7 296 000FRAIS FONCTIONNEMENT total / an 13 520 000FRAIS DE CULTURE ha 40 366 650 14 666 000
TOTAL CHARGES 35 482 000MARGE 1 317 632
Marge du riz blanc par hectare et par cycle en fonction du rendement et du prix de vente
Type groupement ou gros producteur
20 hectares
2.2 Données pour une production de riz irrigué sur 100 ha
CAHIER D’UN PROJET D’INVESTISSEMENT 9
INVESTISSEMENTS (coûts et amortissements en F CFA)Type Unité Quantité Coût unitaire Coût total Taux AmortissementAménagements hydro-agricoles ha 100 2 000 000 200 000 000 0,05 10 000 000Bâtiment gestion équipés m² 20 300 000 6 000 000 0,1 600 000Hangar agricole m² 72 80 000 5 760 000 0,1 576 000Hangar stockage m² 200 80 000 16 000 000 0,1 1 600 000Bâtiment techniques équipés m² 30 200 000 6 000 000 0,1 600 000Tracteurs agricoles un 2 25 000 000 50 000 000 0,1 5 000 000Véhicules un 2 16 000 000 32 000 000 0,2 6 400 000Mécanisation repiquage un 2 4 000 000 8 000 000 0,2 1 600 000Mécanisation entretien un 2 3 000 000 6 000 000 0,2 1 200 000Mécanisation récolte un 1 60 000 000 60 000 000 0,2 12 000 000Mécanisation transport un 2 3 500 000 7 000 000 0,2 1 400 000Station de pompage 150 m3/h un 1 15 000 000 15 000 000 0,2 3 000 000Usine décorticage 8 t/j un 1 6 000 000 6 000 000 0,1 600 000TOTAL INVESTISSEMENTS 417 760 000 44 576 000
FONCTIONNEMENT ANNUEL (coûts en F CFA)Personnel permanent Unité Quantité Coût unitaire Coût totalResponsable d'Entreprise un 1 12 000 000 12 000 000Responsable Administratif et Fin. un 1 4 000 000 4 000 000Responsable Ressources Hum. un 1 2 000 000 2 000 000Responsable de Production un 1 4 000 000 4 000 000Chefs de chantier un 2 2 160 000 4 320 000Conducteurs un 2 960 000 1 920 000Chauffeurs un 2 960 000 1 920 000Irrigateurs un 10 900 000 9 000 000Gardiens un 2 900 000 1 800 000Autres un 4 900 000 3 600 000Frais générauxCommunications Forfait 1 3 600 000 3 600 000Frais de bureau Forfait 1 1 800 000 1 800 000Assurances Forfait 1 1 000 000 1 000 000Déplacements Forfait 1 4 000 000 4 000 000Pièces détachées Forfait 1 1 800 000 1 800 000Petit matériel Forfait 1 1 000 000 1 000 000TOTAL FONCTIONNEMENT 57 760 000
FRAIS DE CULTURES (coûts en F CFA)
Type Unité Quantité Coût unitaire Coût totalSemences kg 125 250 31 250Engrais kg 350 200 70 000Protection Forfait 1 30 000 30 000Irrigation m3 10 000 6 60 000Mécanisation travaux Passage 7 17 500 122 500Redevances eau au volume m3 10 000 1,5 15 000Redevances eau à la surface ha 1 14 400 14 400MO diverses un 10 2 000 20 000TOTAL FRAIS DE CULTURE PAR HA 363 150
PARAMÈTRES ET HYPOTHÈSES Investissements ▪ Nouveaux aménagements entièrement
supportés ▪ Coût des bâtiments estimés sur la base de prix
unitaires entreprise ▪ Véhicules de type pickup 4x4 neufs ▪ Équipement de mécanisation complet ▪ Unité autonome de décorticage inclue (1200
heures de travail par an) Fonctionnement ▪ Équipe de 26 permanents dont près de la
moitié pour l'irrigation (peut être sensiblement réduite selon la conception de l'aménagement)
Frais de culture ▪ Travaux 100% mécanisés, estimés en nombre
de passages de machines : labour, planage, repiquage, protection (2), récolte, liage ou broyage
RÉSULTATS ▪ L'impact des salaires reste trop important (24%
du C.A.). La marge reste faible (2% de l'investissement). La marge du riz à l'ha pourtant apparemment attractive (660 000 F CFA/ha) reste faible face au niveau d'investissement exigé par les aménagements et les équipements de production, de récolte et de transformation
▪ Le retour sur des investissements de cette taille, pourtant pas très loin du milliard de F CFA (investissement + fond de roulement 1ère campagne) peut s’avérer faible
DONNÉES DE BASE (coûts en F CFA)Type Unité Quantité Coût unitaire RemarquesRendement paddy t / ha 6Rendement usine 0,667Coût moyen usinage F CFA / t 15 000Coût moyen transport F CFA / t 20 000Prix riz blanc grossiste rendu DK F CFA / t 265 000Nombre d'hectares un 200 Double cultureTOTAL VENTES PAR HA (F CFA) 1 024 989
COMPTE D'EXPLOITATION (valeurs en F CFA)Rubrique Unité Quantité Valeur unit. TotalRECETTES t 800 230 000 183 998 160
AMORTISSEMENTS total / an 44 576 000FRAIS FONCTIONNEMENT total / an 57 760 000FRAIS DE CULTURE ha 200 363 150 72 630 000
TOTAL CHARGES 174 966 000MARGE 9 032 160
Marge du riz blanc par hectare et par cycle en fonction du rendement et du prix de vente
Type PME 100 hectares
2.3 Données pour une production de riz irrigué sur 1000 ha
CAHIER D’UN PROJET D’INVESTISSEMENT 10
INVESTISSEMENTS (coûts et amortissements en F CFA)Type Unité Quantité Coût unitaire Coût total Taux AmortissementAménagements hydro-agricoles ha 1 000 2 000 000 2 000 000 000 0,05 100 000 000Bâtiment gestion équipés m² 120 300 000 36 000 000 0,1 3 600 000Hangar agricole m² 500 80 000 40 000 000 0,1 4 000 000Hangar stockage m² 5 000 80 000 400 000 000 0,1 40 000 000Bâtiment techniques équipés m² 300 200 000 60 000 000 0,1 6 000 000Tracteurs agricoles un 10 25 000 000 250 000 000 0,1 25 000 000Véhicules un 6 16 000 000 96 000 000 0,2 19 200 000Mécanisation repiquage un 10 4 000 000 40 000 000 0,2 8 000 000Mécanisation entretien un 10 3 000 000 30 000 000 0,2 6 000 000Mécanisation récolte un 4 60 000 000 240 000 000 0,2 48 000 000Mécanisation transport un 10 3 500 000 35 000 000 0,2 7 000 000Station de pompage 1 500 m3/h un 4 15 000 000 60 000 000 0,2 12 000 000Usine décorticage 50 t/j un 1 40 000 000 40 000 000 0,1 4 000 000TOTAL INVESTISSEMENTS 3 327 000 000 282 800 000
FONCTIONNEMENT ANNUEL (coûts en F CFA)Personnel permanent Unité Quantité Coût unitaire Coût totalDirecteur Général un 1 30 000 000 30 000 000Directeur Administratif et Fin. un 1 15 000 000 15 000 000Directeur des Ressours Hum. un 1 10 000 000 10 000 000Directeur de production un 1 24 000 000 24 000 000Chefs de chantier un 10 2 160 000 21 600 000Conducteurs un 15 960 000 14 400 000Chauffeurs un 6 960 000 5 760 000Irrigateurs un 100 900 000 90 000 000Gardiens un 6 900 000 5 400 000Autres un 30 900 000 27 000 000Frais générauxCommunications Forfait 1 3 600 000 3 600 000Frais de bureau Forfait 1 3 600 000 3 600 000Assurances Forfait 1 3 000 000 3 000 000Déplacements Forfait 1 10 000 000 10 000 000Pièces détachées Forfait 1 12 000 000 12 000 000Petit matériel Forfait 1 6 000 000 6 000 000TOTAL FONCTIONNEMENT 281 360 000
FRAIS DE CULTURES (coûts en F CFA)
Type Unité Quantité Coût unitaire Coût totalSemences kg 125 250 31 250Engrais kg 350 200 70 000Protection Forfait 1 30 000 30 000Irrigation m3 10 000 6 60 000Mécanisation travaux Passage 7 17 500 122 500Redevances eau au volume m3 10 000 1,5 15 000Redevances eau à la surface ha 1 14 400 14 400MO diverses un 10 2 000 20 000TOTAL FRAIS DE CULTURE PAR HA 363 150
PARAMÈTRES ET HYPOTHÈSES Investissements ▪ Nouveaux aménagements entièrement
supportés ▪ Coût des bâtiments estimés sur base de prix
unitaires entreprise ▪ Véhicules de type pickup 4x4 neufs ▪ Équipement de mécanisation complet ▪ Unité autonome de décorticage inclue (2000
heures de travail par an) Fonctionnement ▪ Équipe de 171 permanents, dont plus de la
moitié pour l'irrigation (peut être sensiblement réduite selon la conception de l'aménagement)
▪ Cadres de haut niveau, experts de niveau international, pour la gestion et la conduite des cultures
Frais de culture ▪ Travaux 100% mécanisés, estimés en nombre
de passages de machines : labour, planage, repiquage, protection (2), récolte, liage ou broyage
RÉSULTATS ▪ Les économies d'échelle réduisent l'impact des
salaires à 13% du C.A. La marge s'améliore (17% de l'investissement). Un bon management et des économies d'échelle supplémentaires devraient permettre de bonifier sensiblement cette analyse qui, pour une activité agricole qui présente très peu de risques en matière de production et de débouchés, présente une rentabilité prometteuse
DONNÉES DE BASE (coûts en F CFA)Type Unité Quantité Coût unitaire RemarquesRendement paddy t / ha 6Rendement usine 0,667Coût moyen usinage F CFA / t 15 000Coût moyen transport F CFA / t 20 000Prix riz blanc grossiste rendu DK F CFA / t 265 000Nombre d'hectares un 2 000 Double cultureTOTAL VENTES PAR HA (F CFA) 1 024 989
COMPTE D'EXPLOITATION (valeurs en F CFA)Rubrique Unité Quantité Valeur unit. TotalRECETTES t 8 000 230 000 1 839 981 600
AMORTISSEMENTS total / an 282 800 000FRAIS FONCTIONNEMENT total / an 281 360 000FRAIS DE CULTURE ha 2 000 363 150 726 300 000
TOTAL CHARGES 1 290 460 000MARGE 549 521 600
Marge du riz blanc par hectare et par cycle en fonction du rendement et du prix de vente
Type agro-industriel 1000 hectares