Philia&Filia, v. 2, n. 2 (2011): A metáfora de Bergson e a nossa escuta musical
« Non est consuetum in comitatu Sabaudie quod filia succedit patri in comitatu. Genèse de la...
-
Upload
univ-savoie -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of « Non est consuetum in comitatu Sabaudie quod filia succedit patri in comitatu. Genèse de la...
Non est consuetum in comitatu Sabaudie quod filia succedit
patri in comitatu et possessione comitatus
Genèse de la coutume savoyarde de l’exclusion des filles
par
LAURENT RIPART
dans
Pierre II de Savoie. Le “ petit Charlemagne ” († 1268), études
publiées par Bernard Andenmatten, Agostino Paravicini Babliani et
Eva Pibiri, Lausanne, 2000 (Cahiers lausannois d’histoire
médiévale, n° 27), p. 295-331.
La succession de 1268 occupe une place privilégiée dans la formation du droit
successoral savoyard puisque, pour la première fois dans l’histoire de la maison de Savoie, un comte mourait en ne laissant qu’une fille pour toute descendance. En testant pour son frère Philippe, au détriment de sa fille Béatrice, le comte Pierre introduisit donc un précédent dynastique, qui fut invoqué en 1329, lorsque la fille du comte Edouard fut exclue au bénéfice de son oncle Aymon, puis lors des successions de 1496, de 1821 et de 1831, où furent écartés des filles ou des héritiers en ligne féminine1. La succession du comte Pierre devint ainsi une référence fondamentale, qui fut toujours citée par les juristes savoyards de l’Ancien régime, lorsqu’il leur fallait démontrer que, comme pour le royaume de France, les Etats de Savoie ne tombent pas de lance en quenouille2.
Pour autant, les serviteurs des ducs de Savoie refusèrent toujours de considérer que le précédent de 1268 ait pu, en lui-même, constituer la source d’un droit nouveau, car les juristes et les historiens savoyards refusèrent toujours d’envisager que la coutume successorale puisse être soumise aux aléas de la transformation historique. Dans cette perspective, tout événement dynastique renvoyait nécessairemenent à un droit préexistant, ce qui impliquait que le précédent de 1268 fût perçu comme une manifestation et non comme le fondement de la coutume successorale. Comme dans la France des XIVe et XVe siècles3, l’historiographie
1 Pour la succession de 1329, v. infra, p. 31-32; pour la succession de 1496, v. L. USSEGLIO,
Bianca di Monferrato, duchessa di Savoia, Torino, L. Roux, 1892, p. 283-8 et F. GABOTTO, Lo Stato sabaudo da Amedeo VIII ad Emmanuele Filiberto, Torino, Roux, 1893, t. III, p. 1-9.
2 Cité par S. GUICHENON, Histoire généalogique de la royale Maison de Savoie, justifiée par titres, fondations de monastères, manuscripts, anciens documents, histoires & autres preuves authentiques, Turin, 17782, t. I, p. 89 (réimpression plus complète de l’édition originale de Lyon, donnée en 1660). Sur l’origine française d’un tel adage, v. Ph. CONTAMINE, “ "Le royaume de France ne peut tomber en fille". Fondement, formulation et implication d’une théorie politique à la fin du Moyen Age ”, dans Perspectives médiévales, 1987, p. 67-81 et F. COSANDEY, “ De lance en quenouille. La place de la reine dans l’Etat moderne ”, dans Annales. Histoire, Sciences sociales, 1997, p. 799-820.
3 Pour une comparaison avec la coutume française de l’exclusion des filles, v. P. VIOLLET, “ Comment les femmes ont été exclues en France de la succession à la couronne ”, dans Mémoires de l’académie des inscriptions et des Belles-Lettres, t. XXXIV, 1894, p. 125-78; R.E. GIESEY, The juridic basis of the dynastic right to the french throne, Philadelphia, 1961 (Transaction of the american philosophical society, t. LI, n° 5); A.W. LEWIS, Le sang royal. La famille capétienne et l’Etat, France, Xe-XIVe siècle, Paris, Gallimard, 1986, p. 196-201 et J. KRYNEN, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France (XIIIe-XVe siècle), Paris, Gallimard, 1993, p. 127-35.
savoyarde s’édifia donc sur le mythe d’un droit primitif, qui permettait de légitimer a posteriori l’ordre dynastique4.
Les premiers historiographes ducaux s’attachèrent ainsi à rechercher des preuves susceptibles d’enraciner le précédent de 1268 dans un vieux droit coutumier ancestral. Au début du XVe siècle, le chroniqueur Cabaret releva qu’en 1263, la sœur du défunt comte Boniface avait déjà été écartée au profit de son oncle, pour conclure que, dès cette époque, en Savoye est la coustume que les femmes ne doyvent succeder en la contee5. Un demi-siècle plus tard, Jean Servion se référait sans doute aux testaments d’Amédée IV (1233-1253), qui avait réservé sa succession à ses seuls parents mâles, lorsqu’il affirma que le comte Pierre n’avait transmis son pouvoir à Philippe, qu’en confermant les anciens testemens de ces predecesseurs, qui estoyent tels que nulle fillie ne femme ne deust ne ne peust heriter en nulles des seigneuryez appertenant a la sygnieurye de Sauoye6. Pour les chroniqueurs du XVe siècle, la coutume successorale de la maison de Savoie avait donc été établie par une ancienne loi fondamentale, ce qui leur permettait d’affirmer que nulle fillie ne sucesde a leritage de Sauoye par constitucions7.
Cette belle construction historiographique fut toutefois remise en cause par le gallo-centrisme des historiens français, qui considérèrent que la coutume savoyarde d’exclusion des filles ne pouvait trouver son origine que dans l’introduction de la loi salique dans les Etats de Savoie. Dès 1552, le chroniqueur francophile Guillaume Paradin put ainsi affirmer que Pierre avait exclu Béatrice, voulant obseruer ce qui s’obserue en France touchant les femmes8. En 1576, Jean Bodin s’inspira de cette interprétation pour constater, non sans quelques confusions, que la loy salique a esté prattiquee en la maison de Savoye : car
4 Sur la genèse de la loi salique, v. C. BEAUNE, “ Histoire et politique : la recherche du texte
de la loi salique de 1350 à 1450 ” dans Actes du 104e Congrès national des sociétés savantes (Bordeaux, 1979), Paris, 1981, t. I, p. 25-35; id., Naissance de la Nation France, Paris, Gallimard, 1985, p. 273-5 ; K. DALY et R. E. GIESEY, “ Noël de Fribois et la loi salique ”, dans Bibliothèque de l’Ecole des chartes, 1993, p. 5-36 et S. HANLEY et alii, Les droits de la femme et la loi salique, Paris, Indigo & Côté-femmes, 1994.
5 J. d’ORRONVILLE dit CABARET, Chroniques de Savoie (cité d’après la la transcription du ms de la Bibliothèque Nationale de France, fr. 6164, donnée par D. CHAUBET, L’historiographie savoyarde du XIVe au XVIe siècle, Thèse de l’Ecole pratique des hautes études, 1990, p. 381).
6 JEHAN SERVION, Gestez et croniques de la Mayson de Savoye, éd. F.E. BOLLATI, Turin, F. Casanova, 1879, t. I, p. 311.
7 Id., ibid., p. 281. 8 G. PARADIN, Chronique de Savoye, Lyon, 1552, p. 193-4.
Pierre de Sauoye fit debouter sa niece Constance de la succession de Sauoye, par sentence des arbitres accordez l’an M.CCLVI9.
L’autorité de Jean Bodin ne pouvait être aisément rejetée par les juristes savoyards, qui durent donc admettre que la maison de Savoie avait effectivement emprunté la loi salique au royaume de France. Pour autant, ils se refusèrent à admettre que le comte Pierre aurait pu, de sa propre initiative, modifier la coutume pour introduire un droit nouveau. Aussi, vers 1600, Louis de Butet de Maletret proposa une solution politiquement plus satisfaisante en affirmant que la loi salique avait été instaurée par Humbert Ier, le premier des comtes de la maison de Savoie10. Cette construction ne pouvait toutefois être étayée par la moindre preuve et Samuel Guichenon, le grand historiographe du XVIIe siècle, préféra donc y renoncer, pour invoquer simplement le témoignage de ces chartes du haut Moyen Age, données par des aristocrates lege viventes salica, afin de conclure que la loi salique était utilisée en Savoie depuis un passé des plus éloignés11.
Au début du XIXe siècle, la question fut de nouveau posée, lorsque P. Dattà s’interrogea sur les fondements juridiques de l’apanage de la branche des Savoie d’Achaïe12. En analysant, en historien du droit, les testaments des comtes du XIIIe siècle, P. Dattà n’y aperçut qu’une totale “ confusione di legge ”, qui démontrait l’absence d’un véritable ordre juridique, capable de fonder un droit dynastique. Il constata ainsi que les actes de renonciation au comté de Savoie, donnés en 1268 et
9 J. BODIN, Les six livres de la République, livre 6, chap. 5. Le texte est cité dans l’édition la
plus complète l’œuvre, donnée à Lyon, G. Cartier, 1593, p. 1013 (repris par C. FREMONT, M.D. COUZINET, H. ROCHAIS, Paris, Fayard, 1986 (Corpus des œuvres de philosophie en langue française, t. VI), p. 248).
10 Entre les fondements plus necessaires quil donna a son estat pour lenvoyer à la postérité sans être tronqué, distrait ou aliéné, il establit chez soy la loy salique qui ne permet que les femmes héritent ains que les masles empoignent la succession pourveu quils soient du sang et yssut des masles en droite ligne. (L. de BUTET de MALETRET, La première décade de la Maison de Savoie, dans AST, Storia della real Casa di Savoia, Cat. 2a, Storie generali, mazzo VII, 4).
11 Nous ne voyons point quand l’établissement de cette loi Salique a été fait en la maison Royale de Savoie [...] Nous pouvons néanmoins dire avec quelque sorte de probabilité, que les Etats de Savoie étant voisins de la France, il n’est pas inconvénient que la loi Salique s’y soit introduite, parce qu’en fait de lois & de coûtume, les peuples empruntent toujours de leurs voisins ce qu’ils jugent plus propre & plus nécessaire à leur conservation. De plus nous avons des exemples qui nous apprennent qu’en Suisse & au pays de Bugey qui dépendait autrefois de la Savoie, la loi salique avait lieu [...] Ainsi pourquoi ne croirions-nous pas qu’elle ait été embrassée & reçue en Savoie, puisque nous n’en pouvons pas nier l’usage ? (GUICHENON, Histoire généalogique de la royale Maison de Savoie, p. 89).
12 P. DATTÀ, Storia dei principi di Savoia del ramo d’Acaia, signori del Piemonte dal MCCXIV al MCCCCXVIII, Torino, 1832, 2 vol..
en 1273 par deux princesses savoyardes, montraient que “ non era [...] osservata la legge salica per l’esclusione delle femmine13 ”.
Ces conclusions ne parvinrent toutefois pas à s’imposer et les études les plus récentes se sont plutôt efforcées de mettre en évidence l’ancienneté du principe savoyard de l’exclusion des filles. Constatant qu’en 1252, le comte Amédée IV avait déjà substitué son frère à ses filles, André Perret et Bernard Demotz ont ainsi considéré que la succession de 1268 s’était donc effectuée selon un principe déjà coutumier14. Dans un jugement plus nuancé, E.L. Cox put aussi conclure que, dès le milieu du XIIIe siècle, “ the one indisputable feature of the otherwise undefined succession customs in Savoy was the rigorous exclusion of females15 ”. En se trouvant de nouveau rejetée dans les temps obscurs de la coutume ancestrale, la question de l’origine de la coutume savoyarde de l’exclusion des filles demeurait ainsi un problème irrésolu.
Les enjeux de cette vieille question d’histoire dynastique sont pourtant loin d’être négligeables, car de l’interprétation de la succession de 1268 dépendent en grande partie les jugements historiques sur la nature du pouvoir comtal, au temps de Pierre. Admettre, comme Pietro Dattà, que les testaments du XIIIe siècle furent rédigés en fonction du seul arbitraire princier, permet en fait de conclure que le pouvoir des comtes de Savoie n’était pas soumis à un droit transcendant. Affirmer, au contraire, que Pierre et ses frères durent exclure systématiquement leurs filles de la succession comtale revient, inéluctablement, à constater que les comtes de Savoie furent contraints à sacrifier leur propre descendance, au nom de la continuité dynastique et juridique de l’Etat.
Le dossier de la coutume savoyarde de l’exclusion des filles mérite donc un certain intérêt, puisqu’il nous permet de mieux appréhender le rapport du pouvoir comtal au droit, ce constituant essentiel de toute construction étatique. Dans cette perspective, il convenait donc d’étudier dans la longue durée la pratique de l’exclusion des filles, afin de pouvoir mieux situer le principat du comte Pierre, dans l’histoire complexe de la définition d’un droit dynastique.
13 Id., ibid., t. I, p. 6-7. 14 Le testament d’Amédée IV est d’ailleurs interprété de manière divergente par ces deux
auteurs. Pour A. PERRET, “ Principaux organes du gouvernement de l’Etat savoyard de 1189 à 1323 ”, dans Bulletin Philologique et historique, année 60, 1961, vol. 1, p. 345-60, p. 351, cette exclusion des filles aurait été une nouveauté, qui aurait introduit une nouvelle pratique coutumière. B. DEMOTZ, Le comté de Savoie du début du XIIIe au début du XVe siècle : étude du pouvoir dans une principauté réussie, Thèse, Lyon, 1985, t. 2, p. 324-5, interprète plutôt le testament comme le signe de l’application d’un principe préexistant.
15 E.L. COX, The eagles of Savoy. The house of Savoy in thirteenth century Europe, Princeton, P.U.P., 1974, p. 395.
I) L’héritière ambigüe (seconde moitié du XIIe siècle)
Bien qu’au cours du XIIe siècle, les comtes de Maurienne-Savoie aient toujours eu un fils pour leur succéder, il durent envisager l’éventualité d’une succession féminine, lorsque le comte Humbert III se trouva dépourvu d’héritier mâle, après avoir consommé trois mariages. Au début de la décennie 1170, il dépêcha un émissaire au roi Henri II d’Angleterre, pour lui proposer d’unir sa fille Alice au futur Jean sans Terre16. En 1173, les négociations aboutirent à un traité de fiançailles par lequel le comte s’engageait à concéder totum comitatum suum & alias terras suas... Johanni filio Henrici, illustrissimi Regis Angliæ, cum filia sua primogenita, Aalis nomine, si filium ex uxore sua non habuerit17. Au cas où Humbert III obtiendrait enfin un héritier mâle, Alice et Jean recevraient diverses châtellenies et le comte promettait que totum comitatum Belicensem, sicut eum habet, illis concedit.
Le traité de fiançailles de 1173
Hypothèse 1 : Hypothèse 2 : Humbert III meurt sans fils Humbert III meurt en laisant un fils
Henri II Humbert III Henri II Humbert III Roi d’Angleterre Comte de Maurienne Roi d’Angleterre Comte de Maurienne Jean Alice Jean Alice Fils Comte de Maurienne Comte de Maurienne Dotés en comté de Belley
La mort prématurée d’Alice, puis la naissance d’un héritier mâle, rendirent ces dispositions caduques. Pour autant, ce traité fournit une source précieuse qui montre que la dévolution du pouvoir comtal était largement assimilée à une succession de droit privé. La dotation d’Alice, dans le contexte de son exclusion d’une succession désormais relevée par un fils mâle, peut être interprétée comme
16 Sur ce projet de mariage, évoqués par plusieurs sources narratives contemporaines, v. C.W.
PREVITE-ORTON, The early history of the house of Savoy, Cambridge, 1912, p. 338-41. 17 Ce traité de fiançailles, rédigé sur un chirographe, n’est connu que par une source anglaise
(éd. T. RYMER, Fœdera, conventiones, litteræ, et cunjuscunque generis acta publica inter reges Angliæ et alios quosuis Imperatores, Reges, Pontifices, Principes vel Communitates ab ingressu Gulielmi I in Angliam, A.D. 1066 ad nostra usque tempora habita aut tractata, Londres, 1816, vol.I, pars I, p. 28-9).
une allusion claire au principe d’exhérédation des filles dotées18. La donation en dot du comitatus Bellicensem, qui n’était en fait qu’une partie intégrante du comté de Maurienne-Savoie, atteste d’autre part qu’Humbert III semble avoir fait peu de cas du principe d’indivisibilité des honneurs.
Pour autant, le traité de 1173 montre aussi que le pouvoir comtal ne pouvait être considéré comme n’importe quel bien privé, puisqu’il n’était pas possible de le concéder à une femme. Les formules du traité étaient en effet très claires : si naissait un fils, Alice et Jean auraient conjointement une dot, mais si Humbert III n’avait pas d’héritier mâle, seul Jean recevrait le comté. S’il était donc tout à fait possible de céder à Alice des châtellenies entières, qui pouvaient, dans nos régions, être possédées par une femme19, la transmission du pouvoir comtal était à l’inverse une affaire d’hommes, dans laquelle Alice ne pouvait guère être qu’un vecteur nécessaire.
Tout au long du XIIe siècle, les Savoyards considérèrent que le pouvoir comtal ne pouvait être exercé, au moins sur un plan formel, par une femme. Ainsi, lorsque Humbert II mourut en 1103, en ne laissant qu’un fils mineur, ce fut le comte Aymon de Genève qui reçut le titre de tutor, bien que Gisèle de Bourgogne, veuve du comte défunt, semble avoir exercé en pratique l’essentiel de la régence20. En 1189, à la mort d’Humbert III, l’officium tutele fut de nouveau confié à un homme, le marquis Boniface de Montferrat, même si la comtesse Béatrice, veuve du comte défunt, conserva une grande influence21. L’organisation de ces régences semblent donc montrer qu’une comtesse pouvait éventuellement exercer la réalité des pouvoirs, mais que l’officium devait toutefois revenir à un homme.
18 Sur la diffusion du principe d’exhérédation des filles dotées dans la vallée du Rhône, v. N.
DIDIER, “ Le texte et la date du statut de Guillaume II de Forcalquier sur les filles dotées ”, dans Annales de la Faculté de droit d’Aix, 1950, p. 5-22; id., “ Les dispositions du statut de Guillaume II de Forcalquier sur les filles dotées, 1162 ”, dans Le Moyen Age, 1950, p. 247-78; L. MAYALI, Droit savant et coutumes. L’exclusion des filles dotées XIIème-XVème siècles, Frankfurt am Main, 1987 et E. MAGNANI S. CHRISTEN, “ Douaire, dot, héritage : la femme aristocratique et le patrimoine familial en Provence (fin Xe-début du XIIe siècle) ”, dans Provence historique, 1996, p. 195-209.
19 Dès 1123, une femme donnait ainsi à l’archevêque de Vienne un château allodial, sans doute pour le reprendre en fief (v. Cartulaire de Saint-André-le-Bas, éd. U. CHEVALIER, Lyon, 1869, Appendix, n° 78*, p. 289-90).
20 Pour le titre du tutor d’Aymon, v. GUICHENON, Histoire généalogique de la maison de Savoie, t. IV, Preuves, p. 29. Sur le rôle de Gisèle de Bourgogne, v. PREVITE-ORTON, The early history of the house of Savoy, p. 278, qui conclut que “ Gisela was of course the real ruler ”.
21 Cette charge de l’officium tutele est mentionnée dans une charte de 1189, (éd et A. BILLIET et Mgr ALBRIEUX, Chartes du diocèse de Maurienne, Chambéry, 1861, p. 38). La comtesse douairière Béatrice exerça toutefois un rôle important, puisqu’elle souscrivait avant le tutor (v. PREVITE-ORTON, The early history of the house of Savoy, p. 355-6)
Ces mêmes principes s’appliquèrent aussi dans les autres principautés du regnum Burgundie, comme le montre par exemple le règlement de la succession du dauphin Guigues V, qui mourut, en 1162, en ne laissant qu’une fille unique, Béatrice, encore célibataire22. Le Dauphiné demeura alors attaché à la fille du comte défunt, qui put le transmettre à ses deux époux successifs, tout d’abord à Albéric Taillefer de Toulouse, qui fut comte de 1163 à 118323, puis au duc Hugues III de Bourgogne, qui assuma le pouvoir delphinal de 1183 à 1192, avant de le léguer à son fils Guigues-André. Pour autant, jamais Béatrice ne put assumer le pouvoir comtal à titre personnel, puisque l’empereur n’accorda ainsi l’investiture du Dauphiné qu’à ses époux24, qui possédèrent seuls un sceau comtal25. Dès que son fils Guigues-André eut atteint sa majorité, Béatrice fut d’ailleurs remariée au seigneur Hugues de Coligny et disparut définitivement de la vie politique dauphinoise : après avoir fait “ pont et planche ”, la fille de Guigues V n’avait désormais plus guère d’utilité.
La transmission du titre comtal en Dauphiné 22 Sur la succession de Guigues V et les mariages de Béatrice, v. DEVIC et VAISSETTE,
Histoire générale du Languedoc, Toulouse, 1841, t. IV, p. 232; P. FOURNIER, Le Royaume d'Arles et de Vienne (1138-1378). Etude sur la formation territoriale de la France de l'Est et du Sud-Est, Paris, Picard, 1891, p. 30-1 et 72 et G. de MANTEYER, “ Les origines du Dauphiné de Viennois ”, dans Bulletin de la société d’étude des Hautes-Alpes, 1925, p. 50-140, p. 115-8.
23 Alberic étant encore fort jeune, ce fut en fait Raymond V, qui exerça le pouvoir comtal en Dauphiné. Selon MANTEYER, “ Les origines du Dauphiné de Viennois ”, p. 116, qui ne cite pas sa source, Raymond V aurait pris le titre de dominus Gracianopolitani comitatus. Les historiens du Dauphiné ont toutefois souvent considéré que Raymond V aurait délégué sa régence à son frère Alphonse, en se fondant sur la Vita sancti Petri Tarentasiensi, (AA SS, Mai, t. II, die octava, p. 325) qui mentionne Hildefonsum comitem Tolosanum in regione Gratianopolitana eo tempore dominantem. Il me semble toutefois plus probable de penser à une confusion de l’hagiographe, voire à un autre nom du comte Raymond V.
24 Sur le diplôme d’investiture impérial du comté d’Albon, concédé à Hugues III de Bourgogne, v. FOURNIER, Le royaume d’Arles, p. 72, n. 4 et G. GIORDANENGO, Le droit féodal dans les pays écrit. L’exemple de la Provence et du Dauphiné (XIIe-début XIVe siècle), Rome, E.F.R., 1988, p. 191).
25 Les sources sigillographiques fournissent un témoignage éclairant, puisque si Hugues III, et sans doute aussi Albéric-Taillefer, eurent un sceau comtal, aucun élément ne peut donner à penser que Béatrice ait jamais scellé (v. A. ROYER, “ Etude sur les actes des comtes d’Albon et dauphins du Viennois (vers 1030-1049), dans Positions des thèses de l’Ecole des chartes, 1931, p. 175-86, p. 177 et B. BEDOS-REZAK, “ Sceaux seigneuriaux en Dauphiné de 1170 à 1349 ”, dans Economies et sociétés dans le dauphiné médiéval. Actes du 108e congrès national des sociétés savantes, (Grenoble, 1983), Paris, C.T.H.S., 1984, p. 23-50, p. 29-30).
(seconde moitié du XIIe siècle) Guigues V † 1162 Albéric Taillefer Béatrice Hugues III de Bourgogne † 1183 † 1192 1163 1183
Guigues-André N.B. : en gras les comtes ; en italique les régents L’organisation des régences dauphinoises semble aussi témoigner de ces mêmes
réticences à confier le pouvoir comtal à une femme. Sans doute, la Vie de la dauphine Clémence-Marguerite de Bourgogne affirme-t-elle que la sainte exerça le pouvoir en Dauphiné, après la mort de son époux Guigues-Dauphin, en 114226. Toutefois, aucun acte ne lui donna jamais le titre de tutor et sa Vie signale d’ailleurs que l’aristocratie locale refusa de se soumettre à son autorité. Peut-être cette régence s’organisait-elle selon les mêmes principes qui s’imposèrent en 1192, lorsque le jeune Guigues-André dut être placé sous tutelle, car si sa mère Béatrice put exercer la réalité du pouvoir, il lui fallut toutefois concéder l’officium tutele à son cousin Renaud de Forez27. Si, dans la pratique, une femme pouvait donc administrer une principauté comtale, il était toutefois nécessaire que le pouvoir princier puisse s’incarner, même fictivement, dans un homme.
Le comté de Bourgogne offre un exemple particulièrement intéressant, puisque la succession du comte Renaud III, qui mourut en 1148 en ne laissant qu’une fille en bas âge, est particulièrement bien connue28. Les actes privés, les diplômes
26 V. G. BOURSIQUOT-GIORDANENGO, “ Une œuvre narrative de la fin du XIIe siècle : la
vie de la dauphine Clémence-Marguerite de Bourgogne ”, dans Bulletin de la société d’études des Hautes-Alpes, 1975, p. 3-45.
27 V. B. GALLAND, Deux archevêchés entre la France et l’Empire. Les archevêques de Lyon et les archevêques de Vienne, du milieu du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle, Rome, E.F.R., 1994, p. 222.
28 Sur la succession de Renaud III, v. FOURNIER, Le royaume d’Arles, p. 20-6; J.Y. MARIOTTE, Le comté de Bourgogne sous les Hohenstaufen (1156-1208), Paris, 1963 (Cahiers d’études comtoises, n° 4), p. 57-72; R. FOLZ, “ L’empereur Frédéric Ier et le royaume de Bourgogne ”, dans Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 1956, p. 113-26; R. LOCATELLI, G. MOYSE, B. de VREGILLE, “ La Franche Comté entre le Royaume et l'Empire ”, dans Francia, 1987, p. 109-47 et M.Th. ALLEMAND-GAY, Le pouvoir des comtes de Bourgogne au XIIIe siècle, Paris, 1988 (Cahiers d’études comtoises, n° 36), p. 37-41.
royaux et les sources narratives démontrent ainsi que le comté de Bourgogne fut incontestablement considéré comme l’hereditarium de Béatrice, mais qu’elle ne pouvait toutefois exercer personnellement les fonctions comtales29. Avant son mariage avec Frédéric-Barberousse, Béatrice ne reçut ainsi jamais le titre de comitissa, mais fut placée sous la garde de son oncle paternel, le comte Guillaume de Mâcon, qui s’intitula comes Burgundie, tout en exerçant en fait une autorité de régent30. Après son mariage, le comté de Bourgogne fut alors considéré comme une terre de la couronne, qui demeura attachée à Frédéric, même après le décès, en 1184, de l’impératrice31. S’il est indéniable que Frédéric ne put gouverner en Bourgogne que du chef de l’héritage de sa femme32, il est tout aussi évident que Béatrice ne pouvait elle-même exercer ses droits héréditaires sur le pouvoir comtal.
29 La documentation ne laisse aucun doute sur ce point : jamais Béatrice ne reçoit le titre de
comitissa dans les actes bourguignons et les actes royaux évitent de lui donner ce titre. Révélateur est ainsi le traité de 1152 entre Frédéric Barberousse et Berthold de Zähringen, qui évoque de terra quam modo habet comes Willelmus Matisconensis ex parte nepotis suae (éd. MGH, Legum, Constitutiones et acta publica, t. I, n° 141, p. 199). Les sources narratives confirment d’ailleurs ce fait : Otton de Freising parle ainsi de Beatrix Reinaldi comitis filia (MGH, Scriptores, t. XX, p. 412) et Burchard d’Ursberg est très clair sur ce point, lorsqu’il la désigne comme domina Beatrix de genere Burgundium, nobilissima filia comitis Bisuntini, quae illi unica erat heres omnium bonorum ipsius (MGH, Scriptores, t. XXIII, p. 346).
30 Il est bien douteux de considérer que Guillaume ait voulu éliminer sa nièce, comme l’affirma une tradition postérieure (v. MARIOTTE, Le comté de Bourgogne, p. 64-9). Sans doute faut-il considérer son titre de comes, comme une régence viagère semblable à l’usage savoyard du milieu du XIIIe siècle (v. p. 24-25).
31 Il est bien difficile de suivre ALLEMAND-GAY, Le pouvoir des comtes de Bourgogne, p. 38-9, lorsqu’elle considère que “ le comté de Bourgogne avait connu un interrègne puisque le titulaire du titre, Béatrice était décédée en 1184 et que son époux Frédéric Barberousse reste seul maître du gouvernement du pays ”. Le domaine comtal de Bourgogne, géré par préceptes et légats impériaux, fut explicitement définie par la chancellerie impériale comme une terra imperatoris (v. MARIOTTE, Le comté de Bourgogne, p. 123), ce qui montre clairement que Béatrice ne fut pas considérée comme comtesse à titre personnel. Si elle intervint dans l’administration, ce fut bien en épouse de l’empereur, qui exerçait l’autorité suprême, comme le montre par exemple le diplôme de 1166, où Béatrice intercède auprès de Frédéric pour qu’il concède une terre du comitatus (MARIOTTE, Le comté de Bourgogne, Annexe 1, B1, p. 167-8).
32 Les sources narratives sont très claires sur ce point : Otton de Freising affirme que at Reinaldus... tantum hanc puellam suscepit... tocius terrae suae haeredem reliquit. Quam imperator... sub uxoris titulo possidere coepit (MGH, Scriptores, t. XX, p. 413); son continuateur Rahewin considère que reversus de Burgundia imperator, rebus feliciter gestis praediisque coniugis suae imperatricis (ibid., p. 423); tandis que Raoul de Diceto soutient que l’empereur reçut la Bourgogne in nomine dotis (MGH, Scriptores, t. XXVII, p. 270). D’ailleurs, en 1188/9, Frédéric laissa le comté à son fils cadet Otton en l’installant in materna hereditate, in comitem Burgundie (MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniæ, t. X, pars IV, n° 994, p. 283-4).
Ces mêmes principes s’imposèrent de nouveau en 1200, lorsque le comte Otton mourut en laissant deux jeunes filles, qui furent considérées comme les héritières du comté, sans toutefois recevoir le titre de comitissa33. Philippe de Souabe, le plus proche parent mâle, exerça alors les pouvoirs de la régence, mais délégua en fait l’essentiel de son autorité à la comtesse douairière, comme si la veuve d’Otton Ier n’avait pu gouverner que dans la fiction de la continuité d’un pouvoir masculin34. Après le décès de l’aînée des deux filles, la cadette épousa en 1208 Otton de Méranie, qui devint alors comte de Bourgogne, mais ce ne fut qu’à partir de ce mariage que cette héritière put porter le titre de comitissa, qu’elle tenait en fait de son époux et non de son père.
La succession au comté de Bourgogne
(milieu XIIe-début XIIIe siècle)
Renaud III Guillaume de Mâcon † 1148 †1155
Béatrice Frédéric-Barberousse † 1184 (1156-1188/9) 1156
Henri VI Otton Ier Marguerite de Blois Philippe † 1197 † 1200 (1200-1208)
Jeanne Béatrice Otton II de Méranie † 1205 1208 N.B. : en gras les comtes; en italique les périodes durant lesquelles le domaine comtal est rattaché au fisc royal ou placé sous l’autorité monarchique
Les exemples du Dauphiné et du comté de Bourgogne permettent donc de
montrer que le traité de fiançailles savoyard de 1173 s’organisait selon des 33 Les actes bourguignons ne donnent pas alors, aux filles d’Otton, le titre de comitissa, mais
celui d’heres comitis (v. par exemple la donation de la comtesse douairière Marguerite à Citeaux, éd. MARIOTTE, Le comté de Bourgogne, Annexe VI, doc. XV, p. 214-5). Cet usage se retrouve d’ailleurs dans les sources narratives, comme le montre la chronique d’Albric le moine, qui ne donne jamais le titre de comitisssa à Béatrice, tout en la considérant comme l’héritière du comté : Otto... genuit... filiam unicam quam habuit Otto dux Meranie et per eam factus est comes Burgundie (MGH, Scriptores, t. XXIII, p. 863).
34 V. MARIOTTE, Le comté de Bourgogne, p. 121-3.
principes généraux, utilisés dans l’ensemble du regnum Burgundie. En l’absence de fils, la fille du comte défunt était ainsi normalement reconnue comme la seule détentrice légitime de l’hereditarium. Pour autant, si l’héritière pouvait apporter son comté aux hommes qui lui étaient charnellement liés, voire même l’administrer aux côtés de son mari, elle n’en était jamais le véritable titulaire. Ce système successoral était donc fondé sur une dissociation entre l’hereditarium et la légitimité dynastique, que pouvait transmettre une héritière, et le titre comtal, qui ne pouvait être porté que par un homme.
Peut-on toutefois considérer cette masculinité du pouvoir princier comme une simple conséquence des fonctions politico-militaires, que devaient assumer les comtes ? Sans doute était-il difficile qu’une femme puisse exercer pleinement un pouvoir comtal qui demeurait d’abord celui d’un chef de troupe, mais cette explication est toutefois insuffisante pour rendre compte de cet interdit qui empêchait ces veuves heureuses, capables d’administer avec bonheur une principauté, d’assumer officiellement une tutelle qu’elles exerçaient dans la pratique. L’exemple des principautés provençales, où les femmes pouvaient exercer personnellement les fonctions comtales, voire même s’incarner dans un sceau de type équestre de guerre, montre par ailleurs les limites de telles interprétations35.
La masculinité du pouvoir princier ne saurait en fait se comprendre, sans rappeler qu’au XIIe siècle encore, les fonctions comtales, que l’on considérait parfois comme de véritables consulatus36, demeuraient des magistratures impériales, que la tradition romaine réservait à des hommes. En Savoie, comme en Dauphiné ou en Bourgogne, dans les principautés du vieux regnum Burgundie, les successions princières du XIIe siècle s’effectuèrent donc selon les prescriptions impériales, qui interdisaient qu’une fille puisse recevoir un honneur, tout en autorisant sa transmission à un gendre37. Ces principes successoraux s’adaptaient ainsi à l’ambivalence de ces principautés d’Empire qui, tout au long du XIIe siècle, furent tout à la fois un héritage et un grand commandement public38. En permettant
35 V. l’exemple du sceau de Garsande, comtesse, à titre personnel de Forcalquier, dans L.
BLANCARD, Iconographie des sceaux et bulles conservés dans la partie antérieure à 1790 des Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille-Paris, 1860, t. I, pl. V, n° 2 et les observations de BEDOS-REZAK, Sceaux seigneuriaux et structures sociales en Dauphiné, p. 38-9.
36 MARIOTTE, Le comté de Bourgogne, p. 64. 37 V. sur ce point L. SIZARET, Essai sur l’histoire de la dévolution successorale ab intestat,
du Ve au VIe siècle dans les pays de l’ancienne Gaule romaine, Dijon, 1975, p. 171. 38 Il est ainsi intéressant de constater que les principautés provençales, où le pouvoir
monarchique était bien plus faible, semblent avoir plus facilement accepté la dévolution d’un comté à une femme : au début du XIIIe siècle, Garsande, comtesse de Forcalquier à titre
qu’un gendre puisse prolonger une dynastie tombée en quenouille, la transmission du comté par une femme permettait de préserver les droits du sang. En ne pouvant, au moins formellement, être concédé à une fille, le pouvoir comtal n’en continuait pas moins à s’inscrire dans cette vieille tradition romaine, qui réservait les magistratures publiques à des hommes.
Gardons nous toutefois d’interpréter ces pratiques successorales en termes par trop juridiques. L’ambiguïté même du statut de l’héritière, qui se posait en fait en comtesse inavouée, montre que la dévolution du pouvoir comtal ne relevait pas d’un droit successoral prédéfini, mais s’effectuait plutôt selon un compromis pragmatique, susceptible de garantir les droits contradictoires de l’empereur et des ancêtres. Sans doute, peut-on même considérer que le non-dit et l’ambiguïté constituent les caractéristiques principales de ces successions comtales, qu’il serait anachronique d’interpréter en termes de coutume39.
Si la vieille tradition publique, qui exigeait que le comte fût un homme, constituait un humus propice pour enraciner une coutume d’exclusion des filles, elle ne saurait toutefois en constituer l’origine. Il est au contraire remarquable qu’à la fin du XIIe siècle, les usages successoraux de la maison de Savoie, tels qu’ils apparaissent dans le traité de fiançailles de 1173, étaient en tous points identiques à ceux observés en Dauphiné et en Bourgogne, où des femmes purent exercer les fonctions comtales au XIIIe siècle. Il importe donc de poursuivre cette enquête pour rechercher plus en aval la genèse de la coutume particulière du comté de Savoie.
II) Le destin des héritières à l’âge d’or de la succession testamentaire (1235-
1268)
personnel, se fit même confectionner un sceau équestre au type dit “ de guerre ” (v. BEDOS-REZAK, “ Sceaux seigneuriaux et structure sociale ”, p. 38-9). A l’inverse, le pouvoir comtal était clairement assimilé à une magistrature impériale, comme le montre par exemple le titre de consul qu’utilisaient les comtes de Bourgogne (v. MARIOTTE, Le comté de Bourgogne, p. 64).
39 Sans doute ne faut-il pas accorder trop d’importance à Otton de Freising, lorsqu’il évoque une coutume successorale bourguignonne, pour mieux légitimer l’intervention de Lothaire III en faveur des Zähringen, dans la succession du comte Guillaume l’Enfant († 1127). Otton de Freising dut d’ailleurs reconnaître qu’en l’occurence, la dite coutume n’avait pas été appliquée : Mos in illa [provincia Burgundiae], qui pene in omnibus Galliae provinciis servatur, remansit, quod semper seniori fratri eiusque liberi, seu maribus seu foeminis, paternae haereditatis cedat auctoritatis, caeteris ad illum tanquam ad dominum respicientibus. Ex qua consuetudine factum est, ut Gwillehelmus qui dicebatur puer, huius ex parte patris consanguineus, Conradi vero ducis sororis filius, rerum summam, dum adhuc viveret, illa in provincia haberet. Quo fraude suorum rebus humanis exempto, Reinaldo comiti iure haereditario dominium cessit (MGH, Scriptores, t. XX, p. 413).
En 1190, Henri VI restituait officiellement au jeune comte Thomas les alleux et
les fiefs confisqués à son père Humbert III, mis au ban de l’Empire en 1185 pour avoir refusé de répondre devant la cour impériale de la plainte portée par l’évêque de Turin, tout en retenant ad manum imperii les regalia de l’évêché de Sion40. En 1207, le même Thomas de Savoie recevait, de Philippe de Souabe, l’investiture de feudum suum quod per successionem a suis progenitoribus ad ipsum devolutum erat41. Ces deux diplômes, donnés à 17 années d’intervalle, témoignent de l’évolution du pouvoir comtal : alors qu’en 1185, Humbert III avait encore été proclamé manifestus hostis imperii, avant d’être condamné, selon les vieilles procédures publiques, à la confiscation de universa allodia et feoda que ipse infra fines Romani imperii possidebat, le diplôme de 1207 ne concevait désormais plus les relations entre l’Empire et le comte que dans le cadre du seul droit féodal.
La féodalisation des bénéfices publiques, qui s’imposa définitivement au moment même où les bases régionales de la puissance impériale s’effondraient irrémédiablement, transforma radicalement la conception même du pouvoir comtal, désormais assimilé à un fief héréditaire, dont la dévolution s’exerçait selon des règles de droit privé42. Ces transformations juridiques eurent des conséquentes immédiates puisque, dès la mort en 1233 du comte Thomas, les cadets réclamèrent aussitôt leur part d’héritage, pour la première fois dans l’histoire de la maison de Savoie. Au cours d’une crise qui dura plus de vingt ans, les comtes de la branche aînée furent ainsi contraints à concéder en apanage près du tiers des territoires familiaux43.
Les filles du défunt ne furent pas en reste, puisque Marguerite, qui avait déjà reçu en dot 2000 marcs d’argent en 1218, lors de son mariage avec Hartmann l’Ancien de Kybourg44, obtint en 1239 le château de Monthey, puis le bourg de Saint-Maurice, en prétendant que de bonis patrimonialibus competentem dotem nondum fuerat assecuta45. Le droit des filles à participer à l’héritage paternel
40 Ed. Gallia Christiana, t. XII p. 433-4. Sur la mise au ban d’Humbert III, v. PREVITE-
ORTON, The early history of the house of Savoy, p. 346-51. 41 AST, Diplomi imperiali, mazzo I, n. 1. Sur ce diplôme, v. G. TABACCO, Lo stato sabaudo
nel sacro romano imperio, Torino, Paravia, 1939, p. 9. 42 Sur la succession aux fiefs, v. GIORDANENGO, Le droit féodal dans les pays de droit écrit,
p. 207-10, qui montre qu’elle ne semble pas s’être distinguée de la succession allodiale. 43 Sur ces longs conflits successoraux, v. les exposés détaillés de L. WURSTEMBERGER,
Peter der Zweite, Graf von Savoyen, Markgraf in Italien, sein Haus und seine Land, Bern-Zürich, 1856, 4 vol.; F. COGNASSO, Tommaso I e Amedeo IV , Turin, Paravia, 1941 et COX, The eagles of Savoy.
44 AST, Matrimoni, mazzo I/1, 1. 45 AST, Matrimoni, mazzo I/1, 3.
n’était ainsi pas mis en cause, comme le montre aussi l’arbitrage donné en 1254, pour faire droit aux protestations de Pierre et de Philippe, qui réclamaient toujours un partage égalitaire de la succession du comte Thomas Ier. Alors que les deux cadets exigeaient que l’héritage fût divisé entre les 5 branches issues de Thomas, le représentant du comte leur rétorqua quod, cum pater eius decesserit relictis nouem liberis superstitibus, male petit quintam partem, etiamsi comitatus deberet diuidi, cum mater et sorores sue hereditatem fratrum et patris non repudiauerint46. Jamais le droit des filles à l’héritage comtal n’avait été aussi fortement affirmé, comme si les héritières de rang princier participaient aussi de cette “ renaissance féministe47 ” du début du XIIIe siècle, que l’on pourrait peut-être ainsi interpréter comme une conséquence des transformations politiques et juridiques, qui permirent l’essor des tendances à la division patrimoniale48.
Les principes égalitaires qui s’affirmèrent lors de la succession de Thomas Ier furent toutefois réfrénés par le développement de la succession testamentaire, qui s’imposa dans les terres savoyardes de droit écrit, durant le deuxième quart du XIIIe siècle49. Deux ans après la mort intestat de Thomas Ier, son fils Amédée IV
46 AST, Principi del sangue, mazzo I, 4 et 5 (une édition du premier des deux arbitrages dans
E. USTERI, Westschweizer Schiedsurkunden, Zürich, 1955, n° 64, p. 102-5). 47 M. AURELL, “ La détérioration du statut de la femme aristocratique en Provence (Xe-XIIIe
siècles) ”, dans Le Moyen Age, 1985, p. 5-32, propose de considérer que les années 1180-1230 marqueraient une rupture brutale dans un processus global de détérioration du statut juridique de la femme (périodisation reprise et développée dans id., Les noces du comte. Mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213), Paris, Publications de la Sorbonne, 1995).
48 Sur l’essor des tendances à la division des patrimoines aristocratiques, particulièrement net dans nos régions après 1180, v. G. CASTELNUOVO, L’aristocrazia del Vaud fino alla conquista sabauda (inizio XI-metà XIII secolo), Torino, 1990, (Biblioteca storica subalpina, CCVII), p. 160-72). Particulièrement intéressant est le cas du comté de Genève, récemment étudié par G. DETRAZ, “ Un document inédit : le testament de Raoul, comte de Genève (1265) ”, Chemins d’histoire alpine. Mélanges dédiés à la mémoire de Roger Devos, Annecy, 1997, p. 251-68, qui montre qu’entre la fin du XIIe siècle et l’introduction tardive, en 1265, de la succession testamentaire, qui permit d’imposer la primogéniture mâle, les successions comtales se firent largement selon le principe d’un partage entre les héritiers.
49 Sur la diffusion du testament dans les Etats de Savoie, v. J.F. POUDRET, La succession testamentaire dans le pays de Vaud à l’époque savoyarde (XIIIe-XVIe siècle), Lausanne, 1955; P. DUPARC, “ La pénétration du droit romain en Savoie (première moitié du XIIIe siècle) ”, dans Revue historique du droit français et étranger, 1965, p. 22-86, p. 61-70; R. MARIOTTE-LÖBER, Les chartes de franchises des comtes de Savoie (fin XIIe siècle-1343), Annecy-Genève, 1973 (Memoires et documents publiés par l’Académie florimontane, IV), p. 49-52 et M. PETITJEAN, Essai sur l’histoire des substitutions, du IXe au XVe siècle dans la pratique et la doctrine spécialement en France méridionale, Dijon, 1975. Pour les testaments des comtes de Savoie, v. A.C. GUEX, Volumus et precimus : les testaments des fils du comte Thomas Ier de Savoie (1234-1268), Mémoire de licence, Lausanne, 1993.
testa en 1235, puis en 1238, 1252 et 1253, avant de donner deux derniers codicilles50. Ces testaments permirent à Amédée IV d’instituer un héritier universel afin de protéger les droits de son jeune fils, mais aussi d’éviter que ne se renouvelle la crise ouverte par la mort du comte Thomas Ier, en établissant des clauses de substitution en faveur de ses frères. Chacun d’entre eux était en effet appelé à la succession selon le rang de sa naissance, à l’exception toutefois d’Aymon, qui ne fut pas cité dans le testament de 1235, sans doute parce qu’Amédée IV gardait une certaine rancœur contre ce frère puiné qui était parvenu à s’imposer en Chablais, au terme de la discordia qui avait suivi la mort du comte Thomas.
Les testaments d’Amédée IV
1) 23 septembre 1235 Amédée IV Aymon 2) Thomas Guillaume Pierre Philippe 1) Fils éventuel Béatrice Manfred de Saluces Marguerite Boniface de Montferrat
2) 19 juillet 1238 Amédée IV 2) Thomas Guillaume 4) Pierre 6) Philippe 1) Fils éventuel Béatrice Marguerite 3) Fils éventuel 5) Fils éventuel
3) 19 septembre 1252 Amédée IV 3) Thomas Pierre Philippe Béatrice Marguerite 1) Boniface Béatrice la jeune 4) Fils éventuels 2) Fils éventuels
N.B. : les généalogies donnent les enfants (les filles mariées étant soulignées),
ainsi que les frères du comte vivant (avec en italique les détenteurs d’un siège épiscopal). La numérotation donne l’ordre de succession, selon les clauses de substitution de l’héritier universel.
Amédée IV fut donc soucieux de laisser sa succession à un héritier mâle, allant
même jusqu’à préférer, dans son testament de 1252, son frère Thomas à sa jeune fille Béatrice. Pour autant, le comte de Savoie ne refusa jamais de reconnaître le
50 AST, Testamenti, mazzo I, 2, 3, 5 et 6. Ces testaments ont fait l’objet d’éditions, parfois
médiocres, de GUICHENON, Histoire généalogique de la maison de Savoie, p. 67-9 et WURSTEMBERGER, Peter der Zweite, t. IV,
droit théorique des filles à recevoir la succession paternelle51. En décembre 1235, trois mois après avoir testé en faveur de son frère Thomas (II), Amédée IV dut d’ailleurs composer avec ses gendres, qui avaient pourtant déjà reçu une dot, en s’engageant à leur laisser ses territoires italiens, s’il devait mourir sans laisser de fils52. Dans son testament de 1252, il reconnut aussi le droit de ses filles à avoir une part d’héritage, même si le principe d’exhérédation des filles dotées permettait de la limiter à une dot monétaire53.
Plus délicat fut toutefois le problème de la petite Béatrice, trop jeune pour avoir pu être mariée avant le décès de son père en mai 1253, puisqu’elle était issue des secondes noces qu’Amédée IV avait contractées avec Cécile des Baux en décembre 1243. Soucieux de ne pas laisser derrière lui une fille non dotée, susceptible de transmettre des droits sur le comté à son futur époux, le comte de Savoie avait réglé la question, en 1252, en ordonnant que la jeune Béatrice entre au monastère du Betton, pour prier sur la tombe de son père qui avait choisi d’y être enterré54. Cécile des Baux, soucieuse de protéger les intérêts de sa fille, avait tout juste pu arracher, de son époux à l’agonie, un dernier codicille qui accordait généreusement à Béatrice la somme de 100 sous pour qu’elle entre au Betton55. Le
51 Les principes du testament d’Amédée IV semblent d’ailleurs se retrouver dans celui que son
frère Thomas (II) donna en 1248. Grâce aux très nombreuses clauses de substitution, il apparaît que, comme son frère, Thomas privilégiait une succession pour un mâle, sans toutefois exclure totalement une transmission de son héritage à une fille : si non esset masculus proximorem filiam ei substituo (AST, Testamenti, mazzo I, 4, éd. GUICHENON, Histoire généalogique de la maison de Savoie, Preuves, p. 92-3).
52 AST, Saluzzo, cat. IV, mazzo 1. L’acte est rédigé sous la forme d’une donation avec réserve d’usufruit (pour la date, qui pose problème, v. WURSTEMBERGER, Peter der Zweite, t. IV, n° 105-6, p. 53). Si la charte est concédée aux gendres d’Amédée IV, la donation était toutefois destinée à la descendance en ligne féminine du comte de Savoie, qui se réservait la possibilité de redistribuer ultérieurement, entre les deux marquis, les terres concédées, si l’une de ses filles n’avait pas de descendance. En outre, par un autre acte donné le même jour, Boniface de Montferrat dut donner à sa femme, à titre d’augmentation de douaire, la dot que le comte Thomas avait concédée au marquis, lors de son mariage, en 1228 (AST, Matrimoni, mazzo II, fasc. 1, 1/2).
53 Beatricem uero filiam meam, uxorem quondam Manfredi marchionis Saluciarum, et Margaritam filiam meam, uxorem Bonifacii marchionis Montisferratis, in heredes instituo in dotibus quas pro ipsius dedi ... in quibus dotibus uolo et precipio ipsas filias meas esse contemptas de bonis meis, ita non amplius non petant uel requerant aliquid in bonis meis.
54 Volo et precipio quod Beatrix filia mea minor intret monasterium Bittuminis et ibidem sit monialis et pro ipsa ibidem recipienda et sepultura mea et pro remedio anime mee et parentum meorum dono et lego domnui Bittuminis, ubi sepulturam meam eligo et sepeliri uolo, omnia vaysalamenta mea aurea et argentea et omnes anulos meos et omnia monilia mea et ioeria (AST, Testamenti, mazzo I, 5, éd. GUICHENON, Histoire généalogique de la maison de Savoie, p. 69-70)
55 AST, Testamenti, mazzo I, 6.
décès d’Amédée IV permit toutefois à Cécile des Baux, qui exerçait la régence du jeune comte Boniface, de préserver sa fille, qui demeura auprès de sa mère.
La mort du jeune comte Boniface, au printemps 126356, posa de nouveau le problème de Béatrice, puisque l’un des tout premiers actes que fit rédiger le comte Pierre à son avènement fut un vidimus, donné le 14 juin 1263, du codicille d’Amédée IV qui ordonnait que Béatrice entrât eu Betton57. Sans jamais parvenir à ses fins, Pierre semble avoir exigé que sa nièce se fasse moniale, comme le montrent les doléances que Béatrice devait présenter en octobre 1268, lorsqu’elle rappelait que nondum ab illustri uiro bone memorie domino Petro comite Sabaudie qui me dotasse debuerat nec ab aliis parentibus meis uel amicis ullum dotis beneficium recepissem58. Lorsqu’en mai 1268, Philippe succéda à Pierre, il se résolut à marier Béatrice, en prenant toutefois la précaution de la donner à un homme de confiance, son propre beau-frère Pierre le Bouvier. Il exigea aussi que Béatrice, qui portait désormais le surnom révélateur de Contessons, lui concédât, par une donation entre vivants du 21 octobre 1268, la totalité de ses droits sur la succession des comtes Amédée IV et Boniface59. Sans doute, Philippe trouva-t-il l’acte encore trop imprécis, puisqu’il contraignit Béatrice à renouveler trois jours plus tard sa donation, en insérant une clause supplémentaire, par laquelle elle reconnaissait avoir été dotée60.
Les inquiétudes que soulevèrent l’éventuel mariage de Béatrice montrent donc en négatif que, dans les années 1260, la cour de Savoie considérait qu’une fille pouvait transmettre des droits sur le comté de Savoie à son éventuel époux. Le comte Pierre alla même plus loin puisqu’en 1264, dans le premier testament qu’il
56 Sur le problème de la datation de la mort de Boniface, v. WURSTEMBERGER, Peter der
Zweite, t. I, p. 553. 57 AST, Testamenti, mazzo I, 6 (vérifier) 58 AST, Matrimoni, mazzo II, fasc. 3, 6/4. 59 Ego Beatrix dicta Contessons... dono cedo et concedo perfecta donatione inter viuos et
irreuocabili illustri viro domino Philippo nunc comiti Sabaudie et Burgundie patruo meo et eiusdem heredibus sive successoribus ius quod habeo, possum, uel habere debeo, in comitatu Sabaudie et pertinentis eiusdem, tam ex successione predicti domini Amedei patris mei quam ex successione Bonifacii fratris mei quondam filii ipsius patris mei vel alia quacumque causa (AST, Matrimoni, mazzo II, fasc. 3, 6/3).
60 Hanc autem donationem, cessionem et concessionem facio dicto domino Philippo [...] confiteor vel recognosco quod cum aliis beneficiis mihi ab ipso illatis ipse solus ad preces meas et domine Cecilie karissime matris mee matrimonio copulari procurauit cum dicto Petro Bouerio viro meo et de suo proprio in suma sex milium librarum viennensis me dotauit (AST, Matrimoni, mazzo II, fasc. 3, 6/4).
donna en tant que comte, il prévoyait même de léguer le comté de Savoie à sa nièce Eléonore, épouse du roi d’Angleterre Henri III61.
Testament de Pierre de septembre 1264
Raymond-Bérenger Béatrice Thomas Béatrice Fieschi Pierre 2) Philippe † 1259 1251 1) Eléonore Henri III 3) Thomas (III)62 4) Amédée 5) Louis Béatrice Guigues VII
Le testament de septembre 1264 mérite une attention toute particulière, car
quelles que soient les circonstances politiques qui peuvent expliquer que le comte Pierre ait légué son comté à Eléonore, alors qu’il s’apprêtait à participer à l’ost levé pour réduire l’insurrection baroniale de Simon de Montfort63, ces dispositions introduisaient un précédent remarquable puisque, pour la première dans l’histoire de la maison de Savoie, une femme était destinée à relever le pouvoir comtal. Le fait est d’autant plus remarquable que le vieil interdit, qui empêchait une femme d’être investie de la puissance comtale, demeurait encore très présent dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Dans le Dauphiné voisin, ce ne fut ainsi qu’au prix de grandes difficultés, qu’Anne parvint à relever l’héritage de son frère, le dauphin Jean, mort en 1281, puisque le duc Robert II avait revendiqué la succession, arguant qu’un fief impérial ne pouvait revenir à une femme. Si Robert II ne put se maintenir, son bon droit était toutefois suffisamment établi, pour que le roi Rodolphe de Habsbourg ait pu l’investir du Dauphiné en 1284, avant qu’en février 1286, Anne ne lui concède en échange d’une renonciation à ses droits, les terres du Revermont de son époux Humbert de la Tour du Pin64. Alors que la guerre de
61 AST, Testamenti, mazzo I, 11. Sur ce testament, v. dans ce volume la contribution de B.
ANDENMATTEN. 62 Si, après le décès d’Eléonore, l’héritage revenait à Philippe, une clause stipule qu’il pourrait
alors ne pas remettre nécessairement l’héritage au premier-né, mais illi de filiis dicti fratris nostri qui videbitur sibi utilior et convenentior.
63 Sur la participation de Pierre à l’ost de 1264, v. WURSTEMBERGER, Peter der Zweite, t. II, p. 375-412 et COX, The eagles of Savoy, p. 305-18, ainsi que les travaux sur les Savoie et la maison d’Angleterre de F. MUGNIER, “ Les Savoyards en Angleterre au XIIIe siècle ”, dans Mémoires et documents de la société savoisienne d’histoire et d’archéologie, 1890, p. 153-76; et J.P. CHAPUISAT (avec aussi sa contribution à ce volume).
64 V. J. RICHARD, “ L’accession de la maison de la Tour au Dauphiné de Viennois : la guerre bourguignonne de 1283-1285 ”, dans Bulletin philologique et historique, années 1951-1952, 1953, p. 249-63 et GALLAND, Deux archevêchés entre la France et l’Empire, p. 525-6.
succession dauphinoise de 1283-1285 devait démontrer que le pouvoir comtal ne pouvait encore que difficilement échoir à une femme, les dispositions savoyarde de 1264 peuvent donc être considérées comme remarquablement novatrices65.
Dans ces conditions, il peut paraître bien paradoxal que Pierre, qui fut le premier comte de sa dynastie à songer à laisser sa succession à une femme, n’ait jamais pensé à léguer son comté à sa propre fille. En 1264, Pierre n’avait en effet laissé à Béatrice que le seul comté anglais de Richemond, qui se trouvait alors sous le contrôle des barons révoltés. Sans doute se montra-t-il plus généreux, dans le testament qu’il donna le 7 mai 1268 à l’article de la mort, puisqu’il y institua Béatrice heredem nostram... in tota terra nostra quam habemus in Gebennesio et in Uuaudo, tout en réservant l’héritage du comté de Savoie à son frère Philippe66. Toutefois, dans un dernier codicille, dicté le 14 mai par un comte à l’agonie, il décida de revenir sur ces dispositions pour, ad pacem tranquillitatem et concordiam successorum meorum et tocius Sabaudie comitatus, ne léguer finalement à Béatrice que quelques biens en Genevois67.
Si le comte Pierre considérait donc que sa fille pouvait légitimement prétendre à une part au moins de ses terres personnelles, il semble avoir en revanche totalement écarté l’idée qu’elle pût aussi prétendre au comté de Savoie. Béatrice paraît d’ailleurs avoir admis aisément ce principe, puisqu’elle ne semble pas avoir contesté la succession de son père, avant que le comte Philippe ne tente, en août 1268, de lui arracher l’héritage de sa mère, Agnès de Faucigny68. Dès lors, dans le contexte de la petite guerre de Cent ans, qui allait désormais opposer, jusqu’en 1355, le Dauphiné à la Savoie, Béatrice put parfois utiliser les armes de son père et le titre de filia et heres felicis recordationis illustri viri domini Petri quondam comitis Sabaudie, mais elle ne prit jamais le titre ni les armes du comté de Savoie69.
65 Intéressant sont, à titre de comparaison, le comté de Genève où, mourant en laissant deux
filles mineures, le comte Aimon II testa en faveur de ses filles, tout en laissant la possibilité à ses exécuteurs testamentaires de leur substituer un de ses frères, ce qui fut aussitôt fait (v. P. DUPARC, Le comté de Genève, Genève, 19782 (Mémoires et documents publiés par la société d’histoire et d’archéologie de Genève, t. XXXIX), p. 191-2).
66 AST, Testamenti, mazzo I, 16, éd. WURSTEMBERGER, Peter der Zweite, t. IV, n° 749, p. 431-6.
67 AST, Testamenti, mazzo I, 14 (v. la contribution dans ce volume de B. ANDENMATTEN). 68 V. le pacte conclu le 12 août, au lendemain de la mort d’Agnès qui avait testé le 9 pour
Béatrice, entre le comte Philippe et Béatrice de Thoire-Villars pro recuperatione partis terre Fuciniaci (éd. WURSTEMBERGER, Peter der Zweite, t. IV, n° 765, p. 444).
69 Pour cette titulature, qui apparaît en juin 1282, v. WURSTEMBERGER, Peter der Zweite, t. IV, n° 845, p. 475-80 . De cette époque date sans doute le 3e sceau de Béatrice (reproduit dans L. CIBRARIO e D. PROMIS Sigilli della Monarchia di Savoia, Torino, Stamperia reale, 1833, pl. VI, n° 23), avec un type armorial à la croix et en légende :+ S. BEAT(ri)CIS∴ FILIE∴ PET(ri)∴
En se réclamant de son père, Béatrice ne cherchait en fait qu’à se voir garantir la possession de son héritage maternel du Faucigny, comme le montre d’ailleurs cette étrange légende de filia Petri comitis Fauciniaci, qu’elle fit graver sur son sceau70. Sans doute ne faut-il donc pas accorder trop d’importance à l’arbitrage de 1308, par lequel Guigues VIII renonça à tout droit sur le comté de Savoie, puisque les Dauphinois, qui avaient selon l’usage habituel présenté des prétentions considérablement amplifiées, n’avaient en fait jamais réclamé que le Valais et le Chablais71. Ainsi, même au plus fort du conflit entre la Savoie et le Dauphiné, les deux parties semblent donc avoir toujours admis que Béatrice ne pouvait prétendre à la succession au comté de Savoie.
Il serait toutefois erroné d’interpréter cette exclusion de Béatrice comme la conséquence de la mise en place d’une coutume d’exhérédation des filles, puisqu’elle intervint précisément au moment où l’idée d’une possible transmission du pouvoir comtal à une femme commençait à s’imposer en Savoie. Il est tout aussi difficile de considérer qu’en tant qu’épouse du Dauphin, qu’un antagonisme séculaire opposait aux comtes de Savoie, Béatrice ne pouvait faire valoir ses droits sur l’héritage comtal de son père, car cette explication ne saurait rendre compte de l’attitude des Dauphinois, qui auraient pu au moins émettre quelques prétentions formelles, ne serait-ce que pour obtenir quelque profitable dédommagement. Il me semble en fait que les clefs de la succession de 1268 doivent être cherchées dans les conditions de l’avènement du comte Pierre, qui avait succédé à son jeune neveu Boniface, décédé dans des circonstances dramatiques, lors de l’échec d’une expédition savoyarde contre Turin.
En recevant en 1263 la succession de Boniface, Pierre avait en fait devancé les fils de son frère aîné Thomas (II), décédé en 1259, ce qui contrevenait manifestement aux testaments donnés en 1252 et 1253 par Amédée IV. Les historiens de la maison de Savoie ont donc toujours plus ou moins conclu que Pierre, puis Philippe en 1268, avaient spolié leurs neveux, par un véritable coup de force. Toutefois, l’hypothèse d’une véritable usurpation semble bien peu crédible, car il n’existe aucune trace de la moindre protestation des fils de Thomas (II) qui, par leur mère, Béatrice Fieschi, auraient certainement pu trouver dans leur parenté
COMITIS∴ S(abaudie)., qui apparaît dans un acte de 1287 (AST, Traités anciens avec la France, I, 18). Ces prétentions doivent être replacées dans le contexte de la crise dynastique qui suivit la mort de Thomas (III) et de la constitution de la grande ligue anti-savoyarde.
70 + S BEAT(ri)CIS FILIE. COMITIS FAUCI(niaci). Empreinte appendue sous une charte de 1279 (ADHS, Duché de Genevois, SA 63, 24) avec, comme seule reproduction, le dessin fautif de CIBRARIO e PROMIS, Sigilli della Monarchia di Savoia, pl. VI, n° 22.
71 AST, Principi del sangue, mazzo III, 6.
maternelle un champion disposé à défendre leur cause72. Sans doute, peut-on donc considérer qu’au moment où le comté de Savoie, qui avait déjà connu une régence de presque 10 ans, traversait une crise particulièrement difficile, après qu’un comte inexpérimenté eut conduit les troupes savoyardes au désastre, un consensus s’était établi pour confier le pouvoir comtal à un homme mûr, qui avait déjà fait ses preuves sur les champs de bataille de tout l’Occident chrétien, en attendant que les fils de Thomas (II) aient atteint l’âge adulte.
Cette interprétation permettrait d’ailleurs de comprendre que, tout au long de son principat, le comte Pierre ait manifesté une sollicitude toute paternelle pour ses neveux, qu’il considéra toujours comme ses futurs successeurs. En 1264, il n’avait ainsi légué le comté à Eléonore, qu’en précisant qu’elle ne pourrait en aucun cas le transmettre à sa descendance, mais devrait le léguer à Philippe et, après lui, aux fils de Thomas (II)73. Dans son testament du 7 mai 1268, il renouvelait ces dispositions en précisant que si Philippe n’avait pas d’héritier mâle, il devrait laisser le comté à ses neveux, qu’il avait par ailleurs déjà dotés en Angleterre et en Piémont74. La possibilité laissée à Philippe de transmettre le comté à ses descendants mâles était d’ailleurs toute théorique, puisque le frère cadet de Pierre, qui avait certainement dépassé les 50 ans, venait d’épouser en premières noces la comtesse douairière Alice de Bourgogne75, désormais trop âgée pour pouvoir espérer une nouvelle naissance76. Si Pierre mourut en laissant son comté à Philippe, il n’en considérait
72 V. COX, The eagles of Savoy, p. 304, qui constate que la seule trace d’opposition à Pierre
provint de Béatrice des Baux, la mère de Boniface, que le nouveau comte contraignit à renoncer à une part de son douaire.
73 Si uero contingat quod dicta domina regina, nobis quod absit superstitibus, decederet, vel post decessum nostrum, quandocumque licet non ignoremus ipsam habere liberos, volumus tamen quod totus comitatus Sabaudie et totum illud in quo ipsam heredem instituimus, sine retractione [...] perveneat et deuoluatur ad dilectem fratrem nostrem Philipum [...] Quod si non superesset, volumus quod eodem modo pervenit et deuoluatur ad nepotem nostrum primogenitum filium comitis Thomas quondam fratris nostri, vel ad eum qui post eum natus est, primogenito non superstite, ad minorem natum aliis non superstitibus. Et si ad Philippum [...], volumus... ea omnia restituat illi de filiis dicti fratris nostri qui videbitur sibi utilior et convenentior ad dicta bona iure hereditaris obtninenda. (AST, Testamenti, mazzo I, 12).
74 In comitatu autem Sabaudie et in aliis bonis tam ultra Montes quam citra, [...] heredem nostrum facimus et instituimus carissimum fratrem nostrum, Philippum de Sabaudia [...] et si ipsum [...] decedere contigeret sine liberis masculis quandocunque substituimus eidem in predicto comitatu et omnibus aliis, predictos nepotes nostros, uel ipsorum alii superstiti (AST, Testamenti, mazzo I, 16).
75 V. B. GALLAND, “ Un savoyard sur le siège de Lyon au XIIIe siècle, Philippe de Savoie ”, dans Bibliothèque de l’Ecole des chartes, 1988, p. 31-67.
76 Alice avait ainsi été mariée à Hugues de Chalon en 1231, mais elle ne lui fut remise qu’en 1236, lorsqu’elle fut jugée nubile, sans doute à l’âge habituel de 13 ans. Il semble donc qu’elle
donc pas moins que cet héritage devait revenir à ses neveux, auxquels il songea dans ses derniers instants, puisque le 11 mai 1268, il envoyait une dernière lettre patente pour demander à Eléonore et Henri de prendre sous leur protection les fils de Thomas (II)77.
Le comte Philippe semble d’ailleurs avoir toujours renoncé à fonder sa propre dynastie, puisque cet homme sans descendance avait épousé en 1267 une femme ménopausée et ne chercha pas à se remarier lorsqu’il se trouva veuf en 1269. Une fois devenu comte, il manifesta toujours une attention toute paternelle pour ses neveux, en particulier pour l’aîné Thomas (III) qui, dès 1270, portait les armes de son oncle78, dont il épousa en 1274 la belle-fille79, avant de donner en un geste de piété filiale le nom de Philippe à son premier-né.
Tout indique donc que Pierre et Philippe n’ont assumé le pouvoir comtal qu’en attendant que leurs neveux aient un âge suffisant pour être aptes à recevoir à leur tour le comté. Cette hypothèse permettrait d’ailleurs de mieux comprendre l’attitude de Pierre, qui ne prit que la sobre titulature de comes Sabaudie, sans y adjoindre le titre marquisal habituel80, et ne se fit jamais confectionner un sceau comtal, se comportant ainsi en régent plus qu’en comte81. Sans doute, faut-il donc conclure que la soi-disant exclusion de Béatrice n’est que le résultat d’une mauvaise compréhension de la stratégie dynastique savoyarde : comme Eléonore en 1264 ou Philippe en 1268, Pierre n’était pas destiné à faire souche, mais n’exerça le pouvoir comtal qu’à titre personnel, en attendant que ses neveux soient en âge de recevoir le comté qui leur était dû.
Lorsqu’avec le temps, les principes complexes, qui avaient permis les successions collatérales de 1263 et de 1268, finirent par être totalement oubliés,
soit née vers 1223, ce qui signifierait qu’elle avait environ 44 ans lorsqu’elle se remaria avec Philippe, à un âge auquel une femme du XIIIe siècle n’avait plus d’espoir de fécondité.
77 AST, Principi del sangue, mazzo I, 9. 78 L. DOUET D'ARCQ, Collection de sceaux, Paris, Plon, 1863-1868, n° 11669. 79 AST, Matrimoni, 4, 9/1-3. 80 V. les remarques de B. ANDENMATTEN, dans sa contribution à ce volume. 81 Seul GUICHENON, Histoire généalogique de la maison de Savoie, p. 123, attribue un grand
sceau équestre à Pierre, qui proviendrait de la prestation d’hommage de Rodolphe de Gruyère en 1263. Il en donne d’ailleurs une reproduction assez fantaisiste, puisqu’elle comporte par exemple un cimier à l’aigle bien anachronique. Sans doute ne s’agit-il en fait que d’une empreinte de Philippe, attribuée par erreur à Pierre, qui a peut-être été apposée ultérieurement sous la charte de 1263. Tous les actes comtaux de Pierre furent en fait toujours scellés avec son petit sceau personnel au type armorial au lion, avec comme seule légende +: S': PETRI: DE/: SABAUDIA: (reproduit dans D.L. GALBREATH, Sigilla agaunensia. Les sceaux des archives de l’abbaye de St-Maurice d’Aguane en Valais, antérieurs à 1500, Lausanne, 1927, pl. IV, n° 17 (extrait des Archives héraldiques suisses, 1925, p. 1-16; 57-63 et 136; 1926, p. 8-17; 57-69 et 97-109).
l’avènement de Philippe fut considéré comme un précédent fondateur, susceptible de justifier l’exhérédation des filles. Toutefois, dans l’immédiat, la succession de Pierre n’eut aucune influence sur le droit dynastique. Ainsi, en 1273, Eléonore, fille de Thomas (II), renonçait au profit de ses frères Thomas et Amédée, qui l’avaient dotée, à ses droits sur l’héritage paternel, mais aussi à tout ce qui ad eam spectare posset in toto comitatu Sabaudie82. Cinq ans après la succession du comte Pierre, une fille pouvait toujours prétendre à un héritage dans le comté de Savoie, à moins qu’elle n’y ait renoncé, lorsqu’elle reconnaissait avoir reçu sa dot. L’avènement de Philippe n’avait donc rien changé et la maison de Savoie continuait à se réclamer du droit successoral commun.
III) Naissance de la coutume d’exclusion des filles (1282-1343)
Toute la belle construction dynastique, qui devait aboutir à restituer à Thomas
(III) le comté que son père Thomas (II) n’avait pu relever, fut toutefois réduite à néant par un inattendu coup du sort. A la mi-mai 1282, dans la fleur de l’âge, Thomas (III) mourait brutalement, en testant pour Philippe83, l’aîné de ses 5 fils, que le comte Philippe de Savoie ordonnait aussitôt de reconnaître comme son propre fils, dans une lettre patente donnée le 11 juin84. Amédée et Louis, les frères cadets de Thomas (III) ne l’entendaient toutefois pas ainsi et revendiquèrent aussitôt l’héritage de leur oncle. La situation était d’autant plus confuse que Béatrice et les Dauphinois, qui revendiquaient toujours les possessions du comte Pierre, profitèrent des difficultés savoyardes pour lancer une offensive de grande envergure avec le soutien de Rodolphe de Habsbourg et du comte Amédée II de Genève85.
82 Ed. DATTÀ, Storia dei principi di Savoia del ramo d’Acaia, t. II, n° VI, p. 16-9. 83 AST, Testamenti, mazzo I, 19. L’obituaire d’Hautecombe affirme que Thomas mourut le 30
avril 1282 (éd. D. PROMIS, dans Monumenta Historiæ Patriæ, Scriptores, t. I, col. 671-5, col. 674), mais cette date n’est guère crédible puisque Thomas (III) testa le 14 mai 1282.
84 AST, Principi del sangue, mazzo I, 14. 85 Sur ce conflit, v. WURSTEMBERGER, Peter der Zweite, t. III, p. 404-17; FOURNIER, Le
royaume d’Arles, p. 255-68; RICHARD, “ L’accession de la maison de la Tour au Dauphiné ”; DUPARC, Le comté de Genève, p. 194-207 et COX, The eagles of Savoy, p. 444-51.
Les héritiers du comte Philippe Hugues de Chalon Alice de Bourgogne Philippe Thomas (II) Béatrice Fieschi † 1266 † 1279 † 1285 † 1259 † 1283 1236 1267 1251 Guyette Thomas (III) Amédée V Louis † 1282 1274 Philippe Pierre Thomas Amédée Guillaume
Attaqué sur plusieurs fronts, le comte Philippe ne pouvait désormais se
permettre de s’opposer à Amédée et Louis, qui étaient seuls à même de faire face au péril militaire, et lui fallut donc renoncer à soutenir les fils de Thomas (III). Malade et vieillissant, le comte Philippe n’était en fait plus en mesure de faire prévaloir son autorité sur Amédée et Louis, qui commençaient déjà à se disputer sa succession86. Dès le mois de janvier 1283, les deux frères demandaient l’arbitrage de la reine Marguerite de Provence, puis faisaient appel au duc Robert II de Bourgogne, tandis que Philippe confiait à Eléonore et Edouard Ier le soin de règler sa succession87.
Philippe mourut en août 1285, sans avoir sans doute jamais donné un testament, comme s’il avait renoncé à organiser sa propre succession. Au terme d’un conflit militaire, Amédée parvint toutefois à s’imposer, pour devenir le nouveau comte Amédée V, mais en 1286 il lui fallut toutefois concéder en apanage le pays de Vaud à son frère Louis88. Le conflit n’était cependant pas terminé, puisque Louis et ses héritiers continuèrent, jusqu’en 1314, à réclamer le tiers de l’héritage du comte défunt89. Les difficultés de la branche comtale étaient d’autant plus importantes que, sitôt devenu adulte, Philippe, le fils évincé de Thomas (III), revendiqua le
86 Dès 1270, Thomas (III) et son frère Amédée, alors que la maladie empêchait Philippe de
gouverner, concluaient les termes d’un accord avec Béatrice, qui devait s’appliquer si le comte décédait des suites de sa maladie (v. L. CIBRARIO, Storia della monarchia di Savoia, Torino, 1841, t. II, p. 152-3).
87 AST, Principi del sangue, mazzo I, 15 et 16; RYMER, Fœdera, conventiones, litteræ, t. I, pars II, p. 290-1 et 312-3.
88 AST, Principi del sangue, mazzo I, 19bis, éd. USTERI, Westschweizer Schiedsurkunden, n° 182, p. 285-98.
89 V. l’arbitrage du 21 août 1314, conclu entre Amédée V et Louis II de Vaud, super eo quod idem dominus Ludouicus dicebat et asserebat ad ipsum pertinere jure successionis agnationis pro tercia parte comitatum Sabaudie et baroniam et honorem de dicti comitatus (AST, Principi del sangue, mazzo III, 15).
comté de Savoie et ne renonça à ses droits qu’en 1313, lorqu’Amédée V lui concéda un apanage substantiel en Piémont90.
Si confuse et complexe que soit la crise provoquée par la succession du comte Philippe, il convient de constater qu’elle apporta au moins deux éléments nouveaux. D’une part, le droit du comte à disposer de sa succession fut sérieusement mis en cause, comme le montre l’incapacité du comte Philippe à imposer sa liberté testamentaire. D’autre part, jamais, semble-t-il, le corps politique n’avait été aussi impliqué dans ces querelles familiales, comme le montre par exemple cette assemblée de la noblesse piémontaise, rassemblée le 24 mai 1286 à Giaveno, devant laquelle le vicaire comtal fit lire des lettres de Louis et de la comtesse Guyette, qui demandaient à leurs partisans de reconnaître l’autorité d’Amédée V91. En ce sens, la crise provoquée par la mort prématurée de Thomas (III) témoigne des transformations du pouvoir comtal, dont la dévolution échappait à l’arbitraire princier pour devenir désormais une question qui impliquait l’ensemble de la communauté politique.
Cette évolution du pouvoir dynastique ne pouvait rester sans effet sur la dévolution du pouvoir comtal, comme le montre la brutale apparition des premières références à une coutume successorale. Le 14 mai 1282, Thomas (III) ordonnait ainsi dans son testament que son premier-né Philippe pourvoie aux besoins de ses frères secundum bonos usus et bonos mores siue bonam consuetudinem comitatus Sabaudie per ipsius comitatus comites hactenus obseruatos92. Le 11 juin 1282, le comte Philippe avait aussi repris cette clause, en reconnaissant comme son successeur le fils premier-né de Thomas (III), reseruatis congruatis porcionibus aliorum secundum bonos usus et consuetudines comitatus93. La liberté testamentaire se trouvait désormais encadrée par les consuetudines comitatus, qui imposaient au comte d’organiser sa succession selon les précédents déjà observés. L’ordre dynastique devait ainsi s’inscrire dans une coutume immuable, où la communauté politique pouvait trouver le fondement de sa propre continuité.
90 V. l’arbitrage du 20 octobre 1313 : dicti Philippus dominus, Petrus, Amedeus [...] dicebant
et asserebant ad ipsos et ad dictos fratres suos totum comitatum Sabaudie etiam eius pertinenciis et appendiciis pertinere et pertinere debere occasione successionis predicti patris eorum ad quem dicebant dictum comitatum cum suis pertinenciis tamquam primogenitum pertinere et pertinere debere. (AST, Principi del sangue, mazzo II, 4).
91 AST, Principi del sangue, mazzo I, 20 (éd. DATTÀ, Storia dei principi di Savoia del ramo d’Acaia t. II, n° VIII, p. 20-23).
92 AST, Testamenti, mazzo I, 19. 93 AST, Principi del sangue, mazzo I, 14.
Cette notion de coutume, qui n’apparaissait timidement que pour rappeler la nécessité de pourvoir aux cadets, reçut bien vite d’autres applications. Dès 1294, le comte de Savoie imposa ainsi à son neveu Philippe de s’engager à prêter hommage prefato domino comiti et ejus heredi quem sibi faciet uel instituet in comitatu Sabaudie uel si heredem non instituerit primogenito filio ipsius domini comitis tunc uiuenti94. En établissant ainsi qu’en cas de décès intestat, la succession au comté parviendrait au premier-né des fils vivants, le comte Amédée V posait en fait, comme un principe de droit commun, l’absence de toute possibilité de représentation d’un héritier décédé. Le coup de force de 1282-1285 avait ainsi établi un précédent fondateur, qui devait dorénavant s’imposer à tous.
La liberté testamentaire du comte devenait ainsi des plus restreintes, comme le montrent les difficultés que rencontra Amédée V, lorsqu’il voulut instaurer un droit éventuel de représentation en faveur des fils de son premier-né. En septembre 1307, alors que le comte mariait à Paris son aîné Edouard à Blanche de Bourgogne, il annonça par lettres patentes qu’il s’engageait à laisser son héritage au premier-né mâle qui naîtrait de cette union, même s’il devait advenir qu’Edouard mourût avant lui95. Pour autant, Amédée V était si peu sûr de lui, qu’il prit la précaution de doter cet héritier mâle, au cas où il ne pourrait recevoir la succession comtale96. La seule volonté comtale s’avérait insuffisante pour modifier l’ordre successoral puisque, après son retour en Savoie, Amédée V fit tenir une assemblée de nobles savoyards, afin de leur faire jurer quod dictus dominus Eduardus post decessum ipsius domini comitis erit comes Sabaudie et eiusdem dominum Eduardum et primogenitum superstitem filium predictum heredebunt pro domino et pro comite et eisdem successione et suis successoribus masculis primogenitis superstitibus97. La succession comtale ne s’organisait plus selon ces testaments donnés dans les châteaux comtaux, mais devait dorénavant être confirmée en place publique par le serment du corps politique, qui s’imposait ainsi comme le garant de la coutume dynastique
94 AST, Principi del sangue, mazzo II, 11. 95 In casu quod nos prius decederemus quod dilectus Edduardus primogenitus noster [...]
teneat, habeat et possideat comitatum Sabaudie et si dictus Edduardus prius decederet et habeat heredes masculos de Blancha filia bone memorie R. ducis Burgundie promittimus [...] quod dictus heredes masculus successiue habeat, teneat et possideat predictum comitatum (AST, Testamenti, mazzo I, 24).
96 Amédée V institue une dotation de 10 000 livres sur les terres de Revermont et de Bauges, in casu in quo contingeret quod absit, quod filius masculus eiusdem Edduardi uel filiorum masculorum filii successiue comitatum Sabaudie heredere et tenere non posset (AST, Testamenti, mazzo I, 24).
97 AST, Principi del sangue, mazzo III, 4.
Alors que les aléas historiques, qui avaient déterminé la succession comtale au cours du XIIIe siècle, étaient désormais considérés comme des précédents fondateurs de coutume, la succession du comte Pierre, qu’actualisaient les prétentions toujours pendantes des héritiers de Béatrice, tendait naturellement à introduire le principe d’exclusion des filles. Sans jamais exhéréder formellement une héritière ou un heritier en ligne féminine, les actes testamentaires donnés sous le principat d’Amédée V affirmèrent tous que le comté de Savoie ne pouvait revenir qu’à un homme ou à un héritier en ligne masculine, comme s’il s’agissait là d’un lieu commun. Ce principe de masculinité s’étendait aussi aux apanages du comté de Savoie, puisqu’en 1300, Philippe, le fils aîné de Thomas (III), testa en faveur de ses fils ou de leurs héritiers mâles, excluant de sa succession ses trois filles, qu’elles aient ou non été déjà dotées98. La branche vaudoise de la maison de Savoie se réclamait aussi de ces mêmes principes, puisqu’il fallut une autorisation exceptionnelle du comte Aymon, pour qu’en 1341, Louis II puisse transmettre son apanage à sa fille unique99. La masculinité coutumière de la maison de Savoie était dorénavant suffisamment affirmée, pour qu’en 1313 l’empereur Henri VII ait donné le comté d’Asti à Amédée V et eius legitimis heredibus de suo corpore per masculinam lineam ex Mariam uxore sua et sorore nostra predilecta nascituris100.
A la fin du principat d’Amédée V, le droit des filles à recevoir la succession comtale se posa d’ailleurs avec acuité, puisque l’union d’Edouard et de Blanche de Bourgogne était demeurée stérile, après la naissance d’une Jeanne. Inquiet de voir son premier-né incapable d’engendrer un héritier mâle, Amédée V avait alors décidé qu’en l’absence de fils, le comté reviendrait à Aimon, le frère d’Edouard. Il établit alors une convention, qu’Edouard confirma en mars 1324, quelques mois après avoir succédé à son père :
Item voulons que sil defailloit dudit Edduard sanz hoir masle de son cors que la conte de Sauoie ensamble ses appartenances apartiengne et doive appartenir audit Ayme apres de nous et que la fille que le diz Edduard et autres filles si elles restoient de li fusseint mariees en argent selonc lour estat bien et noblement et selon la maniere des convenances qui furent faites ou temps du mariage Edduard et se il estoir ainsi que le diz Edduars eust autres filles dautre feme de loyal mariage nous uoulons aussi que elles soient mariees en argent bien et soufisent selonc lour estat. Et si il estoit ainsi que le diz Ayme deffaillit sanz hoir masle nous voulons que se il avoit filles que elles soient mariees en
98 AST, Testamenti, mazzo I, 25, éd. GUICHENON, Histoire généalogique de la maison de
Savoie, t. IV, p. 109-10. 99 mazzo IV, 10. 100 MGH, Legum, sectio IV, constitutiones et acta publica imperatorum et regum, t. IV, pars II,
n° 914, p. 927-9.
argent selonc lour estat. Et en ce cas la conte ensamble sanz partage dessusdit appartiengne a celi dou nom dou lignage de Sauoie masle que nous ordonerons et si nous ne l’ordenions a celui de qui ordeneroit le diz Edduars101.
Ces conventions constituent un acte important, non seulement parce qu’elles constituent la première véritable affirmation juridique du principe d’exclusion des filles, mais aussi parce qu’elles furent portées à la connaissance du plus grand nombre, par la rédaction d’une lettre patente rédigée en français102. Cet usage de la langue vulgaire est d’autant plus remarquable que la chancellerie savoyarde ne produisait encore guère que des actes en latin, ce qui atteste de l’importance prise par le corps politique, que le pouvoir comtal souhaitait largement associer à l’élaboration du droit successoral. Ces conventions devaient en effet être compréhensibles par tous, afin qu’elles puissent être jurées par l’aristocratie locale : de mars à octobre 1324, le notaire Jean de Creysiaco dit Aiguebelle parcourut ainsi l’ensemble des Etats de Savoie pour enregistrer 35 serments, prêtés par au moins 55 vassaux savoyards, qui jurèrent de respecter ces dispositions103. Le temps de la liberté testamentaire était décidément révolu, puisque la volonté comtale se trouvait désormais clairement soumise à un ordre dynastique transcendant, dont la communauté politique constituait le véritable garant.
Ce droit coutumier était toutefois trop récent pour être encore bien solide, comme le montrent les difficultés qui se posèrent lors de la succession d’Edouard, qui mourut peu après avoir marié sa fille Jeanne au duc Jean III de Bretagne104. L’ensemble du dossier concernant les droits de Jeanne - qu’il s’agisse de son contrat de mariage comme du testament de son père - ayant opportunément disparu, nous ne connaissons pas les dernières dispositions d’Edouard, mais bien qu’Aymon se soit emparé du comté à la mort de son frère, le duc Jean III revendiqua aussitôt, au nom de sa femme, l’héritage savoyard105. Ses droits semblaient en tous cas suffisamment assurés pour qu’il ait pu réunir une ligue anti-savoyarde, avec la participation du Dauphin et surtout de Philippe VI, qui se
101 AST, Principi del sangue, mazzo IV, 1 102 Si les lettres patentes sont en français, l’acte de donation réciproque donné par Edouard et
Aymon, s’ils devaient mourir sans héritier mâle, est en latin (AST, Principi del sangue, mazzo IV, 2).
103 AST, Principi del sangue, mazzo IV, 3. Seul le comte de Genève semble avoir refusé de jurer les conventions (v. J. CORDEY, Les comtes de Savoie et les rois de France pendant la guerre de Cent ans (1329-1391), Paris, 1911, p. 5).
104 CORDEY, Les comtes de Savoie et les rois de France, p. 2, n. 4, date le mariage du 21 mars 1329, tandis que R. CAZELLES, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Paris, 1958, p. 86, n. 4, le situe en octobre 1329, en tous cas avant le décès du comte Edouard, mort le 12 novembre 1329 selon l’obituaire d’Hautecombe.
105 V. CORDEY, Les comtes de Savoie et les rois de France, p. 5-6 et 18.
préparait à intervenir militairement en Savoie, puisque seule l’intervention du duc Eudes IV de Bourgogne et du pape Jean XXII semble avoir permis d’éviter un conflit armé106.
La succession du comte Edouard
Amédée V Sybille de Bâgé † 1323 † 1294 1272 Edouard Ier Blanche de Bourgogne Aymon Yolande de Montferrat Philippe VI de France † 1329 † 1348 † 1343 † 1342 † 1348 1307 1330 Jeanne Jean III de Bretagne Amédée VI Jean II Philippe d’Orléans † 1344 † 1341 † 1383 † 1364 † 1375 1330 lègue ses droits sur le comté de Savoie en juin 1344
Durant tout le principat d’Aymon, la duchesse de Bretagne s’obstina à
revendiquer le comté. En 1339, Aymon pensa s’en tirer à bon compte en concédant à sa nièce et à ses éventuels héritiers, une rente annuelle de 6 000 £ tournois. La somme était considérable, mais une clause précisait que la rente serait toutefois résiliée si Jeanne mourait sans descendance, ce qui s’avèrait très probable, puisque le mariage de Jeanne et de Jean III demeurait désespérément stérile107. La convention de 1339 n’empêcha toutefois pas la duchesse de Bretagne de léguer ses droits sur le comté de Savoie au duc Philippe d’Orléans, fils cadet du roi Philippe VI. Après la mort de Jeanne, en 1344, les Valois ne manquèrent pas d’utiliser le legs de Jeanne pour dissuader les Savoyards de s’opposer à la pénétration française en Dauphiné108, avant qu’en décembre 1345, le roi Philippe VI ne se résolve à renoncer à ces vieilles prétentions, en contrepartie toutefois d’une confortable rente annuelle de 5 000 £ tournois, que le comte de Savoie s’engageait à verser au duc d’Orléans109.
106 V. CAZELLES, La société politique, p. 86-7. 107 AST, Principi del sangue, mazzo IV, 8. 108 V. CAZELLES, La société politique, p. 245-6 et E. COX, The green count of Savoy.
Amadeus VI and transalpine Savoy in the fourteenth century, Princeton, P.U.P., 1967, p.53-6. 109 Arbitrage de Philippe VI sur le debat qui estoit ou que lon esperoit a mouuoir sur ce que
feu nostre treschere niece Johanne de Sauoye jadis duchesse de Bretaigne au temps que elle uivoit disans et affermant a elle seule et pour le tout appartenir toute la contee de Sauoye et les appartenance, la terre de Baugie et les appartenances et généralement toue les terres don feu Eudouart jadis conte de Sauoie son pere mourut saisis et vestuz tant en lempire comme en nostre
La succession du comte Edouard permit ainsi la cristallisation définitive du principe coutumier d’exclusion des filles de la succession comtale savoyarde, que nul ne remit désormais en cause110. En 1343, sans doute lors des funérailles du comte Aymon, fut rédigée dans l’abbaye d’Hautecombe, la nécropole dynastique des Savoie, la première généalogie comtale. Dans ce texte célèbre, destiné à affirmer la continuité dynastique du pouvoir savoyard, apparut la première référence explicite à une coutume d’exclusion des filles, qui aurait été appliquée lors de la succession du comte Pierre :
Uxor eius fuit filia domini Foucigniaci, de qua habuit filiam unam que fuit uxor comitis Albonensis; quod mortuus est sine filio masculo et sic non successit ei filia in comitatu, quia non est consuetum in comitatu Sabaudie quod filia succedit patri in comitatu et possessione comitatus111.
roiaume et ailleurs. Le conte de Sauoie disant au contraire. Cest assauoir la dicte contee et terres ali appartenir par la succession et testament de feu Aymes jadis conte de Sauoie son pere et par plusieurs autres raisons qi seroient longues a ecrire (AST, Principi del sangue, IV, 14). Sur cet arbitrage, v. CORDEY, Les comtes de Savoie et les rois de France, p. 69-73.
110 Constatons toutefois que François Ier émit quelques prétentions du chef de sa mère, Louise de Savoie, lors de l’invasion française des Etats de Savoie, en 1536, mais l’argumentation française fut cependant aisément repoussée par les juristes savoyards et la cour de France en resta là (v. le dossier dans AST, Negoziazioni con la Francia, mazzo I, 32). Ces prétentions semblent toutefois avoir suffisamment inquiété le pouvoir ducal pour qu’il ait demandé, en 1531, un diplôme à Charles Quint afin de garantir que semper ac perpetuus remaneat in ipsius ducis primogenitum filium masculum legitimum ac naturalem et legitime natum et successiue de primogenito in primogenitum usque in infinitum (AST, Materie d’imperio, investiture, mazzo I, 6). D’autre part, consciente de déroger au droit commun, la maison de Savoie s’entoura toujours de précautions juridiques, en exigeant systématiquement, jusqu’au XVIIIe siècle, que ses filles renoncent à leurs droits à la succession lors de leur mariage (v. les nombreux exemples dans le fond Matrimoni de l’AST). Il est d’ailleurs intéressant de constater que le premier acte du duc Philippe de Savoie, lorsqu’il eut succédé au duc Charles II, fut d’exiger que la sœur du duc défunt épouse son fils premier-né, comme s’il eut voulu éteindre les droits potentiels que cette princesse eût pu faire valoir (v. GABOTTO, Lo Stato sabaudo da Amedeo VIII ad Emmanuele Filiberto, t. III, p. 8).
111 Sur cette généalogie, v. A. PERRET, “ L’abbaye d’Hautecombe et les chroniques de Savoie ”, dans Actes du 90e congrès national des sociétés savantes. Nice, 1965, 1968, p. 669-84 et id., “ Chroniqueurs et historiographes de la Maison de Savoie aux XVe et XVIe siècles ”, dans Actes du Congrès Marguerite de Savoie. Culture et pouvoir au temps de l’humanisme et de la Renaissance, Genève, Slatkine, p. 123-34. Je cite ici la version du manuscrit des Archives départementales des Alpes-Maritimes, Città e contado di Nizza, mazzo II, 1, qui donne une version plus complète, plus précoce et moins fautive, que la copie manuscrite éditée par D. PROMIS (v. L. RIPART, “ Le livre des chapitres niçois du XVe siècle : les enjeux politiques d’un manuscrit juridique ”, dans Actes du congrès national des sociétés savantes (Nice, 1996),
En considérant que la succession de Pierre s’était déroulée selon un droit coutumier préexistant, la généalogie d’Hautecombe affirmait en fait que la transmission du pouvoir comtal ne pouvait se concevoir que dans le cadre d’un droit transcendant, auquel la volonté princière devait se soumettre. A l’heure où la communauté politique s’incarnait désormais dans la personne du prince, le pouvoir dynastique était ainsi contraint à se définir selon une coutume anhistorique, dans laquelle le corps politique du comté pouvait trouver le fondement de sa propre continuité. En ce sens, l’affirmation de la coutume savoyarde de l’exclusion des filles ne fut qu’une conséquence de l’étatisation d’un pouvoir dynastique, qui ne pouvait désormais plus s’accommoder des stratégies familiales qui avaient déterminé les successions du XIIIe siècle. Sans doute est-il d’ailleurs révélateur que pour financer les lourdes indemnités promises à la duchesse Jeanne et à ses héritiers, le pouvoir comtal leva un prélèvement exceptionnel pro facto duchissa Bretaignie, que l’on peut sans doute considérer comme le premier impôt savoyard112. Le droit dynastique n’était décidément plus une affaire de famille, mais devenait la possession de la communauté politique toute entière.
La longue et complexe histoire du statut de l’héritière nous révèle ainsi
l’ampleur des transformations de la nature du pouvoir comtal tout au long d’un XIIIe siècle décisif, puisqu’en trois générations les principes successoraux qui organisaient le pouvoir dynastique savoyard se modifièrent radicalement. A la génération d’Alice, éphémère fiancée de Jean sans Terre et tante paternelle du comte Pierre, le pouvoir comtal demeurait encore une magistrature impériale qu’une femme pouvait transmettre sans être pour autant apte à la relever. A la génération du comte Pierre et de ses frères, la principauté savoyarde était désormais devenue une possession purement familiale, où le pouvoir comtal devait être conféré à l’homme mûr, capable d’assumer les fonctions d’un pater familias. Une génération plus tard, l’étatisation du pouvoir comtal permit l’affirmation d’un droit dynastique qui, en définissant en termes juridiques les successions erratiques du XIIIe siècle, donna naissance à la coutume savoyarde de l’exclusion des filles.
Dans cette évolution générale, la succession comtale au temps du comte Pierre ne me semble donc pas relever d’une véritable conception étatique de la puissance
sous presse). Une édition complète du texte sera donnée dans ma thèse, que je devrais soutenir à la fin de l’année 1998.
112 V. CORDEY, Les comtes de Savoie et les rois de France, p. 73 et M. GELTING, “ Les mutations du pouvoir comtal en Maurienne (XIVe-XVe siècle) ”, dans Amédée VIII-Félix V, premier duc de Savoie et pape (1383-1451). Actes du colloque international de Ripaille-Lausanne (23-26 octobre 1990), Lausanne, 1992 (Bibliothèque historique vaudois, 103), p. 215-28, p. 223
princière, qui ne s’imposera en fait qu’à la génération suivante, lorsque le pouvoir comtal s’organisera selon un droit dynastique transcendant. Pour autant, si les successions comtales du XIIIe siècle ne s’organisèrent qu’en fonction des impératifs de la continuité du patrimoine familial, elles constituèrent sans doute un préalable nécessaire à l’étatisation du pouvoir savoyard. En organisant leur pouvoir comtal, désormais affranchi de la tutelle impériale, dans les cadres familiaux de la perpétuation lignagère, les comtes de Savoie élaborèrent en fait les fondements d’une continuité dynastique, où le corps politique put trouver le ciment de sa propre pérennité.













































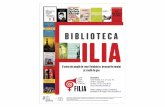





![Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313d1e9b033aaa8b210419a/non-obstante-quod-sunt-monachi-etre-moine-et-etudiant-au-moyen-age-dans-quaderni.jpg)

