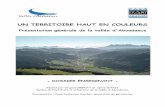"Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle: le système du monde de P. Redento Baranzano...
Transcript of "Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle: le système du monde de P. Redento Baranzano...
DISCUSSIONS COPERNICIENNES AU DÉBUT DU XVIIe SIÈCLE : LE SYSTÈME DU MONDE DU P. REDENTO BARANZANO,
ENSEIGNANT EN SAVOIE
MICHELA MALPANGOTTO*
Portrait de Baranzano.
1. Introduction
D’habitude, la “ révolution copernicienne ” est présentée à travers les faitssaillants qui l’ont marquée et l’attention est portée sur les personnages d’enver-gure qui, comme Galilée, Kepler, Brahe, Ursus, Bellarmin ou Clavius, ont animéle débat ouvert en 1543 par l’édition du De Revolutionibus orbium coelestium deNicolas Copernic. Cette contribution propose de prendre en compte ce mêmesujet, la “ révolution copernicienne ”, selon un point de vue un peu différent enadressant l’attention au contexte, moins connu, moins étudié, et pourtant impor-tant lui aussi, de tous ceux que l’on pourrait appeler les “ gens communs ”, àsavoir tous ceux qui, suite à l’édition du De Revolutionibus, ont été obligés de
* CNRS, UMR 8630 “ Systèmes de référence temps-espace ”Observatoire de Paris61 Avenue de l’Observatoire75014 ParisFrance
370 Michela Malpangotto
faire leur choix. On peut penser notamment aux enseignants en astronomie et enphilosophie naturelle qui ont dû choisir de faire connaître ou non à leurs élèvesles découvertes surprenantes et étonnantes de Galilée ; de présenter ou nonl’héliocentrisme et, si oui, en quels termes ? Pour en dire qu’il s’agissait d’uneidée absurde à rejeter tout à fait ? Que ce n’était qu’une hypothèse mathématiqueutile pour sauver les apparences et les phénomènes célestes ? Ou bien qu’ils’agissait du vrai système du monde ?
Dans ce contexte la figure du père barnabite Redento Baranzano (SerravalleSesia 1590-Montargis 1622) se fait remarquer.
R. Baranzano, Uranoscopia, pars secunda, p. 63.
Giovanni Antonio Baranzano naît le 4 février 1590 à Serravalle Sesia, dans leduché de Savoie1.
Âgé de 18 ans en 1608, il entre dans la Congrégation religieuse des clercsréguliers de Saint Paul, mieux connus sous le nom de Barnabites, où il devientnovice et prend le nom de Redento. Il suit la formation habituelle chez les Bar-nabites, à savoir spirituelle, théologique et culturelle, dans les Collèges de Monza,
1. Aujourd’hui ville italienne qui fait partie de la province de Biella. La date de naissance deBaranzano est connue grâce à l’acte de naissance conservé dans les archives de la mairie de SerravalleSesia, mais elle est également inscrite dans le schéma de l’horoscope du Barnabite, dressé par lui-même et publié à la page 63 de la deuxième partie de l’Uranoscopia. Toutes les reproductions desimages de l’Uranoscopia sont tirées de l’exemplaire de la biblioteca civica Berio di Genova.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 371
de Sant’Alessandro et de San Barnaba à Milan, ainsi que dans celui de Pavie2. En1615, avant d’être admis au sacerdoce3, il est le seul diacre affecté à la Maisond’Annecy, très probablement en raison d’une bonne connaissance de la languefrançaise4. C’est dans cette ville du Duché de Savoie que résidait l’évêque deGenève5, François de Sales. Celui-ci, soucieux de diffuser les enseignementschrétiens chez les jeunes dans une période particulièrement difficile pour son dio-cèse, notamment en raison des luttes protestantes, avait fait appel à la Congréga-tion des Barnabites pour assurer cet enseignement au Collège Chappuisien àpartir de 16146.
Le père Redento fut à la fois un fervent prêcheur dans un diocèse difficilecomme l’était celui de Genève à cette époque, un diplomate engagé dans la fon-dation de nouveaux collèges barnabites en France, un astronome intéressé parl’observation du ciel, un savant d’envergure sensible aux réflexions ouvertes par
2. Baranzano devient novice au Collège de Monza où il reste un an pour recevoir sa formationreligieuse. Il poursuit ensuite ses études studia humanitatis pendant l’année scolaire 1609-1610 auCollège de Sant’Alessandro à Milan, où il suit les cours de rhétorique et d’hébreu. Les studia humani-tatis terminés, Baranzano est affecté à la Maison mère des Barnabites, San Barnaba, à Milan. Il y restejusqu’en 1613 lorsqu’il est envoyé au Collège de Pavie pour terminer ses études théologiques. Mal-heureusement, la dispersion des Actes de la Maison de Pavie pour les années du séjour de Baranzanoempêche l’acquisition d’informations plus précises concernant les cours qu’il y fréquentait et sesenseignants : cela serait précieux surtout pour mieux connaître sa formation astronomique. Pour plusde précisions sur cette partie de la vie de Baranzano tel qu’on peut la reconstituer à partir des docu-ments des Archives historiques des pères barnabites, voir Michela Malpangotto, “ Tradizione aristote-lico-tolemaica e novità copernicane nell’Uranoscopia di P. Redento Baranzano ”, dans L. Giacardi, M.Mosca, O. Robutti (éds.), Conferenze e seminari dell’Associazione Subalpina Mathesis 2006-2007,Torino, 2007.
3. Le 14 novembre 1615, l’assistant et vicaire général de Milan admettra Baranzano au sacerdocesuite à la lettre patente envoyée par le père supérieur d’Annecy, Simpliciano Fregoso, voir ASBR, R.4(Acta Praepositi Generalis), c. 165r, Die XIV Novembris 1615. Grâce au Status personarum des clercsréguliers de Saint Paul, actuellement conservé dans l’Archive historique des Barnabites à Rome, onapprend que Baranzano est ordonné prêtre à Annecy par l’evêque de Genève, François de Sales : Sac-erdos ordinatus ab episcopo Genevensi, in civitate Aniciense in Sabaudia (ASBR, E.2 (Status per-sonarum), c. 373r).
4. Afin de résoudre le problème posé par la nécessité de savoir s’exprimer couramment en languefrançaise pour la communauté de la Maison d’Annecy, le père général Giovanni Antonio Mazentarassure le père supérieur d’Annecy avec la promesse de sujets français soggetti francesi ou de pèresayant une bonne connaissance de cette langue. Il est en effet convaincu que, au delà de l’activitéd’enseignement lors de laquelle le latin sera toujours employé, il est préférable d’acquérir pour laprédication une bonne maîtrise de la langue française car elle sera mieux comprise et par conséquentplus utile pour attirer les fidèles au catholicisme : [è bene] apprendere buona lingua francese, perchèè meglio intesa et gioverà altrove ; et se bene nelle schole basterà la lettione [in latino], ad ogni modoper guadagnar anime conviene nella volgare farsi intendere (ASBR, Epistolario Generalizio, serie I,vol. XVIII, cc. 452-453, 15 décembre 1614). Pour plus de détails concernant la présence des pèresbarnabites en Savoie, voir l’étude très précise et complète de Mauro Regazzoni, “ Presenza dei Barna-biti in Savoia al tempo di S. Francesco di Sales ”, dans Barnabiti Studi, 15 (1998), p. 213- 335.
5. Le Conseil général de Genève établit, par le vote du 21 mai 1536, le passage définitif au pro-testantisme et l’indépendance de Genève de la souveraineté temporelle et spirituelle de l’évêque-prince. En conséquence, au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, l’évêque de Genève fixera sonsiège à Annecy.
6. Pour plus de précisions au sujet de la fondation de la Maison des pères barnabites à Annecy,voir Mauro Regazzoni, “ Presenza dei Barnabiti in Savoia al tempo di S. Francesco di Sales ”, dans Barnabiti Studi, 15 (1998), p. 213- 335. Pour de riches informations concernant plus précisémentl’histoire et l’organisation du Collège Chappuisien d’Annecy, voir M. Rebut, “ Le Collège Chappui-sien ”, dans La Revue Savoisienne , 103 (1963), p. 82-108.
372 Michela Malpangotto
les nouvelles problématiques philosophiques et scientifiques, ainsi qu’un ensei-gnant compétent. C’est précisément l’activité d’enseignement au Collège Chap-puisien d’Annecy qui est à l’origine de son entière production scientifique7
publiée entre 1617 et 16208. Un traité de logique rassemblant les leçons donnéesau cours de l’année scolaire 1615-1616, est imprimé à Lyon en 1618 sous le titrede Summa philosophica anneciacensis. Le volume porte le privilège du Roi,“ donné à Paris ”, et l’approbation du frère Jacques Fodéré, docteur en théologieà Lyon. Un ouvrage consacré à la physique, discipline qui fut l’objet du coursdonné par le père Redento durant l’année scolaire 1617-1618, est imprimé à Lyonen 16199 sous le titre de Novae opiniones physicae. Ce volume porte égalementle privilège du Roy, “ donné à Paris ”, et est publié avec les autorisations de l’évê-que de Genève, François de Sales, (donnée à Annecy en février 1618) et du pré-posé général des Barnabites, Girolamo Boerio, (délivrée à Milan le 20 janvier1618)10, ainsi que celles des théologiens Pierre-François Jay et Jacques Fodéré.
Durant l’année scolaire 1616-1617, le père Redento donne un cours de philo-sophie naturelle consacré au De coelo, avec un succès tel que deux de ses élèves,le parisien Ludovic des Hayes et l’italien Giovanni Battista Muratori da Savi-gliano, rédigent des notes de ces leçons et ils mettent tout en place pour lespublier. C’est ainsi qu’est imprimée à Genève, au cours de l’été 1617, l’Uranos-copia seu de coelo, sans qu’aucune autorisation ne fût délivrée à l’imprimeur, etsans l’aval des autorités religieuses et des supérieurs de l’Ordre des Barnabites.
2. Présentation et objectifs de cette contribution
Le contenu de l’Uranoscopia témoigne de la part active que prend Baranzanoau ferment d’idées et à la recherche libre pour une disposition nouvelle des cieuxen cours à cette époque. Le système du monde proposé par Copernic – plus desoixante-dix ans auparavant – bouleversait l’ordre traditionnel de l’univers etreprésentait, avec les découvertes plus récentes, une nouveauté digne de considé-ration.
Le père Redento, désireux de donner à ses élèves une vision moderne et laplus au fait des connaissances en astronomie d’alors, introduit également dans soncours une présentation du système héliocentrique. Mais l’Uranoscopia paraît en1617 soit un an après le décret du 5 mars 1616 dans lequel la Congrégation res-ponsable de l’Index des livres interdits suspendait les ouvrages enseignant la doc-
7. Baranzano fut également l’auteur d’ouvrages de dévotion parmi lesquels on signale le Briefveet petite adresse, pour bien méditer la Passion de Nostre Seigneur Iesus-Christ publié à Lyon en 1618.
8. La tâche très ambitieuse que se donnait le père barnabite était la rédaction d’une Summa phi-losophica anneciacensis prenant son titre d’un hommage à la ville qui avait donné naissance et rendupossible cette entreprise à la fois didactique et éditoriale.
9. L’impression de l’ouvrage fut achevée le 30 octobre 1618 à Lyon chez Jean Pillehotte qui mar-quera la date de 1619 sur le frontispice.
10. Les copies manuscrites de ces trois permissions sont conservées dans ASBM, A.8, fasc. unico,n.28.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 373
trine héliocentrique, ce qui engendrait un climat d’appréhension chez lescatholiques. Ce n’était donc pas le moment le plus favorable pour se déclarercopernicien ou tout du moins enseigner ce système du monde. Publiée dans laville de Calvin sans les autorisations des pères supérieurs de l’ordre religieux,l’Uranoscopia apparaît sérieusement compromettante et dangereuse pour lacongrégation des Barnabites toute entière et une forte pression est immédiatementfaite sur Baranzano pour qu’il se rétracte officiellement. Ce qu’il fait dans un écritimprimé sous le titre Nova de motu Terrae Copernicaeo iuxta Summi Pontificismentem Disputatio authore Reverendo Patre Don Redempto Baranzano11.
La problématique de cet épisode dans le contexte difficile et délicat qui secrée à cette époque, notamment au sujet des rapports entre science et foi, sembledigne d’une étude plus fouillée. L’examen soigneux des sources documentairesexistantes12 a permis de mieux éclairer, grâce à des résultats nouveaux, lesconnaissances acquises jusqu’à présent sur ce sujet.
11. Voir infra 8- Réflexions conclusives. 12. Au-delà de l’étude des œuvres publiées de Baranzano, grâce à la collaboration et à l’aide
généreuse des pères barnabites, l’accès aux Archives historiques de Milan San Barnaba et Sant’Ales-sandro et de Rome a été possible. Des documents inédits de grand intérêt pour cette recherche y sontconservés.
374 Michela Malpangotto
Le résultat est tout à fait inattendu et dément le jugement courant qui consi-dère Baranzano comme un “ copernicien convaincu ”. La personnalité forte et lesconvictions profondes du jeune enseignant se dessinent en effet plus clairement.Il trouve dans la rigueur du discours scientifique la confirmation de la validité desa propre pensée en arrivant même à formuler un système original du monde et àen légitimer la cohérence.
Le père Redento focalise l’attention sur les principes aristotéliciens quiavaient réglé les mouvements des sphères célestes et il trouve les raisons pour eninvalider la nécessité stricte. Toute cette réflexion lui permet de considérer libre-ment la théorie copernicienne, mais la nouveauté de ce système ne le convaincpas encore : il ne peut pas admettre que la Terre puisse errer dans une sphère sidistante du centre de l’univers. Ainsi, en réponse à cette théorie, il met au pointune théorie personnelle qui peut selon lui être la bonne solution pour sauver lesphénomènes : il s’agit de son alia via.
Cette contribution propose de faire ressortir les éléments essentiels de la pen-sée astronomique du père Redento, les jugements qu’il a lui-même élaborés surla question de systemate mundi, par rapport au système du monde traditionnel età celui de Copernic. Cela permettra non seulement de dévoiler les convictionsintimes de Baranzano, mais également leur cohérence qui s’exprime dans l’élabo-ration d’une vision personnelle de l’univers. Et comme une telle position origi-nale résulte de l’analyse conduite par le père barnabite sur les trois élémentsconstituant l’héliocentrisme – à savoir le Soleil au centre du monde ; la Terre quin’est pas au centre du monde ; la Terre pourvue de plusieurs mouvements –, ilsera possible au final de définir plus clairement les idées de Baranzano et de luirendre les spécificités de sa pensée en mettant en lumière les différences entre savision du monde et l’innovation révolutionnaire proposée par Copernic.
Afin de permettre au lecteur une vérification immédiate sur le contexte pluscomplet des différentes parties de l’Uranoscopia, sur lesquelles s’appuie demanière importante l’analyse présentée dans cette contribution, en appendice estprésentée l’édition critique de certaines sections de l’ouvrage de Baranzano13.
3. L’Uranoscopia seu De coelo
Les nombreuses informations et éléments de réflexion donnés par Baranzanoaniment le cours qu’il dispense au Collège Chappuisien d’Annecy. Cette richesseest à l’origine du vif désir, manifesté par les deux élèves, Giovanni Battista Mura-
13. Actuellement il n’existe aucune édition critique, ni traduction en langue moderne de l’œuvre deBaranzano. L’édition en appendice et toutes les traductions françaises insérées dans cette contributionsont dues à Michela Malpangotto. Au cours de l’article, pour toute référence aux passages édités dansl’Appendice les numéros des lignes concernées seront précisés. Pour tous les passages venant des par-ties non éditées de l’Uranoscopia ou de toute autre ouvrage, les références seront précisément indiquéeset les transcriptions reproduiront fidèlement l’orthographe, la distribution des majuscules et la ponctu-ation des sources originales anciennes et modernes. Seule l’emploi des u / v dans les œuvres anciennessera modernisé afin de rendre les textes plus aisément compréhensibles aux lecteurs de nos jours.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 375
tori et Ludovic des Hayes, dans leurs préfaces, de diffuser ces leçons afin d’éviterla perte de toute cette masse de connaissances que l’enseignant réorganisait enune synthèse exhaustive pour ses élèves14.
L’Uranoscopia seu De coelo15 est en effet une œuvre d’une envergure remar-quable. Le volume, de plus de cinq cent pages, se compose de deux parties : dansla première, intitulée De Corpore coelesti in genere16, Baranzano présente l’ori-gine, la forme, et la nature des cieux en général, les parties qui forment chaquesphère et le nombre de sphères dont l’univers est composé ; dans la seconde, inti-tulée De Corpore coelesti in specie17, il porte l’attention sur les dernières misesà jour apportées au système astronomique traditionnel en s’arrêtant ponctuelle-ment sur chaque sphère céleste dont il présente l’étymologie du nom, la naturedes mouvements et la dynamique spécifique18.
La science des astres est présentée selon le style propre à la scolastique, c'est-à-dire à travers des quaestiones et des dubitationes, pour prendre en compte desproblématiques provenant à la fois des commentaires du traité De coelo d’Aris-tote et des Quaestiones in Genesim. Les thèmes abordés ici sont examinés selondes points de vue différents, allant des argumentations théologiques et philosophi-ques, jusqu’aux dissertations astronomiques et astrologiques. On y trouve destémoignages tirés des Écritures Saintes et des pères de l’Église, ainsi que les idéesde philosophes et d’astronomes, des plus anciens aux plus récents ; et tout celaest examiné par Baranzano afin de présenter ses propres réflexions et conclusions.
14. Giovanni Battista Muratori, Uranoscopiae studioso Salutem, Genève, 1617, p. 5 : [...] time-bam namque ne tam rarae et peregrinae opiniones firmissimis rationibus roboratae perpetui silentiitegerentur velo [...] ut ea quae ipse dicturus erat in tenebris, evulgarem in lucem, et quae praedica-turus in domo, enunciarem super tecta. Ludovic des Hayes, Uranoscopiae studioso Salutem, Genève,1617, p. 13 : [...] toti mundo iniuriam facere putabam, si intra domesticos parietes illa retinerem.
15. Le titre Uranoscopia, qui précède celui plus usuel de De coelo, fut choisi par Giovanni Bat-tista Muratori afin de mettre en évidence la caractéristique des hommes qui dressent des yeux attentifsvers les étoiles : [...] hominis inter caetera animalia capite ad coelum respiciente a summo naturaeauthore, quo caelum specularetur conditi, verum hieroglyphicum Uranoscopicum esse piscem. (Gio-vanni Battista Muratori, Uranoscopiae studioso Salutem, Genève, 1617, p. 7). Il s’inspire alors de lalittérature naturaliste de Pline, Atheneus et Galien, qui avaient parlé d’un poisson ayant, malgré sanature animale, une caractéristique physique commune aux hommes qui est d’avoir les yeux constam-ment dressés vers le ciel. C’est pourquoi il est nommé uranoscops ou coeli speculator : [...] mihi descientiae nomine cogitanti, venit in mentem Authorem licet Italum, Gallice coram illustrissimoGebenensis Ecclesiae Episcopo publice concionantem, ex Plinio, Athenaeo, et Galeno retulisse, quen-dam adinveniri piscem, qui ob oculos supra caput sitos, et recta in coelum semper erectos, Uranos-cops Graece, Latine coeli speculator nuncupatur, talesque se desiderare hominum mentes, et illarumpraecipuum munus esse. (Ibidem, p. 6) Par conséquent, selon l’élève de Baranzano, le terme Uranos-copia, même s’il est inusuel dans la littérature astronomique de l’époque, résumait une série d’élé-ments le rendant tout à fait adapté pour décrire en un seul mot toute la portée de l’ouvrage quirassemblait l’ensemble des leçons du père Baranzano tout en renvoyant également au nom choisi parTycho Brahe pour son observatoire sur l’île de Hven, à savoir Uraniborg : Propterea in eam statimdeveni sententiam, ut haec coelestis corporis Physica tractatio, Uranoscopia (ad quod statuendumceleberrimae illius Tychonicae in insula Haëna conditae artis Uranitargi (sic) me non parum iuvitdenominatio) seu caeli speculatio diceretur. (Ibidem, p. 7)
16. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, Genève, 1617, p. 19. Baranzano y expliquebrièvement le contenu des deux sections de son ouvrage. Le frontispice de la première partie se trouveà p. 17 : Uranoscopiae, seu De coelo Pars Prima in qua novo ordine, modo, et methodo coelestiapraedicata communiora explicantur.
17. Ibidem, Pars secunda, p. 12. Le frontispice de cette partie se trouve à p. 1 : Uranoscopiae seuDe caelo, Pars Secunda. In qua singularum sphaerarum essentia, natura, proprietas, theoria, prae-dominium, distantia, magnitudo, motus, et status, brevibus exponitur.
18. Pour une description plus précise et détaillée du contenu, voir Giovanni Battista Muratori,Uranoscopiae studioso Salutem, Genève, 1617, p. 7-8.
376 Michela Malpangotto
L’ouvrage révèle ainsi non seulement une connaissance vaste et profonde, maisaussi un travail de réflexion et de jugement autonome accompli par l’enseignantsur le plus vaste panorama scientifique alors disponible. Mais ce qui rend cetouvrage véritablement vivant, c’est le témoignage qu’il nous transmet sur larichesse et la complexité du ferment qui animait l’astronomie à cette époque etcomme ce ne fut jamais le cas auparavant. Le père Redento présente l’ensembledes débats contemporains en prenant en compte et en examinant les orientationsde pensée les plus différentes. La richesse des références bibliographiques, ren-voyant à la production scientifique la plus actuelle, lui permet de comparer lesopinions des auteurs qui ont apporté de véritables contributions à la science desastres. Sa description de l’univers s’enrichit alors des nouveautés observées dansle ciel grâce à la lunette de Galilée, cet instrument encore controversé à l’époque,qui avait révélé des choses jamais vues auparavant comme les tâches lunaires, lessatellites de Jupiter, la nature de la Voie lactée ; la précision des observationseffectués par Tycho Brahe à Uraniborg – rendue possible au moyen d’instrumentstraditionnels mais fixes, de grandes dimensions et perfectionnés par Brahe lui-même – met à disposition de la communauté scientifique de meilleures donnéesque Baranzano reproduit dans son Uranoscopia afin de les comparer avec lesrésultats coperniciens des Tabulae Prutenicae, mais aussi avec les valeurs plustraditionnelles de Jean Fernel ou Francesco Maurolico. C’est cependant dans sacapacité à examiner et à évaluer les différentes propositions de systemate mundique Baranzano révèle ses compétences techniques ainsi qu’une capacité très fineà identifier les éléments particuliers caractérisant des hypothèses qui diffèrent, neserait-ce que de façon très subtile :
– le système de la tradition aristotélico-ptoléméenne est alors présenté dans saversion la plus moderne, élaborée par Giovanni Antonio Magini et partagéepar Christophe Clavius19 ;
19. La présentation du système de Magini – géocentrique et géostatique à onze sphères en mou-vement –, insérée par Clavius dans son commentaire à la Sphère de Sacrobosco depuis l’édition de1593, est un modèle pour Baranzano lequel en reproduit des pages entières à la lettre dansl’Uranoscopia. Les temoignages les plus évidents se trouvent dans la deuxième partie de l’Urano-scopia : pour expliquer les deux librations assignées par Magini à la dixième et à la neuvième sphère,Baranzano maintient inchangé le texte de Clavius (cf. Redento Baranzano, Uranoscopia, Parssecunda, Genève, 1617, p. 37 et p. 42-43 et Christoph Clavius, In Sphaeram Ioannis de Sacroboscocommentarius, Mayence, 1611-1612, p. 36-37 et p. 39). Cette explication, plus qualitative et discur-sive, est ensuite complétée par des données techniques et des valeurs numériques dans la PlanetarumTheoria Copernimaginica, in Tabulas redacta rédigée par Baranzano et publiée dans la seconde partiede l’Uranoscopia, p. 190-208. Le père Redento y résume ad verbum le texte des Novae coelestiumorbium theoricae congruentes cum observationibus N. Copernici publiées par Magini en 1589, maisil le modifie pour le réduire à la forme de tables (Tabulae) en imitation aux Theoricae planetarumiuxta placita Alphonsinorum per tabulas digestae que Clavius avait publiées à la fin de son commen-taire de la Sphère de Sacrobosco (Christoph Clavius, In Sphaeram commentarius, Lyon, 1593, p. 532-551 ; le titre évoqué paraîtra dans des éditions successives). Cependant l’analogie entre ces deuxtables se réduit juste à la mise en page car le père barnabite rend cohérent ce que Clavius avait laisséinachevé. En effet, le Jésuite du Collège romain, même si depuis 1593 il avait accepté la solution deMagini et avait bien précisé le manque de validité du système à dix sphères d’“ Alphonse ”, avait gar-dé inchangé (de la prèmiere édition de 1570 à la dernière de 1611) l’appendice comportant les Theo-ricae planetarum per tabulas digestae proposant le système iuxta placita Alphonsinorum. Pour plusde précisions au sujet du changement d’opinion de Clavius dans son commentaire de 1593, voir infra4.2- L’origine et les développements du système traditionnel .
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 377
– le système de Tycho Brahe est présenté à travers les propres mots de sonauteur dans le De mundi aetherei recentioribus phaenomenis, auxquels Baran-zano ajoute également son analyse personnelle précise et fort critique20 ;
– on trouve également des références au système plus récent d’Antonio Loren-zini Poliziano qui, tout en respectant le géocentrisme, assigne à la Terre lesdeux mouvements de libration21 ;
– c’est cependant la nouveauté profonde proposée par le système copernicienqui influence dans une certaine mesure les conceptions astronomiques du pèrebarnabite, lequel consacre à ce système une longue section de son Uranosco-pia.
4. Baranzano et le système de la tradition aristotélico-ptoléméenne
4.1. An posita pluralitate coelorum ponendi sint undecim mobiles an decem annovem an octo
L’acceptation de la structure cosmologique et métaphysique aristotélicienneavait constamment été la base sur laquelle, au cours des siècles, s’étaient grefféstous les savants dont les choix et les orientations de pensée étaient fermementguidés par cet ensemble de normes et principes désormais consolidés. Cetteconscience se reflète dans la formulation utilisée par Baranzano pour structurer lecontenu de l’Uranoscopia, et notamment le texte qui précède et introduit la Dubi-tatio decima de la Quaestio tertia qui semble avoir été construit par le pèreRedento en fonction de ce qu’il voudra affirmer de ordine coelestium sphaera-rum22. La question “ Étant supposée une pluralité de cieux, faut-il admettre onze,dix, neuf ou huit [sphères] en mouvement ? ”23 qu’il donne comme titre à cettesection préliminaire possède une valeur à la fois dubitative et interrogative.D’après l’enseignant barnabite, la réponse n’est ni évidente, ni acquise : elle doitplutôt être le résultat d’une réflexion touchant les présupposés mêmes de cettequestion.
Avant d’aborder le problème de systemate mundi le discours de Baranzanorévèle une volonté délibérée de faire en sorte d’engendrer chez ses lecteurs-audi-teurs une suspension du jugement, une attitude libre de préjugés et conditionne-ments surtout en ce qui concerne un point crucial pour la considération parallèledes structures copernicienne et traditionnelle du monde : les sphères cristallinessupérieures au Firmament, élément qui se révèle être à la fois le plus solide et leplus fragile des débats en cours.
20. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars secunda, Genève, 1617, p. 186-189, renvoie précisé-ment à l’ouvrage de Tyco Brahe praestantissimus nostri aevi mathematicus libro secundo, de mundiaetherei recentioribus phaenomenis pagina centesima, octuagesima nona, novas adinvenit mundanisystematis hypotyposes, [...].
21. Anthonio Lorenzini, De numero, ordine, et motu coelorum adversus recentiores, Paris, 1606. 22. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, ligne 221.23. Ibidem, lignes 103-104.
378 Michela Malpangotto
Éliminées par Copernic, ces sphères avaient eu depuis toujours un rôle domi-nant dans la configuration plus générale de l’univers car elles étaient les respon-sables de tous les mouvements qui entraînaient de manière homogène le globecéleste entier. Les astronomes avaient constamment fait appel à ces sphères pourrendre compte des phénomènes qui s’étaient rendus manifestes au cours des siè-cles. Cela avait produit un univers progressivement croissant qui était passé deshuit sphères de l’univers d’Aristote, à neuf selon Ptolémée, dix selon les Alphon-sines, et onze d’après Magini, à la fin du XVIe siècle24.
Le père Redento reconnaît dans cette évolution le résultat des solutions adop-tées dans le respect constant d’une cosmologie conçue d’après la vision person-nelle d’Aristote25 comme conséquence logique d’une association naturelle demouvements et d’objets visibles.
4.2. L’origine et les développements du système traditionnel
L’évidence visuelle faisant remarquer huit mouvements aux huit corps céles-tes26 – les sept planètes et les étoiles fixes- a amené Aristote à leur associer autantde sphères pour lesquelles il établit que :
– les seuls mouvements possibles sont strictement circulaires et uniformes ;
– chaque corps simple ne peut avoir qu’un seul mouvement propre et naturel ;
– en vertu de la concentricité et de la contiguïté27, chaque sphère transmet sesmouvements par contact à la sphère inférieure qui les reçoit comme praeter-naturales.
En conséquence de quoi la huitième sphère, comportant les étoiles fixes,devient le Premier Mobile qui imprime le mouvement diurne en descendant à tou-tes les sphères célestes et fait ainsi accomplir à l’univers entier une rotation ver-tigineuse et silencieuse en vingt-quatre heures28.
La présentation donnée par Baranzano de l’évolution du système céleste suc-cédant à celle d’Aristote, semble vouloir mettre en évidence la façon dont, paranalogie avec la solution du Philosophe, les astronomes postérieurs ont été ame-nés à garder et respecter ce même mécanisme d’une rotation imprimée du conte-nant au contenu également pour tous les mouvements nouveaux qui seront relevésau cours des siècles et qui, comme le diurne, entraînent l’univers entier.
24. Ibidem, lignes 114-117. L’ouvrage de référence pour l’étude de “ la vie des sphères célestes ”est Michel-Pierre Lerner, Le Monde des sphères, Les Belles Lettres, Paris, 2008. Voir égalementEdward Grant, Planets, Stars, and Orbs, Cambridge University Press, Cambridge, 1994 (digitalreprint, 2009)
25. Pour les origines de cet univers comme “ gestation toute humaine ” voir Michel-Pierre Lerner,Le Monde des sphères, Les Belles Lettres, Paris, 2008, vol. I, p. 3 et suivantes.
26. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 13-16.27. Pour le problème de la continuité et de la contiguïté entre les sphères du monde, voir Michel-
Pierre Lerner, Le Monde des sphères, Les Belles Lettres, Paris, 2008, vol. I, p. 39-41.28. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 119-121.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 379
Cependant, si Aristote pouvait disposer de huit objets et de huit mouvements,cette correspondance ne peut plus être biunivoque pour les astronomes suivantscar les mouvements observés deviennent plus nombreux que les corps célestesvisibles : la solutions qu’ils adoptent alors est de supposer qu’il existe des sphèressupérieures au Firmament, lesquelles, ne comportant aucun corps céleste, échap-pent à notre vue et sont parfaitement transparentes et “ cristallines ”29.
De cette façon, la perception du mouvement nouveau, appelé “ de préces-sion ”, amènera Ptolémée à ajouter une sphère ultérieure au dessus du Firmamenten envisageant un univers à neuf cieux où :
– la neuvième sphère devient le Premier Mobile qui transmet par contact à lahuitième et aux sept sphères planétaires la rotation diurne du levant au cou-chant autour de l’axe du monde, en faisant ainsi accomplir au globe célesteentier cette rotation vertigineuse en vingt-quatre heures ;
– à la huitième sphère, qui porte les étoiles fixes, est maintenant assigné lenouveau mouvement que Ptolémée croit se réaliser du couchant au levantautour de l’axe de l’écliptique, en faisant accomplir également aux sphèresinférieures cette rotation très lente en trente-six mille ans30.
Par la suite, la perception d’un nouveau mouvement global, dit “ de trépida-tion ” ou “ d’accès et recès ”, impliquera l’ajout d’une sphère anastre ultérieure,responsable de ce mouvement31. On arrive ainsi, depuis le XIVe siècle, à envisa-ger un univers à dix cieux : les sept qui portent les planètes, celui des étoilesfixes, et deux dépourvus d’astres dont la seule fonction est de transmettre leursmouvements aux sphères inférieures.
Au cours des siècles suivants, l’astronomie va connaître des périodes de criseprofonde car le modèle “ alphonsin ” de trépidation se révèle en fait inadéquat et
29. Les termes “ Firmament ” et “ cristallin ”, qui seront introduits après Ptolémée dans la tradi-tion latine chrétienne, sont employés ici en suivant l’usage de Baranzano, voir Redento Baranzano,Uranoscopia, Pars prima, ligne 127 et ligne 537, et Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars secunda,Genève, 1617, p. 33-34, p. 47-48.
30. Aucun nom n’est associé à ce mouvement qui, pour toute la tradition latine, est désignécomme la rotation d’une sphère céleste du couchant au levant autour de l’axe de l’écliptique. Baran-zano respecte cette tradition et se réfère toujours à ce mouvement en décrivant sa direction et son axe.Voir Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 121-124, et Redento Baranzano, Urano-scopia, Pars secunda, Genève, 1617, p. 48. Ce sera Copernic, dans le De Revolutionibus, qui nom-mera “ précession des équinoxes ” ce mouvement car, si pour l’astronomie traditionnelle il s’agissaitd’un déplacement de la première étoile de l’Ariès du couchant au levant, c'est-à-dire selon l’ordre dessignes et donc in consequentia, au contraire le système de Copernic voyait plutôt le point équinoxialse déplacer – alors que l’étoile de l’Ariès restait fixe et immobile – du levant vers le couchant, c’est-à-dire contra ordinem signorum et donc in praecedentia d’où le nom de “ précession des équinoxes ”,assigné par Copernic à cette rotation.
31. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 124-128. Baranzano, en suivant Clavius(voir Christoph Clavius, In Sphaeram commentarus, Lyon, 1593, p. 44-66), se réfère à ce modèlecomme à celui “ d’Alphonse ”. Pour une analyse de la paternité alphonsine et l’origine castillane desTables Alphonsines, voir José Chabas-Bernard R. Goldstein, The Alphonsine Tables of Toledo, KluwerAcademic Publishers, Dordrecht, 2003, et Emmanuel Poulle, “ Les Astronomes parisiens au XIVe siè-cle et l’astronomie alphonsine ”, dans Histoire littéraire de la France, t. 43, fasc. 1, 2005, p. 1-54.Pour une description de ce mouvement, voir James Evans, The History and Practice of AncientAstronomy, Oxford University Press, New York, 1998, p. 274-280.
380 Michela Malpangotto
incapable de rendre compte de plusieurs phénomènes – il suffit de penser au pro-blème de la durée de l’année allant de pair avec les nombreuses tentatives deréforme du calendrier. Cette insatisfaction croissante envers le système tradition-nel culmine au XVIe siècle avec la proposition révolutionnaire avancée par Nico-las Copernic.
Il est unanimement accepté que la publication du De Revolutionibus orbiumcoelestium en 1543 a obligé les astronomes européens à se confronter à soncontenu, ce qui a ouvert une période de réflexion encore jamais connue dansl’histoire de la cosmologie occidentale. À côté de la proposition héliocentrique,correspondant à un choix radical, l’ouvrage de Copernic offrait par sa richesseplusieurs possibilités d’exploitation allant de l’amélioration du calcul des tables– on pense par exemple aux Tabulae Prutenicae d’Érasme Reinhold – au travailsur la mise au point d’hypothèses alternatives de systemate mundi. C’est seloncette dernière approche que Giovanni Antonio Magini32 conçoit ses Novae coe-lestium orbium theoricae congruentes cum observationibus N. Copernici,publiées à Venise en 1589. Dans cet ouvrage, l’astronome bolonais accepte l’ana-lyse copernicienne des mouvements de la Terre et de son axe, mais il transfèreces quatre mouvements de manière spéculaire sur autant de sphères supérieures :il suppose ainsi un univers géocentrique et géostatique à onze sphères où la onziè-me devient le Premier Mobile qui transmet sa rotation diurne aux sphèresinférieures ; à la dixième et à la neuvième sont assignées les deux librations – queCopernic attribuait à l’axe terrestre – ; enfin à la huitième sphère est à nouveauassignée la “ précession ” de Ptolémée.
Cette phase finale de l’évolution du système traditionnel est présentée dansl’Uranoscopia avec les mots suivants :
“ Enfin, Magini, à l’aide de Copernic, prit connaissance d’un quatrièmemouvement du levant au couchant et du couchant au levant qu’il appelamouvement de libration, par conséquent il supposa onze sphères en mou-vement, Clavius, en considérant cela dans le premier chapitre de la Sphèrede Sacrobosco, changea l’opinion qu’il avait jusque là soutenue d’un uni-vers à dix cieux en mouvement, et cela pour abandonner, avec Magini, lemouvement de trépidation et supposer les deux [mouvements] de libra-tion ”33.
Dans ce passage, Baranzano introduit pour la première fois le nom de Coper-nic. Toutefois, il lui attribue un rôle secondaire et presque marginal : avec“ Magini à l’aide de Copernic ”, il fait remarquer l’emploi instrumental des résul-
32. De riches informations biographiques et scientifiques sur Magini, ainsi qu’une analyse de sesidées astronomiques, se trouvent dans Antonio Favaro, Carteggio inedito di Ticone Brahe, GiovanniKeplero e di altri celebri astronomi e matematici dei secoli XVIe XVIIe con Giovanni Antonio Magini,tratto dall'Archivio Malvezzi de' Medici in Bologna, Zanichelli, Bologna, 1886 (reimpr. Nabu Press,2010).
33. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 128-134.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 381
tats coperniciens de la part de Magini, lequel, en les extrayant de leur contextenaturel, c’est-à-dire l’hypothèse héliocentrique, les a assujettis aux principes del’astronomie traditionnelle. Une astronomie profondément enracinée dans laculture occidentale, dont l’autorité de Clavius témoigne ici du pouvoir de persua-sion34.
Clavius, qui n’eut aucun rôle actif dans l’évolution des théories des sphèressupérieures, et dont la présence peut paraître inopportune dans ce contexte, a aucontraire un rôle de première importance dans la pensée de Baranzano, précisé-ment dans cette partie de son discours.
Les renvois fréquents au Jésuite du Collège romain dans l’Uranoscopia fontde celui-ci un point de référence et de confrontation important pour le père bar-nabite35. Tout au long de son activité d’enseignement, Clavius avait mis au pointl’édition de nombreux manuels parmi lesquels un commentaire de la Sphère deSacrobosco. Imprimé pour la première fois en 1570, cet ouvrage compte maintesrééditions dont le contenu est continuellement revu, enrichi et mis à jour parl’auteur lui-même jusqu’à la dernière édition datant de 161136. Toutes les ver-sions présentent comme valide le seul système du monde alors existant, à savoircelui “ d’Alphonse ”, à dix sphères. Ce n’est qu’après la publication de la contri-bution de Magini que finalement Clavius “ changea l’opinion qu’il avait jusque làsoutenue d’un univers à dix cieux en mouvement, et cela pour abandonner, avecMagini, le mouvement de trépidation ”. En effet, dans l’édition de 1593, le Jésuite
34. Sur Clavius et les positions des Jésuites vis-à-vis des problèmes posés par l’astronomie dansla période 1450-1632, l’ouvrage de référence reste Ugo Baldini, Legem impone subactis. Studi su filo-sofia e scienza dei Gesuiti in Italia 1540-1632, Bulzoni Editore, Roma, 1992. Voir également LuceGiard (éd), Les Jésuites à la Renaissance, système éducatif et production du savoir, Presses universi-taires de France, Paris, 1995.
35. Le commentaire de Clavius de la Sphère de Sacrobosco est un modèle sur lequel Baranzanoélabore ses propres leçons. Toutes les sections de l’Uranoscopia consacrées à l’astronomie tradition-nelle présentent une synthèse du contenu de la Sphère de Clavius en le reproduisant parfois à la lettre.Voir également supra n. 20.
36. Pour donner une idée du nombre de réimpressions, il suffit seulement de rappeler celles quiont été consultées pour cette étude : Rome, 1581 ; Rome, 1585 ; Venise, 1591 ; Lyon, 1593 ; Lyon,1594 ; Venise, 1601 ; Rome, 1606 ; et la dernière édition se trouve dans le troisième tome des ClaviiOpera mathematica, publiées à Mayence en 1611-1612. Cette dernière édition, publié l’année mêmede la mort de l’auteur, comporte également une dernière mise à jour. Clavius y fait état des nouveautésobservables dans le ciel grâce à la lunette et renvoie au Sidereus Nuncius publié par Galilée en 1610 :Nolo tamen hoc loco Lectorem latere, non ita pridem ex Belgio apportatum esse instrumentum quod-dam instar tubi cuiusdam oblongi, in cuius basibus compacta sunt duo vitra, seu perspicilla, quoobiecta a nobis remota valde propinqua apparent, et quidem longe maiora, quam reipsa sunt. Hocinstrumento cernuntur plurimae stellae in Firmamento, quae sine eo nullo modo videri possunt [...]Luna quoque, quando est corniculata, aut semiplena, mirum in modum refracta, et aspera apparet, utmirari satis non possim, in corpore Lunari tantas inesse inaequalitates. Verum hac de re consule libel-lum Galilaei Galilaei, quem Sidereum Nuncium inscripsit, Venetiis impressum anno 1610, in quovarias observationes stellarum a se primo factas describit. Inter alia, quae hoc instrumento visuntur,hoc non postremum locum obtinet, nimirum Venerem recipere lumen a Sole instar Lunae, ita ut cor-niculata nunc magis, nunc minus, pro distantia eius a Sole, appareat. Id quod non semel cum aliis hicRomae observavi. Saturnus quoque habet coniunctas duas stellas ipso minores, unam versus Orien-tem, et versus Occidentem alteram. Iuppiter denique habet quatuor stellas erraticas, quae mirum inmodum situm et inter se, et cum Iove variant, ut diligenter et accurate Galilaeus Galilaei describit(Christoph Clavius, In Sphaeram commentarius, Mayence, 1611-1612, p. 75).
382 Michela Malpangotto
ajoute une longue section : Sur le mouvement quadruple de la huitième sphèreselon l’opinion des astronomes plus récents37, dans laquelle il formule pour lapremière fois une critique sévère du modèle d’“ Alphonse ”. En effet, celui-cis’est révélé totalement inadéquat et incapable de rendre compte des phénomènesmêmes pour lesquels il avait été conçu. La gravité de la crise qui affecte lascience des astres, explique l’éloge qui introduit Copernic. Celui-ci est le restau-rateur éminent de l’astronomie, pour ne pas dire “ le nouveau Ptolémée, à qui lapostérité adressera toute son admiration et toute sa gratitude ” car à l’époquemoderne, il a sauvé l’astronomie en ayant finalement identifié et calculé les qua-tre mouvements qui entraînent le globe céleste entier38. Cependant, si la commu-nauté scientifique, dont Clavius se fait ici le porte-parole, reçoit de bon gré etavec reconnaissance ces résultats, elle refuse avec autant de conviction la solutionque Copernic a adoptée pour rendre compte de ces mêmes résultats. En effet,l’astronome polonais rend compte des phénomènes observés à travers un systèmenouveau où la Terre perd sa fonction de centre du monde et devient l’une des septplanètes, placée dans la quatrième sphère et pourvue de plusieurs mouvementsqui lui sont propres. Il s’agit d’hypothèses que Clavius juge “ absurdes et oppo-sées à l’opinion commune des hommes, pour ne pas dire téméraires ”39. Parconséquent, l’adverbe “ prudemment ”, par lequel il introduit la contribution deMagini, met en évidence le contraste net entre les extravagances de Copernic etla sagesse de l’astronome de Bologne qui, “ après avoir rejeté ces hypothèses ”des mouvements de la Terre, a concilié ces quatre mouvements et leur périodesétablies par Copernic, avec les hypothèses consolidées et universellement parta-gées par les philosophes et les astronomes. Des hypothèses en raison desquelless’impose la nécessité stricte de placer trois sphères au dessus du Firmament detelle façon que les onze sphères totales représentent pour Clavius la seule voieopportune pour sauver et rendre compte des phénomènes célestes certa ratione,
37. Christoph Clavius, In Sphaeram commentarius, Lyon, 1593, p. 64 : De quadruplici motu octa-vae sphaerae ex recentiorum Astronomorum sententia. Hactenus motum octavae sphaerae ex senten-tia Astronomorum, qui Alphonsum sequuntur, exposuimus, nunc de eodem ex nostra, et eorumsententia, qui Nicolaum Copernicum sequi malunt, disputabimus. Cette section, très longue, absentede toutes les éditions précédentes, y compris de celle de 1591, est ajoutée aux pages 64-78 de la ver-sion de 1593 et restera jusqu’à la dernière édition dans le Tome III des Opera mathematica, p. 33-42.
38. Ibidem, p. 67 : Quoniam igitur motus trepidationis phaenomenis quae variis temporibusobservata sunt, non solum non exquisite respondet, verum etiam pleraque eorum funditus evertit acdestruit, Nicolaus Copernicus Prutenus, nostro hoc seculo Astronomiae restitutor egregius, quem totaposteritas grato semper animo, tanquam alterum quendam Ptolemaeum celebrabit atque admirabitur,conferens suas cum omnium Astronomorum tum veterum, tum recentiorum observationibus, statuit ali-ter de motu octavae sphaerae esse philosophandum. Nam propter phaenomena, de quibus supra dic-tum est, tribuit octavo caelo quatuor motus diversos, praescriptis eorum periodis, sive tarditate, etvelocitate, una cum praeceptis, quibus ad datum tempus supputari possit et maxima Solis declinatio,et motus inaequalis stellarum fixarum, una cum anni magnitudine.
39. Ibidem, p. 68 : Quemadmodum autem quadruplicem istum motum octavae sphaerae, cumeorum periodis a Copernico praescriptis libenter recipimus, et amplectimur, ita modum quo in illisexplicandis utitur omnino reiicimus. Nam ut posteriores duos motus, seu potius librationes octavaesphaerae nobis ob oculos ponat, assumit absonas admodum et absurdas hypotheses et a communihominum sensu remotas, ne dicam temerarias, cum Solem statuat in mundi centro omnis motus exper-tem, terram autem multiplici praeditam motu, cum reliquis elementis ac lunari globo in tertio caelo,inter Venerem et Martem collocet.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 383
et de façon telle que les hypothèses admises n’entraînent aucune conséquenceabsurde40.
4.3. Mise en cause des sphères supérieures
Le dogmatisme duquel, d’après Clavius, dérive l’univocité de la solution d’ununivers à onze sphères en mouvement ne convainc plus Baranzano qui s’arrêtesur une réflexion introduite par une question désarmante tant elle est simple etlogique : “ Peut-on sauver les apparences et les phénomènes à travers une alia
40. Ibidem, p. 68-69 : Quocirca prudenter Ioannes Antonius Maginus Patavinus vir doctissimus,reiectis hisce hypothesibus, et retentis motuum periodis quas Copernicus constituit, quadruplicemillum motum octavae sphaerae tueri ac defendere conatur per hypotheses usitatas, et ab omnibusAstronomis et Philosophis receptas : quippe qui terrestrem hunc globum omni carentem motu in totiusuniversi centro, ut ratio postulat, collocet. Sed quemadmodum ex Alphonsinorum et recepta ad hancusque diem Astronomorum sententia, propter tres motus in caelo octavo deprehensos, cogimur duoscaelos mobiles supra orbem octavum constituere, ut supra est expositum : ita nunc ut quatuor ineodem caelo octavo motus observatos tueamur, opus est supra illud non solum duos orbes mobilescollocare, sed tres, ut iam non solum decem caeli mobiles cum Alphonsinis, sed omnino undecimconcedendi sint, si phaenomena caelestia certa ratione et probabiliter, ita ut nihil absurdi ex assump-tis hypothesibus sequatur, servare velimus et tueri.
Il s’agit des dernières conclusions, connues par la voie de l’imprimerie, de la réflexion astrono-mique de Clavius. Elles sont en parfaite cohérence avec les considérations que Clavius exprime à pro-pos de la théorie de Copernic dès la première édition du commentaire de la Sphère de Sacrobosco dansla partie consacrée au problème des mouvements planétaires. Clavius reconnaît à Copernic le mérited’avoir conçu une voie nouvelle en mesure de sauver les apparences et corriger les périodes desmouvements : [...] potuit, ut erat ingeniosissimus, novam viam excogitare, qua illae apparentiae com-modius (ut ipse putabat) defendi possent, et periodi motuum aliqua ex parte emendari, quas iam ani-madverterat claudicare [...].
En ce qui concerne la variation de la distance des planètes par rapport à la Terre, le père jésuitemène une analyse très précise et fait remarquer la différence substantielle de l’approche du problème,à savoir que, à partir de l’observation du phénomène, les astronomes avaient adopté les excentriqueset les épicycles, alors que pour Copernic ce phénomène devient une conséquence naturelle de la posi-tion de la Terre dans la troisième sphère céleste : Idcirco enim Astronomi hos orbes excogitarunt, quiacerto certius ex variis phaenomenis deprehenderunt, planetas non ferri semper aequali distantia aterra. Quod quidem libenter Copernicus admittit, cum secundum eius doctrinam planetae semperinaequalem a terra habeant distantiam, ut patet ex positione terrae extra centrum mundi in tertiocaelo.
Les hypothèses ptoléméenne et copernicienne sont toutes les deux confirmées par les données desobservations. Selon Clavius, les deux hypothèses sont donc tout aussi acceptables l’une que l’autre.Ce qui pourrait engendrer un doute quant au choix de l’une ou de l’autre. Toutefois, cette possibilitéde choix s’évanouit au moment même où elle est prise en compte : Quod si positio Copernici nihilfalsi, et absurdi involveret, dubium sane esset, utri opinioni, Ptolemaeine, an Copernici potius, [...]adhaerendum esset. Sed quoniam multa absurda, et erronea in Copernici positione continentur, utquod terra non sit in medio Firmamenti moveaturque triplici motu, quod qua ratione fieri possit, vixintelligo, cum secundum philosophos uni corpori simplici unus debeatur motus ; et quod Sol in centromundi statuatur, sitque omnis motus expers, quae omnia cum communi doctrina philosophorum, etAstronomorum pugnant, et videntur iis, quae sacrae literae plerisque locis docent, contradicere, [...].Encore une fois, dans ce passage de Clavius, la force du dissentiment trouve la confirmation la plussûre dans l’autorité des astronomes et des Écritures Saintes avec un appel final au principe d’Aristoteselon lequel un corps simple ne peut qu’avoir un seul mouvement simple : c’est à travers ce principeque Clavius rend manifeste l’impossibilité de concevoir le triple mouvement que Copernic assigne àla Terre.
Toutes les citations sont transcrites à partir de Christoph Clavius, In Sphaeram commentarius,Rome, 1581, p. 436-437 ; on les retrouve dans toutes les éditions suivantes et notamment aux pages519-520 de l’édition de Lyon, 1593, et à la page 301 de la dernière édition dans le tome III de l’Operamathematica, Mayence, 1611-1612.
384 Michela Malpangotto
via, une voie différente de celle à onze cieux ? Je vais prouver que c’est bien pos-sible si l’on présuppose certaines précisions ”41. L’écho de la question initiale,“ Étant supposée une pluralité de cieux, faut-il admettre onze, dix, neuf ou huit[sphères] en mouvement ? ”42, se retrouve ici et l’enseignant barnabite revient surles principes qui ont déterminé cette machinerie complexe d’un monde à onzesphères. Sur ce point, Baranzano s’éloigne de Clavius et en focalisant l’attentionsur ces principes précisément, il établit que, loin d’être probati, ces principes doi-vent plutôt être reconsidérés avec une attitude critique et soumis à un réexamenobjectif visant à établir leur validité sur la base de leur actuation effective etconcrète dans la réalité céleste. Plus précisément, le principe fondamental de laphysique céleste impose que toute sphère, en tant que corps de nature simple, nepeut avoir qu’un seul mouvement propre, alors qu’elle peut recevoir – et trans-mettre à son tour – les mouvements lui provenant ab extrinseco. Cet “ axiome ”est fort restrictif et oblige à trouver l’explication des révolutions célestes à traversun autre principe, lui aussi fort restrictif, qui règle de manière rigide la dynamiquecommune aux sphères célestes. Les mouvements sont alors transmis par contactdes sphères plus externes en descendant à toutes les sphères inférieures. Ainsi, parexemple, la simple rotation diurne, produite comme mouvement propre du Pre-mier Mobile, se transmet progressivement, de telle façon que “ chaque partie duciel doit accomplir une circulation entière dans l’intervalle de vingt-quatreheures ”43. Cette synchronie parfaite du tout, conçue pour sauver les phénomènes,est un attribut nécessaire de la nature même du cinquième élément, l’éther, quirend le monde céleste de la sphère de la Lune jusqu’à la onzième sphère leroyaume de la perfection et de l’immutabilité.
Baranzano, comme l’atteste le contenu de l’Uranoscopia, était bien au courantdes témoignages des anciens observateurs du ciel et encore plus des nouveautésrécemment décelées sur la voûte céleste par ses contemporains44. L’apparitiond’étoiles nouvelles au cours des siècles, les découvertes récentes de Galilée qui,avec sa lunette, révèle l’existence des satellites de Jupiter, la forme de Saturnecomposée de “ trois corps ”, ou l’inégalité de la surface lunaire offrent des raisonsvalables pour mettre en doute l’actuation du fonctionnement parfait de cettemachinerie complexe du monde engendrée par la tradition. D’après le pèreRedento peuvent intervenir dans la réalité céleste des éléments d’imprécision, desfacteurs perturbants qui vont entraver ce processus de transmission des mouve-ments en raison, par exemple, de la résistance pouvant s’exercer entre une sphèreet l’autre, ou de la distance énorme venant s’interposer entre la sphère qui est à
41. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 137-139.42. Voir supra 4.1. “ An posita pluralitate coelorum ponendi sint undecim mobiles an decem an
novem an octo ”, An posita pluralitate coelorum ponendi sint undecim mobiles an decem an noveman octo.
43. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 140-144.44. Voir Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, Genève, 1617, p. 79-80 et Ibidem, Pars
secunda, p. 123-124, p. 126-127, p. 145-146.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 385
l’origine du mouvement et celles qui le reçoivent progressivement, mais aussi dela nature même des corps mus.
Si la réalité ne se réalise pas selon la rigueur imposée par les principes, cesmêmes principes doivent alors être considérés comme totalement invalides et lanécessité, qu’ils imposent, de multiplier les sphères et les mouvements vient ainsià disparaître. Cela signifie qu’il est possible de concevoir un univers duquel dis-paraissent les cieux supérieurs au Firmament et il devient alors possible de pensersauver les phénomènes à travers l’immobilité de l’immense masse éthérée, enlaissant juste les astres en mouvements “ sans qu’aucune conséquence absurde nes’en suive ”45.
La réflexion préalable nécessaire à la formulation d’une réponse autonome àla question posée en ouverture, An posita pluralitate coelorum ponendi sintundecim mobiles an decem an novem an octo, a désormais été menée dans seslignes essentielles et Baranzano s’adresse en discours direct au lecteur pour met-tre en avant le fait qu’il a maintenant la liberté la plus totale pour choisir eligaslui-même le nombre de sphères dont l’univers est formé : onze si, avec la tradi-tion suivie par Magini, on veut assigner un seul mouvement simple à chaquesphère ; dix si l’on admet la possibilité d’assigner deux mouvements au mêmeciel ; neuf ou huit si l’on admet que les mouvements célestes puissent ne pas êtreparfaitement circulaires46.
Libéré de la nécessité qui impose l’existence des sphères supérieures au Fir-mament, le père Redento peut maintenant entamer la tâche qu’il s’était fixée etdonner finalement un nom à la voie alternative, l’alia via, que l’on peut envisageravec le même degré de possibilité accordé jusqu’alors à la voie traditionnelle : ils’agit de l’opinion de Copernic, sententia Copernici47.
5. Baranzano et le système de Copernic
5.1. De ordine coelestium sphaerarum
La vision paritaire des deux systèmes, traditionnel et copernicien, est immé-diatement rendue manifeste à travers l’évidence graphique de cette image qui,unique en son genre, ouvre cette partie du discours consacrée à l’ordre des sphè-
45. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 145-156. Dans cette remarque si pos-sunt, per destructionem huius principii ad quam nullum sequitur absurdum, salvare omnes apparen-tias cur multiplicandi erunt motus et caelestes orbes (Ibidem, lignes 148-151), Baranzano souligneque la destructio du principe traditionnel n’entraîne aucune conséquence absurde et ouvre donc la pos-sibilité de réduire le nombre de sphères célestes. On peut y reconnaître une attitude ouvertement polé-mique vis-à-vis de la conclusion de Clavius d’après qui l’univers à onze sphères était la seule manièrede sauver les phénomènes célestes sans entraîner de conséquence absurde : ita ut nihil absurdi exassumptis hypothesibus sequatur (Christoph Clavius, In sphaeram commentarius, Lyon, 1593, p. 68-69). Voir supra la partie conclusive du paragraphe 4.2- L’origine et les développements du systèmetraditionnel
46. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 170-192 et lignes 210-217.47. Ibidem, lignes 223-224.
386 Michela Malpangotto
res célestes en donnant une représentation claire des deux mondes qui coexistentde façon spéculaire sur la même sphère48.
Redento Baranzano, Urasnoscopia, Pars prima, Genève, 1617, p. 103 ; voir également Appendice, 1. 242-243.
La partie inférieure représente le système traditionnel avec la Terre au centre,les sept planètes et les quatre cieux supérieurs à savoir le Firmament, le Cristallin,le “ ciel de la première libration ”, et le Premier Mobile.
La partie supérieure représente le système de Copernic avec le Soleil au cen-tre, les sept planètes parmi lesquelles la Terre, entourée de la Lune, se trouve dansla quatrième sphère céleste. Comme le met très bien en évidence le vide de lalarge couronne circulaire externe, les cieux supérieurs au Firmament ont dis-paru49.
La présentation du système de Copernic reste essentielle. Elle se maintient àun niveau descriptif en mettant tout d’abord en évidence, de manière mêmeredondante, l’immobilité du Firmament dont le mouvement perçu par l’observa-teur terrestre n’est pas réel mais est plutôt le résultat de ce qui apparaît à la vued’un observateur placé sur une Terre en mouvement :
“ La huitième sphère ne bouge en aucune façon mais se tient immobile. Eneffet, quand une étoile se lève ou se couche pour nous, ce lever et ce cou-cher ne sont pas engendrés par le mouvement de la huitième sphère maispar le mouvement de la Terre, bien qu’il nous semble que ce soit celle-là
48. On n’a pas connaissance d’image semblable à celle-ci qui représente à la fois deux systèmesdu monde différents sur la même sphère. Cette image ouvre la section intitulée De ordine coelestiumsphaerarum (Ibidem, ligne 221).
49. Ibidem, lignes 237-242.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 387
[la huitième sphère] qui se meut, de la même manière, ceux qui naviguentconsidèrent que les arbres, les villes et les régions défilent, et qu’eux-mêmes restent immobiles, alors que l’inverse se produit ”50.
La Terre perd sa fonction de centre immobile de l’univers pour acquérir unrôle actif dans la dynamique céleste. Au seul globe terrestre sont ainsi assignésplusieurs mouvements différents qui lui sont propres, à savoir :
– la rotation diurne qu’elle accomplit en vingt-quatre heures autour de sonaxe, du couchant au levant ;
– la révolution annuelle qu’elle accomplit en parcourant la quatrième sphèredu couchant au levant ;
– le mouvement “ de l’axe terrestre qui tantôt se meut vers le sud tantôt versle nord en changeant de déclinaison ” ;
– les deux librations51.
Ces mouvements sont décrits en expliquant la façon dont ils engendrent toutesles apparences et les phénomènes normalement observés, à savoir la distinctiondu jour et de la nuit qui dans les régions polaires durent six mois, le mouvementannuel apparent du Soleil tout au long des constellations du zodiaque, la variationdurant l’année des arcs diurnes et nocturnes à la même latitude, la succession dessaisons et la précession des équinoxes (mutatio aequinoctiorum)52.
L’analyse ainsi développée montre qu’il est possible d’attribuer à la théoriecopernicienne un degré de probabilité et de possibilité tout à fait équivalent àcelui de la sententia communis. Cela confirme et donne finalement raison àl’image d’ouverture qui présentait par symétrie ces deux opinions.
Toujours dans ce même esprit de rapprochement et de confrontation des deuxsystèmes, Baranzano focalise l’attention sur un point crucial touchant l’ordre dessphères célestes, de ordine coelestium sphaerarum, pour évoquer les argumentsqui ont été avancés en soutien à chacune de ces deux dispositions différentes del’univers : pour l’ordre traditionnel, restent valables les raisons rationes pro taliordine qui ont été confirmées et renforcées au cours des siècles, et que Baranzanoemprunte au commentaire de Clavius à la Sphère de Sacrobosco53 ; alors quel’ordre nouveau du monde est confirmé par les affirmations avancées par Coper-nic lui-même dans le premier livre du De Revolutionibus afin de confirmer sonopinion : Copernicus libro primo Revolutionum capitulo decimo et alibi pluribussupradictam sententiam confirmat54.
50. Ibidem, lignes 243-248.51. Ibidem, lignes 249-257 et lignes 290-292.52. Ibidem, lignes 258-289.53. Voir Ibidem, lignes 533-572.54. Voir Ibidem, lignes 312-366.
388 Michela Malpangotto
5.2. La critique de Baranzano à l’idée d’une Terre dans la quatrième sphèrecéleste
Dès que la communauté scientifique commence à considérer le système hélio-centrique non seulement comme une simple hypothèse mathématique, mais aussicomme une représentation réelle de l’univers, celui-ci devient une menace dange-reuse pouvant déstabiliser un cosmos établi et renforcé au cours des siècles. Laréaction est alors immédiate et correspond précisément aux attentes de Copernic,lequel avait bien prévu “ combien absurde ” aurait été estimé son discours55.
Les “ objections qui peuvent se dresser contre Copernic ” pour invalider sonsystème s’appuient, selon Baranzano, sur des raisons multiples et variées : ellespeuvent dériver de l’autorité des Écritures Saintes ; provenir de la faculté de nossens ; être tirées de l’analyse de la nature du mouvement – circulaire ourectiligne –, de la mobilité de la Terre, de l’ordre et de la position des sphèrescélestes, ou encore même provenir d’arguments tout à fait absurdes. Générale-ment, c’est précisément sur la base d’un mélange de toutes ces raisons que lathéorie copernicienne est jugée radicalement “ absurde ” dans son ensemble :
“ Comme les objections qui peuvent se dresser contre Copernic sont tiréessoit des Écritures Saintes, soit de notre vue, soit de la nature du mouve-ment, soit de la mobilité et de la place des sphères, soit de la comparaisonde la Terre avec les autres planètes, soit encore d’absurdités : en généralcette opinion est jugée absurde ”56.
Baranzano se fait le porte-parole de l’opposition générale en devenant à la foisinterprète et juge des critiques en train de se répandre dans le milieu scientifiqueet savant de son époque. Il prend soigneusement en compte les différentes objec-tions afin d’en révéler le manque de fondement, comme il le déclare lui-même :Quomodo solvantur ea quae proponantur contra Copernicum57. Les argumentsqu’il utilise sont tout à fait originaux et subjectifs, ils révèlent et mettent enlumière les convictions profondes du père barnabite quant à la théorie coperni-cienne dans ses trois composantes fondamentales : le Soleil au centre du monde,la mobilité de la Terre, la Terre dans la quatrième sphère céleste. Les argumentsqu’il développe, notamment à propos de la place assignée à la Terre dans la qua-
55. Nicolas Copernic, De Revolutionibus orbium coelestium, Ad Sanctissimum Dominum PaulumIII Pontificem Maximum Nicolai Copernici Praefatio in libros Revolutionum, Nuremberg, 1543, c.sign ij verso et iij recto ;. traduction en langue française par Alexandre Koyré, Des Révolutions desOrbes Célestes, Diderot Éditeur, 1998, p. 33-34 : “ [...] lorsque je me représentais à moi-même com-bien absurde vont estimer cette αχροαμα ceux qui savent être confirmée par le jugement des sièclesl’opinion que la terre est immobile au milieu du ciel comme son centre [...] Comme donc j’examinaisceci avec moi-même, il s’en fallut de peu que, de crainte du mépris pour la nouveauté et l’absurditéde mon opinion, je ne supprimasse tout à fait l’œuvre déjà achevée ”. La référence à l’ “ absurdité ”de son opinion se retrouve également tout au long du livre premier du De Revolutionibus, voir notam-ment le chapitre V du livre I (p. 53-54 dans la traduction d’Alexandre Koyré, 1998).
56. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 369-373.57. Ibidem, ligne 368.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 389
trième sphère, constituent un point crucial de son analyse qui, d’une part, imposel’adoption d’une perception différente et nouvelle des phénomènes par un obser-vateur placé sur une Terre, non seulement éloignée du centre, mais aussi pourvuede plusieurs mouvements ; et d’autre part oblige à reconsidérer les relations et lesrapports entre la sphère occupée par notre planète et celles qui portent les autrescorps célestes, et en particulier avec les dimensions de l’univers entier.
Tout au long de sa présentation du système nouveau, Baranzano avait déjàillustré les mouvements de la Terre et décrit la façon dont tous les phénomènes etles apparences tirent leurs origine (oritur, nascitur) en vertu de leur interactionavec le Soleil. À chaque mouvement terrestre ont été ponctuellement associés leseffets qui en résultent, et cette correspondance est tellement évidente et plausiblequ’elle rend sans fondement l’objection male Clavius deducit, avancée par Cla-vius selon qui, en dehors du schéma ptoléméen, les équinoxes ne pourraientjamais avoir lieu et aucun lieu n’existerait sur Terre où le jour pourrait avoir lamême durée que la nuit58.
Tout comme Copernic, Baranzano soutient que cette synchronie parfaite n’estpas altérée, même par la présence de la Lune, placée dans le même ciel que laTerre, alors que selon les adversarii, la disposition nouvelle, voulue par Copernicpour ces trois corps célestes, aurait nécessairement dû avoir des répercussionsévidentes sur les éclipses, lesquelles n’auraient plus eu lieu selon les modalités etles circonstances habituellement relevées et observées. L’analyse de ces élémentsmontre que Baranzano a parfaitement saisi la dynamique de l’hypothèsecopernicienne : pour les phénomènes concernant exclusivement les deux luminai-res et leur interaction avec l’observateur terrestre, il maîtrise pleinement les impli-cations engendrées par l’inversion de perspective due aux nouvelles positionsassignées au Soleil, à la Terre et à la Lune. À ce niveau, la théorie coperniciennea encore le même degré de probabilité que le système traditionnel. Cependant,l’innovation de Copernic ne s’arrête pas là. L’astronome polonais a en effet déme-surément amplifié l’univers en le rendant incomparablement plus immense quecelui de la tradition. Non seulement le diamètre du globe terrestre n’est qu’unpoint dans l’immensité du Firmament, mais même le diamètre de l’orbite terrestrene devient lui aussi qu’un point par rapport à la sphère des étoiles fixes : “ ladimension du monde est telle que, [...] par rapport à la sphère des fixes, elle [ladistance du Soleil à la Terre] apparaît nulle ”59. La sphère des étoiles fixes “ estassurément le lieu de l’univers auquel se rapportent le mouvement et la positionde tous les autres astres ”60. De cette façon, la distance démesurée entre la sphèrede la Terre et celle des étoiles rend imperceptible le mouvement annuel de notrepropre planète, ou plutôt le reflet de ce mouvement “ car pour tout [objet] visible
58. Ibidem, lignes 293-310. Cf. Christoph Clavius, In Sphaeram commentarius, Lyon, 1593,p. 154-157.
59. Nicolas Copernic, De Revolutionibus, Livre I, Chapitre X, Nuremberg, 1543, c. 9r ; traductionen langue française par Alexandre Koyré, Des Révolutions des Orbes Célestes, Diderot Éditeur, 1998,p. 73.
60. Ibidem, p. 74.
390 Michela Malpangotto
il y a une certaine distance, au delà de laquelle on ne le voit plus ”61. La Terreelle-même est donc un point dont le mouvement est infime par rapport au tout.Par conséquent, le même axiome de la tradition reste toujours valable chezCopernic. Selon cet axiome “ Quel que ce soit le lieu sur Terre sur lequel il setrouve, l’homme voit la moitié du ciel ”62.
Dans cette nouvelle vision du monde se manifeste “ l’invraisemblable har-diesse de la pensée copernicienne ”63. Une hardiesse que Baranzano n’est pas prêtà concevoir et par conséquent à partager. Le père barnabite ne va pas au-delà desdimensions de l’univers ptoléméen à l’intérieur duquel il insère l’ordre du mondevoulu par Copernic. Ainsi, dans le contexte qu’il imagine, l’hypothèse d’uneTerre située dans la quatrième sphère entre en contradiction avec l’évidence desphénomènes exprimés par les axiomes : il n’est pas possible de voir exactementla moitié de la voûte céleste depuis une Terre située dans la quatrième sphère,ainsi que l’admettrait Copernic selon Baranzano : Procedere illud axioma contrasuppositionem Copernici qui enim dixerit Terram esse extra centrum mundi, nondubitabit etiam dicere non videri totam medietatem64. De même, les étoilesn’apparaîtraient pas toutes aussi lumineuses et par conséquent aussi distantes. EtBaranzano explique avec ces mots quelle serait selon lui la réalité vue par unobservateur depuis une Terre qui tourne sur elle-même et accomplit en mêmetemps sa révolution autour du Soleil : “ les étoiles nous apparaissent presque tou-jours à la même distance bien qu’elles soient tantôt plus lointaines tantôt plusproches ”. En effet, “ nous pouvons seulement voir les étoiles situées en face denous durant la nuit ”, par conséquent nous les voyons vraiment toutes à la mêmedistance car, pendant la révolution annuelle autour du Soleil, la distance qui sépa-re la Terre de la sphère des étoiles fixes reste toujours la même. En réalité, si nouspouvions saisir la voûte céleste toute entière, nous verrions que les étoiles situéesen face de nous durant le jour sont plus lointaines que celles que nous voyonsdurant la nuit ut patet ex suppositione Copernici65.
Les conséquences de cet univers copernicien comprimé dans les limites del’espace ptoléméen sont claires : cet univers ne se contente que de sauver artifi-ciellement les apparences alors qu’il est en totale contradiction avec la rigueurgéométrique et avec la réalité confirmée par les axiomes. Les dimensions del’univers de Baranzano n’annulent pas le rayon de l’orbite terrestre sur la voûtecéleste et cela empêche le père barnabite de concevoir l’existence d’une Terredans la quatrième sphère céleste66.
61. Ibidem, p. 76.62. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 401-402.63. Alexandre Koyré, Des Révolutions des Orbes Célestes, Diderot Éditeur, 1998, p. 4.64. Voir Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 401-413.65. Voir Ibidem, lignes 417-423.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 391
5.3. Baranzano et Copernic sur la possibilité d’assigner le mouvement à laTerre
Baranzano n’accepte donc pas l’idée que la Terre puisse être déplacée dans laquatrième sphère céleste pour y accomplir un mouvement de révolution autour duSoleil, alors que le Soleil lui soustrait la fonction de centre de l’univers. Malgrécela, il trouve dans le De Revolutionibus les motivations utiles pour poursuivre demanière cohérente le développement de son analyse visant à la construction d’unedisposition valable du monde qui, à ce point, ne peut plus être le monde deCopernic.
Le père barnabite a déjà démantelé, avec des arguments tout à fait originaux,les principes aristotéliciens qui réglaient les mouvements des sphères célestesdans la cosmologie traditionnelle67. Copernic lui offre maintenant les argumentspour s’affranchir également du principe qui, depuis des siècles, fonde la physiquedu monde sublunaire selon lequel : “ un corps simple ne peut avoir qu’un seulmouvement simple ”. À ce sujet, Baranzano devient catégorique : il oppose auxarguments de la tradition des affirmations presque axiomatiques, sans s’étendreultérieurement sur des explications ou des preuves de validité.
Il met en cause ce principe dans son essence même, surtout par rapport aucaractère absolu et univoque de la signification qu’Aristote assigne aux deux ter-mes qui sont impliqués : ceux-ci doivent être redéfinis et réexaminés en fonctiondu monde auquel ils sont appliqués. Et donc, dans le monde sublunaire, le mou-vement rectiligne ne peut pas être considéré comme un mouvement simple
66. Le désaccord de Baranzano vis-à-vis de la position de la Terre dans la quatrième sphère devi-ent explicite quand il déclare ouvertement de quelle façon il est possible d’affaiblir les arguments surlesquels Copernic avait fondé son système : Quomodo solvantur argumenta Copernici. Parmi lespropositiones de cette section, les deux premières (Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima,lignes 505-514) sont dignes d’être considérées surtout en comparaison avec la quatrième propositiode la partie consacrée à Quibus fundamentis innitatur Copernicus (Ibidem, lignes 326-332). Depuisplusieurs siècles, l’observation du ciel avait révélé des irrégularités de mouvements des planètes,lesquelles apparaissent parfois plus proches et parfois plus éloignées de la Terre. Les astronomes, ensuivant Ptolémée, avaient partiellement résolu ce problème avec l’introduction des excentriques et desépicycles. Selon Copernic, une preuve évidente de la validité et de la supériorité de son système étaitprécisément la capacité de fournir une explication pour toute irrégularité à travers une seule cause : laTerre en mouvement dans la quatrième sphère. Ainsi, “ [les planètes] se rapprochent toujours le plusde la terre lorsqu’elles se lèvent le soir, c’est-à-dire, lorsqu’elles sont en opposition avec le soleil, laterre étant entre elles et le soleil ; elles sont par contre le plus éloignées lorsqu’elles se couchent lesoir, [c'est-à-dire] lorsqu’elles sont occultées près du soleil, lorsque, notamment, nous avons le soleilentre elles et la terre ” (Nicolas Copernic, De Revolutionibus, Livre I, Chapitre X, c. 8v ; traductionfrançaise par Alexandre Koyré, Des Révolutions des Orbes Célestes, Diderot Éditeur, 1998, p. 72 ; cf.Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 326-332). Baranzano reprend ce phénomènepour nier qu’il soit le résultat d’un déplacement réel. Il fait appel aux lois de l’optique selon lesquelles“ plus un corps est lumineux [...] plus il semble rapproché [...] moins il est lumineux, plus il sembleéloigné ” (Ibidem, lignes 505-508). Pour l’enseignant barnabite, la vraie cause de ce déplacementapparent n’est qu’une variation de luminosité, c’est pourquoi “ quand les planètes ou les étoiles selèvent le soir, elles nous apparaissent plus lumineuses car, le Soleil s’évanouissant progressivement,elles peuvent diffuser leur lumière avec plus d’intensité ; alors que quand elles se lèvent le matin, ellessont moins lumineuses car, la lumière du Soleil s’intensifiant, leur luminosité diminue et ceci est lacause pour laquelle les planètes semblent plus proches [de la Terre] lorsqu’elles se lèvent le soir etsemblent plus éloignées [de la Terre] lorsqu’elles se lèvent le matin ” (Ibidem, lignes 509-514).
67. Voir supra 4.3- Mise en cause des sphères supérieures.
392 Michela Malpangotto
– comme la tradition aristotélicienne l’imposait – car il s’accomplit en réalitécomme la résultante de la combinaison de deux mouvements, l’un circulaire,l’autre rectiligne :
“ Copernic nie que le mouvement de haut en bas et de bas en haut est sim-ple. En effet, il se compose également du mouvement circulaire puisquelorsqu’un corps se dirige vers le bas, il se meut simultanément de manièrecirculaire. D’après ce que l’on vient d’affirmer, on ne peut tout simple-ment pas dire que le mouvement vers le centre est un mouvement simplecar il ne s’accomplit pas simplement tout au long d’une ligne simplementdroite ”68.
Le concept de corps simple doit lui aussi être réexaminé et redéfini en vertude la nature et de la forme même du corps. Il en découle alors qu’à la Terre, enraison de sa nature – qui s’exprime par la gravité innée et la cohésion au centrede ses parties – appartient le mouvement rectiligne, ainsi que le mouvement cir-culaire en raison de sa forme sphérique69. C’est justement la combinaison de cesdeux mouvements qui permet à la Terre d’accomplir sa rotation diurne sans quen’aient lieu les conséquences terribles craintes par les tenants de la tradition,d’après lesquels notre globe se désagrégerait et les édifices s’écrouleraient :
“ Si donc, dit Ptolémée d’Alexandrie, la terre tournait, du moins en unerévolution quotidienne, [...] ce mouvement qui, en vingt-quatre heuresfranchit tout le circuit de la terre, devrait être extrêmement véhément etd’une vitesse insurpassable. Or les choses mues par une rotation violentesemblent être totalement inaptes à se réunir, mais plutôt unies [devoir] sedisperser, à moins qu’elles ne soient maintenues en liaison par quelqueforce. Et depuis longtemps déjà, dit-il, la terre dispersée aurait dépassé leciel même [...] ”70.
Au contraire, en plein accord avec Copernic, Baranzano précise que ce mou-vement naturel n’est pas violent, et que, par conséquent, il se réalise selon uneproportion et une harmonie telles qu’il ne provoque aucun écroulement ni aucuneruine (improportionem vel ruinam)71.
68. Voir Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 446-450. Baranzano reprend lesarguments avancés par Copernic dans le chapitre VIII du premier livre du De Revolutionibus : “ Quantaux choses qui tombent et qui s’élèvent, nous avouerons que leur mouvement doit être double par rap-port au monde et, généralement, composé de rectiligne et de circulaire ” (Nicolas Copernic, De Revo-lutionibus orbium coelestium, Nuremberg, 1543, c. 6r ; traduction française par Alexandre Koyré, DesRévolutions des Orbes Célestes, Diderot Éditeur, 1998, p. 64).
69. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 440-446.70. Nicolas Copernic, De Revolutionibus orbium coelestium, Nuremberg, 1543, c. 5r-5v ; traduc-
tion française par Alexandre Koyré, Des Révolutions des Orbes Célestes, Diderot Éditeur, 1998, p. 61.71. Voir Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 460-468.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 393
Une fois légitimée la possibilité de la rotation du globe terrestre, il devientpossible aussi de faire participer à ce même mouvement aussi l’air qui entoure laTerre, de la même manière que, d’après les adversarii, la partie la plus élevée del’atmosphère participerait au mouvement céleste :
Quando movetur Terra trahit secum aërem eo modo quo adversarii dicuntLunam secum trahere ignem et supremam aëris regionem […].
Baranzano, en accueillant pleinement les arguments de Copernic, met en évi-dence la façon dont la tradition, dans le but d’expliquer le chemin apparent descomètes, avait établi une continuité entre la rotation parfaitement circulaire de lasphère de la Lune et la zone élémentaire adjacente, selon un mouvement solidairequi introduisait ainsi la perfection du mouvement circulaire dans la région sublu-naire (caractérisée par la corruptibilité et le mouvement rectiligne) en franchissantla rupture nette et inviolable entre monde céleste et monde élémentaire. Ce sontdonc les plus fidèles tenants du système traditionnel qui suggèrent à Copernic lapossibilité que, étant admis le mouvement axial de la Terre, celle-ci n’entraîneégalement avec elle la région de l’air en la faisant participer à la rotation diurne.Si l’on admet cette possibilité, l’argument qui d’habitude est porté à l’encontre dumouvement terrestre se dissout immédiatement. Cet argument veut qu’une flècheprojetée vers le haut ne tombera pas à l’endroit depuis lequel elle a été lancée :
Hinc solvitur illud argumentum quo contra nos deducitur : ex motu Terraesagittam in altum proiectam non descensuram ad eundem locum […]72.
Dans cette phrase, il est important de remarquer le choix expressif de Baran-zano. Au lieu de mettre en évidence le mouvement de la Terre à l’encontre duquell’objection est dirigée, il préfère porter l’attention sur les personnes qui le sou-tiennent, auxquelles il s’associe lui-même dans un contra nos collectif. Ce nosrevêt une importance clé pour la compréhension profonde du texte : il apparaîtplusieurs fois dans ces sections de l’ouvrage et pourrait être interprété simplementcomme une adhésion générique à la théorie copernicienne in toto. En réalité,Baranzano ne l’emploie que dans les propositiones où il est question de discuterla seule hypothèse du mouvement de la Terre. Et cette attitude de participationactive est bien différente du caractère tout à fait impersonnel et détaché aveclequel le père barnabite a abordé l’analyse de l’hypothèse copernicienne d’uneTerre placée dans la quatrième sphère, en attribuant ponctuellement la paternitéde cette idée au seul Copernic (ut patet ex suppositione Copernici) et en lui refu-sant en fin de compte toute validité73.
72. Voir Ibidem, lignes 451-459.73. Voir supra 5.2- La critique de Baranzano à l’idée d’une Terre dans la quatrième sphère céleste
l’idée d’une Terre dans la quatrième sphère céleste.
394 Michela Malpangotto
6. Le système de Baranzano
Baranzano était sans aucun doute conscient du caractère non conventionnel deses idées et l’Uranoscopia – la version écrite des cours qu’il avait donné au Col-lège Chappuisien d’Annecy – confirme qu’il voulait assumer vis-à-vis de ses élè-ves le rôle d’informateur qui décrit de manière objective l’état des connaissancesastronomiques de l’époque. On ne trouve, en effet, aucune expression explicitedes convictions personnelles de l’enseignant dans la totalité de l’ouvrage. Uneseule exception existe, dont seul Giovanni Battista Muratori, le disciple qui avaitsuivi son cours de 1616 à 1617 et qui éditera ensuite l’ouvrage74, peut saisir lesens dans toute sa portée. Il ne s’agit que d’un passage très bref qui revêt uneimportance cruciale car il clarifie la pensée de Baranzano.
La cohérence de fond, qui a guidé toute l’analyse développée par le père bar-nabite, montre que chaque conclusion à laquelle il parvient progressivement dansson discours n’est pas l’expression de jugements isolés : prises dans leurs ensem-ble ces conclusions révèlent plutôt tout un parcours qui a servi à légitimer et àconstruire un schéma du monde tout à fait personnel et original :
[…] imo in mea propria [sententia] statuente Terram in centro mobilimotu diurno, aeque bene ponitur libratio in Terra, et cetera75.
Selon Baranzano, la Terre reste au centre de l’univers mais – étant légitiméeau mouvement – possède une rotation diurne et deux légères oscillations de libra-tion.
Restée latente tout au long de l’ouvrage, cette idée est révélée dans ses pointsles plus essentiels par cette seule phrase, très brève, que Giovanni Battista Mura-tori, bien conscient de son importance, n’omet pas de rapporter dans l’édition del’Uranoscopia. Le disciple connaissait la réserve de son maître et sa volonté dene pas laisser transparaître ses idées personnelles à tous ses élèves sans distinc-tion, en raison de l’“ audace ” de ses convictions astronomiques, notamment ausujet des mouvements terrestres. Muratori, dans la préface de l’œuvre, révèle que,à plusieurs reprises et à titre tout à fait confidentiel, Baranzano lui avait dévoilél’édifice de son système du monde. Ainsi, la phrase synthétique, échappée àl’enseignant dans la seconde partie de l’Uranoscopia, confirme et donne son fon-dement à la déclaration plus prolixe de Muratori. Dans leur ensemble ces deuxtémoignages révèlent la structure du monde voulue par Baranzano :
“ […] il juge en effet que la Terre, placée au centre, tourne selon la rota-tion diurne et les deux mouvements de libration, Saturne effectue unerévolution en trente ans, Jupiter en douze, Mars en deux et cetera, il en sui-vrait donc que, si la Terre restait immobile, le Soleil ne se lèverait qu’une
74. Voir supra 1- Introduction et 3- L’Uranoscopia seu De coelo.75. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars secunda, Genève, 1617, p. 42.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 395
fois par an, la Lune une fois par mois, Saturne une fois tous les trente anset de même pour toutes les autres, chacune selon son propre mouve-ment ”76.
Il s’agit d’un système qui s’inspire à la fois de l’influence d’éléments inno-vants empruntés à Copernic et d’une structure générale dérivée de la tradition, letout élaboré avec un point de vue tout à fait original. Baranzano partage etaccepte l’immobilité copernicienne de la masse céleste entière – permettant d’éli-miner les sphères anastres supérieures au Firmament –, mais il respecte le mêmeordre que la tradition aristotélico-ptoléméenne avait assigné aux corps célestes :les planètes accomplissent alors leurs révolutions, et parmi elles, le Soleil tournetoujours dans la quatrième sphère et est ainsi le responsable du mouvementannuel et des saisons, alors que la Terre garde sa position au centre de l’universmais, dans le sillage de Copernic, est libre de tourner autour de son axe pouraccomplir la rotation diurne – qui engendre l’alternance du jour et de la nuit –alors que son axe effectue aussi, lentement, les deux librations.
7. Le système de Baranzano et les Écritures Saintes
Cette analyse de l’Uranoscopia ne peut pas s’arrêter ici. Connaître l’universde Baranzano dans ses présupposés scientifiques et cosmologiques ne signifie pasconnaître la totalité des réflexions et des raisons qui ont amené le jeune Barnabiteà y croire fermement. Il reste encore à mettre en relation cette vision nouvelle dumonde avec le texte sacré pour y rechercher des confirmations possibles lui don-nant fondement et renforçant sa validité. Pour ce faire, il est nécessaire de revenirà la section Quomodo solvantur ea quae proponantur contra Copernicum danslaquelle Baranzano se propose d’invalider les objections principales avancées àl’encontre du système de Copernic.
Un élément commun à la conception du monde de Baranzano et à celle deCopernic est d’avoir assigné le mouvement au globe terrestre. En plein accordavec l’astronome polonais, le père barnabite a tiré du De Revolutionibus toutes lesargumentations nécessaires pour légitimer cette hypothèse sur le plan physique.Cependant, au-delà de cet élément important et décidément novateur, le cadregénéral de l’univers conçu par le père Redento est moins téméraire que celui deCopernic. L’analyse, développée dans l’Uranoscopia, du système héliocentriquedans ses différents aspects constitutifs, a bien montré que le Barnabite ne partage
76. Giovanni Battista Muratori, Uranoscopiae studioso Salutem, Genève, 1617, p. 8-9 : [...] tibipatefacio, plures ipsum habere opiniones mihi saepius declaratas, quas imbecillibus discipulorum ani-mis proponere non est ausus, et terrae motum in sententia pariter communi, audacter sustineret, putatenim terram in centro collocatam, diurno et duplici librationis motu circumvolui, Saturnum solotriginta annorum spatio circumduci, Iovem duodecim, Martem duorum et cetera ex quo sequereturterra immota, solem singulis annis semel tantum oriri, Lunam singulis mensibus, Saturnum trigintaannis, et sic de reliquis pro uniuscuiusque proprio motu. Ce passage semble avoir été totalementnégligé par tous ceux qui se sont interessés à l’oeuvre de Baranzano.
396 Michela Malpangotto
pas la structure de l’univers conçue par l’astronome polonais avec lequel il prendconstamment ses distances en attribuant explicitement à Copernic la paternité deséléments qu’il n’accepte pas (ut patet ex suppositione Copernici77).
Baranzano trouve la confirmation décisive de l’invalidité du système hélio-centrique dans l’autorité du témoignage des Écritures Saintes. Ainsi, en accordavec tous ceux qui, comme lui, refusent cette hypothèse révolutionnaire, il invo-que les mots de Josué, Sol stet : ordonner au Soleil de s’arrêter implique forcé-ment que le Soleil soit en perpétuel mouvement.
L’indubitable clarté de ce passage n’appelle à aucune preuve supplémentaireet suffit, à elle seule, à invalider définitivement l’immobilité copernicienne duSoleil. Cependant, Baranzano s’arrête longuement sur ce bref passage pour déve-lopper une réflexion profonde éclairant mieux ses convictions les plus intimes etles plus personnelles.
Afin d’aider le peuple élu à vaincre l’ennemi pendant la bataille de Gabaon,il était nécessaire de prolonger la durée du jour. Pour atteindre cet objectif :
“ Josué parla au Seigneur et dit en présence d’Israël : Soleil, arrête-toi surGabaon, et toi, Lune, sur la vallée d’Aialon ! Et le Soleil s’arrêta, et laLune resta là, jusqu’à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis ”78.
Dans ce passage, Baranzano trouve dans les Écritures Saintes une allusion aumouvement diurne de la Terre. Il ne manque pas de souligner la concordance deson système du monde avec un texte sacré faisant autorité pour en conclure de lavalidité de son système : nihil contrarium nobis protulit. En effet, d’après laconception astronomique du père barnabite, le phénomène évoqué par Josué nepouvait avoir lieu que grâce à une interruption momentanée du mouvement appa-rent du Soleil et de la Lune, provoquée par un arrêt réel de la rotation diurne dela Terre. Un astronome pourrait parler en ces termes, mais Josué, comme Baran-zano le fait remarquer, était astrologiae ignarus et pour rendre compte del’accomplissement de ce phénomène, il lui suffit d’utiliser l’expression Sol stet.Josué dit ici les choses à sa propre façon, iuxta suum sensum, qui est aussi celledu commun des mortels qui voit le Soleil se lever et se coucher chaque jour, dansune cyclicité perpétuelle, alors que la Terre sur laquelle il se trouve lui apparaîtimmobile.
Ayant pour tâche principale la transmission d’un message de foi à un publicvaste, les Écritures Saintes doivent forcément employer un langage simple quipermet une compréhension immédiate. Ainsi, quand elles se réfèrent aux phéno-mènes naturels eodem modo loquitur, elles s’expriment en accord avec cettevision commune du monde79.
77. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 422- 423.78. Josué 10, 12-13.79. Voir Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 386-389.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 397
Baranzano a prouvé avec cet exemple qu’il est possible de s’approcher desÉcritures à travers une lecture du texte qui n’est pas strictement littérale. Ainsi, ilpeut également aborder sans inquiétude les passages qui se réfèrent à la Terre :firmavit orbem Terrae qui non commovebitur et firmavit Terram super stabili-tatem suam. Ainsi, l’immobilité et la stabilité à laquelle ces phrases font allusionpourront être interprétées80 selon un sens double : mettre en évidence les rapportset les différences entre la Terre et les autres corps célestes qui accomplissent descircuits bien plus amples autour d’elle à une vitesse majeure (magis fluunt et per-turbantur), mais aussi pour souligner la nature de la Terre, c'est-à-dire la propen-sion que toutes ses parties possèdent à rester unies entre elles au centre de la Terred’où rien ne s’éloigne naturaliter. C’est pour cette raison précise que Baranzanopeut au final déclarer ouvertement qu’admettre que le centre de la Terre se meut81
et que la Terre tourne sur elle-même ne souffre d’aucune opposition dans cespassages scripturaires.
Non seulement Josué nihil contrarium nobis protulit, mais l’Écriture Sainte engénéral, dans toutes ses expressions, non est nobis contraria82.
8. Réflexions conclusives
La typographie des frères Chouet à Genève termine rapidement le travaild’impression et quelques mois seulement après la fin du cours de philosophienaturelle donné au Collège Chappuisien d’Annecy, les copies de l’Uranoscopiasont prêtes à être diffusées. Un premier volume est alors adressé le 21 juin 1617par Baranzano au Préposé général de son ordre, Girolamo Boerio, qui reçoit lelivre le 6 août dans la Maison Mère de San Barnaba à Milan.
À cette époque, Milan était un centre culturel remarquablement sensible auxnouveautés et aux résultats d’avant-garde. Le problème de l’accord du systèmecopernicien avec l’autorité des Écritures Saintes était sujet à débat dans les cer-cles savants auxquels participait activement le cardinal Federico Borromeo83. Onen trouve un témoignage digne d’intérêt dans une œuvre, restée inédite, du pro-fesseur aux Écoles Piattine de Milan, Curzio Casati. Celui-ci, dans la dédicace au
80. Dans le texte latin, Baranzano emploie le terme accipitur (Ibidem, ligne 393) que l’on traduitici comme “ interpréter ”.
81. Cette expression est employée souvent par Baranzano pour se référer à la rotation du centrede la Terre sur lui-même : il parle d’un mouvement qui ne provoque donc aucun déplacement du cen-tre de la Terre.
82. Voir Ibidem, lignes 390-400. On retrouve ici à nouveau l’emploi du pronom nos pour identi-fier tous ceux qui, comme Baranzano et au contraire de Copernic, laissent au soleil son mouvementde révolution dans la quatrième sphère céleste. Voir également supra la partie conclusive de 5.3-Baranzano et Copernic sur la possibilité d’assigner le mouvement à la Terre.
83. L’intérêt vif du Cardinal Federico Borromeo vis-à-vis des sciences, notamment de l’astrono-mie et des nouvelles découvertes célestes, fait l’objet d’une analyse remarquable de la part de Mas-simo Bucciantini dans l’article suivant, auquel on renvoie également pour d’autres référencesbibliographiques à ce sujet : M. Bucciantini, “ Federico Borromeo e la nuova scienza ”, dans Tra ifondi dell’Ambrosiana. Manoscritti italiani antichi e moderni, Marco Ballarini, Gennaro Barbarisi,Claudia Berra, Giuseppe Frasso (éds.), Cisalpino Editore, Milano, 2008, Tomo I, p. 355-375.
398 Michela Malpangotto
Cardinal Federico Borromeo datée du 18 août 1610, explique que l’ouvrage viseà exprimer ses positions astronomiques à propos d’une quaestio qui avait été aucentre d’échanges verbaux avec le Cardinal lui-même au sujet de l’accord des dif-férentes théories de systemate mundi – copernicienne, tychonienne et ptoléméen-ne – avec les Écritures Saintes. Il explique que la thèse de Copernic a ses faveurset qu’elle lui apparaît pleinement conforme au texte de la page sacrée. Cependant,lui, laïque, n’omet pas une rémission totale à l’autorité religieuse : “ bien que jen’aurais pas la hardiesse d’affirmer cela sans le consensus et l’autorité de l’Églisetoute entière à laquelle je déclare éternellement ma soumission fidèle et la pluspleine dévotion ”84.
Celle-ci n’est que une des multiples expressions qui révèlent le climat répandudans le milieu scientifique : un climat caractérisé par une forte incertitude refré-nant la liberté de pensée ou du moins d’expression à ce sujet. Ce n’est que le 25février 1616, au cours d’une séance qui réunit les Cardinaux des Congrégationsde l’Index et du Saint-Office, que le Pape Paul V se prononce pour la premièrefois sur la théorie héliocentrique dont il définit le statut doctrinal en déclarant que
“ […] la doctrine attribuée à Copernic que la terre se meut autour du soleilet que le soleil se tient au milieu du monde sans se mouvoir du levant aucouchant, est contraire aux Écritures Saintes, et que par suite on ne peut nila défendre ni la soutenir ”85.
Immédiatement, le 5 mars de la même année, la Sacrée Congrégation del’Index rend public son décret établissant que, parmi tous les livres publiés, ceuxqui, comme le De Revolutionibus, se contentent de soutenir la vérité de l’hélio-centrisme doivent être suspendus jusqu’à ce qu’ils soient corrigés donec corri-gantur, alors que l’interdiction absolue s’impose pour ceux qui, comme la Letteradu père Paolo Antonio Foscarini, défendent non seulement la vérité de la doctrinehéliocentrique mais aussi sa non contrariété avec l’Écriture Sainte86. La position
84. L’ouvrage de Curzio Casati est conservé dans le manuscrit MS. I. 58. inf. de la bibliothèqueAmbrosiana de Milan. Pour plus de précisions voir Ottavio Besomi-Michele Camerota, “ Galileo e ilParnaso tychonico ”, dans Biblioteca di Nuncius. Studi e testi, XLI, Olschki, Firenze, 2000, p. 113-117.
85. On le sait grâce à l’attestation remise à Galilée le 26 mai 1616 par Bellarmin. Dans ce textele Cardinal écrit que Galilée a été informé de la definition prononcée par le Souverain Pontife et pub-liée par la Sacrée Congrégation de l’Index : [...] gli è stata denunziata la dichiarazione fatta da NostroSignore e publicata dalla Sacra Congregazione dell’Indice, nella quale si contiene che la dottrinaattribuita al Copernico, che la terra si muova intorno al sole e che il sole stia nel centro del mondosenza muoversi da oriente ad occidente, sia contraria alle Sacre Scritture, e però non si possa defen-dere né tenere [...] (Sergio M. Pagano, collaborazione di Antonio G. Luciani, I documenti del processodi Galileo Galilei, Città del Vaticano, 1984, p. 135, cité par Michel-Pierre Lerner, “ Copernic sus-pendu et corrigé : sur deux décrets de la congregation romaine de l’Index (1616-1620) ”, dans I primilincei e il Sant’Uffizio : questioni di scienza e di fede. Atti dei Convegni Lincei, Roma, 2003, p. 321).
86. Pour tout détail concernant la publication, le contenu, la portée et la diffusion de ce décret,voir Michel-Pierre Lerner, “ Copernic suspendu et corrigé : sur deux décrets de la congregationromaine de l’Index (1616-1620) ”, dans I primi lincei e il Sant’Uffizio : questioni di scienza e di fede.Atti dei Convegni Lincei, Roma, 2003, p. 321-402.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 399
officielle prise par l’Église de Rome élimine toute ambiguïté et définit clairementles positions à respecter si l’on veut rester dans le chemin de l’orthodoxie.
L’Uranoscopia de Baranzano comportait à la fois une présentation du systèmecopernicien et certaines propositiones qui soutenaient l’accord de celui-ci – ou dumoins de certains de ses éléments87 – avec l’Écriture Sainte. De plus, il avait étépublié un an après le décret de l’Index et sans avoir demandé les permissions dela Congrégation des clercs réguliers de Saint Paul. On comprend alors toutel’appréhension du Préposé général de l’ordre religieux lorsqu’il reçoit à Milan, le6 août 1617, la première copie de l’ouvrage du jeune Barnabite. Le jour suivant,il envoie pas moins de trois lettres aux pères d’Annecy. En particulier à Baran-zano à qui il dit avoir tout de suite remarqué que son livre “ défend l’opinion quela Terre se meut, et que les cieux sont immobiles, une opinion condamnée l’annéepassée par le Souverain Pontife car étant contraire à l’Écriture Sainte ” et il estcertain que “ si l’on verra le livre, il sera toute de suite suspendu et l’auteur répri-mandé. Et ceci au préjudice de notre réputation. Voici le fruit d’un travail imma-ture et l’envie de se faire remarquer [...] ”88.
Ces mots révèlent toute l’urgence de remédier à cette situation de façon immé-diate et efficace en mettant en place une série d’actions résolutives. Il fallaitd’abord empêcher toute sorte de diffusion du livre sous la forme sous laquelle ilavait été imprimé : “ le mieux c’est de faire retenir [le livre], d’éviter qu’il necircule ”89. Le Préposé général demande ensuite à Baranzano de rédiger un textepour se rétracter :
“ [...] il pourra faire un papier dans lequel il déclarera avoir rédigé cetteopinion de Copernic sans savoir qu’elle avait été condamnée par Sa Sain-teté, d’autant plus qu’elle avait été envoyée à l’impression à son insu[...] ”90.
Et cet écrit devra avant tout être soumis au contrôle et à l’approbation despères de Milan.
87. Voir supra 7- Le système de Baranzano et les Écritures Saintes.88. ASBR, Epistolario Generalizio, serie I, vol. XXII, p. 335-336 : P. Gerolamo Boerio à P.
Redento Baranzano, 7 août 1617 : Hieri riceve S. P. la sua delli 21 Giugno, con il libro quale bisognòpagare come comprato alla botega ; a’ pena fu visto, che si vide anco cose di poco gusto, [...] difendel’opinione che la Terra si mova et stiano fermi i Cieli, opinione dannata per contraria alla SacraScrittura da questo Sommo Pontefice l’anno passato, et se il libro sarà visto, tiene per certo S. P. chesarà subito sospeso, et l’autore mortificato con nostra poca riputatione ; ecco il frutto di faticheimmature, et la voglia di farsi nominare, et l’esser troppo a se stesso attacato.
89. Ibidem, p. 336 : P. Gerolamo Boerio à P. Redento Baranzano, 7 août 1617 : Se vedrà donqueil libro, et se ne faranno li rilevi ; ma meglio è che facci trattenere, che non corrano, et si emendiquella opinione per ogni modo, altrimenti se gli provederà in altro modo [...].
90. Ibidem, p. 353 : P. Gerolamo Boerio à P. Redento Baranzano, 3 octobre 1617 : Avanti partirsipotrà far un folio nel quale si dichiari d’haver scritto quella opinione del Copernico non sapendofosse condannata da Sua Santità, tanto più essendo datta alla stampa senza sua saputa, altrimenti siasicura ch’ella ne havrà travaglio, et la Congregatione insieme, per esser opinione condannata puocofa et da questo Pontefice.
400 Michela Malpangotto
Les lettres du Préposé général soumettent le jeune Barnabite à une forte pres-sion psychologique qu’il perçoit à la fois au niveau personnel : “ [le Préposégénéral] ne s’attendait pas à une telle déception venant de vous, et comportantune mauvaise réputation à la Congrégation ”91, mais aussi car il se rend comptequ’il peut être lui-même la cause de répercussions possibles sur l’ordre religieux.Le Préposé général ajoute même à cela une menace : il se dit prêt à en aviser lui-même les “ supérieurs ” à Rome pour montrer que “ la Congrégation n’est pascoupable, mais lui [le père Redento] sera puni ”92. Baranzano comprend que laliberté qu’il s’était accordé, peut-être seulement par enthousiasme de jeunesse,risquait en réalité d’entamer la rectitude et la rigueur morale de la Congrégationtoute entière.
Le jeune père est perdu, confus, sente tanta mortificazione. Il sait que rien nepeut servir à atténuer la faute dont il s’est rendu coupable. Il aurait été inutile defaire retomber la responsabilité sur ses jeunes élèves en déclarant que l’édition del’Uranoscopia avait été préparée et publiée à son insu ou sans son approbation :“ on ne le croirait pas ”93. Et il importait encore moins de préciser sa position per-sonnelle, critique vis-à-vis du système de Copernic car cela revenait à exprimerses propres convictions astronomiques et à préciser son éloignement de la théoriehéliocentrique. Il agit alors en faisant preuve de sens de la responsabilité etd’esprit d’obéissance. Il reconnaît l’accusation selon laquelle il a soutenu la théo-rie copernicienne en assumant ainsi silencieusement la faute de l’avoir pleinementpartagée. Et dans cette admission soumise, il rédige un court texte comportant lesrésultats d’une méditation nouvelle et plus approfondie, menée en conformitéavec l’opinion du Souverain Pontife à propos du mouvement de la Terre supposédans la théorie copernicienne : la Nova de motu Terrae copernicaeo iuxta SummiPontificis mentem Disputatio est immédiatement publiée par la même typogra-phie de Genève et est jointe à chaque copie de l’Uranoscopia.
Les questions qui se posent sont multiples : Baranzano était-il vraiment uncopernicien convaincu ? Sa rétractation fut-elle un simple acte formel ? Jusqu’àquel point cet épisode a forcé le jeune père barnabite à renier et à étouffer sesconvictions astronomiques personnelles ? Ces interrogations ont guidé cette lec-ture de l’Uranoscopia et ont nécessité la recherche, au delà des aspects les plusformels touchant à la structure de l’ouvrage et à la façon de mener le discours,des convictions les plus authentiques de l’enseignant annecien. Le résultat démentl’opinion répandue selon laquelle Baranzano aurait été un tenant convaincu de la
91. Ibidem, p. 336 : P. Gerolamo Boerio à P. Redento Baranzano, 7 août 1617 : Et da lei nonaspettava S. P. questo conforto, con poca riputatione della Congregatione.
92. Ibidem, p. 335 : P. Gerolamo Boerio à P. Giovanni Battista Gennari, 7 août 1617 : E’ giontoil libro del P. D. Redento, nel quale a’ pena aperto si vide che tiene l’opinione che la Terra si movidannata l’anno passato da N. S. per contraria alla Sacra Scrittura. Scrive S. P.tà al detto Padre, etV. R. la potrà vedere, ove gli dice che se costì non se gli provede, S. P. il provederà a darne notitiaalli superiori per far vedere che la Congregatione non ci ha colpa ; ma egli sarà il penitentiato. Nèoccorrerà dire che altri l’habbia stampato senza sua licenza, perchè non gli sarà creduto. Faccidunque per ogni modo, che si corregga, et li altri scritti si essaminino bene.
93. Voir supra n. 93.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 401
théorie copernicienne. C’est pourquoi se disculper de cette accusation génériquene fut probablement pas un trop grand sacrifice pour lui. Cependant, il était bienconscient que ses convictions les plus intimes d’une Terre en mouvement le ren-daient doublement coupable d’avoir osé contredire non seulement l’autorité desÉcritures Saintes, mais aussi l’infaillibilité de la pensée du Souverain Pontife etalors :
Dicendum igitur : iure meritissimo Summum Pontificem Copernici senten-tiam tanquam vero Scripturae sensui contrariam damnasse94.
94. Redento Baranzano, Nova de motu Terrae disputatio, [Genève], p. 15.
402 Michela Malpangotto
APPENDICE
Edition critique de sections choisies de l’Uranoscopia
Note sur l’établissement du texte
Aucune édition ni traduction moderne de l’Uranoscopia de Redento Baran-zano n’existe à present. Afin de permettre une vérification directe de l’analyseproposée dans cette contribution, sur le texte original, une édition critique dessections sur lesquelles s’appuie de manière importante l’étude présentée est pro-posée ici. Il s’agit de la Dubitatio nona et des cinq premiers Membra de la Dubi-tatio decima de la Quaestio tertia de la première partie de l’Uranoscopia.
Notre texte de référence est celui de l’édition princeps, imprimée à Genèvepar la typographie des Frères Chouet, en 1617, selon l’exemplaire conservé dansla Raccolta Carlo Viganò de la Biblioteca dell’Università Cattolica di Brescia(dont une reproduction photographique noir et blanc se trouve dans la collectionLa matematica antica su CD-rom publiée par il Giardino di Archimede, n. 12).
Le siglum S lui sera assigné dans l’apparat critique.
La pagination de l’œuvre ancienne est indiquée entre crochets dans le texte.
La ponctuation et les majuscules ont été conformées à l’usage moderne. Tou-tes les abréviations ont été écrites en entier. Certaines nombres ont été transfor-més en toutes lettres, alors que dans l’original il y a une alternance de chiffres etd’écriture in extenso notamment dans les renvois bibliographiques.
Généralement notre transcription respecte l’orthographe de la source – ce quiexplique la variation fréquente entre “ ae ” et “ oe ” –, seul l’emploi de u / v etde U / V a été modifié car dans l’Uranoscopia il y a une alternance de ces carac-tères à la fois dans les textes en minuscule et dans les textes en majuscule.
Ces interventions ne sont pas signalées dans l’édition, alors que dans l’apparatcritique on signale toute intervention ou correction qui modifie le texte original àl’exceptions des remplacements systématiques des termes suivants : on a choisiparallelus au lieu de paralellus ; imo au lieu de immo ; circumferentia au lieu decirconferentia dans toutes les occurrences de ces mots dans le texte édité.
” usato in S.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 403
[76] QUAESTIO TERTIADe accidentibus corporum caelestium
1 [95] DUBITATIO NONA2 De quantitate discreta corporum caelestium
3 MEMBRUM PRIMUM4 An in coelis habeat locum numerus, id est, an unicum sit coelum
5 Omnibus recentioribus non modo improbabilis verum etiamabsurda iudicatur sententia ponens unitatem in caelo : tum quiaScriptura adhibet nomen caelorum in plurali ut quando dicit utoriretur in caelis lumen indeficiens, caeli caelorum et aquae quaesuper caelos sunt, qui fecit caelos in intellectu, ipsi peribunt et
10 caetera ; tum quia nullo modo possunt salvari tot motuumdiversitates, apparentiae et fenomenae cum singularitate caeli, immoneque cum pluribus caelis nisi positis eccentricis et epiciclis ; tumquia planetae non servant in suo motu eundem ordinem inter se etcum stellis fixis, ergo planetae omnes sunt in caelo diverso ab eo in
15 quo sunt stellae fixae et unusquisque planeta in caelo diverso a caeloalterius alio qui servarent eandem distantiam et aspectum ; tum quiavel moveretur astrum per aliquod canale vel ut pisces in aqua, atneutrum dicibile est, non primum quia illud canale vel est plenum velvacuum, si secundum dabitur vacuum quod repugnat naturae, si
20 replet est eiusdem naturae vel diversae, si diversae violenter ibi erit,si eiusdem et dividitur poterit corrumpi, ubi enim est divisa unitas ibiest incorruptibilitas, non secundum eadem ratione et quia ridiculumest moveri tali motu ; tum quia ex Iob 37° caeli solidissimi sunt etfusi quasi aere.
25 Verum propter has rationes non est totaliter recedendum [96] abopinione Chrisostomi, Acarii et aliorum antiquorum dicentium cae-lum unicum esse, sed media quadam via procedendum, problema-tice utramque partem defendendo.Ut difficilior pars sustineatur sequentes observate propositiones.
30 Prima. Substantia unici huius caeli ex Hyeronimo, in illud Isaïae51°, caeli sicut cera liquescent, est firmitatis similis firmitati fumi,cum enim quaesiisset cur septuaginta interpraetes transtulissentcaelum sicut fumus, firmatum est cum in haebraeo legatur liquescent,respondet ideo tali modo vertisse ut ostenderent qualitatem corporis
35 caelestis. Eodem modo Ambrosius, libro secundo ex capite sexto,dicit stabilitatem caeli similem esse stabilitati fumi, quemadmodumergo fumus facile cedit sic substantia huius corporis caelestis cedetastris dum moventur.
Secunda. Ista liquiditas caelorum non est ab humiditate, quae est40 mater corruptionis, vel alia prima qualitate sublunari, sed a quadam
404 Michela Malpangotto
alia qualitate caelesti consequente formam caeli unde quando Plato,Anselmus, Chrisostomus et alii patres dixerunt corpora caelestia esseignea, hanc qualitatem significarunt ; potius enim assimilaturfluxibilitas corporis caelestis fluxibilitati ignis quam aquae.
45 Tertia. Astra moveri per hoc quintum corpus fluidum maximeprobabile est, unde Augustinus, libro secundo de Genesi ad litteramcapite decimo instituens hanc questionem an astra moveantur caeloimmoto an etiam ipsum caelum cum astris moveatur, respondetomnes apparentias salvari posse ponendo caelum immotum et astra
50 mobilia ; ait enim hoc inventum esse ab iis qui otiosissime etcuriosissime caelestes motus investigarunt.
Quarta. Motus iste astrorum per caelum fluidum non est casualisvel irregularis, ut est motus piscium in mari : tum quia Deus inprincipio talem naturam cuique stellae indidit ut per talem viam tali
55 lege semper circumduceretur ; tum quia intelligentia assistens diri-git, regit et regulat motum stellae sibi commissae.
Quinta. Ad summum, ut salventur omnia faenomena, sufficitponere stellarum epiciclos mobiles ab intelligentia duplici [97] motuet, si necesse fuerit, in epiciclo astrum mobile ablatis eccentricis nam
60 ipsemet epiciclus poterit nunc esse proximior, nunc a terra distantior,quatenus nunc elevatur nunc deprimitur, servata tamen lege propriimotus.
Sexta. Quemadmodum theologi unicuique speciei tribuuntAngelum custodem ita non incongruum erit, posita distinctione
65 specifica stellarum ab invicem, unicuique illarum assignare propriamintelligentiam assistentem et gubernantem illam. Quo posito ipsametintelligentia poterit omnes apparentias causare vel non perficiendospatio quatuor et viginti horarum totum circulum vel per lineamgyrativam ducens epiciclum vel polos epicicli nunc versus austrum
70 nunc versus septentrionem convertendo vel simili alia ratione.Septima. Quae etiam pro sequenti membro servire poterit. Illud
axioma : uni corpori unus tantum convenit simplex motus, praeterlimitationem superius allatam, etiam recipit hanc aliam : quandomotus est tantum ab intrinseco nam quando est ab extrinseco potest
75 idem corpus diversos subire motus.His positis solvuntur argumenta superius allata pro recentioribus
et probatur sententia antiquorum : primo quia Scriptura, ut observavitChrisostomus Homelia quarta in Genesin ubi reprehendit illos quiponunt plures caelos, quando loquitur de creatione caeli utitur
80 nomine singulari ; verum haec ratio debilis est nam in haebraeohabetur saemain, quod est pluralis numeri et caret singulari, undecolligitur responsio ad primum argumentum recentiorum fundatumin more Scripturarum, ut plurimum in plurali numero caelum signi-ficantium nam interpraetes tantum considerarunt terminationem
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 405
85 vocis, non significationem, de reliquo nomen illud plurale stat prosingulari ut etiam nomen Eloin significans Deum. Probatur secundoquia non sunt multiplicanda entia sine necessitate at unum tantumcaelum sufficit ut videmus ex Augustino et communi antiquorum,ergo non est cur multiplicentur plures caeli, minor probatur quia si
90 est aliqua ratio cogens, maxime aliqua ex assignatis pro sententiarecentiorum nempe vel multiplicitas motuum vel illorum regularitasvel caelorum incorruptibilitas at haec [98] omnia salvari possunt,posito uno tantum caelo, multiplicitas quidem motuum perintelligentiam assistentem tali modo et lege a Deo constitutam
95 astrum moventem et eodem modo regularitas, incorruptibilitas veroquia haec non est incompossibilis cum fluiditate ut falso putantquidam recentiores, non enim quaecunque divisio ad corruptionemtendit, ut patet in igne puro elementari alia particula ignis divisa,proxime enim in hac divisione nulla cernitur dispositio ad
100 corruptionem, ergo neque divisio quinti corporis, maxime cum haechabeatur a qualitate supradicta conformi naturae illius.
MEMBRUM SECUNDUMAn posita pluralitate coelorum
ponendi sint undecim mobiles an decem an novem an octo
105 Plures ex patribus, ut Theophilatus in illud Pauli secundae adCorinthios : scio hominem raptum usque ad tertium caelum, ponunttres tantum caelos duos mobiles et unum immobile ; verum illaauthoritas mistice accipienda est et spiritualiter, quemadmodum etraptus ipse fuit spiritualis ; cum enim sint tria genera visionum :
110 corporalis una qua species sensibiles videntur, imaginaria altera quafantasia imagines rerum speculatur, intellectualis tertia quaintellectus divino lumine illustratus ad caelestia cognoscendaelevatur ; Paulus dicit se raptum ad tertium genus visionum, id est adintellectualem. Alii duos tantum. Alii octo ut Aristoteles. Alii novem
115 ut Ptolomeus, Abrachis et alii philosophi eiusdem saeculi. Aliidecem ut Alphonsini ponentes motum trepidationis. Alii tandem utMaginus mathematicus Academiae bononiensis undecim.
Rationes huius diversitatis desumptae fuerunt a diversitatemotuum nam quia tempore Aristotelis erat notus tantum motus
120 diurnus cum particularibus motibus planetarum, ideo posuit octavamsphaeram ultimam ; quia postea tempore Abrachis cognitus fuitmotus stellarum ab occasu in ortum, ideo supra octavam posueruntPrimum Mobile cui attribuerunt [99] motum diurnum, reservantesmotum ab occasu in ortum ipsi octavae sphaerae ; quia Alphonsus
125 Hyspaniarum rex observavit in octava sphaera tertium accessus etrecessus seu trepidationis seu a septentrione in austrum, ideo
406 Michela Malpangotto
decimam sphaeram supra Cristallinum, quod nono loco ponitur,collocavit ; quia tandem Maginus, auxilio Copernici, cognovitquartum motum ab ortu in occasum et ab occasu in ortum quem dixit
130 motum librationis, ideo undecim posuit sphaeras mobiles, quodconsiderans Clavius, in primum caput Sphaerae Ioannis deSacrobosco, mutavit sententiam quam antea tenuerat de numerodenario caelorum mobilium et hoc ut cum Magino auferat motumtrepidationis et ponat duos librationis. Verum an tales motus dentur
135 et qua ratione perficiantur alterius est loci investigare quando scilicetagemus de motibus caelestibus.
Nunc sufficiat quaerere an alia via possint salvari apparentiae etfaenomaenae quam per undecim caelos. Quod possibile esse osten-dam si prius quaedam supposuero.
140 Primum est. Duobus principiis, quae probatione indigent, totamhanc caelorum machinam inniti, nempe omnem caeli partem etomnem sphaeram spatio viginti quatuor horarum motu diurnointegram facere circulationem et caelum inferius rapi a superiore ; utomittam tertium : uni corpori uni convenire simplicem motum.
145 Primum autem quanta incertitudine vestiatur patet quia potestretardari iste motus ob resistentiam alterius corporis superioris vel obdistantiam corporis rapti a rapiente vel ab intelligentia talem motumproducente vel a propria natura corporis moti ; tum quia si possunt,per destructionem huius principii ad quam nullum sequitur
150 absurdum, salvare omnes apparentias cur multiplicandi erunt motuset caelestes orbes ; tum quia non est credibile antiquos astrologos,quos Augustinus dicit curiosissime et otiosissime caelestes motusinvestigasse, ignorasse varietatem illam motuum propter quamrecentiores multiplicarunt tot sphaeras, sed potius cognita tali
155 varietate iudicasse melius esse omnia salvare per principiumoppositum quam per multiplicationem caelorum. Secundum vero totpatitur difficultates, de quibus infra, ut sit facilius talem raptumauferre quam relinquere.
[100] Secundum. Vanam esse solutionem illam quam pluribus160 prosequitur Rubius, qua dicitur duos motus librationis et tertium ab
occasu in ortum falso tributos fuisse octavae sphaerae sensumquecommunem deceptum a sensibus externis circa motum, qui estsensibile commune, occasionem erroris praebuisse intellectui etfacile fuisse motum tam tardum oculis nostris per dioptram vel aliud
165 instrumentum apparuisse, licet revera non fuerit, est inquam vana etfutilis quia in rebus astrologicis astrologis credendum est alioquin, sinegationi locus daretur, omnia possent negando salvari. Oportetigitur supponere tres illos motus et postea per octavum tantumcaelum illos salvare.
170 Tertium. Posito undenario numero sphaerarum admittendos essequatuor supradictos motus octavae sphaerae, nulla enim alia ratione
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 407
talis numerus salvari potest. Posito tantum denario duos motus unicaelo attribuendos, nempe diurnum et a septentrione in austrum,quod non repugnat nam motus accessus et recessus non est contrarius
175 motui ab ortu in occasum vel ab occasu in ortum, unde simul cumillis eidem corpori convenire poterit cum nullum illorum impediat utvidere poteritis in motu sphaerae materialis quae, dum movetur abortu in occasum, potest per motum polorum supra vel infraorizontem moveri a septentrione in austrum. Posito novenario motus
180 contra motum diurnum nempe ab occasu in ortum poni poterit inoctava, diurnus vero in nona et alii duo modo infra explicandosalvandi. Posito tandem octonario salvatur motus ab occasu in ortumper imperfectam circulationem ab ortu in occasum, motus librationisa septentrione in austrum per motum polorum et lineam quandam
185 gyrativam designatam in superficie connexa caeli Empyrei sub quamoveantur stellae, eo modo quo movetur Sol sub zodiaco a principioCancri, id est septentrione, ad principium Capricorni, id est austrum ;non enim est necesse motum caelestem esse perfecte circularem, idest ab eodem puncto ad idem omnino punctum, cum talis motus
190 perfectio vix in rerum natura reperiatur : poterit igitur deflectereusque ad tale punctum et postea retrocedere, eo prorsus modo quodeclinat et revertitur Sol. [101] Deinde cur non possent eidemcorpori coelesti plures motus communicari, maxime si estinanimatum et movetur a principio extrinseco activo.
195 Quartum. Quando Scriptura supra Firmamentum ponit aquas idest ut communiter exponitur Cristallinum nomine Firmamenti, cumAbulense intelligi potest superficies concava octavae sphaerae,nomine vero aquarum ipsamet crassities et profunditas octavaesphaerae, quae ratione suae perspicuitatis potest aquae nomine
200 explicari.Quintum. Scriptura95 quando in plurali caelos nominat vel
accipere Empyreum quod dicitur caelum caeli vel caeli caelorum velservare quandam magniloquentiam, qua res nobiles in pluraliexprimuntur et magnates in familiari sermone suam singularem
205 personam in numero singulari nobis exponunt dicentes : nosPhilippus Hyspaniarum rex et caetera, vel accipere aërem loco uniuscaeli, Empyreum loco alterius et coordinationes sphaerarum96
mobilium loco plurium, non vero velle undecim esse vel decemsphaeras.
210 Probatur nunc quemcunque numerum concessibilem esse : tumquia nulla evidenti ratione infirmatur denarius vel undenariusnumerus sphaerarum, immo suavius omnes caelestes apparentiae per
95. Scripturam S96. Spaerarum S
408 Michela Malpangotto
illum salvantur ; tum quia isti motus principiis astrologiae suntmaxime conformes ; tum quia, ut patet ex tertio supposito, etiam per
215 octonarium omnes eaedem experientiae salvantur nec ulla visinfertur alicui principio probato : astrologiae ergo nihil refert sivehunc numerum sive illum eligas.
Obiectiones fundatae in numero motuum solventur infra, aliaesunt solutae ex dictis in suppositionibus.
220 [102] DUBITATIO DECIMADe ordine coelestium sphaerarum
Duplex considerari potest sphaerarum ordo alter situs alterperfectionis, et circa primum duae sunt sententiae : una communis
225 ponens Terram in centro mundi immobilem, altera Coperniciponentis Solem in centro mundi immobilem et Terram in epicicloLunae mobilem, quae sententia, ut ipse ait, maxime consona est tumordini universi, tum apparentiis motuum, tum naturae corporissolaris ; modo ambobus oculis res consideretur ideo illam omnibusviribus tueri fas est, modo tamen alteri parti probabilitas non
230 denegetur.
MEMBRUM PRIMUMQuid sentiat Copernicus
Maior difficultas quae habetur in sententia Copernici est clarecognoscere quid velit, maxime enim obscure loquitur et magna
235 habetur difficultas in illius mente perscrutanda quam ego sequentibuspronunciatis explico.
Primum. Terra eundem habet locum et situm in ordine caelestiumsphaerarum quem communiter habere Solem putamus ideo : primoloco tanquam centrum ponendus est Sol, secundo Mercurius, tertio
240 Venus, quarto cum Terra Luna, quinto Mars, sexto Iupiter, septimoSaturnus, octavo Caelum stellatum, ut videre est in sequenti figuracuius una pars proponit ordinem Copernici altera communem. [103]
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 409
Secundum. Octava sphaera nullo modo movetur, sed immobilisconsistit. Quando enim aliquod sydus nobis oritur vel occidit iste
245 occasus et ortus non est causatus a motu octavae sphaerae, sed amotu Terrae quamvis nobis videatur ipsa moveri quemadmodum illiqui navigant putant arbores, civitates et regiones fugere seipsosimmotos manere, cum tamen econtrario res se habeat.
Tertium. Terra duplici ad summum motu movetur sibi proprio :250 primus est ab occasu in ortum diurnus in proprio epiciclo quo spatio
viginti quatuor horarum nunc hanc medietatem Soli opponit nuncaliam, ipsis polis immotis remanentibus ; secundus est etiam aboccasu in ortum qui perficitur spatio unius anni et est illemet quicommuniter attribuitur Soli, quo motu singulis diebus unum gradum
255 percurrit ; tertius est ipsius axis quo nunc movetur versus austrumnunc versus septentrionem mutando declinationem, qui motussequenti figura innotescet.
Quartum. Ex primo motu oritur varietas diei et noctis inunaquaque regione, illa excepta ubi sunt poli telluris nam ibi est
260 [104] dies sex mensium et nox sex mensium. Ratio primi est quiadum movetur nunc opponit unam partem Soli nunc aliam a Soleremovet, unde illa quae opponitur illuminatur quae removeturtenebris offunditur quia ponitur in umbra ipsius Terrae. Ratio secundiest quia dum unus polus opponitur Soli, spatio viginti quatuor
265 horarum, non potest removeri ab oppositione eo quod motus isteremotius fiat super polos immobiles unde toto die pars illailluminabitur ; quando vero polus erit occultatus, propter motum axisin umbra Terrae, non poterit per motum illum diurnum ab occasu inortum eadem de causa Soli opponi et sic tunc erit nox sex mensium.
270 Quintum. Ex secundo motu oritur Solem nobis apparere nunc inCancro nunc in Capricorno nunc in aliis signis, Terra enim posita inCapricorno Sol nobis apparebit in Cancro, ut posita in Aquario Solapparebit in Leone, ut patet ex sequenti figura.
Sextum. Ex tertio motu nascitur inaequalitas dierum his qui275 habitant extra lineam aequinoctialem terrestrem, quemadmodum
410 Michela Malpangotto
enim Sole percurrente tropicum Cancri nobis dies est maior nocte,modo explicato in sphaera, sic Terra existente in Capricorno ethabente talem declinationem australem [105] dies erit maior,existente vero in Cancro minor et sic mutatis parallelis aequatori
280 mutabitur magnitudo diei et noctis, eo quod Terra percurrente talisemicirculo maiori vel minori tempore hanc vel illam partem Soliopponat.
Septimum. Ex eodem motu axis qui annuus est quemadmodummotus centri Terrae, oritur etiam mutatio aequinoctiorum quia enim
285 non sunt aequinoctia in iisdem punctis ut fierent si esset perfectacommensuratio.
Octavum. Nisi poneretur talis motus axis esset semper vel aestasvel hyems vel autumnus vel ver, remanerent enim semper iidemanguli inclinationis aequinoctialis terrestris et signiferi seu zodiaci.
290 Nonum. Praeter dictos motus, nempe centri Terrae axis etdiurnum ab occasu in ortum contra diurnum communem ab ortu inoccasum, conveniunt etiam Terrae alii motus librationis.
Decimum. Male Clavius deducit nunquam futura aequinoctianullumque daturum locum ubi dies sit aequalis nocti, nam parum
295 refert sive Sol moveatur circa Terram sub aequinoctiali sive Terraipsa circa Solem sub eodem aequinoctiali, modo eadem semper sitcirculatio idemque utriusque respectus ; item parum refert hominessub aequinoctiali circulo existentes non moveri, ut semper sitaequalitas dierum vel homines eosdem in aequinoctiali Terrae seu
300 illius circulo medio existentes circa Solem tali modo circumvolui,modo servetur semper eadem habitudo. Igitur erit aequinoctiumsecundum Copernicum quando Terra rotabitur sub aequinoctiali etillius axis seu terrestris aequinoctialis ad Libram vel Arietemproductus fuerit et illi semper habebunt diem aequalem nocti qui
305 habitabunt in aequinoctiali terrestri et ratio est quia dimetiens ductusa centro Solis per centra sphaerarum habet rationem orizontis adquem, dum pervenit sydus ponitur in die dum recedit in nocte, athomines, existentes in terrestri aequinoctiali, non possunt priuspervenire ad dimetientem rectum quam in medio itinere ; ergo et
310 caetera. Figura talis est. [106]
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 411
MEMBRUM SECUNDUMQuibus fundamentis innitatur Copernicus
Copernicus libro primo97 Revolutionum capite decimo et alibipluribus supradictam sententiam confirmat et primo quia antiqui
315 philosophi tales suppositiones admiserunt. Philolaus enimPitagoricus, cuius visendi gratia Plato Italiam petiit, numerat Terraminter astra errantia ; Aristarcus Samius, qui quatercentis annis fuitantiquior Ptolomeo, Terram extra centrum mundi mobilem posuit eteodem modo plures antiqui philosophi hanc sententiam
320 comprobarunt.
Secundo. Immobilitas nobilior est mobilitate unde Deus omniumnobilissimus omni caret motu ; at Sol nobilior est Terra ergo Terraepotius tribuenda est mobilitas quam Soli.
Tertio. Melius est moveri contentum quam continens ergo melius 325 est Terram moveri quam octavam sphaeram.
Quarto. Quia experientia constat Iovem, Martem et alios planetasesse viciniores Terrae in ortu vespertino, tunc enim Soli opponunturet Terra media est inter Solem et ipsos planetas, quam quando sunt inortu matutino aut occasu vespertino, quia tunc circa Solem feruntur
330 et Sol medius est inter ipsos planetas et nos ; at si Terra esset inmedio non esset talis diversitas, aequaliter enim hinc inde orirentur etoccident.
Quinto. Quia exacta observatione et confessione omniumastronomorum stellae errantes aliquando propinquiores sunt Terrae
335 aliquando remotiores qua de causa inventi sunt eccentrici et epicicli,ergo iam patet non esse in medio et cen[107]tro omnium planetarum,ergo non inconveniens erit ponere illam extra centrum.
Sexto. Probatur ex proportione distantiarum quas invenimus internos et astra seu ex crassitie sphaerarum. Cum enim crassities Lunae
340 sit viginti et unius semidiametrorum, crassities Mercurii 103semidiametrorum, Veneris 933, Sol 9498, Mars 7640 inconvenienscerte videretur et res maxime improportionata Solem, inter astrapraecipuum tantae virtutis et influentiae, caelum adeo exiguumhabere nisi esset in centro mundi, Venerem autem quae minor est
345 ipso et Martem habere tantam profunditatem in suis caelis. Quaecerte improportio tollitur, posito Sole in centro mundi, sic enimpaulatim augebitur crassities sphaerarum, habita ratione situs et loci
97. Secundo S98. 44 S, On a adopté ici la valeur 94, qui se trouve également plus tard dans le texte de l’Uran-
oscopia (l. 520). La confirmation de l’exactitude de cette valeur se trouve dans les tables à p. 120 del’Uranoscopia.
412 Michela Malpangotto
ita ut Venus, Mercurius et caetera habeant maiorem crassitiem Sole,minorem vero Luna sumpta simul cum Terra et orbe elementari.
350 Confirmatur quia Sol fuit creatus tanquam causa diffusiva luminissui per omnia corpora et vilis, ergo illi conveniebat maxime locusmedius. Confirmatur secundo quia suavius omnes apparentiaesalvantur ut patet ex dictis et melius ex dicendis. Confirmatur tertioquia nulla cernitur implicantia cur igitur non ponetur cum aliunde
355 nobis constet talem ordinem nobis maxime utilem et bono universicongruere ? Confirmatur quarto quia si non maxime quia, ut deducuntantiqui et cum illis Clavius in capite primum Sphaerae I. deSacrobosco, motus non potest convenire Terrae alioquin avesviderentur moveri versus occidentem dum Terra movetur in
360 orientem, motus enim Terrae velocior est motu volucrum et omniaaedificia corruerent vel quia non potest illi convenire multiplicitasmotuum vel quia Scriptura reclamat dum ait : Solem esse similemgiganti qui exultat ad currendam viam et Terram in aeternum stareSolemque aliquando stetisse et a cursu prohibitum vel propter aliam
365 similem rationem inferius assignandam at nihil obstat, ut patebitmembro sequenti.
MEMBRUM TERTIUMQuomodo solvantur ea quae proponantur contra Copernicum
Quia obiectiones quae fieri possunt contra Copernicum vel370 desumuntur ex Sacris litteris vel ex nostro aspe[108]ctu vel natura
motus vel ex mobilitate et situ sphaerarum vel ex comparationeTerrae cum aliis planetis vel tandem ex absurdis ; communiter enimhaec sententia iudicatur absurda. Ideo ut omnia facili negotiodiluantur sequentes observatae propositiones.
375 Prima. Ea quae habentur in Sacra pagina prolata a viris idiotis,profanis vel philosophis naturalibus tantam habent auctoritatemquanta est dicentis auctoritas et non maiorem, ut patet ex his quaedixerunt amici Iob, si enim omnia tanquam de fide accipienda essentliber Iob plures causaret errores, qua de causa reprehensi sunt amici
380 illi a Deo. Quando igitur Iosue, astrologiae ignarus, dixit Solem stareex cuius dicto adversarii colligunt Solis motum, nihil contrariumnobis protulit nam loquebatur iuxta suum sensum, quod patet, inquitAbulensis, ex eo quod dubitaverit non sufficere Solis quietem nisietiam quiesceret Luna quasi vel sint in eodem caelo vel moveri possit
385 inferior sphaera motu diurno, non motu superiori intermedia.
Secunda. Ut plurimum Scriptura loquitur, in his quae naturaliasunt, secundum nostrum captum et hominum existimationem, undequia homines existimant communiter Solem moveri et Terramquiescere eodem modo loquitur.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 413
390 Tertia. Firmitas et stabilitas Terrae de qua Scripturae loquunturdum dicunt : firmavit Terram super stabilitatem suam, posuitcolumnas Terrae, firmavit orbem Terrae qui non commovebitur,Terra in aeternum stat et caetera accipitur vel comparative in ordinead alia elementa quae magis fluunt et perturbantur vel in ordine ad
395 proprium centrum et propriam inclinationem quam habet ut tendat adcentrum, talis enim est Terrae natura ut petat unionem cum omnibussuis partibus et illarum congregationem in centro a quo naturaliternulla recedit. Quod autem centrum Terrae moveatur et Terra totacircumvoluatur non officit supradictae firmitati, unde Scriptura non
400 est nobis contraria.
Quarta. Illud axioma : in quacunque Terrae parte homo sit videtmedietatem caeli, cum grano salis accipi debet.
Nam primo, limitatur secundum nostram existimationem [109] nonsecundum rei veritatem. Veritas enim est etiam posita sententia
405 adversariorum, non posse videri illam circuli partem quae Terraesemidiametro correspondet, ut patet in sequenti figura.
Secundo. Habita ratione parvitatis Terrae et proportionis illius cumoctava sphaera quasi videri illius medietatem, eo quod Terraesemidiameter comparatus cum magnitudine octavae sphaerae fere
410 puncti habeat rationem.
Tertio. Procedere illud axioma contra suppositionem Copernici quienim dixerit Terram esse extra centrum mundi, non dubitabit etiamdicere non videri totam medietatem. Adde semper fluere aliquampartem dum per dioptram sydera conspiciuntur dum aliquae partes
415 deprimuntur aliquae elevantur, eo tempore quo dioptra praeparatur,immo etiam quando praeparata observationibus inseruit.
Quinta. Ideo sydera nobis apparent fere semper in eadem distantiaquamvis nunc remotiora sint nunc propinquiora, quia dum nosopponimur Soli non possumus videre sydera quae sunt post Solem
420 vel ab illius lateribus, sed tantum possumus observare illa quae nobis
414 Michela Malpangotto
obiiciuntur noctu ; de caetero si quolibet tempore stellae apparerentnunc viderentur propinquiores nunc remotiores, ut patet exsuppositione Copernici.
Sexta. Aspectus noster nunc videt Lunam plenam nunc425 deficientem nunc in augmento nunc in decremento nunc caeli
oppositam nunc coniunctam quia Luna circumvoluitur in epiciclocirca centrum Terrae, unde nunc ponitur intra Solem et Terram ettunc videtur coniuncta et carens lumine seu ut com[110]muniterdicitur nova, nunc Terra ponitur inter Solem et Lunam et tunc videtur
430 opposita et plena, quia pars illuminata nostris oculis opponitur nunca lateribus Terrae Solem respicit nunc tandem est in circumferentiaintermedia. De reliquo Luna est in eodem magno epiciclo in quo estTerra, unde nunquam a Terra disiungitur quamvis ratione supradictimotus nobis videatur nunc recedere nunc accedere. Hinc colligitur
435 vanitas illius argumenti quo adversarii deducunt in omni partefuturam eclipsim, cum enim eclipsis non sit nisi respectu nostri tunctantum erit eclipsis quando vel ipsa diametraliter opponetur Soli innovilunio tunc enim eclipsabitur Sol vel in plenilunio eclipsabiturLuna ; verum de his alibi fusius.
440 Septima. Motus potest diverso modo et ratione diversarumqualitatum convenire Terrae. Ratione enim innatae gravitatis et pro-pensionis ad centrum movebitur ad idem centrum ; ratione verosphaericae figurae circulariter, unde supradictas limitationes illiusprincipii : uni simplici corpori unus simplex debetur motus, haec alia
445 addi potest : quando corpus est simplex et secundum formam etsecundum qualitates. Deinde Copernicus negat motum deorsum velsursum esse simplicem nam mixtus est ex circulari, quatenus eodemtempore quo deorsum movetur etiam movetur circulariter. Patetautem ex dictis illum non esse simpliciter dicendum motum
450 simplicem ad medium qui non fit per lineam simpliciter rectam.
Octava. Quando movetur Terra trahit secum aërem eo modo quoadversarii dicunt Lunam secum trahere ignem et supremam aërisregionem, nulla enim alia ratione salvant motum cometarumcircularem in suprema aëris regione nisi quia cum aëre moto
455 circulariter trahuntur. Hinc solvitur illud argumentum quo contra nosdeducitur : ex motu Terrae sagittam in altum proiectam nondescensuram ad eundem locum ; item salvatur quomodo aves nonvideantur moveri versus occasum, simul enim moventur cum aëre utipsi dicunt simul cum aëre moveri cometas.
460 Nona. Ex motu Terrae non oritur destructio aedificiorumquemadmodum neque antipodes cadunt etiamsi nobis opponantur,quia ex quacunque parte Terrae grave semper tendit [111] deorsum,id est ad proprium centrum gravitatis. Ratio autem cur non corruantest quia impulsus Terrae impressus in ea parte ubi est fundamentum
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 415
465 imprimitur etiam fundamento et parieti, ex quo oritur maximaconnexio illius partis cum fundamento, deinde tanta proportione etsuavitate rotatur Terra ut ille motus nullam causet improportionemvel ruinam. Tandem si citula plena aquae circa caput ducta nonpermittit aquam descendere modo motus velocissimus sit, quia
470 impulsus aequaliter imprimitur partibus aquae et citulae, cur dicemusaedificia mota cum Terra casura. Nec obstat instantia Clavii, in caputprimum Sphaerae, impulsum aquae esse versus partes fundi, terraevero versus partes exteriores. Nam primo est disparatio, nam inaedificiis est ut elevatio ad centrum, in aquis vero est opposita
475 inclinatio, in aedificiis est gravitas tendens ad astrum non perquancunque lineam, sed per lineam ipsius parietis, unde unus lapisalium impedit, guttae vero aquae non sese impediunt natura sua ;secundo falsum est impulsum esse versus partes exteriores nam sihoc esset aliquae partes Terrae proiicerentur in aërem.
480 Decima99. Absurda quae deducuntur ut plurimum proceduntTerram esse in centro mundi vel extra centrum immotam, ut quandodicunt hinc necessario declinaturam ad aliquam partemcircumferentiae coeli et sic contingere posse ut Sol et Luna perdiametrum opponantur et tamen non contingat eclipsis, nam posito
485 motu Terrae extra centrum nullo modo posset esse oppositiodiametralis sine eclipsi, maxime cum Luna et Terra non sint in caelodistincto.
Undecima. Non est necesse locum damnatorum esse in centromundi, sufficit enim ipsos esse in centro magis tenebroso, immundo
490 et imperfecto quale est centrum Terrae et multo minus necesse estomnia corpora caelestia simpliciter coordinari secundum perfectiuset imperfectius nam, ut patebit infra etiam in sententiaadversariorum, Mars est ignobilior Sole et tamen superior, ergoLuna, quae est ignobilior Sole, poterit extra centrum collocari.
495 Duodecima. Quando dicitur de ratione corporis essemo[112]bilitatem non est simpliciter intelligendum nisi de possibiliet corpore gravi et levi gravitate et levitate ordinata ad centrumaliquod proprium a quo dimoveri possit, deinde intelligendum est decorpore immediate circundante medium. Quemadmodum ergo
500 coelum Empyreum ponitur esse corpus et immobile, poterit etiamponi Sol corpus et immobile.
MEMBRUM QUARTUMQuomodo solvantur argumenta Copernici
Pro solutione rationum Copernicarum sit.
99. Decimum S
416 Michela Malpangotto
505 Prima propositio. Quo corpus est luminosius et intensius lumenproducit eo propinquius videtur quia citius terminat nostrum visum ;quo remissius eo longinquius quia tardius et difficilius visionemterminat.
Secunda. Quando stellae vel planetae oriuntur vesperi eo510 intensius lumen respectu nostri producunt quia, paulatim recedente
Sole, possunt maiorem luminis copiam diffundere ; quando veromane oriuntur eo remissius lucent quia, paulatim crescente Solisluce, diminuitur stellarum lux100 et haec est causa cur in exortuvespertino stellae videantur propinquiores, in matutino remotiores.
515 Tertia. Simetria et proportio admittit saepe varietatem etinterpositionem alicuius minoris quam sint vel praecedentia velsubsequentia, ut patet in simetria musica ubi ad harmoniam perfecteconstituendam saepe interponuntur semitoni, dieses et silentia ; ergonon destruetur simetria universi etiamsi ponatur quarto loco Sol
520 cuius crassities sit 94 semidiametrorum Terrae et tertio Venus quaesit 933, primo loco Luna quae habeat 31 semidiametrum.
Quarta. Poterit Sol, existens in medio planetarum tanquam mundilampas, aequaliter radios suos ad omnes planetas et Terram ipsamdiffundere ; item omnia vivificare, conservare et producere nec hac de
525 causa ponendus erit in centro mundi.
[113] Quinta101. Aliud est Terram esse centrum sphaerarumtotalium, aliud omnium orbium partialium, illud enim conceditur abomnibus astrologis, hoc negatur ab his qui ponunt circuloseccentricos ; nec inde deduci poterit argumentum102 probans non esse
530 inconveniens illam omnino esse extra sphaerarum centrum.
Aliae obiectiones sunt topicae et facile solvuntur.
MEMBRUM QUINTUMQuisnam sit sphaerarum ordo iuxta communem sententiam
Communiter tali modo coordinantur sphaerae : in centro locatur535 Terra, secundo loco Luna, tertio Mercurius, quarto Venus, quinto
Sol, sexto Mars, septimo Iupiter, octavo Saturnus, nono Stellatum,decimo Cristallinum, undecimo caelum quoddam innominatum cuiconvenit una ex librationi
100. Dux S101. Quintum S102. Augumentum S
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 417
[114]bus, duodecimo Primum Mobile, decimotertio Empyreum et540 rationes pro tali ordine sumuntur vel ex diversitate aspectuum vel ex
velocitate motus proprii vel ex maiori vel minori umbravel ex eclipsi vel ex conformitatibus vel ex effectibus.
Primo. Igitur probatur quia eo sphaera est altior quo minorem103
habet diversitatem aspectus at Luna habet maximam104 et caetera545 ergo et caetera deinde Mercurius et caetera. Maior patet praecedenti
figura et melius infra, minor nota est experientiis.Probatur secundo. Quia eo corpus est propinquius quo caeteris
paribus maiorem facit umbram, ut ostendunt perspectivi at Lunamaiorem facit umbram in eodem signo et elevatione, verbi gratia, in
550 primo Cancri gradu caeteris paribus quocunque alio planeta, utexperientia105 notum est, ergo erit propinquior.
Tertio. Quia quo velocius caelum proprio motu movetur eo magisdistat a Primo Mobili, at Luna velocior est omnibus superioribus eteodem modo alii planetae, nam illa conficit cursum spatio 27 dierum
555 quamvis attendentes ipsius coniunctionem cum Sole illi demus 29 ;Mercurius, Venus et Sol fere spatio unius anni, citius tamenMercurius Venere et Venus Sole, Mars spatio 2 annorum, Iupiter 12,Saturnus 30 ergo et caetera.
Quarto. Sydus eclipsans aliud est illo inferius at Luna eclipsat560 Solem et omnes planetas, Sol Martem, Iovem et Saturnum nec non
103. Maiorem S104. Minorem S105. Experienti S
418 Michela Malpangotto
stellas Firmamenti. Eodem modo Mercurius Venerem, Venussuperiores planetas saltem ex parte ergo et caetera.
Quinto. Probatur contra Aristotelem, libro secundo De caelo etprimo Meteororum, Solem non esse immediate post Lunam quia est
565 tanta distantia inter Lunam et Solem ut inconveniens fuerit Deumnon posuisse aliud sydus inter illos, ponuntur enim mille et sexsemidiametri Terrae, cum inter Lunam et Terram non ponantur nisisexagintaquatuor. Deinde Sol, qui debebat maxime moderate suosinfluxus communicare Terrae, non debebat esse tam vicinus Terrae ;
570 tandem collocandus videbatur in medio tanquam fons luminis, ne sipositus fuisset prope octavam sphaeram Terra nimis obscuraevaderet.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Abbreviations sources d’archive
ASBR Archivio Storico dei PP. Barnabiti di Roma
ASBM Archivio Storico dei PP. Barnabiti di Milano
APSAMi Archivio Particolare dei PP. Barnabiti in S. Alessandro di Milano
Sources
BARANZANO R., Uranoscopia seu De coelo, Coloniae Allobrogum, 1617 ;Réimpression fac-similé sur CD-rom n. 12 de Il Giardino di Archimede.
BARANZANO R., Nova de motu Terrae copernicaeo iuxta Summi Pontificismentem disputatio, [Coloniae Allobrogum] ; Réimpression fac-similé sur CD-rom n. 12 de Il Giardino di Archimede.
BARANZANO R., Novae opiniones physicae seu tomus primis secundae partissummae philosophicae Anneciencis et physica auscultatoria octo Physicorumlibris explanandis accommodata. Cum insigni introductiuncula, Tractatu deQualitatibus occultis et Duplici Indice, Lugduni, 1619
BARANZANO R., Campus philosophicus in quo omnes dialecticae quaestiones,breviter, clare et subtiliter suo quaeque loco agitantur, Lugduni, 1619
BRAHE T., De mundi aetherei recentioribus phaenomenis, Vraniburgi, 1588.BRAHE T., Astronomiae instauratae Progymnasmata, Frankfurt, 1610.BRAHE T., Opera omnia, edidit J. L. E. Dreyer, 15 vol., Copenhague, 1913-
1929 ; réimpression fac-similé Amsterdam, 1972.CLAVIUS C., In Sphaeram Ioannis de Sacrobosco commentarius, Romae, 1581 ;
Romae, 1585 ; Venetiis, 1591 ; Lugduni, 1593 ; Venetiis, 1601 ; Romae,1606 ; dans le tome 3 de Opera mathematica, Moguntiae, 1611-1612.
CLAVIUS C., Corrispondenza, U. Baldini et P. D. Napolitani (éds.), 7 tomes en14 fascicules, (preprint) Pise, 1992.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 419
COPERNIC N., De Revolutionibus orbium coelestium libri VI, Norimbergae,1543 (réimpression fac-similé Bruxelles, 1966) ; trad. italienne de Barone F.(éd.), Opere di Nicola Copernico, UTET, Torino, 1979 ; trad. française par-tielle de Koyré A., Des Révolutions des Orbes Célestes, Diderot Éditeur,1998 ; trad. italienne partielle de Renato Giroldini avec introduction deMichel Blay et commentaire de Jean Seidengart dans La struttura del cosmo,Olschki, Firenze, 2009.
COPERNIC N., Complete works, Dobrzycki J. (éd.), Varsovie-Cracovie, 1978.FERNEL J., Cosmotheoria, Parisiis, 1527.
GALILEI G., Sidereus Nuncius, Venetiis, 1610 ; trad. française de Hallyn F.,Seuil, Paris, 1992 (réimpr. 2009) ; trad. française de Pantin I., Les Belles Let-tres, Paris, 1992.
GALILEI G., Le opere, edizione nazionale, éd. Antonio Favaro, 20 vol., Firenze,1890-1909 ; réimp. Florence 1964-1968.
LORENZINI A., De numero, ordine, et motu coelorum adversus recentiores.Liber philosophis necessarius, Parisiis, 1606.
KEPLER I., Ad Vitellionem Paralipomena, Frankfurt, 1604 ; Paralipomènes àVitellion, trad. fr. partielle par C. Chevalley dans J. Kepler, Les fondements del’Optique moderne, Paris, 1980 ; in Opera omnia, éd. C. Frisch, Frankfurt,1858.
MAGINI G. A., Novae coelestium orbium theoricae congruentes cum observatio-nibus N. Copernici, Venetiis, 1589.
RUBIO A., Commentarii in libros Aristotelis stagiritae De coelo et mundo, unacum dubiis et quaestionibus in Schola agitari solitis. Nun primum in Germa-nia editi permissu superiorum, Coloniae Agrippinae, 1617.
Littérature secondaire sur R. Baranzano et les Barnabites
BOFFITO G., Scrittori barnabiti, Firenze, 1933.CAGNI G. M., Galileiani prima di Galilei, dans “ Barnabiti ieri e oggi ”, Numero
unico, 1983, p. 46-47.CALLOT E., La philosophie annecienne de Dom Redento Baranzano, dans “ La
Revue savoisienne ”, 117 (1977), pp. 51-69. COLOMBO G., Intorno alla vita e alle opere di P. Redento Baranzano scienziato
da Serravalle Sesia, Torino, 1878.DUCIS, Notice sur Dom Baranzano Père Barnabite professeur au Collège Chap-
puisien d’Annecy, dans “ La Revue Savoisienne ”, (1881), pp. 85-88.GUERRINI L., Eliocentrismo e astrologia nell’età di Galileo. L’Uranoscopia di
Redento Baranzano, dans Nella luce degli astri. L’astrologia nella cultura delRinascimento, éd. O. Pompeo Faracovi, Sarzana, 2004.
LUIGI P., LEVATI M., IDELFONSO P. et CLERICI M., Menologio dei Barna-biti, Genova, 1932.
420 Michela Malpangotto
MALPANGOTTO M., Tradizione aristotelico-tolemaica e novità copernicanenell’Uranoscopia di P. Redento Baranzano, dans L. Giacardi, M. Mosca, O.Robutti (éds.), “ Conferenze e seminari dell’Associazione Subalpina Mathesis2006-2007 ”, Torino, 2007.
NICERON J. P., Mémoires pour servir à l’histoire des hommes illustrés dans larépublique des lettres, avec un catalogue raisonné de leurs ouvrages, Paris,1727.
PREMOLI O., Storia dei Barnabiti nel Cinquecento, Roma, 1913.REBUT M., Le Collège Chappuisien, dans “ La Revue Savoisienne ”, 103
(1963), pp. 82-108.REGAZZONI M. M., Presenza dei Barnabiti in Savoia al tempo di S. Francesco
di Sales, dans “ Barnabiti Studi ”, 15 (1998), p. 213-335. RIGHINI-BONELLI M. L., Baranzano Giovanni Antonio, Dictionary of scienti-
fic biography, New York, 1970-1980.TRONTI M., Baranzano Redento, Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto
della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma. I Barnabiti nel IV Centenario dalla fondazione (1533-1933), Numero unico e
annuario dell’Istituto Vittorino da Feltre, Tipografia Artigianelli, Genova,1933.
Litterature secondaire
BALDINI U., Legem impone subactis. Studi su filosofia e scienza dei Gesuiti inItalia 1540-1632, Bulzoni Editore, Roma, 1992.
BERETTA F., Galilée en procès, Galilée réhabilité ?, Saint-Maurice, 2005.BESOMI O. et CAMEROTA M., Galileo e il parnaso tychonico, dans “ Biblio-
teca di Nuncius. Studi e testi ”, XLI, Olschki, Firenze, 2000.BLAY M. et HALLEUX R. (éds.), La science classique XVIe-XVIIIe siècle. Dic-
tionnaire critique, Paris, 1998.BLAY M., Penser avec l’infini, Vuibert-Adapt-Snes, Paris, 2010.BUCCIANTINI M., Galileo e Keplero. Filosofia, cosmologia e teologia nell’Età
della Controriforma, Torino, 2003 ; Galilée et Kepler : philosophie, cosmolo-gie et théologie à l'époque de la Contre-Réforme, trad. fr. par Gérard Marino,Les Belles Lettres, Paris, 2008.
M. BUCCIANTINI, Federico Borromeo e la nuova scienza, dans “ Tra i fondidell’Ambrosiana. Manoscritti italiani antichi e moderni”, Marco Ballarini,Gennaro Barbarisi, Claudia Berra, Giuseppe Frasso (éds.), Cisalpino, Milano,2008, Tomo I, pp. 355-375.
CHABAS J. et GOLDSTEIN B. R., The Alphonsine Tables of Toledo, KluwerAcademic Publishers, Dordrecht, 2003.
COMES M., MIELGO H. et SAMSÓ J. (éds.), “ Ochava espera ” y “ astrofísi-ca ”. Textos y estudios sobre las fuentes árabes de la astronomía de AlfonsoX, Barcelona 1990.
Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 421
EVANS J., The history and practice of ancient astronomy, Oxford UniversityPress, New York, 1998 ; version Française à paraître Les Belles Lettres, Paris.
FAVARO A., Carteggio inedito di Ticone Brahe, Giovanni Keplero e di altri cele-bri astronomi e matematici dei secoli XVI e XVII con Giovanni AntonioMagini, tratto dall’Archivio Malvezzi de’ Medici in Bologna, Zanichelli,Bologna, 1886 ; reimpr. Nabu Press, 2010.
FAVARO A. (éd.), Galileo e l’inquisizione. Documenti del processo galileianoesistenti nell’archivio del Sant’Uffizio e nell’archivio segreto vaticano per laprima volta integralmente pubblicati da Antonio Favaro, G. Barbéra editore,Firenze, 1907.
GIARD L. (éd), Les Jésuites à la Renaissance, système éducatif et production dusavoir, Presses universitaires de France, Paris, 1995.
GEYMONAT L., Galileo Galilei, Torino, 1978 ; Galilée, trad. fr. par SylvieMartin, Paris, 1992.
GINGERICH O., An annotated census of Copernicus’ De Revolutionibus(Nuremberg, 1543 and Basel, 1566), Leiden 2002.
GINGERICH O., The book nobody read : chasing the revolutions of NicolausCopernicus, New York 2004 ; Le livre que nul n'avait lu : à la poursuite du“ De revolutionibus ” de Copernic, trad. fr. Jean-Jacques Szczeciniarz, Paris2008.
GOLDSTEIN B., On the theory of trepidation, “ Centaurus ”, 10 (1964) Issue 4,pp. 232-247.
GRANADA M. et MEHL E. (éds.), Nouveau ciel, nouvelle terre. La révolutioncopernicienne dans l’Allemagne de la Réforme (1530-1630), Paris 2009.
GRANT E., Planets, stars, and orbs, Cambridge University Press, Cambridge,1994 (digital reprint 2009).
JARDINE N. et SEGONDS A. P., La guerre des astronomes : la querelle au sujetde l’origine du système géo-héliocentrique à la fin du XVIe siècle, Paris 2008.
KOYRE A., Etudes d’histoire de la pensée scientifique, Paris 1966, réimp. Paris2007.
KOYRE A., From the close world to the infinity universe, Baltimore 1957 ; Dumonde clos à l’univers infini, trad. fr. par Raissa Tarr, Paris 1962, réimp. 2007.
KUHN T. S., La rivoluzione copernicana, Torino 1972 ; La révolution coperni-cienne, tr. fr. par Avram Hayli, Paris 1992.
LERNER M. P., Le monde des sphères, Paris 1996-1997 ; 2e éd. Paris 2008.
LERNER M. P., Copernic suspendu et corrigé : sur deux décrets de la congréga-tion romaine de l’Index (1616-1620), I primi lincei e il Sant’Uffizio : ques-tioni di scienza e di fede. Atti dei Convegni Lincei, Roma 2003, pp. 321-402.
LERNER M. P. et SEGONDS A. P., Sur un “ avertissement ” célèbre : l’Ad lecto-rem du De revolutionibus de Nicolas Copernic, Galilaeana, V, 2008, pp. 113-148.
422 Michela Malpangotto
MAYAUD P. N., Le conflit entre l’astronomie nouvelle et l’écriture Sainte auxXVI et XVII siècles, Paris, 2005.
PAGANO S. M. (éd.), I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei (1611-1741), Città del Vaticano, 1984 ; Nuova edizione accresciuta, rivista e anno-tata da S. Pagano, Città del Vaticano, 2009.
POULLE E., Les astronomes parisiens au XIVe siècle et l'astronomie alphonsine,dans “ Histoire littéraire de la France ”, t. 43, fasc. 1, 2005, p. 1-54.
ROSSI P., La rivoluzione scientifica : da Copernico a Newton, Torino 1975.
ROSSI P., La nascita della scienza moderna in Europa, Bari 2000 ; Aux originesde la science moderne, Paris 2004.