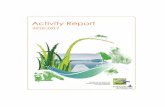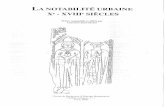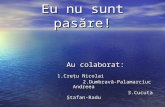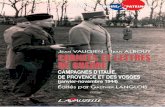Voyages depuis et vers l'étranger au 14 janvier - Ministère de l ...
Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia...
-
Upload
univ-lyon2 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia...
Rendant compte de l’abbatiat d’Arnulf de Louvain (1240-1248), le moine de Villers qui, à la génération suivante, rédige la Chronique de son monastère mentionne l’épisode suivant2:
Alors que l’abbé de Clairvaux avait fondé une maison à Paris pour y instaurer une école, il demanda à notre père une somme d’argent en subside. Surpris, celui-ci fut stupéfi é par une telle nouveauté. Il savait en eff et que l’ordre fondé dans une gran-de simplicité avait louablement persévéré jusqu’à cette époque dans son humilité et dans sa pureté et avait admirablement progressé au spirituel comme au tempo-rel, et que la coutume n’avait jamais prévu que les moines se consacrent à l’étude des lettres, au détriment de l’observance monastique qui convient mieux que tout autre au vœu de leur profession, conformément au mot du bienheureux Bernard: «Le moine n’a pas pour offi ce d’enseigner mais de pleurer» [Bernard de Clairvaux, Sermo LXIV in Cant., 3 d’après Jérôme, Contra Vigilant. 15; PL 23, 352]. Crai-gnant donc que les personnes de l’ordre ne s’amollissent et ne s’enorgueillissent à cause de l’étude, plus qu’ils n’y avaient été sujets auparavant, conformément au mot de Paul: «La science rend orgueilleux» [1 Cor. 8, 1], il déclara avec constance qu’il ne donnerait rien. L’abbé de Clairvaux le prit très mal. Quant à savoir si cet homme de Dieu avait compris la vérité et si l’humilité et la ferveur religieuse sont restées aussi abondantes dans l’ordre qu’avant que ne soient instaurées les études, que la génération à venir en soit juge.
Cette anecdote refl ète des débats réels datant des années 1230-1240 sur l’opportunité pour les Cisterciens d’envoyer des moines étudier dans les écoles3. Elle souligne aussi clairement la novitas que pouvaient repré-
Non obstante quod sunt monachi.Être moine et étudiant au Moyen Âge1
Cécile Caby
cécile caby
senter l’organisation raisonnée et la prise en charge explicite par les ins-titutions centrales de l’ordre – en l’occurrence le chapitre général – des études monastiques non plus dans l’enceinte du cloître, mais au sein des cadres contemporains de production du savoir, à savoir les universités. Qu’on ne s’y trompe pas: l’enjeu du débat n’est pas tant – comme on le lit trop souvent – la légitimité pour les moines de la culture en elle-même4, que les modalités et les cadres de l’acquisition du nouveau savoir scolaire, dans la mesure où ils interféraient avec la construction et la préservation de l’identité monastique cistercienne5. En somme, la question est de sa-voir – pour l’abbé Arnulf de Villers au milieu du XIIIe siècle, comme, un siècle plus tard, pour les visiteurs du collège bénédictin de Montpellier6 – si l’on peut être à la fois pleinement moine et étudiant.
De fait, contrairement à d’autres formes de vie régulière, notamment celle des chanoines réguliers ou surtout des ordres mendiants – et en premier lieu des frères prêcheurs7 –, qui construisent – sinon d’emblée, du moins très rapidement – leur identité et leur fonction dans la société en lien étroit avec le monde des écoles et de l’université8, les diff érentes branches du monachisme bénédictin et plus encore du «nouveau mo-nachisme» tendirent à adopter la position inverse, pour diverses raisons parmi lesquelles le lien intrinsèque entre villes et universités n’est pas la moindre9. Cette attitude hostile à la fréquentation des écoles universitai-res est d’ailleurs consacrée par les discours hagiographiques. On peut évi-demment rappeler les multiples variations sur le tout début du deuxième livre des Dialogues de Grégoire le Grand narrant la conversion de saint Benoît, au sujet de laquelle le moine de St-Albans Matthieu Paris raconte de façon très emblématique comment les moines de son temps lisaient et chantaient «en parlant du même saint, qu’il abandonna l’étude des let-tres et voulut se retirer dans des lieux déserts»10. Mais il faudrait ajouter les multiples exempla et sermons qui déclinent le motif de la conversion de l’étudiant ou du maître fuyant les vanités universitaires dans un mo-nastère, de préférence cistercien11.
C’est bien à ce titre que les études universitaires des moines constituent un observatoire particulièrement pertinent des modalités de construction de l’identité monastique et du statut des moines dans la société. En eff et, en tant qu’il représente au regard de ses congénères un cas-limite risquant
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
à tout moment de perdre ce qui fait de lui un moine, pour ne devenir qu’un étudiant, le moine-étudiant fait l’objet de toutes les attentions de la part des offi ciers occupés à la défi nition des pratiques de l’ordre et à leur contrôle. En ce sens, les discours normatifs produits sur les étu-des des moines tendent à dessiner, de façon plus évidente que beaucoup d’autres objets de législation, les critères distinctifs construisant l’identité monastique, voire l’identité de tel ordre dans la société12. C’est dans cette perspective, et sans prétendre nullement à un traitement exhaustif tant le domaine est vaste, que je voudrais réexaminer certains aspects du dossier des études universitaires des moines aux XIIIe et XIVe siècles, en croisant les discours normatifs (lettres des supérieurs, statuts, défi nitions capitu-laires etc.) et les documents de la pratique (comptabilités, comptes-ren-dus de visites etc.), plus rarement édités voire seulement évoqués par les historiens, alors qu’ils fournissent souvent un éclairage très concret sur la mise en œuvre au quotidien des études des moines dans les écoles urbai-nes. La superposition du statut de moine et du statut d’étudiant – dont le défi nition est d’ailleurs encore en cours au XIIIe siècle – dans un unique individu génère en eff et un certain nombre de procédures d’ajustement des pratiques monastiques que l’on peut défi nir comme autant de com-promis vis-à-vis des éléments constitutifs de l’observance monastique. Or, c’est très précisément à la croisée entre production de la norme et pra-tiques sociales que ces compromis émergent, au gré de confl its, de débats ou de simples tensions qui soulignent les eff orts continus accomplis en vue de la construction d’une identité normée des individus et du groupe. Deux types de compromis imposés par le statut hybride du moine-étu-diant guideront – d’ailleurs très inégalement – ma réfl exion: d’une part les compromis institutionnels; d’autre part les compromis disciplinaires, façonnés par les multiples facettes de l’exubérance dérogatoire, et au sein desquels les compromis spatiaux occupent une place primordiale.
1. Compromis institutionnels
Les moines fréquentant les écoles apparaissent d’abord de façon iso-lée, au détour de quelque lettre sans suite s’adressant à l’un d’entre eux13.
cécile caby
Puis, au milieu du XIIIe siècle, ils surgissent en masse et de façon récur-rente dans la documentation des ordres clunisiens et cisterciens. À ce moment-là, leur nombre, la diversité voire l’indiscipline de leurs com-portement – notamment au regard des critères d’unanimité des nouvelles structures d’ordre –, et vraisemblablement aussi le coût de leur entretien justifi ent en eff et que l’on prenne à leur égard des mesures spécifi ques et communes à l’échelle des ordres14.
Propria domus studio deputata15
Dans l’ordre cistercien par exemple16, c’est de Clairvaux que part l’impulsion, d’abord de façon empirique dès le premier tiers du XIIIe siècle17, puis plus systématiquement sous l’abbatiat d’Étienne de Lexing-ton18, l’abbé visé par Arnulf. Comble du paradoxe, cet Anglais de nais-sance serait entré dans l’ordre cistercien en 1221, en même temps que sept autres étudiants qui suivaient à Oxford les leçons d’Edmund Rich, le futur saint évêque de Canterbury19. Au cours de sa fulgurante car-rière, Étienne fi t de la question des études universitaires des moines le fer de lance de son projet de réforme de l’ordre, comme l’attestent sa correspondance en tant que visiteur et réformateur des monastères cister-ciens d’Irlande dès 1228-122920, mais surtout une lettre adressée en tant qu’abbé de Savigny à l’abbé de Pontigny, vers 1236. Cette dernière avait pour objet de convaincre son destinataire de la nécessité de rassembler les abbés de Cîteaux et Clairvaux ainsi que d’autres personnes compétentes, si nécessaire, sans attendre le prochain chapitre général (Nam secundum peritorum quorumdam de ordine nostro iudicium sine graui scandalo et magno status generalis ordinis nostri periculo nequaquam expectari poterit tempore capituli generalis). Si besoin était, il ne devait pas hésiter à solli-citer l’aide de ses amis à la curie voire du pape lui-même, pour aff ronter la question des études. En eff et, concluait la lettre, une telle urgence et une telle solution étaient parfaitement justifi ées par la nécessité pressante de mettre fi n à la multiplication récente d’aff aires d’hérésie au sein de l’ordre cistercien et de faire face à la menace de sa ruine21.
Devenu abbé de Clairvaux, ce même Étienne su jouer effi cacement de ses soutiens familiaux et de ses appuis muris de longue date à la curie, notamment ceux du cardinal cistercien anglais Jean dit de Tolède (1244-
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
1275)22. C’est ainsi que, il demande et reçoit, le 5 janvier 1245, du pape Innocent IV l’autorisation d’envoyer des moines étudier sub regulari ob-servantia à Paris23. Cette licence est rapidement étendue à tous les abbés de l’ordre cistercien, puis répétée, confi rmée et amplifi ée à l’occasion du chapitre général de l’ordre en septembre 124524. Ce premier essai que le chapitre général, agissant sous la pression pontifi cale et curiale, n’avait pourtant encouragé que du bout des lèvres25, fi t peu à peu des émules, notamment dans le Midi français. Les Cisterciens y avaient d’ailleurs développé depuis plusieurs décennies des liens particuliers avec les ca-dres scolaires créés ou encouragés dans le cadre de la lutte antihérétique. Dès les années 1260, une école de théologie cistercienne fut fondée par l’abbaye de Valmagne près des écoles de Montpellier grâce à un don du roi Jayme Ier d’Aragon (7 juin 1263), puis confi rmée et dotée par la pa-pauté des mêmes privilèges, libertés et immunités que celle de Paris dès 1265. Plus tard, en 1280-1281, Grandselve demanda et obtint l’auto-risation de fonder un studium à Toulouse qui sera reconnu, en 1289, comme le cinquième studium cistercien26. Le modèle des écoles cister-ciennes – lui-même inspiré des pratiques canoniales, puis conforté par les usages des ordres mendiants avec les encouragements de la papauté – fut rapidement adopté, en particulier par les grandes abbayes béné-dictines. C’est le cas de Saint-Denis qui achète en 1263 un terrain des-tiné à la construction d’une maison d’études, mais qui loge sans doute des étudiants à Paris depuis 1229-123027. C’est aussi le cas de Fleury qui, en la personne de son abbé Jean, et avec l’appui du légat pontifi cal, envisage dès 1247 de se doter d’une maison d’étude à Paris, pour les moines-étudiants du prieuré de Saint-Gervais-lez-Orléans «qui fussent supérieurs aux autres en savoir et voulussent acquérir des connaissances plus étendues»28. Quant à Cluny29, c’est en 1260 que le chapitre général enregistre l’existence d’une maison d’études pour les moines de l’ordre et mentionne la présence d’une bibliothèque commune placée sous la garde du prieur30. L’année suivante, le chapitre autorise l’abbé à acheter une maison «pour l’usage des dits écoliers». Enfi n l’institutionnalisation du studium est achevée l’année suivante (1262) lorsque le pape Urbain IV prend acte de l’existence de cette maison d’étude et autorise l’abbé Yves Ier à y construire un oratoire31.
cécile caby
Tournant scolaire et ius proprium dans l’ordre cistercienPar-delà les détails du contexte et de la chronologie propres à cha-
cune de ces fondations32, et avant même de nous arrêter aux diffi cultés concrètes posées par ce type d’établissement dans le quotidien de la vie monastique, il faut relever le caractère extrêmement progressif et sou-vent confl ictuel de l’insertion de ces nouveaux éléments dans les orga-nigrammes des ordres religieux. Certes, la défi nition du chapitre général cistercien de septembre 1245 avait prévu – d’ailleurs sans grand succès – l’organisation d’un réseau de studia en théologie à raison de un par province ecclésiastique, conformément au modèle récemment mis en place dans l’ordre des frères prêcheurs. Pourtant, les mesures concrètes concernant les maisons d’étudiants restèrent longtemps ponctuelles et trahissent une méfi ance et un tâtonnement institutionnel qui ne ces-sera que dans les dernières décennies du siècle. La défi nition du chapitre laissait d’ailleurs la voie ouverte à un système somme toute traditionnel de studia de théologie internes, s’appuyant sur le réseau préexistant d’ab-bayes et par conséquent déconnecté des villes et des universités, ce qui est d’ailleurs un peu contradictoire avec l’indication d’horaires de sorties. Cette solution était du reste confi rmée, quelques mois plus tard, par une lettre du pape invitant le maître général dominicain à envoyer à Cîteaux un maître de son ordre33 et, plus généralement, par la présence diff use de lecteurs mendiants dans certaines grandes abbayes34.
À vrai dire, en tant que fondation nouvelle, le studium parisien – comme plus tard ceux de Montpellier et Toulouse – peina à trouver sa place dans la structure commune de l’ordre. Il n’est qu’à voir son nom, discordant par rapport à l’usage de l’ordre qui réserve la titulature de ses maisons à la Vierge35, mais aussi les hésitations concernant le titre de son supérieur. D’abord nommé prior, le moine placé à la tête de la commu-nauté parisienne est désigné, après 1248, par le terme provisor, sans doute parce que la notion même de prior était contradictoire avec la structure cistercienne et risquait de mettre en péril la juridiction de l’abbé père36. De façon générale, la défi nition du chapitre de 1245 portait d’ailleurs en germe toute une série de tensions liées au respect du principe de fi liation dans l’ordre cistercien – avec lequel l’organisation géographique du pro-jet de réseau des studia était clairement contradictoire37 – et notamment,
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
dans l’immédiat, à la question des rapports juridictionnels de la maison parisienne et de ses occupants avec l’abbé de Clairvaux. Les moines cis-terciens étudiant à Paris pouvaient en eff et provenir d’abbayes de tout l’ordre et il fallait préserver les droits de leurs abbés pères, tout en sau-vegardant la juridiction et le droit de correction de l’abbé de Clairvaux dont la domus parisienne était un membrum proprium38. Deux ans plus tard, le chapitre se préoccupe d’intégrer le provisor de cette maison au sein des rituels collectifs qui cimentent la cohérence de l’ordre: la place d’honneur qui lui est réservée dans toutes les abbayes qu’il visiterait si-gnale d’ailleurs en passant l’importance que les études universitaires ont peu à peu acquise dans l’ordre39. Reste que le statut de cette maison et de ses habitants – étudiants mais aussi futurs et hypothétiques maîtres – est l’occasion et fait l’objet de nombre d’interventions pontifi cales allant pour la plupart dans le sens d’une dérogation au ius proprium cistercien. Qu’il suffi se de citer les privilèges prévoyant l’exemption des étudiants de toute charge dans l’ordre en vertu de leur investissement dans les études (1251)40, l’accueil de novices et la possibilité de prêcher en pu-blic (1254)41 ou encore l’attribution de bénéfi ces ecclésiastiques pour l’entretien des étudiants (1256)42. Autant de mesures qui ne durent pas manquer d’accroître les crispations au sein de l’ordre43. Sans parler du fâcheux déséquilibre que ce statut spécial créait en faveur de Clairvaux, abbaye mère du studium parisien44 qui, même après les réformes des an-nées 1280 créant, cette fois concrètement, un réseau de studia répartis de façon homogène dans les espaces de diff usion de l’ordre, restait le seul studium generale ouvert à tous les Cisterciens d’où qu’ils viennent45. Il fallut attendre une décision du chapitre de 1321 ordonnant la vente du studium parisien à l’abbaye de Cîteaux pour que la juridiction sur l’exceptionnelle maison parisienne, et notamment la nomination de son supérieur, échappe à l’abbé de Clairvaux et échoue collégialement au défi nitoire du chapitre dont le rôle ne fera ensuite que s’accroître46.
Au détour de tel ou tel privilège pontifi cal, on découvre d’ailleurs l’importance des enjeux et on démêle, derrière des clichés en apparence immuables, l’urgente actualité de formules renouvelées par les tensions créées au sein des ordres par la révolution universitaire. Lorsque, en jan-vier 1256, le pape concède aux Cisterciens étudiant la théologie et ré-
cécile caby
sidant à Saint-Bernard de Paris la liberté de prêcher en public47, il fait valoir l’argument d’utilité commune (ne studium vestrum inutile, si non proveniret exinde fructus aliquis) au-delà de tout autre critère, y compris celui du statut monastique (non obstante quod estis monachi). De fait, aux yeux de la papauté du milieu du XIIIe siècle, le modèle de vita religiosa au service de l’Église est désormais celui des frères prêcheurs et mineurs, à l’exemple desquels le privilège renvoie d’ailleurs très naturellement (illa qua fratres minores et predicatores illic morantes utuntur omnimoda utamini libertate)48. Le processus de conformation au nouveau modèle mendiant, façonné par la papauté elle-même, était dans l’air du temps comme Étienne de Lexington l’avait fort bien compris, dès les années 1230, lorsqu’il invitait l’abbé de Pontigny à solliciter de toute urgence ses co-abbés et le pape à réfl échir au moyen d’enrayer la ruine de l’ordre, et en premier lieu son manque de lettrés, si l’on ne voulait pas voir se réaliser les prévisions de certains prédicateurs mendiants selon lesquels, en l’espace d’une décennie, ils auraient dû diriger et réformer eux-mê-mes l’ordre cistercien49. En défi nitive, par-delà l’interprétation qu’il en tire, Matthieu Paris se révèle un observateur attentif et informé lorsqu’il déplore le tournant universitaire des Cisterciens: il en identifi e la cause dans leur volonté de se hisser au rang des nouveaux ordres dans ce qu’il décrit amèrement comme une concurrence âpre entre les ordres religieux, orchestrée par l’orgueil du monde et de laquelle l’ordo monasticus auquel il appartient sort à ses yeux dénaturé50.
Sur fond de croissance du droit et de défi nition toujours plus stricte des critères juridiques d’appartenance à la vie religieuse, les nécessaires ajustements aux exigences de la vie universitaires mettaient en eff et à rude épreuve les éléments substantiels du statut monastique. Mais, en retour, la nécessaire défense de ces derniers contribuait en défi nitive à leur réaffi rmation et à leur actualisation. Il est d’ailleurs assez embléma-tique que le problème des études des moines surgisse, vers 1270-1271, dans une double question quodlibétique du franciscain Jean Pecham (v. 1230-1298) au sein d’un petit ensemble de cinq questions circa statum contemplativorum dont le fi l rouge est très clairement donné par les deux dernières, à savoir le problème du vœu monastique, substance même du statut du moine51. Les deux questions – «Un moine doit-il obéir à son
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
abbé qui lui ordonne de demeurer dans les écoles?» et «En supposant que la profession soit formulée ainsi ‘moi je promets obéissance selon la règle de saint Basile et le changement de mœurs dans le respect de la stabilité dans ce lieu’ peut-il en bonne conscience demeurer au studium?»52 – met-tent en eff et en jeu non la licéité des études en elles-mêmes – question rapidement évacuée au prétexte qu’étudier les lettres sacrées n’est pas contraire à la vocation monastique – mais celle des études in studio pu-blico ou in scholis qui ouvre sur diverses interrogations annexes, systéma-tiquement rapportées à la question de l’obéissance en tant que substan-tialis religioni, du vœu et de ses rapports à la règle. Or, dans ce cadre, les principaux points de la règle qui sont en cause sont d’une part l’humilité et le refus de la gloire – qui donne d’ailleurs lieu à la citation de l’adage de Jérôme que l’auteur de la Chronique de Villers mettait dans les mê-mes années dans la bouche de l’abbé Arnulf –, et d’autre part, et surtout, la stabilitas loci. Entendue dans un premier temps comme stabilité in claustro, sur la base du Décret de Gratien prescrivant la résidence des moines dans leur monastère quia sicut piscis sine aqua caret vita, ita sine monasterio monachus53, la stabilité est ensuite envisagée, dans la réponse à la seconde question qui conclut ce double quodlibet, sur la base de la coutume et de l’institution commune convoquées par le truchement d’une lettre de Bernard de Clairvaux54. À ce point, compte tenu de ce que les moines sont autorisés à sortir du cloître pour de multiples motifs, il est possible de conclure en faveur de la licéité de l’étude des moines qui stantes in scholis ab hac stabilitate non degenerant55.
Les enjeux des études universitaires des moines sur la défi nition et la préservation de l’identité et de la substance de l’état monastique se jouaient donc à plusieurs niveaux emboîtés de façon inextricable: au sein des ordres singuliers, au sein de l’ordo monasticus en général mais aussi, et toujours plus en raison des exigences de la centralisation romaine, au sein de la grande famille des réguliers et de l’institution ecclésiale dans son ensemble.
L’aff aire Étienne de Lexington (1256-1257)Sur ces bases, il me semble pertinent de relire l’une des multiples af-
faires qui se noua au milieu du XIIIe siècle, faisant éclater au grand jour
cécile caby
les contradictions latentes entre la papauté et l’ordre cistercien, à propos des revendications du pape à faire valoir le droit commun de l’Église, y compris face aux prétentions cisterciennes à préserver le ius particulare de l’ordre s’exprimant dans la voix du chapitre général (auctoritas capituli)56. L’aff aire en question eut précisément comme premier acteur Étienne de Lexington, le principal artisan de la promotion du studium cistercien à Paris, alors abbé de Clairvaux. Or, tout porte à croire que ce dernier fut visé en raison de son action – et de ses multiples implications – en faveur de l’introduction de ce corps étranger au sein de l’ordre, à une époque où le projet universitaire arrivait précisément à maturité, notamment grâce au soutien d’Alphonse de Poitiers57: dès 1254, le pape avait enjoint le chancelier de l’université de concéder au frère Guy et aux autres scolares cisterciens de Saint-Bernard de Paris qui en seraient dignes la licentia in-cipiendi et regendi, en dépit de leur statut régulier58; au printemps 1256, soit quelques mois avant que n’éclate l’aff aire, le même Guy, abbé cister-cien de l’Aumône, avait reçu du même pape la licentia regendi scolas et docendi publice Parisius en théologie59.
L’historiographie concernant cet épisode, qui vit la déposition de l’ab-bé de Clairvaux par le chapitre général de l’ordre en 1256, est largement conditionnée par la perception du projet scolaire d’Étienne de Lexing-ton en terme de déclin et de trahison des origines, et donc son implicite condamnation comme contraire à l’ordre. Elle est également portée par la volonté de dissimuler toute forme de tension ou de confl its traversant l’ordre et ses relations avec la papauté60. Alors que les sources cisterciennes (notamment les actes du chapitre général de 1256) entourent l’épisode d’un silence surprenant et suspect pour une aff aire de cette nature, le lien entre la déposition d’Étienne et son projet scolaire apparaît pour la pre-mière fois dans la Chronica Majora de Matthieu Paris. Ce dernier donne même deux versions – complémentaires plutôt que divergentes – du mê-me épisode. À l’année 1256, le moine anglais raconte comment l’abbé de Clairvaux constructor nobilis domus quae Chardenai dicitur, apud Parisius fut déposé par l’eff et de la jalousie de ses frères, sous le faux prétexte qu’il aurait demandé au pape le privilège de conserver son abbatiat à vie, en contradiction avec les coutumes de son ordre. Convaincu de la fausseté des accusations, le pape aurait tenté de faire rétablir l’abbé de Clairvaux
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
dans sa fonction, mais le roi de France tanquam ordinis Cistercensis zelator et protector l’en aurait dissuadé pour sauver l’ordre du scandale (grave scandalum generaretur ordini). Ce même motif aurait également animé la décision d’Étienne de se retirer ne laederetur ordinis auctoritas61. À l’année 1257, Matthieu Paris revient sur l’aff aire, rappelant les fausses accusations soulevées (eo quod contra statuta ordinis Cisterciensis privilegium impetra-verat suo perpetuo abbatizandi, ignominiose depositus est), mais soutenant encore plus clairement le lien entre la déposition de l’abbé de Clairvaux et son projet scolaire (Sed hoc, ut dicitur, malitiose et per invidiam machi-natum est in ipsum eo quod scolam Parisiensem quae Chardenai dicitur, ini-tiavit et initiam sustentaverat...). Il note à nouveau la volonté du pape de le réintégrer dans sa fonction, mais justifi e cette fois l’échec de l’opération par le succès de la brigue curiale des ennemis d’Étienne, peut-être par eff et de transition avec le chapitre suivant de sa chronique entièrement consacré à la déploration du statutum Romae cruentissimum62.
Or, la documentation pontifi cale, longtemps ignorée et exhumée il y a quarante ans environ par C.H. Lawence63, vient globalement confor-ter la reconstruction des faits par le moine de St-Albans, notamment sa chronologie s’étalant de septembre 1256 au printemps 1257. Elle per-met surtout de poser le décor d’un épisode qui peut être ramené dans le cadre d’une typologie de confl its, désormais bien connue, se déployant depuis le dernier tiers du XIIe siècle au sein de l’ordre et entre l’ordre et la papauté, à propos de la nature et de la fonction de l’ordre cistercien au sein de l’Église universelle. Tous les éléments caractéristiques de ces crises à répétition en sont en eff et rassemblés. Du côté du pape, la hié-rarchie entre utilité commune de l’Église et utilité de l’ordre – motif fréquemment employé par Innocent III lors de la promotion de Cister-ciens aux charges d’évêques ou de légats64 –; la récusation de l’argument cistercien – lui-même fondé sur un principe d’immutabilité des privilè-ges pontifi caux en vertu duquel la potestas pontifi cale sur l’ordre serait déléguée de façon permanente au chapitre général – qui consistait pour l’ordre à se réfugier derrière ses coutumes et ses statuts approuvés par le pape, alors que ce dernier faisait prévaloir l’autorité de l’Église romaine sur toute forme de ius particulare, fut-il fondé sur des privilèges ponti-fi caux65; et enfi n, en cas de confl it, la supériorité du droit de l’Église sur
cécile caby
le droit de l’ordre, impliquant la prétention du pape à faire valoir dans l’ordre cistercien la volonté apostolique, quand bien même elle entrerait en contradiction avec une décision du chapitre général – en l’occurrence la déposition de l’abbé de Clairvaux contra inhibitionem pape 66. Du côté de l’ordre, la défense du ius particulare tel qu’il est exprimé dans les cou-tumes et les statuts approuvés par le pape – ce qui implique qu’en accep-tant une procédure non conforme à ce droit, le pape se plaçait en état de contradiction fl agrante –; le refus, sur la base de ce droit spécial, de toute procédure de recours à un règlement extérieur à l’ordre, entreprise non pas collectivement mais directement par l’intéressé67 – en l’occur-rence l’abbé de Clairvaux qui avait vraisemblablement tenté d’anticiper la fronde à son encontre par le recours au pape, manœuvre retournée contre lui par le chapitre –; enfi n, la prétention des abbés-pères et du chapitre général à agir de façon autonome au sein de l’ordre, en refusant toute ingérence d’autorité en provenance du siège apostolique68. Or, en la matière et indépendamment des facteurs immédiats ayant déclenché la crise de 1256-1257, la mise en œuvre du projet universitaire d’Étienne avait justifi é maintes interventions de la papauté, d’abord sous forme de conseils69 mais, aussi souvent, par la voie dérogatoire de privilèges ad hoc. En somme, c’était donc bien de la cohérence de la structure de l’ordre, garantie de leur expérience de vie et des fondements juridiques de l’iden-tité cistercienne, dont il s’agissait. Étienne de Lexington ne s’y trompa d’ailleurs pas si l’on s’en tient au récit de Matthieu Paris, selon lequel l’abbé de Clairvaux déchu aurait préféré renoncer à toute forme d’action et accepter sa déposition ne laederetur ordinis auctoritas, alors même qu’il avait de son côté le pape70.
Compte tenu des tensions et des ajustements de toute sorte suscités par le projet universitaire d’Étienne de Lexington, l’analyse de la crise institutionnelle que ce projet contribua à soulever, au sein d’un ordre que la papauté utilisait depuis plusieurs décennies comme modèle de vita religiosa, me paraît en défi nitive riche d’enseignements. Il est en eff et très révélateur des enjeux soulevés par les études universitaires des moi-nes pour la défi nition de l’identité collective des ordres, mais aussi pour la défi nition des contours de la vocation monastique, que ce confl it se soit précisément noué autour de cette question: d’abord au sein du cha-
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
pitre général cistercien, puis entre ce dernier et une papauté soucieuse de soumettre toute forme de vita religiosa à l’autorité de l’Église romaine, afi n de se doter d’auxiliaires choisis en fonction de leur utilitas.
2. Compromis disciplinaires
Au-delà de cette authentique crise institutionnelle, il ne faut toutefois pas perdre de vue que la recherche des compromis permettant l’incorpo-ration aux ordres religieux du nouveau type de maisons que constituaient les studia monastiques commençait sur le terrain, de la nécessité de régler au jour le jour les risques potentiels que les exigences de la vie universi-taire faisaient courir au délicat équilibre identitaire des moines-étudiants. Or ce règlement passait par des condamnations ou, à l’inverse, des dis-penses et des dérogations émanant des diff érents organes d’élaboration du droit des religieux: le pape, comme nous l’avons déjà relevé, et les or-ganes centraux des ordres – abbés, chapitres généraux etc. Nous ne ferons ici qu’en esquisser quelques aspects, souvent les plus urgents et donc ceux qui apparaissent le plus tôt dans la documentation, renvoyant à plus tard un traitement exhaustif de questions qui nécessitent souvent le recours à une documentation plus tardive et combien plus abondante71.
Compromis spatiaux: lieux de vie et circulations des moines-étudiantsIl apparaît clairement que l’un des principaux motifs qui préside à la
création des premières maisons d’études en ville et qui justifi e souvent l’apparition des moines-étudiants dans la documentation des maisons ou des ordres est la question primordiale de leur logement. Il ne s’agit proba-blement pas d’un hasard dans la mesure où, parallèlement au règlement très concret de son coût, la question du logement des moines-étudiants renvoie d’emblée à un ensemble de critères essentiels de l’identité monas-tique: d’une part la stabilitas, et en conséquence la vie communautaire, mais aussi la question de l’obéissance à l’abbé, seul habilité, avec le pape, à autoriser un moine à quitter son monastère de profession pour aller étudier72; d’autre part, l’idéal de retrait du monde et donc la question des rapports complexes entre vie monastique et espaces urbains, particu-
cécile caby
lièrement problématique pour les ordres qui, comme celui de Cîteaux, professaient le désert73.
Ces questions sont d’ailleurs celles qui motivent les principales in-terdictions promulguées par les synodes et les conciles – notamment le huitième canon du concile de Tours en 1163, repris à Latran III en 1179 et incorporé aux Décrétales dans une bulle d’Honorius III promulguée en 1225 – et les synodes à l’encontre de la fréquentation des universi-tés par les moines. Indépendamment de la stigmatisation de certaines disciplines, comme le droit romain ou la médecine, déconseillées voire interdites aux moines en dépit de dérogations toujours plus nombreuses au cours du XIVe siècle, ce qui semble bien être au cœur de toutes les interdictions est le fait de sortir de la clôture pour aller les étudier74.
Les maisons d’études communes sont conçues d’emblée comme de véritables prieurés dont le but est de recréer un espace et un cadre de vie monastique, en dépit du cadre urbain environnant et malgré les sorties nécessaires à l’assiduité aux cours. Du reste, la législation monastique s’eff orce principalement de préserver ces valeurs identitaires essentielles, en condamnant comme gyrovagues et transfuges les étudiants quittant l’enceinte et les limites de la domus et séjournant en ville sans permis-sion75. Bien que le trait soit clairement forcé par la comparaison implicite avec les ordres mendiants, ce n’est sans doute pas un hasard si Matthieu Paris, certes critique à l’égard du tournant universitaire monastique, mais toujours prêt à mettre en évidence la supériorité de l’ordo monasticus no-tamment face au nouvelles formes de vie religieuse, attribue le succès de la domus monachorum cisterciensium Parisius studentium à leur honesta et ordinata conversatio dont les expressions les plus remarquables sont pré-cisément la stabilité et l’obéissance76: «La maison des moines de l’ordre cistercien étudiant à Paris fut fondée par l’abbé de Clairvaux, Étienne de Lexington, un Anglais, en raison de la honte éprouvée à l’égard des frères prêcheurs et mineurs. Elle se mit à croître heureusement de jour en jour. Et leur vie honnête et ordonnée plut à Dieu, aux prélats et au peuple. En eff et, ils ne erraient pas dans les cités et les campagnes. Ils n’avaient pas l’océan pour matériaux de leurs cloîtres, mais enfermés entre leurs murs et vivant dans la stabilité, ils obéissaient à leur supérieur conformément à la règle de saint Benoît (...)».
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
Concrètement, l’édifi cation de ces maisons d’étudiants ou, plus fré-quemment, le réaménagement de maisons urbaines en vue d’y accueillir des moines-étudiants sont guidés par une logique de préservation des usages monastiques dans un milieu contraignant. Une récente enquête sur les ‘collèges’ monastiques parisiens souligne à juste titre le fort condi-tionnement exercé sur la construction ou l’aménagement des bâtiments par le parcellaire préexistant qui, sauf pour quelques très grands collèges, commande le schéma général de répartition des structures bâties et non bâties77. Il est pourtant probable que certains choix répondent à une re-cherche de compromis entre les contraintes du tissu urbain et les exigen-ces du ‘désert’. Ainsi, l’installation des Cisterciens en 1246 dans une zone inondable s’explique sans doute par la possibilité que leur off rait ce site de se constituer un enclos beaucoup plus vaste que ne le leur auraient per-mis les hauteurs de la Montagne-Sainte-Geneviève, certes protégées mais déjà densément occupées. Les aménagements de terrasses dans la partie septentrionale du terrain le plus exposé aux crues permirent au demeu-rant de reconstituer, au gré de vastes jardins, un avatar de désert urbain78. Cela dit, les maisons d’études pour les moines, tout comme d’ailleurs la plupart des implantations monastiques en ville, se distinguent surtout par leur caractère hybride, tout à la fois infl uencé par l’architecture locale des maisons civiles ou les spécifi cités locales du secteur du bâtiment, et conditionné par les exigences de la vie communes (réfectoires, dortoirs voire cellules admises dans certains cas à titre dérogatoire pour faciliter le travail intellectuel), de la clôture (soin apporté aux murs, portes et jardins), et enfi n de la prière monastique. Ce dernier impératif motive l’attention et le soin portés à la construction d’édifi ces de culte, en gé-néral isolés et non intégrés au reste des édifi ces. Ainsi, à peine installé à Paris, l’abbé de Cluny obtient d’Urbain IV l’autorisation de construire un oratoire dans la maison où les frères étudient (1262), autorisation complétée – après enquête – de l’octroi, en 1279, du droit d’avoir des cloches et un cimetière79. Plus rarement, on est en mesure de distinguer quelques éléments rattachant clairement tel ou tel édifi ce à son ordre d’appartenance: ainsi, dans son collège parisien, Cluny adopte et adapte, en la réduisant, une ‘galilée’ typiquement clunisienne servant de transi-tion entre l’espace sacré de l’église et la ville80. À Toulouse, l’installation
cécile caby
du studium cistercien de Grandselve en plein cœur de la paroisse Saint-Sernin rendit nécessaire la recherche d’un compromis pluriel. Il fallait non seulement régler les contentieux spatiaux ouverts par la construction d’une église secundum formam et modum sui ordinis et dont la longueur, en particulier, ne devait pas dépasser celle de l’église toulousaine des Mi-neurs. Mais il fallait aussi protéger les prérogatives juridictionnelles de la paroisse Saint-Sernin (prédication, lieu et droits de sépulture et oblations variées)81. Pourtant, comme le suggère la multiplicité des modèles de référence évoqués à propos de l’église du ‘collèges’ de Grandselve, il est souvent délicat de trancher quant à l’origine des paradigmes édilitaires qui circulent entre les diff érents ordres réguliers82.
Si, par leur site urbain et par leur disposition monumentale les mai-sons d’études monastiques sont donc fondamentalement hybrides et pour le moins atypiques au regard des autres implantations monastiques de leur réseau ou de leur ordre, elles le sont également par la réglementa-tion de leurs ouvertures – ou à l’inverse de leur clôture – et de leurs rap-ports à l’espace environnant. La nécessité de suivre une partie des ensei-gnements à l’extérieur, auprès des divers maîtres de l’université entraîne de fait les moines-étudiants à quitter leurs établissements, fût-ce sous le contrôle d’une réglementation sévère. Dès 1245, le chapitre général cis-tercien, qui encourage la fondation de studia dans toutes les provinces et avalise l’existence du studium parisien, fi xe d’emblée les horaires d’études (variables en fonction des saisons) qui coïncident avec les horaires où les moines peuvent sortir extra terminos ad studendum83. Au XIVe siècle, les deux principales codifi cations statutaires clunisiennes ayant trait au collège de Paris – celle de Henri de Fautières en 1309-1319 et celle de Simon de la Brosse en 1365 – rappellent l’interdiction de fréquenter la ville en dehors des heures d’études, en particulier d’y prendre ses repas sans une autorisation spéciale et une compagnie adéquate, et a fortiori de passer la nuit en ville. Ces mêmes statuts renouvèlent par ailleurs les admonitions concernant les usages de la résidence commune et les règles de fermeture du collège à certaines heures et à certaines catégories, no-tamment aux femmes84.
Indépendamment des va-et-vient en ville, le fait que les studia ur-bains regroupent des moines provenant de monastères divers implique
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
d’autres types de circulations, à plus longue distance et à l’échelle de l’ordre. Celles-ci sont rythmées par le calendrier des études qui, si l’on en croit les décisions statutaires ou capitulaires, suit en général les sai-sons et, bien entendu, les usages régionaux de chacune des universités. Ainsi Benoît XII prescrit en 1335 aux moines-étudiants de se présenter à Paris pour l’Exaltation de la Sainte-Croix (14 septembre) et dans les autres universités pour la fête de saint Luc (18 octobre)85. Ce calendrier suppose que la sélection des moines-étudiants ait déjà eu lieu pendant une période de vacance estivale, d’où la date proposée par le pape de l’Assomption. C’est un rythme comparable que suivent les Clunisiens de la maison de Paris au début du XIVe siècle86. À la même époque, les étudiants camaldules de Bologne sont renvoyés dans leurs monastères pendant l’été, sauf pour ceux qui passent les vacances à San Damiano ou à Santa Maria di Camaldoli dans les faubourgs de Bologne: à l’automne, avant la fête de saint Luc, jour de reprise des cours, on assiste au fl ux inverse de la rentrée des classes87.
Studium sub regulari observantia: quelques jalons entreexubérance statutaire et codifi cation pontifi cale
Comme nous venons de le souligner à propos des usages de l’espace urbain, les maisons d’études répondent, au moment de leur création, à la nécessité d’encadrer un fl ux d’étudiants réguliers jusqu’alors mal contrô-lés et qui risquaient d’échapper à la discipline de l’ordre, notamment dans des domaines mettant en cause la nature même de la vocation mo-nastique: l’obéissance, la stabilité, la chasteté ou l’alimentation. C’est la raison pour laquelle la question du recrutement des moines-étudiants (sur le plan de leur quantité et de leur qualité) est en général primor-diale dans la législation des diff érents ordres88. Deux critères principaux reviennent en priorité: les dispositions naturelles – âge et capacités intel-lectuelles – et la bonne volonté du candidat, auxquelles s’ajoutent parfois des qualités morales, essentielles pour espérer faire du candidat un bon étudiant mais aussi un bon moine. L’examen de ces critères est confi é aux supérieurs hiérarchiques traditionnels, à savoir l’abbé de l’abbaye de pro-venance et aux représentants de l’ordre, à savoir les visiteurs nommés par le chapitre général pour l’ordre cistercien, l’abbé général ou son repré-
cécile caby
sentant à Cluny. Il s’agit très logiquement de promouvoir les étudiants potentiellement les plus aptes ou les mieux préparés89. À l’inverse, il s’agit d’éviter par ce biais un certain nombre de dérives, notamment (comme le soulignent les statuts clunisiens de 1301) la reproduction, à l’intérieur de l’ordre, des réseaux familiaux ou clientélaires de faveur. La discipline du recrutement concerne également la quantité de moines que chaque maison doit ou peut envoyer étudier: le chapitre cistercien de 1289 parle d’un moine sur 30 en général et de deux moines, là où la communauté d’origine en compte plus de 4090. Benoît XII confi rme, en 1335, les codifi cations de 1316 prévoyant l’envoi d’un moine pour toute maison comprenant de 18 à 30 moines. Il rappelle enfi n les règles spécifi ques au recrutement du studium parisien, qui conserve, voire consacre de ce point de vue, son statut d’exception91. Les motivations relèvent de deux impératifs pratiques conjoints: la nécessité d’épargner les ordres mais aussi les communautés d’origine d’un point de vue à la fois fi nancier – en raison du coût des pensions versées annuellement aux étudiants92 – et démographique. De fait, comme certaines sources le laissent parfois poindre, il s’agit parfois d’éviter de décimer la population présente ou active (les étudiants bénéfi ciant de dispenses en matière d’obligations liturgiques et communautaires) dans la maison d’origine93.
Le contrôle collectif du fi nancement des études par l’instauration d’une caisse commune et de contributions généralisées94 constitue d’ailleurs un autre moyen de mettre fi n ou de limiter les initiatives indi-viduelles (nécessairement soumises aux contributions des familles ou de riches protecteurs), pour privilégier un règlement centralisé favorable à l’instauration d’une discipline commune. Outre les investissements pour l’achat ou la construction des locaux du studium puis le coût de leur entretien, qui justifi aient bien souvent des prélèvements exceptionnels, il fallait en eff et régler la répartition des frais quotidiens des étudiants com-prenant la nourriture, le vêtement et le matériel spécifi que, en particulier les livres, mais aussi les frais pédagogiques (maîtres, répétiteurs etc.). Or, la gestion centralisée de cet ensemble de dépenses contribuait à l’instau-ration d’un mode de vie uniformisé et compatible avec les exigences de la vie monastique95.
En eff et, les maisons d’études ont pour but essentiel de garantir la
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
discipline des étudiants. Si cette mission est évidemment commune à la plupart des collèges universitaires, elle revêt dans le cadre des ‘collèges’ monastiques une forte spécifi cité, liée au statut régulier des étudiants. La réglementation des studia, telle qu’elle est défi nie par les organes cen-traux des ordres dans le cadre de défi nitions capitulaires voire, à partir du XIVe siècle, de statuts spécifi ques, ou telle que l’impose la papauté à l’époque de Benoît XII, entend en eff et proposer aux moines-étudiants ayant temporairement quitté leur communauté d’origine toutes les ga-ranties d’une discipline régulière ordinaire. Il faut en eff et éviter que les études ne deviennent pour le jeune moine prétexte à s’éloigner de la discipline de son ordre, et pour les maisons d’études l’occasion de perdre tout aspect monastique. Chaque maison est d’ailleurs placée sous la tu-telle d’un supérieur investis des mêmes pouvoirs que l’abbé ou le prieur dans son monastère96.
Concrètement, défi nir la teneur de l’observance régulière des moines-étudiants requiert la mise en place d’un habile équilibre entre l’observan-ce de la règle commune et les inévitables dérogations liées aux occupa-tions exceptionnelles de ces moines très spéciaux. D’où les dispenses en matière d’obligations liturgiques, surtout quand ces dernières coïncident avec les heures des cours. Les eff ets de ces dispenses sur la prière com-munautaire ne sont pas négligeables si bien que, au XIVe siècle, elles sont parfois compensées par la présence dans les studia monastiques – qui se distinguent d’ailleurs très nettement en cela des autres types de collèges –, de moines à tous les eff ets (claustrales), responsables du bon fonc-tionnement de l’observance régulière de ces maisons97. D’où aussi les aménagements en matière d’horaires (en fonction des cours) et de lieux des repas, mais aussi d’observance alimentaire puisque les étudiants ob-tiennent souvent des dérogations à l’interdit de nourriture carnée. Sans parler de certains points plus spécifi ques encore, étroitement liés aux pratiques de la communauté universitaire et sur lesquels les législateurs monastiques reviennent fréquemment. Ainsi, la question de la collation des grades universitaires ouvrait une brèche dans la pratique des vertus monastiques (notamment l’humilité). Mais il fallait aussi compter avec certains aspects des rituels de la sociabilité estudiantine: les repas – inter-dits sinon avec des personnes de l’ordre ou très vénérables, par les statuts
cécile caby
clunisiens de 1309-1310 – ou les fêtes et banquets off erts à l’occasion de la collation des grades – interdits ou au moins limités à une forme raisonnable98. D’une manière générale, les statuts tendent à réaffi rmer en priorité tout ce sans quoi le moine-étudiant ne se comporterait plus, et surtout ne serait plus identifi able, comme un moine, à savoir tous les élé-ments de son apparence extérieure, et en premier lieu son vêtement99.
Conclusion
J’ai bien conscience de n’avoir fait qu’effl eurer la question des études universitaires des moines à travers ce parcours volontairement limité à quelques-uns des nombreux compromis mis en œuvre par les monas-tères, les ordres monastiques et la papauté pour défi nir concrètement la fonction et l’identité des moines qui entreprenaient des études hors de leurs monastères, dans les universités. Les points de vue que j’ai choisi de privilégier sont d’une part celui de la construction institutionnelle et de l’auto-représentation monastiques, sans doute parce que c’est celui qui est le plus immédiatement perceptible à travers la riche documentation normative produite à partir de la fi n du XIIe siècle; d’autre part celui de la stratégie ecclésiologique d’une papauté qui avait tenté dès le XIIIe siècle de conformer, par le biais des études universitaires, les membres de l’ordo monasticus – et notamment les plus éminents d’entre eux, les Cisterciens – aux exigences de l’utilitas communis et des urgences qu’elle avait défi nies, n’hésitant pas à l’occasion à remodeler l’expérience monas-tique à l’aune de celle des ordres mendiants.
En dépit des tensions et des confl its, voire au gré de ces confl its, les ordres monastiques manifestent somme toute une assez grande souplesse dans leur capacité à intégrer les maisons d’études, avec tout ce que cela impliquait d’ajustements des hiérarchies et des équilibres internes. Pa-rallèlement, la défi nition, lente et pragmatique, d’une catégorie à pre-mière vue aberrante et antinomique, celle du moine-étudiant, détermi-nait certes une forme risquée d’acculturation des usages monastiques aux pratiques estudiantines – fussent-elles normalisées en fonction du statut régulier des étudiants –, mais fournissait aussi aux ordres de multiples
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
occasions de réaffi rmer avec force les contours infrangibles du statut de moine. En eff et, comme cela a pu être souligné pour la poursuite d’autres formes de déviances monastiques100, le fait même de condamner et de punir un certain nombre de traits défi nis comme contraires à la vie mo-nastique constituait une manifestation du contrôle social exercé par les moines et un moyen pour les ordres de se renforcer en produisant, voire en imposant, leur norme.
Indépendamment des nécessaires approfondissements dans ces do-maines, de nombreuses facettes resteraient en outre à explorer. Ainsi, du côté de la production intellectuelle des étudiants arrivés à maturité, on ignore presque tout de la façon dont les études universitaires des moines conditionnaient ou infl uençaient leurs discours. Peut-on par exemple, au sein des œuvres des quelques 260 maîtres et étudiants recensés dans la maison de Saint-Bernard de Paris, distinguer des pratiques discursives, des méthodes spéculatives, des domaines d’investigations spécifi ques101? Voire, existe-t-il une scolastique monastique?
Une étude isolée sur un ensemble de discours universitaires pronon-cés dans la domus sancti Bernardi de Paris souligne la faible empreinte de l’identité cistercienne des orateurs sur une forme discursive profon-dément marquée par sa matrice universitaire. Tout au plus, à l’occasion de l’éloge des lecteurs, rappelle-t-on que le socius, vivant sous la règle monastique (sub monastice vite regule), a su accomplir en même temps les opera vite scolastice, que sunt attentio, lectio, meditatio et collatio, suivre les cours des maîtres, lire assidûment, mener une réfl exion personnelle sur les matières traitées et en disputer avec ses camarades: bref, une fois de plus, se comporter à la fois en universitaire et en moine102. Mais l’enquête reste largement ouverte.
cécile caby
1. L’expression est tirée de la lettre du pape Innocent IV à l’exécuteur de la bulle accor-dant le 28 janvier 1257 aux Cisterciens le privilège de prêcher librement en dépit de leur statut monastique, cf. infra note 46. Toute ma gratitude va à Isabelle Rosé pour sa relecture stimulante.
2. MGH SS, XXV, p. 208, § 28: Cum dominus Clarevallis fundaret domum Parisius pro studio ordinando, rogavit hunc patrem nostrum unam summam pecunie in subsidium. Domnus admirans hanc novitatem obstupuit. Sciebat namque, ordinem in magna simplicitate fundatum laudabiliter perseverasse usque ad tempus illud in sua humilitate et puritate et mi-rabiliter profecisse in spiritualibus et in temporalibus, nec hactenus consuetudinis fuisse, quod monachi, omisso exercitio claustrali, quod potissimum convenit voto professionis eorum, operam dare studio litterarum, iuxta illud beati Bernardi: “Non est opus monachi docere sed lucere”. Timens etiam, ne persone ordinis causa studii plus insolescerent et superbirent, quam antea fecerant, iuxta illud Pauli: “scientia infl at”, constanter dixit, se nil daturum. Quod verbum dominus Claravallis egre tulit. Utrum hic vir Dei verum senserit, et an tanta sit humilitas et religio in ordine, quanta fuerat ante ordinationem studiorum, iudicet generatio ventura. Sur la datation voir S. Roisin, L’hagiographie cistercienne dans le diocèse de Liège au XIIIe siècle, Louvain 1947, pp. 26-27.
3. Sur la référence d’Arnulf à l’adage de Jérôme et son arrière-plan ecclésiologique, cf. infra, note 47.
4. La suite de la Chronique de Villers raconte d’ailleurs comment, ayant renoncé à l’abbatiat par amour de la contemplation, Arnulf consacra une grande partie de son temps aux activités (d’ailleurs très variées) du scriptorium: Cum autem desiit abbatizare, adeptus est scriptorium, quod est in auditorio prioris; et cum ad omnes horas semper chorum intraret, ad laborem conventus, qui parvus erat, non exibat, sed in scriptorio continue laborabat aut legendo aut orando aut meditando aut scribendo aut confessiones audiendo, ita quod numquam ibidem obdormisse fertur (MGH SS, XXV, p. 208, § 30).
5. Sur ce point, voir les pages mesurées de M.G. Newman, Th e Boundaries of Charity. Cistercian Culture and Ecclesiastical Reform, 1098-1180, Stanford (California) 1996, pp. 37-41 qui souligne comment le refus des Cisterciens s’articule surtout à la conviction d’une incompatibilité entre les nouvelles pratiques scolaires, telles qu’elles se développent entre la fi n du XIe et le XIIe siècle, et l’identité monastique – cistercienne en particulier –, voire l’identité cléricale en général. Je renonce en revanche à citer l’abondante littérature, princi-palement cistercienne, réfutant dans une perspective qui est trop éloignée de la mienne le fait que les Cisterciens étaient ennemis de la culture.
6. Je me réfère à la visite du collège bénédictin de Saint-Benoît à Montpellier, 1369, Les statuts et privilèges des universités françaises: depuis leur fondation jusqu’à 1789, éd. M. Fournier, I-IV, Paris 1888-1894, II, pp. 123 et suivantes qui distingue systématiquement dans l’examen des résidents ce qui a trait ad studium de ce qui a trait ad claustrum.
7. Au sein d’une bibliographie immense, voir la synthèse de L.A. Bataillon, L’activité intel-lectuelle des Dominicains de la première génération, in Lector et Compilator. Vincent de Beauvais,
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
frère prêcheur: Un intellectuel et son milieu au XIIIe siècle, Grâne 1997, pp. 9-20; M.M. Mul-chahey, «First the Bow is Bent in study»: Dominican Education before 1350, Toronto 1998.
8. Sur les ordres mendiants, on partira des volumes Le scuole degli ordini mendicanti: (secoli XIII-XIV), Todi, 1978 et surtout Studio e studia: le scuole degli Ordini mendicanti tra XIII e XIV secolo, 2002 qui, à juste titre, ménage une place aux hésitations de certains ordres à l’égard de leur vocation universitaires, notamment les Franciscains ou les Carmes dont l’adéquation aux pratiques universitaires est partie intégrante du processus de transforma-tion de cet ordre aux origines érémitiques en un ordre mendiant à tous les eff ets.
9. Pour une première approche, U. Berlière, Les collèges bénédictins aux universités du Moyen Âge, in «Revue Bénédictine», 10 (1893), pp. 145-158; V. Cattana, Studi, I: Il mo-nachesimo, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, 9, Rome 199, coll. 444-456 avec une abondante bibliographie.
10. Matthaei Parisiensis, monachi Sancti Albani Chronica majora. éd. H. R. Luard, I-VII, Londres 1872-1883, V, pp. 79-80: cette allusion au prologue et au premier chapitre du deuxième livre des Dialogues de Grégoire le Grand conclue une tirade de l’auteur contre le tournant universitaire des Cisterciens qui auraient cherché selon lui à «ne plus être méprisés par les frères prêcheurs et mineurs, ni par les laïques lettrés principalement par les légistes et les décrétistes (...) et à ne plus «paraître inférieurs aux autres». Sur cette tirade voir aussi infra note 50.
11. Voir par exemple l’exemplum (F. Tubach, Index exemplorum, Helsinki 1969, nº 1103) de la conversion à l’ordre cistercien d’un maître séculier après la vision d’un élève défunt oppressé par une cappa ex pargameno minutis litteris conscripta symbole des sophismes et des curiositates auxquels il a consacré sa vie dans les écoles de logique: T.F. Crane, Th e Exempla or illustrative stories from the sermones vulgares of Jacques de Vitry, Londres 1890, pp. 12-13 (l’exemplum suivant met d’ailleurs en scène la prédication de Bernard aux écoles de logique pour y débaucher les écoliers); beaucoup de textes apparentés circulent dans les recueils dominicains, notamment dans celui d’Étienne de Bourbon, Tractatus de diversis materiis praedicabilibus, I, 23 [éd. J. Berlioz, Turnhout 2002, p. 400] selon lequel l’exemplum aurait été prêché par Pierre le Chantre à Paris et qu’il l’aurait entendu dans de nombreux sermons, témoignant ainsi de sa grande diff usion, cf. Th esaurus exemplorum Medii Aevi du Gahom, EHESS. Voir aussi, sur ce modèle, le récit de la conversion d’Étienne de Lexington, infra.
12. Sur ce type d’approche, cf. G. Melville, Unitas e diversitas. L’Europa medievale dei chiostri e degli ordini, in Europa in costruzione. La forza delle identità, la ricerca di unità (seco-li IX-XIII), dir. G. Cracco, J. Le Goff , H. Keller, G. Ortalli, Bologna 2007, pp. 357-384.
13. C’est le cas par exemple du moine de Saint-Pierre-sur-Dive, rappelé à l’ordre par Anselme abbé du Bec, parce qu’il avait quitté son monastère sans l’autorisation de son abbé et que propter scholas moratur apud Parisium et conversatur in monasterio S. Maglorii (PL 158, col. 1163-4). On soulignera d’une part que le motif de la condamnation est principa-lement la désobéissance et la rupture de la stabilité, et d’autre part le rôle du prieuré parisien comme hospice pour l’étudiant. Pour des exemples d’initiatives individuelles, d’ailleurs plus
cécile caby
ou moins bien reçues dans l’ordre cistercien, voir Ph. Dautrey, Croissance et adaptation chez les cisterciens au treizième siècle: les débuts du collège des Bernardins de Paris, in «Analecta sacri ordinis Cisterciensis», 32 (1976), p. 135.
14. Par commodité, et compte tenu de l’importance de Paris comme pôle d’attraction des moines-étudiants, on partira des textes relevés dans le Chartularium Universitatis Pari-siensis ex diversis bibliothecis tabulariisque collegit (...), éd. H. Denifl e et A. Chatelain, I-IV, Paris 1889-1897.
15. Cette expression est tirée de la défi nition du chapitre général de Cluny, instaurant une maison commune pour les étudiants parisiens (15 mai 1261): Quoniam multus favor est Cluniacensibus Scolaribus Parisius studentibus ex eorumdem studio adhibendus, et ibidem ordo Cluniacensis propriam domum non habeat studio deputatam (...) (Chartularium Universitatis Parisiensis, I, n. 370, pp. 418-419).
16. Voir R. Schneider, Studium und Zisterzienserorden, in Schulen und Studium im so-zialen Wandel des hohen und späten Mittelalters, dir. Johannes Fried, Sigmaringen 1986, pp. 321-350 qui renvoie à la bibliographie antérieure.
17. Dès les années 1220, l’abbé de Clairvaux avait reçu de Mathilde de Garlande une maison parisienne et le chapitre général de 1237 accède à sa demande de clericis habendis Parisius in cappis et tunicis albis pro se et pro omnibus abbatibus aliis qui ibi et eodem modo clericos habere voluerint, ajoutant l’octroi d’un moine et deux convers qui clericis necessa-ria provideant (J.-M. Canivez, Statuta Capitulorum generalium ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786, voll. 7, Louvain 1934-1941 [désormais Canivez], II, 1237, n. 9). La terminologie laisse penser qu’il ne s’agit pas à proprement parler de moines-étudiants. On trouve par ailleurs des mentions éparses de moines cisterciens étudiant à Paris, voir par ex. C. H. Lawrence, Stephen of Lexington and Cistercian University Studies in the Th irteenth Century, in «Journal of ecclesiastical History», 11 (1960), pp. 164-178, p. 176 qui cite des lettres de Jean de Limoges au demeurant assez hostile à leur égard.
18. Sur Étienne de Lexington, voir les indications de B. Griesser en introduction à l’édition de ses lettres: Registrum epistolarum Stephani de Lexinton, in «Analecta sacri ordi-nis Cisterciensis», 2 (1946), pp. 1-118, en part. 1-11 et Ibidem, 8, 1952, pp. 181-378) et Lawrence, Stephen of Lexington.
19. L’épisode est rapporté de façon très factuelle par l’annaliste Richard de Morins (Annales Monastici, III, éd. H. R. Luards, Londres 1864-1869, p. 67) mais il devient un épisode phare de l’hagiographie de saint Edmond et fut coulé, à ce titre, dans le motif de la conversion estudiantine à l’ordre cistercien cité plus haut note 11, cf. Vita S. Edmundi, XVII, in Martène et Durand, Th esaurus Novus Anecdotorum. III, Paris 1717, col. 1789 (l’auteur est Bertrand prieur de Pontigny) et Lawrence, Stephen of Lexington, p. 167. Com-me dans l’ordre dominicain et d’ailleurs dans les mêmes années, ce sont les convertis tardifs qui introduisent les études universitaires au nombre des pratiques cisterciennes.
20. Dans une lettre adressée à l’abbé de Clairvaux sur l’état des monastères cisterciens
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
d’Irlande (lettre 37, éd. Griesser, in «Analecta sacri ordinis Cisterciensis», 2 1946, pp. 45-48), il déplore l’état d’ignorance qui règne en Irlande et notamment la confusion linguis-tique qui l’encourage à interdire que désormais on admette comme moine quiconque ne serait pas en mesure de culpam suam confi teri noverit gallice vel latine (p. 47), de sorte que l’ordre ne devienne pas une tour de Babel ingouvernable (Nec aliud nisi turris Babel construi poterit, ubi nec discipulus magitrum intelligit nec e contra nec congrue dinoscitur, ut dum unus petit panem, alius pro pane porrigat lapidem seu pro pisce tribuat scorpionem). C’est aussi la raison pour laquelle il encourage l’envoi de moines-étudiants à Paris et Oxford: Quapropter Hiberniensibus iniunximus, quod si quem de suis in ordine de cetero recepi desiderent, Parisius vel Oxonium uel ad alias civitates famosas mittere studeant, ubi litteras et loquele peritiam addiscant morumque compositionem, manifestiusque ipsis, quod nullam intendit ordo excludere nationem, sed solummodo ineptos et inutiles et moribus humanis dissidentes (p. 46). La conclu-sion souligne que l’enjeu de la question aux yeux d’Étienne n’est autre que la restauration d’un ordre vieillissant qui menace de s’écrouler: Quapropter ad uos respicit in capite, pater venerande, tales de cetero procurare, ut prefi ciantur, qui se columpnas exhibeant parieti ordinis inclinato et macerie iam fere depulse et virorum tam vita quam litteris digne commendabilium, sicut in tempore beati Bernardi, si non copiam saltim pro magna parte attrahant, qui iam sene-senti et uacillanti ordini nostro manuum prebeant in tempore oportuno (p. 48).
21. Ed. Griesser, in «Analecta sacri ordinis Cisterciensis», 2 (1946), pp. 116-118. Voir Lawrence, Stephen of Lexington, p. 173 qui repousse la date à après 1235 sur la base de la mention d’un predicator quidam, cuius nomen subticemus ad presens, auctoritate sedis aposto-lice indagator hereticorum consignatus, in ciuitate Aurelianensi nuper sollempniter predicauit, Robert le Bougre qui commence son activité de légat en France du Nord en 1235. Dans cette lettre comme dans celle à l’abbé de Clairvaux cité à la note précédente, Étienne agite la menace du vieillissement (ipse ordo qui iam uilescit) et de la destruction totale de l’ordre (ruina) sous les coups du danger de l’ignorance (periculo de defectu litterature). Je me réserve de revenir ailleurs sur cette lettre et notamment sur l’usage qu’elle fait de l’accusation d’hé-résie compte tenu de l’importance de ce thème pour l’ordre en général et pour ses liens avec le monde universitaire, comme l’atteste le cas très particulier de Toulouse: à ce propos, voir D. Baker, Heresy and Learning in early Cistercianism, in Schism, Religion and religious Protest, Londres 1972, pp. 93-108.
22. Sur ce cardinal, dont l’historiographie cistercienne a parfois tenté de dissimuler l’appartenance à l’ordre en raison de son appui très actif à la mise en place des études uni-versitaires, voir L. Paravicini Bagliani, Cardinali di Curia e ‘familiae’ cardinalizie dal 1227 al 1254, Padova 1972 (Italia Sacra 18-19), pp. 228-255. Les relations entre Étienne et la curie se développèrent dès son abbatiat à Savigny comme le soulignent les nombreuses missions de réforme monastique que lui confi e alors le pape Grégoire IX; sa correspon-dance met d’ailleurs en évidence sa connaissance très fi ne des jeux curiaux, voir en part. la lettre à l’abbé de Clairvaux le mettant en garde contre les émissaires des rebelles cisterciens d’Irlande à la curie qui risquent de contrecarrer ceux que l’abbé de Clairvaux et le chapitre général ont prévu d’envoyer: lettre 110, éd. Griesser, «Analecta sacri ordinis Cisterciensis», 2 (1946), p. 111-113.
cécile caby
23. Sur cette maison, voir P.E. Kwanten, Le collège Saint-Bernard à Paris, sa fondation et ses débuts, in «Revue d’histoire ecclésiastique», 43 (1948), pp. 443-472 et surtout Ph. Dautrey, Croissance et adaptation chez les cisterciens au treizième siècle: les débuts du collège des Bernardins de Paris, in «Analecta sacri ordinis Cisterciensis», 32 (1976), pp. 112-215 dont l’intérêt va bien au-delà de l’histoire de la construction des bâtiments du studium.
24. Chartularium Universitatis Parisiensis, I, n. 133, pp. 175-176 et 146, pp. 183-184. Le parallèle entre les deux lettres pontifi cales ne laisse guère subsister de doutes sur le che-min parcouru de l’une à l’autre, tout d’abord dans l’organisation d’un groupe d’étudiants (Ut igitur quod tam sancto et provido est inchoatum principio fi nis laudabilis exitum sortiatur), mais aussi en faveur d’une justifi cation ecclésiologique de la mission des moines-étudiants. En quelques mois, peut-être à l’issue de débats dans l’ordre, le choix des villes pouvant accueillir des étudiants s’est restreint à Paris seule (Parisius vel alibi ubi melius expedire vide-bitur/ hujusmodi studium quod alibi quam in civitate prefata fi eri prohibemus).
25. Chartularium Universitatis Parisiensis I, n. 148, pp. 184-185: le chapitre général invite tout abbé le souhaitant à fonder un studium de théologie et en préconise un par province; il fi xe l’emploi du temps des étudiants notamment les temps de sorties ad stu-dendum, ce qui laisse supposer que les studia se trouvent dans des centres scolaires et que les maisons d’étudiants n’assuraient que le gîte et le couvert; il soutient enfi n le studium per sollicitudinem abbatis Clarevallis Parisius jam inceptum, en réalité la seule structure existante et ce pour plusieurs décennies.
26. Voir C. Obert-Piketty, Benoît XII et les collèges cisterciens du Languedoc, in Les Cister-ciens de Languedoc (XIIIe-XIV e s.), Toulouse 1986 (Cahiers de Fanjeaux, 21), pp. 139-150; P. Gérard, Les origines du collège Saint-Bernard de Toulouse (vers 1150-1335), in «Annales du Midi», 69 (1957), pp. 189-205; L. J. Lekai, Le Collège Saint-Bernard de Toulouse au Moyen Âge (1280-1533), in «Annales du Midi», 85 (1973), pp. 251-266.
27. D. Nebbiai della Guarda, Le collège de Paris de l’abbaye de Saint-Denis-en-France (XIIIe-XVIe siècle), in Sous la règle de saint Benoît. Structures monastiques et sociétés en France du Moyen Âge à l’époque moderne, Paris 1982, pp. 461-488.
28. Berlière, Les collèges bénédictins, pp. 149-150; H. Denifl e, Das erste Studenhaus der Benedictiner an der Universität Paris, in «Archiv für Litteratur und Kirchen Geschichte», 1 (1902), pp. 570-583.
29. Cf. Berlière, Les collèges bénédictins, pp. 150-153; J. Leclercq, Les études universitai-res dans l’ordre de Cluny, in Mélanges bénédictins: publiés à l’occasion du XIV e centenaire de la mort de Saint Benoît, par les moines de l’Abbaye de Saint-Jérôme de Rome, Abbaye de Saint-Wandrille 1947, pp. 348-371; Th . Sullivan, Th e College de Cluny: Statutes of Abbot Simon de la Brosse (1365), in «Revue Bénédictine», 98 (1988), pp. 169-177.
30. Chartularium Universitatis Parisiensis, I, Paris, 1889, n. 361, pp. 410-411.
31. Chartularium Universitatis Parisiensis, n. 370, pp. 418-419 et nº 375, pp. 421-422 (le privilège est élargi par Nicolas III en 1279 à la récitation à voix haute des offi ces et à la jouissance d’un cimetière propre).
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
32. On trouvera d’autres exemples dans Berlière, Les collèges bénédictins qui ne cite toutefois que des cas français et anglais. Dans l’état actuel de mes recherches, il m’est dif-fi cile d’affi rmer si l’absence de ce type d’organisations dans la péninsule italienne est une spécifi cité (éventuellement liée à la centralité du droit à Bologne) ou un eff et de sources. Relevons à ce propos que la constitution réformatrice de Benoît XII, Fulgens sicut Stella (1335) souligne cette absence et encourage la création d’un studium cistercien à Bologne: l’injonction resta néanmoins lettre morte et les étudiants cisterciens italiens continuèrent après cette date à étudier en ordre dispersé ou à fréquenter les studia cisterciens à l’étranger, principalement celui de Paris (cf. C. Obert, La promotion des études chez les cisterciens à tra-vers le recrutement des étudiants du collège Saint-Bernard de Paris au Moyen Âge, in «Cîteaux», 39(1988), pp. 65-78).
33. Chartularium Universitatis Parisiensis, I, n. 151, p. 229; en 1281, le chapitre général ajoute la possibilité d’instaurer l’enseignement d’une autre discipline dans toute abbaye déjà dotée d’un studium de théologie et comptant plus de 80 moines (Canivez, I Statuta; III, p. 287, ann. 1281, n. 9; cit. in J.-B. Mahn, Le pape Benoît XII et les Cisterciens, Paris 1949, p. 52); comme le souligne le mémorandum adressé par les abbés cisterciens au pape Benoît XII, sans doute dans le cadre d’une consultation en vue de la préparation de la bulle Fulgens sicut stella, on estime au XIVe siècle que toute abbaye de plus de 13 moines, abbé compris, doit avoir un lecteur en théologie, et que toute abbaye de plus de 40 moines dotée d’un studium theologie doit avoir aussi un studium philosophie (Ibidem, pp. 116-117). Voir aussi infra note 89.
34. L’un des exemples les plus fameux est celui de Vincent de Beauvais, lecteur à l’ab-baye de Royaumont, cf. S. Lusignan, Vincent de Beauvais, Dominicain et lecteur à Royau-mont, in Lector et compilator. Vincent de Beauvais, frère prêcheur. Un intellectuel et son milieu au XIII e siècle, sons la direction de S. Lusignan e M. Paumier Foucart, Grâne 1997, pp. 287-302. J.-G. Bougerol (Les manuscrits franciscains de la bibliothèque de Troyes, Grottafer-rata 1982, pp. 7-8) fait l’hypothèse que les premiers maîtres du studium parisien aient été franciscains. Plus tard, l’ordre cherchera à faire cesser cette pratique et, dans le 19e article de leur mémoire sur la réforme de l’ordre adressé à Benoît XII, les abbés cisterciens rappel-lent l’interdiction du Libellus antiquarum defi nitionum (1293-1316) de recruter des frères mendiants comme lecteurs compte tenu de ce que ordo cisterciensis habundat satis in ipsius ordinis lectoribus... (Mahn, Le pape Benoît XII et les Cisterciens, p. 134).
35. Sur cet usage, introduit dans les compilations dès 1202, voir B. Lucet, Les codifi -cations cisterciennes de 1237 et 1257, Paris 1977, p. 76. Le nom de Saint-Bernard semble s’imposer très tôt puisque dès l’été 1246 il apparaît dans une lettre de protection pontifi cale adressée aux moines de loco qui dicitur Beati Bernardi Parisiensis Cisterciensis ordinis (Chartu-larium Universitatis Parisiensis I, n. 157, p. 232); il se maintiendra par delà le transfert près de la Seine, au lieu-dit le Chardonnet, à partir de 1247 (cf. Ibidem., I, n. 166-167, p. 195-198; n. 177, p. 208 Parisius in loco Sancti Bernardi in Cardoneto et n. 192, pp. 219-220 à propos du transfert des privilèges d’un lieu à l’autre, 1250). Cette titulature revendique de façon très stratégique le patronage du saint abbé de Clairvaux, derrière l’autorité duquel Étienne
cécile caby
de Lexington (par delà l’appartenance du studium à la blanche claravallienne) se réfugie très régulièrement – et non sans un apparent paradoxe – y compris pour justifi er sa politique universitaire: voir par exemple, quelques années plus tôt, la lettre à l’abbé de Clairvaux sur la politique irlandaise (éd. Grisser, in «Analecta sacris ordinis Cisterciensis», 2 (1946), p. 48).
36. Chartularium Universitatis Parisiensis, I, nº 183 p. 213.
37. Chartularium Universitatis Parisiensis, n 148, pp. 184-185. En 1289, le chapitre général instaure un système de répartition des zones d’infl uence des diff érents studia qui mêle une fois de plus diff érents critères de divisions de l’espace (Chartularium Universitatis Parisiensis, II, nº564, p. 38-39).
38. Chartularium Universitatis Parisiensis, I, nº 183, p. 213. Cette solution, qui faisait des moines du studium des moines-hôtes, fut d’ailleurs explicitement adoptée pour le col-lège de Valmagne en 1252 et 1279 (Ibidem, n. 491, p. 576). Cette spécifi cité est enregistrée par la compilation juridique cistercienne de 1257 sur la base de la décision du chapitre général de 1248: Lucet, Les codifi cations cisterciennes de 1237 et 1257, pp. 105-106 et 256 qui enchaîne ensuite - de façon d’ailleurs un peu incohérente au regard de l’organisation de la codifi cation - sur divers aspects ayant trait au collège: la préséance du proviseur, la réception des novices, la confi rmation de la fondation du collège et les modalités de l’envoi des étudiants (cf. aussi noteº43).
39. Chartularium Universitatis Parisiensis, I, nº193, p. 220: provisor studii Parisius in omnibus abbatiis ordinis, ad quas venerit, stet in choro abbatis immediate ubique post abba-tes, nisi fuerit ibi aliqua reverenda persona, que prius abbatizaverit, cui concessuin fuerit esse ubique post albatem.
40. Canivez Statuta, II, ann. 1251, p. 360: De tribus monachis studentibus Parisius non compellendis ad abbatizandum, si eligantur, cum spes sit de eis quod possint profi cere ad legendum ordinarie Parisius; Schneider, Studium und Zisterzienserorden, p. 333. Sur cette question encore très débattue au XIVe siècle, voir Mahn, Le pape Benoît XII et les Cisterciens, pp. 63-64.
41. Chartularium Universitatis Parisiensis I, n. 161, p. 234 (le privilège est octroyé dum-modo dilectis fi lliis... abbati Cistercii et capitulo generali non displiceat) et n. 227-228, p. 252.
42. Chartularium Universitatis Parisiensis, I, n. 274, p. 314: Alexandre IV dispose d’un bénéfi ce concédé à Jean de Lexington en faveur des étudiants cisterciens de Paris.
43. Il est d’ailleurs remarquable, comme le souligne à juste titre B. Lucet (Les codifi ca-tions cisterciennes de 1237 et 1257, p. 106, note 5), que les décisions concernant le collège Saint-Bernard de Paris aient été insérées dans la codifi cation de 1257 dans la distinction sur les Privilèges. C’est dans cette même distinction que fi gure le chapitre De pena impe-trantium contra ordinis instituta (Ibidem, p. 257) qui sera utilisé par le chapitre général pour justifi er la déposition d’Étienne de Lexington en 1256.
44. L’équilibre entre Cîteaux et les quatre abbés pères, au premier rang desquels celui de
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
Clairvaux auquel l’héritage de Bernard et la taille de la fi liation confèrent un prestige inéga-lable, est dans la première moitié du XIIIe siècle une source récurrente de graves confl its ins-titutionnels dans l’ordre cistercien. Étienne de Lexington les connaissait bien puisque, alors abbé de Savigny, il avait été arbitre de l’un de ces confl its en 1238 (cf. Griesser, in «Analecta sacri ordinis Cisterciensis», 8 (1952), pp. 308-316). Sur ces confl its dans le premier tiers du XIIIe siècle et le danger qu’ils font courir à l’ordre, voir G. Cariboni, Il papato di fronte alla crisi istituzionale dell’Ordensverfassung cistercense nei primi decenni del XIII secolo, in Papato e monachesimo “esente” nei secoli centrali del Medioevo, a c. di N. D’Acunto, Florence 2003 (Reti Medievali. E-book, Reading, 2), pp. 179-214 et Idem, “Huiusmodi verba gladium portant”. Raniero da Ponza e l’Ordine cistercense, in «Florensia», 11, 1997, pp. 115-134.
45. Chartularium Universitatis Parisiensis, II, n. 564, p. 38-39: l’expression du chapitre général est fons omnium studiorum qui sera reprise en 1335 par Benoît XII dans la bulle Fulgens sicut stella (Ibidem, p. 448).
46. Chartularium Universitatis Parisiensis, II, n. 794, p. 241; cf. Obert-Piketty, Benoît XII, p. 148; ce n’est pas un hasard si le chapitre général suivant prit des mesures communes aux trois collèges de Paris, Toulouse et Montpellier pour les organiser en un authentique réseau de studia generalia à l’échelle de l’ordre: Canivez, Statuta, III, p. 360; cf. Lekai, Le collège Saint-Bernard de Toulouse, pp. 255-256.
47. Cette question ne concerne pas tant la possibilité de poursuivre des études externes que la possibilité pour les moines ayant obtenu les grades nécessaires d’enseigner et de de-venir maître. Rappelons que, selon la chronique de Villers, l’abbé Arnulf aurait opposé aux projets d’Étienne de Lexington l’adage de Jérôme transmis par Bernard – le moine n’est pas fait pour prêcher mais pour pleurer. Or, cette référence fait écho à un débat ancien sur la fonction sociale des moines, en particulier sur la légitimité d’un modèle monastique asso-ciant contemplation et fonctions pastorales en vertu duquel le moine pourrait prêcher et par conséquent recevoir des dons, notamment ceux liés au service de l’autel. L’allusion de l’abbé de Villers est donc loin d’être fortuite et c’est d’ailleurs sur la base de la contestation d’un tel modèle de moine-prêtre exerçant la cura animarum qu’Hostiensis dans la Summa aurea (mi XIIIe s.) en vient à nier aux moines la possibilité de devenir maître (Sed numquid religiosus et maxime monachus potest et debet in magistrum assumi?). L’argument de départ est le même que celui que les moines virent opposer à leurs prétentions dans le domaine pastoral, à savoir qu’on ne peut cumuler un offi ce ecclésiastique et un offi ce monastique. Si un bon moine ne peut faire un bon clerc, il ne peut donc faire un bon maître. Et si, un peu plus loin, Hostiensis développe plus longuement l’opinion contraire (Summa, V, de magistris, c. 3), soulignant d’ailleurs les évolutions des opinions à ce sujet, il la justifi e pour des motifs d’utilité collec-tive quand le moine sollicité pour enseigner est plus compétent qu’un clerc séculier.
48. Chartularium Universitatis Parisiensis, I, nº227-228, p. 251.
49. Griesser, in «Analecta sacri ordinis Cisterciensis», 2 (1946), p. 117.
50. Matthaei Parisiensis, monachi Sancti Albani Chronica majora, V, pp. 79-80.
51. Fr. Ioannis Pecham, o.f.m., Quodlibeta quatuor. Quodlibeta I-III, éd. G. J. Etzkorn;
cécile caby
Quodlibet IV (Romanum), éd. F. Delorme, G. J. Etzkorn, Grottaferrata 1989, pp. 123-128 (correspondant aux questions 27-31 du Quodlibet II). Je remercie Emmanuel Bain d’avoir attiré mon attention sur ce texte.
52. Il s’agit des quaestiones 28 et 29 du Quodlibet II; éd. in Fr. Ioannis Pecham, o.f.m., Quodlibeta quatuor, pp. 124-128. Sur la question du vœu, cf. A. Boureau, Le vœu monasti-que et l’émergence de la notion de puissance absolue du pape (vers 1270), in «Cahiers du centre de recherches historiques», 21 (octobre 1998), pp. 23-34 et id., Th éologie, science et censure au XIIIe siècle: le cas de Jean Peckham, Paris 2008, pp. 143-160.
53. C. 16, q. I, c. 8 (éd. Friedberg, I, 763). Sur cet adage et son usage, cf. C. Caby, «Comme un poisson dans l’eau... Propositum vitae et lieux de vie monastiques XIe-XIIe siè-cle», à paraître dans M. Lauwers, dir., Monachisme et espace social. Topographie, circulation et hiérarchie dans les ensembles monastiques de l’Occident médiéval, Turnhout 2010.
54. Fr. Ioannis Pecham, o.f.m., Quodlibeta quatuor, p. 126, l. 45-47: stabilitas loci intelli-genda est secundum «consuetudinum communemque institutionem» uti dicit Bernardus in epis-tola Ad Adam monachum. La lettre en question est la lettre 7 au moine Adam, cf. Bernard de Clairvaux, Lettres, trad. de H. Rochais, t. I (lettres 1-41), Paris 1997, p. 149 et suivantes.
55. Cette conclusion, qui ne considère comme contraire à la profession que ce qui va clairement à l’encontre du commandement de la règle, est cohérente avec la position de retrait que John Pecham est contraint d’adopter en matière de vœu à la fi n des années 1260, pour faire front commun avec les frères prêcheurs contre les séculiers, au nom d’une commune défense de la notion de statut de perfection, cf. Boureau, Th éologie, science et censure, pp. 157-160.
56. Sur ce type de confl its et leur interprétation, voir notamment les travaux de J.-B. Mahn, L’Ordre cistercien et son gouvernement des origines au milieu du XIII e siècle (1098-1265), Paris 1951 (réimpr. 1982), pp. 229-238; M. Maccarrone, Primato romano e mo-nasteri dal principio del sec. XII ad Innocenzo III, in Romana Ecclesia Cathedra Petri, Rome, 1991 et Idem, Studi su Innocenzo III, Padoue 1972, pp. 223-337, II Padova, pp. 821-927; et G. Cariboni, Il papato, cit. supra note 44, pp. 196-197 et 200-213.
57. Chartularium Universitatis Parisiensis, I, n. 220-221, pp. 244-246.
58. Chartularium Universitatis Parisiensis, I, n. 229, p. 252.
59. Chartularium Universitatis Parisiensis, I, n. 265-266, pp. 302-303: l’examen préala-ble avait eu lieu à Rome sous couvert de deux cardinaux, l’irremplaçable Jean de Tolède et le dominicain Hugues de Saint-Cher. La promotion de Guy avait en fait commencé deux ans plus tôt (cf. note précédente), mais avait vraisemblablement été retardée par l’urgence des confl its opposants maîtres séculiers et Mendiants, à moins qu’elle n’ait été repoussée pour des motifs internes à l’ordre cistercien. Cf. Lawrence, Stephen of Lexington, pp. 176-177 et C. Obert, Les lectures et les œuvres des pensionnaires du collège Saint-Bernard: jalons pour l’histoire intellectuelle de l’ordre de Cîteaux à la fi n du Moyen Âge, in «Cîteaux», 40 (1989), pp. 245-291, en part. 271 qui renvoie à la bibliographie à cette date. Sur Guy, voir aussi infra note 101.
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
60. C’est le cas dans l’ouvrage fréquemment répété de D’Arbois de Jubainville, Étude sur l’état intérieur des abbayes cisterciennes aux XIIe et XIIIe siècles, Troyes-Paris, 1858, ainsi que dans l’article de Kwanten, Le collège Saint-Bernard à Paris, qui en vient à nier la dépo-sition d’Étienne et même l’opposition interne à son projet!
61. Matthaei Parisiensis, monachi Sancti Albani Chronica majora, V, 596.
62. Matthaei Parisiensis, monachi Sancti Albani Chronica majora, V, 651-652.
63. Il s’agit de deux lettres – dont une très longue éditée intégralement – enregistrées dans le registre du pape (Les registres d’Alexandre IV, II, éd. J. de Loye et P. de Cenival, Paris-Rome 1917, n. 1791-1792, pp. 551-553) et de sept lettres enregistrées dans le formulaire de Marino da Eboli (F. Schillmann, Die Formularsammlung des Marinus von Eboli, Rome 1929, n. 441-447, pp. 129-130). Voir Lawrence, Stephen of Lexington, pp. 164-178 (on regrettera au passage que l’usage anglo-saxon de ne pas citer les sources dans leur langue originale prive le lecteur de la possibilité de toute enquête sur les artifi ces du discours et sur le lexique mis en œuvre dans le règlement de cette aff aire).
64. M.P. Alberzoni, Dal cenobio all’episcopio: vescovi cisterciensi nell’Italia nord occiden-tale all’inizio del XIII secolo, désormais in Città, vescovi e papato nella Lombardia dei comuni, Novara 2001, chap. 3.
65. Sur ce point Maccarrone, Primato romano e monasteri, pp. 860-862. En l’occur-rence, et comme déjà dans les premières années du XIIIe siècle (cf. Cariboni, Il papato, pp. 196 et 203), l’ordre oppose à un précepte pontifi cal (celui de réintégrer Étienne ou même un hypothétique privilège obtenu avant la réunion du chapitre et garantissant de façon préventive à Étienne son abbatiat) un privilège de l’Église romaine qui dispensait de fait l’ordre de suivre dans le domaine disciplinaire toute forme de décision – y compris du siège apostolique – entrant en contradiction avec la norme institutionnelle de l’ordre fi xée par le chapitre 21 de la quatrième distinction du Liber defi nitionum de 1202, De privilegiis que fi unt contra formam ordinis et de pena transgresorum (B. Lucet, La codifi cation cistercienne de 1202 et son évolution ultérieure, Rome 1964, p. 57).
66. Eugène III avait réservé la déposition ou la suspension d’un abbé au chapitre géné-ral, conformément aux statuts de l’ordre (cité par Cariboni, Il papato, p. 206).
67. Cette question est réglée par le chapitre général de 1197 De querelis ordinis termi-nandis intra ordinem et de pena gravissima transgressorum (Lucet, La codifi cation cistercienne de 1202, p. 57, Dist. IV, 23); cf. Cariboni, Il papato, pp. 206-207 et Idem, «Non ut liceret, sed an liceret». Correzione e esercizio dell’appello alla Chiesa romana presso gli ordini religiosi nel XII secolo, in Oboedientia. Zu Formen und Grenzen von Macht und Unterordnung im mittelalterlichen Religiosentum, éd. S. Barret et G. Melville, Münster 2005, pp. 305-334.
68. Et de fait, comme le souligne maître Th omas de Louth, exécuteur du mandat pon-tifi cal super revocatione sententie depositionis contra fratrem Stephanum abbatem Clarevallis inconsulte late, l’abbé de Cîteaux bien qu’ayant reçu copie du mandat apostolique négligea de le mettre à exécution, à la grande surprise des émissaires du pape; bien plus, revenant
cécile caby
à la charge, les émissaires pontifi caux trouvèrent close la porte de la maison parisienne où résidaient l’abbé et plusieurs moines de son entourage. S’ensuivit un bras de fer qui dura plusieurs jours et qui atteste le refus de l’abbé de Cîteaux à voir le pape intervenir dans une aff aire interne à l’ordre (Les registres d’Alexandre IV, II, éd. J. de Loye et P. de Cenival, Paris-Rome 1917, n. 1791, pp. 551-553). Étienne de Lexington n’ignorait évidemment ni cette règle, ni la diff érence entre un précepte et un conseil pontifi cal, lorsqu’il suggérait vers 1235 à l’abbé de Pontigny, d’écrire à ses amis à la curie quatinus suggerent domino pape, non de prescribenda certa forma studendi, sed ut dominus papa effi caciter det in mandatis abbati Cis-terciensi et IIIIor primis, ut (...) conveniant in aliquo loco competenti prope Parisius et deliberent apud se, sum uigent in ordine ipsius ordinis zelatores et uiri litterati, qualiter huic periculo de defectu litterature, in quo timetur ipsi ordini futuris temporibus, possint prouideri (Griesser, «Analecta sacri ordinis Cisterciensis», 2 (1946), p. 118; c’est moi qui souligne).
69. De ce point de vue, on rappellera la défi nition du chapitre général du 15 septembre 1245 (Chartularium Universitatis Parisiensis, I, n. 148, p. 184) autorisant la fondation de studia en raison du mandatum du pape (de fait envoyé le 4 septembre précédent: Ibidem, n. 146, p. 183) et des petitionem et admonitionem de plusieurs cardinaux notamment Jean de Tolède.
70. Matthaei Parisiensis, monachi Sancti Albani Chronica majora, V, 596. De la même façon, en 1233, au plus fort d’une crise institutionnelle opposant les diff érents abbés pères, devant l’intervention musclée d’Honorius III menaçant l’existence même de l’ordre, toute rivalité interne se tut aussitôt (Cariboni, Il papato, p. 213)
71. Je pense notamment à l’infl ation des décisions statutaires des ordres qui nécessiterait un dépouillement exhaustif, que je n’ai pas fait mais qui peut être partiellement compensé par l’identifi cation de sessions capitulaires particulièrement actives sur le sujet (ainsi, le cha-pitre cistercien de 1333 est particulièrement riche sur la question des études universitaires, cf. Kwanten, Le collège Saint-Bernard, pp. 460-462), par l’existence de codifi cations (par ex. le Libellus antiquarum defi nitionum et le Libellus novellarum defi nitionum, 1350, qui consacrent respectivement le chapitre 4 du deuxième et le chapitre 7 de la neuvième dis-tinction aux études; éd. in J. Paris, Nomasticon Cisterciense seu antiquiores ordinis cisterciensis constitutiones, Paris 1664, pp. 547-549 et 644-649), mais aussi à l’apparition de statuts spécifi ques pour les maisons d’étudiants au cours du XIVe siècle (pour Cluny, voir par ex. les remarques de Sullivan, Th e College de Cluny, pp. 169-177; pour les Cisterciens, Mahn, Le pape Benoît XII et les Cisterciens, pp. 55-56); à la même époque, on conserve d’ailleurs aussi quelques éléments de documentation comptable: voir par ex. Registre de comptes pour le collège papal Saints-Benoît-et-Germain à Montpellier: 1368-1370, éd., introd. et notes par l’abbé M. Chaillan, Paris 1916 et l’exemple du registre de comptes camaldules que j’ai pu exploiter et croiser avec la documentation normative dans C. Caby, De l’érémitisme rural au monachisme urbain. Les Camaldules en Italie à la fi n du Moyen Âge, Roma 1999, pp. 267-281. Les bulles de Benoît XII pour l’ordre bénédictin (Summa Magistri dite Benedictina, éd. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio..., III/2, Roma 1741, pp. 214-240 et pour les études Chartularium Universitatis Parisiensis, II, nº 1002, pp. 463-465) et
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
pour l’ordre cistercien (Fulgens sicut stella, éd. Canivez, III, pp. 410-436 et pour les articles 42 à 55 relatifs aux études, Chartularium Universitatis Parisiensis, II, n. 992, pp. 448-450) viennent souvent faire la synthèse des décisions antérieures dans ces mêmes ordres à moins qu’elles n’en anticipent certaines autres prises à son instigation, d’où l’intérêt d’y avoir re-cours: voir leur analyse sommaire dans Berlière, Les collèges bénédictins, pp. 147-148; Mahn, Le pape Benoît XII, pp. 56-59 et Obert-Piketty, Benoît XII et les collèges cisterciens.
72. Sur le lien étroit entre ces diff érents éléments du vœu du moine, voir les questions quodlibétiques de John Pecham citées supra.
73. Sur ces problématiques, voir Dautrey, Croissance et adaptation chez les cisterciens, en part. pp. 126-127 et 135-136; A. Grélois, La présence cistercienne dans les villes du Midi: un investissement limité?, in Moines et religieux dans la ville (XIIe-XV e siècle), Toulouse 2009, pp. 167-188. Les Cisterciens possédaient des maisons urbaines, mais selon les statuts de l’ordre, elles ne devaient pas accueillir de moines: au détour de la crise opposant le pape et l’ordre cistercien au printemps 1257, on apprend que l’abbé de Cîteaux disposait d’une maison parisienne située non loin de Notre-Dame où il séjournait avec un petit groupe de familiers (Les registres d’Alexandre IV, II, n. 1791, p. 551-553). Il n’est pas sans intérêt de souligner dans ce cadre la façon dont, dans la lettre souvent citée, à l’abbé de Pontigny, Étienne de Lexington renverse l’argument de la solitude et du silence en en faisant un venin mortel à cause duquel, d’ici peu, l’ordre ne serait plus en mesure de tirer le glaive contre l’hérésie! Cf. Griesser, in «Analecta sacri ordinis Cisterciensis», 2 (1946), en part. p. 117.
74. Les interdictions antérieures au concile de Tours insistent davantage sur le motif de l’avarice et de l’appât du gain (gratia lucri temporalis). Sur ces questions, notamment l’in-terdiction de l’étude du droit romain et sa réception, voir C. Bock, Les cisterciens et l’étude du droit, in «Analecta sacri ordinis Cisterciensis», 7 (1951), pp. 3-31; H. Gilles, Les clercs et l’enseignement du droit romain, in Église et culture en France méridionale (XIIe-XV e siècle), Toulouse 2000, pp. 375-387; Idem, Les moines à l’université. L’exemple toulousain au XIV e siècle, dans Moines et religieux dans la ville (XIIe-XV e siècle), Toulouse 2009, pp. 189-201.
75. Contrairement aux collèges mendiants, moines et chanoines suivaient une partie des cours à l’extérieur, dans le cadre de la faculté de théologie: cf. J. Verger, Moines, cha-noines et collèges réguliers dans les universités du Midi au Moyen Âge, in Naissance et fonction-nement des réseaux monastiques et canoniaux. Actes du premier colloque international du C.E.R.C.O.M., Saint-Étienne, 16-18 septembre 1985, Saint-Étienne 1991, pp. 511-549.
76. Matthaei Parisiensis, monachi Sancti Albani Chronica majora, V, pp. 528-529: Do-mus autem monachorum ordinis Cisterciensis Parisius studentium que per abbatem Clareval-lensium, videlicet Stephanum de Lexintona, natione Anglicum, propter obprobria fratrum Prae-dicatorum et Minorum initiata est, felix diatim suscepit incrementum. Et placuit Deo, prelatis, et populo eorum honesta et ordinata conversatio, non enim vagabantur per civitates et pagos. Non erat eis pro claustrali maceria oceanus, sed infra muros suos clausi et stabiles conversantes suo secundum regulam sancti Benedicti obediebant superiori, quod laudabile reputabit, qui re-gulam sancti Benedicti voluerit intueri; in principio videlicet genera distinguens monachorum,
cécile caby
Sarabaitas et girovagos reprehendit; cette remarque apparaît dans un paragraphe consacré aux confl its entre séculiers et Mendiants à l’Université de Paris, comme en contrepoint vengeur aux diffi cultés des Mendiants en raison, selon l’auteur bénédictin, de leur condition de mendicité et donc d’instabilité.
77. A. Perraut, L’architecture des collèges parisiens au Moyen Âge, Paris 2009 qui ne dis-pense absolument pas de revenir à l’article extrêmement stimulant de Dautrey, Croissance et adaptation qui s’interroge avec beaucoup de pertinence sur la façon dont «le Studium cistercien de Paris se trouve ainsi à l’origine d’une redéfi nition durebale du cadre de vie des réguliers dans les villes» (p. 197).
78. Dautrey, Croissance et adaptation, pp. 156-160; Perraut, L’architecture des collèges parisiens, p. 92.
79. Chartularium Universitatis Parisiensis, n. 375, I, pp. 421-422; n. 486, I, p. 571. Sur le caractère primordial de la chapelle dans les ‘collèges’ réguliers se marquant par son isolement (par opposition au schéma dominant de la chapelle intégrée dans les collèges séculiers), Perraut, L’architecture des collèges parisiens, pp. 121-129.
80. Perraut, L’architecture des collèges parisiens, p. 218 qui s’appuie sur les travaux de K. Krüger en particulier Architecture and Liturgical Practice: the Cluniac galilaea dans Th e ‘White Mantle of Churches’, éd. N.Hiscock, Turnhout 2003, pp. 138-159.
81. Fournier, Statuts et privilèges, I, n. 529, pp. 454-456; Lekai, Le collège Saint-Bernard de Toulouse, p. 254. On soulignera que ce type de compromis ouvre une brèche (attestée ailleurs dans des cas comparables) dans la cohérence juridique de l’ordre cistercien, dans la mesure où il prévoit que le provisor seu prior seu ministror qui dicto loco preerunt quocunque nomine nominetur, in principio sue institutionis domno abbati S. Saturnini se presentet perso-naliter et subjectum confi teatur in predictis dictam ecclesiam et oratorium et cimiterium dicti loci Grandis Silve supra dicto monasterio Sancti Saturnini, tanquam majori et matrici ecclesie ratione tantummodo eorum (Ibidem, p. 456)
82. Sur ces questions complexes et qui virent parfois à l’aporie historique, voir les remarques très articulées de Dautrey, Croissance et adaptation, pp. 192-196 sur le bâtiment des moines et l’interprétation plus banale de Perraut, L’architecture des collèges parisiens, pp. 223-229, selon laquelle l’église et le réfectoire de Saint-Bernard de Paris se rattacheraient davantage à des modèles mendiants.
83. On relèvera l’ambigüité du statut qui se garde de préciser la localisation urbaine des futurs studia (à l’exception de celui de Paris déjà créé) et conserve une terminologie de l’espace monastique (les termini) complètement étrangère aux caractéristiques de l’espace urbain. On ne trouve rien à ce sujet dans les compilations cisterciennes de 1237 et 1257, sans doute trop précoces par rapport au problème. En revanche y est souvent évoqué le fait que le moine ait pour résidence propre le monastère (Monachis quibus claustrum propria debet esse habitatio... Lucet, Les compilations cisterciennes de 1237 et 1257, p. 309) et y est in-troduit un nouveau chapitre de monacho in via eunte et redeunte (Ibidem, pp. 161 et 310).
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
84. Le chapitre clunisien de 1301 interdit ut nullus de ordine extra dictam domum [la domus scholarium de Cluny à Paris] Parisius morari et studere presumat sine nostra et successo-rum nostrorum licentia speciali (Chartularium Universitatis Parisiensis, II, n. 1186, p. 687); en 1309-1319 un chapitre entier, le n. 12, des statuts de la maison d’études clunisienne de Paris concerne l’interdiction des repas en ville, à quelques exceptions, et des sorties en ville nisi pro lectionibus et sermonibus audiendis horis determinatis et à l’exception des bacheliers, et enfi n les conditions de ces sorties réglementées (Chartularium Universitatis Parisiensis, II, p. 689). Pour les statuts de Simon de la Brosse, voir Sullivan, Th e ‘Collège de Cluny’.
85. Pour les Cisterciens, voir Mahn, Le pape Benoît XII, p. 57. Le Libellus antiquarum defi nitionum cité par l’article 18 du projet de réforme auquel répondent les abbés cister-ciens dans leur mémoire au pape Benoît XII (début 1335) faisait une obligation aux abbés d’envoyer les étudiants dans leur studium avant la fête de Noël, ce qui est considéré par le réformateur comme une date trop avancée puisque ut communiter fertur major fervor studii est festo sancti Michaelis usque ad Nativitatem Domini; les abbés se défendent en soulignant que, selon les statuts cisterciens, les étudiants doivent être envoyés in principiis studiorum et au plus tard à Noël (Ibidem, pp. 133-134).
86. Chartularium Universitatis Parisiensis, II, p. 690: les pensions doivent commencer à la Saint Barthélémy pour respecter le calendrier des interruptions d’activités en raison des grosses chaleurs estivales.
87. Cf. Caby, De l’érémistisme rural, pp. 276-277.
88. Sur le recrutement chez les Cisterciens, Mahn, Le pape Benoît XII, p. 57; Obert-Pikety, Benoît XII et les collèges cisterciens et Obert, La promotion des études.
89. Le bon fonctionnement des maisons d’étudiants suppose l’existence d’écoles propé-deutiques formant les moines susceptibles d’accéder aux études universitaires de théologie: dès 1245 (cité supra note 34), le chapitre général cistercien prévoit de mettre en place de tel-les écoles; en 1300, il ordonne l’entretien d’un lecteur en grammaire et logique dans toute abbaye de plus de 60 moines (cit. in Obert, La promotion des études, p. 67). Parallèlement et conformément aux instructions pontifi cales de Clément V, se développaient des écoles internes pour l’enseignement des arts libéraux (cf. Berlière, Les Collèges bénédictins, p. 147). Le chapitre de 1331 précise encore le fonctionnement de ces écoles internes de grammaire et logique (Canivez, III, ann. 1331, n. 2, p. 393). Sur le retard du développement de ces écoles internes aux abbayes, voir l’argumentation des abbés cisterciens dans leur mémoire au pape Benoît XII (début 1335), infra note 93.
90. Chartularium Universitatis Parisiensis, II, Paris, 1901, n. 564, p. 38; en 1292, le chapitre renouvelle l’injonction d’envoyer un moine sur 20 ad studium comme le signale l’abbé de Cîteaux aux abbés cisterciens de la province de Canterbury qui tardent à envoyer des étudiants dans le nouveau studium cistercien d’Oxford: A.G. Little, Cistercian students at Oxford in the Th irteenth Century, in «English historical review», 8 (1893), pp. 83-85.
91. Obert-Piketty, Benoît XII et les collèges cisterciens, pp. 145-146, Obert, La promotion des études, p. 67.
cécile caby
92. Dans l’ordre cistercien, les bourses pèsent principalement sur le monastère d’origi-ne de l’intéressé à l’exception de quelques bourses fi nancées pour la moitié ou les deux tiers environ à Saint-Bernard de Paris, seul studium recrutant à l’échelle de l’ordre: cf. Mahn, Le pape Benoît XII, p. 57; Obert-Piketty, Benoît XII et les collèges cisterciens, p. 147.
93. À propos du 4e article de réforme consacré à l’organisation des écoles internes dans les abbayes en fonction de leur population, les abbés cisterciens répondent, dans leur mémoire au pape Benoît XII (début 1335), que multa sunt parva monasteria in ordine que propter parvitates conventuum, exilitates proventuum, divinum nocturnum et diurnum offi -cium, servicia hospitum pauperum et aliorum labores et offi cia monasteriorum et alia negocia in quibus multi monachi necessario ex Regula occupantur, nequirent studia sustinere: or, ces obligations étant essentielles à la vie monastique selon la règle de saint Benoît et le Décret de Gratien, il a été jugé préférable de retarder l’ouverture de studia dans les monastères tandis qu’on les favorisait in locis solemnibus à savoir Paris, Toulouse et ailleurs (Mahn, Le pape Benoît XII, p. 117). Voir pour comparaison les défi nitions en la matière du chapitre général camaldule de 1372 qui descendent bien en dessous des quotas cités («(...) à condi-tion qu’il y ait dans chacun de ces monastères six moines ou novices en plus des étudiants (...)»): Archivio di Stato di Firenze, Camaldoli Appendice, 35, f. 80r (1372 mai 27-juin 2), cit. dans Caby, De l’érémitisme rural, p. 280.
94. On rappellera que c’est une contribution de ce type qui suscite le confl it entre l’ab-bé de Clairvaux et de Villers, cf. introduction supra. Sur les diffi cultés de fi nancement de l’œuvre du Studium Saint-Bernard, voir Dautrey, Croissance et adaptation, pp. 146-150.
95. Voir à ce sujet le chapitre de la bulle Benedictina (éd. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio (...), III/2, Roma 1741, p. 214-240) qui fi xe à 20 livres le mon-tant de la pension réservé aux dépenses journalières, à 6 le montant réservé aux frais de vêtement et de chaussure, le reste servant pour la nourriture, les livres et autres frais. Pour comparaison, voir les décisions capitulaires et leurs eff ets dans l’ordre camaldule, quelques décennies plus tôt, sous le généralat de Bonaventura de Fano, dans Caby, De l’érémitisme rural, pp. 277-282.
96. C’est cette formule qu’adopte le pape Benoît XII en 1336 dans les bulles Benedic-tina et Fulgens sicut stella (Mahn, Le pape Benoît XII, p. 58).
97. Ainsi, la bulle par laquelle le pape Urbain V fonde le prieuré Saint-Benoît de Mont-pellier et le soumet à Saint-Victor de Marseille (1368) prévoit qu’y habitent vingt monachi conventuales dont un prieur, 12 prêtres séculiers qui célèbrent l’offi ce et 16 moines ad stu-dendum in jure canonico (je ne relève pas ici le compromis supplémentaire qu’introduit la dérogation à l’interdiction d’étudier le droit pour les moines): éd. Fournier, Les statuts et privilèges, II, p. 113-114. Selon les statuts de la fi n du XIVe siècle, les Clunisiens de Saint-Martial d’Avignon doivent assister aux offi ces de toutes les heures exceptis illis qui legent (Fournier, Les statuts et privilèges, II, pp. 326 et suivantes, § 8); sur ce studium, G. de Valous, Un prieuré clunisien: le prieuré-collège de Saint-Martial en Avignon, in «Revue Mabillon», 18 (1928), pp. 284-306.
non obstante quod sunt monachi. être moine et étudiant au moyen âge
98. Voir, entre autres, les statuts du collège clunisien de Paris en 1309-1319 (Chartu-larium Universitatis Parisiensis, II, n 1187, pp. 687-691), ou l’article 54 de la bulle Fulgens sicut stella (Ibidem, p. 450) qui confi rme les décisions du chapitre général de 1331 et insère dans le serment du bachelier l’engagement à ne pas donner de banquet le jour où il com-mencera ses leçons (Mahn, Le pape Benoît XII, p. 59 et 63), ou enfi n les statuts de réforme cisterciens de 1339 (Ibidem, n. 1022, p. 483-4). J. Verger signale même des pratiques de bizutage au collège Saint-Bernard de Paris au XVe siècle: J. Verger, Rites d’initiations et conduites d’humiliation. L’accueil des béjaunes dans les universités médiévales, in La dérision au Moyen âge: de la pratique sociale au rituel politique, É. Crouzet-Pavan et J. Verger (dir.), Paris 2007, p. 73-84.
99. Le paragraphe 18 des statuts du collège clunisien de Saint-Martial d’Avignon (1379) rappelle par exemple que claustrales et studentes doivent porter un vêtement unique qui ne doit pas ressembler à ceux de mundanos aulicos (Fournier, Les statuts et privilèges, II, pp. 322-326). En 1339, puis en 1341, les étudiants du collège de Saint-Bernard de Paris reçurent à l’inverse les avertissements du chapitre général pour leur comportement honteux «en habits laïques» qui leur avait déjà valu les remontrances du Châtelet (Canivez III, ann. 1339, n. 6-8, pp. 456-457 et ann. 1341, n. 3, p. 466 cit. in Mahn, Le pape Benoît XII et les Cisterciens, p. 62). Les statuts du collège cistercien de Senanque à Avignon (1497) résument très effi cacement les enjeux de ces questions d’habitus: (...) ne nostri in dicto collegio studentes potius extimentur vagantes quam studentes, et tabernas venerantes quam scolas frequententes, quod, quando exibunt a collegio causa eundi ad studium, bini et bini, decenter et in regulari habitu procedant... Et prout iverint, ita regulariter ac eadem serie ad collegium revertantur (...) (Fournier, Les statuts et privilèges, pp. 502-507, § 14)
100. Th . Füser, Mönch im Konfl ikt: zum Spannungsfeld von Norm, Devianz und Sank-tion bei den Cisterziensern und Cluniazensern, 12. bis frühes 14. Jahrundert, Münster 2000, notamment le chapitre sur les fugitifs particulièrement pertinent pour notre propos.
101. On partira de la liste de Obert, Les lectures et les œuvres des pensionnaires du collège Saint-Bernard; dans cette perspective voir par ex. l’étude de P. Michaud-Quantin, Guy de l’Aumône, premier maître cistercien de l’université de Paris, «Analecta sacri ordinis Cistercien-sis», 15 (1959), pp. 194-219 qui souligne bien le rapport entre fi délité extrême aux sources franciscaines (principalement Alexandre de Halès et Eudes Rigaud) et part d’inventivité dans les productions scolaires du premier maître cistercien; voir aussi les travaux de Th . Falmagne, en part. Les instruments de travail d’un prédicateur cistercien. À propos de Jean de Villers (mort en 1336 ou 1346), dans De l’homélie au sermon. Actes du colloque internatio-nal de Louvain-la-Neuve (9-11 juillet 1992), éd. J. Hamesse et X. Hermand, Louvain-la-Neuve 1993, pp. 183-238 et Les cisterciens et les nouvelles formes de fl orilèges aux XIIe et XIIIe siècles, in «Archivum Latinitatis Medii Aevi», 55 (1997), pp. 73-176.
102. J.-Ph. Genest, L’enseignement des arts libéraux au collège Saint-Bernard d’après une collection de discours d’ouverture dans Du copiste au collectionneur: Mélanges d’histoire des textes et des bibliothèques en l’honneur d’André Vernet, éd. D. Nebbiai-Dalla Guarda, J.-Ph. Genest, Turnhout 1998, pp. 191-218, en part. 221.
![Page 1: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012120/6313d1e9b033aaa8b210419a/html5/thumbnails/37.jpg)