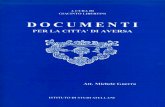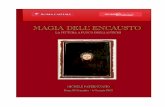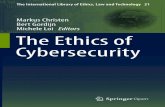Documenti per la città di Aversa, Michele Guerra, a cura di Giacinto Libertini
« Michele Amari ou l'histoire inventée de la Sicile islamique : réflexions sur la Storia dei...
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of « Michele Amari ou l'histoire inventée de la Sicile islamique : réflexions sur la Storia dei...
1 On ne s’intéressera donc pas ici à l’orientalisme en Italie. Celui-ci a faitl’objet d’études, tout comme les liens entre orientalisme et colonialisme, maismanque encore une synthèse systématique de l’essor d’un savoir scientifique surl’islam à partir du XIXe siècle dans le cadre italien.
2 Voir ici-même la communication d’H. Bresc sur l’Abbé Vella, p. 235-263.3 De même, Rosario Gregorio (1753-1809), dont la synthèse et l’effort pour
maîtriser les sources arabes sont notables pour son époque et dont nous reparle-rons plus bas, est rarement mentionné.
ANNLIESE NEF
MICHELE AMARI OU L’HISTOIRE INVENTEEDE LA SICILE ISLAMIQUE
REFLEXIONS SUR LA STORIA DEI MUSULMANI DI SICILIA
L’objet de cet article est la naissance de l’historiographieitalienne portant sur le monde islamique, une historiographie qui ad’abord pris la forme d’un interet pour la Sicile islamique1. Dans cetessor, l’Italie joue, en effet, un role a part dans la mesure ou, commela peninsule iberique, elle a ete soumise partiellement a une domina-tion arabo-musulmane (Sicile et sud de l’Italie peninsulaire); toute-fois, le fait que cette domination ait ete moins longue (du IXe auXIe siecle au maximum) que dans l’espace iberique explique aussi enpartie les modalites specifiques de l’emergence du nouvel objet qu’aconstitue l’histoire de la Sicile islamique. Enfin, le contexte poli-tique, italien et plus largement europeen, de la fin du XVIIIe siecle-debut du XIXe siecle n’est pas non plus sans incidence sur cetteevolution historiographique.
Si le present volume rappelle des manifestations anterieuresd’un interet pour la Sicile islamique – telles l’admirable invention del’abbe Vella2 et les recherches d’Adolphe Noel des Vergers, dontl’œuvre est a cheval entre l’interet croissant pour l’Orient antique etla curiosite pour les Hauteville de Sicile qui anime les savants fran-cais au XIXe siecle –, on doit toutefois a Michele Amari l’histoire dela Sicile islamique qui va devenir la reference obligee. Ses deuxpredecesseurs n’ont guere laisse de souvenir d’un point de vue scien-tifique3. En revanche, une nouvelle edition de la Storia dei Musul-
286 ANNLIESE NEF
4 La date de publication de la première édition est 1854 pour le premiervolume; 1872 pour les deux derniers.
5 M. Amari, Storia dei musulmani di Sicilia, Florence, 2002-2003, par l’édi-teur Felice Le Monnier.
6 B. Soravia, Accesa e declino dell’orientalismo scientifico in Italia, dans Ilmondo visto dall’Italia (Atti del Convegno annuale della Società italiana per lostudio della storia contemporanea), Milan, 2004, p. 270-86, spéc. p. 272-273.B. Soravia montre bien que les fondements de l’école italienne posés par I. Guidisont philologiques et non historiques, ibid., p. 273.
7 On peut se reporter, concernant la vie de Michele Amari, à l’article duDizionario biografico degli Italiani, II, Rome, 1960, p. 637-650. Pour sa produc-tion, aussi variée que vaste, puisqu’elle mêle tout au long de la carrière deMichele Amari histoire et politique, on verra G. S. Cozzo, Le opere a stampa diMichele Amari, dans Scritti per il centenario della nascita di Michele Amari,Palerme, 1910, rééd. Palerme, 1990 (Documenti per servire alla storia di Sicilia,Diplomatica, ser. IV, Cronache e scritti vari), I, p. XLV-CVIII.
8 Ainsi de la biographie rédigée par l’orientaliste H. Derenbourg, peu detemps après la mort de M. Amari, Notice biographique sur Michele Amari,dans Opuscules d’un arabisant, Paris, 1905, p. 87-242 ou des quelques pagesadmiratives de G. Dugat, Histoire des Orientalistes, Paris, 1868-1870, rééd.Londres, 2003, I, p. 12-24. Notons, de manière significative, que M. Amarin’est pas rappelé avant tout, y compris dans ce dernier texte, pour son activitéd’orientaliste.
9 S. Tramontana, Gli anni del Vespro. L’immaginario, la cronaca, la storia,Bari, 1989, p. 87-141.
mani di Sicilia4, qui demeure incontournable pour les historiens duMoyen Age sicilien, a ete realisee recemment5. Bruna Soravia a,toutefois, souligne, a juste titre, que l’experience amarinienne neconstitue pas, a proprement parler, la premiere etape de la nais-sance d’une ecole d’islamistique italienne; elle se place en amont decelle-ci et repond a des motivations fort differentes, sur lesquellesnous voulons revenir ici6.
Michele Amari7 a ete l’objet d’admirations soutenues et debiographies, a la tonalite plus ou moins hagiographique, avantmeme sa disparition, en raison de sa stature politique peucommune8. Cette dimension rejaillit sur son œuvre historique, maiselle a ete surtout mise en valeur, car c’etait la l’analyse la plus aisee,pour son etude des Vepres siciliennes9. On a, certes, releve le socleideologique de la Storia dei Musulmani di Sicilia, mais surtout pourla replacer dans le contexte plus large de l’emergence des Etats-nations et sans en tirer toutes les implications qui en decoulent. Lecontexte politique sicilien, qui a des incidences precises sur la redac-tion de cet ouvrage, a, en revanche, ete neglige, tout comme ont etepasses sous silence les choix promus par Michele Amari en tantqu’orientaliste, ainsi que leurs effets sur l’ecriture de cette histoire.Ce silence est d’autant plus surprenant que l’abondante correspon-dance echangee par l’historien sicilien avec plusieurs grands noms
287MICHELE AMARI OU L’HISTOIRE INVENTÉE DE LA SICILE ISLAMIQUE
10 G. Belfiore, Le lettere di Michele Amari a Reinhart Dozy, dans Bollettino delCentro di studi filologici e linguistici siciliani, 9, 1968, p. 262-293, désormaisabrégé G. Belfiore, Le lettere (1) et G. Belfiore, Le lettere di Michele Amari a Rein-hart Dozy, dans Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 10,1969, p. 179-214, désormais abrégé G. Belfiore, Le lettere (2); A. Borruso, Letteredi Michele Amari a Celestino Schiarapelli, dans Archivio storico siciliano, ser. IV, 3,1977, p. 235-300; Id., Lettere di Ignazio Guidi a Michele Amari, Palerme, 2001(Edizione nazionale delle opere e dei carteggi di Michele Amari, IV Serie – Carteggi,2) et Lettere di Reinhart Dozy a Michele Amari, Palerme, 1999 (Edizione nazionaledelle opere e dei carteggi di Michele Amari, IV Serie – Carteggi, 1).
11 Carteggio di Michele Amari raccolto e postillato coll’elogio di lui letto nell’ac-cademia della Crusca, éd. A. d’Ancona, Turin, 1896 (désormais Carteggio).
de l’orientalisme10, mais aussi avec nombre de ses amis et proches11,a ete massivement publiee. Or, dans ces lettres, l’auteur livre parfoisses conceptions et ses motivations de maniere extremement claire.
Nous nous attacherons donc ici a ces differents aspects dugrand-œuvre de Michele Amari, en nous appuyant a la fois sur cetteproduction epistolaire remarquable et sur la Storia dei Musulmani diSicilia elle-meme. La seule periode islamique de l’histoire de la Sicileretiendra notre attention et nous laisserons de cote les periodesnormande et souabe.
Le positionnement ideologique n’est pas porteur en soi d’unedeformation de l’histoire, surtout s’il est explicite. Neanmoins, lesquestionnements qui l’articulent construisent un objet historique,comme nous le montrerons pour Michele Amari. Un autre elementne doit pas etre neglige : ce dernier ecrit a l’oree des etudes sur lemonde islamique, un monde s’ouvre a lui, tout comme a la genera-tion d’islamisants contemporaine de ses recherches. Il tend donc,pour asseoir ses theories, a projeter des decouvertes concernantd’autres regions sur les realites siciliennes, moins bien documenteespar les sources. Cette difficulte, aisement comprehensible, n’auraitaucune incidence si les etudes sur la Sicile islamique n’etaienttombees en desherence et si, par la-meme, une conception relative-ment fausse de cette derniere n’etait couramment vehiculee dans lesvulgarisations dont les recherches de Michele Amari sont l’objet. Or,ses analyses etaient a la fois motivees par des choix ideologiques etinformees par des partis pris methodologiques.
Les choix ideologiques : identite sicilienne et anticlericalisme
Il faut, pour commencer, rappeler que si l’orientalisme esthe-tique et litteraire a connu une certaine vogue relativement tot enEurope, ecrire l’histoire du monde islamique, ou d’une partie de cemonde comme l’a fait Michele Amari, exigeait de se heurter a des apriori anti-musulmans forts a l’epoque, surtout en Sicile, ou la
288 ANNLIESE NEF
12 Notamment par deux ouvrages de Rosario Gregorio (1753-1809) : Desupputandis apud Arabes Siculos temporibus, Palerme, 1786 et Rerum arabicorumquae ad siculam historiam spectant ampla collectio, Palerme, 1790.
13 Sur ce point, on peut voir le beau livre de J. T. Monroe, Islam and theArabs in spanish scholarship (sixteenth century to the present), Leyde, 1970,chap. II et M. Manzanares de Cirre, Arabistas españoles del siglo XIX, Madrid,1972.
14 C’est le cas de Javier Simonet qui publie nombre d’ouvrages à partir desannées 1860 mais est surtout connu pour ses recherches sur les mozarabes (ibid.,p. 84-101).
15 R. Dozy, Histoire des musulmans d’Espagne jusqu’à la conquête de l’Anda-lousie par les Almoravides 711-1110, éd. revue par É. Levi-Provençal, Leyde, 1932.
16 Plus largement, sur l’impact du contexte «risorgimental» sur l’écriture de
menace «turque» etait devenue un topos populaire. Il fallait doncune motivation serieuse pour se lancer dans cette recherche.Denoncer la supercherie de l’abbe Vella, qui avait deja etecombattue avec succes12, ne pouvait suffire pour justifier le labeurde plusieurs decennies. L’histoire des «musulmans de Sicile», pourreprendre le titre de Michele Amari, est en effet aussi le fruit de deuxpreoccupations majeures de l’auteur : sa volonte d’eclairer l’«iden-tite sicilienne» et son anticlericalisme militant.
Eclairer l’«identite sicilienne» : l’apport islamique
Il est important de souligner que Michele Amari constitue unerelative exception au niveau europeen, par le fait qu’il ecrit sur saterre natale, tout en offrant un tableau susceptible de retenir l’atten-tion internationale. Ceci tient, tout d’abord, a son traitement du sujetqui inclut un retour sur l’essor de l’islam depuis les origines et ne selimite donc pas a une histoire regionale : la Sicile est integree dansun cadre bien plus large. En outre, si l’on prend on consideration lecas de la peninsule iberique, cette impression se confirme. Cetteregion a beneficie de recherches menees par des Espagnols, mais soitces derniers sont totalement tombes dans l’oubli (c’est le cas notam-ment de Pascual de Gayangos mais aussi de Jose Antonio Conde13),soit leur œuvre presente une dimension de controverse telle qu’elleen devient problematique (Francisco Javier Simonet)14. L’histoire del’«Espagne musulmane» (comme on disait alors) de reference pourle XIXe siecle a, par exemple, ete redigee par un Hollandais, ReinhartDozy15, un des grands amis de Michele Amari. Ce dernier est donc leseul a construire un objet historique digne de ce nom tout en ecrivantl’histoire de sa terre, meme s’il faut souligner, encore une fois, lasituation particuliere de la Storia dei musulmani di Sicilia qu’aucunouvrage n’est venu remplacer16, contrairement a ce qu’il en est l’his-
289MICHELE AMARI OU L’HISTOIRE INVENTÉE DE LA SICILE ISLAMIQUE
l’histoire du haut Moyen-Âge sicilien, cf. A. Nef et V. Prigent, Per una nuovastoria della Sicilia nell’alto medioevo, dans Storica, 35-36, 2006, p. 9-63.
17 É. Levi-Provençal, Histoire de l’Espagne musulmane, Paris-Leyde,1950-1953.
18 Thématique inspirée de l’historien Augustin Thierry, comme le rappelleG. Giarizzo dans son introduction à la réédition de la Storia dei musulmani diSicilia (désormais SMS, citée dans la réédition de 2002-2003, cf. supra n. 3), I,p. XXXV.
19 M. Amari l’exprime clairement à R. Dozy dans la première lettre qu’il luiécrit, le 2 avril 1844 : «En Sicile, l’élément arabe prédomine toujours. Notre type,nos mœurs, notre langage en conservent des traces plus profondes encore quecelles qu’on voit dans l’extérieur de nos campagnes et de nos villes et dans lesnoms des lieux. Il y a dans cette histoire bien des problèmes à résoudre qui inté-ressent l’histoire littéraire et sociale d’Italie et de toute l’Europe» (G. Belfiore, Lelettere (1), p. 268).
20 SMS, I, p. 134 : «Una matura riflessione su l’indole e i costumi dei Sicilianiparagonati a quei degli altri popoli italiani non mostra tal divario che non sipossa spiegare con la geografia e con la storia».
21 Pour la conception darwiniste des races que défend R. Dozy, cf. Lettere di
toire d’al-Andalus pour laquelle Evariste Levi-Provencal a non seule-ment revise l’ouvrage de Reinhart Dozy, mais encore propose unenouvelle synthese17. Neanmoins, et en depit de la relative atonie desetudes sur la Sicile islamique depuis le debut du XXe siecle, l’enver-gure de l’œuvre amarinienne est reelle. Or, elle n’est pas l’effet duhasard mais le fruit de deux preoccupations qui animaient sonauteur et qui sont moins contradictoires qu’elles ne pourraient lesembler a premiere vue : le souci d’integrer la Sicile a l’historio-graphie du temps, en montrant que les problematiques sont iden-tiques dans le cadre insulaire et dans les autres regions de l’Europe(dynamiques vainqueurs/vaincus18 en particulier), d’une part, et lavolonte de rendre raison d’eventuelles specificites siciliennes, d’autrepart19, tout en les presentant comme un apport pour la nouvellenation italienne.
Car c’est bien la le nœud de la recherche amarinienne : ecrireune histoire qui lui permette de rendre raison des differences quidistinguent les Siciliens des habitants de l’Italie, tout en montrantqu’elles ne sont pas insurmontables et constituent meme un apport.Rien donc que la geographie et l’histoire ne puissent expliquer20. Defait, Michele Amari defend une conception de chaque peuple commefruit de son milieu et de son evolution, la ou d’autres n’hesitent pas aessentialiser ses caracteristiques (meme s’il n’echappe pas tout a faita ce penchant, qui reflete des conceptions repandues a son epoque).S’il adopte cette position, c’est en partie parce qu’il lutte contre letopos du retard insulaire et il echange sur ce theme des propos tresclairs avec Reinhart Dozy, qui defend, quant a lui, une conceptionplutot darwinienne de l’evolution historique21.
290 ANNLIESE NEF
22 Cf. Carteggio, I, lettre CVIII, datée du 24 mai 1845, à Anna Gargallo,p. 160-161 : «Ma la Sicilia occidentale, anche andando alla messa, ritenne moltode’ modi musulmani, e sopratutto l’antipatia per l’altra razza [c’est-à-dire celledes Grecs de la partie orientale]. Questo spiegherebbe gran parte delle calamitàdella Sicilia, che si prolungano fino ai giorni nostri» (p. 161).
23 L’auteur nuance sa position par rapport à ce qu’elle était en 1845 (noteprécédente) dans sa SMS : «Assai più che l’incerta mescolanza di un fil di sanguestraniero, sarebbe da valutare l’esempio de’ costumi che le colonie arabe eberbere abbian lasciato per avventura alle popolazioni della Sicilia occidentale,più pronte in vero alla violenza che quelle della regione di levante : ma anche inquesto fatto le cagioni sono dubie e diverse, e chi sa che non v’abbiano operatopiù che ogni altro le condizioni topografiche e sociali?», SMS, I, p. 134.
24 On en veut pour preuve l’ouverture de l’ouvrage : «Tra tanti rivolgimentisuperficiali quattro conquisti mutarono radicalmente il paese : che furono ilgreco, il romano, il musulmano e il normanno, o meglio direbbesi italiano. [...]Ma nell’ottavo secolo dopo la nascita di Cristo, seguì il terzo rinnovamento dellaSicilia, per opera dei Musulmani, i quali avean tocco l’apice di lor subita civiltà[...]. Breve del resto il dominio musulmano, nè arrivò a compiere la assimila-zione degli abitanti che avea trovato nell’isola. Sfasciandosi da un canto lasocietà musulmana in Sicilia come per ogni luogo, e spuntando dall’altro canto lanovella nazione italiana, questa trovò, come per caso, la insegna di ventura, gliegregii esempii d’ardire e gli ordini di guerra dei Normanni : talché, verso la finedell’undicesimo secolo, passò il Faro sotto la bandiera di quelli; ripigliò la Siciliache le appartenea per ragione di geografia e di schiatta...», SMS, I, p. 49-50. Lesitaliques sont miennes.
25 «La sola conchiusione certa è che il conquisto musulmano recò in Sicilianel IX secolo, e mantennevi fino all’XI, uno incivilimento ed una prosperità
L’heritage islamique paraıt important a Michele Amari jusqu’al’epoque a laquelle il ecrit, on l’a vu, mais il connaıt des nuancesregionales. Le sort distinct des regions orientale et occidentale del’ıle sous la domination islamique, cette derniere etant plus etroite-ment liee aux nouveaux conquerants que le val Demone, explique,en effet, en partie, a ses yeux, la division interne de l’espace insulaireentre l’Ouest, plus prompt a la violence et a la rebellion que Messine,et surtout la rivalite sterile qui affaiblit la Sicile22. Dans ce cadre, ilne s’agit de rien moins que de rehabiliter la Sicile occidentale, memes’il convient, insiste Michele Amari, de ne pas exagerer ses particula-rites pour des raisons evidentes23. Si son avis sur cette question esttranche dans sa correspondance du milieu des annees 1840, il est eneffet plus nuance dans la Storia dei Musulmani di Sicilia. Rien nedoit s’opposer a l’integration de la Sicile a l’Italie. Or, si l’italianite del’ıle justifie son insertion aisee a l’ensemble national, elle n’est pasun donne essentie (comme l’hispanite pour certains historiens espa-gnols de la meme periode). Elle constitue une realite fluctuante dansle temps, qui tient en grande partie a la geographie et a l’histoire dela Sicile et sera exaltee par les Normands aux XIe-XIIe siecle, unerealite, surtout, qui n’entre pas en contradiction avec l’heritage isla-mique insulaire24, bien au contraire25.
291MICHELE AMARI OU L’HISTOIRE INVENTÉE DE LA SICILE ISLAMIQUE
Reinhart Dozy a Michele Amari, lettre XXXIX, p. 125-126. Pour une discussion surles mérites respectifs des peuples du nord et du sud, lettre XXIII, p. 91-92.ignota allora alle altre regioni italiane, i quali nel XII e per grande parte del XIIIrifluirono su la Penisola e contribuirono allo splendore della patria comune»,SMS, I, p. 134.
26 Cette position est très justement mise en relation avec celles d’O. Rankepar G. Giarrizzo dans son introduction à la SMS, p. XXIII. L’idée à l’œuvre ici estque la papauté et le catholicisme ont été des obstacles à l’émergence d’une nationallemande et d’une nation italienne.
27 M. Amari décrit ainsi les premiers temps de l’Islam : «Fu democraziasociale come oggi si direbbe, la quale forma ben rispondeva ai principii fonda-mentali dell’islamismo : uguaglianza, e fratellanza» (SMS, I, p. 89). Tandis queles ennemis sont décrits ainsi : «passando ai popoli di que’ due imperii, livedremo avviliti dal dispotismo, rifiniti dalle tasse e dalla rapacità degli officialipubblici; scissi da assottigliamenti religiosi» (ibid., p. 93).
Pour Michele Amari, il s’agit donc de demontrer non seulementque la domination islamique, comme l’italianite de la Sicile, tient ala position geographique de l’ıle et a son histoire, mais egalementqu’elle n’a pas nui a cette derniere et lui a meme profite. Cette paren-these islamique n’a pas mis fin a l’italianite sicilienne, elle lui apermis, a l’inverse, de s’affirmer a nouveau. L’apport du passe isla-mique de l’ıle reside en effet dans sa dimension eninemment dyna-mique et, en particulier, dans la rupture religieuse qu’elle constitue.
Anticlericalisme et exaltation des musulmans : un choix malaisemais massif
Execration de l’Eglise et rejet du despotisme du Bas-empire sontquasiment une seule et meme chose pour Michele Amari : despo-tisme et religion catholique marchent la main dans la main pourendormir les esprits26. A l’inverse, l’islam, nouvelle religion, est cequi fait des Arabes une nation. La ou le christianisme, et en parti-culier le christianisme byzantin, accuse de se perdre dans desquerelles theologiques sans fin, favorise le maintien d’empires deli-quescents, l’islam transforme les peuples en autant de nations : c’estle cas des Arabes, des Berberes, des Turcs, etc. Cette dimension tientau paradoxe constitutif de l’islam pour Michele Amari sur lequelnous reviendrons : l’islam est bien la religion d’un peuple, lesArabes, mais il porte en lui les germes d’un egalitarisme qui lui estconsubstantiel et empeche l’emergence d’un veritable – c’est-a-direoppressif – empire islamique27. Il favorise, en revanche, l’affirmationd’autres peuples, conquis par les Arabo-musulmans. Nous verronsplus loin que la raison de cette specifite tient au type de societe danslaquelle l’islam est ne et s’est developpe.
Une telle position ne va pas de soi dans un contexte ou en depitdu developpement de l’orientalisme au sein des elites europeennes,
292 ANNLIESE NEF
28 Lorsque la traduction du voyage d’Ibn Gubayr paraît dans la «Falce» àPalerme, Gaetano Daita écrit à M. Amari, le 15 avril 1845 et évoque la censure :«Tu puoi imaginare che strazio ne abbia fatto la censura, cominciando dal tuoragionamento, ossia della prefazione, sino alle note più innocenti. Tolse perfino,lo crederesti? Le fanatiche esclamazioni ed imprecazioni del divoto Arabo controi Cristiani!» (ibid., lettre CVI, p. 155).
29 Ainsi dans une lettre écrite à Rome le 1er février 1845 par Anna Gargallo àM. Amari, celle-ci évoque les premières traductions de M. Amari (Ibn H
˙awqal) et
se montre pressée de lire celle d’Ibn Gubayr : «Fra gli autori arabo-siculi non vene ha alcuno che avesse abbracciata la religione cristiana? Perseguitavano i vinti?come si fa ad amarli! Cosi lontani da noi per principi e per culto! Eppure noiammiriamo i Greci! ma per gli Arabi sarà un miracolo riserbato al nostro Amari»(Carteggio, lettre CIV, p. 154).
30 Carteggio, I, lettre CVIII, du 24 mai 1845, à Anna Gargallo, p. 161 : «La popo-lazione delle campagne, dopo aver seguito tuttavia l’antica fede, si piegò allanuova, che non era sì lontana da quella, ma piuttosto un scisma cristiano, come lorapresentò Dante. Perché ella rinegherebbe le glorie degli Arabi, se i Francesitengon tanto a quelle dei Franchi, gli Inglesi, a quelli de’ Sassoni, e anche l’originelongobarda è un vanto in Italia. (...). Or la Sicilia, senza gli Arabi forse sarebberestata quel che fu ed è la Calabria, quel che sono le stanze non abitate dal padrone,o, per dir meglio, le più lontane dal suo appartamento in un palazzo che va inruina». [...] «Perché Palermo fu la capitale della Sicilia e de’ domini continentali?Perché Palermo era l’importanza della Sicilia musulmana, e non altro».
les «Turchi» demeurent une reference vivace dans les esprits, notam-ment en Sicile, mais plus generalement dans le monde catholique. Eneffet, Michele Amari, en attribuant de la sorte aux musulmans et al’islamisation des Siciliens un role majeur dans le retour a l’italianitequi etait la leur et etait etouffee par la domination byzantine, heurtedes idees repandues. On en veut pour preuve la censure dont satraduction du recit de voyage d’Ibn Gubayr, redige au XIIe siecle, futl’objet, une censure en partie motivee par la defense du catholi-cisme28. Non moins significatif est l’etonnement manifeste au sujet deson projet de recherche par une de ses correspondantes les plus regu-lieres des annees 1840-1850, Anna Gargallo29. La reponse que lui faitMichele Amari est sans ambiguıte et fort interessante : non seule-ment l’apport des musulmans est decisif, mais l’islam peut etre consi-dere, d’un point de vue religieux, comme une variante duchristianisme30. Cette affirmation lui permet de clore le debat ens’appuyant sur une analyse positiviste de l’emergence de l’islam sansrenier ses positions relatives a la place reduite qu’est censee occuperla religion dans la societe. Toutefois, Michele Amari, sans aucundoute conscient qu’il pourrait ainsi fournir des armes a ses detrac-teurs (qui pourraient voir la un argument pour reduire l’originalite del’islam), n’evoque que rarement les liens qui etaient etablis a l’epoqueentre christianisme, judaısme et islam, au cours de son expose quirevient pourtant abondamment sur le contexte de la naissance de
293MICHELE AMARI OU L’HISTOIRE INVENTÉE DE LA SICILE ISLAMIQUE
31 Cf., sur cette question, S. Patriarca, Patriottismo, nazione e italianità nellastatistica del Risorgimento, dans A. M. Banti et R. Bizzocchi (éd.), Immagini dellanazione nell’Italia del Risorgimento, Rome, 2002, p. 113-132.
cette religion. D’une maniere generale, d’ailleurs, Michele Amari n’estpas interesse par une reflexion sur l’islam comme religion (croyan-ces, etc.), son impact historique, social et politique, ideologiqueserait-on tente de dire, le retiennent avant tout. Au fond, pour lui,l’islam est nouveau moins par sa dimension theologique que parl’egalitarisme social et politique qu’il promeut ou permet de promou-voir. Ce n’est qu’a la generation suivante que l’Italie integrera lecontexte des recherches europeennes sur l’islamologie.
Ces deux dimensions de la Storia dei musulmani di Sicilia – quetedes specificites siciliennes et de leurs causes historiques et geogra-phiques, d’une part, et conception de la domination islamiquecomme une rupture fondamentale, d’autre part – expliquent,pour la premiere, la nature de certains moyens d’enquete retenuspar son auteur et, pour la seconde, les conceptions de l’histoire qu’ildeveloppe.
Questions de methode : construction nationale et expansion coloniale
Dans le cadre de son etude sur l’identite sicilienne, au-dela del’etude des textes, le savant sicilien fait des choix de methode qui sedonnent a lire relativement tot dans ses œuvres et sa correspon-dance. Ils lui permettent de recueillir une information variee qui estsynthetisee dans la Storia dei musulmani di Sicilia, aboutissementd’une lente elaboration. Pour mener sa recolte, Michele Amariutilise des instruments d’analyse lies a des disciplines et a despratiques qui prennent leur essor parallelement dans le cadre desconstructions nationales et dans celui de l’exploration coloniale,deux champs de reflexion et d’experimentation entre lesquels lesrelations sont, bien entendu, multiples.
Une quete linguistique et ethnographique
Michele Amari, pour developper son enquete, adopte unedemarche double, qui lui permet a la fois de repondre a son ques-tionnement propre et de participer aux innovations du XIXe sieclede ce point de vue. Partant d’une observation de la societe siciliennequi l’entoure et qui lui semble caracterisee par des «arabismes»,linguistiques en particulier mais pas seulement, Michele Amari selivre d’abord a des recherches de nature quasi ethnographique31. Or,
294 ANNLIESE NEF
32 Sur le premier, cf. M. Tolmacheva, The medieval arabic geographers and thebeginnings of modern orientalism, dans Journal of Middle East studies, 27, 1995,p. 141-156; quant au second, M. Amari est exilé en France au moment où cettequestion y est débattue.
33 Plusieurs études rassemblées dans M.-N. Bourguet, et al. (dir.), L’inventionscientifique de la Méditerranée. Égypte, Morée, Algérie, Paris, 1998 soulignent bienles liens entre géographie, cartographie, archéologie, ethnographie, prise depossession symbolique et contrôle territorial, dans un contexte qui se faittoujours plus colonial. On peut voir aussi, les réflexions stimulantes deE. Sibeud, Une science impériale pour l’Afrique? La construction des savoirs africa-nistes en France 1870-1930, Paris, 2002.
34 M. Amari se caractérise par sa discrétion sur ce point, y compris quanddes débats agitent la Società geografica italiana.
35 De ce point de vue, l’Italie est marquée par un décalage temporel, même siles discussions sur ce thème y sont précoces. On peut voir, A. Baldinetti, Orienta-lismo e colonialismo. La ricerca di consenso in Egitto per l’impresa in Libia, Rome,1997.
36 R. Dozy, Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes,Amsterdam, 1845 et Supplément aux dictionnaires arabes, Leyde, 1881.
l’essor de cette discipline est a replacer dans un double contexte.D’abord, il est etroitement lie aux tentatives menees pour definirl’identite italienne au XIXe siecle, tentatives au sein desquelles lefacteur linguistique (langue nationale/langues regionales) joue unrole aussi essentiel qu’ambigu. Ensuite, il s’inscrit pleinement dansla veine exploratrice anterieure32 que va venir renforcer et modifierl’experience coloniale33. Michele Amari se situe donc a la jonctionentre ces deux mouvements. Ce choix est d’ailleurs moins acomprendre par rapport au colonialisme italien et aux debats quil’entourent34 qu’il ne reflete les relations qui s’etablissent entre lesavoir elabore par les orientalistes et l’experience coloniale d’uncertain nombre de pays europeens au cours de la seconde moitie duXIXe siecle35.
Ce lien est, neanmoins, d’autant plus fort dans la demarche deMichele Amari que la langue de la domination islamique en Sicile aete l’arabe, une des langues objet d’enquete dans certaines desregions colonisees. La recherche qu’il developpe prend d’ailleurs unedimension essentiellement linguistique, meme si le lexique d’originearabe passe dans le dialecte sicilien rend necessaire un veritabletravail de terrain, «ethnographique». L’interet de Michele Amaripour ces questions rencontre celui du grand orientaliste hollandaisReinhart Dozy, avec lequel il debute, en avril 1844, une correspon-dance nourrie et longue de plusieurs decennies. Or, le point dedepart de cet echange epistolaire reside, precisement, dans l’entre-prise menee par Reinhart Dozy en vue de compiler le premier desdeux dictionnaires d’arabe36 qu’il va composer. Des le mois suivant,
295MICHELE AMARI OU L’HISTOIRE INVENTÉE DE LA SICILE ISLAMIQUE
37 Lettre du 28 mai 1844 : «Je n’avais ajourné la réponse à votre lettre du 16avril que dans l’intention de vous la faire plus complète. Je m’adressai aussitôt àdeux Maltais de ma connaissance, qui m’ont donné la liste que je vous envoie. Ilest un peu drôle que je retarde encore les renseignements relatifs à la Sicile; maisen vérité je ne saurais vous écrire que deux ou trois mots d’origine un peu diffé-rente du fond commun des langues européennes en fait de toilette. Les nomencla-tures les plus propres du pays sont cachées dans l’obscur dialecte de quelquesmontagnes de Sicile; et j’attends d’un jour à l’autre le retour à Paris d’un de mesamis qui a fait un long séjour dans l’intérieur de l’île» (les italiques sont miennes),cf. G. Belfiore, Le lettere (1), p. 269. Suivent trois listes de vocables dans deslettres postérieures : ibid., p. 271-272, p. 274-277 et p. 279.
38 D. Lejeune, Les sociétés de géographie en France et l’expansion coloniale auXIXe siècle, Paris, 1993, et P. Singaravélou (dir.), L’empire des géographes. Géogra-phie, exploration et colonisation XIXe-XXe siècle, Paris, 2008.
39 Cf. M. Amari et H. Dufour, Carte comparée de la Sicile moderne avec laSicile au XIIe siècle d’après Edrisi et d’autres géographes arabes, Paris, 1859.
40 Ce faisant, il établit une carte et une liste de toponymes comme d’autres lefaisaient au même moment au Maghreb, mais aussi dans le reste de l’Italie.
41 Et l’on retrouve ici le lien avec l’instrument linguistique.42 Carta comparata della Sicilia moderna con la Sicilia del XII secolo secondo
Edrisi ed altri geografi arabi, trad. et notes de L. Santagati, Palerme, 2004.
Michele Amari evoque le travail de recolte linguistique qu’il seraitindispensable de mener dans des regions siciliennes, decrites par luicomme reculees, afin de pouvoir repondre a son interlocuteur37. Unetelle recherche n’est pas sans rappeler des enquetes semblablesmenees dans les colonies, francaises notamment.
Ce n’est pas, toutefois, le seul point commun entre la demarcheamarinienne et celles des savants et administrateurs œuvrant dansles colonies, le role joue par la geographie en est un autre.
Le role fondamental de la geographie et de la toponymie
Tout autant que le questionnement sur les langues et les mœurs,la geographie est un instrument commun aux entreprises deconstruction nationale et d’expansion coloniale38. Elle joue un rolepreeminent dans les recherches amariniennes sur la Sicile.
Parallelement a sa quete linguistique, Michele Amari debuteaussi une veritable exploration de la Sicile islamique, en traduisantles geographes arabes qui en ont traite, mais aussi en proposant, apartir des donnees qu’il a tirees de ces descriptions, une carte de laSicile au XIIe siecle39, c’est-a-dire a une date qui permet d’enregistrerles transformations entraınees au sein du territoire par les domina-tions islamique et normande40. Il en resulte une liste de plus de 1000toponymes41 et une carte etablie avec Auguste Henry Dufour, dont iln’est pas ininteressant qu’une traduction commentee ait ete publieea Palerme en 200442. Rappelons, toutefois, que Michele Amariexplique dans son introduction a la carte que son projet initial etait
296 ANNLIESE NEF
43 M. Amari, Carta comparata della Sicilia... cit., p. 18.44 G. Pécout, Naissance de l’Italie contemporaine 1770-1922. Des origines du
Risorgimento à l’Unité : comment l’Italie est devenue une nation, rééd. Paris, 2002(1ere éd. 1997), p. 169-178.
45 Sur ce point, on peut voir le rapide : C. Cerreti, Michele Amari e la SocietàGeografica Italiana, dans Michele Amari storico e politico (Atti del seminario distudi 27-30 nov. 1989, Palermo), dans Archivio storico siciliano, ser. IV, 16, 1990,p. 313-320.
46 Pour le rôle idéologique de cette entreprise de cartographie, cf. G. Pécout,Pour une histoire des représentations du territoire : la carte d’Italie au XIXe, dans LeMouvement Social, 200, 2002, p. 100-109 et La carta d’Italia nella pedagogia poli-tica del Risorgimento, dans Immagini della nazione... cit., p. 69-87.
47 Rappelons que M. Amari a eu des fonctions dans le Consiglio Superioredella Pubblica Istruzione en 1862 et de 1867 à 1886, puis à nouveau quelquesannées plus tard.
48 C’est ce qui motive en partie l’œuvre épigraphique de M. Amari : Leepigrafi arabiche di Sicilia, trascritte, tradotte e illustrate, Palerme, 1875, rééd.revue par F. Gabrieli, Palerme, 1971.
49 Cf. note 33.
de realiser une somme cartographique ou des couleurs differentesauraient permis de faire figurer cote a cote les toponymes medie-vaux et ceux du XIXe siecle. Il dut y renoncer car une telle represen-tation cartographique n’aurait guere ete lisible43.
Il s’agit donc bien, avant l’heure, de «faire l’inventaire» de laSicile pour reprendre l’expression de Gilles Pecout au sujet del’Italie44. De ce point de vue, le fait que Michele Amari soit membrede la Societa geografica italiana des sa fondation en 1867 est signifi-catif45, a une epoque ou sont etablies les cartes des differentesregions d’Italie sous l’impulsion de l’Istituto geografico militare deFlorence46 et ou l’enseignement de la geographie est mis en avantcomme une discipline au service de la construction nationale47.Cette prise de controle du territoire a travers le renouvellement de saconnaissance dans le cadre de la construction de la nation italienneaccompagne la propre quete de Michele Amari, il s’agit ainsi enquelque sorte de restituer la Sicile a l’Italie. Cette tentative prend icila forme de la geographie historique, mais elle ne fait pas l’impassesur la connaissance de la carte sicilienne contemporaine de l’auteur,ne serait-ce que, on l’a vu plus haut, parce que celle-ci contientnombre de noms de lieux qui remontent a la domination islamique.
Cette enquete geographique et toponymique passe aussi par unrecensement systematique des vestiges attribuables a la periode quiinteresse Michele Amari48. Autant de pratiques qui accompagnentailleurs le passage de l’exploration a l’experience coloniale49 et qui nepeuvent avoir echappe a Michele Amari lors de son sejour parisien.Ses recherches doivent permettre aux nouvelles elites italiennes,
297MICHELE AMARI OU L’HISTOIRE INVENTÉE DE LA SICILE ISLAMIQUE
50 Les échanges à ce sujet entre M. Amari et R. Dozy sont particulièrementsavoureux.
51 SMS, I, p. 49-50 : «Tra tanti rivolgimenti superficiali quattro conquistimutarono radicalmente il paese : che furono il greco, il romano, il musulmano e
fussent-elles originaires de l’ıle, de mieux connaıtre et comprendrela Sicile et elles font confluer ce double contexte de construction del’unite italienne et d’expansion coloniale.
Toutefois, en realite, ces donnees ne permettent pas veritable-ment a Michele Amari de repondre aux questions qu’il pose. Elleseclairent en partie les continuites que le savant pense percevoirentre son epoque et la domination islamique ainsi que les apports decette derniere, mais elles ne rendent pas compte des transforma-tions profondes qu’il lui attribue. Il a donc recours a une secondevoie, moins nouvelle dans ses methodes : celle de la philologie et dela constitution d’un corpus de textes tires des manuscrits orientauxconserves en Europe, qui ne contiennent pas seulement des textesgeographiques. Cette demarche s’inscrit dans une entreprise derecherche et d’edition plus vaste, a laquelle participe l’ensemble desorientalistes europeens50. Toutefois, ces sources ecrites, lacunaires,ne permettent pas non plus de traiter l’ensemble des questions rete-nues par Michele Amari et en particulier certaines de celles qui luitiennent le plus a cœur. Ses conceptions sur l’evolution de l’islam etde la Sicile prennent donc ici la releve.
Conceptions de l’histoire : entre Ibn H˘
aldun et la definition d’unprogramme politique pour la Sicile et l’Italie
Deux presupposes permettent a Michele Amari de se tirer de ladifficulte que constitue l’evaluation resolument positive qu’il fait del’apport de l’islam a l’histoire de la Sicile : une vision teleologique del’histoire, commune a l’epoque et que ses commentateurs ont dejamise en avant, d’une part, et une conception cyclique de l’histoireislamique qui, elle, n’a guere ete prise en compte jusqu’ici, d’autrepart. Ils lui permettent, en utilisant le silence des sources, deproposer une lecture de la domination islamique qui definit un veri-table programme pour la nation italienne et une conception essen-tiellement sociale de ce que doit etre son identite.
Une conception teleologique de l’histoire
Nous ne developperons pas ici la conception amarinienne quifait de la domination arabo-musulmane en Sicile une preparation ala domination normande51. Giuseppe Giarrizzo l’a bien exposee et
298 ANNLIESE NEF
il normanno, o meglio direbbesi italiano». À propos de la domination arabo-musulmane : «Ma nell’ottavo secolo dopo la nascita di Cristo, seguì il terzorinnovamento della Sicilia, per opera dei Musulmani, i quali avean tocco l’apicedi lor subita civiltà; e riforniron l’isola di colonie arabiche e berbere; vi portaronoaltra religione, leggi, costumi, lingua, letteratura, scienze, arti, industrie, virtùmilitare e genio d’independenza; in guisa da ritrarre, se non il raffinamento esplendore, al certo l’attività dei tempi greci. Breve del resto il dominio musul-mano, né arrivo a compiere la assimilazione degli abitanti che avea trovato nell’i-sola. Sfasciandosi da un canto la società musulmana in Sicilia come per ogniluogo...»; à la page suivante, l’auteur montre comment les Normands achèventce que les musulmans avaient commencé.
52 Carteggio, I, lettre CVIII à Anna Gargallo, p. 160. Paris, le 24 mai 1845 «Ioson persuaso, e credo poter dimostrare, non solamente che i Musulmani diSicilia si tennero per Siciliani, ma che essi ritemprarono la nazione corotta eavvilita dal dispotismo bizantino. Non credo che si possan mai paragonare agliInglesi gli Arabi, che conquistarono sì gran parte del mondo dal I al III secolo del-l’Egira. Il principato teocratico de’ Califfi valse a ben drizzare le invasioni deipastori d’Arabia, divenuti come per incantesimo una nazione, ma non a costruireun vasto impero politico. L’Africa, la Spagna, conquistate successivamente,disdissero ben tosto l’obbedienza ai Califfi. La diversità delle tribù dei conquista-tori accelerò questo precoce smembramento dalla madre patria. Il genio del-l’Islam, che, non meno del Cristianesimo, anzi forse più potentemente, rendeafratelli tutti i convertiti, fece che gli Arabi conquistatori s’immedesimassero dibuon ora con i Berberi in Africa, con gl’Indigeni in Ispagna e in Sicilia. Perciò daun lato sparve la distinzione nazionale tra vincitori e vinti; dall’altro lato la nazio-nalità presto vi nacque».
53 Cf. la lettre de M. Amari à A. Gargallo (Paris, 24 mai 1845), citée note 30.54 Pour ce qui est de l’autonomie municipale : «Scarsi quanto siano i ricordi
che si avanzan di cotesta parte di civile reggimento negli Stati musulmani delmedio evo, pur non cade in dubbio la esistenza dei corpi municipali. General-mente si appellavano gemâ‘, che suona adunanza [...]. Questo ordine, non isti-
les passages sur ce theme sont legion dans la Storia dei musulmanidi Sicilia : l’assimilation inachevee des Siciliens aux Arabo-musul-mans explique a la fois le sentiment retrouve d’un gout pour l’inde-pendance insulaire au sein de la population a partir du Xe siecle et laprogression des Normands au siecle suivant52.
Les consequences d’une telle conception teleologique de l’his-toire ne sont pas negligeables. Elle permet a Michele Amari desoutenir que les Siciliens ont mene certaines experiences avant lereste de la peninsule italienne. Retenons ici deux exemples : l’auto-nomie municipale et l’autonomie politique insulaire. En effet, si laplus grande partie de l’Italie a du attendre pour les connaıtre leXIe-XIIIe siecle, l’instabilite politique islamique a paradoxalementfavorise cette experimentation en Sicile. Michele Amari expose cetteidee sans fard dans sa correspondance personnelle53. D’une part, lajama‘a islamique, terme arabe qui designe toutes sortes de cercles etrassemblements, mais qui est utilise par Michele Amari avec le sensde «conseil tribal», permet a une autonomie de type municipal de sedevelopper en Sicile54; d’autre part, a l’image de l’ensemble des
299MICHELE AMARI OU L’HISTOIRE INVENTÉE DE LA SICILE ISLAMIQUE
tuito da legge scritta, era appunto novella forma del gran consiglio di tribù e dicircolo [...]. La obbligazione, sempre era collettiva, non individuale : dal cheognun vede essere stata la gemâ‘ corpo morale, e vero municipio. [...]. Cotestiordini dell’Affrica passarono senza dubbio nella colonia siciliana [...]» (SMS, II,p. 10-11).
55 Pour ce qui est de l’autonomie de fait de l’île, M. Amari décrit le verse-ment, au milieu du IXe siècle, de la meilleure part du butin à l’Ifrıqiya maisajoute : «Queste vane cerimonie avanzavano ormai della teocrazia musulmana sipotente e accentrata, né la Sicilia obbediva all’Affrica, più che questa alla ponti-fical sede di Bagdad!» (SMS, I, p. 255).
56 SMS, II, p. 158.57 Ce schéma repris par M. Amari, notamment à propos des conquêtes isla-
miques : «Ma le entrate che ne tornavano ai musulmani si scompartivano invarie guise, e sempre con inevitabile disuguaglianza; avvenendo che le terre preseor si dividissero, or si tenessero in demanio; e che il ritratto dei poderi demanialie le contribuzioni su le terre lasciate ai Cristiani si assegnassero ai corpi delgiund, in una maniera che variava dal mero pagamento di stipendio infino albeneficio militare. Or i corpi del giund, consorterie autonome, civili insieme e
regions de l’empire islamique et pour des raisons qui tiennent a lanature de la domination islamique, comme on le verra plus bas, laSicile a gagne peu a peu son autonomie pendant cette periode del’histoire de l’Islam55.
Une conception khaldunienne de l’histoire
Un presuppose amarinien qui paraıt plus neuf et dont l’absencedans les analyses qui sont menees sur les textes rediges par MicheleAmari tient a la meconnaissance par les specialistes de l’Ottocentoitalien et europeen de l’orientalisme de la meme periode, est laconception cyclique de l’histoire que developpe la Storia dei musul-mani di Sicilia56. L’auteur insiste a plusieurs reprises sur le fait que,partout dans l’empire islamique, existent des tensions entre l’egalita-risme des docteurs de la loi et le conservatisme des elites d’originearabe qui se mettent en place dans les pays conquis, tensions quidebouchent sur une anarchie qui ne nuit pas au developpement dela riche culture islamique, mais a celui d’un ordre public stable.Cette conception entraıne la construction d’un modele de deroule-ment cyclique de l’histoire islamique : une premiere periode, rela-tivement egalitaire, est suivie de la constitution d’elites nouvelles etde la mise en place d’une dynastie arabo-musulmane, qui entraıne ledeveloppement d’une culture et d’une prosperite indeniables, queviennent miner l’inegalite croissante et l’instabilite politique,lesquelles accelerent la fin de la dynastie en question, tandis qu’ungroupe nouveau emerge porteur de revendications egalitaires, quidonnera naissance a une nouvelle dynastie, etc57. Aux yeux deMichele Amari ce schema s’applique bien a la Sicile.
300 ANNLIESE NEF
militari, spiccandosi dalla capitale per andare ad abitar città o castella vicine aipoderi, diveniano al tutto stati nello stato, portavan seco tutti i vizii della feuda-lità; opprimeano la popolazione rurale; molestavano i vicini musulmani ocristiani; erano per ogni verso fomiti di turbolenze. Da un’altra mano, lo asegna-mento degli stipendii o beneficii e la divisione delle terre, per legge musulmana enatura stessa della cosa, davan luogo ad arbitrio e ingiustizia; onde si raccen-deano le antiche ire delle schiatte, delle tribù, delle famiglie; i Berberi si sentianolesi dagli Arabi, gli Arabi iemeniti dai Modhariti, questa parentella da quella; escorreva il sangue; si perpetuavano le nimistà; il governo della colonia divenivadifficil opra ognì dì più che l’altro. Tanto era avenuto in Affrica, in Ispagna, perogni provincia musulmana. Io lo scrivo sì francamente anco della Sicilia, perchéquegli elementi sociali portavano a quegli effetti, e ne veggiamo spuntare i segniqua e là negli annali siciliani dei tempi susseguenti» (SMS, I, p. 267).
58 Ibn H˘
aldun (1332-1406) est l’auteur d’une œuvre à la constructioncomplexe composée d’une Histoire Universelle (Kitâb al-‘Ibar), des Prolégomènes(al-Muqaddina), qui constituent l’introduction théorique de l’ensemble, et d’uneautobiographie. Pour l’articulation entre les trois, nous renvoyons à l’ouvrage citédans la note suivante
59 Pour une analyse détaillée du Kitab al-‘Ibar, on verra G. Martinez-Gros,Ibn Khaldûn et les sept vies de l’Islam, Paris, 2006.
60 W. Mc Guckin de Slane (trad.), Histoire des Berbères et des dynastiesmusulmanes de l’Afrique septentrionale par Ibn Khaldoun, Paris, 1852-1856.
61 Prolégomènes d’Ebn Khaldoun, éd. É.-M. Quatremère, Paris, 1858.
Inutile d’insister, on reconnaıt ici l’evolution de l’histoire dumonde islamique telle que l’a presentee Ibn H
˘aldun58. Prendre en
compte cette conception amarinienne permet de rendre raison de ceque Giuseppe Giarrizzo considere comme des nuances apportees ades modeles d’explications contemporains tels celui d’AugustinThierry. Il se trouve, en effet, que la construction khaldunienne59
n’est pas sans avoir quelques points de convergence avec les theoriesdu XIXe siecle, et notamment avec la reflexion autour de la dyna-mique vaincus/vainqueurs. Cette prise de position amarinienne nepeut surprendre dans la mesure ou le baron de Slane a traduit enfrancais des passages du Kitab al-‘Ibar d’Ibn H
˘aldun, a la demande
du ministere de la Guerre, entre 1844 et 185660, et ou Etienne-MarcQuatremere a edite la Muqaddima d’Ibn H
˘aldun, dans lequel celui-ci
theorise sa conception de l’histoire, en 185861. Or, a cette periode,Michele Amari evoluait a Paris dans le milieu des orientalistes fran-cais, forme en grande partie par Silvestre de Sacy. L’interet deMichele Amari ne pouvait manquer, en outre, d’avoir ete eveille parla publication par Adolphe Noel des Vergers de l’Histoire de l’Afriquesous la dynastie des Aghlabites et de la Sicile sous la dominationmusulmane a Paris en 1841. Cet ouvrage est, en effet, une edition ettraduction de passages du Kitab al-‘Ibar relatifs en partie a la Sicile.Enfin, le portrait que dresse Michele Amari d’Ibn H
˘aldun dans la
presentation des sources arabes qu’il fait au debut de la Biblioteca
301MICHELE AMARI OU L’HISTOIRE INVENTÉE DE LA SICILE ISLAMIQUE
62 «Che direm qui del più antico scrittore d’un trattato di Filosofia dellaStoria, propriamente detta, premesso ad una Storia Universale? Storia Univer-sale s’intenda sempre quella dell’orizzonte, che l’autore scopriva secondo lacultura del proprio tempo e paese. Da quel complesso di fatti, anzi dalle sfere piùvicine ch’ei vedea meglio, l’autore ritrasse le leggi dell’umanità. Ristrigendociall’umile ufizio di raccoglitore de’ testi istorici della Sicilia, diremo che IbnKhaldûn ci giova nè più nè meno degli altri compilatori, da’ quali non sidistingue per la critica de’ fatti particolari, ancorchè nei generali della storiamusulmana egli abbia spiccato sì alto, e spesso anco sicuro, il volo» (Bibliotecaarabo-sicula, I, Turin et Rome, 1880, Tavola de’ capitoli, cap. 50, rééd. Catane,1982, p. LVIII).
63 La question est effleurée par G. Giarrizzo dans son introduction à la SMS,p. XXXI-XXXII.
arabo-sicula, son magistral recueil de textes concernant la Sicile, nelaisse guere de doute sur l’admiration qu’il nourrissait pour cedernier62 : si le compilateur ne lui paraıt guere exceptionnel, lepenseur de l’histoire merite son eloge.
Ce cadre conceptuel fort permet a Michele Amari de presenter laperiode islamique comme le lieu d’une mutation radicale, d’une sorted’elan, meme si elle est mal documentee sur des points essentiels.
Forcer le silence des sources pour accentuer la rupture : ques-tion agraire et hierarchie sociale
Michele Amari privilegie une lecture tres sociale de l’evolutionhistorique sicilienne, sans doute influencee par les rates du traite-ment de la question agraire en Sicile au XIXe siecle, une dimensiontrop souvent negligee au profit de l’insertion de son ouvrage dans lecadre ideologique plus large de l’emergence de la question natio-nale63. Or, plus qu’une analyse, Michele Amari propose en realiteainsi un programme de transformation socio-economique de l’Italieet, en particulier de la Sicile qui presente des specificites de ce pointde vue. Un tel programme vise a transformer profondement l’iden-tite sicilienne et italienne. Dans ce cadre, l’epoque islamiqueconstitue en fait un horizon mythique qui permet de mettre en sceneune evolution souhaitee mais que le silence des sources concernantla Sicile islamique ne permet pas d’etablir historiquement.
Pour Michele Amari, les Arabo-musulmans apportent lesgermes d’une evolution que l’on peut qualifier de revolutionnaire etdont l’exemple, a la maniere des Vepres siciliennes, doit inspirer lescontemporains. Or, une telle position n’est tenable qu’en vertu deslacunes de la documentation. Elles vont permettre de placer la ques-tion agraire au cœur du positionnement amarinien, comme elleest au centre de ses preoccupations concernant la Sicile du
302 ANNLIESE NEF
64 Comme l’a bien rappelé L. Riall, dans son Sicily and the unification ofItaly, Oxford, 1998, notamment chap. 1.
65 Cf. notamment l’entrée h¯
araj de l’Encyclopédie de l’Islam, rédigée parC. Cahen.
66 Cf. SMS, II, p. 15 : la difficulté est résumée de la manière suivante : «Si ècorso il rischio di scambiare il diritto con lo abuso, la eccezione con la regola, laragion d’un paese con la ragione d’un altro, tanto più che la voce kharâj ha i variisignificati che accennammo».
67 En l’absence de sources se référant à cette question pour la Sicile, l’auteuraffirme : «Quanto a noi, ci basta saper le teorie ammesse da Mawerdi, un secoloe poco più, dopo il conquisto di Sicilia : e avremo compiuto il nostro debitodimostrandone coi fatti la osservanza, se non nella colonia siciliana, almeno intempi vicini e paesi analoghi», ibid.
68 «Così il conquisto musulmano guarì la piaga dei latifondi, la quale aveaconsumato la Sicilia fino al secolo nono, e riapparve con la dominazionecristiana nel duodecimo» (ibid., p. 18).
XIXe siecle64, et de deboucher sur une lecture tres orientee de l’his-toire de la periode islamique. Le veritable probleme de methode etde sources que pose l’histoire de cette domination est parfaitementexpose par Michele Amari, tres conscient de cette difficulte. Ilcommence par rappeler, en effet, que l’evolution de la fiscalite et dela repartition de la propriete fonciere (deux questions intimementliees puisque l’identite, notamment religieuse, du detenteur de laterre determine theoriquement la nature de la fiscalite qui pese surles terres en droit musulman65) est difficile a retracer au niveau del’empire islamique tout entier66, et plus particulierement en Sicile. Ilresout, ensuite, la question en s’appuyant sur des traites theoriques,qui supposent dans ce domaine une orthopraxie qui n’est qu’unepetition de principe, et sur une comparaison partielle avec desregions voisines67.
Notons que Michele Amari peut proceder avec une relativebonne foi dans la mesure ou son obsession rencontre aussi celle desjuristes musulmans qui ont abondamment disserte sur ce point ententant de donner une coherence a l’extreme variete des situations.Il y a, de ce point de vue, une convergence notable.
Il va donc, sur cette base, chancelante, postuler une evolutiondrastique de l’organisation agraire qui aurait permis de mettre fin ace qu’il appelle «la plaie du latifondo»68, un mal byzantin (en raisonde l’importance des terres de l’Eglise de Rome) et moderne. Elle estreduite essentiellement par deux types de mecanisme : la repartitiondes terres disponibles entre les conquerants et la division des terresen vertu des regles de l’heritage qui favorisent en islam un morcelle-ment de la propriete, meme si la pratique de l’iqt
˙a‘, concession de
revenus fiscaux leves sur la terre qui devient vite concessionfonciere, freine ce mouvement evalue positivement par l’auteur. Enoutre, avance Michele Amari, les vaincus ne sont pas depossedes de
303MICHELE AMARI OU L’HISTOIRE INVENTÉE DE LA SICILE ISLAMIQUE
69 Ibid., p. 13-14.70 Toutes proportions gardées, M. Amari utilise le passé islamique de l’île
comme les fascistes utiliseront l’histoire de Rome pour défendre leur politiqueagraire. Sur ce thème on verra le bel article d’A. Ingold, «Una storia di Romacontroluce» : l’avenir des modèles antiques dans les politiques agraires fascistes,dans G. Salmeri (éd.), Fascismo e antichità. Tra retorica e pratica, Pise, souspresse. Je remercie Alice Ingold de m’avoir communiqué son texte avantpublication.
71 H. Bresc, La «mala signoria» ou l’hypothèque sicilienne, dans L’Étatangevin : Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècle (Actes du colloqueinternational, Rome-Naples, 7-11 nov. 1995), Rome, 1998 (Collection de l’Écolefrançaise de Rome, 245), p. 577-599.
72 SMS, I, p. 87.73 SMS, I, p. 88 : «[...] società democratica e piena di fervore religioso. [...]
Fu democrazia sociale come oggi si direbbe, la quale forma ben rispondeva aiprincipii fondamentali dell’islamismo : uguaglianza e fratellanza».
leur terre dont ils jouissent en echange du versement aux conque-rants de ce qu’ils devaient auparavant sur leurs terres69.
La limite de la demonstration est claire : Michele Amari voit bienles grands domaines de la periode byzantine reapparaıtre sous lesNormands, mais cela ne lui met pas la puce a l’oreille. Cette paren-these islamique, propice au demantelement des grands domaines, abien existe pour lui, meme si elle n’est pas documentee, et il convientde s’en inspirer! De ce point de vue, donc, l’epoque islamiqueconstitue un horizon mythique qui permet a Michele Amari de penserle futur souhaitable de la Sicile, et donc de l’Italie, c’est-a-dire leuridentite, qui se definit pour lui plus socialement qu’«ethniquement»70.
Un certain nombre d’autres secteurs pourraient ainsi etreeclaires (celui de la fiscalite notamment) qui, au sein de la reflexionamarinienne, doivent s’opposer par leur evolution, qu’il retrace, al’idee repandue que rien n’a jamais change dans l’ıle, tandis que pourl’historien sicilien quelques dominations ont transforme les realitesinsulaires. L’islam a ainsi introduit un droit de propriete inalienableen Sicile et fait disparaıtre les grands domaines fonciers.
La position amarinienne s’articule, pour finir, a une reflexionsur la formation des elites et sur leur nature, domaines foncier dontle role est aussi important dans sa demonstration que ses hypo-theses sur la propriete fonciere.
Michele Amari ne cache pas une forte hostilite a l’egard de lanoblesse sicilienne contemporaine de son epoque. Sa lecture desVepres siciliennes reposait deja sur cette cle71. Or, pour MicheleAmari, l’opposition a la noblesse en place est consubstantielle al’essor de l’islam puisque Muh
˙ammad s’est oppose a la noblesse
mecquoise pendant sa predication72. Il definit donc la societe isla-mique comme «democratique»73, avant qu’elle ne subisse les conse-
304 ANNLIESE NEF
74 S.M.S., I, p. 267.75 «E vuolsi da noi studiare perché, conoscendo gli ordini delle tribù, si
speghieranno agevolmente le vicende della nazione arabica in tutti i tempi e intutti i luoghi. La tribù nomade o, come dicon essi, beduina, che suonerebbe apponoi campagnuola, è saldo corpo politico senz’altri legami che del sangue,senz’altra sanzione penale che la vergogna e il timore dell’altrui vendetta e rapa-cità. Quivi l’unità elementare della società non è l’individuo, ma sì la famiglia [...].Fuori della famiglia cominciano le associazioni : volontarie al tutto; se non chenecessariamente seguon anch’esse la parentela. Così varie famiglie fanno uncircolo [...], al quale è preposto un shaykh, o diremmo noi anziano [...]. È capofittizio della parentela : magistrato senza impero sopra i privati; senz’arbitrio nellecose comuni del circolo, nelle quali egli dee seguire il voto dei padri di famiglia[...]. Tale è la loro gerarchia, politica insieme e militare, che mal si distingue appo iBeduini [...]. Non è mestieri aggiungere qual divario corra tra le famiglie in puntodi ricchezza; consistendo questa in proprietà mobili, e di più mal difese contro gliuomini e peggio contro la natura [...]. Nondimeno sendo le armi in mano alle tribùlibere, la servitù non può allignare troppo tra i cittadini», SMS, I, p. 70-71.
76 Cf. G. Martinez-Gros, Ibn Khaldûn... cit., p. 55-60.77 Même si, ajoute M. Amari : «La forma di governo della tribù torna all’ari-
stocrazia ma larga; temperandola il nome comune, la familiarità patriarcale, ilbisogno continuo che i grandi hanno della gente minuta, la agevolezza disottrarsi a un governo troppo duro, la semplicità e la rozzezza dell’ordinamentosociale. Perciò di rado si vede degenerare in oligarchia, e quasi mai in princi-pato», SMS, I, p. 70-71.
quences de l’enrichissement general, generateur de hierarchisationsociale et d’une nouvelle noblesse. La cle du probleme reside, laencore, dans la repartition des terres et de leurs revenus74. Malgreces evolutions, que l’on retrouve dans toutes les societes, la societeislamique demeure fondamentalement travaillee par une tensiondemocratique, c’est-a-dire dans le langage de Michele Amari, egali-taire. La raison en est simple : son fondement est tribal et nomade75.
Notons d’ailleurs qu’en cela il demeure proche de l’analyse khal-dunienne dans laquelle les notions de bedouinite et de ‘as
˙abiyya, ou
solidarite de clan, jouent un role fondamental76. Cette forme rudi-mentaire de solidarite et le nomadisme qui s’oppose a la construc-tion et a la transmission d’un patrimoine foncier par les elitesexpliquent qu’aucune hierarchisation figee ne puisse veritablementse mettre en place dans un contexte islamique pour Michele Amari.La societe islamique est donc fondamentalement dynamique. Le lienavec Ibn H
˘aldun est ici clair puisque cette tension constante entre
construction d’une noblesse et aspiration egalitaire77, portee par desnomades a l’organisation tribale, est au cœur de l’evolution cycliquede l’histoire islamique telle que la concoit ce dernier, et MicheleAmari apres lui, comme on l’a vu.
Cette remise en cause reguliere des elites en place se declineregionalement. En Sicile, comme au Maghreb, quelques siecles
305MICHELE AMARI OU L’HISTOIRE INVENTÉE DE LA SICILE ISLAMIQUE
78 Le passage suivant est très significatif et il n’est pas inintéressant queM. Amari y cite le Général Daumas, confirmant si besoin en était que l’auteurconnaissait la littérature ethnographique contemporaine traitant de l’Algérie :«Arabi e Berberi dunque : ecco la profonda, insanabile divisione della coloniasiciliana. Tra gli uni e gli altri non era diviario di condizione legale. Mentre inAffrica molte tribù berbere pagavano tuttavia il kharâj [ce qui en fait l’équivalentde non-convertis] e rimanean prive degli stipendii militari, per essere state sotto-messe con la forza, in Sicilia le due genti, venute insieme a combatter la guerrasacra, vantavano uguale dritto ai premii della vittoria. Se non che, in fatto, gliemiri dell’esercito siciliano nascean di sangue arabico, al par che i principi aghla-biti; di sangue arabico o persiano i dottori, gli ottimati, la più gran parte dei cava-lieri del giund; né poteano smettere in Sicilia l’orgoglio e cupidigia da nobili; nédimenticare la maggioranza della schiatta loro in Affrica. I Berberi poi non sitenean da meno di loro : conscii del proprio numero, valore, dritti d’islamismo edritti di natura. Un moderno e sagace osservatore, il generale Daumas, notando ildiviario ch’è tra le istituzioni sociali degli Arabi e dei Berberi, e trattando partico-larmente dei Berberi della Kabilia Grande, come chiaman la regione tra Dellys,Aumale, Setif e Bugia, ben ha dipinto quella nazione col motto di «Svizzerasalvatica». Cantoni e villaggi, al dir suo, fanno unità politiche, rannodansi traloro per leghe più o meno durevoli : repubblichette democratiche, ove ognuno havoce in consiglio; i magistrati elettivi, di breve durata e poca autorità; case nobilipreposte sovente alle leghe, per ambito e riputazione, non per dritto [...]», SMS,II, p. 26-27.
79 Nous renvoyons ici au chapitre 1 du livre V de la SMS.
apres la naissance de l’islam, les manifestations de mauvaisehumeur contre les elites prennent la forme d’une opposition entreBerberes «democratiques» (et ruraux) et «nobles» arabes (et cita-dins)78. Differentes figures de la noblesse sont identifiees et criti-quees dans la Sicile islamique, point que l’on ne developpera pas ici.Toutefois, elles sont caracterisees par leur instabilite benefique.L’islam permet en effet une recomposition permanente des elitesqui, a defaut d’etre socialement acceptables, autorisent l’indepen-dance insulaire et l’italianisation de la Sicile.
Dans ce schema, le role des Normands devrait etre egalementrepense : ils sont ceux qui autorisent a mettre un point final al’evolution cyclique repetitive de l’episode islamique de l’histoiresicilienne, mais ils le font en raison de caracteristiques qui nesont pas sans rappeler celles des bedouins arabes. Eminemmentmobiles, pratiquant un egalitarisme de bon aloi puisque qu’ilsforment en Italie meridionale des groupes de combattants quise partagent le butin de leurs rapines79, ils l’emportent surles Arabo-musulmans de Sicile. Toutefois, ils sauront aussiconstruire un Etat en tirant profit de l’apport de ces derniers. Cefaisant, ils introduisent egalement la plaie de la noblesse enSicile. La lecture de Michele Amari est la encore eminemmentkhaldunienne.
306 ANNLIESE NEF
80 Ces grandes lignes ont été définies dans l’article cité à la note 80.
Conclusions
Michele Amari propose donc dans son grand-œuvre une analyserelativement complexe et nuancee, en s’appuyant sur des partis prismethodologiques et ideologiques varies qui interdisent de se servirde son texte come d’un vade mecum sur la Sicile islamique etnormande. L’episode islamique est concu comme un moment defermentation et de democratisation qui porte a l’autonomie insu-laire et cet heritage constitue grande part de l’apport sicilien a laconstruction de la nation italienne aux yeux de Michele Amari. Cetteoptique, pour enthousiasmante qu’elle soit, s’inscrit dans unprogramme politique pense il y a plus d’un siecle. Elle ne peut etrecelle des chercheurs actuels. Elle induit des distorsions dans lalecture des sources notamment pour ce qui concerne l’evolutionagraire et fonciere mais aussi l’opposition entre Berberes et Arabes,omnipresente pour Michele Amari, qui y lit une tension sociale,alors que les textes ne permettent pas de l’affirmer.
Il apparaıt donc urgent de relire soigneusement le grand textepolitique qu’est la Storia dei Musulmani di Sicilia et de ne plus secontenter d’en extraire idees et donnees sorties de leur contexte deredaction. C’est ainsi, en effet, que sont vehicules des topoi sur l’his-toire islamique, et sur l’histoire de la Sicile plus generalement, parti-culierement difficiles a deraciner, dans la mesure ou les historiens ameme de se reporter aux sources arabes sont peu nombreux. Cetravail est un prealable necessaire a la definition de l’indispensableprogramme de recherches sur la Sicile islamique qu’il convientd’articuler aujourd’hui80.
En outre, ce n’est qu’en se penchant a nouveau sur la Storia deiMusulmani di Sicilia, que l’on pourra donner enfin a Michele Amarisa veritable dimension et toute son originalite, au lieu d’en faire unersatz d’autres historiens europeens qui furent ses contemporains.
Annliese NEF
Universite Paris 4