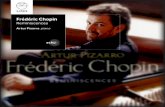« Liban : le mouvement « pour la chute du système confessionnel » et ses limites », in Michel...
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of « Liban : le mouvement « pour la chute du système confessionnel » et ses limites », in Michel...
chapitre 10
Liban : le mouvement pour
« la chute du système confessionnel »
et ses limites
Marie-Noëlle AbiYaghi et Myriam Catusse
Le 20 mars 2011, plusieurs milliers de manifestants marchaient à Beyrouth de la place Sassine (Beyrouth-Ouest) à Sanayeh devant le ministère de l’Intérieur (Beyrouth-Est) pour réclamer l’abolition du système confessionnel qui orga-nise le régime consociatif libanais depuis l’indépendance du pays en 1943. Ils scandaient : « Le peuple veut la chute du régime confessionnel » (al-cha‘ab yurîd isqât al-nizâm al-tâ’ifî), en écho au slogan emblématique des soulèvements populaires tunisien et égyptien (al-cha‘ab yurîd isqât al-nizâm : le peuple veut la chute du régime), « Le confessionnalisme est l’opium des masses » ou « Révolution, révolution contre le confessionnalisme ». Cette manifestation fut le point culminant d’un mouvement né en février 2011, avec des marches et des sit-in dans la capitale libanaise et dans les villes de Jbeil, Tripoli, Saïda, Nabatiyeh et Tyr. Selon les organisateurs, plus de 3 000 personnes sont des-cendues dans la rue lors de la première manifestation, le 27 février 2011 ; ils étaient 10 000 le 6 mars, et 25 000 ce 20 mars. Derrière un étendard commun en appelant « au peuple », le mouvement n’a pas pris néanmoins la même ampleur que les soulèvements dans les pays voisins, ni même que les grands rassemblements populaires pour « l’indépendance » (intifâdat al-istiqlâl)1 qui
1. En 2005, à la suite de l’assassinat de l’ancien premier ministre Ra+k al-Hariri, des mobilisations de masse s’organisent autour de la problématique de la souveraineté du pays : le « Soulèvement de l’indépendance », contre l’emprise syrienne dans le pays, conduit au retrait des troupes du régime baasiste du Liban. Il donne son nom à la
Liba n : le mou v emen t « l a chute du système con fession n el » • 251
avaient réuni dans les rues des centaines de milliers de personnes en 2005, le sit-in qui bloqua le centre-ville de Beyrouth de décembre 2006 à mai 2008 ou encore les aMrontements armés qui secouèrent le pays en mai 2008. Rapidement ce mouvement se divisa et s’essouPa, tandis que le pays devenait le théâtre de mouvements paci+ques ou de mobilisations armées pour ou contre le régime syrien, lui-même en proie à une contestation majeure.
Les manifestants libanais font référence aux soulèvements tunisien et égyptien, yéménite ou bahreïni : le mouvement pour la chute du régime confessionnel s’est animé grâce au souPe suscité par ces protestations, qu’il imite d’ailleurs sur certains points. La vie politique libanaise tout entière est du reste régulièrement décrite comme particulièrement poreuse aux soubre-sauts qui agitent la région : présence de l’OLP jusqu’en 1982 et camps de réfugiés palestiniens, occupations syrienne et israélienne jusqu’aux années 2000, parrainage des diMérents groupes politiques par la Syrie, l’Iran, l’Arabie saoudite, les États-Unis ou la France, ont contribué à brosser l’image trom-peuse d’un jeu politique totalement extraverti. Néanmoins, de la même façon que les autres soulèvements de 2011, la campagne Isqât al-nizâm al-tâ’ifî (pour) la chute du régime confessionnel n’est ni le fait d’un activisme trans-national qui jouerait d’un eMet boomerang pour importer la révolution, ni même le fruit d’un eMet domino à strictement parler. Elle est avant tout enracinée dans une cause et une histoire militante locales. Chercher les causes déterminantes à l’origine des soulèvements, enquêter sur les raisons de leurs « échecs », pourrait céder facilement au piège d’explications ex post et méca-nistes qui ne rendent compte ni du caractère éminemment conjoncturel des processus de soulèvement, ni même des interprétations contradictoires dont ils peuvent être l’objet. Nous n’expliquerons pas les di[cultés à mobiliser le « peuple » libanais contre les logiques confessionnelles et monopolistiques du régime par une quelconque « magie » structurelle de celui-ci, qui l’immuni-serait contre la « contamination » d’une vague de fond qui traverserait les sociétés de la région. Ce qui nous a plutôt intéressées est la façon dont l’his-toire des protestations libanaises récentes a pu entraver l’appel au peuple du mouvement Isqât al-nizâm al-tâ’ifî, en expliquer les logiques et l’insuccès relatif.
Deux ans plus tard, les protagonistes du mouvement déplorent en eMet leur échec. Relativement peu rassembleur malgré les quelques succès des premières manifestations, sans résultats remarquables à leurs yeux, et délaissé
« Coalition du 14 mars » tandis que la « Coalition du 8 mars » est issue des mobilisations qui au même moment dénoncèrent l’ingérence américaine et occidentale dans le pays.
252 • Sou lèv emen ts et r ecompositions politiqu es
au pro+t d’autres formes d’actions collectives autrement plus mobilisatrices sur les plans local et régional, ce mouvement n’a pas eu l’eMet d’essaimage qu’ils en espéraient. Pourtant, s’y plonger montre tout l’intérêt qu’il peut y avoir à examiner les continuités discrètes et, sinon occultées, du moins peu évidentes entre diMérents espaces de mobilisation. Loin de surgir ex nihilo et de disparaître corps et âme, le mouvement Isqât al-nizâm al-tâ’ifî apparaît, au contraire, comme un exemple parlant de renouvellement récurrent et multiforme d’une contestation par des minorités actives. C’est aussi l’illus-tration du cantonnement d’une protestation non pas par la prohibition des prises de parole, mais au contraire par la di[culté de faire entendre sa voix dans un concert de mobilisations. Les di[cultés qu’il y a à s’aMranchir de l’action entre pairs pour s’adresser au « peuple » et le convaincre s’expliquent en grande partie par des routines militantes et par les concurrences multiples et institutionnalisées qui jouent dans l’espace des mobilisations au Liban. Ces dernières euphémisent la portée « révolutionnaire » de la cause et elles s’immiscent jusque dans les dynamiques internes du mouvement.
Dans un premier temps, nous questionnerons la part d’in{uence des mobilisations « ailleurs » sur la genèse et les destinées du mouvement Isqât al-nizâm al-tâ’ifî, pour dans un second temps comprendre comment il s’est inscrit dans un espace de protestation balisé et concurrentiel au Liban : dans un contexte où les mobilisations de rue et les interpellations publiques sont nombreuses et ordinaires, les échos de « l’appel au peuple » se trouvent assourdis. Dans un troisième temps, nous nous pencherons sur les logiques internes du mouvement : freiné dans sa capacité à s’étendre à diMérents seg-ments sociaux, le mouvement a vu s’exacerber les divisions internes entre ses militants.
Les effets déclencheurs et inhibiteurs des révolutions voisines
Les récits recueillis sur la genèse du mouvement racontent comment celui-ci a germé essentiellement à Beyrouth autour de trois types et lieux d’action principalement : la discussion et la mobilisation sur les réseaux sociaux, l’orga-nisation de manifestations, comme ailleurs dans la région ; mais aussi la tenue de nombreuses réunions de concertation ou assemblées générales dans des locaux associatifs, voire dans des salles publiques de la capitale, telles que le Masrah al-Madina, littéralement le « }éâtre de la Ville », un espace culturel géré de façon alternative. C’est sous une pluie battante dans les rues de Beyrouth que prend corps la première marche publique le 27 février 2011, la « manifestation des parapluies » (muzâharat al-chamâsi). Un appel a été lancé
Liba n : le mou v emen t « l a chute du système con fession n el » • 253
sur le réseau social Facebook pour marcher contre le régime confessionnel. Le cortège s’ébranle depuis la banlieue chiite de l’agglomération (Mar Mikhayel) jusqu’au palais de justice (‘Adliyeh), situé à un point clé de la principale ligne de démarcation au temps de la guerre civile. Si l’origine même de l’appel est l’objet de chroniques parfois divergentes, la plupart de nos interlocuteurs s’entendent pour en situer les prémices dans quelques initiatives antérieures.
Les antécédents libanais du mouvement
Ils en imputent la genèse à l’organisation, chaque année depuis 2009, par quelques artistes et étudiants trentenaires d’une « Laïque Pride » (ou masîrat al-‘almâniyîn), une marche festive dans les rues de Beyrouth pour « dénoncer » le système confessionnel libanais et demander l’établissement d’un état-civil laïque. Réunissant quelques milliers de personnes lors de ses deux premières éditions (quelques centaines seulement en 2012), cette initiative, qui a sa page Facebook, réactualise sans vraiment y faire référence une cause défendue à plusieurs reprises dans des arènes diMérentes : celle de l’abrogation du confes-sionnalisme politique, mais aussi de l’institution d’un statut personnel civil et plus largement de droits civils. En eMet, depuis l’adoption de la première Constitution libanaise en 1926, la fonction publique et la représentation politique sont régies par des règles de répartition communautaire selon les principes d’une démocratie de consensus2, tandis que les statuts personnels sont gérés par les tribunaux religieux. Tout au long du xxe siècle, plusieurs partis politiques et groupes parlementaires ont prôné l’abolition de ce sys-tème, notamment les puissantes organisations de gauche et nationalistes arabes à la veille de la guerre civile (1975-1990)3. Au lendemain du con{it, cette problématique est remise au goût du jour alors que se mettent en place les piliers de la Troisième République : bien que la Constitution de 1990 orga-nise formellement un « État des communautés », son article 95 est consacré à « l’abolition du confessionnalisme ». Plusieurs des plus hauts responsables de l’État se font les promoteurs de ce dernier projet, à l’instar du président de la République Élias Hraoui. Il manifeste au cours de son mandat (1989-1998) sa volonté d’instaurer une possibilité facultative de mariage civil, suscitant par exemple en 1997 et 1998 de violentes protestations de la part de
2. Les grandes fonctions de l’État sont réparties entre les diMérentes communautés reconnues o[ciellement (18 en 2013).
3. Karam, Karam, Le mouvement civil au Liban. Revendications, protestations et mobilisations associatives dans l’après-guerre, Paris, Karthala, 2006, p. 183.
254 • Sou lèv emen ts et r ecompositions politiqu es
toutes les autorités religieuses confondues. C’est aussi la posture qu’adopte le président du Parlement depuis 1992, Nabih Berry, chef du parti Amal, qui proclame régulièrement son attachement à la déconfessionnalisation poli-tique du système. Pourtant, son parti, l’une des puissantes milices de la guerre, est un exemple emblématique des organisations partisanes commu-nautaires (ici chiites) et patronales du pays. Son discours directement inspiré du « Mouvement des déshérités » (harakat al-mahrumîn) de l’imam Musa al-Sadr4 au milieu des années 1970 se nourrit du thème de la marginalisation des populations chiites par rapport au système politique, économique et social libanais. La critique du confessionnalisme politique – principalement l’annu-lation de la représentation par quotas confessionnels au Parlement – par ce parti s’explique, comme c’est le cas pour le Hezbollah, dans une grande mesure par l’importance démographique que prennent les Chiites dans le pays, un avantage de poids dans l’hypothèse de l’adoption d’un système de représentation majoritaire et non plus communautaire. C’est là une position taxée d’opportunisme par ses détracteurs, dont les militants de la gauche radicale d’Isqât al-nizâm qui prônent pour leur part une « déconfessionna-lisation tout court (…) qui sépare le religieux du séculier à tous les niveaux du politique mais aussi dans les mœurs et les têtes des gens » (Bassem C., Forum socialiste. Entretien avec les auteures, 6 mai 2013). À la même époque, dans d’autres milieux militants, la cause de l’anticommunautarisme prend une dimension centrale : étudiants et militants des droits de l’homme orga-nisent au début des années 1990 une campagne nationale pour le soutien à un nouveau projet de loi sur le mariage civil. Au tournant des années 2000, une cinquantaine d’associations, de partis politiques et les représentants de groupes d’étudiants participent ainsi au « Rassemblement pour une loi civile facultative des statuts personnels » (souvent appelé Rassemblement pour le mariage civil, Liqâ’ al-zawâj al-madanî). Journalistes, avocats, universitaires, étudiants et autres partisans de la cause animent des réunions périodiques, des pétitions, des campagnes d’information, un sit-in devant le Conseil des ministres et le Parlement et +nalement font présenter par 10 députés une proposition de loi au Parlement en mars 20025. Certains d’entre eux intentent des procès contre l’État a+n de protester contre la mention des confessions sur les cartes d’identité. Pourtant, plus de vingt ans après la signature de l’accord de Taëf (22 octobre 1989) qui devait mettre +n au con{it civil et
4. Ce clerc chiite iranien d’origine libanaise fut l’un des artisans de la politisation de la communauté chiite libanaise dans les années 1960 et 1970.
5. Karam, Karam, Le mouvement civil au Liban, op. cit.
Liba n : le mou v emen t « l a chute du système con fession n el » • 255
prévoyait la décommunautarisation de la vie politique, la société politique se reconfessionnalise de façon remarquable autour du renouvellement des lea-derships partisans, communautaires et patronaux. La proposition de loi n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour parlementaire et le Rassemblement s’est éteint. Quant aux initiateurs de la Laïque Pride et d’Isqât al-nizâm al-tâi’fî, ils montrent peu d’intérêt pour ces expériences antérieures.
Beaucoup des récits de la naissance du mouvement Isqât al-nizâm al-tâ’ifî évoquent aussi le rôle qu’a pu jouer en amont, tant dans le cadrage de la mobilisation qu’en termes de recrutement de militants et de sympathisants, le réseau du « Rassemblement laïque » (al-liqâa al-‘almânî). Il s’agit d’une structure informelle qui s’organise à partir de 2009-2010 sous l’impulsion de groupes et partis de gauche et d’associations « civiles » (non communautaires) pour débattre du principe de séparation du politique et du religieux et le défendre. Le travail du Rassemblement est avant tout intellectuel et doctrinal. Dans les bulletins qu’ils éditent sur papier (Lubnân ‘almâni, « Liban laïque »), ces hommes et ces femmes discutent de la nature du système confessionnel libanais et de ses alternatives. La parenté avec les mouvements révolution-naires de la gauche nationaliste arabe d’avant-guerre est patente. Les modes d’action sont encore bien éloignés du recours par les protestataires de 2011 aux réseaux sociaux et autres outils introduits par l’essor de l’industrie des loisirs et de la communication. Se rassemblent dans ce collectif les membres d’organisations politiques de gauche ou laïques, aux bases sociales congrues (rarement plus d’une centaine de militants dans le pays), mais à l’histoire militante ancienne, souvent antérieure à la guerre civile, avec un fort capital doctrinal et de socialisation politique : le Forum socialiste (al-muntada al-ichtirâkî, trotskiste), l’Union des jeunes démocrates libanais (UJDL, ittihâd al-chabâb al-dimuqrâtî al-lubnânî, communiste), le Rassemblement démo-cratique laïque (al-tajamu‘ al-dimuqrâtî al-‘almânî, fondé par d’anciens militants de l’Organisation de l’action communiste au Liban, OACL), le Secular Club de l’Université américaine de Beyrouth. À ceux-là s’associent les initiateurs de la « Laïque Pride » et des associations telles que le Courant de la société civile (tayâr al-mujtama‘ al-madanî), une association fondée, au début des années 2000, par l’archevêque grec catholique Grégoire Haddad6.
6. Grégoire Haddad, évêque grec catholique de Beyrouth et de Jbeil de 1968 à 1974, surnommé le « prêtre rouge », s’est engagé dans le travail social et la laïcisation du sys-tème politique libanais. Cofondateur avec l’imam Musa al-Sadr du « Mouvement des déshérités », il est du combat pour le mariage civil dans les années 1990 et fonde le Courant de la société civile.
256 • Sou lèv emen ts et r ecompositions politiqu es
Le rôle de cette dernière association dans Isqât al-nizâm al-tâ’ifî s’est avéré déterminant. Non seulement ses cadres ont été parmi les leaders du mouvement, mais encore ils ont ouvert leurs locaux à la première grande réunion publique qui a précédé la manifestation du 27 février et à nombre de rencontres suivantes. S’y retrouvent une centaine de « néophytes » en politique, mais aussi les militants de ces organisations engagées depuis plusieurs mois autour de la problématique de la déconfessionnalisation du système. D’autres collectifs s’y ajoutent rapidement : Helem, mouvement LGBT (Lesbiennes, gays, bi et transsexuels), et Nasawiya, un collectif féministe qui en est issu. Un peu plus tardivement les rejoindront des partis politiques « laïques » (c’est-à-dire non confessionnels), tels que le Parti communiste libanais (PCL), le Mouvement du peuple, le Baas irakien, et le Parti social nationaliste syrien.
Le mouvement Isqât al-nizâm al-tâ’ifî s’enracine donc dans des initia-tives antérieures très « libanaises » car concentrées sur la question du confes-sionnalisme qui organise et singularise le régime dans la région. Il a néanmoins aussi indéniablement bénéficié d’un effet de conjoncture. D’ailleurs, beaucoup de ses militants actifs ont participé, entre janvier 2011 et la destitution de Hosni Moubarak, à des sit-in devant l’ambassade d’Égypte à Beyrouth pour soutenir la révolution (chaque jour pour certains d’entre eux – Adham E. S., PCL. Entretien avec les auteures, 9 mai 2013). L’eMet de démonstration suscité par les soulèvements tunisien et égyptien surtout, mais aussi, un peu plus tard, par le début de la révolte syrienne, se manifeste à plusieurs niveaux : tant en termes de moment choisi que de cadrage de la protestation, de modes d’action, voire de phénomène générationnel. Comme ailleurs, les protestataires déclinent le slogan al-cha‘ab yurîd isqât al-nizâm – mais y ajoutent l’épithète « confessionnel » (al-nizâm « al-tâ’ifî ») : c’est moins la chute d’un autocrate symbolisant le « système » que demandent les protestataires libanais que l’abolition du « confessionnalisme », avec, comme nous le verrons, des divergences sur ce qu’il faut entendre par là.
En ce sens, le mouvement n’inaugure pas vraiment un nouveau cycle de protestation, impulsé comme par diMusion à partir des soulèvements dans les pays voisins. Si le mouvement égyptien en particulier a joué un rôle de déclencheur, le passage à l’acte pour la plupart des militants que nous avons questionnés s’explique davantage par des raisons ancrées dans leurs expé-riences politiques antérieures. C’est à la fois le cas des nouveaux venus dans l’engagement contestataire pour qui c’est l’occasion de passer de la résistance silencieuse à la dissidence ouverte, et celui des militants plus aguerris qui entrevoient en 2011 l’opportunité d’élargir leur protestation, de faire entendre la cause pour laquelle ils se battent depuis plusieurs années, voire décennies,
Liba n : le mou v emen t « l a chute du système con fession n el » • 257
et de rallier de nouvelles troupes à leur projet : la révolution pour certains, mais aussi l’adoption d’une loi pour le mariage civil ou la réforme de la loi électorale qui ancre le communautarisme au cœur de la représentation poli-tique pour les autres.
S’ils n’y font quasiment pas référence, les leaders, les militants et les sympathisants du mouvement Isqât al-nizâm al-tâ’ifî jouent donc d’héritages paradoxaux : certains acteurs ou groupes (notamment le PCL ou encore des acteurs d’Helem) faisaient partie des mouvements « civils » des années 1990, mais le mouvement de 2011 semble amnésique à l’égard de ces expériences antérieures, comme pour en conjurer les échecs. Le « pouvoir de l’exemple » joue +nalement de manière synchronique, à travers les déclinaisons au Liban des slogans tunisiens ou égyptiens, comme s’il s’agissait de faire partie de ce moment révolutionnaire ; mais peu en termes diachroniques, les racines et rémanences plus évidentes étant peu manifestes pour les militants, voire explicitement mises à distance. « Les mouvements des années 1990 n’ont pas su durer ; où sont-ils aujourd’hui ? Ils se sont vendus aux bailleurs de fonds internationaux », nous dit Bassem C. du Forum socialiste.
Les géographies locales, régionales et transnationales
des mobilisations libanaises
Pourtant, si les soulèvements arabes font l’objet d’analyses internationalistes au Liban, en particulier en termes de théorie du complot de la part des alliés du régime syrien, Isqât al-nizâm al-tâ’ifî s’avère comparativement peu relié à des réseaux de personnes ou de moyens transnationaux, sinon en matière de références et de cadrage de l’action.
L’histoire politique moderne du pays regorge, en eMet, d’exemples de mobilisations nourries à l’international ou qui dépassent les frontières du pays, à tel point que, par exemple, certains ont pu, trop rapidement, quali+er le con{it civil de « guerre pour les autres7 », en référence aux multiples enjeux et interventions régionales dans le pays : la Palestine, avec l’aPux de réfugiés, le soutien de la résistance par la gauche libanaise et la présence de l’OLP au Liban ; l’alliance de milices chrétiennes avec l’État israélien ; les interventions armées et occupations syriennes (1976-2005) et israéliennes (1982-2000), appuyées ou combattues tour à tour par les diMérentes milices du pays ; sans compter le rôle des grandes puissances, dont la guerre froide se joua entre autres par le truchement des milices libanaises. L’après-guerre n’échappe pas
7. Tuéni, Ghassan, Une guerre pour les autres, Paris, Lattès, 1985.
258 • Sou lèv emen ts et r ecompositions politiqu es
non plus à cela ; c’est sous une forme de « protectorat syrien » que se réorganise la société jusqu’au départ des troupes du régime de Bachar al-Assad en 2005. La ligne de fracture régionale opposant l’Arabie saoudite et l’Iran sur fond d’exacerbation du clivage communautaire entre Chiites et Sunnites, traverse aujourd’hui l’ensemble de la société libanaise. Chaque formation politique, y compris locale, revendique un parrainage étranger. C’est d’ailleurs en termes de solidarités internationales que sont décrites souvent les formations et coalitions politiques actuelles : le camp du « 8 mars », quali+é selon la pers-pective de « pro-syrien » ou de résistant à la Pax americana et à la normalisa-tion des relations avec Israël ; le camp du « 14 mars » qui ne fait pas secret de ses liens avec les États-Unis, la France ou l’Arabie saoudite et se présente comme « anti-syrien ». Le puissant parti du Hezbollah mobilise tant des élec-teurs que des manifestants ou des combattants sur un agenda à la fois libanais et international. Entretenant une « entente cordiale8 » avec le régime chiite iranien, il participe à « l’exportation » de la révolution islamiste et entretient des relations avec les mondes chiites ; il revendique également le monopole de la résistance face à Israël au sud du pays et, depuis 2012, son soutien à l’armée syrienne face aux insurgés. Quant aux organisations sala+stes qui se sont développées dans le pays à partir des années 1980, elles s’activent elles aussi par-delà les frontières, de façon peu visible jusqu’à des combats meurtriers dans un camp palestinien au nord de Tripoli en 2008, et désormais de façon plus manifeste avec l’émergence spectaculaire du cheikh Ahmad al-Asîr à la faveur de la révolution syrienne dans un quartier de Saïda. D’autres mobili-sations récentes démultiplient ces exemples d’émulations internationales, à l’instar du développement d’un mouvement altermondialiste dans les années 20009. En somme, jusqu’aux enjeux électoraux les plus locaux, les logiques de mobilisation au Liban se nourrissent régulièrement de références, mais aussi de ressources puisées à l’international, dont des +nancements, voire la four-niture d’armes. Cette extraversion n’enlève rien à leur ancrage local.
Dans ce contexte sensible aux mobilisations régionales, si le mouvement Isqât al-nizâm al-tâ’ifî a lui-même été in{uencé par les révolutions tunisienne et égyptienne, la révolution syrienne l’a momentanément vivi+é puis très rapidement inhibé et étouMé. L’émulation cède le pas à de nouvelles préoc-
8. Mervin, Sabrina, « Le lien iranien », dans Sabrina Mervin (dir.), Le Hezbollah. État des lieux, Paris, Actes Sud, 2010, p. 75-87.
9. AbiYaghi, Marie-Noëlle, L’altermondialisme au Liban : un militantisme de pas-sage. Logiques d’engagement et reconfiguration de l’espace militant (de gauche) au Liban, Doctorat de science politique, Université de Paris1-La Sorbonne, 2013.
Liba n : le mou v emen t « l a chute du système con fession n el » • 259
cupations. L’imminence des traductions au Liban de la crise syrienne déplace l’attention sociale et politique, y compris de ces militants, sur d’autres enjeux. Le mouvement perd d’emblée les quelques bataillons qu’ont pu lui apporter ponctuellement, lors des premières manifestations, certains partis comme le mouvement Amal ou le Parti social nationaliste syrien, liés directement ou indirectement au régime baasiste. Parmi les militants d’Isqât al-nizâm, cer-tains pointent le risque de soutenir toutes ces révoltes confondues : « Bien sûr qu’en Tunisie et en Égypte, la tête du président est tombée, et la voie de la révolution est ouverte. Mais en Libye, au Yémen ou en Syrie, ce ne sont pas vraiment des révolutions. Plutôt un soulèvement [intifâda], qui ouvre la voie aux islamistes ou aux étrangers » (Rachid Z., Rassemblement démocratique laïque. Entretien avec les auteures, le 7 mai 2013). Surtout, malgré l’a[rmation sur la scène diplomatique internationale d’une doctrine dite de « dissocia-tion » vis-à-vis du régime syrien, censée éviter aux dires de ses défenseurs que le Liban ne soit le théâtre d’une nouvelle « guerre pour les autres », la société libanaise est de plus en plus bousculée par les guerres qui se mènent en Syrie. L’intensi+cation du con{it syrien se traduit par la radicalisation au Liban des clivages entre groupes politiques soutiens ou pourfendeurs du régime baasiste. Elle rend plus manifestes les blocages politiques du régime et durcit la communautarisation des positions. Dans ce contexte, le mouve-ment pour l’abolition du confessionnalisme cède le pas devant les mobilisa-tions partisanes et confessionnelles pour ou contre le régime syrien.
Une mobilisation parmi les autres
La participation au mouvement Isqât al-nizâm al-tâi’fî est en conséquence à la fois in{uencée indirectement par les révoltes contemporaines voisines et inscrite dans une histoire politique locale. En l’occurrence, la faible dimen-sion révolutionnaire du mouvement s’explique moins par les contraintes structurelles du régime et par les eMets directs de la répression que par les con+gurations des arènes de la protestation. D’une part, l’expression de mécontentements publics est régulière, d’autre part, les concurrents politiques du mouvement sont organisés, mobilisateurs et présents sur les mêmes scènes publiques.
À la diMérence de ce que l’on observe au même moment dans d’autres pays ou au Liban à d’autres époques, la contestation en 2011 ne fait pas l’objet d’une répression mais reste plutôt contenue dans des relations paci+ées avec les forces de l’ordre. Les pouvoirs publics ne déploient pas d’arsenal sécuritaire remarquable par rapport à ces manifestants qui, dans les rues ou sur les
260 • Sou lèv emen ts et r ecompositions politiqu es
réseaux sociaux, appellent pourtant à l’abolition de piliers fondamentaux du système. Si l’on souligne parfois que la répression peut être un inhibiteur de la prise de parole ou à l’opposé, dans d’autres contextes, un stimulant pour les mobilisations, ici le peu de coercition exercé à l’encontre du mouvement dénote plutôt la façon dont celui-ci, quoique exceptionnel à bien des égards, s’inscrit dans des formes relativement routinisées de la vie politique libanaise. C’est là certainement l’un des points de divergence majeurs entre le dévelop-pement des révoltes voisines et le mouvement Isqât al-nizâm al-tâi’fî au Liban, et peut-être un point de convergence avec le Mouvement du 20 février au Maroc, qui s’inscrit lui aussi dans une histoire récente et balisée autant que banalisée des mobilisations où « la contestation apparait calibrée par l’inte-raction avec les agences du régime et par l’état du champ politique10 ».
Routinisation de la protestation et dissidence
La surprise qu’ont pu constituer en tant que tels les soulèvements voisins dans des contextes où le dissensus politique pouvait paraître étouMé par la répression ou d’autres formes de disciplinarisation de la société, n’a pas la même portée au Liban. À bien des égards, le mouvement Isqât al-nizâm al-tâi’fî n’introduit pas vraiment de rupture dans l’ordre des choses. D’ailleurs, des voix se font entendre au cours de l’hiver 2011 pour faire endosser la « maternité » du « printemps arabe » au « soulèvement pour l’indépendance » (intifâdat al-istiqlâl) libanais de 200511, qui a conduit au départ des troupes syriennes du pays. En somme, comme on a pu l’entendre également en Algérie à propos des soulèvements de 1988-1989, une révolution aurait déjà eu lieu : tant sur le plan politique qu’en termes d’expériences militantes. Le retrait des troupes syriennes fut suivi d’une polarisation du champ partisan opposant de larges coalitions inédites, celles du « 8 mars »et du « 14 mars »12.
10. Vairel, Frédéric, « L’opposition en situation autoritaire : statut et modes d’action », dans Olivier Dabène et al. (dir.), Autoritarismes démocratiques et démocraties autoritaires au e siècle. Convergences Nord-Sud ?, Paris, La Découverte, 2008, p. 214.
11. Najjar, Alexandre, « Le “printemps arabe” est né à Beyrouth », Le Monde, 26 juin 2011.
12. Depuis l’assassinat de Ra+k al-Hariri en février 2005, le champ politique liba-nais s’est progressivement polarisé de façon inédite entre le camp dit du « 14 mars » (le Courant du futur sunnite, les partis chrétiens des Phalanges et des Forces libanaises, et plus épisodiquement le Parti socialiste progressiste druze) et l’alliance du « 8 mars » (les partis chiites Hezbollah et Amal, le mouvement chrétien du Courant patriotique libre et diverses personnalités pro-syriennes).
Liba n : le mou v emen t « l a chute du système con fession n el » • 261
Au-delà de la boutade, ceci met l’accent sur les conditions du succès social et populaire de la mobilisation.
Dans ce cas précis, l’idée de répertoire d’action prend un sens utile, quand bien même on en mesure les limites, parce qu’elle engage à tenir compte du poids au présent des expériences passées : dans le Liban contemporain, des-cendre dans la rue n’a rien d’exceptionnel ou de foncièrement transgressif par rapport au régime parlementaire de l’après-guerre. Les principales formations politiques de tous bords y ont eu régulièrement recours ces dernières années. En 2005, les manifestations du « 8 mars » et du « 14 mars » ont réuni plusieurs centaines de milliers de participants, avec un brouillage des clivages familiers. Elles rassemblaient des étudiants et intellectuels en butte au régime confes-sionnel et des représentants et militants des partis issus des milices, entre autres ; elles ont été suivies du retour d’exil de Michel Aoun et de la sortie de prison de Samir Geagea, les deux principaux leaders chrétiens concurrents, exclus du jeu politique de l’après-guerre. Et un peu plus tard, une alliance de circonstance s’est nouée entre le Courant patriotique libre (maronite) qui fut l’un des principaux opposants au régime syrien et le parti du Hezbollah (chiite), le principal allié de Damas dans l’après-guerre. Entre décembre 2006 et mai 2008, le centre-ville de Beyrouth est occupé par un sit-in organisé par les formations parlementaires du « 8 mars » ; quant aux rues des diMérentes villes du pays, elles sont régulièrement le théâtre de sérieuses et meurtrières échauf-fourées armées opposant des forces politiques rivales sur les plans local, national ou international. Autrement dit, descendre dans la rue n’a rien d’exceptionnel en soi. Ce mode d’interpellation publique s’épuise ou suscite moins l’intérêt des publics visés, d’autant que l’eMet de nombre ou la résonance sociale de la cause est ici en défaveur du mouvement Isqât al-nizâm al-tâ’ifî.
En outre, ce mouvement s’inscrit dans un contexte où le con{it politique et les divisions entre élites y compris au sommet de l’État s’a[chent réguliè-rement sur la scène politique ; autrement dit, où l’expression de con{it poli-tique n’a rien de proscrit. Au Liban, les partis politiques, pour la plupart représentés au Parlement et au Conseil des ministres selon la règle consocia-tive, non seulement mobilisent mais s’aMrontent dans le cadre de compétitions électorales, au sein des assemblées, voire, comme on l’a vu, dans les rues ou par les armes. Leurs capacités de mobilisation sont variées, jouant certes de l’adhésion idéologique ou communautaire, mais aussi de vastes réseaux clien-télistes et de fourniture de services institutionnalisés13. La faible popularité
13. Cammett, Melani, « Partisan Activism and Access to Welfare in Lebanon », Studies in Comparative International Development, vol. 46, n°1, 2011, p. 70-97.
262 • Sou lèv emen ts et r ecompositions politiqu es
du mouvement peut s’expliquer par la concurrence que représentent d’autres organisations politiques, qui oMrent des canaux de revendication mais aussi de protection, dans un contexte particulièrement peu sûr. En eMet, le système « confessionnel » non seulement organise une partie de la vie partisane, mais encore nourrit un clientélisme politique, à la fois inhibiteur de citoyenneté et ressource pour faire entendre sa voix et ses intérêts dans l’espace public.
Les divisions sur le cadrage
Dans ce contexte, les ressorts de l’engagement s’avèrent plus complexes que dans le cadre d’autres régimes politiques de la région. D’ailleurs, ex post, les acteurs d’Isqât al-nizâm al-tâ’ifî l’admettent : « En Égypte, ils pouvaient marcher ensemble contre le régime, pas au Liban, car il n’y a pas de dissen-timent général contre le système » (Bassem C., Forum socialiste. Entretien avec les auteures, 6 mai 2013). D’autres soulignent que certaines manifesta-tions donnèrent lieu à des accrochages parmi les manifestants ; ainsi à Jbeil, une rixe oppose les militants du PCL et un manifestant qui porte une a[che critiquant l’armement du Hezbollah. À Achra+yeh, plusieurs personnes brandissent les photos des « zu‘amâ’ » (leaders) avec le slogan « hellu ‘annâ ! » (cassez-vous !), et il s’ensuit une altercation avec les militants de l’UJDL et du PCL qui veulent « à tout prix éviter de nommer les leaders politiques ». Un autre accrochage, toujours à Achra+yeh, oppose des militants LGBT et de la gauche radicale qui dansent en criant leur soutien à la révolution syrienne, aux militants du PCL qui arguent qu’on ne peut pas danser dans une « mani-festation sérieuse » et qu’il n’y a d’ailleurs « pas de consensus à propos de la Syrie ».
Les âpres débats dans les réunions collectives qui jalonnent les étapes du mouvement portent en large part sur le programme de celui-ci. Il apparaît di[cile de désigner autour d’un plus petit dénominateur commun le « sys-tème » (al-nizâm) souhaité. « Il nous a fallu trois réunions pour savoir ce que l’on était. Si on était un mouvement (hirâk). Un mouvement de jeunes… » (Adham E. S., PCL. Entretien avec les auteures, 7 mai 2013). Les plus extrêmes, notamment les militants de la gauche radicale, avancent le slogan d’un État « sécularisé » (dawla ‘almâniyye) : « Nous voulons éliminer toute dé+nition religieuse de la citoyenneté » (Bassem C., Forum socialiste. Entretien avec les auteures, 6 mai 2013) ; « Nous ne voulons pas que le mouvement pour la déconfessionnalisation devienne un mouvement islamiste » (Arabé A., UJDL. Entretien avec les auteures, 6 mai 2013). D’autres préfèrent mettre en avant, comme leurs aînés dans les années 1990, la formule d’un État « civil » (dawla
Liba n : le mou v emen t « l a chute du système con fession n el » • 263
madanîyye), par opposition à l’État des communautés, à l’abolition duquel ils appellent tous. D’autres encore estiment que les questions sociales et de la pauvreté, qu’ils lient à l’économie du communautarisme, sont plus impor-tantes que celle du mariage civil. Ou encore que la revendication d’un État sécularisé (‘almâniyye) présenterait le désavantage d’être une revendication associée principalement aux mouvements LGBT. Ces profondes divergences, que soulignent et regrettent tous nos interlocuteurs, témoignent non seule-ment de leur hétérogénéité idéologique, mais aussi de la di[culté qu’ils éprouvent dès les premiers jours à dé+nir un ennemi commun et à dépasser, y compris au prix de malentendus, les clivages et préjugés qui brouillent l’appel au « peuple ».
Plusieurs sujets ont suscité scissions et désaMections : l’usage du terme ‘almaniyye (sécularisme) qu’utilisaient déjà les membres du Rassemblement laïque ou de la Laïque Pride ; la proposition d’intituler la marche « Isqât al-nizâm al-tâi’ fî wa rumûzihi » (littéralement « la chute du régime confes-sionnel et de ses symboles », c’est-à-dire ses incarnations et représentants politiques) ; on pourrait y ajouter les divergences sur l’intérêt d’évoquer l’usage des armes ou encore les activités du Tribunal international chargé d’instruire l’enquête sur l’assassinat de Ra+k al-Hariri. Les désaccords qui jalonnèrent les manifestations et réunions dénotent en tout état de cause le retour de plusieurs types de refoulés explicites dans les mouvements (poli-tiques, communautaires, mais aussi sociaux et de genre, comme nous le verrons un peu plus loin). À propos de la marche du 6 mars, l’un de nos interlocuteurs déclarait :
Nous avions évité les problèmes jusque-là, mais certains ont décidé de mettre les photos de ceux qu’ils voulaient virer, comme Hassan Nasrallah… Nous avons eu un grand débat sur les photos choisies, certains ont voulu les enlever. C’était notre grande manifestation : nous voulions donner une belle image de nous. Et ça nous a divisés à nouveau. Parce que ces leaderships (za‘âma) restent forts. Il y a eu une vraie bataille dans la manifestation. Un homosexuel s’est aussi exprimé devant la caméra, en disant “nous sommes pour un système séculier (‘almâni)”… ça a dégénéré. Les médias en ont pro+té, ils ont montré nos divisions au public. (Arabé A., UJDL. Entretien avec les auteures, 6 mai 2013)
S’entendre, construire et entretenir une cause mobilisatrice parlante pour « le peuple » sans distinctions de classe ou de confession s’avère particulière-ment éprouvant ; tant parce que les militants s’y épuisent, que parce que les di[cultés rencontrées mettent à l’épreuve la popularité de leur cause. Karam Karam soulignait le même obstacle pour les militants pour les droits civils
264 • Sou lèv emen ts et r ecompositions politiqu es
des années 1990, qui cherchaient à dé+nir entre eux un « plus petit dénomi-nateur commun »14.
« On ne fait pas la révolution dans des réunions »
Beaucoup des militants rencontrés imputent en+n l’« échec » de leur mouve-ment à des raisons internes. Ils mettent l’accent sur leurs divisions : les « révolutionnaires » (al-thawriyûn) vs les « réformistes » (al-islâhiyûn), les militants (al-munâdilûn) vs les indépendants (al-mustaqilûn), les expéri-mentés vs les novices ou encore les hommes vs les femmes. Ils soulignent aussi les rivalités de leadership qui les ont divisés au sein du mouvement, ou encore les in+ltrations partisanes dont ils auraient été l’objet. Ils insistent en+n sur les di[cultés concrètes éprouvées dans l’organisation du mouve-ment et les eMorts pour l’étendre.
Dans le huis clos
De fait, les manifestations et les réunions publiques (auxquelles assistent parfois une centaine de personnes) du mouvement rassemblent de nouveaux entrants, des militants « professionnels » associatifs ou partisans souvent multi-posi-tionnés, des militants « dormants » qui, après avoir été actifs au début des années 2000, s’étaient désengagés, mais aussi les membres de collectifs en marge de la légalité comme Helem. Si cette extrême diversité semble être acceptée, voire mise en avant, par une partie importante des militants, le représentant de la section jeunesse du PCL semble être plus critique : « Cette diversité entre les groupes de gauche, les novices en politique (hawîn siyâsa) et les extrémistes s’est rapidement avérée être contre-productive » (Adham E. S., PCL. Entretien avec les auteures, 9 mai 2013). Plusieurs clivages émergent.
Le label d’« indépendant », autoproclamé par les acteurs concernés eux-mêmes, regroupe notamment des blogueurs et des novices en politique, par opposition aux militants non seulement membres ou proches de partis mais plus aguerris, rodés aux activités de « terrain » et à la gestion des assemblées générales, des prises de parole en public et des réunions. Parfois revendiqué par des militants ou militantes fraîchement désengagés, il désigne la plupart du temps des néophytes qui partagent néanmoins un certain nombre de caractéristiques avec les militants plus anciens ; nés pour la plupart à partir de la +n des années 1970, ils appartiennent majoritairement aux classes
14. Karam, Le mouvement civil au Liban, op. cit.
Liba n : le mou v emen t « l a chute du système con fession n el » • 265
moyennes urbaines et côtoient de près le monde associatif, que ce soit en tant que volontaires ou salariés, dans des conditions souvent très précaires. C’est une caractéristique qui avait déjà été relevée dans le cas des militants alter-mondialistes au début des années 2000. En revanche, dans les années 1990, les militants des associations « civiles » étaient plutôt des étudiants, des journalistes, des avocats, des universitaires.
Ainsi en est-il de la trajectoire de Bassel S., l’un des principaux anima-teurs du mouvement de 2011. Il a[chait à la +n des années 1990 lorsqu’il était encore à l’université ce qu’il appelle des sympathies pour la « gauche natio-naliste arabe ». Il dé+nit aujourd’hui son engagement de l’époque comme « staliniste » même s’il n’était pas « organisé » dans le cadre d’un parti poli-tique. La chute de l’Irak et l’attitude de la « gauche traditionnelle » provoquent chez lui une forte « désillusion » ; il décide alors de cesser tout engagement politique. Il résume ainsi ses convictions politiques : d’abord « contre le confessionnalisme donc de facto contre le Hezbollah qui a tué le Front national de la résistance libanaise [jabhat al-muqâwama al-wataniyya al-lubnâniyya, qui rassemblait dans les années 1980 les forces de gauche contre l’occupant israélien] » ; ensuite contre le « régime syrien et son occupation du Liban ». Il explique ainsi a posteriori son rapprochement de l’Alliance du 14 mars, qu’il trouve « moins pire que celle du 8 mars ». Mais l’attitude du « 14 mars » durant les échauMourées meurtrières du 7 mai 2008 opposant notam-ment des milices sunnites et chiites dans les rues de Beyrouth l’éloigne de tout type de militantisme jusqu’à la révolution égyptienne, où il se rend compte que « quelque chose de diMérent est en train de se passer avec la pos-sibilité de construire quelque chose de nouveau ». Il décide alors de créer une page Facebook (Bassel S., indépendant proche du Forum socialiste. Entretien avec les auteures, 7 mai 2013).
Pour ce trentenaire, comme pour d’autres, Isqât al-nizâm al-tâ’ifî a pu apparaître comme une alternative à ses atermoiements politiques, mais aussi comme l’occasion de faire plus concrètement l’expérience du militantisme, par rapport à l’engagement « philosophique » des années étudiantes. Dans son cas précis, c’est un moment d’in{exion dans un parcours qu’il oriente désor-mais vers l’extrême gauche. Malgré cela, le mouvement ne brouille pas les repères, ne dérape pas, ne sort pas de la route et ne mobilise que des « pairs » ; il ne propose pas vraiment une lecture renouvelée de la réalité sociale, mais emprunte plus volontiers des langages ancrés dans des expériences précé-dentes. En témoigne notamment le cas des militants marxistes ou trotskistes engagés dans le mouvement :
266 • Sou lèv emen ts et r ecompositions politiqu es
Pour le Forum socialiste, participer au mouvement correspondait à appliquer ce que Gramsci appelle les forces de résistance contre l’hégémonie de la classe dominante et par conséquent à créer des brèches dans la conscience de masse au Liban. […] La société civile ne peut pas être le vecteur d’un changement global parce qu’elle se fonde sur l’idée qu’il su[t de réparer ou de réformer l’État et que le système politique peut continuer tel quel. (Bassem C., Forum socialiste. Entretien avec les auteures, 6 mai 2013)
Un autre leader du mouvement, Bassel A., se dé+nissant comme un « membre de la société civile », nous explique :
Contrairement aux autres, moi je n’ai jamais cru en la chute ou le renversement du système. Il ne faut pas donner des illusions aux jeunes […] et avancer plutôt des propositions précises (mashârî‘ muhaddada) comme un projet de loi sur le mariage civil, une loi sur les élections proportionnelles ou encore une loi globale pour la sécurité sociale, etc. (Bassel A., coordinateur du Courant de la société civile. Entretien avec les auteures, 11 mai 2013)
Ces deux derniers extraits d’entretiens illustrent l’un des clivages majeurs qui traversent le mouvement Isqât al-nizâm al-tâ’ifî, celui qui opposa les partisans, minoritaires mais parmi les plus actifs, d’un changement global, voire « révolutionnaire », qui prônent le « renversement du système », et d’autres qui privilégient un mode d’action plutôt sur le mode de la réforme.
Le clivage s’exprime en plusieurs occasions, par exemple dans le choix des itinéraires des manifestations. Celui-ci fait l’objet de longs débats houleux dans les assemblées générales et se renégocie continuellement. D’après les militants de gauche, les itinéraires sont choisis dans le souci d’inscrire le mouvement dans des espaces géographiques marginalisés : ainsi les marches passent par les banlieues pauvres de Dora, Borj Hammoud, Basta, Chiah. D’autres militants préfèrent suivre les lignes de démarcation de la guerre civile comme pour montrer leur refus des frontières réelles ou imaginaires, ou dé+ler dans des +efs emblématiques du confessionnalisme, à l’instar de la marche qui part de l’église de Mar Mikhayel en pleine banlieue sud contrôlée par le Hezbollah, ou celle qui part du quartier d’Achra+yeh, le +ef de la « droite chrétienne ». Ces chemins, qui empruntent des géographies jusqu’alors ignorées des mouvements précédents, ont aussi pour objectif d’inviter à participer des gens qui se mobilisent peu ou plus volontiers der-rière des partis qui oMrent services et protections. Des slogans visent parti-culièrement les habitants, appelés à ne plus être de simples « spectateurs » de la vie politique : « Vous qui êtes à vos balcons, votre peuple est là : rejoignez-le ! » (yalli e’id al-balcon, nzal nehna cha‘abak hon !). Junaid S., un artiste
Liba n : le mou v emen t « l a chute du système con fession n el » • 267
« engagé » membre de Zoukak, une compagnie de théâtre qui ne cache pas son militantisme « politique et social » et son refus « des systèmes de margi-nalisation », explique qu’il a pu créer ces slogans « justement parce que [il] n’étai[t] pas formaté par le clivage du 8 et 14 mars » (Junaid S., Zoukak. Entretien avec les auteures, 27 juin 2013). Si, au début, l’extrême gauche et les indépendants parviennent à imposer ces itinéraires nouveaux, le basculement du rapport de force au sein du mouvement, notamment après l’arrivée des partis politiques, amène à privilégier des marches vers le Parlement libanais. Non seulement les itinéraires rejoignent les tracés classiques des manifesta-tions dans la capitale, mais l’appel au peuple à descendre dans la rue pour renverser le système laisse métaphoriquement la place à l’adresse aux parle-mentaires pour leur demander de réformer les lois sur le statut personnel ou la loi électorale.
Les défilés et réunions générales, habituellement bien organisés et contrôlés par une équipe d’organisateurs qui s’est progressivement imposée, constituent surtout des moments d’euphorie collective, un militant parlant même de moment de « folie ». L’essentiel de la socialisation, des discussions et de l’action politique se passe lors des réunions, qui, bien qu’ouvertes à tous par le biais notamment d’invitations lancées sur les réseaux sociaux, se déroulent principalement à huis clos. La fréquence des rencontres et démons-trations publiques contribue à produire un « eMet surgénérateur de l’engage-ment15 » qui suscite une ambiance d’ébullition. Mais la di[culté qu’éprouvent alors les militants à gérer les temps « froids » du mouvement entre deux manifestations ou assemblées, contribue au +l des mois à son essouPement. D’autant que les réunions, très chronophages (les militants citent notamment une AG qui a duré huit heures), ne font pas l’unanimité chez les participants : « Ce n’est pas dans des réunions que l’on fait la révolution », regrettent plu-sieurs d’entre eux. L’énergie déployée dans la recherche de compromis en interne ne franchit que di[cilement les murs de ces espaces fermés où se tiennent des débats politiques passionnés.
Les cens cachés de la participation
L’origine confessionnelle des participants – militants actifs ou occasionnels, sympathisants, manifestants – au mouvement reste di[cile à mesurer et varie
15. Gaxie, Daniel, « Économie des partis et rétributions du militantisme », Revue française de science politique, vol. 27, no 1, 1977, p. 123-154.
268 • Sou lèv emen ts et r ecompositions politiqu es
selon les lieux des mobilisations, les marches, les étapes de l’action. Certains soulignent que s’y joignent des catégories de populations, tels les Arméniens, rarement présentes dans ce type de militantisme au Liban et tous insistent sur le caractère multicommunautaire d’Isqât al-nizâm al-tâ’ifî. À la diMérence des organisateurs des mouvements civils des années 1990 ou de certains syndicats qui apportent un soin tout particulier, à coup de savants dosages, à ce que leur représentation ne puisse être taxée d’aucun caractère confes-sionnel ou ne puisse prêter le {anc à une contre-oMensive de la part des organisations dominantes, ici, aucun des militants ne fait état explicitement de préoccupations de la sorte. Néanmoins, une sociologie du mouvement montre comment peuvent jouer subrepticement des tropismes confessionnels dans l’engagement, des « cens », c’est-à-dire des inégalités culturelles et sociales dans le rapport au politique16, d’autant plus cachés et intériorisés qu’ils s’exercent contre l’objet même de la mobilisation. On note en particulier la faible représentation relative des sunnites dans les activités du mouvement à Beyrouth, comme cela était aussi le cas des mouvements pour les droits civils dans les années 1990 ou l’altermondialisme des années 2000 ; mention-nons cependant d’importants contre-exemples, notamment parmi des groupes ou personnalités qui ont milité au sein de la gauche nationaliste arabe avant guerre. À l’inverse, la présence de personnalités chiites aux premiers rangs des mobilisations peut être soulignée. Ceci s’explique certainement par des logiques de socialisation in{uencées par une oMre partisane, essentielle-ment communautaire dans l’après-guerre. Celle-ci situe désormais schéma-tiquement plutôt les mouvements sunnites au cœur de l’appareil de l’État et continue, malgré la présence du parti Amal et du Hezbollah dans les rouages des institutions, d’ancrer la politisation des populations chiites dans un discours de défense des opprimés.
C’est au cours des réunions qu’apparaissent aussi certains mécanismes d’exclusion, des « novices » et des femmes notamment, mettant en relief des « conceptions andro-centrées du leadership17 » dans un mouvement où les leaders qui s’imposent sont souvent ceux qui béné+cient du capital militant et des capitaux sociaux les plus importants. En eMet, les processus de prise de décision sont constamment renégociés au sein des réunions ou des AG
16. Gaxie, Daniel, Le cens caché. Inégalités culturelles et ségrégation politique, Paris, Le Seuil, 1978.
17. Fillieule, Olivier, « Travail militant, action collective et rapports de genre », dans Olivier Fillieule et Patricia Roux (dir.), Le sexe du militantisme, Paris, Presses de Science Po, 2009, p. 46.
Liba n : le mou v emen t « l a chute du système con fession n el » • 269
autour de personnages clés qui semblent centraliser de façon informelle la prise de décision. Si quelques procédures formelles (l’existence d’un « modé-rateur », de tours de parole, etc.) mises en œuvre durant les débats sont supposées garantir l’égalité entre les militants, en réalité la pratique met en relief le rôle prépondérant d’activistes incontournables ; des hommes, les plus expérimentés et les plus éloquents.
C’est ainsi que le collectif féministe Nasawiya +nit par se retirer o[ciel-lement du mouvement : « On n’imaginait pas qu’un mouvement révolution-naire pouvait être porteur de sexisme et de misogynie », nous expliquent des militantes (Sara A., Hiba A., Nasawiya. Entretien avec les auteures, 8 mai 2013). Si depuis le début du mouvement « les hommes » ont tenté de « [les] réduire au silence », le con{it +nit par éclater lors de l’organisation de la marche du 8 mars, coïncidant avec la Journée internationale de la femme. Les militantes de Nasawiya proposent alors que cette manifestation porte particulièrement l’attention sur les droits de la femme ; elles sont « surprises » et « choquées » par l’attitude de leurs confrères masculins qui considèrent ce sujet comme « stupide » (mawdû‘ sakhîf ) alors que les « hommes étaient occupés à faire la révolution ». Elles déplorent que certaines d’entre elles soient décrites par leur compagnons de lutte comme des « femmes qui détestent les hommes » (men haters) ou encore « agissant comme des hommes » (mustar-jila) parce qu’elles « prennent la parole en public ». Les pratiques d’« intimi-dation » comme le « haussement de voix » ou « l’agressivité » qu’elles ressentent à leur encontre amènent ces militantes à quitter dé+nitivement le mouvement en arguant, « naïvement » selon leurs acolytes masculins, qu’il ne constituait plus à leurs yeux un « espace sûr » (safe space) : « Elles auraient dû rester et se battre de l’intérieur. La politique n’est un “lieu sûr” pour personne ; c’est un champ de bataille ! » (Bassem C., Forum socialiste. Entretien avec les auteures, 6 mai 2013).
D’autres militantes d’Isqât al-nizâm al-tâi’fî décrient la manière dont leur rôle en tant que femmes a été dépeint de façon « traditionnelle », mettant en avant des attributions et des attentes normatives genrées, la femme étant de facto assimilée à la « mère ».
Les discussions sur la question de la femme ont montré un côté réactionnaire chez certains militants […]. Une des preuves de cela c’est de choisir le jour de la fête des mères pour parler des droits de la femme au lieu de la Journée inter-nationale de la femme, ou encore les slogans qu’ils ont choisis qui n’ont retenu que le rôle maternel de la femme ! Tout cela vient du fait que la plupart des participants au mouvement sont réformistes et pas révolutionnaires même si le slogan o[ciel est le renversement du système. (Bernadette D., indépendante,
270 • Sou lèv emen ts et r ecompositions politiqu es
ex-Forum socialiste. Entretien avec les auteures, 29 juin 2013)
Pourtant, les organisateurs du mouvement, à l’instar d’autres soulève-ments populaires de la région, mettent en œuvre des principes mûris pour certains d’entre eux dans le cadre de collectifs altermondialistes dans les années 2000 et optent pour des modes d’organisation qui privilégient l’hori-zontalité, l’absence de leaders et de porte-parole. Mais, comme l’explique Jo Freeman, l’absence de hiérarchie et de structure, de même que le poids de l’intimité et des relations d’amitié, contribuent à faire reposer la vie de l’orga-nisation, ou d’un mouvement, sur un petit groupe de personnes soudées, ce qui implique des relations hiérarchiques ou des formes de domination d’autant plus prégnantes qu’elles sont niées18. C’est ainsi que les relations d’amitié antérieures entre les coordonnateurs de deux organisations clés du mouvement (l’UJDL et le Courant de la société civile) passent aux yeux de beaucoup d’autres militants pour agaçantes voire « suspectes », certains n’hésitant pas à les accuser de « combines » en douce visant à « contrôler » le mouvement, notamment en invitant ou non certaines personnes ou groupes à des réunions informelles. Ceci contribue d’ailleurs à exacerber le clivage entre les diMérentes composantes du mouvement ; notamment entre associa-tions et partis politiques d’une part, et extrême gauche d’autre part, avec des accusations réciproques d’in+ltration. Le représentant de la section jeunesse du Parti communiste qui nie ces tentatives de contrôle du mouvement nous avoue à demi-mot : « Nous ne faisions rien en secret, mais quel est le critère pour inviter de nouvelles personnes aux réunions ? » Il ajoute : « Ce sont les indépendants qui ont récupéré le mouvement ; on a même découvert qu’ils étaient +nancés par l’Union européenne » (Adham E. S., PCL. Entretien avec les auteures, 9 mai 2013).
Rapprochements « sous tension »
Ces problématiques ont contribué à aMaiblir le mouvement de l’intérieur ; mais ses acteurs ont été confrontés à un autre type de dilemme comme nous l’avons vu : l’ambition de mobiliser « le peuple » dans une société où les assises sociales des partis politiques sont solides, les conduit à des rapprochements complexes et inconfortables avec certaines organisations politiques établies. Si certains encouragent ces rapprochements, d’autres y perçoivent comme une tentative d’instrumentalisation du mouvement par ces partis politiques,
18. Freeman, Jo, « }e Tyranny of Structurelessness », 1970, http://www.jofreeman.com.
Liba n : le mou v emen t « l a chute du système con fession n el » • 271
en vue de renouveler leur image, notamment de la part du PCL, qui y parti-cipe dès la première réunion, par le biais de sa section jeunesse (qitâ‘ al-chabâb) (Adham E. S., PCL. Entretien avec les auteures, 9 mai 2013). D’ailleurs, l’organisation de manifestations, dans les rues de Jbeil, par exemple, doit beaucoup à la présence du PCL dans la localité. Mais le rapprochement cer-tainement le plus controversé est celui du parti Amal, dont la chaîne de télévision diMuse durant l’hiver 2011 une émission hebdomadaire qui suit de près la mobilisation.
Ceci a désorganisé le mouvement, le rendant encore plus poreux par rapport aux in{uences externes, aux concurrences partisanes, et a contribué à le décrédibiliser devant l’opinion publique, qui découvrait sur les principales chaînes de télévision nationales les discours décousus et le manque notoire d’expérience et de programme des militants. Ce fut notamment le cas lors d’une célèbre émission de télévision, Kalâm an-nâs, où l’animateur vedette confondit les militants dans leurs contradictions, faisant apparaître leurs dissensions internes, leur absence de programme et leur inexpérience. Comme le montrait en son temps Patrick Champagne19, autant que sur le nombre de personnes dans les rues, une manifestation se joue aussi dans les interpréta-tions qu’en font les médias : une large partie des sympathisants du mouvement le déserte après cette émission ratée. En ce sens, les limites de l’appel au peuple du mouvement résident aussi dans la di[culté de ses animateurs à sortir de leur espace de discussion habituel. Ils s’avèrent d’excellents animateurs de débats sur le Web et sont présents sur les réseaux sociaux à l’instar de ce que l’on observe en Syrie, en Tunisie, en Égypte ou au Maroc. Néanmoins, comme le souligne Romain Lecomte au sujet de la Tunisie, où la révolte a d’abord été le fait d’une population non connectée, dans le centre du pays20, l’impact des réseaux sociaux en termes de mobilisation n’est que partiel – voire même carrément contre-productif aux yeux de certains des cybernautes. À l’inverse de leurs aînés qui, journalistes, avocats, universitaires pour beaucoup, dans les années 1990 avaient mené une vaste campagne médiatique dans la presse et sur les nombreuses chaînes de télévision libanaises, les militants de 2011 ont en partie perdu la bataille des médias classiques, pour la plupart liés aux principaux partis politiques du pays et assez peu enclins à remettre en cause le statu quo politique.
19. Champagne, Patrick, Faire l’opinion. Le nouveau jeu politique, Paris, Éditions de Minuit, 1990.
20. Lecomte, Romain, « Révolution tunisienne et internet : le rôle des médias sociaux », L’Année du Maghreb , vol. VII, Paris, CNRS édition, p. 389-418.
272 • Sou lèv emen ts et r ecompositions politiqu es
* * *
Deux ans après le lancement du mouvement, plusieurs campagnes ou initia-tives qui en sont, directement ou indirectement, issues ont vu le jour dans diMérentes régions du pays21 : la campagne « Mon droit est ma responsabilité » (haqqî ‘alayyi) organisée à Beyrouth par des intellectuels de gauche et des artistes a+n de sensibiliser les citoyens à leurs droits « civils » (i.e. non confes-sionnels) et notamment leurs droits sociaux ; « Tripoli sans armes », qui organise plusieurs mobilisations dans le Liban nord contre le recours à la violence communautaire qui s’y exacerbe ; le « Forum civil » (al-muntada al-madani) dans la plaine de la Beqaa ; ou encore « Action directe » (‘amal mubâchar), une coalition qui a[che son « indépendance politique » mais est animée, comme son nom l’indique, essentiellement par des militants de la gauche radicale. La liste pourrait s’allonger. Ces diMérents groupes mènent des actions sporadiques de sensibilisation contre le confessionnalisme, mais aussi des actions d’enrôlement et de recrutement de nouveaux militants. Peu populaire et ne mobilisant qu’autour d’opérations ponctuelles, il s’agit avant tout d’un activisme protestataire qui s’exerce et recrute au sein de réseaux de militants et sympathisants de gauche opposés au confessionnalisme, animés par des personnalités aux multiples casquettes, qui partagent des convictions politiques ainsi que de solides liens interpersonnels. Quelques-uns de ses militants les plus expérimentés, convaincus du rôle des « avant-gardes » et ancrés à gauche, ont participé, ces dernières années, aux mouvements qui, parallèlement, agitent le monde du travail : grèves dans l’enseignement, les transports publics, la grande distribution, ou encore à Électricité du Liban. Toutefois, ces mobilisations ne se sont pas vraiment articulées, comme cela a pu être le cas dans les pays voisins, dans un esprit révolutionnaire.
Isqât al-nizâm al-tâ’îfî apparaît bien moins le fait d’un militantisme inter-nationalisé que l’on observerait à l’échelle locale, ou le fruit d’une émulation suscitée par les révolutionnaires tunisiens, égyptiens, yéménites, libyens ou syriens, que comme un mouvement travaillé par des rémanences très libanaises. Loin d’être l’œuvre d’une « immaculée contestation22 », il renouvelle une cause inscrite de longue date sur l’agenda réformateur ou protestataire libanais. Ses acteurs sont issus pour une large part d’organisations souvent marginalisées,
21. AbiYaghi, Marie-Noëlle, « Civil Mobilization and Peace in Lebanon », dans Élizabeth Picard et Alexander Ramsbotham (dir.), Reconciliation, Reform and Resilience. Positive Peace for Lebanon, Londres, Accord Publications, no 24, 2012, p. 20-22.
22. Taylor, Verta, « }e Social Movement Continuity : }e Women’s Movement in Abeyance », American Sociological Review, vol. 54, no 5, 1989, p. 761-775.
Liba n : le mou v emen t « l a chute du système con fession n el » • 273
mais qui démontrent leur capacité à s’animer quand l’occasion se présente. Qui plus est, ses protagonistes ont été confrontés à la di[culté de construire une cause populaire et nouvelle face aux nombreuses entreprises de mobilisations concurrentes qui animent l’arène de la politique instituée. En+n, les limites auxquelles il s’est trouvé confronté n’ont rien d’inhabituel, en particulier le faible ancrage populaire d’un mouvement non communautaire par rapport à celui des partis parlementaires.
Les traits caractéristiques du mouvement pour « la chute du système confessionnel » n’ont rien d’exceptionnel dans les espaces militants libanais, rompus à des formes complexes de solidarité aux géographies variables. Isqât al-nizâm n’a pas – ou peu – mobilisé en dehors des cercles militants habituels de Beyrouth et des principales villes libanaises. Mais il semble avoir d’abord constitué une opportunité de renouvellement politique pour des militants dont la cause est réveillée par les événements qui bousculent la région. Il a été l’occasion d’entrer en politique ou de militer autrement pour des « novices » ou des militants déçus. Il a aussi représenté une opportunité d’étendre les espaces de mobilisation ou de renouveler leur discours pour quelques partis politiques prônant la « déconfessionnalisation politique » du système, dont l’adhésion au mouvement s’est étiolée toutefois très rapidement avec la révo-lution en Syrie.