« Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie...
Transcript of « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie...
LES ORIGINES DU CHRISTIANISME: NOUVEAUX PARADIGMES OU PARADIGMESPARADOXAUX? Bibliographie sélectionnée et raisonnéeAuthor(s): Simon C. MimouniSource: Revue Biblique (1946-), Vol. 115, No. 3 (JUILLET 2008), pp. 360-382Published by: Peeters PublishersStable URL: http://www.jstor.org/stable/44090896Accessed: 03-05-2018 21:34 UTC
REFERENCES Linked references are available on JSTOR for this article:http://www.jstor.org/stable/44090896?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents You may need to log in to JSTOR to access the linked references.
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
http://about.jstor.org/terms
Peeters Publishers is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access toRevue Biblique (1946-)
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
RB. 2008 - T. 115-3 (pp. 360-382).
LES ORIGINES DU CHRISTIANISME: NOUVEAUX PARADIGMES OU PARADIGMES
PARADOXAUX?
Bibliographie sélectionnée et raisonnée* PAR
Simon C. Mimouni
École pratique des Hautes études - Section des sciences religieuses Sorbonne, 45-47 rue des Écoles,
F-75005 Paris
Les résultats de la recherche historique ne devraient avoir aucune incidence sur la « foi » :
ce n fest malheureusement pas toujours le cas ! Pierre Geoltrain
Sommaire
La parution de travaux à un rythme soutenu et les changements de paradigmes, voire de paramètres, sont tels que le chercheur éprouve maintes difficultés à suivre les nombreuses propositions avancées - sans compter que les supports éditoriaux se multiplient, y compris sous des formes informatisées. Le consensus établi dans l'ouvrage collectif dirigé par James D.G. Dunn, publié en 1992, est en train de voler en éclat sous les coups de boutoir des ouvrages collectifs dirigés par Adam H. Becker et Annette Y. Reed, publié en 2003, et par Ian H. Henderson et Gerbern S. Oegema, publié en 2006. The Parting of the Ways est en train de devenir The Ways That Never Parted. . .
Summary
This article seeks to present some new views on the origins of Christianity - taking this expression in a broad sense, to include the first three centuries. The
* Il convient de remercier Justin Taylor pour ses encouragements à la mise au point de cette contribution réalisée à Jérusalem dans le cadre d'une invitation, du 14 octobre au 16 décembre 2007, comme professeur à l'École biblique et archéologique française.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
LES ORIGINES DU CHRISTIANISME 36 1
rapid appearance of books and articles and the changing paradigms, even para- meters, of the subject mean that scholars may find it difficult to follow what is going on. To that add the growing number of periodicals, series and other means of publication, often available only on-line. The consensus established in *The Parting of the Ways* edited by James D.G. Dunn in 1992 is taking a battering from the multi-authored studies edited by Adam H. Becker and Annette Y. Reed in 2003, and by Ian H. Henderson and Gerbern S. Oegema in 2006. The Parting of the Ways is in the process of becoming The Ways That Never Parted.
Par paradigme, avec Thomas Kuhn, un scientifique américain, il faut entendre un cadre dans lequel on fait entrer les connaissances acquises dans une branche du savoir à un moment donné - un cadre qui sert à les comprendre et à les ordonner de manière cohérente, devenant alors utile pour suggérer de nouvelles recherches : la connaissance progresse ainsi de paradigme en paradigme1. Il est évident qu'ensuite il convient de par- tir des sources et des données, non pas du paradigme.
De manière systématique, tout au long de cette présentation, comme on le propose depuis un certain temps, on utilisera de préférence le terme «Judéen» au terme «juif». Pour l'époque envisagée, le premier, qui vient de l'hébreu, de l'araméen, du grec et du latin, paraît plus conforme que le second : il présente notamment l'avantage de ne pas être anachro- nique. Cette appellation veut signifier simplement que l'idée d'une identité liée à l'origine géographique (personne originaire de Judée et aux lois en vigueur dans cette région) a précédé celle d'un statut essentiellement reli- gieux qui n'a été perçu comme tel que bien plus tard. Shaye J.D. Cohen propose aussi une terminologie identique, avec les termes Judaean et Judaeanness, mais en la limitant dans le temps aux IIe-Ier siècles avant notre ère2. Steve Mason, pour sa part, estime que dans l'Antiquité, au moins jusqu'aux IVe- Ve siècles, les Judéens sont compris comme un groupe ethnique comparable à d'autres groupes ethniques avec leur Dieu, leur Loi et leur Temple, et non pas comme les fidèles d'une « religion »3. Entre les deux options, on aurait tendance à pencher pour la seconde. Il est évident cependant que le terme «juif » est plus utilisé dans le langage
1 T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago/Illinois, 1962 (= La struc- ture des révolutions scientifiques, Paris, 1983).
2 S. J.D. Cohen, The Beginnings of Jewishness. Boundaries, Varieties, Uncertainties, Berkeley/Californie, 1999, p. 69-106.
3 S. Mason, « Jews, Judaeans, Judaizing, Judaism : Problems of Categorization in Ancient History», dans Journal for the Study of Judaism 38 (2007), p. 457-512.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
362 SIMON C. MIMOUNI
courant, et l'on sait que l'usage n'a cure des nuances - sur ce point comme sur tant d'autres. Par ailleurs, on utilise les expressions « chrétien d'origine judéenne» ou «judéo-chrétien» et «chrétien d'origine grec- que » ou « pagano-chrétien » avec une valeur purement désignative pour indiquer une extraction ou une provenance, mais sans aucun contenu doctrinal.
On va donc proposer ici quelques éléments de réflexion sur les nou- velles perspectives relatives aux origines du christianisme - une expres- sion qui est à comprendre au sens large, c'est-à-dire englobant les trois premiers siècles. Il ne sera pas question dans cette présentation de la recherche historique sur Jésus de Nazareth ni sur son milieu culturel, politique et religieux, qui n'a pas subi d'énormes mutations ces dernières années, et ce malgré la masse considérable des publications qui paraissent à un rythme soutenu - on peut cependant signaler l'ouvrage de Jacques Giri qui, malgré son titre, porte essentiellement sur le Jésus historique, un travail d'amateur éclairé qui présente l'avantage de tenir aussi bien compte des paradigmes majoritaires que des autres paradigmes4. Deux colloques, dont les actes ont été publiés en 2003 et en 2006, sont
fondamentaux pour prendre connaissance de manière rapide des nouvel- les perspectives dont il va être question ici : ils ont été dirigés par Adam H. Becker et Annette Y. Reed pour le premier5 ; par Ian H. Henderson et Gerbern S. Oegema pour le second6. Tous les auteurs relevant de cette démarche procèdent en considérant la persistance d'une création littéraire chrétienne d'origine judéenne en Palestine au IVe siècle : ce qui est estimé comme la preuve d'une certaine continuité qui se poursuit et d'une rup- ture qui s'installe, une rupture dans la continuité - toute la nouveauté est dans cette formule, qui est sous bien des aspects, paradoxale. Les criti- ques en question ont tendance à désigner de plus en plus comme « proto- orthodoxe » le mouvement qui commence avec des théologiens comme Clément de Rome, d'origine judéenne, et Ignace d'Antioche, d'origine grecque, et qui donnera naissance, selon eux, entre le concile de Nicée de 325 et le concile de Chalcédoine de 451, à l'« orthodoxie » - de fait, à une fusion des nombreux courants.
4 J. Giri, Les nouvelles hypothèses sur les origines du christianisme. Enquête sur les recherches récentes , Paris, 2007.
5 A.H. Becker - A.Y. Reed (Ed.), The Ways That Never Parted. Jews and Christians in Late Antiquity and the Early Middle Ages , Tübingen, 2003.
6 I.H. Henderson - G.S. Oegema (Ed.), The Changing Face of Judaism, Christianity and Other Greco-Roman Religions in Antiquity, Gütersloh, 2006.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
LES ORIGINES DU CHRISTIANISME 363
Partant de cette ligne de pensée, on aurait tendance à considérer, avec eux, qu'il faut distinguer entre deux périodes : l'une qui n'est ni «hété- rodoxe » ni « orthodoxe » s 'achevant avec la reconnaissance officielle du
christianisme par l'Empire romain; l'autre qui est «orthodoxe» com- mençant avec la mise en place d'une Église orthodoxe en Orient et d'une Église catholique en Occident - on n'est pas loin alors du postulat de Walter Bauer dont la mise en place remonte à 19347. Entre ces deux périodes, il conviendrait peut-être de distinguer une période « intermé- diaire » qui commencerait avec le concile de Nicée de 325 et s'achèverait avec le concile de Chalcédoine de 45 1 - une époque majeure car décisive sur laquelle on reviendra plus longuement tout au long de ces remarques et réflexions. Cela n'empêcherait nullement de considérer que cette ortho- doxie, comme on l'a déjà laissé entendre, trouve ses racines chez des auteurs comme Irénée, Clément et Origene que l'on considère comme les fondateurs de la Grande Église qui n'existe cependant pas avant le début du IVe siècle - une date qui reste évidemment à discuter.
Quoi qu'il en soit de cette question de répartition chronologique, qui est somme toute mineure, l'intérêt de cette période «intermédiaire» est démontré dans certaines recherches récentes, qui se fondent notamment sur des écrits comme la composition des Homélies et des Reconnaissances pseudo-clémentines qui sont fondées sur des sources plus anciennes que l'on pense être d'origine judéo-chrétienne. À ce sujet, Annette Y. Reed a posé une question essentielle pour savoir ce que les Pseudo-Clémentines apportent à la connaissance non pas du judéo-christianisme et de leurs sources hypothétiques du IIe ou du IIIe siècle, ce que l'on appelle pour faire bref la Grundschrift , mais des rapports entre le judaïsme et le chris- tianisme qui les ont produites et utilisées en plein IVe siècle8. À cette fin, ce chercheur a examiné tout spécialement les thèmes suivants : (1) celui du statut de Jésus par rapport à Moïse ; (2) celui du statut des non Judéens par rapport aux Judéens et (3) celui des moyens de parvenir au salut dans le discours de Pierre en Reconnaissances I, 27-71 (les premières instruc- tions de Pierre à Clément) et en Reconnaissances IV-VI / Homélies VIII- IX (les sermons prononcés lors de leur séjour à Tripoli) «en essayant
7 W. Bauer, Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum , Tübingen, 19341, 19642 (= Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity , Philadelphie/Pennsylvanie, 1971 ; Orthodoxie et hérésie aux débuts du christianisme , Paris, 2007).
8 A. Y. Reed, « 'Jewish Christianity' after the 'Parting of the Ways' : Approaches to Historiography and Self-Definition in the Pseudo-Clementines», dans A.H. Becker - A.Y. Reed (Ed.), The Ways That Never Parted. Jews and Christians in Late Antiquity and the Early Middle Ages , Tübingen, 2003, p. 189-231.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
364 SIMON C. MIMOUNI
d'élucider l'auto-compréhension de leurs auteurs / rédacteurs ultimes». En un mot, les conclusions d'Annette Y. Reed vont dans la direction d'une persistance de l'influence et de l'existence des communautés judéo- chrétiennes en Syrie-Palestine, au IVe siècle, dans le giron d'une certaine orthodoxie discutant de questions christologiques comme par exemple le groupe de pensée qui se réclame d'Apollinaire de Laodicée, les apol- linaristes9.
Dans la même perspective, mais sur un plan relativement différent, Nicole Kelley montre combien l'insistance sur l'autorité de Pierre dans les Reconnaissances, à cause de sa connaissance des choses humaines et divines, relève de communautés chrétiennes de la Syrie du IVe siècle dont les tendances sont judaïsantes, ce qui ne signifie pas qu'elles sont néces- sairement d'origine judéenne10. Ainsi, au regard de la diffusion manuscrite, cette littérature, nourrie de
questions et de sources judéo-chrétiennes, semble avoir remporté un suc- cès considérable auprès du lectorat « orthodoxe » que ce soit dans l'Orient grec avec les Homélies ou dans l'Occident latin avec les Reconnaissances. Pour certains critiques, ce succès est le signe d'une rupture / séparation qui n'est pas encore consommée : le christianisme est encore dans le judaïsme, mais d'un judaïsme évidemment non rabbinique qui subsiste encore et qui est teinté de christianisme ou plutôt de messianisme. A l'évidence, il a été montré qu'il s'agit d'un judaïsme qui n'est pas « mono- théiste » au sens où on l'entend aujourd'hui : dans cette tendance doctri- nale, il y est soutenu, en effet, que si les idées sur le Dieu d'Israël sont vraies, chacun doit les accepter et adorer cette divinité, ou alors, si elles sont fausses, chacun doit en assumer les conséquences. Il s'agit là, appa- remment, d'un judaïsme qui considère que les croyances et pratiques judéennes sont pour les Judéens et que les autres peuples ont le droit d'avoir leurs propres croyances et pratiques : autrement dit, le dieu judéen doit être le seul dieu à être vénéré par les Judéens - ces analyses ne sont pas nouvelles, puisqu'elles ont été déjà mises en évidences par un auteur comme Günter Stemberger dès 198711. Dans le prolongement de cette
9 Voir A. Y. Reed, « Rabbis, Jewish Christians, and Other Late Antique Jews : Reflec- tions on the Fate of Judaism(s) after 70 C.E. », dans I.H. Henderson - G.S. Oegema (Ed.), The Changing Face of Judaism, Christianity and Other Greco-Roman Religions in Anti- quity, Gütersloh, 2006, p. 323-346. 10 N. Kelley, « Problems of Knowledge and Authority in the Pseudo-Clementine
Romance of Recognitions», dans Journal of Early Christian Studies 13 (2005), p. 315-348. 11 G. Stemberger, Juden und Christen im Heiligen Land. Palästina unter Konstantin
und Theodosius, Munich, 1987 (= Jews and Christians in the Holy Land. Palestine in the Fourth Century, Edimbourg, 2000). Voir aussi G. Stemberger, Juden und Christen
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
LES ORIGINES DU CHRISTIANISME 365
perspective, le judaïsme compterait en son sein plusieurs branches parmi lesquelles il conviendrait d'identifier celles qui relèveraient d'une Alliance d'Abraham et celles qui se réclameraient d'une Alliance de Moïse : toutes partageraient plus ou moins le Temple et la Torah, mais ne les compren- draient pas de la même façon - ils divergeraient donc quant à leur inter- prétation de ce que l'on peut appeler les « universaux » du judaïsme, le bien commun à tous les Judéens.
Elchanan Reiner a bien montré combien, encore en plein Moyen Âge, le judaïsme est loin d'être monolithique et que dans la littérature rabbi- nique, même tardive, de nombreuses traditions hiératiques, pour ne pas dire plus, ont été récupérées à des fins de conservation et de transmis- sion sous une forme plus ou moins dissimulée - y compris des traditions chrétiennes pouvant remonter à des groupes chrétiens d'origine judéenne de Galilée, comme par exemple : la crucifixion de Jésus à Tibériade ou dans ses environs qui est mentionnée dans des passages araméens des Toledot Yeshou12.
Emmanuel Friedheim, pour sa part, a mis en évidence la présence de Judéens « polythéistes » en Palestine aux premiers siècles de notre ère, faisant notamment valoir que la lutte que conduisent les Sages phari- siens / rabbanites aux IIIe-IVe siècles contre la caducité du polythéisme atteste a contrario sa vigueur13.
Paul de Tarse, un Judéen de la Diaspora, semble pouvoir relever de l'Alliance d'Abraham qui, tout en acceptant la circoncision, a tendance à la relativiser surtout en remontant aux patriarches antérieurs - théori- quement non circoncis. Paul accepte le Temple et la Torah, mais dans ce dernier cas ce n'est sans doute pas la Torah de Moïse, celle qu'on dit orale, mais plutôt la Torah de Moïse, celle qu'on dit écrite. Originaire de Diaspora, Paul a été pharisien mais il est devenu chrétien : ce qui montre la fluidité et 1' hybriditě des boundaries idéologiques de cette époque.
À la suite des développements récents de la recherche, on peut se deman- der si les deux formes du christianisme qui sont mises généralement en
im spätantiken Palästina , Berlin, 2007. Voir aussi A. Kofsky - G.G. Stroumsa (Ed.), Sharing the Sacred. Religious Contacts and Conflicts in the Holy Land. First-Fifteenth Centuries CE , Jérusalem, 1998.
12 E. Reiner, «From Joshua to Jesus: The Transformation of a Biblical Story to a Local Myth: A Chapter in the Religious Life of the Galilean Jew», dans A. Kofsky - G.G. Stroumsa (Ed.), Sharing the Sacred. Religious Contacts and Conflicts in the Holy Land. First-Fifteenth Centuries CE , Jérusalem, 1998, p. 223-271.
13 E. Friedheim, Rabbinisme et paganisme en Palestine romaine. Étude historique des Realia talmudiques (Ier-IVe siècles ), Leyde, 2006.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
366 SIMON C. MIMOUNI
opposition, à savoir le christianisme d'origine judéenne (le judéo-christia- nisme) et le christianisme d'origine grecque (le pagano-christianisme), ne seraient pas plutôt deux conceptions du judaïsme chrétien : la première étant originaire de Palestine et de langue / culture araméenne (avec Jacques et Pierre / les hébreux) ; la seconde étant originaire de Diaspora et de langue /
culture grecque (avec Etienne et Paul / les hellénistes). De ce fait, on doit se demander si la focalisation sur l'orientation de la mission chrétienne vers
le monde grec / païen ne serait pas totalement erronée : ce n'est pas que le message chrétien ne se soit pas adressé aux Grecs, loin de là, mais qu'il s'est adressé seulement à ceux gravitant autour des communautés judéennes de Diaspora - du moins jusqu'à l'époque de Justin, voire bien après dans certaines régions de l'Empire romain (notamment en Anatolie). Au-delà des difficultés d'ordre rituel qui se sont posées entre les par-
tisans de l'une ou l'autre conception du christianisme, et qui ont dû déjà exister entre Judéens de Palestine et Judéens de Diaspora, ce qui est alors devenu l'enjeu, c'est l'intégration ou non des Grecs chrétiens à Israël et à l'économie divine du salut à partir de la seule croyance en Jésus le Messie et sans l'observance plus ou moins totale des pratiques : les Judéens chré- tiens originaires de la Palestine ont eu tendance à la refuser ou à la tolérer ; les Judéens chrétiens originaires de la Diaspora ont eu tendance à l'accepter. Cette situation a perduré durant longtemps car les Grecs ont adhéré autant à la conception universaliste (celle défendue par Paul) qu'à la conception particulariste (celle défendue par Jacques). Il n'y a pas eu nécessairement rupture entre ces deux conceptions, mais intégration progressive de l'une par l'autre : les circonstances politiques ont fait qu'à un moment donné la conception universaliste a absorbé la conception par- ticulariste - cette dernière continuant cependant à subsister sous une forme ou sous une autre durant des siècles.
Un point est certain, il faut se méfier de la terminologie technique que l'on rencontre dans les sources : surtout quand il s'agit des termes «Judéens» et «Grecs», «hébreux» et «hellénistes», «judaïsme» et « christianisme ». La circoncision n'est pas alors la ligne de partage entre Judéens et non Judéens comme elle le sera ensuite : il y a des Judéens qui observent la circoncision, il y en a qui la relativisent de différentes manières. C'est une question difficile à apprécier mais la circoncision ne détermine pas encore systématiquement, du moins aux Ier-IIe siècles de notre ère, l'appartenance à Israël14.
14 Voir S.C. Mimouni, La circoncision dans le monde judéen aux époques grecque et romaine. Histoire d'un conflit interne au judaïsme, Paris-Louvain, 2007.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
LES ORIGINES DU CHRISTIANISME 367
Allant dans le même sens, il convient aussi de signaler les travaux de Daniel Boyarín qui ont bouleversé les « frontières » de la pensée sur les origines du christianisme : notamment son Carnal Israel 15, mais aussi son Dying for God 16 ou son Border Lines11, de même que son recueil d'articles intitulés Sparks of the Logos1*. On peut et on doit évidemment critiquer l'utilisation des méthodes et des sources de D. Boyarín, qui ne sont pas toujours conformes, loin de là, à la démarche historienne19, mais on ne peut négliger ou ignorer ses travaux et l'on doit louer le côté génial, certains diront fou, de certaines intuitions de l'auteur qui avec le temps semblent porter leurs fruits. Comment encore ne pas être séduit par l'apport de D. Boyarín à la recherche sur le Prologue de Jean et sa contextualisation par rapport à la littérature judéo-grecque et judéo- araméenne - notamment la littérature pharisienne / rabbanite tardive dans ses rédactions mais pas dans ses traditions20.
Toujours dans la même perspective mais à partir de méthodes et de sources différentes, il convient de signaler aussi les recherches sur la liturgie chrétienne de Jérusalem entreprises avec succès ces dernières années par Stéphane Verfielst21 et par Daniel Stökl Ben Ezra22, qui mon- trent, avec également beaucoup d'intuition, combien les influences judéennes sont présentes dans les milieux chrétiens « orthodoxes » encore au IVe siècle, voire au Ve siècle, et pas uniquement dans l'imaginaire comme on le pense parfois.
15 D. Boyarín, Carnal Israel : Reading Sex in Talmudic Culture , Berkeley-Los Angeles/ Californie, 1993.
16 D. Boyarín, Dying for God. Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism , Stanford/Californie, 1999 (= Mourir pour Dieu. L'invention du martyre aux origines du judaïsme et du christianisme , Paris, 2004).
17 D. Boyarín, Border Lines : The Partition of Judaeo-Christianity , Philadelphie/ Pennsylvanie, 2004.
18 D. Boyarín, Sparks of the Logos. Essays in Rabbinic Hermeneutics , Leyde, 2003. 19 Voir S.C. Mimouni, dans Revue des études juives 166 (2007), p. 299-303 : recension
de Dying for God. Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism et Border Lines: The Partition of Judaeo-Christianity.
20 D. Boyarín, « The Gospel of the Memra : Jewish Binitarianism and the Prologue of John», dans Harvard Theological Review 94 (2001), p. 243-284.
21 S. Verhelst, Les traditions judéo-chrétiennes dans la liturgie de Jérusalem, spécia- lement la Liturgie de saint Jacques frère de Dieu , Louvain, 2003. Voir aussi S. Verhelst, « Pesiqta de-Rav Kahana, chapitre 1, et la liturgie chrétienne », dans Liber annuus 47 (1997), p. 129-138 et S. Verhelst, «Trois remarques sur la Pesiqta de-Rav Kahana et le christia- nisme», dans S.C. Mimouni - F.S. Jones (Ed.), Le judéo-christianisme dans tous ses états. Actes du Colloque de Jérusalem , 6-10 juillet 1998 , Paris, 2001, p. 366-380.
22 D. Stökl Ben Ezra, The Impact ofYom Kippur on Early Christianity. The Day of Atonement from Second Temple Judaism to the Fifth Century , Tübingen, 2003.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
368 SIMON C. MIMOUNI
Pour sa part, Charlotte Elisheva Fonrobert a montré combien les fron- tières sont à la fois floues et fixées au début du IIIe siècle en étudiant la
Didascalie des Apôtres qui est une sorte de « Mishnah for the Disciples of Jesus » - selon sa propre expression23. Les frontières sont floues par rapport à ce que l'on appelle aujourd'hui christianisme et judaïsme mais fixées par rapport aux chrétiens d'origine judéenne de Syrie considérés comme « hérétiques » par l'auteur de la Didascalie des Apôtres, un texte éminemment halakhique dont le fonctionnement herméneutique est assez proche de ce que l'on rencontre dans la tradition rabbinique la plus ancienne.
Il est peut-être temps de dire que les chercheurs, qui proposent de nou- velles perspectives sur les origines du christianisme, utilisent certaines méthodes et certains constats établis par les anthropologues spécialisés dans l'évolution de la culture : notamment les travaux de Homi K. Bhahba24
et de Terry Eagleton25 sur les dialogues entre des univers culturels, enten- dons religieux, se voulant et se donnant comme différents et opposés. Ces études ont mis au jour des stratégies culturelles ou identitaires de fait relativement similaires, voire communes, qui masquent des fragmenta- tions sociétales et imposent d'autres frontières que celles apparentes et qui nécessitent pour ce faire d'autres formes de langage ou de discours plus complexes qu'il est difficile de situer dans le temps et dans l'espace et de retrouver les influences réelles.
Pierluigi Piovanelli, dans ses nombreuses études sur le Livre du Coq, a démontré que des traditions et / ou des récits d'origine judéo-chrétienne ont conflué, à partir du IVe siècle, dans de nouveaux textes apocryphes parfaitement « orthodoxes »26. Rappelons que le Livre du Coq est un évan- gile apocryphe de la Passion de Jésus conservé en éthiopien mais vrai- semblablement rédigé en grec près de Jérusalem dans les années 451-479 - à une époque où le conflit entre chalcédoniens et monophysites occupe
23 C.E. Fonrobert, « The Didascalia Apostolorum : A Mishnah for the Disciples of Jesus », in Journal of Early Christian Studies 9 (2001), p. 483-509.
24 Voir notamment H.K. Bhahba, The Location of Culture, Londres, 1994. 25 Voir notamment T. Eagleton, The Idea of Culture, Oxford, 2000. 26 P. Piovanelli, « Exploring the Ethiopie Book of the Cock, an Apocryphal Passion
Gospel from Late Antiquity », dans Harvard Theological Review 96 (2003), p. 427-454 ; P. Piovanelli, « Marius Chaîne, Joseph Trinquet et la version éthiopienne du Livre du Coq », dans Transversalités. Revue de l'Institut catholique de Paris 85 (2003), p. 5 1-62 ; P. Piovanelli, « The Book of the Cock and the Rediscovery of Ancient Jewish Christian Traditions in Fifth Century Palestine », dans I.H. Henderson - G.S. Oegema (Ed.), The Changing Face of Judaism, Christianity and Other Greco-Roman Religions in Antiquity, Gütersloh, 2006, p. 308-322.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
LES ORIGINES DU CHRISTIANISME 369
les esprits27. Ce texte met en scène, dans le rôle du méchant, un Saul de Tarse plus antipathique que nature. Il semble adopter des perspectives anti- sacrificielles de type vaguement ébionite et il partage avec Y Évangile selon les Hébreux un ajout significatif à la recommandation donnée par Jésus en Mt 18, 21-22 et Le 17, 3-4 au sujet du pardon entre frères et sœurs - voir le fragment conservé par Jérôme dans Contre les Pélagiens UI, 2.
En dépit de ces traits si atypiques, surtout un antipaulinisme caracté- risé, le Livre du Coq a joui d'une réelle popularité auprès des chrétiens d'Égypte et d'Ethiopie : à un point tel qu'il fait, encore de nos jours, partie intégrante des lectures prévues pour la Semaine Sainte de l'Église orthodoxe éthiopienne.
Bref, comme le souligne P. Piovanelli, il serait vain d'expliquer le succès éthiopien de ce texte, comme de bien d'autres, en invoquant le poids des influences judéennes et / ou la permanence de la tradition judéo- chrétienne en Ethiopie, car de tels phénomènes, quand ils ne sont pas de simples illusions historiographiques, ne présupposent pas forcément l'existence de contacts réels entre des groupes judéo-chrétiens et les chrétiens du royaume d'Axoum28.
Il y a donc lieu de tenir pour important l'influence des traditions judéo-chrétiennes dans les textes datant d'entre 325 et 451, voire après : ce qui ne sous-entend pas que ces textes sont nécessairement d'origine judéo-chrétienne. Il en a été de même pour d'autres textes palestiniens du IVe ou du Ve siècle où les traces d'une influence des traditions judéo- chrétiennes sont de plus en plus mises au jour : c'est le cas notamment pour Y Invention des reliques de la Sainte Croix, pour Y Invention des reliques de Jacques et pour Y Invention des reliques d' Etienne. Ce serait aussi le cas si les recherches en cours le confirmaient pour les Actes de Pilate : un texte palestinien également du IVe siècle29.
Une problématique que l'on retrouve plus ou moins à l'identique dans le Sacerdoce du Christ : un écrit considéré, lui, comme de l'époque jus- tinienne30. Dans tous ces textes, le rôle des Judéens dans la stratégie
27 Pour une traduction française, voir P. Piovanelli, « Livre du Coq », dans P. Geol- train - J.-D. Kaestli (Ed.), Ecrits apocryphes chrétiens, II, Paris, 2005, p. 135-203.
28 P. Piovanelli, «Les controverses théologiques sous le roi Zar'a Yâ'Qob (1434- 1468) et la mise en place du monophysisme éthiopien », dans A. Le Boulluec (Ed.), La controverse religieuse et ses formes, Paris, 1995, p. 189-228 ; P. Piovanelli, « Connais- sance de Dieu et sagesse humaine en Ethiopie. Le traité Explication de la Divinité attri- bué aux hérétiques 'mikaélites' », dans Le Muséon 117 (2004), p. 193-227.
29 Voir R. Gounelle, « Jésus, roi du peuple dans les Actes de Pilate » , dans Religions et Histoire 15 (2007), p. 47-49.
30 Voir F. Nuvolone, «Jésus, 22e prêtre du Temple de Jérusalem dans le Sacerdoce du Christ», dans Religions et Histoire 15 (2007), p. 50-52.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
370 SIMON C. MIMOUNI
littéraire de leurs auteurs est à étudier de près pour savoir à quoi ils répondent pour les destinataires, les lecteurs implicites : il n'est pas ano- din et répond à un intérêt qui est à mettre au jour car il ne relève pas encore d'une simple lutte entre judaïsme et christianisme, encore moins d'un antijudaïsme. Actuellement, la prudence s'impose dans les recherches sur le judéo-
christianisme car la Ugnę de partage entre le judaïsme et le christianisme a tendance à bouger, et les bornes en deviennent de plus en plus floues comme elles l'ont sans doute été dans l'Antiquité à l'intérieur de l'Empire romain. Il paraît de plus en plus évident, en effet, que le christianisme impose
certaines de ses définitions et de ses limitations à une époque relativement tardive, non pas nécessairement en éliminant mais en intégrant ses marges : c'est ainsi que le judéo-christianisme de Jérusalem et de Palestine aux IVe- Ve siècles s'est retrouvé dans la Grande Église et que ses traditions ont été intégrées dans le cadre d'une littérature devenue tentaculaire et florissante. Parmi les nombreuses publications parues ces dernières années, il convient de relever l'imposant ouvrage collectif dirigé par Oskar Skar- saune et Reidar Hvalvik et qui vient d'être publié, en 200731 : un véritable manuel dans lequel toutes les questions touchant de près ou de loin au judéo-christianisme ancien sont présentées. Selon Pierluigi Piovanelli, dans une étude stimulante aux contours
parfois surprenants pour ne pas dire stupéfiants, c'est au cours des années qui séparent le concile de Nicée de 325 du concile de Chalcédoine de 451 que les différents courants du christianisme méditerranéen, ceux des tendances judaïsantes comme ceux des tendances gnosticisantes, ont été à même de renouer leurs contacts sur le terrain et de redécouvrir ainsi les traditions memoriales des uns et des autres dans le cadre d'une « proto-
orthodoxie »32. Cette petite « mondialisation », comme il l'appelle, n'a été que de courte durée, avant que les forces centrifuges des particularismes régionaux ne reprennent de la vigueur en donnant naissance aux Églises locales des futures entités nationales du Moyen Âge. Par la suite d'ailleurs, ces Églises ont fini par se retrouver plus ou
moins seules à gérer leurs propres patrimoines culturels, liturgiques et
31 O. Skarsaune - R. Hvalvik (Ed.), Jewish Believers irt Jesus: A History from Antiquity to the Present, I, Peabody/Massachusetts, 2007. 32 P. Piovanelli, « Le recyclage des textes apocryphes à l'heure de la petite mondia-
lisation de l'Antiquité tardive (ca. 325-451). Quelques perspectives littéraires et histori- ques», dans A. Frey - R. Gounelle (Ed.), Poussières de christianisme et de judaïsme antiques. Études réunies en l'honneur de Jean-Daniel Kaestli et Eric Junod, Lausanne, 2007, p. 277-295.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
LES ORIGINES DU CHRISTIANISME 37 1
scripturaires, les canoniques comme les apocryphes. C'est dans ce contexte que P. Piovanelli situe l'une des dynamiques qui a donné lieu à la pro- duction exceptionnelle d'un certain nombre d'écrits apocryphes relative- ment tardifs dont la raison d'être a été notamment la nécessité d'assimiler
et de recycler la grande variété des traditions judaïsantes et gnosticisantes des siècles précédents : en d'autres termes, c'est à partir de ces traditions que l'on a forgé une littérature apocryphe nouvelle de type « orthodoxe » - un véritable acte de recyclage tardif, phénomène de récupération et d'appropriation.
Pour ce critique, le recours à la notion d'une « orthodoxie » tardo- antique ne signifie pas que cette période a été caractérisée par une uni- formité des croyances et des pratiques supérieure à celle de n'importe quel autre moment de l'histoire du christianisme : bien au contraire, cela doit plutôt renvoyer à une prise de conscience de l'existence d'un chris- tianisme universel, aux doctrines desquelles tous les fidèles sont censés se plier - bref, une idéologie à l'élaboration de laquelle le pouvoir impé- rial n'est certainement pas étranger, tellement sa présence est attestée dans les écrits.
Il convient d'observer que tout texte est un acte de communication narrative qui comporte des dimensions à la fois rhétoriques, culturelles, intertextuelles, idéologiques et sociales. Les liens complexes que les pro- ductions apocryphes du IVe ou du Ve siècle entretiennent avec les textes et les traditions qui les ont précédées, sont de nature éminemment inter- textuelles : les uns et les autres s'inscrivant dans un processus d'actuali- sation et de réécriture constantes des mêmes traditions memoriales qui se rapportent aux origines chrétiennes.
Il n'est évidemment pas encore possible d'apprécier dans toutes leurs dimensions et perspectives ces hypothèses nouvelles, d'autant qu'il faut généralement du temps pour imposer toute nouveauté. Cependant, les recherches actuelles permettent de plus en plus d'établir une distinction entre l'avant 325 et l'après 451 : avant 325, le christianisme n'est pas encore une religion ; après 45 1 , le christianisme est une religion. Entre ces deux dates, le christianisme est dans une période de formation d'une orthodoxie pour ses écritures, ses traditions et ses doctrines. Les traditions judéo-chrétiennes de Jérusalem, notamment celles relatives aux inven- tions des reliques de la Sainte Croix, de Saint Jacques et de Saint Etienne sont sans doute à percevoir dans un contexte de récupération et d'appro- priation. En Palestine, le IVe siècle est une période charnière où judaïsme et christianisme sont extrêmement mêlés - sans oublier le paganisme qui est loin d'avoir déjà disparu. Il est fort possible d'ailleurs que nombre de
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
372 SIMON C. MIMOUNI
Judéens soient passés du judaïsme au christianisme sans avoir eu l'impres- sion de franchir une quelconque frontière religieuse : Joseph de Tibériade en est un exemple remarquable33. Il convient de savoir, en effet, que pour un Judéen qui attend l'arrivée du Messie, adhérer à la forme messianique qui l'identifie en Jésus de Nazareth n'est pas un grand problème - du moins dans l'Antiquité. Ce n'est qu'au Moyen Âge, et à la suite des persécu- tions à destination du judaïsme, que les rapports entre christianisme et judaïsme vont changer de manière radicale - ce qui conduira d'ailleurs au renforcement du rabbinisme relativement anti-messianique pour ne pas dire totalement anti-chrétien. D'ailleurs, un Judéen qui adhère aux croyances chrétiennes refuse
généralement le baptême car il se fíense justifié par la Loi en se fondant sur l'idée que le « Christ et les apôtres » appartiennent à la nation judéenne et que le salut vient de celle-ci, ainsi qu'il est rapporté dans le Sacerdoce du Christ, un écrit selon toute apparence du VIe siècle, où il est affirmé que « C'est sur la base de nos fondements qu'il convient de mener à terme l'édification de la croyance et de nous préparer tous, d'un commun accord, à devenir adhérents (disciples) du Messie » (§5 selon la version géorgienne). Ce qui pose le problème extrêmement débattu du moment de la sépa-
ration entre judaïsme et christianisme et surtout celui de savoir quel judaïsme s'est séparé de quel christianisme : c'est ainsi qu'il faut doréna- vant poser le problème. En tout cas, comme le montrent Annete Y. Reed et Adam H. Becker, les boundaries ont tendance à bouger depuis plusieurs années, passant, pour certaines formes du judaïsme et du christianisme, du IIe au IVe siècle34.
Comment ne pas faire référence à Bart D. Ehrman qui a publié en 2003 un ouvrage important sur la question des origines du christianisme dont les limites sont portées au début du IVe siècle35. Pour ce faire,
33 S.C. Mimouni, « U Hypomnesticon de Joseph de Tibériade : une œuvre du IVe siè- cle? », dans Studia Patrística XXXII , Twelfth International Conference on Patristic Stu- dies, Oxford 21-26 August 1995 , Louvain, 1997, p. 346-357. 34 A.Y. Reed - A.H. Becker, « Introduction : Traditional Models and New Direc-
tions», dans A.H. Becker - A.Y. Reed (Ed.), The Ways That Never Parted . Jews and Christians in Late Antiquity and the Early Middle Ages , Tübingen, 2003, p. 1-33. Voir aussi A. S. Jacobs, «The Lion and the Lamb: Reconsidering Jewish-Christian Relations in Antiquity », dans A.H. Becker - A.Y. Reed (Ed.), The Ways That Never Parted. Jews and Christians in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Tübingen, 2003, p. 95-1 18. 35 B.D. Ehrman, Lost Christianities. The Battles for Scripture and the Faiths We
Never Knew , Oxford, 2003 (= Les christianisme s disparus. La bataille pour les Écritures : apocryphes, faux et censures , Paris, 2007). Voir aussi B.D. Ehrman, Lost Scriptures. Books That Did not Make it into the New Testament , Oxford, 2003.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
LES ORIGINES DU CHRISTIANISME 373
l'auteur a largement puisé aux catégories de la «proto-orthodoxie», du «judéo-christianisme » et du « christiano-gnosticisme » afin de traiter des « christianismes disparus » - une reconstruction du christianisme pluriel des premiers siècles qui a été rendue possible notamment grâce aux études fondatrices réunies en 1987 par James M. Robinson et Helmut Koester36. Le sujet de cet ouvrage est de pointer la grande diversité du « premier christianisme » et de ses textes sacrés. Certains ont été incorporés dans le canon du Nouveau Testament. D'autres ont été rejetés, attaqués, interdits et détruits. Le but de l'auteur est d'examiner quelques-uns de ces écrits non-canoniques (notamment Y Évangile secret de Marc), de voir ce qu'ils peuvent apporter sur les différentes formes des croyances et des pratiques chrétiennes durant les IIe et IIIe siècles, et de considérer comment l'un des premiers groupes chrétiens a pris le dessus et a déterminé, pour les siècles à venir, ce que les chrétiens doivent croire, pratiquer et lire comme Écritures sacrées. Bref, cet ouvrage est consacré aux textes et aux formes disparues de christianisme qu'ils ont tentées de légitimer. Pour l'auteur, la grande diversité du christianisme actuel n'est pas nouvelle. Dans le monde antique, il en a été de même. Ce qui est normal car tout phéno- mène religieux conduit à la variété. Quoi qu'il en soit, une forme de christianisme est sortie vainqueur des conflits des IIe et IIIe siècles. Grâce à l'appui du pouvoir impérial, cette forme s'est déclarée unique et cor- recte : elle a décidé qui peut exercer son autorité sur les croyances et pratiques chrétiennes et elle a déterminé quelles formes du christianisme seraient marginalisées et donc détruites. Cette forme a décidé quels livres doivent figurer dans le canon des Écritures et lesquels seraient déclarés hérétiques parce qu'enseignant des idées fausses.
Si l'on va au bout de ce raisonnement, la mise en place du canon « orthodoxe » ne serait pas antérieure au IVe siècle, comme d'ailleurs certains critiques le proposent depuis longtemps. Par ailleurs, le parti vic- torieux a réécrit l'histoire de la controverse, faisant apparaître qu'il n'y a jamais eu de conflits soutenant que ses propres idées ont de tout temps été celles de la majorité des chrétiens, à commencer par l'époque de Jésus et de ses premiers disciples : autrement dit, sa perspective a toujours été «orthodoxe» et les perspectives adverses ont toujours représenté de petits groupes dissidents, occupés à pousser les fidèles dans l'hérésie. Ce que le christianisme vainqueur a gagné au terme de ces conflits initiaux,
36 J.M. Robinson - H. Koester, Trajectories Through Early Christianity , Philadelphie/ Pennsylvanie, 1971.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
374 SIMON C. MIMOUNI
c'est une sorte de confiance d'avoir toujours eu «raison», d'avoir tou- jours détenu la « vérité ».
La réévaluation de B.D. Ehrman conduit à une révision de l'histoire
du christianisme ancien qui doit sortir de l'ornière dans laquelle l'ont placée les historiens ecclésiastiques à partir d'Eusèbe de Cesaree qui, au début du IVe siècle, a retracé les commencements du christianisme.
Pour développer sa thèse, l'auteur organise son ouvrage en trois parties principales. La première, intitulée « Faux et découvertes », porte sur plu- sieurs textes problématiques qui sont : Y Evangile selon Pierre, les Actes de Paul et Thècle, Y Évangile selon Thomas, Y Évangile secret de Marc. Dans la deuxième partie, intitulée « Hérésies et orthodoxie », sont présentés les croyances et plusieurs groupes chrétiens : les ébionites, les marcionites et les gnostiques. Dans la troisième partie, intitulée « Les gagnants et les perdants», sont examinés les conflits qui ont opposé ces groupes alors que chacun a combattu pour convaincre que ses idées sont bonnes et que celles des autres sont erronées. C'est dans cette dernière partie qu'est montré comment les chrétiens «proto-orthodoxes», engagés dans ces batailles intestines, ont fini par gagner.
Ces confrontations, selon l'auteur, se sont déroulées en grande partie sur le terrain littéraire, les membres de ce groupe « proto-orthodoxe » ayant produit des traités polémiques en réponse à d'autres opinions chrétiennes, ayant fabriqué de faux textes sacrés pour appuyer leurs propres points de vue et ayant réunis d'autres écrits dans un canon sacré d'Écritures pour défendre leurs opinions et contrer celles des autres.
La forme de christianisme, qui a émergé des conflits des IIe et IIIe siè- cles, est devenue la religion de l'Empire romain : à partir de là, elle s'est transformée en une institution religieuse, politique, économique, sociale et culturelle. Sur le plan doctrinal, une fois que la proto-orthodoxie a établi que le Christ est à la fois humain et divin, il est resté à déterminer la relation entre son humanité et sa divinité : autrement dit, comment le Christ peut être à la fois un être humain et un être divin. C'est ainsi que de nombreuses propositions ont été avancées et débattues, parfois avec violence, au cours des IVe et Ve siècles.
Il convient enfin d'observer que les idées de la proto-orthodoxie, à leur tour, n'ont pas été surpassées mais proscrites : comme l'affirme B.D. Ehrman, la proto-orthodoxie elle-même est devenue un christianisme disparu. Il semble difficile de penser que la catégorie de la proto-ortho- doxie soit à retenir car elle embrouille plus qu'elle démêle des données déjà complexes. Il n'en demeure pas moins qu'il conviendra cependant de revoir les catégories actuellement utilisées.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
LES ORIGINES DU CHRISTIANISME 375
Il paraît, par exemple, de plus en plus difficile de considérer le gnosti- cisme comme une catégorie historico-religieuse comme on l'a fait jusqu'à présent37 : il serait en effet préférable de parler de tendances gnosticisantes, c'est-à-dire d'une forme de pensée mystique sur la conception plus ou moins complexe du monde d'en bas considéré comme mal et du monde d'en haut considéré comme bon, dans laquelle le divin intervient d'une manière ou d'une autre.
Depuis la parution de cet ouvrage, sous la direction de Lewis Ayres, le Journal of Early Christian Studies vient de publier un dossier sur la question de l'orthodoxie où ce problème est revisité à partir de trois Pères de l'Église que B. Ehrman qualifie de «proto-orthodoxes», à savoir38: Origene (par Catherine M. Chin39), Tertullien (par Andrew McGowan40) et Eusèbe (par Mark DelCogliano41) - l'ensemble précédé par une reprise en traduction anglaise d'une recension du livre de Walter Bauer par Walter Völker parue en 193542.
Il est à craindre que le caractère ésotérique du mouvement chrétien aux trois premiers siècles doive de plus en plus retenir l'attention des cher- cheurs. Il en est ainsi déjà avec les travaux de Guy G. Stroumsa sur l'éso- térisme chrétien dont le premier est paru en 199643 et le second en 199944 - en réalité, ce sont des recueils d'articles.
37 Voir G. Chiapparini, « Gnosticismo : fine di una categoria storia-religiosa ? A pro- posito di alcune tendenze recenti nell'ambito degli studi gnostici », dans Annali di Scienze Religiose 11 (2006), p. 181-217.
38 L. Ayres, «The Question of Orthodoxy», dans Journal of Early Christian Stu- dies 14 (2006), p. 395-398.
39 C.M. Chin, « Origen and Christian Naming : Textual Exhaustion and the Boundaries of Gentility in Commentary on John 1 », dans Journal of Early Christian Studies 14 (2006), p. 407-436.
40 A. McGowan, «Tertullian and the 'Heretical' Origins of the 'Orthodox' Trinity», dans Journal of Early Christian Studies 14 (2006), p. 437-457.
41 M. DelCogliano, « Eusebian Theologies of the Son as the Image of God before 341 », dans Journal of Early Christian Studies 14 (2006), p. 459-484.
42 W. Völker, «Walter Bauer's Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christen- tum», dans Journal of Early Christian Studies 14 (2006), p. 399-405.
43 G.G. Stroumsa, Hidden Wisdom: Esoteric Traditions and the Roots of Christian Mysticism , Leyde, 1996. Voir aussi G.G. Stroumsa, « Paradosis : traditions ésotériques dans le christianisme des premiers siècles », dans Apocrypha 2 (1991), p. 133-153 (= Savoir et salut. Traditions juives et tentations dualistes dans le christianisme ancien , Paris, 1992, p. 127-153 ; Hidden Wisdom: Esoteric Traditions and the Roots of Christian Mys- ticism , Leyde, 1996, p. 27-45).
44 G.G. Stroumsa, Barbarian Philosophy. The Religious Revolution of Early Chris- tianity , Tübingen, 1999.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
376 SIMON C. MIMOUNI
Les hypothèses éloquentes de G.G. Stroumsa sont contestées par cer- tains45 et acceptées par d'autres46. Au-delà des difficultés qu'une pers- pective nouvelle a nécessairement à s'imposer, il n'en demeure pas moins qu'on doit se demander comment une pensée religieuse, qui prône une eschatologie immédiate, pourrait prendre une forme exotérique et non pas une forme ésotérique dans un monde romain où le religieux est dominé par une religion impériale / officielle à laquelle tous les habitants doivent obligatoirement participer en dehors de ceux qui appartiennent à des religions anciennes, notamment les Judéens qui en sont dispensés grâce à une législation spécifique. Le christianisme des origines, du moins certaines de ses tendances,
a tenté d'imposer à ses disciples un intime rejet des valeurs terrestres au nom de la pureté d'une croyance portée vers le seul divin, comme il est rapporté, par exemple, en Je 4, 4 : « Hommes et femmes infidèles, ne savez-vous pas que l'amitié envers le monde est hostilité contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se fait donc ennemi de Dieu ! » - une idée qu'on retrouve aussi, sous des formes sensiblement différentes, chez Jésus en Mt 6, 24, chez Paul en Rm 8, 7 ou chez Jean en 1 Jn 2, 15. Concernant, le caractère ésotérique du mouvement chrétien, les travaux
de P. Piovanelli constituent un apport aussi précieux qu'important47. Cer- tains critiques essaient de repenser de manière fondamentale les identités que l'on englobe sous les ensembles religieux de «judaïsme» et de «chris- tianisme» en reconsidérant certains concepts comme celui de race, d'eth- nicité ou de religion : ainsi que le propose Denise K. Buell48. D'autres cri- tiques proposent de repenser les frontières en considérant la perception de
45 Pour l'ouvrage de 1996, voir les recensions de C. Kannengiesser, dans Journal of Religion 78 (1998), p. 268-269 et J.-D. Dubois, dans Archives des sciences sociales des religions , 43/104 (1998), p. 125-126 et pour l'ouvrage de 1999, voir la recension de J.-D. Dubois, dans Archives des sciences sociales des religions , 46/116 (2001), p. 143- 144 qui contestent les positions de G.G. Stroumsa. 46 Voir R.A. Baker, « The Secret Oral Tradition of Jesus Revealed in Clement of
Alexandria's Stromateis », dans P. Allen - W. Mayer - L. Cross (Ed.), Prayer and Spirituality in the Early Church , II, Brisbane, 1999, p. 229-243 qui accepte les positions de G.G. Stroumsa.
47 P. Piovanelli, « L 'Évangile secret de Marc trente-trois ans après, entre potentia- lités exégétiques et difficultés techniques», dans Revue biblique 114 (2007), p. 52-72 et p. 237-254.
48 D.K. Buell, « Rethinking the Relevance of Race for Early Christian Self-Definition », dans Harvard Theological Review 94 (2001), p. 449-476. Voir aussi D.K. Buell, « Race and Universalism in Early Christianity », dans Journal of Early Christian Studies 10 (2002), p. 429-468. Voir surtout D.K. Buell, Why This New Race : Ethnic Reasoning in Early Christianity , New York, 2005.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
LES ORIGINES DU CHRISTIANISME 377
la circoncision entre le IVe et le VIIe siècle en se focalisant sur des catégo- ries littéraires peu encore utilisées avec une telle perspective, comme par exemple la littérature dialogique, ainsi que le propose Andrew S. Jacobs49.
Un point apparaît en effet de plus en plus évident : il y a eu un judaïsme se rattachant à l'Alliance de Moïse répandu parmi les Judéens de Palestine ; il y a eu un judaïsme se rattachant à l'Alliance d'Abraham répandu parmi les Judéens de Diaspora - on l'a déjà dit mais il convient de le redire, d'autant que la situation est autrement plus complexe que cette répartition.
Le christianisme est issu de ces deux catégories de judaïsme : on peut dire, par exemple, que Jacques de Jérusalem relève de l'Alliance de Moïse tandis que Paul de Tarse relève de l'Alliance d'Abraham. L'Alliance d'Abraham est celle sur laquelle a été fondé le judaïsme chrétien, qui s'inscrit dans la chaîne des mystiques attestés dans les littératures apo- calyptiques. L'Alliance de Moïse est celle sur laquelle a été fondé le judaïsme rabbanite, qui s'inscrit dans la chaîne des pharisiens, des tan- naïtes et des amoraïtes. Autrement exprimé, l'Alliance d'Abraham serait alors l'Israël spirituel et de la circoncision spirituelle, YHebrewness, tan- dis que l'Alliance de Moïse serait l'Israël charnel et de la circoncision charnelle, la Jewishness. Pour certains Pères de l'Église, les chrétiens descendent des Hébreux qui viennent d'(H)Abraham - dans cette généa- logie, ils ne se réclament évidemment pas du judaïsme de Moïse mais du judaïsme d'Abraham.
On doit se demander si un auteur comme Philon d'Alexandrie ne pour- rait pas relever de la ligne de pensée de l'Alliance d'Abraham - l'hypo- thèse est à explorer, même si elle n'est pas aussi simple car cet auteur s'est aussi intéressé à la Loi de Moïse, mais plus écrite qu'orale. De fait, l'Alliance d'Abraham intègre l'Alliance de Moïse mais en la
relativisant dans son application. Il a existé une tendance judéenne d'obé- dience chrétienne qui s'inscrit dans l'Alliance d'Abraham, c'est celle que l'on retrouve notamment dans le mouvement ébionite et dans le mouve-
ment elkasaïte : le premier est sans doute à l'origine du mahométisme et le second du manichéisme comme du mandéisme. C'est donc une ligne de pensée importante qu'il convient d'étudier afin de mieux la mettre au jour: voir par exemple l'ouvrage de Jeffrey S. Siker qui n'a pas eu, lors de sa publication, toute l'attention qu'il aurait méritée50.
49 A.S. Jacobs, « Dialogical Differences : (De-)Judaizing Jesus' Circumcision », dans Journal of Early Christian Studies 15 (2007), p. 291-335.
50 J.S. Siker, Disinheriting the Jews: Abraham in Early Christian Controversy , Louisville/Kentucky, 1991. Voir surtout J.S. Siker, «Abraham in Graeco-Roman Paga- nism », dans Journal for the Study of Judaism 18 (1987), p. 188-208.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
378 SIMON C. MIMOUNI
En réalité, la situation est bien plus complexe, si l'on fait intervenir d'autres critères : comme par exemple ceux autour des « prêtres » et des «sages», les premiers sont attachés à la Palestine et les seconds à la Babylonie.
On peut aborder ces questions avec d'autres modèles : ceux par exemple du judaïsme de Jacob, fondé sur la généalogie, et du judaïsme d'Abraham, fondé sur l'alliance. Dans un cas comme dans l'autre, la création remon- tant à Adam joue un rôle non négligeable même s'il n'est pas toujours identique. Le judaïsme d'Abraham semble être à l'origine du phénomène des sympathisants qui apparaît au Ier siècle de notre ère, mais qui pourrait être plus ancien d'autant qu'il est vraisemblablement fondé sur le statut du «résident-étranger» dans l'Ancien Israël: il est cependant attesté de manière éparse dans la littérature rabbinique ancienne des IIe-IIIe siècles avec les préceptes noachiques.
On le constate, de toute part l'édifice historiographique de ces dernières décennies est mis à mal par des recherches de plus en plus déconstruc- trices des schémas hérités des historiens ecclésiastiques antiques de tout bord et insuffisamment critiqués. Ces perspectives sont encore trop nou- velles et d'un aspect tellement paradoxal qu'il est difficile de les prendre vraiment en considération, mais il est tout aussi difficile de les ignorer. C'est pourquoi, il faut prendre le temps de la réflexion pour savoir si elles peuvent être opératoires de manière cohérente pour l'ensemble de la docu- mentation existante. Il n'en demeure pas moins que ces perspectives sont décapantes pour l'esprit, car elles bouleversent les idées reçues : elles pourraient bien expliquer le caractère hybride des judaïsmes et des chris- tianismes antiques qui ont préféré, à partir d'une certaine époque, se décliner au singulier au travers d'un concept créé de toute pièce mais qui demeure cependant composite : il s'agit de l'orthodoxie51. De fait, on n'a pas inventé l'hérésie comme on le dit souvent, on a inventé l'orthodoxie qui a suscité l'hérésie pour ceux qui ont refusé de rejoindre la ligne de pensée décrétée de manière apparemment unilatérale comme unique. La définition de l'orthodoxie tant dans les judaïsmes que dans les christia- nismes repose sur des compromis issus de réunions de conciliation, c'est pourquoi elle a toujours débouchée sur des dissensions.
Pour l'historien, il en ressort la nécessité de reconstruire de manière cohérente une histoire des origines du christianisme qui tient compte de l'émergence tardive de ces religiosités que l'on appelle christianisme et
51 Voir D. Boyarín - V. Burrus, « Hybridity as Subversion of Orthodoxy ? Jews and Christians in Late Antiquity», dans Social Compass 52 (2005), p. 431-441.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
LES ORIGINES DU CHRISTIANISME 379
judaïsme dans leur volonté de se définir à des fins de positionnement comme «orthodoxe», à une époque où la concurrence est encore forte entre les divers groupes qui s'en réclament. Si l'on veut mieux compren- dre les documents du Ier siècle, il est nécessaire d'envisager la longue durée : notamment pour réaliser comment et pourquoi ils ont été transmis et par qui ils ont été transmis.
Les spécialistes de Y Évangile selon Thomas considèrent que ce texte est plus ou moins contemporain, du moins en partie, des évangiles cano- nisés par la suite, et pourtant, lui, ne l'a pas été. Il en va sans doute de même pour les Évangiles selon les Hébreux et selon les Ébionites dont les traditions sont plus ou moins semblables à celles reprises dans les Synoptiques52.
Le problème de la mise en corpus de certains de ces documents aux dépens d'autres documents ne se comprend également que sur la longue durée, et ce peu importe la date de constitution du canon du Nouveau Testament, dont la plupart des écrits sont connus et utilisés par les grands auteurs qui deviendront plus tard « orthodoxes » et même par ceux qui ne le deviendront pas.
Il a été question ici de la littérature éthiopienne, on devrait rappeler encore que la littérature syriaque est également un conservatoire de tra- ditions chrétiennes anciennes qui remontent souvent à une époque où judaïsme et christianisme ne sont pas encore séparés, ou du moins pas encore de manière définitive. Les traductions syriaques les plus anciennes de l'Ancien Testament ont été réalisées, aux IIe-IIF siècles, à partir d'ori- ginaux en hébreu par des chrétiens sans doute d'origine judéenne, en tout cas « judaïsants » - les manuscrits étant des Ve- VIe siècles. Le christia- nisme de langue syriaque est sans doute celui qui a été le plus marqué par les chrétiens d'origine judéenne, surtout celui qui a transmis une littéra- ture en christo-araméen dont les traces sont encore substantielles.
Il apparaît en effet de plus en plus certain, nonobstant l'opinion de certains spécialistes, que le christo-araméen a été le dialecte des chrétiens d'origine judéenne. La thèse de l'origine judéo-chrétienne a été proposée jadis par Paul Kokowzoff (1906) et Theodor Nöldeke (1868), elle a été reprise plus récemment, en 1988, par Moshe Bar-Asher53. Elle considère que les communautés de langue et d'écriture christo-araméennes ont été
52 S.C. Mimouni, Les fragments évangéliques judéo-chrétiens « apocryphisés » . Recher- ches et perspectives, Paris, 2006.
53 M. Bar-Asher, « Le syro-palestinien - Études grammaticales », dans Journal asia- tique 276 (1988), p. 27-59, spécialement p. 28.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
380 SIMON C. MIMOUNI
constituées à l'origine par des chrétiens d'origine judéenne qui, pour se démarquer des communautés judéennes non chrétiennes mais aussi des communautés chrétiennes d'origine grecque, ont été obligées d'adopter une langue et une écriture différentes. En suivant la définition proposée par Moshe Bar-Asher, précisons qu'on appelle christo-araméen la branche chrétienne de l'araméen palestinien qui fait partie de l'araméen occidental : celui-ci a été utilisé dans différentes régions de Palestine et d'Arabie, voire de Syrie et d'Égypte, entre le moment où l'on a cessé de parler l'hébreu (au début du IIIe siècle) et celui où il a été lui-même supplanté par l'arabe (au milieu du VIIIe siècle). Les christo-araméens sont sans doute les descendants des judéo-chrétiens palestiniens - plutôt de type nazoréen que de type ébionite, comme certains critiques l'ont proposé en se fondant sur la doctrine de leurs textes liturgiques peu éloignée de l'orthodoxie qui se met en place au IVe siècle. D'ailleurs, les nazoréens disparaissent en tant que tels dans la documentation chrétienne au début du Ve siècle, à un moment où les christo-araméens apparaissent dans l'histoire : l'analyse des représentations véhiculées par les désignations linguistiques abonde dans ce sens. Un dernier élément fondamental est à souligner : les mondes antiques
ne fonctionnent pas selon les critères de pensée et de société des mondes médiévaux et des mondes modernes. C'est certes une évidence, mais alors
il faut cesser de plaquer sur les mondes antiques des situations qui sont postérieures aux VIIe- VIIIe siècles, surtout quand il s'agit de religions comme le christianisme et le judaïsme qui, sous la pression de l'islam, sont obligés de se donner une nouvelle facture bien plus politique - laquelle certes s'est mise en place dès le IVe siècle, mais a pris plusieurs siècles pour s'imposer aux populations romaines, ou continuant à se situer dans cette tradition, et ce tant en Orient qu'en Occident. Comment conclure cet état des questions et des recherches ? Il convient
de souligner qu'il est sans doute incomplet car reposant sur le hasard des « rencontres » dans les revues et les livres. L'histoire des origines du chris- tianisme a été reconsidérée au cours de ces vingt dernières années. Il est à craindre qu'il faille encore reprendre les résultats auxquels on est déjà parvenus. La parution de travaux à un rythme soutenu et les changements de paradigmes, voire de paramètres, sont tels que le chercheur éprouve maintes difficultés à suivre - sans compter que les supports éditoriaux se multiplient, y compris sous des formes informatisées, comme par exem- ple la revue en ligne IO Y A AIOS. La plupart des paradigmes ici envisagés varient en fonction de la ligne
de partage entre ce que l'on appelle judaïsme et christianisme. C'est ainsi
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
LES ORIGINES DU CHRISTIANISME 38 1
qu'en quelques décennies, on a fait passer cette ligne de l'an 50, avec la réunion de Jérusalem, à l'an 70, avec l'échec de la première révolte, puis à l'an 135, avec l'échec de la seconde révolte. Maintenant, certains critiques n'hésitent pas à situer cette ligne de partage, le Parting of the Ways, entre 325 et 451 : pour ce faire, ils se fondent sur une argumentation cohérente prenant en compte le plus possible d'écrits et non pas le moins possible, c'est-à-dire les apocryphes aussi bien que les canoniques. Ce qui ne les empêche pas de considérer que le judaïsme « rabbinique », celui des Sages, et le christianisme «orthodoxe», celui des Pères, trouvent leurs racines profondes au Ier siècle de notre ère qu'ils reprennent à des fins de légitimité. Pour eux, il s'agit seulement d'indiquer que l'éloignement, qui se met en place progressivement dans la concurrence, ne s'est pas rapidement consommé de manière définitive ou radicale et sans esprit de retour - tout au moins pour certains courants qui ont espéré durant longtemps maintenir une «synthèse», et non pas un «syncrétisme» comme l'ont affirmé leurs détracteurs, entre croyance messianique et observances halakhiques.
On le voit notamment à propos de l'observance du sabbat dont l'abroga- tion dans le christianisme orthodoxe nécessite une décision du concile de
Laodicée de 378, laquelle ne résoudra rien. D'autant qu'elle sera interprétée et comprise comme une interdiction d'observer le sabbat avec les Judéens, mais pas de ne pas l'observer - Maxime le Confesseur, au VIIe siècle, est encore obligé de revenir sur cette question en proposant notamment une interprétation allégorique assez complexe pour ne pas dire mystique du sabbat54.
La « barrière de séparation, de la haine » (Ep 2, 14), invoquée par Paul dans une de ses lettres à propos du rapport entre chrétiens d'origine judéenne et chrétiens d'origine grecque, ne doit pas impressionner l'his- torien qui sait, par expérience, que tout discours n'est que théorique, surtout quand il s'agit d'un discours d'exclusion - les réalités sont tout autres, et ce sont elles qui l'intéressent ou devraient l'intéresser en se fondant de manière critique sur ses sources, ses questions, ses concepts et ses méthodes.
Quoi qu'il en soit de cette forme de pensée devenue désormais appa- remment obsolète, le consensus établi dans l'ouvrage collectif dirigé par James D.G. Dunn, édité en 199255, est en train de voler en éclat sous les
54 Voir G. Benevich, «The Sabbath in St. Maximus the Confessor», dans Studi sull'Oriente Cristiano 9/1 (2005), p. 63-81.
55 J.D.G. Dunn (Ed.), Jews and Christians. The Parting of the Ways A.D. 70 to 135, Tiibingen, 1992.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
382 SIMON C. MIMOUNI
coups de boutoir des ouvrages collectifs dirigés par Adam H. Becker et Annette Y. Reed, édité en 200356, et par Ian H. Henderson et Gerbern S. Oegema, édité en 200657 et de tous les chercheurs qui s'engouffrent dans la brèche ainsi ouverte. Pourtant dans la seconde édition de son livre
parue en 2006, la première l'ayant été en 1991, James D.G. Dunn main- tient encore que la séparation, dont l'origine est nécessairement antérieure, est intervenue en 70 et 135 et qu'à partir de cette dernière date les chrétiens sont clairement distincts et séparés des Judéens58. Cela ne l'empêche pas d'estimer qu'il n'est pas possible de parler simplement de «judaïsme rabbinique » comme la seule forme connue du judaïsme dans l'Empire romain avant le IIIe siècle de notre ère et de considérer que la séparation est intervenue surtout entre le christianisme de la Grande Église et le judaïsme chrétien. Disons enfin que The Parting of the Ways est en train de devenir The
Ways That Never Parted. . . Raison pour laquelle, on ne peut que sou- haiter « bonne chance aux jeunes chercheurs ! » qui auront à affronter cette nouvelle réalité bien plus complexe mais aussi bien plus satisfai- sante au regard des textes.
56 A.H. Becker - A.Y. Reed (Ed.), op. cit., Tübingen, 2003. 57 I.H. Henderson - G.S. Oegema (Ed.), op. cit., Gütersloh, 2006. 58 J.D.G. Dunn, The Parting of the Ways Between Christianity and Judaism and their
Significance for the Character of Christianity, Londres, 1991 20062.
This content downloaded from 132.203.227.63 on Thu, 03 May 2018 21:34:04 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
![Page 1: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », dans Revue biblique [Paris] 115 (2008), p. 360-382.](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020813/631eb3473dc6529d5d081a79/html5/thumbnails/24.jpg)






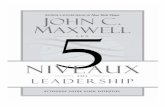


![Le monastère des Saints-Boniface-et-Alexis sur l'Aventin et l’expansion du christianisme dans le cadre de la 'Renovatio Imperii Romanorum' d’Otton III [1990]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313afb03ed465f0570ac9b6/le-monastere-des-saints-boniface-et-alexis-sur-laventin-et-lexpansion-du-christianisme.jpg)











