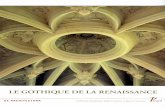« L’architecture des théâtres en Grèce (1980-1989) », Topoi, 1, 1991. p. 7-38.
-
Upload
univ-lyon2 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of « L’architecture des théâtres en Grèce (1980-1989) », Topoi, 1, 1991. p. 7-38.
Jean-Charles Moretti
L’architecture des théâtres en Grèce (1980-1989)In: Topoi, volume 1, 1991. pp. 7-38.
Citer ce document / Cite this document :
Moretti Jean-Charles. L’architecture des théâtres en Grèce (1980-1989). In: Topoi, volume 1, 1991. pp. 7-38.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/topoi_1161-9473_1991_num_1_1_1454
Chronique
L'Architecture des théâtres en Grèce (1980 - 1989)
Ce bulletin ne tient pas compte des études concernant les odéons et autres édifices de réunions couverts Κ Une première partie, classée selon un ordre topographique et, dans chaque section, suivant l'ordre chronologique des parutions, rassemble les rapports de fouilles et les études monographiques. Les chroniques sont signalées, mais ne sont pas analysées. La seconde partie recense les ouvrages et articles de synthèse.
Quand on étudie telle ou telle pièce du répertoire dramatique athénien, on s'intéresse toujours (ou presque) à la configuration du théâtre de Dionysos à l'époque de la première représentation de l'oeuvre analysée. Il en découle une littérature particulièrement abondante, mais pas toujours bien informée des dernières recherches menées sur le terrain, concernant les premiers temps du monument. Afin de ne pas alourdir ce bulletin, je n'ai retenu de cette production que les études qui m'ont semblé le plus à même de faire progresser notre connaissance de l'édifice.
Je serais reconnaissant aux lecteurs d'excuser les lacunes de cette recension, rédigée, principalement, dans les bibliothèques d'Istanbul, et de m'aider à y remédier par l'envoi de tirés à part 2. J'envisage dans un prochain bulletin de recenser les études consacrées aux théâtres d'Asie Mineure.
1. Cf. à leur sujet la synthèse de R. MEINEL, Das Odeion. Ό ruer suchungen an überdachtenantike Theatergebäude, Frankfurt am Main, Bern, Circencester/U.K., 1980, 646 p.
2. Les envois sont à adresser à J.-Ch. Moretti, IFEA, Palais de France, Nuru Ziya sokak 22, PK 54 80072 Beyoglu Istanbul, TURQUIE.
8 ARCHITECTURE DES THÉÂTRES
I. Chroniques et études monographiques
ATHÈNES, ATTIQUE, MÉGARIDE
Attique : généralités 1. E. SIMON, Festivals of Attica. An Archaeological Commentary, Madison, 1983, XX- 122 p., consacre un chapitre de son ouvrage (pp. 89- 104) aux fêtes de Dionysos. Elle accepte la localisation traditionelle du Lénaion sur l'agora, aux abords de la Stoa basileios (p. 100). 2. J. TRAVLOS, Bildlexikon zur Topographie des antiken Anika, Tübingen, 1988, 487 p., donne une présentation rapide, accompagnée d'une bibliographie et remarquablement illustrée des théâtres de l'Amphiaréion d'Oropos (p. 301 pour le théâtre de l'autel et p. 302 pour le grand théâtre), d'Eleusis (p. 96), d'Ikarion (p. 85), du Pirée (p. 342), de Rhamnonte (p. 389), de Thorikos (p. 430-431) et de Trachones (p. 6). La bibliographie postérieure à 1970 concernant le théâtre de Dionysos est consignée pp. 30-31 ; celle concernant la Pnyx, p. 31.
Athènes
GÉNÉRALITÉS 3. A. W. PICKARD-CAMBRIDGE, The Dramatic Festivals of Athens, XXI- 335 p., Oxford, 1953, dont une seconde édition revue et corrigée avait été publiée en 1968, a été à nouveau édité, en 1988, avec des «select addenda» (pp. 359-365) de J. Gould et D. M. Lewis concernant les Lénéennes, les Dionysies rurales, les Grandes Dionysies, les costumes, l'audience et les artistes dionysiaques.
LE THÉÂTRE DE DIONYSOS Cf. n° 1, 2, 111, 112, 114, 120, 122, 123, 127, 128, 131. Chroniques
4. M. KORRES, ArchDelt, 35 (1980) [1988], Chron., pp. 9-14 ; 36 (1981) [1988],CArört.,p.4.
Études 5. w. w. WURSTER, «Die neuen Untersuchungen am Dionysostheater in Athen», Architectura, 9 (1979), pp. 58-76. Je signale cet article, bien qu'il sorte légèrement du cadre chronologique défini, car il fait utilement le point sur les études consacrées au théâtre de Dionysos et présente le nouveau projet de recherche élaboré en collaboration par l'Ephorie de l'Acropole et l'Institut allemand d'Athènes. 6. E. Pöhlmann, «Die Proedrie des Dionysos Theaters im 5. Jahrhundert und das Bühnenspiel der Klassik», MusHelv, 38 (1981), pp. 129-146, étudie la forme du théâtre de Dionysos entre son établissement sur le flanc sud de l'Acropole et l'époque de Lycurgue. Les
[J.-C. MORETTI] 9
vestiges attribuables à cette période sont peu nombreux. E. P. en dresse l'inventaire (pp. 131-133), soulignant, après d'autres, que «l'orchestra, limitée par un mur polygonal, d'un diamètre d'environ 24 m» restituée par W. Dörpfeld n'a aucune existence archéologique (p. 133). Bien que l'idée en ait été accréditée, il n'existe non plus aucune preuve littéraire d'une orchestra circulaire au Ve siècle.
Le rapprochement des quelques éléments de gradins rectilignes conservés avec les théâtres de Trachones et de Thorikos conduit l'auteur à critiquer la restitution de W. B. DINSMOOR («The Athenian Theater of the Fifth Century», Studies Presented to D. M. Robinson I [1951], pp. 309-330) au profit d'un koilon «in der Art von Thorikos» (p. 145). Les premiers rangs de ce koilon étaient en pierre, le reste en bois (cf. les ΐκρια mentionnés par Aristophane, Thesm., 395, cité n. 70). Le terre-plein de l'orchestra, plus large que profond, était soutenu sur son flanc sud par le mur polygonal. De ce côté l'espace scénique, où évoluaient, sans contrainte, le chœur et les acteurs, était limité par une skènè de bois et de toile. 7. A. FRANTZ, «The Date of the Phaidros Berna in the Theater of Dionysos», Hesperia, Suppi XX (1982), pp. 34-39, reprend l'étude de la dédicace de Phaidros, inscrite sur la plus haute marche de l'escalier du bèma (IG II2, 5021). Pour des raisons de vraisemblance historique, il est conduit à la situer chronologiquement entre 300 et 345/6, date à laquelle, au dire d'Eunapius (v. soph., 492, éd. Loeb, p. 508), le théâtre était plein pour le passage d'Anatolius à Athènes. 8. D. SEALE, Vision and Stagecraft in Sophocles, London, 1982, η. ν. 9. L. POLACCO, «Le Supplici, come le rappresentava Eschilo», NAC, 12 (1983), pp. 65-89, élabore une restitution du théâtre vers 464/3 av. J.-C, date probable de la seconde représentation des Suppliantes. Le koilon aurait comporté trois volées de gradins rectilignes se raccordant à angles légèrement obtus. Au sud de l'orchestra était dressée une estrade, le πάγος. 10. F. E. WINTER, «The Stage of New Comedy», Phoenix, 37 (1983), pp. 38-47, soutient que le théâtre de Dionysos fut doté d'un proskènion au moins dès 325 av. J.-C. La construction en serait contemporaine du développement de la comédie nouvelle à Athènes. F. E. W. restitue, entre les deux paraskènions aux facades aveugles, une colonnade, dont les entrecolonnements, à l'exception de trois ouvertures, auraient été garnis de pinax. Le front de scène aurait été supporté par les piliers dont les bases, partiellement conservées, ont généralement été attribuées à une série de supports divisant la skènè en deux nefs. Le proskènion à paraskènions (héritage, au théâtre de Dionysos, d'une phase antérieure de l'édifice) serait donc une invention athénienne de la fin du IVe siècle. Le proskènion à façade rectiligne pourrait avoir été créé en Asie Mineure à la haute époque hellénistique. L'estrade du théâtre de Thasos serait inspirée de ces créations micrasiatiques.
10 ARCHITECTURE DES THÉÂTRES
On comparera cette restitution à celle de R. F. Townsend (n° 15), qui est sensiblement différente, mais qui, elle aussi, vise à
concilier la forme architecturale du théâtre d'Athènes avec son rôle de premier plan dans l'évolution des formes dramatiques. 11. Communication de W. WURSTER au IXe congrès de la FIEC à Orléans en 1982, publié à Gand en 1984, n. v. 12. C. J. SCHWENK, Athens in the Age of Alexander. The Dated Laws and Decrees of the «Lykourgan Era», 328-322 B. C, Chicago, 1985, 510 p. L'ensemble des inscriptions a été relu et chacune est accompagnée d'un commentaire. On y trouvera, concernant le théâtre d'Athènes, une nouvelle édition de IG II2, 351 + 624 (330/329), sous le n° 76 et, concernant le théâtre du Pirée, une nouvelle édition de IG II2, 1 176 (324/323), sous le n° 48.
13. H. M. HALLERAN, Stagecraft in Euripides, London, 1985, η. ν. 14. Ε. POHLMANN, «Bühne und Handlung im Aias des Sophokles», Antike und Abendland, 32 (1986), pp. 20-32, reprend et précise sa
restitution du théâtre de Dionysos avant les remaniements de Lycurgue (n° 6). L'orchestra, de forme rectangulaire, aurait eu une largeur
d'environ 30 m pour une profondeur de 15 m. Les acteurs y évoluaient, avec, en arrière plan, une skènè, qui, selon les pièces, tenait lieu de tel édifice ou de tel élément naturel du paysage. Sur son toit, qui était plat, pouvaient se tenir les morts, les guetteurs et les dieux. Elle servait de vestiaire et permettait aux acteurs de se rendre d'une parodos à l'autre sans être vus du public. Rôle des ekkyklèmes et de la méchanè.
L'espace scénique ainsi défini n'interdisait pas qu'une pièce se déroulât successivement dans plusieurs lieux. Tel est le cas de Y Ajax de Sophocle, dont l'auteur restitue la mise en scène. 15. R. F. Townsend, «The fourth-century Skene of the Theater of Dionysos at Athens», Hesperia, 55 (1986), pp. 421-438, reprend l'hypothèse de W. Dörpfeld selon laquelle le bâtiment de scène de l'époque de Lycurgue comportait une colonnade devant le mur de la skènè, entre les deux paraskènions. η croit pouvoir en assurer l'existence par une nouvelle étude du bloc Inv. 335 (fragment d'architrave + frise provenant d'un angle rentrant, avec métope dans l'angle). Un seul point de la restitution de W. Dörpfeld est critiqué : les flancs externes des paraskènions n'auraient comporté qu'un entrecolonnement et non deux. Une élévation restituée (l'échelle n'est pas précisée) est donnée p. 433, fig. 7 (on la comparera à celle de H. Lauter [n° 111] qui adopte pour la colonnade un rythme plus aéré). L'auteur trouve l'origine du plan de l'édifice dans la stoa de Zeus Eleuthérios sur l'agora. Dans les deux monuments les paraskènions avaient une façade hexastyle, rappelant l'ordonnance des temples doriques, et des métopes aux angles rentrants. L'utilisation de colonnes comme élément décoratif en bordure d'un mur serait due à une influence de l'architecture péloponésienne.
[J.-C. MORETTI] 11
R. F. T. restitue pour la skènè un toit en terrasse, accessible aux acteurs. Un tel bâtiment, doté d'une sorte de faux proskènion, «can be viewed as a forerunner rather than an exception, thereby placing the Theater of Dionysos more within the mainstream of the development of Greek stage design, a position better in keeping with Athens' known role as the leader in Greek Drama» (p. 436).
La pauvreté des vestiges et l'absence d'édifice de ce type conservé interdisent d'accepter sans réserve cette hypothèse (cf. la restitution élaborée par F. E. Winter, n° 10).
16. P. THIERCY, Aristophane, fiction et dramaturgie, Paris, 1986, 408 p., consacre la première partie de son ouvrage (pp. 19-89) aux conditions matérielles des représentations. On y trouve d'utiles mises au point sur les décors, le nombre de portes nécessaires (une seule selon P. T.), le nombre d'acteurs (rarement plus de trois), le rôle du choeur et l'utilisation des machines (ekkyklème et médiane). 17. R. A. MOYSEY, «A New Reference to the Skene of the Lykourgan Theater of Dionysos», AJA, 90 (1986), p. 212. Résumé d'une communication au 87e congrès de l'Institut archéologique américain (27- 30 déc. 1985). R. A. M. présente allusivement le fragment d'inscription publié dans Hesperia, 55 (1986), pp. 177-182 (n° 18). Π daterait de ca 330/329 av. J. C. L'absence de skènè sur la Pnyx parle contre son identification avec le théâtron mentionné en IG II2, 351 (cf. n° 37). 18. A. J. HEISSERER et R. A. MOYSEY, «An Athenian Decree Honouring Foreigners», Hesperia, 55 (1986), pp. 177-182, publient un fragment d'une inscription attique conservée à l'University of Mississipi, University Museum, Inv. 77.3.665. Il s'agirait d'un décret honorifique en l'honneur d'étrangers, qui auraient permis, grâce à un don (1. 4 δωίρεάς) l'importation de matériaux pour effectuer des travaux dans un théâtre (1. 3 τή]ν σκήγΐην). Reconnaissant dans cet édifice le théâtre de Dionysos, les auteurs sont conduits à dater le décret de l'époque de Lycurgue (338- 326). 19. H. KENNER, «Zur Archäologie des Dionysostheaters in Athen», ÖJh, 57 (1986-1987), Hauptblatt, pp. 55-91, tente de cerner le cadre matériel des représentations dramatiques à Athènes durant le Ve siècle av. J.-C. à partir de documents littéraires et iconographiques. Sont successivement étudiés : le rapport entre la forme du bâtiment de scène à paraskènions et celui du palais perse ; la mise en scène de l'apparition de Darius hors de son tombeau dans les Perses d'Eschyle ; la σκηνογραφία d'Agatharchos de Samos et les problèmes de la représentation de la perspective dans les décors ; V Achilleis d'Eschyle ; l'utilisation d'une couverture totale ou partielle de l'édifice scénique avec du rocher (la «felsverkleidete Bühne») ; l'illustration du Ménologion de l'empereur Basile II, enfin, dans laquelle H. Kenner reconnaît un descendant de la skénographie d'Agatharchos de Samos. «Von den Inszenierungen des Dionysostheaters in Athen seit Aischylos, d. h. seit der Zeit nach den Perserkriegen, muss
12 ARCHITECTURE DES THÉÂTRES
durch das übrige 5. und die erste Hälfte des 4, Jhs v. Chr. indurch für die Maler ein starker Impuls ausgegangen sein, so stark, dass er sich sogar bis in das 10. Jh. n. Chr. weiter fortgepflantz hat» (p. 90). S'agit-il d'une plaisanterie ? 20. R. HAMILTON, «Cries within and the Tragic Skene», AJP, 108 (1987), pp. 584-599, montre que la convention du «cri à l'intérieur» et l'existence d'un bâtiment de scène sont antérieures à X Agamemnon d'Eschyle. 21. Th. G. PAPATHANASOPOULO, «Το θέατρο του Διονύσου.Η μορφή του κοίλου», Α ναστήλωση- συντηρήτρηση - προστασία μνημείων και συνόλων β (1987), pp. 31-60, évoque rapidement les premières phases du koilon, conservant, sans discussion, ni référence aucune aux récents travaux d'E. Gebhard («The Form of the Orchestra in the Early Greek Theater»,
Hesperia, 43 [1974], pp. 428-440) et E. Pöhlmann (n° 6, 14), l'idée qu'au Ve siècle l'orchestra était circulaire et le koilon semi-circulaire. La part la
plus importante de l'article est consacrée à l'étude du koilon tel qu'il fut remodelé par Lycurgue.
Les vestiges conservés en place, les représentations du théâtre sur des monnaies impériales et la comparaison avec de nombreux autres édifices montrent qu'il n'existait qu'un seul diazoma (le second de la restitution de W. Dörpfeld), situé à l'emplacement d'un chemin antérieur au théâtre, que le diazoma n'était pas extérieurement bordé d'un podium et que le maenianum supérieur n'était pas autrement divisé que par la prolongation des escaliers du maenianum inférieur.
Les conclusions auxquelles aboutit Th. P. sont incontestables et c'est à fort juste titre qu'il insiste sur l'absence de «diazomas aveugles, c'est-à-dire de diazomas sans issues» (p. 43). 22. H. MAKRI, The Theater of Dionysos, Athens : Rehabilitation of the Auditorium Retaining Walls along and Adjoining the Eastern Parodos (a Summary), Athènes, 1987, 36 p., propose, pour consolider le mur de soutènement oriental du koilon, de remonter partiellement avec de nouveaux blocs son contre-mur de conglomérat ainsi que son parement de calcaire. 23. R. REHM, «The Staging of Suppliant Plays», GRBS, 29 (1988), pp. 263-307. n n'existait pas d'autel permanent dédié à Dionysos dans l'orchestra du théâtre d'Athènes, mais on en plaçait un au centre de l'orchestra pour la mise en scène de pièces comme les Euménides d'Eschyle ou les Suppliantes d'Euripide. Cet autel pouvait avoir différentes fonctions (omphalos de Delphes puis statue d'Athéna dans les Euménides, tombe d' Agamemnon dans les Choéphores). 24. A. FRANTZ, The Athenian Agora XXIV. Late Antiquity : A. D. 267- 700, New York, 1988, XXI-156 p., rappelle pp. 24-25 que le théâtre était encore utilisé pour les assemblées au IVe siècle ap. J.-C. et résume les arguments de la datation du bèma de l'archonte Phaidros avant 345/6 (cf. n°7).
[J.-C. MORETTI] 13
25. Ν. G. L. HAMMOND, «More on Conditions of the Production to the Death of Aeschylus», GRBS, 29 (1988), pp. 5-33, complète son article publié dans les GRBS, 13 (1972), pp. 387-450. Études 1. de la forme du théâtre de Dionysos dans les premiers temps de son installation sur le flanc sud de l'Acropole ; 2. de la mise en scène et de la datation du Prométhée enchaîné ; 3. de l'épiphanie de Darius dans les Perses ; 4. de la mise en scène des Euménides. Contrairement à E. Gebhard et E. Pöhlmann, Ν. G. L. H. soutient, avec W. Dörpfeld et W. B. Dinsmoor, que dans son premier état l'orchestra était circulaire et les gradins avaient une disposition polygonale. Une véritable emminence rocheuse, dont le rôle diverge selon les œuvres représentées, se serait élevée en bordure orientale de l'orchestra, η n'y aurait pas eu de bâtiment de scène. 26. 0. TAPUN, The Stagecraft of Aeschylus. The Dramatic Use of Exits and Entrances in Greek Tragedy, Oxford, 1989, 528 p., n. v.
LE THÉÂTRE DES LENEENNES. Cf. n° 1, 3, 128. Étude
27. Ν. W. SLATER, «The Lenaean Theater», ZPE, 66 (1986), pp. 255-264, défend l'existence du théâtre du Lénaion, mentionné par Pollux, IV, 121.
Le Lénaion, dont aucune trace n'a été repérée sur l'agora, serait à rapprocher du Dionysion έν λίμναις , sur les bords de l'Ilissos. L'inscription IG V 84, 1. 28 mentionne dans ce sanctuaire desÎKpia : N. W. S. propose d'y reconnaître le théâtre où se déroulaient les Lénéennes, du moins avant le remodelage du théâtre de Dionysos par Lycurgue.
LAPNYX. Cf.n°2. Études
28. R. A. MOYSEY, «The Thirty and the Pnyx», AJA, 85 (1981), pp. 31- 37. Le deuxième état de la Pnyx a généralement été daté selon les indications de Plutarque (Thémistocle, 19, 4) de l'époque des Trente (404/403). R. A. M. défend l'idée, déjà avancée par E. Meyer (RE, s.v. «Pnyx»), qu'il est postérieur au rétablissement de la démocratie (403). Les travaux auraient probablement été achevés en 402. 29. P. SIEWERT, Die Trittyen Anikas und die Heeresreform des Kleisthenes, Vestigia 33, München, 1982, 183 p., 4 dépliants. Pp. 10-16, P. S. attribue les quatre bornes de marbre portant des noms de trittyes trouvées à Athènes (/G I2, 883-884 ; SEG 10, 370 ; 21, 109 = IG I3, 1118; 1120; 1 1 19 ; 1 1 17 ) au premier état de la Pnyx. 30. P. KRENTZ, The Thirty at Athens, Ithaca, 1982, η. ν. 31. Η. Α. THOMPSON, «The Pnyx in Models», Hesperia, Suppl XIX (1982), pp. 133-147, présente et commente les maquettes au 1/200 des trois états de la Pnyx réalisées par J. Travlos. L'ensemble des problèmes posés par l'édifice est repris à cette occasion. Le premier état de l'édifice est à dater plutôt vers 450 (après les réformes d'Ephialte) que vers 500
14 ARCHITECTURE DES THÉÂTRES
av. J.-C. Pp. 139-140, H. A. P. défend la validité du texte de Plutarque (Thémistocle, 19, 4) pour la datation du second état, contre l'avis de R. A. Moysey (n° 28). 32. M. H. HANSEN, «The Athenian Ecclesia and the Assembly-Place on the Pnyx», GRBS, 23 (1982), pp. 241-249, aborde successivement trois questions à la lumière de la mise au point de H. A. Thompson (n° 31). 1. Pnyx I and the Quorum of 6000 (pp. 241-242). Si la nouvelle datation, à l'époque d'Ephialte, avancée par H. A. T. pour le premier état du monument est exacte, ce dont M. H. H. est convaincu, les dimensions du koilon, qui pouvait accueillir 6000 personnes, auraient été déterminées en fonction du quorum de 6000 voix exigé lors de certains votes. 2. Pnyx II and Restricted Admission (pp. 243-244). Dans son deuxième état la capacité de la Pnyx était encore d'environ 6000 places. Π est probable que lorsque le koilon était plein, on refusait des citoyens. 3. Pnyx III and Subdivisions of the Auditorium (pp. 244-248). La zone la plus proche de la tribune, isolée du reste du koilon par une balustrade, aurait été réservée aux membres de la προεδρεύουσα φυλή. 33. M. H. HANSEN, The Athenian Ecclesia : A collection of Articles 1976- 1983 \ Opuscula graecolatina 26, Copenhagen, 1983, η. ν. 34. M. H. HANSEN, Die athenische Volksversammlung im Zeitalter des Demosthenes, Xenia, Heft 13 (1984), 21 1 p., η. ν. 35. P. KRENTZ, «The Pnyx in 404/3 B.C.», AJAX 88 (1984), pp. 230-231, réfute l'argumentation de R. A. Moysey (n° 28) selon laquelle le second état de la Pnyx ne serait pas l'oeuvre de l'oligarchie des Trente (404-403), mais celle de la démocratie rétablie (403). 36. M. H. HANSEN, «Two Notes on the Pnyx», GRBS, 26 (1985), pp. 241- 250, 1. Fencing-Off of the Auditorium, restitue d'après Démosthène, 19, 169 et 59, 89f la préparation des réunions de l'ecclèsia à la Pnyx. 2. Trittys Divisions in the Auditorium, critique la position soutenue par P. Siewert (n° 29), selon laquelle les citoyens étaient regroupés dans la Pnyx par trittyes. Nouvel examen (avec photographies) des quatre bornes de marbre mentionnant des trittyes {IG I3, 1 1 17-20), qui proviendraient, selon P. S., du premier état de la Pnyx. 37. D. G. ROMANO, «The Panathenaic Stadium and the Theater of Lykourgos : A Re-examination of the Facilities on the Pnyx Hill», AJA, 89 (1985), pp. 441-454, situe le stade panhellénique de Lycurgue non pas à l'emplacement du stade d'Hérode Atticus, mais entre la Pnyx et l'enceinte. Nouvel examen des deux fondations qui s'y trouvent et ont été interprétées par les fouilleurs comme celles de portiques inachevés. D. G. R. y reconnaît les vestiges de murs de soutènement de deux talus artificiels destinés aux spectateurs. Nouveau commentaire des travaux mentionnés dans IG II2, 351. Le théâtre panathénaïque dont il est question dans cette inscription serait la Pnyx et non le théâtre de Dionysos.
[J.-C. MORETTI] 15
38. M. H. HANSEN, «The Construction of the Pnyx II and the Introduction of Assembly Pay», Ci Med, 37 (1986), pp. 89-98, soutient l'existence d'une association entre la construction de la Pnyx II, dans laquelle un koilon fermé, à accès limité, remplace le koilon ouvert, à libre accès, de la Pnyx I, et l'introduction d'une indemnité de présence à l'assemblée. L'ensemble daterait de la la décennie 403/393 av. J.-C. 39. M. H. HANSEN, The Athenian Assembly in the Age of Demosthenes, Oxford, 1987, n. v. 40. G. R. STANTON, P. J. BICKNELL, «Voting in Tribal Groups in the Athenian Assembly», GRBS, 28 (1987), pp. 51-92, soutiennent que dans
la Pnyx I, qui daterait des environs de 500 (contra H. A. Thompson, n° 31), les citoyens étaient classés à la fois par tribus et par trittyes (cf. P. Siewert, n° 29). Les trittyes urbaines se plaçaient probablement devant le bèma. Cette organisation fut conservée dans le second état de la Pnyx. Les bornes de la Pnyx III n'auraient pas servi à séparer la tribu présidant des autres, comme le pense M. H. Hansen (n° 32), mais seraient les vestiges d'une division du koilon en dix portions attribuées aux dix tribus. L'hypothèse avancée par D. G. Romano (n° 37), qui situe le stade panathénaïque de Lycurgue en bordure de la Pnyx, est critiquée dans un appendice. 41. M. H. HANSEN, «The Organisation of the Athenian Assembly : a Reply», GRBS, 29 (1988), pp. 51-58, refute pour chaque état de la Pnyx l'argumentation de G. R. Stanton et P. J. Bicknell (n° 40).
Le Pirée. Cf. n° 2, 12, 122.
Trachones. Cf. n° 2, 6, 14
Chroniques 42. Ergon, 1980 (1981), pp. 24-25; 1981 (1982), pp. 44-45; O. TZACHOU ALEXANDRI, PraktArchEt, 1980 (1982), pp. 64-67 ; 1981 (1983), p. 154.
Thorikos. Cf. n° 6, 128.
Chroniques 43. H. F. MUSSCHE, P. SPITAELS, «Thorikos», ArchDelt, 30 (1975) [1983], Chron. , pp. 52-53 ; BCH ,113 (1989), p. 591.
Ikarion. Cf. n° 2, 128.
Étude
44. W. R. BIERS, T. D. BOYD, «Ikarion in Attica : 1888-1981», Hesperia, 51 (1982), gp. 12-14, consacrent les pp. 12 à 14 de leur étude à l'«aire
théâtrale». Etat des lieux en 1981. Nouveaux relevés : plan général du site en 1981, malheureusement sans échelle ni indication du Nord (fig. 2) ; relevé en plan et en élévation de l'assise formant la limite
1 6 ARCHITECTURE DES THEATRES
orientale de l'orchestra (fig. 5) ; coupe sur l'ensemble de l'édifice (fig. 5) ; coupe sur deux trônes (fig. 6). Au lit d'attente de l'assise formant la limite orientale de l'orchestra sont creusées une série de mortaises. Les auteurs ne retiennent cependant pas l'hypothèse de l'existence d'une skènè.
Rhamnonte. Cf. n° 2, 121, 128. Chronique
45. Ergon, 1986 (1987), p. 94. Études
46. B. PETRAKOS, Λ concise Guide to Rhamnous, trad. J. Binder, Athènes, 1983, 23 p. Sont consacrées au théâtre les pp. 17-18. Elévation restituée des cinq trônes (fig. 8). 47. Β. PETRAKOS, «Οί ανασκαφές του Ραμνοΰντος (1813-1987)», ArchEph, 126 (1987), pp. 267-298, consacre deux pages de sa chronique (pp. 292-293) au théâtre du IVe siècle av. J.-C.
Oropos. Cf. n° 2, 122, 131.
Eleusis. Cf. n° 2, 113.
Égine Cf. n° 122. Étude
48. 1. D.-S. ; A. P.-K., «Το θέατρο της αρχαίας Αίγινας», Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία Ενημερΰπικό Δελτίο (juin 1989), 4 ρν non numérotées, rassemblent une série de documents sur le lazaret d'Égine, qui fut construit en 1828, au pied de la colline de Kolona, à l'emplacement du théâtre. Son agencement laisse reconnaître celui de l'édifice antique. A en juger d'après les relevés du lazaret, le diamètre du koilon aurait été de 55 m, dimension proche de celle du théâtre d'Epidaure, auquel Pausanias II, 29, 1 1 compare celui d'Egine.
PÉLOPONNÈSE Corinthe
LE GRAND THÉÂTRE. Cf. n° 114, 117, 120, 122, 126, 128. Chroniques
49. C. K. WILLIAMS II, O. H. ZERVOS, Hesperia, 53 (1984), pp. 95-97 ; 54 (1985), pp. 68-80 ; 55 (1986), pp. 159-161 ; 57 (1988), pp. 108-120 ; 58 (1989), pp. 25-36.
LE THEATRON DU SANCTUAIRE DE DEMETER. Cf. n° 113. Étude
50. N. BOOKIDIS, R. S. STROUD, Demeter and Persephone in Ancient Corinth (1987), 32 p., présentent succintement (p. 20), avec illustrations
[J.-C. MORETTI] 17
(fig. 19 et 21), les deux séries de gradins taillés dans le rocher qui se trouvent dans le sanctuaire.
Isthmia. Cf. n° 117, 119, 122.
Sicyone. Cf. n° 122.
Chronique 51. Ergon, 1984 (1985), pp. 61-62 ; K. KRYSTALLI-VOTSI, PraktArchEt, 1984 (1988), p. 241.
Phlionte. Cf. n° 117, 122.
Mycènes. Cf. n° 122.
Argos LE THEATRON A GRADINS DROITS. Cf. n° 112, 128.
LE GRAND THÉÂTRE. Cf. n° 120, 122. Chroniques
52. C. ABADIE et J. DES COURTILS, BCH, 106 (1982), pp. 644-647 ; 107 (1983), pp. 839-841 ; J.-Ch. MORETTI, BCH, 111 (1987), pp. 603-607 ; 112 (1988), pp. 716-720 ;113 (1989), pp. 717-722.
Études 53. M. GUGGISBERG, «Terrakotten von Argos. Ein Fundkomplex aus dem Theater», BCH, 112 (1988), pp. 167-227 ; «Terrakotten von Argos : Nachtrag», ibid., pp. 535-543, publie un ensemble de figurines et de moules en terre cuite trouvés dans une fosse, au Nord du portique adossé au bâtiment de scène hellénistique. Chronologiquement le matériel s'étend entre le troisième quart du VIe et le début du IIIe siècle av. J.-C. Il s'agirait d'un dépotoir d'atelier. La fosse aurait été constituée au moment de la construction du théâtre. 54. J.-Ch. MORETTI, «Le théâtre d' Argos», REG, 102 (1989), pp. XIV- XV, résumé d'une communication faite à l'association pour l'encouragement des études grecques en France. Rapide présentation de l'histoire architecturale de l'édifice.
LE THEATRON DE L'AGORA Chroniques
55. A. PARIENTE, BCH, 111 (1987), pp. 592-595 ; 112 (1988), pp. 700- 705; 113 (1989), p. 701. Epidaure (le sanctuaire). Cf. n° 114, 122, 127.
Étude 56. L. KÄPPEL, «Das Theater von Epidauros. Die mathematische Grundidee des Gesamtenwurfs und ihr möglicher Sinn», Jdl, 104 (1989),
1 8 ARCHITECTURE DES THEATRES
pp. 83-106. A. V. Gerkan et W. Müller- Wiener ont clairement distingué dans leur publication (Das Theater von Epidauros [1961]) les deux phases de construction du monument, l'une vers 300 (partie inférieure du koilon ; premier état du bâtiment de scène), l'autre vers 170-160 av. J.-C. (extension du koilon ; réaménagement du bâtiment de scène). Malgré la disparité chronologique des deux parties du koilon, L. K. soutient que la cohérence planimétrique de l'ensemble ne laisse pas douter que le plan général de l'édifice fût élaboré dès la fin du IVe siècle. La figure de base du monument, le pentagone régulier incluant l'étoile à cinq branches, aurait été choisie parce qu'elle symbolise Hygie chez les Pythagoriciens.
Trézène. Cf. n° 122, 128.
Mantinée. Cf. n° 117, 122.
Tégée. Cf. n° 122,131.
Megalopolis. Cf. n° 112, 114, 117, 119, 122, 128.
Sparte. Cf. n° 117, 119, 120, 122, 128.
Étude 57. D. FEISSEL, A. PHHJPPIDIS-BRAAT, «Inventaire en vue d'un recueil des inscriptions historiques de Byzance. III. Inscriptions du Péloponnèse (à l'exception de Mistra)», Travaux et Mémoires, 9 (1985), pp. 267-395, contient la réédition par D. F. de l'inscription SEG 11, 464, mentionnant la restauration du théâtre sous le proconsul Ampélios, en 359 (pp. 285- 287, n° 24). D. F. souligne à fort juste titre que si la restitution de πέτασος à la 1. 6 est justifiée, le terme ne peut désigner un velum.
Gytheion. Cf. n° 119.
Messene LE THÉÂTRE. Cf. n° 122.
Chroniques 58. Ergon, 1986 (1987), p. 103 ; 1987 (1988), pp. 98-99 ; 1988 (1989), p. 30.
LA SALLE DE SPECTACLE DE L'ASCLEPIEION. Cf. n° 127.
Étude 59. L. MIGEOTTE, «Réparation de monuments publics à Messene au temps d'Auguste», BCH, 109 (1985), pp. 597-607, réédite l'inscription PraktArchEt, 1959 (1965), p. 168 + ibid., pp. 170-173, dans laquelle est mentionné 1.35 το λογείον τσϋ δεικτηρίου c.-à-d. l'estrade de la salle de spectacle de l'Asclépiéion (p. 606).
[J.-C. MORETTI] 19
Elis. Cf. n° 117, 122. Chroniques
60. V. MITSOPOULOS-LEON et R. SCHERRER, ÖJh, 52 (1978-1980), Beiblatt, pp. 78-82 ; V. MTTSOPOULOS-LEON et E. POCHMARSKI, ÖJK 53 (1981-1982), Grabungen, pp. 18-19 ; Ergon, 1979 (1980), p. 18 ; 1980 (1981), p. 31 ; 1981 (1982), pp. 50-51 ; 1983 (1984), p. 65 ; N. YALOURIS, PraktArchEt, 1980 (1982), p. 113 ; 1981 (1983), p. 154.
Études 61. E. POCHMARSKI, «Zum Theater von Elis», Bericht über die 32. Tagung der Koldewey-Gesellschaft, 19.-23. 5. 1982 in Innsbruck (1984), pp. 19-21, constitue un résumé de l'article suivant. 62. E. POCHMARSKI, «Zum Theater von Elis», Grazer Beiträge, 9 (1984), pp. 207-219, présente une synthèse des résultats des recherches menées par la Société archéologique et l'Institut autrichien, depuis 1914, au théâtre d'Elis, dont F. Glaser et N. Yalouris préparent la publication. La première phase de l'édifice date des environ de 300 av. J.-C. Le bâtiment de scène, de forme rectangulaire (23 χ 10,5 m) comportait alors un proskènion ionique, et une skènè divisée sur toute sa longueur en deux parties. Son étage de bois était supporté par des pieux qui s'encastraient dans des pierres placées contre les murs nord et sud de la skènè. Leur ordonnance permet de restituer trois ouvertures dans la façade du front de scène. Deux doubles rampes, symétriquement disposées, flanquent l'édifice scénique. Un canal, dont le cours, semble-t-il, dessinait un U, bordait l'orchestra. Le koilon était divisé en sept kerkis par huit rampes, dont le sol était formé de galets pris dans de l'argile. Il ne comportait pas de gradins de pierres, mais des degrés recouverts de terre battue (ht. : 0,12 m ; prof. : 0,80 à 0,90 m), qui, vraisemblablement, supportaient des bancs de bois.
A la basse époque hellénistique des escaliers de pierres furent installés sur les rampes du koilon et la pente du koilon fut accentuée. Le lit d'attente des degrés fut recouvert avec une sorte de brèche très tendre. Dans les parodos furent placés des bancs. Les rampes du bâtiment de scène furent agrandies.
A l'époque impériale des murets furent construits entre les colonnettes du proskènion, ne laissant libres que trois ouvertures et un nouveau canal fut installé dans l'orchestra (à propos de ce prétendu canal cf. V. Mitsopoulos-Leon, n° 63). 63. V. MITSOPOULOS-LEON, «Zur Verehrung des Dionysos in Elis. Nochmals : άξιε ταύρε und die sechzehn heiligen Frauen», AM , 99 (1984), pp. 275-290, rappelle la découverte durant la fouille de la partie ouest du théâtre et de ses abords de quatorze tombes de XIe siècle av. J.- C. A proximité de cette nécropole se serait développée, selon le schéma défendu par Fr. Kolb (n° 128), une orchestra, centre des évolutions des «seize femmes d'Elis» mentionnées par Plutarque et Pausanias. C'est à cet emplacement qu'aux environ de 300 av. J.-C. le théâtre de pierre,
20 ARCHITECTURE DES THEATRES
consacré à Dionysos, aurait été édifié. Le bassin mis au jour dans l'orchestra est en fait une eschara sous laquelle fut découvert un bucrane, soigneusement protégé. Ainsi se trouve expliqué l'énigmatique άξιε ταύρε de l'hymne entonné par les femmes d'Elis en l'honneur du héros Dionysos (Plutarque, Aetia Graeca 36, p. 299A-B), que le crâne découvert soit celui d'un άξιος ταύρος του θεού, ou représentât Dionysos lui même.
Aigion. Cf. n° 122.
Chronique 64. Th. KYRIAKOS, ArchDelt, 35 (1980) [1988], Chron., pp. 196-198 (Οδός Ναυαρίνου).
Aigeira. Cf. n° 122.
Chroniques 65. W. ALZINGER, ÖJh, 53 (1981-1982), Grabungen, pp. 12-14 ; 55 (1984), Grabungen, pp. 15-18.
Études 66. S. GOGOS, «Das Theater von Aigeira in hellenistischer Zeit», ÖJh, 56(1985), Beiblatt, pp. 160-176, résume, dans ses grandes lignes, la première partie de l'étude suivante.
67. S. GOGOS, , Klio, 68 (1986), pp. 6-31, signe le chapitre «Theater» dans la série de trois articles, élaborée sous la direction de W. Alzinger et consacrée à «Aigeira-Hyperesia und die Siedlung Phelloë in Achaia» (l.Klio, 67 [1985], pp. 389-451 ; UiKlio, 68 [1986], pp. 6- 62 ; III : Klio, 68 [1986], pp. 309-347). η fait le point sur les résultats des fouilles de l'Institut autrichien d'Athènes.
Le koilon en demi-cercle prolongé est adossé à une pente rocheuse dans laquelle sont taillés les deux-tiers des gradins. Il est divisé en deux parties par un diazoma et en onze kerkis par douze escaliers. Dans le premier état du théâtre, daté du IIIe siècle av. J.-C. (plutôt de la première moitié du siècle), l'orchestra (d : 14,40 m) était bordée d'un canal, séparé des gradins par un passage (1 : de 1,15 à 1,30 m). Le bâtiment de scène comportait un proskènion dorique (L : 15,40 m ; prof. : 3 m ca) et une skènè rectangulaire (15,40 χ 6 m) divisée en deux pièces. Deux rampes symétriquement disposées (L : 6,95 m) donnaient accès au plancher du proskènion, dont S. G. restitue le niveau, d'après la pente de la rampe est, à 2,67 m au-dessus du sol de l'orchestra. De part et d'autre de la skènè, en bordure des rampes, se trouvait, selon S. G., deux pièces annexes (7x3 m). Comme seule la face externe des murs qui les limitent latéralement est parée (p. 24), il s'agit plutôt, à mon avis, de rampes, qui conduisaient à l'étage de la skènè : des systèmes analogues de doubles rampes sont attestés au théâtre de Sicyone et à celui d'Elis (cf. E. Pochmarski, n° 61-62). Des portes étaient installées dans les parodos.
[J.-C. MORETTI] 21
A l'époque impériale, vraisemblablement sous Hadrien, le bâtiment de scène fut largement transformé. Un pulpitum (L : 17,90 m ; prof. : 5,65 m) ferma l'orchestra. Le front de scène fut épaissi, légèrement allongé (L : 16,63 m) et garni de six socles (1,50 χ 0,93 m) en façade, qui, chacun, supportait une colonne. Cette frons scaenae était percée de trois portes. Les parodos furent voûtées et un nouveau canal d'évacuation des eaux de l'orchestra remplaça le caniveau hellénistique.
Aucun des deux états n'est présenté en plan restitué.
Stymphale Chronique
68. BCH, 108 (1984), p. 756.
GRÈCE CENTRALE, ILES IONIENNES, ÉPIRE, ILLYRIE
Tanagra Chronique
69. BCH, 110 (1986), p. 709.
Thèbes (de Béotie). Cf. n° 113. Chronique
70. K. DMAKOPOULOU.Arc/iDe/i, 33 (1978) [1985], Chron., p. 113.
Thespies. Cf. n° 122.
Orchomène (de Béotie). Cf. n° 119, 122.
Chéronée.Cf.n°122,131.
Hyampolis. Cf. n° 122.
Abai. Cf. n° 122.
Elatée. Cf. n° 122.
Tithoréa. Cf. n° 122.
Delphes. Cf. n° 113, 114, 120, 122. Étude
71. A. JACQUEMIN, «Note sur la frise du théâtre de Delphes», BCH, 109 (1985), pp. 585-587, critique la proposition de M. C. STURGEON, «A New Monument to Herakles at Delphi», AJA, 82 (1978), pp. 226-235, selon laquelle les reliefs traditionellement attribués à la frise du pulpitum du théâtre proviendraient d'une base ou d'un petit autel des années 110-
22 ARCHITECTURE DES THÉÂTRES
90. Selon A. J., «la seule organisation possible est celle d'une frise sur une seule ligne». Je comprends alors d'autant moins pourquoi «un décor de scène paraît à exclure».
Lilaia. Cf. n° 122.
Kallion. Cf. n° 122.
Oiniadai. Cf. n° 127.
Arta Chronique
72. 1. ANDREOU, ArchDelt, 31 (1976) [1984], Chron, pp. 199-201. Étude
73. I. ANDREOU, «Τό μικρό θέατρο της Αμβρακίας», Ητκιρωπκά χρονικά, 25 (1983), pp. 9-23, présente le monument, qui n'a pu être que partiellement dégagé. L'édifice, situé à environ 100 m au nord-est du temple d'Apollon, fut construit sur un ensemble de maisons et de bains. Son koilon, en demi-cercle, est adossé à un remblai. Cinq gradins ont été dégagés. Deux escaliers divisent l'ensemble en trois kerkis. Les degrés sont composés d'un siège en pierre et d'un repose-pied dallé. L'orchestra (d : 6,80 m) n'est pas bordée par un caniveau. Le proskènion avait en façade six piliers à demi-colonnes ioniques. Un caniveau couvert court au pied du stylobate. La skènè n'a pas été fouillée, mais plusieurs éléments de sa toiture ont été retrouvés. La datation avancée (fin IVe-début IIP siècle av. J.-C.) me semble un peu haute, au vu de la forme de koilon.
Dodone. Cf. n° 78, 120.
Albanie généralités
74. P. CABANES, «Recherches archéologiques en Albanie 1945-1985», RA, 1986, pp. 107-142, présente, au fil de sa chronique, plusieurs théâtres, qui sont encore trop peu connus : Phoinikè (p. 117), Sofratikë (p. 119), Bouthrotos (pp. 120-122), Klos (p. 128), Byllis (pp. 129-130) et Apollonia(p. 131). 75. «La très riche Albanie archéologique», Dossiers hist, et archéo., Ill (dec. 1986), 98 p. On y trouve quelques renseignements sur les théâtres d'Apollonia (p. 41) et de Byllis (pp. 64-65).
Bouthrotos. Cf. n° 74.
Phoinikè. Cf. n° 74.
[J.-C. MORETTI] 23
Sofratikë. Cf. n° 74.
Chronique 76. A. Baçe, Iliria (1983, 2), pp. 255-256.
Klos. Cf. n° 74..
Byllis. Cf. n° 74, 75.
Chronique 77. Iliria (1982, 1), pp. 261-262.
Étude 78. N. CEKA, «Koinoni i Bylinëve» (Le koilon des Bylliones), Iliria (1984, 2), pp. 61-78, résumé en français pp. 79-89, consacre les pp. 75-76 (résumé en français p. 88) aux résultats des fouilles qu'il mène au théâtre de Byllis. Le monument est daté du milieu du IIP siècle av. J.-C. Son koilon, d'un diamètre de 80,50 m, pouvait accueillir 7000 personnes. Le diamètre de l'orchestra était de 1 1 m. Vers le koilon le bâtiment de scène, qui semble étroitement apparenté à celui du théâtre de Dodone, présentait un proskènion ionique et, selon N. G, une colonnade dorique en front de scène. Sur ses trois autres côtés, la skènè était bordée par un portique, disposition que je rapprocherais volontiers de celle du théâtre de Délos.
Les restitutions en perspective présentées fig. 13 et 14 nécessiteraient, à mon sens, d'être révisées sur bien des points, mais il est difficile de se faire une idée juste des choses sans aucun relevé des blocs utilisés pour l'étude.
Apollonia. Cf. n° 74, 75.
Chronique 79. Α. ΜΑΝΟ, Β. DAUTAJ, «Teatri i Apollonisë (Rezultatet e fushatës se' peste" të gërmimeve)» (Le théâtre d'Apollonie [Résultats de la cinquième campagne de fouilles]), Iliria (1982, 1), pp. 191-197, résumé en français pp. 197-198, PI. pp. 199-205.
Étude : 80. Albanien. Schätze aus dem Land der Skipetaren, Mainz, 1988, 476 ρ , catalogue d'une exposition qui s'est tenue au Roemer- und Pelizaeus- Museum de Hildesheim. P. 320, n° 203, N. Ceka commente une section de frise et un fragment de corniche doriques provenant du théâtre d'Apollonia (Apollonia, AM 5025). Les quatre métopes présentées sont ornées de quatre motifs différents : rosette, bucrane, masque tragique (d'Hermès ?), canthare. Sur le fragment de corniche, déjà publié par A. Mano, B. Dautaj (Iliria [1982, 1], p. 195 et PI. VI, c), je lis άγ]ωνοθ?[τήσας L'inscription relaterait, selon N. C, des travaux de rénovation de l'édifice.
24 ARCHITECTURE DES THEATRES
PHTIOTIDE, THESSALIE Démétrias. Cf. n° 127.
Étude
81. P. MARZLOFF, W. BOSER, Demetrias III, Bonn, 1980, 53 p., 9 pi., 19 dépliants, contient un relevé côté (plan et coupe) du théâtre (Plan VII).
Larissa Chroniques
82. BCH, 108 (1984), p. 790 ; 110 (1986), p. 713 ; K. I. GALLIS, ArchDelt 35 (1980) [1988], Chron., p. 275.
Études PREMIER THÉÂTRE
83. Th. TZIAFALIAS, «Το αρχαίο θέατρο της Λάρισας», Πρακτικά του Α ιστορικού-αρχαιολογικού συμποσίου Λάρισα -παρελθόν και μέλλον 26- 281411985, Larissa, 1985, pp. 161-185, résumé en anglais pp. 172-174, donne les résultats de la fouille du premier théâtre, qui a pu reprendre en 1985. La première orchestra de l'édifice daterait de la fin du IVe siècle. Le bâtiment de scène et le koilon actuellement visibles sont attribués à la fin du IIP siècle. Le koilon, adossé à l'acropole, comportait un diazoma bordé sur le flanc extérieur d'un mur et haut de 1,30 m. Th. T. restitue treize kerkis sous le diazoma et vingt-six au-dessus. Les gradins, taillés dans le marbre, portent de nombreuses inscriptions topiques de la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. Le bâtiment de scène comportait un proskènion et une skènè composée de deux pièces séparées par un passage, que Th. T. interprète comme un «escalier charonien». Un sanctuaire de Dionysos se serait trouvé à proximité du théâtre.
SECOND THÉÂTRE 84. Th. TZIAFALIAS, «Το δεύτερο αρχαίο θέατρο της Λάρισα», Πρακτικά του Α ιστορικού-αρχαιολογικού συμποσίου Λάρισα - παρελθόν και μέλλον 26- 28/4/1985, Larissa, 1985, pp. 60-78, résumé en anglais pp. 68-70, présente l'édifice à gradins qui dans un premier temps avait été interprété comme un stade, mais que la poursuite de la fouille a révélé être un théâtre. Son koilon en demi-cercle outrepassé est adossé à une colline. Les deux premiers gradins, entièrement conservés sont en marbre local, le reste était vraisemblablement en bois. L'ensemble est divisé en treize kerkis par quatorze escaliers. Du bâtiment de scène il demeure la skènè, divisée en trois salles s'ouvrant vers l'orchestra. Aucune trace d'estrade n'a été repérée. Th. T. relève la présence de nombreux blocs, dont certains inscrits, utilisés en remploi dans l'édifice. Le bâtiment de scène daterait de la première moitié et le koilon de la fin du Ier siècle av. J.-C. Le monument aurait été construit pour les Eleuthéria, à une époque où l'autre théâtre, transformé en arène, était devenu inutilisable pour les concours dramatiques et musicaux. Passim lire opus incertum au lieu de opus incertus.
[J.-C. MORETTI] 25
MACÉDOINE, THRACE
Macédoine généralités Études
85. E. BOULEY, «Réflexions sur les monuments des spectacles romains de type mixte situés en Germanie supérieure, en Belgique et en Macédoine anciennes», Rev. Arch. Sites, 25 (Févr.-Avr. 1985), pp. 4-13, étudie deux groupes d'édifices qui furent qualifiés de «théâtres mixtes», cinq situés en Germanie supérieure ou en Belgique (Nida, Grand, Senlis, Augst, Ribemont- sur- Ancre), trois situés en Macédoine (Stobi, Phillipes, Thasos). Les cinq premiers n'ont jamais fonctionné à la fois comme théâtre et comme amphithéâtre. Les théâtres de Stobi, Philippes et Thasos, en revanche, ont fonctionné comme des édifices mixtes, mais aucun d'eux ne répond, selon E. B., à «la conception d'édifice mixte». J'en conviens pour Philippes et Thasos, dont les orchestras furent transformées en arènes à l'époque impériale sans que soient supprimés les bâtiments de scène, mais non pour Stobi, qui, ainsi que l'a montré E. R. Gebhard (n° 95), dont E. B. semble ignorer les travaux, fut conçu au IIe siècle pour recevoir à la fois les spectacles traditionnels du théâtre et
les munera de l'amphithéâtre. Il en fut de même pour le théâtre d'Héraclée de Lyncestide, dont la récente publication (n° 94) a confirmé l'existence de théâtre mixtes dans leur conception. 86. L. POLACCO, «In Macedonia, sulle tracce di Euripide», Dioniso, 56 (1986), pp. 17-30, s'intéresse aux dernières années de la vie d'Euripide, passées à Pella, à la cour d'Archélaos. Etude des allusions à la Macédoine dans les Bacchantes. Recherche d'un édifice théâtral euripidéen. Le théâtre fouillé aux abords du palais d'Aigeai semble entièrement hellénistique et n'est sans doute pas celui où fut tué Philippe II. Celui de Dion, en revanche, a pu connaître un état euripidéen.
Dion Cf. n° 86.
Chroniques 87. D. PANDERMALIS, ArchDelt, 29 (1973-74) [1980], Chron., p. 699 ; PraktArchEt, 1981 (1983), p. 63 ; 1982 (1984), p. 67 ; 1983 (1986), p. 55 ; 1984 (1988), p. 74 ; BCH, 105 (1981), p. 819 ; Ergon, 1981 (1982), p. 29 ; 1983 (1984), p. 32-33 ; 1984 (1985), p. 36 ; 1985 (1986), pp. 24-25 ; 1986 (1987), p. 72 ; 1987 (1988), pp. 63-65 ; 1988 (1989), p. 72.
Études LE THÉÂTRE HELLÉNISTIQUE
88. G. KARADEDOS, «Το ελληνιστικό θέατρο του Δίου», Οι αρχαιολόγοι μιλούν για τα Πιερία, 28-29 Ιουλίου και 4-5 Αυγούστου 1984, Thessalonique, 1985, pp. 26-30, avec résumé en allemand p. 26, reprend presque mot à mot le texte suivant
26 ARCHITECTURE DES THÉÂTRES
89. G. KARADEDOS, «To ελληνιστικό θέατρο του Δίου», Ancient Macedonia, IV, Symposium de Thessalonique 21-25 septembre 1983, Thessalonique, 1986, pp. 325-340, fait le point sur la fouille du théâtre, qui se trouve à l'extérieur de la ville. Son koilon est constitué d'un remblai amassé sur un terrain à peu près plan. Ses degrés (ht. : 0,33/0,34 m ; prof. 0,81-0,82 m) sont construits avec des briques crues, qui étaient très vraisemblablement recouvertes de marbre. L'étude des différents types de briques utilisées permet de distinguer deux phases hellénistiques et une phase romaine. Un fragment de placage en poros proviendrait d'une proédrie antérieure à ces trois états. L'orchestra (d : 26 m ca) est bordée d'un canal construit en pierre. On y a mis au jour, dans l'axe de l'édifice, un couloir souterrain comportant une petite pièce à chacune de ses extrémités. Il n'y a pas d'accès à ce couloir à l'intérieur du proskènion, auquel il semble postérieur.
Le bâtiment de scène comprend une skènè rectangulaire divisée en deux nefs par une série de piliers et un dispositif que G. K. interprète comme un proskènion jouxté de deux paraskènions. Ce proskènion est profond de 8,50 m ca et son front se situe sur une ligne légèrement avancée par rapport à ceux des paraskènions. Plusieurs éléments d'un ordre dorique sont attribués au proskènion. Le sol de la skènè se situe à 2,65 m au-dessus de l'orchestra. Des indices chronologiques assez confus laissent supposer qu'une phase au moins de l'édifice daterait du règne de Philippe V. 90. D. PANDERMALIS, «Το ελληνιστικό θέατρο του Δίου» Αρχαιολογία, 33 (Δεκ. 1989), pp. 23-26, est à consulter plus pour son illustration que pour son contenu, qui n'ajoute rien aux n° 88, 89. Malgré le titre de l'article, on trouve p. 28 un bref compte-rendu des recherches menées au théâtre romain.
LE THÉÂTRE ROMAIN. Cf. n° 90. 91. L. PALAIOKRASSA, «Το ρωμαϊκό θέατρο του Δίου», Οι αρχαιολόγοι μιλούν για τα Πιερία, 28-29 Ιουλίου και 4-5 Αυγούστου 1984, Thessalonique, 1985, pp. 55-57, avec résumé en anglais p. 55. L'édifice se trouve hors de ville, au sud-est du théâtre hellénistique. Son koilon en demi-cercle légèrement outrepassé (r : 16,45 m) comportait vingt-quatre gradins reposant sur une série de quatorze voûtes. Π n'était pas architecturalement lié au bâtiment de scène. L'orchestra (r : 10,692 m) était bordée d'un podium. L'édifice scénique se composait d'une estrade, d'un front de scène rectiligne à cinq ouvertures et d'un vestiaire. De nombreux éléments de la décoration architecturale du front de scène et de l'estrade ont été mis au jour. L'édifice, qui fut construit durant le IIe siècle ap. J.- C, fut l'objet de quelques modifications dans le dernier quart du IVe siècle. L. P. insiste sur la combinaison de traits hellénistiques et des traits impériaux décelable dans le monument.
[J.-C. MORETTI] 27
Vergina. Cf. n° 86.
Chroniques 92. Ergon, 1982 (1983), pp. 19-20 ; 1983 (1984), pp. 28-29 ; 1984 (1985), pp. 28-29 ; M. ANDRONIKOS, PraktArchEt, 1983 (1986), pp. 46- 50 ; 1984 (1988), pp. 66-67.
Étude 93. M. ANDRONIKOS, Βεργίνα, οι βασιλικοί τάφοι και οι άλλες αρχαιότητες , Athènes, 1984, 243 p. (traduction anglaise : Vergina. The Royal Tombs and the Ancient City, Athènes, 1987, 244 p.), résume pp. 46-49 les résultats de ses fouilles au théâtre, découvert en 1981. L'édifice est situé à 60 m au nord de palais. Le koilon, adossé, est divisé en neuf kerkis, par des rampes dont le sol est formé par un cailloutis. Seul le premier gradin, qui dessine un demi-cercle légèrement outrepassé, est en pierre. Les autres étaient probablement en bois.
L'orchestra est bordée d'un caniveau de pierre qui ne possède qu'un seul débouché. En son centre se trouve une pierre dont le lit d'attente, située au niveau de l'aire environnante, n'était pas couvert. M. A. la considère, à tort selon moi, comme un autel de Dionysos.
L'édifice daterait du IVe siècle. C'est à cet endroit qu'aurait été tué Philippe en 336.
L'ouvrage, destiné à un large public, ne fournit pas de plan du théâtre, mais il s'en trouve un dans PraktArchEt, 1984 (1988), en regard de la p. 44.
Héraclée de Lyncestide. Cf. n° 85. Étude
94. T. JANAKIEVSKY, Heraclea Lynkestis 2, A Theatre, Bitola, 1987, 167 p. (en serbe). Je me réfère pour ce compte-rendu au résumé en anglais pp. 145-151. Le théâtre fut édifié ex nihilo au IIe siècle de notre ère, vraisemblablement, selon T. J., sous le règne d'Hadrien. Sa cavea, de forme semi-circulaire (d : 58,50 m), comportait vingt gradins de marbre, qui sur les ailes de l'édifice, reposaient sur des substructions en caissons. Au sommet de la cavea était aménagé un sanctuaire, probablement consacré à Némésis. Les noms des tribus de la ville sont inscrits sur le premier gradin (cf. depuis, la publication de T. J. : F. PAPAZOGLOU, Les villes de Macédoine à l'époque romaine, BCH, SupplXVI [1988], p. 262, n. 44). Les sept escaliers qui divisaient la cavea présentent une disposition peu commune : les deux d'entre eux qui jouxtent la tribune centrale relient le premier au dixième gradin ; les cinq autres relient le dixième au vingtième gradin (ne faudrait-il pas en restituer deux autres de ce type en bordure des parodos ?). L'orchestra (d : 26,40 m) est bordée par un podium, qui pouvait être surmonté d'un filet. Trois ouvertures donnant accès à des carceres sont réservées dans sa paroi. Au centre de l'orchestra T. J. restitue une estrade circulaire de bois, à laquelle un escalier, placé sur son flanc ouest, donnait accès. Le même dispositif
28 ARCHITECTURE DES THÉÂTRES
aurait existé au théâtre de Pergame. Le bâtiment de scène comportait un postscaenium divisé en cinq salles et de nombreuses annexes, mais point de pulpitum. Son extension égalait celle du diamètre de la cavea. Son front de scène, de type rectiligne, était percé de trois portes.
L'édifice fut conçu dès sa construction à la fois pour accueillir les représentations théâtrales et pour les jeux de l'amphithéâtre, η est très étroitement apparenté au théâtre de Stobi.
Stobi. Cf. n° 85, 94, 120, 125. Étude
95. E. R. GEBHARD, «The Theater at Stobi : a Summary», Studies in the Antiquities of Stobi III, Titov Veles, 1981, éd. Β. Aleksova et J. Wiseman, pp. 13-27. Au début du IIe siècle ap. J.-C. fut entreprise la construction d'un bâtiment de scène, qui ne fut jamais achevé. Quelques dizaines d'années plus tard l'édification du théâtre fut menée à terme. Son bâtiment de scène comportait une skènè divisée en cinq salles et un front rectiligne percé de cinq portes, mais point d'estrade fixe. Les parodos étaient ouvertes. Les gradins du koilon en demi-cercle outrepassé étaient supportés par une série de murs rayonnants et de voûtes biaises, dans laquelle était aménagé un système de circulation intérieure. Une tribune était installée dans l'axe du monument. Le maenianum inférieur comportait dix-huit rangs divisés en sept kerkis ; le maenianum supérieur dix-sept rangs divisés en quatorze kerkis. Un diazoma couronnait l'ensemble. L'orchestra, de dimensions particulièrement importantes pour l'époque, était bordée d'un podium haut de 1,60 m, qui, à l'occasion, était surmonté d'un filet. Un refuge était réservé sous la tribune. Ainsi l'édifice fut-il conçu à la fois pour les jeux scéniques et pour les chasses et les combats de gladiateurs.
A la fin du IIIe siècle un tremblement de terre endommagea le monument, qui dut être restauré. Un muret haut de 1,50 m remplaça le filet qui couronnait le podium. Deux nouveaux refuges furent aménagés dans le koilon. C'est sans doute pour la même raison qu'un mur, percé de trois portes, fut édifié devant le bâtiment de scène. Deux portes permirent de fermer les parodos. Quand un nouveau tremblement de terre mit à mal l'édifice, il fut encore une fois restauré. La pièce centrale du bâtiment de scène fut transformée en sanctuaire de Némésis. Le monument fut abandonné dans la seconde moitié du IVe siècle.
Philippes. Cf. n° 85, 86, 120. Chroniques
96. Ch. KOUKOUU-CHRYSANTHAKI, ArchDelt, 30 (1975) [1983], Chron., p. 284 ; 31 (1976) [1984], Chron., pp. 299-301.
Étude 97. Chr. SAMIOU, G. ATHANASIADIS, «Αρχαιολογικές και αναστηλωτικές εργασίες στο θέατρο των Φιλίππων», Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και
[J.-C. MORETTI] 29
Θράκη, 1, 1987 (1988), pp. 353-362, résumé en anglais p. 534. Rapport sur les travaux conduits dans le couloir jadis voûté qui se trouve sous le diazoma supérieur et dans l'espace compris entre le mur de soutènement oriental du koilon, la muraiùe de la ville et l'arc qui les relie. Ces recherches confirment les datations de P. Collait : premier état du bâtiment (et de la muraille) dans le courant du IVe siècle av. J.-C, importante transformation dans la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. L'édifice fut abandonné à la fin du IVe ou au début du Ve siècle.
Maronée. Cf. n° 120.
Chroniques 9$. Ergon, 1981 (1982), pp. 12-13; 1982 (1983), pp. 13-14; 1983 (1984), p. 23 ; 1984 (1985), pp. 20-21 ; 1985 (1986), pp. 11-12 ; 1986 (1987), p. 43 ; 1988 (1989). pp. 108-109 ; E. PENTAZOS , PraktArchEt, 1981 (1983), p. 7 ; 1982 (1984), pp. 31-32 ; 1983 (1986), p. 27 ; 1984 (1988), pp. 31-32.
ILES DE L'ÉGÉE
Thasos. Cf. n° 10, 85, 120.
Samothrace. Cf. n° 117, 113. Étude
99. Samothrace 19231192711978. The Results of the Czechoslovak Excavations in 1927 Conducted by A. Salac and J. Nepomucky and the Unpublished Results of the 1923 Franco-Czechoslovak Excavations Conducted by A. Salac and F. Chapouthier, publié par J. Bouzek et I. Ondrejova, Praha, 1985, 161 p. On y trouve (pp. 19-25 ; 36-37 ; 78) les rapports de fouilles qui ont conduit à la publication de F. Chapouthier, A. SALAC, F. SALVIAT, «Le théâtre de Samothrace», BCH, 80 (1956), pp. 118-146.
Eubée ERETRIE. Cf. n° 120, 114.
Chronique 100. C. KRAUSE, AntKunst, 24 (1981), p. 79.
Délos.Cf.n°78,114,127. Chroniques
101. J.-Ch. MORETTI, BCH, 102 (1988), pp. 779-780 ; 103 (1989), pp. 746-752.
30 ARCHITECTURE DES THÉÂTRES
Paros Chroniques
102. BCHy 104 (1980), p. 644 ; 105 (1981), p. 855 ; 106 (1982), p. 603 ; 107 (1983), pp. 811-812 ; 108 (1984), p. 820 ; G. GRUBEN, AA, 1982, pp. 683-685.
Amorgos Chroniques
103. Ergon, 1986 (1987), p. 125 ; 1988 (1989), pp. 122-124.
Théra. Cf. n° 117.
Rhodes
104. G. KONSTANTINOPOULOS, Αρχαία Ρόδος Athènes, 1986, 252 ρ , consacre les pp. 189-190 au théâtre situé au flanc de l'acropole de Lindos. G. K. reprend la datation (IVe siècle) avancée par E. Dyggve dans la publication (Lindos III, II [1960], pp. 399-409, et particulièrement pp. 406-407). L'existence d'une paroi haute de 1,90 m en bordure externe du diazoma invite, je pense, à abaisser cette date, qui n'est fondée sur aucun élément stratigraphique.
CRÈTE
Généralités. Cf. n° 128.
Étude 105. 1. F. SANDERS, Roman Crete. An Archaeological Survey and Gazetteer of Late Hellenistic, Roman and Early Byzantine Crete, Warminster (1982), 185 ρ , consacre des notices aux théâtres de Hiérapytna (pp. 57-59), Chersonisos (pp. 59-61), Lyttos (p. 61) et Gortyne (pp. 61-63) et signale brièvement ceux d'Aptèra, Cnossos, Itanos, Kissamos, Koufonissi, Kydonia et Lissos.
Koufonissi Sitias Chronique
106. N. P. PAPADAKIS, ArchDelt, 31 (1976) [1984], pp. 382-383.
Cnossos. Cf. n° 113.
Gortyne Chronique
107. A. DI VITA, AnnScAtene, LXIII, NS XLVII (1985) [1989], pp. 363- 365.
[J.-C. MORETTI] 31
Π. Ouvrages et articles de synthèse
Généralités 108. E. SIMON, Das antike Theater, Heidelberg, 1972 a été traduit en anglais (London, 1982). 109. J.-M. LEDOUX, R. CASTINEL, «Le théâtre grec», Archeologia, 171 (oct. 1982), pp. 51-62, proposent un dossier d'initiation à l'architecture théâtrale grecque. L'exposé, bien qu'il recèle les erreurs traditionnelles (l'inévitable thymélé au centre de l'orchestra p. 54), pourra rendre quelques services aux lecteurs francophones. Signalons deux perles : «les paraskènia, parfois (sic) en saillie par rapport au proskènion»(p. 55) et, dans la bibliographie, The History of the Greek and Roman Theater de Margaret Princeton (sic, p. 62). 110. H.-D. BLUME, Einfährung in das antike Theaterwesen, 2e éd., Darmstadt, 1984, reprend avec quelques corrections et une mise à jour de la bibliographie, l'édition de 1974. 111. H. LAUTER, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt, 1986, 329 p., 80 fig. au trait, 48 clichés, consacre les pp. 166 à 175 à l'architecture théâtrale. Pp. 168-169 et fig. 55b, H. L. adopte pour le théâtre de Lycurgue une restitution du bâtiment de scène proche de celle défendue par R. F. Townsend (n° 15), avec douze colonnes (angles compris) entre les paraskènions, et un toit plat, praticable, à l'occasion, par les acteurs. Je signale fig. 56b un relevé du bâtiment de scène du théâtre d'Halicamasse, dans lequel H. A. décelé l'apparition en Asie Mineure à la fin du IIe siècle av. J.-C. du front de scène à niches et édicules. Colloques 112. Théâtre et spectacles dans l'antiquité. Actes du colloque de Strasbourg 5-7 nov. 1981, Leiden, 1983, 261 p. Concernant l'architecture je signale la communication de L. POLACCO, «Théâtre, société, organisation de l'Etat» (pp. 5-15), où l'auteur cherche à «savoir si la forme des monuments, la distribution et l'assignation des places peuvent nous dire quelque chose de nouveau sur les civilisations qui ont créé ces monuments» (p. 5). Dans les lieux où l'association entre les divisions architecturales de l'édifice et la classification du corps social est attestée, soit par des inscriptions gravées sur les gradins, soit par des textes (Athènes, Megalopolis, Ephèse, Rome), une telle recherche se justifie pleinement et il peut être profitable de la développer dans l'étude de théâtres construits dans des cités dont l'organisation sociale a été par ailleurs reconnue (Syracuse, Argos). Elle est, en revanche, à mon sens, vouée à l'échec quand elle s'applique à des sociétés dont l'organisation nous échappe. L'embarras dans lequel se trouve L. P. lorsqu'il tente d'analyser en termes de divisions sociales la présence de deux ailes dans le théâtre de Cnossos est à ce titre exemplaire (p. 7).
32 ARCHITECTURE DES THÉÂTRES
113. Anthropologie et théâtre antique. Actes du colloque international Montpellier 6-8 Mars 1986, Textes réunis par Paulette Ghiron-Bisthagne avec la collaboration de Bernard Schouler, Cahier du GITA n° 3, Montpellier, 1987, 326 p. Concernant l'architecture on retiendra la communication de L. Polacco, «Rites des saisons et drames sacrés chez les Grecs» (p. 9-22), dans laquelle sont évoqués, à propos des drames sacrés, plusieurs «aménagements théâtroïdes» (ne pourrait-on pas les qualifier simplement de «théâtraux», en faisant l'économie d'un néologisme ?). Il s'en trouve principalement dans les sanctuaires de Demeter (Eleusis, Corinthe, Pergame, Erma), mais aussi dans certains sanctuaires de Cybèle (Pessinonte), des Kabires (Samothrace, Thèbes) et d'Apollon (Delphes). 114. Atti delVXl Congresso Internazionale di Studi sul Dramma Antico sul Tema : Strutture della commedia greca, Dioniso, 57 (1987), 345 p. Concernant l'architecture : L. POLACCO, «L'evoluzione del teatro greco comico nel IV secolo A. C», pp. 267-279, s'interroge sur la transformation radicale que connaît au IVe siècle le théâtre grec tant du point de vue littéraire que du point de vue architectural. Au début du IVe siècle le théâtre de Dionysos à Athènes comporte une estrade basse entre deux paraskènions. Dans le dernier tiers du siècle apparaît en Grèce une estrade haute, le proskènion, sur laquelle évoluent les acteurs, alors radicalement séparés du choeur, qui reste dans l'orchestra. Ce type d'estrade, qui fut, semble-t-il, édifié pour la première fois à Epidaure (330-320), si du moins l'on accepte, ainsi que le fait L. P., la chronologie d' A. BURFORD {The Greek Temple Builders at Epidauros [1969]), se
diffusa rapidement à la fin du IVe et au début du IIP siècle (Argos, Corinthe, Megalopolis, Erétrie, Délos, Priène). Le théâtre d'Athènes, cependant, ne fut doté d'un proskènion que vers 150, voire, ainsi que le pense L. P., après Sylla. A la suite des tranformations apportées sous Lycurgue au bâtiment de scène les acteurs continuaient à évoluer à un niveau peu différent de celui de l'orchestra. La scène à proskènion n'a donc pas été créée pour la comédie nouvelle. Le proskènion est né en pays dorien, pour répondre aux exigences du théâtre dorien et italiote, non à celles du théâtre attique.
Pour juger de cette hypothèse, il faudrait être sûr de la restitution proposée pour la forme et l'utilisation de l'édifice scénique athénien après les travaux de Lycurgue. Le schéma proposé par L. P. serait caduque, si, ainsi qu'on l'a récemment soutenu, ce bâtiment était doté d'un proskènion (n° 10) ou d'une sorte de proskènion (n° 15).
A propos du théâtre de Delphes, que L. P. situe à la fin du IVe siècle (p. 273), je signale la discrète mise au point de G. ROUX, Delphes, son oracle et ses dieux (1976), p. 177, n. 1, qui montre que l'édifice ne peut être antérieur à 160 av. J.-C.
Accessoires. Cf. n° 14, 16, 23.
115. S. GOGOS, «Das Bühnenrequisit in der griechischen Vasenmalerei»,
[J.-C. MORETTI] 33
ÖJK 55 (1984), pp. 27-53, publie un chapitre de sa dissertation «Ionische Bühnenarchitektur auf griechischen Vasen» (Vienne, 1981). Il y étudie la forme et la fonction de l'autel et du tombeau dans plusieurs scènes qu'il considère comme des images de représentations dramatiques. Le même accessoire a pu tenir le rôle de l'autel et celui du tombeau. 116. P. J. POE, «The Altar in the Fifth-Century Theater», Classical Antiquity, 8 (1989), pp. 116-139. n. v.
Bâtiment de scène 117. E. BILLIG, «Die Bühne mit austauschbaren Kulissen. Eine verkannte Bühne des Frühhellenismus ?», OpAth, XIII/5 (1980), pp. 35-83, rassemble la documentation sur ce qu'il appelle, par opposition aux «Architekturbühnen», les «Kulissenbühnen», entendant sous ce terme l'ensemble des édifices scéniques en bois généralement dénommés scènes phlyaques. L'étude s'ouvre sur un inventaire des vestiges architecturaux. Trois théâtres ont assurément possédé une scène de ce type : Pergame, Syracuse et Corinthe. Pour ce dernier édifice, E. B. est conduit à attribuer à la première phase de construction une partie des encastrements que R. Stillwell utilisait pour sa restitution de la première scène romaine. D'autres édifices ont peut-être possédé une Kulissenbühne (Akrai, Elis, Héloros, Héracléa Minoa, Isthmia, Mantinée, Megalopolis, Phlionte, Rhegium, Segeste, Solonte, Sparte, Théra, Thyndaris).
Sans reprendre le catalogue des représentations sur céramique de ce type de scène, dressé par A. D. Trendall, Ε. Β. en étudie successivement, en se référant à la fois à la documentation architecturale et au corpus iconographique, les différentes parties (l'estrade, les coulisses) et montre que, bien que l'on ne connaisse qu'une seule représentation de Kulissenbühne dans la céramique attique, alors qu'elles sont très nombreuses en Grande Grèce, son origine est à rechercher en Grèce propre.
Cette étude a le mérite d'attirer l'attention sur une architecture mal connue et d'en relever les traces de Sicile jusqu'en Asie Mineure. Dans cette recherche les vestiges architecturaux se limitent à des séries d'encastrements difficiles à dater, mais aussi à interpréter, d'autant que la configuration d'un encastrement n'informe que partiellement sur la forme de l'élément qui s'y fichait (cf. p. 63). Aussi faudrait-il, à mon sens, être encore plus prudent que ne l'est l'auteur : quand on relève, au pied d'un koilon, deux alignements d'encastrements parallèles, rien ne permet de savoir si l'on est en présence des vestiges d'une estrade ou de ceux d'une skènè, ni si l'on a affaire à une architecture volontairement escamotable (comme ce fut, semble-t-il, le cas à Pergame et à Samothrace), ou simplement à une architecture de bois.
118. S. GOGOS, «Bühnenarchitektur und antike Bühnenmalerei. Zwei Rekonstruktionsversuche nach griechischen Vasen», ÖJh, 54 (1983),
34 ARCHITECTURE DES THEATRES
pp. 59-86, propose deux nouvelles interprétations, tirées de sa dissertation (cf. n°115), de la prétendue «scène d'Astéas» et de la «skénographie de Würzburg» 119. C. BUCKLER, «The Myth of the Movable Skenai», AJA, 90 (1986), pp. 431-436, critique la restitution proposée par H. Bulle dès 1928 (Untersuchungen an den griechischen Theatern, pp. 97-110) d'un bâtiment de scène mobile, monté sur roulettes, aux théâtres de Sparte et de Megalopolis. Des blocs à rainures du type de ceux trouvés dans ces deux édifices ont aussi été repérés aux théâtres de Gytheion, d'Orchomène de Béotie, d'Isthmia et de Tyndare. Ils ont pu recevoir des panneaux de bois. L'étude de E. Billig (n° 117, pp. 35-83 et particulièrement pp. 50-53 et 64), qui avait abouti six ans plus tôt à des conclusions analogues, n'est pas citée.
Chasses et combats de gladiateurs. Cf. n° 85, 94, 95.
120. J.-Cl. GOLVIN, L'amphithéâtre romain. Essai sur la théorisation de sa forme et de ses fonctions, Bordeaux, 1988, 458 ρ , 71 PL consacre quelques pages (237-249 et 274-278) de sa monumentale synthèse sur l'amphithéâtre romain aux théâtres de Grèce et d'Asie Mineure qui furent aménagés à l'époque impériale pour y donner des chasses et des combats de gladiateurs. Dans ces provinces orientales de l'Empire, où les amphithéâtres sont très rares, les orchestras de plusieurs théâtres servirent d'arènes. J.-Cl. G. en dresse une liste, dans laquelle sont cités pour la Grèce les théâtres d'Athènes, Corinthe, Thasos, Philippes et Stobi. Il conviendrait d'y ajouter Argos, Delphes, Erétrie, Maronée, Sparte et surtout Dodone, dont le proskènion et la skènè furent arasés quand l'orchestra fut transformée en arène (voir principalement : S. I. Dakaris, ArchDelt, 16 (1960) [1962], Chron., pp. 14-60). L'auteur insiste ajuste titre sur la petitesse de ces arènes de fortune (p. 244) et sur le maintien de la scène dans la plupart de ces édifices (p. 242).
η est regrettable que J.-Q. G., qui semble peu familier avec la bibliographie concernant ces édifices, soit conduit à commettre quelques erreurs de détails. Je signale en particulier que le chiffre de son estimation théorique de 5575 places au théâtre de Dionysos à Athènes (p. 244) doit être au moins multiplié par trois.
Sur les «caractéristiques architecturales des théâtres- amphithéâtres d'Orient par rapport aux édifices mixtes d'Occident» (pp. 247-249), on se reportera à l'article d'E. Bouley, n° 85.
Diazoma. Cf. n° 21.
Nomenclature antique. Cf. n° 9, 60, 62.
[J.-C. MORETTI] 35
Orchestra 121. C. ASHBY, «The Case for the Rectangular/Trapezoidal Orchestra», Theatre Research International, 13 (1987), pp. 1-20, η. ν.
Pausanias 122. S. GOGOS, «Das antike Theater in der Periegese des Pausanias», Klio, 70 (1988), pp. 329-339, étudie la place du théâtre dans la Périégèse. Bien que Pausanias fasse preuve d'une connaissance certaine des oeuvres dramatiques grecques et d'un intérêt soutenu pour leurs auteurs, les édifices théâtraux ne tiennent pas une place de choix dans son guide. Les théâtres mentionnés peuvent être classés en quatre groupes : ceux qui sont cités uniquement comme repère topographique (le théâtre de Dionysos à Athènes, Corinthe, Sicyone, Argos, Trézène, Messene, Patras, Aigion, Mantinée, Tégée, Phlionte), ceux qui sont qualifiés (Isthmia, Epidaure, Egine, Elis, Megalopolis, Abai, Thespies), ceux qui participent à la fois aux deux premières catégories (Sparte, Megalopolis [sic], Delphes), ceux, enfin, dont est seulement notée l'existence (Tithoréa, Lilaia, Elatée, Hyampolis). Il s'y ajoute une série de théâtres, vraisemblablement vus par Pausanias, mais non mentionnés dans la Périégèse (le Pirée [Zéa], Oropos, Rhamnonte, Kallion, Orchomène, Aigeira, Chéronée, Mycènes). P. 335 : lire «Othryadas» au lieu de «Othryadates» ; p. 338 : lire «θέας άξιον» au lieu de «θέαςάζιον».
Places réservées. Cf. n° 6, 29, 32, 36, 40, 41, 82, 89, 93-95, 98, 112.
123. M. J. OSBORNE, «Some Attic Inscriptions», ZPE, 42 (1981), pp. 171- 178, donne dans la troisième partie de son article (proedria, pp. 174-178) un classement des différentes catégories de personnes auxquelles fut accordée à Athènes la proédrie. Nouvelle restitution de IG II2, 512. 124. Ph. GAUTHIER, Les cités grecques et leurs bienfaiteurs (IVe-I'r siècle avant J.-C). Contribution à l'histoire des institutions, BCH Suppl XII, Paris, 1985, 236 p., contient plusieurs développements sur l'octroi de la proédrie, qui fait partie des megistai timai, et sur l'invitation à la proédrie lors des concours civiques (cf index, s. v. «proédrie»). 125. D. B. SMALL, «Social Correlations to the Greek Cavea in the Roman Period», Roman Architecture in the Greek World, éd. par S. Macready et F. H. Thompson, London, 1987, pp. 85-93, invite à mettre en relation, dans l'Orient grec, les divisions architecturales des koilons des théâtres édifiés à l'époque romaine avec les divisions sociales en vigueur dans les villes où ils furent construits. Les inscriptions topiques sur les gradins s'expliqueraient par le désir de réaménager le koilon à l'image du corps social quand les distinctions au sein de celui-ci auraient évolué après la construction de l'édifice. Etude des exemples de l'odèon d'Hérode Atticus à Athènes et des théâtres de Sagalassos, de Stobi, de Termessos et de Pompeï.
36 ARCHITECTURE DES THÉÂTRES
Plans. Cf. n° 56.
126. D. B. SMALL, «Studies in Roman Theater Design», AM, 87 (1983), pp. 55-68, classe les fronts de scène romains selon trois types : le front de scène rectiligne, le front de scène à niche centrale curviligne et niches latérales rectangulaires, le front de scène à trois niches curvilignes. La plupart des fronts de scène des deux derniers types auraient été dessinés selon un tracé directeur fondé sur quatre cercles. En Grèce seul le théâtre de Corinthe dans son état hadrianique entre dans cette catégorie (p. 66). 127. H. P. ISLER, «Vitruvs Regeln und die erhaltenen Theaterbauten»,
Munus non ingratum. Proceedings of the International Symposium on Vitruius' De Architectura and the Hellenistic and Republican
Architecture. Leiden 20-23 January, 1987. éd. par H. Geertman et J. J. de Jong, Leiden, 1989, pp. 141-153, tente, après bien d'autres, de répondre à la question : quel rapport existe-t-il entre les recommandations de Vitruve sur les théâtres (V, 3-8 = 108-124) et les vestiges d'édifices conservés ? La plus importante partie de l'article est consacrée au theatrum Graecorum. Après avoir écarté certains traits du schéma vitruvien, considérés comme secondaires, H. P. I. dresse une liste de dix théâtres répondant aux exigences du De architectura : Priène, Cnide, Messene Qa. salle de spectacles de l'Asclépiéion), Caunos, Athènes, Démétrias, Délos, Iasos, Epidaure, Oiniadai. Vitruve se serait inspiré des réalisations des architectes grecs. Il aurait comme source un traité théorique de la haute époque hellénistique (date de la grande majorité des théâtres construits selon le schéma vitruvien), ou se serait inspiré de la tradition micrasiatique de la basse époque hellénistique. Une série de plans, sans échelle ni indication de l'orientation, accompagne cette étude qui, en l'absence de relevés fiables des théâtres mentionnés, ne peut emporter la conviction.
Théâtre et société
128. Fr. KOLB, Agora und Theater, Volks- und Festversammlung, Berlin, 1981, 131 p. Ce livre, issu d'une thèse, achevé en 1975 («Theaterpublikum und Gesellschaft in der griechischen Welt»), cherche à la suite de W. A. MCDONALD (The Political Meeting Places of the Greeks [1943]) et de R. MARTIN (Recherches sur l'agora grecque [1951]), à cerner les rapports topographiques et fonctionnels qu'entretiennent le théâtre et l'agora. Après une introduction (I), où sont définis les termes utilisés au cours de l'étude, une première partie est consacrée à la fonction de l'orchestra sur l'agora archaïque d'après les témoignages littéraires. L'agora, qui se constitue autour des tombes de héros vénérés, y est assimilée à un ιερός κύκλος, lieu dévolu à la fois aux choeurs et aux assemblées politiques et judiciaires.
La seconde partie (III), qui constitue le corps de l'ouvrage, étudie les rapports entre le théâtre et l'agora à Athènes. F. K. est conduit à restituer, dans l'angle nord-ouest de l'agora archaïque, un vaste sanctuaire
[J.-C. MORETTI] 37
de Dionysos Lénaios, divinité chtonienne de la végétation, à laquelle il attribue l'eschara découverte au sud de l'autel des Douze Dieux. Ce sanctuaire, ombragé par un peuplier noir (αίγειρος), auquel les sykophantes suspendaient leurs accusations inscrites sur des tablettes, comportait, outre le groupe des Tyrannoctones, une vaste orchestra (d = 30 m cà) aux fonctions cultuelles, politiques et judiciaires. Elle n'est autre que le περισχοίνισμα où se déroulaient les ostracismes. L'auteur entérine l'identification du Léokorion, mais ne pense pas que la stoa Basileios ait pu jouer le rôle d'un bâtiment de scène.
Dans une troisième partie (IV) F. K. examine le rapport entre l'agora et le théâtre dans trois dèmes attiques : Thorikos, Rhamnonte et Ikarion. Chacun d'eux possède un «agora-théâtron», qui est inclu dans le téménos de Dionysos (Lénaios). Le dieu est associé dans chaque dème à un héros local et à des nécropoles. Ce réseau d'associations, qui est disloqué à Athènes à la fin de l'époque archaïque, survit aux époques classique et hellénistique dans les dèmes. Hors de l'Attique, F. K. relève le même type de lien entre le théâtre et l'agora à Sparte, Corinthe, Trézène et Morgantina (V). Π consacre la dernière partie de son ouvrage (VI) à l'utilisation du théâtre pour les assemblées populaires à partir des exemples d'Argos, de Syracuse, d'Athènes et de Megalopolis. Le sommaire (VII) est suivi d'un appendice sur les théâtrons de palais et les agoras à auditorium en escaliers de Crète.
Pour illustrer sa thèse F. K. utilise une série de textes typologiquement et chronologiquement hétérogènes et d'informations archéologiques intentionnellement choisies. Il n'est pas lieu de reprendre ici le détail de ses hypothèses, parfois stimulantes, mais rarement convaincantes. Même s'il semble imprudent de suivre l'auteur dans tous ses raisonnements, il faut cependant lui savoir gré de conserver, tout au long de son étude, une certaine retenue et une grande clarté d'exposition. 129. Die griechische Tragödie in ihrer gesellschaftlichen Funktion, éd. H. Kuch, Berlin, 1983, n. v. 130. O. LONGO, «Teatri e theatra. Spazi teatrali e luoghi politici nella città greca», Dioniso, 58 (1988), pp. 7-33, souligne à partir de nombreux exemples pris aussi bien en Grèce qu'en Italie et en Sicile l'interaction des fonctions politiques et spectaculaires dans les édifices théâtraux. L'auteur insiste, à juste titre, sur l'existence en Grande Grèce, à l'époque classique, de théâtrons à gradins curvilignes utilisés pour des réunions politiques : le bouleutérion [?] de Poséidonia et l'ekklésiastérion de Métaponte, qui sont de structure circulaire, l'ekklésiastérion d'Agrigente, qui possède un koilon en demi-cercle largement outrepassé. En Grèce propre, le bouleutérion de l'agora d'Athènes, qui dans son état de la fin du Ve siècle, aurait adopté un koilon en demi-cercle outrepassé, entrerait dans cette catégorie.
Je précise néanmoins que la disposition des sièges dans le second bouleutérion d'Athènes (415-406) est mal connue. Il suffit pour s'en convaincre de se référer au récent ouvrage de J. M. CAMP, The
38 ARCHITECTURE DES THÉÂTRES
Athenian Agora. Excavations in the Heart of Classical Athens (1986), qui ne cache pas le caractère hypothétique de la restitution du koilon (pp. 90- 91). La diversité qui règne à son sujet dans l'illustration de cette étude est pour le moins éloquente : un koilon en demi-cercle outrepassé, orienté vers l'est, est restitué fig. 66 (J. Travlos 1972, W. B. Dinsmoor Jr. 1982), 139 (J. T. 1974, W. B. D. Jr. 1982) et 151 (J. T. 1962), un koilon en demi-cercle prolongé, orienté vers le sud, fig. 67 (W. B. D., Jr. 1983/4) et 153 (W. B. D , Jr. 1983/4), un koilon polygonal, orienté vers le Sud, fig. 91 (W. B. D., Jr. 1985) et 129 (J. T. 1974, W. B. D. Jr. 1982).
Trônes 131. M. E. MICHELI, «Su di gruppo di troni con decorazione vegetale», Boreas, 10 (1987), pp. 63-80, classe les trônes à décor végétal selon quatre types. Parmi les trônes du type «prêtre de Dionysos» se trouvent, outre le trône du théâtre d'Athènes (fin du IVe siècle), éponyme du groupe, et un autre trône du même édifice, un trône de Tégée (provenant du théâtre ? ; fin du VIe siècle) et un autre de Chéronée (provenant du théâtre ? ; seconde moitié du IIIe siècle). Un troisième trône du théâtre de Dionysos (première moitié du IIIe siècle) est placé parmi les trônes du type «agora». Ceux du théâtre d'Oropos (époque syllanienne) font partie du type «Erétrie».
Le trône de l'Acropole (milieu du IVe siècle) serait l'antécédent du trône du prêtre de Dionysos actuellement en place au théâtre d'Athènes. Déclassé lors d'un réaménagement du monument, il aurait été offert comme ex-voto, peut-être à proximité du sanctuaire de Dionysos Eleuthéreus (p. 74). Le trône du Zappion (fin du IVe siècle) semble aussi avoir été un trône de prêtre de Dionysos. Il pourrait provenir du sanctuaire de Dionysos έν λίμναις (ρ. 75).
J.-Ch. MORETTI Institut Français d'Études Anatoliennes