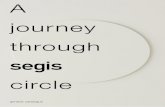« Pratiques religieuses comparées et représentation du divin en Grèce et à Rome » en...
Transcript of « Pratiques religieuses comparées et représentation du divin en Grèce et à Rome » en...
Direttore responsabileNicola [email protected]
Segretaria di redazioneDaniela [email protected]
Comitato scientificoNicole Belayche (École Pratique des Hautes Études -
Section des sciences religieuses)Corinne Bonnet (Université de Toulouse - UTM)David Bouvier (Université de Lausanne)Antonino Buttitta (Università di Palermo)Claude Calame (École des Hautes Études en Sciences
Sociales - Centre L. Gernet)Giorgio Camassa (Università di Udine)Ileana Chirassi Colombo (Università di Trieste)Riccardo Di Donato (Università di Pisa)Françoise Frontisi-Ducroux (Collège de France -
Centre L. Gernet)Cristiano Grottanelli (Università di Firenze)Cornelia Isler-Kerényi (Universität Zürich)François Lissarrague (École des Hautes Études en
Sciences Sociales - Centre L. Gernet)Vinciane Pirenne-Delforge (FNRS - Université de Liège)François de Polignac (École Pratique des Hautes Études -
Section des sciences religieuses)Sergio Ribichini (CNR - Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche
e del Mediterraneo Antico - Università della Calabria)John Scheid (Collège de France - Centres Gernet-Glotz)Giulia Sfameni Gasparro (Università di Messina)Dirk Steuernagel (Universität Frankfurt)Paolo Xella (CNR - Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche e del
Mediterraneo Antico - Università di Pisa)
Comitato di redazioneDaniela Bonanno (Università di Palermo)Corinne Bonnet (Université de Toulouse II - Le Mirail)Marcello Carastro (École des Hautes Études en Sciences
Sociales - Centre L. Gernet)Maria Vittoria Cerutti (Università Cattolica - Milano)Nicola Cusumano (Università di Palermo)Ted Kaizer (Durham University)Francesca Prescendi (Université de Genève -
Université de Lausanne)
Prezzo del volume: Italia privati € 30,00 enti € 40,00Estero privati € 40,00 enti € 50,00
Distribuzione: Salvatore Sciascia Editore s.a.s. - Corso Umberto I n. 111 - 93100 Caltanissetta
ISBN 978-88-8241-320-0
ISSN 1972-2516
© Salvatore Sciascia Editore s.a.s. Caltanissetta© e-mail: [email protected]© http://www.sciasciaeditore.it
Sede: Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Beni Culturali StoricoArcheologici Socio-Antropologici e GeograficiTel. + 39 091 6560301 - 302 - 303
Sezione di Storia Antica - Viale delle Scienze90128 Palermo - Tel. e Fax + 39 091 421737
Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Beni Culturali Storico-Archeologici Socio-Antropologici e Geografici (es. fin. 2008)
[email protected]/?id_pagina=617&id_menu_pre=611
IMPAGINAZIONE Fotocomp - Palermo
R i v i s t a d i S t o r i a d e l l e R e l i g i o n i
MYTHOS 2
S A L V A T O R E S C I A S C I A E D I T O R E
numero 2 - 2008nuova serie(15 serie continua)
Università degli Studi di PalermoDIPARTIMENTO DI BENI CULTURALISezione di Storia Antica
I N D I C E
4
Pratiques religieuses comparées et représentation du divin en Grèce et à Rome
9 N. Belayche - J.-D. Dubois, Présentation17 J. Scheid, Le carmen dans la religion romaine25 N. Belayche - N. Corre, La construction de l’‘étrange’ : quand le latin (et le grec) sont des langues ‘de puissance’45 S. Estienne, Lampes et candélabres dans les sanctuaires de l’Occident romain : une approche archéologique des rituels61 A. Zografou, Sous le regard de λύχνος. Lampes et dieux dans une « invocation apollinienne » (PGM I, 262-347)77 A. Van den Kerchove, L’image de Dieu, l’aimant et le fer. La représentation du divin dans le traité hermétique
CH IV87 M. Troiano, L’Ombre démiurgique : antécédents philoniens possibles du Démiurge gnostique
107 N. Bonansea, Menade, Baccante o Ninfa? Uno studio sull’identità femminile dionisiaca nelle fonti letterarie eiconografiche tra VIII e V secolo a.C.
131 H. Kunz, Römische Kolonien und Municipien in der Provinz Sicilia als religiöse Zentren147 F. Van Haeperen, L’impiété, une caractéristique des «mauvais » empereurs
161 C. Bonnet - J. Rüpke - P. Scarpi (Hrsgg.), Religions orientales – culti misterici. Neue Perspektiven – nouvellesperspectives – prospettive nuove, Stuttgart 2006 (G.F. Chiai)
164 L. Bricault (éd.), Bibliotheca Isiaca I, Bordeaux 2008 (E. Sanzi)166 S. Caneva - V. Tarenzi, Il lavoro sul mito nell’epica greca. Letture di Omero e Apollonio Rodio, Pisa 2007
(N. Cusumano)169 R.G. Kratz - H. Spieckermann (eds.), Divine Wrath and Divine Mercy in the World of Antiquity, Tübingen 2008
(C. Bonnet)172 H. Kunz, Sicilia. Religionsgeschichte des römischen Sizilien, Tübingen 2006 (A. Hupfloher)174 I. Nielsen (Hrsg.), Zwischen Kult und Gesellschaft: Kosmopolitische Zentren des antiken Mittelmeerraumes als
Aktionsraum von Kultvereinen und Religionsgemeinschaften, Augsburg 2006 (G.F. Chiai)177 G. Pironti, Entre ciel et guerre. Figures d’Aphrodite en Grèce ancienne, Liège 2007 (A. Beltrametti)180 F. Prescendi, Décrire et comprendre le sacrifice. Les réflexions des Romains sur leur propre religion à partir de la
littérature antiquaire, Stuttgart 2007 (A. Dubourdieu)182 J. Rüpke (Hrsg.), Antike Religionsgeschichte in räumlicher Perspektive, Tübingen 2007 (D. Bonanno)
187 Lavori in corso (a cura di D. Bonanno)
197 Gli autori
199 Pubblicazioni ricevute
Recensioni e schede di lettura
Varia
Dossier
5
Religious Practices and Representation of the Divine (Greece, Rome): A Comparative Approach
9 N. Belayche - J.-D. Dubois, Introduction17 J. Scheid, The Carmen in the Roman Religion25 N. Belayche - N. Corre, Building “Strangeness”: when Latin (and Greek) are ‘Powerful’ Languages45 S. Estienne, Lamps and Candelabra in the Sanctuaries of the Roman West: an Archaeological Approach of the Rites61 A. Zografou, Under the Eye of λύχνος. Lamps and Gods in an «Apollonian Invocation» (PGM I, 262-347)77 A. Van den Kerchove, The Image of God, the Lover and the Iron. Representation of the Divine in the Hermetic Treatise
CH IV87 M. Troiano, The Demiurgic Shadow: Potentially Philo’s Antecedents of the Gnostic Demiurge
107 N. Bonansea, Maenad, Bacche or Nimph? A Study on the Feminine Dionysian Identity in Literary and IconographicSources between VIII and V Century BC
131 H. Kunz, Roman Colonies and Municipia in Sicily as Religious Centres147 F. Van Haeperen, Impiety as a Characteristic of the ‘Bad’ Emperors
161 C. Bonnet - J. Rüpke - P. Scarpi (Hrsgg.), Religions orientales – culti misterici. Neue Perspektiven – nouvellesperspectives – prospettive nuove, Stuttgart 2006 (G.F. Chiai)
164 L. Bricault (éd.), Bibliotheca Isiaca I, Bordeaux 2008 (E. Sanzi)166 S. Caneva - V. Tarenzi, Il lavoro sul mito nell’epica greca. Letture di Omero e Apollonio Rodio, Pisa 2007
(N. Cusumano)169 R.G. Kratz - H. Spieckermann (eds.), Divine Wrath and Divine Mercy in the World of Antiquity, Tübingen 2008
(C. Bonnet)172 H. Kunz, Sicilia. Religionsgeschichte des römischen Sizilien, Tübingen 2006 (A. Hupfloher)174 I. Nielsen (Hrsg.), Zwischen Kult und Gesellschaft: Kosmopolitische Zentren des antiken Mittelmeerraumes als
Aktionsraum von Kultvereinen und Religionsgemeinschaften, Augsburg 2006 (G.F. Chiai)177 G. Pironti, Entre ciel et guerre. Figures d’Aphrodite en Grèce ancienne, Liège 2007 (A. Beltrametti)180 F. Prescendi, Décrire et comprendre le sacrifice. Les réflexions des Romains sur leur propre religion à partir de la
littérature antiquaire, Stuttgart 2007 (A. Dubourdieu)182 J. Rüpke (Hrsg.), Antike Religionsgeschichte in räumlicher Perspektive, Tübingen 2007 (D. Bonanno)
187 Work in progress (a cura di D. Bonanno)
197 Contributors
199 Publications Received
Reviews
Varia
Dossier
C O N T E N T S
Présentation
Nicole Belayche - Jean-Daniel Dubois
1 « Ce n’est ni la vertu des simples, ni la prière, ni les incantations magiques qui te rendront mère ; reçois avec constanceles coups [des Luperques] ».
2 Nous remercions la Section des Sciences religieuses de l’École Pratique des Hautes Études pour son hospitalité et leCNRS pour son soutien financier, et, très chaleureusement, tous les intervenants, dont G. FICHEUX (Rennes), R. GOR-DON (Erfurt) et P. MATTHEY (Genève) qui n’ont pas pu participer à la publication de ce dossier.
3 SMITH 2003 (rééd. SMITH 2004, 323-339).4 Macrobe, Saturnales 3, 9, 12.5 GRAF 1991.6 Dans la religion de l’“Anywhere”, J.Z. Smith reconnaît « a new geography, cosmography and polity » (SMITH 2004, 332).
MYTHOS • NUMERO 2, n.s. • 2008, 9-16 9
Non tu pollentibus herbisnec prece nec magico carmine mater eris ;excipe fecundae patienter uerbera dextrae […]
Ovide, F. 425-4271
Ce dossier expose quelques résultats des travaux réalisés lors d’un atelier qui a réuni deshistoriens des religions des mondes de l’Antiquité grecque et romaine à Paris les 27-28juin 20082. La thématique retenue : « La représentation du divin dans les pratiques
‘magiques’ : un écart, quel écart, avec les représentations traditionnelles ? » proposait de partir dupostulat que les pratiques religieuses sont une des catégories opératoires pour approcher lareprésentation du divin en Grèce et à Rome – qu’elles appartiennent à des systèmes dereprésentation dits traditionnels ou réputés différents comme la ‘magie’, la gnose oul’hermétisme, ou bien, pour employer la typologie spatiale de J.Z. Smith, qu’elles relèvent duHere, du There ou de l’Anywhere3 –. Les rituels, dans leur combinatoire de mots, de gestes et demise en scène, constituent un observatoire privilégié pour examiner la représentation du divin etses dynamiques, puisqu’ils reflètent des stratégies pour opérer la présentification des instancessupérieures et gérer la communication avec elles. Alliant gestes et paroles, ils suivent des règlesprécises, réputées ne pas laisser place à l’imagination ou à l’improvisation, que l’on se fie auxcomptes rendus de la confrérie publique des Arvales, ou bien, à l’autre bout du spectre social,aux instructions détaillées données dans les papyrus magiques. Dans quelque contexte religieuxqu’ils s’inscrivent, ils énoncent une conception du monde divin dans laquelle les instancessupérieures sont associées à des champs de compétence singuliers, qui peuvent être fonctionnels,territoriaux, occasionnels, etc…, voire universels. Ainsi la gestuelle de l’opérateur rituel exprimeles personnalités des figures invoquées dans la deuotio romaine qui promet dans un vœul’offrande du peuple ennemi : « en nommant Tellus, il touche la terre de ses mains ; en nommantJupiter, il lève les mains au ciel »4.
Sur cette base herméneutique commune, la mise en regard d’éléments de rituels (invocationsprécatoires, imprécatoires ou déprécatoires5, lampes) ou de rites (rites d’initiation à lacontemplation chez les hermétistes qui ne sont pas convoqués d’habitude sur ce terrain)ambitionnait de s’interroger sur les « écarts » éventuellement discernables dans les formes etmodalités de la représentation du divin selon les types de pratiques étudiées6. L’horizon
7 Ce Groupe De Recherche Européen (GDRE-CNRS), piloté par N. Belayche (EPHE/UMR 8585 - Centre GustaveGlotz), réunit cinq équipes de recherche françaises (UMR 8585 - Centre Gustave Glotz, Paris ; UMR 8584 - Cen-tre d’Études des Religions du Livre, Villejuif ; ENS Ulm, Paris ; LAHM (ex CRESCAM), Rennes ; et ERASME, Tou-louse) et quatre partenaires européens (Université d’Erfurt, Allemagne ; Université de Liège et FNRS, Belgique ; Uni-versité de Genève, Suisse ; Université d’Athènes, Grèce).
8 Une 2ème rencontre s’est tenue à Rennes (12-13 décembre 2008) : « Représentation du divin : ses noms et ses règles »(dossier à paraître dans ARG 2010). En 2009, deux rencontres auront lieu : les 23-24 octobre à Liège (Belgique) : «Nour-rir les dieux ? Sacrifice et représentation du divin », et les 11-12 décembre 2009 à Genève (Suisse) : « Les dieux en (ousans) émotion. Perspective comparatiste (Grèce, Rome, Egypte et Mésopotamie) ».
9 Corpus hippocratique, De morbo sacro, éd. LITTRÉ, Paris, 1849, VI, p. 359.
MYTHOS • NUMERO 2, n.s. • 2008, 9-1610
Nicole Belayche - Jean-Daniel Dubois, Présentation
interprétatif était double : informatif et méthodologique. Nous souhaitions rassembler oucomparer des données relatives aux diverses façons dont les Anciens traduisaient leursreprésentations du monde surnaturel dans divers contextes rituels et, ainsi, progresser dansl’appréciation de la pertinence des catégories généralement admises pour caractériser cescontextes rituels, en évitant les pièges idéologiques… autant que faire se peut. Cesquestionnements s’inscrivent dans les axes de recherche d’un vaste programme de rechercheeuropéen : « FIGVRA. La représentation du divin dans les mondes grec et romain »7.
Ce programme a pour objet d’examiner la/les représentation(s) du monde supérieur enconsidérant que le croisement de ses multiples expressions (rituelles, figurées, discursives etconceptuelles) est une voie pour dessiner cette représentation dans son unité – celle d’unereprésentation plurielle –, et ses représentations dans leur diversité – puisque sa pluralité mêmeen fait un matériau plastique, susceptible d’être remodelé en autant de figures divines et deconfigurations panthéoniques qu’il existe pour les hommes de situations. Pour des historiens desreligions, s’interroger sur la représentation du divin revient à réfléchir sur l’objet même de leurétude : comment les hommes construisent-ils la présence – et pas seulement la visibilité –,concrète ou intellectuelle, par tous les langages disponibles, de puissances qui n’appartiennentpas au monde phénoménal, bien que les hommes affirment communiquer avec elles ou en fairel’expérience ? Ces modes de représentation sont multiples et généralement combinés, et leurtransparence n’est pas égale à l’observateur. Ils peuvent être iconographiques (les figurations desdieux), narratifs (les récits mythiques), symboliques (dans les rituels entre autres), politiques(dans les conduites de gouvernance et de gestion des risques au sein des collectivités),conceptuels (les systèmes théologiques), etc. ; d’où la nécessaire diversité des approches. Avec la« fabrique » des polythéismes en point de mire, l’ambition du groupe de recherche dans unesuccession de rencontres thématisées8 est de mieux comprendre les structurations etfonctionnements de ces systèmes complexes, intimement dépendants des circonstances et descadres institutionnels. La démarche ne peut qu’être empirique, de façon à rendre compte de cesopérations de « bricolage » qui informent au quotidien les représentations de mondes qui ne sontni clos ni figés derrière leur réputation affichée de tradition, mais au contraire ouverts,extensibles et plastiques par nature.
Parmi les pistes répertoriées destinées à tisser le matériau final, cette première rencontrecentrée sur l’apport des pratiques rituelles à notre connaissance de la représentation du divin avaitpour principe d’analyse une mise en regard des pratiques dites traditionnelles, y comprisgnostiques et hermétiques, c’est-à-dire considérées comme normales et légitimes par la sociétéambiante, et des pratiques dites magiques. Suivant l’auteur du traité hippocratique de La maladiesacrée, les magiciens aussi « ne parlent guère que de l’influence des dieux et des démons»9.
Entrer dans la représentation du divin par ce que peuvent nous en apprendre les pratiquesmagiques n’est certainement pas une voie facile, étant donné que la catégorie de magie, rétive à
10 Cf. SMITH 1995 (rééd. SMITH 2004). On retiendra dans une production exponentielle : FARAONE - OBBINK (éd.) 1991 ;JORDAN - MONTGOMERY - THOMASSEN (éd.) 1999 ; MOREAU - TURPIN (éd.) 2000 ; MIRECKI - MEYER (éd.) 2002 ;CARASTRO 2006. Pour une revue bibliographique récente, CALVO MARTINEZ 2001.
11 JORDAN - MEYER - MIRECKI (éd.) 1995.12 TAMBIAH 1979.13 Pline, NH 28, 19.14 Pline l’Ancien, NH 28, 13 : si simel recipiatur ea ratio, et deos preces aliquas exaudire aut ullis moueri uerbis, confiten-
dum sit de tota coniectatione. Cf. GRAF 1991.15 Cf. GAROSI 1976.16 Cf. PHILLIPS 1991 ; GRAF 1994 ; JORDAN - MONTGOMERY - THOMASSEN (éd.) 1999 (en part. E. THOMASSEN, 55-
66) ; FARAONE 2006, 21.17 Voir par exemple MARTINEZ 1995.18 Tite Live 8, 9, 5-8.19 CIL XI, 1823 = AUDOLLENT 1904, n° 129 (Arrezzo). Cf. GRAF 1994, 148-151.20 VERSNEL 1991a, 1-64.
MYTHOS • NUMERO 2, n.s. • 2008, 9-16 11
une définition essentialiste, continue de chercher sa définition chez les spécialistes en fonctiondes approches épistémologiques10 : rites d’inversion, pratiques privées, altérité construite par unenorme, pouvoir rituel (ritual power) selon le titre d’une conférence américaine qui a fait date11,parole performative (performative utterance)12, etc. « Il n’est personne qui ne redoute d’êtreenvoûté (defigi) par des prières maléfiques (diris precationibus) » écrivait Pline13, avant de dresserune liste de comportements variés, où se mêlent conduites superstitieuses (par ex. briser lescoquilles), pratiques apotropaïques (inscriptions avec des mots de puissance), formulesprotectrices ritualisées (carmina) et enchantements de tous ordres à fins de compétition. Depuisune génération, le réexamen de cette catégorie historiographique a mis en évidence qu’elle n’étaitpas à isoler comme un objet singulier de l’histoire des religions du monde romain, mais qu’ilconvenait d’en étudier les formes rituelles au moyen de la même grille herméneutique que celleappliquée aux formes rituelles traditionnelles. Pline l’Ancien, déjà, y invitait après avoir évoquédes pratiques de la religion romaine publique, comme la deuotio des Decii ou la deprecatio de laVestale Tuccia accusée d’inceste :
« si l’on admet une fois la démonstration que les dieux exaucent certaines prières (precesaliquas) ou sont touchés par certaines paroles (ullis uerbis), il faut convenir del’interprétation dans sa totalité »14.
On ne s’attardera pas dans cette présentation sur ce que l’Antiquité15, puis l’historiographie,a classé sous le label ‘magique’16. On rappellera plutôt, pour appuyer notre parti-pris comparatif,que la relation votive intervient dans des pratiques rituelles relevant des deux catégories depratiques17, qu’on continue trop souvent d’opposer. La deuotio du général et des ennemis18 avaitde plus fréquentes occurrences semblables dans la vie quotidienne. Des tablettes de plombvouent l’adversaire aux puissances pour l’éliminer :
« […] je livre, dédie, sacrifie auprès de votre puissance divine ([…] apud vostrumnumen, demando, deuoueo, desacrifico […]) »19,
en utilisant une formule ternaire qui se retrouve dans les soumissions de voeux, ainsi que lerappelle J. Scheid dans sa contribution. La victime d’un préjudice, un objet disparu assezsouvent, cherchait satisfaction en en appelant à la justice des dieux. Ces suppliques, à distinguerdes defixiones20, relèvent elles aussi du uotum, c’est-à-dire d’un contrat passé avec la divinité
Dossier
21 CUNLIFFE (éd.) 1988, n° 10.5-7.22 AUDOLLENT 1904, n° 106 ; cf. OGDEN 2002, 219-222.23 CUNLIFFE (éd.) 1988, n° 35.24 GRAF 1994, 174-175.25 STRUBBE 1997, n° 113, 125, 72ter; n° 121, 114; et n° 155, 48. Cf. STRUBBE 1991, 33-59.26 VERSNEL 1991, 60-95.27 STRUBBE 1997, n° 127.28 STRUBBE 1997, n° 285.29 Cf. la qualification magique que la tradition historiographique a longtemps attribuée aux carmina des Saliens ou des
Arvales, par ex. FREYBURGER 2000. Pour le sens de carmen, voir l’article de J. SCHEID dans ce volume.30 Ovide, F. 2, 769-782, citation 581.31 Caton, Agr. 160 : cotidie cantato.32 Cicéron, Lois 2, 59.33 Code Théodosien IX, 16, 3, 7, en 319. Cf. KIPPENBERG 1997.34 PGM II, 1-10 & 139-140.
MYTHOS • NUMERO 2, n.s. • 2008, 9-1612
Nicole Belayche - Jean-Daniel Dubois, Présentation
appelée à l’aide : Deuoueo eum qui caracellam meam inuolauerit (après le vol d’un manteau)21. Ladivinité justicière se voyait offrir tout ou partie du bien dérobé :
« Au dieu Nodens. Silvanus a perdu son anneau et il a donné la moitié [de sa valeur] àNodens. Quant à ceux – parmi lesquels aussi un nommé Senecianus –, ne leur accordepas de santé, jusqu’à ce qu’il ait rapporté [l’anneau] au temple de Nodens »22.
La volonté de voir la justice triompher prenait la forme d’un appel à la vengeance desdieux23, lorsqu’une mort prématurée faisait supposer un acte criminel24 ; mais la structure duprocessus restait invariable. Les imprécations funéraires, nombreuses dans l’épigraphie funérairede l’Asie Mineure impériale pour protéger l’intégrité des tombeaux25, étaient une formeritualisée de cet « appeal to justice »26. Elles activaient par avance la justice rétributive des dieux etemployaient également le lexique du contrat (ἀποδώσουσι)27. Aussi, la sanction financièrepublique continuait-elle d’accompagner la sanction cosmique28.
Le calendrier public romain comportait des fêtes dont le rituel entrerait certainement sous lelabel ‘magique’ dans un autre contexte ; nombre de commentateurs les ont ainsi qualifiées, voirecontinuent de le faire29. L’apaisement des âmes des morts (les manes), auquel on procédaitannuellement le 21 février lors des Feralia, se doublait d’un rituel à Tacita Muta qui affichait sonobjectif :
« Nous avons lié (uinximus) les langues ennemies et les bouches malveillantes »30.
D’autres situations banales réclamaient des proférations rythmées, efficaces, par exemple,pour soigner les luxations d’après Caton31. Leur construction littéraire ne différait pas de celledes carmina de la religion romaine publique et du droit, puisque Cicéron enfant apprenait « letexte des XII Tables ut carmen necessarium »32. Le fait que des rituels ne fussent pas pratiquéslibera luce33, mais comme clandestinement, les rendait bien plus suspects que les procédésutilisés. Dans des pratiques destinées au devenir des affaires terrestres, qui mettaient en avantnon plus la représentation d’un partenariat contractuel entre les mondes humain et divin, maisle principe de sympathie au sein de la nature attesté dans des objets transitionnels, les puissancesdivines des panthéons traditionnels aussi, par exemple l’Apollon de Delphes dans un papyrusmagique34, étaient alors convoquées comme auxiliaires ou agents de l’action.
35 Corpus hippocratique, De morbo sacro, éd. LITTRÉ, Paris, 1849, VI, p. 361.36 Par exemple, l’emploi de λύvχνος dans les PGM est très souvent accompagné par un adjectif précisant son matériau
(πεπλασµένης ἐκ παρθένου γῆς), son aspect (elle ne doit pas être peinte en rouge / ἀµίλτωτος) ou son état (elledoit être καθαρός, καινός, ne pas avoir été utilisée).
37 SCHEID 1998.
MYTHOS • NUMERO 2, n.s. • 2008, 9-16 13
Dès l’Antiquité, les débats sur la valeur, d’efficacité ou de piété selon les cas, des pratiquesdites magiques a porté sur la représentation que ces cérémonies incantatoires et décalées parrapport aux pratiques reconnues donnaient des dieux et, conséquemment, sur les relations queles hommes entretenaient avec eux. Au plan théologique, la critique première intentée à la‘magie’ est de ravaler les puissances divines au rang de figures sujettes à l’asservissement.
« Quelle que soit la cause, soit rites, soit tout autre connaissance ou pratique, dont lesgens de ce métier disent tenir leur pouvoir, ils ne m’en paraissent pas moins être dansl’impiété et ne pas croire qu’il y ait des dieux, ou, le croyant, penser que ces dieux sontsans force et dans l’impuissance d’empêcher aucune de ces merveilles suprêmes qu’ilspromettent »35.
Depuis James Frazer, la singularisation de pratiques comme magiques a continué de mettreen avant la contrainte exercée sur les puissances par les magiciens et leurs λόγοι ἐπανάγκοι (lesparoles qui contraignent). Dans ces rituels, des formes rhétoriques, moins originales que lecontenu de l’énonciation, ou des objets cultuels autrement banals (coupes, lampes, etc.),prennent un relief particulier. Aux yeux des Modernes, les unes et les autres affichent unesophistication d’autant plus remarquable que les papyrus conservent des descriptions pratiqueset vivantes des scénarios36, alors que, dans le monde latin du moins qui n’a guère transmis derèglements rituels (les « lois sacrées »), les rituels traditionnels doivent être reconstitués à partir desources elliptiques et non prescriptives (inscriptions votives, images, fouilles archéologiques,évocations littéraires). Il est, pourtant, à parier que le déroulement de ces derniers était tout aussiminutieux et non moins chargé symboliquement, si l’on se fonde sur les commentarii conservésdes frères arvales37.
Les documents dits magiques, et en particulier les PGM, mettent en présence d’un mondedivin aux figures innombrables qui sont les destinataires d’incantations hymniques réputées lesmettre en branle. D’origines culturelles multiples – égyptienne, juive et grecque pour l’essentiel –,plus ou moins identifiables lorsqu’elles se cachent derrière des noms rituels « barbares », elles sontgénéralement dominées par une grande figure qui confine à la transcendance dans certainstextes. Les panthéons des magiciens affichent des architectures diversement hiérarchisées et lescritiques de l’auteur hippocratique citées plus haut sont loin de rendre compte de toutes leursconfigurations. Les conceptions des magiciens n’étaient pas univoques. C’est pourquoi, bien quele terrain soit conceptuellement miné, il nous a semblé que la représentation du divin dans desdocuments labellisés comme magiques offrait un ensemble cohérent et relativement circonscrit,se prêtant avantageusement à la comparaison avec cette même représentation dans les rituelstraditionnels. Faut-il le préciser, ce dossier n’a pas de visée d’exhaustivité ; au contraire, il choisitde tester des pistes d’analyse en singularisant quatre types de langages rituels – la prière,l’utilisation d’objets cultuels, des pratiques sacrificielles, une conception théologique –.
Le premier type de langage envisagé est celui de la prière. John Scheid étudie la place et lafonction du carmen dans la religion romaine publique. Ce « chant » en prose rythmée désigneaussi bien une prière qu’un hymne. Toutefois, en examinant les carmina célèbres des Saliens, des
Dossier
38 Quintilien, Institution oratoire I, 6, 40.39 Tertullien, Ad Nationes 1, 13, dans le sillage de Fl. Josèphe, Contre Apion 2, 282 : « Il n’est pas une cité grecque, pas
un peuple barbare, où… l’allumage des lampes (λύχνων)… ne soit observé ».
MYTHOS • NUMERO 2, n.s. • 2008, 9-1614
Nicole Belayche - Jean-Daniel Dubois, Présentation
Arvales et celui des jeux séculaires, leurs rythmes et la gestuelle qui les accompagne, J. Scheiddifférencie carmen et precatio : tandis que cette dernière est la formule performative du rituel, lecarmen clôt le rituel par une représentation plaisante et agréable, une offrande poétique raffinéeaux dieux. Le soin esthétique qui préside à la construction du carmen éclaire la fonction du ritedans son rôle de médiation auprès de destinataires surnaturels. Cette étude dégage salutairementla définition du carmen de l’opposition traditionnelle entre religion et magie, qui s’appuyait surl’usage du mot pour qualifier des rituels étranges (comme le rappelle Ovide en exergue) et surune réputation d’archaïsme nécessitant un interprète38. Passant de la forme esthétique aux usageslinguistiques, Nicole Belayche et Nicolas Corre s’attachent à rechercher comment le choix deslangues dans des déclarations en contexte dit magique constitue une stratégie pour construire del’étrangeté dans des formules rituelles autrement banales. Testant l’hypothèse sur la languelatine, précisément pour sa banalité insoupçonnable et insoupçonnée des Romains, ils mettenten évidence plusieurs stratégies qui agissent soit sur le texte complet des invocations, soit, plusétroitement, dans la construction des nomina barbara : outre l’efficacité reconnue à des formulesarchaïsantes, le changement de langue dans un texte et l’utilisation de la translittération, lemélange des langues ou des alphabets, l’intrusion d’un mot latin dans une langue autre, tout enveillant à une profération parfaite grâce à des translittérations. Ce dernier procédé inscritassurément ces stratégies linguistiques dans la pragmatique rituelle.
Pour aborder les objets cultuels utilisés dans cette praxis, on a choisi de porter un regardcomparé sur la présence des lampes, universelle en contexte religieux antique pace Tertullien quiy voyait un Iudaicus ritus lucernarum39. Après avoir posé la place des lampes dans l’équipementdes sanctuaires de l’Occident romain, en fournissant un précieux appendice épigraphique desattestations, Sylvia Estienne enquête (dans la mesure de l’information archéologique disponible)sur leur statut : de l’offrande à fins d’honneur à l’objet fonctionnel dans le rituel. Elle montrecombien les deux statuts sont difficiles à départager du fait même de la polyvalencefonctionnelle et symbolique possible de ces objets. La découverte de lampes d’époque tardive àla fontaine d’Anna Perenna à Rome exemplifie clairement l’étendue du spectre rituel qui secache derrière leurs présences dans les lieux de culte : depuis la lampe des pratiquescontractuelles reconnues, parfois inscrite comme votive, jusqu’à des pratiques ‘magiques’ avéréespour les sept retrouvées avec les defixiones en plomb enchâssées dans leur bec. C’est sur ce mêmefond protéiforme des usages qu’Athanassia Zografou inscrit son analyse de l’utilisation d’unelampe dans une « invocation apollinienne » transmise par un papyrus magique conservé à Berlin,qui fournit des informations sans parallèles, hélas, dans les contextes rituels ‘classiques’. Dans ledéroulement de ce rituel à but divinatoire, la lampe sert fonctionnellement à construire le tempset l’espace nécessaires à sa réussite et procure un support concret pour les opérations decommunication avec l’instance convoquée, Apollon. Plus subtilement, dans sa mise en scène, enacte et en symbole, articulée avec d’autres objets, elle est le réceptacle du θεῖον πνεῦµα appelé àapparaître dans la lumière de la lampe, transfigurée en lumière divine. Devenuesymboliquement la figure même du dieu, le praticien peut alors la manier, toute instancesuprême qu’il soit.
Pour aborder les rites, nous avons également choisi une voie étroite. En effet, pour quienvisage les pratiques rituelles des gnostiques et celles des hermétistes en Égypte, ce n’est querécemment que la recherche a admis de sortir du regard hérésiologique qui a orienté les travaux
AUDOLLENT 2004A. Audollent, Defixionum tabellae [DT], Paris 1904.
CALVO MARTINEZ 2001J.L. Calvo Martivnez, « Cien años de investigaciovnsobre la magia antigua », MHNH 1 (2001), 7-60.
CARASTRO 2006M. Carastro, La cité des mages. Penser la magie enGrèce ancienne, Grenoble 2006.
CUNLIFFE (éd.) 1988B. Cunliffe (éd.), The Temple of Sulis Minerva at Bath,Oxford 1988.
FARAONE 2006C.A. Faraone, Philtres d’amour et sortilèges en Grèceancienne, Paris 2006.
FARAONE - OBBINK (éd.) 1991C.A. Faraone - D. Obbink, Magika Hiera. AncientGreek Magic and Religion, New York-Oxford 1991.
FREYBURGER 2000G. Freyburger, « Prière et magie à Rome », dans J.Moreau - J.-C. Turpin (éd.), La Magie. Actes duColloque International de Montpellier 25-27 mars1999, Montpellier, 2000, 5-13.
Bibliographie
MYTHOS • NUMERO 2, n.s. • 2008, 9-16 15
depuis l’Antiquité. Jusque vers la fin du XXe siècle, les gnostiques et les hermétistes ont étéconsidérés comme des spécialistes de spéculations abscondes et n’ayant pas de pratiques rituelles.Or, la découverte de manuscrits coptes à Nag Hammadi en 1945 et la recherche subséquente surces textes nouveaux a permis d’inverser cette orientation. L’étude des corpus de texteshermétiques grecs, coptes et latins a soulevé bon nombre de rapprochements avec les pratiquesdes temples égyptiens. Comme le montre Anna Van den Kerchove, si la représentation du divindans le quatrième traité du Corpus hermétique passe par l’utilisation des images de Dieu pouraboutir à la contemplation, les hermétistes apparaissent alors comme des hommes del’Antiquité, ordinaires, sachant jouer de l’animation des statues, tout en proposant une voiespécifique de la recherche du divin.
Quant à ce que les pratiques des gnostiques peuvent révéler de leur représentation du divin,ces groupes ont laissé suffisamment d’œuvres écrites pour que l’on y discerne des traces de leurfréquentation des magiciens. L’étude de Mariano Troiano traque moins les pratiques magiquesdu démiurge qu’elle ne met en valeur les représentations philosophiques et théologiques d’unefigure qui est, par excellence, celle de l’artisan de la maîtrise sur la matière du monde créé,visible ou souterrain. S’intéresser à l’ombre divine dans les textes gnostiques permet d’approcherla face obscure du maître du monde, et fait apparaître un portrait controversé du démiurge oùles gnostiques construisent, sur la base de sources bibliques et philosophiques, une figure duresponsable de l’œuvre de la création en décalage par rapport au Dieu biblique des chrétiens ouau démiurge du Timée de Platon.
Ce bouquet de représentations du divin est offert à la déesse « réflexion ». Faut-il encore desprières, des incantations, ou tout simplement « la vertu des simples » (pour plagier Ovide) pourle rendre opératoire ? Il manifeste en tout cas la diversité des combinatoires possibles dans lesprocessus de représentations de l’autre monde et pourrait féconder une recherche plusapprofondie que le projet FIGVRA tente déjà de réaliser. Nous remercions MYTHOS, en lespersonnes de Daniela Bonanno et Nicola Cusumano, d’avoir ouvert ses pages à cette premièreinvestigation.
Nicole Belayche Jean-Daniel DuboisÉcole Pratique des Hautes Études École Pratique des Hautes Études46 rue de Lille 46 rue de Lille75007 Paris 75007 [email protected] [email protected]
Dossier
MYTHOS • NUMERO 2, n.s. • 2008, 9-1616
Nicole Belayche - Jean-Daniel Dubois, Présentation
GAROSI 1976R. Garosi, « Indagini sulla formazione del concetto dimagia nella cultura romana », dans P. Xella (éd.),Magia. Studi di Storia delle religioni in memoria di R.Garosi, Rome 1976, 13-93.
GRAF 1991F. Graf, « Prayer in Magic and Religious Ritual », dansC. Faraone - D. Obbink (éd.) 1991, 188-213.
GRAF 1994F. Graf, La magie dans l’Antiquité gréco-romaine, Paris1994.
JORDAN - MEYER - MIRECKI 1995D.R. Jordan - M. Meyer - P. Mirecki (éd.), Ancient Magicand Ritual Power, Boston-Leiden (RGRW 129), 1995.
JORDAN - MONTGOMERY - THOMASSEN 1999D.R. Jordan - H. Montgomery - E. Thomassen (éd.),The World of Ancient Magic, Bergen 1999.
KIPPENBERG 1997H.G. Kippenberg, « Magic in Roman CivicDiscourse: Why Rituals could be Illegal », dans P.Schäfer - H.G. Kippenberg (éd.), Envisioning Magic.A Princeton Seminar and Symposium, Leiden-NewYork-Cologne (Studies in the History of Religions75), 1997, 150-157.
MARTINEZ 1995D. Martinez, « ‘May she neither eat or drink’ ; LoveMagic and vows of Abstinence », dans P. Meyer - M.Mirecki (éd.) 1995, 335-359.
MIRECKI - MEYER (éd.) 2002P. Mirecki - M. Meyer (éd.), Magic and Ritual in theAncient World, Leiden-New York-Cologne 2002.
MOREAU - TURPIN (éd.) 2000J. Moreau - J.-C. Turpin (éd.), La Magie. Actes duColloque International de Montpellier 25-27 mars1999, Montpellier 2000.
OGDEN 2002D. Ogden, Magic, Witchcraft, and Ghosts in the Greekand Roman Worlds. A Sourcebook, Oxford 2002.
PHILIPPS 1991J.R. Phillips, « Nullum crimen sine lege. Socioreligioussanctions on magic », dans C. Faraone - D. Obbink(éd.) 1991, 261-276.
SCHEID 1998J. Scheid, Commentarii Fratrum arvalium quisupersunt: les copies épigraphiques des protocoles annuels dela Confrérie arvale (21 av. - 304 ap. J.-C.), Rome-Paris1998.
SMITH 1995J.Z. Smith, « Trading places », dans M. Meyer et P.Mirecki (éd.) 1995, 13-27.
SMITH 2003J.Z. Smith, « Here, There, and Anywhere », dans S.B.Noegel - J. Walker - B.M. Wheeler (éd.), Prayer,Magic, and the Stars in the Ancient and Late AntiqueWorld, Pennsylvania State UP, 2003, 21-36.
SMITH 2004J.Z. Smith, Relating Religion, Chicago-Londres 2004.
STRUBBE 1991J.H.M. Strubbe, « Cursed be he that moves my bones»,dans C. Faraone - D. Obbink (éd.) 1991, 33-59.
STRUBBE 1997J.H.M. Strubbe, ΑΡΑΙ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΙ. Imprecationsagainst Desecrators of the Grave in the Greek Epitaphsof Asia Minor. A Catalogue, Bonn (IK 52), 1997.
TAMBIAH 1979S.J. Tambiah, « A Performative Approach to Ritual »,Proceedings of the British Academy 65, 1979, 113-169.
VERSNEL 1991aH.S. Versnel, « Beyond Cursing: The Appeal toJustice in Judicial Prayers », dans C. Faraone et D.Obbink (éd.) 1991, 60-95.
VERSNEL 1991bH.S. Versnel, « Religious mentality in ancient prayer »,dans H.S. Versnel (éd.), Faith, Hope and Worship.Aspects of Religious Mentality in the Ancient World,Leiden 1991, 1-64.
Gli autoriNicole BelaycheÈ Directrice d’études presso la Section des sciences reli-gieuses dell’École pratique des Hautes études, Paris, cat-tedra « Religions de Rome et du monde romain ». Studia lereligiosità e i rituali « pagani » nel mondo romano, con par-ticolare riferimento all’area orientale dell’impero romano,al fine di chiarire la relazione tra le culture religiose, poli-teismi e monoteismi. Ha pubblicato Iudaea-Palaestina.The Pagan Cults in Roman Palestine (Second to Fourth Cen-tury), Tübingen 2001 (Religion der Römischen Provinzen 1).Ha curato con S.C. Mimouni i volumi Les Communautés reli-gieuses dans le monde gréco-romain. Essais de définition,Turnhout 2003 (Bibliothèque de l’École des Hautes Études,Sciences religieuses 117) e Entre lignes de partage et ter-ritoires de passage. Les identités religieuses dans les mon-des grec et romain, Louvain 2008. Dirige attualmente ungruppo di ricerca europeo (2008-11) : FIGVRA. La repré-sentation du divin dans les mondes grec et romain.
Nicoletta BonanseaÈ dottore di ricerca in Istituzioni, società, religioni dal tar-doantico alla fine del medioevo della Scuola Dottorale inStudi Storici dell’Università degli Studi di Torino. Ha discus-so una tesi dal titolo: Simbolo e narrazione. Linee di svi-luppo formali e ideologiche dell’iconografia di Giona tra IIIe VI secolo, in c.d.s. Si occupa di storia del cristianesimo,iconografia greca e paleocristiana.
Nicolas CorreÈ Professeur agrégé di Storia. Conduce una ricerca comparatasui riti o sulle sequenze rituali della religione romana e suquelli classificati dalla tradizione storiografica come “magi-ci”, in vista della discussione della tesi di dottorato pres-so l’École pratique des Hautes études, Sciences Religieu-ses dal titolo: Communione loquendi cum deis immortali-bus (Apulée). Rites et rituels ‘magiques’ dans la religion publi-que romaine.
Jean-Daniel DuboisÈ Directeur d’études presso la Section des Sciences reli-gieuses de l’Ecole pratique des hautes études, Paris, cat-tedra «Gnose et manichéisme» Le sue ricerche sono incen-trate principalmente sui testi copti relativi alla storia deglignostici valentiani e all’espansione del manicheismo inambito mediterraneo. Membro del Laboratoire d’études surles monothéismes (UMR 8584 du CNRS, à Villejuif), èresponsabile di un progetto finanziato dall’Agence natio-nale pour la recherche, dal titolo Corpus des énoncés
barbares, e anche di un progetto collettivo per la pubbli-cazione degli Atti apocrifi di Pilato. Dirige inoltre la rivistainternazionale Apocrypha. Ha pubblicato recentementeLes apocryphes chrétiens, Paris 2007; La Prière de Paule L’Apocalypse de Pierre, in Ecrits gnostiques, Paris 2007,1-10 e 1141-1166; Les recherches gnostiques actuelleset l’évangile de Jean, in B. Decharneux - F. Nobilio (éd.),Figures de l’étrangeté dans l’Evangile de Jean, Etudessocio-historiques et littéraires, Fernelmont 2007, 279-300; L’Evangile de Judas et la tradition basilidienne, in M.Scopello (ed.), The Gospel of Judas in Context, Leiden 2008,145-154; L’utilisation du grec dans le texte valentinien cop-te du Traité Tripartite, in Gnose et philosophie, Etudes enhommage à Pierre Hadot, ed. J.-M. Narbonne et P.-H. Poi-rier, Québec - Paris 2009, 29-43.
Sylvia EstienneÈ maître de conférences in Storia Romana all’Ecole normalesupérieure (Paris). Ha pubblicato diversi articoli sulla fun-zione religiosa delle statue delle divinità, sulla costituzio-ne e la disposizione degli spazi rituali nel mondo romano.Ha curato, con Dominique Jaillard, Natacha Lubtchansky eClaude Pouzadoux, il volume Image et religion dans l’Anti-quité gréco-romaine, Naples (coll. Centre Jean Bérard, n. 28),2008.
Heike KunzHa conseguito il dottorato di ricerca in Filologia Latina eStoria nel 2004 a Tübingen ed è attualmente Lehrbeauftragtefür Latein presso l’Historisches Seminar dell’Università diStuttgart. Si occupa di storia della religione romana. Harecentemente pubblicato Sicilia. Religionsgeschichte desrömischen Sizilien (Religion der Römischen Provinzen 4), Diss.Tübingen 2006 e Rom und die Provinz Sicilia: Zur religiö-sen Identität im Imperium Romanum, in J. Rüpke (Hrsg.),Antike Religionsgeschichte in räumlicher Perspektive,Abschlussbericht zum Schwerpunktprogramm 1080 derDeutschen Forschungsgemeinschaft “Römische Reichsreli-gion und Provinzialreligion”, Tübingen 2007, 16 e ss.; Über-regionale Kultzentren im Imperium Romanum, in H. Cancik,J. Rüpke (Hrsg.), Die Religion des Imperium Romanum. Koi-ne und Konfrontation, Tübingen 2008.
John ScheidÈ stato, dal 1983 al 2001, Directeur d’études all’ÉcolePratique des Hautes Études, Section des Sciences reli-gieuses. Dal 2001 è Professore al Collège de France. Èautore di numerosi volumi sulla religione romana: Religio-
MYTHOS • NUMERO 2, n.s. • 2008, 199-200 197
Gli autori
MYTHOS • NUMERO 2, n.s. • 2008, 199-200198
ne e pietà, Bari 1983; Romulus et ses frères. Le collège desfrères arvales, modèle du culte public dans la Rome desempe reurs Rome 1990 ; La religion des Romains, Parigi 1998(tradotto in inglese e in russo); Commentarii fratrum arva-lium qui supersunt. Les copies épigraphiques des protoco-les annuels de la confrérie arvale (21 av.-304 ap. J.-C.),Rome 1998. Quand faire c’est croire. Les rites sacrificielsdes Romains, Paris 2005 ; Res Gestae Diui Augusti, Paris2007.
Mariano TroianoDottorando in cotutela in Sciences Religieuses, École Doc-torale - Sciences des Religions et Systèmes de Pensée.École Pratique des Hautes Études - Section des SciencesReligieuses / Universidad Argentina « John F. Kennedy » conuna tesi dal titolo La figure du Démiurge. Conceptions gno-stiques et réactions anti-gnostiques. Ha recentemente pub-blicato Lilit y la Cábala: La figura de Lilit presente en el Bahiry en el Tratado sobre la Emanación Izquierda del RabinoIsaac ben Jacob ha Cohen, in EPIMELEIA, Revista de Estu-dios sobre la Tradición, Vol. XIII, N. 25-26, Buenos Aires, 2004,81- 115; La figura de Lilith como punto de contacto entredos movimientos místico-esotéricos medievales: el Catari-smo y la Cábala”, Jornadas sobre Misterio y Esoterismo, Bue-nos Aires 2005, in EPIMELEIA, Revista de Estudios sobre laTradición, Vol. XIV, N. 27-28, CIFHIRE, Centro de Investiga-ciones en Filosofía e Historia de las Religiones - Universi-dad Argentina “John F. Kennedy”, Buenos Aires, 2005 in c.d.s.
Anna Van den KerchoveHa conseguito un dottorato di ricerca presso l’École Pra-tique des Hautes Études a Parigi ed è Professeur agregépresso l’Institut européen en sciences des religions (Éco-le Pratique des Hautes Études). Ha lavorato sui gruppireligiosi nell’antichità, come gli ermetisti, gli gnostici e imanicheisti. Si occupa prevalentemente delle pratichereligiose legate a questi e dei modi di contatto con altrigruppi . Ha pubblicato La maison, l’autel et les sacrifices: quelques remarques sur la polémique dans l’“Évangilede Judas”, in M. Scopello (ed.), Judas in Context. Pro-ceedings of the First International Conference on theGospel of Judas, Leiden 2008, 311-330; Les gnostiqueset la richesse de la langue copte : quelques remarques lexi-cales à propos de l’“Apocryphon de Jean” et de “Melchi-sédek”, in P. Hummel et F. Gabriel (Eds), Vérité(s) philolo-gique(s). Études sur les notions de vérité et de faussetéen matière de philologie, Paris 2008, 107-123 ; e con M.Zago ha in preparazione un volume dal titolo Les énoncésbarbares : formes et contextes d’une pratique magique,Actes du 1er colloque sur les énoncés barbares (Paris,2007), Turnhout, in c.d.s.
Françoise Van HaeperenÈ professore di Storia Romana presso l’Université catholi-que de Louvain (Louvain-la-Neuve).Autrice di un libro tratto dalla sua tesi di dottorato dal tito-lo: Le Collège pontifical (3e s. a.C.-4e s. p.C.), Bruxelles, Rome,2002, ha recentemente curato insieme a C. Bonnet il volu-me Les religions orientales de Franz Cumont, Torino 2006e ha scritto numerosi articoli sulla religione romana: Misesà mort rituelles et violences politiques à Rome sous la Répu-blique et sous l’Empire, in Res Antiquae, 2, 2005, 327-346 ;Interventions de Rome dans les cultes et sanctuaires deson port, Ostie, in Sanctuaires, pratiques cultuelles et ter-ritoires civiques dans l’Occident romain, éd. M. Dondin-Payre, M.-Th. Raepsaet-Charlier, Bruxelles 2006, 31-50.
Athanassia ZografouÈ lettrice di greco presso l’Università di Ioannina (Grèce).Ha difeso una tesi di dottorato (EPHE, Paris, 2000) dal tito-lo Passage à travers Hécate. Portes, routes, carrefours etautres figures de l’entre-deux, in c.d.s.Ha pubblicato articoli incentrati sul politeismo greco (Eca-te, Hermes, le divinità Phôsphoroi), sul sacrificio e il trat-tamento rituale dei resti, sulle ricette dei papiri magici del-la tardoantichità, sulle tradizioni mitiche che si sviluppa-no intorno a certi oggetti nella Grecia antica (per esempiola scapola d’avorio di Pelope).