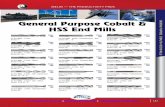« La gloire et l’outrage. Heurs et malheurs des statues honorifiques de Démétrios de Phalère...
Transcript of « La gloire et l’outrage. Heurs et malheurs des statues honorifiques de Démétrios de Phalère...
28- « La gloire et l’outrage. Heurs et malheurs des statues honorifiques de Démétrios de Phalère », Annales HSS, 64e année, 2 (2009), p. 303-340.
La gloire et l ’outrageHeurs et malheurs des statues honorifiquesde Démétrios de Phalère*
Vincent Azoulay
Démétrios, fils de Phanostratos, originaire de Phalère. Il fut, d’une part, auditeurde Théophraste ; d’autre part, orateur populaire chez les Athéniens, il dirigea la citépendant dix ans, il fut jugé digne de trois cent soixante effigies en bronze, dont la plupartétaient à cheval, sur des chars et des attelages à deux chevaux, qui furent achevées enmoins de trois cents jours : à tel point il suscitait l’empressement. [...] Bien qu’il fûtillustre auprès des Athéniens, la jalousie qui ronge toutes choses jeta pourtant sur lui aussison ombre. En effet, victime d’une cabale montée par certains, il fut, sans comparaître,condamné à mort. Certes, ils ne s’assurèrent pas de sa personne, mais ils déversèrent leurvenin sur le bronze, renversant ses effigies dont certaines furent vendues, d’autres jetéesau fond de la mer, d’autres débitées en pots de chambre : car on dit même cela. Et uneseule est conservée à l’Acropole. Favorinus dit dans son Histoire variée que les Athéniensfirent cela sur l’ordre du roi Démétrios [Poliorcète]. Mais aussi à l’année de son archontat,ils [les Athéniens] inscrivirent : année d’illégalité, selon Favorinus 1.
* Cet article est dédié à John Ma dont les séminaires ont inspiré cette recherche. Jeremercie Patrice Brun, Cécile Chainais, CharlesDelattre, AlainDuplouy, Pierre Fröhlich,Anna Heller, Paulin Ismard, Francis Prost et Pauline Schmitt pour leurs remarques etleurs critiques.1 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines des philosophes illustres, Paris, LGF, 1999, V, 75-77(traduction légèrement modifiée). Les textes grecs et latins – et leur traduction – sont,sauf indication contraire, ceux proposés par la collection des universités de France etpubliés par les éditions Les Belles Lettres à Paris.
Annales HSS, mars-avril 2009, n° 2, p. 303-340.
3 0 3
V I N C E N T A Z O U L A Y
Entre 317 et 307 av. J.-C., Démétrios de Phalère fut le dirigeant d’une cité à lacroisée des chemins. Après la défaite de Chéronée et, surtout, au terme de la guerrelamiaque, Athènes était désormais doublement soumise : aux souverains hellé-nistiques, d’une part – en l’occurrence, Cassandre, fils aîné d’Antipater, l’un deslieutenants d’Alexandre le Grand ; aux oligarques athéniens, d’autre part, puisqueDémétrios de Phalère mit en place un régime restreignant la participation descitoyens sur des critères censitaires. À bien des égards, son gouvernement incarnaitle triomphe momentané des oligarques formés dans les écoles philosophiques,aristotélicienne et platonicienne 2.
Son règne reflétait aussi la mutation d’une certaine culture des honneurs et,spécifiquement, de la statuaire honorifique. Longtemps bannies du registre deshonneurs, les premières effigies honorifiques ne commencèrent à être accordéesqu’au début du IVe siècle, avec grande parcimonie – seulement à quelques stratègesvictorieux – et selon un contrôle populaire extrêmement strict. C’est sur ce fondd’austérité que la politique de Démétrios de Phalère prend son relief. Alors que,durant toute l’époque classique, ces distinctions étaient octroyées au terme d’undélicat compromis entre la cité et ses élites, le législateur athénien satura le terri-toire athénien de ses effigies, mettant à l’honneur de nouvelles formes statuaires– la statue équestre –, investissant de nouveaux espaces – les dèmes –, tout enlimitant les autres manifestations monumentales dans l’espace public. Avecl’arrivée au pouvoir de Démétrios de Phalère, les effigies honorifiques furent doncdavantage imposées que négociées ou, à tout le moins, furent octroyées de façonbien moins tatillonne qu’auparavant par le peuple athénien qui, au demeurant,avait été redéfini de façon restrictive. Cette évolution s’inscrivait en outre dans uncontexte plus large : au même moment, les diadoques développaient une propa-gande iconographique de grande ampleur, célébrant leur pouvoir sous la forme demultiples effigies placées au cœur des cités.
Au fur et à mesure qu’elles envahissaient l’espace public, les statues honori-fiques, en principe dressées pour l’éternité, devenaient la cible de multiples dégra-dations. «Déjà le pavé tremble et le piédestal penche, car tout a ses retours. Lereflux est de droit, jamais le genre humain ne reste au même endroit 3. » Par unphénomène de compensation, les effigies de Démétrios de Phalère furent ainsidétruites, transformées ou avilies, selon des modalités variées qui ne devaient rienau hasard. Ces divers outrages constituaient une nouvelle façon, pour le peuple,de contrôler les formes d’expression de la supériorité sociale. Alors que cet examens’exerçait auparavant par le biais d’un processus légal aussi lent que minutieux, ils’effectua désormais de façon sporadique, au gré de manifestations de violenceritualisée. C’est sans doute pour empêcher ce type de réactions brutales que les
2 - Oscillant entre adhésion et rejet du régime démocratique, ces écoles sont réintégrées,au cours du IVe siècle, à la vie de la cité, au point de devenir la vitrine d’Athènes àl’époque hellénistique. Voir à ce propos Éric PERRIN-SAMINADAYAR, Éducation, cultureet société à Athènes. Les acteurs de la vie culturelle athénienne (229-88 av. J.-C.) : un tout petitmonde, Paris, De Boccard, 2007.3 - Victor HUGO, «La colère du bronze », La Légende des siècles, 2e s., XXI, 7, l. 204-206.3 0 4
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
Athéniens, au IIIe siècle av. J.-C., mirent en place de nouvelles régulations législa-tives pour mieux encadrer l’octroi des honneurs suprêmes.
Le Moment Démétrios de Phalère révèle ainsi le caractère foncièrementtransitoire des honneurs. Symbolisant à première vue la fixité et la permanence,les statues sont en effet des machines à penser le changement 4. Parce qu’ellesrésultent elles-mêmes d’une première transformation – dumatériau informe à l’effigieachevée – et qu’elles sont toujours susceptibles de revenir à leur état originel, parfonte ou par destruction, les statues servent aussi à témoigner d’autres passages,symboliques cette fois : du mobile à l’immobile, du vivant au mort, du modèle àsa représentation et, dans le cas des effigies honorifiques, d’un statut social à unautre – du simple particulier à l’homme exceptionnel, distingué par la cité.
Si les hellénistes ont depuis longtemps prêté attention aux rapports entre lesstatues et leurs modèles – et à la façon dont les auteurs anciens eux-mêmes pen-saient le lien entre la réalité et sa représentation 5 –, en revanche, la statuairehonorifique n’est devenue qu’assez récemment un objet d’étude à part entière 6.Parce qu’elle s’intègre dans une histoire plus générale de la sculpture, ce sontd’abord les archéologues et historiens de l’art qui s’y sont intéressés 7. Et parceque ces statues sont avant tout connues par leur base, où figure l’inscription honori-fique, ce sont ensuite les épigraphistes qui en ont fait leur terrain d’enquête,concentrant leurs analyses sur l’époque hellénistique et romaine, pour d’évidentesraisons de documentation 8. Si le cas d’Athènes a été passé au crible dans deuxarticles récents qui offrent à la réflexion de précieux points d’appui 9, le gouvernement
4 -Déjà ARISTOTE, Physique, trad. par P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 2000, III, 1, 201A,utilisait l’exemple de la statue pour penser le rapport entre la puissance et l’acte : « ilest en effet possible que le bronze soit en puissance une statue, mais pourtant l’entélé-chie du bronze en tant que bronze n’est pas un mouvement ».5 - Voir par exemple Jean-Pierre VERNANT, Religions, histoires, raisons, Paris, F. Maspero,1979, p. 105-137 ; Id., Figures, idoles, masques, Paris, Julliard, 1990 ; en dernier lieu,Deborah TARN STEINER, Images in mind: Statues in archaic and classical Greek literatureand thought, Princeton, Princeton University Press, 2001.6 - Voir tout de même Alan S. HENRY, Honours and privileges in Athenian decrees: Theprincipal formulae of Athenian honorary decrees, Hildesheim, G. Olms, 1983, p. 294 sq.,après les premiers travaux, restés sans postérité immédiate, d’Henri FRANCOTTE, «Dela législation athénienne sur les distinctions honorifiques », Musée Belge, 3, 1899, p. 246-281 et 4, 1900, p. 55-75 et 105-123.7 - Voir notamment Andrew STEWART, Attika: Studies in Athenian sculpture of the Hellenisticage, Londres, Society for the Promotion of Hellenic Studies, 1979 ; Paul ZANKER, Themask of Socrates: The image of the intellectual in antiquity, Berkeley, University of CaliforniaPress, 1995 ; Ralf KRUMEICH, Bildnisse griechischer Herrscher und Staatsmänner im 5.Jahrhundert v. Chr., Munich, Biering& Brinkmann, 1997 et Robert R. R. SMITH, «Cultu-ral choice and political identity in honorific portrait statues in the Greek East in thesecond century A.D. », The Journal of Roman Studies, 88, 1998, p. 56-93.8 - Voir notamment les travaux de John MA, «Hellenistic honorific statues and theirinscriptions », in Z. NEWBY et R. LEADER-NEWBY (dir.), Art and inscriptions in the ancientworld, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 203-220 ; Id., «The twocultures: Connoisseurship and civic honours », Art History, 29-2, 2006, p. 325-338, quiétablit des ponts entre l’épigraphie et l’histoire de l’art.9 - Graham J. OLIVER, « Space and visualization of power in the Greek polis: The awardof portrait statues in decrees from Athens », in P. SCHULTZ et R. VON DEN HOFF (dir.), 3 0 5
V I N C E N T A Z O U L A Y
de Démétrios de Phalère n’a en revanche fait l’objet d’aucun examen en profon-deur, alors qu’il représente, c’est du moins l’hypothèse que l’on formulera ici, unmoment clé dans l’histoire de la statuaire honorifique. Du reste, s’il est désormaistraditionnel d’étudier le développement de la culture des honneurs à l’époquehellénistique, le caractère réversible du processus a généralement été négligé :ainsi les historiens n’ont-ils pas suffisamment tenu compte des dégradations variéesdont ces statues furent l’objet, sinon sous l’angle de leur éventuel remploi àl’époque romaine 10. La tragique histoire de Démétrios de Phalère est précisémentl’occasion de dresser les contours d’une véritable culture de l’outrage, établie surla longue durée.
Analyser la résistible ascension de Démétrios de Phalère à l’aune de seseffigies invite donc à multiplier les angles de vue et à varier les échelles de temps.Les statues honorifiques sont en effet à l’articulation de plusieurs temporalités :temps court des ruptures politiques et des réformes législatives ; temps long desrituels et de la mémoire civique. Leur étude implique donc de concilier l’approcheanthropologique et la perspective institutionnelle, voire procédurale.
Prologue. La lente gestation de la statuaire honorifique
Le système des honneurs à Athènes
Dans le monde grec, et notamment à Athènes, le peuple mettait un point d’honneurà récompenser les bienfaiteurs, citoyens ou étrangers, tant pour les remercier deleurs actions bénéfiques que pour inciter les autres hommes à les imiter. Ces hon-neurs s’intégraient dans un système d’échange plus large entre le peuple, quioctroyait les récompenses, et les élites, qui en étaient les principaux récipiendaires.Plus que de simples récompenses, les dôreiai attribuées par la cité doivent en effetêtre considérées comme de véritables contre-dons, s’inscrivant dans un cycle oùles bienfaits répondent aux bienfaits et suscitent une gratitude mutuelle 11.
Early Hellenistic portraiture: Image, style, context, Cambridge, Cambridge University Press,2007, p. 181-204 ; Éric PERRIN-SAMINADAYAR, «Aere perennius. Remarques sur les com-mandes publiques de portraits en l’honneur des grands hommes à Athènes à l’époquehellénistique : modalités, statut, réception », in Y. PERRIN et T. PETIT (dir.), Iconographieimpériale, iconographie royale, iconographie des élites dans le monde gréco-romain, Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne, 2004, p. 109-137.10 - Voir à ce propos Horst BLANK, Wiederverwendung alter Statuen als Ehrendenkmäler beiGriechen und Römern, Rome, L’Erma di Bretschneider, 1969 et, toujours pour l’époqueromaine, Julia L. SHEAR, «Reusing statues, rewriting inscriptions and bestowing honoursin Roman Athens », in Z. NEWBY et R. LEADER-NEWBY (dir.), Art and inscriptions...,op. cit., p. 221-246.11 - Pauline SCHMITT-PANTEL, La cité au banquet. Histoire des repas publics dans les citésgrecques, Rome, École française de Rome, 1992, p. 153 ; Vincent AZOULAY, Xénophon etles grâces du pouvoir. De la Charis et charisme dans l’œuvre de Xénophon, Paris, Publicationsde la Sorbonne, 2004, p. 88-89 ; Jeremy TANNER, The invention of art history in AncientGreece: Religion, society and artistic rationalisation, Cambridge/New York, Cambridge Uni-versity Press, 2006, p. 111 et 122.3 0 6
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
Dans ce jeu d’échange, la cité conserva, durant toute l’époque classique, unrôle éminent : c’est elle qui définissait les formes légitimes de la supériorité poli-tique et sociale, à travers un répertoire d’honneurs dont elle gardait, en dernierressort, la maîtrise. De fait, les Athéniens disposaient pour remercier leurs bienfai-teurs d’une gamme de récompenses variée et hiérarchisée. Ainsi pouvaient-ilsdécerner des honneurs comme un éloge public ou une couronne ; ils pouvaientaussi accorder l’atélie et l’exemption de liturgies – les contributions obligatoires.Enfin, ils réservaient les honneurs suprêmes (megistai timai) pour les services jugésexceptionnels : la proédrie 12, la nourriture au prytanée (sitèsis) 13 et, à partir dudébut du IVe siècle, l’érection d’une statue de bronze, en général sur l’agora 14, quiinscrivait topographiquement le bienfaiteur dans la mémoire de la cité. Les statueshonorifiques constituaient donc l’ultime degré dans l’échelle des contre-dons quela cité pouvait accorder à ses bienfaiteurs en témoignage de gratitude. Elles s’inté-graient dans le cadre d’une symbolique de la récompense, dont les formes étaientloin d’être toutes équivalentes 15.
Toutefois, la statuaire n’intégra que tardivement le répertoire des honneurs– après la guerre du Péloponnèse 16 – et resta décernée de façon exceptionnellejusqu’à l’époque deDémétrios de Phalère. C’est qu’une telle distinction demeuraitproblématique aux yeux des Athéniens du IVe siècle. À bien des égards, les effigieshonorifiques étaient en effet excessivement distinctives. Non seulement elles appar-tenaient au registre des honneurs suprêmes mais, au sein même de cette catégorieéminente, elles faisaient bande à part : la première statue honorifique fut ainsiaccordée plus de trente ans après l’octroi de la sitèsis et la proédrie aux stratègeset aux athlètes vainqueurs aux concours panhelléniques 17.
Comment expliquer un tel décalage ? Tout d’abord, financièrement, unestatue était de loin la plus coûteuse des récompenses – 3 000 drachmes enmoyenne,à l’époque hellénistique – au point qu’il était parfois difficile pour le peuple
12 - Philippe GAUTHIER, Les cités grecques et leurs bienfaiteurs, Athènes, École françaised’Athènes, 1985, p. 12, 27 et, plus largement, p. 92-103.13 - Voir Michael J. OSBORNE, «Entertainment in the Prytaneion at Athens », Zeitschriftfür Papyrologie und Epigraphik, 41, 1981, p. 153-170 ; P. SCHMITT-PANTEL, La cité aubanquet..., op. cit., p. 147-155. En dehors des tyrannoctones et de leurs descendants,Cléon est l’un des premiers citoyens athéniens à se voir accorder la sitèsis, après safulgurante victoire à Sphactérie en 424 : voir à ce propos P. GAUTHIER, Les cités grecques...,op. cit., p. 95.14 - Ibid., p. 96-102, sur ces statues alors réservées aux stratèges athéniens les plus brillants.15 - ARISTOTE, Rhétorique, III, 10, 1411b6-12.16 - P. GAUTHIER, Les cités grecques..., op. cit., p. 96-112 ; JohnMA, « A gilt statue for Kononat Erythrai? », Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 157, 2006, p. 124-126.17 - Cléon fut honoré par la nourriture au prytanée dès 425/4 ; les vainqueurs desconcours olympiques, pythiques, néméens ou isthmiques, se virent décerner la sitèsis etla proédrie dès les années 430. PLATON, Apologie de Socrate, 36d-e ; DÉMOSTHÈNE, ContreLeptine, XX, 141 et, surtout, Inscriptiones Graecae (dorénavant IG) I3, 131, l. 34 (datantdes années 440-432 av. J.-C.). Voir, à ce propos, Donald G. KYLE, Athletics in ancientAthens, Leyde, E. J. Brill, 1987, p. 145-147. 3 0 7
V I N C E N T A Z O U L A Y
d’honorer sa promesse 18. Ensuite, formellement, la statue singularisait son réci-piendaire bien plus que ne le faisaient les autres honneurs : alors que ceux-ci nevariaient nullement en fonction des bénéficiaires, la statue venait redoubler l’effetdistinctif de l’inscription en individualisant le bienfaiteur, probablement moinspar les traits du visage que par la pose adoptée 19. Enfin, symboliquement, c’étaitune distinction fort dérangeante : les effigies honorifiques ne pouvaient manquerd’évoquer les statues divines qui encombraient l’Acropole ou l’agora et reprenaienten outre un modèle héroïque, celui des tyrannicides 20.
Un honneur hyperbolique sous contrôle
À l’évidence, la statue était un honneur hyperbolique. Était-elle pour autant lesigne de la domination grandissante des individus exceptionnels au sein de la cité ?En réalité, son octroi n’impliquait aucun affadissement de l’hégémonie démocra-tique. De fait, c’est toujours le peuple qui contrôlait l’attribution d’un tel honneur :non seulement il limitait drastiquement le nombre des bénéficiaires, mais il défi-nissait aussi la forme de la statue – en accord avec l’honoré 21 – et les lieux oùcelle-ci devait être érigée 22. Enfin, il encadrait étroitement toute la procédure enamont comme en aval.
À la fin du IVe siècle, semble-t-il, une réforme renforça même le contrôlepopulaire. Tout d’abord, la nouvelle législation distinguait désormais clairementles honneurs décernés aux Athéniens, d’une part, et aux étrangers, d’autre part :seuls les bienfaiteurs étrangers étaient susceptibles d’être honorés sur le moment,juste après avoir prodigué leurs bienfaits ; à l’inverse, les citoyens athéniens, ora-teurs ou stratèges, devaient dorénavant attendre la fin de leur vie – après 60 ans –
18 - É. PERRIN-SAMINADAYAR, «Aere perennius... », art. cit., p. 112-117. Voir aussi PhilippeGAUTHIER, «Le décret de Thessalonique pour Parnassos. L’évergète et la dépensepour sa statue à la basse époque hellénistique », Tekmeria, 5, 2000, p. 39-62, ici p. 48et n. 31.19 - C’est pourquoi, dans cette étude, nous n’utiliserons pas le terme « portrait » quiimplique une ressemblance – loin d’être avérée – entre le personnage et sa représenta-tion statuaire. Sur la délicate question du réalisme figuratif, voir les remarques éclai-rantes de Francis PROST, «Miltiade et le lièvre », in F. LISSARRAGUE et al. (dir.), Céra-mique et peinture grecques : modes d’emploi. Actes du colloque international, École du Louvre,avril 1995, Paris, La Documentation française, 1999, p. 245-255.20 - Selon ARISTOTE, Constitution des Athéniens, LVIII, 1, le polémarque effectuait mêmedes sacrifices funèbres (enagismata) à Harmodios et Aristogeiton, probablement près del’enclos où se trouvaient les statues. Voir Sture BRUNNSÅKER, The tyrant-slayers of Kritiosand Nesiotes, Stockholm, Svenska Institutet i Athen, [1955] 1971 ; Michael W. TAYLOR,The Tyrant Slayers: The heroic image in fifth century B.C. Athenian art and politics, Salem,Ayer Company Publ., [1981] 1991 ; Burkhard FEHR, Les tyrannoctones. Peut-on élever unmonument à la démocratie ?, Paris, A. Biro, [1984] 1989.21 - Tel est, par exemple, le cas pour la statue de Chabrias : CORNELIUS NEPOS, Chabrias,I, 2-3.22 - Voir à ce propos les analyses de G. J. OLIVER, « Space and visualization... », art. cit.,p. 196-199.3 0 8
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
pour solliciter éventuellement ces honneurs exceptionnels 23. Comme l’a montréPhilippe Gauthier, au IIIe et au IIe siècle av. J.-C., les citoyens furent désormaishonorés « à froid », lorsque l’écho de leurs actions d’éclat était déjà assourdi par letemps passé 24.
Quand cette législation entra-t-elle en vigueur ? Assurément pas avant ledernier tiers du IVe siècle, puisque l’orateur Démade fut gratifié « à chaud » d’unestatue sur l’agora en 335 av. J.-C. Mais probablement avant 280 av. J.-C., date àlaquelle Démosthène reçut à titre posthume les honneurs suprêmes 25. Peut-onêtre plus précis sur le moment où ces réformes furent mises en œuvre ? À la suitede P.Gauthier, la plupart des commentateurs les placent dans les années 330 av.J.-C., à l’époque où, après Chéronée, l’orateur Lycurgue jouait un rôle prédominantdans la cité 26. Les Athéniens auraient alors vécu comme un véritable choc leshonneurs octroyés à Démade en 335 : non seulement celui-ci était le premierorateur à bénéficier d’un tel privilège, réservé auparavant aux seuls stratèges 27,mais son comportement douteux aurait suscité une réaction morale indignée desAthéniens. De nouvelles régulations auraient par conséquent été mises en placepour empêcher qu’à l’avenir, un orateur manifestement corrompu puisse bénéficierd’une si haute distinction.
Toutefois, cette hypothèse se révèle fragile. Sans se prononcer sur la datedes réformes, Patrice Brun a montré que les honneurs de Démade n’avaient suscitéaucun traumatisme durable dans la population athénienne 28. Au demeurant, pré-tendre que la nouvelle législation visait spécifiquement l’orateur est pour le moinsétrange puisque « l’une des dispositions prévues par ces fameuses lois, ‘avoir donnédes conseils avisés’, entrait exactement dans le cadre de l’action de Démade [...] 29 ».Que ses honneurs aient été attaqués devant les tribunaux n’est pas un argumentplus convaincant dans la mesure où c’est le sort de presque tous les récipiendaires
23 - Voir P. GAUTHIER, Les cités grecques..., op. cit., p. 111-112. La réforme ne changeadonc rien pour les bienfaiteurs étrangers : en 393 av. J.-C., Évagoras de Salamine avaitété honoré sur le moment, tout comme, un peu plus tard, Pairisadès, Satyros, Gorgippos :DINARQUE, Contre Démosthène, I, 43. Voir à ce propos G. J. OLIVER, « Space and visualiza-tion... », art. cit., p. 190.24 - P. GAUTHIER, Les cités grecques..., op. cit., p. 88.25 - PS.-PLUTARQUE, Vie des dix orateurs [Démosthène], 850F-851C. Voir les remarquesde P. GAUTHIER, Les cités grecques..., op. cit., p. 105, qui discerne même l’influence dela réforme dès 293/2 av. J.-C., voire dès 307/6 av. J.-C. (sur des bases toutefois assezhypothétiques).26 - P. GAUTHIER, Les cités grecques..., op. cit., p. 111. Voir aussi M. J. OSBORNE, «Enter-tainment in the Prytaneion at Athens », art. cit., p. 167 et 170, et Ioanna KRALLI, « Athensand her leading citizens in the early Hellenistic period (338-261 B.C.): The evidenceof the decrees awarding the highest honours », Archaiognôsia, 10, 1999-2000, p. 133-161,ici p. 143.27 - P. GAUTHIER, Les cités grecques..., op. cit., p. 109-110.28 - Patrice BRUN,L’orateur Démade.Essai d’histoire et d’historiographie, Bordeaux, Ausonius,2000, p. 83. La présence du petit-fils de Démade parmi le personnel politique dupremier quart du IIIe siècle ne plaide pas, en effet, pour l’existence d’une quelconquedamnatio memoriae dans les années qui suivirent sa mort.29 - P. BRUN, L’orateur Démade..., op. cit. 3 0 9
V I N C E N T A Z O U L A Y
des plus hautes récompenses : le procès de l’orateur Démade s’inscrit à cet égarddans une série initiée par les stratèges Iphicrate et Chabrias 30.
Reste à trouver une autre raison susceptible d’expliquer l’instauration decette nouvelle législation, tant il est vrai que les Athéniens se sont effectivementpréoccupés, au IIIe siècle, de mieux contrôler l’octroi des honneurs suprêmes àleurs concitoyens. Or, entre les années 330 et les années 280, il est une périodeparticulièrement traumatique à cet égard : le « règne » de Démétrios de Phalère,entre 317 et 307, qui fut honoré de plusieurs centaines de statues, à en croireDiogène Laërce 31 et dont le rôle pivot n’a, à ma connaissance, jamais été suffisam-ment pris en compte.
Le Moment Démétrios de Phalère :la résistible érection des statues honorifiques
À son arrivée au pouvoir en tant que gouverneur (epimelêtês) d’Athènes en 317av. J.-C., Démétrios de Phalère avait entre 35 et 40 ans. Il devait sa position à laprotection de Cassandre, le fils d’Antipater, qui avait imposé à la cité l’installationd’une garnison macédonienne au Pirée : c’était la seconde fois, après l’oligarchiede Phocion et Démade entre 321 et 319 av. J.-C., qu’Athènes était ainsi placéesous la tutelle militaire desMacédoniens. À l’intérieur de la cité, Démétrios sembleavoir détenu de larges pouvoirs, révisant les lois de la cité et mettant en œuvre denombreuses réformes politiques, économiques et morales 32. Sans être probable-ment aussi oligarchique qu’on l’a longtemps cru, son action s’inscrivait toutefoisdans un cadre censitaire et, partant, antidémocratique 33. C’est dans ce contextequ’il reçut, selon de nombreuses sources littéraires, des centaines de statues honori-fiques, tout en ayant d’abord pris soin, à peine arrivé au pouvoir, de faire voter àl’Assemblée l’octroi d’une effigie à Phocion, son ancien allié politique, condamnéà mort et exécuté par les Athéniens moins d’un an auparavant 34. Ainsi sa politique
30 - Au demeurant, lorsqu’il s’insurge contre l’attribution d’honneurs hyperboliques,DÉMOSTHÈNE, Contre Aristocrate, XXIII, 196, vise explicitement les stratèges : « tant decitoyens qui avaient rendu de tout autre services que les stratèges d’aujourd’hui n’obte-naient pas de nos ancêtres des statues de bronze, ni des témoignages d’adulation ».31 - De façon étrange, P. Gauthier ne fait pas mention de Démétrios de Phalère dansson ouvrage remarquable, laissant dans l’ombre tant le passage de DIOGÈNE LAËRCE,Vies et doctrines..., op. cit., V, 75-77, que l’inscription honorifique du dème de Sphettosen l’honneur du grand dirigeant d’Athènes.32 - Stephen V. TRACY, «Demetrius of Phalerum: Who was he and who was he not? »,in W. W. FORTENBAUGH et E. SCHÜTRUMPF (dir.), Demetrius of Phalerum: Text, translationand discussion, New Brunswick, Transaction Publishers, 2000, p. 331-345, tente uneréhabilitation du personnage et gomme le caractère oligarchique de son action, en privi-légiant les sources épigraphiques, au demeurant fort rares.33 - Le seuil pour être citoyen fut établi à 1 000 drachmes. S’il était moitié moindre quesous Phocion (319-317 av. J.-C.), son existence même révèle le caractère antidémocratiquedu régime mis en place.34 - PLUTARQUE, Vie de Phocion, XXXVIII (Phocion reçoit une statue en bronze surl’agora et une sépulture publique). Voir à ce propos Sheila DILLON, Ancient Greek portrait3 1 0
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
statuaire – qui s’inspirait à l’évidence des rois hellénistiques et notamment de lapropagande iconographique d’Alexandre le Grand 35 – s’étendait-elle aussi auxgrands hommes athéniens susceptibles d’illustrer sa cause politique.
Nouveau nombre : une épidémie statuaire ?
Dans le cadre du régime instauré par Démétrios, les citoyens ne contrôlaient plusl’octroi des honneurs suprêmes aussi strictement qu’auparavant. Certes, ils conti-nuèrent probablement à voter les honneurs suprêmes au terme d’une procédurelégale : Diogène Laërce met ainsi en valeur le fait que Démétrios de Phalère« fut jugé digne de 360 effigies en bronze 36 », suggérant le recours à l’approbationpopulaire. Toutefois, leur nombre implique nécessairement une rupture radicaleavec les modes de contrôle qui autrefois prévalaient lors de l’octroi des statueshonorifiques aux chefs athéniens ou étrangers.
De fait, les auteurs anciens ont été particulièrement frappés par l’ampleurdu phénomène : pas moins de huit sources évoquent la multiplicité des statueshonorifiques dressées en l’honneur de Démétrios de Phalère, au point que lephénomène semble étroitement associé à son « règne » 37. Seul leur nombre exactsemble faire débat. Tandis que Diogène Laërce parle de 360 effigies, d’après unetradition à laquelle fait écho Pline l’Ancien et qui remonterait au moins à Varron 38,Cornelius Nepos et Plutarque avancent le chiffre de 300 effigies, déjà rapportépar Strabon 39. Favorinus évoque même l’octroi de 1 500 statues, faisant peut-êtreréférence, non seulement aux monuments en bronze, mais aussi en marbre 40.
Que ces chiffres soient probablement exagérés importe peu. Dans tous lescas, ils contrastent fortement avec la parcimonie avec laquelle les Athéniensoctroyaient cet honneur suprême au IVe siècle. La multiplication des effigies deDémétrios apparaît ainsi comme un pied de nez oligarchique aux pratiques démo-cratiques antérieures : leur nombre n’est-il pas une manière de ridiculiser le
sculpture: Contexts, subjects, and styles, Cambridge, Cambridge University Press, 2006,p. 102-103.35 - Andrew F. STEWART, Faces of power: Alexander’s image and Hellenistic politics, Berkeley,University of California Press, 1993, fait l’inventaire exhaustif des sources littéraires,épigraphiques et iconographiques sur le sujet.36 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 75.37 - Les passages sont commodément édités et traduits par Peter STORK, Jan Max VAN
OPHUIJSEN et Tiziano DORANDI, «Demetrius of Phalerum: The sources, text and trans-lation », in W. W. FORTENBAUGH et E. SCHÜTRUMPF (dir.), Demetrius of Phalerum...,op. cit., fr. 1, l. 4-7 ; l. 26-29 ; l. 111-113 ; fr. 19, l. 15-18 ; fr. 24A-C et 25A-C.38 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 77 ; PLINEL’ANCIEN, Histoire naturelle,XXXIV, 12, 2.39 - STRABON, Géographie, IX, 1, 20 ; CORNELIUS NEPOS, Miltiade, 6 ; PLUTARQUE, Pré-ceptes des rois et des généraux, 820E. Voir aussi AMPELIUS, Liber Memorialis, XV, 19, inP. STORK, J. M. VAN OPHUIJSEN et T. DORANDI, «Demetrius of Phalerum... », art. cit.,fr. 24B.40 - FAVORINUS [Dion de Pruse], Discours aux Corinthiens, XXXVII, 41. C’est l’hypothèseséduisante proposée par É. PERRIN-SAMINADAYAR, «Aere perennius... », art. cit., p. 128. 3 1 1
V I N C E N T A Z O U L A Y
contrôle étroit par lequel les démocrates encadraient auparavant l’octroi des hon-neurs suprêmes ? Mieux encore, comment ne pas voir dans la démultiplication desstatues honorifiques du législateur le pendant exact de la restriction du corpscivique voulue par les tenants de l’oligarchie ? Cette première rupture s’accom-pagne en outre d’un autre bouleversement. Au lieu d’être le résultat d’un processuslent et normé, cette épidémie statuaire se produit demanière excessivement rapideet spontanée. L’auteur parle ainsi de 360 effigies en bronze érigées en moins de300 jours : pour arriver à soutenir un tel rythme, les artisans athéniens auraientdonc dû produire plus d’une sculpture par jour, ce qui paraît manifestementexagéré, mais donne une idée de l’ampleur du phénomène 41.
Nouveaux lieux : le maillage du territoire attique
En se faisant octroyer par le peuple athénien un si grand nombre de statues,Démétrios entendait visiblement saturer l’espace et le temps des traces monumen-tales de sa présence. De fait, le nombre de ses statues semble étroitement lié aunombre de jours dans l’année, comme s’il s’agissait, pour le gouverneur de la cité,d’investir l’ensemble du cycle temporel et de ne laisser aucun moment échapperà son empreinte – à en croire, du moins, l’interprétation de certains auteurs latins :« il n’est personne, je pense, à qui l’on dressa plus de statues qu’Athènes n’enéleva à Démétrios de Phalère ; car on lui en éleva 360 – l’année ne comptant pasencore un plus grand nombre de jours [...] 42 ».
Mais cette politique statuaire visait surtout à manifester sa présence dansl’espace. La réplication ad nauseam de ses effigies assurait en effet son ubiquité :si l’Acropole et l’agora furent probablement les emplacements privilégiés de cetteprolifération statuaire, le nombre extravagant de ces effigies impliquait nécessaire-ment un maillage raisonné de tout l’espace attique. Et, de fait, c’est dans un dèmeéloigné du centre urbain qu’a été retrouvée la seule trace monumentale attestantpeut-être l’épisode. En 1965, les archéologues ont en effet mis au jour la based’une statue équestre sur les premiers contreforts orientaux du mont Hymette 43.Sur la partie supérieure de cette base oblongue, une inscription proclame : «LesSphettiens [ont consacré la statue de] Démétrios, fils de Phanostratos. Antignotosl’a fait » (Sphêttioi Dêm[etrion] Phanostratou a[nethêkan]. Antignôtos epoiê[se]). Cettedécouverte apporte ainsi la preuve quasi certaine que Démétrios fut honoré àSphettos, un dème de l’intérieur de l’Attique 44. Certes, un doute subsiste encore :
41 - Ibid., p. 122-123, met en doute la rapidité du processus – qui doit manifestement êtremise en regard de la soudaineté avec laquelle les effigies de Démétrios furent détruites.42 - PLINEL’ANCIEN, Histoire naturelle, XXXIV, 12, 27, in P. STORK, J. M. VAN OPHUIJSEN
et T. DORANDI, «Demetrius of Phalerum... », art. cit., fr. 25A. Voir aussi NONIUS
MARCELLUS, De conpendiosa Doctrina, XII, ibid., fr. 24C.43 - Athéna G.KALOGÉROPOULOU, « Base en l’honneur de Démétrius de Phalère », Bul-letin de Correspondance Hellénique (dorénavant BCH), 93-1, 1969, p. 56-71. Voir Supplemen-tum Epigraphicum Graecum (dorénavant SEG), 25, 1975, no 206.44 - C’est au demeurant le seul témoignage avant l’époque romaine où l’on voit undème accorder cet honneur suprême.3 1 2
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
la statue pourrait avoir été dédiée, non au législateur d’Athènes, mais à son petit-fils homonyme qui fut par ailleurs le bénéficiaire d’un tel privilège à Éleusis unecinquantaine d’années plus tard 45. Toutefois, il serait pour le moins étonnant quel’on ait retrouvé deux inscriptions en l’honneur du petit-fils, et aucune en l’honneurdu grand-père qui marqua tant la cité de son empreinte statuaire 46.
Cette inscription témoigne plus largement de l’activité des dèmes à l’époquede Démétrios de Phalère. Comme l’a souligné Graham Oliver, alors que l’on neconnaît qu’une seule inscription émanant des institutions centrales de la cité pourtoute la période de son « règne », plusieurs décrets sont, dans le même temps,votés par les dèmes de l’Attique, à Acharnes et Aixonè notamment, où le législateurfut honoré par un décret, malheureusement mutilé 47. C’est que les résidents desdèmes avaient toutes les raisons d’exprimer leur gratitude au gouvernant d’Athènesqui avait très probablement pris des mesures économiques en leur faveur 48. Fruitsd’un compromis avec les élites régionales, les statues de Démétrios refléteraientdonc le triomphe d’une Athènes décentrée et la relative marginalisation des insti-tutions civiques traditionnelles au profit des dèmes. Dès lors, sans aller jusqu’à sou-tenir que tous les dèmes de l’Attique aient pu lui décerner un tel privilège, oncomprend mieux la prolifération statuaire en l’honneur de Démétrios de Phalère.
Cependant le bouleversement opéré ne s’arrête pas là. Au-delà même dunombre extravagant de ses statues, de la rapidité de leur érection et de la diversitéde leurs emplacements, Démétrios de Phalère choisit également de leur donnerune forme nouvelle, en rupture complète avec les conventions iconographiquesétablies au IVe siècle et, plus largement, avec les codes de la statuaire démocratique.
45 - Octroyant une statue équestre à «Démétrios, fils de Phanostratos », l’inscriptionIG II2, 2971 a été redatée des années 250 par Stephen Tracy sur des critères paléogra-phiques. Il s’agit donc très probablement de la statue du petit-fils homonyme deDémétriosde Phalère, qui aurait assuré à cette époque les charges militaires d’hipparque et destratège. Voir à ce propos SEG, 44, 1994, no 163 et Stephen V. TRACY, Athenian democracyin transition: Attic letter-cutters of 340 to 290 B.C., Berkeley, University of California Press,1995, p. 41-46. Sur le rôle politique du petit-fils, voir Christian HABICHT, Athènes hellénis-tique. Histoire de la cité d’Alexandre le Grand à Marc Antoine, Paris, Les Belles Lettres,[1995] 2000, p. 171-173 et Roland OETJEN, «War Demetrios von Phaleron, der Jüngere,Kommissar des Königs Antigonos II. Gonatas in Athen? », Zeitschrift für Papyrologie undEpigraphik, 131, 2000, p. 111-117.46 - Comme l’a montré S. V. TRACY, «Demetrios of Phalerum... », art. cit., p. 336,l’inscription ne peut être datée sur la seule forme des lettres.47 - G. J. OLIVER, « Space and visualization... », art. cit., p. 201, n. 53 (avec bibliographie).Sur cette dernière inscription (IG II2, 1201, l. 2-13), voir Matthias HAAKE, Der Philosophin der Stadt. Untersuchungen zur öffentlichen Rede über Philosophen und Philosophie in denhellenistischen Poleis, Munich, C. H. Beck, 2007, p. 74-75.48 - C’est l’hypothèse de G. J. OLIVER, « Space and visualization... », art. cit., p. 191et n. 54. 3 1 3
V I N C E N T A Z O U L A Y
Nouvelle forme : l’adoption du registre équestre
Parallèlement à cet investissement inédit de l’espace, Démétrios de Phalèrepromut une nouvelle forme de statuaire honorifique : la statue équestre. À en croireDiogène Laërce, les 360 effigies en bronze du législateur étaient pour la plupart« à cheval, sur des chars et des attelages à deux chevaux 49 ». Or, sur l’acropole deSphettos, c’est bien la base d’une statue équestre, probablement en bronze, qui aété mise au jour par les archéologues 50. Le recoupement avec l’affirmation deDiogène Laërce plaide donc encore, si besoin était, pour attribuer le monumentau tyran-législateur et non à son petit-fils homonyme.
Le gouvernement de Démétrios de Phalère marque ainsi l’avènement d’unenouvelle forme de statue honorifique. Cette innovation ne concerne d’ailleurs pasles seules effigies du dirigeant athénien, comme l’atteste l’unique décret civiqueconservé pour cette période. Votés en 314/13 av. J.-C., les honneurs décernés àAsandros de Macédoine, un proche de Cassandre, comprenaient une statue enbronze le représentant « à cheval, sur l’agora, là où il le souhaite, sauf près [desstatues] d’Harmodios et d’Aristogeiton 51 » (eph’ hippou en agorai hopou am boulêtaiplên par’ Harmodion kai Aristogeiton[a]). Avec le monument de Sphettos, on tientlà une des plus anciennes attestations de statue honorifique équestre dans lemondegrec 52. Seuls deux antécédents sont en effet connus : d’une part, les effigies deschefs phocidiens Onymarchos et Philomelos, dressées dans le sanctuaire de Delphesà la fin des années 350, lors de la troisième guerre sacrée 53 ; d’autre part, les honneursdécernés par les Érétriens à Timothéos, commandant militaire macédonien de
49 -DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 75.50 - Qu’il s’agisse d’une statue équestre, peut-être en bronze, est une conjecture fondéesur la forme oblongue de la base et la situation de l’inscription, placée sur sa face étroite,indiquant l’avant du monument. Voir à ce propos Jeanne et Louis ROBERT, BulletinÉpigraphique, Revue des Études Grecques, 83, 1970, no 264.51 - IG II2, 450, fr. B, l. 9-12. Outre cette statue équestre, Asandros reçut les autreshonneurs suprêmes – la proédrie et la sitèsis. Voir notamment M. J. OSBORNE, «Enter-tainment in the Prytaneion at Athens », art. cit., p. 167.52 - Voir à ce propos Heinrich B. SIEDENTOPF, Das hellenistische Reiterdenkmal, Waldsassen,Stiftland Verlag, 1968, p. 12-13, qui toutefois se trompe en faisant de Démétrios dePhalère le premier à adopter un tel registre statuaire. Voir aussi François CHAMOUX,«Les origines grecques de la statue équestre à Rome », in Au miroir de la culture antique.Mélanges offerts au président René Marache, Rennes, Presses universitaires de Rennes,1992, p. 55-66, ici p. 59.53 - Voir Denis KNOEPFLER, Décrets érétriens de proxénie et de citoyenneté, Lausanne, Payot,2001, décret no VII, ici p. 181, n. 479, qui souligne le précédent constitué par « lecompte delphique, Fouilles de Delphes, III 5, 23 (réédité par Jean BOUSQUET, Corpus desInscriptions de Delphes, Paris, De Boccard, 1989, II 34), qui fait mention des bases (bathra)d’Onymarchos et de Philomélos (col. II, l. 54 sq.), dont il s’agit de débarrasser le sanc-tuaire avec leurs chevaux (hippous) et leurs statues (andriantas), preuve que, dans lesannées 356-352, les Phocidiens avaient dressé une statue de leurs deux chefs représen-tés, selon toute apparence, en cavaliers ».3 1 4
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
Cassandre vers 319/8 av. J.-C., selon la datation haute proposée par DenisKnoepfler 54.
Comment expliquer le choix d’un tel registre iconographique alors que, pourautant qu’on le sache, Démétrios de Phalère ne fut pas un homme d’armes, maisun orateur et un législateur 55 ? Plutôt que d’y voir une erreur des sources anciennes,il faut l’interpréter comme une stratégie délibérée, d’autant plus signifiante qu’elleest détachée de toute référence à une fonction militaire précise. Par le recours àla statuaire équestre, le dirigeant athénien poursuivait, à mon sens, deux aspirationssymétriques et complémentaires : rompre avec les valeurs démocratiques d’unepart, s’inscrire dans la continuité d’Alexandre d’autre part.
Tout d’abord, en adoptant un tel registre, Démétrios de Phalère contrevenaitaux codes iconographiques propres à la démocratie et renouait avec une forme destatuaire archaïque, dont le cavalier Rampin, érigé au milieu du VIe siècle av. J.-C.,constitue le plus célèbre représentant : le législateur récupérait ainsi à son profitun répertoire tombé en désuétude en raison de ses résonances élitaires. De fait,durant tout le IVe siècle, les cavaliers athéniens (hippeis) furent étroitement associésà l’oligarchie pour avoir pris une part active au renversement de la démocratie, lorsde la tyrannie des Trente en 404 56. Dans les plaidoyers judiciaires, les hippeisfurent souvent accusés d’avoir un comportement arrogant et, partant, de nourrirdes aspirations tyranniques 57.
Certes, les images équestres étaient loin d’être totalement proscrites del’espace public athénien à l’époque classique : dès la fin du Ve siècle, plusieursstèles funéraires représentaient des cavaliers au combat dans le cimetière publicde la cité, le dêmosion sêma 58. Récemment encore, lors des fouilles du métro, lesarchéologues ont mis au jour un obituaire en marbre surmonté par un relief figurantdeux cavaliers combattant deux hoplites, dont l’un est déjà à terre 59. S’y ajouteégalement, dans un registre privé, la célèbre stèle funéraire de Dexiléos qui meten scène le jeune défunt à cheval après sa mort lors de la bataille de Coronée en
54 - Voir D. KNOEPFLER, Décrets érétriens de proxénie..., op. cit., p. 175-189. L’auteur sou-ligne que cette marque d’honneur resta accordée avec une grande parcimonie en dehorsdes grands sanctuaires (p. 178 et n. 440).55 - S. V. TRACY, «Demetrius of Phalerum... », art. cit., p. 337.56 - XÉNOPHON, Helléniques, II, 3, 48 et II, 4, 2-8 et 24-26.57 - LYSIAS, Contre Alcibiade, XXIV, 11. Voir plus largement Iain G. SPENCE, The cavalryof classical Greece: A social and military history with particular reference to Athens, Oxford/New York, Clarendon Press/Oxford University Press, 1993, p. 204-229.58 - Sur l’iconographie du dêmosion sêma, voir Reinhard STUPPERICH, «The iconographyof Athenian state burials in the Classical period », in W. D. E. COULSON et al. (dir.), Thearchaeology of Athens and Attica under the democracy, Oxford, Oxbow Books, 1994, p. 93-103, ici p. 94-95. Les cavaliers semblent avoir souvent, sinon systématiquement, faitl’objet d’une stèle à part qui, outre les noms des cavaliers morts, portait des reliefséquestres.59 - Cette stèle en marbre, haute de plus de deux mètres sans le couronnement ni labase, est datée des années 429/409 av. J.-C. Voir à ce propos Liana PARLAMA et NicholasC. STAMPOLIDIS (dir.), Athens: The city beneath the city: Antiquities from the metropolitanrailway excavations, New York/Londres, Harry N. Abrams, 2001, no 452. 3 1 5
V I N C E N T A Z O U L A Y
394 60. Dès la fin du Ve siècle, les Athéniens avaient donc partiellement acclimatéle registre équestre à leur iconographie publique en dépit de ses résonancesaristocratiques.
Toutefois, cet usage resta limité et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord,son emploi semble avoir eu une visée défensive : loin d’exalter la supériorité intrin-sèque des cavaliers, les stèles équestres entendaient surtout montrer que ceux-cipouvaient aussi se sacrifier pour la démocratie – et non chercher seulement à larenverser 61. En outre, à l’exception du tombeau de Dexiléos, ces monuments nedistinguaient jamais individuellement les cavaliers mais les célébraient toujoursen tant que groupe. Enfin, ces représentations restaient cantonnées dans l’espacede la nécropole, comme si un bon cavalier ne pouvait être qu’un cavalier déjà mort.
Dans ce contexte, on mesure mieux la rupture introduite par Démétrios dePhalère : en adoptant le répertoire équestre pour ses statues honorifiques – et nonpour de simples reliefs votifs ou funéraires –, le dirigeant athénien contrevenaitaux usages démocratiques en vigueur en récupérant l’héritage distinctif de laculture des élites archaïques.
Le dirigeant athénien cherchait surtout, de façon plus positive, à s’inscriredans une tradition récente initiée par Alexandre le Grand. De fait, le conquérantavait prêté un soin attentif à la diffusion de ses portraits et, en particulier, audéveloppement d’une imagerie équestre. À Alexandrie, il était ainsi représenté àcheval en fondateur (ktistês) de la cité 62, tandis que le peintre Apelle et les sculp-teurs Lysippe et Euphranor le mirent souvent en scène à cheval sur le célèbreBucéphale ou bien en conducteur de quadrige 63. Bien évidemment, les diadoquess’empressèrent ensuite d’imiter leur glorieux aîné en adoptant la même stratégieiconographique 64. Démétrios de Phalère imitait donc, à l’échelon civique, lenouveau registre triomphal propre aux rois hellénistiques. Il pavait ainsi la voie à
60 - On connaît également, à Éleusis, un relief votif consacré par l’hipparque Pythodoros,vainqueur chorégique en 415/4, dont le registre supérieur est très proche de celui de lastèle de Dexiléos. Voir à ce propos Tonio HÖLSCHER, Griechische Historienbilder des 5.und 4. Jahrhunderts v. Chr., Würzburg, Triltsch, 1973, p. 99-101, pl. 8, 2.61 - Voir à ce propos I. G. SPENCE, The cavalry of classical Greece..., op. cit., p. 219. Après350 av. J.-C., la cavalerie fut peut-être moins sinistrement connotée : HYPÉRIDE, PourLycophron, I, 16-18. Malgré tout, des résonances négatives continuaient d’être associéesau monde équestre : DÉMOSTHÈNE, Sur la Couronne, XVIII, 320 et les remarquesd’I. G. SPENCE, The cavalry of classical Greece..., op. cit., p. 226-228.62 - PS.-LIBANIOS [Nikolaos le Rhéteur], Progymnasmata, 27, in Progymnasmata, argu-menta orationum Demosthenicarum, éd. par R. Foerster, Leipzig, Teubner, 1915, p. 533-555. Voir A. STEWART, Faces of power..., op. cit., p. 397 et p. 400 (pour la bibliographie).63 - PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle, XXXIV, 19, 15 (Lysippe) ; XXXIV, 19, 27(Euphranor) ; XXXV, 95 (Apelle). Voir aussi STACE, Silves, I, 1, 84-90 (Lysippe) et ÉLIEN,Histoire variée, II, 3 (Apelle). On connaît par ailleurs deux statuettes en bronze représen-tant le roi Alexandre sur un cheval : l’Alexandre d’Herculanum, réplique romaine d’unoriginal datant de 330-320 av. J.-C. et l’Alexandre de Bagram, mise au jour en Afghanistan,réplique hellénistique ou romaine d’un original remontant aux années 330/300 av. J.-C.Voir à ce propos A. STEWART, Faces of power..., op. cit., p. 45 et p. 423.64 - Ainsi Démétrios Poliorcète se vit-il accorder une statue équestre en bronze surl’agora par les volontaires athéniens, dès 303/2 av. J.-C. : SEG, 32, 1982, no 151.3 1 6
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
tous ceux qui, à l’intérieur des cités ou des États fédéraux, prirent le sillage dessouverains macédoniens en recevant au cours du IIIe siècle av. J.-C. l’honneur d’unestatue équestre 65.
Nouveau nombre, nouveaux lieux, nouvelle forme : c’est donc toute la culturedes honneurs mise en place au IVe siècle qui se trouvait bouleversée par l’actionde Démétrios de Phalère. Cette rupture s’inscrivait au demeurant dans le cadred’une politique globale tendant à restreindre les autres formes d’autocélébrationpour laisser l’empreinte monumentale du dirigeant athénien sans concurrence.
Nouvelles restrictions : les lois somptuaires
Le nom de Démétrios de Phalère est resté attaché aux lois somptuaires qu’il miten vigueur. Son action de régulation se concentra notamment sur les espaces qui,durant toute l’époque classique, avaient été au cœur des stratégies de distinctiondes élites athéniennes : la nécropole et le théâtre.
Dans l’espace funéraire tout d’abord, Démétrios de Phalère restreignit drasti-quement la production de monuments représentant des individus, en ronde-bossecomme en relief 66. D’après Cicéron, « il fixa une limitation pour les tombeauxneufs, car il ne voulut pas que l’on plaçât sur le monceau de terre autre chosequ’une colonne (columella) qui ne devait pas être haute de plus de trois pieds, unetable (mensa) ou une vasque (labellum), et il avait nommé unmagistrat spécialementchargé de veiller à l’exécution de ces mesures 67 ». La décision semble avoir étésuivie d’effets, même si les archéologues tendent aujourd’hui à nuancer la brutalitéde la réforme 68 : sur les 249 monuments funéraires attiques qui sont conservésentre 317/6 av. J.-C. et la fin du siècle, la quasi-totalité se présente sous forme depetites colonnes (kioniskoi), généralement identifiées avec les columellae de Cicéron 69.
65 - Voir par exemple John MA, «The many lives of Eugnotos of Akraiphia », StudiEllenistici, 16, 2005, p. 141-191. Cet officier béotien reçut une statue équestre après êtretombé en combattant Démétrios Poliorcète en 293 av. J.-C. : Iscrizioni Storiche Ellenistiche,69. Toujours au IIIe siècle, Milon, officier du koinon épirote, se voit décerner le mêmeprivilège dans le sanctuaire de Dodone. Voir Nikolaos KATSIKOUDIS, «Dôdônê. OiTimêtikoi Andriantes [Dodone : les statues honorifiques] », Etaireia Êpeirôtikôn MeletônIdruma Meletôn Ioniou kai Adriatikou Xôrou, 14, 2006, p. 32-35.66 - Voir C. HABICHT, Athènes hellénistique..., op. cit., p. 74-75 et p. 419, n. 52 pour la biblio-graphie. Le dossier a été étudié à nouveaux frais par Karen STEARS, «Losing the picture:Change and continuity in Athenian grave in the fourth and third centuries B.C. », inN. K. RUTTER et B. SPARKES (dir.), Word and image in ancient Greece, Édimbourg,Edinburgh University Press, 2000, p. 206-227, ici p. 212-222.67 - CICÉRON, Lois, II, 26, 6. Voir aussi PHILOCHORE, Die Fragmente der griechischen Histori-ker (dorénavant FGrHist), 328 F 65. Sur ces lois somptuaires, voir Rainer BERNHARDT,Luxuskritik und Aufwandsbeschränkungen in der griechischen Welt, Stuttgart, Franz SteinerVerlag, 2003, p. 80-82.68 - Voir à ce propos Daniela MARCHIANDI, « Il peribolo funerario attico: lo specchio diuna borghesia », thèse de doctorat de l’université de Naples, 2005.69 - Le comptage est établi à partir des IG II2. Outre 221 petites colonnes, on compte12 structures basses ressemblant à des tables – probablement les mensae de Cicéron –et 10 petites stèles sans ornement ; enfin deux colonnes semblent avoir été réutilisées 3 1 7
V I N C E N T A Z O U L A Y
À l’évidence, la loi visait à limiter les dépenses des riches citoyens ou étrangersqui, dans les années 330/320 av. J.-C., érigeaient de somptueux tombeaux, parfoissurmontés de statues juchées sur des colonnes de plus de dix mètres de haut 70
– non seulement à la périphérie de la ville, mais dans tout le territoire de l’Attique.Par ce biais, Démétrios de Phalère uniformisait les pratiques funéraires des élitesathéniennes et leur retirait un moyen d’autocélébration très apprécié.
Parallèlement le dirigeant abolit un certain nombre de liturgies, dont la choré-gie. L’organisation matérielle des fêtes en l’honneur de Dionysos fut dorénavantconfiée à un unique magistrat, l’agonothète. Si les sources anciennes n’attribuentpas explicitement la réforme à Démétrios de Phalère, les inscriptions ne laissenttoutefois guère de doute à ce sujet 71 : tandis que le dernier monument chorégiqueattesté date de l’année 320/19 av. J.-C., le premier agonothète connu est honoréen 307/6 av. J.-C., juste avant la chute du législateur 72. Quelle qu’en soit la dateexacte 73, le bouleversement est d’importance : alors qu’auparavant les chorègesrivalisaient entre eux pour donner le plus de lustre possible au chœur dont ilsavaient la charge, l’agonothète assure désormais toutes les dépenses pour éviterles phénomènes de surenchère.
Répercutant une formule de Démétrios lui-même, Plutarque éclaire parfaite-ment les objectifs de la réforme : « et à ces chorèges, en cas de défaite, il ne restaitqu’à subir quolibets et railleries ; en cas de victoire, leur revenait le trépied qui,loin d’être le souvenir de leur victoire, selon le mot de Démétrios, n’était quel’ultime profusion de leurs biens gaspillés, le cénotaphe de leur patrimoine disparu
de bassins ornementaux – peut-être l’énigmatique labellum évoqué par l’orateur latin.Voir à ce propos K. STEARS, «Losing the picture... », art. cit., p. 219-220.70 - C’est le caspar exemplede la tombede l’orateur Isocrate,morten338,qui était surmon-tée d’une colonne de trente coudées et d’une sirène de sept coudées : PS.-PLUTARQUE,Vie des dix orateurs [Isocrate], 838C. Quant au tombeau du Macédonien Harpale, il étaitremarquable « par la grandeur et l’ornement (kosmon) » : PAUSANIAS, Périégèse, I, 37, 4-5.Cette loi resta en vigueur après la chute deDémétrios, ce qui suggère qu’elle rencontraitles préoccupations de la majorité des citoyens athéniens : jusqu’au IIe siècle av. J.-C.,aucun monument funéraire figuratif n’est attesté à Athènes. Voir à ce propos GrahamJ. OLIVER, « Athenian funerary monuments: Style, grandeur, and cost », in G. J. OLIVER
(dir.), The epigraphy of death: Studies in the history and society of Greece and Rome, Liverpool,Liverpool University Press, 2000, p. 59-80, ici p. 72-74, qui rapporte la législation deDémétrios à des évolutions sociales plus larges.71 - Peter WILSON, The Athenian institution of the Khoregia: The chorus, the city, and the stage,Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 270-272.72 - Respectivement IG II2, 3055 et 3056 (320/19 av. J.-C.) et IG II2, 3073 (307/6 av.J.-C.). S. D. LAMBERT, «The first Athenian Agonothetai », Horos, 14-16, 2000-2003, p. 99-105, souligne que, dans cette dernière inscription, le nom de Xénoclès est restitué :peut-être est-ce son frère Androclès qui fut le premier agonothète athénien.73 - Ce changement date peut-être de 309/308 av. J.-C., à l’époque où, en tantqu’archonte éponyme, Démétrios de Phalère donna un lustre spécial à la pompè desDionysies. Toutefois, l’interdiction pourrait très bien remonter aux premières années deson « gouvernement », vers 317 av. J.-C. Voir à ce propos P.WILSON, The Athenian institu-tion of the Khoregia..., op. cit., p. 307-308.3 1 8
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
(tôn ekleloipotôn kenotaphion oikôn) 74 ». Le dirigeant athénien assimilait ainsi les fraisengagés lors des chorégies à un splendide tombeau vide – le cénotaphe – et,partant, aux dépenses funéraires qu’il cherchait précisément à réguler : il établissaitdonc un lien étroit entre l’espace de la nécropole et l’univers du théâtre. La réfé-rence au cénotaphe faisait en outre probablement écho auxmonuments chorégiqueseux-mêmes : en cas de victoire, les chorèges bâtissaient parfois de somptueuxédifices dont la seule fonction était d’accueillir l’immense trépied honorifique reçupour prix de leur victoire. Concentrés dans la « rue des Trépieds » qui partait dusanctuaire de Dionysos, ces édifices permettaient ainsi aux chorèges de commé-morer leur succès dans l’espace public 75.
Dans ce contexte, la réforme deDémétrios prend une tout autre signification.En abolissant la chorégie, le dirigeant athénien souhaitait non seulement préserverles fortunes familiales mises en péril par l’esprit agonistique des participants, maissurtout limiter les moyens d’autocélébration de l’élite athénienne : après avoirencadré le luxe funéraire, il les privait d’un autre mode de manifestation de leursupériorité sociale 76.
Nouveau monopole : Démétrios seul en scène
Si Démétrios de Phalère édicta cette double interdiction, ce fut donc à des finspolitiques et non pour des raisons morales ou philosophiques 77. Le dirigeant athé-nien entendait rabaisser la superbe de ses éventuels rivaux pour monopoliser toutel’attention des Athéniens. C’est d’ailleurs le sens des anecdotes, souvent négatives,qui soulignent son amour pour les signes de distinction dont il cherchait pourtantà priver ses concurrents :
Démétrios, ayant édicté des lois (thesmous) régulant l’existence des autres, passa savie à les ignorer superbement. Il prenait un soin scrupuleux à son apparence, se teignant
74 - PLUTARQUE, Sur la gloire des Athéniens, 349B.75 - Voir Hans Rupprecht GOETTE, «Choregic monuments and the Athenian demo-cracy », in P.WILSON (dir.), The Greek theatre and festivals: Documentary studies, Oxford,Oxford University Press, 2007, p. 122-149.76 - Voir Hans J. GEHRKE, «Das Verhältnis von Politik und Philosophie im Wirkendes Demetrios von Phaleron », Chiron. Mitteilungen der Kommission für alte Geschichte undEpigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts, 8, 1978, p. 149-193, ici p. 173, et JonD. MIKALSON,Religion in Hellenistic Athens, Berkeley, University of California Press, 1998,p. 55. En outre, l’agonothésie était bien moins distinctive que la chorégie. Dans lesinscriptions en l’honneur des agonothètes, le peuple prend désormais la place honori-fique autrefois tenue par le chorège – comme dans le monument en l’honneur dupremier agonothète connu, Xenoklès (ou Androklès) de Sphettos, en 307/6 av. J.-C.(IG II2, 3073).77 - Certes, ces mesures font écho aux recommandations d’ARISTOTE, Politique, 1309a16-20 ou de PLATON, Lois, XII, 958D-960B. Toutefois, comme l’a bienmontré H. J. GEHRKE,«Das Verhältnis von Politik... », art. cit., les choix opérés par Démétrios ont leur proprelogique politique et ne sauraient être conçus comme l’application d’un programme deréforme philosophique. 3 1 9
V I N C E N T A Z O U L A Y
les cheveux en blond, se fardant le visage de rouge et usant des onguents les plus délicats.Il voulait avoir l’air lumineux afin de paraître charmant à tous ceux qu’il rencontrait.D’ailleurs, lors de la procession des Dionysies organisée sous son archontat, le chœurchanta des vers composés à sa gloire par Siron de Soles, dans lesquels il était présentécomme « pareil au Soleil » : « L’Archonte, supérieur aux autres nobles (exokhôs eugenetas)et pareil au Soleil, vénère-le donc avec des honneurs tout à fait divins (zatheoistimaisi) » 78.
Être « supérieur aux autres nobles » : telle était donc l’ambition poursuivie parDémétrios de Phalère, lui qui n’était pas un « bien né » 79. À l’évidence cettequête de prestige social explique son investissement inédit du théâtre et de sestechniques. Grand ami du poèteMénandre 80, non seulement le législateur soignaitson apparence à la manière d’un acteur 81 mais il profita de sa position institution-nelle d’archonte éponyme pour recevoir un éloge hyperbolique lors des Dionysies.Comme bien des souverains hellénistiques après lui, il métamorphosa ainsi la pro-cession religieuse en spectacle à sa propre gloire 82. Au demeurant, Démétrios dePhalère semble avoir fréquenté de façon assidue le secteur du théâtre au pointde le transformer en lieu de promenade à la mode : «On sait aussi que tous lesgarçons (paides) enviaient Diognis, l’éromène de Démétrios : ils étaient si désireuxde s’attirer les bonnes grâces de Démétrios que, quand il flânait dans la rue desTrépieds (peripatêsantos para tous tripodas) après son déjeuner, les plus beaux garçonsdemeuraient à cet endroit des jours entiers, à seule fin d’attirer son regard 83 ».
78 - ATHÉNÉE, Deipnosophistes, XII, 542B-D, in P. STORK, J. M. VAN OPHUIJSEN etT. DORANDI, «Demetrius of Phalerum... », art. cit., fr. 43A (nous traduisons), dont lasource semble remonter à DOURIS DE SAMOS (FGrHist, 76 F 10), contemporain deDémétrios de Phalère. Cette procession eut lieu le 9 du mois Élaphèbolion, en mars308, puisque Démétrios fut archonte éponyme en 309/308 av. J.-C. (Marmor Parium, B,ligne 24).79 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit. V, 75 : « en revenus et en construction,il fit croître la cité, bien qu’il ne fût pas bien né (ouk eugenês) ». Voir ÉLIEN, Histoirevariée, XII, 43, in P. STORK, J. M. VAN OPHUIJSEN et T. DORANDI, «Demetrius of Phale-rum... », art. cit., fr. 4. Toutefois, la supposée ascendance servile de Démétrios est uneinvention provenant de sources hostiles ou, à tout le moins, biaisées de façon grossièreet caricaturale. Ainsi est-il possible que, par mariage, Démétrios ait tissé des liens avecla famille de Conon : voir à ce propos John K.DAVIES, Athenian propertied families, 600-300 B.C., Oxford, Clarendon Press, 1971, p. 107-108.80 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 79.81 - Ce souci se traduisait notamment par l’attention particulière qu’il portait aux traitsdu visage : « Il disait que les sourcils ne sont pas une partie minime du visage, ils peuventbel et bien assombrir (episkotêsai) la vie entière » (DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines...,op. cit., V, 82). Sur les jeux de sourcils et leur signification oligarchique, voir par ailleursles analyses de J. TANNER, The invention of art history..., op. cit., p. 128-130.82 - Voir FrankW. WALBANK, «Two Hellenistic processions: A matter of self-definition »,Scripta Classica Israelica, 15, 1996, p. 119-130 et Angelos CHANIOTIS, «Theatricalitybeyond the theater: Staging public life in theHellenistic world », Pallas, 41, 1997, p. 219-259 (p. 233 sur Démétrios de Phalère).83 - ATHÉNÉE, Deipnosophistes, XII, 542E-F, in P. STORK, J. M. VAN OPHUIJSEN etT.DORANDI, «Demetrius of Phalerum... », art. cit., fr. 43A.3 2 0
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
Cette anecdote est d’autant plus significative que Démétrios avait précisémentneutralisé la rue des Trépieds en tant que lieu de distinction sociale. En y déambu-lant (peripatein) en bon disciple d’Aristote, il n’avait dès lors plus à redouter laconcurrence des autres familles athéniennes qui, désormais, ne pouvaient plus yélever de somptueuxmonuments chorégiques. Ainsi était-il enmesure demonopo-liser le regard de tous les Athéniens.
C’est dans ce contexte théâtral que la politique statuaire de Démétrios dePhalère prend finalement tout son sens. Ses effigies s’inscrivaient en effet dansune stratégie plus large qui jouait sur la catégorie du double et de la semblance(eikôn) : sous les dehors d’un acteur fardé ou sous la forme de ses statues (eikones),Démétrios tenait à placer les citoyens en position passive de spectateurs, voired’adorateurs. Du reste jamais la cité ne connut si peu d’activité épigraphique,comme s’il s’agissait de ne laisser place qu’aux seules représentations deDémétriosde Phalère.
De fait, des dix ans que dura son gouvernement, on n’a guère conservéqu’une inscription émanant de l’Assemblée 84, alors que, pour les six années quisuivirent sa chute, plus de cent décrets du peuple, plus ou moins complets, noussont parvenus 85. Les hasards de la transmission ne peuvent à l’évidence suffire àexpliquer un tel décalage. Démétrios de Phalère ne souhaitait manifestement pasexposer officiellement et durablement les décisions de l’Assemblée. C’était là unélément essentiel d’une stratégie globale visant à prendre le contrôle de l’espacepublic : afin d’accaparer l’attention des Athéniens, le législateur entendait viderl’espace public de toutes les autres manifestations de distinction, qu’elles soientindividuelles – par le biais des lois somptuaires – ou collectives – en limitant l’affi-chage des décisions populaires.
Pour mieux assurer son pouvoir, le dirigeant athénien mit donc un termenon seulement au compromis élaboré entre le peuple et les élites civiques maiségalement à l’aggiornamento qui liait les élites entre elles. D’une part, il priva sesrivaux des voies d’expression traditionnelles de leur prestige social. D’autre part, ilremit en cause l’« habitude épigraphique athénienne » qui tendait à saturer l’espacepublic d’inscriptions célébrant le pouvoir décisionnel du peuple 86.Dès lors,Démétriosde Phalère rendait d’autant plus frappantes ses propres apparitions, en chair ou enbronze, puisqu’il était désormais seul en scène, métamorphosant les Athéniensen spectateurs passifs de sa propre gloire.
Toutefois, cette omniprésence eut un douloureux revers. Sans contrepartie,la multiplication de ses statues engendra des réactions violentes, visant à neutraliserces signes de distinction d’autant plus obsédants qu’ils étaient sans concurrence.
84 - Encore s’agit-il du décret déjà évoqué en l’honneur d’Asandros (IG II2, 450), unproche de Cassandre, honoré par une statue sur l’agora : c’est que Démétrios était toutde même obligé de composer avec le pouvoir macédonien et d’accepter les signes desa domination. Voir G. J. OLIVER, « Space and visualization... », art. cit., p. 190.85 - C. HABICHT, Athènes hellénistique..., op. cit., p. 88-89.86 - Voir à ce propos les remarques suggestives de Charles W. HEDRICK Jr, «Democracyand the Athenian epigraphical habit », Hesperia, 68-3, 1999, p. 387-439. 3 2 1
V I N C E N T A Z O U L A Y
Les statues de Démétrios de Phalère furent l’objet d’un retour de flamme, aboutis-sant à leur fonte et, plus largement, à des outrages variés obéissant à une logiquequ’il faut essayer de décoder.
Nouvelles réactions : les statues mises à bas
Selon une inquiétante polarité, les récompenses suprêmes peuvent se muer enleur contraire et l’honneur (timê) devenir outrage (aikia) 87. C’est que, lorsqu’ellessont jugées excessives, les distinctions déchaînent immanquablement l’envie.Comme le précise Diogène Laërce, « bien que [Démétrios de Phalère] fût fortillustre auprès des Athéniens, la jalousie (phthonos) qui ronge toutes choses jetapourtant sur lui aussi son ombre 88 ». Selon un lieu commun remontant à l’époquearchaïque et toujours en vigueur à l’époque romaine, le succès risque toujoursd’éveiller le courroux des dieux et surtout l’envie de la communauté 89. Encore auIIe siècle apr. J.-C., Plutarque s’en fait l’écho en recourant à une comparaisonfrappante : « Aussi la plus belle et la plus sûre sauvegarde d’un honneur est-ellesa simplicité, tandis que ceux qui sont immenses, excessifs, trop pesants, à peu prèscomme les statues démesurées (tois asummetrois andriasi), sont vite renversés 90. »
C’est précisément ce qui se produisit à la chute de Démétrios de Phalère.En 307 av. J.-C., Démétrios Poliorcète investit le Pirée et « libéra » Athènes de ladomination de Cassandre, provoquant la fuite immédiate du législateur. Le dia-doque proclama alors la liberté de la cité et, sous les vivats de la foule, s’engageaà n’installer aucune garnison dans la ville ou au Pirée. Le système censitaire misen place par Démétrios de Phalère fut aboli et la démocratie restaurée. C’est dansce contexte que les statues du législateur subirent alors la colère des Athéniensqui, faute de pouvoir s’en prendre directement au modèle, s’acharnèrent sur sesreprésentations 91. À en croire Strabon, la réaction émanait de la communauté elle-même et non du nouvel occupant : «Mais son impopularité et la haine de l’oligar-chie prirent tellement le dessus qu’après la mort de Cassandre, Démétrios dePhalère fut obligé de s’exiler en Égypte. Les insurgés renversèrent et envoyèrentà la fonte plus de trois cents statues qui le représentaient 92. »
87 - Jean-Pierre VERNANT, «Le pur et l’impur », Mythe et société en Grèce ancienne, Paris,F. Maspero, 1974, p. 121-140.88 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 77.89 - Que les compatriotes de l’athlète victorieux soient jaloux de sa fortune constitueainsi un lieu commun de la poésie de louange. Voir par exemple PINDARE, Pythiques,VII, v. 18-19 ; Id., Isthmiques, II, v. 43. Le poète doit précisément apprendre la mesureau vainqueur et apaiser l’envie de la communauté. Sur la fonction (ré)intégratrice dupoète, voir Leslie KURKE, The traffic in praise: Pindar and the poetics of social economy,Ithaca, Cornell University Press, 1991, p. 195.90 - PLUTARQUE, Préceptes politiques, 820F.91 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 77.92 - STRABON, Géographie, IX, 1, 20. Dans son récit, Diogène Laërce donne la mêmeimpression, même s’il mentionne, in extremis, le rôle de Démétrios Poliorcète : DIOGÈNE
LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 77. Voir aussi PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle,3 2 2
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
En détruisant ainsi les statues de Démétrios – tout comme l’effigie de sonprotecteur Cassandre 93 –, la cité bafouait deux principes essentiels à la bonnemarche du système honorifique, la confiance et la gratitude, auxquels le législateurdéchu avait au demeurant consacré deux traités 94. Peut-être l’épisode fut-il égale-ment l’occasion de nourrir ses réflexions sur les caprices de la fortune qui, selonPolybe, constituait la matière d’un autre de ses ouvrages 95. Toujours est-il que labrutalité du retournement ne fait guère de doute : s’il fut condamné au terme d’unjugement par contumace 96, ses images furent mises à bas sans autre forme deprocès. Tous les auteurs anciens attestent la violence de l’épisode et Favorinusassure même que ses «mille cinq cents statues » (sic) furent renversées « en unjour 97 ». Dans la mesure où les effigies du législateur avaient été, sinon imposées,du moins accordées sans un contrôle populaire approfondi, le retour à l’équilibrese fit donc par la violence et non au terme d’un quelconque processus légal.
Toutefois, si brutale fût-elle, cette manifestation de colère ne s’exprimaitpas sans ordre. De fait, si la violence repose sur la transgression des normes, ellesuit des règles et s’exprime la plupart du temps de façon ritualisée. Submergéespar les flots, vendues, fondues, voire transformées en vase de nuit, les statues deDémétrios subirent une gamme d’outrages d’une troublante diversité. Pour autant,ces dégradations ne devaient rien au hasard et leurs formes relevaient d’une histoireet d’une anthropologie dont on peut rendre raison 98.
XXXIV, 12, 2. Favorinos d’Arles, fr. 70 Barigazzi – cité par Diogène Laërce – fait aussiallusion à cet événement : FAVORINO DI ARELATE, Opere, éd. par A. Barigazzi, Florence,Le Monnier, 1966.93 - PLUTARQUE, Sur les délais de la justice divine, 16, 559D, qui évoque « la statue deCassandre fondue par les Athéniens (andrianta Kasandrou katakhalkeuomenon hup’Athênaiôn) ».94 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 81. Dans la liste des œuvres deDémétrios de Phalère, le Peri pisteôs, consacré à la bonne foi et à la confiance, et le PeriCharitos, sur la gratitude, sont mentionnés de concert avec le Sur la fortune (Peri tukhês).95 - POLYBE, Histoires, XXIX, 21, 3-6, in P. STORK, J. M. VAN OPHUIJSEN et T.DORANDI,«Demetrius of Phalerum... », art. cit., fr. 82A. Méditant sur le destin croisé des Perseset des Macédoniens, Démétrios aurait anticipé dans son traité Sur la fortune la fin de lapuissance macédonienne plus d’un siècle à l’avance, à la grande admiration de Polybe.96 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 77 : « il fut, sans comparaître,condamné à mort ».97 - FAVORINUS [Dion de Pruse], Discours aux Corinthiens, XXXVII, 41 ; PLUTARQUE,Préceptes politiques, 820E. Quant à STRABON, Géographie, IX, 1, 20, il évoque le rôledes « insurgés » (hoi epanastantes) dans la destruction des statues, ce qui suggère uncontexte d’émeute.98 - En l’occurrence, ce n’est pas l’historicité de l’anecdote qui importe, mais les motifsanthropologiques qui ont irrigué les sources anciennes et dont on peut repérer les rejeuxsur la longue durée. 3 2 3
V I N C E N T A Z O U L A Y
La gamme des outrages : « la colère du bronze »
L’expulsion du symbole : le katapontismos
Tout d’abord, à en croire Diogène Laërce, certaines statues de Démétrios furentjetées au fond de la mer. Si l’historicité de l’anecdote est invérifiable, elle renvoieen revanche à un rituel archaïque bien attesté, souvent désigné par les dérivés duverbe katapontizein ou katapontoun 99 : l’immersion volontaire d’un objet au fond dela mer. Un tel traitement poursuivait un double objectif. Tout d’abord, il manifes-tait la volonté des Athéniens d’effacer jusqu’au souvenir même du législateur. Cequi est jeté dans la mer est en effet destiné à y rester : l’acte se veut irréversible.Tel est bien le sens du serment prêté par les Phocéens au moment où, devantl’avancée des troupes perses en 540 av. J.-C., ils décidèrent d’abandonner leurpatrie et « jetèrent à la mer (katepontôsan) une masse de fer rouge, jurant de ne pointretourner à Phocée avant que cette masse eût reparu à la surface des eaux 100 ». Quantaux Athéniens, ils avaient recouru au même procédé lorsque, au moment de lacréation de la ligue de Délos en 478 av. J.-C., ils jetèrent avec leurs alliés « desblocs de fer dans la mer 101 » pour rendre leur serment indissoluble. En noyant leseffigies du « tyran », les Athéniens entendaient ainsi définitivement rayer Démétriosde Phalère de la mémoire civique 102, dans un geste comparable à la damnatiomemoriae des Romains qui avaient l’habitude de jeter les statues des politiciensimpopulaires dans les eaux du Tibre 103.
99 - Le verbe employé par Diogène Laërce est buthizein, « plonger au fond de la mer ».Voir HÉSYCHIUS, s. v. buthizôn : pontizôn en buthô[i]. Le terme a donc une significationproche de katapontizein.100 - HÉRODOTE, Histoires, I, 165.101 - ARISTOTE, Constitution des Athéniens, XXIII, 5.102 - Un tel rituel peut parfois fonctionner en sens inverse. Au lieu de marquer lapunition, il symbolise alors la réhabilitation. Ainsi la stèle témoignant des crimesd’Alcibiade et de ses complices fut-elle solennellement jetée à la mer lors du retour ducoupable à Athènes : voir ISOCRATE, Sur l’attelage, XVI, 9 ; PHILOCHORE, FGrHist, 328F 133 ; DIODOREDE SICILE, Bibliothèque historique, XIII, 69, 2 (katepontisan) ; CORNELIUS
NEPOS, Alcibiade, 6. Le katapontismos est en l’occurrence une façon d’oublier l’outrageet non d’effacer l’honneur. Voir à ce propos Jean-Marie BERTRAND, De l’écriture à l’oralité.Lectures des Lois de Platon, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, p. 160.103 - Voir à ce propos Astrid LINDENLAUF, «The sea as a place of no return in ancientGreece »,World Archaeology, 35-3, 2003, p. 416-433, ici p. 420. Sur cette pratique romaine,voir Michael DONDERER, « Irreversible Deponierung von Grossplastik bei Griechen,Etruskern und Römern », Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts, 61-2, 1991,col. 192-275, ici col. 222. A. Lindenlauf pointe toutefois des différences importantesentre les pratiques grecques et romaines. Tandis que les Romains jetaient seulementles têtes des statues et réutilisaient souvent leurs torses, les Athéniens se débarras-saient apparemment de l’effigie tout entière. Cette différence tient peut-être, si l’onpeut hasarder une hypothèse, à des spécificités culturelles et rituelles : tandis que laculture romaine des imagines mettait en valeur la tête des défunts et non leur corps,la culture statuaire grecque considérait l’effigie comme un tout, un ensemble où lanotion de ressemblance tenait peu de place.3 2 4
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
Ensuite, cette immersion correspondait à un geste de purification. Une tradi-tion athénienne bien enracinée voulait en effet que l’on se débarrasse dans la merdes objets inanimés (ta apsukha) souillés par la pollution du meurtre. Lors de lafête des Dipolies en l’honneur de Zeus Polieus, le prêtre lâchait ainsi sur le sol lecouteau sacrificiel (makhaira) qui avait servi à égorger le bœuf, avant de s’enfuiren courant. L’arme était alors traduite devant le tribunal du Prytaneion et, unefois condamnée, jetée au fond de la mer 104. En tant qu’espace radicalement séparédu monde des hommes, la mer était le lieu le mieux à même d’accueillir, voire depurifier, les objets sacrilèges.
Plusieurs statues meurtrières connurent un tel destin à l’époque archaïque 105.C’est ce que racontent, par exemple, les récits entourant le règne de Phalaris àAgrigente dans la première moitié du VIe siècle. Construite a posteriori, la sinistrerenommée de Phalaris doit beaucoup au taureau de bronze à l’intérieur duquel letyran aurait fait rôtir les étrangers 106. Or, à sa chute, « les citoyens d’Agrigentejetèrent au fond de la mer (katepontôsan) le taureau de Phalaris, comme le ditTimée 107 ». Pour purger la souillure (agos) engendrée par le criminel, la statue futdonc expulsée du territoire de la cité et enfouie au fond de la mer.
Au début du Ve siècle la statue en bronze de Théagénès de Thasos connut,semble-t-il, le même sort. En tant que double vainqueur aux concours olympiques,ce grand athlète était en effet honoré d’une effigie au centre de la cité. Toutefois,après sa mort, sa statue fut l’objet d’outrages répétés de la part d’un de ses adver-saires politiques qui, plein de jalousie, venait flageller son effigie la nuit 108. À encroire les auteurs anciens, la statue se serait alors vengée en tombant sur sonpersécuteur et le tuant. « Les Thasiens la jetèrent alors à la mer (katapontousi), se
104 - PORPHYRE, De l’abstinence, II, 31, 1. Qu’il s’agisse là d’une procédure habituelle estattestée par la Constitution des Athéniens d’ARISTOTE, LVII, 4. Chez PAUSANIAS, Périégèse,I, 24, 4 et I, 28, 10, c’est la hache (pelekus) qui est jugée, mais finalement acquittée. Voirplus largement Jean-Louis DURAND, Sacrifice et labour en Grèce ancienne. Essai d’anthropo-logie religieuse, Paris/Rome, La Découverte/École française de Rome, 1986, p. 66.105 - Voir Robert PARKER, Miasma: Pollution and purification in early Greek religion, Oxford,Clarendon Press, 1983.106 - Voir PLUTARQUE, Collection d’histoires parallèles grecques et romaines, 315C, citantCallimaque (IIIe siècle av. J.-C.). Au demeurant, la sombre réputation du tyran était déjàconstituée au Ve siècle, comme l’atteste PINDARE, Pythiques, I, 185, qui évoquait déjà lefameux taureau. «Mythe » et histoire sont en l’occurrence indissociables. Biaisées par deslieux communs anti-tyranniques, les sources anciennes portent notamment l’empreintedu cycle crétois, reprenant en particulier le motif de la génisse de Minos, construite parDédale : voir Nino LURAGHI, Tirannidi arcaiche in Sicilia e Magna Grecia: da Panezio diLeontini alla caduta dei Dinomenidi, Florence, L.S. Olschki, 1994, p. 21-49.107 - TIMÉE, FGrHist, 566 F 28C (nous traduisons). Voir à ce propos Serena BIANCHETTI,« Falaride pharmakon degli Agrigenti », Sileno, 12/1-4, 1986, p. 101-109.108 - L’histoire de Théogénès/Théagénès a fasciné les auteurs anciens et a été racontéemaintes fois, avec quelques variantes : PAUSANIAS, Périégèse, VI, 11, 5-6 ; DIONDE PRUSE,Discours aux Rhodiens, XXXI, 96-98 ; PLUTARQUE, Préceptes politiques, 811D-E ; LUCIEN,Assemblée des Dieux, 12 sq. ; Sur la manière d’écrire l’histoire, 35 ; EUSÈBE DE CÉSARÉE,Préparation évangélique, V, 34, 2-7 et 9. 3 2 5
V I N C E N T A Z O U L A Y
rangeant à la sentence de Dracon, qui, en rédigeant pour les Athéniens les lois surle meurtre, a condamné à l’exil même les êtres inanimés (ta apsukha), au cas oùl’un d’entre eux, en tombant, causerait mort d’hommes 109. » Selon une procéduremanifestement archaïque – puisque Dracon aurait vécu au VIIe siècle av. J.-C. –,les statues meurtrières pouvaient donc faire l’objet d’un bannissement légal dontle but était d’écarter, aussi loin que possible, la pollution du meurtre.
C’est dans ce contexte rituel que le traitement réservé aux statues deDémétriosde Phalère prend tout son sens. Si nulle mort ne pouvait leur être imputée, leseffigies du législateur n’en avaient pas moins ébranlé durablement l’équilibre dela communauté civique. À ce titre, elles étaient porteuses d’une souillure dont lesAthéniens entendaient se protéger en recourant à cette procédure de bannisse-ment ritualisé.
En définitive, l’épisode reflète non seulement la persistance au début de lapériode hellénistique d’un imaginaire archaïque de la souillure 110, mais témoigneaussi d’une antique conception de la statuaire. S’ils prirent la peine de jeter sesstatues au fond de la mer au lieu de simplement les détruire, c’est en effet queles Athéniens pensaient par ce biais atteindre symboliquement l’exilé lui-même 111.Dans le récit de Diogène Laërce, la destruction de ses effigies préfigure d’ailleursla mort réelle du législateur : rongeant ses statues, le venin (ios) des calomnies faitécho au venin (ios) de l’aspic qui terrassa finalement Démétrios en Égypte quelquesannées plus tard 112. Double symbolique présentifiant l’absent : telle est donc laconception archaïque de la statuaire véhiculée par le sort des statues de Démétrios,
109 - PAUSANIAS, Périégèse, VI, 11, 6. Après une longue famine, les Thasiens consultèrentla Pythie qui leur reprocha le traitement subi par l’effigie de Théagénès. Finalementrepêchée, la statue fut réinstallée au cœur de la cité et devint l’objet d’un culte héroïque,par ailleurs bien attesté archéologiquement. Dans une bibliographie abondante, voirnotamment Jean POUILLOUX, Recherches sur l’histoire et les cultes de Thasos, t. 1. De lafondation de la cité à 196 avant J.-C., Paris, De Boccard, 1954, p. 61-105 et FrançoisCHAMOUX, «Le monument de ‘Theogénès’ : autel ou statue ? », Thasiaca, suppl. auBCH, 5, 1979, p. 143-153.110 - Un autre parallèle, tout aussi vénérable, pourrait être invoqué : l’expulsion du boucémissaire, le pharmakos, lors de la fête des Thargélies. D’abord couronné à la manièred’un roi et entretenu aux frais de la communauté dans une parodie de sitèsis, le pharmakosétait finalement exclu du territoire civique au terme de la cérémonie. Des honneurssuprêmes à l’exil ritualisé : c’est bien le même parcours que suivirent les effigies dulégislateur, depuis le centre de la cité jusqu’aux tréfonds des océans. Voir à ce proposSusan C. JONES, « Statues that kill and gods who love them», in K. J. HARTSWICK
et M. C. STURGEON (dir.), Stephanos: Studies in honor of Brunilde Sismondo Ridgway,Philadelphie, University of Pennsylvania for Bryn Mawr College, 1997, p. 139-143, icip. 141 (sur la statue de Théagénès de Thasos).111 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 77 : «Certes, ils ne s’assurèrent pasde sa personne, mais ils déversèrent leur venin (ion) sur le bronze, renversant ses effi-gies. » Voir à ce propos les remarques de Michel Narcy in DIOGÈNE LAËRCE, Vies etdoctrines..., op. cit., p. 634, n. 2 : « Ion désigne en grec à la fois, comme dans l’épigramme,le venin d’un serpent, et la rouille qui ronge le fer. »112 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 78.3 2 6
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
en profond décalage avec les réflexions sur la mimêsis développées par les philo-sophes du IVe siècle, selon lesquelles les portraits ne sont que faux-semblant, sansaucun lien avec la réalité 113.
La neutralisation du symbole : la vente des statues
Si certaines formes d’outrage s’enracinent dans un lointain passé, d’autres ne secomprennent qu’à l’aune d’une histoire plus récente. Aux dires deDiogène Laërce,certaines statues de Démétrios furent ainsi vendues 114. À l’évidence, ce procédérenvoyait à un tout autre imaginaire que celui de l’immersion rituelle : alors quele katapontismos implique un rapport symbolique entre l’effigie et son modèle, lavente des statues repose au contraire sur un processus de désymbolisation quidisjoint radicalement la statue de sa représentation. Un tel acte revient en effetà convertir un honneur unique, distinctif et individualisé, en une multiplicitéd’éléments interchangeables entre eux : la monnaie symbolise l’égalité devant unmême étalon 115.
Certes, ce n’était pas la première fois que les Athéniens agissaient de la sorte.En 407/6 av. J.-C., dans les derniers feux de la guerre du Péloponnèse, ils avaientainsi fondu certaines statues d’or de l’Acropole – et notamment celles d’AthénaNikè – dans le but de frapper une monnaie de secours 116. Au début du conflit,Périclès envisageait d’ailleurs que la statue chryséléphantine de la déesse puisseelle-même être utilisée pour l’effort de guerre et son or, fondu 117. Sed perseverarediabolicum : les Athéniens réitérèrent ce geste transgressif une trentaine d’annéesplus tard, probablement en 374/3 av. J.-C. Si l’on en croit Diodore de Sicile,Iphicrate aurait en effet intercepté un navire rempli d’offrandes affrété par Denysl’Ancien, alors allié des Lacédémoniens. Le stratège n’aurait pas hésité à « vendre
113 - Voir par exemple Jean-Pierre VERNANT, «De la présentification de l’invisible àl’imitation de l’apparence », Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, La Découverte, [1966]1985, p. 340-341 et p. 350-351, qui reconstitue de façon quelque peu téléologique lepassage de « la présentification de l’invisible à l’imitation de l’apparence » (p. 340).114 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 77.115 - C’est ARISTOTE, Politique, I, 9, 1257a31-b17, qui conceptualise la monnaie commeétalon universel. Sur la fonction civique et égalitaire du monnayage, voir notammentÉdouardWILL, «De l’aspect éthique des origines grecques de la monnaie » et «Réflexionset hypothèses sur les origines du monnayage », Historica Graeco-Hellenistica. Choix d’écrits1953-1993, Paris, De Boccard, 1998, p. 89-110 et p. 111-123. Voir aussi V. AZOULAY,Xénophon et les grâces du pouvoir..., op. cit., p. 171 sq.116 - HELLANICOS DE LESBOS, FGrHist, 323A F 26 et PHILOCHORE, FGrHist, 328 F 141(selon qui l’or venait des statues d’Athéna Nikè). Voir à ce sujet Loren J. SAMONS,Empire of the owl: Athenian imperial finance, Stuttgart, F. Steiner Verlag, 2000, p. 281-286.Au début de l’année 406/5, les trésoriers d’Athéna transférèrent des offrandes auparavantdéposées dans le pronaos aux trésoriers de la ligue de Délos, qui convertirent les objetsen argent en drachmes athéniennes (IG I3, 316).117 - THUCYDIDE, Guerre du Péloponnèse, II, 13, 3-5. Voir Leslie KURKE, Coins, bodies,games, and gold: The politics of meaning in archaic Greece, Princeton, Princeton UniversityPress, 1999, p. 307. 3 2 7
V I N C E N T A Z O U L A Y
comme butin les ornements des dieux (elaphuropôlêse ton tôn theôn kosmon) 118 ».Furieux, le tyran de Syracuse envoya une lettre aux Athéniens pour fustiger leurimpiété : « Vous êtes des sacrilèges sur terre et sur mer. Vous avez pris et convertien monnaie (katekopsate) les offrandes que j’avais envoyées aux dieux, et vous avezainsi commis une profanation envers les plus grands des dieux, Apollon deDelpheset Zeus Olympien 119. » La transformation de statues en monnaie n’était donc pasune nouveauté au moment de la chute de Démétrios de Phalère.
Toutefois, ces deux précédents ne sauraient masquer la rupture opérée àcette occasion. Dans les deux cas évoqués, ce furent en effet des événementsextérieurs, liés à une conjoncture de guerre, qui dictèrent la conduite des Athéniens.En 407/6 av. J.-C., il s’agissait d’une solution de dernier recours, imposée par lescirconstances et la nécessité de reconstruire une flotte mise à mal par les assautsspartiates. En outre, cette transgression reposait sur la fiction d’un prêt momen-tané : une fois la prospérité revenue, les dieux étaient censés recouvrer la jouissancede leurs biens et les statues retrouver leur intégrité 120. Quant à Iphicrate, saconduite était sinon légitime, du moins excusable : en saisissant les offrandes deDenys de Syracuse, il ne faisait qu’exercer son droit de pillage contre un ennemide la cité qui, en pleine guerre, soutenait les Lacédémoniens. Or, rien de tel nepeut expliquer l’agressivité des Athéniens à l’encontre des effigies de Démétriosde Phalère lorsqu’il fut chassé du pouvoir. Si ses statues furent converties enmonnaie, ce ne fut nullement pour répondre aux nécessités du temps : à en croireles sources anciennes, le législateur laissait derrière lui une cité prospère 121. Loind’être le reflet d’une communauté financièrement aux abois 122, la vente de sesstatues renvoyait donc à une volonté délibérée : métamorphoser un symbole dis-tinctif en signes monétaires interchangeables 123.
118 - DIODORE DE SICILE, Bibliothèque historique, XVI, 57, 3. L’auteur situe l’épisode« avant les affaires de Delphes », c’est-à-dire avant la quatrième guerre sacrée, quidébuta en 355 av. J.-C. Or, en XV, 47, 7, il mentionne la capture par Timothée etIphicrate de neuf trières siciliennes, envoyées par Denys à ses alliés lacédémoniens.119 - Ibid.120 - PLUTARQUE, Il ne faut pas s’endetter, 828B : «Et pourtant le grand Périclès fit exécu-ter pour la déesse une parure (kosmon) de quarante talents d’or, qui était démontable :‘Ainsi, disait-il, elle pourra nous servir à financer la guerre et nous restituerons ensuitele même poids d’or’. »121 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 75 (« en revenus et en construction,il fit croître la cité »). Au demeurant, fondre du bronze pour en faire des monnaies n’estpas d’un intérêt financier considérable.122 - C’est le cas, en revanche, à Cos, placée dans une situation financière difficile sousle Haut-Empire : Mario SEGRE, Iscrizioni di Cos, Rome, L’Erma di Bretschneider, 1993,no 230. Retrouvée dans l’Odéon romain en 1928, une inscription du Ier siècle après J.-C.fournit en effet une liste de seize statues honorifiques de citoyens de Cos (vraisembla-blement des citoyens méritants de la première moitié du IIe siècle av. J.-C.) que laGerousia autorise à fondre en raison des « circonstances exceptionnelles » et ce, proba-blement dans le but de frapper monnaie. Voir à ce propos Christian HABICHT, «NeueInschriften aus Kos », Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 112, 1996, p. 83-93, icip. 86 et n. 17.123 - Lesmêmes procédés eurent cours, à l’époque romaine, lors de la damnatio memoriaedeDomitien : «Après lamort deDomitien, les Romains proclamèrent empereur Cocceius3 2 8
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
L’inversion du symbole : de l’effigie aux pots de chambre
Un dernier type de dégradation a particulièrement retenu l’attention des auteursanciens. À les lire, les statues de Démétrios auraient été fondues pour être débitées« en pots de chambre (eis amidas) ». «Car on dit même cela 124 », ajoute DiogèneLaërce. À l’évidence, l’étonnement du biographe implique une hiérarchie entreles différentes formes d’outrages. La transformation en vases de nuit apparaît assu-rément comme l’offense suprême – la seule, au demeurant, dont Strabon se fassel’écho lorsqu’il évoque la chute du législateur : « Les insurgés envoyèrent à la fonte(katekhôneusan) plus de 300 statues qui le représentaient ; certains ajoutent mêmequ’on en fit des pots de chambre 125. » De même que les Athéniens mirent enplace une gradation entre les honneurs, ils imaginèrent une échelle des outragesdont on tient là visiblement l’ultime degré.
De la statue au pot de chambre : comment mieux symboliser la dégradationet la déchéance ? Du reste, les diadoques eux-mêmes se saisirent parfois de cetétrange motif pour souligner toute la distance entre le réel et sa représentationidéalisée. Tel est le cas d’Antigonos le Borgne, exact contemporain de Démétriosde Phalère qui connut le comble des honneurs civiques, en étant le premier hommeà recevoir un culte à sa gloire. En 311 av. J.-C., la cité de Skepsis en Troade luiréserva en effet un traitement inédit. Sanctuaire, autel, statue de culte (agalma),sacrifices, panégyries : l’éclat des honneurs accordés au diadoque bouleversait defond en comble la hiérarchie des distinctions civiques, rendant les statues honori-fiques, auparavant si prisées, bien pâles en comparaison 126. Or, à en croire Plutarque,Antigonos aurait lui-même remis en cause, par le biais d’un rapprochement trivial,la pertinence des honneurs divins qui lui étaient accordés. Ainsi se serait-il écrié
Nerva. En haine du tyran, ses nombreuses statues d’argent et même d’or furent fondues,et l’on en retira des sommes énormes » (DION CASSIUS, Histoire romaine, LXVIII, 1, 1).Sur Domitien et ses statues dévastées, voir aussi PLINE, Panégyrique, LII, 4-5.124 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 77.125 - STRABON, Géographie, IX, 1, 20. Dans les Préceptes politiques, 820E-F, Plutarque faitsubir ce traitement infamant aux statues deDémade : «Mais des 300 statues deDémétriosde Phalère, aucune n’eut le temps de rouiller ou de se patiner et elles furent toutesdétruites de son vivant. Celles de Démade, on les fondit pour faire des pots de chambre(Tous de Dêmadou katekhôneusan eis amidas). » Il est toutefois possible que Plutarqueconfonde les deux personnages. Au demeurant, il se trompe en parlant « des » statuesde Démade, puisque celui-ci n’obtint jamais qu’une seule effigie honorifique : voir àce propos I. KRALLI, « Athens and her leading citizens... », art. cit., p. 147, n. 35. Sur leshonneurs de Démade, abrogés soit à l’été 323 après la mort d’Alexandre, soit en 319après le décès de l’orateur, voir P.GAUTHIER, Les cités grecques..., op. cit., p. 109-110 etP. BRUN, L’orateur Démade..., op. cit., p. 78-83.126 -Wilhelm DITTENBERGER (éd.), Orientis graeci inscriptiones selectae: supplementum syl-loges inscriptionum graecarum, Leipzig, Hirzel, 1903-1905, no 6. Sur l’instauration du cultecivique d’Antigonos, voir ChristianHABICHT,Gottmenschentum und griechische Städte,Munich,C. H. Beck, 1970, p. 42-44. Malgré ce geste de reconnaissance, Skepsis fut détruitepar Antigonos quelques années plus tard : le souverain fonda Antigoneia de Troade, parsynœcisme des cités alentour, dont Skepsis (STRABON, Géographie, XIII, 1, 52). 3 2 9
V I N C E N T A Z O U L A Y
« comme un certain Hermodote le proclamait, dans un poème, ‘fils du Soleil’ et‘dieu’ : ‘Mon porteur de pot de chambre (ho lasanophoros) n’est pas dans lesecret’ 127 ». À l’évidence, l’éloge d’Hermodote fait écho au chant composé à lamême époque par Siron de Soles en l’honneur de Démétrios de Phalère. « Fils dusoleil » (Hêliou paida) pour l’un, « semblable au soleil » (hêliomorphos) pour l’autre :dans les deux cas, la gloire empruntait les mêmes sentiers hyperboliques. Or,Antigonos refusait d’être la dupe de ce concert de louanges. Loin de prétendre àl’autarcie divine, le diadoque se savait prisonnier des impérieuses nécessités de lacondition humaine : le pot de chambre fonctionnait comme un rappel à l’ordre,comme si le diadoque préférait désacraliser lui-même ses propres honneurs plutôtque de voir d’autres les remettre en cause.
De fait, le traitement infamant réservé aux statues de Démétrios de Phalèreimplique une forme de désacralisation. En cela, le procédé faisait écho à l’attitudedu poète Diagoras de Mélos, à la fin du Ve siècle av. J.-C., qui avait osé débiter enpetit-bois une statue de culte (xoanon) d’Héraclès pour faire cuire ses navets 128.Toutefois, la ressemblance entre les deux épisodes reste superficielle. Alors queDiagoras traitait l’effigie divine comme un morceau de bois dont la forme étaitsomme toute indifférente 129, il n’en allait pas de même pour les Athéniens lorsde la chute de Démétrios de Phalère. Loin de considérer ses statues comme unesimple réserve de métal précieux, ils tinrent à refaçonner le bronze pour lui donnerune forme symbolisant la déchéance du législateur. Plutôt que de neutraliser lesymbole, les citoyens choisirent donc d’en inverser le sens.
En l’occurrence, l’inversion jouait sur un double registre. Tout d’abord, lamatière : au lieu d’être associé à l’exaltation du pouvoir, le bronze servait désormaisde réceptacle aux déjections de tous les Athéniens. Il était donc utilisé à contresensdes valeurs symboliques qui lui étaient traditionnellement attachées et, plus large-ment, du langage aristocratique des métaux 130. Ensuite, la forme : en coulant les
127 - Isis et Osiris, 360C-D : Theodorus BERGK, Poetae Lyrici Graeci, Leipzig, 1882, III637. Comment ne pas rapprocher ce mot du propos célèbre de Georg Wilhelm FriedrichHEGEL, La Phénoménologie de l’esprit, Paris, Aubier, 1939-1941, ici t. 2, p. 195 : « Il n’y apas de héros pour son valet de chambre, non parce que le héros n’est pas un héros, maisparce que le valet de chambre n’est qu’un valet de chambre, auquel le premier a affairenon en tant que héros, mais comme quelqu’un qui mange, boit, s’habille, etc., bref, estpris dans la singularité du besoin et de la représentation. »128 - ÉPICHARME, fr. 131 Kaibel = CLÉMENT D’ALEXANDRIE, Le protreptique, II, 24, 4 :Georg KAIBEL (dir.), Comicorum Graecorum fragmenta I, Berlin, Weidmann, 1899. VoirD. TARN STEINER, Images in mind..., op. cit., p. 126-129, ici p. 127. Attaquant les pratiquesreligieuses athéniennes, en particulier la cérémonie des Mystères, il est, dans les Nuées,le modèle de l’impie, remplaçant Zeus par le règne du Tourbillon (v. 828-830). CommeSocrate après lui, Diagoras fut au demeurant poursuivi pour impiété, probablement en415/4 av. J.-C., juste après la terrible répression que les Athéniens firent subir à son îlenatale en 416 : MELANTHIOS, FGrHist, 326 F 3 ; KRATEROS, FGrHist, 342 F 16.129 - Dans la conception aristotélicienne, une statue est la combinaison de la matièreet de la forme : ARISTOTE, Métaphysique, D, 2, 1013b5-8 et 1014a1-15 ; Z, 3, 1029a1-5 et Z,10, 1035a6-7 : « Par matière, j’entends par exemple le bronze, par forme, la configurationqu’elle revêt, et par le composé des deux, la statue, le tout concret. »130 - Voir, dans un autre contexte, L. KURKE, «The language of metals », Coins..., op. cit.,p. 41-64.3 3 0
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
statues en vases de nuit, les citoyens transformaient un honneur distinctif public,visible par tous, en objet utilitaire privé souvent manié par des esclaves 131. Defait, la manipulation des pots de chambre était associée au statut servile : capturépar le roi Antigonos le Borgne, un jeune Spartiate aurait même préféré se donnerla mort plutôt que d’avoir à apporter au roi son pot de chambre, en proclamantfièrement « Je ne veux pas être esclave 132. » Du premier des citoyens au dernierdes esclaves : la transformation en vase de nuit reflétait donc la transmutationtotale des valeurs associées à la statuaire honorifique.
Loin d’être une transgression sans équivalent, cet épisode entrait en réso-nance avec plusieurs autres incidents qui tendaient, eux aussi, à mettre en scèneles liens entre excrétion et exécration, entre souillure et infamie. Sans allerjusqu’à les fondre pour en faire des vases de nuit, certaines statues honorifiquesfurent ainsi recouvertes de l’urine des citoyens en colère. Dans son Discours auxCorinthiens, Favorinus d’Arles stigmatise le comportement des Athéniens qui, nonseulement, mirent à bas les effigies de Démétrios de Phalère, mais outragèrentaussi les statues d’un roi de Macédoine :
Je sais [...] que quinze cents statues de Démétrios de Phalère en un seul et même jour, onttoutes été renversées par les Athéniens. Ils osèrent même vider leurs pots de chambre surle roi Philippe (etolmêsan de kai tou Philippou tou basileôs amidas kataskedasai).Les Athéniens donc arrosaient d’urine son effigie (tês eikonos), tandis qu’il arrosait leurcité de sang, de cendres et de poussière. Chose répréhensible en effet que de mettre le mêmehomme tantôt au rang des dieux, tantôt plus bas que les hommes 133.
Le débat fait rage parmi les spécialistes pour déterminer l’identité du Philippedont la statue est humiliée de la sorte : s’agit-il du père d’Alexandre, Philippe IIde Macédoine, ou bien du roi Philippe V (237-179 av. J.-C.), le premier souverainantigonide à plier devant la puissance militaire romaine 134 ? La réponse importe
131 - Le motif se retrouve à l’époque romaine. En 31 apr. J.-C., les statues de Séjan, leproche de Tibère, sont coulées et transformées en objets prosaïques. Voir JUVÉNAL,Satires, X, v. 56 sq. ; DION CASSIUS, Histoire romaine, LVIII, 11, 3. Voir plus largementPeter STEWART, Statues in Roman society: Representation and response, Oxford, OxfordUniversity Press, 2003, p. 297, n. 161, pour d’autres exemples romains d’hubris contredes statues et Eric R. VARNER, Mutilation and transformation: Damnatio memoriae andRoman imperial portraiture, Leyde/Boston, Brill, 2004, p. 92-93.132 - PLUTARQUE, Apophtegmes lacédémoniens, 234C.133 - FAVORINUS, Corinthiaca, XXXVII, 41. Natif d’Arles, Favorinus bénéficia de lafaveur de l’empereur Hadrien, jusqu’à ce qu’il fût accusé d’adultère avec la femmed’un consul et exilé probablement en 131/132 apr. J.-C. En conséquence, les Athéniensmirent à bas la statue de bronze dont ils l’avaient honoré (§ 35), avant que Corinthe neprît peut-être la même décision.134 - Selon AnnaMaria PRESTIANI GIALLOMBARDO, «Philippos ho basileus. Nota a Favorin.Corinth., 41 », Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 20-2, 1985, p. 19-27, il s’agirait dePhilippe V, dans la mesure où le titre de basileus n’est pas attesté pour Philippe II – cequi est un argument fragile, dans la mesure où Favorinus ne rédige pas un texte officiel,où la titulature serait importante. Toujours est-il qu’en 200 av. J.-C., après avoir apprisla destruction de Chalcis par les Romains, Philippe V fit une expédition contre Athènes 3 3 1
V I N C E N T A Z O U L A Y
peu, en l’occurrence. Ce traitement dégradant prend en effet son sens dans unesérie d’outrages qui dessine un motif dans la longue durée 135. Reste à saisir toutela violence de l’affront : recouvrir d’urine les statues était un geste d’autant plustransgressif qu’il renvoyait en miroir, dans l’imaginaire des acteurs, aux nombreuxrituels de purification dont les statues de culte bénéficiaient : baignées dans l’eaude mer, nettoyées, polies ou encore couvertes d’huile, elles étaient l’objet de soinsdiamétralement opposés à ceux dont l’effigie de Philippe fut la victime 136.
Quelle que soit la véracité de l’épisode, la chute de Démétrios de Phalèremobilisa, chez les auteurs anciens, un imaginaire de l’outrage se déployant dansla longue durée et jouant sur des registres variés. Au-delà de leur apparente diver-sité, ces multiples affronts partageaient toutefois un trait commun. Qu’elles fussentexpulsées au fond des mers, converties en monnaie ou débitées en pots de chambre,au terme du processus, les effigies du législateur étaient totalement anéanties.Dès lors, comment commémorer l’outrage ? Comment témoigner de l’infamie du« tyran » pour les générations futures ? La réponse se trouve peut-être dans le gesteétrange des Athéniens qui conservèrent une statue de l’exilé pour l’inscrire, ennégatif, dans la mémoire de la cité.
La conservation du symbole : la statuaire horrifique
Pour clore l’inventaire des outrages dont les statues de Démétrios furent la cible,Diogène Laërce mentionne en effet une singulière exception : «Et une seule [deces statues] est conservée à l’Acropole. Favorinus dit, dans son Histoire variée, queles Athéniens firent cela sur l’ordre du roi Démétrios. Mais aussi à l’année de sonarchontat, ils inscrivirent : année d’illégalité (anomias), selon Favorinus 137. » Malgréson exil, le législateur continua donc à jouir d’une statue dans le lieu le plus sacré
qu’il dévasta : TITE LIVE, Ab Urbe Condita, XXXI, 24-26. L’été suivant, les Athéniensvotèrent un décret prescrivant de démolir toutes les statues de Philippe et de sesancêtres : TITE LIVE, Ab Urbe Condita, XXXI, 44, 4-5. Voir C.HABICHT, Athènes hellénis-tique..., op. cit., p. 218-219. Pausanias mentionne toutefois l’existence de statues dePhilippe II et d’Alexandre, situées au nord de l’agora, avant l’odéon, « effet d’uneflatterie du peuple à leur égard » (Périégèse, I, 9, 4). Érigées vers 338 ou un peu plustard, durant le règne d’Alexandre, elles pourraient également avoir été l’objet de lavindicte des Athéniens. Au demeurant, les Éphésiens renversèrent les statues dePhilippe II, à la nouvelle de sa mort : ARRIEN, Anabase, I, 17, 11.135 - Le même imaginaire est à l’œuvre à l’époque romaine dans JUVÉNAL, Satires, I,131 : «La journée est magnifiquement ordonnée : la sportule, puis le forum, Apollon lejuriste, les statues des généraux triomphateurs, parmi lesquels ose avoir son inscriptionje ne sais quel Égyptien, un percepteur de là-bas, s’il vous plaît. Ah, contre cette effigie-là, permission de pisser, pour le moins ! »136 - Sur la pratique de nettoyer et d’oindre les statues de culte, voir PAUSANIAS, Périégèse,V, 11, 10 (pour la statue de Phidias). L’image d’Apollon à Délos était nettoyée avecune solution faiblement acide avant d’être frottée d’huile, cirée et parfumée. Voir LillyKAHIL, « Bains de statues et de divinités », in R. GINOUVÈS et al. (dir.), L’eau, la santéet la maladie dans le monde grec, Athènes, École française d’Athènes, 1994, p. 217-223 etD. TARN STEINER, Images in mind..., op. cit., p. 106-113.137 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 77.3 3 2
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
d’Athènes, au contact des effigies divines et des offrandes les plus vénérables dela cité. Comment expliquer cette apparente anomalie qui contraste fortementavec la hargne iconoclaste manifestée par ailleurs ? Sans doute les Athéniens enten-daient-ils ainsi charger cette ultime effigie d’une signification négative, de façonà conserver une trace monumentale de l’infamie du tyran. D’honorifique, la statuepréservée devenait horrifique : sa présence incitait par contraste le peuple athénienà rester dans le droit chemin, en lui proposant un contre-modèle à exécrer 138. Lastatuaire pouvait ainsi marquer tantôt le comble de l’honneur, tantôt le summumde l’indignité 139.
À vrai dire, Démétrios de Phalère connaissait bien les potentialités infa-mantes de la statuaire pour y avoir lui-même recouru sur un mode métaphorique.Si l’on en croit une anecdote relayée par Diogène Laërce, il aurait en effet stigma-tisé l’un de ses adversaires en le comparant à une effigie d’Hermès : « Voyant unjeune homme dissolu, ‘voici, dit-il, un Hermès carré : la traîne, le ventre, le sexe,la barbe’ 140. » Piliers quadrangulaires dressés à la croisée des chemins, les Hermèsmarquaient parfois l’honneur lorsqu’ils étaient accompagnés d’inscriptions – tellesles épigrammes à la gloire des stratèges victorieux contre les Perses, dans les années470. Rien de tel en l’occurrence, puisque la métaphore entendait au contrairesymboliser l’infamie du dépravé. Plus largement, l’anecdote révèle toute l’attentionque portait Démétrios de Phalère à la statuaire, qu’elle lui servît à manifester sapropre gloire ou à signaler l’indignité d’autrui.
Que les effigies puissent marquer le déshonneur est au demeurant un phéno-mène bien attesté en Grèce ancienne. Lors des concours olympiques, les athlètesayant donné ou reçu des pots-de-vin étaient ainsi condamnés à payer une amendedont le produit servait à ériger des statues de Zeus en bronze – les Zanes – dansl’aire sacrée 141. Comme le rappelle Pausanias, ces statues avaient une double fonc-tion : vouer les athlètes tricheurs à l’exécration et glorifier la divinité du sanc-tuaire 142. Toutefois, l’analogie avec Démétrios de Phalère n’est que partielle : alorsque l’effigie conservée sur l’Acropole représentait le législateur lui-même, les Zanesfiguraient la divinité et non le fraudeur. L’infamie ne ressortait donc qu’à la lecturedu texte et non à la seule vision de l’image.
Dans le cadre athénien, il existait en revanche des statues infamantes quiressemblaient au coupable lui-même. Les archontes s’engageaient ainsi par serment
138 - É. PERRIN-SAMINADAYAR, «Aere perennius... », art. cit., p. 137 : « occasionnellement,le portrait pouvait également avoir une fonction de mémoire, mais il faut noter quecette mémoire est négative ».139 - Voir L. KURKE, Coins..., op. cit., p. 314-316.140 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 82.141 - PAUSANIAS, Périégèse, V, 21, 2-18. On connaît cinq séries de Zanes, érigées entre 388av. J-C. et 125 après J.-C., le long de la terrasse des trésors – dont Pausanias rapporteles origines à la façon d’un mythe étiologique. Certaines bases parvenues jusqu’à noussont même signées par le sculpteur : on connaît ainsi un Zanes de 388 av. J.-C., portantla signature de Kléon de Sicyone : Wilhelm DITTENBERGER et Karl PURGOLD (dir.),Inschriften von Olympia, Berlin, Asher, 1896, no 637.142 - PAUSANIAS, Périégèse, V, 21, 3-4. 3 3 3
V I N C E N T A Z O U L A Y
à ne pas recevoir de dons corrupteurs (dôra) sous peine d’être condamnés à consacrerune statue en or, à taille réelle et à leur effigie, dans le sanctuaire de Delphes 143.À l’évidence, cette punition ressemblait à s’y méprendre à l’honneur si prisé parles membres de l’élite athénienne. Seuls changeaient en l’occurrence la nature dumétal – l’or et non le bronze – et le lieu de la consécration – Delphes et nonAthènes. Bien sûr, le passage du bronze à l’or avait un sens économique, puisqu’ilmultipliait le coût de l’amende par 80 ; toutefois, il visait probablement aussi àdistinguer immédiatement la statue infamante des consécrations environnantes.Quant à l’emplacement retenu, il avait pour but de signaler le déshonneur de l’archontenon seulement à Athènes mais dans la Grèce tout entière, comme si la proclamationde l’infamie méritait davantage de publicité que l’annonce de la gloire 144.
Qu’elle ait été ou nonmise enœuvre, cette punition inédite était intimementliée au statut de ceux qu’elle visait. En tant que principaux magistrats de la cité, lesarchontes pouvaient en effet prétendre aux plus grands honneurs et, précisément, àl’octroi d’une statue honorifique. En contrepartie, ils devaient vivre perpétuelle-ment sous la menace de l’indignité suprême : élever une statue signalant à tousleur infamie. La gloire s’éprouvait donc au risque de l’outrage. Ancien archontelui-même, Démétrios de Phalère connut précisément un tel renversement defortune : son ultime effigie offrait à tous le spectacle de sa résistible ascension.
Reste un dernier élément à éclairer. Pourquoi avoir choisi un lieu si véné-rable, l’Acropole, pour commémorer le déshonneur du législateur ? N’y avait-il pasd’autres zones plus adaptées et, surtout, moins prestigieuses pour offrir un telspectacle ? En réalité, c’est précisément pour rendre l’opprobre plus manifeste queles Athéniens retinrent un tel emplacement. À la manière des symboles de gloire,l’outrage s’exprime en effet de façon différentielle : la proximité des statues divinesrendait l’indignité de Démétrios d’autant plus manifeste. Ces jeux d’oppositionconstituaient d’ailleurs une stratégie visuelle éprouvée dans le monde grec. Stigma-tisant les tricheurs, les Zanes prenaient ainsi tout leur relief par contraste avecles nombreuses statues d’athlètes vainqueurs qui encombraient le site d’Olympiedepuis le VIe siècle av. J.-C. 145. De même à Sparte, le roi Pausanias, pourtanthonni de tous, bénéficiait d’un tombeau près du théâtre à proximité immédiatede l’enclos funéraire du héros des Thermopyles, le roi Léonidas 146 : les Spartiates
143 - ARISTOTE, Constitution d’Athènes, LV, 5 ; PLATON, Phèdre, 235d8-e1 ; ARISTOTE,Parties des animaux, LV, 5 (qui précisent tous deux que ces statues d’or devaient êtredes images du fautif lui-même, à taille réelle, et érigées à Delphes) ; PLUTARQUE, Viede Solon, XXV, 3 ; ARISTOTE, fr. 611 Rose : Valentin ROSE (dir.), Aristotelis qui ferebanturlibrorum fragmenta collegit, Leipzig, Teubner, 1886 ; POLLUX, Onomasticon, VIII, 85-86.Voir plus largement R. KRUMEICH, Bildnisse griechischer Herrscher..., op. cit., p. 59-63.Celui-ci souligne toutefois que l’on ne connaît aucune application de la mesure (p. 61).144 - Selon J.-P. VERNANT, Figures, idoles, masques, op. cit., p. 76-77, il se serait égalementagi, pour l’archonte, de consacrer une figure de substitution, rachetant la faute à sa place.145 - Les exemples abondent dans l’œuvre de PAUSANIAS, Périégèse, livre VI.146 - PAUSANIAS, Périégèse, III, 14, 1. THUCYDIDE, Guerre du Péloponnèse, I, 134, 4, men-tionnait déjà la stèle et l’inscription funéraire du roi Pausanias. Voir à ce propos CarolynHIGBIE, «Craterus and the use of inscriptions in ancient scholarship », Transactions ofthe American Philological Association, 129, 1999, p. 43-83, ici p. 62.3 3 4
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
rendaient ainsi visibles, par contraste, les comportements à imiter ou bien à pros-crire. Les Athéniens, quant à eux, n’avaient pas hésité à placer une stèle infamantesur l’Acropole pour en démultiplier le pouvoir dénonciateur. Stigmatisant Arthmiosde Zéleia, accusé d’avoir accepté l’or corrupteur desMèdes dans le deuxième quartdu Ve siècle 147, l’inscription était placée à l’entrée du sanctuaire, juste à côté de lastatue d’Athéna Promachos érigée en souvenir de la victoire contre les barbares :comme l’écrit Démosthène, « on avait alors un tel respect pour la justice et onattribuait tant de prix à punir les auteurs de tels actes qu’on accordait le mêmeemplacement au trophée de la déesse et aux châtiments infligés aux criminels decette espèce 148 ». Honneur et infamie voisinaient donc, se renforçant l’un l’autre.Et c’est probablement pour la même raison – renforcer l’outrage au contact de lagloire – que les Athéniens conservèrent sur l’Acropole l’ultime effigie deDémétriosde Phalère.
L’inscription du symbole : l’épigraphie infamante
En l’occurrence, la statue du législateur déchu assurait la même fonction quel’inscription accompagnant son nom dans la liste archontale. Faute de supprimerl’année tout entière – comme ils purent le faire pour un jour de leur calendrier 149 –,les Athéniens choisirent en effet d’affecter d’une marque négative l’année oùDémétrios fut archonte éponyme et célébra les Dionysies avec tant de faste :d’après Favorinus, « à l’année de son archontat, ils inscrivirent : année d’illégalité(anomias) 150 ». Ainsi l’indignité du « tyran » se trouvait-elle à jamais figée dans la
147 - DÉMOSTHÈNE, Sur l’Ambassade, XIX, 271-272 ; Troisième Philippique, IX, 41-43 ;DINARQUE, Contre Aristogiton, 24-25. La mesure fut prise entre 477 et 450 av. J.-C., sansqu’il soit possible d’être beaucoup plus précis. Voir à ce propos Michel NOUHAUD,L’utilisation de l’histoire par les orateurs attiques, Paris, Les Belles Lettres, 1982, p. 239,n. 380, et plus largement Rosalind THOMAS, Oral tradition and written record in classicalAthens, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 85 et p. 87.148 - DÉMOSTHÈNE, Sur l’ambassade, XIX, 272.149 - Nicole LORAUX, La cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes, Paris, Payot, 1997,p. 173-194. Les Athéniens avaient ainsi supprimé de leur calendrier le jour où Athénaet Poséidon s’étaient querellés pour remporter la première place en Attique – le 2 dumois de Boédromion. « À passer chaque année du premier au troisième jour de ce mois,les Athéniens creusent, au tout début de la numération, un trou qui, comme une cicatricetrès visible, est la trace de l’opération chirurgicale de non-mémoire » (p. 192).150 - DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines..., op. cit., V, 77. Cette mesure exceptionnelletrouve un écho, bien plus tard, dans la damnatio memoriae dont Mithridate VI du Pontfut l’objet à Athènes : désigné comme archonte éponyme en 87/6, son nom fut effacépar la suite de la liste archontale et remplacé par l’inscription anarkhia (absence depouvoir). Voir IG II2, 1713, l. 12 [= Syll.3, 733] et les analyses de ChristianHABICHT, « ZurGeschichte Athens in der Zeit Mithridates’ VI », Chiron. Mitteilungen der Kommission füralte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts, 6, 1976, p. 127-142. Sile parallèle est frappant, il n’est toutefois que partiel : dans le cas de Démétrios dePhalère, rien n’indique explicitement que les Athéniens effacèrent son nom de la liste.Favorinus mentionne un ajout – année d’illégalité (anomia) – et non une suppression. 3 3 5
V I N C E N T A Z O U L A Y
pierre sous la forme d’une inscription accusatrice, au lieu que son nom soit pure-ment et simplement effacé de la liste comme les Athéniens le firent pour Diphilos,vingt ans plus tard, en 287 av. J.-C. 151. En cela, les Athéniens poursuivaient uneantique tradition consistant à rendre public le déshonneur. Car, dans la cité démo-cratique, les inscriptions n’avaient pas seulement vocation à honorer les citoyensmais pouvaient tout autant les flétrir – comme dans le cas d’Arthmios de Zéleia 152.Selon la Souda, le verbe stelizein « ériger une stèle » avait même le sens de «marquerd’infamie » 153. L’épigraphie servait donc parfois à conserver la mémoire dudéshonneur, telles les fameuses stelai attikai qui commémoraient l’impiété desAthéniens impliqués dans la parodie des mystères d’Éleusis et la profanationdes Hermès en 415 av. J.-C. 154. En définitive, « la capacité honorifique de la stèlesemble avoir été, dans cette tradition, considérée comme tout à fait secondaire parrapport à sa fonction stigmatisante 155 ».
Épigraphie infamante et statuaire horrifique avaient donc d’étroites affinités :l’effigie préservée et la marque rajoutée à la liste archontale conspiraient à mainte-nir le souvenir négatif de Démétrios de Phalère. Cette collusion intime n’étaitd’ailleurs pas sans précédent. En cette fin de IVe siècle, les Athéniens gardaient eneffet en mémoire l’étrange destin d’un homme – Hipparque, fils de Charmos –dont la statue dressée sur l’Acropole fut fondue pour devenir une stèle infamante,probablement au cours des années 480.
Les Athéniens, n’ayant pu se saisir de sa personne, enlevèrent sa statue (eikona) del’Acropole, la firent fondre et la transformèrent en stèle, où l’on décréta d’inscrire lesnoms des criminels et des traîtres (anagraphein tous alitêrious kai tous prodotas) :le nom d’Hipparque lui-même est gravé sur cette stèle parmi ceux des autres traîtres 156.
À près de deux siècles de distance, les mésaventures d’Hipparque, le premierostracisé de l’histoire 157, évoquent irrésistiblement le sort de Démétrios de Phalère.
151 - PLUTARQUE, Vie de Démétrios, XLVI, 2 : «Cependant, les Athéniens [...] rayèrentde la liste des [archontes] éponymes Diphilos, qui y était inscrit comme prêtre des DieuxSauveurs » (nous traduisons). Voir à ce propos Enrica CULASSO GASTALDI, « Abbatterela stele. Riscrittura epigrafica e revisione storica ad Atene », Cahiers du Centre Gustave-Glotz, 14, 2003, p. 241-262, ici p. 258-259, n. 57.152 - Voir Jean-Marie BERTRAND, «De l’usage de l’épigraphie dans la cité des Magnètesplatoniciens », in G.THÜR (dir.), Symposion 1995: Vorträge zur griechischen und hellenisti-schen Rechtsgeschichte (Korfu, 1-5 sept. 1995), Cologne, Böhlau, 1997, p. 27-47.153 - Souda, s. v. stêlizein. Soumis à la stêliteusis (publication solennelle), un condamnépouvait, tout à fait simplement et couramment, être appelé stêlitês. Voir à ce proposJ.-M. BERTRAND, De l’écriture à l’oralité..., op. cit., p. 154-155.154 - Voir Christophe PÉBARTHE, Cité, démocratie et écriture. Histoire de l’alphabétisationd’Athènes à l’époque classique, Paris, De Boccard, 2006, p. 267.155 - J.-M. BERTRAND, De l’écriture à l’oralité..., op. cit., p. 155.156 - LYCURGUE, Contre Léocrate, 117. Sur la signification de cette énigmatique transfor-mation, voir les analyses de Josiah OBER, « From epistemic diversity to common know-ledge: Rational rituals and cooperation in democratic Athens », Episteme. A Journal ofSocial Epistemology, 3-3, 2006, p. 214-233, ici p. 220-222.157 - En 488/7 av. J.-C., d’après ARISTOTE, Constitution des Athéniens, XXII, 4.3 3 6
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
Comme le législateur, Hipparque fut archonte éponyme 158 ; comme lui aussi, ilfut jugé par contumace et, s’étant dérobé au procès, condamné à mort ; commelui, enfin, son effigie subit d’étranges avanies. Pour autant, l’analogie ne sauraitêtre poussée trop loin. Tout d’abord, Hipparque ne bénéficiait certainement pasd’une statue honorifique sur l’Acropole : le monument fondu par les Athéniensn’était probablement qu’une offrande privée consacrée à Athéna dont on ignoremême si elle représentait le dédicant 159. Surtout, sa transformation en stèled’infamie reste sans équivalent dans le cas des effigies de Démétrios de Phalère.
Toutefois, en dépit de ces notables différences, le parallèle permet sansdoute de comprendre pourquoi les Athéniens tinrent tant à garder une statue deDémétrios de Phalère sur l’Acropole. Comme dans le cas d’Hipparque, il s’agissaitde rendre l’outrage permanent : «Ce n’était pas pour le vain plaisir de faire fondreune statue de bronze, mais pour laisser à la postérité un témoignage pour le restedes temps (hina tois epigignomenois paradeigma eis ton loipon khronon) de leur indigna-tion à l’égard des traîtres 160. » Tel était bien le but poursuivi par la cité à la chutedu législateur : faire résonner, pour l’éternité, la sinistre réputation du tyran, enchargeant d’une mémoire négative tant son nom – par le truchement de la listearchontale – que son image – grâce à l’ultime statue conservée sur l’Acropole.
Peu après sa chute, les Athéniens eurent à nouveau recours au pouvoir infa-mant de l’écrit à l’encontre de Démétrios de Phalère. Toutefois, en lieu et placed’une exécration publique sur une stèle dressée au cœur de la cité, ils inscrivirentcette fois son nom sur une tablette en plomb, repliée sur elle-même et destinée àêtre expulsée aux portes d’Athènes 161. Il y a une trentaine d’années, les archéo-logues ont en effet découvert dans un puits situé au Dipylon, juste en dehors desmurs, une tablette de malédiction portant le nom du législateur déchu, avec ceuxde Cassandre, de son frère Pleistarchos et d’Eupolémos, un général macédonien 162.Probablement gravée en 304 av. J.-C., l’inscription était dirigée contre ceux quitentaient alors de reprendre Athènes au cours de la guerre de quatre ans 163. Si elle
158 - Petit-fils du tyran Hippias et chef des aristocrates, cet Hipparque fut élu archonteéponyme en 496/5. Voir ANDROTION, FGrHist, 324 F 6.159 - Voir R. KRUMEICH, Bildnisse griechischer Herrscher..., op. cit., p. 63-64. D’après lui, lastatue serait une offrande privée, consacrée avant 488/87 – la date de son ostracisme.D’après Catherine M. KEESLING, The votive statues of the Athenian Acropolis, Cambridge,Cambridge University Press, 2003, p. 179, il s’agirait peut-être de la consécration d’unestatue de vainqueur olympique.160 - LYCURGUE, Contre Léocrate, 119.161 - Voir M. HAAKE, Der Philosoph in der Stadt..., op. cit., p. 77-78. Sur les defixiones àl’époque d’Alexandre, voir plus largement Christian HABICHT, « Attische Fluchtafelnaus der Zeit Alexanders des Grossen », Illinois Classical Studies, 18, 1993, p. 113-118.162 - La tabletteporte l’inscription :Pleistarkhon| Eupolemon |Kassa[n]dron| Dêmêt[rion]|Ph[al]ê[rea]. Sur le texte, David JORDAN, «Two inscribed lead tablets from a well inthe Athenian Kerameikos », Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, 95, 1980,p. 225-239 (avec une datation toutefois erronée). Voir John G. GAGER (dir.), Curse tabletsand binding spells from the ancient world, New York, Oxford University Press, 1992, p. 147-148, no 57.163 - Sur cette guerre dite de « quatre ans » (307-303), voir C.HABICHT, Athènes hellénis-tique..., op. cit., p. 92-93. 3 3 7
V I N C E N T A Z O U L A Y
atteste l’intérêt persistant de Démétrios de Phalère pour les affaires athéniennes,même après son exil, la malédiction témoigne surtout de la réaction des Athéniensqui tentèrent d’empêcher à jamais son retour, en recourant au pouvoir magiquede l’écriture. Le nom inscrit fonctionnait en effet comme un double de Démétriosde Phalère, emprisonné et jeté hors des murs, à la manière dont certaines de seseffigies furent bannies et immergées au fond de la mer.
En définitive, ce double jeu d’écriture – le rajout infamant sur la liste archon-tale et la malédiction placée hors les murs – offre un résumé saisissant de la stratégiesymbolique complexe que les Athéniens mirent en place à la chute de Démétriosde Phalère. S’ils souhaitaient empêcher à tout prix son retour, expulsant jusqu’àson nom de la cité, les citoyens ne cherchèrent pas pour autant à bannir totale-ment son souvenir. Loin de vouloir l’effacer de la mémoire civique, sur le modedu refoulement psychanalytique – comme ils l’auraient fait, selon Nicole Loraux,lors des épisodes oligarchiques précédents 164 –, les Athéniens conservèrent délibé-rément la trace du traumatisme sous la forme d’une inscription flétrissante etd’une statue horrifique : nul déni en l’occurrence, mais une gestion contrastée dela mémoire civique. C’est précisément parce qu’ils avaient gardé le souvenir duchoc créé par Démétrios de Phalère que les Athéniens prirent, par la suite, desmesures législatives pour mieux encadrer l’octroi des honneurs suprêmes.
Épilogue. Violence ritualisée et régulation institutionnelle
Sans doute cette réaction violente trouva-t-elle une traduction institutionnelle, surunmode plus apaisé, dans les années qui suivirent l’exil du législateur. Au IIIe siècleav. J.-C., l’octroi des megistai timai fut en effet réglementé avec une rigueur renou-velée. Or, plutôt que de relier cette nouvelle législation au supposé traumatismesuscité par les honneurs de Démade, il semble plus logique de la rapporter àl’obsession statuaire de Démétrios de Phalère 165 : en procédant de la sorte, lesAthéniens souhaitaient probablement éviter que se renouvelle un tel pullulementde statues honorifiques. En outre, cette évolution législative s’inscrirait parfaite-ment dans l’ambiance prévalant après la restauration démocratique de 307 av. J.-C.De fait, la procédure distinguait désormais deux catégories d’individus dans lacourse aux honneurs : d’une part, les citoyens athéniens, qui n’étaient plus enmesure de briguer les récompenses suprêmes avant 60 ans, et, d’autre part, lesbienfaiteurs étrangers, qui demeuraient éligibles à un tel privilège dès leur actiond’éclat accomplie. C’était là faire écho au changement des temps : si, à la chutedu législateur, le système démocratique avait été restauré et même raffermi sur leplan interne, en revanche, la cité ne jouissait plus de la même liberté en matièreextérieure. Sur ce terrain mouvant, Athènes devait en effet composer avec de
164 -N. LORAUX, La cité divisée..., op. cit.165 - Que ces deux moments aient été parfois confondus par les auteurs anciens estpeut-être à la source de la confusion des auteurs modernes : PLUTARQUE, Préceptes poli-tiques, 820E-F, évoque ainsi la transformation des statues de Démade en pots de chambre.3 3 8
P O U V O I R S E T S O C I É T É S U R B A I N E S
puissants « bienfaiteurs » étrangers – les diadoques et leurs proches – qu’elle devaitêtre en mesure de ménager, si besoin était, en leur décernant sur le moment leshonneurs suprêmes.
Peut-on préciser le moment probable où ces lois furent édictées ? Sans qu’ilsoit possible de trancher la question avec certitude, cette modification pourraitbien s’inscrire dans le mouvement de recodification des lois qui eut lieu en 304/3av. J.-C., peu après la chute de Démétrios de Phalère. Attestée par un décret enl’honneur d’un certain Eucharès de Konthylè 166, cette vaste entreprise fut menéeà bien par le conseil des nomothètes, remis alors au goût du jour. L’inscriptionremerciait ainsi Eucharès pour avoir veillé à la publicité des lois, les inscrivant defaçon à ce qu’elles soient accessibles « à quiconque souhaite les voir (skopein tôiboulomenôi) » et à ce que « personne n’ignore les lois de la cité » 167. Cette volontéde transparence se traduisit, au demeurant, par un extraordinaire dynamisme épi-graphique : entre 307 et 300 av. J.-C., plus de cent décrets du peuple sont attestés,parfois votés le même jour, lors d’une seule et même séance de l’Assemblée. Quelcontraste avec le règne de Démétrios de Phalère, dont la quantité des statues enbronze semble avoir été inversement proportionnelle au nombre de décrets del’Assemblée gravés sur la pierre ! Après une quinzaine d’années de tyrannie etd’oligarchie, la démocratie restaurée s’efforçait donc de renouer avec le passé démo-cratique athénien 168 : c’est dans ce contexte de contrôle populaire renouvelé quela nouvelle législation sur l’octroi des honneurs suprêmes pourrait avoir été votée.
Décidément, la cité n’est pas morte à Chéronée, ni même avec la guerrelamiaque. Loin d’être « devenue une machine à voter des statues » pour honorerservilement les puissants 169, Athènes continua à encadrer strictement l’octroi desdistinctions honorifiques durant tout le IIIe siècle av. J.-C. Pour autant, si la citéconservait la mainmise sur l’attribution des honneurs, elle devait ménager les nou-veaux chefs du monde hellénistique, quitte à les gratifier de récompenses inédites.Dès lors, un contrôle différencié se mit en place. Alors qu’à l’intérieur de la cité, lesélites athéniennes demeuraient soumises au contrôle populaire, les rois macédoniens
166 - IG II2, 487, l. 6-20. Pour un commentaire général de l’inscription, voir Syll.3, 336.167 - IG II2, 487, l. 8-10. Le décret emploie une formule qui n’était plus en usage depuisplus d’un siècle, témoignant de la volonté de renouer avec le passé démocratique dela cité. Voir à ce propos C. W. HEDRICK Jr, «Democracy and the Athenian epigra-phical habit », art. cit., p. 412-413 et les nuances apportées par Christophe PÉBARTHE,« Inscriptions et régime politique : le cas athénien », in A. BRESSON, A.-M. COCULA etC. PÉBARTHE (dir.), L’écriture publique du pouvoir, Bordeaux, Ausonius, 2005, p. 169-182,ici p. 179.168 - Voir C. HABICHT,Athènes hellénistique..., op. cit., p. 88-89 et p. 422, n. 15. C. PÉBARTHE,« Inscriptions et régime politique... », art. cit., p. 176, souligne à juste titre qu’« il estdangereux d’associer automatiquement baisse du nombre d’inscription et institutionspolitiques » ; toutefois, cet écart ne saurait relever de la simple coïncidence : si lesinscriptions étaient plutôt destinées à être vues qu’à être lues, leur multiplication sou-daine après 307 témoigne pour le moins d’un souci renouvelé de transparence, enrupture avec les restrictions d’affichage de la décennie précédente.169 - Voir à ce propos les remarques d’É. PERRIN-SAMINADAYAR, «Aere perennius... »,art. cit., p. 110. 3 3 9
V I N C E N T A Z O U L A Y
et leurs suivants furent parfois les récipiendaires d’honneurs exorbitants : après lachute de Démétrios de Phalère, Démétrios Poliorcète et son père Antigonos leBorgne furent même l’objet d’un culte civique et eurent l’insigne privilège depouvoir dresser leurs effigies auprès de celles des tyrannicides. En définitive, loinde symboliser le déclin de la culture civique, les statues honorifiques au IVe et auIIIe siècle av. J.-C. témoignent plutôt de la mutation des formes d’expression autori-sées de la supériorité sociale, articulant étroitement autonomie interne et dépen-dance relative à l’égard des rois hellénistiques : elles tiennent lieu de miroir grossis-sant des évolutions de la cité athénienne au début de l’époque hellénistique.
Ainsi le sort des statues de Démétrios de Phalère éclaire-t-il d’un journouveau un pan de l’histoire institutionnelle d’Athènes, à un moment charnièreoù la cité doit concilier son héritage démocratique, les velléités oligarchiques deson élite et la dynamique monarchique créée par la conquête d’Alexandre. Au-delà de ces aspects proprement juridiques, l’étude a également mis au jour uneculture de l’outrage auxmultiples facettes. Jetées à la mer, transformées enmonnaievoire en pots de chambre, ou encore conservées comme marques d’infamie, leseffigies de Démétrios de Phalère furent l’objet d’une gamme étendue d’offensesdont la signification n’apparaît qu’une fois réinscrite dans la longue durée. S’effor-çant d’articuler le temps court des ruptures institutionnelles et le temps long del’anthropologie, cette enquête s’inscrit donc dans une certaine façon d’écrire l’his-toire et de penser le politique.
C’est en effet cette perpétuelle oscillation entre temps court et temps long,histoire et anthropologie, politique et rituel qui a guidé l’analyse et notamment lechoix de son objet. Certes, interroger des images – les statues honorifiques – comportaitun risque, jadis souligné par N. Loraux : privilégier une vision marmoréenned’Athènes, figée hors du temps des batailles et des assemblées, arrimée à un soclerituel immuable 170. Toutefois, loin de consacrer l’ellipse du politique, les effigiesde Démétrios de Phalère sont apparues comme des objets pertinents pour penserle changement et révéler la conflictualité inhérente au politique enGrèce ancienne.De la même façon, c’est pour unir le fracas de l’événement et le murmure del’imaginaire que l’enquête s’est concentrée sur un moment précis, le règne deDémétrios de Phalère : parce qu’il fait rupture, l’événement est l’occasion d’entrevoir,à la manière d’une coupe géologique, le politique dans ses multiples articulations 171.
Vincent AzoulayUniversité Paris-Est Marne-la-Vallée
EA Phéacie/EA Analyse comparée des pouvoirs
170 - N. LORAUX, La cité divisée..., op. cit., p. 46.171 - Voir à ce propos Vincent AZOULAY et Paulin ISMARD, «Les lieux du politique dansl’Athènes classique. Entre structures institutionnelles, idéologie civique et pratiquessociales », in P. SCHMITT-PANTEL et F. DE POLIGNAC (dir.), Athènes et le politique. Dansle sillage de Claude Mossé, Paris, Albin Michel, 2007, p. 271-309, ici p. 306-309.3 4 0