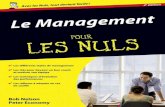"Yanomami: retour sur image(s)", in: Fondation Cartier Trente ans pour l'art contemporain, vol 2,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of "Yanomami: retour sur image(s)", in: Fondation Cartier Trente ans pour l'art contemporain, vol 2,...
237
Bruce Albert, anthropologue français, est directeur de recher-che à l’Institut de recherche pour le développement (IRD, Paris) et vice-président de Survival International France. Fervent défenseur de la cause des Yanomami du Brésil avec lesquels il travaille depuis 1975, il est l’auteur de nombreux articles et de plusieurs livres sur l’ethnographie yanomami, la situation des Indiens d’Amazonie brésilienne et l’éthique de la recherche anthropologique, dont La Chute du ciel. Paroles d’un chaman yanomami paru en 2010.
Pour la Fondation Cartier, il a été commissaire de l’expo-sition Yanomami, l’esprit de la forêt (2003) et a collaboré aux catalogues des expositions Terre Natale, Ailleurs commence ici (2008), Mathématiques, un dépaysement soudain (2011) et Histoires de voir, Show and Tell (2012).
1 Aristote, De l’âme, III, 7.
2 Au cours des années 1970, Claudia Andujar réalise la série de photographies Identidade. Entre 1973 et 1976, le territoire yanomami a été brutalement traversé par une section de la tristement célèbre route trans amazonienne, la Perimetral Norte. Claudia Andujar est par ailleurs l’auteur, avec Alvaro
Yanomami. La danse des images (trad. E. Monteiro Rodrigues, Paris, Marval, 2007).
« L’âme ne pense jamais sans images. »Aristote 1
L’exposition Yanomami, l’esprit de la forêt présentée en 2003 à la Fondation Cartier trouve son origine dans deux rencontres
(scénographique). Les rencontres, déterminantes, se sont faites autour du chiaroscuro métaphysique dans lequel la photo-graphe brésilienne Claudia Andujar a saisi l’humanité intense et vulnérable des Indiens yanomami du Brésil au seuil de leur malencontre avec ceux que le chaman Davi Kopenawa nomme « le Peuple de la marchandise », les napë pë (les « Blancs ») 2. Claudia, amie de luttes et d’aventures depuis plus de vingt ans, de passage à Paris à l’automne 2000 m’y présenta Hervé Chandès qui avait quelques années auparavant découvert son œuvre à la Biennale de São Paulo. L’entretien, d’emblée chaleureux et passionné, ne tarda pas à s’engager avec enthousiasme dans le labyrinthe baroque du chamanisme et de la cosmologie yano-mami. Une grande assemblée devait se tenir début décembre 2000 dans la communauté de Davi, située dans l’État d’Amazo-
-pagner. Nos conversations dans la grande maison collective de
(la « Montagne du vent ») prirent un tour de plus en plus effervescent, au gré du maelstrom baroque des séances de
(pata thë pë) yanomami et de la grande fête reahu qui battait son plein après avoir réuni les représentants d’une vingtaine de communautés alliées autour d’une quantité impressionnante de bananes plantains et de viande de gibier boucanée.
Une photographie prise à cette occasion par Hervé évoque parfaitement les interrogations autour desquelles tournoyaient nos débats. Cette image instaure une sorte de mise en abyme interculturelle. Elle nous donne à voir, dans l’enceinte de la vaste maison collective de , deux chamans vus de face (dont Davi Kopenawa, à droite) qui eux-mêmes présentent une image (un planisphère satellite) à un public d’autres chamans vus de dos et à l’étranger qui photographie la scène. Or, le cha-manisme yanomami consiste – dans le rêve ou la transe – à
Bruce Albert
Memoires Vives-140729-p105-248.indd 237 30/07/2014 16:58
238238
3 Voir Serge Gruzinski, La Guerre des images. De Christophe Colomb
, Paris, Fayard, 1989.
« appeler », « faire descendre » et « faire danser » l’image (utupë a) des existants tels qu’ils furent créés au « premier temps » de la création mythique. Mais dans le cliché au planisphère, c’est un type d’image bien différent que Davi fait descendre devant les siens : non plus une image du temps des origines mais une « peau d’image » ( ) du monde tel que le représentent les Blancs, rétréci aux dimensions d’un rectangle de papier. En cela, Davi met en scène une forme de chamanisme poli-tique inédit qui, pour les Yanomami, marque l’entrée dans une nouvelle forme de « guerre des images 3 ». Celles des Blancs
-gnant, depuis les années 1970, l’avancée des marchandises et des maladies. Il s’agit donc ici, pour les chamans, d’en capturer et d’en retourner la puissance pour contrer l’avancée de ceux qui les propagent sur leurs terres. En solidarité avec ce mou-vement de résistance, la photographie d’Hervé met elle-même en image cette confrontation entre imaginaire chamanique et imagerie occidentale, mais cette fois dans les termes – et à des-
Ce jeu croisé des images hantait nos conversations à et nous nous efforcions d’en faire émerger un projet
d’exposition. Pourtant, sa traduction scénographique butait sur
, décembre 2000. Photo Hervé Chandès
Assemblée générale pour la défense du territoire yanomami. Intervention de Davi Kopenawa, , décembre 2000 Photo Hervé Chandès
Memoires Vives-140729-p105-248.indd 238 30/07/2014 16:58
239239
4 Ce n’est plus le cas depuis l’introduction de certains de nos outils graphiques (papier et
années 1990, en raison de
qui a systématisé l’usage du dessin dans les nouvelles géné-rations (les dessins des décennies précédentes émanaient de quelques individus audacieux, à la demande de visiteurs Blancs). Voir les dessins de Taniki et Joseca Yanomami dans le catalogue de l’exposition Histoires de voir, Show and Tell (Paris, Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2012).
un paradoxe ethnographique qui semblait à première vue dif--
tue le centre de gravité de l’ontologie et de la cosmologie des Yanomami, les images chamaniques ne font chez eux l’objet
qu’il soit 4. Paradoxe apparent, donc, d’une culture focalisée sur les images chamaniques mais pour qui l’iconicité n’a guère d’intérêt et qui ne conçoit que des images « invisibles », ou du moins réservées à la vision des « gens esprits » (les chamans)
(kuapora thë pë).
Bruce Albert, , décembre 2000. Photo Hervé Chandès
Extase d’un apprenti chaman à Toototobi, 1981Photo Bruce Albert
Joseca Yanomami, (« l’esprit anaconda et ses gendres »), 2002 Dessin au feutre sur papier
Memoires Vives-140729-p105-248.indd 239 30/07/2014 16:58
240
5 Tout existant humain ou non humain et tout objet disposent d’une telle « image » originelle (y compris les Blancs en tant que groupe : ce sont les napënapëri pë, « images primordiales des ancêtres étrangers »).
6 Cette « maison » est d’abord la poitrine du chaman au moment de l’initiation puis une maison
dans la « poitrine du ciel ».
7 Les enregistrements sonores sont également des « images de paroles », thë ã utupë.
8 Même si pour les Yano mami nos images sont aussi des utupë, les leurs sont bien plus que cela.
Ouvrons ici une brève parenthèse ethnographique. Les images chamaniques yanomami sont avant tout (mais pas seu-lement 5) celles des ancêtres à la fois humains et animaux du temps des origines. Elles constituent la « valeur de spectre » (pë në porepë) de ces êtres primordiaux, les yarori pë ou « gens gibier », et se manifestent aux chamans sous la forme d’une
-tures corporelles et d’ornements d’une aveuglante luminosité. Ces corpusculaires, sorte de quanta mytholo-giques, peuplent le monde à l’état libre, pris dans une inces-sante activité de jeux, d’échanges et de guerres qui sous-tend la dynamique des phénomènes visibles. Une fois installés, au cours de l’initiation, dans une habitation céleste associée au jeune chaman 6, ils deviennent ses « enfants », une forme appa-rentée, donc, des êtres-images originels. Ce sont alors, selon le jargon des ethnologues, des « esprits auxiliaires » (xapiri pë).
iconophilie (images sur papier ou digitales, animées ou non), représentations plastiques diverses (dessins, gravures, pein-tures, statues) ou modèles réduits (jouets et miniatures) par le même terme – utupë 7. C’est donc cette traduction première, la
et donc l’équation utupë = « image ». En réalité, ce terme ren-
l’eau ou, plus récemment, dans un miroir), à l’ombre portée ou même à l’écho (wãã utupë, « image du son »). Il se réfère égale-ment, on l’a vu, à la « valeur de spectre » des êtres du temps des origines et à leur condition « humanimale » – condition dont la mythologie décrit la perte et que le chamanisme permet de
de tout existant et, pour ce qui concerne les humains, une com-posante de la personne : la « valeur d’image » intérieure (pei në utupë), c’est-à-dire l’image corporelle miniature où siège l’énergie vitale et dont l’extraction du corps est à l’origine de la maladie, mais aussi des altérations de la pensée consciente, notamment le rêve et la transe chamanique.
Le concept yanomami d’utupë ne peut donc être réduit
d’une réalité préexistante sur un médium quelconque (simulacrum) 8. Mais il ne peut pas non plus se voir limité au registre
Memoires Vives-140729-p105-248.indd 240 30/07/2014 16:58
241
9 De récentes études d’imagerie cérébrale ont notamment démontré que l’absorption de certains hallucinogènes végétaux amazoniens comme l’ayahuasca confère aux images mentales produites une qualité absolument identique à celle des perceptions visuelles « naturelles ». Voir D. B. de Araujo et al., « Seeing with the Eyes Shut. Neural Basis of Enhanced Imagery Following Ayahuasca Ingestion », in Human Brain Mapping, vol. 33, nº 11, novembre 2012.
10 Cures, interventions cosmologiques, climatiques et écologiques diverses.
11 Voir Hans Belting, Pour une anthropologie des images, trad. J. Torrent, Paris, Gallimard, coll. « Le Temps des images », 2004.
de nos « images mentales », images mirages qui ressortissent tout autant de la représentation analogique mais, cette fois, intérieure (phantasma). De fait, les images utupë des êtres primordiaux décrites par les chamans avec un grand luxe de précisions esthétiques, le sont d’abord à titre de perceptions directes d’une réalité extérieure considérée comme absolument tangible (le « voir » est ici authentiquement un « connaître ») 9. Par ailleurs, elles sont données à voir et à entendre à travers les chorégraphies et les chants associés à chacun des êtres-images primordiaux que les chamans convoquent tour à tour au cours de leurs sessions, individuelles ou collectives 10. Aux yeux des « gens ordinaires », les chamans sont ainsi de véritables « corps conducteurs » traversés, à titre de supports vivants, par la ligne de fuite des êtres-images revenus du temps des origines. Il ne s’agit donc pas, dans le chamanisme yanomami, de « mettre en scène » ces êtres-images primordiaux mais de les faire adve-nir au monde visible, de rendre leur présence manifeste à tra-vers la « prise de corps » qu’instaure la transe chamanique. Ce « devenir-image » des chamans n’est donc pas ici affaire de mimesis ou de représentation mais, au contraire, de trans-
« corps-images ».Les images non iconiques des chamans yanomami – évé-
nements à la fois visuels et ontologiques, corporels et cosmo-logiques – ne peuvent qu’ébranler notre conception de l’image à la fois sous-tendue par l’opposition platonicienne entre eidos (forme vraie) et eikôn/eidôlon (reproduction, faux-semblant) et indissociable des supports par lesquels elle est proposée aux regards (parois, panneaux, toiles, papiers, plaques, écrans) 11. Ce retour ethnographique sur le « paradoxe » des images yano-mami nous enseigne donc que celui-ci relève avant tout d’un malentendu conceptuel produit par l’anamorphose réciproque de regards culturels dissonants. C’est à partir de la mise au clair de cette équivoque croisée que s’est construit le projet de l’exposition Yanomami, l’esprit de la forêt et c’est à par-
peu pris forme. L’exposition a donc été inventée – avec l’aide indéfectible de Davi Kopenawa – comme un dispositif expé-rimental qui ferait travailler la discordance culturelle entre « image » et utupë par le biais de la « mise en regard » d’un
Memoires Vives-140729-p105-248.indd 241 30/07/2014 16:58
242
12 Voir le texte d’introduction au catalogue de l’exposition Yanomami, l’esprit de la forêt (Paris, Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2003).
13 Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, p. 290.
ensemble d’artistes internationaux et d’un groupe de chamans yanomami de 12. Le pari de cette confrontation trou-vait son prétexte dans la prise au mot de la célèbre remarque de Claude Lévi-Strauss sur l’art comme dernier espace protégé de la « pensée sauvage » de notre société 13. Pourtant, malgré la légitimité et la productivité attendue de cette confrontation, il ne s’agissait en aucun cas d’y assimiler artistes et chamans, ni d’expliquer ou même de traduire une « différence culturelle », mais, au contraire, de donner à voir et à éprouver, à travers l’association libre d’un ensemble d’images, le jeu d’une irré-ductibilité de pensée.
Quelques-uns des artistes pressentis avaient déjà travaillé avec les Yanomami au Brésil (Claudia Andujar et Volkmar Ziegler) ou au Venezuela (Lothar Baumgarten), d’autres (Vincent Beaurin, Tony Oursler et Naoki Takizawa) produi-sirent leurs œuvres à partir de textes de Davi Kopenawa, de
Davi Kopenawa, Raymond Depardon et Lourival, , 2002Photo Bruce Albert
, 2002. Photo Bruce Albert
Stephen Vitiello enregistrant les sons de la forêt, 2002Photo Bruce Albert
Gary Hill sous l’effet de la poudre yãkoana, entouré de chamans, , 2002. Photo Bruce Albert
Memoires Vives-140729-p105-248.indd 242 30/07/2014 16:58
243
vidéos tournées sur place par Geraldo Yanomami et de des-
séjour et d’une rencontre directe dans la grande maison yano-mami de (Raymond Depardon, Gary Hill, Wolfgang Staehle, Adriana Varejão et Stephen Vitiello). La présence de chacun de ces artistes successivement « en résidence » auprès des chamans yanomami avec qui ils travaillèrent étroitement, donna lieu à des rencontres mémorables. Qu’il me soit permis d’en évoquer ici quelques souvenirs marquants.
réunions studieuses que tinrent les chamans yanomami avec Adriana Varejão, réunions consacrées à examiner avec un soin
Dessinateurs yanomami au travail, , 2002. Archives Adriana Varejão
Adriana Varejão, , 2002. Archives Adriana Varejão
Memoires Vives-140729-p105-248.indd 243 30/07/2014 16:58
244
14 Les offrandes de gibier et l’exhibition de parures de plumes sont les instruments privilégiés de la galanterie et de la séduction yanomami.
15 Voir R. Murray Schafer, Le Paysage sonore. Le monde comme musique, trad. S. Gleize, Paris, Wildproject, coll. « Domaine sauvage », 2010, et Bernie Krause, Le Grand Orchestre animal, trad. T. Piélat, Paris, Flammarion, 2013.
prises toutes les 3 secondes durant 24 heures.
17 Les Yanomami disent que les humains ne peuvent voir les êtres-images (les esprits xapiri pë) – et ainsi devenir chamans – que si ceux-ci les regardent déjà. L’expression « observation forte » est empruntée au titre de l’article de Peter Sloterdijk dans le cata-logue de l’exposition Terre Natale, Ailleurs commence ici (Paris, Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2008), p. 93.
et céramiques cannibales – comme autant d’images oniriques në wãri pë) qu’ils s’efforçaient
temps, des groupes de jeunes gens yanomami, sous le charme de leur visiteuse, s’activaient joyeusement en lui proposant, comme en une grande chasse imaginaire, les centaines d’images d’oiseaux et d’autres animaux de la forêt qu’ils avaient décidé de dessiner pour elle 14. Je me souviens aussi de nuits passées à tituber en forêt avec de jeunes chasseurs espiègles, pour accom-pagner Stephen Vitiello qui enregistrait l’entrée en scène musi-cale des animaux de la forêt du crépuscule à l’aube – saisie en continu de l’image nocturne d’un « paysage sonore » dont nos guides nous déchiffraient la composition et nommaient tour à tour les acteurs avec une extraordinaire précision 15. Je conserve également de non moins joyeux souvenirs de nos équipées acro-batiques avec Wolfgang Staehle pour installer ses caméras au sommet de la « Montagne du vent » de , demeure des esprits chamaniques xapiri pë, comme s’il cherchait à y émuler, sur le mode digital d’un espace-temps iconique hyper-réel 16, le regard-image excentrique des non-humains – l’« observation forte » des esprits – sur la maison collective des hommes située en contrebas 17. Mais me restent surtout en mémoire avec une vivacité particulière, par leur exemplarité dans la mise en actes du jeu des images entre nos deux mondes, deux moments clés de notre expérience à , l’un avec Raymond Depardon et l’autre avec Gary Hill.
Dès son arrivée à , Raymond suscita chez Lourival Yanomami, le « grand homme » de la maison et beau-père de Davi Kopenawa, une curiosité particulière. Enjoué et hospita-lier, Lourival était cependant toujours très ironique, voire fran-chement moqueur, envers les Blancs, qu’il ne prenait guère au sérieux. Son intérêt et son amitié pour Raymond étaient donc peu habituels. Je me rendis compte rapidement qu’il l’avait élu, en raison de son âge et de sa gravité respectueuse, comme l’in-terlocuteur privilégié d’un pacte autour des images que notre équipe devait ramener de . Lourival énonça d’emblée ce pacte en des termes on ne peut plus clairs : « Nous n’aimons pas que les étrangers prennent nos images pour les emmener au loin, c’est vrai, car lorsque nous mourrons elles ne pourront
Memoires Vives-140729-p105-248.indd 244 30/07/2014 16:58
245
18 Le voyage du spectre d’un défunt vers le « dos du ciel » ne peut avoir lieu que si toutes les « traces » (õno ki) – nom, possessions, empreintes – laissées de son vivant ont été effacées par le rituel funéraire (« manger les traces »). Dans le cas contraire le mort, attiré par ces supports de nostalgie, ne cessera de hanter les vivants.
19 On retrouve les termes de ce « pacte des images » dans le témoignage de Davi Kopenawa « Gens de près, gens de loin » publié en ouverture du catalogue de l’exposition Yanomami, l’esprit de la forêt, op.cit.
20 Raymond Depardon et Claudine Nougaret, Chasseurs et Chamans, 2002.
21 Voir Bruce Albert, « Territo-rialité, ethnopolitique et dévelop-pement durable. À propos du mouvement indien en Amazonie brésilienne », in Cahiers des Amériques latines, nº 23, 1997.
être brûlées 18 ! Pourtant, toi qui es comme moi un grand ancien,
qui deviennent esprits ! Nous le ferons pour que tu les fasses connaître aux tiens et aux autres gens de loin car nous voulons qu’ils nous aident à défendre notre forêt contre les Blancs man-geurs de terre qui, ici, veulent la détruire 19 ! » Ce contrat moral et politique entre les deux hommes a sous-tendu le tournage
Chasseurs et Chamans et sa diffusion 20. Il manifeste la volonté des Yanomami d’exercer un droit de regard sur leurs images, mais surtout, d’être partie prenante de leur « mise en exposition » en quête d’une reconnaissance internationale qui leur permette de contrebalancer un rapport de forces local très défavorable face aux grands éleveurs et aux chercheurs d’or. Malgré la fragilité de cette stratégie à long terme 21, le capital symbolique de ces images données offre, aujourd’hui encore, une garantie fondamentale de la protection de leur territoire.
Hanté par une joviale et infatigable curiosité, Gary par-courait quant à lui jour et nuit, une petite caméra vidéo à la main, les foyers de la grande maison collective de , en discourant avec ses habitants dans un idiolecte improvisé et volubile qui les amusait énormément. Il fréquentait aussi avec assiduité toutes les séances chamaniques qui s’y déroulaient, fort impatient de s’initier aux effets de la yãkoana, la poudre
-lardement dans les narines à l’aide d’un long tube de canne à
ancien chaman de , de prendre en charge cet inattendu novice blanc et le priai de réduire la dose au minimum. Il m’as-
l’éclat facétieux de son regard. De fait, à peine Gary s’était-il accroupi dans le cercle des chamans pour tendre ses narines
-sant une énorme dose de yãkoana dans les sinus. Sous l’impact
demeura étendu sur le dos, totalement inconscient. Alors, avec une totale indifférence à mes manifestations d’inquiétude, les chamans reprirent de plus belle leur session collective. Mais ils la centrèrent, cette fois, autour du corps étendu de cet étran-ger (napë aleurs chants et leurs chorégraphies de plus en plus intenses, ils
Memoires Vives-140729-p105-248.indd 245 30/07/2014 16:58
246
22 La défense des droits territoriaux yanomami sur la scène politique interethnique urbaine est toujours sous-tendue par une lutte cosmopolitique menée par les chamans depuis leurs communautés en forêt. Le chamanisme yanomami fait souvent usage de cette homéo-pathie symbolique : image des ancêtres des Blancs contre les Blancs actuels, image des
contre leurs beaux-pères, image de l’épidémie contre les épidémies…
23 Accompagné de l’artiste Joseca Yanomami et du professeur Dário Yanomami, en mai 2003.
ancêtres des Blancs (les napënapëri pë). Puis leur transe exu-bérante prit rapidement la forme d’une intense bataille chama-nique contre les Blancs actuels (les napë pë) pour défendre la « terre-forêt des êtres humains » (yanomae thë pë urihipë), le territoire yanomami 22. Dans cet opéra ethnopolitique, Gary Hill – étranger bienveillant venu des lointains – s’était vu associé, en tant qu’« embrayeur » chamanique, aux ancêtres mytho logiques
Omama à partir du sang des anciens yanomami. Initialement objets passifs des images vidéo d’un artiste étranger, les chamans de
avaient retourné la situation et inversé le regard de la caméra en capturant son détenteur, initiant inopiné, dans leur
-mopolitique. Cette scène inédite de video art chamanisé offrait ainsi une version inverse mais complémentaire du « pacte des images » en défense de la forêt scellé par Raymond Depardon. Dans un cas les Yanomami, malgré leur réticence traditionnelle, se donnaient en images au cinéaste pour mobiliser la solidarité de Blancs lointains dont il était l’éminent représentant. Dans l’autre, c’est le vidéaste évanoui, « devenu spectre », qui servait de référent à la mobilisation des images d’ancêtres étrangers dans un combat chamanique contre les Blancs locaux « man-geurs de forêt » (urihi wapo pë). Dans les deux situations mais en chiasme, travaillaient ainsi entre artistes et chamans le malen-tendu productif des images et le pacte de solidarité politique qui étaient à l’origine de l’exposition.
Cet effet croisé, s’il a marqué avec intensité les rencontres de , s’est également prolongé à Paris durant la visite de Davi Kopenawa pour l’ouverture de l’exposition 23. L’aisance et la précision de ses commentaires sur les œuvres exposées
oculaires géants de Tony Oursler, intrication de miroirs de Naoki Takizawa et énigmatiques objets scintillants de Vincent Beaurin) surprirent tant que certains journalistes s’efforcè-rent de l’interviewer en me tenant ostensiblement à distance,
qu’ils supposaient ne pouvoir être qu’une mise en scène. Cette vocation improvisée de critique d’art à la volée n’empêchait pourtant jamais Davi de conclure ses conversations avec ses
Memoires Vives-140729-p105-248.indd 246 30/07/2014 16:58
247
24 Xapiri thë ã oni. Palavras escritas sobre os xamãs Yano mami (« Paroles écrites sur les chamans yanomami »), São Paulo, Instituto Socioambiental en partenariat avec l’association yanomami Hutukara, 2014.
25 Projet mené à bien avec François-Michel Le Tourneau, directeur de recherche au CNRS, auteur de l’ouvrage Les Yano mami du Brésil. Géographie d’un territoire amérindien (Paris, Belin, coll. « Mappemonde », 2010).
interlocuteurs, artistes, conservateurs ou journalistes, en mar-quant toujours la différence, malgré leur air de famille, entre « mise en image » et « devenir image », entre la production de nos images artefacts et la convocation des êtres-images cha-maniques, entre art et cosmopolitique : « Les artistes rêvent presque comme nous, chamans, mais leurs rêves sont autres. Ils deviennent comme des peaux d’images à regarder. Nous, nous faisons danser les images des ancêtres animaux du pre-
sition Yanomami, l’esprit de la forêt, il faut de nouveau sou-ligner tant son caractère expérimental que la pérennité de sa démarche. De fait, non seulement la mise en travail de ses effets interculturels a précédé, comme on l’a vu, le moment de sa présentation scénographique proprement dite, mais elle s’est encore poursuivie bien au-delà. De fait, la dynamique engagée par ce projet a continué de se propager depuis une décennie comme une onde de choc subreptice, tant au Brésil qu’en France, et même ailleurs. Sur place, le séjour des artistes et le vis-à-vis des images se sont enracinés dans le travail pictural de Joseca Yanomami, dont les dessins chamaniques sont, avec ceux de Taniki, revenus à la Fondation Cartier pour l’expo sition Histoires de voir, Show and Tell (2012). Ils se sont également répercutés sous la forme de différents projets auto- ethnographiques menés par de jeunes professeurs yanomami qui éditent aujourd’hui des recueils de textes et de dessins sur le chamanisme, comme Xapiri thë ã oni 24, illustré par Joseca et accompagné d’un CD (Xapiripru, « Devenir chaman ») de chants chamaniques de Davi Kopenawa, Levi et Taniki Yanomami ainsi que d’un DVD de Morzaniel Yanomami (Urihi haromatima pë, « Les guérisseurs de la forêt »). Par ailleurs, la Fondation Cartier a soutenu, parallèlement à l’exposition, la mise en œuvre d’un projet de recherche ethnogéographique réalisé à partir d’images satellite qui s’est, depuis lors, pro-
territoriale avec l’association yanomami Hutukara et l’ONG brésilienne Instituto Socioambiental 25.
Raymond Depardon est revenu chez les Yanomami pour Donner la parole, réalisé avec Claudine
Memoires Vives-140729-p105-248.indd 247 30/07/2014 16:58
248
26 Ces photographies accom-pagnent un texte sur la cosmo- territorialité yanomami : Bruce Albert, « Terre Natale : vues d’ailleurs », in Terre Natale, Ailleurs commence ici, op. cit, p. 145-159. Voir également le livre de Raymond Depardon Donner la parole (Paris, Fondation Cartier pour l’art contemporain / Göttingen, Steidl, 2008), qui
les témoignages en yanomami, français et anglais de Davi Kopenawa, Lourival et Rai mundo Yanomami ainsi que de trois jeunes femmes de , Anita, Ehuana et Salomé.
27 Paris, Plon, coll. « Terre humaine », 2010 ; récemment traduit en anglais sous le titre The Falling Sky. Words of a Yanomami Shaman (trad. N. Elliott et A. Dundy, Cambridge, Harvard University Press, 2013).
28 Acte dû au compositeur brésilien Tato Taborda et au dramaturge allemand Roland Quitt. Créé à l’initiative du sociologue brésilien Laymert Garcia dos Santos, cet opéra multimédia a été présenté entre 2010 et 2013 à Munich, São Paulo, Rotterdam et Vienne. Voir arte.tv/fr/amazonie-un-theatre-musical-en-trois-actes/ 3142756.html.
29 Film produit par l’Instituto Socioambiental de São Paulo et la Cinémathèque brésilienne, réalisé par Leandro Lima et Gisela Motta (images), Laymert Garcia dos Santos, Stella Senra et Bruce Albert (argument et direction). Voir vimeo.com/ 79411469.
30 Voir « Le Mathématicien et le Chaman, les yeux fermés. Entretien entre Cédric Villani, Davi Kopenawa, Bruce Albert et Michel Cassé », in Mathé matiques, un dépaysement soudain, Paris, Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2011, p. 44-51.
Nougaret dans le cadre de l’exposition Terre Natale, Ailleurs commence ici (2008) dont le catalogue, à travers une nouvelle série de photographies, fait écho dans une intimité généreuse et nostalgique à l’exposition de 2003 et à la rencontre du pho-tographe avec Lourival, le « grand homme » de 26. Un chapitre du catalogue Yanomami, l’esprit de la forêt est devenu un livre co-écrit par Davi Kopenawa et moi-même : La Chute du ciel. Paroles d’un chaman yanomami 27. Ce livre nous a ensuite amenés à participer à la conception et à la mise en forme d’un opéra multimédia : Amazonas. Music Theatre in Three Parts, dont le deuxième acte, A queda do céu, est en grande partie inspiré par la cosmologie et la conception des images chamaniques yanomami 28 Xapiri a suivi, tourné au cours de deux grandes rencontres de chamans organisées à en mars 2011 et avril 2012 à l’initiative de Davi Kopenawa et de l’association yanomami Hutukara 29.
-tiques, cette fois) s’est poursuivie à Paris dans un dialogue aussi inattendu que fertile avec Cédric Villani et Michel Cassé dans le cadre de l’exposition Mathématiques, un dépaysement soudain (2011) 30. Depuis lors, un réseau d’initiatives continue à se développer autour des images chamaniques yanomami : ren-contres et expositions d’artistes amérindiens, vidéos et recueils auto-ethnographiques, études anthropo logiques sur la mytho-logie et livres de dessins… Ainsi « l’esprit de la forêt » conti-
et vigueur, entre les chamans yanomami et la Fondation Cartier, entre la maison de la Montagne du vent de et la mai-son de verre du boulevard Raspail.
Paris, mai 2014
Memoires Vives-140729-p105-248.indd 248 30/07/2014 16:58