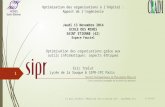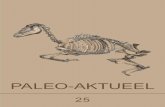Approche comportementale de la dispersion larvaire en milieu ...
Werlé (Maxime). - Strasbourg. Le poêle du Constofel de Saint-Thomas (milieu 14e-milieu 15e s.)....
-
Upload
culturecommunication-fr -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Werlé (Maxime). - Strasbourg. Le poêle du Constofel de Saint-Thomas (milieu 14e-milieu 15e s.)....
1. Demeure connue sous les appellations « châteaude Belvès » et « hôtel de Commarque », forgées sem-ble-t-il au XXe siècle et sans fondement précis (Inscr.M. H., 1948).
2. François Dequesne.
3. Alain de La Ville.
4. À la demande de C. Cione, des prélèvements et desanalyses physico-chimiques ont été effectués en 2011,qui complètent notre connaissance de l’état matérielet de la mise en œuvre de ces peintures.
5. Selon une tradition forgée à une époque incertaine,Clément V aurait acheté cette seigneurie, acquisitionconfirmée par son neveu Arnaud de Canteloup quilui succéda sur le trône archiépiscopal. Cette version,exaltante pour Belvès, n’a pas de fondement histo-rique et la suzeraineté du prélat sur Belvès est anté-rieure : A. Vigié, « Histoire de la châtellenie deBelvès », Bull. Soc. Hist. Arch. Périgord, 1901, p. 188-196.
6. Archives historiques du département de la Gironde,Bordeaux, 1883, t. XXIII, p. 315
7. P. Garrigou Grandchamp, « Introduction àl’architecture domestique en Périgord aux XIIIe etXIVe siècles », Congr. arch. de France. Périgord, 1998,p. 34-35 : Belvès, 1.
8. Noir de carbone/noir de vigne, terre verte, ocres.
9. Chr. Leduc-Gueye, D’Intimité, d’Éternité. La pein-ture monumentale en Anjou au temps du roi René,Lyon, 2007, p. 161-165.
10. H. Fisquet, La France pontificale (GalliaChristiana). Histoire chronologique et biographique desarchevêques et évêques de tous les diocèses de France,Bordeaux-Paris, 1867, t. 5, p. 254-255.
11. En dernier lieu, J. Favier (dir.), Un rêve de cheva-lerie. Les Neuf Preux, Paris, 2003. Je tiens à remercierNicolas Civel pour son aide et la communication deson mémoire, Les Neuf Preux et leurs armoiries : un casd’héraldique imaginaire, université Paris X-Nanterre,1995.
12. Ici, une harpe d’or est présente sur le caparaçon.
13. Derrière David, C. Cione croit discerner un visageet l’espace y est en effet suffisant pour l’accueillir.
14. Sur le bouclier : d’azur, au lion d’or, assis sur unechaise de pourpre [ou de gueules] et tenant avec lespattes une hallebarde. On ne peut vérifier s’il est arméet lampassé et la hallebarde d’argent et emmanchéed’azur.
15.D’argent à une croix d’or potencée, à 3 croisettes d’orpotencées sur le caparaçon, ainsi qu’un sceptre fleurde-lisé, également sur le caparaçon.
16. Parti d’Empire [et de France] sur le plastron.
17. D’or, à l’aigle double, éployée de sable, [becquée,membrée de gueules] sur le plastron.
18. Vierge [et trois couronnes, 2 et 1, la Vierge sortant dela dernière] sur le caparaçon. On ne voit plus que laVierge à l’Enfant.
19. Basilic de sable sur le caparaçon.
20. Deux oiseaux (merlettes ?) de sable sur le bouclier.
21. Vers 1570-1580.
22. Début du XVIe siècle.
23. Seules exceptions, Josué et Judas Macchabée, figu-rés sur le mur opposé. À ce sujet, Nicolas Civel (op.cit. note 11, p. 127, 134, 136) précise qu’ils sont lesseuls Preux à posséder parfois une dimension presquenégative, rendue notamment par le choix de leursarmoiries. Ici, leur désolidarisation du groupe peutexprimer cette dévalorisation relative.
24. Sur ce point, je souhaite vivement remercier pourleur aide précieuse Olivier Renaudeau et ChantalVigouroux (Musée de l’Armée, Département Ancien).
25. N. Civel, op. cit. note 11, p. 68.
26. A. Marin (dir.),Maison dite « des Dames de la Foi »(Périgueux, 24), Bordeaux, 2011.
Bas-Rhin
Strasbourg. Le Poêle du Constofelde Saint-Thomas (milieu XIVe-milieuXVe siècle).
Une étude archéologique du bâti,menée pour l’essentiel en 2008 à l’occasiond’importants travaux de réhabilitation d’unimmeuble sis au 2, place Saint-Thomas àStrasbourg, a permis d’y reconnaître lesiège d’un ancien Constofel. Ce terme dési-gnait, au Moyen Âge, des groupements de
quartier. Les poêles (Stuben) étaient pourleurs membres les lieux des réunions, desbanquets et du ralliement. Le poêle duConstofel de Saint-Thomas est le premierétudié à Strasbourg, offrant l’occasion d’enappréhender les caractéristiques architec-turales et le mode de fonctionnement.
Les Constofel à Strasbourg de la findu XIIIe au milieu du XVe siècle. Ces insti-tutions ont été créées à Strasbourg à la findu XIIIe siècle, probablement à l’initiativedu Conseil, pour participer à la consolida-tion de la paix urbaine qui, jusqu’alors,dépendait du seul droit féodal 1. Il en exis-tait quinze en 1306. Il s’agissait de cir-conscriptions militaires et fiscales, quipermettaient l’encadrement des hommesen état de porter les armes au sein de lamilice strasbourgeoise. Leurs membresétaient recrutés sur la base de leur résidencedans un quartier. Les Constofel n’étaientinitialement pas limités à une catégoriesociale : ils constituaient au contraire ungroupe résiduel, dans lequel se trouvaientréunis ceux qui n’appartenaient pas à unmétier, lesquels avaient commencé à seconstituer en organisations indépendantes.L’insertion croissante de la populationdans les corporations au cours du XIVe
siècle convertit peu à peu les Constofel en
51
Act
ualit
é
Fig. 1 - Strasbourg, 2, place Saint-Thomas, localisation de l’immeuble étudié (dessin M. Werlé, surfond de plan cadastral).
associations à majorité patricienne, réunis-sant des nobles d’une part, des bourgeoisappartenant aux milieux des affaires (ban-quiers, marchands et propriétaires d’outilsde production) d’autre part. Cependant, lepatriciat aristocratique de la ville acquitune position de plus en plus écrasante ausein des Constofel, les membres du milieudes affaires ayant été rejetés vers les corpo-rations. Ce processus, qui s’inscrit dans lecadre des luttes pour le pouvoir àStrasbourg au XIVe siècle, a généré un dur-cissement du climat politique et social :peu à peu, le patriciat noble se concentrade plus en plus sur son propre réseau defidélités féodales et devint étranger auxintérêts communaux.
Les poêles (Stuben) étaient les sièges desConstofel. Ils tiennent leur nom de la pièceessentielle de ces maisons : une grande sallechauffée par un poêle (ou Stube). Ils occu-paient pour les patriciens une place com-parable aux Trinkstuben pour l’artisanatsalarié, qui les tenait pour des symboles del’identité corporative ou professionnelle 2.Les poêles des Constofel, dont les membres
avaient peu à peu pris le nom de Constofler,étaient à ce titre le foyer de l’identitécollective. Lieux de réunion, de repas, defêtes et de ralliement en cas de guerre,d’émeute et d’incendie, ils étaient aussi unlieu de sociabilité où se formait l’opinionpolitique. En plus des membres des patri-ciats noble et bourgeois, ils réunissaient lesmembres ecclésiastiques d’une paroisseet/ou d’un chapitre collégial, ainsi quequelques nobles ruraux. Les poêles dupatriciat avaient acquis une existence poli-tique propre : c’est en leur sein qu’était éluela représentation patricienne au Conseil. Lenombre de poêles du patriciat, estimé àsept après 1332, fut ramené à six en 1362,puis à cinq en 1407. Vers le milieu desannées 1440, trois poêles furent dissouscoup sur coup, de sorte qu’il n’en restaitplus que deux, celui de la Meule(Mühlstein) et celui de la Haute-Montée(Hohensteg).
Le Constofel de Saint-Thomas et sonpoêle dans les sources écrites. L’originedu Constofel du quartier de Saint-Thomas(St Thoman societati), qui figure parmi lesquinze mentionnés en 1306, remontepeut-être à la fin du XIIIe siècle. On ignoretout du lieu de réunion primitif et de sonemplacement ? Occupait-il occasionnelle-ment une maison mise à sa disposition parun de ses membres ? S’agissait-il plutôtd’un immeuble loué, acheté ou édifié àcette fin ? L’emplacement de la parcellen° 2 de la place Saint-Thomas a été identi-fié, depuis le dernier tiers du XIXe siècle,comme l’ancien siège du Constofel deSaint-Thomas à partir de la fin du XIVe siè-cle (fig. 1). Ce dernier est en effet men-tionné dans les sources écrites à proximitéde l’église Saint-Thomas depuis les années1370 (Trinkstube bi sant Thoman en 1374 ;Trinkstube der Gesellschaft zu S. Thoman,gelegen in dem Kirchhof zu S. Thoman en1378) 3. Le chroniqueur Jacob Twinger deKoenigshoven rapporte que ce poêle fut lethéâtre, en 1374, d’une rixe entre les mem-bres des familles patriciennes des Rebstocket des Rosheim, au cours de laquelle troismembres de la famille des Rosheim suc-combèrent 4. Encore mentionné en 1442(stuba armigorum), le Constofel de Saint-Thomas compta parmi les trois poêles dis-sous vers 1445. En 1454 sont mentionnés
« la maison, la cour et la grange qui étaientpar le passé un poêle près de l’église Saint-Thomas » (Hus, Hof und Schüre das vorZiten was ein Drinkstube bi der Kirche vonSt. Thoman), puis, en 1466, « l’ancienpoêle de Saint-Thomas » (die alte Stube vonSt. Thoman).
Lepoêle duConstofelde Saint-Thomasrévélé par l’archéologie. Après la dissolu-tion du Constofel, vers 1444, l’immeublefut affecté à une fonction d’habitation. Il afait l’objet, jusqu’à nos jours, de nom-breuses campagnes de transformation et demodernisation. Peu à peu, le souvenir deson origine médiévale et de l’institutionqu’il avait abritée s’est estompé, de sorteque le poêle du Constofel de Saint-Thomasa littéralement été redécouvert par l’étudearchéologique du bâti. Celle-ci a permisd’identifier les éléments pouvant être attri-bués à son état primitif et de les dater pardendrochronologie de 1348 ou d’uneannée postérieure très proche 5. Elle a, infine, montré le caractère exceptionnel etatypique de cette construction.
L’immeuble s’apparente extérieure-ment, au premier coup d’œil, à une mai-son en pan-de-bois, présentant son murgouttereau sur la place (fig. 2). De planquadrangulaire compact (14,25 x 11,35 mdans les axes au rez-de-chaussée), il com-porte un rez-de-chaussée de plain-pied etun seul étage, sous une haute toiture à deuxversants 6. Il a été édifié entre des immeu-bles mitoyens qui lui sont en partie anté-rieurs (fig. 3) ; l’un d’eux, au sud, étaitpourvu d’un pignon à redents en briques(fin du XIIIe-première moitié du XIVe siècle)[fig. 9]. À l’exception du mur donnant surla place Saint-Thomas au rez-de-chaussée,édifié en briques, le bâtiment a essentielle-ment été construit en pan-de-bois. Cechoix constructif a permis de ménager desencorbellements dans les façades sur rue etsur cour, saillant respectivement de 0,90 met de 1,10 à 1,30 m (fig. 8 et 9). Très peude vestiges des élévations primitives ont étérepérés dans les façades antérieure et pos-térieure. Tout au plus peut-on signaler, àl’étage, dans la façade sur cour, le poteaud’angle nord-est : il présente une réserva-tion pour un gousset (disparu) assemblé àmi-bois en demi queue-d’aronde. Dans la
52
Act
ualit
é
Cl. M. Werlé.
Fig. 2 - Strasbourg, 2, place Saint-Thomas, vuede la façade principale de l’immeuble depuis lenord-ouest.
façade sur rue, le pan-de-bois de l’étage aquant à lui été entièrement reconstruit auXVIIIe ou au début du XIXe siècle.
Le rez-de-chaussée, initialement hautde 5,20 m, constituait un espace indivislargement ouvert sur l’espace arrière decour : il s’apparentait, dans une certainemesure, à une halle couverte, rythmée parles quatre puissants poteaux en chêne sup-portant le poids du plancher de l’étage etde la toiture (fig. 3). Deux d’entre euxtenaient lieu de support de la façade arrière,tandis que les deux autres recevaient en leurcentre la charge des poutres transversalessoulageant les solives de plancher de l’étage.Ce niveau abritait par ailleurs, peut-être dèsl’origine, un puits appareillé en grès, pro-fond de 6,60 m (fig. 4) 7.
L’étage, mesurant 15,85 x 11,85 mdans les axes, était occupé par une seulegrande salle de près de 188 m² (fig. 5). Il afait l’objet d’un traitement particulier dupoint de vue des aménagements de confortet de son décor. En premier lieu, le sol estcaractérisé par un souci d’isolation, vrai-semblablement dû au fait que le rez-de-chaussée était largement ouvert surl’extérieur. Il s’est manifesté par la mise enœuvre d’un parquet constitué de planchesclouées sur des lambourdes (déposées avantl’intervention archéologique), elles-mêmesposées sur l’aire de planches sous-jacente etchevillées dans les solives de plancher del’étage. L’espace entre les lambourdes était
53
Act
ualit
é
Fig. 4 - Strasbourg, 2, place Saint-Thomas,rez-de-chaussée, élévation en déroulé du conduitdu puits (XIVe siècle) [dessin M. Werlé].
Fig. 3 - Strasbourg, 2, placeSaint-Thomas, plan durez-de-chaussée, restitutionde l’état primitif de l’im-meuble édifié vers 1348 etindication des états anté-rieurs, avec projection ausol du plancher de l’étage(dessin M. Werlé).
Fig. 5 - Strasbourg, 2, placeSaint-Thomas, plan del’étage, restitution du plan-cher primitif (vers 1348)[dessin M. Werlé].
Fig. 6 - Strasbourg, 2, placeSaint-Thomas, plan del’étage, avec projection ausol des entraits de charpenteet du plafond lambrissé :vestiges de l’état primitif (vers1348) [dessin M. Werlé].
rempli de mortier, dans lequel étaientnoyés des fragments de briques. Afind’éviter la chute de particules au rez-de-chaussée, des tasseaux en sapin (59 x 4,5-8
x 0,2-0,5 cm) avaient préalablement étéposés à la jonction entre les planches, pourassurer le rôle de couvre-joints. Le soucid’isolation s’étendait également aux murs
et au plafond, presque entièrement lam-brissés (fig. 6 à 9). Les lambris de stylegothique, ornés de lancettes trilobées, ontété partiellement conservés. Ces aménage-ments spécifiques indiquent que cettegrande salle correspondait à la Stube, c’est-à-dire à la salle de réunion du Constofel. Ilest possible que celle-ci ait été chauffée parun poêle (Kachelofen) en saison froide. Ilimporte toutefois de souligner que l’étuden’a pas permis de recueillir d’indices relatifsà l’emplacement du poêle, ni à celui del’accès à la salle. Tout au plus peut-onsignaler la présence d’un petit espace (6m²), initialement cloisonné dans l’anglesud-est de la pièce, qui pourrait avoiraccueilli des équipements de chauffageet/ou constitué un vestibule d’entréedepuis un escalier placé à l’extérieur.
Il est particulièrement remarquable quel’étage ne comporte aucun support internesusceptible de reprendre la charge de la toi-ture : la portée des entraits de charpente,qui constituent le plafond de l’étage,atteint en effet près de 16 m (fig. 10). Ils’agit là manifestement d’une prouesse decharpenterie, exceptionnelle dans ledomaine de la construction civile médié-vale. L’explication réside dans le fait que lesentraits, et donc le plafond lambrissé del’étage, sont littéralement accrochés à deuxpoutres longitudinales au moyen d’agrafesen fer. Ces poutres sont elles-mêmes sus-pendues aux chevrons arbalétriers par l’in-termédiaire de tirants. La toiture, haute deprès de 12 m et de cinq niveaux de comble,paraît n’avoir été initialement dévolue àaucune fonction particulière.
Quels apports pour l’histoire desConstofel à Strasbourg ? L’étude archéo-logique révèle, en somme, un immeubledont la raison d’être paraît résider presqueentièrement, depuis sa construction vers1348 jusqu’à sa désaffectation au milieudes années 1440, dans l’accueil de la sallede réunion du Constofel. Sous l’apparenced’un bâtiment en pan-de-bois sommetoute modeste, assez éloignée de l’imageque l’on aurait pu se faire du siège d’ungroupement patricien, l’immeuble abriteen effet à l’étage une vaste Stube lambris-sée, couverte par un plafond suspendu à sacharpente. Il n’est pas impossible que des
54
Act
ualit
é
Cl. M. Seiller.
Fig. 8 - Strasbourg, 2, placeSaint-Thomas, coupe trans-versale est-ouest et élévationinterne du mur pignonnord : vestiges de l’état del’immeuble vers 1348(dessin M. Werlé).
Fig. 7 - Strasbourg, 2, place Saint-Thomas, vue du plafond lambrissé à l’étage.
équipements annexes (cuisine, latrines,etc.), éventuellement rejetés dans la cour,aient initialement été associés à l’immeu-ble principal, pour permettre au Constofeld’assurer ses fonctions de sociabilité 8.
La question de la destination du rez-de-chaussée, apparenté à une halle largementouverte sur un espace arrière de cour etabritant un puits, mérite cependant uneattention particulière. L’hypothèse d’unespace dévolu à une fonction d’écuries col-lectives, pour les chevaux de guerre que lesmembres du Constofel de Saint-Thomasdevaient entretenir pour le service de laville, mérite notamment d’être émise. Eneffet, le nom même de Constofel ne fait-ilpas allusion aux con stabularii, usagersqui utilisent une écurie en commun ?L’institution n’avait-elle pas initialementune vocation militaire affirmée ? LesAnnales des Dominicains de Colmar
rapportent que, en 1287, « les magistratsde Strasbourg ordonnèrent aux bourgeoisde cette ville de tenir et entretenir deuxmille chevaux » 9. L’institution des Constofelà la fin du XIIIe siècle, puis la constructiond’un nouveau poêle vers 1348 ne pour-raient-elles pas, au moins dans une certainemesure, correspondre à la mise en applica-tion de cette injonction ?
Il conviendrait enfin d’analyser la placede la construction, en 1348 ou peu après,du poêle du Constofel de Saint-Thomasdans l’échiquier politique local. Celui-ciétait caractérisé par des conflits d’intérêtslatents au sein de la société strasbourgeoise,particulièrement vifs au début de l’année1349, à l’approche de la peste noire. Celle-ci, excitant l’antisémitisme populaire,contribua au déclenchement, en février1349, d’un soulèvement des artisans, alliésà des nobles, contre les milieux d’affaires
(patriciat bourgeois et marchands membresd’une corporation) qui dirigeaient la ville.Il est légitime, dans ce climat de tensionset dans ces circonstances dramatiques, dese demander si le nouveau bâtiment n’a pasparticipé d’une volonté de consolidation dece Constofel.
Maxime Werlé (Pôle d’archéologieinterdépartemental rhénan)
1. Les Constofel ont été étudiés dans le cadre de lathèse consacrée par M. Alioth à la vie politique stras-bourgeoise aux XIVe et XVe siècles : M. Alioth, Gruppenan der Macht. Zünfte und Patriziat in Straßburg im14. und 15. Jahrhundert. Untersuchungen zuVerfaßung, Wirtschaftsgefüge und Soziastruktur, Bâle-Franckfort, 1988. Nous empruntons ici, parfois litté-ralement, de larges extraits à un résumé en français dece travail. Le lecteur voudra bien excuser cette com-modité. M. Alioth, « Les groupes socio-économiquesde Strasbourg à la poursuite de leurs intérêts (1332-1482) », Revue d’Alsace, t. 114, 1988, p. 242-243.
55
Act
ualit
é
Fig. 9 - Strasbourg, 2, place Saint-Thomas, coupe transversale est-ouest etélévation interne du pignon sud : vestiges de l’état primitif (vers 1348)[dessin M. Werlé].
Fig. 10 - Strasbourg, 2, place Saint-Thomas, coupe transversale médianeest-ouest, restitution de l’état primitif (vers 1348) [dessin M. Werlé].
2. B. Metz, « Les corporations à Strasbourg au MoyenÂge », dans Les corporations à Strasbourg. Bourgeois etartisans avant la Révolution, Strasbourg, 2009, p. 8-18.
3. Ch. Schmidt,Histoire du Chapitre de Saint-Thomasde Strasbourg pendant le Moyen Âge, Strasbourg, 1860,p. 177 ; id., Strassburger Gassen- und Häusernamen imMittelalter, Strasbourg, 1871, p. 180, 2e éd., 1888,p. 183). A. Seyboth, Das alte Straßburg vom 13.Jahrhundert bis zum Jahre 1870. GeschichtlicheTopographie nach den Urkunden und Chroniken,Strasbourg, s. d. [1890] ; id., Strasbourg historique etpittoresque depuis son origine jusqu’en 1870.Strasbourg, 1894, p. 471-472.
4. C. Hegel (éd.), Die Chroniken der OberrheinischeStädte. Straßburg, Leipzig, 1870-1871, t. II, p. 786-787.
5. L’expertise dendrochronologique, financée par laConservation régionale des Monuments historiquesd’Alsace, a été réalisée par le laboratoire Archéolabs(réf. ARC 08/R3589D). Les onze échantillons datés,prélevés sur des éléments d’origine de la charpente,proviennent d’arbres abattus en 1345 environ (deuxéchantillons), en automne-hiver 1346-1347 (unéchantillon) et en automne-hiver 1347-1348 (huitéchantillons).
6. Un étage entresolé y a été aménagé ultérieurement,en tirant profit de la hauteur du rez-de-chaussée.
7. Le radier de fondation du puits, en bois, ne se prê-tait pas à une datation dendrochronologique, en rai-son de son mauvais état de conservation. Unéchantillon a cependant fait l’objet d’une analyse14C, prise en charge par le Service régional del’Archéologie d’Alsace, réalisée par le laboratoire del’université de Groningen (Pays-Bas). Il a livré unefourchette comprise entre 1272 et 1386 à 95,4 %, soitentre 1272 et 1309 à 71 % et entre 1361 et 1386 à28,9 % (GrA-44709 ; âge 14C : 685 ± 25 BP, calibréà 2 sigma avec Radiocarbon Calibration Programm,1986-2006, M. Stuiver et P.J. Reimer).
8. Sur les fonctions de sociabilité dans les Stuben, voirL. Sittler, « Les Herrenstuben en Alsace », Revued’Alsace, t. 110, 1984, p. 75-96.
9. G. H. Pertz (éd.),Monumenta Germaniae historica.Scriptores (in f°), t. 17 : Annales aevi Suevici, Hanovre,1861, p. 214 : « Consules Argentinenses cives suos equoshabere duo milia precepere » ; traduction par CharlesGérard et Jospeh Liblin. Les Annales et la chroniquedes Dominicains de Colmar, Colmar, 1854, p. 130-131. Voir la contribution de Ch. Lamboley dans R.Oberlé, M. Fuchs et Chr. Lamboley, Les guerres duMoyen Âge, [s. l.], 1999, p. 116-120.
Saône-et-Loire
Cluny. État des découvertes concernantla sculpture de la façade de l’abbatialeCluny III.
Sur la lancée des manifestations scien-tifiques qui ont marqué la célébration duXIe centenaire de la fondation de Cluny III,en 2010, a été conçue une exposition sur legrand portail de l’abbatiale : elle est orga-nisée, en partenariat, par le Musée duMoyen Âge à Paris (« Musée de Cluny »)et le Musée d’art et d’archéologie de Cluny(« Musée Ochier »). À cette occasion, leCentre d’Études Clunisiennes (CEC) aprocédé à une revue générale du lapidaireconservé dans les réserves et notamment decelui récolté lors des travaux de dégage-ment de l’avant-nef, en 1988, qui n’avaitpas encore été vraiment exploité.
Il en résulte une moisson de nouvellesattributions, accompagnées de très nom-breux recollages de fragments (près de 50),qui concernent tant le grand portail (sonlinteau, le tympan et les piédroits), que lesportails latéraux. Ce nouvel examen a enoutre conduit à séparer du lot des morceauxindubitablement attribuables à l’avant-nef(et notamment à la frise qui règne sous le« triforium ») ou à la façade de celle-ci, enparticulier à la demi-rose de son tympan. Laprésente note détaille les principaux résul-tats concernant la façade romane, dans laperspective de l’exposition ; il sera fait partultérieurement des données récoltées sur lesautres parties de l’abbatiale.
Les conclusions auxquelles nous arri-vons précisent sur bien des points l’image
du portail proposée par Kenneth JohnConant, sans remettre en cause l’essentieldes hypothèses magistrales publiées dansson ouvrage de 1968 1.
Les portails latéraux.De part et d’au-tre du grand portail, deux petits portailslatéraux donnaient accès aux grands colla-téraux. Outre les assises inférieures conser-vées de celui du collatéral sud, ils n’étaientconnus que par deux fragments de daisidentifiés par Conant comme ayant abritéla Vierge sur l’un des tympans. Récemmentnous en avons reconnu d’autres élé-ments dans les réserves. Un des linteaux estcomplet 2 : orné de huit grandes roses, ilmesure 2,54 m de long pour une hauteur
56
Act
ualit
é
Cl. J.-D. Salvèque.
Cl. J.-D. Salvèque.
Fig. 1 - Cluny III, linteaux des petits portails : à droite, détail du bord inférieur du linteau aux huitroses ; à gauche, fragment attribuable au deuxième linteau.
Fig. 2 - Cluny III, chapiteau et fragment de fûtde la deuxième colonne du grand portail : ledécor du fût, connu par le dessin de Garnerey(dans K. J. Conant, op. cit. note 1, fig. 28) et ladescription de Benoît Dumolin (vers 1749),assignent à la colonne la deuxième place à par-tir de la baie du portail.