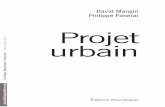Dynamique des réseaux sociaux et résilience socio-économique des micro-entrepreneurs informels en...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Dynamique des réseaux sociaux et résilience socio-économique des micro-entrepreneurs informels en...
1
Dynamique des réseaux sociaux et résilience socioéconomique des micro-entrepreneurs informels en milieu urbain africain
Social networks dynamics and socio-economic resilience of informal African
urban micro-enterprises
J.-P. BERROU et C. GONDARD-DELCROIX
J.-P. BERROU ATER
GREThA – UMR CNRS 5113 Université Montesquieu Bordeaux IV
C. GONDARD-DELCROIX Maître de conférences
GREThA – UMR CNRS 5113 Université Montesquieu Bordeaux IV
Résumé L’article étudie le rôle des réseaux sociaux dans la résilience des micro-entreprises informelles en milieu urbain africain. Il repose sur une méthode originale d’analyse de récits de vie mixant approches qualitative et quantitative. L’étude montre l’impact de la composition des réseaux en soulignant : (i) l’ambigüité des relations familiales ; (ii) le rôle de l’hétérogénéité et de la professionnalisation du réseau ; (iii) l’importance de l’institutionnalisation de l’accès aux ressources. Abstract This paper studies the impact of social networks on the resilience of micro and small entrepreneurs of the informal urban Africa. It is based on an original method of analysis of life stories mixing qualitative and quantitative approaches. The study shows the impact of network composition on resilience by emphasising: (i) the ambiguous role of kinship ties; (ii) the role of network heterogeneity and business ties; (iii) the importance of the institutionalization of access to resources. Mots clé Réseaux sociaux, Résilience, Micro-entreprises, Analyse qualitative, Burkina-Faso Key-Words (5 max) Social network, Resilience, Micro-enterprises, Qualitative analysis, Burkina-Faso Classification JEL (5 max) O12, O17, Z13, L26, O55
2
INTRODUCTION
Le développement socialement soutenable désigne un mode de développement de nature à favoriser la réalisation de besoins humains fondamentaux en même temps qu’il intègre explicitement une vision dynamique. Ce concept suggère que les changements induits par le processus de développement n’amènent pas, globalement, à la dégradation des modes de vies (Ballet, Dubois, Mahieu, 2005). Dans ce cadre, l’analyse dynamique des conditions de vie, à travers les concepts de risque, de vulnérabilité et de résilience socio-économiques revêt alors une importance majeure. Le terme de « résilience » est abondamment utilisé dans un nombre croissant de disciplines scientifiques (Tisseron, 2009). Son usage en socio-économie n’a pas encore donné lieu à un cadrage conceptuel systématique. La résilience socioéconomique peut néanmoins se définir en première instance par la capacité d’un agent ou d’un groupe d’agents à faire face aux conséquences négatives des risques et des chocs sur ses conditions de vie (Moser, 1998 ; Courade et Suremain, 2001). Les risques et chocs considérés sont de nature très diverse (démographique, économique, sanitaire, agricole, environnementale, politique, etc.), et, à la suite de Murdoch (1999), on oppose habituellement les chocs covariants (la probabilité qu’un agent soit touché par le choc est corrélée à la probabilité qu’un autre agent soit touché par le même choc) aux chocs idiosyncratiques (indépendances des probabilités). Dans le contexte spécifique des pays en développement, et en particulier en Afrique Sub-saharienne (ASS) la faiblesse des systèmes de redistribution étatique, l’absence d’un système généralisé de protection sociale ainsi que l’imperfection des marchés du crédit et de l’assurance privée conduisent les agents à mettre en œuvre des mécanismes spécifiques, souvent informels, de protection contre le risque. Parmi ces derniers, le recours aux réseaux sociaux et relations sociales interpersonnelles comme forme d’assurance informelle constitue une forme privilégié de gestion ex post des risques (risk-coping) (Dercon, 2002 ; Fafchamps, 2010). Toutefois, si le recours aux relations sociales s’exprime de manière ex post, ces relations se sont souvent formées bien avant la survenance du choc au sein de divers registres sociaux et pour divers motifs dépassant la seule logique de l’assurance. L’analyse de la dynamique de ces réseaux et relations sociales (évolution et transformation dans le temps) est dès lors toute désignée afin d’explorer leur rôle dans la résilience socioéconomique des populations les plus vulnérables. La présente contribution s’inscrit dans cette perspective et repose sur une étude appliquée aux micro-entrepreneurs du secteur informel de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). Lieu par excellence où l’incertitude, les risques et les chocs sont omniprésents, le secteur informel constitue un terrain d’investigation particulièrement pertinent ; d’autant plus que les transformations sociales liées aux effets conjoints de l’urbanisation et de la crise économique ont conduit à un affaiblissement des institutions sociales traditionnelles et au développement de nouvelles formes de médiation sociale et de solidarité citadine (notamment des réseaux de plus en plus personnalisés, Marie, 1997). Bobo-Dioulasso n’échappe pas à ces transformations et le secteur informel y est le premier pourvoyeur d’emplois (près de 70% de l’emploi) et de ressources des ménages (64% des revenus des ménages) (Fauré et Labazée, 2002). Notre analyse porte alors sur la transformation du réseau social d’accès aux ressources des micro-entrepreneurs au cours de leur trajectoire professionnelle1. Ces transformations sont plus particulièrement appréhendées lorsqu’un choc sur l’activité se produit. L’idée sous-jacente est alors de déterminer dans quelle mesure le réseau social des micro-entrepreneurs leur permet de surmonter divers chocs en limitant leur impact sur la conduite de leur activité (maintien de la production ou du profit par exemple). Dans le cadre de cette étude, nous parlons donc de résilience lorsque l’entreprise survit à un choc grevant l’une des composantes vitales de l’activité : clientèle, fournisseurs, capital (machines, outils, local, trésorerie), travail, matières premières, etc. Notre travail s’inscrit dans le cadre des courants de la nouvelle sociologie économique et de la sociologie des réseaux sociaux (Granovetter, 2008), et plus particulièrement dans la lignée de l’interprétation de la thèse de l’encastrement et du découplage de Harrison White proposée en France par Grossetti et Barthe (2008). Il se veut ici essentiellement empirique et repose sur une méthode originale permettant de saisir la dynamique des réseaux d’accès aux ressources dans le temps. Cette dernière intègre une approche qualitative de collecte des données (méthode des récits de vie) à une approche mixte d’analyse des données (quantitative et qualitative).
1 Les ressources considérées peuvent être autant tangibles qu’intangibles : soutien financier, machines, local, main d’œuvre, clientèle, conseils, information, etc.
3
Une brève revue de la littérature portant sur l’articulation entre réseaux sociaux et résilience socioéconomique en ASS précède l’exposé de nos choix méthodologiques. Nous analysons ensuite, d’un point de vue dynamique, comment la nature, la composition et les possibilités d’évolution/transformation du réseau, favorisent ou contraignent la résilience des micro-entreprises informelles à Bobo-Dioulasso.
RÉSEAUX SOCIAUX, RISQUE ET RÉSILIENCE EN AFRIQUE : UNE REVUE DE LA LITTERATURE
Une importante partie de la littérature portant sur les thématiques relatives au rôle des réseaux sociaux dans la gestion du risque ou des chocs en ASS s’inscrit dans la pensée néo-institutionnaliste en économie. L’attention est ici portée aux « réseaux de partage des risques » en tant que stratégie de « risk coping », essentiellement au niveau des ménages ruraux (Dercon, 2002 ; Fafchamps, 2010). Fondés sur la théorie des jeux répétés, plusieurs modèles micro-économiques montrent que les arrangements informels de mutualisation des risques avec d’autres agents (transfert en cas de choc pour l’un des deux partenaires) sont stables si les gains espérés du partage sont supérieurs à ceux d’un comportement opportuniste (trahison) (Coate et Ravallion, 1993). L’existence d’interactions de long terme entre individus intéressés est alors à même d’assurer le respect de ces engagements assurantiels (« I help you today because I expect you to help me tomorrow »). Le partage des risques s’établit alors principalement entre individus déjà socialisés au sein de collectifs préexistants (ménage, communauté, village, etc.). Néanmoins, compte tenu des problèmes d’asymétries d’information et du manque de mécanismes formels d’application et de contrôle des arrangements, il est généralement démontré que les mécanismes d’assurances mutuels sont incomplets (certains risques, certains individus ne sont pas couverts). Les tests empiriques effectués en milieu rural de plusieurs pays africains (Côte d’Ivoire, Ghana, Tanzanie) ainsi qu’au sein de différents espaces sociaux (ménages, village, ethnie, etc.) vont dans ce sens (Goldstein et al., 2002 ; Duflo et Udry, 2003 ; De Weerdt, 2004). Plus récemment, dans la lignée des modèles théoriques sur la formation endogène des réseaux sociaux (Jackson et Wolinsky, 1996), plusieurs auteurs ont cherché à mettre en évidence que les échanges mutuels se forment sur la base de relations interpersonnelles électives, choisis par des individus comparant entre les gains et le coût de formation ou de maintien d’un lien (De Weerdt, 2004 ; Fafchamps et Gubert, 2007). Les déterminants de la formation de ces liens de partage des risques sont alors souvent la proximité sociale (parenté, religion, ethnie), professionnelle et géographique. Dans cette perspective théorique, la dynamique des réseaux est appréhendée comme le résultat de stratégies rationnelles de la part des acteurs. Notons que si les dons et prêts informels sont les principaux canaux par lesquelles les ménages partagent les risques, d’autres sont identifiables (Fafchamps, 2010). Le partage des risques peut également être inséré dans des relations marchandes comme dans le cas du crédit-fournisseur qui représente pour les micro-entrepreneurs un moyen de gérer des chocs temporaires sur la trésorerie. Les mêmes modèles micro-économiques, fondés sur la théorie des jeux répétés, sont d’ailleurs mobilisés pour expliquer les institutions de marchés et la formation des relations et réseaux d’affaires par les entrepreneurs sur le marché des biens et services (Fafchamps, 2004). Ici, l’incitation à la formation et au maintien de liens d’affaires résulte de l’opportunité de réduire les coûts de transactions. Outre les liens d’affaires, les liens de partage des risques développés avec des outsiders au marché des biens (soutien financier de la famille par exemple) restent importants pour les MPE (Fafchamps et Minten, 1999), d’autant plus lorsque ces dernières sont soumises à une grande variété de risques pouvant bloquer leur activité : la capacité d’emprunt auprès d’un tiers devient une forme d’assurance sociale importante. Sur le plan empirique, il est alors démontré que le capital réseau (le réseau social étant considéré comme un actif productif) a des effets positifs sur les performances économiques des firmes, excepté dans sa composante familiale (Fafchamps et Minten, 2002) et dans le cadre de « réseaux de solidarité » (petits, denses et homogènes), plus utiles pour réduire l’incertitude et l’instabilité des revenus que pour véritablement améliorer les performances (Barr, 2002). Des réserves ont été émises concernant les postulats instrumentalistes et la vision endogène des réseaux sociaux dans les travaux néo-institutionnalistes. Dans une perspective plus socioéconomique certains auteurs soulignent l’influence des structures sociales plus larges, et en particulier du contexte économique et politique, sur les réseaux (Lourenço-Lindell, 2002 ; Cleaver, 2005 ; Meagher, 2010). Ils soulignent également la nature plurielle des règles, normes et mobiles de comportement à l’œuvre au sein des relations sociales : à la fois marchands et non marchands, instrumentaux ou non, calculatoires et intuitifs,
4
conscients et inconscients. Les réseaux sociaux sont donc partiellement exogènes aux stratégies des acteurs. Dans ce cadre, la configuration des liens sociaux d’un acteur importe beaucoup dans sa capacité à obtenir de l’aide en temps de crise. L’étude de Lourenço-Lindell (2002) sur le rôle des réseaux sociaux dans le procès d’informalisation à Bissau (Guinée) fait ainsi transparaître l’importance de l’hétérogénéité des réseaux : tous les acteurs ne peuvent compter sur un réseau combinant une diversité suffisante de liens, avec des liens résilients comblant les défaillances d’autres types de liens2. Dans le même sens Meagher (2010), à travers l’histoire des réseaux économiques Igbo au Nigeria (dans les clusters de la chaussure et du vêtement à Aba), souligne l’importance du découplage et de la diversification des relations en tant que stratégie de restructuration des réseaux en contexte de crise ; un constat relativisé du fait de la vulnérabilité de certains réseaux, notamment verticaux (avec des acteurs en position de pouvoir financier ou politique), à la subordination et la capture politique. Cleaver (2005), dans une étude ethnographique des stratégies de survie des ménages ruraux dans le bassin d’Usangu en Tanzanie, souligne quant à elle que loin d’être une source de soutien, les relations sociales d’accès aux ressources peuvent structurellement reproduire l’exclusion des plus pauvres. Guichaoua (2007), à partir d’une enquête sur les ouvriers (travailleurs journaliers) du secteur du bâtiment à Abidjan montre que la solidarité familiale ne se marie pas avec la réciprocité entre égaux : « Famille et réseaux de pairs semblent figurer donc comme deux espaces sociaux de fourniture de soutiens alternatifs, non cumulables » (p.202). Autrement dit l’extraction de la tutelle familiale apparait comme une condition sine qua non pour participer à des arrangements entre pairs. Pasquier-Doumer (2010), dans le cadre d’une étude sur le peuplement et le développement urbain à Ouagadougou, étudie le rôle du réseau social dans les parcours de vie des citadins ouagalais. En ce qui concerne le soutien financier en cas de chocs (santé, cérémonies, dépenses courantes, etc.), elle montre au contraire que le type de réseau mobilisé est autant hérité que construit. De manière générale, un intérêt grandissant est donc aujourd’hui accordé à l’analyse de la dynamique des réseaux sociaux et à leur rôle dans la capacité des populations vulnérables à faire face aux chocs affectant leurs conditions de vie. Dans cette perspective notre travail repose sur une méthode qualitative narrative basée sur la reconstitution d’histoires de parcours professionnels d’entrepreneurs dans l’économie informelle de Bobo-Dioulasso. Il vise à saisir l’évolution/transformation des relations sociales d’accès aux ressources des micro-entrepreneurs face à divers chocs.
LA MÉTHODE DES HISTOIRES DE CAS ET LA COMBINAISON DES ANALYSES QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
Une adaptation de la méthode des histoires de cas Les données mobilisées pour cet article ont été produites en 2008 par une enquête qualitative. Celle-ci constitue la dernière phase d’une enquête plus large débutée en 2006, et ayant donné lieu en 2007 à une enquête quantitative portant sur l’activité économique et le réseau personnel des entrepreneurs (méthode des générateurs de noms) (Berrou, 2010). Dans le cadre de cette enquête qualitative, 14 micro-entrepreneurs ont fait l’objet d’un entretien approfondi (une à trois heures). Ils ont été sélectionnés de façon à illustrer la variété des branches (production, commerce et services) et le dynamisme des activités informelles. Le groupe d’entrepreneurs témoigne en outre d’une représentativité sociodémographique suffisante, en termes d’âge et d’ethnie notamment, même si deux femmes seulement ont pu être rencontrées. La « méthode des histoires de cas » repose sur des entretiens fondés sur une trame biographique, des récits de vie ou entretiens narratifs (Grossetti et Barthe, 2008). Dans notre cas, les entrepreneurs racontent leur parcours professionnel et l’histoire de leur entreprise est enchâssée dans ce récit. Au cours des entretiens des relances précises concernant les situations d’accès aux ressources extérieures sont introduites de manière à en faire préciser les modalités d’accès. L’histoire est ensuite reconstruite et rédigée a posteriori par le chercheur. Cette méthode autorise à saisir et analyser l’activation de relations ou d’autres formes de médiations (dispositifs collectifs) dans les processus d’accès aux ressources tout au long de la trajectoire professionnelle. Elle permet ainsi d’observer l’évolution du réseau en cas de survenance d’un choc sur l’activité.
2 Les liens forts familiaux étant selon elle plus résistants en temps de crise que les liens faibles, souvent instrumentaux (que l’on retrouve en particulier dans le cadre des activités marchandes).
5
Une méthode mixte d’analyse des données
L’analyse des entretiens est menée selon trois modalités complémentaires combinant méthodes qualitatives et quantitatives (Grossetti et Barthe, 2008). Les deux premières méthodes d’analyse reposent sur l’identification et le codage des séquences d’accès aux ressources extérieures par mobilisation d’une relation ou d’une entité collective. Près de 300 séquences ont ainsi été codées. Sur cette base, nous pouvons interroger la stabilité ou l’évolution des mécanismes d’accès aux ressources. Cela est fait dans le cadre d’une analyse statistique descriptive et de l’analyse de diagrammes de réseaux, en comparant les dispositifs d’accès aux ressources selon la période d’accès : (i) avant la création, au démarrage et après la création de l’activité ; (ii) avant et après un choc. Les chocs considérés sont ceux observés au cours des entretiens. Ils sont de nature diverse (idiosyncrasiques comme covariants) mais le faible nombre d’entretiens ne permet pas de dresser une typologie systématique. Nous prenons ainsi en compte les chocs grevant l’activité que ce soit directement (ensemble des chocs touchant les ressources vitales de l’activité, tels que la baisse de la clientèle, les pannes techniques, l’inflation, etc.) ou indirectement (les chocs sociodémographiques, tels que les décès ou les épisodes de maladie, nécessitant des dépenses impactant le budget de l’activité). Les diagrammes de réseaux consistent à figer dans une représentation schématique la structure et la composition du réseau aux temps critiques de la dynamique entrepreneuriale. Elle est particulièrement adaptée à la visualisation des possibilités de redéploiement du réseau (changements de structure et de composition du réseau) à la suite d’un choc. Ainsi, pour cet article, nous avons sélectionné deux histoires de cas marquées par un choc majeur sur l’activité suivi pour l’une par une trajectoire de résilience (Edmond, 48 ans, tailleur-couturier) et pour l’autre par une trajectoire de stagnation durable de l’activité à un niveau permettant à peine la survie (Rasmané, 42 ans, vendeur de vêtements traditionnels) (figures 1 et 2). L’analyse comparée des diagrammes combinée à l’analyse statistique permet d’identifier des mécanismes qui sont ensuite explicités par l’analyse compréhensive des entretiens. La synthèse de ce travail analytique à trois temps nous amène à mieux saisir le rôle de la composition du réseau et de son évolution dans la résilience des entreprises.
DU RÔLE DE LA COMPOSITION ET DE LA DYNAMIQUE DES RÉSEAUX DANS LA RÉSILIENCE DES MICRO-ENTREPRISES À BOBO-DIOULASSO
L’ambivalence des relations familiales : entre résilience et dépendance
Les relations familiales sont à la fois un facteur de résilience et de vulnérabilité en raison des liens de dépendance sur lesquels elles peuvent déboucher. Que ce soit avant ou après la création de l’activité elles peuvent jouer un rôle déterminant de sécurisation dans l’accès aux ressources. La constitution du capital de départ avant le démarrage de l’activité, à travers une stratégie du « doni-doni » (« petit-à-petit » en langue dioula), est un processus particulièrement vulnérable aux chocs. Cette période est généralement très instable : elle repose sur la multiplication de petits métiers pour les commerçants ou sur une ou plusieurs phases d’apprentissage pour les artisans. L’instabilité du mode de vie et des activités exercées au cours de cette période explique l’importance du rôle des liens forts familiaux. Si ces derniers sont mobilisés pour accéder aux premiers emplois (ou à l’apprentissage) ils le sont aussi pour sécuriser l’accès à certaines ressources durant les phases de transitions entre ces emplois, en particulier en termes de soutien financier et d’hébergement (ce dernier point étant notamment important pour les migrants ruraux, cf. Antoine et Diop, 1995). Ensuite, au démarrage de l’activité, il n’est pas rare qu’un proche parent participe au financement de l’activité naissante ou assure l’hébergement de l’entrepreneur et de son atelier. L’analyse quantitative statistique confirme le poids des relations familiales lors de ces périodes (tableau 1). Après le démarrage de l’activité, et bien que les relations familiales ne représentent alors en moyenne que 16% des relations mobilisées, on observe leur importance en cas de choc sur l’activité, confirmant là des résultats établis ailleurs (Lourenço-Lindell, 2002). Par exemple, Edmond (couturier) souligne que lors d’une baisse importante de son activité due à un choc de demande (départ de beaucoup de ses clients aisés vers la capitale), il a pu bénéficier du soutien moral et financier de son ami d’enfance ainsi que de son épouse. Une tante éloignée du côté de sa femme lui a permis de trouver un nouveau local. Enfin, grâce à un « parent de même village », directeur d’une grosse société, il a pu avoir accès à un marché intéressant.
6
Tableau 1. Type de relations sociales mobilisées selon le moment d’acquisition de la ressource (%)*
Note : (*) Les cellules en gras représentent les valeurs significativement différentes de la moyenne de la variable considérée (sur la base des résidus standardisés ajustés du Khi-2, sig. < 0,10).
Source : auteurs. Toutefois, la mobilisation des relations familiales dans la dynamique courante des activités répond souvent d’un double mouvement contradictoire, à la fois de recentrage sur le noyau nucléaire (le ménage), et de décentrage vers la parenté éloignée (expliquant le poids plus significatif de ces derniers dans le tableau 1). Cela peut tenir à l’aspect contraignant des relations nouées avec la famille proche. C’est ce qu’explique Drissa (ébéniste) pour commenter son départ de la cour familiale où il a, dans un premier temps, installé son activité :
« Oh, dans la famille c’est dur, c’est dur, c’est dur. Y’a beaucoup de paroles là-dedans. Avec la famille quoi y’a des petits… des paroles dedans. (…). Ce ne sont pas des conflits mais tout ce que tu fais là, ils croient que c’est de l’argent que tu gagnes. ».
Les relations familiales jouent ainsi un rôle ambivalent dans la résilience des micro-entrepreneurs et de leur activité. La relation de Boukary, commerçant en matériel audio-vidéo, avec son père en est une parfaite illustration. Multipliant les expériences pendant près de 10 ans dans le milieu du commerce, notamment auprès de son père, Boukary connaît une trajectoire tumultueuse parsemée de divers chocs (vols de ses économies par des coupeurs de routes, trahison d’un employé, etc.). Dans ce contexte, son père est à la fois source de vulnérabilité et de résilience : de vulnérabilité car il réquisitionne régulièrement les économies de Boukary pour surmonter les déboires de ses propres activités (devenant par là-même cause de choc) ; de résilience car, dans le même temps, il joue un rôle décisif dans le lancement de son activité en lui achetant de la marchandise et en lui faisant bénéficier de son réseau de fournisseurs. Aujourd’hui les affaires de Boukary marchent bien et ses principaux fournisseurs, grands commerçants travaillant avec la Chine et Singapour, sont tous des parents de son père. Les relations familiales peuvent aussi conduire, de façon a priori paradoxale, à des situations d’isolement social, les privant de la sorte du rôle stabilisateur décrit plus haut. L’activité de Rasmané (vendeur de fripes) tient tout entière sur sa relation avec Kuanda, un parent de même village qu’il considère comme son frère (ce dernier étant très proche de son père) ; il est son fournisseur et son unique soutien en cas de difficulté (figures 1b et 2b). Toutefois cette dépendance lui pèse : il ne veut pas dépendre systématiquement de lui et toujours lui faire part de ses problèmes, ce qui finirait, selon lui, par être honteux. Il essaie de développer son activité en contournant sa relation avec Kuanda mais de façon infructueuse. Il ne peut en effet afficher ces démarches : s’il allait voir régulièrement un autre fournisseur que Kuanda, ce dernier pourrait le vivre comme une trahison. Il montre ainsi à la fois le caractère aidant et contraignant de la relation tout en évoquant la honte induite par son caractère déséquilibré. Cet exemple montre également un mécanisme d’autocensure par lequel les personnes s’interdisent elles-mêmes de demander l’aide de leurs proches. Cohen (1997) explique cela en s’appuyant sur les trois moments de la réciprocité au sein de la socialité primaire tels que définis par Mauss : donner, recevoir, rendre. « Lorsque l’on croit ne plus pouvoir donner, on préfère ne plus recevoir. Le cercle de la primarité s’en trouve réduit » (p.7). On touche alors ici à l’importance de pouvoir disposer de relations hors-famille au sein de son réseau (Lourenço-Lindell, 2002 ; Cleaver, 2005).
L’hétérogénéité sociale du réseau
L’homogénéité sociale du réseau associée à la prépondérance de relations de dépendances familiales peut conduire à situation de « vulnérabilité relationnelle » (Cohen, 1997) tout à fait caractéristique de la situation de
Type de relations sociales Moment d'acquisition de la ressource Famille
Parenté ethnique, villageoise
Ami proche Connaissance voisinage
Relation professionnelle (amicalement)
Avant la création de l'activité 63,3 1,8 9,2 7,3 18,3 Au moment de la création de l'activité
31,4 5,7 12,9 18,6 31,4
Après la création de l'activité 16,1 16,1 16,1 8,6 43,0
Total 39,0 7,7 12,5 10,7 30,1%
7
Individus
Organisations et institutions formelles
Liens familiaux
Amis, connaissances…
Liens d’affaire
Ressources
Relations diffuses dans l’accès à la ressource
Cercle familial
Cercle élargie (famille élargie, parenté éloignée…) Liens conflictuels =
Figure 0. Légende des diagrammes
Source : Auteurs Rasmané. En comparant l’histoire de dernier à celle d’Edmond (cf. supra) on peut alors illustrer l’importance que revêt l’hétérogénéité du réseau (présence de relations familiales, amicales, professionnelle, de voisinages et de connaissances). Au cours de leur trajectoire professionnelle Edmond et Rasmané sont l’un et l’autre confrontés à une baisse importante de leur activité (choc sur la demande). Pourtant le premier parcours est marqué par un redressement de l’activité lié à un redéploiement du réseau alors que dans le second cas l’activité continue à péricliter en même temps que le réseau reste restreint, homogène et figé. Ce constat est clairement dressé à partir de la comparaison des diagrammes des réseaux d’Edmond et Rasmané tels qu’ils se présentent avant (figure 1) et après la crise (figure 2). L’analyse comparative de ces deux histoires souligne la capacité à mobiliser des relations sociales diverses dans le cas d’Edmond alors que Rasmané reste dépendant d’une relation du cercle familial. Edmond mobilise des relations nouvelles issues du cercle familial élargi et amical qui lui apportent différents types de soutien (nouveaux marchés, soutien financier, soutien moral, accès à un nouveau local, conseils, etc.) lui permettant de faire face à la baisse de son activité3. L’importance de l’hétérogénéité sociale du réseau est confirmée par d’autres cas. Le récit de Boukary entraperçu précédemment en est un exemple. Une fois son activité lancée, il peut faire face à une première grosse difficulté, consécutive à la réquisition, par son père, de toutes ses économies, grâce à ses nombreuses relations d’amitié et de connaissance : il échange de petits services contre de menues rémunération, notamment en nature (nourriture, hébergement, etc.). Ce large réseau de connaissance qu’il développe dans la ville sera d’ailleurs une base essentielle du développement fulgurant de sa clientèle dans son activité actuelle (commerçants audio-vidéo) : « J’ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de camarades, beaucoup d’amis, beaucoup de connaissances. C’est ça qui fait ma force. C’est 90% de mes clients qui sont des camarades ». Mariam (vendeuse de poisson) raconte qu’après la reconstruction du grand marché de Hamdalaye (qui l’avait obligée à déplacer son activité), c’est par l’intermédiaire de diverses connaissances, amis et voisins qu’elle a eu accès à l’information sur les démarches nécessaires pour obtenir une place au nouveau marché. Finalement, ces constats confirment l’importance de disposer dans son réseau de relations hors-famille (Cleaver, 2005) sans pour autant mettre à jour, comme le fait Guichaoua (2007), une opposition stricte entre le soutien obtenu par la famille et celui obtenu en dehors de cette dernière. Contrairement aux résultats de Lourenço-Lindell (2002) nous ne pouvons non plus conclure que les liens forts familiaux soit plus résilients que les autres : il apparaît ici que même les liens faibles peuvent avoir un rôle majeur dans la résilience des micro-entrepreneurs, que ces derniers relèvent de la sphère de l’amitié, du voisinage voire de la sphère professionnelle.
Professionnalisation du réseau et institutionnalisation de l’accès aux ressources
Comme le souligne Fafchamps (2010), les liens d’affaires peuvent intégrer des mécanismes de partage des risques. C’est notamment le cas du crédit-fournisseur qui peut permettre aux micro-entrepreneurs de gérer des aléas dans leur trésorerie. On peut aussi ajouter, sur la base de nos récits, les avances-clients sur la marchandise, voire les délais de paiements des loyers au propriétaire du local. Ces liens d’affaires sont souvent suffisamment anciens, de confiance ou de grande fréquence pour permettre la mise œuvre de ces mécanismes. Ils permettent clairement aux entrepreneurs de gérer un certains nombre de chocs sur leur
3 On remarque toutefois que les temporalités sont assez inégales, notamment en ce qui concerne les périodes suivant le choc. Cela est peu étonnant, la résilience ne pouvant s’observer qu’à long terme alors que les entreprises non résilientes peuvent rapidement péricliter (comme le confirment la forte mortalité et la faible espérance de vie des entreprises informelles).
8
EDMOND
Draman
Conseils
Clientèle
Apprentis
Marchés publics
Coopérative d’artisans
Famille élargie Cercle amical
Boureyma Oumar
Seydou
Fournisseurs Matériel (crédit)
RASMANE KUANDA
Père
Frère
Conseils
Soutien financier
Clientèle
Clientèle
Partage du loyer
OUAGADOUGOU
Marché Central
Cercle Familial
Famille élargie
Figure 1. Le réseau d’accès aux ressources de deux entrepreneurs avant la survenue d’un choc exogène sur l’activité
Figure 1a- Edmond, tailleur couturier - 1983-1990
Source : Auteurs
Figure 1b- Rasmané, vendeur de vêtements traditionnels – 2003-2006
Source : Auteurs
9
EDMOND
Epouse
Salif
Soutien Financier
Conseils
Apprentis
Tante
Atelier
Soutien moral
Soutien financier
Draman
Clientèle
Conseils
Hubert DG Sonabhy
Hyppolite DG Sonabhy
Bobo
Marché public
Boureyma
Seydou Oumar
Fournisseurs Matériels (crédits)
Ménage
Famille élargie parenté éloigné
RASMANE
Frère
Kuanda
Clientèle
Clientèle
Fournisseur Crédits
Conseils
Soutien financier
Local
Soutien financier
Marché Central
Cercle Familial
Famille élargie
OUAGADOUGOU
Figure 2. Le réseau d’accès aux ressources de deux entrepreneurs suite au choc exogène sur l’activité
Figure 2a- Edmond, tailleur couturier - 1990-2008
Source : Auteurs
Figure 2b- Rasmané, vendeur de vêtements traditionnels – 2006-2008
Source : Auteurs
10
activité et notamment de gérer la variabilité de leurs revenus qui peut gêner les paiements réguliers de leurs charges et entraver la mise en œuvre courante de leur activité. Toutefois, lorsque le choc touche une large part du réseau personnel (chocs covariants), ces mécanismes basés sur des relations d’affaires interpersonnelles de confiance peuvent devenir inopérants (les créditeurs, également touchés par le choc, ne peuvent se permettre de différer les remboursements). Les enquêtes mobilisées pour cette étude, ont été produites en 2008, au cours d'une période de flambée des prix des matières premières au niveau mondial qui a provoqué une contraction sévère du pouvoir d’achat des populations et de violentes manifestations dans de nombreuses villes de pays en développement. Les habitants de Bobo n’ont pas été épargnés par ce qu’ils appellent « la vie chère ». Cette dernière a perturbé le mode de fonctionnement habituel des relations d’affaires comme le montre le cas de Drissa, ébéniste. Drissa, dont l’activité est dynamique, travaille essentiellement avec deux fournisseurs réguliers, Sakandé et Zongo, deux grands commerçants de bois de Bobo. Avec eux, il pouvait obtenir des matières premières à crédit pour des montants allant jusqu'à 100 000 F.CFA voire plus selon ses besoins. Il effectuait ensuite les remboursements progressivement, au gré de ses commandes. Avec « la vie chère », il explique que ce n’est plus possible:
« Le marché est lent. Par exemple, aujourd'hui, si tu pars avec eux, demain ou après-demain, ils peuvent commencer à venir te chauffer. Ils passent te dire bonjour tous les jours. Donc, mieux vaut laisser... (rires) C'est que ça va mal, le marché est gâté... Tout est débrouille maintenant, ce qu'on a, on se contente de ça et puis on fait ce qu'on peut avec ».
Drissa règle donc ses marchandises au comptant. Le même phénomène s’observe chez Madou, soudeur, qui préfère payer comptant son fournisseur Adama, avec qui il travaille depuis son apprentissage, de peur de ne pouvoir le rembourser s’il prend un crédit : les retards de paiement de ses clients s’accumulent. Enfin, ces relations durables peuvent à l’extrême conduire à une situation de « sur-encastrement » (Uzzi, 1997) réduisant les marges de liberté et de flexibilité des entrepreneurs en cas de crises (tel le cas de Rasmané, voir supra). Ces réseaux et relations d’affaires, en particulier les liens de coopération entre entrepreneurs, débouchent parfois sur la constitution de communauté, d’association ou d’organisation collective qui peuvent alors jouer un rôle important en termes de sécurisation de l’accès aux ressources en cas de crise. Le tableau 1 montre d’ailleurs que ces modes d’accès aux ressources se développent significativement après la création de l’activité. Il est ainsi fréquent que les entrepreneurs enquêtés, quel que soit leur corps de métier, fassent partie d’une association professionnelle informelle à laquelle s’adosse une caisse de solidarité pour faire face aux différents chocs démographiques touchant les entrepreneurs (« les événements heureux et malheureux ») et qui risquent de déstabiliser leur activité. Les tontines répondent aussi à cette logique. Comme l’explique « Bouba », commerçant de fripes, il cotise près de 1000 F.CFA par jour à deux tontines informelles afin d’éviter des périodes de creux dans l’approvisionnement en marchandises. Pour autant ces mécanises collectifs ou organisationnels de mutualisation des risques, s’ils dépassent les logiques relationnelles interpersonnelles, sont encore parfois relativement sensible aux chocs covariants (si tous les membres du collectif sont touchés). Les modes institutionnalisés d’accès aux ressources (crédit bancaire, en particulier à travers les institutions de micro-finance comme les Caisses Populaires au Burkina Faso) restent alors les mécanismes les plus favorables à la résilience des micro-entrepreneurs en cas de chocs covariants. Or il apparaît, notamment à travers l’histoire de Fatimata (restauratrice à succès), que des relations sociales interpersonnelles sont souvent à l’origine de ces formes plus contractuelles d’accès aux ressources. Cette dernière décrit par exemple comment ses relations avec quatre de ses fidèles clientes, employées d’une caisse populaire, lui ont permis d’ouvrir un compte et d’accéder à toute l’information nécessaire pour obtenir des crédits bancaires. Elle explique alors que son dernier crédit lui a permis d’assurer un fond de roulement pour amortir le choc dû à « la vie chère ». Face à la hausse des prix d’achat, l’indépendance que lui donne son crédit lui a permis de ne pas répercuter cette hausse sur ses prix de ventes afin de conserver sa clientèle. Cette stratégie lui a même permis d’augmenter sa clientèle et son chiffre d’affaire4. Ainsi, c’est donc la dynamique endogène de son réseau qui lui a progressivement permis d’avoir accès à ces crédits. On
4 La comparaison avec les cas de Drissa ou de Madou (cf. supra), pressés de rembourser leurs fournisseurs au plus vite, est saisissante.
11
observe dans ce cas que l’accès aux ressources se découple de son support relationnel pour reposer sur des mécanismes plus contractuels (plus résilients en cas de chocs covariants).
CONCLUSION
L’analyse combinée des entretiens (analyse quantitative, diagrammes de réseaux et analyse compréhensive) nous a permis de préciser comment, dans une perspective dynamique, le réseau social des micro-entrepreneurs informels de Bobo-Dioulasso intervient dans la gestion des chocs et donc la résilience de leur activité. Il apparaît que : (i) les relations familiales ont un rôle ambigu en étant à la fois un vecteur de sécurisation de l’accès aux ressources dans les périodes d’instabilité (notamment dans la phase de constitution du capital de départ) mais aussi de dépendance et de vulnérabilité ; (ii) l’hétérogénéité sociale du réseau accroît la possibilité de trouver un soutien en cas de crise ; (iii) la professionnalisation et l’institutionnalisation de l’accès aux ressources constituent des mécanismes importants de résilience en cas de chocs idiosyncrasiques pour le premier et covariants pour le second. En prolongement de ce travail, une première piste de réflexion réside dans la prise en compte de la contingence. Cette dernière marque profondément le processus de long terme par lequel on observe la formation et l’évolution conjointes du réseau et de l’activité pour des motifs dépassant la seule logique assurantielle (Berrou et Gondard-Delcroix, 2010). Une deuxième piste de travail repose sur la mobilisation de méthodes approfondissant l’analyse dynamique des réseaux, en recourant aux approches et méthodes issues de la sociologie économique et de l’analyse des réseaux sociaux. Dans ce cadre, la mise en œuvre d’enquêtes plus larges, mobilisant un échantillon plus ample et reposant sur la méthode des histoires de cas, permettrait d’apporter des éclairages nouveaux quant au rôle des réseaux d’accès aux ressources dans la résilience des populations vulnérables en ASS.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANTOINE P. et DIOP A B. (eds) (1995) La ville à guichets fermés. Itinéraires, réseaux et insertion urbaine, IFAN-Orstom, Dakar.
BALLET J., DUBOIS JL., MAHIEU FR. (2005) L’autre développement. Le développement socialement soutenable, L’Harmattan, Paris.
BARR, A.M. (2002) The functional diversity and spillover effects of social capital. Journal of African Economies, 11(1), 90-113.
BERROU JP. (2010) Encastrement, réseaux sociaux et dynamique des micro et petites entreprises informelles en milieu urbain africain, Doctorat de Sciences Economiques, Université Montesquieu-Bordeaux IV.
BERROU, JP. et GONDARD-DELCROIX, C. (2010) Réseau social et accès aux ressources dans la trajectoire d’entreprises informelles : récits de vie d’entrepreneurs à Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso), Cahier du GREThA, No. 2010-09, Université Montesquieu-Bordeaux IV.
CLEAVER, F. (2005) The inequality of social capital and the reproduction of chronic poverty. World Development, 33 (6), 893-906.
COATE, S. et RAVALLION, M. (1993) Reciprocity without commitment. Journal of Development Economics, 40 (1), 1-24.
COHEN, V. (1997) La vulnérabilité relationnelle. Essai de cadrage et de définition. Socio-anthropologie, 1 (en ligne : http://socio-anthropologie.revues.org/index74.html).
COURADE G., DE SUREMAIN C.E. (2001) Inégalité, vulnérabilités et résilience : les voies étroites d’un nouveau contrat social en Afrique subsaharienne, In Winter G. ed., Inégalités et politiques publiques en Afrique – Pluralité des normes et jeux d’acteurs, Karthala-IRD, Paris, 119-133
DE WEERDT, J. (2004) Risk Sharing and Endogenous Network Formation, in: S. Dercon (ed) Insurance Against Poverty, Oxford University Press, Oxford:, 197-216.
DERCON, S. (2002) Income Risk, Coping Strategies, and Safety Nets. The World Bank Research Observer, 17(2), 141 -166.
12
DUFLO, E. et UDRY C. (2003) Intrahousehold Resource Allocation in Côte d’Ivoire : Social Norms, Separate Accounts and Consumption Choices, Cambridge MIT.
FAFCHAMPS, M. (2010) Risk Sharing Among and Between Households, in: J. Benhabib, A. Bisin, and M.O. Jackson (ed.) The Handbook of Social Economics, North Holland.
FAFCHAMPS, M. (2004) Market Institutions in Sub-Saharan Africa: Theory and Evidence, MIT Press Massachusetts.
FAFCHAMPS, M. et Gubert, F. (2007) The Formation of Risk-Sharing Networks. Journal of Development Economics, 83 (2), 326-50.
FAFCHAMPS, M. et MINTEN, B. (2002) Social capital and the firm: Evidence from agricultural traders in Madagascar, in: C. Grootaert et T. van Bastelaer (eds) The role of social capital in development. An empirical assessment, Cambridge University Press, Cambridge, 125-154.
FAFCHAMPS, M. et MINTEN, B. (1999) Relationships and traders in Madagascar. Journal of Development Studies, 35(6), 1-35.
FAURE, Y.A. et LABAZEE, P. (2002) Socio-économie des villes africaines. Bobo et Korhogo dans les défis de la décentralisation, Karthala, Paris.
GOLDSTEIN, M., DE JANVRY, A. et SADOULET, E. (2002) Is a Friend in Need a Friend Indeed? Inclusion and Exclusion in Mutual Insurance Networks in Southern Ghana, Working Papers UNU-WIDER Research Paper, World Institute for Development Economic Research.
GRANOVETTER, M. (2008) Sociologie économique, Editions du Seuil, Paris.
Grossetti, M. et Barthe, J.-F. (2008) Dynamique des réseaux interpersonnels et des organisations dans les créations d’entreprises. Revue Française de Sociologie, 49 (3), pp. 585-612.
GUICHAOUA, Y. (2007) Solidarité professionnelle et partage des risques parmi les travailleurs informels. Une étude de cas à Abidjan. Autrepart, n°43, 191-205
JACKSON, M. et WOLINSKY, A. (1996) A strategic model of social and economic networks, Journal of Economic and Theory, n° 71, 44-74.
LOURENÇO-LINDELL, I. (2002) Walking the Tight Rope: Informal Livelihoods and Social Networks in a West African City. Stockholm Studies in Human Geography 9, Almquist and Wiksell International, Stockholm.
MARIE, A. (ed) (1997) L’Afrique des individus. Itinéraires Citadins dans l’Afrique contemporaine (Abidjan, Bamako, Dakar, Niamey), Karthala, Paris.
MURDOCH, J. (1999) Between the market and state: can informal insurance patch the safety net?, World Bank Research Observer, 14 (2), 187-207.
PASQUIER-DOUMER, L. (2010) Le rôle du réseau social dans les parcours de vie des Ouagalais, In Boyer F. et Delaunay D. (Eds), Peuplement de Ouagadougou et développement urbain, à paraître.
TISSERON, S. (2009) La résilience, Que sais-je ?, PUF, Paris.
UZZI, B. (1997) Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness. Administrative Science Quarterly, 42 (1), pp. 35-67.