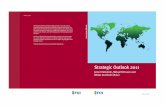VAQUER J., PETREQUIN P. et DEFOIS B., 2011.- Une hache de type Pauilhac au Grès Haut, Calvignac...
-
Upload
univ-fcomte -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of VAQUER J., PETREQUIN P. et DEFOIS B., 2011.- Une hache de type Pauilhac au Grès Haut, Calvignac...
197
Une hache de type Pauilhac au Grès Haut, Calvignac (Lot). Pages 197 à 213
Jean VaquerDirecteur de Recherche CNRSLabo : TRACES, UMR 5608, CNRS, EHESS,Université de Toulouse Le MirailMaison de la recherche5 allée Antonio Machado31058 Toulouse cedex
Adresse personnelle :Pierron, 1 chemin du Moulin Haut, Les Escudiés81110 [email protected]él 05 63 37 10 43
Pierre PétrequinDirecteur de Recherche CNRSLabo : Laboratoire de Chrono-environnement UMR6249, CNRS Université de Franche Comté16 route de Gray25030 Besançon cedex
Adresse personnelle :69 grand Rue7100 [email protected]él : 03 84 65 63 77
Bertrand DefoisDirecteur du développement touristique et culturelCentre de Préhistoire de Pech Merle46330 [email protected]él : 05 65 31 23 33
Résumé :Une nouvelle grande hache en jadéitite alpine aété trouvée fortuitement dans un mur au coursde travaux de restauration d’une ancienne ber-gerie. Elle a dû être placée là en tant que «céraunie » pour protéger le bâtiment de lafoudre. Il s’agit d’une grande hache de typePauilhac à tranchant débordant et à talonéquarri. Cette trouvaille renforce une concen-tration déjà notable de ce type dans leSud-Ouest de la France où il se rencontre soitfortuitement à l’état isolé, soit en dépôt ou biendans le célèbre mais énigmatique site funérairede Pauilhac, Gers. La révision de toutes les trou-vailles de haches en jades en Europeoccidentale, entreprise dans le cadre du pro-gramme JADE, montre deux cas d’associationspossibles du type Pauilhac avec des haches detype Puy, ce qui incite à le placer certainementaprès 4300 av. J.-C. et probablement à l’aube duquatrième millénaire. Cette observationconfirme la distinction avec les types Rarogne,Saint-Michel et Tumiac, attestés dès le milieudu cinquième millénaire dans les tumulusgéants carnacéens et dont la production avaitcessé avant la fin de ce millénaire. Si l’on retientl’hypothèse mainte fois émise que les tranchantsoutrepassés à excroissances latérales et les bordsdroits évoquent fortement certaines hachesmétalliques à tranchant étalé du Chalcolithiquecarpato-balkanique la fidélité de ces copies enjade par rapport à leurs modèles serait plus fortedans le cas des haches de type Pauilhac que deshaches de type Saint-Michel ; et parmi leshaches de type Pauilhac, celles à talon équarricomme l’exemplaire du Grès Haut en serait un
des meilleurs exemples. La répartition de cetype coïncide assez bien avec l’aire de la culturechasséenne et des cultures apparentées (Auzay-Sandun, Néolithique moyen d’Aragon et deGalice) et s’intègre aux grands réseauxd’échanges de matériaux et de biens façonnés,qui en effet caractérisent cette culture dans sonétape de plus grand rayonnement, dans le pre-mier quart du quatrième millénaire.
Mots Clés : Jadéitite du Mont Viso, grandehache de type Pauilhac, Chalcolithique, Chas-séen.
Abstract :A newly-discovered large axehead of Alpinejadeitite was found by chance in a wall duringrestoration work on an ancient sheep pen. Itmust have been placed there deliberately, as a‘ceraunion’ to protect the building from light-ning, in line with folk beliefs that stoneaxeheads were thunderbolts. It is a large axe-head of Pauilhac type with an expanded bladeand squared butt. This new find adds to aregional concentration of this type of axeheadin south-west France, where examples havebeen found both as single stray finds and inhoards; there was also the famous and enigmaticfunerary find at the eponymous findspot. Theexamination of all large axeheads ofAlpine jadein western Europe that was undertaken as part ofProgramme JADE has revealed that there aretwo possible associations between this axeheadtype and axeheads of Puy type; this means thatthe Pauilhac type axeheads should date to after4300 BC and may date to the very beginning of
Une hache de type Pauilhacau Grès Haut, Calvignac (Lot)
�
Bulletin Préhistoire du Sud-Ouest - n° 19/2011-2
198
the 4th millennium. This observation underlinesthe contrast between Pauilhac type axeheadsand those of Rarogne, Saint-Michel and Tumiactypes, which date from the mid-5th millenniumand are found in the giant ‘Carnac mounds’ ofthe Morbihan; the production of these axeheadtypes had ceased by 4000 BC. If one revisits thehypothesis, often proposed in the past, that stoneaxeheads with expanded blades, lateral excres-cences and straight sides evoke the copperaxeheads of the Carpatho-Balkans with theirexpanded blades, then the Pauilhac type jadeititeaxeheads constitute a more faithful copy of theircopper counterparts than do the axeheads ofSaint-Michel type. Furthermore, among Pauil-hac-type axeheads, ones with squared butts, likethis example from Grès Haut, appear to be theclosest copies of all. The distribution of this axe-head type corresponds fairly well with that ofthe Chassey culture and related groups (Auzay-Sandun and the Middle Neolithic groups ofAragon and Galicia), and it is integrated withinthe extensive exchange networks across whichraw materials and finished objects circulated.These networks are a hallmark of the Chasseyculture at the point of its maximum extent,during the first quarter of the 4th millennium.(Translated by A. Sheridan)
Keywords: Mont Viso jadeitite; large axeheadof Pauilhac type, Chalcolithic, Chasséen.
Resumen :Una nueva gran hacha en jadeitita alpina ha sidohallada fortuitamente en la pared de un antiguoaprisco durante unos trabajos de restauración.Debió ser colocada allí como piedra del rayopara proteger el edificio. Se trata de una granhacha de tipo Pauilhac de filo ensanchado ytalón cuadrado. Este hallazgo refuerza una con-
centración, ya notable, de este tipo en elSudoeste de Francia dónde se encuentran, for-tuitamente, ya sea de forma aislada o endepósito o bien en el famoso y enigmáticoyacimiento funerario de Pauilhac, en Gers. Larevisión de todos los hallazgos de hachas dejade en Europa occidental, emprendida en elmarco del programa JADE, muestra dos casosde asociaciones posibles del tipo Pauilhac conhachas de tipo Puy, lo que permite situarlodespués del 4300 aC. y probablemente a princi-pios del cuarto milenio. Esta observaciónconfirma la distinción con los tipos Rarogne,Saint-Michel y Tumiac, atestiguados desdemediados del quinto milenio en los túmulosgigantes de Carnac y cuya producción habíacesado antes del fin de ese milenio. De acuerdocon la hipótesis reiterada de que los filos exten-didos con apéndices laterales y los bordes rectosevocan fuertemente ciertas hachas metálicas defilo de pronunciada curvatura del Calcolíticocarpato-balcánico, la fidelidad de estas copiasen jade, en relación a sus modelos de cobre,sería más fuerte en el caso de las hachas de tipoPauilhac que en el de las hachas de tipo Saint-Michel; y, entre las hachas de tipo Pauilhac, lasde talón cuadrado, como el ejemplar del GrèsHaut, sería uno de los mejores ejemplos. Elreparto de este tipo coincide bastante bien con elárea de la cultura de Chassey y de las culturasemparentadas (Auzay-Sandun, Neolítico mediode Aragón y de Galicia) y se integra en lasgrandes redes de intercambios de materiales yde productos manufacturados, que caracterizanesta cultura en su etapa de mayor influencia, enel primer cuarto del cuarto milenio. (Traducidopor A. Martín Colliga)
Palabras claves: Jadeitita del Monte Viso, granhacha de tipo Pauilhac, Calcolítico, Chasseense.
Une hache de type Pauilhac au Grès Haut, Calvignac (Lot). Pages 197 à 213
199
La trouvaille d’une nouvelle grande hache en jadealpin constitue un évènement rare qui suscite toujoursautant d’intérêt que les premières découvertes qui ontémerveillé les préhistoriens du XIXe siècle. Bien que lenombre des pièces connues et publiées ait considéra-blement augmenté et s’élève aujourd’hui à près de1800 à l’échelle de toute l’Europe, la beauté et la raretédes matières premières et l’ampleur du travail defaçonnage confèrent à ces pièces une valeur quasimentemblématique de la période néolithique. Leur longueurdémesurée et leur très large distribution géographique,de la Mer Noire à l’Ecosse et des Pouilles à la Scandi-navie, indiquent qu’il ne s’agit pas de simples outils,mais plutôt de biens socialement valorisés, destinés àcirculer à longue distance et qui jouaient un rôle depremier plan dans le fonctionnement des sociétés néo-lithiques quelle que soit leur appartenance culturelle.Grâce au programme Jade, coordonné par P. Pétre-
quin de 2005 à 2010 et soutenu par l’Agence Nationalede la Recherche, les problématiques et les méthodesde recherche ont été renouvelées (Pétrequin et al.2012c). La caractérisation des jades, maintenant réali-sable en routine et sans prélèvement destructif grâceaux analyses spectroradiométriques (Errera et al. 2007,2012) a permis de distinguer plusieurs groupes pétro-graphiques, certains étant spécifiquement alpins(jadéitites, omphacitites et éclogites), d’autres pouvantavoir d’autres origines potentielles (néphrites). Lesprospections réalisées dans le massif du Mont Viso(70 km au sud-ouest de Turin) ont amplement confirméles intuitions de Damour (1881) sur l’origine piémon-taise de la plupart de ces jades précieux, mais ontrévélé d’autres centres de production, notamment dansle massif de Beigua-Voltri en Ligurie pour l’omphaci-tite, les éclogites et la jadéitite, et dans le Valais pourla néphrite (Pétrequin et al. 2005, 2012a).La constitution d’une base de données européenne
des lames de hache de plus de 13 cm de long a permisde proposer une typologie morphologique et techniquepour établir un modèle d’évolution chronologique etculturelle couvrant une longue durée, entre le 6e et le4e millénaire avant notre ère (Pétrequin et al. 2012b).La diffusion de lames en roches alpines jusqu’à lafameuse nécropole de Varna en Bulgarie impose uneperspective européenne globale pour la compréhensiondes interactions entre le Néolithique occidental et leChalcolithique ancien de l’aire carpato-balkanique(Pétrequin et al. 2012d). L’étude des contextes dedécouverte lorsqu’ils sont connus, complétée par l’ana-lyse des représentations figurées de l’art pariétalmégalithique du Morbihan (Cassen 2012b), a fournides clés d’interprétation sur le rôle de ces haches dansles dynamiques sociales (Pétrequin et al. 2009). Dansce domaine, d’autres référentiels ethnoarchéologiques-notamment ceux de derniers producteurs de hachespolies de la Nouvelle-Guinée (Pétrequin 2011)- ont été
utilisés avec succès et ont fourni d’utiles retours ouadaptations pour les recherches sur les ateliers de pro-duction ou sur l’organisation des modèles d’échanges.C’est donc dans ce cadre renouvelé que les nouvellestrouvailles doivent être replacées.
1/ La hache de Calvignac (Lot)
La hache de Calvignac a été découverte fortuite-ment par M. Bernard Kellett dans sa propriété du GrèsHaut, commune de Calvignac, Lot. Elle a tout d’abordété apportée à B. Defois, au Musée de Préhistoire deCabrerets pour authentification, puis elle a été exper-tisée comme une hache alpine de type Pauilhac etphotographiée au domicile des inventeurs par J.Vaquer, un cliché étant envoyé par courriel à P. Pétre-quin pour confirmation de la nature alpine de la roche.La trouvaille a alors été déclarée officiellement par lesinventeurs au Service régional de l’Archéologie deMidi-Pyrénées.
1/1 Circonstances de la trouvailleC’est en démolissant un mur de refend transversal
d’une ancienne bergerie bordant la cour du corps delogis ancien du domaine du Grès Haut, pour la trans-former en atelier, que M. Bernard Kellett a trouvé cettegrande lame de hache polie. Celle-ci était placée aumilieu du mur fait de blocs calcaires et de chaux àenviron 1,50 m de hauteur, ce qui indique évidemmentun dépôt intentionnel fait par les constructeurs de labergerie. Vu les conditions de la découverte tout à faitfortuite de la hache du Grès Haut dans le mur d’uneconstruction moderne, on ne peut que se perdre enconjectures sur son possible lieu de dépôt initial. Selontoute vraisemblance, il s’agit d’une trouvaille localeancienne qui a été placée volontairement dans le murde la bergerie du Grès Haut. Cette ferme est indiquéesur la carte de Cassini et existait déjà au XVIIIe siècle.Il faut donc admettre que c’est antérieurement que lahache a été enlevée de son emplacement d’origine etplacée dans le mur selon les croyances classiquesconcernant les céraunies.Le mot céraunie est tiré du grec et signifie « pierre
de foudre ». D’après G. Agricola (1494-1555) « lacéraunie tire son nom de ce que, selon l’opinion vul-gaire, elle tombe du ciel avec la foudre. Elle n’a nistries, ni lignes et diffère de la brontée », cette dernièreétant la « pierre à feu » (la pyrite de fer) nettementstriée et rugueuse. D’après Pline l’ancien (Histoirenaturelle L. XXXVII-51), il y aurait deux sortes decéraunies « une noire et une rouge. Il dit qu’elles res-semblent à des haches, que parmi ces pierres celles quisont noires et rondes sont sacrées, que par leur moyenon prend des villes et des flottes et qu’on les nommeBétules (ou boetyles), mais qu’on nomme cérauniescelles qui sont longues ». En vertu du principe que lafoudre ne tombe jamais deux fois au même endroit, ces
Bulletin Préhistoire du Sud-Ouest - n° 19/2011-2
200
Fig. 1 : Hache en jadéitite de type Pauilhac trouvée au Grès Haut, Calvignac (Lot) dans un mur de la Bergerie de M. Kellett (cliché et montageJean Vaquer, CNRS).
Une hache de type Pauilhac au Grès Haut, Calvignac (Lot). Pages 197 à 213
201
Fig. 2 : Hache en jadéitite de type Pauilhac trouvée au Grès Haut, Calvignac (Lot) dans un mur de la Bergerie de M. Kellett (dessins JeanVaquer,CNRS).
Bulletin Préhistoire du Sud-Ouest - n° 19/2011-2
202
céraunies étaient souvent employées à des fins pro-phylactiques. Cette croyance a été rapportéenotamment par l’évêque de Rennes Marbode (1035-1123) « C’est seulement aux endroits qui ont étévisiblement frappés par la foudre que pense-t-on, onpeut trouver cette pierre, c’est pourquoi on l’appelled’après le grec céraunie, car ce que nous appelonsfoudre, les grecs l’appellent « ceraunos ». Ne serontfrappés par la foudre, ni celui qui la porte pieusement,ni une maison ou des propriétés où cette pierre setrouve déposée ». Ce genre de croyance a dû existerdans le Lot jusqu’à une époque récente ; d’après Men-nevée (1958), les haches polies trouvées sur le Caussede Gramat « étaient considérées comme des amulettespour la protection des troupeaux contre les épidémiesde la maladie du charbon. On les appelait « pierre dutacou » (ce qui en occitan veut dire talon mais ce motest employé pour qualifier la maladie du charbon) eton les suspendait dans une sonnaille au cou des mou-tons ». D’autres mentions font état de leur propriétéanti-foudre « Dans les étables et les bergeries, ellespassaient pour protéger de la foudre » (Soulié 1976).
1/ 2 Description de la hache du Grès HautLa lame de hache polie du Grès Haut est grande,
relativement bien conservée et ne présente quequelques petits enlèvements bifaciaux au tranchant(fig. 1 et 2). Elle a un corps trapézoïdal, avec un talonéquarri et un tranchant outrepassé, très convexe etélargi dont le raccord est marqué par des excroissanceslatérales assez prononcées. Avec ses bords droits, bienverticaux et délimité par des arêtes continues sur lesdeux faces — y compris au niveau du raccord avec letranchant -, cette hache présente une forme tout à faitsimilaire à celle d’une hache métallique à tranchantétalé. La section longitudinale n’est pas tout à faitsymétrique, une face étant plus arquée que l’autre. Lasection transversale est quadrangulaire à bords droitsverticaux et faces bombées. Ces caractères morpholo-giques permettent de l’attribuer au type Pauilhac dunom d’une commune du Gers qui en a livré deuxexemplaires retenus comme morphotypes éponymesdans la famille des haches alpines méridionales (Pétre-quin et al. 1997).Le type Pauilhac fait partie du groupe des haches
en roches alpines à tranchant élargi qui comporte d’au-tres types (Pétrequin et al. 2012b). Elle se distingue dutype Rarogne qui a une forme en cloche, mais avec untranchant moins convexe et des excroissances latéralesmoins prononcées et surtout qui présente une sectionplano-convexe. Elle se distingue aussi des types Saint-Michel ou Tumiac qui ont un tranchant nettement étaléavec des excroissances, mais qui présentent une sec-tion elliptique mince ou lenticulaire.La roche utilisée est une jadéitite (la jadéite étant le
principal constituant) vert clair, très laminée, avec
feuillets alternés vert moyen ou blanchâtre et nom-breux cristaux blancs de rétromorphose ; quelquesanciens grenats en atoll ont été observés ; cette rocheprésente aussi des marbrures vert foncé et au deux tierssupérieur une bande noirâtre homogène à texture trèsfine d’orientation transversale. Par comparaison avecles échantillons naturels du référentiel JADE, l’originede cette jadéitite est certainement le MontViso et peut-être les exploitations du col Barant, au nord de cemassif (Pétrequin et al. 2012a). Le spectroradiomètredu Musée royal de l’Afrique centrale utilisé par M.Errera étant indisponible, aucune analyse spectrora-diométrique n’a pu être réalisée jusqu’à présent.Les dimensions de la lame du Grès Haut sont rela-
tivement importantes par rapport aux autresexemplaires connus :Longueur : 286 mm (estimée 287 en raison des cas-
sures au tranchant),Largeur à la corde du tranchant : 85 mm (estimée
en raison des cassures de l’excroissance gauche),Largeur au talon : 31 mm,Epaisseur maximale : 27 mm,Flèche de l’arc du tranchant : 37 mm.
Le caractère le plus original de la hache du GrèsHaut est son talon équarri qui lui confère une ressem-blance morphologique très forte avec une hache plateen cuivre. Ce caractère n’est pas très fréquent dans legroupe des haches de type Pauilhac (fig. 3), qui pos-sédent le plus souvent un talon conique comme celledu Doul à Peyriac-de-Mer (Héléna 1937) ou un talonconvexe comme celle du Musée de Lectoure, voireoblique comme celle de Pauilhac (Cantet 1991). Il n’ya guère que la hache de Sept Saints à Erdeven dans leMorbihan qui a un talon sub-rectangulaire commecelle de Calvignac (Le Rouzic 1928).
2/ Le contexte néolithique local du Grès Haut et deCalvignac (Lot)
Dans l’ouvrage « Le Lot Préhistorique » de J.Clottes (1969), aucune découverte marquante concer-nant le Néolithique n’est signalée à Calvignac. Lesseuls sites préhistoriques inventoriés dans la communesont des dolmens. Au nombre de six, ils sont pour laplupart situés sur le causse à l’Ouest du Grès (Clottes1978). Il s’agit de dolmens caussenards dont la cham-bre est bordée de deux grands montants avec une dallede chevet engagée et une dalle de couverture uniqueou double. Dans le Quercy, ces monuments dont lestumulus sont généralement arasés ; ont parfois livrédes lames de haches polies, mais elles sont générale-ment en roches locales ou régionales et de dimensionsmodestes. De toutes façon, ces monuments sont attri-bués au Néolithique final ou au Chalcolithique et nepeuvent être considérés comme des sites où des hachesde type Pauilhac pourraient avoir été trouvées. Dans la
Une hache de type Pauilhac au Grès Haut, Calvignac (Lot). Pages 197 à 213
203
Fig. 3 : Variabilité morphologique des grandes haches en roches alpines de type Pauilhac.n° 1 : Lauzit 2, Pauilhac, Gers (dessin J. Vaquer d’après J. Roussot Larroque), n° 2 : Le Grès Haut, Calvignac, Lot (dessin J. Vaquer d’aprèsl’original), n° 3 : Lauzit 2, Pauilhac, Gers (dessin J. Vaquer d’après J. Roussot Larroque), n° 4 : Arthez-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques (dessinJ. Vaquer d’après J. Roussot Larroque), n° 5 : Sept Saints, Erdeven, Morbihan (dessin J. Vaquer d’après Z. Le Rouzic), n° 6 : Conté, Alan,Haute-Garonne (dessin J. Vaquer d’après F. Briois).
Bulletin Préhistoire du Sud-Ouest - n° 19/2011-2
204
région, quelques découvertes de grandes lames dehaches polies ont été signalées dans d’autres types desites. La hache publiée par l’abbé Bergougnoux (1887)provient de la grotte de Conduché à Bouziès (Lot) ;elle mesurait 15 cm de long, 10 cm de large au tran-chant et serait en serpentine. D’autres étaientregroupées dans des dépôts, comme celui de Carboniéà Sauliac-sur-le-Célé (Lot), qui se composait de troishaches en roche volcanique mesurant 22, 19 et 16 cmde long et d’une « en silex » ne mesurant que 10 cm delong ; ce dépôt a été mis au jour fortuitement en creu-sant une fosse à purin dans une écurie ; toutes leshaches avaient des bords droits et ressemblaient à deshaches plates métalliques d’après A. Lémozi (1952).C’est probablement ce genre de contexte qu’il fautenvisager comme lieu possible de dépôt initial de lahache du Grès Haut, à moins qu’il ne s’agisse de ladotation d’une sépulture particulièrement riche,comme celle dont la présence a été supposée sur le sitede Pauilhac (Gers).
3/ Mise en contexte à l’échelle du Néolithiqueoccidental
La trouvaille de la hache du Grès Haut n’apporteaucune information nouvelle quant aux problèmes dedatation et d’attribution culturelle de ce type de hache,ni même à celui de leur fonction. Il faut donc se tour-ner vers les études globales ou vers d’autres contextesmieux documentés pour trouver des arguments de dis-cussion sur ces questions.
3/1 Chronologie de type PauilhacSelon S. Cassen et al. (2011) et P. Pétrequin et al.
(2012b), la parenté morphologique entre le type Saint-Michel et le type Pauilhac permettrait d’envisager unlien fort entre ces deux types, qui se succèderaient rapi-dement et dateraient du milieu duVe millénaire dans lecas de Saint-Michel et de la fin duVe (postérieurementà 4300 av. J.-C.) pour Pauilhac. Les arguments avancéssont la présence du type Saint-Michel au sein descaveaux des tumulus géants de Mané er Hroëk à Loc-mariaquer, du Mont-Saint-Michel à Carnac et deTumiac à Arzon (Morbihan), attribués au Castellicancien et bien daté, dans le cas de Saint-Michel, dans lafourchette chronologique 4600-4300 (Cassen 2012a).Pour ce qui est du type Pauilhac, sa proximité typolo-gique avec le type Puy (le plus tardif dans la séquenceévolutive des grandes haches alpines) et, dans un cas,son association possible avec une hache de type Puy àPeyriac-de-Mer (Aude), ne permet pas de le dater anté-rieurement à 4300 (apparition du type Puy en Italie duNord), ni postérieurement à 3800 (disparition du typePuy dans le Cortaillod de Suisse occidentale) (Pétre-quin et al. 2012b, avec références plus anciennes).Si l’on admet que les tranchants outrepassés avec
appendices latéraux nettement marqués de ces haches
ont un rapport avec des haches de cuivre (inspirationou imitation), cette position chronologique haute pourle type Saint-Michel impliquerait des contacts pré-coces et des liens avec le Chalcolithique ancien del’Europe balkano-carpatique, d’abord par le biaisd’importations en Italie du Nord dès 4600-4500 av. J.-C., puis du fait de l’introduction de la premièremétallurgie du cuivre dans cette région vers 4300(Klassen et al. 2012). D’ailleurs, des effets miroirsentre les deux extrémités de l’Europe rendraientcompte des similitudes stylistiques constatées entrecertains éléments de parure de la nécropole deVarna etdes motifs de l’art des stèles du Néolithique moyen 1atlantique, notamment le motif du bovin aux cornes enlyre et pieds « en pantoufles », les crosses, les signesen U et les corniformes (Cassen et al. 1992, Cassen etPétrequin 1999).C’est en considérant les deux lots d’objets trouvés
en 1865 à Pauilhac (Gers) comme provenant d’unensemble homogène que J. Roussot-Larroque a pro-posé une position chronologique récente pour les deuxhaches de type Pauilhac du site éponyme (Roussot-Larroque 2008a). Si la provenance de ces deux lotsd’objets n’est guère douteuse — dans une gravièreexploitée pour la construction du remblai de la voie dechemin de fer Agen-Auch-, les informations sur lanature véritable du gisement sont vagues (Bischoff etal. 1865) ou paraissent très romancées (notice accom-pagnant le don de la collection A. de Chasteigner auMusée d’Aquitaine, reproduite par J. Roussot-Lar-roque 2008a, p. 96, fig. 1). Dans sa relation de ladécouverte, Bischoff indique que la grande lame desilex se trouvait à 2 mètres de profondeur à côté d’unmur de moellons hourdés de terre et qu’elle était asso-ciée à des os décomposés dont des fragments decrânes, tandis que la grande hache polie en roche verteavait été trouvée à 15 mètres de là au milieu des gra-viers et tout à fait isolée (Bischoff et al. 1865). Le lotrécupéré par le comte A. de Chasteignier comportaitune autre hache en « jadéite », cinq grandes lames ensilex, un collier de sept perles olivaires en or, un « dia-dème » en forme de losange à côtés concaves réalisésur une plaque d’or ornée de lignes de points aurepoussé et deux défenses de sanglier perforées. Ceséléments auraient été trouvés dans la tombe d’un grandchef inhumé avec son cheval favori. De ces deux men-tions, celle de Bischoff semble la plus vraisemblable,car il a pu être directement informé de la trouvaille vusa fonction d’ingénieur des chemins de fer. Celle d’A.de Chasteignier par contre semble plus ou moins ima-ginaire et n’a jamais été publiée ; on ne sait d’ailleurspas par quel canal il s’est procuré ces objets, sans doutesoustraits par les ouvriers au moment de la découverteet vendus sans commentaire direct. Si l’on veut bienaccorder plus de confiance au témoignage de Bischoffqu’à celui du Comte de Chasteignier, il semble peu
Une hache de type Pauilhac au Grès Haut, Calvignac (Lot). Pages 197 à 213
205
probable —vu la distance qui séparait les deux trou-vailles- que la hache du premier lot ait pu faire partiede la même dotation funéraire que celle de la grandelame en silex de Forcalquier. Il pourrait donc y avoir euau moins deux assemblages à Pauilhac.Passant en revue les divers types d’objets de
Pauilhac et en établissant des comparaisons à grandeéchelle, J. Roussot-Larroque a pris le parti de la syn-chronie des divers types d’objets de ces deuxcollections, qu’elle situe dans le premier tiers du qua-trième millénaire (Roussot Larroque 2008a). Lesarguments de cet auteur pour un tel positionnementsont les suivants.
Si les haches en jadéitite alpine de type Pauilhacavec leurs bords dressés et leur tranchant outrepassésont des copies de haches plates à tranchant étalé ; lesmodèles métalliques copiés pourraient être des hachesdu type nord alpin oriental Gurnitz (Autriche) ou destypes apparentés (Szákalhát en Hongie, Handlovà enSlovaquie, Bocca Lorenza en Italie du Nord) quidatent, de l’avis de l’auteur, du début du quatrième mil-lénaire.Les six grandes lames en silex de Forcalquier ana-
lysées finement, selon les critères technologiques de J.Pelegrin, présentent une grande régularité et une épais-seur faible pour une grande longueur avec un profil peuarqué et des talons très réduits à bulbe fissuré, indi-quant un mode de débitage par pression au levier avecune béquille armée d’une pointe de cuivre (Pelegrin2006). Pour ces éléments, il est désormais acquis quequelques lames en silex de Forcalquier ont été diffu-sées en même temps que des lames en silex blondbédoulien dans les ensembles du Chasséen méridionalclassique et récent au moins jusqu’en Toulousain, aucours de la première moitié du quatrième millénaire(Gandelin et al. 2006). La présence d’un grattoir surun fragment de lame en silex de Forcalquier dans lepuits chasséen de Villeneuve-Tolosane est un témoi-gnage très probant. Dans ces séries homogènes, ellessont toutefois très rares, au point qu’il est encore bienpérilleux d’évoquer un mode débitage par pression aulevier et à la pointe de cuivre. À Cugnaux, le seul élé-ment qui le suggère a été trouvé au cours de la fouillemécanique d’un fossé du Chasséen garonnais clas-sique. Cette attestation mériterait à notre sens d’êtreconfirmée par des trouvailles faites dans de meilleuresconditions. En Provence, près des lieux d’exploitationdu silex oligocène rubané, la production de telles lamesa pu débuter au Chasséen récent /terminal (grotte duPertus II de Méailles, Alpes-de-Haute-Provence, ren-seignement de C. Lepère). Toutefois à l’échelle duMidi, c’est surtout au Néolithique final que les lamesde très grandes dimensions comme celles de Pauilhacont été couramment diffusées (Vaquer et Remicourt2009).
La plaque losangique en tôle d’or a été comparée àdes pendentifs en or issus du trésor de Moigrad / Tis-zaszöllos et à un exemplaire en schiste du site deHlinsko en Moravie qui sont attribués à l’horizonBodrogkerestur daté au premier quart du quatrièmemillénaire. Ces trois éléments de référence sont effec-tivement semblables, mais ils portent des figurationsd’attributs sexuels féminins explicites et des perfora-tions au sommet qui indiquent un mode de suspensionbien différent de l’exemplaire de Pauilhac. En fait laparure de Pauilhac est unique à la fois par sa concep-tion technologique et par son décor, ce qui ne permetpas de trouver de parallèle tout à fait convaincant pourla dater (Klassen et al. 2012).Les perles biconiques très allongées en or peuvent
évidemment dater du début du quatrième millénaire sil’on envisage des contacts avec des cultures lointainesde l’Europe orientale, bien qu’aucune comparaisontotalement convaincante ne soit connue (Klassen et al.2012). Toutefois, dans le Midi de la France, des perlesde ce type sont attestées dans plusieurs monumentsmégalithiques du Néolithique final : hypogée du Cas-tellet à Fontvieille dans les Bouches-du-Rhône ;dolmen de Sauzet 1 à Cazevieille, Hérault ; dolmen deSaint-Eugène, Laure-Minervois, Aude ; dolmen duPouyMayou, Bartrès, Hautes-Pyrénées et il serait doncplus facile de les dater de cette période.Les pendentifs sur défenses de suidés à perforation
simple ou multiples sur la racine sont bien attestés dansles contextes chasséens du Midi, notamment dans plu-sieurs sépultures du Chasséen récent garonnais deVilleneuve-Tolosane et de Cugnaux (Vaquer et al.2008). Il faut noter cependant que les exemplaireschasséens sont faits généralement sur des lamellestirées de défenses fendues longitudinalement et façon-nés par polissage, ce qui n’est pas le cas à Pauilhac oùles canines entières n’ont été abrasées qu’au niveau desperforations. Dans les contextes chasséens nord-pyré-néens, il n’y a guère que la tombe de Las Faïchos/Picde Brau à Cournanel (Aude) qui ait livré deux défensesentières, mais celles-ci sont fragmentées au niveau dela racine et ne présentent pas de perforation (Guilaineet Muñoz 1963). La situation est pratiquement iden-tique en Catalogne, notamment dans le Solsonien, oùlorsqu’il s’agit de défenses refendues on observe despièces à une ou à deux perforations par exempleVinyade Pico à Solsona ou Costa del Garric II à Pinell ; maislorsque les défenses sont entières, elles ne présententaucune trace de perforation : El Llord 1 à Castellar dela Ribera (Castany i Llussa 2008). Dans le Midi de laFrance, de tels pendentifs sur défenses non refendueset biforés ne sont attestés en fait que dans des sites duNéolithique final ou Chalcolithique : grotte du Salpê-tre de Coutach, Sauve, Gard et sépulture d’Eyriac,Lussas, Ardèche (Barge 1982).
Bulletin Préhistoire du Sud-Ouest - n° 19/2011-2
206
Notre opinion au sujet de Pauilhac est que l’hypo-thèse d’un ensemble unique à positionner dans lapremière moitié du quatrième millénaire avant notreère est certes plausible, mais n’est pas la seule envisa-geable. Si l’on se fie au témoignage de Bischoff quisemble plus recevable que celui du Comte de Chastei-gnier, on peut douter que les haches en jadéitite aientété associées aux autres objets, qui pourraient toutaussi bien être datés du Néolithique final. S’il s’agis-sait bien d’un monument funéraire, il ne serait pasaberrant de penser qu’il ait pu avoir une longue duréed’utilisation et qu’il ait pu recevoir des dépôts d’âgesdifférents. Non loin de Pauilhac, le cas de la Halliadeà Bartrès, Hautes-Pyrénées — bien que conçu commeun alignement de cellules funéraires indépendantes-est là pour témoigner qu’un même monument a puregrouper des sépultures qui s’échelonnent sur une trèslongue durée ; plus d’un millénaire, dans ce cas là, duNéolithique récent final jusqu’au Bronze moyen(Mohen 1976). Dans cette hypothèse, la question de ladatation des deux haches en jadéitite de Pauilhac res-terait évidemment posée.
La difficulté à dater les deux haches du site épo-nyme de Pauilhac ne rendent pas pour autant caduquesles comparaisons avancées d’abord par P. Pétrequin etal. (2002), puis par J. Roussot-Larroque (2008) aveccertaines haches plates en cuivre à tranchant étalé duChalcolithique d’Europe centrale et orientale. Mais,tout en reconnaissant le synchronisme entre uneEurope du jade et une Europe du cuivre, L. Klassen etal. (2012) ont discuté plus en détail des sérieuses dif-ficultés posées par des comparaisons tropapproximatives entre haches de pierre et haches decuivre ; pour le détail de l’argumentation, le lecteurvoudra bien se reporter à ce dernier travail qui est lamise au point la plus récente sur le sujet.Le recensement des haches de type Pauilhac, entre-
pris dans le cadre du programme Jade par P. Pétrequinet al. (2012b) fait état de 26 exemplaires, dont 20typiques, en plus de celui de Calvignac. Ces exem-plaires sont principalement répartis en France et enEspagne du Nord-Ouest, hormis une préforme qui pro-vient des exploitations du col Barant (Bobbio Pellice,Piémont) sur le versant italien du Mont Viso. La plu-
Fig. 4 : n° 1 et 2, les haches en roches alpines du dépôt du Doul, Peyriac-de-Mer, Aude et n° 3 : une autre de Peyriac-de-Mer, faisant partie elleaussi de la collection H. Rouzaud, conservée au Musée de Narbonne (dessins J. Vaquer, CNRS).
Une hache de type Pauilhac au Grès Haut, Calvignac (Lot). Pages 197 à 213
207
part de ces haches ont été trouvées isolément, sansaucun élément susceptible d’être daté.Toutefois, dans deux cas au moins, une association
possible avec d’autres grandes haches alpines de typedifférent est probable. Le premier cas, bien connu, estcelui du dépôt du Doul trouvé à Peyriac-de-Mer(Aude) qui fait partie de la collection H. Rouzaudconservée au Musée de Narbonne avec l’indicationcoll. Rouzaud 1911 (fig. 4). Ce dépôt associe unegrande hache de type Pauilhac en jadéitite du MontViso (mesurant 34,9 cm) à une grande hache de typePuy qui est en néphrite verte probablement originairedu Valais et qui mesure 33,6 cm de long. Une autrehache de type Puy qui mesure 20,4 cm provenant dePeyriac-de-Mer figure aussi dans la collection H. Rou-zaud du Musée de Narbonne (inventoriée 3615) ; ellea pu faire partie du même dépôt, mais elle ne porte pasla même mention que les autres et n’a pas été signaléepar Ph. Héléna dans sa publication principale sur « lesorigines de Narbonne », ce qui pourrait signifierqu’elle a été trouvée ailleurs dans la commune. Lecontexte de découverte de ces haches est mal connu etl’existence d’un tumulus mentionnée par Ph. Héléna(1937) paraît très hypothétique. D’après le témoignaged’un archéologue amateur local, Henri Barbouteau, ceshaches auraient été trouvées au nord de l’île du Doul,non loin de la station de l’Ilette qui est un site d’habi-tat du groupe de Bize, lequel correspond à un facièsparticulier du Chasséen à placer à la charnière du cin-quième et du quatrième millénaire, ce qui serait uncontexte plausible (et non démontrable) pour le dépôt.En Languedoc, un autre couple possible de grandes
haches alpines a pu exister à la grotte du Pontil à Saint-Pons-de-Thomières (Hérault). Il s’agit d’une entrée decaverne dont une partie de la voute effondrée a laisséun pont naturel. En avant de la grotte, les travaux decarrière réalisés pour extraire du cailloutis destiné à laconstruction de la route départementale 907, Saint-Pons-La-Salvetat, ont occasionné des découvertes derestes de faune quaternaire au XIXe siècle, qui ont faitl’objet d’une étude par le géologue P. Gervais (1867).Parmi les remarquables dessins de cette publication,figure la moitié d’une grande hache de type Puy déter-minée comme en « chloromélanite » (éclogite) parDamour en 1866, puis comme en « jadéite » dans unepublication ultérieure (Damour et Fischer 1878). C’estdans le talus en avant de la grotte lors de travauxd’élargissement de la route que près d’un siècle plustard, G. Rodriguez a eu la chance de trouver une hachede type Pauilhac entière en jadéitite, aujourd’hui lefleuron du Musée de Saint-Pons-de-Thomières (fig. 5)(Grimal et al. 2006).Si l’on considère ces deux associations typolo-
giques comme valables, malgré les incertitudes quisubsistent sur les conditions de découverte, il faut envi-sager un synchronisme au moins partiel entre les types
Fig. 5 : Les deux haches en roches alpines de la grotte du Pontil àSaint-Pons-de-Thomières, Hérault (dessins de J.Vaquer, CNRS, n° 1d’après Gervais 1867, n° 2 d’après l’original).
Bulletin Préhistoire du Sud-Ouest - n° 19/2011-2
208
Pauilhac et Puy, sinon pour la production, du moinspour la circulation et la manipulation de ces pièces pré-cieuses qui ont pu être thésaurisées longtemps avantd’être enfouies. Tandis que les haches de type Pauilhacn’ont pas de contextes bien datables, les haches de typePuy, elles, peuvent être datées plus précisément (voirargumentation détaillée in : Pétrequin et al. 2012b) :leur première apparition en Italie du Nord correspondà la première métallurgie locale du cuivre vers 4300av. J.-C.Plus près de l’aire géographique qui nous concerne,
en Catalogne en particulier, leur présence dans destombes en fosse ou en cistes de pierre permet une attri-bution à la culture des « Sepulcres de fossa », dont lachronologie couvre la fin du Néolithique moyen 1 ettout le Néolithique moyen 2 soit de 4200 à 3500 av. J.-C. L’exemplaire de longue hache alpine de type Puy leplus fameux en Catalogne est celui de la tombe en cistede la Bisbal d’Empordà (Girona), mais en fait il est peuutile pour le positionnement chronologique de ce type,puisqu’il n’était accompagné d’aucun autre élément demobilier. D’autres exemplaires plus petits, mais dutype Puy également, sont attestés dans les tombes lesplus richement dotées du Vallès près de Barcelone,notamment à la Bòbila Madurell M5, Sant Quirze delVallès, à La Bòbila Padrò de Ripollet ou à la Bòbilad’en Joca à Montornès del Vallès dans des tombes detype 3, voire 4 mais jamais de type 5 (Martín Colliga2009, Vaquer et al. 2012). Ces tombes en fosse sontdatables du premier quart du 4e millénaire grâce à latypologie du mobilier associé, notamment celle despièces en silex blond bédoulien chauffé provenant duVaucluse et des céramiques. Les deux cas d’associa-tion des types Puy et Pauilhac pourraient signifier quele type Pauilhac, dont l’apparition pourrait être situéevers la fin du Ve millénaire, a pu passer le cap desannées 4000 av. notre ère.
3/2 Répartition géographique du type PauilhacOutre une possible connexion chronologique entre
les haches de type Pauilhac et la période d’expansionmaximale des influences chasséennes, celle-ci pour-rait se doubler d’une connexion d’ordre géographique.La carte établie d’après l’inventaire de la base de don-nées du programme JADE (Pétrequin et al. 2012b)montre en effet qu’hormis les exemplaires trouvés au-delà des Pyrénées en Aragon et en Biscaye, larépartition des haches de type Pauilhac cadre bien avecl’extension du Chasséen et les cultures apparentées à lafin du cinquième et au début du quatrième millénaire.Cet inventaire s’établit ainsi :
Espagne1/ Dima, Villaro, Biskaia, une typique, L : 25,8 cm
(Vasco, MuseoArqueologico, Etnografico e Historico,Fabregas Valcarce et al. 2012)
2/ Sadaba, Zaragoza, Aragon, une typique, L.34,2 cm (Musée archéologique national de Madrid,Fabregas Valcarce et al. 2012).
France3/ Arthez-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques, une
typique, L : 34,9 cm (Roussot-Larroque 2008b),4/ Guerre, Eauze, Gers, un fragment de tranchant
(Musée d’Eauze, Duclos 1989),5/ Gravière de Lauzit, Pauilhac, Gers, deux
typiques, L. 27,8 cm et 25,3 cm (Bischoff et al. 1865,Roussot-Larroque 2008a),6/ Nougaroulet ?, Gers, une typique, L : 22,8 cm
(Musée de Lectoure, Cantet 1991),7/ Conté, Alan, Haute-Garonne, une typique, L :
24,8 cm (Ferré 2000),8/ Toulouse, Haute-Garonne, petite atypique, L :
15 cm (coll. Fillon, Muséum de Toulouse, de Mortillet1891),9/ Grotte du Pontil, Saint-Pons-de-Thomières,
Hérault, une entière typique, L. : 27,6 cm, associée àune Puy cassée ? (Gervais 1867 et Grimal et al. 2007),10/ Le Doul, Peyriac-de-Mer,Aude, une entière, L.
34,5 cm, associée à une, voire deux haches de type Puy(Musée de Narbonne, Héléna 1937),11/ Le Grès Haut, Calvignac, Lot, une entière
typique, L. : 28,7 cm (trouvaille A. et B. Kellett, danscet article),12/ La Roche Blanche, Puy-de-Dôme, une entière
atypique, L. 13,5 cm (Musée Bargoin, Clermont-Fer-rand, renseignement P. Pétrequin),13/ Village du Peu, Saint-André-Goule-d’Oie,
Vendée, une typique, L. 20 cm (Vincent et Jauneau2007),14/ Le Châtenay, Saint-Denis-La-Chevasse,Vendée,
une atypique, L. 16,8 cm (Historial de laVendée, Lucs-sur-Boulogne, renseignement P. Pétrequin),15/ Sept Saints, Erdeven, Morbihan, une typique,
L. 29 cm (Musée de Carnac, Le Rouzic 1928),16/ La Pouardière, Lalleu, Ile-et-Vilaine, une
typique, L. : 17,5 cm (Leroux 1986),17/ Mene ar C’holiou, Plomelin, Finistère, une
typique, L. : 23,8 cm (Pailler 2007),18/ Chamault, Souppes-sur-Loing, Seine-et-Marne,
une typique, L. : 23,8 cm (Musée de Préhistoire deNemours, renseignement N. Le Maux),19/ Bourgogne, placée à Dijon, Côte-d’Or, une
typique 25,2 cm (conservée au Musée des Beaux Artsde Besançon, renseignement P. Pétrequin),20/ Dragage de la Saône, Maconnais, Macon,
Saône-et-Loire : un typique, L. 17 cm (musée deMacon, renseignement C. Bontemps),21/ Seurre, Côte-d’Or, une typique, L. : 23,8 cm
(coll. particulière, vue par J.-P. Thevenot),22/ Ile Saint Jean, Feillens, Ain, une atypique, L.
14,5 cm (Jeanton et Lafay 1918),
Une hache de type Pauilhac au Grès Haut, Calvignac (Lot). Pages 197 à 213
209
Fig. 6 : carte de répartition des haches de type Pauilhac en Europe occidentale (d’après l’inventaire de la base de données du programme Jade(réalisation J. Vaquer d’après les informations de P. Pétrequin).1/ Dima, Villaro, Biskaia, Espagne ; 2/ Sádaba, Zaragoza, Aragon, Espagne ; 3/ Arthez-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques ; 4/ Guerre, Eauze,Gers ; 5/ Gravière de Lauzit, Pauilhac, Gers, deux ; 6/ Nougaroulet ?, Gers ; 7/ Conté, Alan, Haute-Garonne ; 8/ Toulouse, Haute-Garonne ; 9/Grotte du Pontil, Saint-Pons-de-Thomières, Hérault ; 10/ Le Doul, Peyriac-de-Mer, Aude ; 11/ Le Grès Haut, Calvignac, Lot ; 12/ La RocheBlanche, Puy-de-Dôme ; 13/ Village du Peu, Saint-André-Goule-d’Oie, Vendée ; 14/ Le Châtenay, Saint-Denis-La-Chevasse, Vendée ; 15/ SeptSaints, Erdeven, Morbihan, une typique ; 16/ La Pouardière, Lalleu, Ile-et-Vilaine ; 17/ Mene ar C’holiou, Plomelin, Finistère ; 18/ Chamault,Souppes-sur-Loing, Seine-et-Marne ; 19/ Bourgogne, placée à Dijon, Côte-d’Or ; 20/ Dragage de la Saône, Maconnais, Macon, Saône-et-Loire ;21/ Seurre, Côte-d’Or ; 22/ Ile Saint Jean, Feillens, Ain ; 23/ Pied du Mont Cenis, Lanslevillard, Savoie ; 24/ Pranlary, Vals, Haute-Loire ; 25/Dauphin, Alpes-de-Haute-Provence ; 26/ L’Holade, La Renaudie, Puy-de-Dôme, 27/Atelier de Barant, Bobbio Pellice, Torino, Piemonte, Italie
Bulletin Préhistoire du Sud-Ouest - n° 19/2011-2
210
23/ Pied du Mont Cenis, Lanslevillard, Savoie, unfragment à tranchant évasé (Rey et Thirault 1999),24/ Pranlary, Vals, Haute-Loire, 17,3 cm (Déche-
lette 1908)25/ Dauphin,Alpes-de-Haute-Provence, uneentière typique, L. 25 cm (renseignementA.-C. Gros),26/ L’Holade, La Renaudie, Puy-de-Dôme, une
ébauche typique en cours de polissage, stigmates desciage pour les côtés et l’élargissement du tranchant, L.= 27,9 cm (Clermont-Ferrand, Musée Bargoin, rensei-gnement P. Pétrequin).
Italie27/Atelier de Barant, Bobbio Pellice, Torino, Pie-
monte, une préforme, L. 24 cm (prospection A.-M. etP. Pétrequin, Pétrequin et al. 2012).
La carte réalisée (fig. 6) montre une répartition quin’obéit pas au modèle de répartition des biensd’échanges ayant une valeur d’usage courant (Pétre-quin et al. 2012b). Celui-ci présente généralement desrépartitions polarisées sur la source d’exploitation etles ateliers de production dans un rayon qui n’excèdepas 300 km pour les matériaux ou produits de meil-leure qualité en situation d’exclusivité et avec desproportions qui décroissent soit en fonction de la dis-tance au delà de 300 km, soit moins loin lorsqu’il yavait des situations de concurrence avec d’autressources ou d’autres zones de production (Renfrew1975)C’est une tout autre configuration que présente la
carte, puisque le nombre de trouvailles est faible dansla zone inférieure à 300 km de la source (7 occur-rences, soit une préforme, 2 haches atypiques et 4typiques), elle est élevée dans la zone entre 300 et600 km (soit une ébauche en cours de polissage, 2 aty-piques et 11 typiques) et encore très notable dans lazone entre 600 et 900 km (soit 8 typiques de grandedimension). Une telle répartition n’a pu concerner quedes produits de très haute valeur, destinés à une diffu-sion restreinte pour des personnes éminentes ou desobjectifs très ciblés et à grande distance. Dans lesmodèles théoriques de C. Renfrew, elle correspondraitaux échanges entres élites par émissaire spécial.Par ailleurs, la distribution géographique des
haches en roches alpines de type Pauilhac est nette-ment décentrée par rapport au lieu de production quicorrespond certainement aux gîtes de jades du MontViso ; en effet, elle ne concerne que les régions situéesà l’ouest des Alpes avec des axes forts en direction duSud-Ouest franco-ibérique, de l’Ouest atlantique de laFrance et, dans une moindre mesure, du Nord-Ouestbourguignon et parisien (Pétrequin et al. 2012b). Cettedissymétrie nous semble mériter une explicationnotamment par rapport à la répartition des haches enroches alpines de type Puy qui ont une répartitionbeaucoup plus équilibrée en Europe occidentale avec
notamment des attestations en Italie du Nord, en Cata-logne et surtout en Allemagne et au Danemark(Airvaux et al. 2006). Si l’on tient compte du fait qu’àla période que nous considérons comme la plus pro-bable pour la production des haches de type Pauilhac(fin du cinquième et début du quatrième millénaire),des haches en cuivre produites en Europe centrale oudu Sud-Est auraient déjà été introduites en Italie duNord, l’absence de hache en jade de type Pauilhac danstoutes les régions situées à l’est du Mont Viso trouve-rait une explication très plausible. Dans le cadre decette hypothèse, la diffusion des haches en jades alpinsvers l’Est aurait été bloquée par la préférence accor-dée aux importations d’objets en cuivre (Klassen et al.2012). Et par contre-coup, la production des haches detype Pauilhac (mais aussi de type Puy) aurait alors étéinfluencée par ces modèles métalliques connus desproducteurs du Mont Viso.Ce phénomène bien connu et qui débute dès le
milieu du cinquième millénaire (avec les haches enjades de type Rarogne, Saint-Michel et Tumiac), illus-tre clairement l’opposition entre deux Europe : celledu jade à l’ouest et celle du cuivre à l’est qui se sontd’abord développées indépendamment avant d’entreren concurrence (Pétrequin et al. 2002, 2012b). À latransition entre cinquième et quatrième millénaires, lahache de type Pauilhac indiquerait un dernier sursautdes producteurs alpins avant l’affaiblissement pro-gressif de la symbolique des jades, devant la pousséecroissante du Chalcolithique d’Europe centrale et sud-orientale. Ce processus est amplement décrit dans L.Klassen et al. 2012.
Conclusion
La trouvaille d’une nouvelle hache en roche alpinede type Pauilhac en Quercy, en position secondairedans un mur de bergerie, n’apporte pas d’informationnouvelle sur la chronologie et la fonction de ce type debien très valorisé et assurément emblématique desélites du Néolithique occidental. Cette trouvaille ren-force une concentration déjà notable de ce type dans leSud-Ouest de la France où il se rencontre soit fortuite-ment à l’état isolé, soit en dépôt ou bien dans le célèbremais énigmatique site funéraire de Pauilhac, Gers.La révision de toutes les trouvailles de haches en
jades en Europe occidentale, entreprise dans le cadredu programme JADE, montre deux cas d’associationspossibles avec des haches de type Puy, ce qui incite àplacer le type Pauilhac certainement après 4300 av. J-C. et probablement à l’aube du quatrième millénaire.Cette observation confirme la distinction avec les typesRarogne, Saint-Michel et Tumiac, attestés dès le milieudu cinquième millénaire dans les tumulus géants car-nacéens et dont la production avait cessé avant la fin dumillénaire.
Une hache de type Pauilhac au Grès Haut, Calvignac (Lot). Pages 197 à 213
211
Si l’on retient l’hypothèse mainte fois émise queles tranchants outrepassés à excroissances latérales etles bords droits évoquent fortement certaines hachesmétalliques à tranchant étalé du Chalcolithique car-pato-balkanique (phase de la métallurgie lourde ducuivre, c’est-à-dire une métallurgie centrée sur l’ex-ploitation des minerais oxydés, mais pouvant avoirdéjà une productivité notable vu la facilité d’exploita-tion et de réduction de ces minerais, Strahm (2007), lafidélité de ces copies en jade par rapport à leursmodèles serait plus forte dans le cas des haches de typePauilhac que des haches de type Saint-Michel ; etparmi les haches de type Pauilhac, celles à talonéquarri comme l’exemplaire du Grès Haut en serait undes meilleurs exemples.Si l’on positionne grosso modo les haches de type
Pauilhac vers la transition cinquième- quatrième mil-lénaire ou même un peu après, la répartition de ce typecoïnciderait assez bien avec l’aire de la culture chas-séenne et des cultures apparentées (Auzay-Sandun etNéolithique moyen encore mal connu d’Aragon et deGalice) et s’intègrerait aux grands réseaux d’échangesde matériaux et de biens façonnés, qui en effet carac-térisent cette culture dans son étape de plus grandrayonnement, dans le premier quart du quatrième mil-lénaire. La diffusion des haches en roches alpines detype Pauilhac dans les divers faciès régionaux de laculture chasséenne au cours de son étape classiqueaurait été synchrone de celles des haches de type Puyet parfois couplée à celle-ci ; le type Pauilhac pourraitreprésenter alors un haut de gamme inspiré par leshaches en cuivre du Chalcolithique d’Europe centraleou sud-orientale. De telles longues lames polies enjades alpins auraient alors été destinées aux élites desrégions les plus dynamiques du domaine chasséen,notamment les zones de peuplement récent et celles oùl’élevage des bovins permettait une forte accumulationde richesses et des dynamiques sociales beaucoup plusactives et hiérarchisées.
Bibliographie
AIRVAUX J., BERJONNEAU P., CASSEN S., GAUTHIER E.et PÉTREQUIN P. 2006 – La grande hache polie de laReversaie, commune de Romagne (Vienne). Préhistoire duSud-Ouest, n° 13, 2006-2, p. 173-177, 2 fig.
BARGE H. 1982 – Les parures du Néolithique ancien au débutdes Ages des métaux en Languedoc. Editions du CNRS,1982, 396 p.
BERGOUGNOUX F. 1887 – Les temps préhistoriques enQuercy. Paris, Alcan, 1 vol., 50 p., 30 pl.
BISCHOFF E. et CANETO F. 1865 – Monuments de l’Age dePierre et de la période gallo-romaine dans la vallée du Gers.Revue de Gascogne, T. VI, Auch 1865, p. 389-396, 2 fig.
CANTET J.-P. 1991 – L’Age du Bronze en Gascogne gersoise.Archéologie, n° 4, édition Vesuna, Périgueux, 239 p.
CASSEN S. 2012 - L’objet possédé, sa représentation : mise encontexte général avec stèles et gravures. in : P. Pétrequin,S. Cassen, M. Errera, L. Klassen,A. Sheridan etA.M. Pétre-quin (ed.), Jade. Grandes haches alpines du Néolithiqueeuropéen. Ve et IVe millénaires av. J.-C. Cahiers de la MSHEC.N. Ledoux, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté et Centre de Recherche Archéologique de la Valléede l’Ain, tome 2, p. 1310-1353.
CASSEN S., BOUJOT C., DOMINGUEZ BELLA S., GUIA-VARC’HM., LE PENNEC C., PRIETOMARTINEZM.P.,QUERRÉ G., SANTROT M.E. et VIGIER E. 2012 –Dépôts bretons, tumulus carnacéens et circulations à longuedistance. in : P. Pétrequin, S. Cassen, M. Errera, L. Klas-sen, A. Sheridan et A.M. Pétrequin (ed.), Jade. Grandeshaches alpines du Néolithique européen. Ve et IVe millé-naires av. J.-C. Cahiers de la MSHE C.N. Ledoux,Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté etCentre de Recherche Archéologique de la Vallée de l’Ain,tome 2, p. 918-995.
CASSEN S. et L’HELGOUACH J. 1992 – Du symbole de lacrosse : chronologie, répartition et interprétation. in : Pay-sans et bâtisseurs. L’émergence du Néolithique atlantique etles origines du mégalithisme. Actes du 17e Colloque Inter-régional sur le Néolithique, Vannes 1990, RevueArchéologique de l’Ouest, supplément 5, p. 223-235.
CASSEN S. et PÉTREQUIN P. 1999 – La chronologie deshaches polies dites de prestige dans la moitié ouest de laFrance. European journal of archaeology, vol. 2 (1), p. 7-33.
CASSEN S., PÉTREQUIN P., BOUJOT C., DOMINGUEZBELLA S., GUIVARC’HM. et QUERRE G. 2011 – Meas-uring distinction in the megalithic architecture of the Carnacregion : from sign to material, in M. Furholt, F. Lüth, J.Muller et C. Scarre (ed.). Megalith and identities. ThirdEuropean megalithic studies group meeting, 13-15 may2010, Kiel, p. 1-49.
CASTANY I LLUSSÀ J. 2008 – Els megàlits neolithics del Sol-sonià. Tesi doctoral, departament d’història, Universitat deLleida, 12 décembre 2008, 886 p.
CLOTTES J. 1969 – Le Lot Préhistorique. Bulletin de laSociété des Etudes littéraires scientifiques et artistiques duLot. T. XC, 1969, n° 3-4, 285 p.
CLOTTES J. 1978 – Inventaire des mégalithes de la France : LeLot. Premier supplément à la revue Gallia Préhistoire,volume 5, Editions du CNRS, Paris 1977, 552 p.
DAMOUR A. 1866 – Sur la composition des haches en pierretrouvées dans les monuments celtiques et chez les sauvages.Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, LXIII, séancedu 17 décembre 1866, p. 1-13.
DAMOUR A. 1881 – Nouvelles analyses sur la jadéite et surquelques roches sodifères. Bulletin de la Société Françaisede Minéralogie, 4, p. 157-164.
DAMOURA. et FISCHER H. 1878 – Notice sur la distributiongéographique des haches et autres objets préhistoriques enjade néphrite et en jadéite. Matériaux pour l’Histoire pri-mitive et naturelle de l’Homme, 2e série, t. 9, p. 502-512.
DÉCHELETTE J. 1908 –Manuel d’archéologie préhistorique,celtique et gallo-romaine, I, Archéologie préhistorique.Paris, Librairie Picard.
Bulletin Préhistoire du Sud-Ouest - n° 19/2011-2
212
DUCLOS G. 1989 – Le peuplement préhistorique de la régiond’Eauze. in : Musée d’Eauze. Exposition temporaire desrichesses gallo-romaines d’Elusa, p. 11.
ERRERAM., PÉTREQUIN P., PÉTREQUINA.-M., CASSENS. et CROUTSCH S. 2007 – Contribution de la spectrora-diométrie à la compréhension des transferts longue distancedes lames de hache au Néolithique. Société tournaisienne degéologie, préhistoire et archéologie, X (4), p. 101-142.
ERRERA M., PÉTREQUIN P. et PÉTREQUIN A.M. 2012 –Spectroradiométrie, référentiel naturel et étude de la diffu-sion des haches alpines. in : P. Pétrequin, S. Cassen, M.Errera, L. Klassen, A. Sheridan et A.M. Pétrequin (ed.),Jade. Grandes haches alpines du Néolithique européen. Ve
et IVe millénaires av. J.-C. Cahiers de la MSHE C.N.Ledoux, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté et Centre de Recherche Archéologique de la Valléede l’Ain, tome 1, p. 440-533.
FÁBREGAS VALCARCE R., DE LOMBERA HERMIDA A.et RODRIGUEZ RELLAN C. 2012 – Spain and Portugal :long chisels and perforated axes. Their context and distri-bution. in : P. Pétrequin, S. Cassen, M. Errera, L. Klassen,A. Sheridan et A.M. Pétrequin (ed.), Jade. Grandes hachesalpines du Néolithique européen. Ve et IVe millénaires av.J.-C. Cahiers de la MSHE C.N. Ledoux, Besançon, PressesUniversitaires de Franche-Comté et Centre de RechercheArchéologique de laVallée de l’Ain, tome 2, p. 1108-1135.
FERRÉ R. 2000 – Une hache d’apparat en Comminges : sonorigine – la circulation des haches polies au Néolithique.Revue du Comminges, vol. 116, n° 1, p. 9-14.
GANDELINM., VAQUER J. et BRESSY C. 2006 – Les lamesen matières premières exogènes dans le Chasséen de Ville-neuve-Tolosane et de Cugnaux (Haute-Garonne). in : J.Vaquer et F. Briois (ed.), La fin de l’âge de pierre en Europedu sud. Matériaux et production lithiques remarquablesdans le Néolithique et le Chalcolithique du Sud de l’Europe.Actes de la Table-ronde de l’EHESS, Carcassonne 5-6 sep-tembre 2003, Toulouse, Archives d’Ecologie préhistorique,p. 121-137.
GERVAIS P. 1867 – Recherches sur l’ancienneté de l’Hommeet la période quaternaire. Paris, Arthus Bertrand, 132 p.,IX pl.
GRIMAL J.-P. et SALUSTE J., avec la collaboration de Chi-chard J., Fouet J., Rodriguez G. 2006 – Grandes lamespolies et haches d’apparat en Languedoc central. Archéolo-gie en Languedoc, n°30, Lattes, Fédération archéologiquede l’Hérault, p. 9-19.
GUILAINE J. et MUÑOZ A.-M. 1964 – La civilisation cata-lane des “sepulcros de fosa” et les sépultures néolithiquesdu Sud de la France. Revue d’Etudes Ligures, n° 1-4, p. 6-30, 24 fig.
HÉLÉNA Ph. 1937 – Les origines de Narbonne. Toulouse, Ed.Privat, 491 p.
JEANTON G. et LAFAY G. 1918 – Nouvelles découvertesarchéologiques faites dans la Saône en aval de l’Ile St-Jean,près de Mâcon. Bulletin de la Société Préhistorique Fran-çaise : 7.
KLASSEN L., CASSEN S. et PÉTREQUIN P. 2012- Alpineaxes and early metallurgy. in : P. Pétrequin, S. Cassen, M.Errera, L. Klassen, A. Sheridan et A.M. Pétrequin (ed.),Jade. Grandes haches alpines du Néolithique européen. Ve
et IVe millénaires av. J.-C. Cahiers de la MSHE C.N.Ledoux, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, tome 2, p. 1280-1309.
LÉMOZI A. 1952 – Les quatre haches en pierre polie de Car-bonnié, commune de Sauliac-sur-le-Célé, près Cabrerets(Lot). Bulletin de la Société des Etudes littéraires scienti-fiques et artistiques du Lot, T. LXXXIII, 1952, p. 49-56.
LEROUXG. 1986 – Contribution à l’étude du peuplement dansle sud de l’Ille-et-Vilaine. Mémoire de maîtrise, Universitéde Rennes, multigraphié : fig. 18.
LE ROUZIC Z. 1928 – Hache plate en chloromélanite des Sept-Saints, commune d’Erdeven (Morbihan). Bulletin de laSociété préhistorique française, 25 (6), p. 294-295.
MARTÍN COLLIGA A. 2009 - Les sociétés du Néolithiquemoyen en Catalogne et leur gestion du funéraire. In : J. Gui-laine (ed.), Du Néolithique à l’Histoire : sépultures etsociétés. Séminaire du Collège de France, Paris, EditionsErrance, p. 45-67.
MÉNNEVÉE R. 1958 – Une petite hache polie préhistoriqueprovenant de Saint-Simon (Lot), Bulletin de la Société desEtudes littéraires scientifiques et artistiques du Lot,vol. LXXIX, p. 155-156.
MOHEN J.-P. 1976 – Tumulus des Pyrénées françaises. in : ElsPobles pre-romans del Pirineu. Actes du 2d colloqui inter-nacional d’Arqueologia de Puigcerdà, Juny 1976, Institutd’Estudis Ceretans, p. 97-108.
MORTILLET de G. et A. 1891 – Musée Préhistorique. Paris,éd. Schleicher Frères et Cie, 105 pl.
MUÑOZ A-M. 1965 – La cultura neolítica catalana de lossepulcros de fosa. Universidad de Barcelona, publicacionseventuales de Pyrenae, 417 p., 109 fig., XL pl.
PAILLERY. 2007 – Des dernières industries à trapèzes à l’af-firmation du Néolithique en Bretagne occidentale(5500-3500 av. J.-C.). BAR International Series, 1648,Oxford, Hadrian Books.
PELEGRIN J. 2006 – Long Blade technology in the old world.An experimental approach and some archaeological results.in : J. Apel et K. Knutsson (ed), Skilled Production andSocial reproduction. Aspects in traditional stone-tool tech-nologies. Proceedings of a symposium in Upsala, Agust20-24, 2003, Societas Archaeologica Upsaliensis, stonestudies 2, Upsala, p. 37-68.
PÉTREQUIN P. 2011 – The twentieth-century polished stoneaxeheads of New Guinea : why study them ? in : V. Daviset M. Edmonds (ed.) Stone Axe Studies III. Oxford, Oxbowbooks, p. 333-350.
PÉTREQUIN P., CASSEN S., CROUTSCH C. etWELLER O.1997 – Haches alpines et haches carnacéennes dans l’Eu-rope au Ve millénaire. Notae Praehistoricae, 17,Luxembourg, p. 135-150.
PÉTREQUIN P., CASSEN S., CROUTSCH C. et ERRERAM.2002 – La valorisation sociale des longues haches de l’Eu-rope néolithique. in : J. Guilaine (ed.), Matériaux,productions, circulations du Néolithique à l’Age du Bronze.Paris, Editions Errance, p. 67-98.
PÉTREQUIN P., PÉTREQUINA.-M., ERRERAM., CASSENS., CROUTSCH C., KLASSEN L., ROSSY M., GARI-BALDI P., ISETTI E., ROSSI G. et DELCARO D. 2005 –Beigua, Monviso e Valais. All’origine delle grande asce
Une hache de type Pauilhac au Grès Haut, Calvignac (Lot). Pages 197 à 213
213
levigate di origine alpina in Europa occidentale durante il Vmillenio. Rivista di Scienze preistoriche, vol. LV, p. 265-322.
PÉTREQUIN P., CASSEN S., ERRERA M., GAUTHIER E.,KLASSEN L., PAILLER Y., PÉTREQUIN A.M. et SHE-RIDAN A. 2009 – L’Unique, la Paire, les Multiples. Apropos des dépôts de haches polies en roches alpines enEurope occidentale pendant lesVe et IVe millénaires. in : S.Bonnardin, C. Hamon, M. Lauwers et B. Quilliec (ed.), Dumatériel au spirituel. Réalités archéologiques et historiquesdes « dépôts » de la Préhistoire à nos jours. Actes desXXIXe Rencontres internationales d’archéologie et d’his-toire d’Antibes, Juan-les-Pins, Ed. APDCA, p. 417-427.
PÉTREQUIN P., PÉTREQUIN A.M., ERRERA M. etPRODÉO F. 2012a – Prospections alpines et sources dematières premières. Historique et résultats. in : P. Pétrequin,S. Cassen, M. Errera, L. Klassen,A. Sheridan etA.M. Pétre-quin (ed.), Jade. Grandes haches alpines du Néolithiqueeuropéen. Ve et IVe millénaires av. J.-C. Cahiers de la MSHEC.N. Ledoux, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté et Centre de Recherche Archéologique de la Valléede l’Ain, tome 1, p. 46-183.
PÉTREQUIN P., CASSEN S., GAUTHIER E., KLASSEN L.,PAILLER Y. et SHERIDAN A., avec la collaboration deDesmeulles J., Gillioz P.A., Le Maux N., Milleville A.,PétrequinA.M., Prodéo F., SamzunA. et FabregasValcarceR. 2012b – Typologie, chronologie et répartition desgrandes haches alpines en Europe occidentale. in : P. Pétre-quin, S. Cassen, M. Errera, L. Klassen,A. Sheridan etA.M.Pétrequin (ed.), Jade. Grandes haches alpines du Néoli-thique européen. Ve et IVe millénaires av. J.-C. Cahiers de laMSHE C.N. Ledoux, Besançon, Presses Universitaires deFranche-Comté et Centre de RechercheArchéologique de laVallée de l’Ain, tome 1, p. 574-727.
PÉTREQUIN P., CASSEN S., ERRERA M., KLASSEN L.,SHERIDAN A. et PÉTREQUIN A.M. (ed.) 2012c – Jade.Grandes haches alpines du Néolithique européen. Ve et IVe
millénaires av. J.-C. Cahiers de la MSHE C.N. Ledoux,Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté etCentre de Recherche Archéologique de la Vallée de l’Ain,2 vol., 2528 p.
PÉTREQUIN P., CASSEN S., ERRERA M., TSONEV T.,DIMITROV K., KLASSEN L. et MITKOVA R. 2012d –Les haches en « jades alpins » en Bulgarie. in : P. Pétrequin,S. Cassen, M. Errera, L. Klassen,A. Sheridan etA.M. Pétre-quin (ed.), Jade. Grandes haches alpines du Néolithiqueeuropéen. Ve et IVe millénaires av. J.-C. Cahiers de la MSHEC.N. Ledoux, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté et Centre de Recherche Archéologique de la Valléede l’Ain, tome 2, p. 1231-1279.
RENFREWC. 1975 – Trade as action at distance. in : J. Sabloffet C.C. Lamberg-Karlovsky (ed.), Ancient civilization andtrade. Albuquerque, Omega Editions, p. 1-59.
REY P.-J. et THIRAULT E. 1999 – Le peuplement des valléesalpines au Néolithique : les exemples de la Maurienne et dela Tarentaise (Savoie). in : A. Beeching (ed), Circulations etidentités culturelles alpines à la fin de la Préhistoire. Maté-riaux pour une étude Programme CIRCALP 1997-1998.Travaux du Centre d’Archéologie Préhistorique deValence,2, p. 501-518.
ROUSSOT-LARROQUE J. 2008a – La « sépulture de Chef » dePauilhac (Gers). Bulletin Préhistoire du Sud-Ouest, n° 16,2008-1, p. 91-142.
ROUSSOT-LARROQUE J. 2008b – La très grande hache polieen roche verte d’Arthez-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques).Bulletin Préhistoire du Sud-Ouest, n° 16, 2008-1, p. 151-155.
SOULIÉ P. 1976 – La Pierre du tacou. Bulletin de la Sociétédes études du Lot, 4e fascicule, p. 305.
STRAHM C. 2007 – L’introduction de la métallurgie enEurope, in : J. Guilaine (ed.). Le Chalcolithique et laconstruction des inégalités. Tome 1, Le continent européen.Série des séminaires du collège de France, Paris, EditionsErrance, p. 49-71.
VAQUER J., GANDELIN M., REMICOURT M. et TCHÉRÉ-MISSINOFF Y. (ed.) 2008 – Défunts néolithiques enToulousain. Toulouse EHESS,Archives d’Ecologie Préhis-torique, série monographie, 237 p.
VAQUER J, MARTINA., PÉTREQUIN P., PÉTREQUINA.M.et ERRERA M., 2012 – Les haches alpines dans les sépul-tures du Néolithique moyen pyrénéen. in : P. Pétrequin, S.Cassen, M. Errera, L. Klassen, A. Sheridan et A.M. Pétre-quin (ed.), Jade. Grandes haches alpines du Néolithiqueeuropéen. Ve et IVe millénaires av. J.-C. Cahiers de la MSHEC.N. Ledoux, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté et Centre de Recherche Archéologique de la Valléede l’Ain, tome 2, p. 872-917.
VAQUER J. et REMICOURT M. 2009 – Production et impor-tation de grandes lames en silex dans le Néolithique et leChalcolithique du Midi de la France (4500-2400 av. J.-C.).in Gibaja J.-F., Terradas X., PalomoA., Clop X. - Les gransfulles de silex. Europa al final de la Prehistoria. Actes duWorkshop Barcelone-Gavà 9-10 juin 2008. Edicions delMuseu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona, série mono-grafies, n° 13, ISBN 978-84-3938186-X, p. 35-45, 7 fig.
VINCENT E. M. et JAUNEAU J.-M. 1981 – Hache polie enjadéite de St-André-Goule-d’Oie (Vendée). Bulletin duGroupe Vendéen d’Etudes Préhistoriques, 6, p. 32-33.