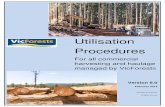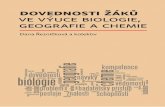Effective utilisation of region's resources for development ...
UTILISATION DE LA BIOLOGIE MOLECULAIRE POUR LA DETECTION DES OGM
Transcript of UTILISATION DE LA BIOLOGIE MOLECULAIRE POUR LA DETECTION DES OGM
BIOLOGIE MOLECULAIRE
1
UNIVERSITE DE LOME ANNEE ACADEMIQUE 2014-2015
Ecole Supérieure des Techniques
Biologiques et Alimentaires
GEE : Gestion de l’Eau et de l’Environnement UE : BILOGIE MOLECULAIRE
Thème : UTILISATION DE LA BIOLOGIE
MOLECULAIRE POUR LA DETECTION
DES OGM DANS L’ENVIRONNEMENT Présenté par :
KWADZO KwamiMadjeDziedzom Edouard
LONHOGAN Koffi Edem
PITIKALO Aklesso Rémi
POTCHO Pitalani
SANNI Samadou
SOMANA KomlanEssénam
SOUROU Kadoukpè Amavi
SOUVI Koffi Patrice
TAKOUGNADI Atehezi Assima
TCHABANA Malik
TCHAMDJA Samssoundine
TETOU Zakiya
WOEGNA Yao Ouwolowoudou-Douwou
Chargé du cours : Prof. KAROU Simplice
BIOLOGIE MOLECULAIRE
2
SOMMAIRE
INTRODUCTION
I- HISTORIQUE ET IMPORTANCES DES OGM
II- OBTENTION ET FONCTIONNEMENT DES OGM
1- Obtention
2- Fonctionnement
III- METHODES DE DETECTION DES OGM
A- TECHNIQUE PCR
1- Principe
2- Les trois étapes de la PCR
3- Les deux types d’analyses que permet la PCR
4- Conclusion partielle
B- LA DETECTION AU NIVEAU DES PROTEINES
1- Principe
2- Expérience
3- Conclusion partielle
IV- LES OGM ET L’ENVIRONNEMENT
CONCLUSION
REFERENCES
BIOLOGIE MOLECULAIRE
3
INTRODUCTION
La biologie moléculaire est une discipline scientifique au croisement de
la génétique, de la biochimie et de la physique, dont l'objet est la compréhension des
mécanismes de fonctionnement de la cellule au niveau moléculaire.Le terme « biologie
moléculaire », désigne également l'ensemble des techniques de manipulation d'acides
nucléiques (ADN, ARN), appelées aussi techniques de génie génétique utilisé pour la
détection des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).
Un organisme génétiquement modifié (OGM) est un organisme (animal, végétal,
bactérie) dont on a modifié le matériel génétique par une technique dite de génie
génétique pour lui conférer une caractéristique nouvelle.
I. HISTORIQUE ET IMPORTANCE DES OGM
La première plante génétiquement modifiée (tabac) a été créée en 1983, suite aux
travaux de recherche fondamentale portant sur le transfert des gènes d’une bactérie
(Agrobacteriumtumefasciens) à des plantes supérieures. En quelques années, les
techniques de transformation génétique ont été appliquées à différentes espèces végétales
(tomate, coton, peuplier, maïs, soja, colza, pomme de terre, oeillets, papaye …) et
animales (mouche du vinaigre, souris, cochon, chat, poulet, vache …). Ces applications
ont conduit à la création d’organismes génétiquement modifiés susceptibles d’être
utilisés dans différents domaines autres que la recherche, comme la santé humaine ou
animale, l’agroalimentaire, l’environnement.
La création de plantes ou d'animaux trangéniques présente de nombreux intérêts.Les
performances des plantes sont améliorées par l'insertion de gènes différents en fonction de
l'objectif recherché: taille plus grande, résistance à un herbicide, à la chaleur, introduction
d'une nouvelle couleur (pigment) ou d'une nouvelle saveur, une production moindre de
BIOLOGIE MOLECULAIRE
4
lipides, etc... On peut de même améliorer les animaux: par exemple, des porcs qui ont
moins de graisse et plus de muscles... La transgenèse peut également servir à la
production de molécules pures en grande quantité à un moindre coût, comme les
molécules thérapeutiques. Aujourd'hui, l'insuline indispensable aux diabétiques est
produite par des levures. Des plants de tabac produisent de l'hémoglobine humaine. Bien
sûr, en médecine, la thérapie génique fait l'objet de nombreux essais, particulièrement
dans la recherche contre le cancer et les maladies génétiques. Le principe de la thérapie
génique est de transformer les cellules atteintes, dans le cas de cellules cancéreuses, soit
les tuer (gènes de la mort cellulaire), soit les rendre "inoffensives" (en les ramenant
presque à la normale), et pour, dans les cas des maladies génétiques, introduire le ou les
gènes manquants ou défectueux qui provoquent la maladie.
II. OBTENTION ET FONCTIONNEMENT DES OGM
1- OBTENTION
Les techniques modernes de génie génétique, consistent à introduire un ou
plusieurs gènes dans le patrimoine génétique d’un organisme et de construire des
organismes dits "génétiquement modifiés". Ces techniques permettent de transférer des
gènes sélectionnés d’un organisme à un autre, y compris entre des espèces différentes.
Elles offrent ainsi la possibilité d’introduire dans un organisme un caractère nouveau.
La production de culture OGMest obtenue soit à l’aide
d’Agrobacteriumtumefaciensutilisant le Ti-plasmide comme vecteur, soit à l’aide d’un
pistolet injectant des particules d’ADN, sur lesquels on a adsorbé les gènes à transférer à
l’intérieurdes cellules végétales. Les plantes transgéniques ont principalement trois
vocations: commerciale, agronomique et industrielle.
BIOLOGIE MOLECULAIRE
5
2- FONCTIONNEMENT
Aujourd’hui, seulement deux types d’OGM sont commercialisés: 10plantes
transgéniquesrésistantesàcertainsinsecteset20végétauxrésistantsauxherbicidesde
contact.Danscettesection,noustraiteronsuniquementdecesdeuxtypesdecultureOGM, en
omettant les autres plants transgéniquesen développement dans les laboratoires des
scientifiques.
III. METHODES DE DETECTION DES OGM
A- Technique de PCR
La « Polymerase Chain Reaction » ou PCR est une technique d’amplification
génique in vitro. Elle permet d’obtenir, à partir d’un échantillon complexe et peu
abondant, d’importantes quantités d’un fragment d’ADN spécifique et de longueur défini
1- Principe
Le principe est de réaliser une succession de réactions de réplication d’une matrice double
brin d’ADN. Chaque réaction met en œuvre deux amorces oligonucléotidiquesqui
définissent alors, en la bornant, la séquence à amplifier (amplicon).
Les acteurs de la PCR :
- l’ADN à amplifier,
- des amorces, spécifiques du segment d’ADN voulu,
- de la Taq polymérase (ADN polymérase thermostable)
- du mélange des quatre désoxyribonucléotides constitutifs de l’ADN.
La PCR est ensuite une répétition cyclique de trois phases différentes à trois
températures différentes : la dénaturation, l’hybridation et l’élongation.
2. Les trois étapes de la PCR :
Pour accomplir cette réaction, quatre choses sont donc nécessaires : le fragment
d'ADN à copier, deux fragments amorces (fragments d’ADN spécifiques du gène
recherché), l'enzyme de la polymérase et une machine spéciale qui contrôle parfaitement
la température.
BIOLOGIE MOLECULAIRE
6
La dénaturation :
Tout d'abord l'ADN choisi, initialement sous forme de double hélice, est séparé en un
seul brin d'ADN. Cette étape est nécessaire parce qu'un morceau d'ADN ne peut pas être
copié lorsqu'il est sous forme de double hélice. Le procédé de séparation s'appelle la
«dénaturation». Celle-ci se produit lorsque l'ADN est chauffé à 90-96°C.
Les amorces :
La prochaine étape est d'ajouter des amorces et de baisser la température pour faciliter
leur collage. Puisque les amorces sont complémentaires aux zones du début et de la fin de
la partie choisie de la séquence d'ADN, elles se colleront sur ces dernières et agiront
comme des éléments constitutifs de l’ADN pour que le processus de copiage commence
et s'arrête.
L’élongation :
Ensuite, la polymérase est ajoutée et la température est légèrement augmentée pour
qu'elle soit idéale au bon fonctionnement de l’enzyme. Elle identifie alors les amorces et
commence à copier.
Le cycle entier est répété à plusieurs reprises jusqu'à l’obtention de millions de brins
d'ADN. La copie d’un cycle prend environ une à trois minutes. Étant donné qu'à chaque
cycle, le nombre de molécules est doublé, le nombre de molécules d'ADN après n cycles
est de 2n. L'ordre de grandeur à retenir est celui du million de copies en quelques heures.
BIOLOGIE MOLECULAIRE
7
3 - Les deux types d’analyse que permet la PCR
La PCR est une technique permettant de détecter la présence d’OGM mais aussi
l’identification d’un gène transgénique.
La détection :
Pour déceler la présence d’ADN génétiquement modifié, on a recours à des
amorces non spécifiques mais présentes dans la plupart des constructions génétiques. En
effet, certains OGM sont construits selon les mêmes modèles. Cela signifie que l’on
retrouve des régions communes à plusieurs OGM (promoteurs, gènes de résistance, gènes
de visualisation, etc.). Il s’agit simplement de détecter l’un de ces motifs pour pouvoir
affirmer la présence d’OGM. Cependant on ne sait pas quel type d’OGM est alors
impliqué.
Par contre, s’il n’y a pas de détection, il est impossible de conclure à l’absence de
ce type d’ADN. En effet, l’OGM peut avoir été construit avec un autre promoteur et un
BIOLOGIE MOLECULAIRE
8
autre terminateur que ceux que l’on a cherché à détecter. De plus certains végétaux,
appelés « faux positifs », ont la particularité d’être toujours reconnus positifs par le test.
L’identification :
La deuxième stratégie permettant d’identifier un ADN d’origine OGM nécessite
cette fois-ci des amorces spécifiquesà chacune des constitutions génétiques possibles et
connues. L’inconvénient de cette technique est qu’elle implique de savoir exactement ce
que l’on recherche, il faut alors utiliser des banques de gènes et des logiciels spécifiques
pour déterminer les amorces à utiliser.
4 – Conclusion partielle
Le principal défaut de ces deux techniques est également leur avantage. Elles sont
capables de détecter des OGM pour des niveaux de un millième à dix millionièmes. Or ce
seuil de sensibilité très faible rend difficile la quantification précise du taux en OGM dans
un végétal. Si un test quantitatif est nécessaire, la technique de PCR peut également être
utilisée, mais dans des conditions particulières qui demandent une mise au point
spécifique. La PCR est donc une technique essentiellement qualitative. D’autre part,
l’introduction des amorces implique que l’on ne peut détecter que des gènes que l’on
connaît déjà.
B -La détection au niveau des protéines
1 – Principe
Il est possible de détecter la présence de protéines résultant de l’introduction
d’ADN étranger. Les méthodes reposant sur la détection des protéines conviennent
surtout aux produits bruts ou peu transformés comme les grains de maïs ou de soja, car les
procédés industriels (chauffage, traitements chimiques…) altèrent les protéines et les
rendent indétectables. De plus la localisation de la protéine ne doit pas rendre l’opération
BIOLOGIE MOLECULAIRE
9
trop difficile. Cette technique présente l'avantage de permettre facilement la quantification
des OGM.
Il s’agit de tests immunologiques de type ELISA (Enzyme
LinkedImmunoSorbanAssay) par exemple. Ils permettent de détecter une protéine codée
par un gène introduit dans une plante. Les principaux avantages de ces tests sont que
ceux-ci sont rapides (effectués en moins de deux heures) et peu coûteux. Pour des plantes
de la même espèce, on distingue bien la présence d’un gène commun (situé en haut) et
surtout le gène transgénique introduit dans la plante de droite.
2 – Expérience
On peut réaliser la même expérience avec une plante transgénique et une plante
naturelle. Après avoir extrait les protéines de la plante, on les met en présence d’un
anticorps spécifique de la protéine codée par un gène transgénique. Cela signifie que cet
anticorps ne peut se fixer qu’à la protéine codée par le gène transgénique. Deux cas
peuvent alors se présenter.
- Une protéine se fixe à l’anticorps. Elle correspond donc à la protéine que l’on recherche.
Un gène a donc été introduit artificiellement dans la plante et a codé cette protéine.
- Aucune des protéines ne se fixe à l’anticorps. Le type de protéine que l’on recherche,
spécifique à l’anticorps introduit, ne se trouve donc pas dans la plante.
Pour visualiser les résultats de l’expérience, on effectue par la suite un lavage,
c’est-à-dire que l’on enlève toutes les protéines qui ne se sont pas fixées à l’anticorps. On
ajoute ensuite un autre anticorps, qui est lui aussi spécifique de la protéine recherchée et
fluorescent. Ceci nous permet de le repérer facilement.
On procède ensuite à un nouveau lavage. Si une protéine est fixée sur l’anticorps,
le deuxième anticorps fluorescent peut alors se fixer sur l’autre côté de la protéine. Le test
BIOLOGIE MOLECULAIRE
10
est ainsi positif (1er cas). Si au contraire aucune protéine ne correspond au premier
anticorps, l’anticorps fluorescent ne se fixe pas. Le test est négatif (2ème
cas).
Schéma de la détection au niveau des protéines
3-Conclusion partielle
Cette dernière technique présente l'avantage de permettre facilement la quantification des
OGM. Cependant, elle convient surtout aux produits bruts ou peu transformés. Pour cette
raison, les méthodes basées sur la détection de l’ADN (par PCR) sont actuellement
privilégiées en Europe.
BIOLOGIE MOLECULAIRE
11
IV. LES OGM ETL'ENVIRONNEMENT
Les mutations génétiques
Les plantes génétiquement modifiées pour s'auto protéger contre un insecte, par
exemple, pourraient susciter l'apparition d'insectes résistants à ces plantes transgéniques, à
la suite d'une mutation génétique « naturelle » chez ces derniers.
Il existe des indices de probabilité de réalisation de ce risque, qui ne découlent
pourtant pas des plantes génétiquement modifiées, mais bien des méthodes utilisées
classiquement en agriculture. En effet, une toxine produite par la bactérie Bacillus
thuringiensis, est utilisée dans différents pays, dont la France, notamment en agriculture
biologique, sous forme de bio-pesticide (mélange de bactéries pulvérisées). Il y a donc de
nombreuses toxines dans cette pulvérisation. On en connaît actuellement plus de 250.
Les effets non désirés
Les Plantes Génétiquement Modifiées (PGM) en vue de leur donner une résistance
naturelle à un insecte peuvent affecter des insectes non visés par la modification de la
plante. C'est le cas par exemple pour les abeilles et le monarque qui, bien que non
indésirables, sont éliminés par certaines plantes génétiquement modifiées.En effet, il a
été mené en 1999 une expérience sur le monarque, papillon d'Amérique du Nord réputé
pour sa beauté. Des chenilles de ce papillon ont été nourries avec des feuilles
artificiellement recouvertes de pollen d'une variété de maïs génétiquement modifié par
l'introduction d'un gène commandant la production d'un insecticide contre la Pyrale. Ces
chenilles ont connu une croissance plus lente et une mortalité plus élevée que d'autres
nourries de feuilles recouvertes de pollen de maïs classique. L'expérience a donc
démontré le « danger » encouru par le papillon.
BIOLOGIE MOLECULAIRE
12
- L'éventuel impact sur les insectes « non cibles »
Des insectes utiles comme les abeilles, risquent d'être affectés par le
développement des plantes transgéniques. On parle alors d'effet sur les insectes « non
cibles », c'est-à-dire sur ceux qui ne sont pas visés par la modification génétique, mais sur
qui la plante transgénique pourrait néanmoins influer le changement de métabolisme de la
plante. Des études portant sur des colzas résistants à un herbicide ont été menées et n'ont
pas permis de mettre en évidence, pour l'instant, des effets sur la mortalité des abeilles, ni
sur leur comportement de butinage. Toutefois, même s'il n'est pas encore apparu
clairement, surtout en comparaison avec les effets actuels des insecticides, ce risque ne
peut être écarté.
Il est donc nécessaire de procéder à l'analyse des sécrétions des plantes
transgéniques mellifères, ainsi qu’à l'évaluation de l'incidence d'une exposition à des
plantes transgéniques.
On pourrait se dire que, devant autant de problèmes réels ou potentiels, il serait
plus raisonnable de bannir les OGM. Ce serait pourtant faire l'impasse sur de nombreux
avantages.
CONCLUSION
La technique de transgénèse est encore toute jeune et de nombreuses questions
restent en suspens. On constate qu’elle présente de nombreux avantages mais également
des risques non négligeables. Utilisés de façon appropriée, les OGM pourraient apporter
de nombreux moyens pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie. Cependant,
la rapidité avec laquelle peuvent survenir les modifications entraînées par le génie
génétique peut avoir des effets encore inconnus.
BIOLOGIE MOLECULAIRE
13
REFERENCE
http://biotech.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article145
http://les-ogms.e-monsite.com/
http://la-bnbox.fr/index.html
http://www.infogm.org/
http://bloghardi.fr/2009/02/ogm-risques-pour-environnement.html