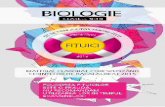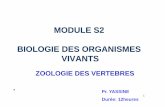Annales de biologie lacustre
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Annales de biologie lacustre
AN N ALESDE
BIOLOGIE LACUSTREPUBLIEES SOUS LA DIRECTION DU
T> Ernest ROUSSEAU
TOME II
1907-1908
BRUXELLES
IMPRIMERIE F. VANBUGGENHOUDT5 ET 7, RUE DU MARTEAU, 5 ET 7
LISTE DES COLLABORATEURS
K. APSTEIN, à Kiel.
S. AWERINTZEW, à Saint-Pétersbourg.
H. BACHMANN, à Lucerne.Th. BARROIS, à Lille.
P. DE BE\UCHAMP, à Paris.
F.-E. BEDDARD, à Londres.E.-A. BIRGE, à Madison.R BLANCHARD, à Paris.
C. BOMMER, à Bruxelles.O. BORGE, à Stockholm.A. BORZL à Païenne.G.-L. BRADY, à Suuderland.C. BRUYANT, à Clermont.
L. CAR, à Agram.R. CHODAT, à Genève.
E. VON DADAY, à Budapest.R. DANGEARD, à Poitiers.
J.-G. DE MAN, à lerseke.
R. DE TONI, à Modène.F. DOFLELN, à Munich.
C. ECKSTEIN, à Eberswalde.
G. FIELD, à Boston.G.-A. FORBES, à Urbana.F. -A. FOREL. à Morges.P. FRANCOTTE, à Bruxelles.0. FUHRMANN, à Neuchàtel.
A. GARBINT, à Vérone.G. GILSON, à Louvain,P. GIROD, à Clermont.P. GODET, à Neuchàtel.L. VON GRAFF, à Graz.R. GUTWINSKI, à Cracovie.
J. HEUSCHER, à Zurich.B. HOFER, à Munich.C. HOFFBAUER, à Trachenberg.C. HUITFELD KAAS, à Christiania.
O.-E. IMHOF, à Brugg.
H. -S. JENNINGS, à Philadelphie.
A. KEMNA, à Anvers.F. KLAPALEK, à Prague.C-A. KOFOID, à Berkeley.
G. LAGERHELM, à Stockholm.K. LAMPERT, à Stuttgart.
K.-M. LEVANDER, à Helsingfors.
R VON LENDENFELD, à Prague.K. LOPPENS, à Nieuport.
p. MAGNIN, à Besançon.C.-D. xMARSH, à Washinoton.J. MASSART, à Bruxelles.
E. MAZZARKLLI, à Païenne.A. MEUNIER, à Louvain.W. MICHAELSEN, à Hambourg.W. MIGULA, à Eisenach.
R. MONTI, à Sassari.
G.-W. MULLER, à rrreitswald.
P. NYPELS, à Bruxelles.
J. NUSBAUM, à Lemberg.
E. PENARD, à Genève.L.-H. PLATE, à Berlin.
H.-C. REDEKE, au Helder.L. R(3ULE, à Toulouse.C.-F. ROUSSELET, à Londres.E. ROUX, à, Bàle.
M. SAMTER, à Berlin.
G.-O. SARS. à Christiania.
J. SCHAFFER, à Vienne.A. SCHERFELL, à Iglô.
G. SCHNEIDER, à Helsingfors.
H. SCHOUTEDEN, à Bruxelles.A. SCHUBERG, à Heidelberg.J. SCOURFIELD, à Leytonstone.H. SIMROTH, à Leipzig.
A.-S. SKORIKOW, à Saint-Pétersbourg.J. SNOW, à Nortliampton.A. STEUER, à Innspruck.T. STINGELIN, à Olten.
S. STRODTMANN, à Helgoland.
J. THALLWITZ, à Dresde.K. THOR, Norwège.R. TIMM, à Hambourg.
G. ULMER, à Hambourg.
H. VAN HEURCK, à Anvers.D. VINCIGUERRA, à Rome.
E. WALTER, à Saalfeld.
H.-B. WARD, à Lincoln.
W. WELTNER, à Berlin.
J. WERY, à Bruxelles.
A. WIERZEJSKI, à Cracovie.
N. WILLE, à Christiania.
V. WILLEM, à Gand.
E. ZACHARIAS, à Hambourg.0. ZACHARIAS, à Pion.
C. ZIMMER, à Breslau.
W^F. ZOPF, à Munster.F. ZSCHOKKE, à Bâle.
TABLE DES MATIÈRES DU TOME II
Pages
J.-G. De Mati. — Contribution à la connaissance des Néma-
todes libres de la Seine et des environs de Paris . . 9
P. Steinmann. — Die Tierwelt der Gebirgsbaclie, eine
faunistisch-biologische SLudi(! 30
S. Awerintzew. — Beitriige zur Kenntnis dei- Siisswasser-
protozoen 163
H. Schouteden. — Les Infusoires aspirotriches d'eau
douce. — II l''^!
E. Rousseau et H. Schouteden. — Les Acinétiens d'eau douce 181
A. Boubier. — L'universalité et la cause de la forme sphé-
rique des organismes inférieurs 212
A. Boubier. — La vésicule contractile, organe hydrostatique 214
M. Le Roux. — Recherches biologiques sur le lac d'Annecy. 220
E. Rousseau. — Les Hyménoptères aquatiques avec descrip-
tion de deux espèces nouvelles par W.-A. Schulz . . 388
Bibliographie limnologique, littérature, analyses et comptes
rendus (Spongiaires, Coelentérés, Bryozoaires, Mol-
lusques, Vers, Crustacés, Insectes, Hydrachnides,
Poissons, Batraciens, Mammifères, Protozoaires,
Algues, Champignons, Plankton, Végétation lacustre,
Macrophytes, Biologie des eaux courantes ou sta-
gnantes, Biologie thermale, Technique, Laboratoires,
Stations biologiques, Nouveaux périodiques et Traités
sur rhydrobiologie) 403
CONTRIBUTION
A LA
DE LA SEINE ET DES ENVIRONS DE PARIS
par 1(> D'- J.-G. de Man, à lerseke (Hollandi^).
La présente note contient mes observations sur quelques Néma-todes libres faites pendant un séjour à Sèvres près de Paris, il
y a quelques années. Vingt-six espèces furent recueillies, dont
aucune cependant n'est nouvelle pour la science. Plus de la
moitié, c'est-à-dire quatorze espèces, fui-ent capturées sur des
pierres gisant dans la Seine et revêtues d'algues; cin(j autres se
trouvaient dans un sol très liumide aux bords de la rivière, dansde la terre qui sans doute était submergée de temps en temps.
Le reste, c'est-à-dire sept espèces, fut observé dans la terre
plus ou moins humide de l'étang des Fonceaux, situé non loin deSèvres.
Parmi ces observations, je tiens à signaler surtout celles sur
une femelle de la Tripyla papiUata portant les deux spicules
du raàle, celles sur une espèce du genre Aphe/eitchits et celles
sur le mâle inconnu jusqu'à présent du Dorijldlmus ceiitro-
cercus.
Nos connaissances actuelles sur les Nématodes libres habitant
les eaux douces de la France sont encore insignifiantes, c'est
pourquoi j'ai pensé (pie ce petit travail pouvait présenter uncertain intérêt.
1^ ^ '^•'^ \
— 10 —
1 . Alaimus primitivus de
(de Man, Die frei in der reinen Erde und im sïissen Wasser
lebenden Nematoden der Niederlimdisclien Fauna. Eine svste-
matiscli-faunislisclie Monographie. Mit 34 lithogr. Tafeln. Lei-
den 1884. p. 30, Taf. I, flg. 1).
Une seule femelle longue de 1.35 mm., capturée en juillet
dans de la terre humide près de l'étang des Fonceaux. Une
femelle de pareille longueur avait été déjà observée auparavant
aux environs deWeimar(de Man, Tijdschrift Ned. Dierk. Ve-
reen. 2'^ série. Dl. I, 1885, p. 10). Chez la femelle observée mainte-
nant le nombre a était 45, (3 = 5, y = 10 (1). Comme chez la
femelle des environs de Weimar, l'œsophage était un peu plus
court qu'il n'a été indiqué dans ma Monograpliie,mais cela s'ex-
plique par la plus grande taille de cette femelle. Elle portait un
seul œuf long de 0.07 mm.Distribution géographi(iue : Hollande (de M.); Angleterre,
Svdenham(de M.); Allemagne, Francfort-sur-le-Mein(P)iitschli),
Slade (V. Linstow), Erlangen (de M.), environs de Weimar
(de M.); Autriche, Laibach (de M.); Russie, environs de Mos-
cou (de M.); Esthonie, Obersee près de Reval (G. Schneider);
Norvège (presqu'île de Bygdô, près de Christiania) (de M.)
2. Monohystera vulgaris de M.
de Man, /. c, 1884, p. 39, taf. III, fig. 10.
Une jeune femelle, longue de 5G mm., observée en juillet
près de l'étang des Fonceaux; a = 32, (3 = 4 1/2, 7 = 4. Au
niveau des organes latéraux le corps était large de 12.4 p., tan-
dis que la distance de ces organes jusi^u'au bord antérit'ur de la
tète mesurait 15.3 a.
Distribution géographique : Hollande (de M.); Allemagne,
Erlangen, environs de Weimar (de M); France, Montpellier
(1) Les dimensions ont été indiquées en millimètres et ont rapport au ver
adulte. Le rapport entre la longueur totale et l'épaisseur moyenne est exprimé
par o(, celui -entre la longueur totale et la longueur du tube œsophagien
(la cavité buccale y comprise) par ,8 et le rapport entre la longueur totale et
la longueur de la queue par y.
— 11 —
(de M.); Russie, environs de Moscou (de M.); Hongrie
(v. Daday).
3. Monohystera similis Rtsli
deMan, L c, 1884, p. 40, taf. III, ûg. 11.
Plusieurs femelles furent observées aux mois de juillet et
d'août dans la Seine sur des pierres couvertes d'algues. Toutes
ces femelles, dont la plus grande mesurait 0.74 nnn., la plus
petite seulement 0.5 mm. (!), portaient déjà un œuf; l'œuf de la
plus petite femelle était long de 0.04 mm. Chez la femelle longue
de 0.74 mm., a était 34, [3 = 4 3/4, y = 4 1/2; chez celle, longue
de 0.5 mm., ces nombres étaient : a = 27, (3 ^ 4 1/3, y = 5.
Distribution géographi(|ue : Hollande (de M.); Allemagne, le
Mein (Kiitschli) ; Hongrie (v. Daday).
4. Monohystera dispar Bast.
de Man, /. c, 1884, p. 41, taf. III, fig. 12.
Quatre femelles furent observées dans la Seine. La plus
grande des trois qui portaient un œuf, était longue de 0.72 mm.,
laphis petite ne mesurait que 0.64 mm. Le nombre a variait
entre 21 et 24, |3 était chez toutes = 5, y = 0, à rexcei)tion
d'une seule femelle longue de 0.72 mm., chez laquelle ce nombre
était = 7.
.l'observai cette espèce aussi à Saint-Quentin en juillet.
Distribution géographique : Angleterre (Bastian) ; Allemagne,
Francfort-sur-le-Mein (BiUschli) ; Esthonie, Obersee près de Reval
(G. Schneider).
."). Monohystera flliformis Bast.
de Man, /. c, 1884, p. 41, taf. III, fîg. 13.
Une seule femelle sans œufs, longue de 0.75 mm., fut observée
en juin aux bords de la Seine, près de Meudon, dans de la terre
humide ; a = 30, [3 = 6, y = 5.
Distribution géographique : Angleterre, Sydenliam (iJastian
et de M.) ; Allemagne, Francfort-sur-le-Mein (Bi'itschli), Erlangen
(de M.), léna (Cobb) ; Autriche, Laibach (de M.); Russie, envi-
rons de Moscou (de M.); France, Montpellier (de M.).
12 —
(j. Tripyla papillata lît^
de Man, /. c, 1881, p. 17, taf. V, ûg. VX
Plusieurs exemplaires, mâles et femelles, l'nrenl observés
dans la terre humide des bords d(^ la Seine, près de Meudon, au
mois de juillet. Un mâle et une femelle avaient atteint la lon-
gueur de 0.4 mm.Une autre femelle, longue de 'SA mm. et pourvue de deux
œufs, présentait le remarquable pliénomène que j'ai observé
auparavant chez quelques Xématodes marins [Thoracostorna
figuratum Bast., ChroiRadora poecilosoma de M., Enoplus
Michaelseiiii Linst.), c'est-à-dire que cette femelle était munie
de deux spicules bien développés. Chez cette femelle anor-
n^ale, a = ::î5, {6 = 6 et 7 = 8 2/3.
La vulve se trouvait chez cette fcnnelle un peu en arrière du
milieu ; sa distance de l'anus était trois fois aussi longue que la
queue; le tube génital antérieur était un peu plus long que la
moitié de la distance entre la vulve et l'extrémité })Ostérieure de
l'oesophage; le tube génital postérieur était beaucoup plus court
et ne s'étendait à peine (jue jusqu'à la moitié de la distance entre
vulve et anus.
Distribution géographi(pie : Allemagne, Mein (Uidschli);
Hollande (de M.); Hongrie, (irand et Petit Balaton (v. Dadav).
7. Chromadora Ratzeburgensis Uinst.
PI. I, lig. 1
(liromador-ii Raf:elmrgensis, von Linstow, Areliiv fiir
Naturg., 42. Jahrg., 1870, p. 13, taf. II, fig. 32 et 'S'S.
? Chromadora &«/Z?o.srt, von Daday, Resultate der wissen-
schaftl. Erforsclmng des Balatonsees, Budapest 1897, Bd. II,
T.l, p. 13, fig. 19-22, et dans : Zoolog. Jahrb. (Spengel), Abth. f.
Syst., Bd. X, 1897, p. KH), taf. 12, fig. 9-13.
Q 0.9 mm., Ç 1 mm. — o. chez le mâle = 2."'), chez la femelle
= 22-21. (3 = <)-(> 1/3. y == 7-7 1/2.
La foi-me du corps est assez ti-ipue et ces \'ers s'atténuent
assez fort en a\ant ainsi qu'en arrière; quant à son aspect
général, cette espèce ressemble à la Cln-otn. Orlei/i de M., mais
celle-ci est plus petite. La cuticule est très finement annelée et
— 13 —
présente sur les champs latéraux des séries transversales de
petits cori)us('ules oblongs ou en forme de Ijaguettes (ûg. l(f, le).
Ces corpuscules, qui ne furent pas vus })ar M. von Linsto\\', sont
prol>al)lem('nt situés dans les anneaux cuticulaires mêmes, non
pas dans les sillons intcrannulaires. Quand on s'imagine au
milieu de chaque anneau cuticulaire une ligne ti'ansversale divi-
sant la série transversale de corpuscules en deux moitiés égales,
la distance entre une telle ligne et la suivante mesure chez le
mâle, au milieu du corps, 1.2 p.. Immédiatement en avant des
taches oculaires, qui ont une covdeur )'o/(ge jaunâtre ou bru-
nâtre, la cuticule porte toujours ({uatre paires dc^ soies courtes
(fig. \a) dans les lignes submédianes, les soies de chaque paire
étant placées l'une en avant de l'autre. La cuticule porte en
outre, sur le corps entier, tant cIkv. le mâle que chez la femelle,
de petites soies submédianes qui se trouvent à des distances irré-
gulières; ces soies sont beaucoup })lus courtes que chez la Chrom.
hiocutatd ; von Linstow ne les a pas observées.
La tète est troncjuée, sans lèvres ou })apilles, et hérissée de
quatre petites soies submédianes. La cavité buccale est assez
profonde, c'est-à-dire 8.7 fx, et ressemble à celle des espèces
voisines; la dent dorsale (hg. \a) est assez grande, mais
je n'ai pu voir si les deux petites dents subventrales qui
existent chez d'autres espèces de ce genre étaient présentes ou
non. Cette espèce se reconnaît aussitôt à sou (jrauit et trèa
uiuscuJeux butbe œsophagien (fig. 1), qui mesure un peu plus
d'un ({uart de la distance entre l'orifice buccal et l'extrémité pos-
térieure de l'œsophage; au milieu du bulbe, les parois du tube
interne sont dilatées de façon à former trois lamelles chitineuses
semi-ovales, dont l'une se trouve dans la ligne médiane ventrale,
tandis que les deux autres sont subdoi^sales. Ces trois lamelles
(fig. \b) sautent aussitôt aux yeux et c'est à elles que s'insère la
très forte musculature radiaire du bulbe. Vu par transparence,
l'intestin présente une QonXam: ja une brunâtre.
L'orifice excréteur de la glande ventrale se trouve au ni\ eau du
fond de la cavité buccale. Les organes latéraux sont situés au
niveau de l'insertion des soies céphali(|ues ; leur forme et leur
structure restaient inconnues. La queue (fig. 1/') s'atténue gra-
duellement et se termine i)ar un petit tube conique de sortie,
comme chez la Chrojji. (h'Jeij/ et la (lironi. biocutata.
Les spicules (fig. \d) sont longs de 32-33 u; ils sont courbés et
se terminent en pointe obtuse. La pièce accessoire se compose de
— 14 —
deux sillons cliitincnx roiinis au milieu et dont Vexirî'iu'itc dis-
tnle on infértciwe es/ légèrement dirifiée de côté (fig. le),
disposition l)i(>n visible sur la figure 33 du mémoire de M. von
Linstow ; la pièce accessoire est longue de 23-24 o. En avant de
l'anus, le mâle présente deuœ ou trois pajnlles médianes,
situées à des distances égales l'une de l'autre; ces papilles
(fig. \d) ressemblent à. celles des espèces voisines. Von Linstow
observa deux papilles préanales chez des mâles longs de
0.69 mm.; moi, j'en rencontrai parfois trois, par exemple, chez
un individu long de 0.81 mm. ; un autre exemplaire, qui mesu-
rait 0.86 mm., n'en portait au contraire que deux. Chez les
jeunes individus, il n'existe encore qu'une seule papille à ce qu'il
paraît; c'était le cas chez un exemplaire long de 0.74 mm.; je
dois cependant remarquer que les mâles décrits par von Linstow
comme étant munis de deux papilles n'avaient encore qu'une
longueur de 0.69 mm. Malgré cela, j'incline à penser que les
papilles préanales paraissent successivement.
La vulve se trouve le jjIus souvent un peu eu a ru ut du
/julieu du corps, mais ordinairement pas autant que ne
l'indique von Linstow; d'après lui, la partie du corps située en
avant de l'ouverture génitale se rapporterait à la i)artie jjosté-
rieure comme 8:9; parmi les individus observés })ar moi, il n'y
avait qu'un seul qui présentait la proportion 8 : 8 5/7 ; chez
tous les autres, le second nombre était plus petit. L'utérus con-
tient un ou deux œufs.
Cette jolie espèce, agile dans ses mouvements, habite la Seine
près de Sèvres, où elle est très commune sur les pierres gisant
dans la rivière. Des exemplaires munis d'oMifs furent observés
aux mois de juin et de juillet.
La Chrom. hutbosa de von Dada}- me semble être identique
à l'espèce décrite ci-dessus.
Distribution géograi)hique : Allemagne, lac de Ratzeburg
(von Linsto\\').
8. Chromadora bioculata .Max Schultze
PL I, n-. 2
de Man, Le, 1881, p. (K), taf. VIII, fig. 32.
Cette espèce est très commune dans la Seine, })rès de Sèvres,
où ]')lusieurs exemplaires furent capturés en juillet sur les pierres
gisant dans la l'iviore près des boi'ds. Les mâles étaient longs de
0.77 inm.; les femelles avaient, une longueur de 0.73 mm.; la
longueur des individus observés dans la Hollande ('"tait un peu
plus grande : ç^ = 0.8 mm., Ç = 0.9 mm. Les taches oculaires
sont rouges. L'intestin a une couleur verte assez p.àle. (Quatre
séries de soies sur la longueur entière du corps (fig. 2). L'arma-
ture génitale se voit dans les figures '2a, 2b, 2c. Les femelles,
longues de 0.65 mm., jjortaient déjà un œuf; ces œufs sont longs
de 0.0 1 mm.; l'utérus en contenait tout au plus deux. Le plus
souvent, le tube génital postérieur de la femelle est un peu plus
long que l'antérieur; celui-ci, guère plus long que l'œsophage,
occupe à peu près la moitié de la distance entre son extrémité
postérieure et la vulve; le tube génital postérieur s'étend de mêmeà peu près jusqu'au milieu de l'espace entre vulve et anus.
Distribution géographique : Allemagne, Mein (Biltschli);
Hollande (de M.); Hongrie, lac Balaton (v. Daday); Esthonie,
Obersee près de Reval (G. Sclm.).
9. Mononchus maerostoma lîast.
de Man, /. c, 1884, p. 03, taf. IX, fig. 34.
Plusieurs exemplaires furent capturés, aux mois de juin et
de juillet, aux bords de la Seine près de Meudon, dans la terre
humide ou bien dans la rivière elle-même, mais j'observai cette
espèce aussi à Saint-Quentin. Tous les exemplaires étaient des
femelles. Une femelle, longue de L9 mm., portait un œuf qui
avait une longueur de 0.09 mm.; le tube génital antérieur ne
s'étendait pas encore jusqu'au milieu de la distance entre la
vulve et l'extrémité postérieure de l'œsophage; le tube génital
postérieur, guère plus long que l'autre, était aussi long que la
queue et n'occupait qu'un tiers de l'espace entre vulve et anus.
La queue de cette femelle et quelques autres paraissait un peu
moins grêle que sur ma figure (/ c, fig. 34c); aussi l'œsophage
était-il comparativement un peu plus court que chez les indivi-
dus observés en Hollande, j3 étant chez ceux-ci = 4, mais chez
les femelles de la Seine = 4 2/3 — 4 3/ L J'observai cependant
plus tard des femelles qui s'accordaient beaucoup mieux avec les
figures citées, de façon (pie nous n'avons affaire ici qu'à des
variétés individuelles.
Distribution géogTaphi(pie : Angleterre, Fahnout h, (Hast.);
16 —
Hollande (de M.); Allemagne, Ei'langen, Weimar, (de j\I.);
Suisse, Roth-See pivs Lucerne (de M.)- M. \on Daday a décrit
nne variété arinatu.s provenant du lac IJalaton.
K). Trilobus graeilis Bast.
de Man, /. c, 1884, \). 75, taf. XI, fîg. 43.
Cette espèce était très commune dans la Seine pi-ès de Sè\res,
où je recueillis, aux mois de juin, juillet et août, plusieurs
exemplaires entre les algues vertes dont les pierres étaient
recouvertes. J'observai un mâle dont l'armature génitale était
bien développée et qui i)résentait déjà (> papilles i)réanales,
({uoiqu'il ne lut long (pie de 1.5 nnn. Une femelle portant nn
œuf long de 0.063 mm. mesurait \A) mm. et une autre ayant
les organes génitaux bien dé^eloppés, quoi(pie sans œufs, avait
une longueur de 3 mm ; ces deux femelles furent recueillies en
juin. Il résulte de ces observations : P (pie l'appareil génital des
mâles est déjà développé à une longueur de 1.5 mm. ;2° que les
femelles produisent déjà des œufs quand elles ont une longueur
de 1.9 mm., et 3° (pie roi)inion d'après la(pielle les individus
observés en juin seraient de plus petite taille que ceux d'octobre
(de M., /. c.) est erronée.
Distribution géogi'a})hique : Angleterre, Falmoulli, eau sau-
màtre (Bast.); Allemagne, le Mein (Biits(dili), environs de Wei-
mar, (de M.); Hollande (de M.); Hongi'ie, lac Balaton (v. Daday),
Zsit\a (()rl(,\y).
11. Trilobus pellucidus Bast
de Man, /. r., 1884, p. 7(3, taf. XI, tig. 44.
Au mois de juin une femelle portant un seul œid' fut l'ecueil-
lie dans la terre très humide des bords de la Sein(>, près de
Méudon; elle était longue de 2.7 mm.Distribution géograplii(pu! : Angleterre, Falmoutli (Bast.);
Allemagne, le Mein (Biilscldi); Hollaude (de M.); Hongrie
{\. Daday).
12. Prismatolaimus dolichurus de M.
(le Mail, /. c, 1884, p. 80, taf. XII, fîg. 47.
Fno femelle adulte, longue de 1.2 mm., fut captuive eu
juillet sui" une pierre submei'gée ])ai' la Seine pi'ès de Sèvres.
Des soies comptes étaient répandues sur le corps entier. La dis-
tance, 8G p., des organes latéraux de l'extrémité antérieure
mesurait à peine 1/7 de la longueui- de l'œsophage.
<^ette espèce liabite aussi les environs de Saint-Quentin. Une
femelle longue de 1.15 mm. v fut observée en juillet; il m'a
paru ({ue ses organes génitaux étaient doubles, situés aux
deux cotés de l'ouvertuiv gé>nitale.
Distribution géograplii(pie : Hollande (de M.) ; Russie, envi-
rons de Moscou (de M.).
lo. Diplogaster fietor Bast.
de Man, /. c, p. 88, taf. XIII, fig. 51.
Cette espèce n'est pas rare dans la Seine près de Sèvres, sur
les pierres submergées et couvertes d'algues. J'observai en juin
une femelle longue de 1.35 mm. qui portait un œuf long de
0.09 mm. ; le tube génital antéiieur, un })eu plus long que l'œso-
phage, s'étendait un })eu au delà du milieu de l'espace enti-e
l'extrémité postérieure de l'œsophage et l'ouverture génitale ; le
tube postérieur, un peu plus court, atteignait presque le milieu
de la distance entre l'ouverture et l'anus. Chez une autre
femelle, longue de 1.3 mm., le tube postérieur était un peu plus
long que l'antérieur.
Distribution géographiiiue : Angleterre, Bagshot (Bast.);
Hollande (de M.).
14. Diplogaster sp.
J'ai encore observé dans la Seine une deuxième espèce du
geni'e Diplogaster, mais une seule femelle sans œufs, capturée
en juin sur une pierre revêtue d'algues et gisant dans larivière.
Cette femelle était longue de 1.4 mm., a = 30, (3= 8,/ = 3.
Le corps était longitudinalemeiit strié et se terminait par une
queue très longue. L'intestin présentait une couleur foncée.
— 18 —
L'ouverture génitale se trouvait un \)r\\ en axant du milieu; sa
distance de l'extrémité de la (jueue mesurait les trois cinquièmes
de la longueur totale; la distance delà vulve jusqu'à l'extrémité
postérieure de l'œsophage était justement deux fois aussi longue
que celui-ci et égale à la distance entre vulve et anus. Le tube
génital antérieur, long de 0.18 mm , s'étendait jusqu'au milieu
de la distance entre la vulve et l'extrémité postérieure de l'œso-
phage; le tube postérieur n'était guère plus court.
Peut-être avons-nous alïaire ici au Diplogaster^ striatus
Btsli, espèce observée dans le Mein. (Bïitschli, Zeitschrift f.
wiss. Zoologie Bd. XXVI, p. 372, taf. XXIIl, flg. Aa-c).
15. Pleetus cirratus Bast.
de Man, /. c, 1884, p. 110, taf. XVII, fig. 68.
Une femelle adulte portant trois œufs fut recueillie en juin
dans de la terre très humide des bords de la Seine près de Meu-
don. Cette femelle était longue de 1.2 mm. ; [3 = 4, y = 9.
La partie antérieure d(> l'appareil génital avait justement la
même longueur que la partie postérieure, c'est-à-dire 0.2 mm.;
la partie antérieure occupait les deux tiers de la distance entre la
vulve et l'extrémité postérieure de l'œsopliage, le tube postérieur
les deux cinquièmes de la distance entre vulve et anus. La
vulve se trouvait justement en avant du milieu du corps.
Distribution géographique : Angleterre, étang près de Bagshot
(Bast.); Hollande (de M.); Allemagne, Erlangen, Weiraar
(de M.); Hongrie, Budapest (Orlev), lac Balaton (v. Daday)
;
Suisse, Pvoth-See près de Lucerne (de M.); Russie, environs de
Moscou (de M.).
1(3. Pleetus sp.
J'observai en juillel, aux bords de l'étang des Fonceaux, une
femelle d'une esi)èce du g(>nre Pledua qui était très voisine du
Pleetus loiigianuhiins Btsli (voir de Man, 1. c. 1884, p. 114,
taf. XVIII, fig. 73), mais (|ui en semblait ditiérer par la forme
de l'extrémité anlérieur(\ la tête. En efiet, la tète de cette femelle
avait la formc^ hémisphèri(|ue et les soies céphaliques étaient
implantées à la base légèrement rétrécie de la tète. Cette femelle
— 19 —
n'était longue que de 0.38 mm., a = :^5, [3 = 3 4/5, y ^= 6,
chiti'res concordant avec ceux du Plectus longicaiulatus. L'ou-
verture génitale se trouvait justement au milieu, sa distance de
l'extrémité postérieure de l'œsophage était un peu plus courte
que celui-ci et mesurait les deux tiers de la distance entre
vulve et anus.
17. Plectus parvus Bast.
de Man, /. c, 1884, p. 115, taf. XVIII, tig. 74.
Une femelle longue de 0.53 mm. et portant un œuf fut
capturée, en août, aux bords de l'étang des Fonceaux : a= 22,
(3 = 4, 7 = 10. L'exemplaire concordait très bien avec la
description citée ; seulement, je croyais voir une trace de lèvres,
et la cavité buccale n'était pas si distinctement délimitée que sur
mes figures. La queue ressemblait parfaitement à ma figure y4.
La longueur de la cavité buccale, depuis l'extrémité antérieure
jus({u"aux trois lignes chitineuses de l'œsophage (7. c, flg. yAa),
mesurait 23 a. La tète portait quatre petites soies céphaliques
courtes. La membrane latérale était assez large. Les mouvements
de cette femelle, qui appartient à la même espèce que j'observai
deux mois plus tard dans une terre sablonneuse et sèche de l'ile
de Walcheren (de Man, Ann. Soc. Zool. de Belgique, 1906),
étaient très agiles. L'ouverture génitale se trouvait justement
en arrière du milieu.
Distribution géogTaphi(pie du Plectus p(/i'rus B-àsl. : Angle-
terre, Falmouth (Bast.); Hollande (de M ); Allemagne, envi-
rons de "W^eimar (de M.).
18. Aphelenchus sp.
Au mois d'août je capturai dans la Seine, près de Sèvres,
sur une pierre revêtue d'algues, une femelle d'une espèce du
genre Apheleiicluis, longue de 0.45 mm. La forme était assez
grêle, le nombre a, exprimant le rapport entre la longueur et
l'épaisseur moyenne, étant 28; (3=-- 7 1/2, y = 10. La tête,
hémisphérique , était séparée du corps par un léger rétrécisse-
ment, comme chez YAph. helophilus de M., espèce habitant la
terre humide aux environs de Leyde (de Man, /. c, 1884,
— 20 —
laf. XXI, fîg '.•1^0; 1'' '''^^' •'''li*' (Jéj)()in-nte dclèn-cs;. Le sivlet
était loiiii,' (le 1 i a et le bouton li'ilobt' à son cxtiviiiitô posté-
lieiire, était fa'ihle Le bulbe était [)ivcis('int'nt aussi long ({uc le
stjlet et mesurait donc un })eu i)lus d'un (•in(|ui('me de l'œso-
phage, qni était long de (32 ',-. Le vaisseau excréteur présentait un
COUPS ondulcux et s'étendait sur la r(''gion œsophagienne et sur
une partie antérieure de la l'égion intestinale, au côté gauche du
corps. La cuticule était très finement annelée. La distance de
l'ouverture g<''nitale ius([u'à l'extrémité de la queue mesurait un
tie)'s de hi longueur du corps et la distance enti'e vulve et anus
était moitié aussi grande que celle entre la vulve et l'extrémité
postérieure de l'œsophage. Le tube génital, qui s'étendait en
avant, présentait un prolongement postvaginal.
La queue caractéristique avait exadeineni la même forme
que celle du Plectus geophilus de M. (de Man, /. c, 1884,
taf. XVII, fîg. 7ld).
Peut-être avons-nous affaire ici à la femelle de VApheIe}i-
C'/ii^s ri rrt7/.s Btsli, espèce habitant le Mein, également sur des
pierres et dont la femelle est encore inconnue^ ; de nouvelles
recherches devront élucider cette question.
19. Tylenchus filiformis lîiitsc hli.
de Man, /. c, p. 152, taf. XXIV, fig. lOL
Une femelle longue de 0.83 mm. fut capturée en août dans la
vase de la Seine près de Meudon, on même temps que des
exemplaires du Dor-i/lrihiiiis stagmiîis. Quant aux dimensions,
a = 35, [3=6, 7 = 5. La distance de l'ouverture génitale
jusqu'à l'extrémité de la queue était un peu plus grand<> (ju'un
tiers de la longueur totale.
Distribution géographique : Allemagne, Francfort-sur-le-
Mein (Bûtschli), environs de Weimar (de M.); Hollande (de M.).
20. Dorylaimus obtusieaudatus lîast.
PI. 111, li-. ;3
de Man^/. c , 1884, p. KiT, taf. XXVI, fig. 10<.».
. Au mois de juillet, trois femelles, dont chacune poi'tait un
œuf, furent capturées dans la terre humide du bord de l'étang
— 21 —
des Fonccaux. La plus g'i'an<le était longue de 2.5 mm., a = 27,
j3 ^^ 4 2/3, y = 80. La partie postérieure de rapi)a''eil génital
mesurait à peine un tiers de la distance entre vulve et anus
L'œuf était long de 0.12 mm. La région œsophagienne a été
figurée (fig. o), povu- montrer la forme du corps et de l'œso-
phage.
Distribution géographiiine : Angleterre, Falmouth (Bast );
Hollande (de M.); Allemagne, Ei'langen, A^'eirnar (de M.);
Autriche, Laibach (de M.); Russie, environs de Moscou (de M.).
21. Dorylaimus intermedius de AL (
de Man, /. c, 1884, p. 170, taf. XXVII, flg. 113.
Dans un sol assez sec, non loin de l'étang des Fonceaux, un
mâle, long de 2.1 mm., fut recueilli au mois de juillet; déjà
auparavant cette espèce avait été observée par moi dans un
terrain semblable (de Man, Tijdsclirift Ned. Dierk. Vereen.,
2e série, 1)1 I, Afl. 1, 1885, p. 13) Les nombres indiquant les
dimensions étaient a = 55, (3=5 1/2, y = 90; ils sont un
peu plus grands que ceux des individus observés par moi en
Hollande, clicz les(piels a = 40, [3 = 4 — 5, y chez le
mâle = 00. Le mâle franc;ns présentait huit papilles préanales,
dont rantérieure était plae(''c un peu plus loin de la septième que
les précédentes. C'est à cause de ces difierences que je rapporte
avec quelque doute ce mâle au Dor. intermedius (voir p. 14).
Distribution géographique: Hollande (de M); Allemagne,
environs de M^'imar (de M.); Suisse, Roth-See jn'ès de Lucerne,
(de M.); Hong'i'ie, lac Ralaton (v. Dadav).
22. Dorylaimus Carteri Bast. var.
de Man, /. c, 1884, p 177, taf. XXIX, fig. 122.
Aux bords de la Seine, près de Meudon, dans un sol très
humide, un mâle et une femelle furent observés en juin. La
femelle, qui appartient à la variété caractérisée par une (pieue
un peu plus longue que chez le type et par la situation de l'ouver-
ture génitale, était longue de 2.1 mm., a = 35, (3 :^ 4 4/5,
y = 25; cette femelle portait un œuf. La queue mesurait juste-
ment un cinquième de la longueur de l'œsophage.
L'ouverture génitale était située assez loin en avant du milieu,
sa distance jusqu'à l'extrémité de la queue mesurant 1.2 mm.
Le tube génital antéri(3ur s'étendait presque jusqu'au milieu de
la distance entre la vulve et l'extrémité postérieure de l'œso-
phage; la partie postérieure, longue de 0.3 mm., était, chez
cette femelle, plus courte qu'un tiers de l'espace entre vulve
et anus.
Le corps du mâle, (pii était long de 2.21 mm., était plus
grêle que celui des individus observés en Hollande : o-, en effet,
était 48, tandis que chez l'espèce typique ce nombre varie
entre 30 et 35; (3 = 5, y = 28. Comme chez les individus
décrits par Bastian, le mâle présentait 11 papilles ])réanales,
outre la papille anale.
Distribution géographique : Angleterre, Falrnouth (Bast.);
Hollande (de M.); Allemagne, environs de léna (Cobb).
23. Dorylaimus centrocercus de M.
PI. I, fig. 4
de Man, l. c, p. 175, taf. XXVIII, fig. 119.
Sjn. : Dort/laimus oMusicaudatus, de Man, /. c, 1884,
p. 167, taf. XXVI, fig. 100(/-e (mâle).
J'eus le bonheur, lors de mon séjour à Sèvres, de découvrir le
mâle, inconnu jusqu'à i)résent, de cette espèce si commune dans
les prairies de la Hollande. Tandis que la femelle a une queue
très caractéristique en forme de croc/ie/, celle-ci paraît obtuse
chez le mâle : ayant observé en même temps, avec les mâles,
plusieurs femelles dans le même gazon, il m'a été possible d'étu-
dier les autres caractères, non pas sexuels, propres à ces mâles
et à ces femelles et de constater ainsi que ces exemplaires
étaient, en effet, les deux sexes d'une même espèce.
Ces vers furent recueillis en juillet dans un sol assez humide
près du bord de l'étang des Fonceaux.
.Le mâle du Dor. ceiitrocercu,s présente, à l'exception de la
queue, la même forme géuérale du cori)S (pie la femelle, mais sa
longueur totale est un peu plus petite (|ue celle de la femelle
observée en Hollande. Le premier mâle (pie je recueillis était
long de 1.37 mm., a = 33, (3 = 4 3/5, y = 60. La (jueue
(fig. 4a) était très courte et obtuse. Outre la pajjille anale, ce
mâle présentait une série médiane de vingt papilles préanales
— •^3 —
qui étaient contiguës; la première ou postérieure était située un
peu en a^ ant des spicules. La distance linéaire des extrémités
des spicules (fig. Aa) mesurait 47 p_, cette distance n'était
donc pas encore deux fois aussi longue que la (pieue. Les
spicules ont une forme assez trapue, ils sont un peu courbés;
leur extrémité distale ou inférieure (fig. Ah) est arrondie et ils
présentent les deux stries cliitineuses comme chez d'autres
espèces ; les pièces accessoires sont petites, triangulaires,
pointues (fig. An).
Le deuxième mâle observé, long de L5 mm., était muni de
seize papilles préanales, outre la papille anale; les spicules
étaient longs de 46 u. Quant aux dimensions, a = 32,
(5=5, y = 00.
Un troisième, enfin, long de L58 nun., })résentait les dimen-
sions suivantes : a = 34, (3 = 5, y = 65. Il v avait dix-sept
papilles préanales, outre la papille anale. Les spicules mesu-
raient 47 p..
La longueur des trois femelles étudiées et dont chacune
portait un œuf, variait entre 1.35 mm. et L45 mm. Chez l'une
de ces femelles, longue de 1.43 mm., a = 30, (3^4 1/3, y == 45.
L'ouverture génitale se trouvait un peu en arrière du milieu et
l'œsophage mesurait justement les deux tiers de l'espace entre
la vulve et son extrémité postérieure. Le tube génital antérieur
s'étendait un peu plus loin que le milieu de la distance entre la
vulve et l'extrémité })Ostérieure de rœso})hage; le tube génital
postérieur, guère plus long, mesurait la moitié de l'espace entre
vulve et anus. L'œuf était long de 75 p. La queue de cette
femelle avait la forme figurée dans ma Monographie (fig. llOrf).
La tête, c'est-à-dire l'extrémité antérieure du corps portant
les i)a])illes, parait assez haute chez cette espèce, presque moitié
aussi haute que large à la base; chez la femelle, longue de
1 43 mm., la tète était large de 14 a à la base et haute de 6.5 p.;
chez le mâle, long de 1.5 mm.,ces nombres étaient 14.5 p et 6.5 p..
Le stvlet de cette femelle était long de 40 p., mesuré de la pointe
jusqu'à l'épaississement postérieur; celui du mâle mesurait
39.2 p..
La partie étroite antérieure de l'œsophage passe assez
suhiieinent, en arrière du )tiiJieu, dans la partie élargie
(fig. 4), de sorte que la partie antérieure se rapporte à la partie
postérieure comme 3 : 2; c'est ainsi que chez le mâle, long de
1.37 mm., la partie antérieure et étroite de l'œsophage mesurait
24 —
0.17G mm. et la partie postériem^e 0.117 mm. Clicz la femelle
rcesopliage concorde tout à fait avec celui du mâle.
Il me parait très vraisemblable cpie le ver (fue j'ai décrit
et tîgurc auparavant comme le mâle du Dor-. ob/usicaudaliis
Bast. (de Man, /. c, p. 108, taf. XXVI, fig. I09(l-e), est le mâle
du Dor. ceufrocercas décrit ci-(hsi^\\s. En efiet, comme je l'ai
observé plus tard, le mâle du Do)'. obfusicmid/ftus ne iwésente
(|ue 11 papilles préanales, outre la papille anale, qui, chez cette
espèce, est double; les deux premières, en comptant d'arrière en
avant, sont contiguës; la troisième se trouve à une petite
distance; ces distances augmentent graduellement, tandis que les
papilles antérieures sont un peu plus rapprochées. Les spicules,
dont la forme est différente, sont pres(|ue trois fois aussi longs
que la queue et les pièces accessoires, qui sont étroites, allongées,
mesurent un Uei'S de la longueur des spicules (voir de Man, Ann.
Soc. Zool de Belgique, 1906).
Le mâle du Dor. centrocercus décrit ci-dessus semble se
rapprocher beaucoup de celui du Dor. polyhhistus Bast.,
espèce habitant l'Angleterre, mais chez celle-ci l'œsophage ne
mesurerait (\\xun septième de la longueur totale.
Distribution géographi(iue : Hollande (de M.).
21. Dorylaimus Bastiani Btsli.
de Man, /. c, p. 185, taf. XXXI, fig. VM.
Une femelle, longue de 2.3 mm., sans (xnifs, fut capturée dans
de la terre assez sèche, i)rès de l'étang des Fonceaux,au mois de
juillet, a = ôO, p = 5 1/2, y = 25. Le tube génital antérieur,
long de 0.35 mm., s'étendait pres(iue jusqu'au milieu de la
distance entre la vulve et l'extrémité postérieure de l'œsophage;
le tube postérieur, un peu plus court, occupait à peine un tiers
de l'espace entre vulve et anus.
Maintenant, il me parait très vraisemblable que le ver que j'ai
rapporté (j). 11) au Dor. in/ermediifs doit être regardé comme
le mâle, inconnu jus(pi'à présent, du Doi-. Bastiani. Ce ver se
trouvait dans le même gazon (|ue la femelle du Do)'. Bf/stiaui,
longue de 2.3 mm. La taille et les diuKîUsions, indiipiées i)ar les
nombres a, p et y, concordent pariai temenl, de même que la
tête et l'œsophage. De nouvelles recluM-ches sont nécessaires
pour élucider cette question.
— 25 —
Une femelle portant un seul œuf fut recueillie aussi dans la
Seine, sur une pierre, au mois d'août. Comme j'indiquerai dans
un travail qui paraitra bientôt dans les Annales de la Société
Zoohxjiqne de Belgique, il est encore douteux si le Dor.
h7'i(jdammeusis de M. soit, en effet, une autre espèce que le
Do}\ Bastiani, lequel, dans ce cas-ci, ne serait (ju'une variété
à queue plus courte.
Distribution géographique : Allemagne, Francfort-sur-le-Meiu
(Bûtschli), léna(Cobb); Hollande (de M.); Hongrie, lac Bala-
fon (v. Daday).
25. Dorylaimus stagnalis Duj.
PL II et m, fiy. 5
Dorijlaimus stagnalis, Dujardin, Histoire naturelle des
Helminthes, 1845, p. 281, pi. 3, fig. C.
T)ori/lai}nas stag /a/lis, Bastian, Monograph on tlie Anguil-
lulida", 18G5, p. 10(5, pi. IX, fîg. 35-37.
Do?ylaimns stagnalis, Bûtschli, Beitrage zur Kenntniss
der freilebenden Nematoden, 1873, p. 27, taf. I, fîg. 4a-d, et
dans Zeitsclu'ift f. wiss. ZooL, XXVI Bd., p. 379, taf. XXV,fîg. 13 a-c.
Doi'i/laimus stagnalis, de Man, /. c, 1884, p. 18(), taf.
XXXII, fig. 132.
Dorylaimus stagnalis, von Daday, Zoolog. Jahrb. Abth.
fur Syst. Bd. X, 1897, p. 124.
? Dorylaimus striatus, von Daday, l. c., p. 127, taf. 14,
fig. 8-11, 14.
C(3tte espèce, déjà connue depuis plus de soixante ans, est très
commune dans la Seine, près de Meudon, où de très nombreux
exemplaires adultes furent recueillis, mâles et femelles. Le mâle
atteint une longueur de 5.3 mm., la plus grande femelle observée
était longue de 8 mm. ; les autres dimensions sont indiquées,
chez le mâle, par les nombres a = 40, (3 = 5, 7 = 115; chez
la femelle a varie entre 40 et 45, (3 entre 5 et 0, y entre 1(5 et 20.
Le corps (fig. 5) a donc wno, forme assez grêle, tant chez hî mâle
que chez la femelle; la région antérieure ou œsophagienne (fig. 5<:'
et 5^/) s'atténue assez foiiement, de sorte que la largeui' à la
base de la tête n'est (\\\ an cinquième ou sixième de celle à
l'extrémité postérieure de l'œsophage. La tète, large de 30 u,
2
— 26 —
n'est pas liante et porte deux cercles de très petites pa])illes, qui
échappent facilement à la vue ; le cercle antérieur se compose de
dix papilles, arrangées comme d'oi'dinaire (ûg. 5c); rautr(> n'en
semble avoir (pie six.
Les organes latéraux se voient dans les figures 5e et 5r/; ce sont
ties sillons assez /r^r^c.v, conduisant dans une fissure située entre
la tête et les parois du corps (fîg. 5e) ; ces organes ressemblent un
])çu à ceux des genres Oiicholaimiis et Anticoma (de Man,
Anatoniisclic Untersuchungen iiber freilebende Nordsee-Nema-
toden, f88C), taf.VI, fig. 5, taf. IX, fîg.Tr/). D'aiirès M. Cobb, les
organes latéraux du l)or.'paj)'i1hihis Basi. et du /)or. Langii
Cobb seraient spiroïdes (Cobb, Jenaisclie Zeitsclirift f. Natur-
wiss., 188S, p. 69).
La cuticule est lisse, non pas ann(3lée extérieurement, mais elle
présente, dans une couche située près de la surface externe, des
stries tongitadiuates sur la longueur entière du corps (fig. ~)a).
Le nombre de ces stries se mont(^ à trente, sur la moitié })Osté-
rieure (\\\ corps des femelles; ces stries, déjà observées parBastian
(Pliilos. Ti-ansact., 186(5, p. 551), sont parallèles les unes aux
autres; leur largeur est à peu près égale et les espaces inter-
médiaires (pii les s('pai'ent sont également à peu près de la même
largeur. Au milieu du corps des femelles la largeur des stries varie
entre 3.6 a et 5.8 ry, ct^lle des espaces intermédiaires entre 8.7 u
et 10.2 u. Sur la région postérieure du corps les stries s'anasto-
mosent par-ci par-là, et jjarfois elles sont ici moins distinctement
parallèles. Au-dessous de la couche des stries longitudinales sont
situées les deux couches à fibres oblirpies croisées (fîg. 5^), qui
ont été également déjà observées jiar Bastian (t. c ). Enfin,
j'ai cru avoir observé un(» couche profomle de fibrilles transver-
sales.
La région antérieure du corps, autant que s'étend le stvlet, se
voit dans les figures 5e et 5r/,la pointe du stylet dans la figure 5/'.
De fines papilies cuticulaires sont répandues sur le corps entiei',
surtout dans les régions submédianes.
Mes observations sur le mâle ne concordent pas avec celles
décrites par Biitschli dans le second de ses travaux cités. Outre
la papille anale, située justement en avant de l'anus (elle n'est pas
indi(piée sur la figure ÏSh), le mâle présente, à ipielque distance
(le celui-ci, nue séi-ie jn'éanale et niédi(me (te 45-48 ])apittes.
Ces jiapilles, dont chacune est poui'vue d'un nerf (fig. 5/), sont
vontiyni's; étant assez saillantes, (.'lies l'ont paraître rint('gu-
— 27 —
ment comme annelé (fîg. 5?) et M. Biitsclili l'a, en effet, décrit
comme tel. Ces papilles vues de face })résentent une forme ova-
laire (fîg. Dy); leur axe transversal, c'est-à-dire leur largeui-,
mesure 7.27 y.. L'es})ace occupé par les papilles est long de
0.125 — 0.15 mm. ; la distance de la papille i)Ostérieur(' jusipi'à
l'anus est longue de 0.17 mm., et la distance de la papille pla-
cée le plus en avant jusqu'à l'anus mesure 1/1 I — l/Ki de la
longueur totale. Bastian n'a pas non })lus obscrx é' ces paj)illes. La
distance linéaire des extrémitt'S des sj)icul('s nicsuivo.l mm.,
distance à peu près deux fois aussi gi-andc (pic la ((ueiic (lig. .5/i);
ces organes, dont les deux extrémités sont assez algues, sont
courbés et l'on voit en dedans deux stries chitincuses presque
contiguës. L(^s pièces accessoires sout petites, triangulaires
(fig-.-^/O-
L'ouvei'ture génitale est toujours située en avant du milieu
(lig. 5), sa distance de l'extrémité de la queue mesurant les trois
cinquièmes jusqu'à un peu plus des deux tiers de la longueur
totale. La pro})ortion entre la distance de la vulve jus([u'à l'anus
et celle de la vulve jusqu'à l'extrémité postéi'ieure de l'œsophage
est assez variable : parfois la première est trois fois ou un ])eu
plus de trois fois aussi longue (pie l'aiilre; chez d'autres exem-
plaires elle n'était qu'un p(Mi plus de deux fois aussi longucî ({ue la
distance entre la vulve et l'exti'émité posl(M'ieure de l'œsophage.
Le tube génital postérieur est toujours plus long (pie l'auti'e;
chez une h'inelle longue d(! 8 mm. le tube })Ostérieur ('lait une
fois et demie aussi long que la partie anlérieure et occupait un
})eu plus d'un tiers de l'espace entre vulve et anus; le (iibe anté-
rieur s'étendait le long des trois quarts de la distance entn^ la
vulve et l'extrémité postérieure de l'œsophage.
J'observai une femelle longue seulement de 4.8 mm., pourvue
d(''jà de trois œufs; le tube génital i)0stérieur n'était (pie d'un cin-
(piième })lus long (|ue le tube antérieur et occupait justement un
tiers de la distance entre vulve et anus; le tube antérieur s'éten-
dait comparati\ement aussi loin en avant que chez la femelle de
8 mm. Tant(jl la distance entre la vulve et l'extrémité postérieure
ih l'œsophage est justement aussi longue que celui-ci, laiit(Jt
elle est plus petite, tantôt, (pioique rarement, un peu plus grande
(jue l'œsophage.
Le nombi'e le plus élevé d'œufs observés par moi dans une
femelle Se montait à 35 : les œufs sont petits, longs de 0.125 mm.11 me })arait probable que le Do/'. afria/ns v. Daday est id(3n-
— 28 —
tique à. l'espèce décrite par Dujardin, parce que je suppose
que les stries longitudinales ont été décrites par le savant hon-
grois par erreur comme des sillons et que les papilles préanales
lui ont échappé.
Distribution géographique : France, Rennes (Duj.); Angle-
terre, Falraouth, New Cross (Kent) (Bast.); Allemagne, le Mein
(Bïitschli), Erlangen (de M.); Hongrie, Rakôsbach (Ôrley), lac
Balaton (von Dadaj).
26. Dorylaimus macrolaimus de M.
deMan, /. c, 1884, p. 1<)1, laf. XXXIII, fig. 138.
Une femelle sans œufs, longue de 3.4 mm., de cette espèce
très rare fut capturée, en même temps que des exemplaires du
Do7\ stagnaiis, dans la vase de la Seine près de Meudon, en juillet;
quant aux dimensions, a était 50, (3 = 4 1/2, y = 14. La queue
n'était pas normale ; c'est pourquoi le nombre y était un peu
plus grand que d'ordinaire. L'ouverture génitale, située chez le
ver adulte un peu en avant du milieu, se trouvait chez la femelle
de la Seine un peu en arrière du milieu. Le tube génital antérieur
dépassait à peine le milieu de la distance entre la vulve et l'ex-
trémité postérieure de l'œsophage ; le tube génital postérieur,
légèrement plus long, mesurait beaucoup plus d'un tiers de la
distance entre vulve et anus, s'étendant presque jusqu'au milieu
de cet espace.
Distribution géographique: Hollande (de M.); Hongrie, lac
Balaton, environs de Budapest (v. Dadav).
EXPLICATION DES PLANCHES
Planche I. — Fig. 1. Chromadora Ratzehuy^geyisis
Linst., région antérieure d'une femelle, vue du côté latéral,
X 500; \a, la tète de cette femelle, vue de profil, x 1370; 1^,
appareil vahulaire du bulbe œsophagien de la femelle vue de
l)rofil, le côté ventral se trouve à droite, x 1370 ; le, partie de
la r(\gion latérale du corps d'une femelle un peu en a\ant du
bulbe, X 1370 ; k/, région anale et armature génitale du mâle
vues de profil, x 1370 ; le, partie inférieure de l'armature
Arm.Biol. lac.JI. pi.m.
mj.3.1
Ticf.Sa.
Fig.Scj.
J.G.ci.eMaîi deJin. Lith. AiuitJulius Kliakhardl,l,eipzig
— 29 —
génitale vue do la face ventrale, X 27U0 ; \f, queue de la femelle,
vue de profil, X 500.
Fig. 2. (lu-omn(h)}-(i hioculuta. Max Scliultze, région an té-
térieure d'une femelle vue du côté latéral, X 500 ; 2c/, armature
génitale du mâle, vue de profil, X 1350; 'Ih, exti'émités infé-
rieures des spicules et des pièces accessoires vues de la face
ventrale, X 2700; 2c, les mêmes légèrement comprimées, X 2700.
Fig. 4. BorylahniiS centrocei-cus de M., région œsopha-
gienne d'un mâle vue de côté, X 250 ; 4«, extrémité postérieure
du mâle, X 900 ; Àh, extrémité inférieure d'un spicule, X ISOO.
Planche II. — Fig. 5. Doryhùmus stagnaUs Duj., femelle
adulte, longue de 8 mm., vue de côté, X 55 ; hb, \\\q des
couches obliques croisées de la cuticule au milieu du corps de
la femelle, X 1350; he, la tête vue du côté dorsal, X 1350;
5/?, région postérieure du mâle Mie de côté, X 500 ; 5/, vue
d'une partie de la région papillifère préanale du mâle vue de
côté, X 1350 ; 5y, quelques papilles préanales du mâle vues du
côté ventral, x 1350.
Planche III. — Fig. 3. Doryluhnus ohhisicoudatus Bast,,
région œsophagienne d'une femelle vue de profil, X 170, Fig. 5r/,
Dorijldiniiis stagnalis Duj.; vue d'une partie chi milieu du
corps d'une femelle, indiquant les stries longitudinales de la
cuticule, X 350; 5c, vue latérale et 5(/, vue dorsale de la région
antérieure du corps, X (585 ; dans la figure 5c le côté dors.d se
trouve à gauche; 5/, extrémité antérieure du stylet vue du côté
dorsal, X 1350; 5r/, organe latéral de la femelle, X 1350.
o'C^^^o
DIE TIËRWELT DER (iEBlRGSMdHE
eine faunistisch-biologische Studie
von Paul Steinmann, ans Base!
VORWORT.
Die vorliegendo Studie soll niclit eine genaue i'aunistisclie lîc-
arbeitimg der Bergbachbewohnerscliaft sein. Sie ist weit davon
entfernt, auf Vollstandigkeit Ansprucli zu machen. Melirere
Gruppen, z. B. die Nematoden und Oligocliaeten, mussten voll-
slàndig in Wegfall Ivommen, andere wurden nur ergànznngs-
weise beriicksiehtigt. Aucli besclirankte icli meine Untersuchun-
gen auf eigenes Material,und der faunistisclie Teil dieser Arbeil
ist somit ein Sammelbericht. Wenn ich die von andern gefun-
denen Baclifoi'men fast vollstilndig ausscliloss, so bedeutot, das
eine Beeinti'iichtigung, die ich jedoch dadnrch rechtfertige,
dass es mir liauptsàchlicli uni die Biologie der torrenticolen
Fauna zu tun war. Da aber der Begriiï « Bergbach » verscliieden
weit gefasst werden kann und da ich mich auf die Angaben
anderer nicht unbedingt verlassen wollte, zog ich es vor, nur
Tiere zu beriicksichtigen deren Wolinort ich au s eigener
Auscliauung kannte. Icli machte mir dahei' l)ei jedem Bach No-
(izen liber Wasserstand, Temperatur, Gefalle, Grosse des Nie-
derschlagsgebietes, Natur des Untergrundes, Pflanzenwuchs, etc.
Das Untersuchungsgcbiel wui'de môglichst weit ausgedehnt,
damit auseinanderliegende Stromgebiete unter sich verglichen
werden konnten.
Ich batte aiso die Absicht, in weiten Umrissen ein Bild der
.^ 31 ^
Bnclifauiia zii eiitwi'rrcn; icli woUu; zcii;('ii, ans wclclicii biuio-
^isclKui und googi'apliisclion Elcmonten sio sicli zusammensoizt
und wic sich Tior und bi'\volintes Médium zu ciuandcr vcr-
liallen.
Die Ai'boit boscliaftigte micli voni Miirz 1905 bis zum No-
vomber lOOii.
Es drangt micb, aucb an diesor Stcdlo meincm vorohrLen
Lehrer, Herrn Prof D'' F. Zschokke aus dessen Anrogung die
vorliegende Arbeit entspi'ungon ist, und der mir beim Samineln
und Sicliten des Materiales, bei der Besebaftung der Literalur
und in vielen andern Dingen unermiidlich zur Seite stand, von
Herzen zu danken.
Daes auch tiergeogi-apldscbe Fragen wai'en, die beantwortet
werden sollten, war eine genaue Bestimmung des Matei'iales
unbedingt notig. Icli ei'laubte mir dalier, fiir einzelne Gruppen
bewahrLe Spezialisten zu Rat zuzielien.
Die Herren G. Bollinger, D'' J. Carl, S. Clessin, Prof.
D'" 0. FuHRMANN, D'" A. Graeter, Pi'of. D'' R. Lauterborn,
D'' F. Ris, D'' J. Roux, R. Schâferna, D'' A. Thienemann,
Pi'of. D' W. VoiGT, H. Wagner, D^ C. AValter, G. Ulmer,
bestimmten oder controllierten meine Mollusken, Collembolen,
Turbellarien, Copepoden, Dipteren, Perliden, Infusorien, Am-
])liipoden, Trichopteren, Kâfer, Hydracliniden.
Den Hen-en D'' K. Bretscher und D'' Th. Steck bin icb fiir
Ratscliiage betreffend die Literatur zu Dank verpHicbtet.
Beim Sammeln des Materiales wurde ich von den Herivn
G. Bollinger, W. Fehlmann, E. Graeter, Th. Herzog,
I)'- C. V. Janicki, p. Merian, R. Sarasin und D'' C. Walter
untei'stûtzl.
Allen genannten Herren sage ich fiir ihre \vertvolle Mitliilfe
aufrichtigen Dank.
32 ~
EINLEITENDES KAPITEL.
Characterisierung des Untersuchungsgebietes.
Die von mil' niclii- oder weniger genau untersucliten Bacli-
sj'stemo, 59 an der Zald, guliôren vcrschiedenen Gcbirgsgnip-
ix'niind Stromgebioton an, wie folgendc l'horsicld zcigen mag :
Ich sammflto einige Tagc in der Nalie von Lugano uml in
F a i (l .
Wahrend meines Aufentlialtes an der zoologisclien Station in
Tricst (Septembor 1905) untcrsuchte ieli einige Karstbaclio im
Gebict des istrianisclien Flusses Ilisano und den Ausfluss des
unierirdisclien Sti'omes vonSt. Canzian, den Timavo.
Mit Ausnahme des Timavo, den ich seiner tiefen Wassertem-
peratur wegen und als Parallèle zn den Grossen Jurafjuellen,
der source de l'Orbe bei Vallorbes und der source de
l'Areuse bei St.-Sulpice niclit ausser Acht lassen woUte,
waren fasi aile von den genannten Gewàssern typische Wildbà-
cli<>, cliaracterisiert durcli starkes Gefàlle und daher schnell-
fliessendes oft sicli iiberstiirzendes und zerstaubendes Wasscr.
Den Untergrund bilden gewôhnlich macldige F'elstriimmf-r
und grobes Geschiebe von RoUblocken.
Die Auswasclibecken unter den Wassersiiirzen fuUen sicli
teils mit Sand teils mit feinem Scldamm. Die Végétation erfreut
sicli in den obern Regionen keiner grossen Entwickelung;
Aveiter unt(>n, im Waldgebiet, beginnen die Wassermoose eine
grôssere RoUe zu spielen. Niclit selten bilden sicli aucli Algen-
iiberziige an den i'iberttuteten Felsen. In den Quellen des
Schwarzwaldes traf ich ziemlich regelmJissig das Wassermoos
Fo)din(iUfi anfipijreticd an. Im Allgemeinen scheint der
Bach des Kalkgebirges Algen-, der des Urgebirges Moosvege-
tation vorzuziehen. Untergrund, Wasserstand und Temperatur
wechseln in weiten Grenzen je nach der Gesteinsart und Hôhe
der Gebirge, denen der Bach angehort.
Nach allgemeinen Gesichtspunkten liisst sich zwischen Jloch-
(jchh-gshdch und MiffeUjchn-fjshdch unterscheiden.
I. Der Hochgebirgsbaeh ist entweder ein eigentlicher (Uet-
scherabfiuss und zeichnet sich dann durch eine Reilie von Merk-
malen aus, die weiter unten Benicksichtigung flnden sollen,
oder er entspringt auf den Alpweiden oder in Schutthalden oder
wi rd vom Schmelzwasser tiefgelegener Schneefelder gespiesen.
In diesem Fall unterscheidet er sich nur wenig von den Ba-
clien des Mittelgebirges.
Der Gletscherbach ist durch ein grosses Niederschlagsgebiet
cliaracterisiert. Der Wasserstand wechselt daher in weiten
Grenzen, indem Trockenheit und winterliche Kalte das Ab-
— 34 —
sclimelzen (Ici- GlotscliHi' vcrhindei'l nml so giinzliclies Versicgeii
zur Folgc liabcn kann, w.-iluvnd Kcgen und Hiizc Ilochwasser
1111(1 Ûberscliwcmmungeii liervorrufen konncn. Entspreclieml
dor grossen Wassei'meng(? wird dci- Untcrgrund durcli macli-
lige RoUblocke und Felstruramer gebiklet, zwist-ben denen sich
dcr Moranensand des Gletscliers ablagert. Die Temperatur des
Wassers slelit jaliraus, jalircin nur wenig iib(n- dem Sclimelz-
punkt.
Beis[)icl : Fiiidclnbaeh liei Zermatt.
Er luit bei 4.5 km L;inge vom Gletsclier bis zur Eininùndimg
in die Visp 538 m Gel'alle Er entwassert einer Fliiclie von fast
40 km^ Die sein Niederschlagsgebiet umgrenzende Wasser-
sclieide erliebt sich zweimal iiber 4000 m Meereshôlie. (Rimp-
fisclihorn 4203 m vmd Sirahlliorn 4101 m.) der Holienunler-
srliied von diesen Punkten der Wassersclieide bis zur Einmiin-
diing des lîaches betriigt bei 13 km Entfernung in der Luftlinie
2570 m.
Folgende Temperaturen wurden widirend dcr heissesten
Jahreszeit an der Einmiindungsstelle also nacli ca 3.5 km lan-
gem Lauf gemessen :
1.) 7 Augiisl lOOC). . . 2.5" c
2.) 12 100(3. . .3° c
3.) 22 •• 1000. . . 2.5%'
Der GleLsclierbaeh mit seinen extremen Beilingungen isi fiir
Tiere und Pflanzen fast unbewolinbar. Es ist mir niclit ein ein-
ziges Tier \ov Augen gekommen, von dem ich annehmen konnte,
dasses seinen Wohnsitz dauernd im Gletscherbacli aufgesehla-
gen liabe. Fiir Planaricn ist der sandige Untergrund niclit
giinstig. Dit' wenigen Shj//fn/nj/-U\v\en, die ieli bie und da
sammeln konnte, stammen wold aus den kleinen liinnsalen,
die seitlicli in den untern Bach mïmden. In soldien Gewassern
waren die Larvcn oft in Fnmassen anzutreffen.
Ungleich besser gestallen sich die LcbensbetUngungen ini
Hocligebirgsbacli, der auf Alpweiden seinen Ursprung nimmt.
ZscHOKKK bat in seinem Werk iiber dit" • Tierwelt der Hoch-
gebirgsseen (Ue Temperaturen sok-lier Baclie limgere Zeit re-
gelmassig gemessen und kommt zu dem Résultat, dass die iius-
sersten Grenzen von 4" und 12° nur selten iiberschritten wer-
den. Ganz ausnahmsweise stieg die Temperatur aui' 18° bis 10°.
— So-
leil l)in ^'cneigt anzunclimcii, dass es sicli hier iira \\asser-
ai'ino, i'iboi' hcissc Scliuttliaidon und Felswando l'iesolnde I>;ich('
liandelto, die oft aussergewôlmlich warmcs Wassort'iUiron. Wiegross die Wirknng Acr Sonnenstraldon in solclien Fidlen ist,
beweist mir ein kleincs Bachlein westlich von Zerniutt, das hv.\
ca 2500 m. auf einer Alpweide entspringt und mit ()8 "/o Geialle
zu Tal eilt, um bei 1()8() m. in die Visp zii miinden.
Am <S Augiist Quellbac'li 1). ea 2;î(H» m 5.5" c
• 14 •• (sonnig) vor der Miindung in die Visp 13° c
" 15 " (triib) - -. •. 7°c
Die hôcliste Temperatur, die icli wahrend dei' vier Woclien
meines Zermatter Aufenthaltes messen konnte war 13° c. Ge-
Avulnilicli wurden (3-7° niclit iibersclirilten. Bei Bachen ûber
2000 m. war nieist 5° die oberste Grenze.
Die Hoclialpenbiiche, die niclit von Gletscliern gespiesen wer-
den gleichen in ihren Bedingungen, in Végétation, Untergrund
und aueli in der Zusammensetzung der Fauna den jNIittelge-
birgsbJiehen. Ein wichtiger Fnterschied bestelit in dem Um-stand, dass sicli das Wasser hoehalpiner Biiclie meist in Glet-
sclierbaclie ergiesst, dureli deren Unwirtlichkeit eine Einwan-
derung von Tieren aus deni Tal ausgeschlossen erscheint. Die
liochalpinen Bâche in ihrei' Abgeschlossenlieit bieten der
alpin- glazialen Reliktenfauna ein Refugiuni, und icli wi'isste
keinen Ort, wo die Bedingungen t'ilr Reinerlialtung tlieseï- Faunagiinstiger ^\';iren.
II. Der Mittelgebirgsbaeh ist im allgemeinen ausgezeiclmet
durcIi ein kleines Niederschlagsgebiet (ieli beti'achte nur Bâche
mit starkem Gefâlle). Er steht mit dem ïal in oiïener Commu-nication und nimmt auch immer wieder neue Einwanderer auf,
denen Nahrungsmangel und zu liohe Temperatur, ï'bervolkerung
der Fliisse oder Feinde aller Art das Bleiben im Tal verunmôg-
lichen. Die Végétation ertVeut sich meist einer starken Ent-
wickelung. Besonders wenn der Bach Berg\\'âlder durchstrômt,
siedeln sich gerne allerlei Pflanzen in seiner feucliten Nâhe an.
Moose iiberziehen die umspiilten und auch die untergetauchten
Felsblôcke, und da und dort, wo sich unter stiu'keren \\^asser-
fâllen kleine Auswaschbecken nut sandigem oder schlammi-
gem Untergrund bilden, nisten sich auch Algen ein. Die sub-
mersen Moosrasen beherbergen neben Diatomeen auch eine
— 36 —
reiclie Fauna, die wir in ciiiom spjiieren Kapitel zvi liespreclien
gedenken.
Der Wassersiand ist l)eim Bacli des Mittolgebirges viel
constanter als bci dem des Hocligebirges. Die Qiiellen lieforn
jaliraus, jaliroin eine fasL gleiche Wassermonge. Plotzliclie,
starke Regengiisse kommon infolge des kleinen Niederschlags-
gebietes lange nicht in dem Maas zur Geltung wie beim Hocb-
gebirgsbach. Ein Einfrieren im Winter ist ausgesclilossen, da
das dei- Erde entstrômende Quellwasser eine betrachtliclie
Wiu'me besitzt- und bei der raschén Rewegung und fortwidiren-
den Erneuerung niclit sclmell genug abgekiihlt wird.
BeispieJ. I>ac]i bei Fliihen (Basler Jura).
Niederscldagsgebiet ca 4 km 2. Meln'ere starko Quelbm.
Nach der Vereinigung der Haupbiuellen un(erbalb Hofstiit-
len ist dei' IJaeh ziemli(di wasseri-eieh an dieser Stelle wurden
l'olgende Temperaturen gemessen.
10 Mai 1005 0.5"
M Juni 1905 <S.5"
5 Juli 1905 10 5'^
29 Nov. 1905 9"
17 Jan. 1905 8.5"
(3 Aug. 190() 9"
1906 9.5°
Weit grôssere Tempei-atui-schwankungen macbt der Heidcn-
wubr bei Silckingen wahrend des Jaln-es (kircb. Die oberslcn
Quellen sind zwar ebenfalls durch grosse Constanz der Tempe-
raiur ausgezeichnet. Fiir die QueUe bei Hiïtlen ^("rzeiebnet("
icli folgendi; Temperaturen :
27 Mai 6.5".
10 Juli 7".
1 Nov 5.5".
21 April G".
Die Quellen sammeln sicli und werdim durch einen kiinslli-
clien Grab(m dem Berg entlang in ein anderes Baelisvstcm
geleitet. Dei- kunstlicho Mittellaul' soll aus der Rômcrzeit
stammen und fiilirt zum grossen Teil durch Moorgebiet. DorI
g(!winnt die Lufttempei'atur einen grosstMi Einfluss, aul" das
Wasser,so dass der Unterlauf zu verschiedenen Jahreszeiten sehr
— 37 —
verschiedene Temperaturcn aufwoist. Hioriiber folgonde Anga-
ben :
25 AprillV)05
27 Mai 1905
29 Mai 1905
21 Jimi 1905
1 Nov. 1905
21 Aprill906
5°C.10" C.
14'- C.
16° C.
G"C.9° r.
Es bliebe mil" niin noch iibrig, die Bâche naeh derGesteinsart
ihres Untergrundes zu gliedern und auf die Unterscliiede auf-
merksam zu maclieii, die zwisclien Urgebirgsbacli iind Kalkge-
birgsbacli bestelien. Begreiflicherweise iibt der Kalkgehalt einen
bedeutenden Einfiuss auf Zusainmensetzung und Haufigkeit der
Flora und Fauna aus.
In sehr kalkreichen Bàclien komnit eine Moosvegetation
kaum auf ; dagegen sind solche Baehe algeni'eicher. Fin
I)etraclitlichei' Teil der Fauna muss miter solchen P>edingungen
zu Grunde gehen. Am l'eiclisten fand icli die Tierwclt im
Heidenwuhi', bei Sackingen, einem kalkannen, stai-ken,
l'eicldich mit Moos bewachsenen Schwarz\valdl)aeh, iiber <lessen
Temperaturverliàltnisse ich oben berichtet liabe.
Icli komme demnach zum Schluss, dassReichtum an Moos und
niangelndei' Kalkgehalt im allgemeinf^n die Futwieklung der
Fauna begiinstigt ; wir werden jedocli Fonnen Ivennen lernen,
die den kalkhaltigen Bach bevorzugen, ja geradezu characteri-
sieren.
38
II
Spezielle Behandlung einzelner Tiergruppen.
1. TROTOZOEN.
Liste der sicher bestimmten Arten.
1. Ci/iihoderid (Diijuilhi Ehrenr.
Z. DifffiKi'Kipijriforinis Perty.
;î. NehcJd fitraça Pknard.
I. ('()/Jii(n//()/)sis /-f/f/a SciiK.
Die Rlii/opodon zeicliiien sicli, wie Zschokke in soincn « Hocli-
i^cbii'gssoen » hervorliobt, durcli Cosmopolitisnius ans ;si(>
kciinen keinu Grenzon dci' Holie und d<'i' Tiefe, siu iintorschcidcn
nitditzwisclicii liolicm Nordcn und tropiscliemSiïdon. Sodurftcn
wii- erwarteii, die Vorti'eter diescr iliissorsi ani)assungsf;iliigen
Grappe aucli im Bacli anznlreften. I)a icli jedocli nur bei ganz
wonio-en P);i(di('n niein Aiigcnmoi'k auf dicso kleinsten Ticrc
l'icbten konnte, bleib( mciiie Liste dei- IJacbi'liizopodeii eiiie sebf
bescln'Jinkie.
Ci/phodcriff anipuUa lebl. nacli Penard l'asl in alleii iinsern
Seen und zwar iibei-all in (bu- Ticb». bdi fand das Tier ziendicb
liiiniïg in einer kalten Quelle des Heiden wubrgebietes. Es
bielt sicb in den Fonfinalis rasen auf.
DifffiKjia j)i/rifor"mis ist ein Aveitverbreitetor Cosmopolil,
d(,'i' verscbiedene, zu profunder Lebensweise neigende Varietiiten
ausbildet. Idi fand ibn an der gleiclien Stelle wie ( [i/plioilrr/f/
und ausserdem im Bach von Barscliwyl (Jura).
Nehcla vitraea bewohnt ebenfalls die Tiefe der Seen. Pexard
gibt als Fnndorte an : Lac Ness (Ecosse) und Lac Lenian
(100 _ i;}() m. Tiefe). Zschokke kennt die Art ans dem
Viei'waldsliii tersee, \\o er sic, L50 m iief, aiitiand.
In den Rbiiiikonbaclien traf Zschokke regehii;issigrt'y//ro-
jji/.jcis aciileal(t Ehr an; er deiitet die eigenh'nnliidien Slaclieln,
die das Gebiiusc; dieser Rliizopoden auszeicbnen, als Reien-
tionseiiu'icbdniiivn Ix'i slarker Stronmng iiiid xci'niiUet, dass die
— 39 —
Form in ruliig'em Wasser in die nnbostaclielte Centropi/xis
ecornis iil)ergelio.
Bas Voi'komnien von tvpischen Tiefontieren im Bach, das uns
aucli l)ei andcrn Gruppcn wioder begegncn wird, deutet wold
auf gvmeinsamen Ursprung und glaciale Abslammiing liin,
wie in einrni spatern Kapitel niihei' ausgefiihrt werden soll.
Bie feuchten Moospolster des Wasserrandes belierbergen
neben Rotatorien, Neniaioden, Ôligocliaeten, Tardi-
gi'aden aucli eine Anzald Ciliaten und Flagellaten, die
icli wegen \\nvv Seltenlieit niclit bostinimen konnle. Es liandelt
sieli zweifellos um Angelidrige der cosmopolitisclien lîewohnei'-
scliaft des feuchten Mooses, die ITu' die lîachfauna ni(di( weiler
in Betracht kommen.
In Biii'sclnvvl fieng ich in ein(>in stark iiberHuIclen Moos-
biischel zwei von Co/Iinri/iopsis raga SciiR. bcfallcin'
C}'cloi)ideii .
2. ROTATORIA.
Im idjerflub'lcn Moos sind Pvaderlicre keine Seltenlieit.
Ilauptsiichlich ti'elen uns die characteristischen, an gewisse
Moosarlen fast symbiotisch angepassten Cosmopoliten entgegen.
Siclicr bcslininicn liessen sicli :
1. h'oi/fer ni/garis ScuRK. u. Eiirrg.
2. Pli'dodiiia l'oscolri Ehrbg.
o. Mctopidhi (iciihiiiKita Eiirho.
4. CaUidina bidens Gosse.
5. •' parnsitica Cigl.
1-4. sind im Baehmoos hiinfige Erscheinungen.
5. fand ich ziemlich îiJiufig parasitisch an Gammnrufi jndex.
Ausser diescu mrhr oder weniger i-egelmiissig aul'tretenden
Tiei'en kamen mir auch vcrcinzelte andere zu Gesicht, deren
genaue Beslimmung mir nicht môglich war. Besonders
merk\\iir(lig \var eine kleine Pro«/e.s:-ahnliehe Form, die amVorderende ein aufFallend reduziertes Rjiderorgan, dafiir aber
zwei kraftige Haken besass. Leider mislang di(^ Pi'aparation
der zwei Exemplai'e, die ans dem Moos eines ^^^aldbaches bei
Bottmingen slammten. Ich hofte jedoch, dièse merkwiirdige
Art, die voi'ziiglich an kh'itcrnde Lebensweise angepasst zu
— 40 —
sein sc'lieint, spiiter wieder auffinden und beschreiben zu
kônnen.
3. TURBELLARIA.
Rhabdoeoela.
Im Moos der f)ergbache von Fliilien, Sackingen und
Biirscliwvl konnte icli zu verscliicdenen Malen rhabdocoelc
Strudehvi'irmer auiiindun, furner stammt eine Anzalil solclier
Wûrmer aus Bergbàclien des Hasliberges (Berneroberland).
Leider konnten die kleinen Tiere niclit in lebendem Zustand
untei'suclit worden und dalier w-àr mil- eine genaue Bestimmungniclit môglicli.
Herr Prof. D"" Fuhrmann liatte die grosse Freundliclikeit,
die fraglichen Exemplare naclizubestimmen. Es ergab sicli :
1. Barsclnvyl : Gyrator her)uaphroditus Ehrbg.
2. Bottmingen : SteiiostoiHd hmcojjs 0. Sch.
3. > Vorfed' spec. {armiger-Tx\m?,).
4. FI il 11 on : Sfeitostotna leucops 0. Schm.
5. Hasiiberg :
Stenoatoiita leucops und Voi'ex besitzen am Hinterende
eine Art » Klebzeilen )>,die ilinen im rasclifliessenden Bacli wolil
gute Dienste leisten, Sie liefern ein Secret, das die M^irmer
befàliigt, sicli im Wasser aufrecht zu stellen und nur mil demKôrperende an der Unterlage liaften zu bleiben.
FuHRMANN fand im Baclie des Augustinerliolzes, der
jedocli niclit zu den Bergbachen gezàhlt ^^•er(len darf, da er zu
langsain fliesst, im Sommer zu ^^arm wird und viel ^'ermoderlRle
PHanzenteile entliiUt, folgende Rhabdocoele :
1. Microsto7nalineare Oe.
2. " caniini¥\]'SKMAim.
3. Macrostoma viride Ed. v. Ben.
4. Slenostotna Jeucopjs (). Sch.
5. Proi-hijHchus siagnalis M. Scii.
Neben diesen Rliabdocoelen kam — das sclieinl mir von
grosser Bedeutung zu sein — aucli das Cliaractertier klarer,
fliessenderTiewiisser, die' deiidrocoele Plancwia yonocepluila
DuGÈs vor.
— 41 —
Intoressant ist Prorhyiichus, der in einom einzigen Exemplar
im Winter erboutet wurde.
Eine andere Art derselben Gattimg-, Prorhynchus foutiiialis
Vujd, îst ein stenotlieniK^s Kaltwassertier, das wold liaiiptsiicli-
licli subterran verbreitet ist. Trotz eil'rigem Suclic konntc icli
das Tior, das Lauterborn ans dem kalten Pfcrdsbrun-
nerbacli bei Johanniskiviiiz nieldct, nirgends nachwcisen.
Die Rliabdocoelen sind in ilirer Mclirzalil Cosmoiioliten und
als solchu wenig wiihleriseli beini Aufsucben eines Auf-
cntlialtsoi'tes.
Im allgemeinen sind die Angehoi'igen der Baselcr Faiina nach
FuHRMANN Sommertiere, deren Hauptentwicklnng auf Sp;U-
friihjabr und Sommer lallt und die den Winter nur in ver-
einzelten Exemplaren i'iberdauern. Z^^•ei Ausnahmen, unsere
Bekannten vom Baeli : Gijrdtor hcriiutphi'oditus Eiirbg und
SteMostoma îeitcops 0. Sch., sind Sommer und Winter in
gleiclier Anzahl vorlianden. Selbsl unter dem Eise bemerkt man
niclits von einer Abnahme an Individuen. Zu diesen zwei
Wintertieren, von denen Gyrator hermaj)hro(Ji(u.s sogar auf
ZsciioKKKS Liste der unter dem Eis der Hocligebirgsseen
erbeuteten Lebewesen flguriert, gesellt sieb der einzige Pi'O-
rhyiichus staynalis, der ebenfalls im Winter gefunden wurde.
Lebenslaliigkeit im Wintei' und TendtMiz zu torrentieoler
Lebensweise sind sehi' oft Merkmale ein uud desselben Tieres
und sind, besonders, wenn sie nocb mit geograpbischen und
biologischen Eigenlïunlichkeiten gepaart auftreten, Kennzeiclien
glacialen Relictentums. leb kann mir ganz gut denken, dass
auch unter unsern heutigtMi (-osmopoliten glaciale Elemente sicli
fînden, die von anpassungsfiihigen Eiszeittieren abstammen und
sicli daller auch an wiu-meresKlimaundneue Lebensbedingungen
gewôlmen konnten. Allein sie untersclieiden sicli lieute nocb
von dér grossen Masse der postglacialen Einwanderer durcb
glaciale Cliaracterzûge, durcb \"orliebe fiir tiefe Temperaturen,
lange Embryonalentwicklung u. s. w.
Tricladea.
Die Bacbtricladen sind in der letzten Zeit ein iiberaus beliebtes
Objekt biologiscber und tiergeograpiscber Studien ge^^orden.
Vor allen gebûbrt Voigt das Verdienst, durcb sorgfaltige
3
— 42 —
Beohaclitungen die eigentiimliclie Verbreitung der einzelnon
Arten imd deren Grund aufgedeckt zu haben. Icli liabe bei
meinen Bachuntersuehungen die von Voigt angeregten Fragen
iiberall im Auge gelial)t iind Iiabe meine Bofuiido in der Arbcii :
• Biologisclies und Geographisclies von Gebirgsbacliplanai'ien ••
Arcli. Hvdrobiol. II, inbopag. 180 ff. niedergelegt. An dieser
Stelle will ieli mich mit einer kui'zen Zusaminenl'assung be-
oniio-en und verweise i'iir Einzelbeiten auf meine austïdn-liclie
Arbeit.
Icli schicke eine Liste der gefundenen Arten voraus :
1. Ph/naria alpina (Dana).
2. Phinaria gouocephala Dugks.
3. PI(iii(ir}(((DcH(lroc()eîum)h(cte(i^V\\\A.VÀi.
4. Poli/celis coniufa Johnson.
5. Po/ijcel/s nigra Ehrb.
G. Planaria torcn M. Shulzkï'
7. PlioKiv'tn caraticd Friks?
Planaria alpuia, PoJijceris cornata und Planaria gono-
ccpha.la sind die typiscben Bac]ii)lanai'ien; Polijcclis nigr((\m(\
Planaria lactea wandcrn da und dort ans stehendem odei-
langsam fliessenden Wasser in den Unterlauf der Bâche.
Planaria torva fand icli nur an einer einzigen Stelle im
fliessenden AVasser, sonst ist sie ini stelienden Ti'impel und See
zu Hause.
Am meisten interessieren uns selbstversUindlicli die drci
Bachformen, von denen zwei, Polycelis cornufa und vor allem
Planaria alpina fast aile Bedingungen orfiillen, die Zschokke
in seinen " Hocligebirgsseen •• von Glacialrelikten verlangt.
Si(^ sind stenotherme Kaltwasserbewohnei-, i)flanzen sicli nur bei
tiefen Temperaturen gescldechtlich fort und kommen alpin und
montan, Planaria alpina nacli den neuesten Untersuclumgen
Thienemanns (113) audi nordisch vor (Rùgen).
VoiGT fand, dass in jedem typiscben Bach aile divi Tricladcn
vorkommen; jede bewohnt jedoeh nur ein bestimmtes Gebiet
und fehlt im iibrigen Bach. Im Quellgebiet und im Oberlauf
lebt P'ianaria alpina (Dana), den mittleren Teil nimint
Polycelis cor-nula .Johnson ein, wàhrend von untenher ans
don Fliissen^/-*/rt??«ria gonoce})hala Dugès narhdrjingt.
Vdigt glaubt, dass die Tiere einander aushungern und dass
jcdc Art sich so wcil vcrbreitc, als ilir die Wassertempi-ratur
— 43 —
gestatte. PJanaria alphia sei an das kalteste Wasser an-
gepasst und konne sicli daliei* in der Quellregion gcgen die Kon-
kurrcnz der andern wiirmebedûrftigeren xVrten orfolgœicli
Ix'liaiiptcn, widirend sic im untorn Toil des Bâches ansgeliungei't
woi'den sei. PJanaria (joiioccphala konne im obern Teil
nîclit existiei'en; da iln- das Wasser zu kalt sei, musse sie den
kiiltebediii'ftigeren Arten nnterliegen. Pohjcclis cornuta
endlich ninnnl infolge ihres zwisclien (k^i beiden in der Mitte
stebenden Wiirmebedùi'fnisses ancb im Bach den Mittellauf ein,
Geographisches. — Icb fand die Vei'breitung iiberall in der
von VoiGT angegebenen Weise. Entspreebend den verscliiedenen
klimatisclien Verhaltnissen war der Verdrangungsprocess in
d(^n einzelnen Gebii'gsgrupi)en verschieden weit vorgeschritten.
In den A Ii)en ist Planar'ia alpina alleinlieiTscbend. Polj/-
ceJis cornuta beginnt eben erst einzudiingen. Im .Tni'a ist
dieser Prozoss schon weiter gedieben und im Scbwa rzwald ist
Planariaa/j)rna bereits in die olH'rstcnQuellenzuriickgedriuigt
oder sclion ganz verschwnnden.
Icb babe in meiner ansfiibrliclien Ai'beit einzelne Biespiele
publiziert und (kiselbst aucb ansgefidn-i, dass und wai'um icb
die Ausbungci'ung im Sinne Voigts nicbt allein iïir massgebend
halte.
Es fiel mil" nàmlich auf, dass Planarienzabl und Nabrungs-
menge in gar keinem Verhaltnis zu einander steben, dass man
oft Biicbe anti'iti't, in denen mindestens fur dopi)elt so viel
Planarien Nabrung vorhanden wàre, als wirklicb den Bach
be^^•olmen. Icb kam daber auf die Idée, dass die directe
Einwirkung der nngiinstigen TemperaturverhaUnissc auf die
Foi't})flanzung der Strudelwiirmer dei' Hauptgrund der Tren-
nung der Vei'breitungsgebiete sei.
Erst in zweiter Linie kommen Nabrungsverbaltnisse in
Betracht, und zwar iibt Qualitiit und Quantitat der BiHite einen
Einfluss auf die Verbi-eitung ans, indem die qualitativen
Nabrungsbediirfnisse bel den einzelnen Arten verschieden sind.
Immer wabrscbeinlicher wird aucb der anfangs bestrittene
Einfluss der geologiscben Beschafienbeit der Gebirge, denen die
Bacbsysteme angebôren. Lamfert (40. a.) macht auf den
grossen Unterschied in der Planarienbevolkerung desKalk- und
Urgebirges aufmerksam. Er fand, dass im Urgebirg derVerdran-
gungsprocess zu Ungunsten von Phinaria alpina viel weiter
— 44 —
gedielien ist, wiilirend Pobjcelis cqrrrufa nmgekchrt im Kalk-
gebirg viel scliwacher vertreten ist. Almliclie Kosultate lieier-
len aiicli meine Planarienuntersuclmngen (OU)- Kalkgclialt
des Wassers sclieint somit fur Planaria alp'uia weniger
schadlich zu sein als fiir Polycelis cormifa. Niilieres iiber
die Frage nacli der Wirkung des Kalkgelialtes findet sich in
meiner "pianai-ienarbeit, pag. 192. Ausserdem wiire nocli in
I5e(ra(-lit zu zielien die von Wilhelmi (159) aufgeworfene Frage
der I)ewaclisung der Baelie.
Aile dièse Momente wirken im ganzen Bachlauf gleiclnniissig
und tragen dalier allein nichts zur Frklarung der Verbreitungs-
eigentiimlichkeiten bei. Dagegen ist von erainenler Bedeulung
di(> Wassertemperatur. Aile andern Faktoren grcifen hôelisiens
modifizierend in den Prozess der Verdriingung ein.
An dieser Stella mag kurz der Versucli gemaclii werden, die
M'irkungder klimatisclien Anderungen auf die Verbreilung zu
cliaracterisieren.
Zur Erkiàrung der getrennten Verbreitungsbezirke.
Icli stelle mir vor, dass Planaria alp'nui sich urspriuigiieli
das ganze Jahr nur geschleclitlicli fortpflanzt. Dieser Zustand,
d(4^ lieute nocli in den Hoelialpen weiterdauert und aucli an
einzelnen Stellen des iMittelgebirges, wo starke Quellen mit
constanter Tempera! ur dem Boden entstroraen (Ikùspiel : F 1 ii h e
n
im ,lura, wo icli das ganze Jahr geschlechtlieh ditterenzierte
Planarien fand) noch in unserer Zeit anzutrctïen ist, war zur
Zeit der letzten grossen Vergletscherung der normale Zustand
auch im Tal. Damais besassen aile Biiche eine gieichmiissige,
liefe Temperatur. Wenn wir auch annehmen, dass zwischen
Eiszeitsommer und Eiszeitwinter bedeutende Unterschicde
wai-en, so glich doch das Sclnnelzwasser, das im Sommer rcich-
licher floss, die; Tempei-aturen in den Biichen aus.
Spater, Ijeim Zuruck^\eichen der (lletscher, erwiirmten sich
die Biiche im Sommer viel stiirker als im Winter. Daher
nnisste wahrend der warmen Jaln-eszeit die sexuelle Vermelirung
im Sommer wegfallen. Ungewohnte Temperaturverhaltnisse,
hcsonders i-nschcr AVechscl, fiihrten zur Selbstverstiimmclung
durcli Quertcilniig.
Je iiine-er nun die Sommer wurdcu, um so mehr musste die
— 45 —
sexuelle Foi'tpflaiizung weiclien imd mil ilii' die Ampliimixis, die
Individiialiiiitenmisehung, olme die sieh bald Degenei'alion
einstellen iimss, iind je wai'mci' sie wui'den, uni so mehr gowann
die « asexuelle Vermeliruiig », dic^ Selhstverstiimmelung, an
Ausdelinung, welclie ungolieiiei'e Anforderungen an das Rege-
nerationsvermôgen stellte und die Aiisbildung des Generations-
ap})arates, w'ie dies Stoppenbrink (101) im Einzelnen ausfiilirt,
verhindert. Durch wiederliolte Querteiliing selbst nocli rege-
nerierender Tiere wurde der Organismus sehliesslich so ge-
sclnviicht, dass die Aiisbildung der Gesclileclitsorgane den ganzen
Winter unterbleiben musste. Dies fiilirte im Tal zum Ausstei'ben
der alpinen Planarie. Nur in Baelien von tiefer, constanter
Temperatur konnte sie sicli noch balten, da sie dort noch die
urs})riingliclien Bedingungen vorfand.
Poh/ceUs cormita vermag sicli normal geschlechtlich und
ungeschleclitlicli zu verraehren ; docli muss aucli sie zwisclien
je z\vei Perioden asexueller Fortpflanzung zur « Auffrischung »
eine sexuelle einscliieben. Weil sie aber gegen Ungunst der
Temperatur nicht so empfindlieh ist wie ihre alpine Nebenbuh-
lerin, konnte sie sieh liinger ira Taie lialten. Scldiesslich be-
gann jedoeli die Warmezunahme die Sexualitat im Tal iiber-
ïiaupt auszuschaiten, und nun trat Polycelis den Riickzug in
den Bach an. Dort fand sie die ihr zusagenden Bedingungen
und verbreitete sieh so weit nach oben als es ihr die Temperatur-
verhaltnisse gestatteten. Da namlich ihr Optimum hôlier liegt
als das \on Phrnai'ia alp'nta, gebot sehliesslich der Aufwiirts-
wandernden das immer kalter \\-er(lende AA^asseï- Hait. Das
Fehlen von Polycelis cornuta in der Quelle erkliirt sieh also
ans zu tiefer Temperatur, die ebenso wie zu liolie die Sexualilàt
herabsetzt.
Von den Stromen lier dringt nun in die warmsten Absclmilte
der Bâche der postglaziale Einwanderer, der warmebediirf-
tigste der drei Strudehviirmer, Planario gonocephala ein.
Ihre obère Verbreitungsgrenze wird durch ihr holies Tempera-
turoptimum gezogen, das etwa bei 14-1(5'^ C. liegen mag, im
typischen Bergbacli also kaum erreicht wird.
Die Grosse des Mischgebietes zweier Arten, z. W. die Liinge
des Bachlaufes, in welchem zwei Arten giinstige Bedingungen
flnden, ist in planarienreichen, also nahrungsarmen r');u'hen
weniger betriichtlich als in nahrungsreichen. In solclien Ge-
wàssern kommt also der Aushungerung im Sinne Voigt.s
— 46 —
etwelclie BcdcuUing zu : sie sclùiri'l die von den T(>mi)ei'atur-
vcrlialtnisscn gegebonen Gronzen, olinc jodocli die Gronzen
solbst verscliieben zu kônnen.
Anpassungen. — Die Planari(Mi, dci-cn Vci'brcitungseigen-
tiinilicbkcitcn hier besproclien wurdeii, sind rein toi'renticol;
sie i'elilen dem sLelienden Wasser mit Ausnalime dor Planaria
(6/yy/Mr^dieoiiindiekaUenHocllgebil•gsseenundGletsc]lertumpel
liinaut'wandert Ihre Lebensweise gibt sicli in einer Anzahl
Baclianpassungen za erkennen, die kurz an dieser Slelle
beliandelt werden sollen.
Wie bei allen echten Bachtieren ist das auiïalligste Merkmal
starke dorsoventrale Abflacliung und Liclitsclieu. Im
erwaclisenen Zustand leben die Planarien meist imter Steinen,
an di'nen sie sicli mittelst Scldeim festlieften. Ihre Rewegungs-
weise isl siets eine kriecliende. Schwimmbewegungen, wie
sie bei Hirudineen oft vorkommen, sind zwar mehrfach
beschrieben worden (Hkrtwig : « Lehi'bucli der Zoologie»:
«... oder sie tummehi sich freischwimniend im Wasser Iierum.
In letzterem Fall maclien die grôsseren Formen undulierende Be-
wegungen des Kôrpers ») berulien jedoch sicher auf Irrtum, wie
auch WiLHELMi (159) nachweist. Aile drei Arten sind dnrch
grosse Emi)findlichkeit gegen Verimreinigung ausgezeiclmet
und bewohnen nur klarc, fliessende Gewâsser, Phmaria gono-
cephala ist naeli Lauterborn im Rhein geradezu das Leittier
fiir Verunreinigungen, indem es ûberall da fehlt, wo der Fluss
durcli Abwasser verschmutzt wird. Den Coccons entschliipfen
meist wenige, in der Entwicklung fortgeschritlene, den Alten
iihnliclie .Tunge. Die Coccons kônnen frei sein und verscliliefen
sich dann infolge ihrer Schwere zwischen und unter die Steine
des Untergrundes Phinaria alpina und Polijcelis cornuta)
oder sie werden mit einem Stiel an die Steine angeheftet. Aile
.Bachplanari(m sind durcli ausserordentlich grosses Hungerver-
môgencharakterisiert. Neben der geschlechtlichen Vermehrung
besitzen unsere Strudelwiirmer auch die Fàhigkeit asexueller
Fortpfllanzung durch Quei'teilung. Sie liât jedoch bei den ein-
zelnen Forni(>n eine selir verschiedene Bedeutnng. Wiilii'end
i'iir PJdiKirid (/onoci'ji/nt/// die Teilung eine iioi'niale Fort-
ptianzungsi'orm ist, bei der sich vor der Loslôsung die ^erloren
gehenden Telle zu regenerieren anfangen, teilt sich Poh/celis
olme vorangehende Régénération, jedoch oline pathologische
Anzeichen.
— 47 —
llvl ridiKirid (ilitiud slii'bUlas eiiie (Icr abgctrcuiilL'ii Sliickf
gewôlinlicli ah. Die Teihing liât also liici- den Cliaraktcr von
Solbstvorstiimmeluiig als Roaction aul" Unguiisl der Tcmpcrainr-
vorlialtnisse.
Die Verbi'citung- (1er anderen Trieladen war in meinem Unter-
sucliungsgebiet eine geringe.
- Flanarla cdcatlca Pries? selicint noch stenotliermei- zu sein
als Planaria alpina, ist jedoch deni Rachleben niclit so gui
ang('})asst. Sie stellt die Beziehungen zwisclien profundei' und
lorrenticoier Fauna lier, indem sie in der Tiefe der scliweize-
rischen Seen (iin Vierwaldstattersee bei 70—05 m) auftritt.
CtEYER fand sie oberirdiscli in verseliiedenen Quellen der
scliwabisclien Alb. Herr E. Graeter, der gegenwartig die
seliweizerischo Tlolilenfauna bearbeitet, braelite die Planarien
ans melireren subterranen Baclilàiifen mit.
Eine Verwandte der Plnnaria ynontenujrina Mrazek, eine
polypliarvngeale P/r/;?Y/r/c/ alpina fand icli in melireren Exem-
l)laren im Karst. Nalieres dariiber tîndet sich in meiner aus-
i'iilii'lichen Arbeil iib(>r Gebirgsbacliplanarien (UO).
Phniarla. [Dcadrocoehnn) hictea MCill. lievorzugt meist
langsam fliessende, elwas versclimutzte Gewasser, steigt aber da
und dort aueli in klare Biiche liinauf. Besonders im Birsigtal,
bei FI il 11, (;)berwvl und Bottmingen fand icli sie liie und da
nchen Pl(/iau'la (lOiiocejihaJa, docli blicb sic aucli hier iinmt'r
vereinzelt.
Planaria to)'va M, Schulze? (Bestimmung niclit ganz siclier)
leht im Karst gemeinsam mît Polycelis cornafa. Ich sammelte
melirere Exemplareim Timaro bei San Giovanni.
In kalten Baclien Bôhmens fand Vejdowsky mehrere Plana-
rien, die ich hier der Vollstandigkeit wegen erwahnen will,
trotzdem es mir niclit gelang, die Formen in uiiserm Gehiet
nachzuweisen.
1. Planaria Mrazeki Vejd. In Biichen, augenlos, wolil
mit Tendenz zu subterranem Leben.
2.P/«wrrri«y//«f«DuGÈsansFrankreich(DuGÈs),Boliinen,
(Ve.id.), Odenwald (Lauterborn) und Riigen (Thienemann)
bekannt, hewohnt ausschliesslicli sehr kalte Biiclie und wurde
ausser auf Riigen nur in vereinzelten Exemplaren angetrotîen.
;j. Phuan-ia alhissima Ve.td. leht in grossen Quellen
Bôhmens (selten).
— 48 —
Hirudinei.
Die Egel sind fiir das Lcben im Bach niclil geuigiiet. Mcino
Liste bleibt dalior wenig urafangreicli :
1. Nephelis octoculata Moq.-Tand.
2. ' atomarui Moq.-Tand.
3. Glossiphonia heterodita h.
4. " stagnalis L.
Diegenannten Arten geniessen weite Verbreitung in Siim])fen,
Graben imd AA^iesenbaclien Sie sind gegen tiefe Temperatur-en
selir empflndlicli, im Winter gelang es mir nie, einen Egel zu
erbeuten. Die Tiere sclieinen sicli in der kalten Jalireszeit im
Schlamm zu vofkriechon. Mit der Neigung zum Pai'asitismus
ist eine Vorliebe fin* verschmutztes, verwesende organisclie
Stofte entlialtendes Wasser verbimden.
Ûber dieNahrung von.Vp/9/?e/i.s lesen wir bei Moquin-Tandon
(55) : « Se nourrit de planaires, de mouches et d'animalcules
infusoires, dévore, d'après MIiller, des limnées et des planorbes.»
Die hier aufgefiïhrte Sj^'ischste muss im Bacli eine starke
Reduktion erfaliren ; die Schnecken sind daselbst elier selten;
von den Planarien kommt liôchstens Planaria lactea in Be-
ti'acht, die aber sell)st nur ausnahmsweise in stark be\v<'gten
I);ichen vorkommt. Die eigentliclien Bacdiplanarien mit ihrem
Bedi'irfnis nacli t'rischem Wasser und die Hirudineen, die vor-
zugsweise in vei'sclimutztcm leben, schliessen sicli gegenscitig
aus. Die Kntomostraken, die unter dcm Namen Monocles zu-
sammengefasst AN'erdcn, luid (he Infusorien sind im IJach so
selten, dass sie kaum als Nahrunçî'stiere in Frage kommenkonnen. So gestalten sich denn fiir die Hirudineen die Lcbcns-
bedingungcu im Bach Jiussci'st scliwiei'ig und dicsc Gruj)pe
bicibt nach Arten- und Individuenzald sehr schwach vertreten.
Heinrichs fand bei seinen Untersuchungen iiber die Hiru-
dineen der Umgebung von Bern 23, in den rascliesten Biiclieu,
im Gaebelbach und'im Siigebach bei Niederlindacli nie
Hirudinc.'en, in anderen waren sie nur vereinzelt anzutreiîen.
Kr schliesst d;u'aus, dass den Hirudineen fliessendes Wassei"s
keinegrmstii!enLebensbe(liiiL!'iint!'enl)i(îte rauch tiefe Temperalui'
l)ezeichnet emls ungi'uistig fiir das Gedeihen der Egel.
Die einzeluen Fimde versprengter torrenticoler Colonieen
— 49 —
lassen sich wolil alinlicli crklarcn ^\\^' das li()('liali)iii(' A'orkom-
mon von Hirudiiiecn : durch passi vcn Transport. Die Hini-
(lineen sind ausserst widerstandskriiftig- gegon Ausli'ocknon.
Selbst làngt>rer Aufenthalt in der Luft kann ilnion nacli
Moquin-Tandon niclit schaden.
Ich gebe folgende Notizen iiber meine Funde :
Nephells ocfoculatd Moq.-Tand. In einem stark ver-
sumpften Abflnss des Lac des Rousses in der Nalie von
Brassas, Jouxtai: Coccons und Tiere verschiedenen Alters
;
stark bevvaclisener Bach (Potamogetoii) bei Weil (Baden).
Nephelis atomaria Moq.-Tand. Zwei Exemplare im
Risanotal (Istrien). Das Tier ist von Hf^inrichs in ver-
schieden(>n Scln^'eizerseen gefunden \\orden. lin fliessenden
Wasser blieb es selten (Worblenbach, Lôtsclienbacli).
Glossiphoniff heterocUia L. Mehrero Exemplare aus einem
Wiesenbach l)ei P rat te In.
Glos.sijjhonia stru/nafis L. hiuifig in einem Baelie bei
Dolina im istrianisclien Karst.
5. CLADOCERA.
Im tvpisclien Bergbach ^\'urden nur gel'uudrn :
1. Ih/oci-yptus ncutifi'ons Sars.
2. (lu/ihu'ris Sj)hn(')'icus 0. F. j\I.
Die pelagisclien Cladoeerenkônnenausnalieliegenden ( Iriuiden
im schnellfliessenden Bach keine dauernde Heimat Hnden. Meist
sind sie aucli sehr zart gebaut und eignen sicli so wenig zum
Leben im vielbewegten, zerstiiubenden Bacli unserer Gebirge.
Fine Gattung aber, die zum Bodenleben iibergegangen ist, sonsi
vorzngsweise Tinn])el- und Seebewobu<'rin, vermag aucb in die
IJiiclie voi'zudringen.
Die Cla<locere Tljjoc)-i/j)tus ncutifroiis Sars enld<M'kle ich
in einem Waldbach des Birsigtales bei Bottmingen. Das
intéressante Tierchen ist fiir die Umgebung von Basel neu.
Es liât naeh Lilljeborg eine ansgesprochen nordische Wn*-
— 50 —
bi'oituiig uiid iicigL ZLiin Ticfeiilt'lK'ii. Es wiirdc gclundeii in
Schwedcn und Norwegon, în Finnland, im Ladogasee
il<.J8 m tief) (Nordquist) in Bôlimon (Ga ttersclilagen-
Teicli: Vavra). Im Léman {Monta hathycola Vernet
= Ilyocryptits acnUfroiiH Sars) ist es ein ausgesi)i'Ochenes
Tiefentiei'. Aucli in S cli weden steigt die Cladocere oft auf den
Grund tieforGewasser(5()—60 m. tief, Lill.teboro).
Lauterborn, der die Art ans dei' Rlieinebeno kennt,
betont, dasssie aucli milten im Winter anzutreften ist.
Ein Tier mit nordiseher Vei-breitnng, vorzugsweise profnnd
lebend, das im Tiimpel zur Winterfauna gehôrt, scheint mir im
Bacli kein Znfalisfnnd zn sein. Es handelt sich, wie ich glaube,
uni einen Emigranten, der in den seicliten, warmen Tiimpeln
niclit zu existioren vermag und deslialb das kalte Bachwasser
aufsucht. Hierbei erleichtert ihm seine FiUiigkeil, am Boden zu
leben, den Ul)ergangaus dem steliendenin dasfliessende Wasser.
IliJocri/pfiL^ acutifrons ist wie die Hjdrachnide Hygrobates
albiiiffs, wie einige Rliizopoden, Ostracoden undTurbel-
larien ein I>eweis der engen Beziehungen zwisclien Tiefen- und
Bodenfauna einerseits und Baclifauna andrerseits.
Die zweite Cladocere, die ich in denMoosrasen dei' Auswascli-
becken unter den Wassei'stiirzen des Sackinger Bergbaclies
fand, s])ielt imBacli eine ganz andere Rolle. Es ist der Cosmo-
polit Chy(Jo]-us sphaericiis O. F. M, die liaufigste aller Clado-
ceren im Norden wie im Siiden, vom Ufer der Seen bis in die
grôssten Tiefen vom Tal bis zur Sclineegrenze der Ali)en(]iôclister
Fundort nacli Zschokke 2610 m). Sic ist eine Bodenform,
kann aber aucli pelagiscli leben. Temperaturgrenzen kennt sic
kaum. Sie lebt in iiberhitzten Tiimpeln wie aucli unter der
starren p]isdecke des Hochgebirgsees.
Das Vorkommen dièses allgemein verbreiteten Tieres, das
^•orzugs^^^eise am Boden lebt, an ruliigen Stellen des Bâches,
scheint mir niclit bcsonders merkwiirdig zu sein ; es zeugt nur
von dergrossen Anpassungsfahigkeit dièses Cosmoi)oliten.
Zschokke fand im Mieschbrunnen , einer kalten, sehr
starken Quelle bei Partnun Chytioras spJufcricus 0. F. M.,
Alona rostrata Kocii und Acropeî'us /eiicoccpha/us Sars =neylectus Lilljeborg.. Leiztere Art ist eine typische Boden-
form mit nordlicher Verbreitung. (Schweden, Norwegen,
Nordsibirien, Finland, Kola, etc.).
51 —
(). COPEPODEN.
Nur zwei Ai'teii licsscn sicli mit Siclieiiioit l)es(,iinmon :
1. Cf/clojjs /u)f/)rif///fs Fisc'HKR;
2. Canthocamjtlns rluicticus Sciimkil.
Eiiizdiie Cvclopidon fand icli in dcu Moosrason (hn- Bei'gbiiclic
von S;i('kiiigon und Barschwvl, Fli'ilicn, ]^)ollolaj und
in dem Waldbach bei Bottmingon. îlei'r Di*. A. Graeter,
der die Freundlichkeit batte, die Bcstimmungvn zu id)ernebmen,
konntf^trotz der seblecbten Conservierung in einigen Exemplaren
(Ma \vi Cyclops fJmbrlatus Fischer mit Siebcrbeit erkcnnen.
Ancli die unbestimmbaren gehôren vermutlicb liiei'ber. Diesc
Form zeiclmet sicb durcb grosse WidersfandslVdiigkeit und
leicbtes Anpassungsvermogen ans. Sie bevorzugt iil)erall
fliessende Gewiisser, t'eldt aber auch dem stcbenden niclit.
GRAP:TER(21)nenntansder Umgebung von Basel meluvreM^'ilier
in denen der Krebs t'eldt, in dei'en Zu- odei- Ai)tliissen er jedoch
anzutrefi'en ist. Thiknemann kennt den Co[)epoden als Mitglied
der Bacld'auna Riigens (114). Vosseler und Zschokke fanden
ilm ebi-nfalls in tliessendem Wasser. Nielit sclten lebt er aueli in
den P)i'unnen der Al[)enweiden. leb konnte ibn in t'olgenden
Baelien mit Sicberlieit naebweisen :
1. Bacli bei Fliiben, Jura.
2. • •• Rbeinfelden .
;j. - - Bottmingen.
Ci/cJojts fimhriafits ist dureli kosmopolitisclie Verbrcitung
ausgezeiclniet wie uns die von Zschokke, «Tierwelt der Hocbge-
birgsseen» pag. 142 aufgeziddien Fundorte beweisen, Er steigt
in den Alpen bis zu 2()86 m(unterer See von Orny). Er ist aus
bocbnordiseben und tropisclien Geliieten l)ekannt und ist sogar
befidiigt, in eoneentriertem Mineralwasseï' zu leben (Richard).
Seine Vorliebe fiir das fliessende Wasser liangt wobl mit der
Fahigkeit zusammen, auf der Unterlagezu krieeben.
Im Biirselnvyl fand ieli Cyelopiden, die von Cofhur-
i/iopsis vaga Schr. befallen waren.
Haufîger als die Cyelopiden sicllten sieli Angeliôrige der
Harpaetieidengattung Cajithocamptus im Moos der Bâche
ein. Herr lY Graeter bestimmte sie als Canthocaniptus
fhiheficiis ScHMEiL. Dièse noi'discli-alpini' Kaltwasserl'oi'm isl
bis jetzt iiur ans den Seen und Baclien des Rliatilvon, \vo sie
\on ZsciiDKKE ziierst entdeckl wui'de, und aus Schottlandbekannt. Aucli hier ist es die tietV', constante Temperatur
unserer Gebirgsbache, die dieser stenothermen Art das unge-
wohnte Leben im sclinellfliessenden Bach ermogliclit. Der
Ûbergano- wird ihi' ei'leiclitert durch ilire Vorliebe fiir Moos,
in dem sie sich leicht vor dem Weggespiiltwerden schiitzen
kann.
7. OSTRACODEN.
Die Ostracoden eignen sicli, alinhcli wic die Cladoceren und
Copepoden, sofern sie Planktontiere sind, nicht ziim Bacldeben.
Eine Ausnahme maclien hier wie dort die des Schwimmens un-
kun(ho-en Bodentiere, die bei dieser Abteiluno- der Krebse aller-
dings stiii'kei' ^'el'treten sind als bei den Cladoceren und Cope-
poden. W^nn aiich die Ostracoden im Bach selten bleiben, so
dai'f raan hier docli von eic'entlichen Baehformen reden, von
Arten, die bis jetzt noch nie ira stehenden Wasser gefunden
wurden. Den beiden andern Entomostrakenabteihmgen fehlen
solche torrenticole Vertreter vôllig. Die von mir aufgefundenen
Arten bewohnten das ïiberflutett; Moos, in dem sie sich klet-
ternd fortbewegten.
Leider stand mir zu wenig Matci-ial zur Veriïigung, um di(>
Bestimmung, die sich bei dieser Gruppe als besondrrs schwierig
erweist, mit wïmschenswerter Sicherheit durchfidH'cn zu
konnen.
1. Prionocypris serrata Norman.
Hie und da im iiberiiuteten Moos des Sîickinger Berg-
baches.
Die Art o-oliort nach Kaufmann nicht zu den lijiufiaslen ; sic
bewohnt langsam flicssend(î B;i('h(> mit Ptlanzenv.'uchs und
scJicint das sd'licndc und licfc Wasser vollstiindig zu mcideii.
Die Ausbildung der zweiten Antenne, deren Schwinnnhaarc
^('rk^lmmert sind, verurteilt das Tier zu kletternder Lebens-
weise.
— Dà —
2. Candona spec.
Sackingen und Moos cinesBachus ani Ilasliborg (Berner-
oborland). Dio Gattiing ist dem Bodenloben vollkommen ange-
passt. Dio mcisten Arten bewolmcn dcn Selilamm des Ufors
von Seen mid Tiimpeln. Candona pnhesccns Saks wurdc
von Kaufmann nui- in einem Bàchlein der Umgcbung von
Lugano atifgefnndon. Dio hanfigste Art der Galtung, Can-
dona candida CF. M., golit nacli Zschokkk ancli in tli('ss(>ndos
Wassor ïibor; sie bogegnoto ihm meln-faoli in don Wasscradorn
am Plassoggenpass (Rliiitikon).
3. Herpetocypris spec. (.0
Reste einos Tieros, das wahusclioinlieli in ^Vu^'^^i' (latlnng
geliort, fand icli im Moos einos Baohos ini Kosonlauigobiot
(Bornoroboi'Land). Auoh dièses Ostracodongenus ist dos Scliwim-
mens niclit knndig.
ZscHOKKE konnt ans dem Rliiitikon oino Anzald Mnseliel-
ki'obso, dio sieli in fliessendes \\'asser wagen. Si<' sollon im
folgonden nocli kurz besproclien werden :
1. Paracypridopsis Zschokkei Kauimaxn.
In (k'n P);iclion bei Partnnn, Snlzflnli nnd Plasseggon
\()n KaufiMANN in mehroren Gogonden doi' ScliW(iiz gofunden.
Dio An bositzt vorkiimmoi-to Schwimmborsten an der zweiton
Antenne und ist eine ansgesproehen torrenticole Klctterform.
t. Candona candida 0. F. M.
Kin sclir vcrbreitoiei' Cosmopolit, (U'i- schr lioi'li in die Aljjon
stei^t und aueli der Tid'e nnserer Seen nielit feldt. Zschokkp:
fand das Tier melirfaeli im A'irrwaldsta 1 1 ersec bri Tiefon
von 20-75 m.
3. Cyclocypris laevis 0. F. M.
Ahnlich der vorigon eine soin- widerstandslaliige Art. Sehr
verbreitot, klein von Gostalt, steigt in die Tiefe d(M' Seen.
ZsCHOKKE : ^'ier^valdst;ittersoe, ',VMS:> m Tiefe; idjer-
wintei't; geliort jedoc-li zu den seliwimiiK'uden Formeii.
54
4. Cypris ophthalmica J urine.
Eine selir verbreitete, liocli in die Alpen steigonde Spezies;
aiicli subteiran, Icbt in der Tiefe des Vicrwaldstiit tersees
bis ZLi 214 m, iiberwintert unter dem Eise.
5. Cypris fuscata Jurine.
Cosmopoli t : Europa, Norda iiwrika, Mexico.
6. Cypridopsis vidua 0. F. M.
Resistente Form, weit vei-ljreitet, neigt zum Leben in der
Tiefe. Zii allen Jalu^eszeiten zii finden.
So setzt sicli also die Ùsiracodenfauna der Biiclie ans zwei
Elementen zusammen, ans ecbten Bacbtieren (Priunocyprh
serratd, P<iracypridopsis Zschokkei und ^ ielleicbt Candoua
jjubesceiis) nnd ans ani)assnngslaliig('n weitverbreiteten Cos-
mopoliif'ii, die meistaucli profund voi'kommen.
8. AMPIIIPODEN.
Die Flohki'ebse ti-eten im Bacli in geringer Artenzabl auf,
si)ie]en aber inlblge ilu'cr gi'ossen Iiidivi(bienzabl Irotzdeni eine
bedeutende KoUe.
GammavHS jiuîexV'hi in den Moosi-asen der IJiiclie oft in
fabelhafter Alenge. Aucb Niph(//-(/tis jiuteanus fand icli in
der Aeusequelle in selirgrosser Zabi.
Die wenigen Arten mugen bier zusammengestellt werden :
1. (r(f//i})i//ru.s jjuleiC DE Gekr.
2. " jfy^^//r/^'//.ç (Ray 1710) Edwards 18 10.
3. NijiJuirgiis j)}ite(ii(us de la Valette.
Gammarus pulex de (Ieer.
Fundort : Fast in allen Biieben der MiUelgelùi'ge. Im
Hocbgebirg^ nielir vereinzelt, in Zei'iiiall z. B. vollstandig
feblend.
— 55 —
Die gemeinsto Art; lebt im fliessenden und stelionden Wasser
in grosser Menge. Im Bach bleibt das aiipassungslaliig» Tier
im allgemeinen klein. Es scheint Icalkiges Wassci- zu bevor-
ZLigen. Im Urgobirg konnle ich iiKÙst nur oinzelnc Excmplarc
sammcln, wiihi'ond dci- kalkreicho Bach otl imgelieuere Mengen
dièses Krebses enthielt.
Gammarus pungens (Kay 1710) Edwards 1840.
Ich kenne dièse Form ans einem Bachlein nahe boim
L u g a n e l' s e e
.
Eine ihr am nàchsten stehende lebt im Timavo bei San Gio-
vanni (Bucht von Triestl nnd kommt dort znsammen mit
ihnnindrus pide,t und Niphargus (puteanKs) hili-eiisis
vor.
Herr K. Schaferna, Assistent am zoologischen Institut der
Universitàt Prag, der meine Ampliipoden bearbeitete, glaubt,
dass er eine almliclie Form in montenogrinisehem Material
gefunden liabe. Er hofft, in kurzer Zcit iil)er dièse und audere
sclnveizerische Amphipoden ausfiihrliclien lîerieht abicgcn zu
kônnen.
Niphargus puteanus de la Valette.
Fundorte : Arense(|uclle bei Saint-Sulpice (massenliaft).
Kalte Quelle im Ileidenwuhi-gebiet (1 Exempt.).
Bâche bei Par pan (Graubiinden) (2 ExempL).
Quelle " •• " (1 ExempL).
Dieser Krebs le1)t sehr hauflg in HohlengeN\;issern und in
der Tiefe der Seen. Zschokke meldet ihn aus dem R h ii t i k o.n
und aus der Tiefe des Viei-waldstat tersees (43 Fundorte von
30-125 m). Lauterborn kennt ihn aus Quellen und ans Grund-
wasser in der NiUie des Rheines bei Lud wi gsha l'en .
Niphargus tatrensis Wrzésn.
Drei Exemplare ans dem Timavo l)ei San Giovanni. Die
Art wurde von \\'rzésni()Wski in einem Sc'li()pl'brunnen bei
Zakopana am Noi'dabhang der Tali-a cnldcekt; sic scheint
nach Zschokke alpin in Seen, Ijrunneu und liiiclien ziemlich
— 56 —
verbreitet zu sein. Er n(mnt niclit weiniger als 7 Fundorte
iiber 1700 in.
9. ISOPODEN.
Die Isopoden felilen nacli Zschokke den Hocliseen vollstiindiii'
(eine oinzigo Ansnalnno im Kaukasus). Sio sind aucdi vom
Leben ini lypischen Gebii'gsbach so gut wie ausgeschlossen.
I(di fand cinzig im Timavo, der vicl niebr Flusscbaracter zeigt
und in eincm Baclio boi Dolina (Karst) oinzebic Excniplarc von
AseNifS nq}((iHcus Autokum, die, wio mir Hcrr Schàferna
giitigsl niitleilt, genan mil dor allgcmein vcrbrcih'tcn ^^'ass('l-
ass(d iibci'cinslinimb'n.
10. TARDIGRADEN.
Der ;inss(3rsi anpassnngsfiUugo, cosmoi)olitiscbo (Mnzigo Was-
sfii'bewobnci' nnter den I5;u'ti('i-cb('n, der allgemein verbreitele,
in EisUimpeln und niiler dei- winterlicben Eisdeeke der
Hochalpenseen \vi<' in warmen Tiimpeln der Ebene existenz-
lïdiige : Mac/vb/o/tis iiiiicrniii/.f Du.r. fîndet sicb regelmiissig
im Moos ^Vn- Hei'gijiiclie von Fliilien und Siiekingen.
11. IlYDRACARINA.
Die Zabi dei' lorrenticolen Wassermilben ist eine sebr be-
triicbtliclie. Das Matei-ial sammelte icli gemeinsam mit Hen-n
Di' C. Waltkr, (1er gegenwartig mit der Bearbeitung der
scbweizerisclien Hvdi-aearineni'auna bescbiiftigi ist. Es wurden
48 Baclisysteme nacli Hy(h'a('liniden abgesncbt. Besonders i-eicb
waren die Gebirgsbacb<' nnt moosigem Untergrnnd. Im ganzen
wnrden 52 Arten erbeutet, die sicb auf 2 nene und 17 bekannle
Gattungen vei'tedlen. 14 Arten waren nen und 20 wurden zum
ersten Mal in der Sclnveiz naebgewiesen. Die Bescbreibungen
der neuen Gattungen und Arten sind \on G. Walter im «Zool.
Anzeiger» (155, 15()) ])ul)liziert worden; die 2 neuen Lehertid-
arten besclirieb Sig Thor ebendaselbst (125).
58
GRNUS SPEZIES AUTOR
Pi
5êBEMERKUNGEN
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Sperchoii glandulosus .
" (lenticulatus.
insignis .
» vaginosus
» plumifei*.
' luontanus
" koenikei .
" mutilus .
setiger . .
Pseiidospei'chon . veri'ucosus
Teutonia pi-imaria
Torrenticola . . . anoiuala
Psevidotorrenticola rhyncota
.
Feltria minuta.
armata.
bi'evipes
zschokkei
» scutifera.
rubra
M rouxi.
» jurassica.
composita
x\tiiriis scaber . .
" interniedius
Koen.
Koen.
Waltei'
Thor
Thor
Thor
Walter
Koen.
Thor
Protz
Koen.
Koch
Walter
Koen.
Koen.
Walter
Koen.
Fiers.
Fiers.
Walter
Walter
Thor
Kram.
Frotz
11
23
1
5
3
1
2
2
1
3
3
.lieu
Hochai pin.
Iloclialpin.
meu
neu
(neu)
(neu)
Nordisch-alpin.
— 59
GENUS SPEZIES
Pi
I5EMERKUNGEN
47
AS
40
50
Atunis ci'initus . . .
...... assei'culatus.
lijartdalia .... runcinata . .
Ljania bipapillata. .
Hydi'ovolzia . . . placopliora .
... cancellata .
Thor
— 60 —
sclilossen; sie mùssen sich auf das Mittelgobirge bescliranken.
Ist der Ubergang von Fliiss- zu Baelifauna dcHitlieli zu veiiblgen,
so sind zwiselien der Fauna des stehenden iind der des fliessenden
Wassers viel scliarfere Grenzen gezogen.
Von den 52 Arten des fliessenden Wassers bewoJnien nur vier
zu gleiclier Zeit das stehende: Teutoiita pi-unaria (von Thor)
in der Rlione, von uns nur im stehenden Wasser gefunden)
Atractides spinipes (nacli Piersig in steliendeni und fliessen-
dern Wasser, von uns nur in bewegtem Médium nacligewiesen)
Hygrabates reticulatus (in steliendem und langsamfliessen-
dem^A^'asser, meidet bei uns rasehe Biiclie vollstandig) und
Hi/fp'ohdtes albinifs, der bei uns in der Ti(>fe der Seen, in Nor-
wegen in Biielien lebt. Ausserdeni wurdc Lehcriia Waltereinmal in stehendem Wasser gefunden.
Ich will an dieser Stelle die Arten nach der Natur des be-
wolmten Médiums sondern.
I. — Wf/sse)'j)ri/be)i des sfelteiu/eH ]]7(sse7\s mit Teitdenz
:-hrn Ubo-gaug tu den Fluss.
*Teutonia primaria Koen., Cosmopolit.
II. — Wassermilben i)i Bach und Tiefsee.
Hjgrobales albinus Thor, torrenticol-prot'und.
III. — Wassermilben des stehenden u. langsam fllessemtenWassei-s.
*Hvgrobales relicuLatus Kram., Cosmopolit.
IV. — Wassermilben mit Vorliebe fin- das- ftiessende
Wasser.
*Alractides spinipes Kocli, Cosmopolit, aueh alpin.
V. — Wassermilben in grôsseren Flusse)i
und in Wasserlaufe^i des Hugellandes bis ca .~00 m.
1. Sperchon plumifer S. Thor.
2. " insignis Walter.
— (31 —
3. Sp(,'rchoii koi'iiikci Waltor.
4. PseiidotoiTeniicola anomala Wallci'.
5. Tlivopsis cancollata (Protz).
VI. — lu stark bonrc/fcfji Wasser {m'ii Ausnalimc von N'^ 1).
a) Nur im Mittelgehirgc.
1. Loberlia ^vaUe^i S. Tlior. .
2. " inaequalis Kocli. i
3. Pseudosperclion vermcosus (Protz). \ aucli in Fliïssen.
4. Atnrus crinitus T. Thor.
*5. Torrenticola anomala Kocli.
6. Thyastliori Walter.
7. Atractides octoporus Piors.
8. Lebertia lineata Tlior.
0. Sperclion montanus Tlioi'.
10. Felti'ia armata Koon.
11. •• brevipes Waltor.
12. " scutifera Piors.
13. '- rouxi Waltoi'.
14. •• jurassica Waltor.
15. Aturns asserculatus Walter.
b) Ivi MilteUjehircji:' und ini Nonlen.
1
.
Atractides nodipalpis Piers
*2. Aturns scaborKram., , . ,„
r. T • 1- -11 * n^iw^.. y auci m rliisson.3.- Ljania bipapiUata llior. ^
*4. Hygrobates calliger Piers.
5. Sporchon setiger Thor.
6. Aturns intormodius Protz.
7. Hjartdalia runcinata Thor.
c) I/n Millel- und HochfjcJiirçjc.
*1. Lebortia porosa ïlior. \
2. Lobortia sparsicapillata Thor. /i , .
\ ,. \ , j- \ <ia und dort in3. SptMvlion denticulatus Koen. (
piiisson*4. •• glandulosns Koon. |
5. ., vaginosus Thor.
6. Foltria zscliokkoi Koen.
7. • rubra Piors.
8. Sporadoporus invalvaris Protz
9. Panisus torrenticolus.
— 62 —
d) Miitelf/rhhrj, Iloclir/chirg laul Norden.
1. Hvgrobatos norvégiens (Tlior).
e) Hochgebirg nncl Norden.
1. Felti'ia composita Tlior.
f) Niir ini Hochgebirg.
1
.
Tlivas oblonga Koen.
2. » curvifrons Walter.
3. Lebertia maeulosa Koen.
4. Sperchon mutilus Koen.
5. Feltria minuta Koen.
(). Hydrovolzia plaeopliora (Monii).
7. » cancellata Walter.
8. Calonvx latus \¥alter.
9. Pai'tnunia oblonga Koen.
10. " steinmanni Walter.
An^n. : die mit * verselienen Ai'ten sind Cosmopoliten.
Unsere Hydracarinenfauna setzt sicli also zusammen ans:
I. Arten des Hoeligebirges (1), Arten des Mittelgebirges (15),
Arten des Mitlel-und Hoeligebirges (0).
Gebirgsformen, die im Norden fehlen. . . . 34 (* 2)
II. Arten der Gebirge, die im Norden vorkom-
men""
12 (* 4)
III. Arten der Fli'isse und der Hiigelgebiete. . 6 (* 2)
52 (* 8)
Aile 8 Cosmopoliten, von denen 2 {Teutonia primarid und
Hygrohates reticulatus) fur die eigentliclie Bachfauna in
.Wegfall kommen, zeicbnen sicli aus durch die Fiiliigkeit, zum
Flussleben iibergelien zu kônnen, 3 davon steigen zugleicli ins
Gebirge (Lebe7-'tiap07'Osa, Sperchon glandulosus, Atractides
spinipjes). Fine einzige Art erfiillt aile Bedingungen, die wir
von eigentlichen Ubiquisten erwarten. At)-actidcs spinipes
bewobnt stebendes, fliessendes und sclniellfliessendes Wasser,
steigt im Hocbgebirg bis zu 2000 m und feblt aucli dem Norden
niclit.
x\uffallend ist die geringe Zabi der Cosmopoliten unter den
— 63
(oiTcnticolcii IIv(lr;u'arinon. Walirciid im Ti'iniiK'l uiid Sec tlic
Weltbiirg'or die Haui)ti"olle spielen, widirend die Lokalformen
nacli At'ten- nnd Individuenzalil selir stai'k zuriicktret(>n,maclien
im Gegenteil unter don Bachmilben die Cosniopoliten nur etwa
12 % der Gesammtbevôlkerimg ans. Aile andern sind ent-
weder isolierte Lokalformen oder spoi-adiscli in k;dtem Wasser
auftretende Arten. Sic machen den Eindruck ^'on Fliiclitlingen.
Meist haben sie den Contact mit dem Tal schon vei'loren. Nur
wenige Arten unterhalten Beziehungen mit den Artgenossen
anderer Bachsysteme, indcm sie nocli in die Fliisse iil)erzugehen
im Stande sind, die iibrigen gehen an isolierten Stellen dem
Aussterbcn entgegen. Es sind wohl Mitglieder einer zur Zeit
der letzten grossen Vergletsclierung verbreiteten Fauna, die sich
beim Wàrmerwerden des Klimas im Tal niclit an die veràn-
derten Lebensbedingungen gewôlmen konnte und ausstarb, in
den kalten Gebirgsbachen aber eine ZuHucht fand. Als Krite-
rium fiir die Richtigkeit dieser Auftassimg gelten neben biolo-
gischen Eigentiimliehkeiien, die spàter besproclien werden
sollen, das gemeinsamc Vorkommen in den Gebirgen und im
Norden. ÎSaturgemass mussten die Relikte in der Postgiacial-
zeit den zuriickweichenden Gletscliern naeh beiden Riclitnngen
folgen, nacli Sûden gcgen die Alpen und nacli Norden gcgen die
scandinavischen Gebirge. Auch die deutsclien Mittelgebirge mit
ihrem raulien Klima bildeten Zuflu(*litsl)urgen fiir dièse kiiltebe-
diirftigen Tiere. Wiv sollten demnach ^'r^varten, im Norden,
in den Mittelgebirgen und in den Alpen auf dieselben Formen
zu stossen.
Wirklicli bestatigte sicli dièse Vermutimg fiir 12 Arten, die
teils in den Alpen, teils in den Vorgebirgen Icben, meist auch zu
gleicher Zeit die Mitt(dgebirgsbache bewolmen mid im holien
Norden wiederkehren. Fiir die grosse Zabi der torrenticolen
Milben sind dièse Beziehungen nocli niclit naciige\\icsen, doch
liofïe icli ziiversiclitlicli, dass eine genaue Durchforscliung der
Alpen wie auch der Gebirge Alitteldcuischlands und Skandi-
naviens neuc Parallclen aufdecken und das Bild der glacialcn
Reliktcnfauna vervoUstiindigen wird. Besonders die 10 hoch-
alpinen Formen, die unter 1000 m noch nicht nachgewiesen
sind, diirft(>n sich wohl im Moos der Gletscherbiiche des nôrdli-
chen Schwedcn und Norwegen wieder auffinden lassen.
Die Tiefe unserer Seenmit ihrer constanten. tiefen Temperatnr
erhielt ihre Bevôlkerung nacli Zsciîokke ebenfalls posiglacial.
— 64 —
Sienothermo Fluclitlin!^c,dcnen das Klima dos Ui'ers iiicliL melir
ZLisaû'U', wandcrten* aiif den Grund dor Seen liinunter. Iliro
nilchsten Verwandten lùittenwiralso in don Bàclien der Gobirgo
und des Nordens zu suclien. Nun gelang es uns wirklicli, im
Vierwaldstattersec eine Mille aufzufinden, die genau mit
Hygrohales albinu.s Tnoii ans norwegischen BorgbiicJien
identiscli ist. In der Tioi'c des genannton Sees ist Hygrobates
albinus die gemeinste Hydraclinide; sie wurde in vielen
Exomplaren an Fundorten in einer Tiefe 35—63 m gesam-
melt. Eine andere Form, Lehertia fmdnsignita (Lebert),
bishernur ans der Tiefe des G en fer- und Vierwaldstatter-
sees bekannt, goliôrt einer Gattung an, doron Verbreitung auf
nordiscbe Horkunft deutet.
Biologische und morphologische Eigentiimliehkeiten
der Bachhydracarinen.
a) Sch-wimmhaare.
Das aufïVdligste Merknial, das aile l)achl)o\voluionden ^^'asser-
milben auszeichnet, ist der Mangel an funklionioronden
Seliwimmhaaron.
Eine Ausnalinie maclit niorkwih'digvrwoise der Cosmopolit
Lebertia porosa S. Thor. Das Tior konnnt in der Regel nur
in stehendem und langsaintiiessendem "V^^asser ^or. In der
Schweiz ^^'urde es meisl in Flûssen und Dorfbachen gosammelt
(.Aubonne, Thor., Birs bei Basel, Birsig bei Basel, Dorf-
BACH bei Batterkindon (HôhlExNBACii von Hasel). Fin
einziges Exemplar stamnit ans einon Wildbacli Grau blindons:
Urden-Fvirkli, 2150 m iiber Meer.
In Norwegen ist die Form in Soe und Fluss sehr liàufîg.
Sie kommt aucli in Asien, Herzegowina, Fi-ankreieli
und Italien vor. Das Ticr ist siclier keino Bacldbrm. Wie
es in den stark bewegten Bach von Urden-Fiirkli gelangt,
ist mir ein lîJitsel. Icli kann mir dièse auftallen(k^ Tatsache
lioclistens (hn^-h passive Ibortragung <M-kl;u-en.
Die Arton der Untorgattung Ncolebn'lia S. Thor l)Ositzen
einzelne Schwimmliaare, die jedocli kaum mebr zum Sclnvinnnen
dienen kônnen. Die zwoi bieher geborondcn Arien />r^O'//r/
— 65 —
irt///('i'i S. 'ril()l{ uild L('hc)-/iff sjj(/j:sic((jn//(i/(/. S. Tlloli
gcliôren molu' xiir Flussfaiiiia.
Dio Untorgattung Pscwlolehertia S. Tiior liât gai- keine
Scliwimmliaare molir. Dio di'ci scliweizei'ischeii Arton Le-
hertia Zschokhei Koen., Lehertia niacnlosa Koen. und
Lebertia lineaia S. Tiior sind eclite Gebirgsbacliformon. Die
2 ersten steigeii in den Al])on iiboi' 2000 m ; die letzte ist bis
jetzt nur ans den Borgbaclien des Jnra bokannt.
Im Begrirt', die Schwimmbaare zn vei'lieren steben die Gênera
Hygrobntes und Afracfidcs. Beide zeigen nocli Bezieliungen
zum steiienden Wasser.
Im stebend(>n Wasseï' leben dagegen meist Hvdraearinen mit
Scliwimrabaaren. Eine Ausnalime macbt, abgeseben von der
Sclilammfoi'in Limnochares das Genns Thi/as, dessen Arten
sicli teils ans Bodenleben angepasst liabon, teils aber zui' eigent-
liclien Baclifauna geboren.
Im Ganzen sind also die Bacldivdi'aclinidcu nicbt mil
Scliwimmliaai'en ausgeriistet; don wonigen Ausnalnnen stobi
oin Gros von 15 Gênera mit 41 Spezies gegoniiboi', bei donen die
Scliwimudiaaro spni'los vorloron gogangen sind.
b) KôrpergTôsse.
Die Bacbbvdraearinen sind im allgomeinen kloin.
Die Gattungen Felti'ui, Ahinis, Hj(irt<hiJia nmscbliossen
dio kleinsten unserer Hvdracarinenai'ten. Die Miminalgi'ôsse
bositzt Fellria avDuda mit 0,305 mm. Die grossten unter
diesen kleinsten Arten sind Afur/ts scr/ber und Afurus cri-
n/tus (0,5 mm).
Dio Arten des Genus Sjjcrchot/ scbwanken zwisclien 0.57 und
1.5 mm. Die neue Art Sp. Insicpiis M^alter erreicbt eine
Grosse von 2 mm. Der einzige Fundort. oin kloinor Wass(M'Iaui'
dos Hiigellandes, ist von allen Fundorton der S/)C7'c//i)j/ arien
der am wonigsten bergbacbidmliclio.
Sobr auliallend ist, dass unter den H;/(//-<)bn/cs arten dio
typiscbste Baobform//. caJUger Pikks. nur otwa balb so gross
wird als ibre Ver\Mmdton dos stebenden Wassers.
H. caUiger Ç 0.8 mm lang.
H. albinus Ç 0.7 mm lang.
H. reticidatus Ç 1.2 — 2 mm lang.
H. loii(jij)(ilj)ls Ç 1.8 — 2.5 mm lang.
— 66 —
//. nigroinnculiil IIS Ç 2 — 2.5 mm lang'.
Zu don kloinstcn Formen licliorwi [wu-ly Ljmiid hijmjitlldtd
mit 0.65 mm imd Torrenticola anomala auf 0.75 mm.Die grosso Molirzalil dor iibrigon Arton ist ca. 1 mm gross.
Gi'ôssen von 2 mm wh' s'iahei Sporadopot^us iiii'olrdris und
l'diii.sifs fo)')'c/iik:oIu.s voi'kommon, sind sclion Ausnahmo-
IVdlo.
- Betracliton ^^il dom gegeniibor die Woihorformon, so bo-
gognon wir niclil solton Mill)on von 3, 4, 5, ja ausnalnnswoise
sogar 8 mm (Hijdrachiid geographica).
Niir àusserst selten wird die Grosse von 1 mm niclit crroicbt.
c) Dorsoventrale Abplattung:.
Mit znnolnnondor ^"orvollkommnung in dor Anpassung ans
Bacblobon nimmt aucli dor (Irad dor Abflacliung zu.
Die Formon, ^^'olcho nocli don Ubergang zam Woilior vor-
mittoln : Hi/gr-Dhates, Ati-actides, Lehertid sind moist kugo-
lig. Aneb Spin-chon gelioi-t zu den wonig abgotiaobion Gattun-
gen. Dio boclialpine Art Sj). //iidiln.s ist auf dor Ri'iokon- und
Raucbsoite flaob; fast aile anik^'n baben oino oifôrmigo (testait.
Thyas ist in doi' Jugend immor kugolig, boi ausgo\\'acbsenen
Tierenist jodocb oft oino Abliacbung dos Ritokons zu bt^obacliton.
Pdrtnunia und Caloni/,r sind selion mobr abgeliaclit. Eine
woitere Stufo stollen dio Gattungon Spoyadoporus, Panisus,
Tor-reiiticold , Psewlof()})'€iiticola FeJtrid , Hijdforoizia
und Ljdiiid (bar. Am flacliston scboinou die A/?^7^s•-;dl^di(']lon
Formen zu soin : Atiwus und Hjaiiddlia. Roi leiztoror bildol
sicb eine koilf()rmige Kôrpoi'gestalt aus, wie das boi Koenikp:
m) Tafel I b^g. 10, zu sobon ist.
d) Panzerung.
In dor Ausbil(bmg dor Ranzerung bogognon wir boi don
Raclunilbon \\'oitgobi'ndon Sob\\"ankungen. Solbst nabo vor-
wandto Gatlungen, ja sogar Arton dersolben Gallung wcicbon in
diosom Punktf^ oft stark \o\\ einandor ab.
^^ollst;ui(Hg ungopanzort sind :
Piniiiiniid , Cdloiii/.r, Sporadojxti'us, Hijgrohdlcs, Afriic-
lides, Lehoiid, Sjier'cl/on (z. T.).
— 67 —
Einen sclnvacli ciiiAvickeltcn Panzer wcisen auf :
Spo'cJiOJi (z. T.), Thi/as, Thi/Oj)s/s, Ptinisus, Fclh-'ui
.
Stark gepanzei't siiid da^ogcn :
Torreiiticold, Pseuilotcn'rotticold, Aturiis, U](i)'tihill(i
.
Ljctnia iind Hydrorolzin.
\^^enn sieh bei so grossen Scliwankungon in dci' Panzeraiis-
bildung niclit auf den Grad der Baclianpassung schliessen lasst,
so ist das noch weit mehr der Fall mit der Consistenz, Sprôdig-
keit und Structiir des Integumentes, das sicli bei den einzelnen
Formen selir verschieden verlialten kann nnd ot'l zur Unterscbei-
dung der Arten ein nnd derselbcn Gattnng dienl.
e) Lange und Stàrke der Beine.
Gnte Scbwimmer sind mit langen, scblanken P)einen ans-
geriistet. Bei einigen A /«./'arten werden die Beino doppclt
so lang als der Kôrper. Sein" lange Extremitaten besitzt anch
das Genns Hi/ih'odioi-etifes; ilnn schliessen sieli an Lhinicsia,
Hijfirnhatcs; und At)'(icfi(k's, wo die Beinlinigen meist die
Korperlinige i'iber t retïen
.
Aile niclit sclnvimmenden Formen liaben dagegen mehr odcr
weniger kurze, stiimmige Beine, so die v'^cldamraform L'nn-
iiochares und verscliiedene Thj/ds-AviQw. Das Genus Feltj'ia
zeichnet sich durch kurze, kraftige Beine aus; idjuliclies liisst
sich von den Gattungen Afurus, Hjnrtdarin , Tu)-renticola
und andern sagen. Auti'allend kurze Beine kommen bei
Sporadoporus, Thijopsis nm\ Huih'oroîzia vor. Bei Aturusist im miinnlichen Geschlindit das hinterste Beinpaar autiallend
verlilngert und verdickt; das vierte und t'iinfte Glied ninnnt eine
fast keidenformige Gcstalt an. Die D<'ulung diescr auii'allen-
den Abweichungdiirfte niclit leicht sein.
Es liesse sich daran deiikcn, dass die \^'i'dickung des Peines
eine Besclnverung hcdcuiet, so wic gewisse Trichoplcrcnlarven
ihre Gehiiuse mit grôsseren Steinen belasten, um niclit fort-
gescluvemmt zu werden. Merkwiirdig ist, dass nur das miinn-
liche Geschlccht in dicser Weise ausgezeichnet ist, wahrend das
Weibchen normale Beine etwa von den Dimensionen einer
Feltria aufweist. Ich halte es daher fiir walirsclieinlich, dass
— 68 —
(lie anormalo EnLwickluiig des I)(>iii('S irgvndwic mit dcm
Gcschleclilslcbeii zusamincnliangt.
NaclidenBftobachtungcn des Hvdraclinidenforscliers Sig. Tiior
diont das vierte Beinpaar ])oi HjartOalia runcinata Sig. Thor
walirsclieinlicli als Reizmitiel imd Samoniïbertnigor. Bei diesor
Gattung sind jedocli die Glieder des in Frage stelienden Bcines
niclit oder niir wenig verdickt.
f) Be-waffnung der Beine, Retentionseinrichtungen.
Hat uns sclion die kurze, gedrungene Gestalt der Beine die
Vermiitimg wacligerufen, dass die locomotorischc Funklion der
Exti-emitaten zu Gimsten der Retentionsfunklion zuriickgetreten
sei, so werden wir in dieser Meinung nocli bestarkt durcli die
Beobaclitung der Bewaffnung der Beine. Bei allen Bachhvdraca-
rinentreten kurze, steife Borstenauf, sogenannteDornborsten,
die aueli bei den Wassermilben des stelienden Wassers ver-
breitet sind, dort aber meist weniger steif sind und zu den
Haaren und SehwimmborsLen iiberfiihren. Fiir die torrenticolen
Arten besonders bei den Hjdrypbantiden ist die Anordnnng
der Dornborsten am distalen Ende jedes Beingliedes tvpisch.
Besonders schôn sind dièse Retentionsborstenkrànze bei den
Gênera Thi/as, Thijnpa'is:, Spoirtdoporus, Panisus und
Pc^r/;? '^;/ /V^ ausgepriigt. Aucii bei einigen FcUria- \\m\ Le-
hciiinwvWw Ijcmerkl man die T(^ndenz zu kranzloi'miger An-
ordnung der 1 îorslen
Fine zweite Art von Borsten sind die Siibel- oder Degen-
borsten, deren Spitze oft spatelfôrmig verbreitert ist. Sie
geniessen keine so siarkc Verbreitung wie die Dornboi-sten.
Manclie Borsl(>n sind aucli eini'achei' gebaut und bilden einen
IJbergangvon den Dornborsten zu den Haaren.
.Sie werden oft ebenfalls als Degenborsten bezeicbnet; besser
wJire wohl liier eine andere Benennung, vielleicbt "Doleh-
borsten-t aiu Platz.
Fini' andere Form, deren Funktion icli mir niclit zii d('uten
vermag sind die Fiederborsten. ]')esonders scliôn kommen
dièse Organe bei Sperchon pluniifcr S. TiioK, der ilmen
seinen Namen verdankt, zm- Ausbildiuig. Sie gleiclien in Bau
und Forni den Federn der Vôgel. Sciiaub versuebt, gesliitzt
auf di(; Taisaclie, dass ein Lumen uacliweisbai' ist, sie mit <len
— 60 -
Traelieenkiemen anderer ^vass('l'be^^•()llll('Il(lol• Ai-diropodcn y.n
vei'gieiclKm.
Dio End
k
l'a 11 on konneii bel dcii ciiizcliicii ( latLimiicn sclir
vorschiodcn entwickelt S(>in. Die Hvdracai'inm des sl("liend(!n
Wassoi's liaben meist schwaclio Krallen. Eino Ansualimcmaclion Wetthia und einige Pioninen. Sclir geiing sind sic
bel Linmesia und z T. bri ArrJienwms ausgebildot.
Boi den Bachmilbeii findm sicli dui'cliweg wohl entwickidic
Krallon. Manclimal, z. lî. bei Thi/as, Rj/dr-ovoh-if/ iiiid
Partiiuiii(( liositzcn sio oiiifaclie Hakeniorm. Niclii sclini
sind sie mit deni (Hicd bowcgiich dureh cinc Art Kiigcl-
gclenk vurbunden, ktnincn so nach Bodiirfnis gedrolil Nwi'dcn
inid bei beliebiger Stellung des Beines Hall tindcn. Manclie
^lattungen besitzen siclielfônnige Klaueii, A^vow M'ii-kiing oft
z. P). boi Pditisus und Lebo-tia uocli dui'ch hakenfoimige
Boi'sten verstarkt ^ve^den kann. Stai'ke ('onii)lication ei'lVdu't
die Krallenbewaffnung niaucher Wasserniilbeu durcli die Aus-
bildung von Nebenzinken.
Atnrus scaber zeiclinet sicli duivli eine dreizinkige I)o])pel-
kralleaus. Die Krallon von Sperchon i\in\ Pseudospei'chon
sind ans zwei Zinken zusammengesetzt; die manclier Feltria-
ai'ton bestelien aus einem grossen Hauplzalm und z\^'oi seliwii-
clieren Nebonzahnen.
Den kompliziertesten Bau weisen die Endklauen bei den Gat-
tungen Sporadoporus und Cdloiiyœ m\i. Jede setzt sieli aus
einoi- Anzalil kammartig neben einander gelagerter Zinken undZàlmen zusammen. A^on der Sporado}j07'us-Kvàl\Q gibt Piersig
in "Deutscldands Hvdraclniiden", pag, 41(3, eine ausfiilndiclio
Beschreibung. Die eigenti'unliclioFussbewaffnung von Cnlouyx,
die der Gattung den Namen eingetragen liât, wirtl M'alterdeinniichst scliildern
.
g) Grosse und Zahl der Eier.
ZscHOKKE liât in seiner "Tierwelt der Hoebgebirgsseen''
darauf bingowiesen,dass die torrenticolen AVassormilbon relativ
grosse Eier besitzen und schliesst daraus aul" lange Embryo-nalent wiek lung. Die Jungen sind dann ziu- Zeit <\qv Geburt
krilftig und wolil entwickelt und soniit iui Staudc, der Ungunst
der Lebensbedingungen zu trotzen.
— 71 —
Gebii'gsforin zii soin. Eino aueli nui' anniilierndc Grcisse dos
Eios kommt boi keinor andorn Hjdi'acarinon dos stoliondoii
Wassoi's voi'.
h) Periodicitàt im Auftreten und passive Uebertragung-.
Dio Hvdraoai'iiion dor El)ono, dos slolioiidon ^^^lSSOl'S und dos
Flussos mit lanijsamor Stromung iiberwintorn moist in W(>nii>-on
Exomplaron und orroiclion dio grossto Indiviihiouzalil zu bc-
stimniton Zoiton, moist im FriUiling und im Fi'iilisonnnor.
Ganz andors dio Baolnnilbon : W'io boi allon torrontioolon
Tiei'on konnon ancli bier die Jabi'oszoiton ibi'o \\'irknnu- niobt
e'oltond maobon. Auf oinor Anzabl Exkui'sionon wJdn'ond des
Wintoi's konnto icb feststoUon, dass allô oebton Bacbtioro
obenso baufig sind wie im Sommor.
Im Soo und Woibei' ist die Entwicklung viol i'ascboi\ dio
Fi'ucbtbai'koit viol grôsser. (Siobo obige Angabon iibcr dio
Eizabl.) Die Larvon und Puppon wordcn durcb Wassciiusckton,
an dio sio siob aniiiuigon, von A\''oibor zu W'oiboi' gotragcii. Zur
Bovolkorung woit abli(^gendei' Soondionon (lioNvmpboni)ui)pon,
dio sicli an Wassorpflanzon fixioron und oin limgoi'os Aus-
ti'ocknon loiobt ausbalten. Don Ti'ansport bosorgon in diosom
Fall bauptsiiolilicb Wassomogol.
AUo dioso Einricbtungon foblen don Jli/drac/o-inen dos
Baobos. Ubor dio Larvon der toiTonticolcn Wassormilbon woiss
man so viol wie nicbts. Icb vormuto, dass das Larvenloben
onts})i'ooliond d<'r langon Eiont\^'icklung stai'k abgokiirzt, viol-
leicbtganz untordi-iickt wird. Passive Cborlragung ist mangols
geeignoter Vobikol fast ganz ausgoscblossen. Die meiston
Insekten, dio otwa in Frago kommen konnton, Ejjheriieriden,
Per-Iidcu. und I)ij)fe)'eit, biiutonsiob vor dom wogfliogon. Die
K a l'or sind im Bacli nui' sobwaob voi'troton, moist nur zufallig
vorscbloppt odor ^•o^i^l•t und balton das Baoblobon ^\olll nicbt
lango ans. Vôgol suobon dio oft voi'steekton WildbJiobo kaum
auf. So bloibt nur oino Erklarung fiir dio Bosiodolung dor
Bàclie : aktives Wandern.Àbnlicb wïe Planarid alpina ans dom ïal bei dor Er\\'ar-
mung des Klimas langsam in die Baelio und von da in dio kalton
Oborliiufo imd Quellen auswanderto, abnli(di vcrbroitctcn sicb
die stonotbermon Milbon vom Tal bci' in (\\ii B;ie]io, in dor
Ebono starben sie ans und in don kiiblen Baeblaufen der Gebii'go
fanden sio nocli eine Zufluclit. Almlicli wie bei Planaria al-
^>/^zrt liess sicli aiicli boi den Milben eine starke Zunabme der
Individucn/abl in den Qiiollgebietfm maneher Bâche feststellen,
wiUn'end die bclreffendcMi Arten deni Unterlauf vollstilndig
feldten.
Somitglaubon wir allc^ (n-hUm Baclihydraccn-'uren, die dem
slelienden Wasser fehlen und voran die Bewohner der kalten
Quellen dei' Hocligebii'ge als Relikte der Eiszeit-Fauna autiassen
zii sollen. Fiir diesi' Aiuiahme si)i'<'(']ien die geogi'ai)liischen
IJeziehungen, das Vorkoumien der alpinen Formen im Miltel-
gebii-ge und iniNoi-den; der l'b<Tgang von torrenticohm Arten
in die Seentiefe, ferner die morpbologisclien nnd biologischen
Anpassimgen an die ungilnstigen Lekmsbedingungen iin Bach
uikI die hmge Daiier des Enibrvonallebens, wolil eine Folge der
iiel'en Tenipcraliir des bewolmten Me(linnis.
12. C(JLLEMBOLA.
Ini lialbiiberiiuleten Moos einiger Bei'gbiiche samuielte ich
einzelne Concuihohi , die Herr L)'' .T. Carl in Genf mir freund-
lichst besUniinlc. Sie gehoren seibstverstiindlicli nicht zur
Baclifauna und ich fiihre sie nur der ^\)llslandigkeit wegen an :
1. Moos ans Biichen ani Hasliberg (i>(M'neroberland bei ca.
1200 m :
Neanurtt nmacorum Tk.mpl. -ini l'euchlen Moos und unier
der Rinde morscher Stamme-.
Isototna pahistris Miiller var. pdJiuJa Schàffer "im
feuchten Boden«.
2. Moos eines Sturzbaches bei Zermatt, 1700 ni.
ImtoDui iKihtsti-h MiiLLKR \u.r. pfi]Ji(hi Sciiâffkr.
3. Moos ans Bei'gbiichen von Parjian.
P(ij)iru(H m'niutus (¥x\>,K.) lIauj)tforni. — Im Laub.
73
13. EPHEMERIDAE.
Dio Zalil (lor bachbewolinénden Fphouei'iden-Cjaiiungen ist
reclit siattlicli. Leider konnten wir die Zalil dei- Arten niclit
feststellon, da die Spezieszugelioiigkeit nacli den Larvenstadien
bis zum heutigen Tag noch nicht ennittelt werden kann.
Tell sebieke eine Liste voraus:
1. Rhithrogena semicolorata Curt.
2. Rhithrogena spec. andere Ty])en.
3. Iron spee.
4. Epeorus alpicoJa Eïn. ?
5. Epeorus spec.
(). Ecdyurus spec. mehrer(,' Typen.
7
.
Ba et is gemell i (s Etn .
8. Baëtis alpinus Pict. ?
9. Baëtis spec. andere Typen.
10. Heptophlehia spec. 2 Ty[)en.
11. Potamanthus liiteus L. \
12. Otigoneiiria rhenana Pict. ( Rliein.
18. Prosopistonia foliaceuin Fourcroy.j
14. Ephemerella sjjcc.
Untei' den einzelnen Gattimgen Ijisst sicli eine Reibe der
BachanpassLing verfolgen, die liaui)ts;ie]dicb nacb zwei Ricli-
tiingen liin tendiert : Dorso-ventrale Abtlacbung iind Vergrôsse-
riino- der Adliiisionsflacliiv Diesen Zielen slreben aile Racb-
epliemeriden zu.
Am besten angepasst sind die Gattungen Iroii nnd Rhithro-
gena. EpeoruswYA Ecth/urus stehen niclit weit nacb, wali-
rend Baëtis melir Moosbewobnerin ist und speciellere Anpas-
sungen zeigt. Lepjtophlehia und Epherne}'etla bevorzugen
langsain fliessende Radie, Otigonearia, Prrjsojjisto/j/a und
PotaDUintluis kenne icli nui- ans dem Rliein. Die Lai've von
Ephemera, rulgata endlicb fand icli nie iin tiiessenden Wasser,
ti'otzdem icli das Imago melu-facli an Biicben sammelte.
Epeorus, Ecdgiirus und Leptophlel)ia fand icb im lîacli
der Haslerboble. Weiter unten sollen die niorpbologiscben
Verànderungen, die die cavicle LebensNxeise bedingt, niiliei'
bescbrieben werden.
— 74 —
All(î Bacliformen leben Sommer und Winter. Aile Alters-
stufen sind zu jeder Jahi'eszeit anzutretien. Dies scheint anf
langdauerndes Lai-venleben zu deuten. Naheres dariiber ist im
allgemeinon Kapitel iiber •- Anpassungen der Tiere an deii
Bergbach « (p. 181 tf) zu finden.
Rhithrogena: Larm starh doi^soventral abgeffacht,
erstcs Paar dey Tracheenkiemenlamellen sta7'kverhreÀtet;
drei Schwanzfdden.
Fi"-. 2.
Fiu-. 3.
Fio. 1.
Fig. 4
Larve von Rhilhrogena sem icolorât 'i
.
Fig. 1. — Nahezu erwachsene Larve.
» 2. — Kiemenlamelle (L Paar).
» 3. — » (2. Paar).
» 4. — Erste Maxille.
Rhithrogena semicolorata Ccrt.
Imago: lU'i Siickingen, \V(dir, lîarscliwyl, Bott-
mingen.Larve : Sebr verbnntei im Jura und Srhwarzwald. Ali)in be
Z <' r m a 1 1 1800 m. A n d e v m a 1 1 (2 Nov. untcr Scbne e)
Die Ti))(i(i'nics sclioincn vorzugswoiso in don Somnici'monntcn
7M fliogon.
Beschreibung der Larve. — Die Larve gieicht der von Eaton
bescliiiebenen Rh. aurantiaca. Jedoeli ist der Ko\)i eng mit
dem Thorax verbunden. Die drei Sednvanztaden sind unbehaart.
Der Fémur zeigt in der Mitte einen dunlclen Pnnkt und (birnm
einen ovalen Ring (fîg. 1). Das Basalglied des Maxillarpalpus I
(fig. 4) ist sebr kraftig entwickelt. Die redite ^landibel ist
plumper als bel Rh. aurantiaca. Die Fiirbung variiert etwas
mit dem Alter. Meist war der Rucken oliv bis grau gciarbt.
Fiir Détaille verweise icb auf meine Figuren.
Bedeutungsvoll ist der Haarmangel an den Scliw anzf;iden.
Da bei den Ephemeriden des stelienden Wassers die bcbaarten
Sclnvanzborsten eine Art Schwinnupalette erzeugen, ist die
Reduktion dieser Scliwimmliaare als eine Bacliani)assung auf-
zufassen.
Aiarmliaca ist die Form der Fliisse und Baclie dei- Ebene, in
denen die geringe Wassergescbwindigkeit das Scliwimmen nocli
ermôgliclit. Semicolorafa dagegen sclieint viel mebr Gebirgs-
i'orm zu sein. Eaton nennt als Sommertemperaturen, bei denen
die Ephemeridenlarve gedeilit, 10— 1 IM". Sie liidt sidi nur
an raseben Stellen (- swift parts ••) der Piiicbe auf.
Meyer-Durr kennt mebrrresdiweizerisclio Fundorte : 28. Mai
bei Kraucbtal und Hindelbank, 17. August, am Fusse
.lura bei Solotliurn ; I^rcnigartcn im Aargau (Boll).(l('^
Iron: Larve abge/fffcht. Erstes Paar der Tracheen-
riemenlamellen stat^k tergrossert, iiiereii- bis hcr:fo)'intg.
Zicei Schuianzfade^i
.
Die Gattung erinnert an Epeor-us, von denen sie sicb liaui)t-
sachlich durdi die verbreiteten Kien:ienlamellen auszdelmet.
Audi die Form der ersten Maxille gleidit der von Epeoriis.
Die Gattung ist nacli Eaton amerikaniseh. Idi fand jedocli
mehrere Larven, die zweifellos liiebei- gebôren, in eiiiem Berg-
badi der Kalkalpen bei I mst, Tirol, am 7. April. Ein Exemplar
braehte mir Herr Pi'of. D'Zschokke ans Parpan (Graubiinden)
mit. Er fand es in einem Wildbacli bei ca. 1500 m. Meine
Larve weiclit ziemlicli stark von der als Irou spee be-
sdiriebenen und abgebildeten des EATON'selien Werkcis ab.
— 76
Beschreibung der europaischen /ro;?larve. — In dci- Fonngloiclit (lie Larvo dci- aiuerikaiiisclien. Der Feiiiur ist jedoeli
stiii'ker verbi'eitert und zeigt 3 di^akl*} Fleckeii iind in d(ir
Mitteeinen liellen Punkt (fig. 1). Das erste Paar der Kiemen-laniellen ist breiter und liât inelir Herzform (fig. 2). DasLabi'um (fig. 3) ist vorn gerade abgestutzt und tràgt nur seitlicli
Fis-. 3.
Fie-. 5.
Fie-. 1.
Fio-. 2. Fia-. 6.
Larve von Irvn spec.
Fiii. 1. — Bein.
» i. — Kieinenlamellen (1. Paar).
» 3. — » (2. Paar).
» 4. — Lal)ruin.
» 5. — Mandihel (Redite).
» 6. — Maxille I.
Dorstcn. An den Mandibeln besitzt der zweite Ilauzalni t'eine
S(dvtnidare Zahne (fig. 5). Das letzte Glied des Maxillarpalpus I
(fig. ()) ist sclilank und triigt sclir l'eine Haare; das zweite ist
relativ vielJanger nnd fast so lang wie das letzte. An (lerS})itze
des Lobus findet sicli eine eini'aclie Zange mit besonder<'r Mus-
kulatur.
77 —
Irou ist dem Bachleben vielleiolit nocli bessci' angepasst als
Rliithj-ogena, da ausser dem ei'sLeii Lainelleiipaar aucli di(!
andern eincn ctwas verbreiterten, massiven Rand besitzen, dcr
koine Trachéen entliiilt und sicher die Anfgabe bat, die Adhii-
sionsiiiiche zu vei'grossern (flg. 3). Die Form scheint selir selten
zu sein.
Epeorus : Lai'rc (ilxjeflddtl . Ers/es Paar dcr Kioneii-
JcimeUen )uir seh)' irenkj verhrcilo't. 2 Schwanz-flulen.
Epeorus torrentium? und Epeorus alpicola?
Larveii, die stai'k der von Eaton beschriebenen und ab-
gebildeten Lar\e von E. fi))Tentium gleichen, fand ich sein-
regelmassig, jahraus jahrein, in Siickingen, sowie mehrmals
im Wehratal und in der Haslerliohle. Ein Exemplar einei"
etwas abweichenden Larve fand ich irn lîerneroberland.
Sie diirfte \\o\\\ zu Epeorus alp'icoJa Etn. gehôren. MeLachlan fand das Imago dieser Art fast an der gleichen Stelle,
wo ich die Larve fîeng (Meyringen, beim Alpbach). Die
Larve von Meyringen zeichnete sicli^von den andern ihnx'li
eine phnnpere Mandibel mit einfaclierer Zalmbewaftnung ans.
Die erste Kiemenlamelle neigt noch weniger zur Verbreiterung
als bei torrculhim
.
Ln Jura scheint Epeorus zu fchlen. E. uJpicola steigt nacli
Eaton in den Alpen bis zu 2000 m.
Ecdyurus : Eurre (ilxjcjhichl. Beine uud Kopf sfo)-];
rerhreilert; ers/es Pour de)' Kiemeulamelleii normal;
3 Schwanzfaden.Ecdyurus ist die haufigste und verbreitetste Ephenierick-n-
Gattuhg der Baclie. Ich fand sie im Jura, Schwarzwald,Alpen und Karst. Die Larven der einzelnen (legenden sind
recht verschieden; da icli aber die Zugehôrigkeit doch nicht
ermitteln konnte, will ich es unterlassen, die Unterschiede
anzugeben. Dagegen \\ill icli auf einige Gattungscharactere
aufmerksam machen.
Der Fémur von Ecdi/urus ist ungew(")bnlic]i laug und blatt-
artig vci'brcitert; ei' iilx'rnimmt die Funktion der A'ergrcisserung
der Adhiisionsflache. Das erste Paar der Kiemenlamellen ist
eher kleiner als die iibrigen. Ein verbreiterter Rand i'ehlt den
— 78 —
Lamellen ; sie stelum vollsUmdig im DiensLe dor Respiration.
Die Fibrillenbiiscliel sind meist slarker entwickelt als bei don
V('r\vandl(Mi Lpcortis, T)-())i und Rhith^'ogcna. Das Labnim
isl Gulsproclicnd der starken Vcrbivitcrung des Kopfes seitJich
fiiigelartig ausgezogen. Der Lobiis <\i'Y ersten Maxille triigt
an d<M' Spi(/t' keine Hanzidnie, istdageg(în oft mitselir schônen,
kannnarligen Chitingebilden ansgcstaltct. Aile Mnndglied-
massen sind ziemlicli stark beliaai't. Die drei Scliwanzfaden
konnen kald sein oder Haare tragen.
iVus der Schweiz sind bis jetzt mehrere Arten von Ecdyin'us
bekannt.
Ecdynrns ffuijrhiHmPiCT., Rlione bei Genf , Pict.; Inn
bei Celerina (Oberengadinj, Meyer; Bnrgdorf, Emme,den ganzen Mai, jedocli nicht jedes Jahi-, Meyer; Oi'be, boim
Lac deJoux, Me Lachlan; Basel, Bern, P]tn.
Ecdrjurns hiteraViH Curt., mehr in Biiclien : l>aclie amSalève (Pict.), Kranclital, Hindelbank, Emme(MEYER),
Jouxtai.
Ecdyiirus helcellcus Etn. Hoclialpen der Sclnveiz : Val-lorbes. Lac de Jonx, Int(>rlaken, Etn., Me Lachlan.
Ecdyurus venosus Fabr., Bex, Bern. Me Lachl. St.
Moritz, Jouxdistrikt.
Baëtis : Larre uiclit ahgepacht. Fihi'iJlcidnischel fcldoi
.
KicrueidameJlen chifitch oral h/s bij'i/forwig, boreg/irl).
3 Schwanzffulcn, (Un' ni'dtlere oft seJ)r sch>rach cidirickelf
Baëfislehi teils in ruliigvrn Gewassern, teils in wilden Berg-
bîiclien. Die Larven sind meist klein und selir beweglicli. Sie
bcwohncn mit Vorliebe iiberflutetes Moos. Daher deutet ilire
Organisation auf kletternde Lebensweise.
Die Beine wei-den niclit ^\•ie bei der Ecdyu)-i(Sgvu\)pc seitlicli
ausgebreitet, sondern sind richtige Kleiterbeine gewoi'den
(fig. 5). Manchmal wirkt eine Verliingerung der Tibia mit dem
Tarsus zusammcn als eine Art Zange. Sehr gut entwickelt sind
aucli die Klauen. Sie tragen eine Reilie feiner Widerhaken. Die
Ai'ten, die den Wiesenbach luid Graben bewohnen, verm()gen
aucli zu scliwimmen, indem sie das Wasser mit der durcli die
Beliaarung dei' Scliwanzfiidcn enistelienden Scli\vinnni)alette
schlagen(z. B. Baëlls Rhodaiil Pict., eine weit verbi'citetc, in
der Scliwêfe nur ans den Niederungen bekannte Art). Die
BaëtisldiTYen dei- Wildbiiche, vorab die von Baëtis goncltus
— 70 —
Etn., besitzcn kt'ine solclie Sclnvimm\oi'ri('hUing, <lio iliiicn iin
rasclitiicssenden I')ach docli niclils iiiilzcii \vurde. Bei Bffëfis,
(leineUns isi dcr miitlere Scliwanzfadoii nidimentar. Die Mund-
(j-liedmasseii zeitieii bei deii einzelnen Ai1en bedeutende Ver-
scbicdenheiten. Bcsonders stiirk variiert yV^v Palpus doi- ersten
Maxille.
Fi-. 1.
Fit;-. 2.
Fis. 3.
Fig. 5.
Fi?. 4.
Larve von Baëtis gemellus Etn.
Fig. 1. — Erwachsene Larve.
y, 2. — Tracheenkiemenlamelle.
» 3. — Labriiin.
» 4. — 1. Maxille.
» o. — Bein.
» 6. _ Mandibel (linke).
Fig. 6.
Die Gattuna- isi sehr verbreitet und zilbli liber 25 Arten.
Die Larve von Baëtis gemeJhis. die icb durcb Aufzucbt iden-
tiflzieren konnte, soll nacbstebend b<-scbi'ieben werden.
80 —
Baëtis gemellus Etn-
Ti'aclieenkicinenlauiclloa blattiurmig (tig. 2), oval lus Ijirii-
formig, oline Fibrillenbuscliel, gleichiniissig bcwimperl.
Labnim (fig. 3) mit uinor seicliten Ein1)ii('liiung in dev Mitte,
fein bcliaari. Palpus der ersten Maxille (fig. 1) sehwach cnt-
wiclvelt mit 2 Gliedorn, nur an der Spitzo mit einigen
stumpfen Borsten. Abti'cnnung dos letzten Gliedes des 2ten
Maxillar-(Labial-)tasters undeutlichoi- als bei B. Khodani.
Schwanzfàden fast unbohaart, mittlerer sehr schwacli, etwa
1/5 so lang als die andern. Fîirbung grangelbe mit dunk-
lerem Hinterleib ; auf letzterem segmentweise belle Flecken
mit 2 dimklen Pimkten. Dièse Zeicbnung ist am scliônsten auf
den mittleren Abdominalsegmenten ausgvpi'Jigt.
Die Larve kommt in den Alpen und im Scbwarzwald ziem-
licli liiinfig vor, im Jura lierrsclien andere Typen vor. P)ei Zer-
matt fand ich das Tier in einer Holie von iiber 2000 m. In der
Nalie von St. An tô ni en steigt sie bis 1500;n (Zschokke)-
Leptophlebia : Larve klein, etioas abgeflacht, Tracheen-
]ii('iiieii'J-:-i})/ii(j, in de?' Mitte schicarz, Schiva'iizfdden 3,
sehr lojig, tnit Hteifen Borsten t)esetz-t.
Ich fand 2 Formen die beide niclit mit der von Eaton beselirie-
benen L. cinctn i'ibereinstimmen.
Die eine Fonn fand icli in mcliivivn Berghiudien d<'r Umge-
bung von Lugano nn.d in Imst (Tirol), die andci'c in der
Haslerbolile im si'idlicdien Scliwai'zwald
Die Gattungen Ephenieretia, Potoridiilliiis, Ofujonenria
und Prosopistoma sind kaum melii- in eigentlielien Ik'i'g-
biiclien anzutreffen. Die erste der genannten bevorzugt \\'iesen-
baclie, die andern fand ich ausscdiliesslicli im Rliein. Dièse
Formen vermogen demna(di nocdi zii sclnvimmen. Was sich an
mannigfaltigen Einri(ditungen kund giebl.
Die Beine tragen gewôhnlieli Sehwimmliaare, elienso die
Scliwanzfaden. Dagegen beweisen wohlent^^'ickelte Ki'allen und
Neigung zu dorsovent râler Abfiacliung, dass man es innnerhin
mit Formen des fliessenden Wassers zu tun bat. Ejdioncrettd
steigt in Fliilien bis gegen die kalte (Quelle liinauf. \\(\ sie auch
mitten im Wînternicht UAAi.Pr'osnjiistnnui fandHerr IvGrak-
TER im Rhein in der N;ihe von Siickingen zum ei'steu Mal auf
— 81 —
Sehweizt'i'geljiet. LAuxKKHitKN iiicldct sic ans dcr Nalie von
Fi'iedi'iclisliat'en, Noll ans dev (legenddes Loi'cley t'clsens.
Sie sclicini nhov das ganzo (Icbict des Hlicines verbrcitcl zu
sein, isL jedoch scliwei- zn selien, da sie ihren scliildfoi'niigen
Korpei" meist l'est an die Unterlage anpresst. und deslialb leicld,
fiir einen Teil der Steines geiialten wii'd. O/if/oj/cuj'if/ )-he-
naïKt, PiCT. ist die liaufigste aller Rlieinephemeriden. Ihre
Lai've ist etwas al)g<'flaelit, verniag aber gut zu sc]l^^•inllnen.
Poldntdiillni.s hi/cus L. ist ini Rbein ebenfalls nieht selten.
Morphologische Verânderungen infolge cavicoler Lebens-weise.
Als ieb ani 3. Novendx'i' lUOÔdendurclidie Ei'dniannsb()ble bei
Hasel (siidl. Sidiwarzwald) fliessenden Ikieb nidersu<dite, ei'ben-
tete ieb eine Anzalil Baeliinsektenlarven, nnlerdenen sieli aucli
drei Epbemeridenarten befanden. Die H()ble beberbergt eine
ziemlicli artenreiche P'auna, darunter luancbe ccbtf! Hôlilentiere
wie Nipliff)'f/i(s j)/(.fef(iuis, AseUas caA'nUcns, Vitr-cna Jwî-
rctica und niancbe Collemhola.
Die Anwesenlieit der Insektenlarven kann ieb niir nur (bu-eb
Eiiis(dnveniinmung vielleiebt scdion im Eisstadium ei'kbaren.
Innnerliin verdienen die auffàlligen Veninderungen, die das
Hôldenleben zur Folge liatte, bier nabere Rescbreibung zu er-
fabren.
Lepiophlel)in wàv dureb ein einziges, scbleebt conserviertes,
be^cbadigtesExemplai" vertreten,an dem ieb keinei'Jei Besonder-
beiten zu entdecken vermoebte.
Dagegen konnte ieli melu'ere Ecih/urus- und^^j^or/^^'-Larven
untersucben, bei denen die Folgen subterraner Lebens\\eise
leielit zu beobacbten waren. Statt der dunklen, bi'iunilicben bis
oliven Farbentone beri'scbte ein l)lasses Braungelb voi'; ein
Exemplar war l'ast fleisebfarbig. Ani Kopf und an den Beinen
der Ecdyitrus\m'\Qn waren merk^^urdige seliwarze Zeieli-
nungen zu seben, feine, geki'iimmte Linien mit bauniartiger
Verzweigung. Wabrend beim gewolniliclien Lcdj/Mr/fs des
Baelies die Ocellen kaum })ignientiert sind und im Gegenteil als
bellere Punkte auf dem dunkleren Kopfsebild sielitbar werden,
\\'aren sie liier sebr dunkel gelai'bt ; bei zwei Exemplaren bildete
sieb sogar eine Pigmentbriieke ans zwiselien den Faeettenaugen
und den Ocellen. In den Tracbeenlamellen wai- die Verastelung
der Ti'acbeenstiimme autiallend deuilieb sicbtbar. Die Lpconis-
— 82
larve ^\^av alinlicli L!:('t';irl)t ; nur l'elilten die scliwarzeii Zcicli-
iiungen. Die Ocellen ^va^eil audi liier auffallcnd diinkel ; docli
untcrblieb eine cigentliclie Briicken})ildiiiig. Zwei Exemplai'e
zcielmeten sicli duirh eint; starke Verkiirzung des Abdomensaus. Dies scheiiit pathologisch zu sein.
Die ziemlicb weitgelienden Verànderungen, die sicli liier wolil
sicher am Individuum vollzogen haben nnd nicbt durcli langere
Einwirkung der Dunkellieit auf mehrere Generationen ent-
sianden sein kônnen, beweisen, wie stark die P]pliemeriden
vom Liclite aldiJingig sind. Icli werde aiif dièse Tatsache sjxiter
nocli zu sprechen kommen, A\'enn ^\"ir nacli der Ursaclie der
Scliwarmbildung fragen. (S. Kapitel iibei' An})assungen dei'
Tiei'e an das Leben im Bach, p. 181.)
14. PERLIDAE.
Die Perlidenlarve ist eine sehr liàufîge Erscheinung ira Bach.
Sie teilt meist Aufentlialtsort und Lebensweise rait den Epheme-
ridenlarven vom Ec(Jijurusij\)\v&, denen sie auch in der aussern
Erscheinung ziemiich nahe kommt. Wie jene ist sie in dorso-
ventraler Ricliiung stark abgeflaclit, jedoch nie so stark wie
z. B. Ecdynrus oder Epeonis. Die Beine Averden ebenfalls
seitlich ausgebreitet und der Fémur nimml oft- bhittfôrmige
Gestalt an. Die Hauptunterschiede zwisclien den Larven der
beiden Familien sind in der Lage und Form der Respirations-
oi'gane zu suchen. Wo bei den Perliden àussere Kit^nen auf-
treten, fînden sie sich niclit wie bei den Epliemeriden seitlicJi
vom Abdomen, sondern in der Nahe der Einsatzstelle der Beine.
Entsprecliend den zwei gleichartigcni Fhigelpaaren sind vier
Fhigelscheiden vorhanden, \\';Uu'end bei den Epliemeriden nur
deren zwei sichtbar werdtm. Die Fiihler und Schwanzfàden
sind meist derber, letztere kommen stets in der Z\\'eizahl vor.
Leider kennt man die Pei'lidenlarven noch zu wenig, um nach
ihnen bestimmen zu konnen. Icli muss raich dahei' mit einer
Aufziihhmg der an Biidien gesammelten Imagines und einer
(bei'sichl liber deren Voi'kommen begniigen. Herru D'' Kis,
der mein Mat^rial in i'reundlichster Weise bestimnil(\ sage ich
aut'h hier meinen besten Dauk.
— 83 —
1. Perla cephalotes.
n) Fonn mit laHggcflufjrltcn Mannchen.
Fundorte : IJa rscliwvl (Jura) bis 27. Juli; sehr haiifig
Anfangs Jiini.
Ans dei' Scliweiz ans dru Gegendeii von Sonecboz, Biel,
Z il rie h (Limniat) bekaimt.
b) Fonn mit km'zqeptigelten Mdnnclwn.
Fiimlorte: Saut du Doubs (Jui-a) und ( )i-be(ju<'nf' bei Val-
lorbes, 30. Juli !
Aus d(M' Schwciz von Seliatfbauson, Siders, Genf,
Emme bei IJurdoi'f gomeldet.
In Fhiss und Bach vorbreitete l'orm.
2. Perla marginata P.VNZ.
Tessin, Biirschwyl, Saut du Doubs, Juni.
Fine in Waldbaclien vcrbreitete Forni. dio in dcr Regel
unsern Fliissen felilt.
3. Perla maxima Scop.?
Einige nielu sicher bestimmbare Larven die vielleielit auch zu
P. marginata gehoren, wurdcn im Tessin bei Faido am
7. Oktober 1005 gesammelt.
Die Art ist in Fliissen Miiteleuropas verbreitet.
4. Chloroperla rivulorum PiCT.
1 Exemplar aus Lausen (Jura).
Die Art ist nacli Meyer an Alpenbaehen und wilden Berg-
wàssern liiiufig anzutreften. Pictet fand sie am Fuss des Jura
bei Genf. Weitere Fundorte sind Berneralpen, Engadin,
Tessin, Goitha rdmassiv, Albula, Tirol, Rhiitikon,
bis 2300 m.
Fine sehr weit verbreitete Gebirgsforin, dii- aucli iiberall in
den Vorbergen zu findcn ist, den grossen Stroraen dagegen
fehlt.
— 84
5. Chloroperia grammatica I'oka.
Fiiiidortc : I);i rsc]i\\'vl iind M'ehi'atal, Scliwarzwald.
Die Art is( sclu' vcrbrcitcf; sie komnit inassenliaft in allen
se]i\\'('izcriseli('n Stromcn vor, felilt aber aucli don Bachen
nirgends. Sic wurde nocli bei 1200 m. am Sclinobeihorngefangen. Iiii Tii'ol stoigt sie nacli Heller und v. Dalla
ToKRE iibei' 1700 m. In Norwegen ist si(! bis in dcn liohen
Noi'den liinaui' verbreitet.
6. Taeniopteryx Risi Mouton.
Fimdorle: Sacl^ingen, Bai'seliwyl.
Eine fiir Bergbaclie selir cliaraeleristiselie Form, die den
gi'ôssern Fliissen fehlt. Sie wurde von Murton in Ts orwegenan vier Stellen gefundi'n.
7. Dictyopteryx Imhoffi l'iCT.
Fnndort : Bar scliw yl.
Eine vorz^gs^\'eise dem Rliein angebôrende Art, die sich von
da in niclit allzu fcrne GcMiisser verbreitet.
N. Dictyopteryx spec.
Larven verschiedenen Alters im Tessin nnd in Zei'matt,
2100 m. Walii'seheinlich liandelt es sich uni die liocbalpinen
Formen I). ((l\>'niii Put. oder iiitricdtd Pict.
*,). Isopteryx torrentium Pict.
Barscliwyl, Juni.
"Ein regelmassiges Mitglied der Fauua nicbt zu kleinei' Baclie
von rascliem Laul".
10. Isopteryx tripunctata Pict.
Bîirscliwyl , Juni.
Konimt oftmiassenhai'l am Rbeiu vor; bclcbt aiicli kleinei'e
riewiisser und steigt ziendich lioch in die Alpen empor.
85 —
11. Nemura (Protonemura) nitida Picï.
Sackingon, 10. Oktobei-; Zermatt, August?
Eine Art, die im Spiitlierbst fliegt und die Gebirge b(!vorziigi
verbreitet. Zschokke keiint das Tier ans deiii Ivli.-i tikoii .
12. Nemura (Protonemura) fumosa Ris.
l^arsclnvjl, Juni.
Geliôrt vorwiegeiid der I)achl'auna an und lebt nichi scllcn
an kleinen Quellen. Sieigt auch ziendich hocli in dir Alpen
empoi'. Lenzerlieide nnd Rosenlaui.
13. Nemura (Amphinemura) cinerea (Ouv., Mokt., Ris).
Bàrschwyl, Juni.
Verbreitetes Mitglied der BacJifauna, da und dort auch in
Quellen. Zschokke fand die Art im Rhiitikon. Sic kuninit
nacli MoRToN aucli in Scliottland vor.
ii. Nemura marg-inata Klap.
Biirschwjl, Juni.
Sein' verbi'eitet, gehort der Bacli- nnd Quellent'auna an und
l'elilt den Stromen. Sieigt im Jura bis 1 000 m; wurde noeb amSclinebelliorn 1200 m. crbeutet. Sie Hiegt voni Aj)!']! bis
spàt im Sommer.
In den Biicben Riigeiis ist die Forni naeb Thiknkmann
(114) baufîg.
J5. Nemura (Amphinemura) triangularis Ris.
Barscliwyl, Juni.
Gehort vorwiegend der Bach- und Quellenfauna an und
besitzt ^^'obl ann dici'nd die gleiche Verbreitung wie Nenini'd
cinerea
.
Aufiallend isl , dass \\\in' die echten Baehl'ormen. die zu gleicher
Zeit hiiuflg auftreten und deren Jabrescjclen und Scb\\-ai'mzeit
deslialb leiclit controlliert werden kônnen, fast den ganzen
Sommer fliegen, wàhi^end die Flussforinen nur zu gewissen
— 86 —
Zeiten aiiftroton. Almliclies konnten wir bei den Epliemeriden
beobachten. Audi hier zeigt sich also, dass die Jalireszeiten
sicli den Bewohnei-n der Gebirgsbàche nicht fiildbar maclien
konnen, da die Temperaturen im tvpisclien Racli Soivmiei' und
Winter anniihernd gleich sind.
15. TRICHOPTERA.
Die Ti-ichopieren diirfeii, was Individiien- \ind Artenzahl be-
trifFt, ZLi den im Bach am besten vertretenen Tiergruppen gezàhlt
werden. Zaldreicli sind die Literaturangaben iibei' lorren-
ticole KocJierfliegen. Eine betrachtliclie Menge von Arten und
Gattungen gehoren anssehlicsslich dem Bacli an. So finden wir
auch eine mannigfaltige Reihe von Bachanpassungen, Einrich-
tungen, um der (3ewalt der Strômnng zu trotzen. Die verscliie-
denen Familien erreichen oft mit verschiedenen Mittehi
denselben Zweck.
Icli schicke eine Liste meiner Funde, die in liochst vei'dankens-
werter Weise Herr Dr. Thienkmann in Greifswald be-
stimmte, mit einer Ùbersicht iiber die Verbreiinng der einzelnen
Formen in meinem Excursionsgebiet voraus.
Die Larven sind je nach der Lebensweise verscliicden orga-
nisiert.
Die gewohnlich in Geliiinsen lebenden besitzcn keine Nach-
schieber oder nur kurze Haken, die den Zweck haben, das
Geliause beine Vorwàrtssclu'eiten festzulialten. Bei den frei-
lebenden odev nur lose Gehàuse ans scldeimigen Fiiden und
Steinen bewolnienden Larven, bei den Rhyaco])liiliden und
Hjdropsjcliiden sind die Nachschieb(!r gross, beinartig und
tragen eine (l)ei den Hy(b'opsjchiden) oder zwei (bei den
Rhvaeophiliden) gut entwicdvelte Klauen; der ganze Ajjpai'at
(hent der Rétention und Lokomotion. Sehr oft sielit mau solche
Larven riickwarts gehen. Hiebei greifen die Naelischiebei" aus
uud suchiMieineu Vorsi)rung oder eine Unebcnlieit, an der sie sicli
i'csthaken Iconuen. Ist ein solcher Hait gefundeii, sozidien sie
(h'H Korper spanneriihnlicJi an und setzen die vorih'rca Beine
au die Sbdle, wo der Naelischieber haftet . Dieser liisst los und
suclit von neuen Hait. Eiue solche Art der Bewegung liisst
sich sehr Icicht bcobachleu bei Ivhyacophilidcn und Hydropsy-
- 87 —
N A M E
1 Stenophylax picicornis Pii t.
2 Stenophylax spec. . . .
3 Ecclisiopteryx guttulafa Pict
4 Drusus discolor Hamb. .
5 Drusus spec
6 Apatania spec. . . .
7 Limnophilidae unhest
8 Sericostoma limidum tiag
y Sericostoma spec . . .
10 Goët ina unbesl. . .
11 iMicrasema minimum iMc L.
12 Helicopsyche sperala Me L. ?
13 Crunœcia irrorata Gurl. .
14 Reraea maurus Ct. . - .
15 Odontocerum albicorne Scop
16 Hydropsyche spec. . . .
17 Philopotamus ludificatus Me
18 Philopotamus montanus Donov
19 Plectrocnemia spec . . .
20 Polycentropus spec. . . .
21 Hhyacophila aquitanica Me L.
22 » nubila Zelt (?) .
23 » spec. (vulgarisgruppe)
24 » spec. (glareosagruppe)
25 Glossosoma Boltoni Curt.
26 Agapetus i'uscipes Curt. .
27 Ptilocolepus granulatus Pict
28 Stactobia Eatoniella Me L.
29 Oxyethira sagittifera Ris (?)
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
— 88
cliidcn, (lio man aus iliren Gangen aufsclieuclit. Sie ist im
Slaiidc, (lio Tiere selir rascli voi'wai'ls zu biiiigeii.
Limnophiliden .
Vier Gattungon von meiner Triehopterenausbeuie geliôren
zu dieser Famille. Eino grosse Anzalil iinbestinimbarer Larven,
die icli im ganzen Gebiet fand, meist Bewolmer ans feinen Stein-
clien aufgebauter Kôcher, da und dort aucli mit pflanzliclieii
Teilen und kloine Sclmeckengehausen mïissen, cbeni'alls liiolicr
gereclmet werden.
Die Gattung Stenophylax, von der icli plcicornis Pict.
nacli dem Imago bestinnuen konnte, ist durcli ziemlich reiclie
Bachvertretung ausgezeicimet.
Icli fand Larven, die zu diesem Genus gehôrcn in den Jura-
und Scliwarzwaldbâclien. Aucli Ulmer' kennt aus dom
Scliwarzwald Larven von Stenophylax, die er zum Teil zu
St. stellatus Gt., zum Teil zu latipennis stellt.
Stenopjhi/lax jncicornis Pict. ^\•ur(le in der Sclnveiz an
verscliiedenen Stellon gofunden. Die Fliege ist vorzugs^^'cise
eine Bewolmerin kleiner- Quellen und begleitet Caltha pjalns-
tris bis auf die liôclisten Alpweiden himauf. Pictet fand sie
in der Umgebung von Genf; Mûller: Hosp entai; Zeller:
Bergiin. Me Lachlan bezeichnet sie als alpine Form. Sie
ist aus Osterroicli, Ungarn, Bôlimen, Tatra etc. be-
kannt und fehlt aucli in Lapland nicht Ris erbeutete das
lier auf dem Gotthard, Meyer-Dùr in der Faucigny,
Ulmer im nordliclien Harz, Thienemann in den Vogesenund im Scliwarzwald; ausserdem auf Riigen.
Lolztgenannter Forsclier hait das Insekt fur ein Glacialrclikl
undstûtzt siclidabei auf folgende Tatsaclien : "... bewohnt die
Gewasser der Alpen, des Nordens und isolierte kalte (^)uellen
der Mittelgebirge und der Ebene. Laieht im lîocligebirgi^ im
Sommer, im Mittelgebirge und in der Ebene im <'i'sten
Fi'iilijaln'. "
Ecclisiopteryx guttulata Pict.
Nicbt voITstiindig siclier l)estimmi; baut aus lîliiUchcn von
luiiiliiKdis (iHl/iii/n'I/cd und be\()rzugt (Jiiellon. Icli kenne
c^^
— 89 —
dio Art ans melironm Qiiellen dos Heidenwulirgebi(?tos
im siulliclion Scliwarzwald. Meyer-Diir fand das IinaiiO
massenliaft an Biiclien in der Umgebung von Burgdorf,
Kanion Bei'n. Das Inscki gonicsst im Noi'den dei' Alpcn cino
wcitc Vci'bi'eiiung und fchlt aueli in SelioLtland, ScliwtMUni
und La plan d niclit.
Drusus.
Eine t'iir das Gebirge Ivpiscbo Gattnng. Sieboi' liess sicb
nur die Art Drusus discoJo)' Ramb. bestimmen. Sie wurde in
der Scbweiz zu verscliiedenen Malen anfgefanden : so \on
Zeller (Bergnn), Miiller Hospcntal), Frey-Gessner
(Sedrun, Boll, Bernbardhospiz, Zi'iricli), Zschokke
(Rhiitikon), Ris (MnrgLal und Gottbard). Sie feldt nacli
Heller, von Dalla Torre und Thienemann im Tirol nicht.
Ulmer fand sie im Harz, Thienemann in den Vogesen und
im Sclnvarzwald.Icb selbst fand das Inselvt bei Zermatt regelmassig in Biiclien
von 1700-2900 m. sowie in den Wasserlaufon des Rliiitikon,
wo es sclion von Zsciiokkî-: nachgewiesen ^^-ar.
Das Geliiiuse bat die Form einer koniscben, et\vas ge-
kriimraton Rôbre. Der vorderc Teil ist igelartig von steifen
Bremsvorricbtungen pfianzlicber Natur, Wurzel- und Stengel-
stiicken besetzt. wiilu-end d(îr bintero Teil nur ans Steinchen
besbibt. Die eingemauerten Pfianzentriimmer liiiufen sicb auf
dem convexen Teil der Kriimmung stark an (der concave Teil
liegt ja nie der Unterlage auf). Es scbeint, dass die Tiercben
in der ersten Jugend, wenn sie infolge ilirer kleinen Gestalt
nocli binter jedem Vorsprung Sclmtz gegen die Strômung
fînden, die Bremsvorricbtungen nocb nicbt nôtig baben; daber
ist der binterste, iUteste Teil der Rôbre davon frei. Spàter
mit wacbsendem Scbutzb(Hliirfnis werdcn die eingerammten
Pflanzenteile immer starker.
Andere 7A\Drusu.s geborende Larven fanden sicb untcr meiner
Ausbeute vom Jura und vom Scbwarzwald.
Apatania bewobnt nacb Me Lachlan nordlicbe und arc-
tisclie Gegenden von Europa, Asieu und America. Die Art
Ajjafcmia funbriata Picx. ist fiir die Hocbgebirge Central-
europas typiscb. Meine Larven liessen sicb nicbt genau be-
6
— 90 -
stiramen,doch ist anzunelinien, dass sio zu A^ycdama f'imhriata
gehôren. Dafûr spriclit (1er Fundort: Sàckingen im sud-
lichen Schwarzwald. Fiir dièses Gebirge wurde die Art von
Me Lachlan nachge^^'iesen.
Die Gehàuse bestelien ans ziemlicli gi'oben Steinen und sind
kunstlos zusammengetïigl. Das Ganze ist koniseb, etwas
gebogen und dorsoventral leicht abgeplattet. Die Gehàuse
sind meist auf steiniger Unteriage leiclit mit Fiiden angeheftet,
scheinen aber zeitweise doch be\^'eglicli zu sein. Das Tier kam
bei Sàckingen besonders hJuifig in einer sehrkalten Quelle vor,
wo ich schon im ersten Friïhjahr zui- Zeit der Schneeschmelze
eine bedeutende Anzahl erwachsener Larven antraf
.
Sericostomatiden .
Sericostoma timidum Hag.
Imago in Bàrsclnvyl (Jura).
Dièse Art seheint t'ïir den Oberrhein typisch zu sein.
Sericostoma spec. Larven ans einem Waldbach ])ei Rhein-
felden und aus dem Oiistal bei Liestal. Ulmer fand im
sïidliclien Schwarwald Sericostoma personatam Spf.xNC.
Me LAeiiLAN giebt tur den Oberidiein an: *S'. personatam
und timidum, i'iir den Schwarzwald, Gegend von Titisee:
*S'. turludum Me L.
Meine Gehàuse sind leicht gebogene, aus feinen Steinclicn
zusammengesetzte Rohren
.
Goërinae, Bach bei Sàckingen, Khàtikon, Bàclie ])ei
P a r pan, G r a u b ïi n den.
Es handelt sich um Larven der Gatiungen Goëra, LitJiax
und Silo, deren Zugehôrigkeit nicht zu ermitteln is(. Die
Gehàuse sind rohrenfôrmige Sandkocher mit grôsseren, seitlich
angebrachten Beschwerungssteiuchen; das Ganze sielit dalier
stark verbreitert und depress aus. Die der Unterlage auf-
liegende Seite ist flach, die obère etwas gewôlbt.
Micrasema minimum Me L.
Bach bei Siickingen, Sentier, Jouxtai (Jura).
— 91 —
Me Lachlan und Ulmer fanden im Oberrlieingebiet Mici^a-
sema spec. Nacli Thienemann steigt M. minimum im Tirol
ziemlicli hocli (1400 m); ererbeutete die Artaucli im Sclnvarz-
w a 1 d .
Als Gehiiuse dieneii don Larven kloiiie geradc Sandroliren,
durcli Verwondung von organischen Beslandteilen meist etwas
dmikel geiarbt (im Allvoliol).
Helicopsyche sperata Me L ? Tafel IV.
Zwei Bâche der Umgebung von L u g a n o : C a s s a r a t e t a 1
.
Die Art ist in der Schweiz nur ans jener Cxegend bekannt.
Vorkommen nôrdlicb der Alpen fraglich.
Gehàuse schneckenfôrmig. Die von mir gei'undenen 5 Exem-
plare lebten aile im fliessenden A^'asser, niclit im Trockenen
oder Feucliten, wie man das sonsi fiir die Gattung annimmt.
Ich liielt 2 Larven 14 Tage lang im Wasser, bis mich langere
Abwesenheit zwang, sieabzutôton.
RouGEMONT fand, dass ein Aufentliali von einigen Stunden
im stelienden, ^\•enn aucli frisclien ^^'asser den Tod herbeii'iihre;
er nimmt dalier an, das Tiei' sei zu den Landbewolmern zu
rechnen. Die Larve ist jedocli mit Einriclitungen verselien, die
ilire Zugehôrigkeit zur ^^'asserfauna ausser Frage stellen. Sie
bewegt sicli, wie ich im Aquarium beobachtete, nur mit Hilfe
gesponnener Faden, in dcnen sie sich mit den Beinen verankert.
Sie kletterte auf dièse AVeise oft an der glatten A^^and des Aqua-
riums in die Hohc, ging aber, trotzdem ihr die Aloglichkeit
geboten war, auf einen aus dem A^^^ssor ragenden Stein zu
klettern, nie zum Luftleben iiber.
Revelière fand 1860 am Monte Renoso (Corsica) 00 Heli-
copsijchcgehixme in cinem Bergbacli (lorrent). Sie gehôrten
zu H. Revelieri Me L.
P. Mabille sammelte 1875 ebenfalls in Corsica und zwar in
raschfliessenden Borgbiiclien (lutjiiil tnounfnin lorrcnts)
Somit scheint die bislicr angenommene hygi'opetrisclic oder
gar terrestrische Lebenswcise fiir Helicopsi/che gar niclit
immer zuzutreiien. A'ioUeicht ist torrenticole Lebensweise
sogar die normale und wird nur beim Austrocknen der Ge-
wàsser durch die andern ersetzt.
'J^^
Fiy. Fi-. 1.
©Fia-. 2.
Fiff. 4. Fio-. 3.
Helicop.'ii/che .sperata Me. L. Larve.
Fig. 1. — Larve.
» 2. — Gehause in Naturlicher Grosse.
» 3. — » vergrossert von oben.
» 4. — » » von unten.
" 5. — Kachschieber.
93
Criinoeccia irrorata Curt.
Moosi'ascn des Sackinger Bergbaeli(is.
Nacli PiCTEï in der Niilie von Genf. Von Me Lachlan im
Sclnvarzwald und von Thienemann in dcn Vogesen nacli-
gewieson. In Grossbrilannien verbreitet, aber niclit liiiufig,
kommt nacli Thienemann auf Riigen in Quellen vor.
Das Geliause der Larve bestelit ans eiiifaclien Sleinchen nnd
Pflanzenti'iimmern. In der Regel lieri'sclien die pflanzlichen
Elemente, Moos-, Gras- nnd Stengelstiickclien \or. Die Larven
leben im Moos und fiihren ein liygropetrisehes Dasein.
Leptoeeridae.
1
.
Beraea maurus Ct.
Lugano, 5. Augiist 100(); Imago.
Scliweizerisclie Fundoi'te : Andermatt, Gôschenen;Vogesen : Thienemann; Sclnvarzwald : Ulmer; Ober-rliein : Me Lachlan.
Da icli nur das ImaiiO faiid, ist mil- das Larvengeliause un-
bekannt.
2. Odontocerum albicorne Scop.
Hauflg im siidliclien Sclnvarzwald, Wehratal, Sackin-
gen, Jura, Biirschwvl, Bellelay, Sentiers, Alpen,(Lugano).
Nacli Meyer-Di'ir bei Burgdorf biiutig. Uis kennt die
Form aus dem Jouxtai und aus Biiclien in der Nalie des
Luganersees. Aus dem Scliwarzwald melden sie Me Lach-
lan, Ulmer, Thienemann. Im Tlii'iringerwald und im
Harz lebt sic uach Llmkr. Thienemann wies sie fiir die
Vogesen nacli.
Die Larve dieser liiiuHgen Art lebt in clcfaulcuzabn-
iiludicbcu, aus feincn Stcincbcn kuustvoll zusanuni'Ugesetzten
Uobrcu. \'oi'der Melamorpbose schliesst sie dir Mi'uKbmg mit
eincm gi'osseren S(eine ab und klebt oit nocli eineii zweiten
94 -
•BeschwerungssLein- an dcii Kôclicr. Vor (1er Verpuppung
wird das Gehaiise mit starken Fàden an der Unterlagc fixiert.
Hydropsychidae .
1. Hydropsyche spec.
Niclit naher Ijestimmbarc Larven fanden sicli oi't massenliafi
in allcn Gcbieten : Sclnvarzwald, Jura, Aipcn nnd Karst.
Ausser einigon unbestimmbaren LimnopliUkloi sind dies die
einzigen im Karst erbeiiteten Trichopteren.
Die Gattung ist iiber die ganze Erde verbreitet. Die Geliause
sind gewôhnlicli fixiert nnd ans grôsseren Steinclien aul'gebaut.
Sie bilden gewissermassen ein Zelt, dessen Boden der grosse
Stein bildet, an dem die Tiere angeheftet sind.
2. Philopotamus ludificatus Me I..
Bergbaclie bei Sàckingen und Liigano.
Nacli Me Lachlan ist die Art liaufig im aljjinen und sub-
alpinen Gebiet. Ris fand sie im Tessin und im Murgtal,
Thienemann, Heller und v. Dalla ïorre im Tirol, Ulmer
im Harz und in Thïiringen, Zsciiokke im Rliiitikon,
Thienemann im Vogesengebiet.
Geliause wie bei HydropsijcliC, nvu' wei'den elier grossere
Steine verwandt.
3. Philopotamus moutanus Doxov.
Nur aus der H a s 1 e r 1 1 o h 1 e
.
Die Art ist verbreitet. Meyer-Diir fand sie liiiufig in
reissenden Biiclien. VcM'breilung imd Geliause wie bei der
vorigen Art; sclieini die tieferen Lagen zu bevorzugen.
'i. Polycentropus spec.
Sentiers, Jouxtai, Liigaiio.
Besonders die Art Pofi/ccn/rojxfs fJorotnaciUiihis liiiufig
und verbreitet. Larvengeliiiuse aus Steinchen best(;liend, die
loeker durëli I)etritiisgesi)iunste ziisaunnengelialten werden.
Zur Zeit der Ver]iui)pung \\\\\\ ein festeres Geliause bezogen.
— 05 —
5. Plectrocnemia spec.
Saut du Doubs bci Les lîrenots.
Die Gattung erfreut sicli oiner ziemliçli weiion Vci'l)reitung.
Die Larven bewohnen meist klares, fliessendcs Wasser undleben teils frei, teils in lockeren Steingehausen und schleim-
artigen Gàngen.
Rhyacophilidae .
Larven nur in Biiclien.
Da sich die Tiere bei der Ver^juppung mit einem dichten
Coccon umgeben, sind sie naeli Thiknkmann an sauerstoff-
reiciies, also stark bewegtes und kiihles Wasser gebunden.
Das Aufziehen der Puppen in A(piarien missiingt regelmassig.
Auch in dvr tVeien Natur fand Tiiiknemann oft abgestorbene,
vei'faulte Rh//aco])lNl(f\m\)i)cn und icb kann dièse Beobaclitung
aus eigener Erfalu'ung bestàtigen. Es liandelt sieh hier umPuppen, die infolge von Sauerstoffniangel erstiekten. Vielleicht
lasst sich auch daran denken, dass der b(ù kalteni AA^asser stark
herabgesetzte StottVechsel dureli zu starke Erwiii-mung des
Wassers so sehr zunimmt, dass sich die Producte der Excrétion
nicht rascli genug osmotisch durch die Cocconhiille entfernen
und dass so der Tod durcli Vergiftung eintritt.
Rhyacophila aquitanica Me L.
Elûhen, Bellelay, Siickingen, St. Antonien in
Bergbachen.
Von Me Lachlan fiir den Ôberrliein nacligewiesen. ImTirol nach Me Lachlan und Thienemann, im Schwarzwaldnach denselben Autoren. In der Auvergne von Eaton nach-
gewiesen.
Wie aile Rhi/acojjhihdavyen leben auch dièse teils frei
(vorzugsweise in der Jugend), teils in fîxierten Gehausen, die
meist aus grôsseren Steinen bestehen als beim Genus Hi/dro-
psyche. Die Puppc liegt bei den Rlij/acopJnJiden nicht frei
im Gehause, sondern ist in einem liinglicli-ovalcn, braunen
Coccon eingeschlossen.
— <.)ii —
Rhyacophyla nubila Zett.
Einigo Exemplarc, die vielleiclit dieser Ai't ant;'ehôren,
stammen ans Bellelay (Jura).
Die Art ist im nôrdlichen Europa verbreitet. Si(? lebt in
Scandinavien, Finland, Lapland, Russland, Polen etc.
Mein Fimd wàre walirsclieinlicli der siidlicliste Punkt. Ulmerkeiintdas Insekt ans dem Harz undans Thiiringen.
Andere, niclit spezifiscli bestimmbare Rhyacophihil-àvxaw
nnd -Puppen Avaren selir lianfig in den meisten Bàchen an-
zntretfen. Besonders zaldreich waren die Vertreter der rul-
^«r/.s'-Grnppe. Angeliorige der ^/«r^o.S'ft-Grnppe fand icli
dagegen nnr in St. Antônien nnd bei Andermatt.
Glossosoma Boltoni CuRT.
Fliilien, Barschwyl, Siickingen, liauflg.
Die Art ist nacli Meyer-DIir in der Scliweiz verbreitet.
Zeller fand sie in Bergïm nnd Ris im Tes si n. Sie lebt
auch im Schwarzwald (Me Lachlan, Ulmer, Tiiienemann,
und in den Vogesen (Tiiienemann).
Agapetus fuscipes CritT.
Bîirscliwyl, Silckingen, Imst (Tirol).
Eine verbreitete Art. Lebt nach Pictet im Jura. Meyer-
DIir fing .sie in der Nahe von Burgdorf; Me Lachlan,
Ulmer und Thienèmann kennen sie ans dem Schwarzwald;sie fehlt nach Tiiiene.mann auch den Vogesen niclit.
Die kleinen, ziemlich festen Gehause sind oft massenhaft auf
stark iibertluleten Steinen anzutreffen; sie gieichen im Baudenen der andern Rln/acopliiJiden.
Hydroptiliden.
Ptilocolepus granulatiis I'k.t.
Lugano: Imago, ;>. August IIHh;. (,)uellige Sicile ini Walunweit des Bâches, in dem ich Hclicopsyche fand.
— i)7
Eine ans Piiaiizcii bauciido l hergaiigst'orin zwisclK'n h'Iii/aco-
philiden iind HijdroptUuleii. Sic Icïbt iiacli Lautkrbornvorzugsweise im iïberfluteten odcr vom spi-ûlicndon A^^cllen-
scliaum feuchten Mooso. Icli faiid das Imago an einoi- Wald-quelie mit Beraca inaunis und einem unbostimmbaron Ilijdi'o-
jjsychewe'ihchen zusammen. Me Laciilan vei'mut(^t, dass dio
Larve am gleichen Oi'te wio C)'unoccla, HeUcoiist/che und
Adicella vorkommen miisse. Thienemann fand das Tiei- mit
Ct'imoecia und AdiccUa zusammen und icli kann die Ver-
mutung Mo Lachlans in Bezug auf Hdicopsijche bestatigen.
Stactobia Eatoniella Me. L.
Massenhaft an einem iïbertiuteten senkrechten Felsen in
Zermatt (1800-1850 m).
Von Eaton im Wall i s (V;i 1 d' Illiez) gefunden. Thiene-
mann sammelte das Tier im Tii'ol. Die verwandte FormSt. fuscïcornh kam Thienemann bei Gôschenen und an der
Furka, beim RhonegTetscher vor.
Die sehr kleinen Larven leben halb terrestriscli, nacli Thiene-
mann "hygropeti'iscli", an feuchten, mit Algen iiberzogenen
Felswànden. Sie be\\'ohnen 2,5-3 mm lange, ans Selilamm-
partikelclien aufgebaute Rôhren, sollen aber nach Eaton in der
Jugend frei leben. Die Puppen sind nacli Thienemannbesonders intéressant durcli den Mangel an Scliwimmbaaren.
Sie brauclien vor dem Ausseliliipfen nicbt ans Land zu
sc]i\\'immen, da sie unter keinen Umstanden im tieferen 'V\''asser
gedeihen.
Einige andei-e Formen, die aucli ol't livgropetriscli leben,
Stactobia fuscicornis, Beraea mau7'us imd Cr-imoecia i?'ro-
rata, sind gewissermassen im Begriff, die Schwimmhaare zu
verlieren. Bei der Landform Enoicyla pitsilla Burm. sind sie
spurlos A crloren gegangcn.
Oxyethira spec. (O. sagittifera llis.V).
Kaunsertal im Tirol; massenhaft in einem Baehe unter
Schnee (Miirz 1900).
Die Lai'ven dieseï- Gattung w;n'cii bis vor kurzem uur aus
stelienden (Icwiisscrn belvanul. LAri'i:i<i^.()KN' faud die Ihischen-
tormigen, olme Fremdkoi'per aurgebautcn Gehiiusc von O.njc-
— 98 —
thira Frici Klap. î" zuerst in raschfliessenden Gebirgsbachcn
des Pfàlzerwaldes.
16. DIPTERA.
Von den Diplci-cu, doren Larven die extremsten Anpassangs-
erscheinungen im ganzen Stamm dei' Insekten aufweisen,
durfton wir ancli erwarten, Vertreter unter der Bachfauna
anzutrefien. Es treten uns sowohl eclite Bacliformen entgegen,
die nur in bewegtem Elément zu existieren vermôgen, als auch
Ubiquisten, deren grosse Anpassungst'iihigkeit und Resistenz
gegen ungewolmte Bedingungen ilmen erlaubt, das Leben im
Tiimpel mit dem im Bach zu vertausclien.
Mit Ausnahme der Moosformen, die eigentlich mehr demWasserrand als dem eigentliclien Bach angehôren {Stratio-
myiden und Tipuliden), sind aile Larven Kiemen- oder Haut-
atmcr. Dies erklart sicli aus dem Sauerstotfreichtum des durch-
liii'tcten, bewegten Wassers. Ausserdem wàre ein Aufsteigen
zur (3berflache, wie wir das bei der luftatmenden Culex\?i.Y\&
beobachten, infolge der starken Stromung unmôglich. Unter
den eigentliclien Bacliformen felilen die Scliwimmer vollstandig.
An ruhigen und besonders an schlammigen Stellen tritt oft die
schwimmende Chirono7nusln.r\e auf, da und dort im Moos
sogar die nur durch Schwimmen sicli fortbewegende Cerato-
pogon\RV\e.
Die folgende Liste mag Aufschluss gebon iiber die Verbreitung
der Dipteren im Gcbirgsbach :
.1. LijxMieura b)'eriros/ri.s Ia)\\.
2. spec.
3. Sij/ufl/Hjj/ spec.
4. Chi?'Ouo)ji/is spec.
5. Cerdlopogoii spec.
G. Tauj/tarsus dires Johannskn.
7. Tdin/pu.s spec.
8. ]VuIpieIla spec.
9. Phalacrocera spec.
Im IVeien Bach oder
im iiberflntoten Moos.
— 99
zeln und Bliittern.
10. TipuUi hUescoiS Fahr.î'
11. •• qiqantea Schrank.î'i t ^
12. Pedicia rivosa L. \^"^ ^'''''^[ ^«^ Wiir-
13. A/^erw; spec.
14. Tabanus cordiger Meigen.
15. Oxyccra spec.]
16. Pericoma spec.'
y Hyg-ropotriscli.
17. Stratioînyide. )
1 . Bachformen.
1. Liponeura brevirostris Lr>\v.
Dièse merkwi'irdige, asselartige Larve kenne icli nur ans demHeidenwLilir bei Sackingen, von \vo sie Zschokke (168)
bereits gemeldet liât. In diesem stark bewegten Bach suclite
sie immer die wildesten Stellen auf, wo sich sonst kein einziges
Tier zu halten vermag. In ruhigerem Wasser spiirte icli ihr
vergebens nach. Die Larve trat ziierst Mitte Mai auf. Ende.Tuni waren die Pii[)pen hiiufig anzutretfen, die Larven nur sehr
sparlich; im Juli feldten ])eide, ebenso im August und imSeptembei'. Soweit sich auf diesen wenigen Notizen fussen
hisst, ist die Metamorpliose dièses Tieres in sehr kurzer Zeit
abgewickelt. Die Larven scheinen das Ei in vorgeschrittenem
Zustande zu verlassen und sehr rasch zu waclisen. Aucli die
Verpupi)ung scheint nur kurze Zeit zu dauern. Verkiirzung der
Zeit des Puppenzustandes sclieint auch bei der anderen typischen
Bergbachfliege, bei Simulhmi Platz zu greifen. Auch Phala-crocera hiilt sich nach Schmidt-Schwkdï nur wenige Tage in
der Puppenliidle auf.
Leider isi iiber die erste Eniwickehmg von LijioHeKra nocli
niclitsbekannt. Ich vermute jedoch, dass die Entwickehmg iin
Ei einen grossen Teil der Zeit der Gesanitent\\-ickelung in An-spruch niramt und dass das Ei iiberwintert, in weniger kalten
Bachen der Mittelgebii'ge mogiiclierweise aucli -iibersommert-.
Fur letztcres sprechen die Angaben \on De\mtz, der das Insekt
Mitte September in einem sehr schnelltliessenden Gebirgsbach
des Ockertales bei Goslar erbeutete. Er fand Larven, Puj)pen
und Lnagines zu gieiclier Zeit. Dièse entstamnitcn wolil t'incT
im Friilijahr abgelegten -Brut--, die den Sommer als Eier iiber-
— 100 —
(laiiei't halle luid deii ("hergang- von Larve und Piippe zum
Imago so i-ascli durchlicf, dass aile drci Metamorpliosesladien
lichen einander zu lin<len ^^a^(n.
ZsciioKKK hidi LipoiH'/f/y/ iïir ein (llacialrclikl. Fiii' dies(;
Ansieht sprieht die lange Eientwiid<Lehing, in iU^v his zu einem
gewissen Grade eine Parallelerscheinnng znr Viviparitat der
Hoehalpenticre, ^\rv Sfilfiuni mira (th-a, Lacerta rh'ipara etc.
Fi-. 1
.
Larve von Liponeura brerit'ostris Low
^
Fiy. 1. — Erwaclisene Lai've von oben.
« z. — » »
» 3. — Pupjie von oljen.
» 4. — » vou unten.
von unten.
erbliekt wei-dcn kann. Im Mittelgehirge scheinl das Insekt iiii
Hoehsommer vollkomnieii zu fehleii; Ende Juni veisehwindet es
ans dem Berghach von Siiekingen. Es seheint, dass die Ef-
wiinnuna" des Wassers, die «lerade heim Hcidenwulir ziemlieh
hedeutend wei'den kann (sielie die hetreffendcn .Messnngen aul
pag. 9), das Tier zu ciiici' raschen Ahwicdcelung drv Melamor-
pliose notigl.. Die ahgek'gten Eier iniissen cinc Uulieperiodc
durehmacheii, his ilnicn ginislige TeinjuM'aliii- ciue Weitei'-
entwickelung erlauht. Wcnii wir so der Tciiiperalur eine
— loi —
wiclitig(î RoUe bcimossen, so miïssen wir erwaiion, dass in don
Bachen mit constanter tiefer Temperatur die Larve jahraiis
jalirein lebqn kann. Wii'klicli kommt im Rliatikon eine Lipo-
nciira vor, dio sich regelrniissig- den ganzen Sommer in all(Mi
kalten, rasclifliossenden Biiclion dor Gegend von Partnunauf-flnden liess (Zsoiiokkk).
Es sclieint soniit oin ahnliclior Fall vorzuliogen wio bei Pla-
nafia alpind und PohjceUs coriinla, wo aiicli eine ursprùng-
licli nicht von den Jalireszeiten abhangende Fortpflanzung im
Mittelgebirge in einen regelmàssigen Jahrescyclus iiberging,
indem die WJirme d(^s Sommers die Ausbildung von Gescldechts-
organen ^er]linderte und so einen regelmiissigen W'eclisel von
asexneller und sexueller ForLpflanzungsperiode her\orripf. Hier
wie dort dauert dor urspriïnglicîie Zustand in den kalten Biichen
d(n' Hochgebirge weiter. Dieser Umstand scheint mir selu' fiir
die Annahme zu spreclien, Liponeura bj'rr/r'osh'is soi ein
Relikt ans der Glacialzeit.
Die Anpassung an das Leben im Bach findet ihren Ausdruckin einer liocligradigen Abtlachung der Baucliseite, die dem Steine
eng sich anlegt; auch die Riickenseite ist nur schwach gewôlbt.
Die ilintorleibssegmente sind liorizonlal etwas verbreitert und
mit Ausnahme der zwei k'izten scliarf von einander abu'esetzt.
Jedes Hinterleibssegment trjigt seitUch einen tasterartigen
Anliiingsel, ih'V an der Spitze (ùnige stcife Haare ardVeist
(fig. 8), sowie einen krallenf6rmig(m Anhang mit stark chitini-
sierter Spiize, der den Zweck liât, bei der Losliisung der zn
besprecliendcn Saugscheibe (tig. Il) mitzuwirken. Letztere ist
selu' t'ompliziert gebaut und bestelit ans einigen Chitinreifen, die
concentrisch angelegt und unter sich (huvh (dastische Cliitin-
liiiuie verbunden sind. Letztere werdcn diu'ch sehr feine
straldig angeordnete Chitinstiibe gestïitzt. Zwischen demzweiten und dritten Ring stelien in regehnassigen Zwischen-
raumen (3 Knopfe mit Borst(m, (Ue wold als Sinnesorgane das
Zusammenwirken von Krallen und Saugscheiben zu regehi
haben. Im Centrum setzen sicli selir starke Muskeln an, (huvli
welclie der Grund des Saugnapfes der Unterlage geniihert oder
davon entfernt werden kann.
Als echte Bachform atmet (he Lai'V(> (hu'cii Kiemen (Ue in
iln^?r Form an die BhUkiemen der Clilronomldeu erinnern
und aus einem Biiseliel von y\ 7 tîngerformigen Scliliiuchen
bestelien. DKwrrz bezeieluiet dièse Gebilde als Trachéen-
— 102 —
Fio- Fio-. 6.
/ ;k
Fio'. 9.
Fi- 10
fi'j. H.
Fit — Liponeui-a spec. (alpin) von olien erwachsene Larve.
— » » » von nnten >> »
— Segment von Liponeura spec.
— » » » breinrostris Low.— Kopf-von Liponeura spec.
— » » » brevirostris Low.— Saugscheibe der alpinen LiponeurcdàTve (stark vergrossert).
— 103 —
kiemen. Das Tier sclieint im Mittelgebirge ziemlicli stark
vertreten zu sein. Wierze.tski meldet es ans einem wiklen
Gebirgsbach der Hohen Tatra. Dewitz entdeckte einen
Fundort almlicher Natiir im Ockertal bei Goslar.Die in Simroths, -Enisteliung der Landtiere- abgebiklete
Dipte7^eni?œ\ii beziekt sich nacli einer l)riofli('hen ]\Iitteikmg
an Herrn Prof. Zschokke ebenfalls auf Lipoueiwa hrcvi-
7'ostris, die in den Bergbiicken Tkiiringens iind des Voigt-1 an des nickt selten ist.
Naek einei- biieflielien iMitteikuig Thienemanns kommteine Lipoiieurii\-Av\e bei Arollo 2000 m. liock vor. Icli bin
geneigt dièse kockalpine Form mit jener andern zii ^ereinigèn,
die im Rkàtikon und bei Parpan nack Zschokke kàiifig ist
und die ick diesen Sommer in mekreren Exempk^ren den F)àcken
der Umgebimg von Partnun entnakm.
Ick seke davon ab, an dieser S telle eine genaue Besckreibimg
der alpinen Liponeura zii geben, da ick koffe, im nacksten
Sommer ausgiebigeres Material zu sammeln und die genaue Be-
stimmung der Larve durcli Aufzuckt durckfiikren zu kônnen.
Immerliin mag kier eine kurze Diagnose der Larve — die
Puppe konnte ick nickt nacliweisen — ikren Platz fînden.
Kôrpergrôsse iUmlick wie Liponeura brevirostris.
Form : Etwas mekr zusammen gesckoben und abgeplatiet. Die
letzten Kôrpersegmente nickt so deutlick getrennt wie die drei
ersten (ick S[)reclie liiei' nur von den Segmenten des Abdomens)(fig. 5, 6).
Saugsckeiben im AVrkaltnis um ein Drittel grosser als bei
L. breriro.st)'is (fig. 7), die krallenartigen seitliclien Anlùinge
(R) viel starker entwickelt und braun cliitinisiert. Die --Taster-
(T) sind von langen steifen Haaren besetzt. Am Kopf(fig. 9) ist eine starkere Ckitinpanzerung zu constatieren.
Anstatt der kleinen punktfôrmigen Panzerplàttcken und Leisten
(fig. 10) der L. brevirostris findet sick kier eine grosse dunkel-
branngefarbte ausgebucktete Platte vor, die von feinen Porendurcksetzt wird.
Die Farbung ist nickt wie bei L. brerirostrts weisslick son-
dern sckiefergrau bis sckwiirzlick. Die Fiikler sind nur etwa
kalb so lang als bei der Vergleicksart.
104 —
2. Simulium.
VcM'schicdcno Spccics, <li<' kaum ocler nur sclii' unsichcr
bestimmt Avcrdcu koniitcn.
Aile Simiiliiunliiv\en sind vorziigiicli an das fliessende
Wasser angepasst; sie bewohnen mogliclist wilde Bâche. Von
der Temperatur des Wassers scheinen die Larven nur in gerin-
gem Maasse abliàngig zu sein, da ich sie fast in jedein rascli-
fliessenden Bacli anlraf, sogar — und dort als die einzigen tie-
risclien Bewolmer — in den directen Gletsclierabfliissen bei
Zermatt. ï'brigens liandelt es sich hier nur um gewisse Arten,
die sich von denen der Mittelgebirge durch verschiedene Merk-
male, besonders durch die Fàrbung, die Augenstellung luid die
Labiumbezahnung unterscheiden.
Da sicli jedoch die Arten niclit nach den Larven bestinnucn
lassen, und da ich zogere, die von Johannskn in -'Ncav York
State Muséum Bull.- 38 beschriebenen Simuliidenlarven Amc-
ricas, selbst wenn sie mit den unsrigen ziemlich geiiau iiberfùn-
stiramen, ohne weiteros zu identificieren, so muss ich midi
darauf beschriinken, die Gattung als solche zu l>etracliten.
Folgende Daten mogen die geringe Abh;uigigk(ùt der Lai'\ en
von der Jaln^eszeit beweisen.
IlATU.M
— 105 —
In Zermatt fand icli im Angust eine ungelieure Anzalil Simu-
lien in einom kleinen Abiluss eines Schnoefeldos mit oiner
^''assertemperatnr von 0,5" C.
Die Simuliumlarven besitzen eino gedrungene Korporgcstalt
.
i)n.<. Hintei-ende hat don bei den Chironomidén wohl cnt-
wickelten Sinmmelfuss niclit aufzuweisen; dagegen ist das vor-
dere Seheinfiisspaar gut ausgebildet und tràgi einen Kranz von
hakenfôrmig gekriimmten Borsten. Auch ara Hinterende ist
ein ahnlicher Kranz zu beobachten. Die Mundteile sind fiir die
Aiifnahme winziger organischer Bestandteile eingericlitet, ^vie
sie von der Strômnng mitgefiilirt ^^'erden. t'ber die Bewegung
der Sh)uUiuml({v\en mag im Kapitel id)er die Bewegung im
Bacli pag. 139 nachgelesen werden.
3. Chironomidén.
i'bei' die Larven der arienreichen CTru})pe der Zuckmiicken
wissen wir noch sehr wenig. Von den 220 europàischen Spe-
eies ist moines Wissens kanm oino in al Ion Motamorphose-
stadion bekanut und docli ist die Chironojji/islixi-yo eine der
hiiufigsten Erseheinungen des SiissNvassers.
Die meisten Arten goliôron wold dom stelienden oder lang-
samfliessenden Wasser an. Dagegen passen sioli mehrore
resistento Formen ancli dem ungowolmten Loben im Baohe an;
einige diirfen sogar der typisclien Baelifanna zngezahlt wordnn.
Wir lasson don lotztcren don ^'ortritt.
1. Tanytarsus dives .Iohannsex.
Bostimmung ziemlioli sioher.
Die Larve wurde in B;io]ion des Kliiitikon gefundon ; sie
stimmt fast genau mit dor von Zsciiokke in dor Tiofe dos
Viorwa Ids t ;i tto rsoos hiiufig aufget'undenen Taïujtdvsus-
larvo idier<'in, ()io ioli mit moinon Exemplaren vergleichen
konntc
^. Tanytarsus spec.
Selir naho \er\vandt odor idontisch mit dor amorikanisclion
Art Tdiii/tnysns exiguiis. Icli besitzo nur sehr wenigo
7
— 100 —
Exemplare ans einem Bach bei Zwingen (Jura). T(uujtarsus
ea-igiiKS Joiiannsen sclieint etwas kleiner zn sein. Intéressant
ist, dass clas Larvengehàuse dieser Bacliform mit einem Stiel an
die Unterlag-e flxiert ist. Fixation ist eine liiinfîge Baeh-
anpassung.
3. Ein Ghironomus mit sehr starken Retentionsliaken am
vordern und liintern Sclieinfusspaar.
Seine Bewegnng erinnert stark an die von Simidium,
er scheint ebenfalls Fiiden zn spinnen in denen er sicli
verankert.
leh mâche an dieser Stelle auf den amerikanischon (liirono-
mus /fa rus Johannsen aufmerksam, der ebenfalls stark be-
wegtes Wasser bevorzugt und bei dem Johannsen -prolegs
with numerous cnrved liairs and posterior pair with nume-
rous prominent bilobet liooks-, also ebenfalls vorzugiichf! Reten-
tionseinrichtungen beobachtete.
Andere Chironomiden fand ich hier nnd dort in Biichen Die
Larve von Chirouomns plumosus L. traf ich ziemlich regel-
miissig im Bach von Fliihen und Siickingen, wo sie ruhige
Stellen nnd nicht direct mit dem Bach in Verbindung siehende
Pfiitzen bexorzLigte.
Vereinzelt kamen mir auch Angeliih'ige der Gattungen
TanypuH nnd WuîjiicJhi vor Angen; dièse Lar\en scheinen
jedoch nnr znlTdlig in den Bacli ûberzng(dien und fanden sich
stets nur in wenigen Exemplarcn und nie an stark Ixnvegten
Stellen der lîiiche.
Im ïibertluteten Moos stellte sich nicht gar selten die scliwirn-
mende Ceratopogûnlarye ein.
Ûber die Verbreitung der einzelnen Arten lasst sich nichts
sagen. Wir stehen da auf einem nocli zu wenig bebauten
Boden und die Bestimmung nach den Larven bleibt untei- allen
Umstanden nnsichor, wenn es nicht gelingt die Tien- bis zum
Imago aufznziehen.
Ein Eindruck ergiebt sich aber ans der Beobachtung der
torrenticolen Chii'onomiden : Der ISach beherbergt zweierlei
Elemente : Edite Bachtiere nnd znfiillig in den lîach xcrschla-
gene, sonst das stehende Wasser belebende Chironomiden,
deren Anpassungsfahigkeit ihnen ermoglicht, im 15ach zu
leben.
Die Larven der Cliirouorniden stelkMi biologisch eine l'ber-
— 107 —
gangsstufo dar von den Bewolmern dos tVeien Bai'lios Lipo-
iieura, SinuU'non, etc., zu den Moos- imd Schlammlarven, die
fiinlie Betraehtung der Baelit'anna \\'enigei' wiclitig sind, dcnen
A\'ir aber o-leichwolil die i'olgenden Zeilen widiiu'ii ^\()ll('n.
1. Phalacrocera spec. (Tafel).
Ist an das Moos Fontinalis cmtipyretica gebunden. Ich fand
ein einziges Exem})lar dieser hôclist merkwùrdigen Larve in
einer kalten Quelle des Heidenwuhrgebietes bei Siickin-
gen. Doi't klammerte es sieli, iUinlich wie es nacli Lauter-
BoRN Phalacrocera repVicata tut, mit Hilfe zweier starker
Cliitinliaken an den Zweigen des umfiuteten Mooses l'est.
Die Larve ist besonders intéressant, weil sie einen geradezu
verbliiftenden Fall von Mimicrv darstellt. Ein unbefanffener
l>eobae]iter wiirde das Tier, wenn es sicli niclit bewegt, sclbst
untor der Lupe fiir einen Teil des Wassermooses lialten,
Ùber den Rûeken laufen zwei Reihen blattartiger Anliiuige,
die nach vorn hin gesiigt erscheinen. Dann l'olgen drei Grupi)en
von je z\\ei nalie bei einander stelienden und dann 6 Gi'uppen
\Qi\\ drei solclien Blattern, von denen das voi'derste immer das
kiirzeste, das hinterste das langste ist. Diu'cli dièse Anordnung
bilden die drei Blatter in ilirer Gesamnitlieit eine einlieitlielie
Grnpi)e, die in Grosse und Foi'm ung(^ta]ir(Mn('m Blatt von Fon-
l'niaJ'iH entsi)i'ielit.
Der Scliatten, den das Blait wirft ist durcli dnnkle're Fiir-
bung auf dem lielleren Griin des Larvenkorpers tauscliend nacli-
gealimt. Die Seiten tragen ebenfalls eine Reihe von blattartigen
Gebilden, walirend die Baucliseite eine doppelte Reihe kleiner
sehuppent'ôrmiger Blattchen zeigt. Durcli die starke Betonung
der Riieken- und der zwei Seitenreihen ci'gibt sicli (4ne Copie
der Dreizidiligkeit von Foiitinalh.
Die Farbc, ein saftiges Griin, stinnnt l)is in die iVinslcn Ab-
toninigon mitdci' der M'olni- und N;ihr})flanze iiberein. "Kopf--
und Hint(U'ende gleichen der PJialoo-occra reiilica.ta von der
ich durch die Freundlichkeit von Herrn Prof. D'' Lauterborneinige Vergleichsexemplare (M-ldclt. Die inii' vorliegende Larve
ist 1,1) cm lang. Die Liinge der linigslen Tracheenkiemen-
anhànge betragt 1 mm.Gegeniiber der von SciiAriDT-ScHWRDT, Miali, und Walker
— 108 —
und neuerdings von Lauïerborn beschriebenen Larve von
Phxdacrocera replicnta ergeben sicli folgonde Untersehicde:
Phalacroccra replicata. Phahicrocera spec.
Form der Trachéen- PtViemen- und Galieltbrni. Gesag-te Bliitter.
fortsatze :
Lange der Fortsatze: Maximum O.S cm. Max. 0.15 cm.
Bas Tiei' scheint wie Ph. repVicata zu iiberwinteni, da ieh
es Ende April bei 1000 m Hcibe ca. 14 Tage nach der Schnee-
schmelze fand.
Andere Tipuliden.
Am Randc der Bàclie, im iiberfluteten Moos und im Genist
von angesclnvemmten Wurzeln und Blaltern, kamen bi'uifig
weitere Tipnlidenlarven verscliiedener Gattungen vor.
Eine Larve, die ich in Zermatt, Lugano und im Jurafand, gehôrt wahrscheinlich zu Tïpula lutescens Fabr.
Eine andere, sehr dunkel gefarbto TipuIcàîvcxQ stammt aus
dem iiberfluteten Moose des Heidenwuhres bei Saclvingen.
Ebendort fand ich auch eine sehr grosse Tipulide (3,9 cm lang)
zwei wurmlormige Abliange am Analende weisen auf die Foi'm
Tij)ula gigantea Schrank, die nacli Braiser in Waldbiicben
unter Laub imd Steinen lebt.
Da und dort fand ich auch die Larven von Pedichi r-irosn
.
Das grossie Exemplar stammt aus dem Heidenwuhr, wo es
das iiberfiutete Moos bewoimte. Erwahnenswert ist, dass ich das
gleiche Tier aus dem Schlamm des Vierwaldstattersees herauf-
holte und zwar aus einer Tiefe von iiber 50 Metern . Ebendalier
stammen auch einige andere Bachlarven, eine A//? <^r/.r spec, eine
Perlide (wahrscJieinlicli ISemura niliihi) und eine Eplieme-
ride. Es darf wohl angenommen wcrdcn, dass dièse Tiere
bei Hochwasscr aus ilu'er Ileimat, den Iliiclicn Innuiiter-
geschwemml ANcrdcu. Môglicher\Màse traf dièse unfi'eiwillige
Versetzung sclion den Laicli, ^vi(' w'w iihnliclies fin* die Hôlden-
biiche be^^'ohnende Epliemcridcn, Perliden und Tricliopteren
anzunelimen lial)en. Lauterborn fand die Larv(^ in zusamnien-
gescliwemmtem Laub der Bâche und an snmpfig(|uelligen
Stellen des Buclienwaldes ziemlicli liaufig. Zsciiokke kennt
— 109 —
(las Iiisekt ans deiii Rliatikon, wu (;s die Einmuiulungsstellen
der Baelie in dio Seen bevorzugt.
Almliclios gilt tïir A/heriœ spec, die icli ans Sackingeniind Bellcdav kemie. Dièse Larven stimmen genau mit der in
••Aiiuatic Inseots in New York State- (1903) Plate 10,fig. 1, ab-
gebildcten "Larva of an unknown Lejjtid'^ idjerein, wie auch
Lautkrhorn bemerkt (43), der in Moosrasen raschfliessender
Gebirgsbache kleine, im Gegensatz zn nieinen Funden braun-
gef;irhte .l///(';v".rlarven sanimelte. Zschokkk meldet Afhcrioc
spec. ans einigen Biiclien des Rhiitikon.
Ttfhf/jiiis cordujer Meigp:n befindet sich ebeni'alis nnter
nieinem Material. Die Larve ^\nrde einem Baeb bei Slvoft'ie in
Istrien entnomnien, in dem -àxn^li- Planai'id ((Ijnna, das
typisc'hste Dacbtier, Aorkommt. • Lautp]Rborn fand die Art ini
Sande des Rehbacbes bei Nenliofen. Wenn icb mich recbt
ei'innere, war auch der Bach bei Skoi'i'ic stark sandig.
Aile hier behandelten acephalen Larven mit Ausnalune der
Plialacrocera bewohnen Moos und Genist von Wurzeln undBhittern sowie Scdnvemmsand. Dort leben sie in Huhlen undGàngen. Ihre Gestalt ist demnaeh \\'nrm- bis wursttormig. Die
Tip/i/a-àvien besitzen gar keine Fortsatze. Pedicia zeigt vomviertletzten bis zum zweiiletzien Hinterleibsring zapfenartige
Vorspriinge. A/Jie}-i,v liât ani' der Bauchseite jedes Ringes ein
stunnnelfnssahnliclies mit Hakenkranz bewehrtes Paar vonForLsJitzen. Boi Tabroius endlich erheben sicJi dièse Schein-
tïisse nicht nur anf der Bauchseite sondern auch an den Seiten
und am Riicken.
Fine weitere Gi-up[)e von I)ii)teren le[)t in den Algenuber-
ziigen fenchter oder schwach iiberftuteter Felsen '- hygro-peti'tsch ". TiiiENEMANN, der den Namen znerst brandit,
nennt mehrere Vertreter dieser Fauna. Neben einigen Tri-
choptei-enlarven, besonders der H_v(h'0[)iilide Stctctohia cato-
nieJla, tritt regelmassig die Strationnide O.cijcera spec.
auf. Icli traf beide Larven in Zermatt an einer iduM'fluteten
Felswand. Gft werden die zwei wichtigsten Vertreter der \\y-
gropetrischen Fauna noch \o\\ einer andern Stratilmvide be-
gleitet, die sich durcli sLarke Behaarung des Korpers ans-
zeichnet, sowie von einer Psycliodide die den Stratiomyiden
ziemlich iiinilich sieht. Sie triigt am Hinterende vier blattartige
Anhinige, die am Rande kammartig diclit mit gefiederten lan-
gen lîorsten verselien sind, und cinen shnnpl'cn Stacliel, an des-
— un —
sen Ende mehrere lange, steife Borslcn slelieii. AnidruncU'
dièses Stachels fînden sich 1-6 fingeriormige KiemcnaidiJingv.
Das vierte imd das limite Segment des Kcirpers tragen je einen
sehr kurzen Vorsprimg mit kammarlig in die L;inge gezogenem
Hakenbesatz. Dièse Stummelfùssen vergleichbaren Organe wïr-
ken analog den Kletlerkrallen der Stratiomvi<len. Das 8ie und
das 9te Segment zeigen ventral eine Art Saugscheibe, die dui'cli
einen Kranz leinerHaken begrenzt\\ird. Jede Scheibe ist schein-
bardoppelt. Der ganze Apparat erinnert an die von Ulmkk (128j
beschriebene Dipterenlarve (ïafel I, fîg. 9). In der Lebens-
weise gleicbt die soeben gekennzeiclmete Psjeliodide (àvi/-
cera ; icli land sie an lencliten Felsen in der Umg(d)vmg von
Lugano, Zermatt und Faido. Die Larve gleicbt der von Miall
und Walkkr als Pericoma canescn/s b(>scbrie!)enen. Viel-
leiclit liandelt es sicli um eine Art derselben Gattung. Icb botte
spater eine genaue Bes('breibmig der Metamorpliose g(d)en zu
kônnen. An dieser Stelle mag die kni'ze Kennzcicbnung der
Bacb merkmale geniigen.
Thienemann land, wieer mir bi'icttirh uiitteilt, am 20. Juli 04
an leucliter Felswand bei (losclienen (1129 m Holie) neben
andern, der bvgropetriscben Fauna angeborenden Larven, aucli
Psycliodideii. Icb vermute, dass es sicb um das gleicbe Tier
bandelt, das mir vorlag.
Lauterhorn sammelte im modernden Laub und in den leucb-
ten und iiberttutelen Moosrasen verscldcdener Bergbiicbe eine
Psychodide, die er liir Pcricoiiui si)ec. liidt. Seine Larven
liingen oit uacb Art der Stratiomviden an der Obei'Hiiclie des
Wassers.
An dieser Stelle dïirlen aucb die brasilianiscben Psvcliodiden
MiiLLERS niclit unerwiibnt bleiben, die in Form und Lebens-
weise auftallend an Liponeura erinnern. Eine Reibe von
baucbstiindigen Saugsclieiben dient aucli bier zur Fixation mid
Lokomotion im starkttiessenden Bacb. Abliachung und Keten-
tionsbaken v(irvollst;»udigeu das P)ild des typiscben Bacb-
bewobners. Eine Besclu-eibung und Abbildung dieser Larven ist
zu finden in -Trans ol ibe entom. Soc. London-, 1895.
Die von Flmer: "l'ber die Anpassung einiger \\'asserlar\ en
an das Leben in tliessenden Gew;issern«, pag. 20, bcsclnûeljene
Larve diirl'te wold selir nalie mit den brasilianisclien Art en
verwandt sein. Aucb meine Pericom(iï\\\\\\\v\\e Form diirllc in
ibre Nalie gcboren.
17. PLANIPExNNIA.
Ein regclmjissiges Mitglied der Ijaclit'auna, das icli als Imago
imd als Larve in uiid an dcn IJcrgbiiclien von I^'liilien,
Sackingen, Biirscliwvl und Rcllelav fand, ist
Osmylus maculatus Faiîu.
Das Insckl- ist fast iilter ganz Enropa vorbi'citct nnd Miegt an
kiilden Biichon. Die Larvon hîlxMi nnt(n' den Steinen am Vïev
dcr Biiclie; sie sind langiicli-spindelfôrmig gebaut und zeigen
keine bemorkenswoi'ton Bachanpassungen.
. 18. COLEOPTP]RA.
Fin" die Schwiinmkii fer sind die vom Bach gebotenen
Lebensbedingnngen keine giinstigen. Bei starker Stromung
ist scbwimmende Bewegungsweise unmciglieh, und docli sind
dièse Kàt'er gezwungen, in^ relativ kurzen Zeitintervallen, zum
Luftscliopfen an die \\''asseroberfl;iche zu steigen. Wenn ich
trotzdein da und dort Ange]K)rige dieser Insektengruppe fand,
so erkliirt sicb das ans der Eigenschaft der Bergbâche, unter
Wasserstûrzen Auswaschl)eeken zu bilden, in denen das Wasser
relativ rubig ist. Das Vorkommen ^on Scliwinimkafern an
solcben Orten muss niclil (hu'cli active Wanderung im Ijacli
erkliirt werden; die meisten Kafer besitzen die Fiihigkeit,
fliegend von Tiimpel zu Tiimpel zu gelangen und andere, denen
dies niclit so leicbt nuiglicdi ist, konnen docb lang<' Zeit ausser-
halb des Wassers leben und so durcli Vôgel gelegentlicli wi(Hler
in ein giinstiges Médium versL'lilei)i)t werden.
Die SclnvimmkJiferfauna dvi- Biicbe ist also nicbt ans typiscben
Bachformen mit l)esonderen Anpassungen an das fliessende
Wasser zusammengesetzt. Si(ï umfasst eine Anzald Formen,
die der Zul'all in die Biiclie gefiibrl bat, und die lum eine Zeitlang
(lie ungewolmten Bedingungen im IJacli ausbalten, bis sie wieder
wegfliegen, fortgesi)i"dt werden oder zu (Irunde geben. Manebe
scbeint jedocb die tiefe Temi)eratur der Biicbe anzuzieben.
Dies sind meisi Tiere mit alpiiier uiid iiurdliclicr A'erbrfiluiig,
wie
1. H;/(h-()j)nrH.s itiralis Heer
2. HeU'porus glacudls Villa
o. Agabn.s covgeue)' Payk.
uiid andere. Sie kommen teils erst im erwacliseiien Ziislaiid,
hie und da sclion als Larven iii den Baclien vor (Zsciiokke :
Biiche des Rliiitikon).
Icli gebe l'olgciide Liste voji Baclifuiideii (1):
N AM E FUNDORT
Hydroporus nigrolineatus Steven .
» halensis Sturm
» nivalis Heer
» nigritaHeer(Zschol\ke)
» spec. Larven (Zschokke)
Dytisciclenlarve (Zschokke)
Agabus congener Payk
Noteras sparsus Mis
Heleporus glacialis Villa
Anacaena limbata F
Laccobius minutus !
Limnebius spec
Hydrobius limbatus Fabr
Dvtiscidenlarveii
liach bei Riirschwyl (Jura)
» amCIturerjoch (iraubùnden
Hiiche am Cavelljocb
)) im Rhiitikoii
Hauptzufluss des liuiersees
Bergbach bei Lugano
» » Bellelay (Jura)
Siickingeii (Schwarzwald)Imstund Iniisbruck (Tirol)
Kaunserlal (Tirol)
Skoflie (Istrieii)
Kaunserlal (Tirol)
Lugano
Timavo (Karst)
Eiiie andere Stellung als die Sclnvimmkiii'er, die bloss als
zutallige Gaste aufzufassen sind, nehmen die Kletterkafer im
(1) Icli verwende die Nomenclatur von Favhe: ..Faune des Coléoptères du
Valais-' (Xeue Denkscliriften d. allg. Schweiz. Ges. 1". d. ges. Naturwissen-
schaften, Bd. XXXI, 1890).
— li:^ -
Bacli ciii. Uiiter iliiicn giebt os einige fiir die IJacIil'aïuia
Ivpischo Gattungen, deren Arien meist kloin sind iind an dcn
Beinen fine vorziiglielie Ki'allenbewaflniing zeigen. Ilir Anf-
enlhalsoi'l sind die iiherflutelen Moosrasen. EhjNSàvivn l'and
ieli liic nnd da aneli untei' Ul'ei'sleinen.
Die Famille der Parnlden nnifasst elne ganze Anzalil
Gattungen des fllessenden \^^assers. Potamoj^h'dus, Eimis,
Limnius, Stenelmis l'ehlen dem stehenden Wasser fast voll-
standlg. Anch Parmis ist meist in Biiehen und Fliissen zu
finden.
Dlesen Lebensbedingungen enlspreeliend sind die Veii.retei-
der Famille der Parnlden mit autfallend grossen Klanen
ausgeriistet, die ilmen zinn Klettern Ira Moos nnd zur Rétention
im fllessenden Baelie dienen. Die H vdropliillden-Gattung
Hijih'aena, die mit den Parnlden Aufenthaltsort und Lebens-
weise gemelnsam bat, besltzt zwei gut entwickeite Klauen, die
an elnem bewegllcben, sehr langen letzten Tarsengiled eln-
gelenkt sind, und meln-ere Dolcliborsten, wolil mit Retentlons-
funktlon, an den Tlblen.
Mein Verzeiehnis torrentleoler Klettei'kàfer welst folgende
Arien auf:
1. Hi/dracna fjracilis Germ."2. •• angnstdtd
.
3. •• spee.
4. Parnus aaricidatus III.
5. Lhnnius tuherculatus Mïill.
(3. Elmis Gernmri Erichs.
7. •• aeneus Mull.cS. •• MaïKjetii MCill.
*,». •• sudalis Erichs.
Hydraena gracilis Germ.
Isl mir ans S;iekingen bekanni, \vo si(> reclit liàufig im Moosdes He 1 den wu lires zu linden ist. Favre meldet sle aus
Lausanne und Cosso na v, woer sle lue und da in Biielien antraf.
Hydraena ang'ustata.
Wcnigv Exemplaivdicscr Art slammcn aus dem Moos ciiics
Brunneiis bel Zci-ma II.
114
Hydraena spec,
(leren Bcstimmung mislang, lebte mit g)-//cifi.s ziisainnit-n in
einem Baclic des Risanotales in Istrien.
Parnus auriculatus lu..
ist im Hoidcnwnhr Ihù Sackingcn nichi selten zii ti-cliVn.
Favre nonnl mehivrc Fundorte im \A'allis, P)UGNI()X in dor
Gegend vom Gcnfersee.
Lîmnius tuberculatus Mûll.
kenne idi ans Bellelay im Jura, dcxdi schcinl das Tier redit
selien zn sein.
Elmis Germari Erichs.
Das einzige, Exemplar (^nlstammt einem Bergbacli bei
Lngano. Favre fand die Art bei Domodossoia unter den
Steinen eines Bergbacdies.
Elmis aeneus Mûll.
Dièse weit ^('l•bl•eitete AiM traf ich im ganzen Gebi(>t reehl
hàufig an. Ich nenne folgende Fundorte: Schwai'zwald :
Sàckingen, Welir, Hasel; Jura: Fii'ihen, Barsclnvyl,
Bellelay, Brassus etc.; Alpen : Lngano, Partnun,
St. Antônien; Kai'st : Timavo, Skoffie.
Bemei'kenswei't scheint mir das snbterrane Vorkommen Aon
/::'. aeneus im Bach der Haslerhohle. Es handelt sich wohl
wie bei den andern B)ew()lniern dièses Hôhlenbaches um Ver-
schwemnnmg ans den ol)erirdisc]ien Quellen.
Elmis Maugetii MiiLL.
Wui'de im Tima\o, dem AnsHuss des unterirdischen
KarslHusses Reka, bei San Giovanni gesammelt.
115
Elmis sodalis FIriciis.
Eiiiii^o Exrmi)lar(> onislammcn (l(>r Orbcqucllc hoi \:\\-
loi'lx's und (>ineiii Baclie des Cassa rat inalcs nordiicli von
Lu!4aiio.
Die (ialtiiiig Ochthchius Leacii, die cbfMd'alls ini IJacli un ter
Steinen lebt, ist mir unbekannt. Fayre kennt zwei Arteii:
0. (innnihihis Mues, und (). pi/ynuteus F.
Auf eine sein- intei'essante Gi'uppe von Kiifei'n )iiaelil uns
Favre in seineni \A'erke: --Fanne des Coléoptères (bi Valais (>t
des régions limitrophes-, p. :VZ, aufni(M'ksani. Es sind Land-
kiifer, die in unmittelbarer Nahe der Piaclie oder unter li'ockcn
gelegten Ufersteinen, z. T. aueli unter tief eingegrabenen Fels-
blôcken leben. Die Zald dieser Bewohner der BacbniUie ist
zienilieli l)etr;ielitlieh. Nielit \\'enige davon gelioren zu den
tvpiselicn Alpenfornien und kehren regelmassig an allen Bachenin derselbrn Zusammensetzung ^^•ieder.
leh nenn(>:
1. BenihiiliiDii fascioIdfuiK Duft.
2. ftl)}(iJe Duft.
o. (jeiiiculatum Heer sive alpinum Dej.
4. • conforme De.t.
5. • cotnplauatum Heer.
(). Siej/Hs (jldcidUs Heer.
7. Nebrla picicornis F.
8. î» Jochischii Sturm.
9. Pac(/c)'((s lo)igicoriiis Aube = l'i/fico/iis F. var.
sanguinicoUis Stepii. ete. etc.
Wahrselieinlicli ist es die kiildc^ Teniperatur der Bachnidie,
di<' dièse Kal'er vei-anlasst, ibren Wolmsiiz dort aufzuscblagen,
idinlicji wie aueli die Xidie \on Sebneefeldcrn und Glelseliern
eine Anzabl KJifer anzielil.
Kâferlarven
Unter meinen Material beflnden sicli eine Anzald Kiderlarven,
dei'en Bestimmung bei der mangelliaften Kenntnis d(s Zu-
sammenlianges zwisclien Larve und Dnago nieist nielil ni()g-
lieb ist.
Ulmer fand im Bach die Larveii •cinigt'r KaiVr-; ci' nennt
die Gattungen Ci/phon iind Elmis. Auf Zschokke's Liste
torrenticolei- Insektenlarven dos Rhalikon figurieren: Cyphonspoc, Lai'V(> ans dem ganzon Gt'biet dcr Su Iz fin h, und Larven
^ on D y t i s e- i d e n da und doi't im K h ;t t i le ( ) n
.
leli selbst fand Cyphonhwxan ziemlieli i-cgelmilssig widu'end
des ganzen Sommei's. So im Jura: Fliilien, ()rb(M|nelle
bei Valloi'bes, Bellelay; bei Saekingen und ^^'<'ll^ im
Sehwarzwald. Die Imagines der Galtung Cyphon besuclien
die Pflanzen des Ufers von Tiimpeln und IJiielien. Fayke zalill
fiïr sein Gebiet sieben Arien. \on denen Cyplnui Pad't L. dii'
liauflgste ist. Die Larven ieben vorzugsweise an d(Mi Sieinen in
der NîUie des Ufei-s, di(^ \om ^\''asser gerade nocli iiberspiilt
werden. Sie fallen durcli iln-e starke dorsoventrale Abplatlung
auf und selnniegen sieli den Steinen sehr eng an.
Ans verscliiedenen Orten im Jura stannnt auch eine Par-
nidenlarve, von der ieli Nci'uudc, dass sie zu Elmh geliort.
19. MOLLUSCA.
Die MoUusken geniessen im BacJi ziemlieh starke Ver-
tretung. Mehrei-e Arten diiri'en zui' eigentlichen Dacld'auna
gezàhlt werden und treten regelmassig und liiiutig auf. Andere
werden nielir zufallig torrenticol, walu'end ilire g('\\(')hnliehe
Heimat das stchonde und langsamfliessende Wasseï' ist
.
Einige sind ausgesproehene Quellfornien, die an sehr kaltes
Bachwasser gebunden zu sein sclieinen. Eine der inir ^•orliegen-
den Arien bewohnt a orzugs^^'eise Hohlenbiielie und fehlt der
Oberwelt. Die meisten suehen im Baeli ruliige Stellcn auf und
lialten sich mit Yorliebe in den Aus\vaschl)ecken unter d(Mi
Wasserstiirzen, auf scbwaeh iiberfluteien Steinen und der-
gleichen auf. Da pflanzlielu^ Nahrung im Bach oft spiirlich ist,
bilden mehrere Arien torrenticole Hungerformen ans.
Ich stelle im Folyendtni meine Funde in einer Liste zu-
sannnen
1. L'iiHiuiea jjdliisiris Mi'ill.
2. •• nrald Drp., forma typica
.
'.]. " \ar. fontindlis Studer.
•4. • •• vai'. ohliisd K(iHi:i;r.
5. Lïmanea ovata var. succinea Nils. od. hnlthica L
6. •• ppyegra MiiLL. f. t.
7. « -r \ar cv^r/'r/. Cless.
8. •• truncataln Mi'ill.
U. Pltuioi-his coutortus L.
10. AHcijhis ff/n'ifff/lis Mûll.
11. •• cffjjuJoides ^AN.
12. Bythuiella (ilta Cless.
13. » ahhremata Mich.
14. •• Dunkeri Frauenfeld.
15. Vitrella kelvet/ica Cless.
IG. LithogJyphus fluiniuensis Sadler.
17. Neritina fiumatiUs L.
1 <S . T 7/ / rr/Yrt p isci i ia lis MiiLL
.
19. Pisidhitn oraliDU Cless.
A. Gasteropoda.
Limnaea palustris MiiLL.
Saut (lu Doubs.
Dièse Art geliort sielioi' niclil zur Baclifaima. Ilir ^^or-
komnion im Saut du Doubs imiss durcli Vei'schwommung aus
deni lac d«'s l'i-ciicls, ciuer seeartigen Erweiterung des
Doubs, erkliirt werden. Icli fand an derselben Slelle nocli
mehreiv Arten, die soiist nur ini stehenden Wasser zu Hause
sind
.
Limnaea ovata Drap.
lebt nachCLESsiNiiurin steliendem uiid sehr langsani tiiessendeni
Wasser. Icli fand sie da und doi't aueh in i-nsclirtiessenden
Bàclien Da die Art in sehr weiten Grenzen variiert isl es sehr
schwieing, einzelne Forraen als Varietiilen auszuscheiden.
ExemplaiT, die sich dem Tjpus niihern, fand ich regeliniissig
im Bergbaeh von Fli'ihen und ausserd<'ni ini Kaunserial bei
Feuchten (Tirol).
In die NiUie von var o/d/fstf Koi^elt, die ini Ni'uenburger-
see zu Hause ist, muss eine Forni voni Saut du Doubs
— 118 —
gestellt werden; (1er var. fontinalis Studer iilinolt oin anderes
Exemplai' von deinselben Fundort.
Eine Sclmecke ans dem Karsi (Bach bei Dolina, Istrion)
stellt einen Ubergang zwisclien var. ancciiiea Nilson und bal-
thica L. vor; sie zeigt sogar Verwandseliaft mit LimnaeaIteregra var. curta Cless.
Limaaea peregra Mûll.
Eine grôssere Anzald dieser Fornienreihe angehôrendtM' und
sicli dem Tvpns niUiernder Exemplare samnielte icli im Kai-st
beiSkoffie, Dolina und San Giovanni (Timavo).
Brockmeier liait Limnaea peregrœ t'iir eine Hungei-rorni
von Limnaea ovata. Er glaubt, dass sicli Ûbergangsl'ormen
leiclit auffinden lassen dïu'ften. Wii'klicli zeigt ein Geliause von
Dolina Charactere beider Arten (sielie oben). Die Liinnaeen
sind ausseroitlentlich variabel je nacli (1er Nalur des Fnndortes,
Kalkgelialt des Wassers, Ptlanzenwuclis etc.
Limnaea truncatula Miu.L.
Dièse Art wii'd von Brockmeikk als eine Kiiininerrorni von
L. jifiJiisiris Mi'iLLER angeselicn. Die Geliiiuse d<'r Arten
glcielien sieli selir, so dnss es niclil scinver fallen di'u't'le, dnreli
Auswahl geeigneler Exemplare eine Verbindungsserie zwisclien
den beiden Extremen aufzasielleu. Ijimnaea ifinicalnla. ist
im AUgemeinen kleimn' und besitzt eine liellere, zerbreclilicliere
Scliale und gewôlbtere Umgange. Sie vertiitt naeli Brock-
meier Limnaea palantris an ungimstigen Orlen, in leiclit
ausli-ocknenden Griiben, in Baclu-n und (^)u('llen,im Noi'den und
im Hochgebirg.
Icli bin in der Lage, eine ganze Anzald Fundorte in I);iclien
des Schwarzwaldes, der Alpen und des Jura anziit'iiliren.
Leider bestand meine Beute meist nur aus wenigen Plxemplaren.
Icli sebe eine Ûbersicht i'ibt>r die Fiindoi'tc und iilier die
Grossenverliiiltnisse. Es wunlcn nur crwncliscne Exemidare
geinessen.
I. Schwai'zwald: Welii', Hascl, Siickingeii, Inz-
lingen: _Maximaigrosse . . . 5,2 mm.Minimum 3,2 mm.
— 119 —
Jura : Fliilien, Mariastein, Gelterkindon , SaiU du
Doul)S.
Maximum . . . 5.5
Miuimum . . . 3.2
Alpen : Zermatt, Findeln, Richai'dsquelle bei
Innsbruck.
Maximum ... 5
Minimum ... 3.1
Die im Schwarzwald und in Zermatt gesammelten
Exemplare waren viel dunkler gctarbt und neigten zu starker
Auftreibung der A\^indungen (hauptsachlich der letzton),
nàherten sich also dei- Variation ventricosa Moq-Tand. Dièse
Eigentiimliclikeiten sind vielleicht eine Folge des kalkarmen
Wassers, in denen icli die Tiere sammelte.
Aile meine Exemplare bleiben bedeutend liinter der von
Clessin alsMittel angegebenen Liinge zuriick. Manche orreiclien
nicht einmal das Clessin'scIic Minimum von 3,5 mm. Dieser
Befund deckt sich mil den Angaben Zschokkes iib(>i- die
Grôssen der im Rhiitikon gesammelten Limnaeen ; nur sind
meine ausschliesslich in raschfliessenden, steinigen Riichen ge-
sammelten Exemplare verhidtnismiissig noch kleiner als die
Rhiitikonlimnaeen, die zum Teil auch aus Tiimpeln, Seen
und R)runn('n stannnen. Auch Zschokke fand hiiuflg Formen,
die an die A'ariation ventricosa erinnerten.
Wenn wir mit Brockmeier annehmen, dass Liuuiacd pa-
/«s/;7"s, die sich durch wenig gewolbte Umgange auszeiclmet,
bei ungiinstigen Lebensbedingungen sich der gewôlbteren
triuwatula naliert, so ist die stark gewolbte var. ventricosa
als eine extrême Endform in der Umbildungsreihe anzusehen.
Zur Ausbildung solcher Abweichungen sind auch extrême Re-
dingungen notig, wie sie vor allem im Sturzbach der Hochali)en
gegeben sind. Autiallend ist dass die bauchige Auftreibung der
Windungen (hauptsiichlich der letzten) nur im kalkarmen
Wasser des Schwarzwaldes und der Walliser-A Ipen
vorkam, wahrend die Gehàuse aus den Jurabjichen keine
Abweichungen zeigten. Wir werdcn auch bei AifCj/lus sehen,
dass Kalkarmut die Variation begiinstigt
.
— 120 —
Planorbis contortus 1>.
im Saut du Doults, innss durcli zutVdlige Versclnv(Miîmung
ausdemLac des Brenots erklart wcrdon.
Ancylus fluviatilis jMûi.l.
Sein- liiiuflg und regeliiiiissig, vorziiglicli in starken Bachen.
Da die Formen an ein und demselben Fundort stai'k variieren,
sah icli davon ab sie nach Varietaten zu sondera.
An Fundorten waren namliaft zu maelien :
1. Sclnvarzwald : Sackingen,Welii\ Inzlingcn, Hasél;
2. Jura : F liihen, Rellelay;
.3. Alpen : Bayrisclie Alpen, Flircnborgci' Klause.
Auffallen<l ist das Vorkommen von Aiici/Ius in dcr Hasler-
hôhle. Aucli Wiedersheim fand die Ai't ^^ubierran in H()hlen
des W il riem berger Jura.
Folffende Tabellen môgen Aufsebbiss geben iiber dio «rossen
A'eriinderungen, welelie die Art an ein und demselben Fundort
durchmacben kann. Icli mass von zwei Fundor(en aHe unge-
talu" gleich gross<'n Indivicbien und beujiibte nncli, nur er-
waebsene ExempLare auszidesen, da die Ilobe mit dcm Alter
zi(Mnlie]i slark variiert.
i\B>. — DicMaasse sind in ijuii. zu \('rst('ben.
A. Bergbach von Sâckingen (Sch-warzAvald)
— 122 —
Hôhe von 3.2 mm). Dièse mittlere Holie Clessins ist bei
meinen Exemplaren eineMaximalhohe; derDurclisclmitt betriigt
im Jura mid im Scliwarzwal d nur 1.*.» inin, das Minimum
sogar 1.4 nun.
Daraus wiii-ezu folgern, dass sicli im Bach der Niedemngen
und im Gebiet der grôsseren Fliisse, wo Clessin seine Exem-
plare liauptsachlicli sammeite, Ancijlus fiaviat'dis weniger
abfiaclit als in denen des Gebirges. Es bestelit somit ein
Zusammenliang zwisclien Stromgeschwindigkeit und Ab-
flacrmne-. Im scdmell fliessenden Wasser flacht sicli die Sciniecke
stàrker ab als im langsam fliessenden. Dies braclite micli auf
den Gedanken, ob nidit der Ort, wo das lier lebt, d. h. die
SUirke der dort lierrselienden Slrômung, die Grosse der
Abflacliung bedingt ; ob niclit die flaelieren Exemplare auf (km
stark iiberfluteten Steinen leben, wahrend die gewôlbteren aus
(km ruhio-eren Stellen des Baelies aus den Auswaschbeckeii der
Wasserstiirze stammen. Da sich die Napt'sclmecken nui- sehr
lane'sam beweuen und die meiste Zeit iUmlicdi wie die Planarien
in einem schlafidnilidien Zustand verharren und wohl kaum
grôssere Wanderungen unternelunen, kanii man sclion von
einer Stromungsstiirkc» rcden, in der das Tici' autViichsI. Ich
habe mich b(Mnïdit, die Frage dureli dii-ektc Ik'obachiuug zu
losen, in dem ich die au l'iddgen Stellen gesammelten Selinecken
absonderte und udt denen aus starlcer Str()mung vcrglich.
Wirklicb selieint sicli meine Vermutung zu bestiiligen ; ich wage
jedoch noch nicht, ein abschliessendes Urteil abzugeben, bis
ich mit einer grossen Zalilenreihe die Saclic zu beweisen im
Stande bin.
Ancylus capuloides Jan.
Einzelne Exemplare aus dem starkbewegten Bach vonFliihen.
Dièse Art ist bis j(dzt nur aus dem stehenden Wasser bekannt.
Als Fundorte werden von Clessin und Geyer Schweizerseen
sowieder Garda-, Starnberger- und Chiemsec angegeben.
Das Tier belebt nach Sukbeck vorzugsweise die I^erzone an
Orten, wo ziendich lieftiger Wellenschlag shittfindet. Ans
dieser Vorliobe fiir bewegtes Wasser, die sich am TTcr des
Vierwaldstattersees leicht nachweisen lasst, erklart sich
wohl das Vordringen in den Bach. Die Diuiensionen stiunnen
gut mit den von Clessln angegebenen iiberein. Die Tiere sind
— 123 -
vel-ài'iY hoher ixh AiicfjlKS /fiii'iafilis imd zeichnen sicli durcli
eine rein eifôrmige Mûndung der Scliale ans, wiUirend fiuina-
tilis eine naeli voi' vei'breitorte Mtindnng auiVeist. Ùbrigens
lassen sieli, soviel sicli nacli meinem sparlichen Matcrial benr-
teilen lasst, ancli hier Briicken flnden, die fiir beide Fornien
gemeinsamen Ursprnng wahrsclieinlich machen (siehe z. B.
var. gibbosmn Bourg.).
Bythinella alta Gless.,
eine Qneilenform, ist naeli Clessin anf das nordliche Tirol und
die angrenzenden Gebiete bescln-anki. Ich fand meln-ere Exem-
plare in einem Bach am Fernipass nahe bei d<>r Ehrenberger
K la Lise bei Rente (Nord ci roi).
Bythinella abbreviata Michaud.
In der Lt'bi'iisweise, Gi'ôsse nnd Form \\'enig von der vorigen
Art nnterschieden. Ich fand ein einziges Exeniplar dieser nach
Clessin auf die westliche Sclnveiz beschrindcten Art in cincr
Waldqnelle bei Wehr (siid-westlicher Schwarzwald).
Bythinella Dunkeri v. Frauenkeld.
Die Art koiniiit sclir rcgelniiissig in den kleinen Waldqucllcn
des Heidenwnhrgebietes (siidl. Schwarzwald) vor.
Lautekborn kennt das Tier aus niehreren Walcbjnellen des
Pfidzer waldes. Die Laichablage fîndet nach ihni ini Februar
statt (1). Dieser Umstand (Vermeln-ung wiihrend dev kalten
Jahreszeit) verbunden mit der Vorliebe fiir kalte Quellbache,
fiihren ilni zur Vermutung, Bythitiella Dunkeri sei ein
Glacialrelikt. Dasselbe durfte wahrscheinlich anch fiir die andern
Bvtliinellen seine Gellung haben. Ihr ausschliessliches
Vorkonnncn in Quellcn und kalten Biiclien und uiehr noch ihre
ôrtlich beschriinkte Verbreitnng — nach v. Fkai'ENFeld und
Clessin sind aile Bythinellen durch wenig umfangreiche,
inselartigc A^M'brcilungsbezirke ausgezeichnet — verbunden mit
(1) In Biichen mit sehr constanterTeraperatur (Sonuner uiul Winter 7'— S')
war der Laich das aanze Jahr anzutreffen.
— l->4 —
der erst ïnr Bj/th h) ello Duukeri ni\Qhge^yle^onen, aber wahr-
scheinlicli aucii andorn /ukommondo Eigenscliaft des Winter-^
laicliPns spriclit selir lïu' die Zugeliôrigkoit zur Glàcialfauna.
Durch passive Ûbertragung lassen sicli die Verbreitiiiigseigen-
tiimlichkeiten nicbt erklaren. Zugvôgel iind ^^^assel•vôgel
besiichen den bevorzugtesten Aiifenthaltsort der lîvtliinelien,
kleine, einsame im Wald versteckte Quellen, wohl kaiim, und
wenn das aucli aiisnahmsweise einmal gescliehen sollte, so ist
doch der Weg von einer solchen Quelle zur andern so weit und
die Walirscheinliclikeit, dass der Vogel, an dessen Fiïssen sicli
per Zufall eine Bythir/ella ïesige^ctyA liât, gerade wieder an
einer Waldquelle sicli niederlasst,, so gering, dass man eine
solclie Art der Verbreitung ruliig ausscbliessen darf. \^'ir
miissen also das Voi'konunen von P> vtliinellen in verborgenen
Quellen durch aktive Wnnderuug erklaren. Nicbt zwar durcli
AVanderungen des Individuunis, sondern der Art , wie wir
das tur Planaria nlpind und VoJucelh corniita annehmen
mûssen, die icb oft mit Bijtlùnclhi zusamnu^n antraf. Wir
batten also vorauszuseizon, dass fi'iiber der ganze Bacblauf von
BijthlaeUa besetzt war, dass a])er zunelunende Teinperatur das
Aussterbcu iui Uuterlanf bewirktc. Iiu (legensatz zu den
Plan a ri eu, die sicb, wie Thienkmann hetonl, durch gi-osse
Stabilil:atd(>r Ai't auszeichnen, siud die P, yt]iiu(>l leu variabeh
WahrsclHÙulicb liahen sidi die liculigen Arlcu iiifolgc vou
gt^ographischer Isolieruug ans eiuci- zur Eiszcit idjerall gleicli-
massig veii)reiteten Stanunforni entwickelt. Die Artunter-
schiedesiud ja iuisserst geriugfiigig uud wabrscbciuHch v;crden
sicb die einzelncn Foruieu unschwer ibuvli l hergauge verbiudcu
lassen. Grosse und Lcbensweise stinuacu bei alleu iibereiu.
Eine Ausualune — «lie fiiizigc uulci' 18 Arien — macht BijUi'i-
nella Steiiii, (be in Nord(leutschlau<l aui Ffci' von Fbiss(Mi und
Seen lebt.
Vitrella helvetica Cless.
Herr E. (tKAKTkh faud dicsc A ri in dri' H ;i slcrliob le
(Scbwarzwald).
r)i(> GaUuug isl iu uiebri'acber Fliusicht inicressant. Sic be-
wohut Hiessende Il()hlengcwasser m\y\ ist bliud. Iln-e uiichsteu
Verwandlen siud die Brackwassergaltung Hijdrohia Hart-
mann und die oben bebandelte Gattung ByihhieJla Moq.-Tand.
— 125 —
So\\>'it sicli nac-li den Merknialen dci" Scliale bcurtcilen liisst,
aiif (lie wir Ix'i der Seltenheit lel)end(M' Vitrcllon cinstweilen
angewicseii sind, seliliesst sicli dci' TV/rt'/Zrttvpus cng- an die
Forni BythlnelJfi Sch)niilfi vai-. hararicct Cless an.
Vit}'eU(C macht nun nocli viel \\\e\iv als BijUiuicUa, dcn Ein-
druek oines Reliktes. Es gibt wohl kaum cinen Ort mit
kiihlerei', constanlorer Tempera tur als Hôhlenbache. Dass
fvelikte ans der Eiszeit hanfig in Hôlik^n leben, wurde schon
mein-facli, z. B. von Zschokke, von Veydovsky, Thienemannuntl anderen hervorgehoben. Die Vi t relie n besitzen nun nocli
viel engbegrenztere Verbreitungsbezirke als die Bythinellenund fur sie ist passive Ubertragung von einem Bachsvstem in
das andere voUstJindig ausgeschlossen. So bat sicli denn im
Laufe der Zeit infolge der geograpliisclien Isolierung fast fur
jedes Hôhlensystem ein besonderer Vitre llentjpus herausge-
bildet. Geyer betont uml beruft sicli auf eine ahnlielie Stelle
Hamann's, dass fast jede Hôhle nur eine einzige Art besitze.
Wir haben also in Vitrella eine Riclitsehnur zur Beurteilung
der Verbreitungseigentûmlichkeiten der Gattung Bi/thinella.
Lithoglyphus fluminensis L.
Drei Exemplare ans dem ïimavo (Karst).
Wolniort nach Clessin in Bàclien und Fliissen. Verbreitung:
Krain und Kroatien.
Dièse Form geliort systematisch ebenfalls in die Nalie von
BythineUa und Vitreîîa. Aueli sie zeigt Vorliebe fiir das
fliessende Wasser; einige Arten sind sogar nur aus Quellen
bekannl. Die Gattung geniesst im Osten und Si'idosten weite
Verbreitung; sie felilt der Selnveiz voUstandig.
Neritina fluviatilis L.
Mehrere Exemplare aus dem TimaAO (Karst). Eine
Aveitverbreitete Flussforra, die in ganz Europa mit Ausnahme
des Oberlaufes von Rhein und Don au zu Hanse ist.
Valvata piscinalis Mûll.
Rdi besitze von drei Fundorten je ein Exemplar. In den Se(^-
abflùssen des Sauts du Doubs und dei- Souree de l'Orbt?
— Wi —
lasst sicli ilir Vorkoninicii duix-li A'ci'sclnvcmmung crklart'ii.
Im Bach von Skoft'ic (Karst) sclicint sii^ ans cincni untVi'iion
Siimpfp eillgo^^'an(lol't zu sein.
Die Art ist iiber ganz Eui'0})a. vorbi-eitcl und Icbl \()i'zugs-
woise in stclicndcni odcr langsainfli(>ss<'nd('ni ^^^•lss('^.
Zu diosen ocliton Wassersclmocken gcsellt sicli nocli einc
livgi'Oi)liile Landschnecke, die nacli den Beobaclitungon Ross-
MÀSSLERS, SuRBECKS und andoi'ei' aueh im Wassor Icbcn kann;
es ist Siicchiea Pfelfferi Rossm., die icli zweimal an schwacli
iiberflnteten Ufersteinen des Bergbaclies von Fiûhen be-
obaclitete.
B. Bivalvae.
Pisidium ovatnm,
eine Quellenform, ist tjpiscli fiii' die Urgebirgsformation. Sie
ist ans dem Schwarzwald, dem bayrischen Wald und
S i 6 b e n b il r g e n bekannt
.
Ich fand einige Exemplare in einer sehi' kalten Quelle des
Heidenwuhrgebietes bei ca. 1000 m.
Die Bachmolluskenfauna besteijt also, iilmlicli wic andciv
lorrenticole Tiergru})})en aus ephemeren p]in^^an(lel'el•n, dci-en
gewôlinlielie Heimat See und Tumpel ist, und aus ecliien Bacli-
tieren. Zu den letztern sind zu rtrlinen :
1. Bythhiella Diinherl.
2. ^: alta.
3. •» abbreviata.
4. Vitrella helvetica.
5. Ancylits fluviatUis.
(). LithoglypJms fluminenais.
7. Limnaea truncatiûr/ (z. T.).
6. Pisidium ovatnm.
— 127 —
III
ALLGEMEINE KAPITEL.
1. Zusammensetzung der Bachfauna.
ZsciiOKKE selzt in seinor Arbeit iiber die Tierwelt der Hocli-
gebirgsseen auseinander, dass zwei sehr verschiedeno Faimen-
elemente im stehenden alpinen Gewasser zusammentreffen :
Stenotherme Kaltwasserbewohner und Eurytherme anpassungs-
faliigo ••Ubi(|iiïsten--, die meistiiber den ganzen Erdball verbreitet
sind imd dalier den Namen -Cosmopoliien-- ^erdienen. DerUbiquist zeiclniet sichausdurchdieFàliigkeit, in verschiedenen
Medien leben zu konnen. Er ertràgt weite Grenzen der Tempe-ratur, der clieinisehen Zusainniensetzung und der })hjsikalischen
Eigenschaften des bewolmtini Médiums. Er ist im Stande
•iiberall" zu leben. Der Cosmopoiit erfreut sich einer weiten
A\n'breitung iibei' den ganzen Erdball
Gewôlmlicli sind beide Eigenschaften in einem Tier ^•ereinigt
und stelien in ursachlicliein Zusammenhang: Der Cosmopoiit
Aei'dankt seine weite A^erbreitung seiner geringen Empfîndlich-
keit gegen aussere Einfliisse. Er ^ermag z. B. Warme undKiilte gleieli gut zu ertragen, ist also im Stande, im Norden wie
im Siiden zu leben.
Eigentliclie Ubiquisten sind kaum je durch ôi'tlicli besehriinkte
Verbreitung ausgezeichnet und weitverbreitete Cosmopoliten
sind in den meisten Fallen résistent und anpassungsfàliig,
konnen ;dso 'S'ersclnedenartige Medien bewolmen.
Im stehenden Wasser konnen allerdings Cosmopoliten auf-
treten, die die Bezeichnung --IThiquisten-- nur in geringem
Maasse verdient^n, indem sie z. B. nur gegen Temperatur-
einflusse unenqjfindlich sind, sich dagegen zum l'bergang in
extrême Medien, in bewegtes Wasser, in die Wildbache, in die
Tiefe der Seen etc. ungeeignet erweisen.
Dagegen diirfen Tiere, die im stehenden Wasser zu Hanse und
zugleich im Stande sind, sich dauernd im extremen Médium,z. B. im Bach anzusiedeln — also Ubiquisten im pollen Sinne
— 121^ —
des ^A^)^t('s — iminci' als rosnioiiolitcn ;iiil'g'<'l';isst wenlcii. Icli
kciiiic kciii ciiiziges Ticr, das stcliciidcs iiiid sclincUHicssciidcs
Wasscr l:)(>\\-oliiil, oliiic zu glciclicr ZcKCosmoiiolit zii sein.
Ob sieli LiiiItT dt'ii ccliU'ii l>acliI)('\voliii('rii, die dciii slcliciidcii
Wasser felilcii uiid dcslialb iiiflit Ubi(|uisk'n sijid, wcii-
Aerbreitete Cosinopolilen fînden, ob die Bergbache Afrikas uiid
Amerikas z. B. die gleiclien Ephemeridenarten etc. besitzen,
scheint, ^^•ellll luan geographisclie Isolierung als artbildenden
Fakloi' a.nerkennt, iVaglicb zu sein, kann aber bei dem lieiitigen
Stand der Baclifoi'schung nielit entscliieden werden. Fiir die
ubiquistisclien Kosmopoliten, die gieichsam auf allen Punkten
mit einander in Fiihlung zu bleiben im Stand sind, konunt die
ôrtlielie Trennung als Spezialisierungsfaktor in Weg'fall.
So viel icli nacli nieinen Untersucliung(>n beurteilen kann,
sind die zur Baclifauna geliorendcn l'biquisten immer auch
Cosmopoliten und umgekelirt Icli darf dalier beide Xamenbrauclien; sie bezeiclmen miter dei- toiTenticolen Tierwelt das
gleiclie Faunenelement.
Im Bach leben ungefàlii' die gleiclien biologisclien und geo-
graphischen Gruppen wie im Hocligebirgssee und in der Seen-
tiefe. Die Zahlenverlialtnisse sind allerdings anders.
1. Cosmopoliten, Ubiquisten.
Im Gegensatz zum Iloclisee und zur Seentiele, wo das cosmo-
politiscli-ubiquistisclie Elément eine fiihrende Holle spielt und
weit melir als die Hali'te der Gesamtfauna ausmaclit, tritt hier
die eigentliche Baclii'auna, die dem stehenden Wasser voU-
kommen fehll, zu Ungunsten i](n- rbiquisten stark in den
Vordei'grund. A^^aln'end der Hocligebirgssee von scincn B(^-
wohnern nur Unempfindlitdikeit gegen l'ngunst der lVm])eratur-
und Nahrungsverhaltnisse verlangt, konunt im Bach \oi' allem
die Kesistenz gegen den Druck der Stromuug in Fi'age. DasLeben im stehtMiden WasstM- der Ilochgebirge und in dei- Tiefe
der Seen ist niclit stai'k verschieden vom Leben im Tiunpel undSee der Ebene. Wenn auch beim Hochsee der lange Eis-
verschluss und bei der SccuticiV <\('v Lichtmangcl und der grosse
Wasserdi'uck in Betracht konunt, so will das noch gar nichls
sagen gegêniiber den extremen Bedhigungen, die dci- Bachseinen Bewolmern bieiel. Die rortwJdirend wcchsclndc Stif)-
— 12Û —
miing, (lie hei Gewittei'rcgcn ot'l oiiu' ungvliourt' Tiewalt liai,
«ler stoiiiigc UnltM-gmiid, drv Maiigcl an PflaiiZ('jn\uclis iiml die
(i('t'(\ eonslanlc Tciiipcralur sicllcii (icii SMii'zhacli in scliai'lVn
Coiilfast /uni Tinnix'! uml niaclicn dcn lU'Woliiiciii des sldicndcn
M''assrrs dcn Thcrgang zu loi renlicolei" Lebenswcisc rmsscrst
scln\'('r.
Einc gi'ossc Anzalil anpassuiigsraliigcr Cosniopolilcn, die
sclbsl in don Eistiinipeln des Gletsclierrandes zu gcdeilicn \ev-
môgeii, sind \x^m IJacldclx'n ausgeschlossen. Sie \\';ir(Mi nichi
ini Slandc dcr \A"uc]il dci- Sd'oniuiig zu trofzeii. Langorc
Lelieiisdaucr ini lîacli, A'crnicliruniJ' oder gar dauernde Ein-
bùrgei'uiig isl dicscii Eorincn \()llst;indig unniôglicli.
Zufàllige })a,ssive l'InM-tragung koinmt soniit Ix'i ilcv IJo-
siedelung des Bâches durcli Cosmoiioliten kauni in lîctraelit, su
wichtig sie l'iir die lîcwolnicr des stagnici'ciidcn alpincn Ge-
wassers sein mag.
Eine andere Eingangspibrte in dcn lîacli, die Non \iclcn
Cosmopoliten begangen wird, sind die hall) odcr ganz uber-
fluteten Moosrasen, die zuni Tcil gar nicht mit dem Bach in
Verbindung stehen und nur von dem Gischt des zerslaubenden
Wassers i'euclit erhalten werden. Doi't lebt eine grosse Tier-
gesellschal't, bunt zusannnengewiirfelt aus allen môglichen
Gruppen, eine Eauna, welche wiederkchrt in d(Mi Moosiiber-
ziigen der Brunntroge, der feucliten Eelsen, dcr Moorc, kurz
iiberail wo ihr feuchles Moos zur Verfiigung steht . Ihr gelK)ren
Di})terenlarven, Neinatoden, Oligoc hacten, IvOta-
lorien, Gasti'ot r ichen , cinzelne Infusoricn und Ela-
goilaten, Tuidiidlaricn (rhabdocoeb') und Tarti-
graden, ausscrd(*ni einc gi'oss(> Anzahl halbaquatiler Milben.CoUembden und Kafei- an.
Ich bin iiberzeugi, dass sich untcr dcn hier genannien l'icr-
gruppen Formen tinden \\iirdcn, die mehr dem untergetauchlen
Moos angehôren, wahrend andere Tendenz zu liaibierresirischer
Lebensweise zeigen. Eine Rotatorienform des fiiessenden
Wassers ist z. B. Furculavia ReinharcUi Eiirh. Doch
iassen sicli hier scliwer Grenzen aut'siellen.
Es scheint also in diesen Moosrasen eine Einwaiiderung in
den Bacli vor sich zu gehen, indem einzdne Mitglieder der
Moost'auna sich an das Leben ini sulimcrscn Moos ani)assen und
so torrenticol ^^erden. Ich liai»' in dcr \orliegenden Arbeit
{.Vu'^i' Tieriicsellschaft nicht, odcr nur cru;inzunos^^•(>ise benick-
— 130 —
sichliu'l. Kiiic m'iiaiu' UnU'rsuehiiniJ' solchcr Foriiiéii y-aboo o ~ o
Stoflfzu cini'i' Ix'soiidci'cn Ai'boit vind hi'achic iiiicli /u woit von
nKMnoni Tlioiiia ab.
Untoi- (Um' cio-onl-lichcii lîaclirauiia, d. h. uiilcr dcr ]i('^\"ollll('l-
st'liaft liolilaufiicgondci-, ])<'sj)iilt('i' Siciiic wwd stai'k iibci'iiiitclci',
vôllig imt(M'g('tauclitor Moosrasen, ist dio Zahlder Cosirio])olil('n
eine aussei'ordcnllich geringo; dagegen treien die ecliton Bach-
l'ormen stark in den Vordorgrund.
Die wichtigsten Cosmopoli ten, die auch in stark stromendeni
Wasser das Leljen zu IVisten im Stande sind, niôg<>n hier noeh
einmal zusammengestellt werden :
1 . Gammarus pulex De Geer.
Er vei'dankt seine Anwc^senheit im lîach seiner ungewôlni-
liclien An})assung'staliigkeit, ausserdem seiner Gewohnlieit,
unicr liold aufliegenden Steinen zu leben, \vo ilmi die Sti^ômung
niclit A'iel anliaben kann, und nrclit zul(>tzt der grossen Frucht-
bai'keit, die eine ÛberbevcUkerung im Fluss zur Folge liât. Nacli
ineinen Beobaclitungen sind jedoeli die Bachformen von denen
des stehenden Wassers nacli Grosse nnd Empfîndlichkeit gegen
Temperaturanderungen ziemlich verscliieden . G a mm a ride n
ans Tiimpeln konnten \iel sl;irker(> Erw'jirninng ertragen als
solclie ans Baclien.
2. Einige Chironomiden, <lie jiMloch i\n\ Wasserrand luid
die schon erwidniten Moosrasen bevorzngen. Andere Verti'eter
dieser Gruppe felilen jedocli dem sielienden Wasser und diirfen
daller zur tvpisclien Baclii'auna gezalilt wei'den.
3. Limnaea ovata und peregra.
Beides resistenle Mollusken, die vorzugsweise dem stehenden
Wasser angeluM-en. Im tiiessenden bleiben sic eher selten und
gelien nur ausnahinsweise in sehnellfliesseudes iilier.
4. Die Hydracarinen Lehertui spdr-sicctptUida, Atrac-
t'iLlcsi .s7^?n?7^PS,L^'^;pr'//c/y;rjrY>.s:/'/(im AljienliaelunnZnfallsfund).
5. Einige Birudineen (hingen iiiissert seKcn in stark
bewegtes Wasser ein.
— 131 -
Andere CosnioiX)! i tcn, (lie icli viM'einzelt in Wildbachen
traf, sind Opter des Zufalls. Sie wui'dcn wohl meist durch
wanderndc A^ôgol otler Inseklen ans dem stelitMidon Wasser
verseldoppt. In diesem Fall sind wenige Ostracoden nnd
Cladoceren.Die Scliwimmkai'ei-, die sieli da nnd doi'i in den Ans-
\A'asclibecken nnter den A\''assei'f;dlen ansiedeln, gelang(ni
selbstandio; dnivli Flug in den IJacli; docli beweist aucli hier die
Selienlieit der Fiinde, dass der nngiinslige Znl'all ini Spiel Avar.
Vermehrung findet im Bach kamn statt nnd der Kafer fliegt
nacli knrzer Zeit wieder weg nnd sucht einen Tiinipel oder
einen Sumpt' auf, wo er von seiner Seliwimmtahigkeit Gebrancli
macben kann nnd wo ihni Qnanlit;it nnd (^ualitat der Naln-nng
besser zusagt.
2. Torrenticol-profunde Elemente.
Eine zweite Grnppe torrenticoler Tiere spielt im Bach, wasIndividuen- nnd Artenzahl anbelangt, eine nntergeordnete Rolle.
Umso grôsseï' wird ilu'e Bedentnng, wenn wir nach dem Ur-
sprnng der Bacht'anna t'ragen. Sie nmfasst Formen, die im
Bach nnd in der Tiefe der snbalpinen Seen ^orkommen, den
seichten Gewàssern der Ebene dagegen meist felden.
1. Rhlzopoden.
Ci/phoder-ia cu/ipiilla Ehrb. nnd Nebela ritraea Penardleben im Tal vorwiegend in der Seentiefe nnd treten in den
kalten Gebirgsrpiellen wieder auf.
2. Planaria cavatica Fries ?
Wurde in mehreren Hôhlenbàchen gesammelt nnd kommtprofnnd im Vierwaldstattersee vor.
3. Ilyocryptus acutifrons Sars.
Lebt vorzngsweise in den Tiefen der Seen nnd fehlt anch demBâche nicht.
— 1.S2 —
i. Einig-e Ostracoden.
('(DuloiDi vdmVuUi ( ). F. M., Ci/chici/jjris hieris (K F. M.,
<'i/lti-}(i oitltlhdjm'ica JrKiNK, Ci/iiriiloiisis riihni (). F. M.
WcitNcrbivilcIc (Josmopolilcii, iiii lîiicli wolil iiicist zulTillig,
ncigcn zum Tiet'ciilobcn.
5. Niphargus puteanus Kocii.
In Holilciigewasscrii iind Quellcn; ist in dei- Tiefe dt'i' Stvn
zicnilicli hjinfig.
Cl. Hygrobates albinus S. Thor.
In (Icr ïierc (les Mcrwaldstattei'seos liaufig, ansserdem
nui' ans norN\'egisclien I>(>rgl);icli('n bekannt.
7. Chironomiden.
Speziell ein Tamjtm-Hu^^ vielleicht Tain/tarsuH dires
JoHANNSEN. Im Rliatikon baehbewohnend und ini A'ior-
w a 1 d s t à 1 1 e r s e e hàufîg profund
.
o. Echte Bachtiere.
Das ganzp Heer der iïbi'igen torrciiticolen Tiere darf als pclite
Bachfauna angesjjrodicn w^rden. Ihi'c ^^'rbreitung besebriuikl
sicli auf CTe^\';lss<'^ mil s(ai'k<'i' Sli'(")uiung. Eino Verpflanzung
in stêbendes Wasser bai baldiges Abst(M-ben zur Folge.
Ziichtungsvei'suche in Aquai'ien obno l'ortAN'ahrende \^^asser-
spûlung mislingen l'pgtdmassig.
Saucrstoffi'oicbtuni und Kidlc (b'S Wasscrs scdicincn die
wicbtigslon Lebcnsbodingungcn zu sein.
Unter (bcscn Tieren spiclcn die grossie Ivolb::
a) Naeli Indi\i<bien- und Artenzabl die Insektenlai'ven der
vorscinedensten Abteilungen :
1. Trichopteren.
2. Di])teren.
;i. Perliden.
4. Ephemei'iden.5. Colèoptei'en (z. T. aiieb als Imagines).
G. Planipennia.
h) IliiK'n zimiielist komm^ni in Betraclil dio Hydracarinen,(lio b('sond(M's duivli grosso Artenzalil ausg'czciclmet sind, in
(^ucllcn oi't aucli diircli grosse Individucnzahl auffallrn.
c) Die Turbellarien, mit geringer Arten-, selir oft aber
grosser Individuenzald.
d) Die MoUusken; die wenigen Arten treten dann und \\ann
sehr zahlreieli aid', besonders Ancj/Ius ffnriati/is.
e) Am schwaclisten sind vertreten : die Crustaceen; wenige
seltene Arten iiuler den (Jstracoden und Copepoden.
Andere Cii'uppen sind unter der ecliten Baehtierwelt niebt
vertreten; sie senden hocbstens cosmopolitische oder torrentieol-
profunde Vertreter in den Rach.
2. Anpassung der Tiere an das Leben
im Gebirgsbach.
Der \Mldbaeli bi(^tet seinen DeNVolniern eine Ileiniat \(m so
ausgepriigtem Cliaracler, dass sicli dies in der (testait und
Lebensweiso der Raelitiere \\id<n'spieg(dn niuss. Dièse An-
l)assungsei'sclieiiiungen soll (bis folgende Kapit<d zusanunen-
t'assend beliandeln.
1. Anpassungen an die StrSmung des "Wassers.
a) Dorsoventrale Abplattung.
Die auffallendste Ersebeinung, die uns Ijei fast alb'u bJaeb-
iioven entgegentritt, ist die Neigung zu dorso^'entr;der Ab-
flacliung. Am selionsten finden w'ir sie bei cinigen Ephe-mei'idenlarven ausgepriigt; icli neime di(^ Gattungen
Ehillnuxicna , Iran, Epeorus, Ecdi/io-xs; elwas ^^'eniger
stark koimnt sie bei den Flussformen OUfioneuria rlieiiana,
Potaynanlhus luteus und Prosopistoina foliaceuni zur
Geltung x\bgeflacht sind aucli (He Plana rien und viele
Hydracarinen. Unter den ietztern giebt es einige typische
Bacbformen, deren Organisation melu' auf das Leben im
— 134 —
flutenden Moos deutet, iind die deshalb iiur ^^'('nig abgeflacht
siiid. Andere, z. B. Aturns und Hjarfdalia, erreiclicn ini
Gegcnteil eine Kôrpergestalt, die, von der Seite geselion, cinem
Keil zu vergloiclien ist. Dièse Form scheint in holieni (Irade
geeignet zu sein, der Gewalt der Stromung zu ti'otzen.
Unter den Dipterenlarven sind besonders zu nenncii die
^iSiselartigeLiponeura und die hygropetrisclien Stratiomyi den,
speziell Oœycera spec. Sodann mag hier die Abflachung der
Hirudineen erwàlmi werden, die zwar mehr die wàrnieren
Bâche bewohnen. Die Coecons dieser Tiere sind ganz breit
gedrïickt und liegen dem Stein vollstandig an. Starke Ab-
flachung zeigen auch die bachbewohnenden Kiiferlarven
{Ci/jjhon und Parnidae) und Ancylus fluviatiUs, liber dessen
Variationsfàhigkeit die Tabellen aufpag. 120 u. 121 Aufschkiss
geben. Selbst die weiter unten zu besprechenden Schutzgeliause
der Phrjganiden werden oft depress, so bel Goerinaeund Apatania.
Die Vorteile der dorsoventi-alen Al)flaelunig liegen auf der
Hand.
W'ir kônnen die Oberflache, die das Tier der- Strônrang bietet
,
mit einer schiefen Ebene vergleichen.
Je wcnigei' das Tier abgeflacbl is(, uinso scliici'er ist tUese
Ebene, umso gi'osser wird in unscivr Figur der ^^'ildv('l y.
Bezeichnen wir mit S die Stronnmg tles Wassers, mit / die
Lange und mi 1,-7^ (li(^ Holie der schiefen Ebene, zerlegen w'w die
Kraft S in die Componente li = d(Mn fiir scliiefe Ebene nnwirk-
samen Teil der Stromung, und in die Componente Q senkrecht
— 135 —
auf l, die den Driick der Strômung auf die schiefe Ebene dar-
stellt, so ergeben sicli ans der Alinliclikeit der Dreiecke folgende
Proportionen :
Q : S = // : /
— 130 —
gebreitet. Es ontliiilt nur selir sparliche Traclicon, und clio an
den untei'ii Paaren woldontwickelten, biiscliplfôrmig(^n Kiomen-
fibrillen sind imr als zwci od<'r drei rudimentare Gobilde sicht-
bar. Der ganze Api)ai'at scheint seinor ursprimgliclien rospii'a-
torisclien Funktion cntfremdet zu sein und dient nun vollstiindig
als Fixalionseinriclitung. Bei don Arton dor Gattiing Epeo7nts
besitzen aile Kiemenlamellen, besondei's aljer das erste Paar,
einen verbreiterten, tracheenfreien Rand, der denselben Zweck
vei'folgt Ecdyurus weist normale Kiemenlamellen aiif. Da-
gegen ist der Fémur stark blattfôrmig verbreitert und dient so
zur Vergrôsserung der Adbasionsflachc. Aucli die ausser-
onlentlicli langeu S('h\\';nixl';ld(Mi ^^•irk(Ml wobl idinlieli.
c) Geringer Kôrperumfang:.
Eine ^^'eiiere Eigentiindiclikeit der Baclitiere, ebenfalls als
Sclmtzmiltel gegen d;is Weggeschwemmtwerden, ist die
geringe Kôrpergrôsse. Die Mitglieder der Bachfauna sind t'ast
immer die Zwerge unter ihren Verwandten in Tiirnpel und
See. Die Ilvdracbnidengattungen FeJtrin und Aturus, die
eehtestcn Jîacldiere sind zugleieh die kleinsten H vdracli-
niden (siclie «lie Tabellcn iibei' die (li'()ss('n der Bacbliydrach-
nidcn, i)ag. 70). Die au iib('i'Hut(M('n Fclscn Icbeiide Triehop-
terenlarve Staclnhiti g('li()ii zu den kicinsicii. Die Kafer
Ehnis, Paviins, L'nnn'ms, Hijdi-detKi siud cbeid'alls von sein-
geringer Grosse. Aueli die Quellformen Biiiliuielhi Duiiheri
und L'niinaea fruncatiila sind Zwerge unter den Ver-
wandten. (ifininun'us jjnlex wird im Bacli niclit so gross
^^it' in Tiinqxd und See. Aucb die Baclibewolmer unter den
i/ft/Y/.s'larven sind kleiner als die M^eiliei- und Flussformen.
Kleine Tiere tinden in den kleinsten Ritzen und binter den
niedrigsten Vorspriingen Schlupfwinkel, wo sie voi' d<M' (rewalt
der Stromung sicber sind.
r/) Fixations- und Retentionseinrichtungen.
Die iîarbtici'c zeigen uebeii den An})a,ssungserseli(Mnungen,
die die iiussere Kôrpergestalt betreflten, aucli besondeiv^ Einricb-
tungen die zuiii Tt'il wicbtige innere Umbildungen zur Folge
haben koinicu : inuskul()se Saugnapfe, Sebleima.ussebei<lung,
SpinndriisiMi de., zum Tcil aueb auf die iunere Organisation
— 137 —
keine Einwirkimg liabon. Dieso Apparato sind toils Umbil-
dungen von urspi'iinglicli andci'on Zwocken dienondcn Organon,
teils aucli Ncubildungen
.
Ic'li untoi'sclieide zwisclien O'gaïKMi dci- Fixation, die das
zeilweilige odor daiiei'nd(> Fosthat'tcn an der Untorlago oi-môg-
lichen, und Apparaten dor Retent ion, (]i(> mehr boi dor Be-
wegung ini Bacli in Funktion ti'eien und dem Tier orlaubon,
sicli an Vorspn'ingen und Fnebenlieiten der Unteiiage t'estzu-
lialten.
Dauerndt' Fixation kommt ziemlicli liiiufig bei Di^jlfrcn und
Ti'iclioplei'en \oi'. Besonders die Pu})i)('n hol'tcn sich fast
regelmiissig an die Unterlage an. Oit dienen fîxiei'ie Geliause,
bei den Cliironomiden-Roliren ans Saiid und Scldamm als
Sehutzmitlel gegen die Gewalt der Stromung. Die Trichop-
teren Odontoccrum, Hi/tlj-opsyche, Philopotainns, Rhya-cophila, Glossosoiua, Agiipetiis u. a. m. leben teils schon als
Lai'ven, teils erst als Puppen in fîxierten Geliausen. Zuni
Fixierendei' Kôcdier dient eine ziihklebi'ige Gespinnstmasse, die
sehr vielen Bachtieren zukonimt und, wie wir weiter unten
selien wei'den, bei der Bewegung eine grosse RoUe spielt.
Dauernd der Unterlage angelieftet sind aucli die Puppen der
Norziiglicli ans Bacldeben angepassten Dipteren Liponcwaund S/Dudluin, sowie die Coecons und Laiclnnassen Aieler
Insekteu, W^irincr und Hvdi'aeai'inen. Fine Ausnahnie niachen
Phinarid (ilj)'niii und Po/t/celis co)'i/n/a, dcivn Coccons t'i-ei
ain Gi'und des Bâches liegen und sieli zwisclien Stein(^n und
Sand verschicl'cu PldjKD-id (joiioccidnila befestigt iin Gegen-
teil ihi'e Coccons mit Stielen an die Untci-lage.
Eigentliclie Fixations;ippai'al(\ die oit ein(^ coui})lizierte
Construction aufweisen, sind die Sauggruben, wie sie manche
Planarien, z. B. Dendrocœlum hicteuin, besitzen und die
Saugnapfe, wie sie am schônsten bei den Dipteren Perico))ia
und LijioiiciD'a ausg(>pi';igt sind. Hierher gehort aucli die
Kriechsohle von A)icyhi.s, die in Geslalt und Funktion an einen
Saugnapf erinnert. Zum Festhalten dient nicht blos der
Schleim, sondern es treten Muskeln in Aktion, Jdmlich wie bei
der marinen Fissit7'e/la, welche ^'orzugs^veise die Uferzone
bewohnt, wo sie der Brandung stark aiisgesetzt ist. Das Tier
des fliessenden Wassers schûtzt sich genau so wie das Ti(M' der
Brandung vor dem Weggespiilt werden.
Eine viel mannigfaltigere Reihe von Ditt'erenzierungsmoglich-
9
— 138 —
kfnton mac'lion die Retontionsapparate durcli. In ilirer ein-
faclisten Form sind es kraftigo dornai-tige Borsten, die sicli bei
luanclien H ydrachnideii aut' friihere Scliwimmborsten zurûck-
ITdiren lassen. Sie trett^n aucli ziemlicii hauflg bei Insekten-
larven iind besonders bei Kafem auf. Die Dornen kônnen da
und dort gekriimmi sein und leiten so zu den Krallen iiber,
unter denen sich wieder eine ganze Entwicklungsreilie ver-
sdiiedenei' Vei'vollkoninmnng aufstellen làsst, bis zu den kom-
plizierten, kammartigen Gebiiden, die den Hydracarinen-
gaitungen SporadoiJorus und CaJonyx zukommen. Oft sind
die Klauen beweglicli mit dem Glied verbunden und kônnen so
bei beliebiger Stellung des Beines Hait flnden. Einrichtungen
die speziell die Verankerung in den Algeniaden iiberfiuteter
Felswànde bezwecken, sind die Haarkranze der Stratiomyido
Oxycera und die kannntormigen Gebilde am Hinterleib dei-
Psychodide Pericom((. Aucli die auf kegelfôrmigen Papillen
stehenden Borstenbiiscliel mancher Chironomiden haben
wobl eine solclie Funktion.
Alnilicli wie dièse Retentionseinrichtungen wirken die Brems-
\onicbtungen inancher Trichopterenlarvengehause. Ich
Irai' in aljjinen Baclicn melu'fach Drusiiskocher mit einge-
maiiei'ten WurzelstiickcdKMi u.dergi. Dasseiben fanden Zschokke
und Ulmer haufig in alpinc^n und Mittelgebirgsbaclien. Hierher
gehôren auch die Staeheln des Wurzeli'iissers Centropyxis
aculeata Ehrb. die Zschoickk als BivmsvoiTichtungen autîasst,
und die der naclisten \'<'r\\andten des stfdienden Wassei's,
r'. ecoritis, fcblcn.
e) Die Be"wegung im Bach.
Die iin \origen Abscbnitt besprocbenen Fixationseiniicb-
tungen tinden ausgiebige Verwendung bei der Locomotion.
Icbbrauche nur zu erinnern an die Be^vegungs^^•eise mittels(
Schieimspur, <lie bei Planarienund Scbneckcn iiblich ist.
Audi l)ei Ilbabdocoelen kommen (Icbilde voi-, die FuiiR-
MANN mit dem Ausdruck '• Klebzeilen » bezeichnet und
die ahnlicben ZA\'ecken dienen wie die Schleimdrûsen d<>r
Schnecken und Planarien. Einige Tricbopteren, z. B.
HeUcopsycJie, vor alien aber die Dip t e r en 1 a r \ e Simulimn,
bewegen sich mit Hilfe gesponnenei- Fiidcn, in denen sie sicli
— 139 —
verankei-n Bei Helicopsijche konnte icli beobacliten, dass
zuerst einigo F;id(Mi g-osponnen werden ; dann greifen die
voi'dorn, dann die liintern Beine in das Gespinnst ein, der ganze
Kôrper wird otwas ^Ol'gese]loben, indeni sieli das Tior in sein
Geliliuse znriickzieht und zn gleicliei' Zeit mit den Beinen sich
im G(^spinnst liait. Nun komnit die Larve von neuem aus demGehause lieraus, streckt sich, spinnt neue Faden und zielil das
Gelùiuse wieder an sich. Die Lai'\e von Shnuimm bewegt
sicli, ebenl'alls mit Hilfe gesponnener Faden, ausgespi'Oclien
spannermassig. Sie besitzt am Voi^dei^nde (Stunnnelfuss) tmd
am Hinterende je einen Kranz hakenformiger BorsttMi. Wennsie iVisst, gi'eift sie mit dem liintern Hakenkranz in einige
kreuzweis gesponnene Fiiden luid liissl den Korper iVei imWasser flottieren, das ihr in Gestalt winziger oi'ganischer Be-
standteile NahiMjngzufiihi't. Will sie sich bewegen, so zieht
si(^ l'asch einige neue Faden, gi'eil'l ndt dem Hakenkranz der
Stummeltïisse in dies Gespinnst ein, lasst liinten los, kri'unmt
den Korper schleifenfôrmig, greift mit dem liintern Hakenkranz(>in, streckt sich und spinnt \o\\ neuem u. s. f.
Ahnlich bewegen sich auch gewisse C hi ron o m i d en. Ùberdie Bewegungsweise der Trichopterenlar ven vom Hij-
dropsjjchc- und Rhyacophila-l^\\m^, die aucli an die Locomo-tion der Spannerraupen erinnert, bei der jedoch das Hinterende
ausgreil't und das Vorderende nachgezogen ^\il•(l, niag auf
pag. 80 Genaues nachgelesen werden.
Sehr autîallig ist die Bewegung von Liponeura . Die baucli-
stiindigen SaugnJipl'e dieser merkwiirdigen Lar\e ^\•erden
segmentweise durch die chitinisierten Scheinfusspaare jedes
Segmentes losgelôst, schieben sich vor und heften sich vonneuem fest. Wenn ein Segment dièse Manipulation vollendet
liai, kommt das nàchstfolgende dran u. s. \\'. Almlich bewegtsich wohl die von Ulmer(" Ùber die Ani)assuiig einiger Wasser-larveii an das Leben iin Geliirgsbacli •• Hamburgischer Lelirer-
verein fin- Naturkunde, Jahrb. I, 1V»01-1V>02), beschriebene
Larv(% die, soviei icli ans der kurzen Besehi'eibung entriehmen
kann, sehr nahe verwandt ist nut der Larve von Pericoma.(pag. 110) Merkwiirdig ist auch die lîewegung der flachge-
dinickten /icv/y^^'i^.ç-iUmlichen F j)]iemei'idenlarv(Mi, die mit
horizontal ausgebreiteten Beinen, olinc den Koi-pcr \un der
Unterlage loszulosen, sehr schnell dahinzujj-leiten verstehen.
Ahnlich muss man sich die Beweo-unt>- der Hvdracarine
— 140 —
Hydrorolzia vorstollon, welelio soitlicli ausgobroitoto ge-
kriimmte Beine besitzt.
Niclit mindor seltsam bewegl sicli (bisMannchen von Aturus
und mehrerer andet'or Milben dci- Biielie. Wabivnd die droi
voi'dei'u Beinpaare die Locomotion bcsorgon, wird das \ierU'
untatig nachgeschleppt. Bei einigen Fornien ist es kolbenfôrmig
verdickt und seheint so gleichsam als Breinsapparat zu fuidv-
tionieren. (Naheres dariïber siehe pag. (37.)
f) BeschAverung als Schutzmittel g:eg:en die Strômung.
Ausser dem soeben besj)i-oehenen etwas zweifelhaften Fall
wird bei den Trie hop ter en hiUifig die Scliwerkraft als Schutz-
mittel gegen die Strômung ausgeniitzt. Die meisten torrenti-
colen Trichopteren bauen aus Steinen. Viele ])egniigen sich
nicht mit Sandkôi-nern und kleinen Kieseln, sie verwenden
cinzelne gi'ôssei'e Steine, diedazu dienen, das Weggespiilt\\-erden
zu erschweren. Bei dem Pupi)engeh;iuse von Odontocerimi
bildct mcistein grosses Steinchen den Abschluss des aus feinen
Sandkoi'nern mosaïkartig zusammengeseizten (4ep]iantenzalin-
idmlichen Gehiuises. Bei den Kochei'u der Gocrina finden
latéral einzelne Besclnverungsstcine Verwciidung.
g) Réduction der Sch-wimmhaare.
Ein négatives Mcrkmal aller P)achli('re hiingt mit der Ein-
busse der Schwimmbewegung zusannncn. Aile Schwiunnappa-
rate sind reduziert oder ganz zuriickgebildt't Die lîachhjdrach-
niden besitzen die Schwimmhaare ihrer Verwandten in TiimiM'l
und See nicht mehr. (Nidieres dariiber siehe pag. (il.) Die
Schwinniipalette der Weiherephemeriden ,gebildet ans
l'eincn Ficderborsten an den Schwanztïiden, fehlt den meisten
•lîachbewohnern. Unter den Lai-vcn xowBtiiiis liisst sich mit
zunelnnender Anpassung ans Barhleben die Tendenz \(M'folg(Mi,
die SchN\"iuindiaare und mit ihnen den mittleren Schwanzl'aden
zuriickzubilden. (S. pag. 79.) Die stark depressen Ephe-
merid<Milarven Epeonts, Ecdyuriis, Rhithrogena und
Iro)i besitzen teils 3, teils aucli nur 2 voUstàndig kalde Schwanz-
l'aden, wàlirend ihre nàclisten Verwandten im Fluss, z. lî. Rhi-
throgena aurantiaca, noch rudimentare Schwimmhaare auf-
weisen. Die Cladocere Ilyocryptiis, die zwar mehr der Seentiele
— 141 —
aiigeliôi't, (li(> icli nhci- aiicli tonvnticol l'and, liât das vorzii^-liclif
Sclnvimmvorinôg'tMi iliror naclision Ven'waiidttMi vollkomincn
v('i4or(Mi ; iilmlich orging os einigen Ostracodon ; von Ictztoivn
iicnnt Kaufmann als echte Bodentiere, z. I). miici- andcni
Herpetocijijris, lli/odronuis, Microojjnvs, Daj'ir/nula
.
Dom fliesscndcn Wasser kommcn die Ai'toii Paracypridopsis
Zschokkci Kaufmann und PrioiioojiD-is Hcrrata Norm zu.
Bei allen dieson Formen sind die S('ln\'immliaai'o doi- zweiten
Antenne, rudimentiir. Kaufmann spricht die Vernuitiing ans,
("Cyprididen und Darwinuliden -, Revue suisse, 1900,
pag. 244), dass Schwimmborsten ein sekundarer Erwcrb seien,
wahrend die soeben aufgezahlten Arien sich nocli mehr der
Stammform naliern. Er glaubt dies aus der Tatsache ableiten
zu sollen, dass niclit nur das fliessende sondern aueli das
stehende Wasser kriecliende Arten beherbergt. Ich kann mir
jedoch ganz gut vorstellen, dass sich eine urspriingiich schwim-
mende Form auch im stehenden Gewiisser ans Bodenleben an-
passt ; wir haben ja Parallelen bei den H ydraclmiilen und
Cladoceren. Auch maclit z. B. die Beborstung der zweiten
Antenne von Paraci/prklopis Zschohkei viel eher den Ein-
druck von etwas reduziertem (Kaufmann braucht selbst den
Ausdruck " \erkiimmert '•) als von etwas unfertigem, in der
Entwicklung liegrifieneni. — t'ber den Sch^^immhaarverlust
einiger Trichopterenpuppen, s. pag. 97.
h) Schutzgehàuse.
Die Gehiiusi', die den Larven der meisten Trichopterenund mancher Dipteren als Versteck dienen, haben zwei
Zwecke zu erlullen. Ini stehend(>n und langsam fliessenden
Wasser dienen sie als Schutzmittel gegen Feinde, besonders
gegen Fisclie, denen die Trichopteren eine willkommene
Nahrung sind. Im sclmellfliessenden Bach, der kaum mehr
von Fischen besucht wird, dienen die Kôclier in erster Linie als
Scliutzmitlel gegen die Strômung.
Die Tr ich opter engehause des Bâches zeigen eine sehr ver-
schiedene Gestalt. Drei Besonderheiten sind bereits erwahnt
worden : das Vorkommen von Bremsvorrichtungen und Be-
schwerungsteinen so^^'ie die Neigung zu dorso\enti'aler Ab-
plattung. Typisch ist, dass die im stehenden Wasser so
l)eliebten Gehause aus Pflanzenstoften bei der BeNolkerung der
14^^
liitchf nur wenig Aiiklaug fin(l<'ii. PflîinzciikoclHM' siiid aut"
L;rossore Bowogliclikcit cingciichtct uiid cinc solclic ist Ix'i dcii
IJaclitiert'ii, dio sicli von Scliritt zu Scliritt vcraiikcrii iniissen,
uni iiiclil w<'gg('Si)iilt zu worden, \('i'})(')nt. Slcingehiiusc ver-
Icihon auss(>rd('ni bedeutond niclir incclianiselien Scliulz. Nur
aus Ptianzcu haut, sovicl icli nacli niciucni Material beurtcilcn
kann, einzig Lcclisioptcr-yx guttulata Pict, eine Bowolinci'in
(U'i- Fojifhif//isràsen, die icli im Scliwarzwald in Biichen
t'and und cinc ini Tima vo gefundene Linmopliilid c, die sicli
ihrHausaus Bliittern von Wassei-pflanzon {Potainogetou etc.)
zusannuensolzt.
Fixierte Larvengeliause sind ini P>acli rcclit liaufîg. Einnial
scliwemnd die Strômung von seibst Nahrung herbei, so dass
active Bt'M'egung unnotig \\m\ und (bmn ist Totalfixation ein
grosse!' Vorteil, der deni Tier beftige Muskelanstrengungen und
die Ausbildung von Fixations- und PvetenTionseinricldungcn
erspart.
Fine beliebte Fonn der Geb;iuse ist iUn- " Flepbantenzahn «.
Sie entstebt durch Kriinnnung einer ui'si)riinglie]i ^^'ohl geraden
Rôbre. Die bierher geliorenden (leliiiuse von Odoiitocermn,
Sericostonia etc. sind aus sebf feinen Steincben zusammenge-
setzt und ^^'^u'den, wenn sie gerade \\-;ii'en, sebi^ leicbt im Bacb
rollen. Dies wiixl nun dui'cli die Krummungvei'binderi. Neigung
zur Elepliantenzabn-Form zeigen aucb eine Anzalil von Limmo-pliilid(Milarven. LuniiiO[ihUus griscus L. liât nacb den
Abbil(biiigen von Struck in der Jugend ein fast gerades Gebause
walirend iVn- ausge^^acbsell(> Larvenkoclier den voi^liingenannten
sebr jilmlicli ist.
i) EigTÔsse und Dauer des Embryonallebens.
Eine autiallende Saclie ist die Grosse tler Fier hei den Baeb-
bydracarinen. Man ptiegt daraus aut" bing(biuernde Em-
bi^yonalfMitwicklung zu scliliessen. Dièse liât wobl den Zweck,
das Tier in ('in(nii nj()gliclist fertigen Zusiand den Kani})!' mit
den ungiins(ig(Mi Lebcnsbedingungcn aul'iiebmen zu lassen.
(N;diei'(s iibcr dicscii l'uiikt ist auf i)ag. (i*.>ff. zu fiudeii.)
143
k) Respiration.
Bei den Baclitieren tritt die Liiftatmung stark zun'u'k. Das
sti'omeiide Wasser gestattet den Tieren iiiclit, zuni Lui'tseliopfen
an die 01)orflaclie des Wassers zu steigon. Lut'tatmer wie z. B.
Cnfe.rhxryen sind daher \om Bachleben ausgeschlossen. Datïii'
sind Ha.utainiung und Atinung diircli echte Kiemen {('hh'o-
nomus, Liponeurii?) oder duivh Ti'aclieenkienien {Lplic-
me?Hden, Pcr/iden, Phff/r/o'occra etc.) bei dei- Bachfauna
selir belie])t.
Lui'tatmeud sind die liygropelriselien Strationi viden,
Oxycera etc. An iil)erfiu(eten Felsen brauclien dièse Formen
nicht an die Wasserobertliicbe zu steigen um Lufl zu schôpfen.
Der Ûbergang zur Haut- und Kiemenatmung wird erleiehtert
durch den grossen SauerstotiVeiclituni des scliàumenden, zer-
stJiubenden Gebirgsbachwassers.
2. Anpassungen an die Temperaturverhâltnisse.
Auf einer Anzalil wiilu'end des Winters unternomraener
Excursionen gelang es niii' festzustellen, dass die Fa,un;i der
eigentlicben Bergbàche jahi-aus jalu^nn nacb Zusammensetzung
und Quantitiit annaliernd die gieiche bleibt. Dies sdiien auch
sebr nati'u'licb, (bi Messungen zu versclnedenen Jabreszeiten
so geringe Temperaturscbwankungen ergaben (S, pag. 3«)), lUiss
nian an einen Einfluss der Jabreszeiten auf die Tierwelt niclit
denken kann. Der einzige Umstand, der an eineni Zuriick-
yeben der Bacbfauna wiibrend des Winters sdmld sein kônnte,
der Mangel an bereinfallenden Landtieren, kann nicht so sclnver
ins Gewicbt l'allen, (ba vieb^ Bacbtiere aucb von piianzlicber
Kost leben konnen, ^ or alleni \o\\ diii-ren, faulenden Blattern
und Wurzelwerk, die ini Souuner und Winter im Bacli zu finden
sind.
Wàhrend die Fauna. des Tiïinpels und Sees ini Fridding er-
wacbt, im Sommer die luxdiste Bliite erreicbt und im Spiitlierbst
meist abstirijt, um den Winter in bitenten Zustiinden zu m^v-
bringen, ist die Tierwelt (Un- Gebirgsbiicbe aucli widu-end dei*
kalten Jabreszeit in voILm- Entwicklung. .Tabraus jabrcin findet
man junge und alte ïiere neben einandei'. Selbst ITu' Wirbeb
— 144 —
tici'f bcliiilt (liesor Satz seine Giillii;koil. So t'and icli in
Zc rniat i En(l(.' Aiigust nocli Entwicklungssladion von Rannf/fscf/ l)ci circa 2,000 Mcter in eincni Baclio. Lauterborn
Ijcobachk'to in Baclien des Pl'iilzei'waldes wahrend des
Miniers den braunen Froscli meln'facli mnnter unter Steinen
sitzend. Die torrenticole Lebensweise scbaltet also den ^^'intel•-
sclilafaus.
Eine Ausnabnie maebt die Larve von Liponeura hrcri-
rosf)-is ans deni Scbwarz wa Id , die mir eine ganz kurzc VaiI-
wickhnigzu dui'chlaut'en selieint und aueb als fertiges Insekt
kauni sebr binge Icbt. (Nab(;res dariiber sielie pag. 90 ff.)
Alb' andern Insektenlarven reagieren in Anpassung an die
gleiclimiissigen Temperaturverbidtnisse nicbt auf Jahreszeiten-
weclisel. Dies erkannte sebon Pictet bei den Epbemeridendes Bacbes. Ursprunglicb nimmt er an, dass die Larven ein
Jabr leben, dann fiel ibm auf, dass im Herbst \ie\e junge Larven
den Bacb bevolkerten und er scbloss daraus, dass die Larven zu
ibi'ci- Entwicklung nur ein lialbes Jabr bi'aucben. Swammerda.m
glaubtdie Daucr der Lai'venentwieklung auf (b'ei Jalire ansetzen
zu miissen. Die ganze Unsicliei'lieit bei'ubt auf der ungebeuern
Sebwierigkeit, (Ue das Ziieliten dieser stenotliermen Tiere ver-
ursaebt, sowie auf dei- sebwer verstàndlicben Tatsaclie, dass
man das ganze Jabr Larven des versebiedensten Altei's })ei
einander antrifft und dass trotzdeni die Imagines zu einei' be-
stimmten Jabreszeit sebwarmweise ausflicgen. Viellcielit bisst
sieb (Ue Frage so erkbii'en : Bekanntbcli fliegen die Epbeme-rîden immer an den Abcndcn sclioner Tag(> und zwar na.eli
meinen B("ol)acldungen nacb bingerem RegenwiMtci' nie ani
ei'slen scbonen Tag, sond<M'n erst am zweiten odcr (bittcn.
Somit scliien (be Dauer der IJebcblung auf den bHzten Abscbluss
der Metaniorpliose einen Einfluss zu baben. BekannJbe]i sind
die Insekten gegen Liebtreize sebr empfindlieb. Die Epbenie-ridenlarven der Gattungen Ecrlyuriis, Ei>eorii8, Irou und
Rhithrogeaa, (Ue uns bier liauptsiicliUcb interessieren, b'ben
immer unter Steinen, sind also liclitselicu ; die Imagines und
besonders die Subimagines wei'den im Gegenteil (buvli das
Licbl angezogen, wie man sieb leicbt iiberzeugen kann, ^\•enn
man sieb nacbts mit einer Lampe ins Freie setzt. Nun sicllc
icli mil' vor, dass die vorgescbrittensten Pup})en, bei dcncii das
Imaginalauge^ bereits dureli die PuppenliiiUe liiiKku'cli funk-
tioniert, durcb bingere Belicbtung in unsci'm Fall \om Sonnen-
— 145 —
sdiein angozogvn iliiv finsItM'n Scliluiil'winkel vei'lassen, sicli
ans Land bogchen uiid doi't ilire Mclamoi'phose al)scliliossen.
l)a (las Sonnonliclit cinc Zritlang- wii'kon muss, bis dir Larvcn
roagiorcn, lïdll die Fliigzcit meist aul' don Spiitnachmitlag und
Ai)ond. Zn diesor Hypoiliose passt soin- sel lôn die lîcohaclitnng-
PiCTETs, dass im Sommer, wenn die Sonne viel fn'ilu^r sclieint,
ol't die Scliwiirme sclion am Naclimittag auftrcten. Der Zeit-
punkt des Aiisfliegens sclieint also von der Daiier der voran-
gehenden Sonnenbeliclitung abziiliangen Nur auf dièse Weise
nnd niclit dureh Ândernng der TemperaturverliiUtnisse konne
die mebrl'acli bescliriebenen Falle erkliu't werden, \\o Insekten-
scliwiu'me mitien im Winter auf Sclniee beobacbtei wurden.
Wabrsclieinlich batte starke Belicbtung die Puppen be^\•og•en,
ans Land zu kriecben und hier hatte die Métamorphose stattge-
funden. Dass Puppen iiberwintern konnte ich verscliiedene Maie
besonders im Tirol beobachten.
Die Temperatur des Gebirgsbachwasst'rs ist eine tiei'e. Sie
crlaubi nur \v(>nigen anpassungsfiihigen Cosmojioliten und
stenothermen Ivaltwasserbewolmern, sich im Bach aufzuhalten.
Iviilte des Wassers iibt auf das Leben einen tiefgehenden
Einfiuss aus. Sie setzt den Stoffwechsel herab und verlangsamt
so die ?]ntwicklung. Dadurch wird auch das Nahrungs-
bediirfnis geringer. Die meislen Bachliere Averden auch durch
die forIwiUu'ende Stromung zu einem untatigen Zustand des
Hall»scldafes verurteilt, in dem sie wenig Nahrung bi^diirfen.
Ich si cil le mchrere Versuche an iib(n' das Hungervermogen
lorrcnlicolcr Ti»Mv. Fast iibcrall zcigic sich, dass sie sehr
wenig Nabrung zum L(>ben nôtig liaben. So zïichtete ich
Larvcn der Trichopterengattung Ayatanïa, die ich
vicr Monalc lang ohne Nahrungliess. Planarien hielten sich
soiîar noch viel lano-er, wie ich das in meiner Planarien arbeit
ausgefiihrl habe und wie sich vor allem aus den Hunger-
versuchen Stoppenbrinks ergibt. Auclie Gammarus vermag
sehr lang(^ zu hungern. Wenn man mit solchen Daten die
Nahrungsmengen vergleicht, die ein Tiimpeltier wiihrend
eines Tages zu sich nimmt, so sclieint der Unterschied fast
unglaublich.
Der Mangel an i)flnnzliclier Nahrung ruft im Bach vielfach
eincr carnivoren L(>bensweise ; docli sind auch sehr vicie, z. 15.
die meisten Trichopteren und Dipieren, wahrscheinlich
auch manche Ephemeriden und Perliden omnivor. Her-
— 146 —
bivor sind die Mollusken und von den I)i])teren die Stratio-mjiden und Pkalacrocera. Von den Planarien kann sieli
Planarïa alji'nia aucli mit Algennahrung begniigen, wie mir
zwei Funde iin Kliatikon beweisen. Die Quant iliit dei- Raeli-
fauna ist in holiem Grade abliangig von {\vv Menge ^Wv vorhan-
denen i)flanzlic]ien Naln'ung. In moosreielien Biiclieii entfaltet
sieli der grossie Reiclidun an Arten und ludividuen.
3. Ursprung der Bachfauna.
Die édite Baehfauna sebeint ans Ti'unpel- und ^^Vi]lel•fornlen
bervorgegangen zu sein. Beide Extrême lasstni sieli unsebwer
dureh UbergangsfornK'ii verbinden, die Icils (b'iii Fhiss und
langsamfliessenden P)aeb des Taies angehoren, teils sebon
torrentieol werden, wenn ilu'e Anpassung aueb noeb niangelliaft
ist. Ol't lassen sieli aus iiab(^ Ncrwandten Gattungen und
Arten eigentliebe Ubergangsi-eiben nacb ib^n Grad der mor-
pbologiseben Anjiassung ans Baelilel)en aut'stellen, wie ich dass
bei den Hvdracai'inen (pag. 56 ff.) anzudeuten versuelit babe.
Man kann ^•erfolgen wie selirittweise die Mei-kinale des stelien-
d(ui Wassers, Scbwimmiïdiigkeit, Ruder- und Steuera])parate,
Luftatmung, ete. veidoren gelien, wiibrend torrentieole Merk-
male, Fixations- und Reientionseinriebtungen, Hautatmuiigete.
iinmermebr sieli entwiekeln. Nicbtverbelilen darf ieli, dass oft
wenig angepasste Formeii auttallend boeli eiiqiorsteigen und
sebr wilde Bâche bewobnen konnen, widirend gut ange])asste
zwar immer aber nielit aussebliesslicb stark bewegtesWas-ser aufsuclien, sondern da und dort aueli in rubigeren Biielien
leben.
Trotz diesen Ausnalimcn entspriebt jedocli der Cbaraeter der
Tierweit deiii des Bâches; im stark bewegten Wasser trittt manN orzugs\\'eise gut im rubigen wenig angepasste Formen.
Nun stellen wir die Frage : M^arum entsebliessen sicli Tiere
des stehenden Wassers zur Auswand(M'uiig in den Bach, wo(loch die Lebensbedingung(Mi und \or allem die Nabrungsver-
biiltnisse so n iel schleebter sind als in ibrer friiberen Heimati^
Man konnte denk(>n, es s(>ieii die glcicbcn Griindc, di<' brute
nocli deiii Bïïcb Cos!iioi)()liteii zufiibrcii : l'l)('r\(')ikei'ung des
urspriinglieheii \\'olingebieU'S und Ausbuiigerung durcb Artge-
— 147 —
iiosseii. Alléin dièse Annalime (M'kl;ii'l das Felileii der heutigen
ecliten IJaclifauna in Fluss uud Tiiiniicl nielit. Die Hesieddung
(1er Bac]i(> war deslialb iiielil eiii(> Aus\\anderung iiifolge von
rbervôlkerung, sondern eine •' Fluelit ".
Spiiren wir den Gifuiden nacli, welclie die torreniicole Fauna
ans den Seen, Tiimjx'ln und Fliissen verlrieb.
Am ehesten werden wir zum Ziel gelangen, wenn wiv die
Lebenso-ewohnheiten der Baclitiere mit denen der Weihertiere
vergleiehen.
Die bachbewohnende Tier^^•elt ist biologiscli cliaracterisiert
durcli A'orliebe fiir tiefe, constante Teniperaturen, sie darf als
•• stenotlierm- bezeichnet werden. DieBewolmerdes slehen-
den Wassers der Ebene sind entweder Warmwassertiere und
brine-en die kalte Jahreszeit in Danerzustiindenzu oder sie ertra-
gen die weistesten Tenii)eraturgr(Mizen mit Leiclitigkeit, verdie-
nen also die Benemnmg • eurytherm •• (Môbius).
ZscHOKKE fasst stenotberme Kaltwassertiere, die zu gleicber
Zeit nodi andere Bedingungen erfiillen als Glazialtiere auf,
als R e 1 i k t e e i n e r e i s z e i 1 1 i e h e n F a u n a . Er verlangt ausser
dem Vorkommen im kalten Wass'/r der Gebirge gleielizeitiges
Vorkommen im Norden, in der Tiefe der subalpinen Seen und
in isolierten kalten Gewassern der Ebene. Selbstverstiindlieh
kann ma.n nielit (U'warten, dass aile Relikte sammtlielie
Bedingungen erfiillen, ofl treten z. B. im Norden nalie ver-
wandte Formcm auf, die nian sicli durcli Divergenz aus einer
gemeinsamen Stammform entstanden denken kann.
Priifen ^^'ir nun die Frage, ob unsere stenotlnn-men Bacli-
bewohner die geforderten Bedingungen erfiillen und als Gla-
zialrelikte aufgefasst M'erden diirfen.
Leider wurden die Bâche 1ns jetzt nocli sehr wenig faunistisch
untei'suclit und liau])tsac]dich im Norden fehlen nocli seiche
Parallelarbeilen, die uns w^ohl ^^'ertvolle Ergànzungen liefern
kônnten. Immerhin ergaben sich einige wichtige Beziehungen
bel den H ydracarinen (s. pag 00, (57).
Die Faunen der Mittelgebirge und der Alpen sind sehr jUmlich
zusammengeseizt. Hauptsachlich bei den Insektenlarven gab
esnur wenige Arten, die niclit an beiden Orten auftraten.
Endlich stellen aucli manche Formi^n die gei'oi'derten Be-
ziehungen zwischen Bach- und Tiefenfauna lier, wie im Kai)itel
iiber die Zusammensetzung der Baclifauna gezeigi wurde.
Somit wage ich die Behauptung aufzustellen, dass aile
— 148 —
cclitcn Ci ('l)i l'i^'sbacli ticrc , (lie lien le dcr Eln'nc folilcn
als Glacialrclikl (' aut'gct'assl wcrdcii iniisscii.
k'ii onvaiic bostinimi, dass durcli s});il(M'(' î'nicrsuchungcn
sicli die Ahiiliclikoit in dor Zusammpnsctzung dov Faima des
Xordens imd (1er der Gebirgc nocli deutliclier liei'aussteilen
^^'i^d.
Fiiliren wir uns nocli voi'Augen, wie der Verdriingiingspro-
zess verlaufen sein miiss und ^\•as i'i'ir Faktoren liau})isaclilicli
mitgewirkt haben.
Zur Zeit dei' letzten grossen Vergleiseherung traien aiif der
scbnialen Landzunge, die zwisclien den Gletschern des Noi'dens
und deiien der Ali)en ausgespart war, eine grosse Anzalil in'<\r-
giazialer Tiere zusamuKMi. Teils waren es Tiere der Ebene,
leils wurden sie ans ihrer alpinen oder nordisclien Heimat durch
die Norruckenden Gletscher auf das eisfrei bleibende Gebiet
gedrangt.
Dièse Glazialfauna. iebte in Wasser von constanler tiefer
Temperatur, Sauerstoffreiclitum und schleeliien Nahmngsbe-
dingungen, sie zeielnielen sieh also duivh langsamen Stoff-
^\'eehsel, grosses Hungerverinôgen, langdauernde Euibryonal-
ent^vickkmg• und grosses Sauerstottbediirfnis aus. Aile dièse
Eigcniscliaften Ivomraen der lieutigen eclitiMi IJacht'auna in mebi'
oder weniger ausge])r;igler WVise zu.
lîeim Warmerwerden des Klimas anderlen sicli im Tal dièse
Verlijiltnisse. Mit dem Steigen der A^'asserieini)eratur ging
Hand in Hand eine Venninderung des Sauerstoit'gelialles. Auf
ih'V andern Seile aljei- steigerle sicli durcli starkere Erwarmung
der StoftVeehsel und mit ihm das Sauersioftbediirruis. Bei so
ungiinstigen Bedingungen ging dlo glaeiale Fauna raseli dem
Absterben enigegen, besondei's als nun eine neue Fauna ein-
draug, eineA^^armwasser- und riii((uisl(>nfauna, die sieh bei den
neuen VerliiUtnissen wohlfiihlle, l'aseli vermehrte und der alt-
eine-ebiirfferten Kallwasserfauna, die durcli den gesteigerlen
Stoffweclisel immer notN\endigere Nahrung streitig maelite.
Nur wo die Wasseriemperalur naeli ^^•ie vor eine tiefe blieb,
konnten sicli unsere Tiere noeli lialten. So folglen sie denn
dem schm(dzen(len Fis in die Biiehe. Die neuen Einwanderer
kounlen den Fliiclitlingen nielit folgtni, da sie sieli nieht so
l'aseli an das tliessende \^'^asser gew("»lmeii konuleu. Letztere
(M'fuhren nun ein verseliiedcMies Seliieksal. Maiieli(> fiilirten die
zuriiekweielienden Gletscliei- nacli Norden, andere i'olgten dem
— 149
selimelzpndon Eis iii dio Hoclialpon, oinigo stiogon in die kiilile
TieiV der Seon liinuiitei' uiid ein wcitorer Toil suclitc die kalten
Gewiissoi- (Ici- Mittelgebii'ge aiif.
l)ei don Roliklon, die vom Baclilc^ben au^^g•escldos^en \^•al•en,
ersetzte j)assive Ùbertragung dnivli Insekten und Vogel die
aetiv(^ Waiiderung. Manche Tiere beni'itzlen die l>;ieli(' als
Auswandei'uiigssli'assenvoni Tiïnipel dt^s Taies biszuni GbMselier-
see der Hoelialpen; sie i)assten sicli, an ihrem Ziele angehingt,
^^•ie(lel' an das stehende \A^assei' an. So konnte ich in mehre-
ren bochalinnen Seen die Anwesenheit echt toi-renticoler Lebe-
\\esen wie z. B. Plandvia alpina, Nemuralavxon etc. eon-
slatieren. AnebZscHoKKE fand da und don Baehtirre untei-den
ri'ei'steinen der Hoeliseen glaubt al)er, dass es sieh meist umZnlVdle liandelt. Die Mchrzald der Fliiehtlinge, die sicli den
B.ïehen anvortraiil liattcn, geriet jedocli in eine •• Saclvgasse •
nnd halte niehl (leh-gcnheit, in cinen S<'(^ 0(Um' Tiimpel zu
gelangen.
Einigen Art en geniigte die tiefe T(Mnp(>ratur der Baelie nicht;
sie wanderten in die Quell(>n liinanf und von da ins Innere der
Erdc, in die Hôhlengewiisser, zu denen jahraus jalnvin kein
^^;u•lll(ndel• Sonnenstrahl liinunterdringt und die dcshalb stets
eine gleielnniissige, tiefe Temporal ur bositzen.
So triigt also (lie Tiorwelt des Sturzbaehes eincn (knvliaus
glaziaU'U Character, der sicli wold nirgends sonst so rein zu
erhnlton vermag. Dios habon \\ir don starken biologischon
Eigentiindiehkeiten des lîaeldebens zuzuschreiben, die hier
iiH'lu' als andersw'O das eosmopolitisehe Elément zuruekhalten.
— 150 —
IV
ZUSAMMENFASSUNG
1 . Die cliarakteristischen Bedinguiigen des Gebirgsbaclies sind :
a) Constante, tiel'e Temperatur;
b) Starke Strômung und Schwankungen ini Wasserstand;
c) Saiierstoffreiclitum infolge der heftigen Wasserbewegung;
(J) Pilanzenarmut;
e) Steiniger Untergi'und.
2. Die vorgenannten Bedingungen di'i'icken dei' Tierwelt
einen characteristischen Stempel auf und beeintlussen :
(i) Zusamnienselzung ans resistcnton Cosmopoliten und
stcnol liermen Siisswassei'bewohnern;
h) Korpei"gestalt : Morpliologisclie Anpassungen, Fixa-
tions- und Retentionseinrichtungun, dorsoventrale Ab-
plaitung, Verz^^'el•gung etc.;
c) Lebensweise : Geringes isabi'ungsbo<liirFnis, lang-
danci'ndc End)ryonalentwicklung.
3. Die Dacbi'auna. setzt sicli zusamnien aus:
(i) Cosmopoliten, Ubiquisten;
h) Torreniicol-profunden Elcnicntcn;
() pA'hten l>ae]itier(>n.
4. Die I>aeld'auna wii-d aus Fornien gebiidet, die urspriing-
lich deui stebendcn Wasseï' angehoi'ten. Der Einfluss des
l>ae'blebens giebt sicb bei den einzelnen Formen vei'scbieden
deutlieli zu erkennen.
5. Aile ecliten Gebirgsbachformen diirl'cn aïs Glazialrelikte
aufgefasst werden, wcil sic die von Zsciiokkk gefor'derten
Bedingungen :
(() Gleiclizeitiges A'orkonuneii ini Ccbirgc und ini Noi'den;
b) Gleiclizeitiges Voi'konnnen ini Ccbii'ge und in der Se(>n-
tiefe;
c) Feblen in den warmen, stebeudcn und langsam-
fliessenden Gewassern der Ebene;
d) Fortpflanzung bei tielen Temperaturen,
nielir oder weniger erfûllen.
Alphabetisches Verzeichnis der im Bachgefundenen Arten.
Mein Matorial bosîelit ans 121 Gattungen imd 223 Arten,
die liier alpliabetiscli geordiiet nocli einmal zusaminengestellt
werden s;ollen.
1. [Agabus congener] ... .... 112
2. Agapfitus fuscipes 9()
3. [Anacaena limbata) . . 112
4.. Ancylus capuloides 122
5. » fluviatiUs 120
6. Apatania fimbriata .... . 89
7. [Asellus aqualicus] 56
8. Atherix spec 109
9. Atracti(le.s nodipalpis 57
10. » octoporus . 57
11. » spinipes 57
12. Aturus asserculatus. 59
13. )) criiiitus . . 59
14. » inlermedius . ... 58
15. » scaber 58
16. Baëlis gemellus . 73
17. » • spec. . . ... 73
18. Beraea mauriis 87
19. Bylhinella abbreviata . 123
20. » alla 123
21. » Dunkeri 123
22. Callidina bidens 39
23. » parasitica 39
24. Caloiiyx latus 57
25. Candona spec 53
26. Canthocamptus rhaelicus 51
27. [Centropyxis aculeata] . .... 38
28. Ceratopogon spec HHi
29. Cbiroiiomus llavus (?) lOi;
30., » plumosus 106
31. » spec 106
32. Chloroperla grammatica 84
33. » rivulorum 83
34. Chydonis splia>ricus 49
35. Colhurniopsis vaga 39
36. Crunoecia irrorata . • 87
37. Cyclops fimbriatus .... .... ol
38. Cyphoderia ainpuUa 38
39. Cyphon spec '"'
40. Difflugia pyriformis 3N
41. Dictyopterys Imhoffi ^i
4(2. » spec • •«^4
43. Drusus discolor .... 8/
44. » spec^~
45. Ecdyurus lluminum'3
46. » helveticus ... 73
47. » lateralis 73
48. » venosus 73
49. Elmis aeneus Ui
50. » (iermari . . 114
51
.
» Maugetii J ' i
5(2. » sodalis • •115
53. Epeorus alpicola (?)"3
54. » torrentium"3
55. Ephemerella spec ''S
56. Feltria arniata 58
57. » brevipes 58
58. « composita ' 58
59. » jurassica 58
60. » minuta 58
61. » rubra 58
6"2. » liouxi 58
63. » scutifera 58
(li. rt Zschokkei ... i><^
65. (lammarus pulex ^^^
66. ') pungens 55
67. Glossiphonia heteroclita i9
68. > stagiialis ^^9
69. Glossosoma Holtoni^~
70. Gorra spec^"
71. [(iyralor herniaphroditus] -iO
7'2. [Heleporus glacialis] ' •-
73. Helicopyche spec ^~'
74. [Herpetocypris spec.) 53
75. Hjartdalia runcinata 59
76. Hydraena aiigustata 113
77. » gracilis 113
• 78. » spec 113
79. [Hydrobius limbatusj Il"2
80. [Hydroporus balensis] 11-
81.I
» nigrita] 11"2
82. [ » nigrolinealus] 11"2
83. 1.) nivalis] 11'2
84. » spec. (Larven) 11-
85. Hydropsyche spec^~
86. Hydrovolzia cancellata 59
87. » placophora 59
— 154 —
137. Neritina fluviatilis 125
138. Nipliargus puteanus 55
139. » tatrensis 55
140. [Noterus sparsus] 112
141. Odoiitocerum albicorne 87
142. Oligoneuria rhenana 73
143. Osmylus maculatus . . 111
144. Oxycera spec . 109
145. Oxyethira sagittifera (?) . 87
14(3. [Papiriiis miiiutus] 72
147. Panisus torrenticolus 57
148. Parnus auriculatus 114
149. Partnuiiia angusta .... 57
150. » steinmanni 57
151. Pedicia rivosa 108
152. Pericoma spec 110
153. Perla cephalotes 83
154. » margiiiata 83
155. » maxima ? . 83
156. Phalacrocera spec. ? 107
157. Philodina roseola 39
158. Ptilocolepus granulatus 87
159. Pisidium ovatum 126
160. Planaria alpina 42
161. Planaria cavatica 42
162. » gonocephala 42
163. y> lactea 42
164. » torva 42
165. ( » albissima) 47
166. ( « Mrazek-i) 47
167. ( » vitta) 47
168. [Planorbis contortus] 120
169. Plectrocnemia spec ... 87
170. Polycelis cornuta 42
171. » nigra 42
172. Polycentropus flavomaculatusV 87
173. Potamanthus liiteus . . 73
174. Proaies spec. ? 39
175. Prionocypris serrata 52
176. [Prorhynclms stagnalis] ..... ..'.... 40
177. ( ^> fontinalis) 41
178. Prosopistoma foliacea 73
179. Pseudosperchon verrucosus 58
180. Pseudotorrenticola rhynchola 58
181. Fihithrogena semicolorata 73
182. Pihyacophila aquitaiiica 87
183. » _ glareosa-gruppe 87
184. » nubila? ". 87
185. » vulgaris-gruppe 87
— 155 -
186. Rotifer vulgaris 39
187. Sericostoma timidiim8"
spec 87
189. Silo spec 8/
190. Simulium spec lOi
191. Sporadoporus iiivalvaris . 57
192. Sperchon denticulatuç 58
193. » glandulosus 58
194- « insigiiis 58
195. » koenikei . .58
196. » inontanus .... 58
197. » mutilus 58
198. » plumifer 58
199. » setiger 58
200. « vaginosus 58
201. Stactobia eatoniella 87
202. ( » fuscicornis) 87
203. Slenophylax pizzicornis 87
204.. » spec 87
205. Stenostoma leucops 40
206. Taeniapteryx risi 84
207. Tabaiius cordiger 109
208. Taiiypiis spec 106
209. ïaiiytarus dives (?) 104
210. » spec 104
211. Teutonia primaria 58
212. Tipula gigantea ? • 108
213. » liitescens? 108
214. » spec 108
215. Thyas curvifrons 57
216. » oblonga 57
217. » thori 57
218. Thyopsis cancellata 57
219. Torrenticola anomala . . • 58
220. [Valvata pisciiialis] 125
221. Vitrella helvetica 124
222. Vortex spec 40
223. Wulpiella spec 106
iV. B. Die mit eckigen Klammern[ J
bezeichiieten Arton sind Zufallsfunde,
die mit runden Klammern () wurden von mir nicht torrenticol gefnnden.
LITERATURVERZEIGHNIS
AuBÉ. Ch. Iconographie et histoire nat. des Coléoptères d'Europe, t. V.
BoRELLi. Osservazioni sulla Plan. alp. (Dana). Boll. Mus. zool. ei Anat.
comp. Torino, 8, 1893.
BoRELLi. Sulla presenza délia Planaria alpina e délia Polycelis cornuta
nei Pirenei. Boll. dei Musei zool. ei Anat. comp. Torino. t. XX, 1905.
Brauer. Fr. Die Zweifliigler des kaiserl. Muséums zu Wien. Denkscbr. d.
k.k. Akad. d. Wiss., 47, 1883.
Brockmeier, h. Die Lebensweise v. Limnaea tnincatnla. Forsch.-Ber.
Biol. Stat. Pion., G, 1898.
Chapuis etCandèze. Catalogue des larves des coléoptères. Bd. 8.
Chichroff. Becherches sur les Dendrococles d'eau douce. Arch. Biol., t. XII,
1892.
CiiiCHKOFF. Sur une nouvelle espèce du genre Phagocata Leidy. Arch.
zool. expér. et générale, t. IV, 1, 1903.
Clessin, s. Exciirsionsmolluskenfauna. Nûrnb., 1884.
Clessin, s. Die Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns u. d. Schweiz. INiirnb.,
1887.
Dewitz h. Beschr. d. Larve u. Puppe v. Liponeura breviroslris Pow. Berl.
Ent. Zeitschrift, 2.5, 1881.
DuGÈs. Recherches sur l'organisation et les mœurs des planaires. Annal.
d. Se. nat., série I-XV, 1828.
DuGÉs. Aperçu de quelques observations nouv. s. I. planaire et pi. genr.
voisins. Ann. Se. lNat.,21, 1830.
Eaton. A Revisional Monograph of Récent Ephemeridae or Mayflies. Trans.
Limneal societyzool. 3, 1888.
Favre. Faune des coléoptères du Valais et des régions limitrophes. Neue
Denkscbr. Schw.Ges. Nat., XWI, 1890.
FoREL, F.-A. Le Léman. Monographie limnologique, 1. 111. Lausanne, 1901.
Fredericq. Présence de la plan. alp. Dana en Belgique. Bull. Ac. roy. d.
Belg., cl. des se, 1905.
Fredericq. La faune et la flore glaciaires du plateau de la Baraque-Michel.
Bull. Ac. roy. de Belgique, cl. d. se. 1904.
Fuhrmann. Die Turbellarien der Umgebung von Basel. Revue suisse d. zool.,
2, 1894.
Geyer, D. Land- und Siisswasser-Mollusken. Stuttgart, 1890.
Geyer. Beitriige zur Vitrellenfauna Wiirttembergs. Jahreshefte d. Ver. fur
vaterl. Naturk. in Wiirttemb., 1904.
Geyer. Beitriige z. Vitrellenfauna Wiirttemb. .lahresh. d. Ver. fiir vaterl.
iNaturk. in Wiirtt., 1905.
Geyer. Beitr. z. Vilrelleiifaiiiia Wiirtt., t.lll. .lahreshefte d. Ver. fi'ir vaterl.
Naturk. in Wûrltemb., U)<)(k
Graeter, A. Die Gopepoilen der Umgeb. V. Basel, t. XI, 1903.
Heer, 0. Fauiia coleopterorum helvetica. Turici, l.Sil.
Heinrichs, B. Hirudineeu d. Umgebuiig- von Item, llaiinover, 1905.
Heller u. V. Dali.A Torre. Ueber die Verl)reitungd. Tierwelt im Tiroler
Hochgebirge. Sitzber. der k. Akad. Wissenschaften. Wien, 83 1881.
HuDSON AND Gosse. Ilotifera. London, 1889.
Karsch. Aus der Biologie der lîlepharoceriden. Biol. Centr., Bd. 1, 1881/82.
Kauffmann. Die scbweiz. Cytberideo. Bévue suisse zool., 4, 1896.
Kaukfmanx. Cyprideii und Darwiiiuliden d. Scbweiz. Bévue suisse zool., 8,
1900.
Keller, J. Die uiigescblechllicbe Fortpllanzung der Si'isswasserturbellarien
Diss. Zurich. Jena, 189i.
IvELLER, J. Turbellarieii der Umgeb. v. Zûricb. Bévue suisse zool., 3, 1895.
Ive.mpny, p. Zur Keniitnis der l'lecoi)teren. I. Ueber Nemura. Zool. bot.Wien,
1885.
Kempny, p. Ueber die Perlidenfauna Norwegens. Zool. bot. Wien, 1900.
Kennel. Untersucbungen an neuen Turbellarien. Zool. Jahrb. Anat., 1889.
KiRCHNER u. Blociimaxx. Mikrosk. Tierw. d. Siisswassers.
KoENiKE. Zwei neue Hydrachnidengattungen a. d. lUiiitikon. Zool. Anz.,
1892.
KOEXIKE. Noch eiiie Hydracbuide aus dem Bhiitikon. Zool. Anz., 1893.
KoENiKE. Neue Sperchonarten a. d. Scbweiz. Bévue suisse de zool., 1895.
KoENiKE, F. Ueber bekannte u. neue Wassermilben. Zool. Anz., 1895.
KoENiKE. Acbt neue Lebertiaarten, eine Arrhenurus u. Alract.-Art. Zool. Anz.
1902.
KoENiKE. Ueber ein paar Hydracbniden a. d. Scbwarzwald nebst Beschr. etc.
Mitt. Bad. Zool.-Ver., 13/15, 1902.
Lampert. Ueber die Nabrung der Bachforeile und des liachsaiblings. AUg.
Fischerei-Zeitung, Nr. 15, 1900.
Lampert B. Ueber die Verbreitung der dendrocoelen Strudelwiirnier in
SLiddeutschland. Jabresb. d. Ver. vaterl. Naturk. Wùrttemb., 60, 1904.
Lauterborn, B. Beitriige z. Microfauna und Flora der iMosel. Zeitscbrift fur
Fischerei, Jahrgang IX. 1901, 1.
Lauterborn, B. u. AL Bimsky-Korsakow Eine merkwûrdige Hydroptiliden-
Larve {Ithytrichia lamellaris Etn). Zool. Anz., XXVI, 1903.
Lauterborn. Beitr. z. Fauna u. Flora d. Oberrheins, t. II, Faun. u. biol.
Notizen. Mitt. Pollicbia, 1904.
Lauterborn. Z. Kenntnis einiger Chironomidenlarven. Zool. Anz. 1905,
t. XXIX.
Lauterborn. Die Ergebnisse einer biol. Probeuntersuchung des Bheins.
Arbeiten a. d. kaiserl (iesundbeitsamte, t. XXII, 3, 1905.
Lauterborn, B. Demonstrationen aus der Fauna des Oberrheins und
seiner Umgebung. Verh. deutschen zool. (ies. in iMarburg, 1906.
Leydig. Naturgeschichte der Dapbiiiden. Tûbingen, 1860.
Lilueborg, W. Cladoceva sueciae. Nova acta reg. Soc. Scient. Upsaliensis,
ser.,lll,t. XIX, 1901.
Maglio, g. Secondo elenco d'idracne del Pavese. Bend. Ist. Lomb-, 38, 1905.
— 158 —
Maglio, C. Idracnidi nuovio. poco nosi dell Ilalia sup. Zool. Anz.,30, 1906.
Me Lachlan. a monographie revision and synopsis of the Trichoptera of
theEur. Fauna. London, l<S7i-l<SN0.
Me Lachlan. Op. cit. First add. Supplément, l(S8i.
Meyer-Dlïr. Neuropteren d. Schweiz. Mitt. Schweiz. ent. Gesellschaft, t. IV,
1874.
Miall and Walkek. The Life-history oi Pciicoina camscens (Psychodidae).
With a biographical and critical appendix by Baron Osten-Sacken.
Transactions Entom. Soc. London, 1(S!)5.
Miall, L.-C U Siielford, Il.The Structure and Life-history ofP/^t/acroa'rrt
replicata. Transact. Entom. Society, lNi)7.
Moquin-Tandox. Monograpiiie de la famille des Hirudinées. Paris, l<Si().
MoNTi, R. L'eteromorphosi nei Dendrocoeli d'aqua dolce ed in part, nelle
PI. alp. Rend, del Inst. Lomb, t. 11, 18i)9.
Monti, R. Ueber eine neue Leb. art. Zool. Anz., 26, 1903.
MoNTi, R. Ueber eine kûrzl. entdeckte Hydrachnide {Polfixo placophora).
Zool. Anz. 28, 1905.
MoNTi, R. Génère e spec. nuovi d'idracnide. Rend. Ist. Lomb., 38. 1905.
Mrazek. Ueber eine neue polypharyngeale. l*lan. aus Monténégro. Sitz bar.
b. k. bôhm. Ges. d. Wiss., 1903.
MuLLER, F. Verwandlung u. Verwandtschaft d. Blepharoceriden. Zool.
Anz., 1881.
Needham, Morton,Johannsen. May-Flies and Midges of New-York. New-
York State Mus. Bull. 1886
NoRDQULST, 0. Moina bathycola (Vernet.) und die grôssten Tiefen in welchen
Clad. gefunden wurden, t. XI, 1888.
Penard, E. Faune rhizopodique du bassin du Léman. Genève, 1902.
PiCTET, F.-.L Recherches pour servir à l'histoire et à l'anatomie des Phryga-
nides. (!enève, 1831.
PicTET. Histoire générale et particulière des insectes névroptères. Famille
des Perlides. Genève, 1842.
PiCTET. Histoire nat. gén. et part, des insectes névroptères. Famille des
Ephémérines. Genève, 1843.
PieTET. iMémoire sur les larves des Némoures. Annal, se. nat., t. 26.
PiCTET. Mémoire sur les métamorphoses des Perles. Annal, se. nat., t. 28.
PiERSiG, R. Deutschlands Hydrachniden. Zool., 22, 1900.
PiERSiG, R. (u. LonMANx) Hydrachnidae u. Halicaridae. das Tierreich,
1901 (1).
PiERSiG, R. Eine neue Aturusart. a. d. hiihmisch-bayrischen Walde. Zool.
Anz., 25, 1901.
PiERSiG,R. Eine neue Hydrachn. a. d. bôhm.-bayr.\Valde. Zool. Anz. 25, 1901.
PiERSiG, R. Neues Verzeichnis der bisher im siichs. Erzgeb. aufgefundenen
Hvdr. Ber. Annab. Ver. 1903.
(1) Die HydraclinidenliUTatur vor Pieiisk; « Hydraclinidao im Tierreich »
wurde niir wenij^'' heriieksiclitiyt, da sie lui i^cnamitcn AVcrke aufgenom-inen ist,
— 159 —
PiERSiG, R. Ueber eine neue Hyilr. ans dem IJohmer-Walde. Zool. Anz., "27
1904.
PiERSK., H. Eine neue Aturusarta. d. bolim.-bayr.Walde. Zool. Anz. Hl, 19UI.
Plate, K. Beitr;i!,^e zur Naturg-eschiclite der Tardigradeh- Zool. .lahrb. Anat.
u. Ontogenie, Bd. 3.
J. PumiEH ET BiîUYANT. Les Monts-Doi-eetla station limnologique de Besse.
Ann. d. Biol. lacustre, t. I, 190(i.
Protz, a. Eine neue Hydrachnide a. d. (iattung Aturns Kram. Zool. Anz.,
"15, 1901.
Bedtexbacher. Fauiia auslriaca : Die Kafer. Wien., 1858.
Richard, J. Note sur Moina bathycola (Vernet). Zool. Anz., t. XI, 1888.
Ris. Neuropterologischer Sammelbericht, 189i-189H. Mitt. Schweiz. ento-
molog. Ges., 9, 10
Ris. Trich. d. kant. Tess. u. angr. (iebiete. Mitt. Schweiz. entom. Ges.,
t. I, 1.
Ris, F. Die schweizerischen Arten der Perlidengattung Nemura. iMitt.
Schweiz. entom. Gesellsch., Bd. 10., Heft. 9.
Ris, F. Einige Neuropteren a. d. .louxtal. Mitt. Schweiz. entom. (ies. 10, 5.
Rouge.mont. Notice sur VHelicopsijchc spemta, Me L. Bull. Soc. Neuchcàtei,
1879.
RouGEMONT. Ueber Helicopsyche. Zool. Anz., 1879.
Roux, J. Faune infusorienne des eaux stagnantes des environs de Genève.
Genève, 1901.
ScHAiEiL. Deutschlands freilebende Sûsswassercopepoden. Zoologica 1892-
1898.
ScHMiDT-ScHWEDT. Kerfe u. Ivertlarven d. sûss. Wass. bes. d. stehend. Gew.Zacharias : Tieru. PHanzwelt d. Sûsswassers. Leipzig 1891.
SciiMiDT, 0. Die dendrocoeien Strudelwiirmer a. d. Umgeb. v. Graz. Zeitschr.
wiss.Zool., XBd.. 1860.
ScHMiDT, 0. Ueber Planaria torva. Zeitschr. f. wiss. Zool., t. XI, 1862.
SiMROTH. Die Entstehung der Landtiere. Leipzig, 1891.
SiLFVEXius, A.-J Ueber d. Métamorphose einiger l'hyg. u. Limnoph. Act.
Soc. Faun. Flor. fenn., 21, 1902.
SiLFVENius. Ueber d. Metamorph. einiger Hydropsychiden t. II. Act. Soc.
Faun. Flor. fenn., v. 26 2, 1903.
SiLFVENius. Ueber d. Metamorph. Phryg. u. Limnoph. II. Act. Soc. Faun.
Flor. fenn., 25, 1903.
SiLFVENius. Ueber Metam. einiger Phryg. u. Limnoph. III. Act. Soc. Faun.
Flor. fenn., 27, 2, 1904.
SiLFVENius, Z. Trichopterenfaunad. Ladogakarelien. Act. Soc. Faun. Flor.
fenn., 27, 8, 1906.
SiLFVENius. Trichopterologische Untersuchungen. 1. Ueber d. Laich d.
Trich. Act. Soc. Faun. Flor. fenn., 1906.
Steinmann, p. Geographisches und Biologisches von Gebirgsbachplanarien.
Arch. f. Hydrobiol., 1. 11, 1906.
Stingelin. Die Cladoceren der Umgehung von Basel. Rev. Suisse de Zool.
t. III, 1895.
Stoi'PENBRInk. Die (ieschlechtsorgane der Sùsswassertricladen. Zeitschr.
f. wiss.Zool., t. LXXIX, 1905.
— 160 —
Stoppexhrink, F. lier Einfluss herabg-es. Erniihrung auf d. hist. Raud.
Strudehv. Diss. P.onii. 1*,)()5. Zeitschr. f. wiss. Zool.,7'.), l.
Struck. IviibecUsclie Tricli. u. Geh. ihrer Larveii uiid Puppen. Liïbeck, l'JOO.
Struck. Beilr. z. Keniit. d. Tricliopterenlarven. Lub., 1903.
SuRBECK. Die MoMuskenfauna des Vierwaldstiittersees. llev. Suisse d. Zool.,
6, 1899.
Terxetz. Ilotatorien der Umgebung v. Basel. liasel, 1S92.
Thiebaud ET Favre. Contribution à l'étude de la faune des eaux du Jura.
Ann. Biol. lac, I, 19U6.
Thienemann. Putzapp. d. Trich-Puppen. Zool. Ain. .'21, 1904.
Thienemann. Z Trich-Fauna v. Tirol. Allg. Z. Entom., 9, 190.i.
Thienemann. Ptilocolepus granulatus Tich. Allg. Z. Ent., 9, 1904.
Thienemann. Biol. d. Trichopterenpuppe. Dissert, lena, 1905.
Thienemann, A TirolerTricbopteren. Zeitschr. d. Ferdinandeums, t. 111,49,
1905.
Thienemann. l'Ianaria alp. auf lUigen uiid die Eiszeit. .Jahrber. Geogr. Ges.
Greifswald, 1906.
Thienemann, A. Die Tierweltder kalten Bâche und Quellen auf Uûgen. Mitt.
des Naturh. Ver. f. Neupommern u. Rûgen z. Greifswald, 38, 1907.
Thon, K. Neue Hydrachn. aus d. Bohmerwald. Zool Anz., 1901.
Thon, K. Ueber ein neues Hydrachnidengenus aus Bôhmen. Bull. Cesk.,
6, 1902.
Thor, Sig. Zwei neue Hydr. Gatt. u. 4 neue Artenaus Norw. u. Bemerkung.
ùber Begattung v. Hjartdalia n. g. Zool Anz., 1903.
Thor, Sig. Zwei neue Spei-clion-Arten u. eine neue Aturus-Art aus d. Schweiz.
Zool Anz., 26, 1902.
Thor, Sig. Ueber Hydrovolzia Sig. Thor. Zool. Anz , 29, 1905.
Thor, Sig. Beitriige z. schweiz. Acarinenfauna. Bévue suisse Zool., 1905.
Thor, Sig. Lebertiastudien. Il-V. Zool. Anz., 29, 1905.
Thor, Sig. Lebertiastudien. Vl-Vll. Zool. Anz., 29, 1906.
Thor, Sig. Einc intéressante neue Milbengattunga. d. Schweiz Sammiungd.Herrn. D' W. Volz. Zool. Anz. 28, 1905.
Thor, Sig. ]>eberfia Stutien, t. XI-XIV. Zool. Anz. 36, 1906
Thor, Sig. Uber zwei neue in il. Schweiz von Herrn G. Walter (Basel) er-
beutete Wassermilben. Zool. Anz. 31, 1906.
Ulmer. Anleit. z. Fang. z. Aufzucht u. Konserv. der Kocherfliegen. Allg. z.
Entom., 7, 1902.
Ulmer. Zur Trichopterenfauna des Schwarzwaldes. Allg. Zeitschr. f. Entomo-logie 7, 1902.
Ulmer. Ueber d. Anpassungeiniger Wasserlarven a. d. I.eben i. Iliessenden
Gewassern. .Jahrber. liamb. Lehrerv. Nat., 1902.
Ulmer Trichopterologische Beobachtungen a. d. Umg. v. Hamburg. Stett.
Entom. Zeit.. 1902.
Ulmer. Beitriige zur Métamorphose der deulschen Trichoplereii. l-XV.
Allgemeine Zeitschr. f. Entomologie, I902-1!)03.
Ulmer, G. Ueber das Vorkommen von Ivrallen an den Jieinen ciniger Tri-
chopterenpuppen. Allg. Zeitschr. f. Entomol., 8, 1903.
Ulmei{. Trichopteren (Hamb. Elbuntersuchung). V. Milt. Naturh. Mus. Ham-burg, 20, 1903
— 161 —
Ui.MKR. ZurTrichoptereiifauna von Thuriiig-en II. Harz. Allg. Ztsch. f. Ent.,
1903, 1). ;iil-350.
Ulmeu. Zur Triclioptereiifaïuia v. Hesseii. Allg. Zeilschr. f. Eut., <S, r,)03.
Ulmer. Zur Ti-ichopterenfauiia v. Tliiiniigeii. V. Allgem. Zeilschr. f. Ent.,
9, 1904.
Ulmer, G. Weitere r.eitriige zur Métamorphose d. ileutscheiiTrichopteren.
Stett. eiitom. Zeitschr., 1903.
Ulmer, G. Deutsche Wasseriiisekten und ihre Entwicklung. « Aus der Hei-
mat >>, 15, 190-2/:2-i.
Ulmer,. G. Hamburgische Elhuiitersuchung. V. Trichopteren. Mitt. d. iiath.
Mus., XX, Hamhurg ,1993.
Veydovsky. Zur vergl. Aiiat. d.Turb. Zeitschr. f. wiss. Zool., 60, 1895.
VoiGT, W. Die Fortpfl. v. PI. alp. (Dana). Zool. Anz., t. V, 15, 1892.
VoiGT, W. Die ungeschl. Fortpllanzung von Polycelis cornuta.
VoiGT, W. DieungeschlechtlicheFortpflanzungderTurbellarien (Sammelref).
Biol. Zentralblatt, t. XIV, 20 u. 21, 1891.
VuiGT, W. Planaria (jonocephala als Eiiulringling in das Verbreitungs-
gebiet von PL alp. und Put. corn. Zool. Jahrh. Aht. f. syst. Geogr. u.
Biol. 8, 1894.
VoiGT, w. Ueber Tiere, die sich vermutlich von der Eiszeit her in unsern
Bachen erhalten haben. Verhandiungen d. Naturhist. Vereins preuss.
Rheinlande etc. 52. Jahrg., 1895.
VoiGT, W. Die Einwanderung der Planariatlen in unsere Gebirgsbache.
Ebenda, 53. Jahrg., 189(3.
VoiGT, W. Ueber zwei intéressante Fundstellen von Pol. corn. Sitzungsber.
d. Niederrheinischen Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde zu Bonn,
1901.
VoiGT, W. Die Ursachen des Aussterbens von Plamtria alpina im Hunsrûck-
*gebirge und von Polycelis cornuta im Taunus. Verhandl. d. natur-
hist. Ver. d. preuss. Rheinlande etc., 58, 1901.
VoiGT, W. Die \Vanderungen derStrudelwurmer in unseren Gebirgsbiichen.
Ebenda, 01. 1904.
VoiGT, W. Die Ursachen des Aussterbens von Planaria alpina im Hunsrûck
und im Hohen Venu. Ebenda, (t2, 1905.
VoLZ, W. L'e.vtension de quelques espèces de Turbellaria dans nos ruis-
seaux. Arch. se. phys. nat., octobre-novembre 1899.
VoLZ, W. Die Verbreitung einiger Turbellarien in den Bachen der Umge-
bung von Aarberg. Mitt. naturf. Ges. Bern, 1899.
W.\LKER. List of Diptera Brit. Mus. V-Vll.
Walter, g. Hydrachniden aus der Tiefenfauna des Vierwaldstiittersees.
XXX, Zool. Anz., 10, 1906.
Walter, G. Neue Hydrachnidenarten aus d. Schweiz. Zool. Anz., 30, 1906.
Walter, G. Neue schweizerische Wassermili)en. Zool. Anz., 1907.
Werer, E.-F. Faune rotatorienne du bassin du l^éman. Revue suisse zool.,
5, 1898.
W'iERZE.isKi. ZurKenntnisder Blepharoceridenentwicklung. Zool. Anz.. 1881.
WiLiiELMi. Beitr. z. Kennln. d. Verbr. u. liiol. d.Siisswassertricl. Zool. Anz.,
t. XXVII, 1904.
i t o a à. Q
— 162 —
WooDWOKTH, Will. Contributions to tlie Morphology of the Turbellaria, 1.
On the structure of l'iuigocata gracilis Leycly. Hull. Mus. Comp. Zool.
Harv. Coll.,L.\\l.
Zacharias. Zur Frage der Kortpllanzung- durch Querteilung- bei Stisswasser-
planarien. Zool. Anz., t. Vlll, 1SS5.
Zacharias. Vorlituf. Mitteil. u. d. Erg. einer faun. Exe. i. d. Iser lliesen-
und GlatzerGeb. Zoo). Anz., t. Vlll, 1NS5.
Zacharias, 0. Teber Fortpllanzung und spontané Querteilung b. Siisswasser-
planarien. Zeitschr. wiss. Zool., 13, IHHi).
ZscHOKKE, F. Die zweite zool. Excursion an die Seen des Khiitikon. Verh.
Naturf. Ges. Basel. nd.9, 1891.
ZscHOKKE. Die Tierwelt der Hochgebirgsseen. Neue Schweiz. Denkschrift.,
37, 1900.
ZscHOKKE. Die Tierwelt der Gebirgsbiiclie. Chur, 1900.
ZscHOKKE. Die Tierw. eines Kergbaches b. Siickingen iin sùdl. Schwarzw.
Mitt. Bad. zool. Ver., 11/12, 1902.
ZscHOKKE, F. Die Tiefenfaunades Vierwaldstiittersees. Verh. Naturf. (!es.
Luzern, 1905.
ZscHOKKE. Uebersicht ûber die Tiefenfauna des Vierwaldstiittersees. Arch.
f. Hydrobiol. u. l'ianktonkunde, Bd. Il, 1906.
CORRKIENDA.
Page 34, au lieu de: Er eiitwassert eiuer Flache, lisez : uiid
entwassert.
Page 36, au lieu de : ziemlich wasserreich an dieser Stellc,
lisez : ziemlich wasserreich. An dieser Stelle
et plus bas, au lieu de :
1906 9.5°, lisez : 7 Sept. 1906 9.5"
Page 50, au lieu de : Monta bathycola, lisez : Moina bathycoJn.
Page 54, au lieu de : Aeusequelle, lisez : Areusequelle.
Page 60, au lieu de Lebertia Walter, lisez : Lebertia Walleri.
Page 62, au lieu de : I. Arten des Hochgebirges (1), lisez :
I. Arten des Hochgebirges (10).
Page 73, au lieu de : Heptophlebia, lisez : Leptophlebia
.
Page 75, au lieu de : Tracheenriemenlamellen, lisez : Tracheen-
hiemeiilamellen.
Page 81, au lieu de : Eisstadium, lisez : Eistadium.
Page 91, à : Helicopsyche sperata Mo L ? Tafel IV, suppri-
mez Tafel IV.
Page 99, supprimez I. Bachformen.Page 100, au lieu de : (pag. 9), lisez : (pag. 27).
BEITRAGEZUR
KEITIIS DER SUSSWÂSSERPROTOZOEN
von S. AWERINZEW
Leiter der Biologischen Station an der Murmankiiste
(Alexandrowsk, Gouvernement Archangelsk).
I
Walirend meiner Studien iiber die Protozoen liât sicli bei mir
ein zit-mlich reicldichcs Material fiir die Systematik wie aucli
fiir die Morphologie verschiedener Formen angesammelt ;einen
Tcil dieser Beobachtiingen liabe icli bereits in friilieren Auf-
sjitzen kurz in russischer Sprache mitgeteilt; ein anderer Teil
gab den Stoff fur weitere Arbeiten ab. In dem vorliegenden
Aufsatz môchte icli einige dieser fragmentarisclien Beobach-
tiingen verôftentlich(?n, indem ich vermiite, dass dieselben fiir
das weitere Studium der Protozoen niclit ganz ohne Nutzen
sein werden.
1. Arcella discoides Eiikenberg
Der Durchmesser des Gehiiuses dieser Art iibertriti't dessen
Hohe um rnehr als das Dreifache. Die grosse Pseudopodien-
offnung behndet sich in der Mitte der leicht eingebuchteten
unteren Gehauseseite und ist von einem Kranz kleinster, nur
— 164 —
schwer zu bemerkender Poren umgeben. Der Durclimesser der
Pseudopodicnôfinung botriigt etwa 3|io-5/io des Geliausediirch-
messers.
Icli kann inicli niclit mit Pknakd (1902) einverstanden er-
klaren, welclier in ArccUa poJijpora eine besondere selb-
standige Art erblickt, da ich melirfach vielkernige Arcella
gofimden habe, bei welchen der Durclimesser der Pseudo-
podienôffhimg 3/io des Geliiiusedurciimessers entsprach (z. B.
Durclimesser des Geliiiuses: 0,200 mm; Durchmesser der
Pseudopodienôfinung : 0,060 mm), gleichzeitig aber auch Exem-
plare mit 2 Kernen, bei deiien der Durchmesser der Pseudo-
podienoffnung 4/io-5/io des Gehàusedurclunessers betrug (z. B.
Durchmesser des Gehauses : 0,265 mm; 0,195 mm; 0,126mm;
Durchmesser der Pseudopodienotlhung : 0,184 mm; 0,097 mm;
0,052 mm).
Ebenso habe ich niclit allein Exemplare von Arcella discoï-
des mit 2, 6, 8 und 25 Kernen, sondern zweimal auch solclie
mit 48 und 53 Kernen gefunden, ein Umstand, der natiirlich
mit der Vermehrung dieser Rhizopoden zusammenhangt, welche
ich gleichfalls fast vollstimdig verfolgen konnte und in eiiiem
speziellen Aufsatz zu beschreiben gedenke.
Nach den von mir aufgefundenen A. discoïdes zu urteilen,
wird dièse Art am haufigsten in grossen Gewiissern mit vor-
handener Strômung angetrofien, ebenso aber auch in Bàchen
und Fliisschcn. Es will mir scheinen, als wàre es gerade die
Gestalt selbst des Gehauses, welche mit dem Vorhandensein von
Strômungen in einem Zusammenhang steht, doch ist es mir
derzeit wegen Mangel an genugendem Material nocli niclit
môglich dièse Abhàngigkeit mit Sicherheit festzustellen.
2. Difflugia corona Wallich
In mehreren Planktonproben aus dem Elusse Svr-Darja,
welche ich durch Herrn L. S. Berg erhalteniiabe, fand ich unter
Anderem eine ziemlich grosse; Anzalil von Exemplaren dieser
Art. Ihr kugelfôrmiges Gehause tallt besonders infolge der
Anwesenheit von konischen, i-egelmassig angeonhictcn liohlen
Stacheln in_die Augen, deren Oberfiiiche mit kleinen, regel-
mâssig geformten Sandkornchen bedeckt ist.
Dièse Exemplare von D. corona zeiclmen sich voi- alleu
— 105 —
anderen bislier bescliriebenen liauptsaclilich dadiircli ans, dass
ilire gesammte Oberflaclie von ebensolchen balbkugeligen Hocker-
chen bedeckt ist, wie bei D. tubey^culata (Awer.) Wallich;
aller Walirscheinlicbkeit nach wird es sich als notwendig er-
weisen, eine neue Varietàt D. corona var. tuberculata auf-
zustellen.
Ausserdem ist bei dieser Form die Anoi'dniing der Reserve-
sandkôrnchen in ihrem Protoplasma von Interesse; dieselben
liegen in einer regelmassigen Schicht an der Grenze zwischen
dem Ecto- und Endoplasma dieser Rhizopode, so dass wir,
nachdem an conservierten Exemplaren das Gehause durcli vor-
sichtigen Druck entfernt worden ist, eine Difflugie mit einem
sclieinbaren zweiten Gehause erblicken, welehes ans den durcli
die dûnne Ectoplasmaschicht hindurchsclieinenden Reserve-
sandkôrnchen besteht.
3. Difflugia tuberculata Wall. spec.
Bereits im Jahre 1899 gelang es mir, mit dem pelagischen
Netz von Apstein in einem der kleinen Seen des Gouvernements
Novgorod eine betriielitliche Anzahl von Difïlugien zu erbeuten,
welche icli schon damais als mit der von Wallich b(>schriebenen
D.proteiformis subsp. globularis var. luhercidaia (1804) (1)
vollstiindig iibereiustinnnend erkannte.
Das Gehause dieser Difflugie zeielmet sieh liauptsachlich
dadurch aus, dass seine Oberflàche mit kleinen, fast halb-
kugeligen Erliôbungen bedeckt ist. Besonders charaeteristiseli
erscheint der Umstand, dass das Gehause von D. tuberculata,
sowohl in dem oben erwahnten Falle, wie auch bei allen
spàteren Funden, nicht aus Sandkornchen, sondern aus Kiesel-
plàttchen von verschiedener Gestalt zusammengesetzt war;
selbst dann, wenn sich zwischen den tafelfôrmigen Gebilden
andere von unregelmassiger Gestalt vort'anden, erwiesen sich
dièse letzteren, iln-em Verhalten im polarisierten Lichte nacJi
zu urteilen, gleich den Tàfelchen nicht als Fremdkôrper,
(1) AwERiNZEW, S., «Beitrage zur Faunistik der Protozoen von Bologoje und
dessen Umgebungen» (Trav. Soc. Nat. Saint-Pétersbourg, t. XXX [1899]. und
«Berichte der biolog. Siisswasserst. St. Petersb. Naturf.-Ges. », Bd. I [1901J).
— 166 —
sondern als Produkte dos Stotf\^'eclisels in dem Pi'otoplasma
der Rhizopode selbst.
In den Grundproben ans denjonigen Localitaton, wo ich im
Plankton fin' gewôlmlicli D. fubcrculata gefnnden liatto,
konnte icli diose Forra niemals feststellen.
Es làsst sich einstwoilen niclits Bestimmtes darùber aussagen,
ob irgend eine Abhàngigkeit zwiscJien einer derartigen Bildnng
von Hôckerchcn auf der Geliàuseoberflàclie und dem Vorkommenim Plankton besteht; allein das Anffinden abnlicher mit Hôcker-
chen besetzter Formen von D. coi^ona nnd zwar ebenfails ans
dem Plankton vorleiht einer solchen Vermutung eine gewisse
Wahrscheinlichkeit.
Verworn liât es bei der xVusfûhrung seiner Versuche liber die
Entstehung der Gelianse der Rliizopoden ('^Biolog. Protisten-
Studien-, Zeitschrift wiss. ZooL, Ed. 50) zweifellos aucli mit
D. tubercuhita zu tun geliabt; allein es ist kaum anzunehraen,
dass die lialbkugeligen Vorwôlbungen ihres Gehânses nur aus
einem einzigen, stellenweise mit Bakterien bedekten Plàttcben
bestanden liaben sollt(m.
4. Nebela lageniformis Penard
Leidy bat im Jabi'o 1870(1874) imter dem NamoniV. harhaid
eine Form beschrieben, welclie einigermassen an iV. lageni-
formis erinnert und sich von dieser durcli die An^^•esenlleit
diinner, baarartiger Gebilde an! (l(>r Oberfliiclie des Geliauses
nntersclieidet.
Penard (1902) glaubt annelnnen zu diirl'cn, dass dièse Gebildo
nicht sowohl Toile des Gehauses als vielmohr auf diesem
letzteren sitzende Parasiten (Algen) darstellen.
Was micli betrifft, so bin ich, auf Grund der Zoichnungen von
Penard, wie auch nach eigenen Beobachtungen, eher geneigt,
in diesen Auswuchsen keine Fromdkorper, sondern Gebilde zu
ei'blicken, welclie einen Teil des Gehauses von A^ lageni-
formis ausmachen, und zwar Aus\\"iichse bestehend ans der di(^
einzelnen Plilttchen mit oinander vorklobenden und iln^e Unter-
lage bildenden Substanz.
Wir kônnen demnacli dièse Gebilde als einen gloichsam nicht
vollstàndig entwickelton Kiel ansehen, iUinlich dem Kiele von
N. carinata; nichtsdesto\\'oniger wird man in dem Vorliandon-
— 107 —
soin der Alliage eines dcrartigen Gobildes nocli niclit einon
Grund erblicken kônnen, die damit versehenen Formcn in eine
Ijesondei'o Spezies auszuscheidon, solange andorc cliaracteris-
tische Eigentïunliclikeiten l'elden.
Nacli don von mir boi vorscliiedonen Nehela-Arion gomacliton
Boobachtungen zn urteilen, werden wir bei der Aiifstelkmg
si)ozifisclier Merkmale solchen Gebilden kaum eine grosso Be-
dentung beilegen kônnen, wie es dev Kiel nnd die hohlen Aus-
wiichse von verschiodener Gestalt sind, indem derartige Bil-
dungen ausserst iinbestandig ersclieinen.
5. Urceolus alenitzini Mereschk.
Dièse originelle Form liabe ich melirfach angetroffen und stets
ist es mir bel langerer Beobachtung gelungen, die Fiiliigkeit
ihrer ectoplasmatischen Schicht, nach Reizung eine klebrige
schleimige Substanz auszuselieiden, nacbzuweisen; ein gleiches
Verhalten habe ich aucli bei anderen Protozoen boobaclitot.
Infolge dieser Eigentiimlichkeit bleiben an der Oberflaclie dieser
Flagellate nicht selten Schalen von Diatomeen, Sandkornclien
u. dergl. Gebilde mehr kloben. Es untorliegt wolil keinem
Zweifel, dass eben wegen dièses Umstandes die Tertre ter der
Gattung Urceolus, welclie von Stein und Penard gefunden
wurden, von Fremdkcu'pern bedockt waren.
(). Peranema triehophorum Ehrbg. sp.
Bei dieser ziemlich lijiufigen Art habe ich imter Anderem
mohrfach das Aiisstossen der Nahrungsroste an einer be-
stimmten Stelle im hinteren Drittel dos Kôrpers beobachten
kônnen (1). Wir haben es demnach bei dieser Art bereits
mit einer bestlindigen AfterôfFnung zu tun; dièse besteht, nach
inoinen Beobachtungen zu ui-teilen, in einer ( )tinung im Ecto-
plasma in Gestalt eines kleinen kurzen Rôhrchens mit zu-
sammenfallenden Wanden, deren Vorhandensein nur widirend
des Detacationsprozesses bemerkt werden kann.
(1) Vergl. Stein, Fr., «Der Organismiis der Infusionstiere», I, p. 77.
— 108
7. Synura uvella Ehrbg.
Sowohl Stp:in (1878, Taf. 13, Fig. 25) wie aiich Fresenius
(1858) weisen aiif das Vorhandensein einer grossen Anzahi von
Augenflecken bei einigen Exomplaren von Synura urclla hin.
Ich selbst habe schon 1899 und aucli spàter nocli àhnliche
Formen geselien, allein bei genauerer Untersnchung er\A'ies es
sich, dass die von den genannten Aiitoren als Aiigenflecke
beschriebenen Gebikle nichts anderes waren, als einzelne
Anbaufungen von rôtliebem Pigment (HaematocJirom?), welcbe
auf deni vorderen Teile der Monade angeordnet liegen.
Wàhrend der typisclie Augenfleck der Flagellaten ans einer
albuminôsen Gi'undsubstanz bestelit, liaben die in Frage
stehenden Piginenianhiiufungen Ultropfcben zur Grundsubstanz,
in denen das Pigment aufgelost ist. Die Zabi dieser Pseudo-
augenflecke imterliegt nacb meinen Beobacbtungen betràcbt-
licben Scbwankungen : in ein und derselben Kolonie trifft man
Monaden mit 3, 5, 8 und sogar 12 Pigmentfleckcben an (1).
8. Amphileptus trachelioides Zacii. sp.
Zacharias land im Plankton des Gi'ossen Ploner Sees ('^For-
scliungsber. d. biol. Stat. Pion-, II. 1893.) einen Organismus aus
der Gruppe der Infasoria asjrirotricha, welcben er DUeptus
trachelioides benanntt^ Wiilu'end moines Aufentbalts auf der
biologiscben Siïsswasserstation am See Bologoje babt; ich melir-
facb im Monat Mai bei der Untersnchung des Seeplanktons
Infusorien angetroften, welclie durcliaus mit der Bescln^eibung
und (k^n Zeichnungen von Zaciiarias iibereinstimmten. Allein
auf Grund des Baues der nur wâhrend der Nalirungsaufnahme
sichtbaren spaltfôrmigen Mundoffnung miissen dieselben niclit
in der Gattung Dileptus, sondern in einer and(3ren, allerdings
ziemlicli naliestehenden Gattung Amphileptus untergebraclit
werden(2).
(1) Vergl. AwERiNZEw, l. c. (1901), p. 228.
(2) Anm. Wesenberg Lund {Biol. CentraWL. Bd. XX, 1900) hàlt Difcptustrachelioides mir fiir « eine Temporalvarietat des Trachelius ovum Ehrljg-.
Ich pei'sonlich kann micli dieser Ansicht nicht ausschliessen,da Amphileptustrachelioides Trichocysten hesitzt, welche soviel bekannt ist, bei dem zweitender senannten Inl'usore fehlen.
— 1G9 —
Im Allu-emoinen waren die von mil' ojefundenen Formen fast
in jeder Hinsiclit mit don von Zacharias beschriebenen identisch
und icli konnte gleicli diosem Forscher grosse Variationen in
der Grosse des Rûssels und der Gestalt des Kôrpers kon-
statieren und micli ebenso von der Anwesenheit von Triclio-
cysten und Zoochlorellen ûberzeugen, welclier Umstand micli
ebenfalls keint; contractile Vacuole bei diesen Formen ent-
decken Hess. In meinen Kulturen encystierten sicli die Amphi-
Icptus trachelloides sehr rascli und der Bau ihrer Cysten
erinnerte durcliaus an die Cysten von Dileptus trachelioides
von Zacharias.
Indem ich die beti-effenden Jnfusorien bei verscliiedenen
kùnstliclien lîedingungen beobachtete, bin icli gleich melu^eren
anderen Erforschern von Planktonformen zu der Ûberzeugung
gelangt, dass die Planktonorganisrnen fast gar nicht Ijefahigt
sind schroffe ïemperatursclnvankungen zu ertragen. Bei der-
artigen positiven oder negativen Temperaturschwankungen
gingen die AniphUcjdus fj'achelioides entweder zu Grunde
oder aber sic encystierten sich, je nach der Hôlie des Tem])e-
raturunterscliiedes. Durcli diesen Mangel an Anpassungs-
faliigkeit an schroffe Temperatursclns'ankungen làsst sich
wahrscheinlich auch der Umstand erkliiren, dass die Mehrzald
der Planktonformen aus Fliissen und Scen nicht in kleinen
Gewàssern angetrofïen wird, deren Wasser rascher Erwiirmung
und Abkiililung ausgesetzt ist.
Ebenso konnte ich auch an A;;?^y///V<7V»..v trachcHoides die
Abhangigkeit der Planktouorganismen von der Temi)ei'atur des
Wassers ilberhaupt konstatieren, womit der Ersatz der einen
Arten durch andere zweifellos in starkem Maasse zusannnen-
hangt.
Amplùh'ptus tracheHoides habe ich im Bologojesee nur so
lange angetrotten, als die Temperatur des Wassers 22° C nicht
erreichte; bei der Erhohung der Temperatur des Seewassers
wurde die Zahl der zur Beobachtung gelangenden beweglichen
Amphileptus allmàhlig immer kleiner, die Zahl ihrer Cysten
dagegen immer grôsser.
Auf Grand der Beobachtungen, welclie ich an Aynidiilcptm
h'achelioifk'S, sowie an anderen, in ihrcm Protophisma Zoo-
chlorellen enthaltenden Infusorien und Rhizopoden aiigestellt
habe, bin ich allm;dilig zu dem Schlusse gelangt, dass wir es
wohl kaum in allen solchen Fallen mit einer wahren Symbiose
U
— 170 —
zu tun habon. Die Zooclilorellen bilden in allcn dit'sen Fallon
entweder das einzige odor doch ein Roscrve-Nahrmaiorial fur
ihre Wirte, indem z. B. bei Ditrema, Amphitrcma und
Hyalosphenia keinerlei aiidere Nalirungsreste zu bemerken
sind, als Zoocblorelten in verschiedenen Stadien des Zerfalles;
ebenso kann man aucli bei Amphileptus bei der Delacation die
Aussclieidung von Ûberresten beobachten, in welclien man
unschwer Zerfallsproducte von Zooclilorellen erkennen wird.
—I oo-o-«
Les Inlusflires Aspirotriclies il'eai ûouce
[VM' H. SCIIOUTEDEN.
II
J'ai })ublié récemment dans ces Annales un travail embras-
sant tous les Infusoii'es Aspirotriclies d'eau douce à l'exception
des Astoniata. J'étudie ceux-ci dans la présente note.
Comme précédemment je me suis basé principalement sur la
Monograpbie de Schewiakoti'. En 1*,)U() Scliweier a i)ublié dans
lesTmdi S. Peterb. Obscli. Estest., Otdcl. Zool., vol. XXIX,n" 4, sous le titre " Parasititclieskia rèsnitcliia Inl'usorii ^^ un
mémoire sur les Infusoires endoparasites qui, en ce (pii concerne
les Asj)iro( riches, n'est en somme pas différent de celui de
Schewiakoff. — La table des Opcdina est toutefois empruntée
à Bezzenberger.
S'' Sous-ordre. — Astomata.
Les Astomata ne comprennent (qu'une seule famille, celle des
Opalinldœ.
19. — Fam. OPALINID.E.
Cette famille renferme actuellement sept genres, dont toutes
les espèces sont parasites d'Animaux. Trois de ces genres sont
marins : deux d'entre eux, Ojiiiluiopsis Eœtt. et ChroinidiiKt
— 172 —
Gonder(= Beuedeii'ui Fœtl.), i-eprésentés l'iin })ar une ('S])èco,
l'autre par deux, sont endoparasites de Céphalopodes; le troi-
sième, Protophrya Kof., vit dans les '• Brood-sacks • d'un Mol-
lus(|ue marin, Lïttorïna rudh. — Les (juatre autres genres
sont seuls représentés dans les eaux douces (comme parasites
d'Animaux, bien entendu). Toutes leurs espèces sont en(loi)ai'a-
sites soit de Vei's, soit de Mollusques, soit d'Ampldbiens; une
d'elle, fort mal connue, vivrait même dans un Bryozoair(> ; une
dernière, Anoplo[)h)'[/(i l))'(inchi(irum,\\i sur les branchies de
Crustacés. Pour chacune j'indi(|ue l'iiabitat connu, par les
signes que voici :
Ey = sur les branchies de Crustacés,
Po = tube digestif de Vers,
P3 = tube digestif d'Amphibiens,
P4 = tube digestif de Mollusques,
P5 = ilans Bryozoaire.
Comme on le veri-a, j'ai mentionné toutes les espèces, mém(^
celles qui vivent dans les Oligochètcs terricoles, les Lunibri-
cns, etc. Les Opalines endoparasites de Batraciens se trouvent
déjà, dans les cas connus, dans les têtards.
Les ([uatre genres représentés dans les eaux douces se distin-
guent comme suit :
1. L'infusoire possède ou bien une ou deux i-angées de
vacuoles contractiles, ou bien un canal contractile
allongé. (Pj'()t()phi/tf a une vacuole unique.) 2
L'infusoire n'a ni vacuoles ni canal contractile.
4. OpdHud.2. Corps ayant en a\ ani une ventouse ou des crochets, ou ren-
fei'mant un bàtonnel. 3
Ni ventouse, ni crochets, ni bâtonnet interne.
1. Anoplo}ih)-ya.
o. Infusoire offrant 1-2 crocliets à l'extrémité antérieure ou
ayant un bâtonnet interne; 1-2 rangéi^s de vacuoles con-
tractiles; noyau en cylindre long.
2. îh)plU{)ph)'i)u
.
Une ventouse à l"exti'émit('' antérieure du cor[)s; un canal
longitudinal contractile; noyau ellipsoïdal 011 réniforme.
0. Discojihrija.
173 —
1. — ANOPLOPHRYA Stein 18G0.
Les quatre espèces connues se séparent comme suit :
1. Coi'ps en cylindre allongé, ou rubané ; rangées de cils ser-
rées ; noyau occupant presque toute la longueur du corps;
de nombreuses vacuoles contractiles (en 1-2 rangées). 2
Corps elli])soïdal ; rangées de cils peu nombreuses ; noyauovalaire, n'occupant pas toute la longueur du corps ;
5-7
vacuoles contractiles, en 1 rangée; la division se fait
transversalement. A. hranchiarum.2. Corps en cylindre allongé. :j
Corps large, aplani, rubané; à l'extrémité postérieure, de
longs cils ; vacuoles contractiles disposées en une seule
rangée. A. f/7um.
3. Vit dans le tube digestif de Vers. 4
Vit dans le tube digestif de Mollusques.
A. i^cTmicKJar'ts.
4. Vacuoles disposées en une seule rangée; les deux extrémi-
tés du corps sont arrondies. A. naidos.
Vacuoles disposées en deux rangées ; l'extrémité antérieure
élargie. A. nodulata.
1. A. NAÏDOS (Dujardin) Kent. — Schewiakofï', p. 381. Po
Kent 1882, Schewiakott' 189G, Scliweier 1900 (p. 39),
Scliouteden 1900.
Syn. : Opali7ia naïduiti Dujardin 1811; Opalina naidosSlein 1851, Lankester 1870; AnopJophrya inermisKent 1881 ; OpaUiia inermis Stein 1859 ; Anoplo-ph) 'j/a rata Ken 1 1 88 1 ; Opalina o rata Claparède 1 802
.
Hah. : Oligochète : Nais serpentina \ Hirudinée : Clep-
sine hiocida.
2. A. NODULATA (Midler) Kent. — Schewiakoft'p. 381, pi. VI,
fig. 1 15. P.
Kent 1881, Bûtschli 1889, Schewiakoti' 1890, Sclnveier
1900 (p. 41, pi. I, fig. 14), Schouteden 1900.
Sj/n. : Leucophra nodulata Millier 1780; Leacophi-ys
nodulata Dujardin 1841 ; Leucopjhrys striata Dujar-
din 1841, Claparède etLachmann 1859; Opalina lincatn
— 174 —
Scliultzo 1851, ria])aW'(le ci Laclimann 1850; riapaW'do
1800; Opalina jtrnlifei-a Claparôde et Laclimann 185<.>;
Opalina sp. Frcy 1858; AnopIopliJ'ipi sir'nita Kcnt
1881 ; Anoplojihy'iia proUfera Kent 1881.
HaJ). : Oligoclictes : LnmhricJis, Nrris Ulforalis:, CJitcllio
nrcnarius, etc.
o. A. FiLiiM (Claparcde) Kent.— Sclicwiakoff, }). 382. V^
Kent 1881, Scliewiakoit'LSOG, Scliweier lUOO (p. 11).
Sijii. : OiKiliiut fihun Claparcde 18(j0, Vejdowsky 1879.
Ilah. : OligocliMcs : Ench;jfra'iis vfir. sp., (liicirio are-
luirius.
I. A. VERMicuLARis (Lci(h) Kent. P4
Kent 1881.
Syn. : Leucophrys rerjnicuJâris haxAx ISll
.
Hah. : Mollusque : PabnUna decissa.
5. A. BRANCHiARUiM (Stcin) Kcut. — Schewiakoff, p. 382,
pi. VI, fig. 14(). E,
Kent 1881, Biitschli 1880, Schewiakoff 189(). Scliwcicr
1900 (p. 42).
Syn. : Opalina branchiarimi 8ie,ml8ô\; Anoplophr-ya
circidans Balbiani 1885, Schneider 1880.
Hah. : Crustacés: Ganimarus pulex, Asellas aqtudicus.
Ohs. : L'Anopjloj)hrya convexa (Claparcde) Kent, para-
site (h; P//////o(/c)'^^ (Polychc te), n'est très probablement
pas identique à cette espèce comme rindi([uent, avec
doute d'ailleurs, Schewiakoff et Sclnveier.
().? A. cocHLEARiFORMis (Lcidv) Kent. Pa
Kent 1881.
Syn. : Leiœophrys cochJcarifor)n}s Leidy 1855.
Hab. : Oligochète : Lunihriculua tenais.
7.? A. sociALis (Leidj) K(mt. P5
Kent 1881, Foulke 1885,
Syn. : Leacophrys socia/i.s Leidy 1855.
Haï). : Bryozoaire : UrnateJhi graci/is.
Ohs. : Cet Infusoire est l'ort mal connu et sa position sys-
tématique fort incertaine. Il en est de même pour les
espèces suivantes, citées par Stokes : A. No/ci (Foulke),
A. fuiricnJns (Leidy), A. inodcsia (Leidy), A. jnrJn
(Leidy).
175
2. — HOPLITOPHRYA Stein 1860.
Les espèces connues se distinguent de la façon suivante :
1. Corps en cylindre allongé ; à l'intérieur un long bâtonnet;
pas de crochet à l'extrémité antérieure ; une ou deux
rangées de vacuoles. 2
Corps non en cylindre allongé; à l'extrémité antérieure,
une épine ou crocliet simple ou bifide; deux rangées de
vacuoles. 4
2. Corps en cylindre allongé, rétréci en avant; le bâtonnet
interne occupe deux tiers de la longueur du corps.
H. séants.
Extrémité antérieure du corps aplatie et coupée ol)lique-
ment; le bâtonnet interne occupe presque toute la lon-
gueur du corps. 3
3. Le bâtonnet interne est géniculé à l'extrémité antérieure;
4-5 vacuoles, en une seule rangée.
H. claimta.
Le bâtonnet interne est courbé en forme de nœud à l'extré-
mité antérieure ; 2 rangées de vacuoles contractiles.
//. fastigata.
4. A l'extrémité antérieui'e du corps, un crochet bifide; cori)S
ovalaire. //. hurihrici.
A l'extrémité antérieure, une épine non bifide; corps s'élar-
gissant en avant. //. picngeus.
1. H. SECANS Stein. — Scliewiakoff, p. 385, pi. VI,fig. 147 Pg.Stein 1859, Kent 1881, Biitschli 1880, Scliewiakoft'LSOG,
Schweier 1900 (p. 45).
-S'^;.'. ; Opallna spiculata Warpachowsky 1886.
Hah. : Oligochètes : LiDnhi'icus tei'restris, L. varle-
gatiis, Enchytrœus verniicularis.
2. H. FASTIGATA Môbius. — ScliewiakofT, p. 385. P2.Môbius 1888, Scliewiakoff 1896, Scliweier 1900 (p. 46).
Hab. : Oligochète : Enchytrœus Môbii.
3. H. CLAVATA (Leidy) Biitschli.— SchewiakofT, p. 386. Po.
Biitscldi 1889, Schewiakoff 1896, Scliweier 1900 (p. 46).
— 176 —
Syn. : Hoplitophrya securiformis Stein 1861, Kent 1881;
Leucophrijs cîavata Leidy 1855.
Hab. : Oligochète : Lumbricus variegatiis.
4. H. LUMBRici (Dujardiii) Kent. — Sclunviakoff, p. H8(j,
pi. VI, fîg. 118! P..
Kentl881,Butsclilil889,ScIiewiakoffl89C),Sc]i\veierl900
(p. 47, pi. I, fig. 17), Schouteden 1900.
Syn. : Opalina Lumhrici Dujardiii 1841, Scliultze 1851,
Perty 1852; Stein 1854; Opalina armata Stein 1854,
Quennerstedt 1805; HopJito])hryn falcifera Stein 1801,
Kent 1881.
Hab. : Oligochète : Lamhricas ferrestris.
5. H. PUNGENS Stein
Stein 1801, Kent 1881.
Hal). : Sœnuris vaiHegata.
3. — DISCOPHRYvV Stein 1800
(= Haptophrya Stein)
Trois espèces reconnues :
1. Ventouse arrondie. 2.
Ventouse en fer achevai. D. hHtonis.
2. Extrémité antérieure du corps élargie et transformée en une
ventouse, hordée d'une rangée de cils ; noyau ellipsoïdal.
D. planarhmi.3. Extrémité antérieure du corps déprimée et portant une
ventouse, dont le bord est cilié et qui présente un anneau
interne de cils. I). giganfea.
D. PLANARIARUM (Siebold) Stein. — Schewiakotî, p. 388,
pi. VI, fîg. 150 Po.
Stein 1800, Biitschli 1889, Levandor 1895, Schewiakoff
1890, Schweier 1900 (p. 49, pi. I, fig. 19).
Syn. : Opalina planariarum Siebold 1839, Stein 1854,
Perty 1852; Opalina polyinorpjJia Schultze 1851;
Haptxyphrya planariarum Stein 1807, Kent 1881.
Hab. .• Turbellariés : Planaria torvaet sp.
— 177 —
2. D. GiGANTEA (Maiipas) Schewiakoff, p. 889. P3.
Schewiakoff 1896, Schweier 1900 (p. 51), Colm 1904,
Sclioati^doii 1900.
St/n. :? Opalina discoglossi Everts 1879; Hcrpiophnin
g'Kjantca Maupas 1879, Certes 1880, Kent 1881.
Hab. : Anoures : Bufo panthcrinus, Rana esculenta,
Discoglossus pjictus.
3. D. TRiTONis (Certes). Pg.
Syn. : Haptophrya tritonis Certes 1880, Kent 1881.
Hûb. : Ui'oclèle : Triton aîpirnts.
— LADA Vejdowsky 1882
Une seule espèce, fort mal connue. Position du genre incer-
taine; ? Astomata selon Biitsclili.
1. L. Wrzesniowskyi Vejdowsky, P2?Vejdowsky 1882, BiÙschli 1889.
Hah. : ? Phreatothriœ pragensis (Oligochète).
4. — OPALINA Purkinje et Valentin 1835
Nous distinguerons comme suit, avec Bezzenberger, les espèces
décrites :
1. Un seul noyau, formé de deux moitiés arrondies, réunies
par un filament. 2.
Au moins deux noyaux complètement séparés 3.
2. Corps fusiforme, élargi en avant, rétréci en arrière, aplati.
Op. intestiiKiIis.
Corps ovalaire, peu aplati. Op). caudata.
3. Deux noyaux seulement ; la coupe transversale du corps est
ovalaire. Op. macrouucJedta
.
Au moins rpiatre noyaux. 4.
4. Quatre ou (•in(j noyaux; coupe transvei'sale du corps
circulaire
.
Oi j la 1 1 1 -enla ta
.
Noyaux nombreux. 5.
— 178 —
5. Corps aplati, fortement foliacé. 6.
Corps peu aplati, ovoïde. Op. flcwa.
6. La plus grande largeur du corps est en arrière du milieu . 7
.
La plus grande largeur est avant le milieu du corps. 9
7. Extrémité postérieure étirée en une sorte de rostre.
Op. coracoidea.
Extrémité postérieure arrondie. 8
8. La largeur du corps égale à peu près la moitié delalongueur.
Op. ranarum.
La largeur est supérieure à la moitié de la longueur.
Op. lata.
9. Au plus 5 fois aussi long que large. 10
Environ 10 fois aussi long que large.
Op. longa.
10. Environ 3-3 1/2 fois aussi long que large; triangulaire, en
forme de virgule large. Op. ohtrigona.
Environ 4 fois aussi long que large; fusiforme, l'extrémité
antérieure arrondie. Op. dimidiata.
Op. ranarum (Ehrenberg) Purkinje etValentin.— Schewia-
koff, p. 393, pi. VI, fig. 153. ' Ps.
Purkinje et Valentin 1835, Dujardin 1841, Perty 1852,
Stein 1854- 1859 -18G7, Claparède et Lachmann 1859,
Quennertedt 1865, Engelmann 1876, Zeller 1877, Kent
1881, Pfitzner 1886, Biitschli 1889, Levander 1895,
Scliewiakoff 1896, Scliweier 1900 (p. 56, pi. 1, fig. 22),
Bezzenborger 1903, Maier 1903, Wallengren 1903, Lô-
wenthal 1904, Kunstler et Gineste 1902, Schouteden
1905 et 1906.
Syn. : Bursaria ranarum Ehrenberg 1830-1833-1837;
Lankester 1870.
Hab. : Anouves : Rana fiisca {escidenta in Scliweier!)
Bufo variabilis, B. cinereus.
Op. lata Bezzenberger, Arcli. Prot., III, p. 166, pi. XI,
fig. 10 (1903). Ps.
Hab. : Anoure : Rana limnocharis.
Op. obtrigona Stein. — Scliewiakoff, p. 393. PsT
Stein 1867, Zeller 1877, Kent 1889, Scliewiakoff 1896,
Scliweier 1900 (p . 58) , Bezzenberger 1903 , Scliouted<m 1 906
.
Hab. : Anoure : Ilyla arborca.
— 179 —
4. Op. DiMiDiATA Stoin. — Scllowiakoff, p. 301, pi. VI,
flg. 154. P3.
Stoin LSf)?, Zollor ISTT, Kent 1S81, IJiitsclili 1880, Sclie-
wiakort' 1806, Scliwoici- 1000 (p. 58. pi. I, tii^. 2:!), 15<"Z-
zonborg-er 1003, Sclioutedon lOoi).
Hdh. : Anoures : R<irta esoiJciihi, Bnfo cincreu!^.
5. Op. cntRAcoiDEA Dozzonberg-iM-, 1. c, jk 1')(), pi. XI, fig'. 8-0
(100:!). 1^-!.
liai). : Anoun^ : l\(iii(( ci/(inôj)]ih/ct/s.
(k Op. LoNtiA BezzonbiM'gi'r, 1. c, p. 1<)7, pi. XI, fig. 11
(1003). P:i.-
Hah. : Anoure : Raïut Ihniwclwris.
7. Op. FLAVA Slokes. — Scliewiakoff, p. 304. P3.
Stokes 1884 et 1888, Schowiakott 180(3, Scliweier 1000
(p. 58), Bezzenberger 1003.
H(/b. : Anoure : Saiphwjjus Holhrooki.
8. Op. lanceolata Bezzenberger, 1. c, p. 165, i)l. XI, fig. 7
(1003). P3.
Hah. : Anoure : Rana esciileutd rar. chiiieusis.
0. Op. macronucleata Bezzenberger, 1. e, p. 1(')3, pi. XI,
fig. 5-6 (1003). P:î.
IR(I). : Anoure : Bufo viehniosliclus.
10. Op. iNTESTiNALis (Ehreuberg) Kent. — Seliewiakott',
p. 301. P:i.
Kent 1881, Biitschli 1880,Selie\viakoff 180(),Scli\v<'ier 1000
(p. 50), Bezzenberger 1003, Colui 1001, Schouteden 1006.
Syn. : Opalinn similis Zeller 1877; Bursaria intest i-
nalis Ehrenberg 1830.
Hah. : Anoures : Bomhiudtor igneus, Petobdtcs fiiscus,
Riuui rsculentd.
11. Op. CAUDATA Zeller. — Scliewiakoff*, p. 305, pi. M,fig. 155. P.'!.
Zeller 1877, Kent 1881, Scliewiakotl* 1806, Scliw.'ier 1000
(p. 50, pi. I, fig. 21), Bezzenberger 1003.
Hah. : Anoure : Bo)nt)iti(ifor igiicKS.
180 —
INDEX
(Les synonymes sont en italiques)
Anoplophrya 173
armata 176
Benedenia 172
branchiarum 174
caudata 178
Chromidina 171
circulans 174
clavata 175
cochleariformis 174
convexa 174
coracoidea 178
dimidiata 178
discoglossi 177
Discophrya 176
falcifera 176
fastigata 175
fdum 174
flava 178
gigantea 177
Haptophrya 176
Hoplitophrya 175
inermis 173
intestinalis ...'.... 178
Lada 177
lanceolata 178
lata 178
lineata 173
longa 178
lumbrici 176
macronucleata 178
naidos 173
naidum . 173
nodulata . 173
obtrigona 178
Opalina 177
Opalinidfc 171
Opalinopsis 171
ovata 173
planariarum 176
polymorpha 176
proliféra 1 74
Protophrya 172
pungens 176
ranarum 178
secans 175
securiformis 176
similis 178
socialis 174
spiculata 175
striata ....... 173
tritonis 177
vermicularis 174
Wrzesniowskyi 177
LES ACmÉTIENS DEAU DOUCEpar E. Rousseau et H. Schouteden.
l)('])uis la })ublicat,ioii du ti"iNail tlo Sand : Étude ijioitogra-
phlque SH.r le (p'aupe des Iiifusolres Tentaculifères (Ann.
Soc. Belge de Microscoi)ie, tomes XXIV-XXV, 1899-1901), peu
d'espèces nouvelles d'Acinétiens ont été décrites; on connaît
actuellement — avec les formes douteuses — en^'iron 80 espèces
habitant l'eau douce. Nous avons cm bien faire en donnant ici les
tables dichotomi(|ues de ces Acinétiens, sui\ant le plan adopté
l)our les travaux analogues publiés déjà dans ces Annales sur
les Rliizoi)odes et les Aspirotriclies. Nous ferons i)araître dans la
suite d'autres travaux du même genre, afin de permettre à
ceux (jui s'occupent des organismes microscopiques d'eau douce
d'arriver rapidement à une idt>ntifîcation presque certaine des
formes (pi'iis rencontrent.
Table des familles :
1. Formes dé})Ourvues de tentacules, vivant en parasites dans
le cytoplasme d'un Protozoaire.
Fa.m. Poi)t)P]iRYiDAE (formes parasites des genres
Kndospha e) rt et; Sph (le) -oph l'ya)
.
Formes libres, pour\ues de tentacules. 2
2. Tentacules peu nombreux (1 ou 2, rarement o à 5), cylin-
driijues, allongés, insérés à l'extrémité antérieure du
corps. 1. Fam. Urnulidae.
Tentacules nondjreux, disposés ou non en faisceaux. 3
3. Une loge. 4
Pas de loge. 5
— 182 —
4. Une loge conique dont la base sert de pédicule, pei'cée à son
extrémité ajùcale (h; 2 à 8 (ordinairement (3) lentes laté-
ral.'s îdlongées, pour le passage des tentacules.
2 Fam. Metacinetidae.
Loge non pei'cée de lentes latérales semblables; un pédicule
ou non. 4. Fam. Aci^^^etidae (genres
Ac'meta et S()h'j/()j)In\i/r/).
5. Coi'j)s muni dt; plusieurs gros prolongements cylindriques
ramifiés t(M'minés chacun par 2 à 4 tentacules ou bien
l)rolongements non ramifiés terminés chacun })ar untentacule. ô. Fam. Dendrocometidae.
Corps non conformé ainsi. (3
(3. Corj)s lobé ou ramifié, les types })rimitifs étant simplement
ovoïdes et la ramificaiion pouvant se réduire à un seul
bras cylindro-coni(pie; chaque loi)e, bras ou ramification
l^ortant un faisceau de tentacules.
(3. Fam Dendrosumidae.
Corps autrement conformé. 7
7. Reproduction })ar scissiparité. Animal libre ou fixé, unpédicule ou non, i)as de bourgeon adhésif, tentacules
ordinairement ré[)artis régulièrement sur tout le corps
sp]iéri(pie. 3. Fam. Podopiiryidae.
Reproduction })af embi-yons endogènes ou par gemmesexternes ciliées. Animal fixé i)ar un pédicule ou [)ar unbourgeon adhésif formé par une petite saillie non difieren-
ciée à l'extrémité jjostérieure du corps.
4. Fam. Acineïidae (genres
lin JICita, et Tol,'nj)hi-ij(i).
Fam. 1. URNTJLIDAE.
Corps globulaii-e, ovoïde ou pyriforme, parfois très allongé,
muni de 1 à 5 tentacules cjlindi'iques, flexueux et allongés,
insérés à l'extrémité antérieure du corps; noyau ovale ou irré-
gulier; une ou plusieurs vacuoles contractiles. Pédoncule et
loge, ou loge seulement, ou ni loge ni pédoncule, l'individu
étant fixé })ar une portion du cori)s. Reproduc^tion })ar scissi-
— 183 —
parité oblique et inégale, la ciliation de la })ortion libérée étant
holotric'he.
Deux genres.
Table des gciwes.
1 . Corps ovoïde, pvi'iforme ou obpjriforme, sans loge ni pédi-
cule, un tentacule sinueux à l'extrémité antérieure du
corps. 1. Rhyncheta.
Corps spliérique ou ovoïde, occupant la moitié ou la totalité
d'une loge ovoïde ou urcéolée, allongée, fixée par son
extrémité postéideure, offrant sur sa face antérieure une
ouverture arrondie ou subtriangulaire par où passent
1 ou 2 (rarement 3 à 5) tentacules filiformes.
2. Urnula.
1. RHY?^CH^TA Zenker 1866.
Trois espèces.
Table des espèces.
.. Tentacule atteignant au moins les deux tiers de la longueur
du corps. 2
Tentacule ne dépassant pas le cinquième de la longueur du
corps. R. gammari.\. Corps obconi(|ue (obpyriforme), se rétrécissant vers l'inser-
tion du pédicule, large au sommet, le tentacule naissant
près d'un des angles (sur coupe optique).
R. obco)iica.
Corps pyriforme, fixé par la large extrémité, le tentacule
continuant le corps graduellement rétréci.
R. cyclopiun.
.. Rii. OBCONICA Hartog 1902.
Un exemplaire trouvé sur le 4*^ sternum tlioracique de
Cyclops gigas.
!. Rh. cyclopum Zenker 1806, Kent 1882, Bûtschli 1889,
Bloclimann 1895, Entz 1896, Sand 1899.
Sur les membres tlioraciques et l'abdomen de Cyclops.
184
3. Rh. gammari Eismond 1805, Sand 1890.
Sur les plaques branchiales de Ga nunaras pidcx
.
2. URNULA Clap. et Lachm. 1858.
Une seule espèce :
1. U. EPiSTYLiws Claparède et Laclnnann 1859 et 1861,
Engelmann 18()2, Stein 18<J7, Wl•zesnio^^ski 1877, Kent
1882, Biitschli 1880, Blochmann 1805, Entz 189(3, Sand
1800 et 1800.
Sur !(_' p(MoncuIe d'Ejjisfijlis.
fam. 2. metacinp:tidae.
Corps ovoïde, occujjant la moitié ou les deux tiers d'une loge
ovoïde, cupuliforme, urcéolée ou trap(''zoïdale, dont la base sert
de pédicule, fermt'c antérieurement; les faces latérales se con-
tinuent sans limite précise en une face antérieure; loge percée
de 2 à 8 fentes équidistantes, longitudinales, par où passent les
tentacules; ces fentes se continuent sur la face antérieure et se
rejoignent à son centre en une ouvert ui-e commune; novau ovale
ou sphérique; une vacuole pulsatile; tentacules cylindriques et
rectilignes, assez longs. Reproduction })ar scissiparité inégale,
peut-être par embryons. Conjugaison.
Un seul genre.
1. METACINETA Bûtsclili 1889.
Une seule (>spèce :
1. M. MYSTACINA (Ebreub.) Ilutscldi 1889, Koppeu 1888,
Dangeard 1890, Blochmann 1895, Sand 1899.
Cothurnia mysticina Ehrenberg 1831.
— 185 —
Acinefff mystichid Elirenboi'g 1838, Stein 18 10 et 1867,
Clapaivdo et Lachmann 1859 et 1801, Biiisclili 1876,
Mereschkovsky 1870, Kent 1882,Parona 1883, Stokes 1888.
Ac. mystacina var. carchcsii Gruber 1879, Kent 1882.
Ac. cothurnia Claparôde et Laehmann 1859, Kent 1882.
Ac. inystacuia var. loiigipes Mereschkovsky 1879,
Sand 1899.
Ac. (data Stokes 1885-1888; Met. my.stacina var.
atata Sand 1899.
Ac. .stagnatitis Stokes 1886-1888.
Ac. acuminata Stokes 1887-1888 ; Met. mystac'nia
var. acuminata. Sand 1899.
Ac. fcrÀlïs Stokes 1894 ; Met. )nystacuia var. ftexUis
Sand 1899.
Ac. «;?-(/?6/rt;7',s-Maskell 1887.
Ac. /fos Maskell 1887.
Met. mystachut var. hreripes Sand 1899.
Sur les végétaux aquatiques ; aussi marin.
Plusieurs \ariétés :
Dans la var. atata Stokes, les fentes de la loge sont placées
chacune sur un rebord relev(;'; parfois la loge peut porter de
petits ailerons ou des pointes (var. acnm'niata, Stokes) ; la partie
postérieui de la loge s'amincit graduellement en un tube conique
ou cylindrique, très courtdans la var. l)reinpes Sand, très long
dans la var. tongipes Meresch. Les tentacules sont filamenteux
et flexibles dans la var. ffeœitis Stokes.
Fam. 3. PODOPHRYIDAE.
Temporairement ou toujours mobiles, ou parasites internes;
rarement fixés sur Cyclojis. Corps sphérique, pas de loge, i)arfois
un pédicule mince, rectiligue en général; tentacules rayonnant
de la surface entière du corps ; noyau sphéri(|ue ou ovalaire ; une
ou plusieurs vacuoles contractiles. Reproduction par scissiparité,
exceptionnellement par formation d'endjryons.
Quatre genres.
Pi
— 186 —
Taille (les genres :
Formes vivant en parasites (sans tentacules) dans le cyto-
plasme d'un Pi'otozoaire. 2
Formes libres. 3
Parasite dans Stenio)- ou un autre filié; re])roduction par
scissiparité. 3. Sphdei'oplwya.
Parasite permanent (jamais libre et à tentacules) dans un
Suceur ou un Vorticellien; rei)ro<lu('tion par bourgeons
internes. 1. Eiidosphaera.
Tentacules simplement capités. 4
Tentacules s'élargissant en large entonnoir à leur extrémité.
Fixé sur Cndops. 2. Choanophrya.
Un pédicule mince, court ou long. .Jamais parasites.
1. P<)<l()j)Jiri/(i
.
Pas de pédicule. Quebpies espèces sont parasites tem})oraires
(v. ci-dessus). 3. Spjhaero^jhrya.
1. PODOPHRYA Ehrenb. 1833.
Cin(| espèces, se présentant sous plusieurs formes :
a) État pj-e :
1. Pédicule et tentacules plus courts (|ue le tiers du diamètre
du corps; tentacules nombreux, subégaux, un noyau et
une vésicule. P. hrei'ipoda,.
Pédicule et tentacules plus longs que le tiers du diamètre
du corps. 2
2. Tentacules peu nom])reux (1.5 environ), subégaux.
P. Mav}i((si.
Tentacules nombreux (50 environ), subégaux ou inégaux. 3
3. Tentacules très inégaux, quelrpies-uns atteignant de trois à
six fois le diamètre du corps. P. lihei'a.
Tentacules i)lus ou moins inégaux, ne dépassant i)as trois
fois le diamètre du coi'ps. 4
4. Pédicule sinu<îux, tentacules subégaux. P. fî.ica.
Pellicule droit, s'insiM'aut sur un jjrolongement coni(pie du
corps qiii donne à celui-ci un aspect ])yriforme; tentacules
inégaux. P. (jelatmosa.
— 187 —
b) Kl/s/es (ceux do bi'cr/jioda n'ont pas été observés) :
1. Kystes munis d'un pédoncule. 2
Kystes sans pédoncule. P. gclatinosa.
2. Kystes munis de 5 cercles en relief, très proéminents, striés.
P. fixa.
8 à K) cercles non striés, peu proéminents.
P. libera.
Pas de cei'cles. P. Maupasi.
c) État mobile (ceux de iixa et breripoda n'ont pas été
observés)
:
1. Ceintui'o de cils incomplète à l'extrémité postérieure; noyau
ovoïde. P- Maifpasi.
Ceinture de cils complète ; noyau spliéri(|ue. 2
2. Pas de tentacules. P. libéra.
Deux faisceaux de t<>ntacules. P. gelatinosa.
1. P. BREViPODA Sand 1890.
Parmi les Algues.
2. P. Maupasi Bïitsclili 1889, Sand 1899.
Pod. fixa Maupas 1876, P. Maupasi var. minitna
Sand 1899.
Sur des Algues.
3. P. LIBERA Perty 1852, Carter 1805, Kent 1882, Maupas
1881, Biitscldi 1889, Stokes 1888, Blochmann 1895,
- Butscliinsky 1897, Sand 1899.-
Pod. fixa var. aJgirensis Maupas 1876.
4. P. FIXA (0. F. Midler) Ehrenberg 1838, Cienkowski 1855,
Claparède et Lachmann 1859, Hertwig 1876, Entz 1879
. et 1896, Kent 1882, Meresclikovsky 1881, Maupas 1884,
Biitschli 1889, Stokes 1888, Dangeard 1890, Bloclunann
1895, Butschinsky 1897, Sand 1899.
Trichoda fixa 0. F. Midler 1786.
Actinophrys sol Stein 1849 et 1854.
Actinophrys pedicellata Dujardin 1841, Pineau 1848.
Actinophrys diffbrmis Perty 1852.
Orcula trochus Weisse 1847.
Podophrya fine Fraipont 1877.
Parmi les plantes et les particules en suspension dans l'eau.
— .188 —
P. GELAïiNOSA (Buck) Saiid 18<.)()-00.
Acineta gcla/ùtos// I>iK'k 18(S1.
Trlchophri/d (jelatiKOsa Sclicwiakoti' 1<S<.);J.
Une des espèces les plus coiuiiiuiies. dans l'eau douce et
les cultures de cresson.
2. rHOANOPHiiYA Hailog l'.i()2.
Fne seule espèce :
1. C\\. INKUNDIHtlLIKKKA (Hai'IOL!) IlarlOg J1K»-J.
Si/n. : Ai'iiK'ld fcD-iiDi-ctjitiniiin Zcidvcr ISOii (ncc Ehrcn-
berg); Podojihnjd? 'nifuiidibiir/fo-d Ilai'log 1881;. 1(7'-
neta Infiuidibidlferd Kent 1882.
3. SPHAEROPHRYA riap. et Laclun. LSry.i.
Six espèces :
1. Formes parasites internes d'Inl'usoii'es. 2
Formes libres. 3
2 Parasites dans SteiitiV. S. stoitorea.
Parasites dans les Ciliés {Stento/- et \'orticelliens exceptés).
S. pusinn
.
o. Corps spliéri(|ue avec 30 à 40 tentacules allongés, irréguliè-
rement distribués, une grande vacuole gazeuse avant la
moitié du diamètre du corps et servant à l'aire Hottcr
l'animal ; nombreuses vacuoles pulsatiles.
iS'. hijih-oHtalic'i
.
Pas de ^ acuole gazeuse semblable pour la flottaison. 4
1. Subsj)li(''rique ou ovale, la moitié antérieure ciliéi', la moitié
})Osl(''rieure avec 8 à 10 tentacules courts, irrégulièrement
disti'ibui's, un uojau, <leux vacuoles jtulsaliles.
S. slciilo]-ca.
Pas de cils. 5
5. Sphéri(pie, lentacutes allongés et localisés dans une seule
zone dii coi'jjs; une seule vacuole contractile.
S. jifo-ra.
189
Toiitaciihs répartis sur toute la surface du corps. (5
Coi'ps ovale (lu(|uel s'irradient des tentacules dont la lon-
gueur atteint jus(iu'à douze l'ois le diamèlre du cori)s.
S. ()C((fn.
Corps sp]i(''i'i([ue mmii de t<'ntacules ti-ès couMs ou à peine
l)lus longs (jue le diamè'tre du cor])S. 7
Cytoplasme incolore; noyau spliéi'ique ou ellipti(|ue ; tenta-
cules nombreux (jusque 50) minces, très courts ou à peine
plus longs que le diamètre du corps. *S'. pusiUa.
Corps plus grand que dans tous les autres Sphaeroplu'ija ;
tentacules très nombreux, minces et ne déqjassant (|ue
d'un (piart ou d'un tiers le diamètre du corps. Cytoplasme
à nombreuses granulations brunâtres. Noyau ellipti(pie.
Uessembl(> à un Héliozoairo à de faibles grossissements.
S. sol.
1. Spii. stkntorea Maupas 1870, Kent 1882, Sand 1800.
Sph. .v^'y//o;-M-Bi"itschli 1870 et 1889, Blocbmann LSU.").
Libre, ou parasite dans Stentor,
2. Spii. pusilla Claparèdeet Lacbmann 1859, Halbiani 18()1,
Engelmannl802et 1870, Eberliard 18()2, rUitscbli 1870 et
1889, Kent 1882, Gourret et Roeser 1880 et 1888,
P)lochmann 1895, Entz 1890, Sand 1899.
Sj)h. sol Metsclmikoff 1801, Keni 1882, Entz 1890.
Sph. pcwauiaecioruin Maupas 1870.
Sph. urostijtae Maujjas 1870, Kent 1882, Parona 1883.
Hph. )n(i(jna Maupas 1870), Kent 1882, Maskell 1880,
P.loclimann 1895, Entz 1890
Sph. sti/tonijchioe Kent 1882.
Libr(^ parmi les Algues, ou parasite dans divei's Ciliés.
3. Spii. iiydrostatiga Engelm. 1878, Kent 1882, Sand 1899.
Parmi les Lemna.1. Spii. parva Greeff 1888, Biitsclili 1889, Sand 1899.
Sur les mousses liumides (une seule fois à Marburg, en
Allemagne).
5. Sph. ovata (Weisse) Lacbmann 1859, lîiitscbli 1889, Sand
1899.
Acti)iOj)Iiri/s orotff Vi'oh^.i' 1818.
(3. Sph. sol Laulerborn 1901 (nec Metsrbnikoti' !*).
190 —
4. ENDOSPHAERA Engelm. 187(3, Entz 1896.
Une seule espèce :
1. End. Engelmanni Entz 189G, Sand 1899.
Parasite dans Tohophnja ot divers Vorticeliiens et
autres Infusoires.
FAM. 4. ACINETIDAE.
Corps de forme variable avec une loge et un pédoncule ou l'un
d'eux seulement ou bien un bourgeon cytoplasmi(|ue adhésif;
tentacules nombreux, fascicules ou dispersés, répandus sur tout le
corps ou localisés dans une région de sa surface. Noyau variable,
une ou plusieurs vésicules contractiles.
Reproduction par embryons endogènes péritriclies (parfois
holoti'iches ou liypotrich(^s ou sans cils ou en forme de Sphacro-ph)-i/a) ou par gemmes ex termes ciliées ou par ces deux modes à
la fois; quelquefois en outre })ar scissiparité; ou bien reproduction
par diverticules générateurs.
Quatre genres.
Tableau des genres.
1. Pas de pédicule. 2
Un pédicule. 3
2. Pas de loge, animal fixé par un bourgeon adhésif.
1. HaUezia.Une loge. 4, Solciiophrya.
3. Une loge de forme variable. 3. Acineta.
Pas de loge. 2. Tokophrya.
— 191 —
1. HALLEZIASand 1805.
Trois espèces :
1. Tentacules groupés en faisceaux. 2
5 à 20 t<!nta('nles de longueur variable, non fascicules, à
rextrémité antérieure du cor[)S, celui-ci i)lus ou moins
régulièrement oviforme, parfois pvriforme ou ovale.
H. ocifnrmis.
2. Corps plus ou moins cylindri(]ue, allongé; deux faisceaux
antérieurs de 6 à 25 tentacules ino^gaux.
R. Bncliei.
Corps spliéroïilal ou pvriforme ; 2-1 faisceaux d(> tentacules.
H. hritdiypoda.
1. H. oviFORMis Sand 1899.
Eau douce, parmi les Algues.
2. H. BucKEi (Kent) Sand 1899.
Podophrija Biichel Kent 1882.
Pod. compressa Nutting 1888.
Parmi les Algues.
3. H. BRACiiYPODA (Stokes) Sand 1899.
Tokophrya brachiopoda Biitschli 1889.
Podophrya brachijpoda Stokes 1885-88.
2. TOKOPHRYA Butsclili 1889.
Vingt espèces.
1. Corps pvriforme (spliérique au stade jeune) avec un petit
nombre de tentacules non fascicules mais répartis sur toute
la surface de corps ; un noyau et 1 à 2 vacuoles pulsatiles;
pédicule non strié transversalement, recourbé, s'amincis-
sant du sommet à la base. T. incïinata.
Corps de structure autre. 2
— 192 —
2. Corps quadrangulaire, deux fois plus long que large avec un
faisceau de t('iita(_'ules à chacun des quatre angles; unnoyau; pédicule allongé, épais, s'élargissant delà base au
sommet. T. astac'i.
Corps de sti'uctui'e autre. ;j
3. Organisme plongé dans une gelée; cori)S cvlin(lri(pie, deux
fois plus long que large; pédicule petit; tentacules courts
et nombreux insérés sur toute la surface du cori)s.
T. parroceU.Structure autre. 4
4. Corps cylindrique, très allongé, quatre à six fois })lus long-
que large. 5
Animal ne répondant pas aux descriptions précédentes. (j
5. Tentacules p(;u nombreux et localisés à l'extrémité antérieure.
1 à 2 vacuoles pulsatiles antéro-latérales. Nojau o^alaire.
T. cylindrica
.
Tentacules répartis sur tout le corps ou plus ou moins régu-
lièrement en 4 faisceaux; un antérieur, un postérieur et
un au milieu de chaque face latérale. Une grande \acuole
pulsatile antérieure et d'autres plus ])etites, souvent voi-
sines des grou^tes de tentacules. Novau rubané.
T. eloïujdfn.
0. 2-4 tentacules fîexueux, très fortement capités, animés de
mouvements de va-et-vient les courbant en tous sens.
T. fîeœiris.
Tentacules rectilignes, rarement sinueux, rigides. 7
7. Tentacules non fascicules [Discophrya Lachm.) 8
Tentacules fascicules; ou bien 2-4 tentacules flexueux, très
fortement capités, animés. 15
8. Pédicule beaucoup plus long que le diamètre du cor])s. U
Pédicule au ])lus à peu i)rès égal en longueur au diamètre du
corps. 10
9. Tentacules répartis sur toute la surface du corps.
T. macrost}/ln.
Tentacules localisés au l)ord ant(''rieur. T. mdcrocoid'is.
10. P(''(licule à peu près égal en longueur au diamètre ducorps. 10
Pédicule beaucou]) plus court que le diamètre du corjjs. 14
11. Pédicule assez mince, cylindrique; s'il est épais, il ne l'est
pas plu? que les tentacules. 12
Pédicule très épais, au moins au sommet; tentacules toujours
— 193 —
minces, distribués irrégulièrement sur toute la surface du
cori)s. l-'^
12. Pédicule assez épais; tentacules au nombre de o ou \ irrégu-
lièrement distribués sur la moitié antérieure du corps,
aussi (''pais que le pédicule. 7\ crussijics.
Pédicule et tentacules minces, ceux-ci assez nombreux, irré-
gulièrement répartis sur toute la surface du corps.
T. ciliafa.
18. Pédicide à base très mince, s'évasant considéraljlement et
brusquement dans sa moitié antérieure qui s'insère sur
toute la face post(''rieure du cor})s. Noyau ramifié.'
T. Steint.
Pédicule large, s'évasant légèrement de la base au sommet,
s'insérant sur une partie seulement de la face postérieure
du corps. Noyau ovalaire, irrégulier.
T. Lichiensteini
.
14. Corjjs réniforme, avec une proéminence au mili(ni de la face
antérieure. Pédicule presque aussi large et aussi épais que
le corps. Tentacules distril)ués irrégulièrement sur le
bord antérieur. Une rangée de vacuoles i)ulsatiles le long
du bord antérieur. Noyau discoïdal ou en fer à clieval.
T. ferrum-equiniim.
Corps de forme variable, parfois réniforme mais sans proé-
minence antérieurt". Pédicule beaucoup plus mince et
moins épais (jue le corps. Tentacules disposés en une cou-
ronne antérieure ou en deux faisceaux latéraux. Une
rano-ée de vacuoles le long des bords antérieur et latéraux.
Noyau rubané ou en fer à cheval. T. cothurmita
.
\~). Un seul faisceau latéral, de tentacules, ceux-ci assez longs,
pointus ou capités; pédicule pas i)lus long que la moiti<'' du
diamètre du corps; une seule vacuole contractile; un
noyau ovalaire. T. cm'chfiaii.
Deux à quatre faisceaux de tentacules. Iti
16. Deux ou trois faisc<'aux de tentacules. 17
Qnatr(» faisceaux de tentacules. 2\
17'. Deux faisceaux de tentacules. 18
Trois faisceaux. 10
18. Corps de foi-me variable, souvent bilobé à l'extrémité anté-
rieure, avec sur chaque lobe un faisceau de tentacules
allongés, souvent reliés entre eux par des tentacules inter-
médiaires, l'aspect fascicule n'étant alors plus apparent.
— 194 —
Pellicule rectiligno ou légèrement incurvé, dépassant la
longueur du corps. 1 à 3 vacuoles contractiles. Noyau de
forme variable. T. cyclopimi.
Corps subspliéri(pie ou pyriforme, rétréci en arrière. 2 fais-
ceaux antéro-latéraux do tentacules courts. Pédicule
sinueux, dépassant rarement en longueur celle du corps.
2 vacuoles contractiles. Noyau ovoïde. T. infusionum.
\\). Trois faisceaux de tentacules neitenient ca])ités. 20
Trois faisceaux de tentacules non dislinctomont capités.
Noyau sphérique. Cytoplasme liyalin. T. dinptomi.
20. Cytoplasme brun opa(|ue. Noyau sphérique.
T. pijruyn.
Cytoplasme incolore. Noyau de foiine variable.
T. cyclopitin.
21. Tentacules au plus aussi longs que le corps (jui est pyramidal
ou (juadi'angulaire, chacun des angles portant un lobe
arrondi sur lequel s'insèrent les tentacules. Pédicule
dépassant de moitié la longueur du cor})s. 1 à (souvent )>)
vacuoles pulsatiles. Noyau ovalaire. T. quadripartita.
Tentacules plus longs que le corps (jusque (> fois). Pédicule
ne dépassant en généi-al pas la nioiti('' du corps.
T. cijclopuin.
1. T. MACRosTYLA (Stokes) Biitschli 1881), Sand 1899.
Podojjh)'i/a ))Uicroiihjla Stokes 188-5 et 1888.
2. T. MACROCAULis (Stokosj Sand 1899.
Acinetamao'ocaidis Stokes 1887 et 1888.
Sur Myriophyllum.
3. T. CRASSiPES (Fric et Vavra) Sand 1899.
Acluid.a? crasslpes Fric et Vavra 1894.
Sur les antennes d'un Crustacé (Boli("'me).
4. T. ciLiATA (Frenzel) Sand 1899.
Suct(»'eU.a ciluila Frenzel 1891.
Eau bourbeustî (Ré[)ublique Argentine).
5 T. Stkini (Clap. Laclun.) lîiitschîi 1889, P.lochmann 1895,
Sand 1899.
Podophrya Sleinii Claparède et Lachmann 1859,
Engeîiîiann 18(32, Kent 1882.
Sur Dytlscus.
— 195 —
6. T. LiCHTENSTEiNi (Clapai'ède, Laclimann) Biitschli 1889,
Sand 1899.
Podophrya Leichtenstebiii Clapai'ède et Laclimuiiii
1859, Kent 1882.
Podophrya Wr:-es}iwwshil Kent 1882.
Acineta hyphydj'i Stoin 1854, Wrzesniowski 1877,
Parona 1883.
7. T. FERRUM-KQUiNUM(Elirenborg, non Zenker) Biitschli 1889,
I^loclnnann 1895, Sand 1899.
Podophrya ferrum-equinum Ehrenberg 1838, Kent
1882.
Discopjh^^ya speciosa Lachmann 1859.
Acineta diademiformis (p.) Pritcliard 1801.
Sur HydrophUiis pjiceus.
8. T. COTHURNATA (Weisse) Biitschli 1889, Koppen 1888,
Blochmann 1895, Entz 189G, Sand 1899.
Acineta cothurnata Weisse 1847.
Acineta diademiformis (p.) Pritchard 18G1.
Podophrya cothurnata Claparède et Laclimann 1801.
Sur les coquilles, Lemna et CaUitricha.
9. T. IXCLINATA (Kellicott) P.iitschli 1889, Sand 1899.
Podojjhrya inclifiata Kellicott 1885, Stok(!s 1888.
Sui' le pédoncule des Camharus.
10. T. PARRocKLi (Cioui'i'et et Roeser) Biitschli 1889, Sand 1899.
Acineta parroceli Gourret et Roeser 1880.
Marin et d'eau saumàtre.
11. T. ASTAcr (Ckp. et Lachm.) Biitschli 1889, Blochmann 1895,
Entz 1896, Sand 1899.
Podophrya astaci Claparède et Lachmann 1859, Engel-
mann 1802, Kent 1882.
Sur Astacus fluviatilis.
12. T. CYLiNDRiCA (Pertv) Biitsclili 1889, Butchinsky 1897,
Sand 1899.
Podophrya cyJindrica Perty 1852, Kent 1882,Merescli-
kovsky 1881.
Sur les Leynna.
13. T. ELONGATA (Clap. et Laclim.) Biitschli 1889, Blochmann
1895, Entz 1896, Sand 1899.
Podophrya elongata Claparède et Lachmann 1859,
Kent 1882.
Sur les coquilles et les Algues.
— 19(5 —
14. T. FLEXiLis (Kellicott) IJutsclili 1S89, Sand 18U1».
Po(loj)]i,-t/(i fJ(\ri1/s KcHifOd ISST, Slokcs 188S.
Sur EpishjVts.
15. T. CARCHESii (flap. et Lachin.) I)i'i(selili 1889, Blocliiiiann
1895, Sand 1899.
Podophyi/a Carchesii ria})ar(""de et Lachinann 1859 et
18()1, Kent 1882,Kôppen 1888, Stokes 1888.
Sur le pédoncule de Carchcs'Hon et (VEiJfsff/I/s.
10. T. QUADitiFARTiTA (Clap. et Lachm.) Biitsehli 1889, Blocli-
niann 1895, Sand 1899.
Podophyi/n qnadvipartita Tlaparède et Lachmann 1859
et 18(il, Engelmann 1862, BiUselili 1870, Kent 1882,
Kôppon 1888, Stokes 1888.
Sur les plantes et les Mollusques aquatiques.
17. T. CYCLoPU.M (Clap. et Laclim.) Biitsehli 1889, Scliewiakoti'
1893, Fric et A'avra 1894, Blochmann 1895, Entz 1890,
Sand 1899.
P()iloj)]ii-!/(i cjjclnpxtn Claparède (>t Lachmann 1859 et
1801, Lachm. 1859, Kent 1882, Stokes 1880 et 1888,
Imliof 1885 et 1890, Kofoid 1891.
Achield, fuberosa Stein 1851 non Ehrcnhcrg.
Achicta phrygnnidarwn Stein 1867.
Acineffileninarinn Stein 185 l,Kent 1882, Biitsehli 1889.
AciiiPtd /fnrù//i/is Sioke^ 188r)-88.
Podophr-ijn phnjgcmichir-iuii Kcni 1882.
Poflnplu'ijn molP/s Kent 1882.
Sui' Cf/clo/j.s, (himmarus, Epi^chura, les larves (1(>
Phrvganes, Lemtta, VaUisneria, etc.
18. T. iNFUsioNU.M (Stein) Biitsehli 1887, IMochmann 1895,
Entz 189(3, Sand 1899.
Podophrya fixa var. Stein 1854.
Acincfa infusionum Stein 1859.
Podt)p/u'i/a inf/(.swnum Engelmann 1802, Kent 1882.
Eaux stagnantes.
19. T. PYRUM (Clap. et Lachm.) Biitsehli 1889, Sand 1899.
I*od()j)hr//apj/rH,/nC\-à\mvo(\e et Lachmann 1859 et 1801
,
d'Udekem 1864, Kent 1882.
Sur les Lanna
.
20. T. DiAPïOMr (Kellicott) Sand 1899.
Podopjhrya diaptomi Kellicott 1885, Stokes 1888.
Sur les anneaux de Diaptoinus,
107 —
3. ACINETA Ehrenb. ISliii, Sand 1800.
Dix-neuf espèces :
1. Tenlaeules non fasciciih'S; loge et eoi'[)S non rom})rimés de
liauL en bas. 2
Tentacules. fascicules; loge et corps coin})riniés do haut en bas.
5
2. Loge et corps comprimés de haut en bas; loge triangulaire
à. l'angle postéi'ieur duquel s'insère un pédicule mince et
fiexueux, corps non adhérent à la loge, muni de ({uelques
tentacules courts sortant par une fente de la loge. Cyto-
plasme jaune brun. A. pava.
Loge et corps non compriuK'S de haut en bas. 3
.'). Loge ovalaire à grand axe transversal, couverte de petits
mamelons disposés régulièrement, largement ouverte an-
térieurement, i)rolongée par un petit pédicule conique.
Gor[)S attaché seulem(>nt à l'extrémité [)Ostérieure de la
loge et faisant saillie en avant en une sphère plus petite
que la loge et garnie tle tentacules allongés. Un novau
et 2 vacuoles pulsatiles. A. h'ifar'ia.
Loge à grand axe antéro-j^oslérieur, non ovalaire. 4
4. Loge losangiqueî à grand axe antéro-})Ostérieur, à angles
arrondis et à côtés concaves, ouverte en avant et prolongée
par un petit pédicule mince et cylindrique. Corps remplis-
sant la loge et proéminant par ^ou^ erture antérieure où
se trouve un bou(]uet de tentacules pas plus longs que la
loge. Un noyau et une vacuole contractile.
A. jiij)'if()7'inis.
Loge obpyriforme à grosse extrémité antérieure tronfjuée
et ouverte, s'unissant postérieurement au pédicule i)ar un
renflement si)hérique. Pédicule épais atteignant deux à
ti'ois fois la longueur de la loge. Corps en forme de cy-
lindre allongé, s'unissant à la logo en arrière et en avant,
faisant saillie en dehors d'elle sous forme d'une calotte
]iémisphéri(iue garnie do nombreux tentacules. Un noyau
et une vacuole. A. cicgans.
5. Loge à face antérieure, plane et i)ercée d'une fente transver-
sale par les extrémitf''S dilatées do laquelle passent deux
faisceaux de tentacules. 6
— 198 —
Loge ouverte par toute sa l'ace antérieure sur les extrémités
latérales de laquelle sont insérés deux faisceaux de tenta-
cules ; ou bien loge ne présentant que deux ouvertures
antéro-latérales pour les deux faisceaux de tentacules.
7
6. Loge cjlindro-conique, pédicule très court, corps remplis-
sant presque totalement- la loge, noyau ovoïde.
A. urccolata
.
Loge subtriangulaire en coupe opti(pie ou en forme de
(lemi-ONOÏde;pédicule six foisplus long (pie la loge, corps
occupant au plus la moitié antérieure de la loge ; noyau
rubané. A. grandis.
7. Loge ouverte par toute sa face antérieure. 8
Loge ne présentant que deux ouvertui-es antéro-latérales,
laissant passer les deux faisceaux de tentacules. 18
8. Loge évasée ou en formede tonnelet i)ortant de 10 à 15 étran-
glements circulaires transvers;uix ; corps ne remplissant
pas complètement la loge. Un noyau et une vésicule con-
tractile. A. ornata.
Loge dépourvue d'étranglemenls circulaires transversaux. 9
9. Loge contenant, au moins la moitié du corps. 10
Loge ogivale, allongée, sur laquelle est j)Osé le corps, sphé-
ri(]ue, trois fois })lus large que la loge et dont un petit
prolongement coni(iue pénètre seul dans la loge.
A. crusiaceorum
.
10. Loge en forme de poire dont la queue très courte serait le
pédoncule et dont la grosse extrémité serait troïKjuée,
corps si)liérique. A. sjjecïosa.
Forme ne ré])ondant pas à cette descri})tion, 11
11. Tentacules rigides. 12
Tentacules longs et flexibles, animés de mouvements de va-
et-\ient qui les recourbent en tous sens ; loge conique ;
pédoncule court, A. cuspklata.
12. Pédicule dépassant beaucoup la liauteur de la loge. 13
Pédicule ne dépassant pas la hauteur de la loge. 15
13. Pas de renflement à l'union du pédicule et de la loge ; loge
cylindrique. 14
Loge coni(|ue;pédicule épais, cylindii(jue ; un renflement à
l'union du pédicule et de la loge Iportion du corps inté-
rieure^suspendue au bord antérieur de la loge, remplis-
sant une portion \ariable de la cavité de la loge;portion
— 199 —
extonio mamelonnée ou sphéi'i(|ue, de dianirlrc jjîirfois
lril)le de celui de la loge, avec 2 (rarement 3) faisceaux de
tentacules. Parfois la portion externe du corps est pour
ainsi dire mdle, les tentacules étant portés sur deux jjetits
mamelons antéro-latZ-raux. Un novau et une vacuole con-
tractile]. A. i)aj)}IUfer((.
14. Loge plus lai'ge que liante ; cor})s ovalaire à grand axe
transversal, occupant environ les o/4 de la loge, sa
})ortion externe en forme de mamelon très aplati avec
deux faisceaux antéro-lat(''raux de tcntacuh^s. Vu novau
rubané, une vacuole contractile. A. Ifisantcold
.
Loge plus haute (|ue large ; corps spliériquc, ne rem})lissan1
pas la moitié d(> la loge, sa ])ortion externe en forme de
mamelon aplati portant deux faisceaux antérodal('raux de
tentacules. Une vacuole contractile. A. sirrrjdcj'.
15. Pédicule égalant au moins la, moitié de la hauteur de la
loge, au plus cette hauteur. 10
Pédicule rudimentaire, large, cvlindrique ; loge coni(jue. 17
16. Loge ressemblant à une tulipe à bord antérieur pentalobé;
pédicule moitié moins haut que la loge; corps rem})lissant
presque complètement la loge avec sa portion extérieure
mamelonnée portant deux faisceaux antéro-latéraux de
tentacules. Une vacuole contractile. A. tidvpa
.
Loge en demi-ovoïde régulier, le bord antérieur lisse;pédi-
cule mesurant environ la hauteur de la loge ; corps sub-
ovale, remplissant environ les 2/3 de la loge avec sa
portion extérieure conique avec deux faisceaux antéro-
latéraux de tentacules. Noyau si)héri(]U(\ une vacuole
pulsatile. A . ^ileupoi-tensis.
17. Loge conique, comprimée, avec deux lèvres antérieures (en
dessus et en dessous) ; corps (remplissant complètement
la cavité de la loge) prolongé entre les lèvres en une lan-
guette portant 2 faisceaux antéro-latéraux de tentacules.
A. Vniguïfera.
Loge sans lè-sre, le bord antérieur échancré ; la face anté-
rieure du corps est plane et porte les 2 faisceaux de tenta-
cules. Var, interrupta.
18. Loge irrégulièrement cylindrique, i)lus haute que large, à
bord antérieur concave;pédicule très court ; corps rem-
plissant souvent la cavité de la loge ; noyau allongé, une
vacuole contractile. A. lacustris.
— âoo —
Loge conique, aussi large (|ue haute, à bord antérieur droit
ou con^\>xe;])édicule n'avant pas la moitié de la liauteur
de la loge ; corps remplissant complètement la cavité de
la loge; noyau s])liérique, une ^'acuole contractile.
A. (teqiKdis.
Espèce extrêmement variable, ordinaii'ement marine, mais
(rouvé(; aussi dans l'eau saumàtre. Loge de formes et
dimensions diverses; pédicule ayant de 1/10 à 5 fois la
liauteur de la loge ; c0i'i)s de formes diverses remplissant
à peu pi'ès complètement la cavité de la. loge. Noyau très
variable, 1 ou 2 ^a.cuoles contractiles. A. Uibet^osa.
1. A. BiFAKiA Stokes 1887-88, Sand 181)9.
Dans les infusions de foin.
2. A. PYRiFORMis Stokes 1887, Sand 1800.
Sur les plantes aquatiques dans les mai'es i)eu profondes.
3. A. ELEGANS Imhof 1883-84, Sand 1800.
Sur Bythofrej)hes loïKjhnan.us.
4. A. FLAVA Kellicott 1885, Stokes 1888, Sand 1800.
Sur Stephanodiscus niagarae.
5. A. URCEOLATA Stokes 1885-88, Sand 1800.
Sur les plantes aquatiques des eaux stagnantes.
6. A. GRANDIS Kent 1882, Biitschli 1880, Blochmann 1805,
Sand 1800.
Sur Anachar'is et Potai)wgcton.
7. A. ORNATASand 1890.
Dans l'eau saumàtre.
8. A. CRUSTACEORUM Saud 1800.
Dans l'eau saumàtre, sur un petit crustacé.
0. A. SPECiosA Maskell 1887, Sand 1800.
Acineta elegnns Maskell 1880, non Imhof.
10. A. CUSPIDATA kellicott 1885, Biitschli 1880, Stokes 1888,
Sand 1800.
Dans l'eau douce.
11. .\. PAPiLLiFERA Koppcn 1888, Biitschli 1880, San<l 1800.
Marin et d'eau douce, sur iUra.
12. A. LASANR'OLA Maskell 1887, Sand 1800.
13. A. siMPLKX Maskell 1880, Kirk 1887, Sand 1800.
14. A. NiEïïPORTENSis Sand 1809.
Parmi les Algues, dans l'eau saumàtre.
— 201 —
15. A. TULiFA Maskell 1887, Sand 189».).
16. A. LiNGUiFERA Claparcdo et Lachinann 1859, Kent 1882,
Parona 1883, Bûtschli 1889, Bloclimann 1895, Entz 189(3,
Sand 1899.
Achieta ligulata Stein 1859.
Ac. uitei-rupta Parona 1883.
Sur les Coléoptèi'es a(|uatiques; aussi dans l'eau saumàtre.
17. A. LACUSTRis Stokes 1886-88, Sand 1899.
'ëiWY Anacharis.
18. A. TUBKROSA Ehrenberg 1838, Stein 1859, Claparède et
Lachmann 1859, Fraipont 1877, Entz 1878 et 1884,
Meresclikovsky 1880-81, Kent 1882, Parona 1882, van
Rees 1884. Mobius 1888, Biitschli 1889, Sand 1895-99.
Achieta citcuUm Claparède et Lachmann 1859,Hertwig
1876, Mereschkovsky 1880, Kent 1882, Butsehli 1889.
Ac. poculiun Hertwig 1876, Kent 1882.
Ac. fœtida Maupas 1881, Kent 1882, Gruber 1884, Entz
1884,1889 et 1896,CTOurret et Roeser 1886, Florentin 1899.
Ac. corrugata Stokes 1894.
Surtout marine, mais se rencontre aussi dans l'eau sau-
màtre, dans la pellicule blanchâtre qui recouvre l'eau cor-
rompue, sur Enteromo7'i)ha et d'autres plantes aquati(|ues.
19. A. AEQUALis Stokes 1891, Sand 1899.
^\\v Myriophyllum et d'autres plantes aquaticjues.
4. SOLENOPHRYA Clap. et Lachm. 1859.
Quatre espèces :
1. Loge beaucoup plus haute (|uc large ou beaucoup i)lus large
que haute. 2
Loge à peu près aussi haute que large. 3
2. Loge beaucoup plus large que haute, en cvlindro l)as, adhé-
rant par la base et ouverte en a^ant. Cori)s de forme
variable, reposanl sur le fond de la loge sans être adhé-
rent aux côtés, portant 4 à 6 faisceaux de tentacules sur
sa face antérieure. Noyau ovalaire. 1 à 8 ^•acuoles con-
tractiles. S. crassa.
13
202
r<>i 'Loge siibcylindi'i(|n(', deux à trois fois plus Iiautiî (|uo larç
ouverte en avant, fixée par son extrémité postérieure
rétrécie. Corps adhérent à la loge et occupant toute sa
cavité, deux faisceaux de tentacules courts sur la face
antérieure. S. )iotonectae.
3. Loge subspliérique fermée avec un l'ebord équatorial près
duquel la loge est percée de 4 à ouvertures. Corps avec
4 à 6 faisceaux de tentacules qui sortent par les trous de
la loge. S. inclusa.
Loge pjriforme, tronquée au sommet, le bord antérieur
fendu transversalement. Corps muni d'un faisceau de
tentacules sortant par le bord antérieur de la loge.
S. 2)era.
1. S. CHASSA Claparède et Lacbmann LS50, Kent 1882, lUitsclili
1889, Blochmann 181)5, Sand 1809.
Sur les racines des Lemna.
2. S. NOTONECTAE (Clap. et Laclnn.) Rutscldi 1889, liloclunann
1895, Sand 1899.
Acineta iiotoncctae Claparède et Laclunann 1859 et
1861, Kent 1882.
Calix notonectae Fraipont 1877.
Sur Notonecta gJaiicd.
3. S. INCLUSA Stokes 1885 et 1888, I^iitschli 1889, Sand 1899.
Sur Pt 'oseï plnacea
.
4. S. PERAStolves 1885 et 1888, Biitschli 1889, Sand 1899.
'èvir Mijrioph [/Il H,nt el autres plantes aquatiijues.
Fam. 5. DENDROCOMETIDAE.
Corps hémisphérique ou lenticulaire, fixé par une plaque chi-
tineuse s'étendant sur toute la surface Ijasale ou sur une portion
de celle-ci, muni de nombreux tentacules ti'ès i)etits, courts et
coniqu(3S, placés à l'extrémité de prolongements cvlindri([ues ou
coniques, simples ou ramifiés. Pas de loge ni de pédicule. Une
vacuole conTt-actilc marginale. Reproduction par formation d'un
embryon péritriclie, à face ventrale aj[)latie. Conjugaison.
JO'S
Deux genres.
Table (les (jenrcs.
Coi-ps muni do 1 à 6 (ordinaircuK-nl 4) gros prolongcmenis
cylindriques bifui'qués ou trifur([ués deux ou trois t'ois de-
suite, cliaouno des dernières Ijranches portant de 2 à 4
tentacules.'
1- Dciulnmmietcs.
Coi'])S muni dt? 10 à 20 i)i'olongements coni(iues, non rami-
fiés, sur chacun desquels s'insère un tentacule.
2. Stijlocomctes.
1. DEN1)R<)(^0METES Stein 1851.
Une seule espèce :
1. Dendrocometks pakadoxus Stein 1851-r)4, Laclimann 1850,
I^iitschli 1877 et 1880, Wrzesniowski 1877, Robin 1880,
Maupas 1881, Kent 1882, Kellicott 1885, Plate 188G,
Schneider 188(), Stokes 1888, Eismond 1801 et 1805,
Kofoid 1804, Bloclnnann 1805, Entz 1800, Sand 1800 et
1800-
Sur les poils des ])attes et sur le bord des i)hu|ues bran-
chiales des Gamutcu'us.
2. STYLOCOMETES Stein 1807.
Une seule espèce :
1. Stylocometes dkutatus Stein 1807, l>iïtscldi 1880, Eis-
mond 1805, Blochmann 1805, Sand 1800.
Aciiicta digitala Stein 1850 et 1878.
TricJiOphri/a digilata Claparède et Laclnnann 1850,
Kent 1882.
Trichophrija ophrt/dii Cla[)arède et Lachmann 1850.
Digilophrya Eraipont 1877.
Pericometes digilatns Schneider 1887.
Asril/cohi digilala Plate 1888. •
204
Sur le bord des lamelles branchiales (VAscllus et Gam-marus, aussi sur lus tiges d'Ophri/dmm versatile.
Fam. 6. DENDROSOMID.E.
Coi'ps de forme variable, ramifié ou non, libre ou fixé, avec
de deux à un très grand nombre de tc^ntacules cvlindri([ues,
capités, non fascicules et répandus sur tout le corps ou sur une
portion seulement de sa surface, ou fascicules et localisés sur les
lobes ou les ramifications;])as de loge ni de ])édicule, pai'fois
une enNelopi)e formée de grains de sable; noyau spliérique,
ovoïde ou irrégulier et ramifié; une à un très grand nombre
de vacuoles contractiles. Reproduction (dans les cas connus) par
embryons endogènes péritriches ou liypotriclies en forme de
lentille biconvexe aplatie ou par gemmes non ciliées, ])arfois
tentaculées.
Cnu[ genres.
Table des genres.
1. Organisme flottant, libre. 2
Organisme fixé. 3
2. Corps massif entouré d'une enveloi)pe formée de fines parti-
cules sableuses et végétales accolées, s'étendant aussi sur
les [)rolongements du corps au nombre de huit, cliacuu de
ces pi-olongements étant muni d'un bou(piet de tentacules
faisant saillie hors de l'enveloppe. Noyau elliptique.
4. Astrophrya.
Corps spliérique muni de (3 protubérances, deux aux deux
pôles déterminant le grand axe et quatre dans le i)lan
é({uatorial Ces protubérances sont grosses, très obtuses
et portent chacune de 12 à 20 tentacules très larges, r(>c-
tilignes et capités. Une ou deux vacuoles })ulsatiles; un
noyau ellii)ti(iue, grossièi-ement granulé.
5. Staurojihri/a.
o. Corps h-régulier, encroûtant, d'où s'élèvent un grand
nombre de digitations obtuses et courtes, couronnées par
— 905 —
des bouquets de tentacules aussi longs que le corps;
nojau irréguliei', rubaniforme et rameux.
3. Ley^nœophrya.Corps formant sur le support un réseau sur lequel se
dressent de longs prolongements, simples ou ramifiés,
terminés par une extrémité renflée ])ortant un faisceau
de tentacules capités; le stolon brun, les branches inco-
lores ou i^ougeàtres; novau ramifié comme le corps.
2. Demlrosonuf.Corps ovoïde, quadrangulaire, trapézoïde, hémisphérique ou
lobé, avec un ou plusieurs vacuoles; noyau de forme
variable. 1. Trichopkrya.
1. TRICHOPHRYA Clap. et Laclim. 1859.
Cinq espèces.
Tableau des espèces :
1
.
Corps ovalaire-allongé avec un seul faisceau de tentacules à
son extrémité antérieure. T. itischun.
Plusieurs faisceaux de tentacules ou tentacules non fasci-
cules. 2
2. Un faisceau de tentacules à chacun des trois angles du corps
qui est aplati, cordiforme ou triangulaire.
T. cordiformis.
Tentacules non fascicules ou bien 4 à 12 faisceaux. 3
3. Corps allongé, plurilobé avec 4 à 12 faisceaux de tentacules
insérés sur les lobes ou à tentacules non fascicules et
épars sur toute sa surface. De 3 à 11 vacuoles.
T. epistylidis.
Une seule vacuole. Tentacules non fascicules. Corps nonlobé. 4
4. Cor])s de forme très variabh^ avec 10 à 30 tentacules
inégaux, divergeant de toutes les parties du corps.
T. i-arinhilts.
Corps subhémisphérique avec 1 ou 2 tentacules allongés.
T. shjijj/eiJG.
— 20G -
1. T. pisciUM Bi'itsdili 1889, Schowiakoff 1893, Sand 1890.
Sur les branchies (ÏEsoœ, Pe^'ca et Acerina.
2. T. coRDiFORMis Scliewiakoff 1893, Bloclimann 1895, Sand
1899.
Fixé dans l'angle de la furca de CijcJops phaJeratus.
3. T. EPiSTYLiDis Claparède et Lachmann 1859 et 1861, Stein
1859-78, Biitscldi 1876 et 1889, Badcock 1880, Kent
1882, Maskell 1887, Stokes 1888, Scliewiakoff 1893,
Bloclimann 1895, Entz 1896, Sand 1899,
Actinophrijs sol Perty 1852,
Dcndrosoma Astaci Stein 1859-78, Kent 1882.
Acineta sp, Cienkowskv 1855.
T)nchophr}ja sinuosa Stokes 1886-88.
Sur les végétaux aquatiques, Epnstj/Hs, Astaciis et les
plaques branchiales des Gammarus.4. T. VARiARiLis Sand 1899.
Parmi les Algues et les plantes jupiatiques.
5. T. siMPLEX (Zacharias) Sand 1899.
Acineta simplcx Zacharias 1892.
Sur les chaînes flottantes de Fragilaria crotonens/s.
2. DENDROSOMA Ehi-enb. 1838.
Une seule espèce :
1. D. RADIANS Ehrenberg 1838, 1810 et 1862, Dujardin 1811,
Perty 1852, Claparède et Lachmann 1859 et 1861, Prit-
cliard 1861, L(>idj 1874, Levick 1880, Kent 1882, Biitschli
1889, Stokes 1888,P>loclimann 1895, Entz 1896, Sand 1899.
Cette espèc(\ (pii atteint jusque 2,400 \^, se ti'ouve sur
AïKicluiris. Mi/)-i()])htjJIunu elc.
3., LERN.EOPHPvYA Perez 1903.
Une seule (ïsjièce :
U /.. crijnfdlfi Perez 1903.
Sui' les pai'lies jcinies des colonies de Coril;/l()j)]tnr(i
.
Ilhi/ncluila ci/ctopum Zcnkcr.
lh„ii!a cimli/liJt> Clap. ol Lichm..
• 1" Mslmincla mfnlaema (Elirenlj.),
/t,.« (0. V. Mlllliîrl,
ri/a iiii
.,lwiiliri/ii culimlrira (l'crtyl,
r'/'l'>junn (Clnp. cl Laclim.).
,,„„,/: //-uWiVu (Clap. l't Ladim.).
,,„, „,„/ M;i>Wl,
— luMiiicola Maskell,
— htlji'rosa Ehronb-,
, ,, ,,,,,.„„ „„(„,„r(m! ICIap. cl I.aclim.l.
i;ii'hi.jiliii/<i l'jM.wy'i'/K Clap. et Laclinl
— ruriallilis Sanil,
I),'iuIroswiia railiuiis Ehrcnb.,
.Ulroiiliriiii aivnaria Awcrinlz.,
SNiiiroiilirijn eleyans Zacli..
l.rymm'ltUyija raptlala Peveil.
— 20->
4. ASTROPHRYA Awerintzew 1903.
Une seule espèce :
1. A. ARENARiA Awei'intzew 1904.
Plancton (Volga, Russie).
5. STAUROPHRYA Zacliarias 1891
Une seule espèce :
1. St. elegans Zacliarias 1897, Sand 1899.
Plancton (Lac de Pion).
Espèces aberrantes, insuffisamment décrites
ou de position incertaine
1 et 2. Acineta Icq^pacea Stokes 188.5 et stellata Kent 1882
= pour Bûtschli, Hedriocystls pelluc'ida. (Héliozoaire.)
3. Acineta solaris Stein 1859 est insuffisamment décrit,
c'est peut-être un Podophrya.
4. Actinosphœridium pedatitm Zacliarias 1893 est d'après
Penai'd (Les Hcliozaires d'eau douce, p. 318) voisin de
Nuclearia caidescens ou appartient peut-être au genre
Tokophri/a.
5 et 6. Acanthocystis conspicua Zacliarias 1897. Zacliarias
décrivit cette espèce comme Héliozoaire, Sand en fit un
genre nouveau Heliocoinetes renfermant une autre
espèce marine : H. digitatus Sand 1899; Sand considère
que ce genre est intermédiaire entre les Héliozonires et
les Acinétiens. Penard {l. c.) pense que ces deux espèces ne
font pas i)artie des Héliozoaires.
— 208 —
Acthiolophus capitatus Penarcl 1890. Décrit (Vabord par
Pénard comme \m Heliozoaire, puis par Sand également,
quoique cet auteur lui trouve de grandes ressemblances
avec la Tokophrya limbata ; en dernier lieu, Penai-d
estime qu'il faut en faire un Acinétien.
Jetraedriyphrya planctonica Zykoff 1901, simplement
cité dans Je " Zoologisclier Anzeiger «, 1901; nous
ignorons s'il a paru une description de cette espèce.
Tricho'phrija angulata Dangeard 1890. D'après Sand,
espèce insuffisamment décrite et à position douteuse qui
n'est pas un Tentaculifère.
TABLE ALPHABETIQUE
N. B. — Les slinon !fmes sont en italiques
ACINETA 197
ACINETIDAE 190
ACTINOLOPHUS 208
ACTINOSPH^RIDIUM .... 207
acuminata 185
fftqualis 201
alata 185
algirensis 187
angularis 185
angulata 208
arenaria 207
ASELLICOLA 203
Astaci (Tokophrya) .... 195
astaci (Trichophrya) .... 206
ASTROPIIRYA .... 207
AUTACINETA • 184
bifaria 2(X)
brachiopoda 191
brachypoda 191
brevipes 185
brevipoda 187
Ikickei 191
capitata (Lenia^ophrya) . . . 206
capitatus (Actinolophus) . . . 208
carcliesii (Tokophrya) . . . 196
carchesii (Metacineta) . . . 185
Choaxophuya ..... 188
ciliata 194
compressa 191
conspicuus 207
cordiformis .... . . 206
corrugata ....... 201
cothurnata 195
cothurnia (Metacineta) . . . 185
crassa 202
crassipes 194
crustaceorum 200
cucullus (aciiieta) 201
cuspidata 200
cyclopum (Rhynchoeta) . . . 183
cyclopum (Tokophrya) . . . 196
cylindrica 195
Dendrocometes 203
Dendrocometidae .... 202
Dendrosoma 206
Dendrosomidae 204
diademiformis 195
diaptomi 196
difformis 187
digitatus (Stylocometes) . . . 203
(ligitatus (Heliocometes). . . 207
Digitophrya 203
elegans (Staurophrya) . . . 207
elegans (Acineta) 200
elongata (Tokophrya) .... 195
ENDOSPHyERA 190
Engelmanni 190
epistylidis (Trichophrya) . . 206
epistylidis (Urnula) .... 184
ferrum-equinum (Tokophrya) . 105
feyrum-equinumiChoano^hTya.) 188
fixa(Podophrya) . . .."
. 187
^ica (Podophna) IN7
tlava 200
llexilis (Tokophrya) . . . . 195
flexilis (Metacineta) .... 185
flos 185
fliiinatilis 196
fœtida 201
gammari 184
— 210 —
gelatinosa 188
grandis 200
Hallezia 191
Heliocometes 207
hydrostatica 189
hyphydri 195
inclinata 195
inclusa 202
infundibulifera 188
infusionum 196
interrupta 201
lacustris 201
lappacea 207
lasanicola 200
lemnarum 196
LERNiEOPHRYA 206
libéra 187
Lichtensteini 195
ligulata 201
linguifera 201
longipes 185
macrocaulis 494
macrostyla 194
magna 189
Maupasi 187
Metacineta 184
Metacinetidae 184
minima 187
mollis 196
mystacina 184
mysticina 184
nieuportensis 200
notonectae 202
. obconica 183
ophrydii 203
Orcula 187
oriiata 200
ovata 189
oviformis 191
papillifera 200
paradoxus 203
paramaeciormn 189
parroceli 195
parva 189
pedatum 207
pera . 202
jjedicellata 187
Pericometes 203
phryganidarum 196
piscium 206
planctonica 208
pocultim 201
podophrya 186
Podophryidae 185
pusilla 189
pyriformis ....... 200
pyrum 196
quadripartita 196
radians 206
RHYNCH^TA. ...... 183
simplex (Trichophrya) . . . 206
simplex (Acineta) 200
sinuosa 206
soi (Trichophrya) 206
soi (Podophrya) 187
sol (Sphœrophrya) .... 189
Sol (Sphœrophrya) .... 189
Sol (Solenophrya) 000
solaris. ........ 207
Solenophrya 201
SpH/Erophrya 188
speciosa (Acineta) 200
speciosa {Tokophrxa) . . 195
stagnatilis 185
Staurophrya 207
Steini 194
stellata 207
stentorea 189
Stentoris 189
Stylocometes 203
stylonychiae 189
suctorella 194
Tetraedophrya 208
tokophrya 191
Trichophrya .... . 205
Trichoda 187
trochus 187
tuberosa (Acineta) 201
tuberosa (Tokophrya) . . . 196
tulipa "201
urceolata 200
Urnulidak IS2
Urxula 184
urostylae 189
variabilis 20('t
WfzcsniotrsUi 195
L'universalité et ia cause de ia terme spliérique
DES ORGANISMES INFÉRIEURS
par A -Maurice I>()ubier
Docteur es sciences, Privat-docent à l'Université de Genève
La forme sphérique paraît être la forme primitive et fonda-
mentale des êtres organiques, car on la retrouve partout à la
base de tous les groupes d'unicellulaires, aussi bien animaux que
végétaux; de même la cellule œuf est, elle aussi, typiquement
sphérique. On en pourrait citer de très nombreux exemples; en
voici seulement quelques-uns pris parmi les groupes les plus divers.
Chez les Algues vertes, ce sont PalmeIJococcufi minfafus,
Eremosj)haera viridis, Dictyofiphaerhmi Ehrenhergia-
num, Hariotina reticulata, Chlorella vulgaris, du groupe
des Protococcacées;
puis Palmella miniata, Tefraspora
n/racea, Sphaerocijsfis SchrœfetH, du groupe des Palmel-
lacées; Pleurococcus vulgaris, du groupe des Pleurococcacées;
Gonium pectorale, des Volvocacées.
Chez les Protozoaires, citons parmi les Héliozoaires, qui sont
tous ou presque tous typiquement sphériques : Acfinojjhri/s
snl, Actinoaphaerium Eichhornu, Astrodhculus radhms,Heterophi 'j/s, Pomphohj.rophrys, Lithocolla g/ohosa.
Chez les Radiolaires, Haeckel a démontré que là aussi la
forme primaire et originelle est bien la sphère, telle que nous la
présentent les Thalnssicolla, les Thalassosphaera , les Ceiws-
phaera, les Sjihaerozoum et les Col/osphaera
.
Parmi les Foraminifères, citons les genres PiluUna, Saccn-
7)iina, Tfm?'atu)Jiina, Glohlgerina, Orhuliua.
Le Tentaculifère Sphaerophy^ya est absolument sphérique
quand il est libre. Les Flagellés Anipkimonaa, Multicilia
,
Chrysococcas sont aussi des animalcules sphériques. Il en est
de même des Noctiluqaes, représentants du groupe des Cysto-
flagellés. Les infusoires ciliés eux-mêmes, les plus différenciés
des protozoaires, laissent facilement (mtrevoir la forme sphé-
— 213 —
rique originelle, car elle est peu modifiée cliez C/ofi-icfur
globosd, Hok)i)hri/(( onim, Prorodon tO'QH, etc.
Ces quelques exemples suffisent pour démontrer l'universalité
de la forme spliérique à la base des formes organiques. Essayons
maintenant d'expliquer la raison d'être de cette forme.
Pour cela nous nous adresserons à la masse prutophts-
tnique qui constitue ces organismes inférieurs, mélange très
complexe de corps nombreux, de substances diverses dont la
})lu])art sont très compliquées.
Cette masse protoplasmi({ue se prc'sente comme une substance
visqueuse ou semi-liquide; plongée dans l'eau, elle présente la
tension superficielle des liquides, force d'atti'action des molé-
cules superficielles les unes pour les autres ({ui fait que la
surface enveloppante de cette masse protoplasmique se comporte
comme si elle était formée d'une membrane tendue.
Nous pouvons maintenant assimiler la masse })rotoplasmique
des organismes spliériques immergés dans l'eau, à un liquide
sans poids abandonné à lui-même. Les forces moléculaires (|ui
agissent dans ce li(piide tendent à rassembler le plus de molé-
cules possible à l'intérieur de la plus ])etite surface possible.
Or, ce volume n'est autre (|ue la sphère.
Le physicien belge Plateau a montré ce i)hénomène par une
expérience saisissante. Dans un mélange d'eau et d'alcool, dont
les prO])Ortions sont telles qu'il a la même densitc' que l'huile
d'olive, il introduisit une certaine masse d'Iiuile, au moyen d'une
pipette. Cette masse d'huile se trouve ainsi dans un équilibre
parfait au sein de l'eau alcoolisée, i)uisque les choses se passent
comme si la poussée de haut en bas de la masse d'huile était
annulée par la poussée de bas en haut de l'eau alcoolisée. Il n'y
a plus en jeu dans cette goutte d'huile, liquide sans poids, que
les forces moléculaires dont il a été (juestion plus haut. En
consé(|uence, on voit que la masse d'huile s'arrondit en une
masse spliérique parfaite et parfaitement stable.
Les choses se passent absolument de la même façon chez les
organismes spliéri(|ues, librement suspendus dans l'eau. Ils se
trouvent là dans les conditions d'un liquide ou d'un semi-liquide
sans poids, et par consé(pient prennent la forme d'équilibi-e de ce
liquide sans i)oids, c'est-à-dire une foi'me parfaitement spliérique.
On peut admettre aussi et du même coui) (pie les organismes
spliériques immergés dans l'eau possèdent, en la totalité de leur
masse, cela va sans dire, la même densité que l'eau.
La Vésicile Contractile, orpne lijdrostatipe
pai- A. -Maurice Ijoubier
Docteur es scienct'S, privat-docent à l'Université de Genève
On a beaucoup disserté sui' la vacuole ou vésicule contractile
(les Protozoaires, mais la. ({uestion n'est pas entièrement résolue.
(Quelques points ce})en(lant sont ou semblent ac({uis.
C'est tout d'abord (jue la vésicule contractile est un a])pai'eil
ti'ès répandu, que l'on rencontre dans toute la série des liliizo-
podes (à l'exception des monères, oi'ganismes rampants et
fluants), des Héliozoaires, des Flagellâtes, des Infusoires, mais
elle parait manqu(,'r en général aux pi'otozoaires marins (Radio-
laires, Noctilu(|ues). Cette large répartition démontre que la
\ésicule doit jouei' dans la vie de tous ces organismes un rôle
pliysiologique de première importance.
La ou les vésicules contractiles sont localisées sous Tecto-
l)lasme, lout proche de la surface de l'organisme; elles se rem-
plissent (diastole) et se vident (systole) alternativement, à des
intervalles plus ou moins rapprochés, suivant les espèces et
suivant les individus.
(^hez les Amibes, au moment où la vésicule entre en diastole,
on voit api)araitre d'abord plusieurs petites vésicules situées
côte à côte, ({ui finalement éclatent les unes dans les autres et
confluent en une grande vésicule Mais le plus souvent, la vési-
cule grossit régulièrement et S(î gonfle comme par osmose. Quel-
quefois, coiiune chez Pclonujxd.,au li(Mi d'une seule grande
N'ésicule, on en voit un très grand nombre de petites.
Chez les Rhizopodes testacés et chez les Infusoires, la position
de la ou des vésicules est plus fixe ; elles sont localisées, toujours
sous r(;ctoi)h^sm(>, soit à la partie antérieui"e près de la bouche,
soit à la partie postérieiu'e..
,
— 215 —
On obsorvo, à la diastole, (juc l;i vésicule eoniractile possède
une tension osmotique très i'orte, due à la pression de son con-
tenu. On n'est pas d'accord sur la natvu'e de ce contenu.
BuTSCHLi et Rhumblkr adineitent (pie c'est tout simplement
de l'eau;pour Brandï le contenu serait à réaction légèrement
acide; Penard pencherait pour un contenu composé d'eau
chargée d'acide carboni([ue.
Autre «piestion. Lors de la systol<', où va le contenu de la
vésicule contractih,'? Celle-ci se vide-t-elleà l'extérieur de l'animal,
dans le milieu ambiant ou à l'intérieur, dans le protoplasme
même de l'organisme ?
Depuis les expériences de Jennings (1) en 1904, l'accord parait
s'être fait et l'on admet que l'expulsion est extei-ne. En employant
l'encre de Chine, Jennings a observé sur des Infusoires ra})pa-
rition à cluKpie systole d'un petit nuage blanchâtre à la place et
au moment où se vidait la vacuole.
Reprenant l'expérience avec Aniocba tcrricola, Penardconstata le même phénomène et abandonna alors la thèse de
l'évacuation interne de la vésicule, thèse qu'il soutenait encore
en 1002 dans sa '• Faune rhizopodique du bassin du Léman -.
" Il n'y avait plus de douie, dit-il après son expérience, la vési-
cule se vidait au dehors et le nuage blanc n'était (|ue l'expression
du contenu de la vésicule ré})andu au sein de l'encre de Chine •• (2).
Relativement à la provenance du liquide qui remplit la \ési-
cule, on admet assez généralement qu'il arri^•e à la vésicule de
tous les points du corps et que ce li(pùde est constitué par l'eau
entrée dans le corps par l'alimentation ou par voie d'osmose.
Les uns admettent alors (pie la vésicule contient une eau forte-
ment oxygénée, qu'elle fait circuler ensuite à l'intérieur du pro-
toplasme. La vésicule serait ainsi un appareil de respiration et de
circulation. Depuis que l'accord s'est fait sur le mode d'expulsion
du contenu de la vésicule, expulsion externe, cette opinion est
devenue insoutenable et doit être abandonnée.
Du reste, on ne comprend pas comment cette eau pourrait être
encore oxygénée en arrivant à la vésicule, après avoir circulé
dans tout le corps de l'organisme.
(1) Jennings. H. S. « A method of deinonstratiny the externat dischargeol' the contractile vacuole », Zool. Anz., Bd. 27, p. 656, 1904.
(2) Penard, E. « Sur la décharge externe de la vésicule contractile dansrAmoel)a terricola », Rer. suisse de zool., vol. 12, p. 607, 1904, et « Observa-tions sur les Amibes à pellicule », Arch. fur Protistenkunde, p. 192, 1905.
— 216 —
Les autres tiennent au contraire le contenu de la vésicule pour
un produit d'excrétion du proto])lasme, exci'étion (|ui est expulsée
à l'extérieur au moment de la systob. La vésicule contractile
serait dans ce cas un appareil d'excrétion. Contre cette opinion
il faut relever, avec Penard, le fait que les Rliizopodes, })ar
exemple, se débarrassent de leurs produits azotés solides au
moyen de vacuoles spéciales, qui éclatent à l'extérieur et qui très
probablement ex[)ulst^nt par la même occasion les produits azotés
liquides. La vésicule contractile ferait donc doul)le emploi,
d'autant plus (|ue les produits d'excrétion li(|uides peuvent très
bien s'échapper par difilision à tra^ers la membrane. Enfin, alors
même que ces produits pourraient être é^'acués i)ai' la ^ oie de la
vésicule, celle-ci est un appareil trop considérable et important
pour n'avoir comme fonction que celle d'excrétion; il est de plus
inadmissible tl'admettre (]ue la quantité des produits li(|uides
d'excrétion d'un petit organisme protozoaire soit aussi considé-
rable que l'exige l'activité intense des vésicules contractiles. Cliez
les Infusoires Ciliés, par exemple, il faudrait admettre (pi'en
moins d'une demi-heure l'organisme excrète une masse de
déchets liquitles égale au volume même du corps, puisque la
vésicule se contracte toutes les deux à trois minutes et cpie son
volume représente environ 1/10*^ à 1/15^ du volume total.
Chez un Infusoire du genre Lembadion, Penard a obser^'é
une activité plus considérable encore de la vésicule contractile.
•• M'étant aperçu, dit-il, (}ue dans cet infusoire la vésicule
contractile battait avec une rapidité extraordinaire, j'en isolai
un exemplaire, puis, après avoir recouvert la goutte d'eau d'une
mince lamelle sous laquelle l'animal ne pouvait se déplacer, je
comptai les pulsations et j'arrivai au chiftVe d'une pulsation
pour deux secondes ;})renant ma montre à secondes, je la plaçai
à côté de moi, je comptai 30 })ulsations, et je m'assurai qu'il s'en
fallait d'une seconde poui* (|ue l'aiguille eût de son côté fait le
tour du cadran; je renouvelai l'expérience })lusieurs fois de
suite; toujours c'étaient de 30 à 31 pulsations i)ar minute; le
synchronisme des battements était pour ainsi dire aussi parfait
que l'auraient été les oscillations d'une pendule. Un autre
individu, examiné dans les mêmes conditions, me donna le mêmesynchronisme, et le même cliiti'rc de pulsations \y<\v minute -(l ).
(1) Penard, K. « Etude sur la Clypeolina inarginata, » Arch. f. Prôtis
tenkunde, Bd. 8, p. 81, 1906.
— 217 —
Quittons maintenant les })ro])l("'mcs se rattachant à la vésicule
contractile elle-même, pour envisager un problèm*' plus général
relatif aux conditions de la vie des protozoaires plongés dans le
milieu aquatirpie.
La densité de la masse protoplasmirpie prise dans son
ensemble et qui constitue le corps des protozoaires doit être
sensiblement la même que cidle de l'eau, car la forme de ces
organismes est en principt^ s})liéri([ue.
Ils sont au sein du li(piide ambiant comme des liquides sans
poids. Les forces moléculaires qui agissent dans de tels liquides
tendent à rassembler le plus de molécules possible, soit le plus
grand volume possible à l'intérieur de la plus petite surface
possible; ce volume est la sphère.
C'est ce i)liénomène que le physicien belge Plateau a montré
par une expérience saisissante. Dans vm mélange d'eau et d'alcool
ayant la même densité (pie l'huile d'olive, il introduisit au
moyen d'une pipette une certaine masse d'huile. Cette masse se
ti-ouve en é(juilibre parfait au sein du liquide, puisque les choses
se passent comme si la poussée de haut en bas do la masse d'huile
était annulée par la poussée de bas en haut de l'eau alcoolisée.
Or, l'équilibre de cette masse se traduit par la forme sphérique
pai'faite et tout à fait stable ipie prend la niasse d'huile.
Pour pouvoir changer de place, monter et descendi'e dans
leur habitat a(|uatique, les organismes qui nous occupent doiveni
donc pouvoir détruire cette stabilité parfaite qui tend à les main-
tenir en un même point du liquide.
Il est donc d'une nécessité absolue pour ces organismes de
posséder un appareil qui leur permette de modifier le poids de
.leur ,corps, autrement dit un appareil liydrostati(jue. Cette
nécessité apparaîtra d'autant plus évidente si l'on réfléchit que
par l'afflux de l'eau d'alimentation et d'osmose, le corps de ces
organismes tend à devenir de plus en plus lourd et ainsi à
descendre progressivement dans le milieu ambiant.
La vésicule contractile est le seul organe du corps des proto-
zoaires qui paisse jouer ce double rôle très important : servir de
robinet de sortie à l'eau qui entre constamment dans l'organisme
et en même temps d'appareil hydrostati(pie modifiant le poids du
corps et permettant l'ascension et la descente au sein du licjuide,
autrement dit la vésicule contractile est un organe servant à
régulariser et à modifier la quantité d'eau contenue dans l'orga-
nisme.
U
— 218 —
Examinons maintenant à la lumièi-e de cette tliéorie le fonc-
tionnement de la vésicule contractile.
Par xoiQ alimentaire et par voie d'osmose à travers la paroi
poreuse, l'eau pénèlrc à l'intérieur du corps des organismes
protozoaires, v circule, y abandonne ses éléments nutritifs et
respirables, puis pénèti-e, chargée peut-être de produits résiduels,
dans la vésicule contractile, comme l'eau iiénMre dans k's
' walerballasls ^- des sous-marins.
Le poids total du corps de l'organisme augmente ainsi progres-
sivement et plonge dans le milieu and)iant, jnsqu'au moment où
survient la systole de la vésicule.
Allégé de son ballast, le corps de l'organisme remonte dans le
liquide.
L'observation suivante, due à Penard (1), vient à l'appui de
cette manière de voir.
Dans VAinœha terricola on voit les mouvements en marcIie
se ralentir quelque peu avant la systole et même ijarfois s'arrêter
tout à fait. Mais immédiatement après la systole, la marche de
l'organisme reprend de plus belle. Les choses se passent donc
comme si l'organisme, alourdi de plus en plus par le trop-plein
d'eau, a jx/ine à se mouvoir, tandis que l'évacuation du contenu
de la vésicule lui permet de reprendre i)lus léger sa locomotion.
Un autr<' fait vient encore à l'appui de cette théorie hydro-
statique dela,\ésicule contractile. Chez les Infusoires ciliés on voit
une notable diminution du volume de la vésicule chez les orga-
nismes fixés : ()j)e]'cidaria, Cothurnia, Ophrijdhun, Vor-
ticcUd. Il en est d(3 même chez les Tenlaculil'ères. Chez ces
animalcules, la fixation n(3 i)ermet plus des cluuigemenls notables
de place au sein du milieu, les déplacements très faibles, étant,
assui'és par le jeu de leur ijédoncule contractile.
La régi'ession dans le fonctionnement de la vésicule, appareil
hydrostati([ue, entraine sa réduction anatomique. Il serait
inadmissible (pie la vésicule entrât en régression si c'était un
appareil d'excrétion ou de res])iration.
Enfin, la vésicule n'existe plus chez les Oi)aHnes, Infusoires
ciliés })ai-a.sites; ces organismes n'ayant plus que faire d'apiinivil
]iydrostati(pie, celui-ci a disparu par défaut d'emj)loi.
Reste à interpréter l'absence de vésicule contractile chez les
(1) Penaru, E., Faune rliizopodique du bassin du Lnnun, p. G59.
— 219 —
Radiolaires et les Cystoflagellés (Noctiluques), organismes
marins.
Il faut d'abord noter en thèse générale que la densité du
milieu marin diffère de celle de l'eau douce, ce qui pourrait
avoir quelque influence, encore à déterminer.
Puis les Radiolaires sont des organismes à structure très
compliquée, dont on ne connaît pas la signification des diverses
parties.
Enfin ces animalcules flottent au gré des vagues sans faire
aucun efibrt pour se diriger. Ils peuvent agiter leurs pseudo-
l)odes, se contracter et, i)ar ce dernier moyen, agir sur leur
équilibre hydrostatique. Jusqu'à preuve du contraire, on peut
parfaitement admettre avec Delage et Hérouard (1) (jue • les
contractions, dues à la simi)le coniractilité générale du proto-
plasme, déterminent un mouvement exosmotique des liquid(3S
qui, étant plus légers que les autres substances, augmentent le
poids spécifique et font plonger le corps. Quand cesse la con-
traction, le corps absorbe de nouveau du liquide et reprend son
volume et sa densité primitifs qui le ramènent à la surface ".
Une simple correction est à faire à cet exposé, c'est que l'eau
de mer qui baigne les mailles de protoplasme doit être plus
lourde et non plus légère que les autres substances, prises dans
leur masse, et que l'introduction de l'eau doit évidemment faire
plonger le corps et non le faire monter.
Quant aux Noctiluques, ces animaux flottent plutôt ([u'ils ne
nagent. Gotiiard et Heinsius ont constaté qu'en eau libre ils
modifient leur densité de manière à flotter toujours, mais il
reste encore à savoir comment se produit ce phénomène.
(1) Delage et Hérouard, La cellule et les Protozoaires, page 172, 1896.
Reclierclies Mologipes sur le lac dlnnecï
par Marc Le Ivoux
Docteur es sciences, Conservatmir du Musée d'Annecy
(1)
INTRODrCTION
Le lac (l'iVnnecy était resté jusqu'à ce jour, à peu de chose
près, ignoré au point de vue de sa faune et de sa flore; d'autre
part, il n'existait pas encore de travail d'ensemble sur la biologie
d'un grand lac français. C'est la raison qui m'a déterminé à
entreprendre les recherches dont ce mémoire est l'exposé.
Deux notes très sommaires, simple esquisse des premiers
l'ésultats que j'avais obtenus, ont été publiées, mais, depuis ce
temps, les observations se sont multipliées, de nombreux maté-
riaux ont été accumulés, dont la somme commençait à faire une
contribution appréciable à l'histoire naturelle du lac d'Annecy.
J'aurais volontiei's (uicore attendu a^ant de faire paraître ce
travail, l'estimant encore bien incomi)l(>t et redoutant d'exposer
des conclusions prématurées. Le désir de faire connaître un
domaine inexploré l'a pourtant emi)orté en raison de ce fait que
mes recherches, surtout en ce ipii concerne les allures du planc-
ton, ont été continuées pendant une période exceptionnellement
longue, régulièrement une fois par mois, de 1895 à 1905.
Si. souvent des observations passionnémeni suivies m'ont
(1) L'Ac;ulàmie de Savoie a décerné ;i ce mémoire en HK)7 le grand prix de
la fondation Calle destiné iï récompenser le meilleur travail sur les sciences
naturelles se rapportant à la Savoie.
221 •
apporté de précieuses satisfactions, je ne dois pas eacliei- (pic des
mécomptes, des faits inexplicables et déconcertants en eux-
mêmes, ont parfois jeté le trouble et le décoiu'agement dans monesprit. Tous ceux ([ui se sont occupés d'études lacustres me com-
prendront ; ils ont éprouvé les mêmes im})ressions !
Parmi les nombreux organismes mentionnés, on notei-a cer-
taines particularités individuelles qui distinguent les formes de
notre lac de celles des autres lacs étrangers. Quelques différences
mor])Iiologiques existent, mais peu importantes et non suHi-
santes, à mon avis, pour justifier la création de nouvelles espèces.
Ce ne sont, en somme, que des variétés locales. On ne saurait,
en effet, assez réagir contre cette tendance, peut-être un peu
trop répandue, de la fabrication d'espèces par la mise en relief
de tel ou tel caractère d'un être qui n'est (]ue la résultante de son
adaptation aux conditions de milieu. En matièri^ de biologie
lacustre, on pourrait pres(pie dire : autant de milieux, aulanl de
formes.
Les recherches bil)liographiques sont, on le conçoit, ti'ès dilH
ciles i)Our un travailleur isolé, loin de tout établissement scienti-
fique d'enseignement supérieur. On Aoudra bien me pardonner
les lacunes qui pourront être constatées dans cet ordre d'idées.
Cependant, plus que celle de toute autre ville d'égale impoi'tance
de pro\ince, la bibliothè(pie municipale d'Annecy est suffisam-
ment pourvue d'ouvrages et d'excellents mémoires d'histoire
naturelle, (jue les limnologistes pourront consulter avec fruit.
D'autre part, le voisinage du grand centivï universitaire de
Genève m'a été d'un grand secours. En outre de la lib(''i'alité
avec laquelle la Ribliothèi|ue de rUniversité m'a comnnmi(|ué
quelques ouvrages indispensables, j'ai rencontré chez nos voisins
le plus bienveillant accueil.
Ce m'est un agréable devoir de remercier ici tous ceux qui,
par l'envoi gracieux de leurs publications on par des renseigne-
ments épistolaires, m'ont mis en mesure de remédier à ce que
mon information bibliographique pouvait avoir d'incomplet :
MM. les professeui's Forkl, de Morges; Schrôïkk, de Zurich;
Senn, de Bàle; Yung, de Genève; FiiiiRMANN, de Neufcliâtel,
Amberg, Stingelin, d'Olten ; Pittard, de Genève ; Bedot, de
Genève; Wesenberg-Lunj), de Copenhague; Favesi, de Pa-
doue; Richard, de Guerne, Blanchard, Monier, Pavillard
et Magnin.
J'adresserai également l'expression de ma \ive reconnaissance
09'>
aux savants qui, cliacun dans sa brandie d'activit/' sciontifîque,
m'ont éclaiiV' de leui-s conseils :
M. le professeur Tiiodat, de Genève, au sujet des Algues péla-
giques et littorales.
M. GoMONT, qui a mis la plus grande ohligeance à déterminer
les Algues des tufs lacustres.
MM. les docteurs Weber et Penaud, pour les Rotateurs, les
Héliozoaires et les Péridiniens.
MM. Corbière et Hy, qui ont contrôlé les Limnopliytes, les
Carex, les Mousses et les Cliaracées.
Enfin, mon témoignage d'affectueuse svmpatliie va tout parti-
culièrement à l'adresse de mon ami Ph. Guinier, professeur de
botanique à l'Ecole forestière de Nancv, en compagnie duquel
j'ai fait d'intéressantes courses, en api)liquant sur le terrain les
notions de la géobotanique pour l'intelligence des associations
végétales. C'est à lui que . je dois la détemnination d'une bonne
partie des plantes phanérogames.
Annecv, le 80 janvier 1007.
LAC D'ANNECYAltitude U6"'525
dkprès In crtU d'Lbt mkjor
au 1 i S>% ooo
Courbes Lsobatliês
cllyyrès M A J)dehec(jiLe
i__i I 1— ilMLK
Entreverriesl
Bout duLac\
Fis-. 1,
— 224 —
LE LAC D ANNECY
Coord(h/j/<''(\s (j('og)7(jjh/ques. — Le lac d'Annecy, ainsi
appelé du nom de la ville qui est bâtie à son extrémité Nord-
Ouest, sur le i'és(?au de canaux de ses émissaires, le Thioux et lo
Vassé, est situé dans le département de la Haute-Savoie })ar 3"ol
de longitude moyenne Est de Paris et 15"51 de latitude moyenne
Nord.
Son altitude est de 44G'"525, étiage conventionnel correspon-
dant à 0"^2r) au-dessus du zéi'O de l'échelle li3'drométri({ue du pont
de la Halle, à Annecy.
Il est figuré sur les cai'tes suivantes : Carte du service vicinal
du ministère de l'intérieur au 1/100,000 f. xxiv-25 ; carte de
l'état-major au 1/80,000 ff. UiObis et I6\)bis; carte des services
de la carte g(''ologirpie de France au 1/80,000, mêmes numéros.
La carte des profondeurs a été levée en ISÔO par DELKiiFX'QUK à
l'éclielle du 1/20,000, avec éijuidistances des courbes isobatiies
d(> 5 mèti'cs et [mbliée pai' le minisière des travaux publics.
Deso'ijjfioj/ jilujsiqiic; les niitratUes du. lac. — Le lac
d'Annecy, dont la direction générale est Nord-Ouest-Sud-Est, est
creusé sur le bord extérieur des Hautes Chaines calcaires du
Genevois dont les premiers jjUs en constituent la unu-aille orien-
tale.
kn Nord s'étend la vaste [)laine des Fins, ancien delta d'alln-
vions d'un torrent (le Fier) postglaciaire, (|ui s'ai)})uie d'un
côté aux collines molassi(|ues d'Annecy-le-A''ieux et (|ui de l'autre
s'avance dans le lac par la côte marécageuse d'Albigny.
Brusquement, à l'Est, montent les talus liauto'iviens boisés de
la montagne deVeyrier, couronnés par une falaise calcaii^eui'go-
nienne abru])te, qui s'élève jusqu'à lacote 1,300 mètres, pour
s'abaisser par i'iq)ture de voûte, au i)assage de la trouée d(3
Bluffy, r(''snllaut d'un formidable (l(''l)layeiiient (bi à r(''i'osion
postglaciaii-e.
Sous les ci'éles décbi((iietées de Lanfon et de la Roclie Mura/^,
dévalent des pi'airies el des i)ois arrèt(''s un moment par la butte
— 226 —
nummuliliiiuc de la fort(M'osso féoilalo do Méntlion ou tran-
cliéos not par les escar[)om,3nts jurassiques de Saint-Germain.
Tout en bas, comme une gigantesque masse effondrée, s'écrase
ce paradoxal Roc de Chère, dont le plateau gréseux, sorte de
sauvage toundra entaillée de vallons tourbeux, s'étend à l'alti-
tude de ()1() mètres pour venir plonger par un eftVavant à pic
de 100 mèires de hauteur dans les eaux profondes du lac.
A l'abri de la muraille ensoleillée du Roc, où s'agrippe une
ardente végétation d'él(''m(Mits méridionaux, l'anse calme de
Talloires creuse un peu le littoral. La côte reprend ensuite vme
direction Sud et il y a })lace à peine alors pour la route entre le
rivage et les talus broussailleux de la, montagne de Verthier,
premier degré du soubassement de la prestigieuse Tournette qui
domine tout le bassin.
Dans la région méridionale du lac, large de 1,500 mètres, les
cours indolents de l'Eau-Morte et de l'Ire ont édifii'' une basse
plaine d'alluvions en pai'tie marécageuse, qui se raccorde avec
la vallée de Faverges, ancien thalweg d'un puissant cours d'eau,
mais aujourd'hui •• vallée morte ", où les deux ruisseaux ont
depuis longtemps atteint leur profil d'équilibre.
La rive occidentale du lac remonte sans articulations vers le
nord, limant les dépôts fluvio-glaciaires de Bredannaz et se
rapproche de la montagne d'Entrevernes, (|ui par abaissement
progressif de l'axe de son pli, s'avance en face de la falaise de
Chère, par la presqu'île de Duingt qui éteint sa dernière ondu-
lation dans le haut fond du Roselet.
A l'orée de la b(?lle vall(''e d'Entrevernes, resserrée entre Tail-
lefer et le Roc des Bœufs, le paysage change.
C'est la simple harmoni(> des lignes de la grande dépression
de Leschaux s'ouvrant largement vers le Sud dans le massif des
Bauges et qui se raccorde a.ux pentes boisées du Semnoz. Cette
verdoyante vallée, accidentée mollement d(> collines molassiques
et de buttes morainiques, s'étend entre les marécages de Saint-
Jorioz et de Sevrier et la montagne prochaine : la croupe du
Semnoz, qui développe lentement sa tranquille silhouette depuis
la, plaine d'Annecy jusipi'à la cote 1,704 mètres au Crèt de Chà-
tillon.
Puis le rivage du lac s'approfondissant rapidement, se rap-
proche de la montagne jusqu'au rocher de la Puya, qui projette
ses splendides~T3hàtaigneraies sur la nappe l)leue des eaux.
Enfin, la cuvette du bassin lacustre est fci-mée ])ar le prolon-
— 2-28 —
gement septentrional du Semnoz, accidenté de cassures qui
isolent le Crèt du Maure de la, colline du Cliàteau et dont les
couches se perdent dans la plaine d'Annecy avec des allures de
« dôme •• (1).
Dans la boue glaciaire et les alluvions, corrodant ensuite la
molasse sous-jacente pour y creuser son lit, l'émissaii'e du lac,
le T]iioux,va se précipit<'r dans le Fier, dont l'érosion régressive,
(pu a d(''jà cisaillé les gorges de Lovagny, est parvenue à
entamer le dur seuil de Cran.
Eléments Ibn/wlogiques (2). — Ainsi délimité géographi-
(piement, le lac d'Annecy se compose de deux bassins : celui du
Nord, le • Grand Lac ", long de 10 kilomètres, large de sKoOO,
avec une profondeur de 64™70 ; celui du Sud, le " Petit Lac •• , long
de 4 kilomètres, large de l''500, avec une ])rofondeiu' de 55'"20.
Ces deux parties sont séparées topographiquement par un
détroit entre le Roc do Chère et Duingt, mais batliymétrique-
ment par une sorte de barre très aplatie, rejetée à 1 kilomètre
au Nord de Duingt, sur un fond d(î 49'"30, et qui est due au
cône de déjection torrentiel du Laudon.
Relief. — La plaine lacustre ou plafond du lac est accidentée
de hauts IVmds : l'ilot rocheux du Roselcl, prolongement de la
montagne de Duingt; plus au Nord s'élèvent deux moraines sous-
lacustres, le Ci'ét de Chàtillon, à 800 mètres à l'Est de
Sevrier, recouverte seulement par 3™30 d'eau, la région voisine
étant à 40 mètres de profondeur; le Crêt d'Anfon, à 5()(t mètres
à. l'Est de Stnrier, à une i)rofondeur de 8"'(30 par des fonds de
25 à 30 mètres.
Une plate-forme littorale, plus ou moins développée, dont la
profondeur n'excède pas 5 mèti'es, la Beine ou le " Blanc » qui
s'avance jus(pi'au •• Bleu •• (partie profonde), occupe certains
points ; vers Albigny, surtout entre Sevrier et St-Jorioz, où elle
s'étend sur une largeur de 000 mètres, et enfin toute la rive Sud
du lac.
(1) Ri;vii. et Lk Ukux, « Observations nouveUes sur la terminaison ]ièri-
clinale de la chaîne Nivolet-Semnoz », Rev saroisienne, 1906, p. 173
(2) Ces éléments sont décrits d'après Delebecque, « Les lacs français», 1S98,
et L. DuPAiio, «TEb Lac d'Annecy ». Arch. des Se. p/iy.v. el nat. de Génère, fé-
vrier 1894, et (les observations personnelles.
oog
La côto est très déclive sui' le littoral Ouest entre Sevrier et
Annecy, ainsi que sur toute la l'ive orientale. Elle est accidentée
par l'escarpement formidable du Roc de Cliè're, qui plonge
presque à pic dans le lac (pente 87 p. c). A une distance de
2 mètres de cette falaise, la sonde accuse des fonds de 42 mètres
tandis que le promontoire du Duingt, en face, plonge par ime
pente de 63° jus(|u'à la profondeur de 35 mc'tres.
La plaine centrale du lac est horizontale ; elle occupe la plus
grande partie de la surface dont les 3/5 sont, en effet, à l'inté-
rieur de la courbe isoijatlie de 45 mètres.
Superficie. — Le lac d'Annecy a 27 kilomètres carrés 04 de
superficie. Son cube est de 1.123,500,000 mètres cubes. Le rap-
port de sa profondeur à sa surface est de 1/(54,51. Ce rapport est
influencé par la profondeur considérable, 80"'6, d'un gouffre, le
" Boubioz ", dont l'entonnoir elliptique aux axes respectifs de
250 mètres et 200 mètres s'ouvre à 800 mètres au Sud-Est
d'Annecy, et à 200 mètres du rivage entre les courbes isobathes
de 25 et de 30 mètres.
Pluies. — Les précipitations nnnuelles sont en moyenne de
1™32 d'eau à Annecy. La surface du lac étant de 27 kilom. c. 04,
il résulttî des calculs de Delebecque qu'il reçoit annuellement
6,615,000 mètres cubes d'eau. Le débit de l'émissaire est de
10 mètres cubes 75 par seconde, soit annuellement de 340,000,000
de mètres cubes. Il résulte des graphifjues établis depuis 1892
l^ar le Syndicat des industriels du Thioux que les extrêmes
des niN'eaux des eaux ont été constatés : maximum le 17 jan-
vier 1809 avec la cote + r"39, et le minimum les 23 et 24 no-
vembre 1906 avec la cote — 0">44 (1).
Température . — La température de l'eau du lac varie entre
les extrêmes suivants que j'ai notés : le plus fort maximum des
couches superficielles était de 23" le P'' août 1904 ; le minimum
le plus bas a été de 0°3 le 13 janvier 1903.
Le lac d'Annecy appartient, d'après la classification de Forel,
au ti/jie tempéré, à stratification thermique alternante, c'est-
à-dire directe en été (décroissante de la surface au fond) et
(1) Communication de M. rinyénieur A. Croi.auu, de Cran.
— 230 —
inverse en hiver (croissant de la surface aux parties profondes).
Le lac gèle parfois entièrement. La congélation totale est sur-
venue en 1573, en 1583, en 1681, en 1G84, en 1830 et dans les
hivers de 1879-80 et de 1890-91.
Couleu)'. — La couleur des eaux correspond, d'après mes
observations, au n" IV de l'échelle de Foi'cl, c'ost-à-dii-e au bleu
outremer foncé.
Transparence. — La plus grande limite de visibilité que
j'ai constatée a été de ll'^lO, la plus faible de 3™5. (Voir chapitre
du Plancton.)
Affïuents. — Nature pétrograpliitjue du bassin d'ali-
meyitation. — Le lac est alimenté par un certain nombred'affluents et par C[uel(|ues sources sous-lacustres. (Voir carte
fig. i.)
Les deux ruisseaux des Marquisats sortent du glaciaii'e cpii
a comblé les deux vallons d'éi'osion consécutifs aux cassures du
Crèt du Maure et des Espagnoux (1).
Les Nants de la Planche et du Loi proviennent des
niveaux aquifî'res du Gault et des boues glaciaires morainiques.
Le Laudon draine les bombements molassiques de la dépres-
sion de Leschaux. Il recueille les eaux qui ont filti'é au travers
des fissures de la carapace urgonienne du Semnoz et qui sont
collectées par les marno-calcaires de l'Hauterivien.
Le ruisseau de Péris ou Bourdon prend sa source dans les
moraines glaciaires et recueille également les eaux de la, Molasse.
Le torrent d'BrUreverjtes descend du col du Golet, collec-
tant les eaux des marnes nummulitiques et albiennes qui repo-
sent dans le synclinal urgouicn de la vallée.
Le ruisseau de Bournette draine les dépôts morainiques de
la Tliuile et recueille les eaux des pentes néocomiennes dans
lesquelles se creuse le col de IJoi'nette.
Vire provient des niveaux néocomiens qui forment les sou-
bassements du Charbon et du Trélod.
VFau-Mo)-te court dans les alluvions modernes, rassemble
(1) M. Le Roux, « Le terrain glaciaire et les blocs erratiques du Crèt duMaure », Rev. sav., 1905, p. 55.
— 231 —
les ea,iix des montagnes de Faverges et celles du ruisseau de
Montaiin qui descend des flancs de la Tournette.
Les torrents d'A)tgo)t, le Ncmt du Crot et le Nant Sec à
Talloires, sortent des marno-calcaires jurassiques de la Tour-
nette.
Les faibles sources (jui suintent dans les fissures de la falaise
du Uoc de Clièi'e, près de la faille occidentale, déversent les
eaux (jui ruissellent dans les dépressions du grès nunnnuli tique
et fuient par deux ou trois bétoires en relation avec le soubasse-
ment urgonien de ce massif.
La source sulfureuse de Mentlion jaillit de la boue glaciaire;
ses eaux sont collectées par les grès nummulitiques.
Le Bioson descend du col de Blufïj, où il recueille les eaux
des marnes hauteriviennes et des marno-calcaires jvu-assiques.
Enfin, les petits torrents du mont Veyrier sortent des schistes
et marnes du Flyscli et des niveaux liauleriviens du flanc Ouest
de la montagne.
Les ruisseaux des Barattes descendent du Tongi'ien, celui de
la Pesse ou d'Athigt/!/ des marnes de l'Aquitanien et des allu-
vions postglaciaires.
Les affluents sous-lacustres ont une certaine inq)ortance. Le
principal est le Boabio:-. .Vm pu me rendre compte que cet
entonnoir, d'où jaillit la source sur sol rocheux, est dû à un
accident tectonique intéressant. Il se trouve, en effet, au [)oint
d'intersection de deux failles conjuguées dans la partie Nord du
Senmoz, ayant déterminé une dénivellation i)ar faille entre le
Crét du Maure et la Colline du Château (cassure Noi'd) et entre
le plateau des Espagnoux-Puya et le Crét du Maure (cassure
Sud)(l).
D'auti-es souires ont été signalées par I)p]LEBECQUE ;deux près
du Boubioz, température 10"4 et 10"G; l'autre près de Lettraz,
tem})érature H"4.
La présence d'une source dans le Boubioz est également con-
firmée par les analyses de Duparc (2). Les eaux sont, en effet,
plus riches en matières dissoutes (résidu fixe : gr. 1624 par
litre) (pie les eaux du lac, (pii ne titrent (pie gr. L511 par litre.
Ce caractère est commun à tous les affluents du lac.
(1) M. Le Roux, « Quelques points de la géologie du Semnoz », Rev. sav.,
1897, p. 9, et J. Revil et M. Le Roux, Rev. Sav., 1906, p. 173.
(2) L. Duparc, « Le lac d'Annecy », loc. cit., p. 21.
232
II
LES ORGANISMES FLOTTANTS
Les recherches efFeetuées sur le lac d'Annecy, antérieurement
à celles qui font l'objet de ce travail, se réduisent aux trois notes
suivantes.
Au point de vue faunistique, en 1883, Imhof (1) explore le
milieu du lac à la liauteur de; Veyrier. Il note dans une capture
pélagique douze espèces, signale l'absence de Bytotrephes lon-
gimanus et l'abondance ù!Aspîanchna helvetica, plus nom-breuses que partout ailleurs.
La même année, Forel (2) faisait une exploration rapide du
lac, mais seulement au point de vue de la faune profonde. Dans
une note postérieure (3), il l'appelle les recherches d'Imhof en
s'étonnant également de l'absence de Bytotrephes, '• l'un des
crustacés les plus grands et les plus caractéristiques de la faune'
lacustre «.
En 189G, Chouat étudie le pliytoplancton du lac d'Annecy (4)
et donne une liste de trois espèces dominantes et de dix-neuf
autres espèces observées comme accessoires dans le plancton.
A. — La flore pélagique
Phytophuicton : Limnoplancton Haeckel, Warming
A toutes les époques de l'année on rencontre à l'état pélagique
un certain nombre d'algues en quantité plus ou moins considé-
rable et se groupant souvent en associations végétales dont la
(1) O.-E. Imhof, « Die pelagische Fauna und die Tiefsee Fauna der zwei
Savoyerseen », Zoologischer Anzeiger, VI, n" 155, 1883.
(2) Forel, « Dragages zoologiques et sondages thermoinètriques dans les
lacs de Savoie », Rev. sav., 1883, p. 87.
(3) Forel, « Etudes zoolo^iques dans les lacs de Savoie », Eev. sav.,
1884, p. 1.
(4) Chodat, « Remarque sur la flore superficielle des lacs suisses et fran-
çais », Bull, de l'herbier Boissier, t. V, n" 5, mai 1897.
— 233
variation est fonction des saisons et en général des facteurs clima-
ti(iues. Elles ap[)artionnent aux classes des Schizophycées. des
Phœopiiycées, des I)Accillariacées et des Ciiloropiiycées
I. — Schizophycées
Les espèces dominantes sont : Anahœna ffos aquœ var.
circinalis, GQmphosj)hœria lacush'is.
Les espèces disséminées sont: Merismopcdia clegruis, Oscil-
laioria proUfica, Oscilldloria rubescens, Chroococcus tur-
gidus.
1. Anahœna circinalis Kircli. — Cette Scliizopliycée, qui
est constante et très abondante dans le i)hjtoi)lancton, mais
moins fréquente près du ri\'ag-e qu'an lai'ge, se groupe en petites
masses tioLtantes irrégulières d'vm ^ert sombre avant parfois
jusqu'à 3 et 4 millimètres de diamètre. Elle sert constamment
de siq^port à un infusoire : VorticeUa convallaria, qui vit en
commensalisme avec son bote.
Anahœna se maintient, parles temps très calmes, tout à fait
à la sui'face, mais on la trouve plus communément à 0"'50 ou
1 mètre de profondeur. Elle se dévelojjpe par njvi'iades à cei'lains
moments de l'année. Février et mars semblent marquer l'époque
de son maximum. Elle est peu fré<|uente (iu automne, mais die
est rare en été.
2. Goniphosphœria îacustris Cliodat.
3. Merisnwpedia clcgans{A. Braun) Nœgeli.
4
.
Oscillaloriapi'oUfica Goinont = LynghiaproJillca Grev.
— Cette oscillaire, extrêmement fine et délicate, est fi'é(piente
dans le pliytoplancton. C'est à cette algue, extrêmement ténue, de
couleur purpurine, qu'il faut rapporter ces fins tricliomes (dia-
mètre : 2.7 a) qui s'enclievêtrent parmi les autres organismes
flottants.
5. Oscillatoria r-ubescens I). C. Cette Scluzoplivcée caracté-
ristique des lacs de Neufcliàtel, de Bienne et de Morat, ne consti-
tue jamais ici de - fleurs d'eau . On rencontre ses filaments de
15
— 234 —
teinte rougeâtre disséminés à la surfaeo on lii\'or et au prin-
temps.
G. Chroococcus twgidus Noeg. Chodat signale dans le lac
Chroococcus 7ninutus var. carneus en qualité d'algue péla-
gique. Je n'ai pas su retrouver cette espèce, mais j'ai rencontré
par contre, rarement d'ailleurs, une autre Scliizoplijcée voisine,
formée de cellules sphériques de 18ij.de diamètre, associées par
2, 3 ou 4 et légèrement lavées de bleu pâle.
II, — Phseophycées
Espèces dominantes : Cerathim hirnmUnelUi, Dinobryoïi
divergens, D. cyUndricnm.
Espèces disséminées : Ceratiiim cornutum, Per'id'niium
tabidatum, P. apiculatum, Glcnodhiium pifs/ïliun, G. hel-
veticum, G. ciiictum. G. viride, Dinobryon stipitahim vf
laciistins, Stichogloca oIwacea,McdIomonas acaroides
ar
1. CercUiiuii hirundineUd 0. F. Millier = G. macroceros
Schrank. C'est la forme dominante par excellence dans le plij-
toplancton, toujours mêlée au cortèg(3 des autres organism(>s
pélagiques : Diatomées, Entomostracés, Rotateurs.
On la rencontre à toutes les époques de l'année en plus ou
moins grande abondance, mais elle est certainement plus rare en
hiver et parait oiirir son maximum en juin et juillet, mois où
se développent les Péridiniens, à cause de l'élévation de temi)é-
rature. Le procès-verbal d'une de mes pèches montre qu'en
juillet 190(), Ceratium existait par milliards dans le lac, à tel
point que l'eau en était toute troublée dans le bocal où j'avais jeté
la capture
.
Cet organisme est essentiellement i)olymoi'phe ; son cycle de
variabilité est très curieux (fig. 4).
La forme type est caractérisée en avant par ime longue corne
droite, tandis qu'à la pai'tie postérieure, s'écartent, en divergeant
plus ou moins, deux longs a})pendices et un troisième })lus court
(fig. 1, 5,7, 14 et 5b).
Comme dimensions moyennes, la distance entre l'extrémité de
la corne antérieure et celle de la plus longue des cornes posté-
rieures est ÏÏe 205 u, tandis que le diamètre maximum est de
(34.8 p..
— 235 —
Une autre forme montre deux cornes postérieures de longueur
presque égale, mais moindre (pie celle de la corne antéiieure.
Elle est beaucoup plus rare (flg. 2, 8, 23, 31 et 31ii).
Le tv[)e à trois cornes, une antérieure et deux })Ostéi'ieures
i. — Cycle de variabilité des Ceratium hirumiinclla et conuiium- Les
figures i, 2, 32, très grossies, montrent le globule rouge; (ig. 5. l'orga-
nisme en voie de dédoublement ; fig. 6, le type à trois cornes; les autres
ligures à plus faible grossissement montrent les variations luorpliolo-
giques des Ccralium.— Fig. 3i et 35. variété de Dinobvjion cjilindviCKin
= (B. protnberans var. pediforme [.emm)
— 236 —
])arallèles, est encore moins fréquent. Il r(''i)ond à la figure
donnée par Imiiof (1) pour son Ccratmm reticulahun.
Il semble cerlîiin, à cet égard, quel'ondoit faire rentrer cette
forme au titi'e do variation individuelle et saisonnière dn tjpe,
car je l'ai toujours rencontrée pendant les mois d'hiver : février
et mars; jamais à nne autre époque (fig. 6) (2).
Le passage de cette variété au tjpe se fait par l'apparition
d'une corne postérieure extrêmement courte (fig. 1, 4, 14, 24, 20,
12 et surtout fig. 1) où le parallélisme des cornes postérieures est
très accusé en même temps que se dessine un rudiment de la troi-
sième corne.
Cet appendice, beaucoup plus court, peut se déformer ou s'in-
curver (fig. 13, 20 et 27), ou encore rarement se garnir d'un
denticule accessoire (fig. 10). Les cornes postérieures se raccour-
cissent parfois en divergeant fortement de manière à donner
l'aspect caractéristique des figures 142, U.-?-
Enfin, les cornes peuvent être rejetées d'un côté, tout en se
maintenant parallèles (fig. 9), en mémo temps que la troisième
corne est très réduite.
Les Ceratium se rencontrent à la surface et ils sont très rares
dès que l'on dépasse la profondeur de 20 mètres.
Ils se reproduisent par division nucléaire et par dédoublement
ainsi que l'a bien vu H. Blanc (3).
J'ai pu constater ce fait sur un individu captur('' dans une
pêche de nuit. La figure 5 montre, en effet, h^ novau qui com-
mence à s'étrangler, la corne antérieure d(\jà (L'-doublée et la
ligne de rupture de la carapace très visible.
1. Cerat'nmi cormUumWLw .= C. te1raceros^Q\\v\mk. Cette
espèce, bien moins fréquente, n'ai)[)arait qu'en hiver, depuis
octobre jusqu'en février. C'est un organisme (fig. 32, 25, 16,
19, 28, 29, 30 et 33), trai)u, massif, présentant trois cornes dont
(1) Imiiof, Resultiite yneiner Suidien ûb. die pclagische Fmma klein. u.
grosserer Siisswasserbecken derSchiceic. Zeitsclir. fiir wiss. Zoologie, XL. Btl.,
tab. X, f. 1.
(2) Une variété identique de C. hirundinella a été décrite par Apstein coaime
caractéristique, en automne, du Dobersdorfsee — Schroter, Die Schivebcflora
unserer Seen, p. 26.
(3) H. Blanct « Note sur le Ceratium hirundinella, sa variabilité », /i/r?/.
Soc. vaudoise des Se. nat., XX, 1885, p. 305.
— 237 —
l'antérieure est grosse et recourbée. Sa manière de progresser
est curieuse, il nage, en effet, très vite en effectuant une série
de culbutes. Ce Péridinien habite uniquement les eaux superfi-
cielles, à l'inverse de ce qui se passe dans le Léman, où, d'après
Penard (1), il se tient toujours au fond.
C. cornutum,qui n'apparait qu'en hiver, peut être i)ris commeun exemple typi(|ue de l'influence des variations climatiques sur
la morphologie d'un organisme, ainsi qu'il sera expliqué plus
loin.
Les Peridiniens sont constants dans la flore pélagique, surtout
en ce qui concerne Peridinium tabulatuni et GlenodiniumpiisiUitm, sans être toutefois dominants au même titre que
Ceratium ou Dinobrjon. Les autres espèces n'j figurent qu'à
l'état disséminé.
J'ai retrouvé dans le lac d'Annecy 6 espèces sur 9 des Dinofla-
gellés du Léman, décrits par Penard (2).
3. Periiliiiiu))} tahuldliun. Clap et Lachm. généralement
coloré en brun jaunâtre, nage en tournant continuellement autour
de son axe l^^A^ à 50 ^j.. On le trouve depuis le printemps jusqu'à
l'automne.
4. PerUrniium a]jic'i(Jatnm Fennix], Très rare,
5. Glcnodhii/nji /)UsiIl({j)/Pi.nv,m\. Le pins souvent incolore,
mais parfois munidechromatophores d'un jaune verdàtre l^ 18 a
la := 8 y. Abondant en juin et juillet.
6. GIe)iodinuiin cbictuni Ehr. Rare,
7. GloioduiiiDU lielteticiDti Penard. Espèce très rare / =51.3 a, je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois : le 28 avril 1898.
8. Gloiod'niiuin, rirlde Penard. Egalement très rare, n'a été
recueilli qu'une seule fois. / = 37.8 p..
Ces Peridiniens se rencontrent à la surface ou à une faible pro-
(1) Penard, « Les Péridiniacées du Léman », Bull. Soc. Bot. de Genève,
n'ô, 189L
(2) Penard, « Les Péridiniacées du Léman », loc. cit.
— 238 —
fondeur : 0™50 à 1 mètre. Ce sont de bons nageurs, mais au delà
de 3 ou 1 mètres; ils deviennent rares.
Les DiNOBRYONS sont un élément eonstant dans le pliytoplane-
lon où ils atteignent leur maximum en juin et juillet. Ils sont
plus rares en hiver et cependant l'un de mes procès-v(>rbaux
de pèclie montre que le 18 janvier 1901, les Dinobryons pullu-
laient tellement (jue l'eau en était toute brune dans les bocaux
(pli contenaient la pèclie (1).
Par les temps couverts ou orageux on les rencontre en grande
quantit('', mais après une série de pluies et en raison de l'abaisse-
ment de température (pii en résulte, môme aux époques de leur
maximum, ils peuvent subitement diminuer considéralilement en
nombre.
Ehrenberg avait établi pour ce Flagellé, en 18o3, le genre
Sertularia Imhof a depuis distingué quatre nouvelles es})èces (2),
mais c'est surtout récemment que, grâce à Ciiodat (3), la sjsté-
iuati(|ue de ce genre a été nettement établie.
U. D'inohrijon dlvo'geiis Imliof. Espèce dominante en com-
pagnie de la suivante Caractérisée par ses bi'anclies divergentes
inclinées chacune de 45° sur la i)récédente. Longueur mojennedes colonies = 190 p. Les cui)ules / == 41 a, la = 10 u pré-
sentent un étranglement caractéristique sépai'ant riiypoplnse du
corps.
10. Dlnohvjon ci/lindricum Imliof. Arbuscules coniques à
ramifications dressées,peu divergentes.Colonios^=280y; cupules
/^80a, Ja= 10.5 p.. Celles-ci ont les pointes incurvées, mais
ne présentent pas de sillon à la base de l'hypophyse.
Il faut rattacher sans aucun doute à D. cyllndricum unefoi'me très rare dans le lac d'Annecy (fig. 34 et 35). La base de
la cupule s'allonge en corne légèrement recourbée, à sillon hypo-
physaire bien marqué. Lemmermann a fait de cette forme, ren-
contrée par lui près de Pion, l'espèce D. p7'otuberans Lemm.
(1) L'abondance de ces flagellés a notalilement relevé la quantité de planctonqui l'ut dosée ce jour-là.
(2) Imhof, Zoulo;jischcr Anzeiger, 1883. p. 655.
(3) Chodat, Etudes de biologie lacustre, p. 304.
— 239 —
xiiv. /)('(/!fb)-)uc (1). Le mémo autour dit (^ue ce Dinobrvon a été
trouvé dans le Brandebourg, en Silésie et on Nouvelle-
Zélande (2).
11. D'ninhi'i/ciii sfipitatuni Stein var. If/c/f.s/r/s Chodat.
Espèce très rare dans le lac, rencontrée seulement deux fois, on
hiver et en été. Colonies / = 200 u, cupules l — 40.5 p.,
la = 8 y, prescjue régulièrement conirpKJs.
12. Mallomonas (ic(iroides7j-àd\\. J'ai longtomi)S rechorclié ce
Flagellé que Chodat considère comme un dos éléments caracté-
risti(|ues de la flore superficielle. Dans une poclio (12 mars 190()),
il s'est enfin rencontré, mais en très petit nombre.
Cet organisme (/ = 50 u. est reconnaissal)lo à ses longs cils,
à ses deux chromatO})liores bruns })lacés en bande de clia(]ue coté
du corps.
On rencontre également l'organisme suivant, mais assez
rarement.
13. Sticliof/Ioerf oJirncca Cliodal. C'est une algue très petite
dont les cellules sont incluses dans une gelée. Ciiodat (3) range
Slicbogloea parmi les Pliéopliycéos, malgré la similitude que
leur tliallo i)résonto avec celui des Botrijococcus, surtout à
cause de la couleur olivâtre des chromatoplioros privés de
pjrénoides.
in. — Bacillariacées
Espèces dominantes : Asterionella gracillinid, Fragilaria
crotoncusis, Cijclotella comta var. Lemcmensis, C. comta
var. operculata, C. comtccYRr. Bodanica, C. comta var. melo-
siroides.
Espèces disséminées : Cj/clotella catenata, Tahellaria foc-
cidosa, T. fe)u'si)'afa, T. fen. var. asterioneUoides, Fra-
gilaria capucina.
(1) Lemmekmann, « Algen eines Moortiimpels beim Pion», in Fors'chungs-
bericht. ans d. Mol. Stat. zu. Pion Th. 8, 1981, p. 78, f. 2.
(2) Lemmermann', « Beitriige z. Kenntn. der Plankton alg. », in Bericlit
dor Beulsch Botanisch. Gcsellschaft. Bd. XVIII, 1900, p. 514.
(.3) Chodat, Icc. cit., p. 182.
— 240 —
Espèces erratiques : Sijnedrn delicatissiuifi, S. uhui var.
amphiy^hynchus, Epithemia argus \h\\ alpestris. Cijmhclla
ciimhiforme, C. lanceolata, Si/nedra lUna var. longissima,
S. hinaris,S. radians, S. i^aitcheriœxhv. pari'ula, Cymato-plcura clUptica, SurireUa. biseriata.
1. AsterioneUa graciUiina (Hantzscli) Heiberg. Cette diato-
mée pélagique par excellence est une des plus élégantes que l'on
puisse rencontrer. Sa forme type est celle à huit rayons égaux,
variant de 65 à 90 //, inclinés régulièrement de 45° les uns sur
les autres.
Les individus du lac d'Annecy possèdent des rayons un peu
plus courts que ceux du Léman, qui atteignent jusqu'à 100 u;
mais ils présentent en été un élargissement très marqué des
rayons à leur base, ce qui donne une sveltesse remarquable aux
frustules (fig. 0,-3).
Chodat qui a noté cette particularité, voit dans le tyjie du
Léman une forme gracilior qui peut s'appliquer pendant une
certaine période de l'année à la jolie Diatomée de notre lac.
Le polymor])liisme de celle-ci est assez marqué. Les rayous
peuvent se grouper au nombre de 9, 10, 12, jusqu'à 20. Les for-
mes à rayons, dont deux sont exactement parallèles, peuvent être
considérés comme un stade du développement de l'algue qui se
reproduit par dédoublement des frustules.
Ceux-ci peuvent s'accoler également suivant un».- disposition
particulière figurant une courbe spiralée qui peut devenir irré-
galière en s'ouvrant de plus en plus, mais en condensant les
ravons de manière à donner un éventail sur une surface gauche
(fig- ^^,-2).
Nous verrons, à propos de la biologie du plancton, la raison de
cette organisation (1).
Le maximum des Astérionelles est en avril et mai avec unplus petit maximum en automne. Elles sont bien moins abon-
dantes en été.
2. Fragilaria crotonensis Edw. Kitton = Nitzschiclhi
p)ecten Brun. Les frustules de cette Diatomée, longs de 110 à
120 y, sont agglomérés en longues bandes aplaties qui com-
(1) Ces colonies spiralées sont citées par Rikli dans le plancton du lac deLiigano. ScHROTER, Die Schicehepora, pp. 29 et 52.
— 241 —
prennent jns(iu'à 150 individus. Ces l'nhans subissent souvent un
mouvement de rotation autoui' de leur axe longitudinal de manière
à présenter des étranglements. Leur maximum se présente en
novembre et aussi en février et mars.
3. Fragilaria capuchia Desm. Cette espèce est moins fré-
quente. Ses frustules / = 21 à 30 y, fortement colorés par la
diatomine, s'accolent en rubans comprenant une cin(|uanlaine
d'individus.
4. djcIotcUa comta Ktz. Dans cette espèce très polvmorphe,
on i)eut distinguer plusieurs variétés. On trouve les grandes
Cvclotelles caractéristi(pies des grands lacs, aux frustules novés
en série linéaire dans une bande gélifiée.
5. G. comta Ktz. var. Bodanica Eulenstein, la plus belle de
nos Cyclotelles, est rare, mais elle est remplacée ])ar une forme
plus grande et plus comnnme.
C. coiiita var. Lenicoioisis O.-F. Muller (1).
0. C. operciilata Agardh. var. antiqua Brun. Diatomée
assez abondante, aux frustules de 32 a de diamètre.
7. C. mclosirohles Kircli, espèce rare.
8. C. cafenafa Bvixn. Rare. Frustules / = 13 y, reliés entre
eux pai- de petites dents engrenées.
Le maximum des Cvclotelles a lieu en février et mars avec
un autre sensible en décembre.
Deux autres espèces habituelles des sociétés littorales, mais
bien organisées pour la flottaison, se rencontrent à l'état erra-
tique dans le plivtoplancton.
9. Tabellaria fenestrata Ljngb. avec sa variété proxim.
asterionelloides Grunow, dont les frusttdes s'organisent en
une disjjosition pseudo étoilée.
10. T. ffocculosa Roth. aux frustules disposés en zigzag. Le
(1) Chodat, Biologie lacustre, p. 187, fig. 3.
242
maxirauiii des Tabellaria est en tevrior et mars. Elles devien-
nent très rares en été.
Le groupe des Svnedra est également bien représenté dans le
plivtoplancton, surtout à la fin de l'automne.
11. Sipicdra acus Ktz. var. (IeUcaf/ssi))iaW.Sm. l = 205 p.
12. f>. uliKi Ehr. var. anijili'rrhyuchus Elir.
D'autivs vivent en parasites sur les algues elles Entomostraeés.
13. S. l'a nchcr-iœ \cxv. [)((} rida Kiz. sur filaments de Mou-
geotia.
14. S. Innaris Ehr. dont les l'rustnles ar(|ués diverg<'nt d'un
coussinet muipieux fixé le i)lus souvent sur la furca ou les soies
caudales des Cvclops et aussi sur les téguments vides des larves
de Coretlu'a.
15. 5'. r-adiaiis Ktz. dont les t'rustules rayonnent d'un coussin
gélifié accrocli('' aux algues flottantes.
Les Surirellécs sont des formes Iiabitucdles du littoral ou du
limon de fond, mais on les rencontre fré(juemment à l'état
erratique.
1(). Cymaloplcnra cUiplica W. Sm.
17. Sin-'n-eUa hiseviata Breb.
Rentrent également à litre accessoire dans le pli\ toiilancton.
18. l'ijmbeUa ci/jiibifb)-j/ie Breh.
19. C. lanceolata Ehr. — C. gastroldcs Ktz. dont les t'rus-
tules pédoncules dans le jeune âge et fixés aux cailloux submer-
gés, deviennent libres.
20. Lpithemia argun Ehr. var. aljicsh-is lîrun. (|ue l'on
rencontre communément dans le tapis nuiqueux des pierres
immergées et qui sont entraînées de leur habitat i)Our mener
une existence erratique.
— 243
IV'. — Chlorophycées
Espèces dominantes. — Boti'ijococcus B)-nniN, Sphocro-
cijstis Schroeteri, Glococf/sfis ntnpla.
Espèces disséminées. — Dncti/Iococcus natans, Ooci/slis
lacustris, Neph?'Oc>/tiH//i Agardliiaituin, SccacdcsiJius
obliquas, S. quadricauda, Pediasi)'ii))i BorijaniDn, Moii-
geofia gracUlima, M. glyptosperma, M. genufiexa, Sjth^o-
gi/ra varia7is, S. quinina, S. quadrata, S. W^cbo'}, S.
TFt'^eri var. elongata, Zygnema criiciatuni, Z. anonudaiii,
Zi/gogoniam pectinatum, Hyalotheca dissiliens, Chœtos-
plicridiiun P^'iiigshehnii, (liardcium obtusiDn.
1. Botryococcns Bi'duul Klz. Cette Cliloroplivcée qui, à
certaines êj)oqiies de l'année, forme une association végétale ti'ès
nette avec la Scliizoplijcée Anabœnacircinalis, se tient de préfé-
rence an large. Par les temps calmes ses thalles, qui forment
des colonies mamelonnées d'un beau vert, flottent exactement à
la surface, mais à la moindre agitation des eaux ils s'enfoncent
pour se maintenir à une profondeur de 0^50 à 1 mètre.
La taille des colonies atteint jusqu'à 2 et 3 millimètres de
diamètre. Cet organisme développe des gouttelettes huileuses
(pli im])régnent tout le réseau delà membrane. Cette huile prend
à certains moments de l'année une teinte rouge brique. J'ai noté
des Botryococcus uniformément teintés de rouge en été, en
liiver et au ])rintemps.
En liiver, les algues devenaient rouges à la suite d'une période
de temps clair et ensoleillé.
Les colonies de Botryococcus, de même ([ue celles d'yVnabœna,
servent souvent de support à un commensal, la VorliccUa
convcdhiria.
Leur développement maximum a lieu de mars à octobre ; elles
sont ])lus rares en hiver.
2. Sphœi'ocystis Schrœtcri Cliodat. (1) se rencontre en toute
saison. Elle semble être })lus fréquente au printemps, en été et en
automne; elle devient rare en liiver.
(1) Chodat, Etudes de biologie lacustre, p. 292, pi. 9.
— 244 —
3. (Tinrncj/s/is ronpin Ktz., moins frcnjucnfo qu(^ la prccé-
dente.
4. DadylococcHS iiatayis Cliodat., très rare.
5. Oocystis /ficus/ris Cliodat., rencontrée une seule fois en
avril 1809.
6. yephroci/tinm Agardhianuml^oeg., également rencon-
trée une seule fois dans la môme ])èche que la jirécédente.
7. Scenedesj/N(.s o/^Iiqu)is Kiz., rave.
8. S. qu((ilric<iuda Kiivli., rare (1).
0. Peduistrittn Boryanu))i Menegli. Celte Protococcoidée
est surtout littorale, habitant au milieu des algues filamenteuses
ou dans le mucus (jui revêt des tiges des roseaux.
Elle est très fréquente à l'état erratique dans la flore i^éla-
gique. On la rencontre en toute saison, mais plus abondant(! en
automne.
Il faut faire également rentrer dans le i)livtoplancton à titre
pélagi(]ue :
9. (liar(iclu)it obtitsuni A. Ih-., recueillie une seule fois,
parasite sur la furca d'un Cycloi)S.
10. ('hœlosj)hœi-idinnt Pi'ii/gsln'i/j/ii Kleel)alm., trouvée une
seule fois fixée sur un filament d'une touti'e flottante de Vau-cheria geminata.
On rencontre également en toute saison, flottant en masses
plus ou moins grandes à la surface, des flocons d'algues vertes,
C-onjuguées filamenteuses, qui sont arrachées au littoral ])ar les
vagues et sont entraînées en jilein lac, où elles végètent. On les
voit ])lus abondamment de])uis le mois d'avril, pendant tout
l'été, éj)oque à laquelle elles atteignent leur maximum.
(1) Ces deux Scenedesmus sont des formes de marécages, tiabitarit les eaux
riches en matières-organiques. Ils sont évidemment erratiques, ayant d'ailleurs
été recueillis flottant tout près des Roselières d'Albigny.
— 245 —
L'une de ces algues doit cejiendant être considérée, à cause de
sa constance, comme planctonique : c'est la très petite
11. Mougeotia gracillhan Wiiiv.
Parmi les autres très fréquentes, dont quelques-unes ont été
observées en état de reproduction, il faut citer :
12. Moitgeotia ghjptosper-ma d(' P>_v.
13. Mougeotia genuftexalv\z.=^PIeuroc(ir}nis inir((J)His
\. Dr.
14. Spirogyra lYcrians (Hass) Ktz.
15. N. quinina (Ag) Ktz var. yV' iiorlicuJ/s \'aucli.
10. .S', qnaih'atd Ktz.
17. !S. Weberi Ktz.
18. S. Weberi var. elongata Rab.
19. Zijguema crnciatnin . Ag.
20. Z (i.noinahun Hass.
21. Zijgogonium {Kiz) j)ectin(itum Vaucli.
22. Enfin une Desmidiée : Ugalotheca dissiliens (Smith)
llalplis. minor forma y de Delponte — ei-ratique évidemment,
car elle est fréquente dans l'enduit muqueux qui revêt les tiges
des Roseaux.
Il est intéressant de signaler, dès à ])résent, l'absence dans le lac
d'Annecy des Volvocacées pélagiques si communes dans les lacs
suisses : Pandorina moriim, Emlorrna elcgans, Volroor-
globator.
Parmi les éléments satellites du jjlijtoplancton, on rencontre
constamment des fragments d'organes de ])lantes i)lianérogames
qui constituent un faciès spécial de la flore flottante : le Pleuston
(Schrôter), dont font également partie à titre macropliytique
Lemna, Ccrafophi/lfum et Utricnlnrui
.
(1) ScHROTËK et KiRCHNER, Die Veyetalion des Bodensecs. Th. I, p. 14.
— 246 —
On recueille ainsi en quantité des poils épidermirpies de
Platanes. On sait que 1 epiderme des jeunes feuilles et des
rameaux de cet arbre est recouvert d'un tomentum très dense
formé de poils doublement étoiles qui se détachent assez rapide-
ment au cours du développement. Etant donnée l'abondance des
Platanes sur la rive nord du lac, il est naturel que les poils
entraînés par le vent aillent se répandre à la surface de l'eau.
Dans le même ordre d'idées, il faut citer aussi les grains de
pollen des Conifères, (juelquefois très abondants, des zvgospores
d'algues.
Les champignons inférieurs parasites ne manquent également
})as, ce sont : Leptothrix rigidula Ktz., dont les filaments
hvalins hérissent les Hvalotheca; les Cjmbella et un certain
nombre de Diatomées; Saprolegiiia ferax, couvrant de ses
houppes blanchâtres les catlavres des larves d'insectes et des
crustacés pélagiques.
B. — La Faune pélagique
ZOOPLANCÏON
Mêlées aux algues i)élagiques, cliaque coup de filet ramène
d'autres espèces fort nombreuses en individus, et qui font partie
de la faune pélagique : le Zooplancton. Ces êtres, qui se ren-
contrent en plus ou moins grande abondance en toute saison,
présentent des maxima sensibles à certaines é[)oques.
Ils a])})artiennent aux groupes des Sai'codinés, des Infusoires,
des Rotateurs et des Entomostracés.
Les Sarcodinés
( )n ne trouve à l'état iiélagique que certaines espèces d'Hélio-
zoaires habituelles des grands lacs aux eaux })ui'es et transpa-
rentes. Elles ne doivent cependant figurer dans le ])lancton qu'à
titre erratique, car elles vivent sur le limon dans la région litto-
rale ou profonde.
Le grou})e des Rhizo])odes est peu représenté dans le zooi)hui('-
lon, car ces animaux sont surtout confiné-s sur la plaine centi'ale
du lac d'oti ils ne sortent presque jamais.
— 247 —
1. Acanthocystîs turfacea Carter. Penard (1), p. 235.
Cette espèce est très abondante et mesure -10 à 48 y. de dia-
mètre; les aiguilles les })lus longues atteignent 07 à 70 a.
J'ai rencontré une fois un individu teinté en vert par des
Clilorelles.
2. Acanfhocf/sfis spinifori Graett' Penard, /oc. f77.,p.245.
3. Rajihidocn/sfis Lemcoii Pen. Penard, loc. cit., p. 196.
Ce curieux Héliozoaire est caractérisé par des spicules en
forme de trompette, diamètre = 35 y, longueur des aiguilles
= 07.5 y.
Il diilère un peu de celui du Léman par l'évasement plus mar-
qué de l'extrémité des grandes aiguilles.
Le corps est fortement coloré en brun })ar les Dinobi"sons dont
l'animal se nourrit. J'ai rencontré cet Héliozoaire en assez grand
nombre le 18 janvier 1904, jour où l'eau était extraordinairement
chargée de ces Pliéoplivcées. Il est curieux de rapprocher ce fait
de celui observé par Penard qui trouva en abondance R.Lemarti,
en 1891, dans le Léman en un moment où les Dinobryons pullu-
laient également.
Les Infusoires
A l'exception de Vorficella co}ii'all(n-}(i,qui est nettement
pélagique, ce groupe est [)eu re})résenté. On ne peut signaler
([ue des espèces erratiques vivant normalement sur le littoral
dans l'enduit muqucnix des cailloux ou dans celui des tiges de
Roseaux, et entrainés en plein lac avec les flocons d'algues
flottantes.
1. Lageiiophï'jjs raginicnJa St. Roux (2), p. 135.
2. Ei)tsfyJtH [dicdtUis Elu*. Roux, loc. cit., \k 1~3.
Rencontré sur le corps des Copépodes et des Nais,
3. VorficcIIc conrc/Uaria Elu'. Roux. loc. cit., p. 119.
(1) Penard, Les Iléllozoah^es d'eau douce. Genève, 1901.
Voir aussi : Id., Les Harcodinés des grands lacs. Genève, 1905.
lu., Faune rhizopodique du bassin Léman. Genève, 1902.
^2) J. Roux, Faune infusorienne des environs de Genève. 1905.
— 248 —
Cet Infusoiro est constamment fixé en quantités innom-brables sur les colonies d'Anabœna et de Botrjococcus.
L'algue est en commensalisme avec son Iiùte et non en sym-biose, car on ])eut observei' la Vorlicelle se nouri'issant et digé-
rant à part.
4. AspicUsca lynceiisO. F. MiiUer. Roux, lue. cit., \). 110.
5. Aspidisca costata Dujard. Roux, loc. cit., p. 111.
Ces deux Infiisoires vivent ])armi les masses iiottantes des
Conjuguées filamenteuses.
G. Mesodinium acarus St. Roux, p. 33.
Espèce rare, rencontrée parmi les algues flottantes.
7. CoIep^hirtusO. F.WnWav. Roux, p. 30.
Le corps contient toujours quelques Chlorelles et des globules
graisseux de couleur bleue.
8. Holophri/a orum Ehr. Roux, p. 21.
Corps fortement coloré en vert par les Chlorelles.Vit au milieu
des masses flottantes de Conjuguées.
On rencontre à peu près constamment des Infusoires dans les
pèches }!élagiques, mais ainsi que l'a fait remarquer Roux et que
j'ai pu le vérifier, leur maximum de dévelopjjement coïncide avec
celui des Diatomées qui leur servent de nourriture, soit en
automne et au commencement de l'hiver. J'ai constaté que les
espèces garnies de Chlorelles se trouvent surtout au printemps et
en automne, rarement en été.
L'algue et l'infusoire vivant en symbiose, il y a évidemment
avantage pour l'algue à ce que son hôte l'entraîne à la surface
pour profiter de l'action de la lumière. On peut penser, d'autre
])art, que l'insolation trop vive, en })lein lac, pendant les mois
d'été, ralentit le développement des Chlorelles, (pji finissent par
disi)araître. Cette question de biologie est d'ailleurs fort obscure.
Il faut noter, en outre, que les esj.èces à Chlorelles existent toute
l'année dans la région littoi'ale.
Les Rotateurs
Les espèces purement pélagicpies de ce groupe sont toutes
excellentes nrrgeuses. transi)arentes, délicalcs et constituent une
bonne partie du zooplancton.
— 249 —
S'il est absolument indispensable d'étudier les Rotateurs à
l'état vivant, il est bon également de les fixer pour examen plus
complet. Dans ce but, on peut employer la formule de Weber (1)
ou bien le procédé de Beauchamp (2).
La faune rotatorienne du lac d'Annecy est toujours, suivant la
règle, pauvre en esjjèces, mais nombreuse en individus.
Espèces dominantes : Notholca lo7igisinna,Amirœa cochlea-
7ns, Asplcmchna p7nodonta, Triarthra longiseta.
Espèces disséminées ou saisonnières : Polyarihraplatyptera,
Notholca striâta, Gastropus stijlifer, Anapus oral/s, A/m-
roea aculeata.
1. Notholca longispina Kellicot. Weber (3), p. 728.
Très commune et très abondante. Deux formes se rencontrent
dans le lac,simi)les variétés individuelles; l'une aux deux grandes
épines antérieures égales, l'autre dont une épine latérale atteint
la longueur des deux autres. Elles sont également notablement
plus jjetites que l'espèce type du Léman, l = 420 à 500 p.
2. Anuroea cochlcai'is Gosse. Weber, p. 709.
Aussi abondante cpie la précédente, surtout en aviil et en
mai. Il y a diminution en été et réa]jparition en octobre.
3. Asplanchna priodonta Gosse = A. helretica Imhof.
Weber, p. 377.
Cette magnifique espèce est d'une transparence absolue. Sa
longueur varie de 528 à 627 u. L'œil est toujours pigmenté
de brun.
A. priodonta est assez rare en été. On le voit ajjparaitre en
décembre pour se développer extraordinairement en mars. La
{\) Communication inédite de l'auteur, le D'" Weber. — Pour lOO'''"^ de
pèche ajouter 20^m:5 de solution de chlorhydrate de cocaïne à 2 p. c; laisser
agir un quart d'heure ou une demi-heure au maximum. Ajouter 20«ni3 de
solution osmique à 1/1000. Laver à fond sept ou huit fois ou bien pendant
un quart d'heui'e au moyen d'un courant d'eau dans lequel on agite la pèche
contenue dans un entonnoir en verre, fermé en bas par une gaze serrée par un
caoutchouc.
(2) UE Beauchamp, « Instruction pour la récolte et la fixation en masse
des Rotifères », Arch. de Zool. e.rp., 1906, vol. IV. Notes et revue, n" 2.
(3) Weber, « Faune rotatorienne du bassin du Léman », Rev. suisse de
Zoologie, t. V, fasc. 4, 1898,
16
— 250 —
femelle est beaucoup plus abondante que le mâle, dont le corps
est cylindri(jue et plus petit / = 330 u. Je n'ai d'ailleui's rencon-
tré qu'une seule fois ce dei'nier.
4. Triarihra loitgiséta Ehr. vai". 1/mnetica Zacharias.
Weber, p. 40G.
Très commun également, ce Rotateur possède dans la forme
du lac d'Annecy des é})ines qui ont jus(prà cinq fois la longueur
du corps, ce qui permet de le rapprocher de la variété limne-
tica de Zacharias (1).
On le trouve abondamment en mai-s, il diminue en été pour
reparaitro en octobre.
5. Pohjarthra phitijptera Ehr. Weber, p. 401.
Cette espèce très rare dans le jjlancton de printemps et d'été,
se rencontre surtout d'octobi'e à mars.
6. Notholca striâta (). F. Millier. Weber, p. 720.
Très rare, rencontré une seule fois au large de Saint-Jorioz.
Ce Rotateur doit être erratique dans le })lancton. C'est d'après
Weber une forme littorale.
7. Gastropus stylifcr Imliof. Weber, p. 753.
Très rare.
8. Aiiapas oralis Bergendal. Weber, p. 700.
L'estomac est toujours remi)li de corpuscules jaunâtres (à
cause des Dinobrvons dont l'animal se nourrit), et de masses
colorées en noir.
9. Anurœa aculeata Ehr. Weber, p. 701.
Espèce rencontrée une seule fois en avril 1899.
Les Copépodes
Ces agiles petits Entomotracés, très transparents et parfois
teintés de vives couleurs, sont essentiellement pélagi(|ues et
constituent avec les Calanides la majeure partie du Zoojjlancton,
(1) Zacharias, Forschungsherichte ans d. Mol. Stat. :u Plein, 1892. Th. I,
p. 23.
j)réscntant des varialions saisonniôros très noites. On rcnconiro
dans lo lac d'Annecy les es})èces snivanic^s :
1. Cyclops strenuus Fischer. O. Sciimeil, I. IT, fig. 12 à
15 (1), J. Richard (2), p. 227.
La coulenr des individus est rouge ou orangée, sui'lout au
])rinteinps, où a lieu le maximum de celle es})èce (aM'il). En clé,
ils sont souvent incolores, ils diminuent en automne.
2. Cj/clops alxjssorum G. (3. Sars. Brady (3), ]>. 8.
Ce Co])épode est assez rare. Il est toujours incolore. C'est une
forme arctique abondante dans les lacs d'Ecosse. Sars l'a décrit
sur des spécimens péchés dans le lac Maridals près de Christia-
nia. C'est une espèce très voisine de (7. strenuus, et comme on
ne la trouve jamais en été dans le lac d'Annecy, il faut proba-
blement la définir comme une forme saisonnière hivernale de ce
dernier.
3. Ci/clops pentagoitus A^osseler, = C. prasinus Fischer.
Richard, p. 233. Schmeil, taf. V, f. 2, Furbes (4), pi. XIX,f. 1 et2, pi. XX, f. Iet2.
Espèce \)Q\\ commune.
4. Ci/clopjs serrulatus Fischer. Richard, p. 234. Sciimeil,
taf. V, f. 6 à 14.
Espèce également rare
Les Gladocères.
Une grande et très belle espèce domine ce groupe et représente
l'unique espèce des Leptodoridae, qui est, par sa transj)arence
absolue, hautement adaptée à la vie pélagique.
(1) Otto Schmeil, « Deutschlands freilebende Siisswasser Copepoden
Cyclopidae ». Bibl. zoologlca, Heft II, p. 191.
(2) J. Richard, « Recherches sur les Copépodes liljres d'eau douce ».
Ann. des se. nat. zooJ., XII, n° S. Paris, 1891.
(3) Brady, « A revision of the British species of fresh water Cyclopidae
and Calanidae. » Nat. hist. transact of Northumherland, vol. XI, p. 68.
(4) E. FoRBES, « A contribution to a knowledge of North American IVesh
water Cyclopidae. » Bull, ofthe Illinois State lahoratory, vol. V, p. 27.
— 252 —
1. Lepiodora hyalina Lillj. = L. KhuU'n Fockc. Hellich
p. 110 (1).
Ce cladocère est carnassier, il ne se nourrit que de petits ento-
mostracés qu'il vient chasser pendant la nuit dans les couches
superficielles du lac. Il se tient au large et dans les profondeurs
])endant le jour. Je ne l'ai jamais recueilli qu'après le coucher du
soleil.
2. Sida cristaUina O.F. Millier Hellich, }). 15. Sïingelin(2),
p. 187.
Cette Sida est toujours rare, mais elle se rencontre plus fré-
(juemment en novemljre et décembre.
3 et 4. Diaphanosoma (Daplmella) hr-achyurum Lievin.
Didphanosoma (Daplmella) Brandtianum Fischer.
Ces deux espèces sont rei)résentces dans le lac d'Annecy, mais
la deuxième est de beaucoup la plus fréquente.
Chez D. hrachyura les épines des grifiés caudales sont parai-,
lèles et les bords de la carapace sont munis d'épines courtes. Les
dimensions du corps chez celle-ci sont plus grandes r"™2 à 1 """32
que chez D. Brarultiana qui ne dépasse pas 700ij..
Il n'y a pas
de différences sensibles dans la grosseur des yeux, quant à
l'étranglement qui sépare la tète du corps, il est moins accusé
chez D. Brcmdiiana. Cette dernière se rencontre surtout en
hiyer. C'est une des espèces ({ui montent la nuit à la surface, ainsi
que le montrent les notes relatives aux pêches nocturnes.
La majeure partie du groupe des Cladocères est formée par le
genre Daphnia, pour lequel on a établi de nombreuses espèces.
I)URCKiiARi)T(3)a bien débrouillé cette systématique un peu con-
fuse en restituant à des variétés (forma) du type la plupart des
formes (ju'il a rencontrées dans ses investigations des lacs suisses.
De l'examen des nombreuses formes du lac d'Annecy, il résulte
qu'il faut les considérer uniquement comme des variations sai-
(1) BoiiusLAv Hellich, «. Die Cladoceren Bohmens ». A}-ch. cler naturic.
Lundeadurchforsch. von Bdhrnen, III. Bd, IV. Abth., II. Heft.
(2) Stingelln, « Dio Cladoceren der Umgebung von Basel », Rei\ suisse de
zoologie, Bd. III. — Id. « Neue Beilrage z. Kenntn. der Cladocerenf'auna der
Schweiz ». Rev. suisse de zool., t. XIV, 1906.
(3) G. BorckhXrdt, « Faunist. u. System. Studien ul)er das Zoo])lanclon des
gross. Seen der Schweiz ». Rcv. suisse de zool., t. 7, 1899.
— 253 —
sonnières, du moins en ce qui concerne D. longlspiua var hija-
luui, qui se ['encontre très polymorplie en tout temps avec des
maxima au printemi)S (mars, avril) et en novembre, époque à
laquelle existent les ephljjpliun jusqu'en avril où la cavité
incubatrice contient des jeunes.
5. Daphiiia îongispina (ivpe) (3. F. Millier, avec sa variété
D. liyalina est constante en toute saison. Il est maintenantreconnu, d'après les travaux récents de G. 0. Sars, que toutes les
formes de D. hyalina doivent rentrer comme variétés indivi-
duelles locales et saisonnières de D. longispnna (1) (fig. 5-1).
6. Daphnta hyalina Leydig forma typica Leydig. Rurck-HARD, p. 40.5, pi. 10, fig. 2, abondante au printemps, devient plus
rare à la fin de l'hiver (février, mars) où elle est remplacée par
les formes suivantes «, b, c, d, e, parmi lesquelles on trouve
tous les passages depuis la normale jusqu'aux formes les plus
aberrantes. Les modifications portent sur les silhouettes de la
tète et du bec (v. fig. 5, a, h, c, d, e).
a) D. hyalina foi-ma galeafa Sars. = D. galeata Millier. =D. oxyccphala Sars. Burckhardt, p. 502, f. 12 et 13.
La tête porte au vertex une légère éminence, })arfois nette-
ment mucronée. La coquille est réticulée et porte à son bord
postérieur une rangée de pointes. Forme analogue à celle duLéman.
h) D. hyalina form. lucernensis Burck. Burckhardt,
p. 497, t. 10, fig. 7 et 20. Le corps très ovoïde est allongé, le
bord ^'enf rai de la tête est légèrement concave, le bord dorsal se
raccorde en ligne di-oite avec le contour du corps. Forme ana-
logue à celle du lac des Quatre-Cantons.
c) D. hyalina forma turicensis Burck. Burckhardt, p. 40(3,
t. 10, f. 17. Tète aplatie, bec très détaché, ovoïde avec pointe
bien indiquée. Analogue à la forme du lac de Zurich.
d) D. hyalina forma p)rimitiva, Burckh. Burckhardt,
p. 403, t. 10, f. 8. Tète arrondie surélevée en bosse frontale,
rostre très séparé de la tète par un étranglement. Analogue à la
forme du lac des Quatre-Cantons.
(1) G.O. Sars, « On the Crustacean fauna of Centival-Asia», Ann. du mus. de
Sl-Pétershourg , vol. 8, 1903, et Stingelin, « Unser heutigos Wissen ii. die
System, u.d. geogr. Verbreitung der Cladoceren », Co)igrés lut. de zool., Berne,
1904, p. 536.
254
e) D. hijnlinn forma Sfech'i Biirckli. Burckiiakdt, p. 407,
t. 19, f. 4. Tète suréknrc })rolongée sans étranglement dans le
rostre qni est coniqne. Analogne à la forme dn lac de Thoune.
A la fin de l'hiver et an commencement dn printemps, j'ai ))u
observer toîis les pr/ssfffjes de l'iuw ('/ Vautre des formes
décrites ci-dessus. An j)rint('m])s, celles-ci se raréfient et en été on
ne rencontre presque plus que 1(; type. 11 semblerait donc que
Kig. 5 — Variations saisonnières de Dapluna lonf/ispina 0. F. Muller, var.
InjaUrm Leydiij;-. Fig. 1. f. ti/pica Burcii. fig. a, f/aleata Biirck ; fig. b. f.
lucerncnsia Biirck.; lig. c. f. tnriccHSis Burck.; lig. il. f. primiliva Burck.;
lîg. e. t. SU'.cki Barck. — (Réponilant comme fonnae proximae de celles
décrites par Burckhardt.)
dans l'évolution ontologique de l'animal, ces formes p-lus ou
moins aberrantes représenteraient les divers stades mori)]iolo-
giques qui gravitent autour du t.vj)(! Dai)hnia liyalina formatypica (lato sensu) Daplmia longispina, avant de se fondre en lui
et ne seraient en somme que des variations saisonnières de ce
Cladocère.
— 255 —
7. BosminalongispinaLejc][g,=^B.bohemica Stïugl. Stin-
GELiN, p. 230, t. 6, f. 26. Fréquente en tout temps, mais semble
cependant avoir son maximum du printemps à l'été. On rencontre
parfois en hiver des individus portant dans leur cavité incuba-
trice des œufs ou des jeunes teintés d'une belle couleur azurée.
8. Bosmina loiigirostris-cornuia 0. F. Millier-Jurine.STiN-
GELiN, p. 224. Moins abondante que la précédente, elle se trouve
surtout de noAembre à ianvier. Notre forme mesure 430 u. ; elle
a donc une taille supérieure à celle du tvpe qui n'excède pas
350 a.
Les espèces sui^antes jouent un rôle beaucoup moins im])or-
tant dans la composition du zooplancton où elles ne figurent pour
ainsi dire qu'à titre erratique. Elles vivent en effet au milieu des
touftes flottantes d'algues filamenteuses arrachées au littoral et
entraînées au large.
9. Acroperus leucocephalus Ivoch. Hellicii, p. 79. Stinge-
LiN, p. 239, f. 28.
Ce cladocère est ici beaucouj) plus petit 183,6 u. que le tvpe, qui
atteint jusqu'à 800ij..
10. Alona affinis Levdig. Stingelin, p. 245, f. 32.
Individus également plus petits 229 y. que le type, ([ui d'après
Stingelin, atteint 770 y.
.
11. Plenro.i'us excisas Fischei'. Stingelin, p. 253, f. 38, 39.
Cette espèce / = 320 y. parait au printemps ainsi que la sui-
vante :
12. Pleuroxns hastatus Sars. Stingelin, p. 265.
13. Chijdorus sphœrlcus 0. F. Midler. Longue de 243y, cette
forme se rencontre en hiver.
Les Calanides.
Ces Entomostracôs sont peu variés comme espèces, mais
innombrables en individus. Ils forment avec les Co])épodes la
majeure partie du zooplancton.
— 25n —
Généralement teintés en l'ouge par un pigment formé d'une
matière colorante spéciale (1), ces êtres sontdonés d'un liant degré
d'iiéliotropisme positif, ce qui ('X})lique leur abondance dans les
couches superficielles, particulièrement sur la beine qui est for-
tement ensoleillée. On constate d'ailleurs que, mis dans une
cuvette en verre, ils se massent toujours du côté de la lumière.
En hiver, les femelles portent des paquets d'œufs colorés en rouge
vermillon et aussi de un à cinq spermatophores accrochés à
l'abdomen.
J'ai vainement cherché dans le lac deux formes glaciales et
alpines Diaptomus denticornis et D. baccilUfer qui sont fré-
quentes dans les lacs élevés des Hautes Alpes (2).
1. Diaptomus gracills G. 0. Sars. Burckh., p. 045, t. 22,
f. 1, 2.
Ce Calanide hautement pélagique a une distribution géogra-
phique assez étendue. Sa présence, d'après de Guerne et
Richard (3), n'avait pas encore été constatée en France. Son
développement maximum parait être de janvier à mars, époque
à laquelle on rencontre des femelles chargées d'œufs et mêlées à
de nombreux nauplius.
2. Diaptomus hiciniatns lÀW]. de G. et Rich, p. 47, pi. I,
f . 25.
Notre espèce est caractérisée par la forme extrêmement laci-
niée des lobes latéraux des deux derniers segments de l'abdomen,
qui sont très divergents et fortement mueroués. C'est une forme
alpine et une espèce arctique, particulièrement abondante dans le
lac où elle trouve son maximum au printemps (avril, mai).
{1)R. Blanchard, « Sur une carotine d'origine animale », Méin. de la Soc.
sool. de France, III, 1890, p. 113.
(2) Blanchard et Richard, « Sur la faune des lacs élevés des Hautes Alpes »,
Mém. de la Soc. zool. de France, 1897, p. 45.
(3) DE Guerne _et Richard, « Revision des Calanides d'eau douce », extr.
des Mém. de la Soc. zool. de France, vol. II, 1889, p. 1(5.
— 257 —
III
LA REGION PROFONDE
A. — Conditions physiques du milieu
Indépendamment du gouffre du P)Oul)ioz, dont le fond atteint
80™G0, la plaine du lac d'Anne(?y s'étend par des fonds moyensde 60 mètres. En raison de cette profondeur relativement faible,
y a-t-il une faune et une flore véritablement spéciales ? Les espè-
ces ne s'y rencontrent-elles au contraire qu'à l'état erratique ?
Ce sont des questions qu'il était intéressant d'étudier, aussi, à
l'exemple de Forel pour le Léman, ai-je essayé de me rendre
compte des éléments climatiques et de tous les facteurs géné-
raux du milieu : la température du fond, la profondeur à laquelle
pénètre la lumière, la nature du limon.
La te7npéraUire. — Les premières observations ont été
effectuées par de Saussure (1) en 1780, qui descendit son ther-
momètre à 163 pieds dans le gouff're du Boubioz et trou^'a 4"5,
alors que la temi)érature de la surface était de 11°5.
En 1860, BoLTSiiAUSER (2) déterminait les limites extrêmes de
la variation de température des eaux du lac. Il trouvait pour la
surface 20° et 2° : moyenne = 11": pour le fond (de la })laine
lacustre) 8° et 4° : moyenne = 6".
En 1883, Forel (3) constatait 17"5 à la surface et 6"1 à la
profondeur de 55 mètres.
Les sondages de Delebecque donnent plus tard les résultats
suivants :
1890 27 juillet plafond du lac 4«7
10 septembre id. 4"8
1891 10 juillet à 63 mètres 4"6
1895 27 février à 63 v 3°8
Pour le Boubioz en 1891 à 80 11"8
25 » 3°5
Au-dessus de 25 " 3°4
(1) DE Saussure, Voyage dans les Alises, 179G, vol. III, § 1162, p. 4.
(2) BoLTSHAUSER, « Le lac d'Annecy », Rev. Saroisienne, 18G0, p. 2.
(3) Forel, « Sondages zoologiques et thermoni étriqués », Eev. Savais., 1884.
— 258 —
A plusieurs reprises au cours de mes péclies, j'ai eu ?oin de
prendre la temjîérature du limou de fond pai* 55 mètres environ,
soit en été, soit en hiver, en utilisant le procédé conseillé par
FoREL. Voici les résultats :
Année 1890 30 mai 4°5
« 12 juin 4"5
V 15 juillet 4°5
1897 13 juin 4"3 \ Moyenne- 30 juillet 4-^0 de l'été
'^ 10 août 4^5;
4-'5
1898 13 juin 4"G
» 20 juillet 4"4
189G12mars 3"5)
Moyenne
1897 4 janvier 3"7 ( de l'hiver
» 8 février 3"(')j
3"6
J'ai i)U ainsi constater (|ue la moyeluie de huit sondages en été
a donné pour la température du limon 4"5,c<dle de trois sondages
en hiver la moyenne de 3"G.
Le limon de fond. — La plaine du lac est recouverte sur
une éi)aisseur que je n'ai pu évaluer, mais qui doit être considé-
rable, d'un limon assez tenace et uniformément gris. Si on le
laiss(! rei)Oser longtemps dans un cristallisoir à l'air libre, le
limon se dessèche, se fendille, une coloration jaunâtre superfi-
cielle apparaît, mais celle-ci est due à une couche très mince
des Diatomées qui, comme nous le verrons, [)ullulent dans la
région profonde.
Ce limon doit être considéré comme un dé[)()t d'alluvion et
formé en partie })ar la préci])itation mécani(pie du carbonate
de calcium dont les fines })articides s'accumulent, })ar une
descente extrêmement lente, sur le fond. Il se réduit pai' la des-*
siccation en une poussière blanche impalpable.
• Une notion particulière est fournie par l'examen du limon du
Boubioz. — J'ai fait })lusieurs fois des prises i)ar 75 mètres
de profondeur sur les parois de ce goufire, au moyen d'une
drague coni(|ue qui pouvait extraire des blocs d'un certain
volume. Or ce limon, au sortir de l'eau est formé de deux cou-
ches, l'une bleuâtre en profondeur, l'autre superficielle, d'une
épaisseur de Là 2 centimètres, de couleur jaune ferrugineuse et
})énétrant irrégulièrement dans la masse. Il faut attribuer cette
— 259 —
double coloration, ainsi que l'a montré Forel(I), à un degré diffé-
rent d'oxydation des sels de fer qui sont contenus dans le limon :
" le limon à la surface contient du peroxyde de fer, tandis que
dans la couche })rofonde un certain degré de réduction s'opère
par la destruction ])eut-étre des matières organiques et le fer se
change en protoxyde ".
Il résulte des analyses de Duparc (2) que les boues de fond
recueillies au milieu du Grand Lac par 64 mètres de profondeur
renferment 33 à 34 p. c. de silice.
On doit attribuer cette proportion à l'influence des apports
torrentiels du Laudon ([ui lessive les formations glaciaires et les
molasses fortement silicatées qui encombrent la dépression de
Leschattx, et aussi pour une partie appiT'ciable à l'extrême abon-
dance des Diatomées qui recouvrent d'une mince couche le limon
de fond.
Mais dans les boues du Boubioz la proportion s'élève à
68.03 p. c. de silice et de silicates. Ce fait s'exjjlique aisément,
si on considère (pte le griffon de la source sous-lacustre s'ouvre à
même la roche vivo qui se rapporte selon toute vraisemblance au
niveau supérieur de l'Hauterivien qui est très siliceux (3). Je crois
donc que l'on peut attribiter cette proi)ortion considérable de silice
à l'intense décalcification de la roche i)ar l'action des eaux de la
source qui la traversent.
En résumé, le limon de fond est très homogène sur le plafond
du lac et d'une même teinte grisâtre, il est oxydé dans l'entonnoir
du Boubioz. Le premier passe, en se rapprochant de la beine, à
des dépôts détritiques, sableux puis argileux. Ceux-ci s'agglo-
mèrent en une argile plastique très liante qui est entraînée dans
les émissaires du lac. Cette argile a notablement gêné par sa
ténacité les travaux de curage du canal du Vassé, au i)rin temps
de 1905.
Pénétration de la lumière. — Les radiations lumineuses
jouant un rôle impoi'tant dans la vie et le dévelop})ement des
organismes, il était intéressant de rechercher la profondeur
(1) FoREL, Le Léman, vol. I, p. 119.
(2) L. Duparc, « Le lac d'Annecy », Arch. des se. phys. et nat. de Genèi-e,
t. XXXI, 15 février 1894.
(3) Revil et Le Roux,« Structure de la partie septentrionale du Semnoz »,
Rev.Sav., 1906.
— 2(30 —
maximale à laquelle hs rayons solaires })envont [)énét rer dans la
masse des eaux.
Mais cette quantité de lumière qui traverse l'eau devient si
diffuse qu'il était nécessaire de trouver un réactif assez sensible
pour la déterminer. Forel a enseigné une méthode photogra-
phique (1) très ingénieuse, dont j'ai légèrement modifié le dispo-
sitif, afin de pouvoir effectuer les opérations en })lein Jour.
J'ai décrit ailleurs (2) l'appareil et donné le résultat de mesexpériences dont il est seulement besoin de rappeler ici les
résultats.
La pénétration de la lumière dans le lac e?>i plus forte en
hiver qiCen été, en raison inverse du développement des micro-
oi'ganismes. On peut établir la limite d'obscurité à la profondeur
de 80 mètres en hiver et de 70 mètres en été. Sur le ]>lafond du
lac, l'éclairage est assez faible ; dans les profondeurs moyennes
règne un demi-jour plus ou moins long pendant les mois d'hiver
et un crépuscule constant pendant l'été.
Des deux procédés de dragage employés par Forel, le râteau à
poche de mousseline ou le seau ovale en fer l)lanc lesté })ar un
plomb à la ligne de sonde, j'ai employé surtout le dernier.
Le produit de la drague était versé dans un cristallisoir et
abandonné sur la table du. laboratoire dans un endroit sombre
ou à la. lumière diffuse.
On constate qu'a})rès quelques heures, la surface reposée du
limon se colore d'une légère teinte brune composée d'une innom-
brable quantité de Diatomées mêlées à des filaments éCOscil-
I/dres.
Lorsqu'on soumet à une vive lumière une partie seulement du
vase contenant le dépôt, cette couche brune n'apparait pas. C'est
là une indication probable que ces organismes sont adaptés déjà
par leur genre de vie à un milieu totalement dépourvu de radia-
tions puisqu'ils cherchent à se soustraire à l'éclairement en
s'enfoncant dans la masse du limon.
(1) Forel, Le Léman, vol. II, p. -134.
(2) M. Le Roux, « Notes bioloj^iques sur le lac d'Annecy », licv. saroi-
sienne, 1899.
— 26. —
B. — La flore profonde
Il n'a pas été fait jus(|u'à présent de recherches sur \-à région
profonde au point de vue de hi flore. J'ai exploré seulement le
Grand Lac par des profondeurs de 30, 40 et 50 mètres en une
trentaine de coups de drague en été ou en hiver. Le gouffre du
Boubioz a été également fouillé trois fois.
Les résultats obtenus donnent ainsi une notion assez complète
sur la physionomie générale de la vie dans les profondeurs.
Rappelons rpie les conditions de milieu dans cette région sont
les suivantes :
Température basse : en hiver 3"0 et ne dépassant pas 4°5 en
été.
Affaiblissement ou extinction pres(|ue complète de la lumière.
Tranfpiillité absolue des eaux.
Pression considérable, 6 atmosphères en-siron, sur le plafond
du lac.
Tous ces facteurs contribuent à assurer aux organismes une
région de calme et des conditions d'uniformité d'existence.
Les plantes à chloro})h}lle ne pouvant plus ^ivre à cette pro-
fondeur, toute végétation jjhanérogamique a disparu. Les bords
de cette immense cuvette désertique sont seulement garnis,
comme nous le verrons plus tard, jusqu'à 8 ou 10 mètres au-
dessous de la surface, des derniers gazons de Characées.
La flore des profondeurs, végétant sur le limon, se compose
uni(piement de Schizopiiycées et de Diatomacées, aux espèces
peu nombreuses mais en nombre d'individus considérable.
Schizophycées.
Ce groupe n'est représenté que par des Oscillariées, dont les
filaments forment comme une trame lâche au tapis uniforme des
Diatomées.
Phormidium subfiiscum Ktz. = Oscillaria subfusca
Agardh.
Phormidiam uncinnturn Gom. = OsciUdtoria arach-
noidea Aoardh.
— 26::! —
-
Diatomacées
Régions
30"" 40-r>0n 80"
Epithemia ocellata Elir
E. gihba Ehr
E. argus var. alpestris Ehr.......Himanthidium arcus Ehr. . . . . •
Ceratoneis arcus Ehr.
Amphora ovalis Ktz
Cymbella Ehrenbergii Ktz
C. alpina Grun
Navicula elliptica Ktz
\. pusilla W. Sni. forma alpestris Brun
Pinnularia viridis Rai)
P. viridis Ehr. forma major Rab. .
Stauroneis Cohnii Hilse var. minuta Ktz.
Pleurosigma attenuatum W. Sm. .
PI. acuminatum Grun
PI. » » var. ScalproidesRab.
Cymatopleura solea Breb. et Sm. . .
C. solea var. apiculata Pritsch
C elliptica type Breb. et Sm
C. » var. Constricta Grun. . .
Surirella spiralis Ktz
Sur. norica var. costata Ktz
S. biseriata Breb
S. gracilis Grun
Synedra ulna Ehr
S. biceps W. Sm
( yclotella operculata Ag. var. anticjua Ktz.
Melosira arenaria Moor
Nitszchia sigmoidea var. Brebissoni . . .
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Spéciales
à la région
profonde
+
+
+
+
très -fnoml)reux
+
fortement
coloré
+
— 263 —
La comparaison des éléments de cette liste avec cenx des espèces
littorales qui est donnée \)\n^ loin, est instructive, car elle montre
qu'un certain nombre de formes sont communes aux div43rses
régions, tandis qu'on ne trouve ])as ailleurs que sur le limon tie
fond les deux Oscilhiriées et les Diatomées : Ceratoneis rn'cus,
Cymbella alpina, Naricula eUijdica, Pinnularia riridis
form. 7najor-, Pleurosigtiia atleuuatum. PI. aciuniuatiDu
var. scalproides. PL aoonhtatuin et les belles espèces
Sitrirella spir(flis, S. norica, S. (jracUis. Un fait curieux à
noter est également la présence exclusive dans la région profonde
d'une Mclos'n'd arenaria; toute autre espèce de ce genre man-([uant absolument dans le lac d'Annecy.
Doit-on voir là des espèces ada])tées? Il n'y a aucun doute
pour les formes communes aux deux régions qui résultent d'indi-
A idus vivant et se re})roduisant liabituellement sur le littoral et
([ui ont été entraînés au large, tombés sur le fond où ils conti-
nuent à végéter. Ce sont des formes eri'ati(|ues dans la région
profonde.
En ce qui concerne les espèces qui ne se rencontrent que sur
le fond, elles pourraient bien être définitivement adaptées, car
elles s'y reproduisent. .T'ai constaté en eiïet plusieurs fois le pro-
cessus de la sporulation. D'autre })an, les espèces sont presque
toutes de très grande taille;particulièrement Su7HreUasplr((Us
et P'ninnlarid . Les Surirelles spiralées des grands fonds du
Léman ont au plus 140 a de diamètre. Les nôtres atteignent près
de 300 a et ne présentent })as la même toi'sion que les })récé-
dentes. Le frustule a en etiét la forme d'une liélice de l)ateau à
branches égales. Pleiirosigma ne se rencontre également qu'en
profondeur. Chez SurireUa norica, i'endochrome est fortement
teinté en rouge brun. Y a-t-il là une relation entre cette intense
coloration et cette constatation faite par Forel (1) que certains
animaux de l'eau profonde du lac d'Annecy sont plus fortement
pigmentés que les mêmes espèces qui vivent sur le littoral ? Je ne
saurais le dire, me bornant à enregistrer le fait sans pouvoir en
donner une explication satisfaisante.
(1) Forel, Faune profonde du Lànan, p. 13-t.
264
(\ — La Faune profonde
Quelques indications sur la faune profonde du lac d'Annecyont été fournies par deux dragages effectués en 1883, l'un parForel(I), l'autre par Imiiof (2), devant Verrier, par 55 mètresde fond. Le premier donne une liste de douze espèces, le seconden ajoute six autres, soit en définitive un total de dix-huit
espèces. Forel conclut en outre que la faune y est abondante et
variée et qu'elle se distingue de celle des autres lacs par la
grande taille et la pigmentation plus foncée de certains animaux(AseUus, Fi -eda ncella) .
Un certain nombi-e de dragages effectués en toute saison à la
profondeur de 40 à 45 mètres, soit à 80 mètres dans le Boubioz,m'ont pei'mis d'ari'iver à une connaissance plus com])lète desespèces (jui peujjlent la région profonde.
Les Sarcodinés
Ce groupe est l'oprésenté par un certain nombre de Rhizopodeset d'Heliozoaires.
Atnœha Umax Duj. Penard (;J), p. 35. Sur le limon par 30 m.A. profeus Rosel. Penard, p. 57. Sui' le limon par 30 m.Dt/fliigia scdlpelUiim Pen. Penard p. 243. Sur le limon par
30 m.
D. constricta Eliv. Penard, p. 258. Sur le limon i)ar 40 m.Hyalosphenia puncfatd Peu. Penard, p. 341.
Rare. Je ne l'ai rencontré qu'à l'état de coquille vide par
40 m. de fond.
Quadrilla irregidaris Arcli. var. glolmlosa Pen. Penard,]). 380 et Sarcodinés (4) p. 42. Rencontré dans le Boubioz par80 m. de fond.
. Cyphoderia rnargaritacca Eliv. var. major Pen. Penard,p. 475. Boubioz 80 m., très fréquente.
(1) Forel, La Faune profonde des lacs suisses, 1884, p. 134.
(2) Imhof, « Die pelagische Fauna u. die Tiefseefauna der /wei Savoyer-
seen », Zool. Anzeiger, VI, n° 155, 1883.
(3) Penaru, Faune rhizopodique du bassin de I.éman. Genève, 1902.
(4) Penard, Les Sarcodinés des grands lacs. Genève, 1902.
— 265 —
Gromia squamosa Pen. Penard, p. 501. Sarcodinés, p. 73.
Boubioz par 80 m.
Clathridina Cienkowskii Menoscli. Penard (1), p. 276. Sur
le limon par 40 m.
Acaritlux'ystis turfacea Carter. Penard, p. 23.3.
Cet H("liozoaire, qui est fréquent à l'état pélagique, se ren-
contre souvent sur le limon par 30 mètres où je l'ai observé
plusieurs fois en état de reproduction.
Rcqthidiophri/s paUida Schultze. Penard, p. 176. Sur le
limon par 30 m. Le corps est souNent rempli de Diatomées
qui lui donnent une teinte jaunâtre.
Actinophrys sol Ehr. Penard, p. 98. Sur le limon par 30 m.
Notre espèce, qui se nourrit de Diatomées, est remarquable par
sa taille, qui atteint 85 a.
On constate dans cette liste quelques formes communes au
littoral et à la région profonde ; mais les Sarcodinés de fond ont
une taille plus considérable. Quelques-uns sont spéciaux à la
région profonde et ne se rencontrent jamais ailleurs, tels :
Cyphoderia mat^garitacea, Quadrida irregidaris, Diffftt-
giascfdpellum, D. constricta, Hyalospjhœnia, ClcdhruUna.
Leur taille exceptionnelle coïncide avec celle des grandes Diato-
nées dont ils font leur nourriture (exemple les Surirella et
Pinmdaria du Boubioz où se rencontrent les très grandes
Cyphoderia).
Les Infusoires.
Ce groupe esi pauvrement représenté par deux espèces de pro-
fondeur.
Lionotus anser Ehr. Roux (2), p. 37, pi. II, fig. 5.
Sur le limon par 40 mètres de fond.
Stentoi' cœruleus Ehr. Roux, p. 86, pi. V, fig. 7.
Cet infusoire non fixé vit sur le limon par des fonds de
50 mètres, il est toujours plus coloré en bleu vert que le type
décrit par Roux.
(1) Penard, Les Heliozoaires d'eau douce, 1904.
(2) Roux, La Faune infusorienne des environs de Genève, 1905.
17
— 266 —
Les Hydres.
Lorsque l'on abandonne dans une envotte le limon de fond,
après un certain temps de repos apparaissent de petits points
rouges qui piquent la surface. Ce sont des Hydres au corps
allongé, grêle et bourgeonnant, parsemé de nombreuses taches
.pigmentaires rouge bri(pie. Cette forme de fond, loujours liljre,
correspond à la Ya^riéié riibra Lewes.
Les hydres sont d'ailleurs très fréquentes dans la région litto-
rale, fixées aux rameaux des Chara, des Myrio])hylles de la
beine ou à la partie inférieure des feuilles des Lemna (Albi-
gny). Cette espèce littorale est //. ridgaris présentant des
variations de couleurs, dues évidemment à l'alimentation de ces
animaux, qui ont amené certains auteurs à établir les espèces
H. griscd, IL riridis, H. i-ubjrc. C'est à cette dernière variété
adaptée et à l'état non fixé qu'il faut attribuer l'hydre de la faune
profonde.
Les Turbellariés.
Ce groupe est représenté par un petit nombre d'espèces api)ar-
tenant aux AUoiocoeles et aux Rliabdocoeles.
PlagiosloyiKi Leutani G. du Plessis (1).
Rencontré une seule fois par 30 mètres de fond.
Mcsostoma rostratiun Ehr.
Sur le limon })ar 35 mètres.
M. riridiihon M. Sch. = Tupldophnia riridis ( ). Schm.
Vortea;trunccdu!i Ehr.
Ces deux espèces par 30 mètres de fond.
Les Cestodes.
Dn peut considérer comme faisant i)artie de la faune profonde,
à, l'état de parasites chez des i)oissons (pu descendent très bas à
certains moments de l'année.
Dihoihyiiîin Vnjnhi Donad. ^= Liynhi sii//j)Iicis.sijji/( Aucl.
(1) Gkaff, « Note sur la position systèinaticuic «lu Vofti-x Lennaii à\\ Ples-
sis », Matériaux pour Vliisluire du Léman, XXXVI, [). 2VA.
— 2G7 —
Parasite de la Perche, du Gardon, du Chovainc. Chez ce der-
nier, elle envahit la cavité générale d'une façon extraordinaire,
à tel point que l'animal en est très dilaté.
Je n'ai jamais constaté Botryocephalus latas Br. dans
aucun des poissons que j'ai pu disséquer. Ce Cestode paraît
donc manquer dans le lac.
Les Nematodes.
Gordhis aquaficns L.
Se rencontre en indi^•idus assez courts (4 centim.) dans le
limon par 35 mètres.
Dorijlaimus stagiialis Duj.
Mei^mis aquatilis Duj
.
Parasite dans les larves de Tant/pus, vit également dans le
limon, à l'état libre, par 30 mètres de fond.
Les Oligochoetes
Les Choetopodes d'eau profonde sont i-eprésentés seulement
par deux espèces.
Tubifeo! rivulorum Lam., (lui vit aussi bien dans la région
littorale.
Embolocephalus reJutinns H. Randolph = Sœnaris rchi-
tina Grub. Piguet (1) p. 74. Brktsciier (2) p. 500.
Ce beau ver est très rare. Je l'ai recueilli une seule fois dans le
limon de fond par 40 mètres.
Les Bryozoaires
Deux espèces existent seulement dans le lac, l'iuie exclusive-
ment littorale Plumatella repens L., qui applique étroitement
ses colonies sur les pierres, l'autre formant un zoarium libre ([ui
ne se trouve que sur le limon de fond.
Fi-edericella Duplessii F.-A. Forel. Le zoarium est ramifié
en corne de cerf, à branches irrégulières, d'une couleur brune;
les zoecies sont disposées du même côté des rameaux.
(1) E. Piguet, « Note sur la répartition do quelques vers oligochœtes »,
Bull, de la Soc. vaud., vol. XXXV, n" 131.
(2) Bretscher, «Die Oligochœten von Ziiricli », /îfr«e suisse de Zool.,
t. III, fasc. 4, 1896.
— 268 —
Ce Bryozoairo est toujours libre dans le limon sur lequel il est
susceptible de se déplacer. 11 ressemble énormément à celui
qu'AsPER (1) a découvert dans le lac de SilvajJana, en Engadine.
— FoRKL, qui a le j^remier signalé cette Frédericelle dans le
lac d'Annecy, tient sa congénère du Léman i)our une modifica-
tion adaptée à la région profonde de la Fredcricclla snltana
van Bened., du littoral. Ce qui (3st vrai pour le Léman ne l'est.
l)as pour le lac d'Annecy, où nous ne connaissons pas d'autre
espèce littorale que P. l'epens.
Les Rotateurs
Une seule espèce de ce groupe appartient à la faune profonde.
Floscularia probosculea Ehr. Weber, loc. cit. 277, pi. 10,
f. 10 et IL Trouvé pour la première fois par Imhof fixé sur une
branche de Frédericelle, ce Rotateur est entouré d'un tube très
transi)arent et mesure 127 u. de long. Je ne l'ai rencontré que
dans cet habitat.
Les Mollusques
Parmi les Pulmonés, un seul se rencontre sur le limon par
48 mètres de fond.
Lymnoea abyssicola L. Brot. Brot (2), p. 109.
Cette coquille transparente et d'un blanc laiteux n'est proba-
blement qu'une variété adaptée à la région profonde de L. auri-
cularia fréquente sur le littoral. En tout cas, dans ce nouveau
milieu cette Lymnée a diminué de taille et ses tours sont moins
nombreux. Sur le fond par 40 mètres et trouvé aussi dans
l'estomac d'un Corégone.
Pisidium amnicum Millier. C'est l'espèce du littoral, mais
beaucoup plus petite. Il est probable que ce mollusque a été
entraîné dans la profondeur où il trouve des conditions de vie
analogues, et si la taille a diminué, c'est que le limon est évi-
demment plus ])auvre en matières nutritives, d'où l'arrêt de
dévelopi)ement qui en est la conséquence. — Trouvé dans l'esto-
mac d'un Corégone l = 2'»/'" h = 1"V™G.
(1) AsPER, « BeitrJlge zur Kenntniss der Tiefsecfauna der Schweizer Seen ».
Zool. Anz., III,tB80, n' 54, p. 206.
(2) L. Brot, « Matériaux ^wur l'histoire du Léman », XV, n" 109.
— 269
Valvata piscinalis 0. F. Mûllei* var. ohtusa Draj). Rencon-
trée une fois dans l'estomac d'un Corégone.
Les Ostracodes
Deux espèces sont spéciales à la l'aune profonde. Elles ram[)ent
sur le limon où elles ])euvent s'enfoncer au moyen de leurs
antennes en laissant le trou d'entrée visible derrière elles.
Candona liicens Baird = C. candida Lillj. = C. lucens
similis. Forel Cet ostracode d'une couleur nacrée / = P'/'^S se
trouve sur le limon [)ai' 30 mètres.
Acanthopiis proxim . clongatus H. Vernet Vernet (1).
Je dois dire que c'est avec un point de doute que je signale
cette espèce dont je n'ai rencontré qu'un seul exemplaire en très
mauvais état. La coquille étant vide ne permettait pas d'arriver
à une détermination rigoureuse ])ar l'examen des organes
internes. Celle-ci est jaunâtre, transjnirente sur les bords qui
sont garnis d'une frange de petits cils au milieu de laquelle
partent des poils assez longs. Vue de dos, la coquille offre une
écliancrure au milieu des valves qui baillent en avant et en
arrière.
La présence dans le lac d'A. elongatus serait intéressante,
car cette esjjèce d'affinités marines, décrite jmr Vernet dans le
Léman, n'a encore été signalée qu'en peu de points. Notre Ac.
ditière cependant du ty[)e par la réticulation assez nette du
champ de la coquille et se rapprocherait de Limnicythere reti-
cidata Scharpe (2) découvert dans l'Illinois.
Les Cladocères
Les animaux de ce groupe sont surtout adaptés à la vie péla-
gique. Quelques-uns s'égarent cependant dans la région pro-
fonde. C'est de là que la drague ramène avec le limon de toute
la plaine centrale.
Alona affînis Leydig. = Lyiiccus quadrangularis Nor-
man et Brady.
(1) H. Vernet, « Acanthopus, un genre nouveau d'Ostracodcs ». Bull, de
la Soc. i^atid. des Se. nat., vol. XV, 80, p. 506.
(2) Scharpe, « Contrib"" to a knowledge of the N. Americ. fresh wat. Ostra-
coda ». Bull. Illinois State Lahor., vol. IV, p. 423, pi. XXXIX, f. 2,
— 270
'eNoti'e espèce correspond bien à la, (lesci'ii)ti()n et à la figui
données par Stingelin, loc. cit., p. 244, f. 33, avec cette diffé-
rence au point de vue de l'ornementation de la coquille que celle de
la forme d'eau profonde, est complètement lisse, /= 770 y, tandis
que notre espèce pélagi(|ue est beauc()U[) jjIiis petite, 229 p, mais
conforme au type.
Sujwcephfflns vetulns 0. F. Millier. Sur le limon par
30 mètres.
Les Calanides
On ne rencontre dans ce groupe aucun Diaptomus, mais seule-
ment Canthocamptus staphyliniis Jurine. assez fréquent sur
le limon à toutes profondeurs
.
Les Amphipodes
Des deux Gammarus ipii sont nettement littoraux, un seul
habite parfois sur le limon de fond.
Gammarus Delebccquei Chevreux et de Guerne (1), fut
recueilli par Delebecque au cours de ses sondages du Boubioz, en
février 1891. C'est une espèce ubiquiste qui vit aussi bien sur le
littoral que sur le limon de fond, où ce])endant il est moins fré-
quent.
Les Isopodes
Ase/lus Foi'cU H. Blanc (2). Cet Isoi)ode péché pour la pre-
mière fois dans le lac par Forel, est extrêmement rare. Il est
d'un gris plus foncé que le type du Léman, sa taille est également
plus réduite, 4™/'". Il est aveugle ou du moins ne possède que des
taches pigmentaires rudimentaires. Blanc en fait une espèce
voisine d'yi. fY/r«'//«'C?f.ç Schrodte, Aselle des cavernes, aveugle
et incolore. Notre espèce, privée d'yeux, ne peut être le résultat
d'un fait d'adaptation à un milieu privé de lumière, ce qui n'est
pas le cas pour le lac d'Annecy, où il n'existe pas d'obscurité
absolue dans les profondeurs. Ce ne peut être un produit de
transformation d'A. aquaficns, ([i\\ n'existe pas dans notre lac.
Il est plus vraisemblable de su})i)Oser (pie A. Foi'cli est une
forme échap]x'^e de quel<pie caverne souterraine (M1 communica-
tion avec les eaux du lac.
(1) Chevreux et de Guern'k, Comptes roidus de VAc. des Se, 30 mai 1892.
(2) H. Blanc, Malèriau.r jyoxr Vliistoire du Léiiia>i, L, pi. Xll.
— 271 —
Les Tardigrades.
TTn seul est eomniuii au littoral et à la rauiie profoiKle : Mihie-
shi/^/=Arcliscnj/ ((Dul/gradum Schrank, qui habite aussi bien
les buissons de Mvi'ioj)hvlles et l(>s gazons de Cliara, que le limon
de fond, où il est cejjendant beaucoup ])lus rare.
Les Hydrachnides.
Trois espèces sont caractéristiques du limon de fond : Hygro-
bates longipalpis Kœnick = Campognatha Foreli Leb.
AtaX' crassipes }^h\W'\\ Espèce })ourtant excellente nageuse,
que l'on rencontre sur le littoral, mais qui s'égare aussi dans la
profondeur.
Lcbertla insigiita^owm-An, Neuman (1), p. 09, T.VIII,fi'. 4,
foruie répondant parfaitement à la description de l'espèce scan-
diuave qui n'a pas été encore rencontrée, dans le Léman ni les
autres lacs suisses.
Les Insectes.
Ce groupe est représenté par des larves de Diptères très fré-
quentes dans le limon à toutes les profondeurs.
C]iiro)iO)nns plnmosus L.
Corethra pjhti/NCO)')tis Fabr.
Trnn/pus (Meig.) Sp.
En résumé si on ('"tablit une statistique de la faune et de la
flore profondes, on constate qut^ les plantes sont représentées par
31 espèces, tandis (pie l'on compte 44 espèces d'animaux, et cette
liste est naturellement loin d'être complète.
En ce qui concerne ces derniers on a vu que les R]iizo})odes
sont dominants et sont des formes exclusives de la ])rofondein\
La densité de la population, sur cette plaine du lac uniforme et
soumise à des variations climatériques nulles, est relativement
faible.
Certaines espèces y sont jjIus abondantes que les autres : Cam-pognathn, Tiihifcr, T)o}'gIaim}is, Mermis et les larves de
( It'n'oiiointis et de ('orctliva, mais on les trouve également dans
la réuion littorale.
(1) Neuman, « Oin Sveriges hydraclinider », Konijl. Urensha i-eteiiskaps-
Aka/;e))uens Hcindlinyar, Bd. 17, n° 3.
— 272 —
Au point de vue des caractères biologiques, la pigmentation
est plus marquée que dans les formes littorales et à part les
grandes Cyphoderia et Actinophrys, la taille est généralement
l)lus faible.
Est-ce une faune autocliLone ou bien une faune littorale
adaptée? La réponse à cette question est difficile... Doit-on y voir
une faune émigrée? Dans le cha[)itre relatif aux origines de nos
espèces lacustres, nous verrons ce que nous devons en jjenser.
Si une affirmation troj) précise n'était pas jjrématurée, il
semble que, à part certains animaux tels que Plagiosloma,
Accudhopus, Frederïcella, il faut considérer la population
delà région profonde comme composée d'espèces littorales accom-
modées à ce milieu, qui non seulement y vivent, mais encore s'y
re})roduisent, témoin les œufs d'insectes, de vers, d'iiydrach-
nides, et toutes les formes larvaires que? la drague ramène presque
chaque fois.
Un autre groupe d'animaux fréquente temporairement les eaux
profondes : certains poissons. On connaît, en efïét, les migrations
hivernales des Cy])rinoides qui quittent les eaux refroidies de la
beine pour descendre vers le « bleu ». L'eau étant plus transpa-
rente à cette époque de l'année, ils peuvent plus facilement
trouver dans cette région leur nourriture com})Osée des petits
animaux qui fuient la beine devenue pres(|ue désertique en raison
de l'ar'rêt de la végétation.
La microfaune normale des profondeurs n'est pas influencée
par les variations climatériques; elle est d'ailleurs toujours aussi
abondante en hiver qu'en été.
C'est ainsi que les bandes de Lottes viennent y j^oursuivre le
frai des Corégones ; les Perches descendent également en eau
profonde pendant l'hiver; la Truite émigré en tout temps pen-
dant le jour dans les profondeurs pour revenir se nourrir de nuit
sur la beine; l'Omble Chevalier se tient toute l'année dans les
régions de profondeur moyenne ; de même que les Corégones
qui viennent frayer en hiver sur les premières pentes du" mont ". Ceux-ci deviennent ])élagiques pendant la nuit, car ils
chassent à ce moment en plein lac dans les couches superfi-
cielles. Enfin, les Gardons, Blageons, Chevaines se retirent en
bandes nombreuses pendant l'hiver dans la région de profondeur
moyenne pour revenir frayer en beine lors du renouveau de la
végétation.
273
IV
RECHERCHES PLANCTONIQUES
A. — Variations annuelles et décennale du Plancton
Pour étudier le plancton, j'ai eu recours d'aljord aux pêches
horizontales en ce qui concerne sa distribution et surtout aux
péclies verticales pour les évaluations quantitatives. Ces der-
nières ont toujours été effectuées, pour donner plus d'uniformité
aux résultats, depuis la profondeur de 20 mètres en remontant
le filet jusqu'à la surface. L'expérience m'ajant appris (|ue les
pêches effectuées au delà de 30 mètres ne donnent (pie des quan-
tités négligeables d'organismes.
Mes recherches ont été poursuivies régulièrement pendant
onze années de 1805 à 1005;j'ai effectué une pèche par mois en
notant exactement les tem])ératures de l'air et l'eau, la transpa-
rence et l'état du temps.
Pour obtenir plus de i-igueur dans le dosage du plancton le
filet était descendu en un même point dix fois de suite après
avoir, à chaque remontée, recueilli soigneusement hi cajjture. Il
eût été, en effet, difficile dans un seul trait de filet, d'évaluer une
quantité de matériel très faible.
La quantité brute de plancton inscrite dans les tableaux suivants
est donc calculée en prenant le dixième de la totalité prise dans les
dix coups de filet.
L'éprouvette de mesure était un tube divisé en dixièmes de
centimètres cubes. Le tassement du plancton pouvait être
considéré comme complet au bout de vingt-quatre heures, mais
je le laissais reposer pendant quatre jours pour diminuer les
chances d'erreur.
Il était facile de ramener par le calcul la quantité obtenue en
cm^ à l'unité de surface Im^ et d'évaluer ainsi la quantité de i)lanc-
ton contenue dans le cylindre d'eau avant 1 m- de section qui a
été filtré par la remontée du filet dei)nis la })rofondeur de 20 mètres.
Mon filet ayant 0'"22 de diamètre : sa surface est de SSO'^^^h.
Pour obtenir la quantité de plancton recueillie par la filtration
d'une colonne d'eau de 20 mètres de liauteur et de 1 m- de base, il
suffit de multiplier la dose brute de plancton par le facteur 26.31.
285
/>. — La transparence
On ;i \u ({lie dans une colonne des tablcïaux pivcùclonls, la
Li'anspai'(Mi('o é\ aliK'C i)ai' la limite de visibilité d'un corps éclairé
descendu dans la profondeur (par le disque de Secclii) avait été
soigneusement notée au cours de chacune des pèches mensuelles.
Il y a, en effet, une relation très nette entre cette propriété de
l'eau et les variations du plancton. L'opacité ou la transparence
sont dues à la plus ou moins grande abondance des minuscules
éléments en sus})ension dans le liquide et sont fonction de la vie
animale ou végétale et de la multiplicité des organismes.
Tableau de la transparence observée de 1895 à 1905
MOIS
— 286 —
Lapins fort(3 limilo do visibilité constatée est do 11 "UO en
lovri(;r 1898, la plus faible de ;i'"5 on mai 1902 (1). On voit par
comparaison, à la lecture des tableaux annuels, que le 22 fé-
vrier 1898 la quantité de plancton par mètre carré est très
faible = 0.792 cm^ et que le 17 mai 1902 le maximum annuel
est atteint avec 7.656 cm^.
La transparence est plus grande en hiver qu'en été. La moyennedéduite de la période décennale est de 8"'7() d'octobre à mars et
de 5^98 d'avril à septembre.
L'écart des limites de visibilité entre les périodes froide et
chaude de l'année est moins considérable dans le lac d'Annecy
que dans le Léman où Forel a trouvé (2) comme moyenne,
d'octobre à avril, r2'"5 et de mai à septembre 7'"3.
Les maxima du printemps et du commencement de l'automne
sont dus au développement des organismes qui se multiplient à
ces époques de l'année. L'abondance du plancton et la transpa-
rence varient en raison inverse. (V. graphique.)
(1) DELEKErQUE {Les Lacs français, p. 176) a constaté qu'au milieu du GrandLac la transparence variait^ entre le niininiuni de G'.SO (10 mai 1890) et le
maximum de 13 mètres (14 février 1894): en outre iju'en deux jours, à la fin
de juin 1890, elle toml)ait de G^SO à 2'"50 à lu suite do pluies torrentielles.
(2) FoREL, Le Léman, t. II, p. 421.
— 2^7 —
COURBES RÉCAPITULATIVES
de la variation quantitative du Plancton et de la transparence
Les quantités totalisées par mois pondant onze, années consé-
cutives donnent le schéma général de l'allure des variations
planctoniques de 1895 à 1905 :
'
Janvier féuier Mars %fll Mai Join Juillef Aoû» Sapfamb. Octobra llo»emti. Oécamb.
1.193 1.320 1.6(53 4.078 7. 500 7.424 4.106 2.349 1.954 2.790 2.354 1.701
— 288 -
V
BIOLOGIE DU PLANCTON
A. — Variations diurnes et nocturnes du Plancton
En ce qui concerne les variations diurnes et nocturnes duplancton, je n'ai à fournir que trois observations : l'une allant
de 8 h. du matin à 9 h. du soir, les deux autres allant de 8 h. dumatin jusqu'à la nuit (9 h. du soir), pour être reprises à 4 li. dumatin. A ce dernier moment la partie explorée du lac, entre
Annecy et Chavoire, n'était pas encore atteinte par les rayons dusoleil levant.
La pèche a été effectuée en tirant le filet horizontalement, pen-
dant dix minutes, à la surface et à 20 mètres de profondeur.
2 juillet 1897. — Petite brise et beau soleil, température de
l'eau : 21°; le temps se couvre à partir de 9 h. du soir.
à 20 mètres cm^ 5Surface 8 h. M.
— 290 —
La courb(^. <1(? suri'ac(^ indique une diminution pendant la
pluie, à 10 11. du matin, puis une augmentation continue, mais
extrêmement faible, jusqu'à 9 heures du soir. La courbe de ])ro-
fondeur maiv]uc un léger acci'oissement continu.
11 juillet 1900. — Temps très beau, ciel clair, le soleil se
couvre légèrement à midi. Pendant la nuit, beau clair de lune.
Sui'face 8 h. M.
- 291 —
/)'. — Distribution spécifique du plancton
Sans vouloir préciser d'une façon rigoureuse, ce qui d'ailleurs
serait illusoire, le mode de distribution d'éléments essentielle-
ment mobiles et soumis à l'actioa d'agents complexes, on peut
établir cependant dans ses grandes lignes la répartition des orga-
nismes qui composent le plancton.
Pendant le jour, à partir du rivage sur toute la beine, les
premiers coups de filet ramènent des Copépodes et des Cala-
nides dominants à la surface et mêlés à une faible quantité de
Cladocères. En profondeur de 5 à 20 mètres, on trouve, très
rares, Cladocères et Copcp)odes.
A mesure qu'on s'avance vers le large, les Cladocères dimi-
nuent et on n'en trouve presque ])lus dans une zone où abondent
les Péridiniens {Ceratium, Dinobryon) et les Diatomées péla-
giques {Asteriouella, Cyclotella, Frarj'daria).
Le plancton se raréfie; les Rotateurs, êtres pélagiques par
excellence, deviennent dominants, et plus au large il y a abon-
dance de Botryococcus et iïAnabœna, se cantonnant à une
faible distance au-dessous de la surface. La faculté hjdrosta-
ti(pie de ces Algues les maintient exactement à la surface dans
une eau absolument calme, mais elle est entravée par la plus
faible agitation des eaux. Il en est de même des Pliéopliycées, ce
qui fait que si l'on veut recueillir tlu pliytoplancton, il est néces-
saire de traîner le filet à la profondeur optima de 50 centi-
mètres. Ces algues sont très abondantes pendant le jour.
A la fin de la journée, près du rivage, la distribution des orga-
nismes change. Les Cladocères deviennent dominants; les
Copépodes, mêles à quelques Rotateurs, sont plus disséminés.
Pendant la période d'obscurité, à partir de 9 lieures du soir,
le plancton augmente. Les Coptpodes diminuent et ce sont les
Cladocères qui montent à la surface, mêlés aux Leptodora
,
qui apparaissent seulement à ce moment. Je n'ai jamais ren-
contré ces dernières pendant le jour.
Les Copépodes et Calanides sont mêlés à une quantité
innombrable de larves de Crustacés à divers stades de dévelop-
pement. Les Asterionella, F7rigilaria,Ceratm)n, Dinobryondominent. Botryococcus et Anabœna sont rares. J'ai constaté.
292
(le mémo que Blanc (1) pour le Léman, une oxtr;ioi'dinaii'<i
multiplication de ces organismes qui se développent pendant la
nuit. Il faut donc attribuer, avec l'juiteur précité, l'augmentation
du plancton superficiel, à ce moment, à ce fait ({ue les Ceratium
se multiplient avec intensité pendant la nuit, en même temps
que les Nauplius se transforment en Copépodes.
Avant le lever du soleil, à 4 heures du matin, les Copépodes
et Calanides redeviennent dominants à la surface.
G. — Résultats des recherches planctoniques
De l'examen des tableaux précédents, on peut déduire un
certain nombre de faits bien établis.
La quantité de plancton varie dans le cours d'une mémo année.
Il existe deux maxima très inégaux (|ui s'introduisent dans
les limites d'avril à juin pour le })lus fort et de novembre à
décembre pour le plus faible.
Le graphique récapitulatif des onze anuf^es montre le premier
maximum en mai, le deuxième en octobre.
Toutes choses égales d'ailleurs le développement du })lancton
marclie avec le réchauffement progressif de l'isiu jusfpi'à une
certaine limite, tandis (ju'en deçà de la limite inférieure atteinte
par le décroissement automnal de la température, la multiplica-
tion des organismi's semble être moins active.
L'épo(pie des maxima pour cliaque année peut se déplacer.
Variations des maxima
— 293 —
La quantité de plancton varie d'une année à l'autre et on voit
qu'au total il y a eu, par exemple, deux fois })lus de plancton en
1895 qu'en 1898.
Si l'on examine le tableau de l'année 1898, on constate (pie la
température de l'eau a été moins élevée presque pour cliaipie mois
que dans les autres années, que les jours d'exjjérience ont été
pluvieux ou neigeux. Il y a donc une relation (''vidente entre la
température et l'abondance du i)Iancton.
La comparaison des moyennes donne ])0ur le plancton un
minimum de l''"^390 pendant les mois d'hiver et un maximum d(^
g.m3354 pondant ceux du printemps. Cette (piantité est beaucoup
plus faible que dans le* Léman pour les mois coi'i'esi)ondants.
Les maxima corresijondcnt à la ])rolifération de certaines
espèces, par exemple:
Le 25 juin 1895, le chiftre s'est élevé à 10,560, à cause de l'abon-
dance de Cyclops slrennus; le 15 juillet 1890, la quantité de
plancton (4,221) est due à la multiplication (extraordinaire des
Cei'cUium; le 15 avril 1900, le chiffre s'élève à 3,432, à cause du
pullulement des Botryococciis ; le 18 janvier 1904, c'est la
quantité prodigieuse de Dinobrijons qui relève anormalement
l(î chiffre du dosage à 2,112.
Le plancton n'est pas uniformément réparti à toutes les profon-
deurs. Abondants à la sui'face, les organismes se raréfient à
mesure que la profondeur augmente, et à partir de 30 ou ;i5 m.
les quantités ramenées par le filet sont inappréciables.
Le plancton est plus abondant par temps couvert au large et
il est en plus grande quantité à la surface; au-dessus d'une faible
couche d'eau qu'au large.
Près du bord, la densité des organismes est forte pendant
les mois de mars et d'avril ; elle diminue en été. Toutefois,
à cette dernière période le plancton est toujours massé en plus
grande quantité près du rivage, tandis qu'il est raréfié au large.
Ces derniers résultats concordent avec ceux de Pittard(I), mais
sont en désaccord avec les faits établis pai* Blanc (2) pour les
lacs suisses.
Les organismes sont inégalement répartis dans les couches
(1) E. PiTTARD, «Sur le plancton des lacs de Joiix ». At-cli. des se. phys. et
nat. de Génère, 4e pér., 111, 1897.
(2) H. Blanc, «Distribution horizontale et verticale du l'Iancton». Areli.
(les se. pJiys. et nul. de Genève, nov. 1895, p. -IGO.
— 294 —
superficielles. Ils peuvent s'accumuler en certains endroits et
former des essaims très localisés : •• Chemins d'animaux de Graetf-r
.
Je n'ai pu, jusipi'à présent, déterminer les causes de ce phénomène.Enfin le plancton est soumis à des migrations verticales assez
nettes. — Lorsque le soleil brille ou par un beau clair de lune, la
quantité diminue; elle augmente d'autre part pendant les nuits
obscures. Le gros plancton : Leptodorcs, grands Cladocères,
DaphueUa, est à peu près absent de la sui-face pendant le jour;
il remonte des profondeurs pendant la période d'obscurité.
Incertitude des observations planctoniques.
En résumé, dans l'i'tat actuel de nos connaissances, il règne
encore beaucoup d'obscurité sur les causes (jui produisent les
irrégularités considérables constatées dans les allures des orga-
nismes flottants.
Après des recherches poursuivies pendant une longue ])ériode,
je n'arrive à enregistrer qu'un certain nombi'e de conclusions
sans pouvoir expli(]uer les pliénomènes observés.
Les faits sont en eux-mêmes parfois très déconcertants.
Les difiérences morphologiques saisonnières, la ])ériodicité des
espèces sont des résultats bien établis, mais les variations quan-
titatives du plancton présentent de tels écarts qu'il est difficile
d'en déduire des lois.
En somme, les conditions d'apparition et de développement des
organismes sont soumises à des facteurs d'essences très difiei'en-
tes, biologiques ou physiques, dont les effets se combinent et se
pénètrent à l'infini et ces variations sont fonction d'éléments et
d'énergies que nous ne savons jusqu'à présent déterminer.
Je ne pourrai qu'adopter la conclusion qu'un certain nombrede limnologues ont énoncée à la suite de leurs tra^'aux.
Les études planctoniques,— et j'ajouterai par expérience mêmepoursuivies sans intei'ruption pendant une série d'années — sont
un peu illusoires et jusqu'à ce jour ont été assez infructueuses. Il
faut trouver une autre voie dans ce champ d'expériences, afin
d'éviter les déboires et les mécomptes dans lesquels les procéd(''s
exclusifs de la mensuration du planôton nous ont entraînés.
• Nos notions actuelles, a dit Yung (1), sur les variations sai-
(1) E. YuNd, « Vai'intions ([uaiilitalivcs tlii planctDii dans le lac Lùiiinn ».
Arcli. des sr. })Iiijs. et nat. de Geiiève, If) auùt 1U02, ]). 130.
— 29b —
sonnières du plancton reposent sur des reclierches fragmentaires
s'étendant soit à un certain nombre de mois de l'année, soit à une
année entière, mais jamais à une série d'années. La liàte que l'on
mot généralement à publier des résultats incomplets obtenus par
des méthodes difterentes encombre la littérature ])lanctoni(|ue de
documents sans portée. Il est inutile de continuer à se faire des
illusions à cet égard. «
Je crois avoir répondu au désir exprimé ]jar le naturaliste
genevois en poursuivant mes observations pendant une })ériode
plus que décennale. Le> résultats obtenus n'ont pas été propor-
tionnés à l'efibrt et j'en arrive à être convaincu qu'en ce qui
concerne les lois déterminantes des variations du plancton, il est
impossible, à l'heure actuelle, de démêler un fil conducteur ({ui
permette de les dégager de l'ensemble complexe des influences
physico-chimiques ou climatiques auxquelles sont soumis les
organismes. — Je me suis borné à enregistrer des faits. Peut-
être l'espoir subsiste-t-il que de la multiplicité des observations
et de la coordination des matériaux accumulés sortira un joui-
une explication satisfaisante de ces phénomènes très attachants
de biologie générale qui, jusipi'à i)résent, n'ont pas laissé péné-
trer leur secret.
I). — Eléments de la variation des espèces
La température
La température a une certaine intluence sur la variation
morphologique ou la pi'Tiodicité de certains végétaux ainsi que
sur l'époque de leur multiplication ou de leur diminution.
Cerathmi cornutum par exemple apparaît en hiver.
Ce Péridinien est, par contre, extrêmement rare pendant les
mois chauds de l'année. — Cette forme a-t-elle une véritable
valeur spécifique ou bien n'est-elle que la physionomie dimor-
phique d'une espèce modifiée par l'action d'un facteur
thermique !*
C. Cornutum montre un corps trapu, ramassé, nuuii de coui'ts
prolongements et offre une surface plus réduite que C. Jiirun-
dineîhf, dont les cornes longues et très déliées favorisent la
flottaison en multipliant la surface dans un milieu d'une densité
moindre, puisque ce dernier otîre son maxnnum en été.
— 296 —
C. Cornutum up])arait donc naturellement pendant l'hiver avec
des pj'0})riétés hydrostatiques adéquates à un milieu plus froid
et plus dense et n'ayant pas besoin de dévelo^jper une grande
surface. Il disj)arait ou regagne les profondeurs pendant les
mois d'été.
Pour C. Jiir-iiiidiiicUd , la forme à deux cornes ])arallèles
courtes et épaisses'est probablement une variété saisonnière du
type, car je l'ai toujours rencontrée pendant les mois de janvier,
février et mars.
Une adaptation analogue se constate chez certaines Diatomées
l)élagiques. AstcricmeUn gracUluna est ])lus grêle en été
qu'en hiver, pas d'une façon absolue, mais c'est un fait général
-(fig. 6-3). Sa forme se rapi)roche de celle d'A. (ji-adJUma var.
gracilior Cliodat, du Léman (1).
La longueur de ses frustules est de 80 à 90 u; ceux-ci
s'organisent en étoiles dont les rayons sont en nombre supé-
rieur à 8 (mai à juillet).
Depuis la fin d'octobre et pendant les mois d'iiiver, la longueur
des rayons est moindre; elle ne dépasse pas (38 [j- et leur épais-
seur est sensiblement plus considérable (fig. 6-1).
C'est pendant la saison froide que l'on rencontre plus spécia-
lement la dis[)Osition sjjiralée (fig. 6-2) ou du moins l'accolement
plus serré des frustules se groupant suivant une surface
gauche (2). Voilà encore un fait d'adaptation à un milieu plus
froid et plus dense.
On ne renwmtre i)as dans le lac d'Annecy Tahelhn-ia fenes-
ii-ata dans la disposition très régulièrement étoilée (ju'elle
prend au lac de Zuricli (3), mais nos Tabellaires ont cependant
en hiver une tendance à organiser leurs frustules en rayons par
3 ou 4 (fig. 6-4-5) donnant ainsi une forme pseudo-asterionel-
loïde.
h]n été, à cause de la plus faible densité de l'eau, ces
Diatomées pélagiques se disposent en chaînes plus ou moins
sinueuses.
(1) Chodat, Eludes de hioJofjie lacustre, p. 22.
(2) L'existence (runc Asterionelle de taille très réduite, rencontrée par
PiTTARu dans les eaux très froides du Daubensee, à 2,174 ni. d'altitude, vient
encore confirmer ce fait de la variation individuelle de cette Diatoniée
pélagique en fonction de la teinjiérature du milieu où elle vit.
(3) C. ScHROETER, Die Sclnoeheflora ut^serer Seen, taf. 1, fig. 34.
297
Les CycloteUcs organisent leurs colonies en bandes très
longues, sortes de chajx'lets incdus dans une gelée qui est émi-
nemment favorable à leur tlottabilité.
Dans un lae tle tvpe tempéré comme celui d'Annecy, où la
Fig. (). —Variations saisonnières d'Astorionella gracilUma, fig. 1, forme
d'hiver, long, des ray. = 6i ;j ; lig. 2, forme spiralée; fig. 3, forme d'été
(forma gracilior Chodat) long, des ray. = 89 [j. — Fig. 4 et 5, Tabidlaria
fenestrata montrant la tendance à l'arrangement asterionelloide pendant
l'hiver.
température de l'eau ne descend jamais bien bas, ces Diatomées
n'éprouvent pas le besoin de condenser leurs bandes en spirales
surbaissées comme les individus du lac de Zoug.
Les colonies de Fragilaria crotoiiensis semblent, pour la
même raison, formées d'un nombre beaucoup plus considérable
d'individus pendant l'été.
19
298 —
Aptitude à la flottaison
Les Tahdhiria sont admirablement adaptés à la flottaison, à
cause de la plus grande surface (qu'elles peuvent développer par
la disposition de leurs frustules et aussi à la faveur des petits
coussinets de gelée hyaline qui séparent ces derniers. On
retrouve le même processus chez T. pocculow.
Les Chlorophycées nettement i)élagiques : Rpluerocustis,
Ooci/stis, etc. , sont incluses dans une enveloppe hyaline, sorti; de
gelée qui augmente le volume de l'algue et la rend plus apte à la
vie flottante.
Il faut également citer pour mémoire, les flocons de Conjuguées
filamenteuses dont la faculté hydrostatique est favorisée par
l'émission des bulles gazeuses résultant de l'activité biologique
de ces i)lantes, ainsi que les plaques d'Oscillaires arrach(''es au
fond et ({ui montent à la surface en raison de la production de
nombreuses bulles d'oxygène.
Les Anabœna sont criblées de vacuoles où se développe un
gaz que Ciiodat a reconnu comme étant une aminé (1).
Ce dernier auteur a démontré que les vacuoles {\!OsclUalu)-}((
rttbescens contiennent le même gaz (2). Ce sont des conditions
éminemment propres à la flottaison.
Les Botryoccoccus sécrètent ime huile qui inqjrègne tout le
réseau de la colonie. " C'est le seul exemple, dit CiioDAT(AK*.r/7.),
d'une Algue flottant j^ai' ce procédé et s'organisant une demeuiv
aux dé])ens d'une huile. "
Rôle de la lumière. Moyens de défense contre l'insolation
Si l'énergie solaire est nécessaire à la vie des })lanles, les
r<'c]iorches de WiESNER (3) ont montré que les végétaux n'uti-
lisent qu'une certaine partie de la lumière qu'ils reçoivent, soil
parla disposition particulière des organes, soit par leur ombre
portée.
(1) Chodat, « Flore pélagique superficielle des lacs suisses et français ».
Bull, (le Vherhier Boissier, t. V, n^ 5, p. 311.
(2) Chodat, « Structui'e et biologie de deux algues pélagiques ». Journal
(le Botanique, 18ÎK).
(3) Wiksneïï; « Die liLdiotropischea Krschcinungen im Pflaiizenreicli ».
Akad. d. Wiss. eu U'ien, t. XXXIX, II. T.
— 299 —
Il est coi'Lain que les algues vertes ne se trouveraient pas bien
d'une trop forte insolation et ce fait est surtout très net chez
quelques-uns de ces organismes habitués à la vie pélagique,
c'est-à-dire vivant dans une région superficielle où aucune
fraction de la lumière incidente n'est perdue.
Chodat (1) avait déjà fait remarquer que l'huile rouge sécrétée
})ar Botr-yococcus Braimi n'était pas seulement destinée à
faciliter la flottaison de ces algues ; cette production concourt
surtout, en tant qu'écran coloré, à protéger le végétal contre
l'action trop violente de la, lumière.
L'expérience m'a prouvé cette assertion, car j'ai pu obtenir
des colonies rouges en maintenant des Botrjococcus verts dans
un bocal exposé au soleil pendant tout un mois de juillet.
J'ai d'ailleurs toujours noté exactement l'apparition des
Botrjococcus colorés et mes observations confirment les faits
établis par le professeur genevois.
Dans l'été-, au lac d'Annecy, les colonies sont rouges numéri-
quement dans la pi-oportion de un tiers. La production du
pigment a donc lieu à l'époque où la température de l'eau est
très élevée et où l'insolation est la plus forte, deux facteurs qui
agissent dans le même sens.
En hiver et au printemps, les Botryococcus colorés apparaissent
dans les journées très claires et ajjrès une période de temps très
découverts ou de beau soleil hivernal; les colonies rouges et
vertes sont alors en quantité égale.
Amberg (2) a fait connaître que dans le lac de Muzzano, qui
s'échauffe fortement en hiver, on ne rencontre que des Botrjo-
coccus rouges. Il en est de même pour le Katzensee.
Il y a évidemment une relation entre l'élévation de tempéra-
ture et la foi'te insolation, qui agissent dans le même sens (comme
c'est le cas pour le lac d'Annecj), de manière à provoquer une
réaction de l'organisme en vue de développer des mojens de
protection.
Les Pliœophjcées (Ceratium) sont douées d'une grande faci-
lité de flottaison, à cause de la présence dans ces organismes de
(1) Chodat, V. dans « Ilech. sur la flore superficielle » {Bull, de Vlierbier
Boissier, t. V, n° 5, p. 58) la théoi'ie de cette action physico-chiaiique.
(2) Amuerg, Beitràge z. biol. des Katzensees, 1900, p. 45.
— « Bioloy. notiz. iib. den Layo di Muz/.ano ». Forscli. ans
d. biol. Station ou Pion. Bd X, 1903.
— 300 —
globules incolores de nature graisseuse. Bergii avait admis une
telle composition pour d'énigmatiques taches l'ouges ({ui a})pa-
raissent à certaines époques de l'année, ainsi que je l'ai constaté
maintes fois en été (fig. 4-1, 2, 32).
L'apparition de cette tache rouge, précisément dans les mois
où l'insolation est la plus forte, permet de supi)Oser qu'elle joue,
comme chez Bolrvococcus, peut-être pour une faible part, le rôle
d'un écran protecteur.
E. — Périodicité. Variations saisonnières
Lorsqu'on examine comparativement les captures faites au filet
fin aux différentes époques de l'année, on constate qu'à côté
d'espèces permanentes qui figurent en plus ou moins grande
abondance et en tout temps dans le plancton, certaines formes
animales ou végétales temporaires apparaissent, deviennent
progressivement ou parfois brusijuement Oominantes pour dis-
paraître ensuite ou ne laisser subsister que ipielques individus
dissé?m?iés.
Il y a donc là des sociétés animales ou des groupes d'associa-
tions végétales qui déterminent des physionomies saisonnières.
L'allure de la périodicité est particulièrement intéressante à
noter pour le lac d'Annecy, où les recherches ont été poursui-
^ies pendant une longue période.
En ce qui concerne les végétaux, on remarque d'abord que le
Pliytoplancton est plus riche en hiver qu'en été.
Anahœna cïrcinaJis présente son maximum de développe-
ment en février et mars.
Oscillatoria rubescens est abondant en hiver et au com-
mencement du printemps.
Ceratium hirundinetta présente tout son développement en
juin et juillet, avec \\n deuxième maximum en octobre. Parmi
les variations individuelles de cet organisme, le type à deux
cornes parallèles se rencontre principalement en février et mars.
C. cotmutum est une forme exclusivement hivernale.
Les Dinobrjjons abondent en juin et juillet. Je n'ai constaté
({u'une fois le fait anormal de leui- extrême nmltiplicalion en
janvier.
— 301 —
Po'idiniiuji t(ibalatit))i se rcnconti'o (l('j)uis mai jusqu'au
commencement de l'automne.
Glenodinliun pusilliim de juin à fin juillet.
Asterionella gracilUma est abondante en avril et mai. Elle
diminue en été.
CycIotcUa comta présente deux maxima : l'un en février et
mars, l'autre en novembre et décembre.
Tabellaria fenestrata est abondante en février et mars.
Synedra deHcatlsshna est pérennante, mais parait plus fré-
quente à la fin de l'automne.
Botri/ococcus Brauni est pérennant, mais surtout al)ondant
en mars et aM'il, avec un nouveau maximum en octobre.
Sphœi'ocjjsiis Schrœteri parait depuis mai jusqu'à la fin de
l'automne, toujours disséminée. Cette algue devient rare en
hiver.
Pediastr-uin Boi'ijcuiiun est pérennant, mais semble être
plus abondant en automne.
Quant aux Conjuguées filamenteuses, errati(|ues pour la })lu-
[)art dans le plancton, leur maximum se place depuis a^ril et mai
jusqu'en automne.
En particulier, Mongeotia gracUluna se rencontre en tout
temps dans les pèches pélagi(pies.
F. — Les associations végétales saisonnières
Il existe des espèces saisonnières appai'aissant sous rinfluenc(>
de conditions climati(jues ou physico-chimiques encore indéter-
minées, qui constituent des associations comjjosées de formes se
groupant pour donner en quelque sorte un faciès teynporaire et
variable à la végétation flottante. Certains types sont en
nombre restreint, dissémiités ; d'autres sont dominants. Ceux-
ci impriment au passage végétal une caractéristique analogue à
celle que l'on a décrit sous le terme de Groupes d'associa-
tions (Flahaut) ou dans le cas liRvticiûier A'Associations planc-
ton iqnes. On pourrait interpréter ici avec Pavillard (1) le
Phyto})lancton comme un •• ensemble, nuancé dans sa physiono-
mie par l'intervention de quelques éléments secondaires, décom-
(1) J. Pavillard, Recherches sur la flore jyélagicjue de Véta7ig de ThauMontpellier, 1905, p. 97.
— 302 —
posé ainsi en so?is-fo7V)?ations chronologiquement encliainéos
dans un ordre plus ou moins régulier suivant le cours des temps
et le caprice des évolutions individuelles «
.
Il y a donc lion de considérer en faisant cadrer nos grandies
formations saisonnières avec les sous-formations précédentes :
1° Phytoplancton d'hiver (novembre, décembre, janvier,
février, mars) caractérisé par les Diatomées dominantes : Fragi-
laria crotonensis, Cyclotella comta, Tahellaria fenestrata,
Asterionella gracillima (forme moins grêle à rayons plus
courts; des Péridiniens : Ceratimn comutuïn eX des Schizo-
pliycées dominantes : Anabœ}ia circincdis, Oscillatoria ru-
bescens. (Sous-formation : Diatomo-Schizophycaie).
2° Phytoplancton de printemps (avril, mai, juin) caractéris('
par la multiplication de CercUiumhiru.n(UrieUa, AsterioneUa
^rrtci//ima dominants ; l'apparition des Dinobryons et de i?o-
tryococcus Brauni; la diminution des Diatomées. (Sous-forma-
tion : Ceratio-Asterionellaie.)
3° Phytoplancton d'été (juin, juillet, août) caractérisé par
les Péridiniens dominants : Peridinimn tahulatnm, Gleno-
dinium pusilhun, Dinohryon divergens, D. cylindriciun,
D. stipilahmi; Conjuguées filamenteuses et Chlorophycées géli-
fiées : Sphœrocysfis et Oocysfis disséminées. (Sous-formation :
Peridino-Ciilorophycaie.)
40 Phytoplancton d'automne (septembre, octobre) caracté-
risé par Pediastriim Borya}ium dominant, diminution des
Péridiniens et la réap})ai'ition des Diatomées pélagiques (Cyclo-
tel/a) qui commencent à redevenir dominantes. (Sous-forma-
tion : Pediastro-Cyclotellaie.)
G. — Périodicité du Zooplancton
Les Héliozoaires se rencontrent toute l'année, toujours peu
nombreux dans le Plancton.
Les Infusoires semblent présenter un uiaximum d(.' dévelo})-
pement à la fin de l'automne et en hi^•er, à cause de l'abondance
excessive des Diatomées dont ces petits êtres font leur nour-
riture.
Les Rotateurs existent en toute saison, mais sont plus fré-
quents à certaines périodes de l'année.
Triarthra longiseia est abondant en hiver. Il atteint son
— .••!03 —
maximum en févri(îi' et mars, dcAieiil, très rai'c en (''(/', poui*
i"ei)ai'ai(.i'e en octobre.
Poluarllira platijptcvd^ est relativement rare. On le ren-
contre très disséminé d'octobre à mars.
NotJiolca longispiiia présente un maximum en mars-avril.
Anurœa cochlenris parait depuis avril jusqu'en juillet.
Asplanchna priodonta est fréquent de décembre à mars. 11
devient rare en été.
Les Entomostracés, qui forment le plancton de grande taille,
existent pendant toute l'année, mais en quantités variables et
présentant des variations sensibles.
Cyclops sti'OiuHS offre son maximum au printemps ; il
diminue en automne.
C. abi/sso}'HtJi est une forme d'hiver.
Sida crlstaUina existe en tout temps, mais toujours en petite
quantité; elle semble plus fréquente en novembre et décembre.
Daphnella Brandtiana est une forme d'hiver, tandis que
D. brachyura existe en toute saison.
Bosinina longispina se rencontre toute l'année, mais elle
semble présenter un maximum du printemps à l'été.
Dfiphnia Jo)Ujisphia var. hycdina est très polymorphe.
Dans sa forme tyi)e, elle est plus fréquente au printemps et
en été. Ses ixtru'fés ))iorphologiques existent surtout à la iin
de l'hiver.
Bosmina loii<jirosf)'is est plus rare et parait de novembre à
janvier.
Pleu7^oxus eœcisus et PI. hastatus sont frécpients au prin-
temps.
Chydoras sphœricus se trouve en hiver, mais toujours à
l'état disséminé.
Parmi les Calanides, Dlaptoymis gracilis et D. laciniatus
existent toute l'année, mais le premier semble être beaucoup plus
abondant de janvier à mars, tandis que le second offre son maxi-
mum au printem})s (avril, mai).
En ce qui concerne le zoopiancton, on peut en défînitiAC déli-
miter les groupements saisonniers suivants :
1" Plancton d'hiver : Triarthra longiscfa, Poîyarthra
platyptera, Aspjlanchtia pji'iodonta, Cyclops abyssormn,
Daphnella Brandtiana, les variétés de Dapjhnia hyalina.
— 304 —
Bosmina lot/gh^ostris, (liydorus sphœricus, Dlaptomusgracilis.
2P Plancton de printemps : Nothoica Joitglsp'ma, Amirœacochlem^is, Bos77iina longispma, Plem^oxus excisus, PI.
hastatus, Diapiotnus laciniatus.
3" Plancton d'été : Anurœa cochlearis, Cyclops stre-
nuus, Diapto'inus laciniatus.
4° Plancton d'automne : Infusoires et à peu près toutes les
formes précédentes très disséminées.
:-i05 —
VI
lJ L I B R a R y
LES ASSOCIATIONS LITTORALES
LES MACROPHYTES
Quelques notes sommaires d'iierborisations représentent toutes
les contributions apportées depuis une cinquantaine d'années à la
flore des environs d'Annecy, mais les plantes du littoral du lac
ou les vraies Limnoplivtes n'ont fait l'objet d'aucun travail.
Parmi ces dernières, quelques espèces seulement sont citées
éparses parmi les listes floristiques (1) (2).
On ne trouve naturellement dans ces articles aucune indication
sur le groupement des plantes, la raison de leur habitat et
l'influence des stations sur les associations végétales. Pugetseul montre une certaine préoccupation autre que celle d'établir
une liste aride et non métliodique des plantes qu'il rencontre en
donnant le conseil aux géographes botanistes de s'attacher à la
•• topographie et à la géologie des espèces «
.
Les rapports de la vie végétale avec les conditions fondamen-
tales du milieu et du sol sont cependant des plus intenses et ce
n'est que depuis les travaux de HmiBOLDï (1807), Meyen (1836),
DE Candolle (1855), Ctrisebach (1877), Warming (1895), Drude(1897), ScHiMPER (1898), que la géobotanique s'est rapidement
développée. En Suisse, Briquet, Chodaï; en France, Flahautont donné une vigoureuse impulsion à cet ordre de recherches
et c'est à ce dernier que l'on doit d'avoir, par un essai de nomen-
clature phjtogéographique, apporté une lumineuse clarté dans
l'emploi des termes, engagés jusqu'à ce jour dans une syno-
nymie confuse.
Ce sont ces principes qui ont été suivis au cours de ce travail,
soit en faisant cadrer la terminologie avec celle employée par
(1) Puget, « Botanique des environs d'Annecy ». Bull, de VAssociation f.oi i-
inontane. 18.55; Id., « Plantes des environs d'Annecy ». 1856, p. 46.
(2) « C. R. de la session extraordinaire de la Société botanique de France
à Annecy ». £tdl. de la Soc. bot. de France. 1866.
— snC) —
S(;iiK()TKK cl. IvrKciiNKR (1), soit en conservant les divisions ('(a-
blies par AlA(_iNiiN (2) dans ses publications limnologiques.
Le terme zone a été en ])articiilier introduit dans la nomen-clature par Magnin, qui on fait usage pour la d('limitation des
espèces végétales en profondeur (zone des Chara, zone des Pota-
raots). Cette désignation S(3ra maintenue en ne l'admettant que
})0ur décrire la région où la plante croit de préférence (X unité
fopographique),nmh en spécifiant bien que telle espèce peut être
remplacée dans sa zone habituelle par telle autre. Par exemple,
les Chara, <|ui croissent sur le talus de la beine jusqu'à une assez
grande pi'ofondeur, peuvent envahir cette dernière et former des
gazons littoraux sous une très faibh? couche d'eau ; il en est de
même des Potamots et des Myriophjlles, qui, quittant leur zone
bathymétrique, peuvent venir végéter tout près du bord.
La nomenclature relative aux unités biologiques se réduit à la
notion des Associations végétales ou Gî^oupes d'associations
(Flahaut) (3), Formation (Grisebacii et Schimper).
La végétation des eaux, celle des marais, celle de la prairie
constituent un type de végétation : faciès du paysage en rela-
tion étroite avec le milieu et dépendant des conditions physiques
de la station. Ce type de végétation est caractéi-isé par une asso-
ciation ou des groupes d'associations (l'imité biologique).
Prenons, par exemple, le marais. On y verra des individus
d'une seule espèce groui)és, les Roseaux, qui se développent en
fourré compact pour constituer un association, une formation :
la Phragmitaik.
Que les Joncs viennent à pénétrei' les Roseaux en laissant à
l'une ou l'autre des espèces la place prépondérante, nous aurons
ainsi un groupement de deux sociétés, l'association des Roseaux
et des Joncs : la Phragmito-Scirpaie. Maintenant que, parmi
l'espèce dominante des Roseaux viennent par ilôts s'installer les
Massettes, que, d'autre part, dans l'intervalle laissé libre entre
les tiges aériennes de ces plantes, s'étalent à la surface les Nénu-
pliai's, un autre groupe plus complexe d'associations se sera
établi, imprimant une physionomie particulière à la station et
constituant ainsi le type de végétation du marécage.
(1) ScHROTER und KiRCHNER, Die Vegelalio)i des Bodensees. Lindau, 1896.
(2) A, Magnin, La végétation des lacs du Jura. 1904.
(.3) Flahaut,^«TEssai de nomenclature. jjhytnjiVDgrapliique ». Bull, fie la
Soc. languedocienne de géographie. 1901.
— 307 —
On aura ainsi dôterminé dans leurs grandes lignes divers
groupes d'associations : la Ciiaraie, caractérisée par les Cliara;
la PoTAMAiE, par les Potamots, les Myriopliylles, les Naiades ;
la Phracimiïaie, par les Roseaux; la Scirpaie, i)ar les Jones; la
Caricaie, groupement très complexe d'associations où dominent
les grands Carex déterminant une Magno-Caricaie, autour des-
quels viennent se ranger de nombreuses espèces constituant le
type de végétation de la prairie humide : les groupes d'associa-
tions de Ir Molinicf cœyu.Iea, du SchoenifS nigricans et du
Juncus ohtusifforns.
Il est im})ortant de noter que ces groupes d'associations
peuvent être remplacés dans leur zone par des associations
)'eprésenfafires (espèces prenant la place de l'espèce type de
la formation), par exemple h Typhaie pénétrant la Phragmi-
taie, à l'exclusion des Phragmites, I'Equisetaie ou I'Heleocha-
RAiE remplaçant les Scir])es, la Molinaie ou la Bryophytaie
pouvant se substituer à la Caricaie, représentée seulement par la
Saulaie ou I'Aulnaie (1).
A. — Les zones de végétation
Les associations qui déterminent la })liysionomie végt'tale du
lac d'Annecy et de ses bords sont disposées en général avec une
certaine régularité. Elles enserrent le littoral de plusieurs cein-
tures dont la continuité n'est pas absolue et qui se pénètrent par-
fois les unes les autres en s'invertissant très rarement. Mais il
existe une condition fondamentale qui détermine le groupement
de ces sociétés, c'est l'élément station dépendant du substratum
et de la profondeur de l'eau.
Cette répartition est bien caractérisée pour le lac d'Annecy,
qui rentre dans le type des lacs véritables, c'est-à-dire d'une
étendue et d'une profondeur suffisantes pour que l'action des
vagues ait pu déterminer une plate-forme littorale ou beine (2).
La beine est principalement bien développée au Nord, à l'Ouest
et au Sud faisant suite à la plaine basse d'Albigny, aux maré-
cages entre Sevrier et Saint-Jorioz (pi. III-2 et pi. IV-1), à la
(1) C'est au moyen de tous ces termes, dus à Magnin, que les associations
seront désignées.
(2) F.-A. FoREL, Le Léman.
— 308 —
partie alluvionnaire conihlée pai' les aliiuents du lac, l'Ire et
l'Eau morte.
Il est à noter de suite (jue si l'on compare le lilloral d"AlI)ignv
et celui du Bout du Lac, la beine d'amont est plus riche en asso-
ciations végétales quc^ la beine d'aval, à cause du voisinag(^ des
affluents et peut-être aussi parce que les eaux n'y ont pas encore
subi de décalcification.
La Caricaie.
La premièi'e de ces zones qui appartient au rivage et s'étend
sur la grève émergée et les bords marécageux, est intermédiaire
entre les domaines terrestre et lacustre.
Les conditions de milieu v sont très variables. Cette région peut
être alternativement émergée aux basses eaux ou inondée pendant
les crues. Là, s'organisent les associations de Laiclies : la Cari-
caie, formation assez complexe des terrains littoraux où lés espèces
palustres plongent leurs racines dans un sol constamment humide.
Les espèces dominantes de grands Carex, justifiant l'appellation
de Magno-Caricaie (Magnin) pour cette association, sont repré-
sentées par Carex strictaet C. paludosa. Ce dernier, moins
fréquent, croit en individus formant des gazons serrés sur le
terrain déjà gagné sur l'eau et qui a acquis une certaine stabilité.
C. stricta se présente sous forme de larges touftés isolées, épaisses
et robustes, déterminant une zone littorale ou coi'don plus ou moins
développé (pi. VI-1).
Cette espèce, aux racines et rhizomes enchevéti-és, consolide
le terrain pour y préparer la venue de sociétés qui, telles que
Molinia cœralea, se grou])ent en une Molinaie qui joue un rôle
actif dans la constitution du marais à graminées et de la prairie
humide qui se relie à la Strictaie littorale.
La prairie humide est l'habitat des Aulnes {AIuks iitcana
A. glutinoHci) et des Saules {Salix aîba, S.piirpurea, S. cine-
rea, S. incana formant l'association Alno-Salicaie pi'enanl
place dans la Caricaie ou s'y substituant.
Dans la Caricaie sont disséminés ou associés les éléments
suivants: Stach>/s i^aluMi^is, Alisma plaiitago, Pediciihiris
pfdustris, Scifccio pr/IffdosKS, PohjfjnniDri rmiphiblun} var.
ier-)'estre, S/jargani/u/f ramosHni, Carex para, C. Daixi-
liana, C. hhia, C. )nax'iyna, C. disticha, C. stricta, C. palu-
dosa.
— 309 —
Les espèces végétales qui habitent la prairie liumide sont :
Caltha [jalustris, Thalictriun ffavuni, Œiianthe Lacheua-lii, Spirœa ulmarin, EiJipactis palusfris, Scahiosa siiccisa,
Lysbnachia mdgcu-is, Cirsintjt pcdustre, Anyelica s;/Jves-
tris, Lythriun salicaria, Gal'nmi palustre, Hi/pericimi
tetrapterum, Scutellaria galericulata, Mentha aquatlca,
Sc7'ophularia nodosa, Juncus ohtusiffo7'us, J. coïKjlomera-
tus, J. effusus, J.glcmcus, J.bufonms, Scirpiis compjressxs.
Quelques plantes montagnardes, adaptées à cette basse alti-
tude, s'y reproduisent exceptionnellement par individus isolés.
Ce sont: Tofieldia ccdycidata, Soyeria palu.dosa, Spyirœa
arunciis, Alnus viridis, Phyteuma oj'biculao'e, Ph. spica-
fum, Gymnadenia odoratissima, (kimpjanida rhomboi-dalis, Asfrnnfia maj07', Rmnrncîdîis panvmnhi , Orchis
simia (1).
La Bryophytaie.
Dans la Caricaie s'associent fré([uemment deux mousses,
Hypnuin cuspidatum et Climaciiun dendroides, mais dans
la zone littorale, alternativement émergée et submergée, dans les
endroits où les enrochements, les éboulis ou les murs de soutè-
nement des quais empêchent l'extension de la Caricaie, se développe
un autre groupe d'associations : la Bryophytaie. Parmi ces
mousses, les unes s'accommodent indifféremment de la sécheresse
ou de l'humidité. Orthotrichum saxatile Brid. Hypmumeiiryngium. Sch., espèce rare dont les touttes brun jaunâtre sont
associées aux feuilles vertes de Bcwbida vinealis Brid., nus.-
quelles se mêlent également les touffes brunes de Barbidarecurvifolia Sch.= B. refiexa Lind., aussi associée à Euryn-chium ctYùSsinervum Tii\\.; Barbida miiralis Tim.; Brymnargenteitm L. ; Grimmia pidv'mata, Sch. ; G. apocarpaHedw. Les autres, franchement hydrophiles, laissent flotter leurs
touttes lâches au-dessous de la surface de l'eau, s'accrochent aux
cailloux submergés, ou tapissent les cavités ombreuses creusées
dans le Roc de Chère, Fissidens crassipes, Cindidotus foidi-
naloides, P. B. Amhlystegium riparium, Br = Hypn. y-
distichum. BouL; Fanaria hygrometrica ; Mniajn undu-latum Neck.
(1) Ces huit dernières espèces m'ont été obligeaninient signalées par M. G.
Beauverd, conservateur de l'Herbier Boissier.
— 310 —
Les groupes d'associations suivantes, représentés par des plan-
tes amphibies ondes limnophvtes exclusifs, rentrent entièrement
dans le domaine lacustre. C'est d'abord la puissante formation
de la Roselière {Rohrsûmpfe de Warming) qui comprend les
sociétés de Scirpes et de Phragmites.
C'est à cet horizon batliymétrique que se développe ce tyne de
végétation particulier des microplijtes, constructeurs des tufs
lacustres résultant de l'intense décalcification des eaux produite
par l'activité biologiijue de certaines algues Schizopliycées, ainsi
(jue nous le verrons dans un chapitre suivant (pi. III-2).
La Scirpaie
L'association de Sci.rpus lacnstris, le Jonc des chaisiers, se
constitue en zone plus ou moins discontinue qui est pres(|ue tou-
jours présente le long du littoral. Elle s'étend jusqu'à la profon-
deur de r"50 au maximum et est habitée par des plantes aux
rhizomes traçants qui s'enracinent au fond de l'eau, mais déve-
loppent à l'air libre leurs tiges et leurs fleurs. La Scirpaie, nette-
ment individualisée au lac d'Annecy, est plus ou moins développée
ou réduite et ne manque, pour ainsi dire, (|ue dans les endi'oits où
la côte s'abaisse trop rapidement ou plonge à pic sous les eaux.
Elle est, dans la règle, bordée au large par la ceinture des
Roseaux.
La Scirpaie p(ait être envaliie par des associations représenta-
tives de plantes telles que Tjjjjha, Equisetum, Heleochco-is,
rarement Lemna, qui constituent ainsi une Typhaie, une
Equisetaie, une Heleocharaie, une Lemnaie. On y rencontre
donc les espèces suivantes : Typlia UUifoIia, Equisetum limo-
siun, Heleocharis palustris, Balclingera arundinacea
,
Iris pseudo acoi'us , Leinna ininor , Spcu'gcDihnii rainosuiii,
S. siynplex, Hippuris rulgaris, Menyanthes trifoliida,
Trapa natans, Roripa mnpjhibia.
La Phragmitaie
Voici, maintenant, la i)lus importante association de la Rose-
lière qui occupe des étendues considérables au nord, à l'ouest
et au sud du lac, en raison du grand développement de la beine
dans ces régions.
Les sociétés de Roseaux Phrayinltes cidyaris (Arundu
— 311 —
phragmiles L.) se multiplient en l'ouiTésdans une zone qui ne
dépasse pas la profondeui' de 3 mètres. Cette espèce, dont les
individus'atteignent parfois la liauteur de quatre mètres, possède
la propriété d'assécher le sol qu'elle occupe en le recouvrant de
ses débris et en le transformant peu à peu en prairie mai'éca-
geuse. Les Roseaux subsistent encore en groupes disséminés sur
le sol con({uis (pi. VI-2), et leurs tiges brisées apportées au bord
par les vagues contribuent aussi (pi. III-2) à la formation d'un
cordon littoral de matières organiques décomjjosées qui servira
de substratum à l'établissement du la Strictaie. Cette formation
couvre la Beine proprement dite, sur laquelle elle s'étale pai'fois
sur une largeur de 400 mètres.
C'est sur les Roseaux que s'organisent d'autres associations
littorales micropli}ti(|ues formant un enduit glaireux recouvrant
leurs tiges au-dessous du niveau de l'eau. On retrouve égale-
ment sur les Joncs ce même enduit brunâtre dont il sera (piestion
plus loin.
La Plu'agmitaie est souvent envahie, dans les anses abritées
où l'eau est tranquille, par certaines associai ions. Ainsi se con-
stituent une NuPHARAiE(pl.V-l), une PoLYiioNAiE où se groupent
les espèces : Xupluir hiteum, Nymjiliœa (dhn , Rdinniculiis
diraricafas, R. ti-ichophyUiis, Ilijjp/uis rul(j(u'i.s,G^!/ceria
aquatica, Utricnlur'ui l'ulgaris, Poli/goiuon (unphih'nnn
variété un(ans.
La Potamaie
La région lacustre proprement dite ou zone des eaux pro-
fondes est habitée par des })lantes essentiellement limnophjtes
{Limnées de Warming). Quelques-unes élèvent leiu's tiges
feuillé<;s et leurs fleurs jus(|u'à la surface de l'eau et constituent
les groupes d'associations des Potamogeton et des Myriophjlles.
C'est la PoTAiNiAiE ou SuBMERSiPOTAMAiE (Magnin). Elle s'étcnd
dans sa situation normale de 4 à 5 mètres de profondeur sur la
])eine, mais peut aussi se rapprocher du rivage dans les endroits
où la profondeur s'affirme rapidement, près des estacades des
embarcadères où l'agitation de l'eau causée par le mouvementdes bateaux à vapeur contribue à une aéi'ation intense. Commeassociation représentative, on trouve sou\ent dans cette zone la
Naiadaie.
Les espèces liabituclles de la Potamaie sont :
PoUdttoyelon pcffuliiifiis^i' groupant qui'l(|urf()is uettenit'ut
— 312 —
à l'exclusion des autres espèces pour former une Perfoliati
POTAMAIE (Magnin), P. crispus, P. lucois, P. nitens, P. pec-
tinatus, P. piisillus, Myriophylliiin spicatum, M. verticil-
latum, Ceratopjhyllum demet'sum, Naias major, Ranuncu-/i(s divaricr/fus, R. frichophyllus, FontinaliH antipjyretica.
La Charaie
La. végétation des i)lantes phanérogames est cantonnée au
rivage et sur la beine. Mais sur celle-ci, même tout près des
bords et descendant sur le talus de la beine jus(|u'à la profondeur
de 8 mètres, s'installent les associations des Cliara en gazons
courts et denses. Au delà de cette limite batlivmétrique s'ar-
rêtent les macropliytes et la vie végétale n'est plus représentée
sur le limon de fond (pie par des micropliytes. Les limites de
la Charaie sont, d'autre part, très extensibles, car ces plantes
s'accommodent fort bien du peu de profondeur des eaux. On les
voit, en eftét, en compagnie des Mjriophylles envahir toute la
beine nord et couvrir de leur tapis, au-dessus duquel s'in-
clinent dans le sens du courant les longues tiges des Potamots,
les émissaires du lac : le Thioux et le Vassé.
On y trouve associés : (ïkara fœtida (mêlés aux rares Nitella
f.exilis), Ch. aspjera Wild var. curta, Ch. ceratophylla, très
abondant, Ch. gymnophylla Braun, dans la forme paragym-nophylla Unger, par laquelle elle se rattache à Ch. fœtida
(feuilles cortiquées ça et là sur leur premier entre-nœud).
B. — Biologie de quelques limnophytes
Nous avons noté ({ue les Joncs (Scirpus lacustris) peuplent
la région du lac comprise entre les Roseaux {Phragniites vul-
ga?'is) du large et la grève rocailleuse. Ils pénètrent parfois ces
derniers en déterminant ainsi un groupe d'associations, la
Ph}'ag)uitoScirpaie. Ce n'est qu'à tilrede disposition toutà fait
anormale, en regard de ce qui se passe pour les autres lacs, que
dans celui d'Annecy la Scirpaie peut se développer en dehors
des Roseaux vers le large (1). J'ai longtemps clierché la raison
(1) Cette inversion a été signalée par Magnin (loc. cit.) comme fait excej)-
tionnel, aux lacTdu Bourget et (rAiguelielelte, ainsi que clans quelques lacs
du Jura.
— 313 —
de cette curieuse inversion et ce n'est qu'à la suite de la longue
période de sécheresse de l'été et de l'automne 1906, où le niveau
du lac a baissé de plus d'un mètre, laissant à découvert de vastes
étendues de beine (100 métros en face de Saint-Jorioz), que j'ai pu
Fig. 7. — lUologie des Joncs. Rhizomes de Scivpus lacustris, R. Racines.
A droite, Se. lacustris, variété volubiie.
me rendre compte des conditions biologiques qui influent sur la.
localisation de ces associations (pi. IV-1).
Sur le sol desséché, encombré de cailloux, serpentait le lacis
20
— 314 —
noir des rliizomos des joncs, sigillés do nombreuses cicatrices
l)rovenant des anciennes tiges brisées et présentant vers l'extré-
mité vivante un faisceau de deux ou trois tiges, tandis que le bout
du rhizome se rele^'ait en un bourgeon terminal (1) (pi V-2).
Partout où le sol, soit par le fait de l'érosion qui déblaye les
rives, soit par suite de l'établissement d'un cône de déjection
torrentiel à gros éléments, est formé d'un cailloutis mélangé de
sable et de dépôts détritiques, les Scirpes s'installent à l'exclu-
sion des Phragmites. Ces derniers, au contraire, semblent
trouver leur optimum végétatif sur les beines i)lus ou moins
développées où le sol est limoneux et extrêmement meuble.
L'examen comparé de la structure des racines de ces deux
plantes donne l'explication des préférences écologiques de
celles-ci.
Considérons le rhizome des Joncs ; il est formé de sortes de
longs câbles noueux, souvent anastomosés, de couleur noire,
hérissés de toutes parts de rcwines relativement courtes,
épaisses, robustes, munies de radicelles pe?t nombreuses
(flg- ^)-
Tout autre est l'aspect d'mi pied de Roseaux fraichement
extirpé. D'un rhizome de couleur blanche, de consistance
faible, muni à l'extrémité d'un bourgeon terminal à écailles,
minces et soiq)les,se détachent des faisceaux de tiges se ramifiant
par le développement de bourgeons basilaires. Des entre-nœuds
part un chevelu de racines munies de radicules secon-
daires ténues, fieœibles, formant dans l'ensemble des
touffes très lâches s'échajrpant latéralement du rhizome.
(flg. 8).
Or, les bords du lac sont en général garnis d'un talus d'eboulis
caillouteux. C'est là que se groupent les Scirpes dont les racines
courtes et robustes s'introduisent dans les interstices des pieri'es
y trouvant, par adaptation morphologique, des conditions bio-
logiques excellentes.
Plus au large, les cailloux n'existent plus; les matériaux
d'alluvion des torrents, superposés par ordre de densité décrois-
(1) Il est a remarquer que les bourgeons des Scirpes et des Phragmites qui
se développent normalement l'année suivante, montraient, ainsi que les
jeunes tiges de l'année, une Ibliaison nouvelle d'un vert tendi'e, le 8 octo-
bre 1906, conséquence de ce lait que ces organes avaient été exondés pendant
longtemps.
— 315 -
santé à partir du i'i\ago, no sont })lus com})Osés (juo de fins
limons. C'est im sol des plus favorables pour la végétation des
Roseaux, (|ue les racines minces et flexibles pénètrent facilement
et qui sont adaptées à la nature meuble du substratum.
Fig. 8. — Biologie des Roseaux. P\\ihomes de Phragmitesvnlffaris.
R. = chevelu des racines.
Dans les fourrés de Scirpes,on rencontre parfois des individus
déformés d'une façon curieuse. Cette anomalie consiste cliez
certains de ces Joncs en une torsion spiralée de la tige résultant
d'une inégalité de croissance des faisceaux. Les })la,ntes attectées
de cette déformation végètent toujoui's près du l)ord et ce cas
— 316
tératologiriiie ost dû ])robabloment aux périodes alternantes de
séclieresse et d'immersion auxquelles sont soumises les tiges
dans cette région (fig. 7).
La biologie de Polygonum amphibiiun offre un fait paiii-
Jicre et feuilLes sur uii-
j'hi^ome de vAr. n^itAnsa.u3Lnl prti ui forme terrestnl
A là suite dune émersioncfi lonsut durée.
V'vji. '.I. - l!i()loi;i(; de Poluffonum ainphibium. Adaptation d'iiiin forme
submergée au milieu aérien.
— H17 —
culièi'cnitMil intéressant. Près du [)Oi't de la. Tour, en un point ou
l'association de P. amphibiiun var. natftns est i'ei)résentatif
de la Potamaie, je trouvais en octobre 100(3, à la suite d<^ la
longue sécheresse de l'été, un certain nombre de tiges s'écliap-
pant de rhizomes sur lesquels j'avais recueilli, les années précé-
dentes, P.amphib. var. ncdoMS type, dont les feuilles flottaient
à la surface par 1 mètre de profondeur (pi. II),
De ces rhizomes émergés poussaient des rameaux dont les
feuilles reproduisaient (ainsi que le montre la fîg. 9) sensible-
ment la forme terrestre caractérisée par le long pétiole, la
pubescence et les gaines ciliées.
Il y a donc lieu de remarquer ici un phénomène remarquable
d'adaption au milieu aérien d'une plante habituellement sub-
mergée, et une variation morphologique très nette, marquéepar le retour d'un type à feuilles nageantes à la forme terrestre,
à la suite d'une émersion prolongée.
C'est dans la région de la beine nord que l'on peut surtout se
rendre compte de la marche de la végétation des limnophytes.
L'arrêt de la vie végétale est complet en hiver, et il est marquéen outre par la mort de beaucoup de plantes lacustres, tandis que
chez certaines autres les rhizomes vont reprendre au printemps
une nouvelle vigueur pour développer les jeunes tiges. En hiver,
on n'aperçoit sur la beine que les teintes neutres ou rouillées des
fourrés de Roseaux ;la ceinture littorale des Joncs a disparu,
car les vagues ont brisé toutes les tiges au niveau de la surface,
saules les feuilles radicales en longues lanières de ces dernières
plantes végètent en rosettes sur le sol. Quelques buissons de
Potamogetoii pectinatus restent vivaces, tandis que les
gazons vert sombre des Charas couvrent le fond de leur morneta})is pendant toute l'année.
" A la fin du printemps, le développement de la végétation
lacustre est très rapide. On a pu constater récemment, après les
travaux de curage des canaux (21 mai 1005) qui avaient boule-
versé les rhizomes et racines des plantes aquatiques, que huit
jours plus tard les Potamots et les Myriophylles ai)paraissaient
hâtivement et qu'à la fin de juillet tous ces végétaux étaient en
fleurs.
318 —
C. — Répartition des associations littorales
Après avoir énuméré les divers groujx'meiits biologiques (jui
caractérisent les zones de végétation du lac, il y a lieu mainte-
nant d'entrer dans le détail des stations, en indiquant la succes-
sion des associations i)articulières aux régions lacustre, stagnale
et palustre. On devra j rattacher les sociétés des espèces des
marécages et des prairies fraîches, qui ne peuvent être disjointes
des formations littorales; leurs stations sont en effet fondées sur
un substratum (pii se relie étroitement par son origine aux précé-
dentes régions, car il n'est que le résultat do l'envahissement
de la végétation consécutif à la période de comblement, le
terme ultime du cycle vital d'un lac.
Les éléments topographiques du lac d'Annecy qui déterminent
les stations sont les suivants :
1" Les bords marécageux et les larges beines : Bout du Lac,
Albigny, Sevrier-St-Jorioz-Duingt;
2" Le littoral oriental du Petit-Lac, caractérisé par une pente
caillouteuse et une beino presque nulle;
3° La rive est (pii, de Menthon, va r< 'joindre les marécages
d'Albigny;
4" La rive ouest, depuis le Beau- Rivage jus(|u'au port
d'Annecy.
Ces deux dernières régions à beine absente et à pente très
déclive.
5° La falaise abru])te du Roc de Chère, aux associations litto-
rales très réduites, avec les éléments xérothermiques des parois
méridionales.
Dîi Port du Bout du Lac à la Tour Beauvivier
(Section A-L., flg. 10) (1).
Au ponton des bateaux à vapeur, la beine est très réduite et la
profondeur tombant à cinq mètres, permet l'association d(^
(1) Il ne faut pas espérer trouver ici une liste floristiqiie comjilète. Tel n'a pas
été mon l)ut, je n'ai eu que la pensée d'esquisser à grands traits la pliysiono-
niie spéciale de Ja^végétation,en faisant ressortir le groupement principal des
associations.
— 310 —
Pot(i)nofj('ton pcrfoUcUn.s et P. lucens, ceilo dcmipri^ auxrouilles non incrustées do calcaire. Cette Perfoliati-Potainuio,
Po/. ()j)p<)si/i/"()nus, forme |6 et a, P. crisjucs, P'oîijynitifiH
amphibinriiY. nataiis, Mijriophi/Uum vcrtkùJhduiii ost])éno-
ti-ée d'une petite Nupliaraio et au Sud d'une Phragmito-Scirpaie.
Jusqu'à l'embouchure du ruisseau do Bournette s'étendent
concentriquement :
1° Une Magno-Caricaie, Carex stricta, en toufies bien déve-
loppées, piquée de quelques buissons de Salix trkindra et
offrant la végétation des prairies humides : Alis)na plantago,Festiica ariindinacea, Juncus effusus ;
2" Une Heléocliaraie (Heleocharis palustris) formant une
bande entre la zone inondée et la grève exondée périodiquement;
3° Une Scirpaie (Scirpus tacustrls) avec taches de Nijm-pliœa et disséminés : ŒnaïUhe crocata, Stachys palustj'is,
Equïsetmn arvense ;
4° Une Phragmitaie.
La série se complète ])lus loin d'une Potamaie (Pot. pecti-
tiatiis) pénétrant la Scir})aio avec associations l'oprésontatives
de Poljjgoniim auiphibium var. nataus^Raniuiculus t)-icho-
phi/llus, Hijjpuris imigaris.
Les éléments marécageux de (;ette région sont : Senccio ])alH-
dosus, Galium palustre, Spirœa ulmaria, Li/siniKchia
ndgaris, Stachi/s palustris, HeleocluD'is 'palustris, Cir-
siujii palustre, Xlisyna plantago.
A l'embouchure du ruisseau se dressent les épis violets de
Baldingera arundinacea accompagnés de Mentha aquatilis,
Ilippuris rulgaris, Ranunculus divaricatus ei R. tricho-
pliglhis.
Jusqu'à l'embouchure du ruisseau de la Nubière se dé\oloi)po
une formation marécageuse avec dominants : Tlio/i^zirt cœrulea,
Scabiosa succisa et {mrsemés : Epipjactis pialustris, Pedicu-
laris palustris, Parnassia palustris, Lotus tenuis, Roripaamphibia, qui a pour ceinture le long du littoral les associations
suivantes en série complète :
1" Saulaie {Salix alba, S. triandra) en rares buissons, et un
pied ^\'Alnus viridis ; 2" Magno caricaie; 3° Equisetaie com-
prenant l'association de Equisetuin limosum et E. variegatuni
pénétrant lesScirpes; 4° Scirpaie avec taches de Naias major ;
4" Phragmitaie; 5° Potamaie; (3° Charaie.
Dans toute la prairie humide jus(prau moulin de la Nubière
— 320 —
se dressent des Joncs (,T. obtusifolius) dominants avec
Phragmites parsemés au-dessus d'un tapis végétal com])Osé de
Ranunculus flammula, Pediculat^is pahtst?ns, ŒnantheLachenalii, Parnassia jmlustris, Senecio ixtludosits
.
Vers le bord ap])arait une zone de Molinia cœrulea suivie
d'une Caricaie pénétrée de Roseaux et réduite à 1 mètre où
végètent Salix p^irp^^rea, S. triandra, Alnus incana,
Rhamnus frangula.
Plus loin la Molinie forme une bonne moitié des associations :
Joncs dominants et Phragmites disséminés. Apparaissent par-
semés : Lotus tenuis, Œnanthe Lachenalii, Symphytumofficinale, Pedicidayns jMlustîHs.
La prairie humide passe à une véritable Molinaie avec
M. cœ?ndea et Eqnisetum limosum parsemé. Sur le bord,
dans l'eau peu profonde ajjparaissent : Myriophyllum verti-
cillatum, Potamogeton hicens, Nuphar hUeum.C'est alors que se développe une colossale association de
Phragmites hauts de 3 à 4 mètres, se serrant en une sorte de
brousse presque impénétrable qui s'étend vers l'est, jusqu'au
bord de l'Ire, en remontant jusqu'à la prairie humide qui est
bordée au sud par le cours d'eau, d'où émergent sur la lisière
quelques buissons de Saliœ alba. et (XAlnus glutinosa.
Sous le couvert de ces fourrés végètent sur le sol de plus en
plus inondé : Menyanthes trifoUata en tapis; dominants :
Juncus obtusiflorus, Molinia cœrulea, Scahiosa. succisa,
Equisetum pjalusfre; parsemés : Orchis conopea, Hype-
?Hcum tetrapterum, Parnassia jjahistris, Œnanthe Lache-
nalii, Galium tdiginosmn, Lysimachia imlgaris.
En se dirigeant vers le sud, le marais s'assèche progressive-
ment. Là se développent les groupes d'associations de Juncus
obtusiflorus et de Schœnus nigi^icans, ce dernier établi
dans les dépressions et formant dans l'ensemble de l'association
des taches brunes. Sont parsemés : Eriophorum latifolium,
Carex ffa/va, Pinguicula vulgaris, avec buissons isolés do
Salix triandra et S. purpnirea. On constate ici la présence
inattendue de Tofieldia calyculata, très abondant au milieu
des Schœnus. Cette plante montagnarde vient s'associer dans la
prairie humide avec Molinia cœridea (1). Quelques taches
(1) Cette Colcliicacée a été signalée également par Magmn dans une station
analogue (marais du Bourget).
321
DuinçU ^;F"'
""Bjilmette
Bredri/iiuiz .-.S^"--
Pig. 10. — Les associations littorales. — Le Petit Lac et les marais du Bout
du Lac. (Sections A-B, A-L, L-K du plan, voir légende tig. 12.)
— 322 —
disséminées de Ti/jiha latifolia viennent également se meiei-
avec Œnaallic LdclicnaUi.
Celte })rairie marécagense est drainée par un riiisseau ravi-
nant un cône de déjection i)lus ancien qui amène l'apparition de
Salioc incana, de Jitncus tciiageia, EquisctiDn palustre et
Aira cœspiiosa en raison du colmatage du marais par les
alluvions.
Ces alluvions se poursuivent vers l'est jusqu'au bord de l'Ire
où l'on constate l'envahissement de la végétation forestière dans
un bois d'Aulnes blancs et de Peupliers noirs, constituant l'étage
dominant. Apparaissent comme sous-bois encombré de lianes :
Ihomihis fiqndas, Loniccra peridhnenitm, Ij. .iv/Iosteum;
les espèces sylvatiques sui^'antes, abondantes : Salioc incana,
S. purpwea et parsemées : RJun/itia.s frangula. Prunusspiiwsa, Vibunium opulu.s, Ligustrum vulgare, Salix
incana.
En se rapprochant des bords du lac, la })rairie devient de plus
en plus humide avant de passer au marécage inondé. C'est une
grande Joncaie à Jiuwus obtusiflorus et Scabiosa succisa
dominants avec Lotus tennis, Galiuni uligiuosuni abondants,
Trifoliurn pi'atense, T. uioiitanum, Œnanthe LachenaUi,
Orchis co)iopea, Epipactis palusfris, parsemés.
Puis l'association de Juncus obtusi/for'ns, avec les Ph}'ag-
mites de plus en plus dominants, s'étend pour se relier à la
grande Pliragmitaie, très dense, qui, sur une largeur de près de
150 mètres, (mvaliit la beine du lac.
Sur bi rive droite de l'Ire, près de la Tour Beaiivivier, sur
chaque rive de l'Eau morte, se reproduit la même })hjsionomie
de paysage, car les mêmes groupes d'associations se continuent
avec une parfaite monotonie, pour s'éclaircir progressivement et
se raccorder aux associations littorales de la rive orientale du
Petit Lac (section L-K.).
En résumé, le champ de cette exploration, sur laquelle il est
nécessaire d'insister, offre, a\'ec une régularité que nous ne
retrouverons plus ailleurs, la série des associations types ou de
ses faciès représentatifs correspondant aux unités topogra-
plii(]ues, c'est-à-dire aux stations représentées par l'eau peu
l)rofonde, le marécage, la prairie inondée, les alluvions. Ces
différentes coîMlitions sont caractéristiques de l'une des phases
cycliques de la vie du lac correspondant au stade du marais et à
— 323 —
celui où la profondeur (1<> \\\n\ csl (Icvciuic nsscz r.-iihlc pour
permettre) le (léveloppeiueuL de la zone i)alusli'(>, où le riMigc se
fixe par l'ariivée des Laiches ci de la Molinie, et aussi celui où
la végétation sylvaticpio apparaît sur les cônes de déjection des
cours d'eau.
En schématisant les zones et les associations végétales du Bout
du Lac, on se représentera une ceinture littorale constituée par
les plantes des terrains humides qui plongent leurs racines dans
un sol constamment imprégné d'eau :
1° La Molinaie où, dans la prairie humide, Molinia can'idca
joue un certain rôle dans l'empiétement de la végétation sur l'eau
et dans certains cas arrive à constituer, d'après Sciirôter,
l'espèce définitive de la prairie. Cette association végétale est
peu développée au lac d'Annecy;
2'' La Magno-Garicaie (Magnin), représentée par les gi-andes
espèces de Carex C. Stricta et C. paludosa;
3° La Saulaie ou son association représentative l'Aulnaie,
disséminée dans la Caricaie;
4° La Scirpaie, pénétrée par les associations représentatives
Equisetaie et Heléocharaie ;
5° La Phragmitaie, souvent pénétrée par les Scirpes;
6" La Potamaie, accompagnée des associations représentatives
Nupharaie, Mjriophyllaie, Naiadaie, tandis que sur le talus du
mont de la beine s'étalent les gazons de Chara IbrmanL:
7" La Charaie.
Du Portait Bout du Lac au 'promontoire de Duingt.
(Section A-B., flg. 10.)
La côte se dirige sans articulations du sud au nord et ne pré-
sente i)artout qu'une beine excessivement réduite. On en trouve
une sensible en face du hameau de Bredannaz, à cause d'un
ancien cône do déjection. Au nord de ce point, le lac a entanK"
les alluvions fluvio-glaciaires qui s'élèvent à une assez grande
hauteur et la live est, par suite, caillouteuse et très déclive.
Les associations littorales se composent d'une zone de Carex,
Magno-Caricaie, très réduite, piquée de quelques Saules buisson-
nants : SaVix cinerea,S.alba,S.i)ur})iu'ca etd'A/;r?^s• ivicana.
Jusqu'au niveau de Bredannaz, une zone continue de Joncs
jalonne la côte, pénétrée ça et là par de rares taches de
Roseaux.
— 324 —
Au port (le Duingt, où la profondeur do l'oau augmente brus-
(|uenient,se développe une belle Perfoliati-Potamaie avec groupes
d'associations de Polygo7iUïn amphihlum var. milans et de
Nuphar luteum, tandis que le fond est tapissé des gazons noirs
de Naias major.
Une zone très clairsemée de Scirpes entoure le promontoire du
château de Duingt; on retrouve également au large une Scirpaie
très réduite autour des gros cailloux qui servent de soubassement
à la balise du haut fond du Roselet.
Du promontoire de Duingt au delta du Laudon.
(Section B-C, fig. ll-I.)
En contournant le promontoire de Duingt, on ne rencontre
qu'une Phragmitaie très lâche avec Scirpes disséminés.
La présence de trois petits ports, où la profondeur est un peu
plus grande, détermine des anses abritées où l'eau est tranquille.
Dans la première nagent les feuilles de Polygonum mnphi-
bium; dans la deuxième se groupent Typha latifolia, Alisma
plantago, Lemna w?,/nor; dans la troisième où Typha laii-
folia domine, végètent Potamogeton pecfmafas, Nuphar
luteum, Polygonum amphibium abondants, Sch-jj/ts lacus-
tris, Alisma plantago, Slachys palaslris, Glyco-ia aqua-
tica parsemés.
En dehors, les Scirpes forment une zone enveloppée elle-même
par une Phragmitaie très dense (pi. I).
A l'ouest s'étend une prairie marécageuse à Roseaux domi-
nants et à Joncs disséminés, dont les éléments caractéristiques
sont : abondants : Phagmitcs rulgaris, Caltha palnstris,
Œnanfhe Lachenalii, Spiram idmaria; parsemés : Juncus
oUusiflorus, Epipadis palustris, Lotus uligiuosns, Sca-
hiosa siœcisa, Lyshnachia mdgaris, Cirsium palu.slre,
Angelica sylvestris, Lychnis ffos cucidli, Lyfhriim sali-
caria, Soyeria paludosa (1).
Cette prairie va se raccorder à une association de Carex
stricia et Cpaludosa formant Magno-Caricaie appujée par un
(1) La présence, en cet endroit, de cette plante montagnarde estintéressante
comme exemple à rapprocher de Tofieldia, d'adaptation d'une plante à une
basse altitude.
— 325 —
cordon littoral de débris de })lantes apportées par les vagues,
au delà de laquelle Polygonum ajnphibium var. terrestre,
Equisetum limosum et Heteocharis palustris envahissent
une Typliaie entourée par une mince Scirpaie et une large
Phragmitaie (pi. III-2).
En face l'église de Duingt, un marais du même type se con-
tinue avec Phragmites dominants, pénétrant une Strictaie bordée
de Saules et d'Aulnes, reliée à une vaste Phragmito-Scirpaie.
Tout le sol de cette Roselière est littéralement jonché de
cailloux sculptés, les tiges elles-mêmes sont fortement inci'ustées
(v. fig. 13-1, cliap. suivant), et cette formation particulière va se
continuer très développée jusqu'au delà du delta du Laudon.
Dans ce marais se rencontrent })arsomés : Pedicularis
palastris Bijperlcuni tetrapteram, Scutellaria galeri-
cnlata, Equisetum pjalustre, Senecio pjaludosas.
Avant le ruisseau d'Entrevernes, la Scirpaie devient très
réduite, envahie par la Caricaie. Dans le marais et la prairie
humide (jui bordent le ruisseau s'associent aux Carex les Jititcus
oblasiffoi'us disséminés. La Caricaie est envahie par les
Phragmites.
Au delà du ruisseau, la prairie marécageuse bordée sur le
littoral par les mottes de Carex s,trlcta, se relie à une Scir})aie
et à une Phragmitaie qui très vaste s'étend fort loin sur la beine.
Les groupes d'associations qui constituaient la végétation de ce
marais sont, dominants : Juncus obtusifforus,Schœnus nigri-
caiis ; abondants : Carex ftfcva associé à des gazons de
C. Dacalliana ; parsemés : Phrag/nites rulgai'is, (Ena)ithe
LaclienaUÏ, Orchis palustris, Epj'ipactis palustris , Parnas-sia palustris, Orchis latifulia, Lgsijnachia vulgaris,
Pedicularis palustris ; ti'ès parsemés : buissons de Rharnuusfrangula.
Le cône de déjection du torrent de Bourdon interrompt brus-
quement la série des associations littorales en ne laissant sub-
sister qu'une Caricaie très réduite (pi. VL2).
Cette station offre un exemple intéressant de la prise de
possession du terrain con(juis sur le domaine du lac par la végé-
tation sylvati(jue.
1° Arbres : dominants : Alnus incana, Popmlus nigra;
abondants: Scdix <Uba; parsemés : Fraxinus excctsior,
Quercus pedunculata, Abies excelsa, Salix pnwpurea ;
— 326 —
2° Arbustes : abondants : Vibiirnum ojmlus, Coriws san-guinea, LujHstrimi ruîgarc; parsomés : Pt^unus spinosa,
Erony^nus europeus, Frangula nilgaris, Spirœa ulmaria,S. aruKCKs, Lonicera œijlostemn
;
3° Tapis herbacé : abondants : Molinia cœrulea, Brachij-
])odiutu sijlrdticum, Vinca mmor; parsemés : Euphorhiaamygdaloides, HeUehoriis fœtidus, Galium sylvaticum,
Phragmites vulgaris, Bromtis asper, Agrostis alha, Carexpaludosa.
A partir du délia du Boui'don s'étend un marais à Juncusohtusifi.or-HS dominant oX Molinia cœimlen ei Sencclo palu-dosus parsemés, ourlé sur le littoral par une Magno caricaie et
une Phragmito-Scirpaie. La Caricaie disparait pour faire place
à l'association représentative Heleocliaraie (H. palush'is), sur
laquelle s'élèvent des buissons d'Aulnes glutineux et de Saules
blancs.
La ceinture littorale s'invertit, Phragmites au bord, Scirpes
au large et passe sans transition à une prairie humide à Juncus
obtusiflorus dominants et Phragmites abondants. Toujours dans
les dépressions humides a})paraissent les taches sombres des
Schœnus nig^icans, à coté des espèces suivantes :
Abondants : Paimassia pjalustris, Potentilla tornientilla ;
parsemés : Eupatoriiim cannabinum, Spjirœa idmaria,Spi7Ytnthes œst'rralis.
Avant la Tuilerie, une Magno-Caricaie en mottes disjointes
de C. stricta envahit la Scirpaie qui est bordée vers le large
par une Phragmitaie (pi. Vl-i).
Au port de la Tuilerie végètent dans l'eau i)lus profonde les
associations de Potamogeton pectinatus et Myriophylluin
Hpicatuni, bordées en dehors par la succession normale, puis
invertie des Scirpes et des Pln-agmites.
Plus loin, la Phragmitaie pénèti'e la Caricaie très inondée où
se trouve une station riche en Utricularia culgaris.
Le marais donne asile à Orchis palustris, Lycopus enro-
pMieus, Selinum carviflora, Spiranthcs (eslivalis et la cein-
ture littorale s'api)auM'it, représentée seulement par (|tielqties
rares touffes de gi-ands Carex.
Jus(ju'à l'enTbouchure du Latidon, les associations de la Rose-
lière montrent une tendance à l'inversion, qui s'atlirmera défini-
327 —
V\g. 11.— [>es associations littorales. — I lie Duiiigt au Laiuloii (section 1!-C);
11. tlu Laiulon à Sevrier (section (>1>); Ml. La côte et la falaise du lîoc de
Chère de Meiithon à Talloires. (Sect. H-K du plan, v. fig. 1*2)
— 328 —
tivement complète au débarcadère des bateaux. Une véritable
Molinaie s'(''tablit, avec larges taches très pures de SchœmisnigiHcar/s dans la prairie humide à Juncus ohtiisifloriis
.
Les autres éléments floristiques sont : abondants : Eqn'isetum
palustre, PotentUla tomnentïUa ; i)arsemés : Lyswiachia
vulgaris, Thalictrum flavum, Epipactis palustris, 09'chis
latifoUa, Gnlium idiginosum, Œnanthe Lachenalii, avec
rares individus de Chlora perfoliata.
Dans la Caricaie à taches de Menyanthes trifoliata pénétrée
par la Phragmitaie avec Scirpes au large, en face le hameau de
Sales s'étend une prairie marécageuse avec Equisetiun pa-
lust7'e et Tofieldia calyculata très parsemé; quelques buissons
(X'Alnus (jlutinosa, Salix triandra, S. jyurjnirea, S. t?Han-
dra X cinerea, piquent çà et là le tapis végétal.
L'avancée sur le domaine du lac du cône de déjection du
Laudon amène encore la discontinuité dans les associations
littorales. Ce cône peut être considéré comme une Phragmitaie
envahie par les alluvions d'où surgissent encore parsemés He-
leocharis, Typha, Scirpus, Phragmites, Eqidsetum,Carex
avec prise de possession du terrain -^diTScdix alha et S. triandra.
Une barre de galets, sorte de cordon littoral, exhausse le sol
à l'embouchure du Laudon, réduisant au minimum, par ce
changement de conditions de milieu, l'ancienne végétation
lacustre.
On reconnaît sur le delta de ce torrent les stades successifs de
l'envahissement de la végétation forestière. Apparition des
plantes d'alluvion, premiei-s pionniers de la consolidation du sol :
Hippophae rhamnoides, Salix iticana, Popidus nigra,
dont les longues racines traçantes affermissent le terrain, puis
de la végétation sylvatique : Euphorljia, Lïgustrum; élimi-
nation progressive des éléments du marécage : Phragmites,
Sciiyes et prédominance de Molinia cœridea. Enfin les arbres
prenant rapidement le dessus constituent un étage dominant
surmontant un sous-bois formé par les espèces arbustives :
1° Arbres : dominants : Salix incana, Alnus incana, Po-
pidas itlgra; abondants: S. triandra, S. purpnir-ea; i^arse-
més : Salix alha ;
2" Arbustes : abondants : Hippophae rhamnoides, Fran-
gida vidgaris, Ligustriim vidgare, Euphorhia amygda-
loides; parsemés : Clematis vitalba ;
— 329 —
3° Tapis herbacé : dominants : Molinia cœrulea qui devient
de plus en plus abondant à mesure que les Phragmites dispa-
raissent;parsemés : Calamagï^ostis Epigeios, Agrostis alba,
Brachypodiiun jyi'iiinaïuni
.
Du delta du Laiidon à Sevritr
(Section C.-D., fig. 11-11.)
Le caractère topograplii(|ue de cette région est l'existence
d'une beine parfois extrêmement large et d'une faible profondeur,
la disparition de la prairie humide et des marécages par suite
de l'exlension des cultures jusiju'au bord du lac.
Sur la rive gauche du Laudon s'étend un marais à Schœnusnigricans associés à des rares Phragmites. Il est bordé par une
Caricaie réduite où poussent Salix incana, Alnus iticana,
1^7'angula mdgaris, Fraœinus excelsior, Spirœa idmaria.Le tapis lierbacé est constitué par Eriophorufn latifolmm
et Schœnus nigtncaus dominants, avec parsemés : Ch^siumpalustre, Lyshnachia mdgayis, Trifolium pratense, Orchis
conopea, 0)'chis bifolia, 0. maculata.
A la hauteur de la Tuileiie s'étend une assez vaste Equisetaie
se continuant par une Nupharaie (Nuphar hdeimi) qui pénètre
la Scirpaie bordée au large par une Phragmitaie. Dans l'eau plus
profonde végètent: Potamogeton perfoliatus, P. crisjnis,
Chara fœthla (pi. V-1).
C'est ensuite la répétition du marais à Joncs à /. obtusifforus
et Eriophorum latifolium dominants, et un groupe d'associa-
tions assez marqué de Carex Davaliana et C. paiiicea
.
Au delà du promontoire débouche le ruisseau de la Planche,
sur le cône de déjection duquel la végétation forestière s'est
établie avec éléments connus.
Arbres : Popidus nigra, Fagus sylvatica, SaUœ incana,Fraj-inns eœcelsior, Alnus glutinosa, Quercus sess'iliflora
.
Arbustes : Ligustrum vulgare, Frangula vulgaris,
Spirœa ubnaria.
Le tapis herbacé possède encore l'empreinte de la végétation
palusti-e : MoUnta cœrulea, Carex stricta, Phragmites par-
semés.
21
— 330 —
Plus loin, le marais à Joncs et à Schœnus présente quelques
pieds isolés de Tofiehlia cahjculala, tandis que la Caricaie qui
le borde envahit tout le littoral qui devient très humide avec
Menyanthes trifoUata douiinant et, parsemés : Erlophorumlatifoliuyn, Tofieldia calyculata, Mcntha aquatica, Lych-
nis fîos cuciilli, Iris pseudo acorus. Dans la prairie près de
la gare de Sevrier, le tapis végétal est émaillé d'une belle
association de Gentkina pneivmonanthe.Dans toute la région décrite ci-dessus s'étend une énorme
Roselière, avec invertissement dans la règle des Phragmites et
des Joncs. En quelques points ceux-ci jalonnent le bord, séparés
par une vaste étendue stérile limoneuse semée de concrétions
tufeuses, au delà de laquelle la Phragmitaie s'étend sur une
largeur de 3 à 400 mètrt;s (pi. IV-1). Aux embouchures des
ruisseaux, contre les jetées, s'organisent des Potamaies, envahies
parfois par la Charaie et piquées en deux endroits de taches d'une
Nupharaie très réduite.
De Sevrier à la Puya. (Section D-E, lig. 12.)
Depuis le chemin de l'église de Sevrier, sur une certaine éten-
due, se développe une ceinture littorale de Scirpes plus ou moins
pénétrée par les Phi'agmites. Dans l'anse, où débouche un ruis-
seau dont les alluvions limoneuses ont constitué un tei-rain favo-
rable pour les Roseaux, les Joncs n'existent ])lus. Là prend place
une énorme Phragmitaie formant une épaisse brousse de 3 à
3'"50 de hauteur et qui s'étend jusqu'à 150 mètres sur la beine.
Les fourrés de Scirpes recommencent avec des taches loin-
taines de Phragmites. — A })ai'tir du sentier qui passe sous la
voie du chemin de fer, il y a inversion peu imi)ortante dans les
éléments de la Roselière.
. Jusqu'à la tour du Cellier, les associations d*^ limnophytes se
réduisent à des buissons de Myinophylles mêlés à des gazons de
Chara; une Caricaie représentée par des touffes isolées de
C. stricta, piquée ca et là d'Abius glutinosa et de Salixhicana, se relie à la })rairie cultivée par une Molinaie aux
individus assez parsemés.
Les Phragmites s'étendent alors sur' la beine l'ecouverte de
cailloux à incrustations tufeuses et bordée vers le larg<' pnr nue
Charaie {('. fœtida, C. aspera).
— 331 —
En arri^-ant à l'esijlanade do l'hôtel Beau-Rivage, quelques
Scii'pes (environnent le débarcadère dont les pilotis s'enfoncent
dans une végétation dense de Myriophylles et de Potamogetonperfoliatus.
Puis la profondeur s'accuse rapidement, quelques toulFes de
Scirpes jalonnent le rivage.
Après le liangar de bateaux, une petite plage permet l'établis-
sement d'une Caricaie avec pieds disséminés de Juncus g/aucus.
Tout près du bord s'installent Cerafophi/lhun demersumdans une Potamaie à P. natans, P.perfoliatus et Myriopjhyl-
liun spicatum. Au large, dans le bleu, transparaissent les
gazons de Cliara {Ch. ccratop)hylla associé à Cli. fœtida) Les
mêmes associations se continuent jus({u'au promontoire de la
Puya où, sur les blocs à demi submergés et sur les murs de sou-
tènement, végète la florule des mousses décrites plus haut dans
la Brjophytaie.
De la Ptiya au Port d'Annecy. (Section E-E', fig. 12.)
La beine reparait encore peu développée. La côte se jalonne
de Scirpes et de Phragmites. Dans l'eau peu profonde croissent :
Potamogeton lucens, P. densits, Polygonitm amphibimn,Utricidaria riilgarls. La lisière du rivage est formée par une
Caricaie où végètent : Salix capraea, S. cinerea, S. alba,
Stachys palustris, Heleocharis pjalustris, Spirœa ulmaina,Polygommi ainphilniun var. terrestre, Equisetimi palustre,
Scrophidaria nodosa, Eupatorium canrHibinum.
La beine s'élargit de plus en plus; les gazons de Cliara
C. ceratojjhylta, associés à Naias major, atteignent presque
le bord et contournent la jetée. C'est là qu'apparaissent les con-
crétions tufeuses de plus en plus nombreuses, jonchant le sol.
Dans le Port (Thioux) et le canal du Vassé, la profondeur de
l'eau permet l'établissement des associations habituelles de la
Cliaraie et de la Potamaie. A l'entrée, végètent isolés quelques
pieds de Numphar lidcnm, associés à de rares Joncs. LaCharaie est représentée par des gazons de Chara fœtida.,
mêlés à Ch. aspera var. curta et à quelques rares Nitella
flexilis.
La Potamaie comprend : Potamogeton perfoliatus, P.
— 332 —
densus, P. crispus, P. lucens, P. pectinatiis, P. pusil-
lus, associés aux formes do Renoncules aquatiques, Rammcu-
lus (Batracliium) tricJiophyUus, R. divaricatus.
Du Port d'Annecy à Chavoire.
(Section E'-F-G, flg. 12.)
Une large beine s'étend dans toute la partie nord du lac,
qu'elle borde depuis la Préfecture jusqu'à la Tour en diminuant
d'importance à la pointe d'Albignv.
Là se développent en abondance les gazons de Cliara, C. gym-
nophijlla, C. fœtlda, C. gymnophylla, associés à quelques
buissons de Myropjhyllam spicaUmi et des groupes isolés de
Potamogeton perfoliaius, et P. densus.
Le sol est ici abondamment jonclié, autour de l'ile des Cygnes,
de concrétions tufeuses.
Les murs de soutènement de l'avenue Eugène Sue, qui borde
le lac, sont garnis de quebpies mousses : Barhula vineaUs,
B. recurvtfoUa, Grimmiapidvinata, G.apocarpa, Euryn-
chium crassinervimn: Une zone continue de Scirpes con-
tourne la presqu'île d'Albigny avec bordure externe de Plirag-
mites.
La prairie Immide, dans cette partie, est une Caricaie bien
déterminée av(;c Salue cinerea, S. pui'purea et caractérisée
par l'associatign de Carex qui se pénètrent mutuellement :
C. stricta, C. disticha avec parsemés : C. Daraliana, C. pidi-
caris et une petite forme de C. disfans, isolé à souche rampante
et ne s'organisant pas en touties.
Les plantes habituelles des prairies humides forment ici le
tapis végétal : Sparganium ramosion, Caltha palustris,
.Scirpus compressus, Cardamine pratensis, Valeriana
dioica, Colchicum autumnale, Polygakc depressa, Pedicu-
laris pcdustris, Sph^œa idma7na et une mousse abondante
Clhnachim dendroides.
Au delà de la presqu'île s'étend un petit marécage envahi par
une belle Caricaie en tourtes discontinues: C. stricta, C. disticha
associés. Dans les flaques d'eau végètent : NyinjdKca alha,
Lemna niinor, Equisetum limosum, Amblys/egitnn ripa-
— 333 —
f\ Port de [3 •foin- II)
Fort /<• h Tour (l)
F
la Tuua E
GRAND LAC5eclu)tis D-E , E-r , F-O
/V'
— 334 —
rium. Contre la jetée, dans l'eau profonde : l'otnmogeton
Incens, P. densus, P. pectinatus, P. pusillus, P. pe^^folia-
fus, Myriophyllum verticïllatum.
Cette Potamaie se relie à une Caricaie avec SeJiecio paliulo-
sus et Equisetum limosum dominants.
Il y a à remarquer ici l'alluvionnement progressif déterminé
par un cordon littoral de débris de Roseaux et de Joncs. L'herbe
finit par s'y installer et c'est un processus de la prise de posses-
sion de la terre ferme sur le domaine du lac.
La Scirpaie clairsemée se maintient assez loin du rivage
et les fourrés de Roseaux forment au large un rideau compact.
A l'embouchure du ruisseau d'Albigny s'établit Careœ
ripciria. Sur ces bords croissent : Tris pjseudo aco7ms,Alismr/
plantago; dans l'eau flottent les tiges de Panunculus dircwl-
catus.
Au delà s'étend une large Caricaie formée par l'association de
C. stricta, C. pjcdiidosa, C. aciUa, et Equisetuyn limosum,
Caltha palustris, Heleocharis pahistris qui végètent presque
en contact avec la Scirpaie.
Au premier port de la Tour s'établit une Potamaie dont les
espèces rej^résentatives sont Myruypliylluin spiccUum et
Polygonum amx)hîhium var. natans. Les Scirpes bordent le
rivage jusqu'au deuxième port ombragé de la Tour dont l'eau
tranquille abrite Potamogeton crispus, P. pcrfoliatus,
Myriophyllum spicatum (pi. II).
Jusqu'au port de Chavoire, il y a alternance de Scirpes et de
Roseaux avec tufs lacusti'es (pi IV-2). Le rivage est bordé
d'une Magno-Caricaie réduite à queLjues touffes de C. stricta
au-dessus desquelles s'élèvent des buissons de Salix pmrprurea
et S. cinerea. Plus au large s'étend une ceinture littorale de
Potamogeton p)erfoliatus et des gazons de la belle Characeratophylla particulièrement abondante au-dessous de la roche
Margeria. Les murs qui soutiennent les terrains des propriétés
riveraines ont empêché le dévelop])ement des associations litto-
rales, qui se réduisent à quelques îlots Scirpes en dedans d'une
zone constante de Potamots et de Chara.
335 —
A' Ohaooire aux hains de Menthon. (Section (î-II.)
Los terrains cultivés (|iu arrivent jus({u'au bord du lac, soute-
nus parfois par dos murs en pierres sèches, ont notablement con-
tribué à modifier la physionomie végétale de cette partie du
littoral. La côte est en outre très déclive. Seules, les associa-
tions de limnophytes subsistent : Scirpes alternant avec les
Roseaux, invertis rarement. Une zone continue do Potamots et
de Chara forme la bordure interne. La Caricaie est réduite à
rpielques touftes de C. stricta ou à des buissons de Salix cine-
rea, S. incana, S. alba, S. fragilis, Cornus sanguinea au-
dessus desquelles s'élèvent Populns nuira et quelques rares
individus iXUlmns camjjestris.
La profondeur augmente brus(|uementdans l'anse de Menthon.
La Potaraaie s'étend ici tout le long du rivage piquée de rares
touffes de Scirpes.
La Falaise du Roc de Chère. (Section H-K, fîg. 11 -III.)
Au sud des Bains s'élève Ijrusquement une énorme falaise
urgoaienne, à i)ic sur le lac, au delà de laquelle une faille déter-
mine un dénivellement qui ramène la masse urgonionne infé-
rieure au niveau de l'eau. — Puis celle-ci se relève lentement
pour atteindre son maximum à la Grotte des Oiseaux et retomber
après deux ondulations synclinales au nord de la baie de Talloires.
Dans ces conditions, il n'y a guère de place pour l'établisse-
ment des associations littorales.
Ces associations n'existent pas, en raison de la profondeur des
eaux jusqu'à la faille occidentale. Sur la grande falaise s'ac-
crochent des espèces xérophytes supportant les conditions de
chaleur et de sécheresse particulières à ces parois ensoleillées et
s'échaufïant fortement.
Dans les fissures croissent de rares Q^«erc?f.s scs.si/^'/forrt et
les espèces n^rhusHYes Amelanchier vulgaris, Cerasus nuiha-
leb, Juniperus communis. Les plantes herbacées sont repré-
sentées par Sesleria cœridea,Ge7rinium scmgitmeitm, Silène
nutans, Hippoc7'epfs comosa, Semperviimm tectorum,
Pencedanum cervaria, Aethionema saxatile. On aperçoit,
cramponnés à des hauteurs inaccessibles, deux éléments carac-
— 336 —
téristiques des parois rocheuses : PotentiUa caulescens, Hiera-
ciimi Jacquini ; enfin des fougères xéropliiles : Aspleniiun,
Polypodium serratnm, Ceterach offlcinariun.
Quelques an fractuosités ou grottes, dans lesquelles l'eau pénètre
au niveau du lac, sont des stations favorables où végètent, dans
une atmosphère humide, l'intéressant A(:/i«n/^?^?;? capilhisVene-
ris, dont les touffes chétives sont constamment arrosées par les
embruns des vagues (1).
La côte se relève ensuite et les éboulis rocheux de la falaise
ont permis l'établissement d'une très petite Caricaie où quelques
touffes de C. sticta et (YHcicocharis pahtstris mêlés à Scirpus
lacushHs ont pris pied au niveau de l'eau. Au-dessus, presque en
contact, Frangitla rulgaris, Rhamnnis cathartica, Rh.
alpina mêlent leurs chétifs buissons à quelques Saline purpu-rea, S. incana, S. alba disséminés. Enfin PopuJus nigra,
Alnus incana forment les éléments raréfiés d'une Saulaie.
Aux environs de la Grotte des Oiseaux, une petite plage donne
prise à une Molinaie composée de Molinia coeridea, mêlé à
Carex strïcta, et aux espèces habituelles des marécages : Lysl-
machia vulgaris, Lgthriun salicaria, Œnanthe Lachenalii,
envahie par quelques Scirpes et Phragmites disséminés.
Au-dessus, sur les falaises plus ou moins abruptes, se sont éta-
blies des colonies xérothermiques et l'aire du Buis décrites en
grand détail par Ph. Guinier(1oc. cit.) et sur lesquelles il est
superflu de revenir ici.
L'anse profonde de Talloircs se raccorde par une courbe gra-
cieuse aux pentes broussailleuses et très rapides de la partie méri-
dionale du Roc, et la profondeur qui devient moindre détermine
un changement dans les associations littorales. Celles-ci se
réduisent à quelques touffes de Scirpes en bordui'c d'une large
zone de Potamots et de Myriophylles.
. Du marais de Verthier à la haie de Talloires.
(Section K-L, fig. 10.)
La puissante Roselière qui s'étend depuis l'embouchure de
l'Eau morte en fourrés comi)acts ou en groupes d'associations
(l) Ph. Guinier, « Le Roc de Clière, Etude phytogéographique ». Revice
savoîsienne, 1900-1907.
- 337 —
(Joncs ci Roseaux) devient de moins en moins dense à mesun^
qu'on s'avance vers l'est.
Cette Phragmito-Scirpaie se termine l)iMis(]uement au coude
de la route de Talloires. En ce point, le domaine du lac s'affirme,
et la ceinture littorale se sim])lifie. — Les Pliragmites disparais-
sent presque complètement et on ne trouve plus maintenant que
des taches isolées de Scirpes qui jalonnent la rive dans une zone
large de 1 à 3 mètres.
Cette particularité est commune avec la rive opposée du Petit
lac, on la notera constamment jusqu'à Talloires. Si on se ra|)pelle
certains faits de la biologie des Roseaux et des Joncs, on se ren-
dra compte que si les Joncs existent ici, c'est à cause des condi-
tions de station : berge très déclive, formée d'éboulis caillouteux.
Les Roseaux, faute du beino limoneuse et meuble, ne peuvent yprendre pied.
La ceinture très disjointe des Joncs se continue jusqu'après le
cône de déjection du p(itit torrent des Balmettes où les Phrag-
mites reparaissent par ilôts très peu denses. Ceux-ci se conti-
nuent très disséminés pour contourner le ])romontoire d'Angon,
où des Potamaies très réduites avec Naias major s'installent.
Le cordon littoral des Joncs se continue jusqu'au port de Tal-
loires. La Caricaie n'existe pour ainsi dire pas depuis l'extrémité
sud de la cote orientale jusqu'à Talloires; elle est représentée
par de rares touffes de grands Carex, ceinture très lâche, piquée
ça et là de buissons d'Aulnes, de Saules blancs et cendrés.
Les cônes de déjection des torrents donnent prise, suivant la
règle, à l'envahissement -de la végétation sylvatique avec ses
éléments habituels.
— 338
VII
LES MICROPHYTES LITTORALES.
Los associations littorales ayant été décrites en ce qui concerne
les Macroplijtes ( Pluinùi'ogames, Mousses, Characées), il reste
à étudier d'autres plantes qui sont fixées au sol ou sur les corps
étrangers, ou bien reposent sur le limon dans la région littorale
et qui appartiennent aux Microphytes.
Les conditions écologiques qui permettent le développement
de cette flore microj)liytique du littoral se rencontrent dans
l)lusieurs stations distinctes : les murs des quais, les pilotis, les
blocs alternativement émergés et recouverts par les eaux, la
zone submergée des cailloux de la grève, l'embouchure des ruis-
seaux ; enfin, les plate-formes constituées par la beine où des
algues Schizophycées, décalcifiant l'eau avec énergie, édifient
les intéressantes concrétions tufeuses du lac, où aussi d'autres
algues du même groupe corrodent les pierres et contribuent, par
un curieux j)rocessus de carie, à la formation des cailloux
sculptés.
Un simple coup d'œil sur les rives du lac permet de se rendiv
compte qu'il existe une certaine localisation, pres({ue de la, régu-
larité, dans l'ensemble do la distribution des associations litto-
rales de Microphytes.
Lorsiju'on suit les quais (jui bordent les émissaires du lac et
aussi ceux du jardin public, on a])erçoit d'abord, au travers de
l'eau verte et cristalline, un type de végétation particulier.
Sur le fond limoneux des canaux, près du bord, s'étendent de
larges plaques lichenoides brunes ou à reflets verdàtres, dont le
œntour est comme godronné et légèrement soulevé. Elles déve-
loi)pent leur tapis velouté souvent sur une largeur de plusieurs
décimètres. C'est V Oscillaforia limosa Agardli. = 0. Froeli-
chii Ktz. GoMONT (1), p. 230, pi. VI, f. 13, très développée en
hiver, mais qui devient rare en été. A côté vivent en association
(1) GoMONT, "Monographie des Oscillarièes ••. Ann. de lu. Soc. nat. Bot.,
T série, t. XV et XVI.
— 339 —
avec la précédente : Phormidium farosum var. (3 Gom. * (1),
GoMONT, loc. cit., p. 200, pi. V. f. 13, Phormidium Retzil
Gom. form. 7mpestris'^'= Ph. rupesfre Ktz. Dans le feutrage
eompact forme par les longs tricliomes de ces Oscillariées vivent
de nombreuses Diatomées : Stauroneis anceps Ehr. et Cyma-
topleura solea var. apicidata Pritch.
Les mêmes Oscillaires s'accrochent à la partie submergée des
pilotis des embarcadères en compagnie d'autres curieuses Diato-
mées agglomérées en chaînes dans une gelée muqueuse : Schizo-
nema lacustre Ag. = CoUetonema lacustre Ktz., dont les
colonies se découpent en franges brimes mêlées aux lanières
blanchâtres, décolorées, des Oscillaires mortes. Ce tapis sombre
et ces buissons sont égayés par la note claire des Conjuguées
vertes : Zygnemées, Spirogyrées, dont les filaments croissent
et s'agglomèrent en masses floconneuses qui sont emportées
ensuite par les courants et deviennent erratiques dans les eaux
du lac. Vers la fin de l'hiver apparaissent sur les gazons de
Cliara, qui tapissent le fond de l'eau, de singulières boules blan-
châtres, petites masses mmpieuses de quelques millimètres à
2 centimètres de diamètre, qui sont piquées d'une multitude de
points d'un vert clair. Ce sont les colonies d'un Infusoire :
Ophrydium rersatile, dans la gelée duquel vivent en symbiose
des AÎgues vertes, ChloreUa spec. Dans la masse se meuvent en
quantités innombrables de très petites Diatomées : Nitzschia
minutissinta Gm.Sur les mêmes gazons et les rameaux touftus des Myriophylles
reposent en gros flocons verts les filaments enchevêtrés de
Mougeotia genuflcxa Ktz., arrachés aux pierres du rivage et
dont l'isolement de leur substratum habituel n'entrave pas
l'activité végétative.
Au milieu des cordons littoraux de débris organiques ou sur la
grève exondée gisent çà et là des coquilles vides d'xVnodontes,
dont (|U('l({ues-unes sont recouvertes près de la charnière de
taches gris verdàtre plus ou moins confluentes, qui sont formées
par les filaments rampants de Gojigi'osira codiolifera Chodat,
algue perforante jouant également un certain rôle dans la carie
des pierres.
(1) Les algues marquées d'un * ont été soumises à l'examen de M. Gomont,
qui, très obligeamment, a bien voulu les déterminer.
— 340 —
La Tolypotricaie. — Au niveau oxact do la surface de l'eau,
les murs des quais, les degrés des escaliers, les blocs à demi
submergés sont frangés d'une lisière absolument continue de
houppes noirâtres qui ondulent sous l'action des vagues.
Cette zone est habitée par les groupes d'associations de Toly-
pothrix lanata Wartm. et Tolyp. penicillata Thuret *, dont
les filaments servent de support à certaines Diatomées : Cocco-
neis placentula Ehr. et Achnantes exilis Ktz., qui dresse
sur de graciles pédoncules ses frustules rigides. En février et
mars, ces Tohjpothrlx présentent leur maximum de développe-
ment. Leur activité biologique est soumise au degré de hauteur
des eaux;quand celles-ci baissent, les algues se dessèchent et
forment un enduit noirâtre caractéristique qui marque la zone
constante de cette association, la Tolypotricaie, que l'on ren-
contre tout le long du littoral du lac (pi. III-l).
Les Mousses submergées servent également de support à
Tohjpothrix distoria Ktz., auxquelles viennent se mêler les
houppes vert bleu de PIcctonema Tomasiîiianum, Bornet *
= PI. mirahlle Thuret.
A l'embouchure des ruisseaux, sur les pierres lavées par l'eau
vive, s'installent les rameaux bruns piqués d'un chapelet de'
glomérules sombres <\q Batrachospcrmum 7noniJiforme Ktz.
(que l'on trouve également, mais de taille très réduite, sur les
pierres de la beine Nord) et les élégantes touffes pourpres de
Bangia atropwpjurea (Dillw.) Ag.
Certaines parties du littoral, où la grève est très décli^'e et
bordée d'une série d'enrochements ou d'éboulis de cailloux sub-
mergés, sont des stations spéciales soumises à divers facteurs
climatiques : éclairage intense, changements de température de
grande amplitude, alternatives de sécheresse et d'humidité (côte
depuis la Puya jusqu'à Beaurivage et tout le littoral est du lac).
Les gros blocs à demi submergés, les murs de soutènement des
quais sont parfois creusés de cavités peu profondes où l'eau
s'accumule par l'action des vagues ou des embruns. Dans ces
petits bassins se développent des enduits d'un beau rouge dus à
une Volvocinée, Sphaerella lacustris Wittr. = Chlamydo-
coccus pduvialis A. Br. Par suite de la sécheresse, cette Algue
constitue ufie couche brun grisâtre, mais elle recommence à
végéter dès qu'elle se trouve soumise à l'action d'une humidité
— 341 —
prolongée. Sur ces blocs s'accrochent également les croûtes
mamelonnées de divers Nostocs.
La Chlorophycaie. — Nous avons vu (ju'au niveau de l'eau
s'étale toujours le cordon littoral de la Toljpotricaie, mais, en
dessous de cette zone, surtout au printemps et en été, les pierres
complètement submergées de la grève de 0'"50 à 1 mètre de pro-
fondeur se recouvrent uniformément d'une toison lâche d'un
beau vert formée })ar les filaments enchevêtrés et ramifiés de
CJddophord gloinerata, mêlés aux gazons soyeux vert jaune
des Ulothrlx zonata et aux touffes des VaucJicria (jemïnata
et surtout de Mougeotia genufleuoa dominants.
Il existe donc ici un groupe d'associations que l'on peut consi-
dérer comme une Clorophycaie très nette.
La Diatomaie. — Pendant l'hiver, les mêmes pierres
innnergées se recouvrent d'un mucus jaune brun, véritable tapis
végétal composé en majeure partie de Diatomées où les espèces
dominantes, Gomphonejna oUvaceum, G. inti'icatHm,t\reiisent
leurs buissons aux ])édoncules enchevêtrés, parmi lesquels se
déroulent les longs chapelets articulés de Diatoma mdgare et
D. grande au milieu desquels glissent les fines aiguilles des
Synedra et les délicats fuseaux des Naficula.
Voici donc encore un autre groupe d'associations, la Diato-
maie représentée par l'enduit muqueux des cailloux submer-
gés et qui pénètre presque toujours la Chlorophjcaie.
La Sehizotricaie. — Une autre formation des })lus remar-
quables est constituêo tout le long des grèves et sur les parties
de la beinc les plus voisines du littoral, \ràv des cailloux couverts
d'incrustations calcaires, spongieuses et grisâtres. Cette couche
est, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, le résultat
d'une décalcification des eaux due à un phénomène biologique.
A la surface de ces tufs s'accrochent les coussinets d'un beau
vert de Chœtophora tuherculata, les thalles d'un vert gai de
Bidbochœte setigc7'a, de Coleochœte imlmncda, les rosettes
des CoJeochœte scutata, enfin, ça et là les mamelons noirâtres
de Scytonema turfaceimi Cooke = Smjsi'plion pulcuiatus
Breb.
Les tufs sont sillonnés eux-mêmes dans toute leur épaisseur
par les filaments morts ou vivants de certaines Oscillariées
— 342 —
ai)partenant au genro Schizothriœ, formant im groupe
d'associations, la Sciiizotiiricaie, spécial à la région des conci'é-
tions calcaires (v. cliap. suivant).
La Desmidiaie. — Un autre groupe d'associations trouve son
liabitat dans la zone de la Roselière. Les tiges des Pliragrûites et
des Scirpes sont recouvertes, dans toute la partie qui se trouve au-
dessous de l'eau, d'une sorte d'enduit muqueux, de couleur
jaunâtre, où l'on rencontre une foule d'organismes. Des dépôts
tufeux garnissent également les tiges (flg. 13-1) et leur origin(>
est la même que celle des cailloux incrustés. Tous les groupes
d'associations précédents se trouvent réunis dans cette station
particulière. Ici apparaissent, en raison des conditions de station
marécageuse, les Dcsmidiées, représentées par une demi-dou-
zaine d'espèces seulement. On remarquera la pauM'elé du lac
d'Annecy en fait de Desmidiées. Ces algues n'existent pas dans
la flore pélagique (1), à cause de la grande pureté des eaux et
l'absence à peu près complète des matières organiques. Les
points les plus favorables à leur végétation se rencontrent préci-
sément dans la région de la bcine marécageuse, où les Roseaux
et les Joncs abondent ; les fragments de ces plantes tombent au
fond de l'eau et la macération superficielle des tissus où
s'installent les mousses blanchâtres de Cludothrix dichotoina
Colin est une condition des meilleures pour le développement
de ces algues. Leur localisation dans la Roselière permet de
détei'ininer ])Our cette région une association spéciale de iiiicro-
pliytes, la Desmidiaie.
(1) La seule Desmidiée que j'ai rencontrée dans mes pêches de surface
Ilyalutheca dissilicas, provenait d'un trait de filet donné en avant du maré-
cage d'Albigny. Cette algue doit donc être considérée seuleirient comme un
élément planctonique de marais mélangé à la flore pélagique lacustre.
— 343 —
Eléments de la flore microphytiqiie littorale
ALGAE (1)
V Classe : Florideae
Batrachospermum ^nonilifornu' Kotli., emboucluuv des
ruisseaux et pierres de la Beine N.
Bangid airojiurpurra Dilw., emboueliure du ruisseau des
Marquisats.
3'' Classe : Chloropiiyceae
!" Ordre : Confkrvoideae
Coleochœte pulmnata A. Braun, sur les pierres de la beiue.
(L scutata Breb., enduit des Roseaux, tufs de la b(>ine.
C. soluta Pringsli., enduit des Roseaux.
Bulhocha'te setigera (Rotli) Ag., enduit des eailloux, nièlé
avec les Spirogyres ; sur les tufs.
B. nana Wittr., tufs de la beine.
Aphanochœterepens A. Br., sur filaments de Spirogyre.
Ulothrùic zonata Web., sur les pierres.
Chœtophora tubcrcidosa Roth., pierres et mousses sub-
mergées.
C. longipUa Ktz., sui" les [)ierres de la beine et du littoral.
Draparudldia glomcrata Vaueli., a^•ec Spirogyres.
Stigeockmium JongtpUmn Ktz., avec les Bulbocliœte sur
les pierres et les tufs de la beine.
S. nanmn (Dillw) Ktz., sur les pierres du littoral.
Cladopliora glomerata Ktz., sur les tufs, les })ierres du
littoral, les mousses submergées.
2'' Ordre : Sipiioneae
Vaucheria ornithocephala Ag. var. sericealAw^h., parmi
les Cladopliora, sur les pierres.
T^. gotiiixda D. C, sur les cailloux du littoral.
(1) D'après la classification De Toxi : Si/Iloijr nhjarinn omniian hucvs que
coynitarnm. Padua LS89-1S94.
344
3*^ Ordre : Protococcuidak
Chlnmydococcus pluvialis A. Br. = Sphaerefla lacuslris
Wiltr , sur les pierres et les blocs périodiquement inondés.
Gongrosh^a codiolifori Cliodat., sur les pierres incrustées
de calcaire et sur les coquilles vides d'Anodontes.
Scenedesmus quadricaudaBreh., enduit des Roseaux.
Pediastrimi Boryammi Menegb., parmi les mousses immer-
gées, les Toljpotlirix et dans l'enduit muqueux des cailloux.
Trentepohlia umhrina Ag., en couche rouge à la base et
sur les racines des peu})liers et des saules lavés i)ar les vagues à
Talloircs.
4® Ordre Con.tugatae
Mougeotia parvida Hass., enduit des Scir])es.
Mougeotia genufiexa Ag = Mesocaipus jjlenrocarpus de
By., sur les pierres et en gros flocons reposant sur les gazons de
Ciiara.
Mesocarpiis scalaris (Hass) de Bj.
Zygnema cruciatum Ag., en gros flocons reposant sur les
buissons de Mjrioplijlles ou les gazons de Cliara.
Z. leiospeDiuun de By., sur les pierres et dans l'enduit des
Roseaux.
Spirogyra ad/tata Ktz., parmi les Tolypothrix, sur les
pierres.
Spirogyra var-iaus (Hass) Ktz., dans l'enduit des Roseaux.
Sp. quinina Ag. var de jjor^ica^is Vaucli., sur les cailloux.
Sp. Weberi Ktz., sur les pierres.
Sp. Weberi var. elongata Rab., sur les pierres.
HyaJotheca. dissiliens (Smith) Rall's minor forma / de
Delponte., dans l'enduit des Roseaux.
- Cosmarium Botrytis Menegh., enduit des Roseaux.
C. a,nomahi)n\)c\\).,
G. margarïlïferum Menegh.,
C. crenatum Ralfs.,
SfaurasfrutJi teliferitmliAlh.,
345
4" Classe Bacillariacae
Naincula rhi/nchocephala Ktz. var. Geneveusis Brun (Ij,
enduit des cailloux et des Roseaux.
A'', pusilla W. Sm. var. alpesUHs Brun., enduit des pierres.
N. Jaiiuscuîa Ktz = iV. patula W. Sm., enduit des pierres.
N. vidgaris Heib = Colletonema lacustre Kutz = Schizo-
nema lacustre Ag., sur les pilotis.
N. rulgaris Heib. var. lacushHs Brun., sur les i)ierres.
Pinnularla viridis Rab., enduit des Roseaux.
Cymbella Ehrenbergii Ktz.,
C. gastroïdes Ktz. = C. lanceolatum Brun., enduit des
Roseaux et pierres.
C. prostatum Ktz., enduit des Roseaux.
C. cymbiformis Breb.,
C. )jihmscula Griinow., sur les pierres.
C. imriabilis Wartm.. »
C. cœspltosum Ktz., « et enduit des Roseaux.
Ainpho)'a ocaUs Ktz., sur les incrustations calcaires.
Gomphouema constrictum Ehr., enduit des cailloux.
G. dichototmim Ktz., sur Tolypothrix et Cladoplioi-a et dans
l'enduit des cailloux.
G. intricatum Ktz., sur les cailloux et l'enduit des Roseaux
et des Joncs.
G. abbrematum Agardh., sur les Cladophora.
G. ollvaceum Ktz., dans l'enduit des Roseaux.
Cocconeis pjlacerdula Ehr., appli(piés sur les tihunents de
Cladophora et des Tolvpothrix des pierres.
Achnanthes exilis var. minutissima Ktz., dans l'enduit des
Joncs et sur les Tolypotlu'ix.
CijynatopÀeiira elliptica W. Sm. var. apiculata Pritsch.,
enduit des pierres.
Surirella norica Ehr. var. costata Brun., enduit des
Roseaux.
Diatoma vulgare Bory., enduit des pierres et des Roseaux.
D. Ehrenbergii Ktz. var. grandeW. Sm., enduit des pierres
et des Roseaux.
(1) J. Brun, Diatomées des Alpes et du Jtira. Genève, 1880.
22
— 346 —
D. elongatum Ag., enduit des pierres et des Roseaux.
Meridion circulare x\gardh., sur fllaments de Vaucheria.
Synedra ulna Ehr., enduit des pierres.
S. gt^acilis Ktz., sur les pierres et attacliées aux filaments
de Mougeotia.
Nitzschia minutissima W. Sm., dans la gelée des Ophrv-
dium
.
Tahellarid fenestrata Ktz., boues des gazons de Cliara.
T. ffocculosa Ktz., .»
Epithemia arçiiis Ktz., enduit des Roseaux.
E. co^gus var cûpestris Grun., •• et sur les luis.
E. ocellata Ktz.,
E. zehra Ktz.,
E. turgida Ehr.,
Eiinotia arcus Ehr. var. hidens W. Sm. et Greg., enduit
des Roseaux.
CycloteUa oper'Cidata Ktz. var. mdupaii , sui- les pierres et
dans la boue des gazons de (Miara.
h^ Classe. Cyanophycae (I).
Calothriûo parietina Thuret.
Dichotrix Nordstedti Born. et Fiali.
Eividaria hœmatites Bornet et Flahaut.
Scytonema turfaceum Cooke = Sirosijdiou pHlr/iudiis
Breb.
S. myochrous Agardh.
TolypoUirix lanata AA^artmann.
T. penicil/ata Thuvet.
T. distorta.
Nostoc commune Vaueli.
Plectonemri Tommasiniainim Bornet
OscUlatoria limosa Ag.
Phormidium favosum Gom. var. p Gom.Ph. Retzii Gom. forma rupest^^is.
L'énumération des autres Cyanophycées, eonslrucleurs des
Tufs, prendra place dans le chapitre suivant.
(1) Classificatîoii de Bornet et Flahaut, Révision des- Nostocacées hétérocys-
tées, Paris, 1886-88 et de Gûmont, Monographie des Oscillariées. Paris, 1893.
— 347 —
VIII
LES TUFS LACUSTRES ET LES GALETS SCULPTES
Nous a^'ons vu que la beine est particulièrement développée
dans les parties N. et 0. du lac, sur une largeur variant de 250
à 500 mètres C'est là que s'organisent de singulières productions,
développées d'une manière intense et caractéristique au lac
d'Annecy,
Lorsqu'on parcourt en bateau cette région, par temps calme,
on a])erçoit sur le fond recouvert de l'"50 à 2 mètres d'eau, des
masses spongieuses, mamelonnées, blanchâtres, joncliant le sol
en assez grande abondance. Leur volume est très variable ; elles
deviennent plus rares à mesure que la profondeur augmente et
on n'en trouve plus au delà de 5 à 6 mètres.
Les pieux des anciennes stations lacustres, les tiges de Roseaux
et des Joncs (Roselière de Duingt) sont également garnis de ces
incrustations qui re^'étent, d'une façon générale, tous les corps
étrangers, bois, fragments de métal, (jui sont immergés depuis
longtemps sous les eaux.
A l'état frais, ces masses se présentent sous l'aspect d'encroû-
tements pierreux d'un gris sombre, d'une légèreté assez grande
et extrêmement fragiles. Desséchées, elles prennent une couleui-
gris clair et deviennent presque friables.
Ce sont des tufs calcaires, d'une origine spéciale, pour
lesquels les cailloux de la beine constituent une sorte de pôle
d'attraction.
Ils se développent au-dessus et sur les côtés de la pierre, tandis
que la face inférieure de celle-ci en est totalement dépourvue.
Dans les crevasses ou anfractuosités de ces tufs s'agite tout un
monde de Crustacés, de Coléoptères aquatiques, de larves de
Phryganes, de Vers. La surface est, dans la règle, recouverte
d'un enduit jaunâtre de Diatomées et de place en place s'accro-
chent isolés ou confluents de petits coussinets verdàtres, oli-
vâtres ou brun foncé qui ne sont autres que des algues Chloro-
pliycées ou Schizophycées. Ces dernières, comme on le verra,
jouent un rôle capital dans la genèse de ces productions tufeuses.
Certaines concrétions sont très caverneuses ou bien à surface
— 348 —
môandriformo ou irrégulièrement sillonnée. Elles rappellent
parfois la structure des tufs calcaires déposés pai' les sources
incrustantes.
D'autres montrent une texture compacte en profondeur qui
dessine une zone blanclie autour du ton plus sombre de la roche
(flg. 5, 6. 7).
Si on enlève la partie superficielle de ces tufs, qui se désagrège
très facilement, on arrive bientôt à la pierre, la(|uelle, dans
certains cas, a perdu sa compacité et dont la consistance est deve-
nue lâche et crayeuse.
On constate déjà ici, sommairement, deux phénomènes
distincts :
1° Production d'un dépôt calcaire;
2" Attaque et transformation des couches superficielles de la
pi<MTe.
Les dépôts se forment indifféremment sur tous les corps, mais
en ce qui concerne l'attaciue des pierres, seiiLs les calcaires
subissent cette action; les briques, grès, cailloux de roches cris-
tallines ne présentent pas trace de carie.
Historique.
CiiODAT est le premier (jui ait signalé la présence d'algues
incrustantes dans le lac d'Annecy (1) : '• Des algues ou cyano-
l)hvcées peuvent aussi déposer du calcaire dans les eaux froides,
ainsi au roc de Clier, au lac d'Annecy, ainsi que l'auteur a pu
s'en assurer d'après des matériaux fournis par M. le })rofesseur
Forel. •'
Les tufs lacustres, dans les lacs suisses, ont fait l'objet d'une
étude très documentée de Forel (2) ((ui signale i)0ur mémoire
deux variétés de tufs dans le lac d'Annecy : les concrétions
tufeuses de la beine et la corniche sous-lacustre du roc de
Chère.' Le même auteur ignore l'existence des galets sculptés dans ce
lac : " Notons que sur le littoral du lac d'Annecy, il n'y a pas
trace de galets sculptés et cependant nulle part les algues incrus-
tantes ne sont mieux développées. » Il cite le texte même de
(1) CtiouAT, « Communication relative ;\ des algues inrnis(,antes et ])er-
l'orantes ». ArcTïTdes se. ph. et nut. de Genève, 15 mai 18117, p. '^M.
(2) F. A. Forel, Le Léman, t. III, pp. 186 et 385 à 398.
- 349 —
Chodat, ù l'examen duquel il a soumis ces tufs :•• L'algue
incrustante prineipal(> <^st Hi/ch-ocolciim calcilegiDii iJrann.
Mais il y a en outre des RirHhirh(, des Scytonema, des
OscUlaruL et çà et là des di'bris qui ressemblent plus ou moins
à Eiiactis calcivora ••. " La conclusion, ajoute Forel, n'est-ellc
pas bien prochaine : si, malgré l'incrustation abondante de
YEi/drocoleuni, il n'y a pas de sculpture, n'est-ce pas à l'absence
plus ou moins complète de VEuactis qu'il faut attribuer ce
défaut ? "
Enfin, j'ai signalé sommairement, en 1899, la distribution des
concrétions tufeuses sur la beine et les bords du lac et leurs
relations avec les zones de végétation, mais sans insister sur le
phénomène de leur formation (1).
Dans son analyse des eaux du lac, Duparc (2) écrit : " L'ap-
pauvrissement des eaux des affluents est le résultat d'une décal-
cification provoquée par la vie organi(|ue... On peut s'en con-
vaincre par la présence de nombreux dépôts tufacés qui
recouvrent la beine du lac et que l'on peut également recueillir
contre les parois abruptes qui forment le prolongement sous-
lacustre du roc de Chère. Ces dépôts sont dus à des algues très
abondantes dans le lac. -^
Ces diverses notes constituent toute la littérature relative aux
concrétions tufeuses du lac d'Annecy.
Distribution des tufs.
Les conditions climatiques, pliysico-chimi(|ues et biologiques
(|ui pr('sident {i la formation des tufs se trouvent réalisées en
plusieui's [)oints du lac. Ce sont la forte insolation, la tempéra-
ture relativement élevée des eaux, l'abondance des algues litto-
rales et l'activité extrême de celles-ci dans le phénomène de
décalcification des eaux.
On peut dire que sur tout le littoral, en exceptant toutefois
l'extrémité S. du Petit Lac, où les tufs semblent manquer, ces
concrétions se forment en quantité, partout où la beine trouve
place ; elles garnissent également les éboulis pierreux de la côte E.
,
très déclive depuis Menthon jusqu'à Chavoire. Dans les vastes
(1) M. Le Roux, « Notes biologiques sur le lac d'Annecy ». Rer.sar. 1899.
(2) L. Duparc, « Le lac d'Annecy ». Arch. des se. ph. et nat de Genève,
15 février 1894, p. 26.
— 350 —
EXPLICATION DE LA PLANCHE
1. Tige de Roseau recouverte d'incrustation tufeuse.
% 3. Type particulier d'incrustation, sorte de feutrage de Schizothiix étalé
en membrane sur le sol de la beine exondée en octobre 190(3, entre
Duingt et St-Jorioz.
4, 5, 6, 7, 8. Cailloux montrant en section l'épaisseur du tuf.
9, 10. Cailloux à incrustations mamelonnées.
11, 12. Cailloux à incrustations mamelonnées montrant les coussinets isolés
ou confluents de Schizophicées : Scytonema turfaceum et Rivvlaria
hœmatiies et les petits thalles isolés d'une Chlorophycée: Coleochœle
pulvinata- Beine du Nord.
13, 14, 26, 27. Pierres à demi débarrassées de leur revêtement d'algues, mon-
trant la partie cariée sillonnée de galeries méandriformes.
15. Caillou sculpté de petites cupules coniques profondes au milieu de
galeries sinueuses.
16, 17, 18. Fragments des tufs à cupules du Roc de chère.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Cailloux débarrassés en partie de leur couverture
d'algues (Reine de St-Jorioz), cariés suivant des lignes irrégulièrement
divergentes (19) ou sinueuses (23, 24) ou suivant des lignes indiquant
les points de moindre résistance, veines alignées parallèlement,
favorables à la décalcification (20, 21).
28. Très bel exemplaire de galet sculpté méandriforme (côte de Chavoire),
29, 30. Types de cailloux à incrustations cérébriformes.
Echelle : Réduction de iji.
— 352 —
Roselières de Duingt-Saint-.Torioz;, les tiges des Joncs et des
Roseaux sont recouverts d'une couclie tufeuse (fig. 13-1); mêmesur le sol limoneux de cette région, s'étalent de larges i)laques
feutrées constituées par ce dépôt (fig. 13-2, 3).
Le phénomène ultime de désagrégation de ces tufs par l'action
des vagues joue un rôle important dans la formation des plages
au pourtour des beines, formées de sable fin où il y a mélange
par décalcification partielle d'éléments siliceux et de limon cal-
caire détritique provenant des concrétions. C'est ainsi que se
dépose cette variété de tufs lacustres en grains plus ou moins
gros, qui ourlent le bord des marécages d'Albigny ou les quais
des promenades du bord du lac en une sorte de cordon littoral
alluvionnaire.
Une importante formation est celle, toute spéciale, (pu borde
la muraille abrupte du Roc de Chère. Sur la côté S., avant d'ar-
river à la grotte des Oiseaux, commence à se dessiner une forte
corniche sous-lacustre que l'on peut suivre jusqu'au point où
l'abaissement des couches urgoniennes détermine une jjetite
plage au niveau du lac. Cette corniche reparaît avant d'arriver
à la faille occidentale, maisbienmoins marquée, pour disparaître
complètement avant la carrière des Bains de Menthon, où elle
est remplacée par la couche tufeuse qui recouvre uniformément
les cailloux immergés.
Cette corniche sous-lacustre s'étend à une profondeur variable
de 0'"60 à 1™20 en formant un surplomb horizontal do 50 centi-
mètres de largeur en moyenne. Le dépôt calcaire est solidement
fixé à la paroi rocheuse et va en s'atténuant en verticale, rayé
de stries ou vallonnements, à mesure que la profondeur aug-
mente. La drague emmanchée recueille encore des fragments
tufeux contre la falaise jusqu'à 2'"50 de profondeur. Au delà de
cette limite, on ne peut savoir ce qui se passe.
Le haut fond du Roselet qui fait face au Roc est entouré
d'une beine très réduite où végètent des Joncs ; là aussi existent
en quantité des cailloux sur lesquels l'incrustation tufeuse est
fortement développée.
Il en est de même sur le Crét de Chàtillon, où la profondeur
n'est que de 3™3, au large de Sevrier. En raison peut-être de la
profondeur trop considérable (8™6) sur le Crét d'Anfon, voisin
du premier, les tufs semblent absents sur ce haut fond.
353 —
Origine des tufs
En 1<S<,)1, DuPARC (1) donnait l'analjso cliimi(|U(' des eaux du
lacet constatait quo le résidu fixe était en moyenne de 0.1511,
tandis que les eaux devaient titrer 0.1991 environ de matières
dissoutes en tenant compte de l'apport des affluents. Il va donc
appauvrissement de 0.05 par litre.
L'explication de cette diminution du calcaire doit être clierchét'
dans le phénomène de la décalcification provoquée par la vie
organique. Il s'ensuit la formation de concrétions tufeuscs,
résultat du processus biologique de la végétation de certaines
algues qui décomposent le bicarbonate de calcium en dissolution
dans l'eau, t.n absorbant l'acide carbonique et en précipitant le
carbonate devenu insoluble.
Les eaux de surface sont également moins chargées en ma-
tières dissoutes que les eaux profondes. Cette différence provient
de ce que l'absorption de l'acide carbonique est plus intense à
la surface, en raison de l'insolation, d'où découle cette conclusion
que les tufs lacustres n'existent plus à partir de la profondeur de
six mètres.
On conçoit que par l'apport des affluents, par l'érosion et le
lavage des terrains, une certaine quantité de carbonate de cal-
cium se trouve en suspension dans l'eau du lac (2).
Les travaux de Tii. Schlœsing (3) ont montré (pie lors(pie
l'eau tenant en suspension un carbonate neutre terreux insoluble,
se trouve exposée à l'action d'une atmosphère plus ou moins
riche en acide carbonique, une certaine (|uantité de ce gaz est
fixée par le carbonate pour former du bicarbonate soluble. Inver-
sement si l'acide carbonique diminue dans l'atmosphère, du car-
bonate neutre se précipite. ScHLŒSiNG a ainsi établi qu'une loi
mathématique préside à ces phénomènes. « A chaque taux
d'acide carboni(|ue de l'air correspond une propoi'tion déterminée
de bicarbonate formé. Si ce taux croit ou décroit, la quantité de
(1) L. DuPARC, loc. cit., p. 24.
(2) Le carbonate de calcium est extrêmement peu soluble : 13 millig. en-
viron par litre d'eau à 16°.
(3) Th. Sciilœsing, «Contriljution à l'étude de la chimie agricole», Encydop.
Chimique, p. 14, et Compte rendu de l'Ac. des Se. 1872, p. 138.
— 354 —
Ijicarbonaio varie dans lo même sens jusqu'à ce (jue l'aeiclc carbo-
ni(|ue ail ac(|uis dans l'almosplière une tension donnée. ••
Or, les plantes aquatiques, de même que les végétaux ter-
restres qui décomposent l'acide carboni(|ue de l'air, s'empareni
avec énergie de la quantité d'acide carbonique contenu dans
l'eau, qui est le produit de l'oxjdation des matières organiques
et de la respiration animale ou végétale.
Elles se comportent rjthmiquement, pour ainsi dire, en con-
cordance avec la loi de Schlœsing en décomposant le bicarbonate
soluble dont l'acide carbonique et utilisé par ces végétaux qui le
réduisent pour s'assimiler le carbone sous l'action de la lumière,
et les échanges gazeux sont, dans la \ie des algues ])ar exemple,
particulièrement intenses au moment de huv reproduction.
Expériences sur les tufs lacustres
Capaciti' (Vabsorption. — Un fragment de tuf (i)ri-. sur la
Corniclie sousdacustre de Chère), abandonné, au sortir de l'eau,
sur papier buvard jusqu'à égouttement com})let pesait . 38^''50
Desséché à l'étuve son poids était de r2-''30
Quantité d'eau d'absoi'ption. . .20-''20
Soit (58.05 }). c. en poids de la matière humide.
Un autre échantillon (})ris sur la beinepi'ès del'Iledes Uygnes),
traité dans les mêmes conditions d'expérienc(î, pesait . 10-''203
Desséché à l'étuve, son poids était de 2^'''24o
Quantité d'eau d'absor})tion. . . 7-'^9(30
Soit 71.08 }). c. de la matière humide.
Aiialt/se (1) — La moyenne de trois analyses (pialitatives et
(juantitatives sur prises variant de 2 à 3 gi'ammes de matière
sèche, a donné :
Calcaire p. c. 62.32
• Silice 5.17 r ..p, o,>
Fer 0.(37
Matières organiques . . 31. KJ
Divers (alumine, oxvgè'ne uni
au fer . . . . . . . 0.(30 o])tenu })ar diflèrence.
100.00
(1) Ces analyses m'ont été très obligeamment faites par M. le prof. Guerby,
du Lycée d'Annecy.
— 355 —
La i)i'oportion considérable do silice est à remarquer. Elle
provient des silicates et des grains de sable décantés par l'eau ei.
aussi de l'énorme quantité de Diatomées contenues dans l'enduit
([ui recouvre les tufs. Le chiffre, également très élevé, des
matièi'es organiques est dû aux x\lgues, dont les filaments
vivants ou morts abondent dans ces concrétions.
Vitesse du dépôt. — En 1898, le 29 novembre, je retirais du
lac, à trois mètres tle profondeur à l'E. de l'Ile des Cygnes un
fragment métallique, débris de seau, en fer-blanc, recouvert
d'une couche uniforme de tuf. Pesé dans un vase taré remi)li
d'une quantité donnée d'eau, je notais un poids de 255 gr. 081.
Je replaçai au même endroit ce fragment en le déposant sur la
beine dans une boite en fer-blanc ouverte au sommet.
La hauteur des bords du récipient au-dessus du sol devait
empêcher l'apport des matières étrangères, sables, graviers, qui
auraient pu introduire des causes d'erreur.
kvi bout d'une année, le 30 novembre 1899, je retirais le frag-
ment de tuf. Pesé dans les mêmes conditions (pie pour l'expé-
rience initiale, le poids était de 272 gr. 277.
Le dépôt crustacé avait donc augmenté de 17 gr. 246.
La longueur du fer-blanc étant de 12 centimètres sur une
largeur de 5 centimètres; sur sa surface de 60 centimètres
carrés il s'était donc déposé gr. 047 de calcaire par jour dans
le courant de l'année.
Cette expérience, qui n'a évidemment pas toute la rigueur
désirable, donne donc en gros la mesure de la rapidité du];dépôt
qui, on le voit, est assez grande. On ne peut aller plus loin dans
les conclusions, car les données du problème ne permettent pas de
déduire la quantité totale de carbonate de chaux qui peut se
déposer dans les eaux du lac par le fait seul de la vie organique.
Pour un calcul exact, il faudrait évaluer toutes les surfaces
(comprises en dehors de la courbe bathymétrique de cinq mètres
où le dépôt des tufs peut se produire), qui sont recouvertes par
cette production. Or, il serait téméraire d'aiïîrmer (jue les algues
sont distribuées partout, dans cette zone, d'une façon uniforme.
Pour avoir une idée du phénomène général de décalcification
dans le lac, il faut provisoirement s'en tenir aux résultats de
l'analyse de Duparc (1) qui a démontré que le titre normal des
(1) Duparc, loe. cit., p. 26.
— 356 —
eaux devrait ôtre de 0,1001 au lieu de 0,1511, en tenant compte
de la décalcification. Le cliiffre do matières dissout(îS serait donc
de 223.688.850 kil., au lieu de 166.760.850 kil. O'c^st donc
53.028.001) kil. de calcaire (jui sont ])récii)ités par l'activité orga-
nique des algues.
Les Alg-ues incrustantes et cariantes.
L'étude microscopique d'un tuf lacustre est chose assez
délicate.
En présence d'un tel encroûtement (jui masijue les détails de
sa structure interne, on doit avoir recours à un réactif approprié
qui permette de se débarrasser du calcaire, c'est-à-dire à un
dissolvant agissant en même temps sur les végétaux qui y sont
contenus pour fixer leur plasma sans trop l'altérer.
Le liquide de Pezenyi répond à ces conditions (1). Un petit
fragment de tuf mis en contact a^-ec lui est au bout de quelques
heures parfaitement débarrassé de son calcaire.
On voit alors immédiatement que la masse est formée
d'innombrables filaments d'algues enchevêtrées qui sont des
Oscillariées. En général, les couches extérieures sont seules
vivantes ; dans la profondciur, on no rencontre que des gaines
vides. Les mélanges d'espèces constituent la grande diiïiculté de
ce travail; il faut essayer de les isoler au moj'en d'aiguilles extrê-
mement fines.
L'examen macrosco})i(|ue d'un tufapporte uneautre notion essen-
tielle. Si l'on fait une section au couieau, l'instrument traverse
d'abord une couche spongieuse, puis atteint une partie où le
dépôt devient liomogène, blanc crayeux et de consistance caseuse,
pour arri\er à la région intacte de la pierre (pii a servi de base à
l'incrustation. On trouve encore dans cette région altérée des
débris de gaines.
Voici donc un deuxième phénomène marqué i)ar une carie
très nette de la })ierre.
(1) Je dois à rextrèine obligeance de M. Gomont la technique relative à ces
algues et l'indication du réactif employé par lui :
Acide chromique à 0,5 p. c 3 part.
Acide azotique à 10 p. c 3 part.
Alcool 3
BoLLES Lee et Henneguy, Traité des tnéth^dcs techniques, 2' éd., p. 41.
_— 357 —
Enfin, dans certains cas, la couche concrétionnée est déblayée
par des causes mécani(|ues (juelcon(|ues, elle ne se montre jjIus
(|ue par ilôts démantelés. La surface de la lùei'i'c, mise ainsi à
nu, est sillonnée de pistes méandriformes, sortes d'incisions
riibanées de profondeur variable; elle est aussi parfois perforée
de cupules. C'est le troisième stade du cycle évolutif des tufs
lacustres, représenté par les galets dont les sculptures sont dues
aloi'S h l'intervention d'autres agents secondaires.
La Sehizotrieaie. — Les principaux agents de; la formation
des tufs lacustres et de la carie des pierres sont des algues Sclii-
zophycées rentrant dans le genre SdiizofhrLr s. g. Innciis et
Hijphœothrir des Nostocacées liomocystées (1).
Si on considère le type de végétation des concrétions calcaires
et les espèces qui concourent à les produire, on est amené à
reconn ^ itre un autre groupe d'associations nncropliyti(|ues : la
ScHizoTRiCAiE, ayant pour habitat la zone balhymétrique de () à
mètres répartie à peu i)rès sur (out le littoral.
Afin de donner un aperçu floristiijue des tufs lacustres, je ne
saurais mieux faire que de dresser la liste des associations types
les plus fréquentes relevées sur 19 échantillons provenant de la
beine nord et de la corniche du Roc de Clière qui ont été
soumis à l'examen de M. Gomont et ont été déterminés par lui.
1. Rirulai-ia sp.
2. Tohjpoth'ix proxim T. Hinbatit, Thuret, mais bien
distinct de cette dernière espèce par ses filaments rampants, très
diftérents par leur structure des rameaux dressés. Probablement
sp. nov. (2).
3. Caîothrix fiisca Borne t et Flahaut.
4. Dichotrix gijpsophila Born, et Flahaut.
Mixta. Shizotlirix lateritia Gom =^ Ili/drocaleinii
calcilegum Braun.
5. Rinûarln hœmatites Agardh = Euact'is calc/rovd
A. Braun.
Mixta. Rivuh(.ri(( Biasolettiand Meneghini.
(1) Gomont, " Monographie des Oscellariées ». Ann. des Se. )iat. bolanique,
T ser.,t. XV et XVI.
(2) Le temps m'a manqué pour recherclier des échantillons tle cette alyue,
qui mérite un examen approfondi
.
— 358 —
et 7. Toh/pothrix proxim. limbata.
8. Rivularla Biasoleltiana Menegh.
9. Scytonema densum Bornet.
DichotriûC Orsiniana Born. et Flah.
Stigonema infurme Ktz.
Schizothrioc lateritia Gom.
10. Stigonema informe Ktz.
Schlzothrix lateritia Gom.
11. Rivularia hœmatites Agardli.
12. Stigonema informe Ktz.
Sci/tonema myochroiis. Agardli.
densum Bornet.
SchizotJwix lateritia Gom.
13. 14, 15. Schizotrix lateritia Gom.
Stigonema informe Ktz.
16. Schizothrix lateritia Gom.
Stigonema sp.
17. Schizothrix fascicidata Gom.
18. Schizothrix fascicidata Gom.
Dichotrix gypsophila Born. et Flaii
19. Schizothrix fascicidata Gom.
lateritia Gom.
Ces deux dernières constituant de grosses masses calcaires sur
la corniclie du Roc de Chère.
Les Schizopliycées cariantes sont surtout Schizothrix lateri-
tia, S. fascicidata, Rimdaria hœmatites et R. Blassolet-
tiana. Il faut y ajouter, dans certains cas assez rares et à titre
très accessoire, Gongi'osira codiolifera Chodat, dont on ren-
contre parfois les taches vei-dàtres sur les cailloux de la beine.
Sur toutes les concrétions tufeuses s'installent, en outre, les
coussinets plus ou moins incrustés des autres algues habituelles
du littoral : Stigonema turfaceum Cooke = Scytonema tur-
faceum Cook = Sirosiphon pidvinatas Breb. (pi. IV-2 et
fig. 13-12-11).
Scytonema alatmn Borzi= Petalonemaalatnm Berkeley.
Gloeotrichia natans Rab.
Associés aux thalles de Coleochœte pidimiata A. Braun,
l)resque toujours i)résente et à Nostoc commune Vauch.
— 359
Les galets sculptés.
J'ai longtemps ignoré l'existence des galets sculptés dans le
lac d'Annecy. Leur découverte est toute récente. Elle est due, en
etiet, à la longue période de sécheresse de 1906, pendant laquelle
les beines, ainsi que la corniche tufeuse du Roc de C]ière,ont été
mises au jour sur une large étendue, facilitant aussi l'exijloration
de régions inaccessibles en temps ordinaire. J'ai donc pu étudier
sur place la biologie des concrétions tnfeuses, poursuivre les
observations au laboratoire sur des (''chantillons intacts et bien
vivants. La planche ei-jointe réunit h^s exemplaires les plus
typiques (tig. L3).
Le problème de la carie des pierres et de la sculpture des galets
est, parmi ceux concernant la biologie lacustre, l'un des plus
captivants.
De nombreux travaux ont été publiés à ce sujet. L'énoncé de
cette copieuse littérature encombrerait inutilement le présent
mémoire ; il y a lieu de renvoyer le lecteur au 3° volume du
Léman, oîi Forel a lumineusement exposé l'état actuel de la
question (1).
Parmi les principales explications des divers auteurs, dont
toutes s'accordent à peu ])rès sur un seul point : l'action incrus-
tante des algues et qui, à côté, invoquent dans la généralité du
i)rocessus biologique l'intervention préalable ou ultérieure
d'autres agents cliimiques ou mécani(|ues, il faut retenir les sui-
vantes :
FoREL considère les Cyanophycées des tufs comme simplement
incrustantes, mais non perforantes. Si, par l'action des vagues, la
couche organique formée par les algues est enlevée, l'eau chargée
d'acide carbonique dissout chimiquement la pierre. Il démontre
en outre, par des expériences ingénieuses, que les sillons sont
creusés par les larves de certains insectes Névroptères(Tiwo(:Z6?5);
que ces sillons sont dénudés et que les crêtes séparatives seule-
uicnt sont garnies par les coussinets d'algues.
KiRCHNER (2) adopte à peu près les mêmes conclusions, mais
le creux des sillons est, d'après cet auteur, rendu plus profond
(1) F.-A. FuREL, Le Léman, vol. III, pp. 386 ù 405.
[2) ScHRiETER u. KiRCHNER, Die Vecjetation des Bodoixees. 189(5, |i.47,Tar. II.
- 360 —
par l'action dissolvante do l'eau qui agit consécutivement sur
ces sortes de couloirs dus à la coi'rosion produites par les larves.
Chodaï(I), (|ui a également étudié attentivement les tufs
lacustres, constate que le revêtement algueux est continu; les
sillons, comme les ci'étes, sont recouverts d'une incrustation à peu
près d'épaisseur égale.
D'autre part, si on aplanit au couteau la surface du caillou
après avoir enlevé la couche friable, on voit dans cette dernière
une apparence marbrée déterminée par un semis de veines vertes
rampant sur le fond grisâtre de la pierre. Il y a pénétration de
l'algue dans la masse de la pierre. '• Au contact de végétaux
cariants, cette dernière devient plus friable et plus blanche ; en
certains points, la pénéti'ation des algues est plus forte et alors se
dessine une l'acine v(?rte autour de laquelle le calcaire est progres-
sivement attaquée. " Les larves viennent ensuite désagréger la
masse cariée.
Enfin Wesenberg-Lund (2) dit (pie les algues commencent
l'attaque do la pierre* plus tard, les animaux viennent creuser les
sillons en déblayant la surface corrodée. Il ajoute que la corro-
sion n'est pas localisée seulement sur les calcaires, dans les lacs
du Danemark, mais que les silex mêmes sont atteints.
Mes observations viennent d'aboi'd absolument confirmer les
vues de Chodat, car j'ai souvent rencontré sur les cailloux tufeux
de la beine la zone cariée en profondeur et complètement recou-
verte d'une couche d'algues ininterrompue (fig. 5, G, 7, 8).
Voici d'ailleurs une observation qui est assez instructive.
Sur la face Sud du Roc de Chère, un peu à l'est d'une des
grottes où GuiNiER a constaté la présence inattendue de l'Adimt-
lum capillus Veneris, se montre un ressaut de la falaise
rocheuse recouvert en temps ordinaire de r"20 d'eau. En octobre
1900, cette corniche était immergée et on pouvait voir à sa sur-
face de curieuses cupules (fig. 16, 17, 18). La baisse extraordi-
naire des eaux a d'ailleurs permis de prendre une photographie
-de leur ensemble (pi. III-l).
A droite et à gauche de ce point, la corniche tufeuse est en
place plus ou moins érodé(^ par le choc des vagues et l'enduit
crustacé habituel recouvre les parties où la roche n'est pas
(1) 11. CiKMJAT, Etudes de biologie lacustre, p. 112.
(2)Wesenb«ug-Lund, Sludier oi^erSoekalk. Bœnnema'vi o(j Socgytje i dmiske
Indxœer. Kjobenhavn 1901.
— 361 —
dénudée. Les dépressions ou creux circulaires mesurant 5 à
10 cent, de diamètre sont rapprochés et séparés par des arêtes
irrégulières sur lesquelles reposent de minces coussinets
d'algues. Le fond des cupules montre la structure ordinaire de
la roche.
Tout près de là, des concrétions tufeuses étaient en place, plus
spécialement localisées en des sortes de coussinets saillants à la
surface de l'enduit général, ayant les mêmes dimensions que les
cupules. Avant gratté l'un des coussinets, je remarquai qu'à, une
profondeur de 2 à 3 centim., la structure de la roche se modi-
fiait. Celle-ci apparaissait plus molle, comme crayeuse, en un
mot, cariée. Lorsque le couteau avait enlevé totalement cette
couche, une cupule se dessinait, montrant au fond la pierre com-
pacte et inaltérée.
Les intervalles ou crêtes séparant ces dépressions sont recou-
verts d'une mince couche d'algues jeunes, tandis que les larges
coussinets sont formés par une agglomération de Schizothrix
lateritia, S. fasciculaia associés à RivulmHa hœmatites et
R. Blasolettiana dont les colonies se multiplient avec une
activité plus ou moins grande et concourent toutes ensemble à
l'attaque de la roche.
Par quel mécanisme la carie se fait-elle? L'hypothèse de
Chodat est assez ingénieuse : « Ne se pourrait-il pas, dit cet
auteur, que les Schizothrix et autres Myxophycées eussent la
propriété de prendre le CO- du calcaire même qu'elles habitent en
le transformant en Ca(OH)^ lequel, par l'acide carbonique excrété
par la respiration et contenu dans l'eau, se transformerait selon
le temps et les circonstances en carbonate de chaux de seconde
formation? «
Il est difficile d'expliquer le phénomène, mais l'observation ci-
dessus relatée met en lumière le rôle très net et indiscutable de
la carie des pierres par un processus de décomposition crayeuse
dû à l'activité biologique de certaines algues. Puis des phéno-
mènes successifs apparaissent. Par une cause quelconque, le
revêtement vivant ou mort des végétaux qui formaient mamelonsur la pierre a été déblayé, l'action mécanique des vagues, unie
au pouvoir dissolvant de l'eau, a entraîné la matière pierreuse
altérée et devenue friable, et par lavages continus le fond de la
cupule est nettoyé montrant à nu la roche intacte.
362 —
Biologie des tufs lacustres et des cailloux sculptés.
Voyons maintenant comment il faut comprendre la g'cnèse des
tufs lacustres et la sculpture des galets.
Il est incontestablement établi que des algues spéciales {Schi-
zophycées) décomposent par leur activité biologique k; calcaire
contenu en dissolution dans l'eau, à l'état de bicarbonate de
calcium.
Elles s'emparent de l'acide carbonique et laissent précipiter le
carbonate de calcium insoluble qui se dépose au milieu des fila-
ments d'algues pour former un coussinet pierreux.
Entre le premier dépôt formé par les algues incrustantes et
l'état de sculpture des galets, qui est le terme ultime du pro-
cessus biologique des tufs lacustres, il y a place pour des opéra-
tions successives exécutées par plusieurs agents, d'abord hsalgues, puis les (inimaux, concurremment avec certaines
actions mécaniques ou physico-chimiques résultant du milieu
ambiant.
Considérons un tuf en formation représenté par un caillou où
se sont accrochés quelques-ims des cousinets isolés des algues
Schizolhrix laterUia, S. fasciculata, qui décalcifient l'csau
avec énergie et sont surtout les agents les plus actifs de la carie
des pierres.
Deux jeunes thalles élémentaires, formés de nombreux tri-
chômes enchevêtrés, s'installent à peu de distance l'un de l'autre
(fig. M-1 en A et B).
Par suite de l'accroissement végétatif, les deux coussinets se
rapprochent et finissent par confluer (fig. 2) pour arriver, au bout
d'un certain temps, à n'en former qu'un. Par la réunion de nom-
breux coussinets on arrivé au stade mamelonné des concrétions
tufeuses.
Les parties vivantes des algues sont tout à fait à la périphérie,
tandis qu'à mesure que celles-ci vieillissent, les filaments les plus
anciens et les plus internes meurent et se réduisent à d(.'s gaines
vides (fig. 3.)
Mais il faut considérer en même temps que pendant toute la
période de l'activité biologique de la plante, la c(u-ie superl'iclelle
de la pierre s'est effectuée et qu'elle est d'autant plus profonde
aux points où les filaments sont depuis i)lus longtemps fixés. Ona donc des points de moindre résistance en A et B déterminés
— 363 —
par une carie plus intense et tout préparés à un action efficace
d'érosion de la part de certains agents mécaniques ou chimiques.
Il y a donc dans ce premier stade un processus tout à l'ait
com]jarable à celui qui caractérise la biologie bien connue des
Sphagnum : leur développement, la mort des touffes les plus
anciennes et la formation consécutive de la tourbe.
Fig. 14. — Figures schématiques montrant le processus de la carie des
pierres consécutive au développement des algues incrustantes.
Explication de la figure. — Les filaments des algues en pleine activité végé-
tative sont indiqués par des traits pleins ; les algues dépérissantes ou mortes
par des traits discontinus ; la partie cariée de la pierre est limitée par un
pointillé.
N'est-il pas en outre curieux de remarquer que, dans ces cous-
sinets d'algues, les couches extérieures de la masse sont seules
vivantes, tandis que dans les couches profondes on ne rencontre
que des gaines?
S'il était possible de comparer des formations naturelles d'une
importance aussi inégale, on pourrait dire que ces masses pier-
l'euses d'origine végétale ressemblent à celles que forment les
coralliaires dans les récifs madréporiques.
— 364 —
Si on rccneille des tufs lacustres et qu'on les maintienne en
observation dans un cristallisoir, on remarciue bientôt dans
toutes les anfractuosités de ces concrétions une extraordinaire
agitation. De nombreux animaux se meuvent, viennent nager
à la surface, puis s'abritent dans les creux et rampent dans
les galeries sinueuses à la recherche de leur nourriture, sous le
couvert des buissons pierreux.
Ce sont d'abord Gammariis flumatUis et G. Dclebecqaei,
dont les pattes aux griffes rigides et le corps muni d'une dure
carapace contribuent, par leur frottement continuel, à l'agran-
dissement des galeries.
Puis de petits Coléoptères aquati([ues cheminent en tous sens
dans ces sentiers méandriformes : Pkctawbus maculatus,
Riolus cuprens, Laccobius 7mmttif,s (1) et ses nombreuses
larves qui accomplissent leur développement dans les réduits
obscurs des tufs.
On trouve en outi-e, en abondance, une très petite Phrygana
sp.? qui construit son tube mobile avec les éléments détritiques
très fins des galeries ; mais celles-ci sont vraisemblablement des
ou\rières de la dernière heure et dont le rôle esl très secondaire.
FoREL, dans sa théorie des cailloux sculptés des lacs suisses,
avait attribué la sculpture de ces pierres à l'intei'vention d'une
grande Phi'jgane Tin odes.
J'ai retrouvé ce nevroptère, ou plutôt Hijdropsi/che maculi-
coi'/iis Pictet, en abondance au lac d'Annecy. Cette larve attache
son fourreau serpentiforme à la surface de& pierres dénudées
de la beine Nord, mais cet organe est simplement appliqué sur la
roche et ne détermine pas, ainsi que j'ai pu m'en assurer maintes
fois, la moindre érosion à sa surface. Il faut donc considérer
ici comme nul le rôle de l'Hydropsjché dans la sculpture des
galets que l'on doit attribuer, sans nul doute, poui' partie et
comme action finale, à l'intervention des animaux dont il est
parlé plus haut.
Les sillons sont à peu près déblayés d'algues, tandis que les
crêtes en sont pourvues, fait qui concorde avec celui énoncé par
FoREL. L'examen des figures 4, 5, G, montre clairement comment
les coussinets d'algues arrivent à se réunir en laissant aux points
(1) Je dois la détermination de ces Coléoptères à un spécialiste, le D' Regim-
BAHT, d'Evreux, que je suis heureux de remercier ici de son obligeance.
— 365 —
A et 1), pai' suite de la mort des algtuis, place à la (lésai^'réiiatioii
par l'action mécanique des eaux, peut-être aussi par une action
ciiimique et au passage ultérieur des animaux qui se chargeront
de déblayer les matériaux.
Les parties externe et médiane sont recouvertes par les coussi-
nets jeunes, tandis que les parties a et h, formées d'algues
anciennes et mortes, sont déblayées. On arrive en définitive à
comprendre la disposition des algues sur les crêtes de la pierre,
tandis que les sillons a et h en sont dépourvues.
L'action chimique, encore inexpliquée, est d'ailleurs indé-
niable, si on considère la planche 13-19, 20, 21, qui montre des
cailloux en partie débarrassés de leur revêtement algueux où la
décalcification s'est produite en suivant les lignes de stratification
de la pierre, jalonnées par des veines de substance plus atta-
quable.
Résumé des associations végétales du lac d'Annecy
Il est maintenant utile de prendre une vue d'ensemble des
groupes d'associations végétales, en distinguant les régions
d'Iiabitat (unités topographiques) et les associations ty})es ou
représentatives (unités biologiques).
En tenant compte de la terminologie et des notions établies
[)ar AVarming et Drude, des travaux de Schrôter et Kirchnersur le Bodan, de Magnin (Lacs du Jura, p. 132), de Pavillardsur l'étang de Thau, en les complétant par des observations
pei'sonnelles, on peut établir pour le lac d'Annecy le tableau
suivant :
— 3fi6 —
FORMATIONS
ZONES D HABITAT
GROUPES
d'associations
ASSOCIATIONS
REPRESENTATIVES
1^ Bi
Flore littorale.
Benthos littoral
IIaeckel.
Plantes des Rives.
Amphiphytes des marais.
Roselières.
I Rohrsiimpfe (Waeming).
Limnopliytes.
Limnées {Warming),
Tufs lacustres.
Néréides (Waeming).
Flore profonde. \ Schizophycées.Benthos profond
l (Waeming).Haeckel.
'S 2 1a) Macropliytes
b) Micropliytes.
5 '"'
1
.
Ilydrocharites émergées
(Waeming)Pleuston nageant.
2. Ilydrocharites immer-
gées (AVaeming).
Pleuston flottant.
Conjuguées filamenteuses
entraînées à la surface du
lac. Organes des plantes.
(Poils des platanes^ Pol-
len, Zygospores).
Saulaie,
Caricaie
(magno-earicaie)
Scirpaie.
Pliragmitaie.
Potamaie.
Charaie.
Tolypotricaie.
Chlorophycaie.
Desmidiaie.
Diatomaie.
Scliizopliycaie.
Lemnaie.
Ceratopliyllaie
Utriculariaie
.
Zygnemaie.
Aulnaie.
Molinaie.
Bryophytaiê.
Equisetaie.
Heleocharaie.
Typliaie.
Pliragmito-
Scirpaie.
Nupliaraie.
Myriopliyllaie.
Pulygouaie.
Scliizotricaie.
Oscillariaie.
Spirogyraie.
Plantes flottantes.
fPhi/toptmicton.)
LimnojJÏanctoit
IIaeckel.
peeiodicite :
Hiver :Diatomo-Schizophycaie.
Région Printemps : Ceratio-Asterionellaie.
Eté : Peridinio-Chloropliycaie.
Automne : Pediastro-Cyclotellaie.
pélagique.
^ç^^
— 367 — /^ -^ -«fc-»^ ^\^
L I B R A R Y
A.
IX
liA FAUNE LITTORALE
A. — LES INVERTEBRES
Les animaux qui composent les foules innombrables de la faune
flottante, ceux qui peuplent les eaux profondes vivent dans des
conditions d'habitat toutes différentes de celles qui caractérisent
la région littorale.
Plus ou moins près de la rive rampent sur le limon les êtres
inférieurs, Amibes, Héliozaires. Dans l'enduit muqueux des cail-
loux submergés et des tiges de roseaux s'agite tout un monde
d'Infusoircs, de Nématodes, de Tardigrades, et de Rotateurs.
Sur les gazons de Chara reposent les curieuses boules gélifiées
des Ophrydium
.
Dans les anfractuosités des cailloux tufeux de la beine se
meuvent de nombreux Crustacés, des larves et des Coléoptères
aquatiques ; au milieu d'eux, les industrieuses Phryganes cons-
truisent leurs tubes. Parmi les Cliara ou sous les feuilles des
Lentilles d'eau, les Hydres balancent leurs tentacules, et de place
en place s'érigent sur les cailloux de rares colonies d'Epongés.
D'autre part, les Bryozoaires appliquent étroitement leurs arbus-
cules sur la muraille des rochers abrupts submergés, sur les
pilotis ou la carène des bateaux. Des Hydraclmides })arés de
vives couleurs cheminent au milieu des plantes aquatiques ; les
Ostracodes sillonnent paresseusement le limon à la surface
duquel ram})ent les Planaires. Sur le sable de la beine reposent
les coquilles d'Anodontes, tandis que les Pulmonés s'accrochent
aux cailloux ou rampent le long des tiges aquatiques.
Rhizopodes, Héliozoaires
A))iœba proteus Leidy. Enduit des Phragmites et sur les
tufs, parmi les Vorticelles.
Hyalodiscus Umax Duj., enduit des cailloux.
— 368 —
BïfffAUjia lohostoma Leidy., sur les feuilles des Myrio-
phjlles.
Actinosphoe7''ium Eischornii Eliv., enduit des Roseaux
et des cailloux.
Infusoires
Carchesium polyinnum Elir., sur les feuilles des Myrio-
phylles.
Vorticella cmnpanula, id.
Acineta grandis Kent., sur les filaments de Tolypothrix.
» linguifera Clap. et Lacli., id.
Colpoda cucullus 0. F. Millier, parmi les Cladothrix sur les
figes de Roseaux en décomposition.
Coleps hirtus 0. F. Miiller, sur l'enduit des Roseaux.
Voi'ticella nebulifera 0. F. Miiller, sur l'enduit muqueux
des cailloux.
Ophrydmm versatile Ehr., var., «cfm/z.s Roux., en boules
gélifiées sur les gazons de Cliara.
Chilodon cuculMus 0. F. Millier, enduit des Roseaux.
Paramœciumbursaria Ehr., id.
Metopus sigmoides Clap. et Lacli., id.
Lionotus anser 0. F. Miiller, enduit des cailloux.
Halteria grandinella 0. F. Miiller, id.
Spongiaires
Eupongilla lacustris L., en petites placjues lichenoïdes, tou-
jours petites et rares, sur les cailloux de la beine nord (1).
Hydroides
Hydra vulgaris L., avec ses variétés H. fusca, L. //.
ruhra, L. R. viridis L., sur les plantes aquatiques, Lemna,
Chara, Myriophylles.
(1) Une autre éponge, Ei^hydatia fluviatilîs kucX. , se développe, certaines
années en abondance, dans le Thioux, émissaire du lac.
— 369 —
Turbellariés
Microstomum lineare Ocrst., onduit dos pierres.
Vorteœ scojmrmsO. Schm., id.
truncatus Ehr., sur le limon.
Polycelis nig^rc Ehr., sous les pierres,
Detidrocœlmn lacteum Oest., id.
Mesosto7na Imgua 0. Schm., id.
Cestodes
Dihothriiun Hgula Donn. = Ligit/ff su/iidicissujin Auct.
parasite du Chevaine et du Gardon.
Nematodes
Dorylahnus stngnaJ is Duj., enduit dos Roseaux.
Gordius aquaticus L., marécages d'Albignv.
Annelides
A. Choetopodes.
Tuhifex rivulorutn Lam., dans le limon.
Nais elinguis 0. E. Millier, enduit des Roseaux.
IwohosckleaO. F. Miillor, id.
B. Hirudinées.
Haemojjis sanguisuga L., côte d'Albigny.
Clepsine Moculata Sav., sous les pierres.
Nephelis vulgwis Moq. Tand., id.
Rotateurs
Philodina roseo/ft Ehr., enduit des cailloux et dos Roseaux
parmi les Phoi-midium favosum et Retzii.
Rotifer vnlgaris Schrank., enduit des cailloux et des Ro-
seaux.
— 370 ---
(JopcHS lahidtns Gosso, onduil dos cailloux et des Ivoscaux.
ProLÛcs pctvomyzon Elir., id.
Diglena forcïpata Ehr., parmi les •Conjuguées filamen-
teuses.
Eiichlanis macrura Ehr,, enduit des cailloux.
Monostyla lunaris Ehr., id.
Colurus hicuspidatus Ehr., id.
Metopjidia solidus Gosse, id.
Mastigocerca lopjhoessa Gosse, parmi les Spirogyros.
Bryozoaires
PliunatcUa repens h., sur les pierres, dans les grottes sub-
mergées et obscures du Roc de Chère.
Crustacés
Simocephalus vetidus Schoedl., parmi les Conjuguées fila-
menteuses.
Acrcqjerus leucocephaliis Baird, = A. harpae Baird.,
parmi les Spirogjres.
Pleuroxus hastatus Sars., parmi les Spirogvres.
Chydorus sphoericus 0. F. Miiller, id.
Cypji'is fasciata 0. F. Miiller, boue des Cliara.
fitscata Jurine, parmi les toutfes de Zjgnema.
C'i/cloct/jjiHs serena Koch., dans les gazons de Cliara.
Canthocamptus staphi/linus Jurine, id.
Gammarus fluviatilis Roesel, cailloux de la beine,
» Delebecquei Chevr. et de Guerne, id.
Tardigrades
Macrobiotns mao'unyœ L)uj., enduit des Roseaux.
Hydraehnides
Atax craasipes 0. F. Miiller, })armi les plantes aqua-
tiques.
— 371 —
Rj/rp'obafes lo//r/ip(f/pis Herm., Kon., parmi les plantes
aquatiques.
Limnesia pardina Neuman.» histrionica Bruz.
Mollusques
A. Gastropodes,
Limnaea stagnaiis L., parmi les Roseaux, sur les pierres.
» auiHcularia L,, parmi les Roseaux à Albigny.
» parvula Locard (1), pierres à Menthon.
" 2)ereg)'a Millier, sur le littoral de la partie Nord.
palustris Millier, id.
Pkmorbis marginaius Drap., partout sur le littoral.
carinatus Miiller.
anstatus L. rare, amené probablement d'un ruis-
seau.
Valvata piscinaUs Miiller, beine Nord.
opaca Dumont et Mortillet, au test éburné, brillant
et complètement opaque (2), mais qui pourrait bien être une
variété locale.
Ancylus fluvlatiUs Miiller, sous les pierres et parmi les
Roseaux.
Bithynia tentacidata L., parmi les gazons de Chara.
B. Lamellibranches (3).
Anodonta anatina L., en quantité sur la beine nord et
les Roseaux d' Albigny,
Anodonta. anatina var. major L., en quantité sur la beine
nord et parmi les Roseaux d'xVlbigny.
(1) Quelques exemplaires ti'ouvés sur littoral de Menthon proviennent du
déversoir de la source sulfureuse, située à quelques centaines de mètres de
distance, où cette espèce est abondante. Il est intéressant de noter que l'action
sulfureuse paraît avoir été nulle sur cette espèce, assez polymorphe (Détermi-
nation Locard.)
(2) G. Mortillet, •' Une coquille spéciale au lac d'Annecy ". Rev. Sav. 1892,
p. 251.
(3) Unio pictoviim L. ne se rencontre pas dans le lac, mais il se trouve dans
son émissaire, le Thioux.
— 372 —
A7iodonta Cijgnca L., en (jiianiit('' sur la hciiic non! et
l)armi les Roseaux d'Albigny.
Pisidmm amniciim L., sur les fonds tufeux de la beinc et
dans les Chara.
Sphaeriumcorneiun L., sur les fonds tufeux de la beine et
dans les Chara.
Insectes
A. Coléoptères.
Comme dans tous les grands lacs, les Coléoptères aquatiques
sont peu nombi-eux en espèces On y trouve :
Agabus bipustidafHS L.
Laccobius mimitus et ses larves, dans les anfractuosités des
tufs.
Riohis cupreus Germ., id.
Platambus maciilatiis Fab., id.
Halypjlus fhiviatilis Aube, parmi les plantes aiiuatiiiues. .
Hydrojjorus paîustris L.
Dytiscus marginalis L.
Quelques Coléoptères vivent au bord des eaux :
Elapjhrus uliginosus Fabi\, dans les marécages, sous les
feuilles.
Odacantha melanura L., ])armi les Roseaux.
Harpjalus azureus Fabr., sur le bord du lac.
Bembidium SturniH L., sur la vase.
Sur les Iris pseudacorus vivent en quantité Haïtien pseii-
dacori.
B. Névroptères.
Limnophilus rho?nbicus L., larves, parmi les gazons de
Chara
Hydrop)sychc sencx Pictet, id.
» tnaculiformis Pictet, appliquent leurs tubes
sur les piei'i'es de la beine.
Plwyganen minor Ct, dans les anfractuosités des tufs
lacustres.
— 373 —
C. Hémiptères.
Notonecla yîaiica L.
Naucoris cimicoides L.
Nepa cinerea L.
Ranatra lïnearis L.
l). Névroptères
LiheUula ruUjdhL L.
quadrimaciildld L.
Açp'ioii })iicUa L.
hastalatiun Ch.
Cloeon (lipferum L.
Oeschna afflnis L.
Epliemera mdgata L.
Nemura vurlegaid 0.
E. Diptères.
Corenirti pliDnicoi'iùs Falji'., larves sur le liinoii.
(7ii)'())i<)j)it(S ])liuR0.sns L., lur\('s, liil)(>s sur les cailloux de
la beino.
Tanypiis varins Fabr., larves sui- le limon.
B. — LES VERTEBRES
Mammifères
Quelques rares mammifères, en raison de leur genre de vie,
habitent les rives du lae. Ce sont toutes des espèces de la plaine
ou fréquentant les cours d'eau, qui viennent chasser au bord des
eaux :
Lntra vulgaris Erxl., Loutre.
Arvicoki amphiblas L,, Rat d'eau.
Mus decumanus Pallas, Snrmulot.
Crossopus fodiens Pallas, Musaraigne d'eau.
Vespertilio ingstaclniis Liesler, Vespertilion moustac.
374
Oiseaux
Rapaces.
Falco haliœtus Temin. Aigle pêcheur; printemps.
Circdelus gaUicus Vieil!., Aigle Jean le Blanc; de passage,
niche dans les rocs de Veyrier et de Chère.
Milvus (lier Briss, Milan noir; niche au i)rintemi)S au mont
Veyrier.
SfriiV aluco L., Chouette Efiraie; vieux murs au bord du lac.
Passereaux.
Hirnndo riisUca L., Hirondelle de cheminée ou ordinaire.
" urhica L., Hirondelle de fenêtre ou Cul blanc.
rijjciria L., Hirondelle de rivage.
Les dates d'arrivée et de départ des hirondelles sont variables,
ainsi qu'on le verra dans le tableau suivant mentionnant des
observations dejjuis 1893 :
Dates d'aurivée
1893 2 mars,
1894 15 avril.
1895 30- mars, en masse du 1" au
10 avril.
1896 10 au 19 avril
1897 13 et 28 avril.
1898 5 avril.
1899 30 mars; en masse 10 avril.
1900 20 au 23 mars.
1901 18 avril.
1902 10 avril.
1903 30 mars.
1904 1" avril.
1905 10 avril.
Dates ue départ
25 septembre;passages les 3, 4 et
10 octobre.
15 septembre; passages les 5 et 15 oc-
tobre .
14 et 15 septeml)re.
() octoljre.
11 octobre.
7 octobre.
15 octobre.
17 octobre.
16 octobre.
19 octobre.
30 octobre.
23 octobre.
9 octobre.
Alcedo hispida L., Martin-pêclieur.
Ciuclus aquatlcus Bechst., Merle d'eau ou Religieuse.
Calamoh&P'pe palustris Bechst., Rousserolle des marais,
Rossignolet.
— 375 —
Calamoherpe arundinacea do S. Longcli., Ronss(n'olle des
Roseaux.
CMlamoherpe phragmita de S. Longcli., Rousserolle plirag-
mite.
Motacilla alba GmeL, Bei-geronnotte grise.
Échassiers.
GaUinago média Leacli, Bécassine ordinaire.
major (jmoX., ^' double.
Charadrhis squatarola L., Vanneau pluvier.
morinellus L., - guignard.
Vanellus cristatus Mej et Wolf, Vanneau huppé.
Ardea garzetta L., Héron garzette.
stellaris L., •' butor.
Ardetta m'mida L., Héron blongios.
Nyctlcorax gtnseus Strickl, Héron bihoreau.
ardeoJa Temm., Bihoreau à manteau.
Totanus calidris L., Chevalier gambette.
glottis Bechst., Chevalier aboveur.
Hœmatopus ostralcgus L., Huitrier pie.
Rallus aquaticus L., Râle d'eau.
p07'zana VieilL, Râle marouette.
Gallinula chloropus L., Poule d'eau ordinaire.
FuUca atra L., Foulque macroule.
Palmipèdes.
Cijgnus olor L., Cjgne tubercule, domestiqué, ajauL produit
une année des Cygnets faux albinos (1).
Anas boschas L., Canard sauvage.
" acuta L., Canard pilet.
" c^«;^r/it/ft L., Canard garrot.
« o'ecca L , L., Sarcelle d'hiver.
Spatula clypeata L., Canard souchet.
Anser cmereus Meyer, n'apparaît (|ue dans les hivers très
rigoureux. Un passage d'oies sauvages en grand nombre a été
constaté sur le lac complètement gelé, en février 1891.
(1) FouEL, Le Léman, t. III, p. 309. (Etude sur les Cygnets laux-albinos
du Léman.)
— 376 —
Mergus serrntor L., Harle huppé.
L(i7'us ?'idibnrtdu.s L., Mouette rieuse.
flavipes L., Mouette à pieds jaunes.
Sterna flui'iatUis Naum., Hirondelle de mer Pierre Garin.
nigixi Boie, Hirondelle épouvantail.
Curbo coî^moranus Mejer, Grand cormoran.
Podiceps cristatus L., Grèbe huppé.
)jiinor Gm., Grèbe cartagneux.
Coh/mlnis glacialis L., Plongeon imbrin.
» (irrficffs L., •• lunune.
Reptiles
On peut considérer comme faisant partie de la i)Opulation
lacustre, à titre erratique, les espèces suivantes, très fréquentes
sur le littoral et dans les marais ou qui nagent souvent dans les
eaux du lac (côtes d'Albigny, de Saint-Jorioz) :
Tropidonotus natrix L., Tropidonote ou Couleuvre à collier.
Tropidonotns riperinus Lat., Couleuvre vipérine ou Vipère
d'eau.
Tropidonotus tesseUatus Laurenti, Trojjidonote tesselé ou
yil)ère d'eau.
Amphibiens
Les marais autour du lac sont les stations préférées d'un cer-
tain nombre d'Amphibiens :
Rana esculenta L., Grenouille verte.
Bufo calamita Laur., Crapaud des Joncs.
" vi?^idis Laur., Crapaud vert.
Les Urodèles sont représentés par :
Salnmandra macidosa Laur., Salamandre tachetée.
Triton cristatus Laur., Triton à crête.
punctatus Latr., •• ponctué ou lobé.
" (dpestr-is Latr., •• alpestre.
— 377
Poissons
Dans une note déjà ancienne, Poulet de Talloires, donnant
une liste des onze espèces de poissons que l'on rencontre dans
le lac d'Annecy, se demande anxieusement pourquoi ce bassin
lacustre est l'un des moins poissonneux de rEuroi)e. Il attribue
cette pauvreté au dépeu])lement produit par les espèces voisines,
à la conformation du lac et au régime des vents qui j régnent (1).
Si les espèces sont peu nombreuses, le lac n'en est pas moins
aujourd'hui assez riche en individus. Les essais de peuplement
ont partiellement réussi et de nouvelles formes se sont fort bien
acclimatées. Mais le nombre des pécheurs, celui des engins ont
sensiblement augmenté, la pèche en temps prohibé est largement
pratiquée et, en raison de cette ardeur de destruction, les poissons
no trouvent pas la tran(|uillité nécessaire à leur développement.
Il est une autre raison qui doit entrer en ligne de compte,
c'est la quantité relativement faible des petits organismes qui
habitent les eaux. Le plancton est, en eftét, ainsi qu'on l'a vu,
beaucoup inoins ciboiidant (|ue dans les grands lacs suisses, par
exemple, et, comme c'est un des éléments temporaires et essen-
tiels de la nourriture de certaines espèces, il se peut que cette
pauvreté ait une influence sur le développement des poissons.
Perça fluvlatilis L., Perche de rivière.
La Perclie adulte vit en hiver dans les profondeurs moyennes.
Elle vient frayer en avril sur la beine et sur les gazons de
Charas. Les jeunes éclosent peu de jours après et, au commen-
cement de l'hiver, jeunes et vieilles redescendent dans la profon-
deur. La Perche atteint parfois des dimensions exceptionnelles,
non par allongement, mais par un élargissement et une élévation
plus grande du corps. Un individu conservé au musée d'Annecy
mesure 0'"60 de longueur sur une hauteur de 0'"20.
Il existe dans le lac deux variétés de Perches : l'une aux
bandes vivement colorées qui se tient près des bords; l'autre,
plus rare, à la teinte plus sombre et taches noires plus ou moins
distinctes, qui se cantonne particulièrement dans les eaux pro-
fondes du Petit Lac.
(1) J.-B. Poulet, « Note sui" la pisciculturu dans le lac d'Annecy ». Rei'.
sav., 186G, p. 67.
24
— 378 —
Gasterosteiis pungitms L.. Epinocliette. — Vit à l'embou-
clmre des cours d'eau.
Cottus gohio L., Chabot de rivière. — Se tient sous les pierres
du littoral, à l'embouchure des émissaires du lac.
Ci/j)rinus car^no L., Carpe commune. — Vit en été sur la
beine ou à la limite du bleu et descend en profondeur moyenne
pour y passer la mauvaise saison. Elle remonte au printemps
pour frayer d'avril à fin mai sur le littoral.
Cyprinus carpio var. rec/ina Bonaparte. Individu au musée
d'Annecy. C'est une forme italienne qui tient le milieu entre
C,'. hungaricus et C. elatus (1).
Tinca milgains Cuv., TancJie. — Habite pendant l'été les
fonds vaseux et herbeux. Pendant l'hiver, elle se tapit dans le
limon du fond. Elle fraye en beine de mai à juin.
Leuciscns rutilus L. = L. prasinus Ag = Ij. paliers
Blanch. Gardon commun (2).
Poisson blanc très commun dans le lac et faussement appelé
Vairon par les pêcheurs. Ces Cyprins vivent en nombreuses
sociétés sur la beine. En hiver, ils se tiennent dans les eaux
plus profondes, sur les talus au niveau du bleu et se rapprochent
du rivage en avi'il et mai })Our frayer sur les plantes aqua-
tiques.
Squalhcs Agasizii Heckcl. Blageon. — Appelé également
Vairon par les pêcheurs, qui ne le distinguent pas du Gardon. Se
trouve en abondance vers le Roc de Clu're et sur la beine nord,
où il fraye en avril.
La distribution géographique du Blageon est intéressante. Ce
poisson existe dans le lac du Bourget et dans celui d'Annecy.
Sa présence dans ce dernier lac, son absence dans le lac de
Constance et dans le Léman soulève un j^roblème d'immigration
assez curieux.
Il faut admettre que la chute du Rhin comme la perte (Ui
Rhône ont constitué \me barrière infrancliissable pour cette
(1) Carlo Luc. Bonaparte, Iconografia délia fatina italica, 1. 1, Pesci, f. 1.
(2) D'après Fatio (Faune des vertébrés de la Suisse. Poissons, vol. 1, p. 501),
le Gardon pâle, Lenciscus pallens, de Blanchard, ne doit pas être séparé de
L. ratihis, ce ne serait qu'une simple variété.
— 379 ^
espèce, tandis que le lac d'Annecy qui la possôde est dans les
mêmes conditions d'isolement par les Gorges du Fier. Nous
verrons plus tard qu'elle a été, suivant toutes probabilités, la
voie d'immigration du Blageon.
Sf/ualius cephalus L. Chevaine. — Très répandu, il fraye
en mai et au commencement de juin. Pendant l'Iiiver, il se retire
dans les profondeurs.
Phoxinus loevis Ag. Vairon. — N'habite que l'embouclun-e
des ruisseaux. Erratique dans le lac.
Cohttis harhaiula L. Loche franche. — Se taj)it dans les
anfractuosités des murs des quais et sous les pierres. Elle fraye
en avril et mai.
Coregomis Schinzil He/reticus (Alpinus) Fatio. — Ce
salmonidé est d'introduction récente. 3,334 alevins de 5 à 6 centi-
mètres de longueur furent, en eftet, jetés dans le lac en avril 1884.
Ces jeunes provenaient d'œufs, insuffisamment déterminés, que
le pisciculteur M. Lugrin avait reçu d'un étal)lissement de
Huningue. Il n'est pas rare maintenant de pêcher, dans le lac
d'Annecy (1), des C. helveticus pesant de 1,800 à 2,500 gram-
mes. Ce Corégone se tient dans les profondeurs moyt>nnes dans
le jour et chasse la nuit dans les couches superficielles. Au mois
de décembre, les femelles sont gonflées d'œufs et on les voit en
troupes nageant à la recherche de leur frayère, qui est plutôt
littorale, car elle ne dépasse })as 6 mètres de profondeur.
On a essayé d'introduire Coregonus (Wm^j/ianui) Lava-
refus Cuv. et Val. Lavaret en jetant dans le lac, en mars 1902,
4,000 alevins qui n'ont pas vécu; l'expérience a été répétée en
mars 1905 avec 5,000 alevins de un mois.
Il en a été de même de Coregonus hiemalis Jurine : Gra-
venche, par la mise à l'eau en janvier 190G de 9,000 œufs.
Sabno Salar L. Saumon. — On jeta en 1892, 7,000 alevins
de Saumons près de Sevrier ; de même en 1896, 6,600 ale-
vins près de Talloires. Les renseignements manquent sur cet
essai de peuplement.
(1) L'itlentification du Corégone du lac d'Annecy résulte de Tétude des
U'ois sous espèces de C. Schtnz-ii faite en collaboration avec M. Guettiez,
directeur de l'établissement de pisciculture de Thonon.
— 380 —
Sabno lacustris L. Truite. — Les variétés de Truites sont
nombreuses : Sabno alpinus Blocli, S. punctatus Cuv, S.
marmoratus Cuv. Les variations de couleur et de taille sont
fonction du milieu où vit ce salmonidé. Dans les eaux profondes,
les teintes sont plus ternes et dans l'eau moins profonde elles
sont très vives et variées.
La grande Truite des lacs, que l'on trouve rarement dans le
Petit Lac, atteint parfois des dimensions extraordinaires. On a
capturé en 1890 un exemplaire qui mesurait 80 centimètres de
longueur; quelques années plus tard, un pêcheur ramena un indi-
vidu qui pesait 13 kilogrammes.
Sabno irideus Gibbon. Truite arc-en-ciel. — Ce poisson a
bien réussi après quelques essais de peuplement en 1900, 1902 et
1905.
Salreliniis umhia L. Omble Chevalier. — C'est un poisson
éminemment pélagique, qui chasse la nuit à la surface et descend
facilement dans la profondeur, où il fraye en décembre, janvier
et même février.
Il existe deux variétés d'Omble, l'une à chair blanche, l'autre
à chair rosée. On doit voir là vraisemblablement une question
de régime, causée par les Entomostracés dont le poisson fait sa
nourriture ; les Diaptomus et Cyclops sont, en effet, communé-
ment remplies de gouttelettes huileuses d'un rouge orangé.
L'Omble Chevaliei' n'existe dans le lac que depuis 16 ans. Enoctobre 1890, on y jeta 2,220 alevins aussitôt que fut eiiéctuée
la résorption de la vésicule ombilicale.
Sa/mo fontinaUs Mitch. — Truite d'Américpie ou Saumon de
fontaine. — On a fait un essai de peuplement en mars 1905 qui
parait avoir réussi. 100 saumons de fontaine de 26 mois furent
jetés sur la côte de Sevrier, près du ruisseau de la Planche, et il
n'est pas rare de pêcher en cet endroit de beaux individus de
-cette espèce.
Esox, lucius L. Brochet.— Mentionné ici pour mémoire. — 11
était très abondant autrefois, ainsi qu'il résulte d'un texte de la
fin du xvi'^ siècle (1). Il n'existe plus dans le lac depuis au moins
un siècle.
(1) Alfonso Dekhkne.» Fraj^mentuin descriptionis Saliaiuliae », année 1593-
1600. Manuscrit latin. Arcli. d'Etat de Turin.
— 381 —
XiKjullUi ruUjariH Tiirlon. Anguille.— Très raivdans le lac,
. l'Anguille a eu'; pècliée sous Saint-Jorioz,à Sevrier, à Albignj, au
bout du lac, à Mentlion, (p]xemplaii'e de 90 centimètres au Musée
d'Annecy.)
Lota miUjarh Jenyns. Lotte. — Ce poisson se rencontre sur-
tout dans les profondeurs de la partie sud du lac. On le voit
s'échapper par bandes des creux de la falaise du Roc de Chère et
des talus pierreux de la rive de Veyrier. Très carnassier, il se
nourrit de petits poissons blancs, de perchettes, de truites et de
jeunes Corégones qu'il va chasser dans les profondeurs.
382 —
ORIGINE DES ESPÈCES LACUSTRES
L'histoire de la genèse des faunes lacustres est encore en-
tourée de beaucoup d'obscurité ; de nombreuses théories sont
écloses qui n'ont guère fait avancer la question. C'est un des
faits importants de biologie générale relative aux lacs qui est
loin d'être élucidé.
Etudions le cas particulier d'Annecy. La faune qui peuple ce
lac est-elle autochtone, les espèces actuelles sont-elles le résul-
tat d'une lente adaptation, ou bien sont-elles immigrées par les
voies fluviales ou d'autres moyens passifs de dispersion? Il res-
sort de l'étude comparative des faunes du lac d'Annecy et de
celles des lacs suisses qu'il y a, en général, identité dans l'en-
semble des organismes inférieurs; que, d'autre part, on constate
des ditiérences notables dans la statistique ichtyologique; que
certaines espèces sont franchement lacustres, à l'exception des
Corég'ones qui y ont été introduits artificiellement, tandis que de
nombreuses espèces vulgaires qui habitent les cours d'eau de la
région en sont rigoureusement exclues.
On a vu que deux formes de la faune profonde, Plagiostoma
Lemani, Acanthopus elongatus, })résentent des affinités avec
des genres marins. D'autres habitent aussi bien la mer que les
eaux douces (\).Amtrœa cochlearis, PoJijarthra pUdijptera
,
Lepjtodora hyaliua, sont des éléments de la faune jx-lagique
des lacs Scandinaves, des côtes de la Baltiipie et du golfe de
Finlande (2).
Doit-on, comme Pavesi (3) l'a fait pour les lacs italiens, con-
(1) Ce lait n'est pas spécial aux animaux ; nous avons également parmi les
Phéophycéés, comme espèce indifférente : Ccratium hirundinella,q^ui \itd3.ns
la mer du Nord et dont la distribution géographique est très étendue.
(2) PoucHKT et DE GuERNE, Comptes rendus de l'Ac. des se, 30 mars 1885.
(3) P. Pavesi, « Altra série di richerce y studij suUa fauna pelagica dei
Laghi italiairr». Soc. Veneto Trentina (K se. nat. Padova, 1883.
Id. «Trois petits lacs du bassin tessinois y>, Arch. des se. ph. et nat. de Gen.,
XXII, .3° p., 1889, p. 356.
— 383 —
sidérorlos (Hrcs vivants du lac d'Annecy, comme les i'est(^s d'une
faune ancienne {fauna relegata) ou comme le terme actuel de
l'évolution de formes ayant vécu sur place. En adoptant cette
hypothèse, on doit conclure que les facteurs climatiques devaient
être semblables dans notre pays pour les espèces indigènes d'ath-
nités arctiques à ceux des régions du nord, tandis que les espèces
d'afiinités marines se trouvaient dans les lacs à une époque où
ceux-ci étaient en libre communication avec la mer. Par suite
de la dessalure progressive des eaux, dès que le fiord où le golfe
a été isolé de la mer par l'exhaussement d'un cordon littoral ou
le comblement alluvionnaire, l'adaptation à un milieu d'eau
douce s'est accomplie après une longue série de siècles. C'est
également la théorie de Lôven et de Sars, repoussée d'ailleurs
par FoREL (1), qui ne peut admettre que les lacs suisses et subal-
pins soient des restes des anciens fîords des mers tertiaires.
Maintenant, le lac d'Annecy a-t-il été en communication avec
la mer pliocène ?
Ce que nous savons sur la formation de ce bassin lacustre, qui
est d'origine tectonique, nous démontre que son creusement est
dû, vraisemblablement comme celui du Léman, à un affaissement
en bloc du massif alpniqui eut lieu après les dépôts de la molasse
aquitanienne. Il était donc, dès avant l'extension de la mer
l)liocène, complètement isolé, cette dernière période ne s'étant
traduite dans notre pays que par l'établissement d'un régime
fluvio-lacustre. Le lac était certainement peuplé à ce moment
par une faune indigène qui ne résultait pas de l'adaptation des
organismes à l'eau douce })ar suite de la fermeture d'un golfe
marin.
En ce qui concerne les espèces arctiques, communes aux
régions froides et à notre lac, il n'y a eu qu'un instant, à une
époque très reculée, où les conditions favorables à l'existence de
ces êtres ont pu être réalisées. C'est la période glaciaire, où la
progression formidable des glaciers de l'Isère, escaladant le
massif des Bauges, combla la cuvette du lac dont une dislocation
antérieure avait déjà esquissé la forme. Dans ces conditions, il
est inadmissible de prétendre que des êtres qui peuplaient déjà
ce lac avant l'époque glaciaire aient pu subsister et se perpétuer.
Tous les organismes ont été anéantis par les invasions glaciaires.
(1) FoREL, Faune profonde des lacs suisses, p. 149.
— 384 —
Donc, on ne })Oiit admettre une continuité (uitre la faune antégia-
ciaii-e et la l'aune actueHo, l'époque glaciaire avant été, clans le
temps, une barrière infranchissable. La faune des temps plio-
cènes a donc été détruite, et en dernière analyse il faut conclure
que les espèces actuelles sont d'origine post-glaciaire.
Il est rationnel d'admettre que le peuplement actuel s'est fait
à l'époque coïncidant avec l'établissement du réseau hydrogra-
phique définitif de la région et avec l'apparition de la végétation
sylvatique, et ces ancêtres lointains ont lentement évolué sur
place pour donner une partie des espèces encore vivantes dans
le lac.
Il subsiste encore un point de doute à l'égard de la présence
de certaines espèces d'affinités marines (1). Puisque ce ne sont
pas des reliques, quelle a donc été leur voie d'immigration ?
On connaît depuis longtemps le rôle joué dans la dissémina-
tion des espèces par les oiseaux aquatiques, surtout parles palmi-
pèdes migrateurs.
A. HuMBERT (2) et FoREL ont apporté des faits probants rela-
tifs à la migration passive des Entomostracés à l'état d'œufs
d'hiver, attachés aux plumes des oiseaux de passage, ce qui ex-
plique la parfaite identité des faunes des divers lacs de l'Europe.
La dissémination des espèces d'après de Guerne (3) serait duc
aux oiseaux aquati(|ues qui accomplissent de longs voyages du
Nord au Midi en hiver et en sens inverse au printemps. Ce rôle
explique " le caractère cosmopolite de certains types et l'intro-
duction de ces types dans les bassins lacustres d'origine récente »
.
On conçoit que des animaux peuvent, par ce moyen, être
transportés à des distances énormes, étant donné la rapidité du
vol de certains oiseaux, le canard sauvage par exemple, d'après
DU PuY DE Pedio (4) pouvaut franchir 66 à 72 kil. à l'heure.
(1) D'après Weissmann {Entstelmng der cyclischen Fortpfîanzinuj bci den
Daphnoiden^ 1879), Leptodora hyalina viendrait par différenciation d'une
Daphnide primitive dont on ne connaît pas autrement la descendance directe.
— FoREL, « Faune pélagif|ue des lacs d'eau douce ». Arcli. de Genève, 3° pér.,
t. VIII, p. 238.
(2) A. HuMBERT, « Matériaux pour servir à l'étude de la faune profonde
du Léman ». Soc. vaud. des Se. nat., vol. XIV, p. 221.
(3) DE Guerne, « Sur la dissémination des organismes d'eau douce par les
palmipèdes '•. Comi-te Rendu de la Soc. de Biologie, 8° sér., t. V, mars 1888.
(4) DU PuY DE Pedio, Essai sur le vol des oisemix en général. Paris, 1879
— 385 —
D'autres expériences dues à Eusebio (1), sur la dessiceation des
Entomostracés et leur reviviscence, ont démontré que les Infu-
soires, Rotiteres, Tardigrades sont transportés sous l'orme de
germes et d'adultes. A ce dernier état, les Entomostracés peuvent
conserver leur vitalité pendant 40 ou 50 heures. Les œufs d'hiver
peuvent résister à des périodes de sécheresse et de froid pendant
plusieurs mois.
J'ai un seul fait concluant à apporter à l'appui de cette théorie,
sans avoir entrepris d'ailleurs d'expériences suivies. Ce n'est que
par hasard, ayant raclé un peu de la boue desséchée sur les
pattes d'un canard sauvage tué à Saint-Jorioz, en décembre 1898,
que j'ai pu reconnaître à l'examen de la matière diluée dans
l'eau : un Tardigrade, un Rotateur {Rotifer sp.), trois espèces de
Diatomées dont D. elongatinn, une carapace de Daphnie et
enfin un Ephippium intact.
k côté de ce mode de dissémination des organismes par l'action
des oiseaux migrateurs, il existe deux autres voies d'immigra-
tion : les affluents et les émissaires du lac.
Quelles sont donc les relations du lac d'Annecy avec le régime
hydrographique de la région ? Un émissaire, le Thiou, se jetant
dans le Fier qui, lui-même, se déverse dans le Rhône; une série
de petits affluents dont le plus important, l'Eau-Morte, draine
toute la dépression de Faverges.
Ces cours d'eau peuvent-ils être des voies d'immigration pour
les espèces lacustres et en particulier pour les poissons ? Voyons
d'abord comment se comporte l'émissaire.
Le Thiou sort du lac à son extrémité N.-W. et francliit sur
une longueur de 1900 mètres environ une suite de petits seuils
rocheux avant de se jeter dans le Fier. Au total, la différence de
niveau entre le lac et la chute de Cran est de 27™60.
A quelques kilomètres en aval, le torrent se précipite dans la
fissure des gorges du Fier, où rimpétuosit(!' du courant se brisant
contre les arêtes vives, a formé de nombreuses marmites de géants
aux énormes blocs tourbillonnants.
Le Fier ne présente plus ensuite d'accidents notables sur son
parcours jusqu'au Rhône.
En ce qui concerne les poissons, nous trouvons dans le Fier
(1) Eusebio, « Reclierclies sur la faune pélagique des lacs d'Auvergne ».
Trav. du lab. de zool. de la fac. des Se. de Clermont, t. I, 1887-88, p. 13.
— 386 —
tont(3 une séi'ie (rospècos ({iii n'oiif jaut'iis jnt fiunichh' les
fo}-)iii(Jal)Ies tourhUlons des gorges de Loragiiy. C'est tout
à fait comparable aux pliénomènes natui'els de la Perte du Rhôneà Bellegarde, de la chute du Rliin à Schatfouse. qui interdisent
absolument l'entrée du Léman et du Lac de Constance aux
espèces fluviatiles de leurs émissaires. Ainsi la Blennie, l'Alose,
le Barbeau, l'Ombre commune, le Chondrostome nase, le saumon,
la Lamproie ne se rencontrent jamais en amont des gorges du
Fier, tandis qu'on les capture très souvent en aval.
Il est donc certain que le Thiou ne peut être une voie acces-
sible aux poissons pour leur remontée dans le lac.
En est-il de même des aMuents ( Laissant de côté les petits
torrents de montagne, un seul nous intéresse, c'est l'Eau-Morte.
Au travers de la vallée morte de Faverges, abandonnée aujour-
d'hui par un cours d'eau qui fut jadis puissant (1), coule l'Eau-
Morte dont l'importance ne correspond plus à l'ampleur de sa
vallée, et qui descend du col de Tamié en recueillant les tor-
rents de Saint-Ruph et de Montmin. Il existe, tout près, un
autre torrent. La Chaise, qui prend sa source à la Tournette et
se dirige contre la chaîne alpine pour se déverser dans l'Arlv,
affluent de l'Isère, en traversant le défilé de Marlens.
A Faverges, point où les deux cours d'eau Chaise et Eau-Morte
sont le plus rapprochés, existe, entre les bassins du lac d'Annecy
et de l'Isère, un seuil géogra})hi(|U(' d'une ti-ès faible hauteur
sur une largeur de 20 mètres, si bien (|ue l'eau captée dans
l'Eau-Morte pour l'alimeniation des usines de Faverges est
déversée artificiellement dans la Chaise. Il est en outre reconnu
qu'à la suite des crues causées par des pluies persistantes, l'eau
mélangée des deux torrents se déverse indifféremment soit vers
le bassin du lac d'Annecy, soit vers celui de l'Isère.
Il y a là un phénomène qui trouve son explication dans la
comparaison de l'ancien régime hydrographique et de l'état
topogi'aphique actuel.
A la ifn de l'époque pliocène, l'Isère, l'ecevant le Doron et
l'Arly, ne s'inclinait pas alors par un coude brusque vers le
S.-W. au niveau d'Albertville ; elle empruntait le cours de l'Arly
et celui de la Chaise pour se déverser directement par l'Eau-
(1) LuGEON, « Leçon de géographie physique ». SocitHe rmidoise des se.
nat.. 4' sér., vol. XXXVI, n^ 124, p. 62.
Ann. Bioh Lac. — T. II. Pl. 3.
Au Roc de Chère, une plate-forme sous-lacustre tufeuse, à cupules, montrant
son revêtement d'algues incrustantes, à o™6o au-dessus, contre la falaise,
une zone noirâtre formée par les gazons desséchés des Toïypotlivix, indique
le niveau normal du lac. Au second plan : promontoire de Duingt. — Vue
prise en octobre 1906.
Phototypie Week Frères, Bruxelles. '"'lot- 1^^. Guinier.
La Beine entre Saint-Jorioz et Sevrier avec cordon littoral de débris de Joncs
et de Roseaux, les incrustations tufeuses et les cailloux sculptés jonchant
le sol de la Scirpaie; au large, la Phragmitaie. — Octobre 1906.
A ni:. BioJ. Lac. T. II Pl.
^kllJi,
fc*jïï^tt^^i C'-WV^^'-->^^mm
f:
''*^4--«s?
La Beine entre Samt-Jonoz c: Scvrier, presque à sec en octobre 1906. Plagedésertique semée de cailloux tufeux, déblayée de Scirpes et bordée aularge par une dense Phragmitaie dont la ligne sombre se profile sur le
Roc de Chère, dominé à droite par la Tournette.
V ) -a
,-<^
Phototypie Wc... n.i.., i.u..;:... i-t.„t. M,. Gumier.
Sur la côte E. entre Chavoire et La Tour. Énormes tufs lacustres à secdans la Phragmito-Scirpaie. Les cailloux incrustés sont parsemés decoussinets d'algues Schizophycées et Chlorophycées. Diamètre moyendes tufs : o™20. Au fond la côte d'Albigny.
A un. B'iol. Lac — T. II. Pl. 5.
P; es de la jetée du ruisseau de la Planche (Sevrier). Au i^r plan, Nupharaie
bordée par une Scirpaie puis par une Phragmitaie très dense. Au loin,
la montagne de Veyrier.
Pliot. rii. Guinier.Phototypie Week Frères, Bruxelles.
Sur la Beine, près du ruisseau de la Planche (entre Saint-Jorioz et Sevrier)-
Tufs lacustres dans la Scirpaie. Sous une mince couche d'eau, transparaît
le lacis des Rhizomes noirâtres des Scirpes. Au large, la Phragmitaie.
A un. Biol. Lac- — T. IL Pl. 6.
:Lt ''J---£ï^
mMM SSs&ïS^Près de la Tuilerie (Saint-Jorioz). Une Maj^no-Caricaie représentée par des
mottes disjointes de Carex strida envahit la Scirpaie qui est bordée au
large par une ceinture de Phragmites.
Pliototypie Week Frères, Bruxelles. Phot. Pli. Guinier.
Le cône de déjection du Bourdon montrant l'envahissement progressif du
domaine du lac par la végétation sylvatioue. Sur le cordon littoral de
galets, la Scirpaie et la Phragmitaie en contact avec une Caricaie très
réduite et Salix purfurcas S- alba, Populus uigra, Ahnis wcana.
— 387 —
Moi'le dans le lac d'Annecy, dont l'émissaire traversait la plaine
des Fins, au nord d'Annecy, et recueillait le Fier pour aller
rejoindre le cours moyen des Usses. Ce torrent se jetait, comme
aujourd'hui, dans le Rhône. Ces faits de capture et de décapita-
tion de torrents ont été lumineusement exposés par Lugeon (1).
Autrefois, le Rhône était donc en communication directe avec
le lac d'Annecy ; les espèces fluviatiles ont pu pénétrer dans ce
dernier, mais il est certain qu'aucune n'a pu s'y maintenir, en
raison des invasions glaciaires. Aujourd'hui, l'isolement est
complet de ce côté, par suite de l'édification du delta torrentiel
du Fier post-glaciaire qui comble aujourd'hui la plaine des Fins
et a exhaussé, ainsi que j'ai pu m'en assurer par l'étude des
dépôts i)Ost-giaciaires de la région au nord d'Annecy, par l'accu-
mulation formidable d'apports d'alluvions, le niveau du lac
d'Annecy (2).
Mais l'isolement est-il complet du côté de Faverges? C'est peu
probable, en raison de l'éti'oitesse et de la faible altitude du seuil
qui permettent, pendant les hautes eaux, le passage des espèces
fluviatiles du bassin de l'Isère dans celui du lac d'Annecy.
C'est donc vraisemblablement la voie d'immigration de la
Truite, du Blageon, de l'Anguille, et même delà Lotte, arrivée
du Rhône par l'Isère, si on n'admet pas la possibilité d'une
introduction artificielle de ce dernier poisson, aucun document ne
le prouvant, du reste.
L'absence des Corégones, à l'état autochtone, n'infirme d'ail-
leurs pas ces conclusions, ces salmonidés n'existant pas dans les
cours d'eau du bassin de l'Isère; le bassin le plus rapproché de
nous où ils vivent est le lac du Bourget qui, comme on l'a vu, est
complètement séparé du lac d'Annecy par la cassure abyssale oii
s'engouffrent les rapides du Fier.
(1) Lugeon, Loc. cit. suprà.
(2) Delebecque a démontré (Lacs français, p. 359) que le niveau du lac
devait autrefois être à la cote 430, soit 1(5 mètres au-dessous du niveau actuel.
LES HYMENOPTERES AQUATIOIJES
par E. Rousseau
avec description de deux espèces nouvelles, par W-A. Sr.iiULZ.
Pendant longtemps YAgriotypus armatus, unique représen-
tant de la famille des Agriotypidae, décrit par CuRTis.en 1832,
l'ut considéré comme le seul Hyménoptère ayant des mœurssemi-aquati(|ues. Regardé d'abord comme spécial à l'xVngleterre
et rencontré depuis un peu partout dans l'Europe centrale,
VAgriotypvs co^ituitus Curt. demeura presque inconnu au
point de vue de son étliologie : on savait seulement que la
femelle de cet insecte plongeait sous l'eau, probablement dans le
but de déposer ses œufs dans le corps de quelque larve aquatique.
KoLENATi fut le premier (1848) qui observa l'état larvaire
à'Agriotypus armatus, mais il ne put réussir à obtenir
l'insecte parfait, et ne sut préciser s'il était question d'un Diptère
ou d'un Hym(''noptère. Un peu plus tard, Kriechbaumer parvint
à obtenir des éclosions, ses observations furent publiées par
DE SiEBOLD en 1858. L'année suivante, de Siebold découvrit
une grande quantité de coipies d'un Phryganide renfermant des
nymphes (\!Agriotypiis ; à cause de la différence de taille entre
celles-ci et les nymphes précédemment décrites, il crut avoir
afiaire à une nouvelle espèce qu'il proposa d'appeler Agriotypiis
7najor et que Bridgmann et Fitch reconnurent ultérieurement
devoir tomber en synonymie d'armatus.Klapalek a décrit en détail les mœurs et les métamorphoses
de cet intéressant insecte. Les adultes à'AgriotyjJUS se ren-
contrent aux bords. des ruisseaux, souvent en grand nombre,
dans les premières belles journées d'avril et mai. Ils volent dans
les endroits ensoleillés et se posent volontiers sur les feuilles
des plantes aquatiques; si une femelle tombe à l'eau, elle peut
- 389 —
résister au courant et se met à sautiller à la surface du liquide
avec autant d'agilité qu'une Hydromelva (Verhokff). Quand
elle plonge, la i'emelle est entourée d'une mince couche d'air,
elle nage à l'aide de ses pattes et va sur le lit. du ruisseau, sous
les pierres, pondre ses (pufs (un œuf dans chaque larve de
phrigane). Elle peut ainsi séjourner sous l'eau jus(|ue dix mi-
nutes. La larve passe sa vie sous l'eau, en parasite dans les
coques de certains Trichoptères, notamment Silo paUipes, Silo
nigricoi-nis, Goëi^a pilosa et aussi de Siiaihidopteriœ capil-
lafa , Trichosto})ia picicome, Odon(occyu})i albicoi-itc dont
elle dévore la larve; en juin, elles se transforment en cocons et,
en septembre, on trouve les nvmphes; l'éclosion se fait au
printemps suivant. Les fourreaux de phrvganides renfermant le
parasite se reconnaissent facilement au long prolongement
brunâtre en lanière qui existe à une des extrémités de la coque,
du côté de l'opercule; ce prolongement est souvent beaucoup
plus grand (pie la coque elle-même (jusque 86 millim. de long
suri millim.de large). Les deux extrémités de la coque sont
herméti<]uement obturées par une abondante sécrétion de fils
émise par les glandes salivaires de la larve au moment de sa
nymphose. L'opercule est aussi fermé à l'aide d'une petite pierre.
La lar^e ou la nvmphe du })arasite se tient dans un fort cocon
brun dont les côtés adhèrent à la paroi de la coque; en dessous
d'elle, il y a une petite chambre vide où se trouvent les restes
de la larve de l'Iiôte. Le prolongement en lanière est fortement
uni à la paroi antérieure du cocon et passe à ti*avers la membrane
antérieure, entre la petite pierre operculaire et la ])aroi de la
coipie. A la pai-tie postéri(?ure du cocon se trouvent les excré-
ments et la dernière mue larvaire du parasite.
En 1803, sir J. Lubbock signalait l'existence de deux autres
espèces d'Hyménoptères, de taille minime (1 millim.), nageant
sous l'eau et dont il donna la description : Pohjnema natans
et Prestwïchia aquatica.
Lubbock ne connaissait que la femelle de Prestu'ichia
aquatica. Elle fut retrouvée trente-quatre ans après, en 1890,
par Enock qui découvrit en même temps le mâle. En 1897,
Willem captura plusieurs exemplaires des deux sexes dans un
fossé aux environs de Gand et fit de nouvelles descriptions,
celles données par Lubbock et Enock étant trop sommaires et
quelquefois fautives.
— 390 —
Prestwichia se meut dans l'eau comme un Hvdraclinide, en
se servant de ses pattes comme rames ; on le voit aussi marcher
dans le sein du liquide sur les plantes et les parois de l'aqua-
rium, les ailes repliées sur le dos. L'animal peut aussi s'observer
marchant à la surface de l'eau ; lorsiju'il veut pénétrer dans le
liquide, il baisse la tête, l'enfonce verticalement, se pousse par
quelques mouvements rapides des pattes et se trouve bientôt
marchant dans une posture renversée sur le plan de séparation
de l'eau et de l'air. Quelques secousses le détachent de la surface
et le rendent libre à l'intérieur du liquide. Willem vit un de ses
exemplaires, sorti de l'eau, se lissant les ailes mouillées an
moyen des pattes postérieures et continuant ce manège pendant
plus d'une demi-lieure ; de temps en temps, il s'interrompait pour
relever les ailes et les faire rapidement vibrer, vraisemblable-
ment dans le but de les séchei'. Un faux mouvement ayant fait
retomber l'insecte dans l'eau, Willem ne put vérifier si c'étaient
là les opérations préliminaires au vol. Le mâle, qui est aptère,
pittoresquement comparé par Enock à une - pauvre puce afia-
mée «, aies mêmes allures aquatiques que la femelle oi, hors de
l'eau, a des mouvements plus paresseux.
Les métamorphoses de Prestwichid sont peu connues.
Willem croit que Prestwichia est parasite des eeufs d'une
espèce (XAgrion, De Steeani Ferez l'indique comme parasite
des œufs de Notonecta et Dytiscus.
Quelques années après la description de Polyneitia un tans
par LuBBOCK, Ganin en 1869, fit connaître son développement
embryonnaire, l'espèce fut ensuite retrouvée au Wiirtemberg par
VossELER et i)lus tard Enock en captura de nombreux exem-
plaires et identifia Potijnema nataits avec Cajrqihractus
cinctus Haliday. Il y a i)Ourtant lieu de remarquer que d'après
Westwool) (1879), Pohjnema natans rentre dans le genre
A?iaphes Haliday, qui a la priorité sur Polynema et Cara-
phractus, de sorte que cette espèce doit s'appeler actuellement
Anaphes cinctus.
La larve de Anaphes cinctus {Polynema natans) vit dans
les œufs de Calopteryx rirgo ; ceux-ci sont ordinairement situés
dans le parencliyme des feuilles de Nyniphaea. Au bout de six
à sept jotu's, on trouve déjà de très petites larves d'Anaphes
prêtes à subir la nynq)]ios(' et, dix à douze jours après, l'insecte
parfait sort.
— 391 —
Anaphcs peut vivre plusieurs heures sous l'eau dans laquelle
elle se meut à l'aide de ses ailes; sa démarche est plutôt sacca-
dée si on la compare à celle de Prestirlchta qui nage, comme
l'on sait, à l'aide de ses jjattes.
Dans ses études embryologiques sur les insectes, Metschni-
KOFF, en 186G, signala l'existence d'un Hvménoptère parasite
des œufs de Gerris lacustris, il en étudia le développement qu'il
rapporta à une espèce de Teleas indéterminée. Ganin retrouva
le même parasite et dessina la larve si bizarrement constituée de
cet hvménoptère. En mai 1000, M. P. Marciial recueillit dans
un étang des environs de Paris, les œufs de Gerris parasités par
un Proctotrupide, qui devait être identique à celui des deux
auteurs précédents ou être en tout cas une espèce fort voisine.
« Toutes les pontes de Gerris que j'ai observées, écrit Mar-
•r CHAL, étaient formées d'œufs alignés sur la face inférieure dt;s
" feuilles de Putamogetoii, le long du bord libre. En passant
» en revue le produit de ma première récolte du 12 mai, je pus
• constater que dans certaines rangées d'œufs de teinte jaune et
•• qui contenaient des embryons de Gerris déjà formés, se trou-
•• \aient quelques œufs d'un blanc mat ; en examinant ces œufs
•• au microscope, je vis que leur contenu était animé de mouve-
» ments de contraction ondulatoires, et en les ouvrant je mis à
" découvert une larve annulée présentant une tête armée de
" petits crochets mandibulaires et qui évidemment était une
» larve d'Hyménoptère ; cette larve très avancée dans son déve-
» loppement correspondait à. la troisième forme larvaire de
" Ganin et remplissait toute la coque de l'œuf. Désirant con-
•^ naitre le développement du parasite que je venais de découM'ii',
•• je recueillis, le 14 mai, de nouvelles pontes de Gerris, et en
^- examinant les œufs les uns après les autres, je trouvai à l'inté-
•' rieur de certains d'entre eux la première forme larvaire du
" parasite, qui ressemble beaucoup à celle représentée par Ganin,
•' mais elle m'a paru en ditïerer par la disposition des soies et
" par la brièveté de la corde caudale ; de plus je n'ai pu constater
" la présence d'une dent à la base de cette dernière.
•^ Dans le courant de juin, j'obtins l'éclosion de six individus
•• adultes dont quatre femelles et deux mâles. Ils étaient éclos
•' dans un grand verre en partie rempli d'eau, où flottaient des
•• fragments de feuilles de Potamogeton [)Ortant des œufs de
" Gerris parasités. Grâce à la présence d'un dis([ue de verre
— 392 —
servant de couvercle, ils restèrent emprisonnés à l'intérieur du
verre et je pus les observer à loisir; or, j'eus bientôt la sur-
prise de voir que ces minuscules Hyménoptères pouvaient éga-
lement bien se servir de leurs ailes pour -soler et pour nager.
Chacun d'eux traversait en volant l'espace (|ui s'étendait entre
la surface de l'eau et le couvercle, ou bien volait d'une paroi
à l'autre. Pour pénétrer dans l'eau, il inclinait la tête en avant
et faisait \isiblement un effort destiné à vaincre la résistance
opposée ])ar la tension superficielle ; ce passage de l'air dans
l'élément liquide lui était d'ailleurs rendu plus facile lorsqu'il
se trouvait sur le bord d'une feuille flottante qu'il n'avait qu'à
contourner pour pénétrer dans l'eau. Une fois immergé,
l'insecte, continuait à marcher ; s'il se trouvait sar une plante
aquatique, il cheminait alors avec une aisance aussi grande
que s'il eût été en dehors de l'eau ; si, au contraire, il n'était en
contact avec aucun corps solide, il se mettait à nager avec ses
ailes, frappant l'eau avec ces dernières sans précipitation et
d'un mouvement cadencé ; il pouvait ainsi s'élever oa descendre
et traverser toute l'épaisseur d'eau qui se trouvait contenue
dans le verre ; lorsqu'il arrivait à la surface, il devait faire un
nouvel effort pour passer du liquide dans l'air libre; i)uis ne
" tardait pas à reprendre sa vie aérienne. »
La mode de locomotion aquatique de cet Hyménoptère {Liin-
nodytes gerriphagus nov. gen., nov. spec.) est tout à fait com-
parable à celui de (Anaphcs cinctus,Polynema natans). Mais
LuBBOCK n'a pu voir ce dernier insecte faire usage de • ses ailes
•• pour le vol. De plus, d'après Ganin, chez Anaphes cinctus
" {Polynema natans), les ailes seraient remplies de sang et
•• fonctionneraient comme des brancliies; les trachées, par conti'e,
« feraient défaut à tous les stades de l'évolution. Chez la parasite
des œufs de Gerris, au contraire, l'aile présente la structure
" habituelle et il existe un stigmate métathoracique normal. ••
En août 1894, R. Montez, trouva au Grau du Roi, près
d'Aigues-Mortes, de nombreux exemplaires d'un Hyménoptère,
qu'il ne nomme pas, mais dont il donne une description assez
complète. Il croit pouvoir rapporter ces insectes au groupe des
Pi'octotrupides. Ils se ti'ouvaient sous la forme d'une multitude
de petits })oints noirs, se détachant avec peine, sous des pierres
atteintes })arcliaque vague ou même complètement plongées dans
l'eau. MoNiEZ pense que cet Hyménoptère (quitte sa retraite la
— 393 —
nuit pour chercher sinon sa nourriture, (ki moins les hirves
d'insectes auxquels il confie sa progéniture.
En 1902, De Stefani Ferez fit connaître une auti'e espèce de
Liynnodytes, à mœurs semi-aquatiques et également parasite
des pontes de Gerris, le Limnodytes setosus nov. spec.
Dans le même travail, De Stefani Ferez décrit un autre
Hvménoptère aquatique api)artenant à la famille des Braconides :
Giardlnaïa urinatoi' no\. gen. nov. spec, dont il put observer
les métamorphoses. La nymphe se présente sous la forme d'une
petite chrysalide brune allongée sur le Potronogeton pecti-
natimi; elle possède à l'exti'émité de l'abdomen une armature
spéciale formée de deux crochets qui lui permet d'encastrer ses
derniers segments dans les tissus de Potamo(jetO)i, le reste du
corps étant libre et ayant l'aspect d'un petit boui'geon.
Stefani, en examinant l'insecte parfait, vit qu'il était tellement
voisin du genre Adonon qu'à une inspection superficielle on
pouvait croire qu'il y appartenait, mais il reconnut ensuite qu'il
s'agissait d'un autre Braconide; contrairement à ce (pu a lieu
pour la plupart des espèces de cette famille, la nymphe est nue,
sans coque, caractère qui conduit Stefani à créer une nou-
velle famille, Hijdroihetidae, dont ferait aussi partie le genre
Ademon, que l'auteur soupçonne avoir des mœurs aquati(]ues,
ainsi que d'autres Braconides (surtout Blacides). Quand la
période nymphale est terminée, l'adulte de Gco'dinaïa urinator
rom})t la chrysalide sur le dos, monte le long des ramuscules de
la plante, ariive à la surface de l'eau et prend son essor.
Le 11 octobre dernier, comme j'examinais les produits d'un
dragage fait dans le lac d'Overmeire, ayant placé quelques échan-
tillons de Myrioplujllum dans des bocaux pleins d'eau, quelle
ne fut pas ma surprise de voir dans l'un d'eux un Hyménoptère
nageant parfaitement et avec la plus grande aisance au sein du
liquide.
Comme ses caractères ne permettaient pas de le rapporter cà
aucun des Hyménoptères aquatiques connus jusqu'à présent, je
crus avoir affaire à une espèce nouvelle et je fis de nouveaux
dragages, afin de recueillir d'autres spécimens, mais mes recher-
ches demeurèrent sans résultat. Fendant trois jours je pus
conserver en vie et observer à loisir cet int(''ressant insecte dans
25
— 394 —
un large tube à réactif \Ae'm d'eau, a])r(''s quoi je fis parvenir le
spécimen en question, conservé dans l'alcool, à mon savant
collègue hyménoptérologiste W. A. Schulz, qui me fit savoir
qu'il s'agissait d'un exemplaire femelle d'Ade/jioJi decrescens
(Nées) se rapprochant beaucoup de la forme mutuator Nées.
Nous avons vu plus haut que de Stefani Ferez avait déjà
soupçonné les mœurs aquatiques de cet Hyménoptère.
Quel(|ues jours après, étant retourné à Overmeire, dans le but
de me livrer à de nouvelles investigations, je fus assez heureux
de trouver, dans les mêmes conditions, deux autres exemplaires
femelles de Braconides ayant également des mœurs aquatiques,
mais nageant moins bien que VAdemoïi. Cette fois, il s'agissait
de deux espèces tout à fait nouvelles que W. A. Schulz baptisa
sous le nom de Dacnusa Rousseaui et Cho?^ebus natator.
Nous en donnons plus loin les descriptions empruntées au
travail de Schulz : ^^ Schwimmende Braconiden ^', qui a paru
récemment dans les Annales de la Société entomologique de
Belgique.
D'après Marshall (in André, Species des Hyménoptères, Bra-
conides.), Ademon decrescens habite la plus grande partie de
l'Europe, mais il est peu commun. Il vit en petits essaims sur le
Nasturtiuni officinale, au bord des ruisseaux et des fossés. Ses
métamorphoses sont inconnues.
L'exemplaire que j'ai pu observer pendant plusieurs jours
était presque toujours sous l'eau, je ne l'ai vu soi-tant de ce
liquide que rarement en grimpant le long d'une plante aquatique.
Il semblait hors de l'eau plutôt embarrassé et lissait presque
constamment ses ailes à l'aide de ses pattes postérieures ou les
faisait légèrement vibrer, comme s'il allait prendre son \6\, pro-
bablement dans le but de les sécher et de désagglutiner les abon-
dants poils dont ses ailes sont couvertes et lui permettre ainsi de
prendre une réserve d'air suffisante pour ses pérégrinations aqua-
tiques futures.
I^our pénétrer dans l'eau, il plongeait la tète en avant en
s'aidant par quelques mouNements des pattes. Il nag<'ait alors la
tête en bas à l'aide de ses pattes, les ailes restant inactives et
repliées sur le corps, les pattes postérieures semblant surtout
l'aider à se lancer en avant . Il est possible aussi qu'elles lui per-
mettent dacourir rapidement à la surface des eaux, comme les
Raitali'd, mais c'est une hypothèse que je n'ai pu vérifi(>r.
Ademoii nageait dans l'eau avec la jdus grande aisance, parfois
— 395 —
je l'ai vu clicmiiicr le long de la pai'oi du tube ou sui' la tige de
Mj/riojihi/Uuin (ju'il contonait, sans avoir aucunement l'aii'
d'èti'o incomniod!''. Il restaiL parfois plusieui'S heures sous l'eau,
sans en sortir, allant jusqu'au fond même de l'aquarium, ce qui
n'était pas le cas pour les deux autres espèces de Braconides :
Dacnusa Rousseaui et Chorebus uatator, qui se meuvent éga-
lement dans l'eau à l'aide de leurs pattes, mais ne s'écartent
guère de la surface et offrent dos mouM'inents beaucou}) ])lus lents
et paresseux que Adetnon.
i''i«. 1. Patte postéi-icure (l'oi-teineiit grossie) de ^Idciiion dccrcuccna (Ivces), ffiiielli
La plupart des Pjraconides {Dacuusff et genres voisins,
Gyrocfuiipa, (liorehus, Chacnusa, Chaenon, Sj/ntocrasis,
Alloea, Ah/sut, etc.) qui vivent dans le voisinage des eaux
douces et salées offrent probablement la ])ro[)riété de se mouvoirdans l'eau et Schulz, dans son intéressante notice, fait très juste-
ment remarquer les caractèi'es très ])articuliers (ju'offrent ces
insectes aux ailes pubescentes frangées de longs cils et aux tarses
dilatés, qui i)(n'mettent l'adaptation à ce genre de vie. Des
— ::i9(3 —
observations ulléricuivs altentivus viendront probuljlcinent à
ra})l)iii (lo cette tlièse.
DACNUSA ROUSSEAUI spec. nov.
Dièse Art kônnte wegen ilirer imansgebncliteton Vorderfiiigel-
Hadialader leiclit fiir eine Angeliôrige der Gattung GyrocampaFôrst. gelialten werden, wozu jcdocli wedei' die gekerbte Liings-
Fig. 2. — Daouisa Rousseaui Sclilz. Weibehen : aj Draufsiclit^ bj Mesoplcuren mit
Furclioii^ c) lîintorfussglieder, stark vcrgrôsscrt.
furclieihrer Mittelbrustseitennoclidie gestreckte Endliiilfte des
2. Abschnittes dieser selben Radialader passen. Durch beide
Merkmale reilit sie sicli vielmehr riclitig bei Dacnusa Halid.
ein, ohne indessen auf irgend eine der in diesem Genus von den
Aiiktoren erricliteten Formen bezogen werden zii kônnen. Aucli
vmter den vielen, 1895 von C. G. Thomson besclu'iebenen scliwe-
disclien Z)«cn ?<s«-Species habe icli micli vergeblich bemiilit,
eine herauszufinden, die mit dem mir vorliegenden weibelien
— ;397 —
iibereinkiimr. Trotzdem ist dicses scliarf cliai'akiorisiri uiid
rechtlortigt damit die Aufstellung einer neuen Art.
D. Ronssetnù ist nacli T. A. Marshall's Tabolle,amii;iclist('n
mit D. semb'Hfjosa Ilalid. (1839) verwandt, mit der si(^ das
wenigstons am Grande langsruiizlig gesti'ichelte 2. Hintei-leib-
stergit, das sclnvarze Abdomen sowie die von der Fliigelsi)itze
entferntc und, wie bereits gesagt, niclit ansgebuchtete Radial-
ader gemein liât. Die Unterschiede liegen u. a. in der gerin-
geren Grosse,denkiirzeren Fiilileni,der allseitiggeschlossenen 2.
Voi-dei'fliigel-discoidalzelle und in der liinglichovalen Hinter-
leibsform von Rousseaui. Meine Abbildung (fig. 2) mag die
folgende Neubescln-eibung beluifs Wiedererkennung der Wespeunterstiitzen.
Weibchen. Kôrperlange knapp 2.5 mill. Kopf liinter den.Vugen kanm verbreitei't, aut' Stirn und Scheitel von einemMittellàngskanal durchzogen. Fiihler etwas kiirzer als der ganzeKôrper, ungefâhr 1 1/2 mal so lang aïs Kopf, Bruststiick undMittelsegment zusammengenommen, lO-gliedrig; es ist aber zu
bemcrken, dass bei dem typisclien Stûcke beide Fiihler an der
Spitze leicht scln'issellormig ausgehôhlt sind, was datur spricht,
dass ihnen nocli weitere Glieder ansassen, deren jcdocli anscliei-
nend nur nog wenige gewesen sind.
Der Komplex von Thorax und Mittelsegment hat anniihernd
die Gestalt eines langgestreckten Rechteeks, mit fast parallelen
Seitenrandern. Die beiden Langsriefen auf dem Dorsulumdeutlich, am Ende, vor dem Schildchen, in eine massig tiefe,
oblonge Grube abfallend; der Raum zwisclien ilmen diclit fein
punkiirt, bloss voi'U leicht ausgelioldt. Mittelbrustseiten
(s. Fig. ^b) gliinzend glatt, von drei starken Furchen durch-zogen, deren eine, untere, breite der Lange naeh streicht undgrob (piergekerbtist, diezweite voniln- vorn senkreclit abgehend,({uer bis zur Vorderfliigehvurzel zieht und ebenfalls gekerbt,aber schmider ist, wiiln-end endlich die dritte, kurze undtiefeingedriickte, glatte in sclu'agei' Langsrichtung vom Hintcr-
rande, bei den Metapleuren ausgeJit. Mit Ausnahme der Mittel-
brustseiten ist der Vorderh(J)-j)e>' bis zu/jf Mittelsefptienl
einschliesslich matt und zloiilich Jmig and dicht griunjdbbehaarf. HïnterschUdchen ztr eiiion ztthnart}()en Hochererhoben. Beine lang und schmaehtig, aber docli in geringeremGrade als vergleichsweise bei Adonoii decresccns (Nées)
;
aile Tarsen ein wenig kiirzer als die ihnen voraufgehenden
— 398 —
Scliicncn. Tf/rscnc/idglicil siimlliclior drei lU'inpaai'fi i/dcfi
clem Etale zii. etœas verbreHert und verdtcht, gieiclilang
don z^^'oi vorJiergegangenen Tai'sengliedcrn mitsammon; Klaucn
lang und di'mn. Sclienkel leiclit kenlig verdickt; Vorderschie-
nen starh gehogen. Fliigel matt kupferrot bis violett irisirend,
didit beliaart imd dalior etwas getriibt crsclieinond, amAussensaume hehler Paare mit langer, zottiger Haar-
franse. Stigma durohwog gefarbt, lang imd scbmal, bis zur
Mitte des Vorderrandes der Kadialzelle reicliend. Radialader
von der Flûgelspitze entfernt, im 2. Ahschnitte nicht ausge-
buchtet, vielmehr hier anfangs scliwacli nach unien gewôlbt
und in der Endliàlfte gerade gestreckt, wodurcli die Radialzelle
Lanzettform gewinnt; 1. Abscbnitt der Radialader gerade, auf
dem Stigma sonkrecht, auf dem 2. Abschnitte in stumpfem
Winkel silzend und daber ansclieinend scbrag gericlitet, im
Grunddittel des Stigmas entspringend und von etwa der halben
Lange dièses Grunddittels. 2. DiscoiddlzeUe der Vorder-
flilgel voWiommen geschlossen; Nervulus stark postfurcal,
rlicklaufende Ader scbwacli antefurcal. Hinterflùgel sebr
sclimal.
Mittelsegment binten gerade abgestutzt, iiberall mit grober
Runzelung, die aber unter dem an ibm besonders dicliton,
zottigen Haarkleide wenig deutlicb ist; immerliin scheint vorn
ein Mittellangskiel ausgepragt zu sein. Hintei'leib obenauf de-
press, im ganzen elier ein wenig breiter als der Tborax,
làngliclieifôrmig, von vorn bis zum Ende des 3. Tergits regel-
massig verbreitert und mit geraden Seitenrandern, danacli
ziemlich scbnell der Spitze zustrebend und an den Seiten et^^as
nach aussen gewolbt. 1. Tergit nach vorn zu ansebnlicli
vcrschmalert, kegeifôrmig, ungefiihr 11/3 mal so lang als binten
breit, in seiner ganzen Ausdelmung diclit und fein làngsrunzlig
gestreift; die Seitenhôcker vor den Luftlochern nur eben ange-
deutet. 2. Tei'gii ni seiner Grundhàlfte, und zwar an den
Seiten etwas weiter nacb binten zu als mitten, gleichfalls, nur
feiner und regolmassiger I(lngsnadelrissig-run:-elsfrei//g; die
Tergite sonst polirt glatt und ihro Hinterriinder sebr undeutlicb
vorgezeichnet. Sternite aucb glatt und stark glanzend. Lege-
sclieide diinn und gerade, die Hint(?rleibss})itze ein wenig (umdie Lange des 3. Hint(^rtarsengliedes) iiberi-agt^nd. Bebaarungam Abdomen spjtiiicb, auf seine Spitze und die Sternite
bescbi'ankt.
— 399 -
Schwarz. Oberkiefer, 1. Fiililergeissiglied und die Beine rot-
gelb; die Hiit'ton und ersten Scli(?nkelringe aller Paare, ferner
die Voi'der- und Mittelsclienkel an der Oberseite, die darauf
folgenden Scliienen und Tarsen fast ganz und an den Hinter-
beinen die Oberseite der Schenkel nebst ihrei' Endlialfte unten,
dieScliienenspitze sowie das letzte Fussglied, sind schwarzbraun
iïberwasclien. Fliigelschuppen gliinzend pechschwarz. Stigma
und Flïigelgeader gelbbraun, die Vordei'rand- und Basaladern
melir schwarzbraun.
Mannelien unbekannt.
Benannt ist Wespo zu Ehreu ihres Kuldeekers.
CHOREBUS NATATOR spec. nov.
Die iibrigbleibende Species der im See von Overmeire gefun-
denen Sclnvininier-Braconiden gehort noehmals zu den Dacnu-
sinen. Es maclit aber Miilie, sie in einer der von den Auktoren
aufgesteilten Gattungen unterzubringen. Docj/ /!S(f -hlnûk-h is(
ilire etwas vor deni Ende g(^streckt verlaufende Vorderfiiigel-
Radialadt'r; doeli verbietet eine solclie Genusdeuiung u. a. der
verhalinisniJissig lange und gegen die Spitze seitlieh stark
zusannnengedriickie Hinterleib des Tieres. Der Gesaintlieit ilu^er
Charaktere nacli, insbesondere aucli wegen ihrer bcliaarten
^^etzaugen, liabe ieh micli endlicli cntscldossen, dièse Art bei
den wenigen, nebenbei bislier stets in der Fabe von Wasser
angetroffenen Sclilupf\ves[)en einzui'eihen, die untcr deiii Hai,i-
DAYSclien Gattungsnameii Choj'cb us {IS'SS) umlaui'en, obwold sie
liiervon abweicliend ini Vorderfliigel eine offene 2. Discoidal-
zellebesitzt.
Kommt innerhalb dieser Gattung in der naclisten Nalie von
naiciihun Halid. (1839) zu stelien, mit welcher Art sie von der
unteren Aussenecke der 1. Cubitalzelle massig weit entfernte
riicklaufende Ader, die Lange des Hinterleibes und dessen voin
4. Ringe ab compresse Gestalt gemein bat. Die Hauptunter-
schietle kônnen in der etwas geringeren Kôrpergrosse, den ein
wenig liingeren Fiihlern, den grôsstenleils dunkelgeiarbten
Beinen und namentlich in dem kûrzeren und breiter(m 1. Abdo-
minaltergite von natatoi" erblickt werden.
Weibclien. Kôrperliinge 2.G5 mill. Kopfquer, so breit als das
Bruststïick, beiderseits liinter den Augen deutlicli vorge(|uollen,
— 400
glaiizend, l'cin iiiid m;issig diclit bohaart, aufSclieitel und Hinter-
ïiaupt olme Làngseinsenkung. Fuhler etwas langer als Kopf +Thorax + Mittolsegnient, ungefàlir 1 1/4 mal so lang als dièse
drei Kôrperabsclmitte zusammen, IG gliedrig, gegen das Ende
leiclit verdickt. Dorsulum infolge dicliter und feiner Punktirung
matt, aucli in dem miitleren Langskanale, der an den Seiten
von je einer deutliclien, vorn als zahnartiger Hôcker vortreten-
den Riefe begrenzt ist. Mittelbrustseiten glalt und glanzend,
unten mit einer tiefen und breiten, grob quergerunzelten Langs-
furche, dariibei', am Hinterrande, bei den Metapleuren mit
einem kurzen, ebenfalls tiefen, aber glatten Langseindrucke und
vorn mit einem starken, scln^agen, bogenfôrmigen, \mter der
Flûgehvurzel endigenden gerunzelten Quereindrucke, Hinter-
schildchen mitten scliarf gekielt; von der Seite betraelitet,
erscheint es dort zalindvt'uj erhoben. Beine etwas kïu'zer und
kràftiger als in den z^^•ei oben abgeliandelten Wespenarten;die
Tarsen sàmtlich ungel'jUn' gleiclilang den ilinen jeweils vorauf-
gelienden Sdiienen. EndgUcd der Tarsen aller Paare von
gleidier Lange wie die beiden vorliergehenden Glieder mitsam-
menund nach dem Ende Iiin rerhreiterf, jedoch etwas weni-
ger als bei Dactiusa Bousseaui m.; Tarsenklauen kurz und
ziemlicli kràftig. Schenkel nach dem Ende zu etwas keulig
verdickt; Vorderscliienen gerade. Fltigel schwach irisirend, an
sich glashcll, aber wegen ihrer dichten Behaarung von leicht
getrûbteniAusselien; haarfranse am Aussensaume der vorderen
kiirzer und schwacher als in der soeben erwalmten Species, an
demjenigen der hinteren dagegen, die auch hier lang und schmal
sind, ebenso lang wie in dieser Stigma dick, immerhin etwas
diinner, als die Lange des ihm annahernd reclitwinklig, in
1/3 seiner Lange, aufsitzendcn Grundaljschnittes der Radialader
betràgt, dabei lanzettlich und ziemlich langgestreckt, gleich-
miissig gefarbt, Radialzelle verhaltnismiissig kurz, weit vor der
Fliigelspitze endigend : zum Vergleiche sei mitgeteilt, dass das
Stigma die Mitte der Vorderrandes der Radialzelle liberragt. 2.
A])schnitt der Radialader im ersten Drittel seiner Lange etwas
bauchig nach unten gewôlbt, darauf gerade gestreckt und dicht
vor dem Ende wieder leicht nach oben gebogen. Riïcklaufende
Aderzwar etwas hinter die 1. Cubitalquerader geschoben, aber
um wenigerjils 1/3 der Liinge der die 1. Cubital von der 1. Dis-
coidalzelk) trennenden Ader : besser làsst sich dièses Verhidtnis
vielb'ichi so ausdrrudcen, dass die 1 . TnljUalquerader nicht schari'
winklig- gebroclien ist, um so eine Sechseckfoi'm fiir die 1.
Cubitalzelle zii ergeben, sondern dass sie in ilireni unteren Drittel
bloss einen kràftigen Bogen bildet. 2. Discoidalzelle im Vor-
der/fiïgel unten imd aussen loeit gedff'net ; Nerviilus stark
postfurcal.
Mittelsegment kurz, nui' halb solang als breit, iiinton sclinur-
gerade abgpstutzt iind senkreclit nach unten failend, an denSeitenràndern etwas bucklig naeh aiissen gewôlbt, auf der
Scheibe nahezu eben und grob runzlig skulptirt, olme besondere
Eindriicke; ein Mittellàngskiel ist auf ilir nur ganz vorn leicht
angedeutet. Hinterleih sitzend, langer als KopfscMld,Thorax und Mittelsegment zusammen, am Ende, vom 4.
R'uige ab, comjJress ; 1. Tergit dichtund fein langsgerunzelt,
fast so breit als das Mittelsegment und yiiir loenig bezio.
beinahe gar nicht langer als am geraden Hinterrandebreit, nacli vorn scliwacli verjûngt, seitlicli olme vorspringende
Hôcker. Dièse Bauart des Abdomens liesse an das GenusPole?non Gir. denken, von dem sicli aber meine Art sclion rein
oberflàchlicli durcli die weniggliedrigen Fûhlcr und das glatte
2. und 3. Tergit unterscheidet. Bis zum 3. bezw. Anfange des
4. Tergits ist der Hinterleib depress. Tergite vom 2. an und aile
Sternite glatt und glanzend. Der Komplex des 2. bis 4. Tergits
verjûngt sicli kegeliormig nach liinten zu. Legesclieide vi^enig
vorragend, gerade und dùnn.
Beliaarung an Thorax, Mittelsegment und Hinterleib kurzund sehr sparlich, gleich derjenigen an Kopf und Flihlern
graugelb.
Schwarz. Rotgelb sind an den Vorder- und Mittelbeinen die
Hûften, Schenkelringe und die Unterseite der Schenkel, an denHinterbeinen eine leiclite Aufhellung der zweiten Schenkelringesowie der Schenkel auf deren Unterseite. Stigma und Flùgel-
geàder gelbbraun.
Mànnchen unbekannt.
— 402
BIBLIOGRAPTIIK
1S48 KoLENATi. Gênera et species Trir.hopleroruin.
I(S58. Von Siekold. Agriolypas urmatits in Trickostoma picicovne (Amtl.
Ber. d. 3i Versaininl. Deutscher iNaturf. 1858, p. "211).
I8ii[. \U)\ >iE\îi)],D. Vebar AgriotifiJih'i aniiatm Stett. Ent. Zeit. XXII).
1863. J. LuuBOCK. On two aquatic Ilymenoptera, one of which uses its
wings in swimming- (Trans. Linn. Soc. ot London, XXIV).
1809. Ganin. Beitrivge zur Erkenntniss der Entwickelungsgeschichte bei
den Insecten. (Zeitschr. fur Wiss. Zoo). XIX).
1866. Metschnikoff. Embryologische Studien an Insecten (Leipzig, 1866.
1884. Bridgmaxn et Fitch. Introductory Papers on Ichneumonidae (Entomo-
logist. XVII.)
1892. Verhoeff. Ueber einige seltene Tracheaten an Rheinlande (Ent.
Nachr XVIII).
1893. Klapalek. Métamorphose der Trichopteren (Arch. Landesdurch-
forsch. Bohmen. VIIIi.
1894. R. Moxiez. Sur un Hyménoptère halophile (Rev. biolog. du Nord de
la France).
1895-96. F. Enock. Aquatic Hymenoptera (Nature).
1896. V. Willem. Note sur le mâle de Prestwichia aquatica Lùbb. (Ann.
Soc. Entom. de Belgique, XL )
1896. V. Willem. Description de Prestwichia aquatica Lubb. (Bull, scient.
France et Belg. XXX).
1900. P. Mauchal. Sur un nouvel Hyménoptère aquatique, le Limnodytes
gerriphagus (Ann. Soc. Ent. France. LX).
1902. T. De Stefani Perez. Osservazioni biologiche sopra un Braconide
acquatico, Giardinaïa urinator, e descrizione di due altri Imenot-
teri nuovi (Zool. Jalirb- f. syst. XV).
1907. W. A. Schulz. Schwimmende Braconiden (Ann. Soc. Ent. de
Belgique. LI).
BIBLIOGRAPHIE LIMNOLOGIOUE
COMPTES RENDUS, ANALYSES, CITATIONS
(Nous publierons désormais sous cotte rubrique, dans chaque
tome des Annales, dc;s analyses ou des citations bibliogra-
phiques des travaux parus depuis 1906 et qui concernent la
Limnobiologie.
Nous prions les auteurs de bien vouloir nous faciliter cette
tâche en nous faisant parvenir les tirés à part de leurs mémoires
et nous faisons appel à nos collaborateurs pour qu'ils nous four-
nissent des résumés des publications qui nous éclia])peraient.)
N" I
Spongiaires
1. 1900 N. Annandale. Notes on the Freslnvater Fauna of
India. N° 1. A Varietv of Spongilla lacustris from
Brackisli Water in Bengal. (Journ. Proc. As. Soc.
Rengal. "Vol. II, p. 55.)
[Var. bengalensis nov. var]
2. 1907. R. KiRKPATRiCK. Notes on two species of African
Freshwater Sponges. (Ann. Mag. N. H., XX, p. 523.)
[Spongilla cerebellata Bwbk. du Caire et Ephydatia fhiinatilis
Linn., nov. var capensis du Cap.]
3. 1900. R. KiRKPAïRiCK. Report on the Porifera, witli notes
on species from the Nile and Zambesi. (Zoolog. Res.
Third Tankanvika Exped. Cunnington.) (Proc. Zool.
Soc. London. Vol. I, p. 218.)
[r/auteur décrit liuit spongiaires d'eau douce (sept Spongilla, un
Ephydatia) dont trois sont nouveaux : Spongilla Cunningtoni, Sp.
Rousseletii, Sp. (?) Zambesiana, Ephydatia plitnwsa var. Bronni
nov. var. Le nombre des Spongiaires d'eau douce d'Afrique est donc
actuellement de dix-neuf espèces.] (E. 11.)
404 —
Coelentérés
4. 1*.>0G. E. T. Browne. On tlio Frosliwalei- Mcdusa Liinnoc-
nida, langaiiicao and ils occurrence in tlie River Niger.
(Ann. Mag. Xat. Hist., XVII, p. 304.)
(La présence d'une MéJuse dans le Niger fut signalée pour la pre-
mière fois en 1888, parle D' Toutain (Bamakon, Soudan français). En
1U03, S. S. Budgett rapporta quelques exemplaires d'une Méduse
trouvée dans le Forcados Hiver, une des branches du delta du Niger.
Les deux méduses se rapportent à Uinnocmda tankanicae Urdim. \a\
présence de cette espèce dans les eaux du Niger pourrait faire
admettre l'hypothèse qu'elle a émigré des eaux de la mer jusqu'aux
lacs africains pour s'adapter peu à peu à l'eau douce (comme c'est le
cas pour Cordylophora lacustris).]
5. 1906. S. Ekman. Cordjlopliora lacustris alhnan i HjiUma-
rens vattenoinrade. (Arkiv. f. Zool. Bd. III, p. 1.)
[Cordylophora n'était connue jusqu'à présent en Suède que dans
les environs de Stockholm. Ekman en a trouvé des exemplaires au
centre de la Norvège, dans la rivière Hyndevadson; l'auteur émet
diverses hypothèses pour expliquer la présence de celte espèce à
un point si éloigné de la côte.)
Plathelminthes
6. 1900. L. BoiiMKJ. (Zeitschr. Wiss. Zool., LXXXI, p. 344.)
[Bohmig donne un travail d'ensemble sur l'anatomieet la systémati-
que des groupes suivants des Triclades : Procerodidae et Bdellou-
ridae. O.i y trouve les descriptions des familles, sous-familles, genres
et espèces avec la synonymie.]
7. 190G. E. Breslai'i. Eine neue Art der marinon Turbellai'ien-
gattnng Po/ijci/stis (Macrorhi/nchiis) ans dcm Sïiss-
wasser. (Zool. Anz. Bd. XXX, p. 415.)
[Polucjjstis Goettii sp. nov. (Jardin botanique de Strasbourg).]
'8. 1907. E. Enslin. Die Vorbivitung der Planarien im Gebiete
der Wiosent. (Mitt. Naturli. Ges. Niirnbei'g, 1907, p. 7.)
[Planaria alpina est très abondante, Polyceli^ cornuta manquepresque entièrement, l'espèce la plus répandue e^^l Planaria yonoce-
phala. Dans la région des sources, on trouve assez souvent associée
à PL alpina, Dewlrocoelum lacieum. Il n'y a pas de différences mor-
phologiques entre les exemplaires des eaux Iroides (sources, fon-
taines) et ceux des eaux à température plus élevée.]
— 405 —
9. 1907. E. V. Daday. In Sudamerikanisclien Fischen lobonde
Trematoden-Ai'ten. (Zool. Jalirb. Syst., XXIV, p.-KiO.)
[Distomum quadrangtilatum sp. n. dans Salmo pacn,
Diptodiscnsmarenzt'Ueri sp. n. dans Saimo sp.,
Microrcliis n. g-, pour Ampliisioina megacotijlc Dies, A. ferrnmequinum Dies,
Pseudocluilorchis n g. poar Amphisfoma cylindricum Dies.,
B. nephrodorchis n. sp. dans Salmo pacu et i\ pacupa,
Ps- macrostomus n. sp. dans Salmo pacupa et S. sp.,
Chiorchis dilatatus n. sp. dans Colossoma brachypoma,Cil. paUiUitus n. sp. dans Colossoma braclnjpona.
I.a description des espèces est suivie de considérations anato-
miques.l
10. 11)00. F. F. Laiulaw,. Report on tlie Turbollaria of tlie
Tliird Tankanvika Expédition condiicted by D"" W. A.
Cunnington, 1904-1905. (Proc. Zool. Soc, 1906, ]).777.)
[Planaria {ankanyikae nov. sp.]
1 1 . 1900. ^^^ Nicoll. Some new and little-known Trematodes.
(Ann. Mag. N. H., XVII, p. 513.)
[Psilostomum redactumsp. n. dans l'intestin de Gasterosteus acu-
leatus.]
12. 1907. A. Luther. Ùber die systeniatisclie Stelknig der
Rhabdocaelen-Familie Catennlidae s. str. •= Stenos-
tomidae Vejd.). (Zool. Anz., XXXI, p. 718.)
[L'auteur discute la place systématique des Catenulidae (= Slenosto-
midae).
Selon lui, la famille des Catenulidae renferme lesgenres suivants :
Catenula Dugés, Lophorhynchas Hrdlstrom et Luther nov. gen. proSlenostomiun tuygidam Za.cb. , StenostomumO .Schm. et Bhynchosco-lex Leidy.
Dans la famille des Mio'ostoinidae, il comprend deux sous-familles
(antérieurement des familles) : subfam. Microstominae avec les
genres .4 /a«r/na Buscli et Microstomum 0. Schm.; subfam. Macros-tominae avec les genres Mecynostomum E. Bened., OrnalostomumE. Bened. et Macrostomum G- Schm.]
13. 1900. A. MrtÂzEK. Eine Zweite polypliai'jngeale Planarien-
foi-m ans Monténégro. (Sb. K. Bohm. Ges. XXXII,1900, p. 1.)
[Planaria anophthalma nov. sp. (Monténégro).]
14. 1907. A. IMrÀzek. Ein europàisclier Vertreter der (Iruppe
ïemnoceplialoïdea. (Sitzb. K. IJ()]ini des Wiss., 1907).
(Les Temnocephaloïdes n'étaient jusqu'à présent connus que des
régions tropicales et subtropicales. Mràzek décrit une nouvelle
'<i"„°'
— 406 —
espèce Scutariella didactyle n. g.,n. sp. du lac de Scutari (Monténé-
gro), trouvée dans Palaemonetes.]
15. 1907. A. MrÂzek. Cestoden SUulien. (Zool. Jalirb. Sjst.,
XXIV, p. 591.)
[Cysticerques dans Lumbriculus variegatus, Aploparakis crassi-
rostris, etc.)
16. 1906. W. Plûtnikow. Die Rliabdocôlen Turbellarien der
Umgebung des Goktsclia-Sees. (Zool. Jabrb., XXIII,
p. 395.)
[Onze espèces, parmi lesquelles quatre nouvelles : Mesosloma
armeniacum, Vortex erivanicus, V. Kessleri, V. caucasicus nn. sp.]
17. 190(3. E.RossBACii. (Zeitsclir.Wiss. Zool.,LXXXIV,p.;501).
[L'auteur étudie l'anatomie et le développement des Rediale dans
Paludina (Cercana echinata) et Lymnaceus (Cercaria armata).]
18. 1900. E. Sekera. (S. B. K. Bôhm. Gos., XIII, p. 1.)
[Descriptions de monstres doubles de Macrostoma hyslrix et Pro-
rhuncliHS balticus-] *
19. 1900. E. Sekeka. (Ôp. cit., XXXIV, p. 1.)
[Descriptions de quehjues formes tératologiques de Planaria albis-
sima.]
20. 1906. E. Sekera. Ubor die Verbreitiing- der Selbstbcfnicli-
timg bei don Rhabdocoeliden. (Zool. Anz., Bd. XXX,p. 142.)
21. 1906. E. Sekera. Zïir Selbstbefruchtung bei don Rhabdo-
coeliden. (Zool. Anz., XXX, p. 230).
[.Sekera explique que l'autogamie a un beaucoup |)lus grand rôle
chez ces formes qu'on ne le supposait. Dans les Stenostomidae (Cate-
nuln, Stenostoma), les follicules testiculaires crèvent à l'intérieur du
corps, mettant en liberté les spermatozoïdes qui atteignent les ovaires.
Chez Macrostoma, l'organe copulateur terminal peut se plier de façon
à pénétrer dans l'ouverture génitale femelle. H en est de même chez
les Prorhynchidae, les Eumesostomidae, Vorticidae, etc En résumé,
par l'observation de la reproduction chez des individus isolés,
l'auteur semble avoir remarqué que l'autogamie est générale chez les
Rhabdocoeles d'eau douce.]
22. 1907. P. Steinmann et E. Graeter. Beitrage zur Kenntnis
der scliweizerischen Hôhlenfauna. (Zool. Anz., XXXI,
p. 841.)
[Steinmann décrit une nouvelle planaire aveugle : Planaria infcr-
nalis no\. spec. (Hcilloch, dans laMuotatal).]
— 407 —
23. 1907. P. Steinmann. Eine polyphai-yngeale Planarie ans
dor Umgebung von Neapel. (Zool. Anz., XXXII,
p. 364.)
[F/auteur décrit une planaire des environs de Naples, pourvue d'un
polypharynx et qui est peut-être identique à la PL montenegrina
Mrâzek.]
Nemathelminthes
24. rJU<). E. CoRTi. SuUa Paramermis contorta di Kolin.
(Zool. Anz., Bd. XXIX, p. (327.)
[L'auteur propose : Hydromermis impUcata n. nov pro Para-
mermis contorta Kohn, nec. Mermis contorta v. Linst. — Il donne
ensuite les caractères du genre Hydromermis- La famille des Mermi-
tidae est formée de plusieurs genres qu'on peut considérer comme
formant deux sous-familles, suivant que leur cuticule est simple ou
formée de fibres entre-croisées :
Champs Spi- Pa-
Mennithinac i Neomermis v. Linst. 1904.
(cuticule avec libres ' MerinisDaj. 1842.
• entre-croisées ) (Paramermis v. Linst. 1898
Hydromermithinae(Hydromermis Corti 1902
(cuticule simple.)(Psendomermis De Man 1903
25. 1000. E. VON Daday. Zwei batlnbisclie Nomatoden aus
dem Vierwaldstattoi- Sou. (Zool. Anz., XXX, p. Uo.)
[L'auteur donne la description de deux Nématodes trouvés dans la
région abyssale du lac des Qaatre-Cantons par le professeur Zschokke :
Dorylaimus zschokkei et bathybius nn. sp.]
26. 190(3. F.-G. Kohn. Naclitrag zii : Einiges iibor Paramermis
contorta (v. Linstow) = Mermis contoi-ta v. Linstow.
(Arb. zool. Inst. Wicn. ï. XV, p. 213.)
27. 1906. M. Rauther. Beitriige zur Kenntnis von Mermis
albicans. (Zool. Jahrb. Abt. f. Anat., XXIII, p. 1.)
[La première partie de ce travail comprend l'étude de l'organisa-
tion de Mermis albicans, le restant comprend l'histologie de la peau,
des muscles, du système nerveux, de l'œsophage, etc., de cette
espèce.]
28. 1906. G. Schneider. Sûsswasser Xcmatoden aus Estland.
(Zool. Anz., XXIX, p. 679.)
[L'auteur donne l'énumération des Nématodes libres recueillis par
lui dans le lac d'Obersee près de Reval (Estland), soit 8 espèces,
dont 3 nouvelles, qu'il décrit et figure : Aphanolaimus sp., Chro-
madoraleliberti,Chromadora revaliensis.] (E. P>.)
musc.
— 408 —
Annélides
39. 11»0(3. F.-E. Beddard. Repoi't on tlie Oligocliaeta ot' (lie
Tliird Taukanyika Expédition, conducted bj D'W. A.
Cnnnington, 11)04-1905. (Proc. Zooi. Soc, 190G, p. 206.)
[Slahlmannia inermis, Metschaina tanganyikae, Ocnerodrilus
illyogenia) cunningtoni, Alluroïdes tanganyikae, sp. nn.]
30. 1007. F.-E. Beddard. On some new speeies of Eai'tlnvorms
of tlie Family Eudrilidae, belonging to tlie Gênera
Poljtoreutus. Neumannielia and Eminoscolex, IVoni
M' Ruwenzori. (Froc. Zool. Soc, 1007, p. 415.)
[Polijtoreutus ruwenzorii, P. Granti, Neumannielia ruwenzorii,
Eminoscolex ruwenzorii nn. sp.J
31. 190G. K. Brktsciier. Ûber cin neues Enehytraeidengenus.
(Zool. Anz. XXIX, p. 072.)
[Eucnchytraeus n.g. bisetosus n. sp.].
32. 1906. L. CoGNETï! DE Martiis. Gli Oligoclieti délia regiono
neotropicale. II. (Mem. R. Accad.ScTorino(2).T.LVI,
p. 147.)
[Description de Pliearactima habereri, Ph. marenzclleri, Ph. ambi-
gna, Tritogenia morosa nn. sp.]
33. 190(5. L. CoGNETTi DE Martiis. (iMem. M. Acead. ScTorino,
XLIII, p. 781.)
[Description de Dichogaster tristani {Costa-\V\ca) et de Anieo/des
dcsaj'isù' (Paraguay) nn. sp.)
34. 1900. V. Maule. Ûber die Vejdovskyolla comata Micli.
und Naïs liaramata Timm. (Zool. Anz., XXX, p. 302.)
35. 190G. E. PiGUET. Oligochètes de la Suisse française. (Rev.
suisse zool., XIV, p. 185.)
[L'auteur étudie les 28 Naïdes connus en Suisse et donne une table
dichotomique, ainsi qu'une revision systématique, passe en revue
l'influence des saisons sur la manière de vivre, la coloration, etc.]
36. 1900. E. PiGUET. (Rev. suisse zool, XIV, p. 889.)
[Piguet donne la liste des A.eolosomatidae, Naïdidae, Tubificidae
l.umbriculidae et llaplotaxidae qu'il a trouvés en Suisse. Il décrit aussi
une intéressante espèce nouvelle : Rlijiticodrilns Icmani, trouvée à
120 mètres de profondeur dans le lac de Genève.
]
37. 1907. D. RosA. L'Allobophora minuscula n. sj). (At(i SocNatrModena (1). Vol. VII, p. îiS.)
— 409 —
38. 100(). W. M. Smallwood. Notes on Branchiolxlclla. (lîiol.
Bull. Vol. II, p. 100.)
[Développement des cellules sexuelles.]
39. 100(3. R. Southern. Notes on thu genus Enclivtraous, witli
Description of a new Species. (Irisli Natural. Vol. XV,
p. 179.)
[Enchytvaeus sabulosus nov. spec|
40. r.HHj. F. Von Wauner. Zur Oecologic des Tubitex und
Lumbi'iculus. (Zool. .Jalirb., XXIII, p. 20."').)
[bes Tubil'ex sont des habitants de la vase, l'autotomie est chez eux
beaucoup mohis prononcée que chez les autres Olig-ochètes; l'auteur
commente l'étonnante énergie des Tnbifex, qui sont en mouvement
pendant plus de quatre heures sans interruption. Chez les Lumbri-
ciUiis, l'autotomie est hautement développée ; l'auteur explique
comment les Tnbifex font leur tube et la fréquente association de
Tabifex et Lmnbricuhis.]
41. 1000. L. B. Walton. Naididae of Cédai' Point, Oliio.
(Amer. Natur., XL, p. 683.)
[L'auteur donne la description des Naididae de Cedart Point et
donne des tables dichotomiques sur les genres et les espèces de cette
famille.)
Rotifères et Gastrotriches
42. 10()(). P. DE Beauciiamp. Notommata (( opeus) eerberus
Gosse. (Zool. Anz., XXXI, p. 005.)
[Description et figure. La description et la ligure données par
Gosse se rapportent mal à cette espèce!
43. 1007. P. i»E I>eauciia:\ip. Morphologie et Naiiations de
l'appareil rotateur dans la série des Rotileres. (Arch.
'de Zool. exp'% XXXVI, p. 1.)
[D'après une opinion généralement admise, l'appareil ciliaire des
Rotifères est composé de deux couronnes, l'une préorale ou trochus,
l'autre postorale ou cingnlum- L'auteur démontre que ce type n'est
. pas réalisé dans la vingtième partie des espèces, il s'applique à
presque tous les BJelloïdes, parmi les Ilhizotes aux Mélicertiens, aux
Scirtopodes, à deux ou trois genres de Ploimes, et c'est tout. La très
grande majorité des Ploimes qui forment la grande masse des Rolilères
y échappent en entier.
Après avoir donné quelques descriptions et figures de l'appareil
ciliaire de huit espèces de Ploima (Notommata eerberus Gosse,
Diglena forcipata 0. F. m\\., Furcularia forficulaEïwenb., Proaies
petromyzon Ehrenb., Pedalion mirxmi Huds., Cjjrtonia tuba Ehrb.,
Euchlanis dikitata Ehrenb., Hijdatina senta G. F. Miill.), l'auteur
arrive à construire un type général d'appareil ciliaire (intermédiaire
— 410 —
à Notommata et à P^dalion) et dont il est facile de faire dériver
tous les autres par des modifications étroitement liées au genre de vie.
L'appareil rotateur se compose fondamentalement d'une plaque ciliée
buccale et d'une bande ciliée circumapicale : la reptation entraine un
grand développement de la plaque ventrale, qui régresse chez les
formes nageuses ou fixées, oîi elle ne sert plus qu'à l'adduction des
aliments et disparaît totalement chez les formes carnassières à mastax
préhenseur ou suceur. Une ceinture terminale de cils forts se diffé.
rencie chez les premières pourlanageou l'adduction delà nourriture,
aux dépens soit de la bordure du champ apical, soit de la plaque
buccale elle-même. Il est vain de vouloir homologuer un cercle
ciliaire d'une espèce donnée à l'un des cercles d'une autre, prise
arbitrairement comme type, il est vain aussi de baser une classification
sur des caractères aussi nettement adaptatifs et de conclure de ses res-
semblances, comme l'a fait\Vesenberg-Lund, à des parentés réelles]
44. 11)07. P. DE Beauciiamp. Sur rabsorj)tion inteslinalo, la
formation et l'utilisation des réserves chez les Roti-
fères. (C. R. Ac. Se. Paris, t. CXLIV, p. 524.)
[L'organisme des Rotifères est capable de mettre en réserve cha-
cune des trois grandes classes d'aliments sous forme : 1" de globules
protéiques confinés dans la paroi stomacale, réfringents, basophiles,
vitalement colorables seulement pendant leur élaboration ou leur
digestion ; on peut les envisager comme un stade de l'absorption,
mais ils ne sont bien développés que chez les animaux très abondam-
ment nourris; 2'' de glycogène dans les organes autres que le tube
digestif, surtout les plus actifs, et qui est, lui aussi, rapidement
consommé pendant l'inanition ;3"^ de graisse, dans le tube digestif
surtout, mais aussi dans les organes voisins, qui constitue une réserve
plus stable et plus facile à reconnaître, et pour ce motif, la seule qui
ait été signalée jusqu'ici.]
45. 1907. P. DE Beauchamp. Sur la digestion de la chloroplivlle
et l'excrétion stomacale chez les Rotifères. (0. R. Ac.
Se. Pai^is, t. CXLIV, p. 1293. )
[L'estomac des Rotifères est capable d'opérer un véritable triage
des substances qu'il absorbe, rejetant immédiatement les unes sous
forme de grains très acidophiles, mettant les autres en réserve sous
forme de globules plus ou moins basophiles ainsi que de graisse. Les
colorants vitaux usuels, qui caractérisent plutôt certains de leurs
états, ne permettent pas de distinguer les premiers des seconds;
leurs véritables colorants spécifiques et naturels sont la chlorophylle
et les autres pigments qu'ils ont mission d'éliminer.]
46. 1900. T. KiRKMAN. Second List of Rotii'era of Natal.
(Jouiii. R. Micr. Soc. London, p. 203.)
[L'auteur avait donné en 1901 une première liste des Rotifères du
Natal, comprenant 52 espèces. Il y ajoute 20 espèces, dont une est
nouvelle : Copeus tiiangidatus sp. nov.]
— 411 — .
47. 100(3. V. Langhans. Asplanchna [n'iodoula Gosse und
ilii'o Variation. (Arcli. f. Hydrob., I, p. Vo\).)
[l/examen d'un riche matériel de provenances diverses amène
l'auteur à constater que Asplanchna hclvelka Imhof n'est pas syno-
nyme de A.pviodonta (losse, mais constitue au contraire une variété
bien caractérisée (taille, mastax). Il décrit aussi une nouvelle variété
var. henrietta de A. in'iodonta.]
48. 190(5. J. MuRRAY. Rotifera of tlio Scottisli Lochs. (Trans.
R. Soc. Edinbui'gii, vol. XLV, p. 151.)
[Murray donne la liste des Rotifères recueillis dans un grand
nombre de lacs d'Ecosse, soit 177 espèces. Les principales formes
trouvées dans les diverses régions — pélagique, ai»yssale et littorale—de ces lacs sont comparées avec les formes trouvées dans les mêmes
conditions dans d'autres pays, l/auteur termine par quelques
remarques sur certaines espèces et par la description de 6 nouvelles
espèces : Philodina humata, Callidina longiceps, CnlUdina habita
var. hallata, Callidina natans nn. sp. de Murray et Philodina flavi-
ceps n. sp. de Bryce et Notommata pumila n. sp. de Rousselet.]
49. I00(). .T. Murray. On anow Bdelloid Rotii'er, Callidina vosi-
cularis. (Jouiii. (,)nelv. Alicr. Club. (2). Vol. IX, p. 2.5'.).)
[Callidina vesiciUaris nov. spec]
50. lUOO. J. Murray. Some Rotifei-a of tlio Fortli Avca, witli
Desci^iption of a new Species. (Ann. Scott, nat. Hist.,
p. 88.)
[L'auteur donne une liste des Rotifères de Forth Area et la des-
cription d'une nouvelle espèce : Stephanops microdactyius.]
51. 1006. J. Murray. Some Rotifei'a of tlie Sikkim Hima-
laya. (.Toui-n. Iv. Micr. Soc, p. 037.)
[L'auteur donne la liste des Rotifères récoltés et la description de
plusieurs espèces nouvelles : Philodina indica, Ph. squamosa, Calli-
dina pcrforata, Call augusticollis Murray var. attenuata var. n.,
Call. crenata Murray, var. nodosa var. n., Call. formosa. n- sp.,
Rotifev longirostvis Janson var fhiibriata var. n., Adineta longi-
cornis sp. n.]
52. 1000. J. Murray. The Bdelloid Rotifera of the Forth Area.
(Piw. R. pliYS. soc. Edinburgh. Vol. XVI, p. 215.)
[L'auteur énumère 53 espèces de BJelloïdes, parmi lesquelles une
nouvelle espèce: Callidina microcephala, qu'il décrit et tigure, ainsi
qu'une variété de Philodina brevi2)es.]
53. 1007. .1. Murray. South American Rotifers. (Amer. Natu-
ral., XLI, p. 07.)
[.Vlurray énumère 13 espèces de BdelloïJes recueillies dans des
O
- — 412 —
mousses humides de la Guyane anglaise. Il décrit et figure deux nou-
velles espèces : CalUdina tripm et C(UL speciosa, 3ims\ que deux nou-
velles variétés : CalUdina pevfoyata var. americana et CalUdina
mullispinosa var. cvassispinosa ]
54. 11)0(5. R. C. PuNxNETT. Sex (leteniiinaLion in Hydatina, witli
some Remarks on ParLhenogenesis. (Proc. R. Soc.
London, vol. LXXVIIIb, p. 223.)
[L'auteur rejette la théorie de Maupas disant que le sexe chez
Hijdatina est déterminé par la température, ainsi que celle de
Nussbaum disant qu'il est déterminé par la nourriture. Les expériences
ont amené l'auteur à considérer trois types de femelles parlhénogé-
nétiques : il, femelles produisant un haut pourcentage de femelles
qui pondent des œufs mâles; B, femelles produisant un has pourcen-
tage de femelles qui pondent des œufs mâles ; C, femelles produisant
des femelles qui ne donnent jamais d'œufs mâles. Un pur lignage du
type Cfut entretenu pendant 73 générations sans jamais donner nais-
sance à des mâles; l'inlluence de la température ne modifia nullement
les résultats.]
55. 1906. Ch. F. RoussELET. Rotifera of Kew Gardons. (KewBulletin, add. ser., V, p. 68.)
[1/auteur énumère 120 esprces de Rotifères qu'il a observées dans
le jardin botanique de Kew. Beaucoup d'espèces sont intéressantes
et rares, mais aucune n'est nouvelle.]
56. 100<J. Cti. F. RoussELET. ConMbution to oui^ Knowledge
of Llie Rotifera of Soutli Africa. (Journ. R. Micr. Soc.
London, p. 393.)
[Après avoir fait l'historique de nos connaissances sur les Rotifères
de l'Afrique australe, l'auteur rend compte de l'excursion faite dans
cette région par la « Britisb Association for the Advancement of
Science » et donne la liste des Rotifères recueillis pendant cette
expédition. 11 énumère ensuite les 148 Rotifères connus de l'Afrique
australe (20 Rhizota, 13 Bdelloïda, 41 Ploïma Illoricala, 68 Ploïma
Loricata). H n'y a pas d'espèces nouvelles.)
57. 1906. Cil. F. RoussEEET. Note on Tetramastix opoliensis
(Zach.). (Journ. (;)uek. ^Nlicr. ("lub(2), vol. IX, p. -131.)
[Cette espèce très rare et qui jusqu'à présent n'a encore été ren-
contrée que trois fois :1° à Oppela, sur l'Oder, par Zacharias en 1807
;
2" près de Tabor, en Bohême, par HIava en 1899; 3' en Rhodésie en
1905 par Rousselet, est redécrite et ligurée par l'auteur. Les descrip-
tions antérieures étaient mauvaises et il se fait que Tetraiiiastix
appartient aux Triarthradae et non aux Anuraeadae.]
58. 1906. E.T. Weiœr. (Zool. Jalu-I)., XXIV, p. 207.)
[WeblîT ayant examiné quelques échantillons de plankton recueillis
en Indo-Chine, Java et Sumatra par Walter Volz, donne la liste des
— 413 —
Rotifôres (^j sp.) Il n'y a pas d'espèces nouvelles, mais l'auteur décrit
et fis'ure quelques-unes des formes les plus remarquables qu'il a
examinées : Bracidonus falcatus Zach., Mctopiilia Ehrcnbcrgi
Perty, Poluchaetiis Collinsii. Gosse, Bfachionus iiiilitaris Ehrbg. et
Eachlanis plicata Lev.] {E. R.)
Crustacés
59. lOOC). C. Artoal Ric'ci'cho sperinicntali sul modo di l'opi'o-
dui'si deir Arteinia salina (Biol. Ccntralbl , Ud.XXM,p. 2(3.)
[Artom fait remarquer que dans les inar.iis salants de Cngliari, les
J* d'A r teinia salina sont toujours communs, leur nombr(3 l'emporte
de beaucoup sur celui des ^, sans qu'il y ait cependant de proportion
fixe entre les deux sexes. Le nombce des copulations diminue si la
quantité de sel contenue dans l'eau augmente. Les Artemia de
Cagliari sont vivipares en hiver.J
60. 1900. r. Artom. (Biol. Centralbl., VA. XXVI, p. 204.)
[Artom relève les critiipies faites par f^oeb contre les expériences
de Schmankewitch sur VArtemia satina- 11 étal)lit les faits suivants:
l" 11 y a des formes d'Artemia probablement parihénogénétiques, qui
vivent en eau douce, restent Artemia et ne deviennent pas « Bran-
ckipus »; ^2'il y a des formes de BrancJiipus (B. fero.c et B. spinostts)
qui vivent dans l'eau salée, ne sont probablement pas parthénogéné-
tiques, qm restent Branchipns et ne deviennent pas « Artemia »;
3' il y a des formes iVArtemia qui vivent dans les marais salants et
ne sont pas parihénogénétiques.]
61. 1906. V. Brehm. Ûboi' das Vorkoiniiu'ii von Diaptomus
tati'icus Wiei'z. in den Oslalpon und ubei- Diaptomus
Kupclwioseri nov. S}). (Zool. Anz., XXXI, p. 319.)
[Brehm signale la capture à Lunz de Diaptomus talricus Wierz,
dont riiabit:itsontlesCarpalhes,il décrit les variations morpliologiques
de cette espèce dans le lac de Lunz. 11 donne ensuite les descriptions
d'une nouvelle espèce : Diaptomu'i Kupelwieseri, et termine en expo-
sant le but et les aménagements de la nouvelle station limnologique de
Lunz.]
62. 1906. G. S. Brauy. On tlie EntomosLi-acan Fauna of tlio
Xew Zealand Lakes. (Proc. zool. Soc, 1906, p. 692.)
[L'auteur fait une comparaison entre les lacs anglais et ceux de la
Nouvelle-Zélande, il énumère ensuite les espèces de la Nouvelle-
Zélande et décrit comme nouvelles : CeriodupJinia globnsa, Cala-
maecia gen. nov. lucasi, Cijprinotussarsi nn. sp.]
63. 1906. W. T. Calman. Report on tlie Macrurous Cfustacea
of tlie Third Tanganvika Expédition, eonductcd by
— 414 —
D'- W. A. Cimnington, 1904-1905. (Proc. zool. Soc,
1906, p. 187.)
[13 espèces, dont 3 seules étaient connues, une seule espèce dans le
Nyasa et le Victoria Nyanza et 12 espèces dans le Tanganika. Lmino-
caridina retiarius, parvula, similis, latipes, socius, spinipes, Cari-
della nov. gen. cunningtoni, minuta, Atyella nov. gen. brevirostris,
longirostris nn. sp ]
64. 1907. W. T. Calman. On a Froshwater Decapod Crustacean
collected h\ W. S. Burcholl at Para in 1829. (Ann.
Mag. N. R., XIX, p. 295.)
[Euryrhynchus Burchellin- sp. (Para) et description complète de
Euryrhynchus Wrzesniowski Miers. (Cayenne).]
65. 1906. G. Chichkoff. Copépodes d'eau douce de Bidgarie.
(Zool. Anz., XXXI, p. 78.)
[L'auteur énumère 30 espèces ("20 Cyclopidae, 2 Harpacticidae,
<S Gentropagidae) parmi lesquelles 19 étaient inconnues en Bulgarie;
la plupart proviennent des environs de Sofia.
Diaptomus mirus Llljeb. présente une nouvelle variété var. Serdi-
cana (Sofia).]
66. 1907. Cii. Chilton. A New Fresliwater Gammarid from
New Zealand. (Ann. Mag. Nat. hist., XIX, p. 388.)
[Phreatogammaras propinquus, sp. nov.]
67. 1900. Cii. CiiiLTON. Notes on sonie Crustacea from tlie
Fresliwater Lakes of New Zealand. (Proc. Zool. Soc,
1900, p. 702.)
68. 1906. A. W. CooPER. Notes on a new Species of Gymno-
plea from Riclimond, Natal, South Africa. (Ann. Nat.
govern. mus., I, p. 97.)
[Adiaptomus g. n. natalensis, sp. nov.]
69. 1906. H. CouTiÈRE. Sur une nouvelle espèce d'Aljjlieopsis,
A. hangi, provenant d'un lac d'eau douce du bassin de
rOgoué. (Voyage de Hang. 1906.) (Bull. Mus. Hist.
Nat., Paris, p. 876.)
70 . 1907. W. A CuNNiNGToN. Report on tlie Brachyurous Crus-
tacea of the Third Tankanyika Kx])edition, conducted
by D^' W. A. Cunnington, 1901-1905. (Proc. Zool.
Soc, 1907, p. 258.)
[8 espèces, dont 3 nouvelles : Potamon (Potamonaules) orbiios-
pinus, P. platynotus, Plathytelphusa conculcata, nn. sp.]
— 415 —
71. 190G. J. A. CusiiMAN. Ostracoda of Massaeliiisetts. (Amer.
Natural., XLI, p. 35.)
[L'auteur donne la liste de 7 ostracodes du Massnchusetts S. E.]
72. 1907. E. VON Daday. Untersuchungen iiber die Copepoden-
fauna von Hinterindien, Sumatra und Java, nebst einem
Beitrag zur Copepodenkenntnis der Hawaii-Inseln.
(Zool. Jahrb., XXIV, p. 175.)
[Enumération des 17 espèces recueillies aux Indes, à Sumatra et à
Java, par le D' W. Wolz, trois nouvelles espèces : Cuclops asperi-
cornis, Nitocm platypus, Diaptomus visnu. nn. sp.]
73. 1900. J. G. DE Man. Eine neue Sûsswasserki'abbe aus
China. (Zool. Anz., XXX, p. 35.)
[Potamon (Pavatelpliusa) Endymion, n. sp.]
74. 1900. P. Gadd. En nv Parasit-Copepod IVàn Kaspiska
afvet. (Ai-kiv. Zool.'Bd. III, n^ 15.)
[Caligus dentatus n. sp.]
75. 1907. Z. G.TORG.TEWic. Ein Beitrag zur Kenntnis der Diap-
tomiden Serbiens. (Zool. Anz., XXXII, p. 201.)
[Liste des 18 espèces trouvées jusqu'à présent dans les Balkans,
avec quelques considérations bioloi^iques et la description de trois
espèces nouvelles : Diaptomus scvbicas, Diaptomus biseratm et
Diapiomus spec]
76. 1906. Iv. GuRNEY. On some Fi'csliwater Entomostraca in
tlie Collection of tlie Indian Muséum, Calcutta. (Journ.
Prov. xAsiatic Soc. Bengal., II, p. 273.)
[Gurney ajoute à la liste des Entomostracés connus de l'Inde,
14 espèces, dont deux sont nouvelles : Estheria inilica et Daphnia
fusca.]
77. 1906. W. B. Herms. Notes on a Lake Brie Slu'imp. (Oliio
Nat., VII, p. 73.)
[Phototropisme de Palaemonetes exilipes Stimps.]
78. 1906. E. HÉROUARD. La circulation chez les Daphnies.
(Mém. Soc. Zool. France, t. XVIII, p. 214.)
79. 1906. A. IssAKOWiTSCH. Geschlechtsbestimmende Ursachen
bel den Daphniden. (Arcli. Mikr. Anat., Bd. LXIX,
p. 223.)
[Issakowitsch étudie la formation du sexe chez Simocephahis
vetulas et Daphnia magna, qui d'après lui est liée à l'influence de la
nourriture et accessoirement de la température. Quand la nourriture
est insuilisante, les (futs donnent naissance à des mâles, et si elle est
encore plus insuilisante, il se forme un simple œuf d'hiver.]
— 410 —
80 . 19()(). L. Kkiliiack. Zur Biologie dos Poljphemus pediculus,.
(Zool. Anz., XXX, p. 1)11.)
[Pùlijphemm priliculus présente deux époques de reproduction aux
environs de Berlin : une en juin, l'autre en octobre.]
81. 190(). L. Keiliiaciv. Cladoccron ans den Dauphiné-Alpon.
(Zool. Anz., XXIX, p. 094.)
[f/auteur a examiné les (^ladocères des eaux slag-nantes des Alpes du
Daupliiné : quelques-uns des lacs et marais explorés sont situés de
I,800à2,U(K) mètres. Keilliar k a trouvé l,") espèces nouvelles pour cette
région.
I.a va.r.friffi(la de Acropcnis harpae était considérée jusqu'à présent
comme une forme locale des montagnes de Suède; on la trouve aux
environs de Berlin en hiver. La coiffe céplialique de cette espèce se
modilie sous l'inlluence de la température comme chez les autres
Daphnies pélagiques. Au lac mort (930 m.) le réchauffement de
la température n'amène aucune variation morphologique chez les
Cladocères.]
82. 1900. V. L. JvELLOG. New Species of Artemia.. (Science,
XXIV, ]). 594.)
[Artemia franciscana nov. spcc.(Standford), description et variétés
sous l'influence de la salii-.ité de l'eau.]
83. 1900. V. LAriGAïoLLi. U bardas Vorkommen von Doppelau-
gen bei einer limneiischen Daplmie. (Zool. Anz., Bd.
XXIX, p. 701.)
[Diaphanosomu brachi/ayum présente dans le lac de F.avarone
(Trieste) tous les stades de transition entre l'espèce ne possédant
qu'un seul œil et celle olfrant deux yeux bien développés, l/auteur
appelle cette dernière Diaphanosoma brachyurum trideiiiinum.]
84. 1900. V. Lak(UÏ()Lli. DiaithanosomabrachyuruinlAèx.,var. trilleiiHiium. (Arcli. f. Hydrob., I, p. 428.)
[L'auteur décrit et figure une variété de Dapltnia byachuijrum,offrant deux yeux situés latéralement, trouvée dans les lacs du Karst.]
85. 1900. R. Lakociik. Die (^)j)epoden dei' Umgebung' von I^ern.
(Dissertation, Berne, 1900.)
[Le nombre de Copépodes connu en Suisse, d'après les recherches de
l'auteur, est de 43 (9 centropagides, 2:2 cyclopides, 12 harpadicides);
aux environs de Berne, il en a trouvé 26. Les Cyclops vivent générale-
ment ensemble par société de certaines espèces, c'est ainsi que dansles grands lacs on trouve réunis C. fnscns, albidus, et piasinm-serrulatm,el parfois aussi C.macrarus; on trouve ordinairement 1 ou2 espèces de Diaptoinus pour 12 espèces de Cyc/ops ; les tourbières
n'ollVent^pas de fume spéciale en Ct/clops; Cyclops fuscus et ulbidassont slénolhermes. C fjrdcilis est une forme d'été, C- bicuspidaliis
— 417 —
une forme d'hiver. L'auteur donne ensuite certaines remarques systé-
matiques et morphologiques, ])uis l'ait les recherches expérimentales
sur la ponte chez lesCyclops et termine par l'étude détaillée (Hahitat,
Localité, Uiologie, Périodicité, Coloration, Systématique et Syno-
nymie) de chacune des espèces.|
86. llKXj. L. LÉGER. Ai-gules et Salmoniculturo. (Bull. Soc.
Contr. (l'Aiiuiculture, XVIII, p. 41.)
[Dégâts causés par les argules dans l'élevage des Salmonidés, et
moyens d'y remédier.)
87. 1V)00. L. Masi. Faune de Roumanie Ostracodes récoltés
par M. Jaquet et détei'uiinés par M. le D'' L. Masi.
(Bull. Soc. Se. Bucarest. Ann. XIV, p. 047.)
\Iliocupris ffotica n. sp.]
88. 1907. 0. Rabes. Régénération der SchwanziTulen bei Apus
cancriformis. (Zool. Anz., XXXI, p. 75o.)
[Régénération complète du filament caudal en trois semaines.]
89. 1*.K)(3. K. SciiAFERNA. Uber eine neue blinde Garaniaride-
nart aus Monténégro. (Zool. Anz., XXXI, p. 185.)
[Il s'agit d'un nouveau Gammaride aveugle, le Ti/phlogammarus
mràzeki nov. gen. nov. spec. Schilferna, pris en grandes quantités
dans les environs de Gettinje et de ^jegus parle professeur Mrâzek
dans son voyage au Monténégro. L'auteur donne la description (avec
figures) de cette nouvelle espèce. On ne connaissait encore que deux
Gammarides aveugles : le Phyeatogammarm fragilis Chilton, sans
yeux, et le Bathyoni/x devismesi Vejd, à yeux considérahlement
réduits.]
90. lOOC). T. ScoTï. Crustacea of the Fortb Area. (Proc. R.
Phys. Soc. Edinburgli, XVI, p. 207.)
[Catalogue des Ostracodes, Copépodes et Cirripèdes.]
91. 1000. T. Scott. Notes on British Copepoda : cliange of
Names (Ann. Mag. Nat. Hist. (7). Vol. XVII, p. 458.)
92. 1000. T. Scott. Notes on new and rare Copepoda l'rom the
Scottish Seas. (21 th. ann Bep. Fish Board Scottland.
Pt. ;J, p. 275.)
[Amphiascus catharinae n. sp.j
93. 1007. D. J. ScouRFiELD. New British Cladocera. (.Tourn.
Quek. Micr. Club., 1007, p. 71.)
[L'auteur signale la présence aux environs ileScarborough deAlond
wellncii Keilhack et de PU'uvo.rns denlicalalKS IJirge à Exuùnster,
— 418 —
nouvelles pour l'Angleterre. Cette dernière capture est particulière
ment intéressante, l'espèce n'ayant encore été rencontrée qu'en
Amérique.)
94. 100(). T. R. R. Stebbing. Ampliipoda. I. Gammaridea.
(I)as Tierreich, Lfg. 21.)
[Monoyrapliie des Gammarides : L'auteur décrit 41 familles,
304 genres certains et 9 douteux, 1 ,07(î espèces certaines et 257 dou-
teuses. Les (iammarides des eaux douces comprennent :
HaustorUdae, 1 genre, 1 espèce ;
Calliopiidae, 2 genres, 3 espèces;
Gammaridae, 40 genres, 195 espèces;
Tatitiidai', 4 genres, 25 espèces ;
Corophiidae, 3 genres, 9 espèces.]
95. 1007. M. Thiébaud. Entomostracés du canton do Neiicliâ-
tel. (Zool. Anz., XXXI, p. 024.)
[Le bilan des Entomostracés neuchâtelois est le suivant : 57 Clado-
cères, 34 Copépodes, dont 19 Cyclops et 12 Canthocamptus, 24 Ostra-
codes, soit un total de 115 espèces. L'auteur donne la description
d'une nouvelle variété de Canthocmnptus schmeilii Mràzek, la var.
brcviseta. Il signale la présence de certaines espèces : Canlliocamp-
tus rubellus, qui n'avait encore été trouvée qu'en Suède par Lilljehorg,
C gracUis; les deux tourbières où ils ont été trouvés sont d'origine
glaciaire.)
96. 1900. W.Vavra. Ostracoden von Sumatra, Java, Siam,
den Sandwicli-Inseln und Japon. (Zool. Jalirb. Syst.
GeogT. RioL, XXIII, p. 413.)
[Les Ostracoiles rapportés par le D' W. Volz de son voyage dans ces
réglons comprennent 10 espèces, parmi lesquelles (5 sont nouvelles :
Ciiprinotus {Hemicmnis G.O. S.) Kaufnianni (.Japon), Stenoci/ijris
derupta (.lava), St-biinacronata (Siam), Ci/pridella rn/io/a (Sumatra),
Lininicjithere notodonta (Java). L'auteur décrit un nouveau genre
Hungarocifpris pour Cjiprois dispar Chyz. et discute la systématique
des genres Eiicijpyis (i. W. Miill., Cijprinotus Brady, Cijpridclla
Vâvra et StenocyprisG. 0. S.)
97. 1907. F. Ve.tdovsky. On somo Fresliwatci' Ampliij)odos :
The réduction of tlie Eve in a new Gammarid from
Ireland. (Ann. Mag. N.'h., XX, 1907, p. 227.)
[Bathyonyx nov. gen. devismesi n. sp.)
98. 1900. (). Zacharias. Zur Biologie und (Dekologie von
Polypliemus pediculus (Zool. Anz., XXX, p. 455.)
(L'auteur fait les mêmes constatations que Keilhack sur les Poli/jthe-
mns : Dans un yrand marais (Ivoppentoich) du Riesengebirg. dont la
température de l'eau ne s'élève pas, même en été, au-dessus de 12",
— 419 —
la période de reproduction est limitée à quelques générations. Cette
période, pendant laquelle les O offrent une brillante coloration, dure
environ un mois et demi. Polmihevms hiverne sous forme d'œufs de
durée. Les exemplaires de Poluphemus du Koppenteich atteignent
une taille plus considérable que ceux des vallées avoisinantes ou des
lacs du nord de l'Allemagne.]
99. l'.HHj. N. VON ZoGRAF. Hoi'maplil'oditismus bci demMann-clion von Apiis. (Zool. .\nz , XXX, }). 5G;J.)
100. l'.HX'). A. ZwACK. i'ber dcn foinorcn Ban iind die Bildung
des Eppliippiums von Daplmia liyalina Levdig. (Ber.
nat. med. Ver. Innsbruck. Jaln'g. 29, p. XI.)
101. 1900. W. Zykoff. Bosminopsis in Centralrnssland. (Zool.
Anz., XXX, p. 22.)
[L'auteur signale deux captures de Bosminojjsis Zernowi Linlvs au
centre de la Russie, dans les rivières Oka et Nara. Le genre Bosmi-
nopsis a comme aire géographique l'Amérique du Sud (La Plata, Para-
guay, Amazone), le .lapon (Nord et Centre) et le système du Voli;a, où
il est connu de six localités.] (E. U.)
Hydrachnides
102. 190(). Z. Georgevitscii. l'eitrag znv Kenntnis dei' Ily-
draclniiden Macédoniens. (Zool. Anz., XXX, p. IW.)
[L'auteur énumère!21 espèces, parmi lesquelles 7 espèces sont nou-
velles et dont il donne les descriptions. Ce sont Ej/lais citcllata,
E. cavii)ontia, E. bissaciata, E. dentata, Arrhenurns co)vnatns,
A. calycularis, Diona macedonica nn. sp.]
103. 190(3. J. X. Halkerï. Zoologieal Results of the Tliird
Tanganyika Expédition, eonducted by L)'' ^^^ A. Cnn-
nington 1904-05. Report on tlie Hydrachnida. (Proc.
Zool. Soc. London, 1900, p. 584.)
[Deux espèces seulement ont été rapportées : Eucentridoplwrus
spinifi'v [Koen.) et Arrlieniorm plenipalpis Koen. L'auteur reproduit
les descriptions originales.]
104. 1900. J. N. Halbeut. Notes on Iiisli Hydraebnida. (Ann.
xMag. Nat. Hist. A^ol. XVIII, p. 4.)
'
[Momonia nov. gen. (Hygrobatidae) falsipalpis nov. sp. et Arrhe-
nurns octogomis nov. spec]
105. 1900. F. KoENiKE. Niclit (^irvipes thoracifer Piers,, son-
dern C. discrepans Koen. (Zool. Anz., XXX, p. 514.)
— 420 —
106. 100(). F. KoKNiKR. Forolia pannata nom. nov. (Zool. An>5.,
XXX, p. 5i;>.)
(Pro F. cassidiformis Haller non IJmncsia cassidiformis Leb.)
107. lUOT. V. LAïKiAÏoLLi. Glenodiiiium pnlviscuhis (Elir.)
Stoin var, ociilatum Milii imd Atax iiitenncdius Kocmi.
vai-. lavaronensis Milii. (Zool. Anz., XXXI, p. oOO.)
[Nouvelle variété de VAta.r intennedivs-]
108. l'.HM). ('. Maglio. Idracnidi nuovi o poco noii dell' Italia
superioiv. (Zool. Anz., XXX, p. 40<).)
(Les espèces nouvelles décrites par l'auteur et provenant toutes des
environs de Pavie sont : Sperchon ticinensc, Airaclides paceùi.
Htidriijihantt'S Kocnikei, Arrhenitruii mcuigii nn. sp.|
109. lUUG. W. J. Rainhow. A Synopsis ofAustralian Acai'ina.
(Rec. Anstral. Mus. Vol! VI, p. 145.)
[3 Hydrachnides dont deux espèces nouvelles que l'auteur décrit :
Eijlaïs )nacculloclii, Atax cuniberlandcnsis.]
110. 1000. E. Roi'SSKAF. Notes })Oup servir à l'étude des
Hvdraclinides de Belgiiiue. (Mém. Soe. Entom. lîelg.
X'il, p. 181.)
[Procéiiés pour la conservation et la préparation dos Hydrachnides et
liste des S7 espèces de la IJels^ique'-1
111. 1V)06. C. I). SoAR. Notes and observations on tlie Liie-
History of Fresli-Water Mites. (Journ. Quek. Mier.
Club. p. 359.)
112. l'.KJC). S. TiioK. Lebertia Sludien. IX à XIV. (Zool. Anz.,
XXX, pp. 70, -271 et 403.)
[Description et ligures de Lebertia (Pilolebertia) inuequalis (Koch);
examen critique des espèces connues du sous-genre Pilole.bertiu :
porosa Thor, obsciira Thor, i.nsignis Neum., inaequutis (Kocli),
quadripora Koen.; description d'un nouveau sous-genreMw'o^('/^(!r//a
pour Lebertia brevipora Thor que l'auteur décrit à nouveau ainsi
que la nymphe; description de Lebertia (Mixolebertia) contracta
Thor.)
113. 1900-07. S. TiioR. Lebertia Studien. XV à XMII. (Zool.
Anz., XXXI, pp. 105, 272 et 510.)
[Description et lîi^ures de Lebertia gtaltraThor cl de sa nymphe;
de L. relicla nov. sp.; de /.. lineata Thor et de sa nymphe; sur les
espèces connues du sous-genre Pseudoleberlia : description d'un
nouvean-sous-genre He.ralebertia pour /.. sligniatifera Thor et plicaln
Ivoen.l
— 421 —
114. 190G. S. TiiOR. Ubor zwei noue in der Schwoiz von Herrn
C. Walter (Basel) erbeuteto Wassormilben. (Zool. Anz.,
XXXI, p. 67.)
[LeberUa (Neolehcrlia) walleri n. sp. et L. (Pseudolebcrlia) lineata
11. sp.]
115. lUOT. S. TiioR. Eino neue Neolebei'lia ans Italien. (Zool.
Anz., XXXI, p. 902.)
I
Description et figures île Leliertia (NcolehoUa) viaglioi Tlior
(Tessin).]
116. l'.HHj. C. Walter. Hjdraclmiden ans der Tiefen Fauna
der Vienvaldstiittersees. (Zool. Anz., XXX, p. 322.)
[Trois espèces seulement ont été capturées : Lebevtiatauinsif/nita
(Leb.), Hjigrobates dlbinas^-T-, que l'auteur considère comme un
« relicla species » et qui est probablement identique avec Campo-
gnalha schnetzU'ri\.eb., Tipligs Zschokkei nov. spec]
117. 1V)0<J. C. Walter. Noue Hydrachnidenai'ten ans der
Sehweiz. (Zool. xVnz., XXX, p. 570.)
[Description des espèces suivantes : Portnunia Steiniiianni, P. lata,
Aturus asserculatus, Pseudotorrenticola rininchota, S/ioxhon insi-
f/nis elHgdrovolzia canadlata nn. sp. habitant les eaux courantes.]
118. lOOO. r. Walter. Neun Scliweizerische Wassormilben.
(Zool. Anz., XXXI, p. 208.)
[Qalonyx n. g., pour Portnunia lata Walt., Tltijas curcifrons,
n. sp., Sperchon Koenikei n. sp., FeMria brevipes, n. sp., Feltria
JHvassica n. sp., Feltria ron.ci n. sp.[ (E. IL)
Tardigrades
119. 100(3. -T. Murray. ScoTtisli Alpine Tardigrada. (Ann.
Scott, nat. Hist., p. 25.)
[Diphascon alpinum nov. spec. décrit et lii^uré.]
120. 1001). .T. Murray. Tho Tardigrada oi' tlie Fort Valley.
(Ann. Scott, nat. Hist., p. 214.)
[Diphascon oculatum nov. spec. décrit et figuré.]
121. 1000. F. Richters. Wiedorbelebungsversuclie mit Tanli-
graden. (Zool. Anz., XXX, p. 125.)
(F. Piichters étudie la reviviscence chez quelques Tardigrades et
particulièrement chez Macrobiolus coronifer T.icht. Il reçut en août
l'.)03 de nombreux exemplaires de cette espèce dans de la mousse
venant du Spilzberg. liendant celte mousse humide, il obtint la révivis-
422
cenceaubout de vingt-cinq minutes, le !26 mai 1904, donc neuf mois
après. I.e 9 novembre 1904, donc quinze mois après, il fallait trente-
cinq minutes pour obtenir la reviviscence. Le 17 juin 1905 (après
22 mois», il fallait une beure, et le 7 février 1906, il n'obtint plus aucun
résultat. Par contre, à la même date, il put obtenir la reviviscence.
après deux beures trois quarts sur Milnesium tardifjrativm L)oy et
Macrobinlim Hufrlandi Sch. qui n'avaient préalablement été soumis
à aucun essai, il fallait vingt-quatre heures pour la produire chez
Echinisciis blanti Richt. Il semble donc que le pouvoir de reviviscence
varie suivant les es|)èces et suivant leur répartition géographique.|
122. 190(). F. RiCiiTKKS. Zwei noue Ecliinisciis-Artcn. (Zool.
Anz., XXXI, 1). 11>7.)
[Description et figures de Ecliiniscits comiitiis n. sp. (Pfalz) et
Ecli. eh'fjans n. sp. (Nagasaki).J
(Iv H.)
Insectes
123. IV»Or). N. Annandale. Notes on llic freshwator Fauna of
India. X" III. An Indian acjnatic ockroach and beetle
larva. (J. As. Soc. P.eng., 2, 1900, p. 105.)
|0n ne connaît encore que quelques rares espèces d'Orthoptères
adaptées à la vie aquatique et provenant toutes des contrées tropi-
cales. Eu retournant des pierres dans un cours d'eau du Cbota-
Nagpore, Annandale découvrit une larve O se rapportant évidemment
à une espèce du genre Ej)iliimpy(i (IMaliide) dont il avait antérieure-
ment signalé deux espèces à mœurs aquatiques. Placée dans un bac
d'eau, elle nageait rapidement à l'aide de ses six pattes et venait de
temps en temps projeter hors de l'eau l'extrémité de l'abdomen con-
formé d'une manière spéciale pour la respiration. L'auteur parle aussi
d'une larve de lampyride, probablement de Luciola iH'spertina, pré-
sentant également des mœurs aquatiques, vivant sur Pistia stratioU'S,
et donne la description du mode respiratoire de cet insecte. J
124. l'.KH). X. Annandale and Cii. Paiva. Noies on tlie fresli-
^\•ate^ Fauna of India. N° VI. The lile-liistory of an
aquatic Weevil. (.1. As. Soc. Bong., 2, 1000, p. 197.)
Illescription, mœurs et métamorphoses d'un Curculionide à mœurs
aquatiques, vivant sur LimnaniJieimwi.]
125. 190(3, E. Ber(;rotii. Systematisclie und svnonvmisclie
Bemei'kuno'en i'iber Hemiptcren. (Wien, Ent. Z.,XX^',
p.l.)
[Hennoiobatoch's gen. Hydrometridae = Ifcnnatobaiea, Anisojis
Kirliahlyanux nom. n. pr. cik'pol Kirk.)
— 4L\3 —
126. r.>()(). K. iJKiKiKoTii. Xciio austi'o-nialavisclic Ihniiiplci'a.
(Wion, Ent. Z., XXV, p. 12.)
\ Perillopm Breddini forme macroptère.]
127. 1*JU(3. F. E. Blaisdell. Notes and (lesi;rii)Liuii ol' tlic larva
of Culox vai'ipalpus Coq. (Ent. News, XVII, p. 107.)
128. 190G. G. Breddin. Die Hemiptei-on von Colebcs. (Halle,
Abh. xXatf. Ges., XXIV, p. 1.)
I
Descriiitions d'Hydrometridae nouveaux : Gerris anmUicornis,
vulpina, Plilomera pamphaf/m, dorceus, laelaps, oribasus un. sp.
(Celebes). Ddscriptioiis d'Hydrocorisae nouveaux : Anisops Bvcddini
n. sp. (Celebes). Anisops Fieberi nom. nov. pour nirca Fieb.]
129. 190(3. F. B. Browne. A com})arison of Agabus aifinis
Payk witli unguiculans Thonis. (Ent. Rec, XVIII,
p. 273.)
130. 1000. F. B. Bruvvne. A studv of tlio aquatic Coleoptera
and their surroundings in tlie Norfolk lîroads district.
(Xorwicli Trans. Nat. Soc, VIII, p. 2»H).)
131. lUOG. J. Bueno. Tho crvptocerate Hemiptera of America
in tlie writings of Prof'' A. L. Montandon. (Froc. Ent.
Soc, VIII, p. 15.)
[lUbliographie des travaux publiés i)ar Montandon sur les Hémip-
tères aquatiques américains et liste des espèces connues.)
132. IDOi). .1. BuEXo. Lifc-histories of Nortli American Water-
bngs. (Canad. Entom., XXXA'III, p. 189.)
[Mœurs de Belostoma flaminm elRanatra quadridentata]
133. 190(). T. I). A. Cot'KERELL. Preoccupied generic names
of Colooptera. (Ent. News, XVII, p. 240.)
[Helopeltina nom. n. pr. Helopeltis.]
134. 1900. S. R. CiiRiSTOPiiERS. On tlie im[)ortance of larval
cliaracters in tlie classification of Mos(jnitoes. (Se Mem,Mcd. Ind. N. Ser n^ 25, p. 1.)
135. 1900. W. Distant. Tlie fauna of Britisli India, including
Ceylon and Burma. Rliyncliota, vol, in-8°.
[Hijdrocorisae des Indes anglaises. — Plea miniitissima (= Leaclii
Kirk.). — Plm paUcscens sj). nov. (Calcutta).]
136. 1900. H. G. Dyar. Illustrations ofMosquitolarvae. (Proc
Ent. Soc, VIII, p. 15.)
["24 sp. décrits et figurés.]
— 424 —
137. lOOt). H. G. Dyar. Koy to tlio known larvae of tlio
Mosqiiitoes oi' tlie Unitod Sl;U"S. (Cir. V. S. Dep' agi'ic.
Bur. Ent., no 72, p. 1.)
[Table dichotomique des larves de Culicides coniuies des Etals-
Unis.]
138. lOOti. H. G. Dyar et F. Knab. The larvae of Culicidae
classified as independont organisms. (J. N. Y. Enl.
Soc., XIV, p. 1G9.)
139. 1901). E. P. Felt. Insects affecting park and woodlaiid
ti-ees. (N. Y. Mem. St. Mus., VIII, p. 1.)
[Descrii)tions et table dichotomique de quelques larves]
140. 190<). M. Grahiiam. Four new Culicida(> IVom Jamaïca,
West Indies. (Canad. Ent., XXXVIII, p. 811.)
[Larves de Aedes auratus, pertinax, Jantliinosoma echinata,
Mochlostyrax jamaicensis.]
141. 190<). C. G. H EWiTT. Some observations on tlie reproduc-
tion of tlie Hemiptera-Cryptocerata. (Trans. Ent. Soc,
p. 87.)
[Copulation et ponte de Corixa et Nepa cinerca.]
142. 1006. R. Jeannel. Remarques sur Siettitia balsetensis
Abeille et sur la faune aquati(jue Inq^ogée. (Bull. Soc.
Ent. Fr., p. 98.)
[La faune aquatique hypogée est surtout bien connue en Amérique;
ce n'est guère que de|)uis quelques années qu'on a entreprissonétude
en Europe. Elle comprend non seulement la faune cavernicole, mais
aussi la faune phréatique très riche : il est probable que dans les
sables reiiosant sur des couches imperméables d'argile, les eaux
phréatiques ont tracé des rigoles assez vastes donnant naissance k
toute une faune comprenant même des Vertébrés. C est ainsi que
Chilton a ilécouvert dans la nappe phréatique, en Nouvelle-Zélande,
toute une série de formes nouvelles appiirlenantaux genres suivants:
PhroatoicHS (Isopodei), Cruregens,Cyangonix,Gamniayus,CalUoini(s
(Amphipodes), Phreogetes, Phreodrilas (Vers), Potamopuyous ((Jasté-
ropodes).
Dans le Texas, Eigenmann a observé de nombreux animaux rejetés
jtar un puits artésien de 5S mètres de profondeur. I>a plupart des
espèces étaient nouvelles : Cypridopùs (Ostracodes), Cijdops (Copé-
poûes),Cocdidotaca.Cirolanidcs (lsopodes),Cr(/»f/0)(/.r (Amphipodes),
Palacmonctes (Décapodes) et Tijphlomoloe (Amphibien».
En Algérie. Rolland et Blanc ont montré la présence d'animaux dans
la nappe phréatique du Sahara, oîi les puits de l'Oued-liir rejettent des
poissons vivants.
- 425 —
M. .leannel a retrouvé dans un puits du lîeausset le cuiieux Dyliscide
obscuricolo : Siiititia halsctcnsis, dont il donne une description rom-
plète. Il fait remarquer que les habitants des eaux phréatiques
difTèrent notablement des habitants aquatiques des cavernes, ils sont
beaucoup moins modifiés dans leur forme]
143. 1U0(). A. Ç. Jensen-Haakup. A new species of tlio gcnus
Bei'OSLis. (Km. Medd. Ser., 2, III, p. 50.)
[Berossîis Engelhart) t\. sp. (Argentine).]
144. r.iOO. G. W. KiKivALDY. A guide to llic study of lîrilisli
Wiitcrbugs. (Entoniologist., XXXIX, pj). (iU, 79, 151.)
[Catalogue raisonné et mœurs des Hémiptères aquatiques d'Angle-
terre.I
145. lUOO. (\. W. KiliKALDY. List of tlie genoi'u of tlie Pagio-
l)odousH('iiii})tera-Hetei'optoi"a, witli tlieif type species,
troiîi 1758 to 11»04. (Trans. Am. Ent. Soc., XXXII,]). 117.)
ICatalogue des genres coiuius de Mepidae, Gerridae et Naeo-
geidae.]
146. l'.'Of). F. Knah. Xoles ou Dcinocerites cancei' Tliéob.
(Psvclic, XIII, j). \^ô.)
[Larves de Deinoccnlcs cancer, Janthinosoma jamaicensis.]
147. r.>0(3. F. Megusar. Einlluss abnofmalei- Gravitaiions-
wii'kung auf die Embiyonalentwicklung bei llydi'O-
philus aten-imus Esch. (AitIi. Entw. Mec, t. XXII,
p. Ml.)
[(Kufs, larve et embryologie de H. aterrimus Esch.]
148. 1U0<). E. G. MiTCiiELL. Mouth parts of Mosrpiisto larvae
as indicative of habits. (Psyché, XIII, [). 11.)
149. lUOC). E. G. MiTCHELE. On ihe Icnown krvae of the genus
Franotaenia. (J. N. Y. Ent. Soc, XIV, p. 8.i
150. llUKj. E. M.iôBERd. Om nagi'a svenska insektei's biologi
och utveckling. (Ai'k. Zool., III, p. 1.)
|l»escription de la larve de Anisomeya Claussi (Dytiscidae).]
151. lOOO. E. M.iôi^ERfi. Ziir Kenntnis einigei' imter Seetang
lebenden Insekten. (Z.Wiss. Insektenbiol., II, p. 137.)
1 Métamorphoses de Cercyon Uttondis.]
152. 1006. R. C. OsBURiN. (observations and ex])ei'iments on
(h-agon Aies in brackish water. (Amer. X'at., XL,
p. 395.)
— 426 —
153. 100(3. A. Popovici-Baznosanu. Contributions à rétudc de
l'organisation des larves des Flpliéniérines. (Arch. Zool.
exp. sér. 1, V. notes et revue, p. lxyi.)
154. 1006. B. Poppius. Eine neue Art der Gattung Hydaticus
Leach. aus der nôrdlichen Mandshurei. (Rev. russe
ent., yi, p. 58.)
[Hijdaticus laeviusculus sp. nov. (Maiulchourie).]
155. 1006. B. Poppius. I>eitragc zur kenntniss der Coleopteren-
fauna des Lenathales in Ost Sibirien. I. nali})lidae und
Dytiscidae (Ofvers. F. Vet. Soc, XLVII, p. 1.)
[Afjabus aenescens, diibiosm, femoralis var. pallens, Hydaticus
rugosus, Hydropoms nobilis, tomentosus, punctatissimns, lenensis,
nn. sp. (E. Sibérie).]
156. 1006. M. RÉGIMBART. Dytiscidae, (lyrinidae, Hydroplii-
lidae. Vovaa-e de M. Charles Alluaud dans rAfriinic
orientale. (Ami. Soc. Ent. Fr., t. LXXV, p. 235.)
\Bidessns brevistriga, Canthydrus AUuaudi, Clypcodytes Neu-
manni,Copelatus aethiopicus, atrosulcatus,Heyophydrus variahllis,
HydroporasfNebriopoyus subg. nov.) kilimandjarcnsis, Uyphydrmmaculiceps, variolos^is, nigrovittatus, Laccophiius pilitarsis,
flaveolus, prodttctus, Yola frontalu, dilatata, Aulonogyrus flavi-
ventris, hypoxanthus, epipkuricus, Orectogynis laticostis, niga-
lifer, fcminalis, coptogynus, erosus, nn. sp., Leroyi Aig. var. n.
Nairobi'nsistavetensis, Berosus tetracanthus, gracilispina, subglo-
bosus, corrugatus, Cevcyon limbicolUs, Cyclonotum rubrocinctum,
Globaria simplex, seriata, Helocharcs melanonophthahnus lieiclie
nn. var. notalicollis et curtns, laeviusculus, Hydiaena bvevipalpis,
Allnandl, kilimandjan'nsis, Hydrochus albicans, Megasternum
brunneum, Ochtkebius strangulatus, tenuipunctus, rugulosus,
Philhydrus Alhiaudi, Spcycheus crenaticollis, huriwralis, Sphaeri-
dium obsciirum, Volvulus compressus, obsoletus, dlipticus nn. sp.
(Afrique orientale).]
157. 1006. M. RÉGiiMBAriT. Description d'un Dytiscide nouveau.
(Bull. Soc. Ent. Fi-., p. 203.)
[Hydroporus {Deronectes) Peyerimlioffin. sp. (Algérie).]
158. 1006. M. RÉGLMBART. Dytiscidae, (lyrinidae et Hydro-
})]iili(lae. (Nova ('niinea. Leyde, 5. Livr. 1. p. 21.)
[Platynectes decempuncfatus, Dineutes tetracantlius, nn. sp.
(Nouvelle-Guinée).]
159. 1006. E. Reitter. Drei neue im Quellgebiet des Indus
von Prof. D^' Kokcn gesammelte Coleopteren. (^^'icn,
Ent.Jîtg., t. XXV, p. -10.)
[Hydrous {Pagipherus) Piesbergeni, stcrnitalis nn.sp. (Turkestan).|
— 427 —
160. l'.MX). E. IvEiTTER. Xeu(> Col(X)i)ton'n ans dci' j'aicark-
tisclion Fauiia. (W. Eut. Zlg., t. XX^^ p. ;!1.)
ICoelostomatranscapicum, orbiculare var. nn. punclicolle, subac-
veum et nigrinus (ïranscaspie) nn. sp ]
161 1 '.»()( ). J. SahlberCt. Agabus (Gaurodjtes) gelidus n. sj).
(Medd. Soc. Fauna FI. XXXII, p. 15)
162. l'.iOC). J. Sainte-Claire Deville Svnopsis dos Hvdi'aena
du nord de l'Afrique. (Abeille, XXX, p. 283.)
163. l'.iOG. A. J. SiLFVENius. Beitriige zur Me(amoi-[)liose der
Triclioptereii. (Acia Soc. Fauna et FI. Feun., XXMI,p. 1.)
[Métamorphoses de Af/apetus coinatns, AQvijpnia picta, Braclti/-
cenlnis subnubihis, Erotesis baltica, Glossosoma vernale, Goëra
pilosa, Holocentropus auratns, stagnalis, Hijdropsjfclie, Hydropsi/cha
saxonica, ançuustipenuis, instabilis, lepida, Lepldostoma hirtuin,
Leptoccrus fulvus,s(>nilis, annulicornis, aterrimas, cinereus, excisas,
Lijpe sp., Micrascma setiferum, Molanna aagustata, Molannodes
Zelleri, Mifstacides azurea. longicornis, NcurecUpsis bimaculata,
Neuvonia lapponica, Notidobia ciliaris, Occetis ochracea, lacaslris,
PInlopotainus montanus, RhjiacophUa nabila, septentrionis, Seri-
costoma personatiim. Silo paUipes, Tinodes Waeneri, Triaenodes
bicolor, Wormaldia sabniffra.]
164. lUOi). A. J. SiLFVENius. Ueber die Métamorphose einigei'
Phryganeidenund Limnopliiliden. III. (Acta Soc. Fauna
et FI. Feun., t. XXVIÎ, p. 1.)
[Métamorphoses de Agrupnctes cvassicornis, Coljiolaalius incisus,
lloloslomis atrala, Limnophiias borcalis, flavicornis, marmoratus,lunatas, a/finis, bimaculutas, luridas, Micropterna latcralis, Nearo-
nia vaficras, clnthrata, Phrygancd varia, Stcnoplii/lax dubius,
infiimatas et table dichotomique pour la détermination des larves de
Phryganéides de Finlande.]
165. 100(5. E. SuNDViK. Iakttagelser i afseende a A'olucolla
])ellucida. (Soc. Fauna FI. Feun., XXXII, p. 115.
j
[Mœurs de la larve de Volucella pellucida.]
166. lOOii. R. TiLLYARD. Life historv of Lestes leda Selvs.
(P. L. S. N. S. W. XXXI, p.'409.)
167. 1*.)0(3. G. Ulmer. Uebersiclit ûber die bislier bekanntt'ii
Larven europaïscher Tiicliopteren (Z. Wiss. Insekten-
bioL, II, pp. 111, 162, 209, 253 et 288.)
[Table dichotomique des larves deTrichoptères d'Europe]
— ^28 —
168. lOOn. Cl. Ulmkk. l'cbcr die Larve eiiior IJrasilianisclion
Tri(']ioi)U'ivn Spocirs (T)'ii)k'l('ti(los gracilis Bnrm.)
1111(1 vcrwaiidU' FoniKm ans Neu-Seelaiid und Indien.
(Ann. Biol. lac, I, p. 32.)
169. ll»fK). \A'amvK. Zur Lcbenswcise des Gelbrandcs. (Allg.
Fischerciztg, XXXI, p. 310.)
IMœurs du Dijlmm marçiinalis L.]
170. l'.KH). Z Zaitzev. Drei nene Dviisciden Ai-teii. (Rev. russe
cnL, Vl, p. 2().)
\A(jabm fulvaster, lateaster, Macrodijtes dcUctus un. sp. (N.-O.
Sibérie).]
(E. R. el H. S.)
Mollusques
171. 10i)(). C. F. AxcEY. Relevé des mollus(|ucs teiTestres et
iiuviatiles de la Péninsule arabicpie. (Journ. Concli.,
Paris, vol. LUI, p. 257.)
[Catalogue raisonné. — La faune malacologique du sud de l'Arabie
offre la plus grande analogie avec celle de la côte des Somalis; cette
faune si' rapproche aussi, naturellement, de celle de Socotora, mais
l'ile en question doit avoir été isolée à une époque 1res ancienne.
1
172. l*.H)(i. C. F. Anœy. Addenda au relevé des molbiscpies
ieri^eslres et fiuviatiles de la Péninsule arabiiiue. (Journ.
roncli., Paris, vol. LUI, p. 17L)
173. l'.H)7. r. F. Axt'KY. Additions au relevé ili.'s inollus(|ues
hM'i-esli-es et tiiuiatiles de la Péninsule arabique. (Joui^n.
ànich., Paris, vol. LIV, p. 21.)
174. l'.ioO. r. F. A.N'CEY. Sur l'i )mplialotroi)is annalonensis Pi'r.
et les formes voisines. (Journ. Concli., Paris, vol. LUI,
]). 2'.)S.)
175. l'.KH). C. F. Anc]<:y. Xotes criti(|ues et svnonvniirpies.
(Journ. foncli., Patois, vol. LUI, p. 310.)
\Planoybis Hildcbninti von Mart. = PI Madagascaiicnsis Smith;
PI. Tancn'dn Parav. = PL pulchcUan Phil.; PL inareolicus l>et. =PL Ehrcnberçii Heck; PL subsalinanm bines = PL Boissiji Pet. et
Mich.l
176. l'.KM). i\ F. Ancey. Descriptions of two new Cleopatra
aaid a Pisidium. (Nautilus, XX, \). 45.)
[Pisidium planetum (Madagascar) nov. spec]
— 420 —
177. ]00(). F. r. Baker. A])i)licatioii oi' de Vrics' Aliilatiou
Tlioorv lo tlio MoUusea. (Amei-. Naliiral., vol. XL,
p. ;î27.)
178. 100(3. F. C. Baker. Lvmnaea Hinklevi n. s[). (Xaulilus,
XIX, p. 142.)
179. 1007. F. C. Baker. Lvmnaea Daniolsi sp.nov. (Nauiilns,
XX, p. 55.)
180. 1007. F. C. Baker Descriptions of new specics oi' Lvm-
naea. (Xautilus, XX, p. 125.)
[Lymnaea Dahli, Leai nn. sp. (N. Amer.).]
181. 1007. F. C. Baker. A new Spliaorium tVom Illinois.
(Xautilus, XX, p. 21.)
[Sphaerium stamineum forbesi nov. var. (N. Amer.).]
182. 1000. A. Bavay. Sur quelques coquilles oubliées du
M^iséum de Paris. (Journ. Concli., Paris, vol. LIH,
p. 248.)
[Limnaea crassimcula (iles Mariannes) nov. sp]
183. 100(3. H. BeestOxN. West Lancashii'e non Marine Mol-
lusca. (.Tourn. Concli., Manchester, vol. II, p. o4())
184. 100(3. S. Brusina. Revision des Dreissensidae vivants du
svstème européen. (.Tourn. (_^onch., Paris, vol. LUI,
IK 272.)
|2 genres et 11 espèces, pas de sp nov.]
185. 1007. C. H. Cjiadwick. List of Wisconsin Sliells (suite).
(Xautilus, XX, p. 22.)
[Liste lies Univalues d'eau douce du Wisconsin.|
186. 100(5. S. Clessin. Zur ConMivlien l'auna des Loss in
Gebiete der Donau. (Xachritsbl. Deutscb. Malac. (ies.,
XXXVIII, p. 1(37.)
187. 100(3. E. CsiKi. IL MoUusca. (Fauna Kegui Hungariae,
P>udapest, 1000.)
[Historique des recherches malacolog-iques en Hongrie et catalogue
des ù'M espèces connues.]
188. 1000. Pu. Dautzenberg et H. Fischer. Liste des mollus-
ques récoltés par M. H. Mansuy en Indo-(]liine et au
Yunnan et description d'espèces nouvelles. (Journ.
Conch., Paris, vol. LUI, j). 34;:!.)
ICatalogue raisonné. — Melania Jacqucti (Tonkin) sp. nov.]
— 430 —
189. lOOC). V. Franz. Plnsa aciita Drap., in Dcutscliland ein-
gebi'irgcrt. (Nachriclitsbl. Doulsch. Malak. Gos.,Jalirg.
XXXVIII, p. 202.)
190. 1907. L. S. Friersun. Soirio Observations on tlie Ova of
Unionidae. (Naulilus, XX, p. 68.)
191. 1900. H. C. FuLToN. Description of a now s})ecies of T'nio
(Ciineopsis) from Yunnan. (Ann. Mag'. X. H., XVII,
p. 240.)
\Unio tauriformis sp. n.|
192. 1900). L. (tERM.^in. Introduction à l'étude de la faune
malacologique terrestre et fluviatile du massif armori-
cain. (C. R. Ass. franc. Av. Se. Sess. XXXIV, p. 577.)
193. 1901). L. Germaln. Études sur quelques mollusques
terrestres et fluviatiles du massif armoricain. (Bull.
Soc. Se. nat. Ouest, Xantes, vol. VI, p. 1.)
[L'auteurdonne la nomenclature d'un certain nombre de mollusques
non encore signalés dans les départements de Marne-et-Loire et de
la Loire-Inférieure ; il tait remarquer que le Limnaea Michaudi l.oc.
est tout au plus une var. viajov du L. intermedia Fér.)
194 1900. M. Gluver. Notes on the Dritish Land and Fi'esli
water Sliells collected by tlie Late Mr. Tliomas Glover.
(Journ. Conch., Manchester, vol. II, \). 308.)
195. 1900. Iv. HiLBERT. Zur Kenntnis der Preussischen Mol-
luskenfaïuia. (Scluift. pbys. okon. Ges., Kônigsberg,
Jaln-g. XLVI, p. 41.)
196. 1907. A. A. HiNKLEY. Some Sbells of Mississipi and Ala-
baina. (Nautihis, XX, p. 40.)
[Liste des coquilles du Mississipi et de l'Alabama.|
197. 1900. H. HoNKiMANN. Limnaea (Gulnaria) o\ata Drap.
var. Kôlderinova. (Xachriclitsbl. Deutsch. Malak.Ges.,
Jaln-g, XXXVIII, p. 45.)
198. 1900. E. HoLZFUSS. Planorbis corneus L., ein Dopi)elai-
mei'. (Natur und Haus, Jabrg. XIA", j). 2;)4.)
199. 191)0. T. KuRMos. Beitrage zur Molluskenfauna des
Kroalisclien Karstes. (Xacliricbtsbl. Deutsch. Malak.
Ges., Jalu'g. XXXVIII, pp. 73 et 140.)
[Catalegue des Mollusques du Karst. — Neritina fluviatilis var. n.
Zernovnicenm.]
— 431 —
200. 190G. W. A. LiNDiiOLM. Einige Bemerkuiigcn iibor die
Svstematik dcr Valvatidae. (Nacliriclilsbl. Douiscli.
Malak. Ges., .lalirg. XXXVIII, p. 187.)
201. 11)0(3. \V. A. LiNDiioLM. Beitragziu- Molluskenfauna von
Liltaiien. (Xachi'iclitsbl. Deiitsidi. Malak. (xcs.. .lalirg.
XXXVIII, p. 11»3.)
202. 1000. A. Mayi-'IKLD. Conli'ibiitions towards a List oï
West-SufFolk non marine Mollusca. (Joui'n. Concb.,
Mancliester, vol. II, p. 340.)
203. 1000. PI. Xeuville et R. Anthony. Liste préliminaire de
Mollusques des lacs Rodolpbe, Stéphanie et Margue-
rite. (Bull. Mus. Ilist. nat , Paris, p. 407.)
|l-a faune malacologique de ces lacs est essentiellement d'eau
douce, elle n'est pas halolimnique comme celle du Tanganika.]
204. 1900. H. Neuville et R. Anthony. Troisième liste de
Mollusques d'Abyssinie (collection Maurice! de Roth-
schild.) (Bull. Miis. Hist. nat , Paris, p. 310.)
205. 1900. H. Neuville et R. Anthony. (Quatrième liste de
Mollusques d'Abyssinie (collection Maurice de Roth-
schild.) (Bull. Mus. Hist. nat., Paris, p. 411.)
206. 1900. H. A. PiLsmtY. A New lîraekish-Walcr Suail fi'om
New Engiand. (Nautilus, XIX, ]>. 90.)
[Paludestrina salsa n. sp.]
207. 1900. H. A. PiLSimY. Vitrea rhoadsi and Snceinea relusa
magister. (^Nautilus, XIX, p. 109.)
208. 1907. H. A. PiLSHiiY. Two new Ameriean gênera of
Basommatophoi'a. (Nautilus, XX, p. 49.)
[Amphigi/ra nov. gp.n. Alabamensis n. sp. (Alaljama) et Ncoplanoy-
bis nov. gen. tantillm nov. spec (Alabama).]
209. 1907. H. A. PiLSHKY. Note on Lepyrium. (Nautilus, XX.
p. 51.)
210. 190(). IL B. Preston. Description of a new speeies of
Limnaea from N.-^^^ Ausd-alia. (Proc. Malac. Soc,
London, vol. VII, p. 30.)
[Limnaea egregia nov. spec]
211. 1907. H. B. Preston. Descriptions of new speeies of
Land and Freshwater shells from Centi-al and South
xVmerica. (Ann. Mag. N. H., XX, 1907, p. 490.)
\Limnca Sclli, Plannrbia Costariccnsis, Planorbis Honcurdiana.
PI. Merulaensis, Pkijsa Oulleata, Pk. cornca, nn. sp.]
— 432 —
212. 1*.>00. \\'. RoTii. Znr Ehroni'ottung dor Paludina. (Natui-
imd Haiis, Jahrg. XIV, p. 171.)
213. 190G. W. RoTH. ï'ber die Herkunft und das .Vlter der
Zuriclisee-Paludina. (Bl. fiir Aq. imd Terrariehkunde,
190G, n° 18.)
214. 1907. 0. ScHRÔDER. Beitrage 7a\v Histologie des ManUds
von Calcyculina (Cyclas) lacustris Millier. (Zool. Anz.,
XXXI, p. 506.)
215. 190G. E. A. Smith. Report on tlie Mollusca of tlie ïliii'd
Tanganvika Expédition, conducted bj D''. W. A. Cun-
nington, 1904-1905. (Froc. Zool. Soc, 1900, p. 180.)
[-25 espèces duTanganika, dont 2 nouvelles : Anceya rufocincta et
Ancylus tanganjjiœnsis; 8 espèces de Victoria Nyanza. dont 2 nou-
velles : CorbiciUa Cunningtoni, Sphaenwu Victoriac]
216. 190r). C. Skil. Pliysa acuta Drap, bei Miinehen. (Xach-
l'ichtsbl. Donlscli'. Malak. Ges. ,.la]irg. XXXVIII, p. 203.)
217. 1900. V. Sterki. New Varieties of Xorlli American
Pisidia. (Xaulihis, XIX, p. 118.)
[Pisidiuni variabile var. brevius. var. hifbridum; Pis. nobfroia-
cense, var. i:rj)ansnm, var. ek'vatum, var. quadratum, var. lincalinn.
var. fratevnum, var. alabamense nn. var. (Amérique du Nord).]
218. 1V)07. y. Sterki. New species of Pisidiuni. (Nautilus,
XX, p. 5.)
[Pisidium proxhniim (N. Amer.)]
219. 1907. V. Sterki. Id. (loc. cit., p. 17.)
[Pisidium miimsculum, fragillimum, levissimum, subroltinduvi,
Friersoni (.N. Amer.)nn. sp.j
220. 1907. ^'. Sterki. Sphaerium Lendersoni n. sp. (Nautilus,
XX, p. (J9.)
221. 1907. V. Sterki. New Pisidia. (Nautilus, XX, p. 87.)
\Pisidiuin negkclnm nov. spec, var. corpulcnlum nov. var.
(N. Amer.jl
222. 1907. V. Sterki. New Pisidia. (Nautilus, XX, p. 98.)
[Pis. snpciius, snccineum (N. Amer.) nn. sp.)
223. 1907. P). Vai.ker. Notes on ^'alvata. (Nautilus, XX,
p. 25.J
[Valvala sinccra Danidsi n. var., I'. bicarimila conmrtiinsu. v.,
lu'vdcpirssa n. v. (iN. Amer.)|
— 433 —
224. l'.iOT. 1). ^^'ALKER. A list of Sliolls l'rom Xcbrnska. (Nau-
Lilus, XX, p. 81.)
225. VM) .T. WATERSoNand .1. W. Taylor. Land and Fr( sli-
watei- Mollnscs of S' Kilda. (Ann. Scott. Xat. Hisl.,
p. 21.)
226. 1U0C>. C. Zeimeï. Dio PorlinuscliL'l (Mcleaiirina luargari-
tifci'a L). (Xatur und Haus., Jalii'g. XIV, \k 202.)
(!]. U.)
Bryozoaires
227. l'.'UT. A. Okx. Einc di-itte Art von l^>(•^inatella (F. Daven-
|)orti n. sp.). (Zool. Anz., XXXI, p. TKi.)
228. r.'OT. (\ F. R()rssELia\ Roport on tlie Polyzoa of tlio
Tliii'd Tankanvika Expédition conductcd bv 1)'. W. A.
Cunnington, "l90t-li»05. (Pme. Zool. Sor., VMl
,
p. 2r>0.]
[PlamatcUa tankanuih'ie sp. nov.. PlumalcUa ri'pens vnr.?,
Arachnoidia Ran-Lania'slcri Uoora, Victon-Ua sijmtiioticu si). n.|
229. l^OiJ. A. ^^^ \A\\.ters. Bnozoa from Cliatliam Island and
d'Unille Island. New Zealand. (Ann. Mag. X. H.,
XVII, 1). 12.)
[Pluiuatdla princep^i Ivraep. (lac Huro, l. Clialliam).|
(k. L.)
Batraciens
230. UK»7. V. Hacker. C'bcr Mendelsclic ^>lvl'bung boi Axo-
lotln. (Zool. Anz., XXXI, p. '.»'.•.)
231. F.iOT. .\. H. REA(iAiN. Reptilien luid Ampbihien vom
Roseland-Indianor-Resérvat. (iebict in Siid Dakota.
(Zool. Anz., XXXII, p. 31.)
ISimple liste.I
232. F.HlC). ^^^ NA'olterstorff. Iber den Formenkreis des
Tri/on {=MoIge) vittafus Civay. (Zool. Anz., XXIX,
p. (illt.)
— F bel- Triton pvrrliogaster subsp. orientalis Dav.
(Zool. Anz., XXX, p. 5Ô8.)
233. FH)7. ^^^ ^^^)LTERST()RF:•. Iber neue Tritonenformen
(")steiTeiselis, insbosondei'e Triton (= Molge) vulgaris
sul)S}). lyi)iea forma Kamniei'eri n. f. (Zool. Anz.,
XXXF p. Tio.)^
(Iv II.)
— 434 —
Poissons
234. 1 '.)()(). Basiiford Dean. Notes on tlie living spécimens of
tlie Australian Lungsfîsli, Ceratodus Forstcri, in tlie
Zoological Societvs Collection. (Proc. Zool. Soc, IDOG,
p. 108.)
235 1900. L. S. r>ER(;. Description of a now Cvprinoïd Fisli,
Paraleucogobio notacanthus, from N. Cliina. (Ann.
iMag. Nat. Hist., XIX, p. 103.)
236. l'.'OO. L. S. Ber(;. Description of a new rvprinoïd Fish,
Ai'clieilognatus signifer, from Koi'ea, witli a Synopsis
of ail tlie known PJiodeinae (Ann. Mag. X. H. XIX,p. 159.)
237. 190<'). L. S. Perg. Ùbersiclit der Salinoniden von Amiir-
Becken. (Zool. Anz., XXX, p. 395.)
[Liste des 1 1 Salmonidés connus de l'Amur, avec quelques descrip-
tions, dont celle d'une espèce nouvelle : Coregomis ussuriensis (Ussuri,
Chanka See).]
238. 19()(). L. S. Berg. Ubersiclit der Cata])liracti (Fam.
Cottidae), Cottocomeplioridae nnd Comeplioridae des
Baïkals(>es. (Zool. Anz., XXX, p. 908.)
(L'auteur donne la liste des espèces trouvées dans les dragages
effectués dans les grandes profondeurs du Haïkal par le professeur
Korotneff. Les Cottidae comprennent G genres et 11 espèces; sont
nouveaux : Asprocottus Herzensteinii nov. gen. nov. spec, Abysso-
cottaii nov. gen. pour Korotneffi, gibbosns et Boulengeri mi.ssp.,
Liinnocottus nov. gen. pour Cottus Godletcskii {\)\h) et mcgalopa
(Gralz ). — La famille des Cottomephoridae est nouvelle avec le genre
CotlomepJiorm gen. nov. pour Cottns Grewingki (Dyb.). — Les
Comeplioridae comprennent un genre de 2 espèces.)
239. 190(i. L. S. Berg. Note on Doliichtlivs stellatus Sauvage.
(Ann. Mag. X. H., XVIII, p. 393.")
240. 190('). L. S. Berc;. Description of a new species of Leuco-
gobio from Korea. (Ann. Mag. X. H., XVIII, p. 394.)
\Leucogolno coreanus sp. n. et table dichotomique des Leticogobio
connus.]
241. 1900. (t. a. Boulenger. Fourtli Contribution to tlie
Iclitliyology of Pake Tankanyika (Trans. Zool. Soc,
Xyil, 190(), ]). 537.)
(Si espèces dont Miivcmciiius tunkanicaniis. Pcllomila viiodov,
— 435 —
Aleste rhodopleuva, Neobola minuta, Dinotoptinusf/. ». Cunning-toni,Ch)'ysichth!is sianenna.Phyllonenms g.n. ti/pus, Anclienoglanis
occi(lenlali'ivar.taiiganicanus,S!jno(lontis)iit'lanosticlnsJIaploclulits
pmnilus, Lates augiistifrons. Lamprologus bicvianalis, L. Cunning-loni, L. momlahn, L. mullil'orciatiis, L. caUipletiis. L. reticulahui,
L. ralliarus. Panitilapia frontosa, Batliiihatcs minor, Haiilota.vodun
g. n. iiiicyolcpis, Peliiiatochyornis pk'urospilus, P. rhodosligiini,
Trematocara nigrifrons, Tilapia latifrons, Cunningtonia n. g.
longiventraUs, Masitacembelm Cunningtoni, nn. sp.]
242. l'.>0(). G. A. P)OULEN(JER. On some Fislios IVom ilic
Kwango. Hiver in Angola, collected by D'' \A\ J.
Ansorge. (Ann. Mag. N. H., XVII, p. llO.)
( Vavicorhinus Ansorgii, Apotochilus macrocephalm, ssp. nn ]
243. lOOO. G. A. I)(_)ULANGER. Descriptions of new Fislies
discovered by Mr. E. Degen in Lake "\'i('(oria. (Ann.
Mag. N. H.", XVII, p. 433.)
[Petrocephalm Ik'geni, Marcusenius nigricans, Alestes Sadleri,
Barbus lobogeni/n, B. MinclunL B. Magdalenae, Clarias AUuaudi,liagrus Degeni, Siinodonlia Victoriae, Paratilapia cinerea, Pelma-tochromis Speldi, P. flavipinnis, P. microdon, P. obesus, Haplo-cliromis percoidcs, H. Stanleyi, H. bicoloy, H. crassUabris, H.dranU, H. hhmaHi, Tilapia variabdis, T. nigricans, T. Martini,T. lacrimosa, T. nubila, Platutaeniodus gen. nov. Degeni, nn. sp.|
244. l'.KKJ. G. A. I)OULEN(iKR. On a Gollection of Fishes froiii
GaHalmid. (Ann. Mag. X. PL. XVII, p. .^7.)
|8l espèces connues et N espèces nouvelles : Barbus Zuaicus,B. MacmiUani, B. Bottegi, H. ZapJiiri, B. gudaricus, B. eimigstus,
B. Margaritae, B. alticola.]
245. 11)00. G. A. IJouLENcJER. Description of a new Fisli of
tlie genus Clarias from Uganda. (Ann. Mag. X. PL,
XVII, p. 500.)
[Clarias Werneri n. sp.j
246. lOOi;. G. A. BouLENGER. On some \\'est African S^jccies
of Barbus. (Ann. Mag. X. PL, XVIII, p. 32.)
247 . 1000. G. A. BouLEiNGER. Description of a new Barbus fromtlie Uganda Protectorato. (Ann. Mai;' X. H. XA'III
p. 30.^
[Barbus Portali sp. n.J
248. 1000. G. A. BouLENGER. Description of a now MormvridFish from Soutli Tamcroon. (Ann. Ma^•. X. IL, XA'iII,
p. 30.)
[Marcusenins Bulesii sp. ii.|
— 43G —
249. 190<). G. A. BouLENGER. Description of a new Silurid
Fisli of tlie g(3nns Doumoa Saiivag(\ from Angola.
(Ann. Mag. N. H., XVIII, p. 347.)
[Doumea angolensis, sp. n.)
250. 190(3. (i. A. BouLENGER. On tlie Présence of Two Species
of Anabas in the Wliite Nile and tlie Balir-el-Gebel.
(Ann. Mag. X. H., XVIII, p. 348.)
[Anabas Muriei elPetherici\
251. 1907. G. A. r)0UEEXGER. On the Variations of Slereolepis
gigas, a great Sea-Percli from California and Japan.
(Ann. Mag. X. H., XIX, p. 489.)
252. 1907. G. A. Boulengek. On an African Barbel liillierto
confounded with Bai'biis iriniaculatus Peters. (Ann.
Mag. X. H., XIX, p 492)
[Barbus decipiens, n. sp.]
253. 1907. G. A. Boulenger. On Barbus aureus Cope, i'roui
Xatal. (Ann. Mag. X. H., XIX, p. 390.)
254. 1907. G. A. IJoulenger. Description of a new Cyprinid
Fisli of tlie genus Labeo from tlie Transvaal. (Ann.
Mag. X. H., XIX, p. 392.)
[Labeo Riiddi sp. ii.]
255. 1907. G. A. Boulenger. Description of a new ("ichlid
Fisli from Portuguese East Africa. (Ann. Mag. N. H.,
XX, 1907, p. .")().)
[TUapla Sivijnnertoni nov. spec. (Buzi River).]
256. 1907. G. A. Boulenger. Descriptions of tbree new Fresli-
water Fislies discovered bv Mr. G. L. Bâtes in Soutli
Cameroon. (Ann. Mag. X. H., XX, }>. .50.)
[Synodontis Balesii (Ja Uiver), Claria lonnior (Kribi River) et
Eleotris Kribensis {\ivihi River) nn. sp.]
257. 1907. G. A. P)OUlenger. Descriptions of two new Fresli-
water Fislies discovered by D'" W. .1. Ansorge in
Mossamedes, Angola. (Ann. Mag. X. H., XX, p. 108.)
[Labeo Ansordii {Dongwenna) et Paratilapia angusticeps {Za.mhes\)
nn. sp.]
258. 19(J7. G.A Boulenger. Descriptions of two new African
species of Barbus. (Ann. Mag. N. H., XX, p. ;i3().)
[Barbns aspilus (Ja Hiver) et trispiloviimus (Congo) nn. sp. et
table ilicliotomique des Bai.bas d'Afrique.]
— 437 —
259. 1VH)7. G. A. BouLENGER. Descriptions ot' tlireo newFresli-
\\-A\vv Fislies discovered by Mr. (i. L. Bntes in ('ame-
roon. (Ann. Mag. N. H., XX, p. 485.)
[Nannocharax ocellicauda (Ja River), Barbus coUipterus (Ivribi
River), Maslacembelus lonf/icauda (Kribi River) nii. sp.)
260. r.K)7. G. A. BouLENOER. Descriptions of threenew Fishes
tVom Central Africa. (Ann. Mag-, X. H., XX, p. 487.)
IPetusiaa Woosnami (Aruwimi), Barbus Johnstonii (Afr. centrale
anglaise) et Amphilius Hargeri (Afr. centrale anglaise) nn. sp.]
261. 1U07. H. W. FowLER. PennsylvaniaFislics. (Amer. Nat.,
XLI, 1007, p. .").)
[Catalogue raisonné des Poissons de la Pens\ Ivanie.|
262. 1007. V. Gratzianow. Ûbersicht der Siisswassercottiden
des Riissischen Reiches. (Zool. Anz., XXXI, p. 0.54.)
[Table dichotomique des 19 espèces de Cottides connus en Russie ;
une espèce nouvelle : Cottus Koshcirnikoici et deux nouveaux genres :
Cephalocottus pour Cottu>i amblystonwpsis Schmidt et Mesocottuspour CottihS haitci Dybowsky.]
263. 10()(). E. Leoniiardt. l'ber die Mopskopbildnng bei Abra-
mis vimba L. (Zool. Anz., XXXI, p. .53.)
264. 1000. M. Plehn. Ûber den Exoplithalmus bei Fisclien.
(Allgem. Fisch. Zeitg., XXXI, p. 351.)
265. 1007. C. M. L. Popta. Einige Fiscliarten ans ('bina,
Xenocypris lampertii nnd Clianodicbtliys stenzii nov.
sp. (Zool. Anz., XXXII, p. 243.)
266. 1000. I). G. STEAD.FisIiesof Australia. Sydney, 1000.
IGuide systématique et populaire pour l'étude des poissons les plus
intéressants de r.\ustralie.|
267. 1000. C. T. RegaiN. Description of tln'ee new Fislies from
Yunnan. (Ann. Mag. iN. IL, XIX, p. 03.)
[Schizothoriix taliensis (Tali Fu Lake), Discngnathm Yunnanensis(Yunnan Fu l.ake) etSilurus Grahami (Chun Kiung l.ake) nn. sp.]
268. 1000. C. T. PvEGAx. On tlie Fi^esliwater Fislies of tlic
Island of Trinitad, based on tlie Collection, Notes, andSketcbes made by Mr. Lecbmere Guppy. (Proc. Zool.
Soc, 1000, p. .378.)
[Table dichotomique des 41 espèces connues de la Trinité, descrip-
tion de quelques espèces dont Tetragonoptorus Guppjji, Psaulaii-
chenipteriis Gappi/i, Paranchenipterus Paseae nn. sp.|
— 438 —
269. 1006. C. Tate Regan. A Revision of tlie South-American
Ciclilid Gênera Relroculus, Geopliagus, Hetorogramma
and Bioto(>cus. (Ann. Mag. X. H., XVII, p. 10.)
[Tables dichotomiques et descriptions des espèces de ces genres.
yielerogramma gen. nov. pour Mexop>^ part. Giintli, Gcojjliagns part,
(jopeet Biotodama Pelleg., //. Borellii sp. n (Paraguay).]
270. 1000. r. Tate Regan. Notes on somo Loricai'iidFislics,
witli Descriptions of two new Species. (Ann. Mag.
N. H., XVII, p. 04.)
\Ancistrus Bovallii (Guyane anglaise), Loricaria Stcinbachi
(Argentine) nn. sp.]
271. 1000. C. Tate RE(iAN. Tlu^ ^'cndacos of Loclnnabcn and
of Derwentwater and Bassentliwaite Lakes, Con^gonus
vaùdesius and Coregonus gracilior. (Ann. Mag. X. H.,
XVII, p. 180.)
[Coregonm graciUoy n. sp.|
272. 1000. (\TateRegax. A Revisionof tlicFislies of tlieSontli
American Cichlid Genei-a C^iclda, (^liaetobranclius, and
Chaetobrancliopsis, \\iili Notes on tlie (^lenera of
Amei'ican Cicldidae. (Ann. xMag. X. H., XVII, j) 2;ïO.)
[Tables dichotomiques et descriptions des genres cités et de leurs
espèces.)
273. 100(). C Tate Regan. Descriptions of two new rvi)rinid
Fislies from Yunnan-Fu, colleeted by Mr. J. Grabanj.
(Ann. Mag. X. H., XVII, p. 832.)
\Cypviw(>i micvLttiiis et. Nemachilus Grahami nn. sp.|
274. 1 000. C. Tate RE(iAN. Descriptions of fivenew Freslnvatci-
Fishes from Sarawak, Bornéo, colleeted by D'' G. Hos<'.
(Ann. Mag. N. H., XVIII, p. 0().)
[Barbus Hosii, Cosmoclnlusfalcifer, Liocassis barmnemis, L. Hosii,
Macrones baranensis nn. sp.]
275. 1000. G. Tate Regan. Description of a new ('yprinodont
Fisli of tlie geniis Jci/i/iis/rf from Ai-gcntina. (Ann.
Mag. X. H., XVIII, p. 154.)
\Jennnsia maculata n. sp.]
276. 1000. G. Tate Regan. A Gollection of Fislies from ilic
King River, Western Australia. (Ann. Mag. X. H..
XVIII, p. 4.->0.)
L5sp. avec Nannatlierina gen. nov. Balstoni sp. n.]
— 430 —
277. l'.iOT. C. Taxe REdAN. Dcs('rij)iioiis of tlirco now Fishcs
from Yunnan, collccted bv Mr. J.Graliam. (Aini.M;ig.
N. IL, XIX, p. 03.)
\Schizotkoyax taliensis, Discognathus Ymnanensis, SiUirus
Grahmni nn. sp.]
278. 1007. C. Tatk RK(iAN. Diagnosos of iiew Ceniral American
Fresliwater Fislies of tlie Familles Cvi)rinodoniidao
and Mugilidae. (Ann. Mag. N. H., XIX, j). (il.)
[Ricidas flabelUcauda, R. Goilmanni., Xiphopliorus brcvis, Ago-
nostomus macracanthus, A- Salvini nn. sp.]
279. rJUT. C. Taxe Regan. Doscrii)tions of six new Fresli-
water Fislies from Mexico and Central Ameiica. (Ann.
Mag. N. H., XIX, p. 258.)
\Piiaelodus Boucardi, brachjjcephahts, Rogersi, Gambasia anncc-
tcns, G. terrabensis, Sicydium Pittieri nn. sp.]
280. l'.iOT. C. Taxe Regan. Description of two new Cliaraci-
nid Fislies from Argentina. (Ann. Mag. N. H., XIX,
p. 201.)
[Pogonochavax gen. nov. Relii, Phoxinopsis gen. nov. tupicioi
nn. sp.]
281. 11»07. C. Taxe RE<iAN. Description of two new Cliaraci-
nid Fislies from South America. (Ann. Mag. N. H.,
XX, p. 402.)
\ Mimagonkitcs nov. g. Barberi sp. nov. (Paraguay) et Ctenocharax
nov. g. bogolemis sp. nov. (Hogota)-! (E. R.)
Mammifères
282. 11H)0. O. Thomas. A new Aijiiatic (lenus of Muridae
discovered hy Consul L. Soderstrom in Ecuador. (Ann.
Mag. N. H., XVII, p. 80.)
\Anotomgs nov. gen. leander sp. n. (M' l'ichinclia, Equateur).]
(E. K.)
Protozoaires.
283. l'.iOO. S. AwERiNXZEW. Pt^èsnovodniia Koixiekojki. (Arb.
k. Natiirf. Ges. Petersb., XXXVI, 2, pp. VIII -f :il5,
5 pi.) (en russe).
Ce mémoire fort important comprend deux parties. Dans la pre-
mière, pleine de faits intéressants, l'auteur étudie la structure des
— 440 —
Rhizopodes testacés : protoplasme, inclusions variées, vacuoles pul-
satiles, noyau, chromidies, log-e; la multiplication, la nutrition, la
propagation, la conception de l'espèce, [.es travaux n" 2<S5 et 2(S(1 ne
sont que des reproductions en langue allemande de certains chapitres
de l'ouvrage. — Dans la seconde partie l'auteur étudie les Uhizopodes
testacés au point de vue systématique. Il donne des tables dichoto-
miques et des descriptions fort bonnes pour toutes les espèces d'eau
douce, ainsi que pour chacune d'elles la synonymie et l'habitat connu.
Un certain nombre d'espèces nouvelles sont décrites (v. n" 2N4). Les
tables dichotomiques sont celles qui ont été reproduites en langue
française dans ces Annales, tome 1.
284. 1900. S. AwERiNTZEW. Ùber einige neiic Aiicn geliiiuso-
tragender Rliizopoden des Si'isswassers. (Arch. f. Pro-
tist., VIII, PP- 80-04.)
Descriptions des espèces suivantes (décrites déjà en langue russe
dans 283): Pj/xidicula invisitata n.sp., LccquereusiaanQulalan.
sp., L. extranea n. sp., Di/llugia scplentrionalis n. sp., Nebela spu-
mosa n. sp., N viaxima n. sp., N- pulchcrrima n. sp.
285. 1000. S. AwERiNTZEW. Die Struktur und die clicmisclie
Zusammensolzung der Geliiiuse bei deii Siisswasser-
rlnzopoden. (Arch. f. Protist., VIII, p 05-111.)
Les types primitifs ont la loge formée uniquement d'une matière
organique, structure alvéolaire. Les types plus évolués ont la loge
composée de deux couches : une interne fort mince, en matière orga-
nique (plus, sans doute, une faible proportion de silice), et une
externe constituée des matériaux les plus divers, donnant à la loge
son caractère particulier. L'auteur étudie cette seconde couche chez
divers types, chez Arcella notamment. Etudie aussi la substance
organique fondamentale de l'enveloppe.
286. 1000. S. AwERINTZE^Y. Beitriigo zur Kenntnis der Sïiss-
wasserrhizopodcn. (Vorliiuf Milt.) (AitIi. f. Protisi.,
VIII, pp. 112-110.)
En cinq paragraphes successifs, l'auteur parle :1" des dimensions
de la loge des Uhizopodes : les spécimens provenant de zones froides
auraient une loge plus grande ; t de la distribution géographique des
Rhizopodes d'eau douce : en général cosmopolites, mais il y a quel-
ques formes à habitat spécialisé, dans les fagnes par exemple; 3" de
la sécrétion de substances collantes par le protoplasme : lors de la
rétraction des pseudopodes, on peut les observer plus ou moins net-
tement; 4' de la membrane nucléaire : elle est double, la membrane
externe est de nature protoplasmique, l'interne, très mince et
amorphe, représente la membrane vraie, formée par la paroi externe
de la substance achromatique; 5° de Fencystement : admet les deux
types de cystes : protection et reproduction; avant l'encystement,
évacuation d'eau, donc diminution de volume, et apparition de glyco-
_ 441 —
gène ; l'encystement se fait en général dans la loge même, rarement
en dehors.
287. 11J0(3. K. BoTT. Vhev die ForiptianziiiiLi- von Pelomij.ra
palust7ns (Gi-eetf). (Zool. Anz., XXIX, pp. 803-80().)
Note préliminaire à 288.
288. lOOC). K. BoTT. t'ber die Foi'tpflnnzung von Pelomyxapalastris nebsl Mitteilungen iiber ihren Bail. (Arch. f.
Pi'otist., VIII, pp. 120-158, 2 pi.)
Divers détails sur la structure de Peloirnjxa ; regarde, avecSTOLC,
les Glanzknrper comme matériaux de réserve. Décrit la reproduction :
pliénomènes compliqués amenant une réduction chromatique, la for-
mation de pronuclei de premier, puis de second ordre, puis constitu-
tion aux dépens de ceux-ci (ou Keimkugeln), par un processus
étrange d'immigration de la chromatine dans une vacuole interne,
en même temps qu'il y a encystement, de petites amibes qui sortent
du cyste au sein du Pelomi/xa, y circulent un certain temps, puis
s'en échappent en masse- Devenues libres, elles prennent une forme
rayonnée, nageant dans le liquide, copulent deux à deux et donnent
une zygote. De celle-ci naît une amibe qui ne tarde pas à s'étaler sur
le substrat et se transforme par multiplication de son noyau, d'abord
unique, en un Pelomijxa.
289. l*.H)(3.*BouGoN, Les Infusoii^es parasites (5?i/;!e). (Microgr.
l)répar., XIV, pp. 70-90, 217-222,2(30-271, pi. IX^ et
XXIV.)
290. 1U0(3. G. BouEï. Culture du Trvpanosome de la Gi'enouille.
(Ann. Inst. Past., XX, pp! 5(34-577, pi. XXVI.)
Etude du Tvijpanonoma rotatorium Mayer, dans Rana esculenta.
Culture, division, etc.
291. l'JOG. E. Brumpt Sur quelques espèces nouvelles de Try-
panosoines parasites des poissons d'eau douce; leur
mode d'évolution. (C.-R. Soc. Biol., LX, p[). 1(30-162.)
Suivant le mode d'évolution des Trypanosomes chez les Hemidepsis
(Hirudinées leur servant d'hôte intermédiaire), l'auteur distingue trois
groupes :
.4. Evolution limitée à l'estomac de VHciinck'psis. Dans cette caté-
gorie se rangent le Trypanosome delà brème, celui du brochet et
Tiupanosoinu barbi n. sp. (dans le sang de Barbus fluviatilh),
Tr. percœ n. sp. (—Perça fluinatilis), Tr. acerinœ n. sp. (— Acerina
cernua), ainsi que Tr. squalii n. sp. {Sqiiatiiis cephalus), espèce
étudiée incomplètement.
(*) L'astérisque devant un nom d'auteur indique un travail qui n'a pu
être vu.
— 442 —
B- l/évolution tléhule dans l'estomac, puis s'efl'ectiie dans l'intestin,
où elle persiste très longtemps. Me l'intestin, les parasites reviennent
dans l'estomac pour passer dans la gaine de la trompe. C'est le cas
pour leTrypanosome de l'anguille, Tr. f/ranulosuiii Lav.-M.
C. L'évolution se poursuit dans l'estomac, puis, après un certain
temps, lesTrypanosomes viennent dans la gaine de la trompe. Telle
est l'évolution chez le Trypanosome de la carpe et chez Tv- pitodini
n. sp. {Phoxinus lœvis).
I). Dans ce groupe sont rangées provisoirement les espèces dont
l'évolution, commencée dans l'estomac, n'a pu être suivie encore :
Trypanosome de la loche et Tr. Langcroni n. sp. (Colins fiobio),
Tr. scanlinii n. sp. (Scardinius crutrophtalmus), Tr. leucistù n. sp.
(LeuciscusxAT. sp.), ainsi que Tr.cleqam n. sp. {Gobio flnviatilis),
espèce étudiée incomplètement.
292. 11HH3. E. Brumpt. Mode do transmission et évolution dos
Trvpanosomos des poissons. — Dosci'iplion de ([uel([Uos
espèces de Ti'V[)anopIiasmes des poissons d'eau douce.
— Trypanosome d'un crapaud africain. (C-R.Soc. Biol..
LX, pp. 1()2-164.)
Décrit l'évolution du Trypanosome de l'anguille, Tr. granulosuiH
l^av. et Mesn. Absorbé avec le sang de l'anguille par les embryons
d'ftcmiclepsis, il passe dans l'estomac de l'Hirudinée et après quelques
heures y revêt la forme Critliidia; il y a segmentation active et mul-
tiplication des parasites. Ceux-ci, au bout de quarante-huit heures,
ont passé dans l'intestin et ont i)ris la forme llerpelomonas, sous
laquelle ils persistent durant de longs mois (forme ancestrale'.') ; après
septante-deux heures.on trouve aussi de véritables Trupano-^niiia, Si\ec
membrane ondulante, remontant l'estomac et que l'on trouve accu-
mulés en nombre dans la gaine de la trompe et les premiers cœcums
de l'estomac le cinquième jour. Ce sont ces formes qui sont inocu-
lées aux anguilles et par simple allongement revêtent la forme du
Tr. gramtlosum.
Les essais d'évolution dans d'autres Hirudinées que VHeviich'psis
n'ont pas réussi, les cultures en milieu Mac Neai. et Novv non plus.
Pour tous les Trypanosomes étudiées par l'auteur, l'inoculation a
également lieu toujours sous la forme Tri/panosoma.
Décrit ensuite les espèces suivantes : TrijpanopliasiHa Guernei
Brumpt 1905, du sang de Cotlus gobio, évoluant chez Piscicola;
Tr. barbi n. sp. du sang de Barbas llurialHh, évoluant chez
Piscicola; Tr. abraviidis n. sp. du sang d'A6rrt/yt/.s, évoluant chez
llemiclepsis (ne passe jamais dans la gaine de la trompe); Tr. trutta-
du sang de Salmo fario, évoluant probablement chez Pi.^cicola.
Enfin, description de Trupanosoma soinalcnse n. sp., du sang de
Hitfo reticulatus.
293. 1006. E. Brumpt. Expériences relatives au mode de U^ans-
mttssion des Trypanosomes et des Trypanoplasmes par
les Hirudinées. (C.-R. Soc. Biol., LXI, pp. 77-70.)
— 443 —
Donne de nouveaux détails sur ses expériences d'infcstalion des
poissons au moyen d'Hirudinées. Les résultats négatifs de Kiivssi.i.n/,
sont sans doute dus à des vices d'expérimentation. Montre aussi que do
nouvelles générations de Trypanosomes peuvent se superposer chez
le même individu.
294. 1000. K Brumpt. Rôle pathogène cl mode (je transmission
(lu Trijpanosoma inopindtuyn Ed. d VA. Soi'uvnl.
Mode d'inoculation d'autrt^s Ti'vpanosoincs. (C.-R. Soc.
P)iol. LXI, pp. 1()7-1(3U.)
Le parasite vit dans le tube digestif de ÏHelobdcUa algirica. Passe
dans la gaine de la trompe et est ainsi inoculé aux grenouilles et rai-
nettes piquées par l'Hirudinée. Les Trypanosomes se multiplient dans
le tissu conjonctif et passent dans le sang du batracien, amenant la
m:)rtde celui-ci : anémie, œdèmes, etc. Le parasite est inoculable.
295. lOOiJ. O. BiiTSCiiLi. Beiti'aue zur Kcinitnis des Pai-amvlons.
(Arcli. f. l^rotist., Vli,PI).
107-228, pi. VIII. )
Ltude soignée des Paramylonkurner : étude physique et action de
divers réactifs. F.e matériel provenait d'Evglenu vcUtlii var. [î (fvanv-
lala Iviebs.
296. 190G.*G.X.rALiviNs.TlieProlozoanIife-cvclc.(Biol.l]ull.,
XI, PI).220-24 1.)
297. lUOO. G. N. Calkixs. Tlie Pi'otozoan life-cvcie. (Science,
N. Y., [2] III, pp. 867-:i70.)
Généralités sur les Protozoaires.
298. r.»Oi'). G. X. Calkins. Life-cvcle of ilie Proto/oa. (Xature,
LXXIV, p. 552. )
299. lVH)t). G. 'î>i. CALumn. Paramaecium aiu^elia and muta-
tion. (Science, N. V., p. 064.)
• llésumé d'une communication parue dans Proc. Soc. E.rp. Biol.
Mfd., III, pp. 48-4'.). D'une culture de P. catalatam, l'auteur a isolé
un couple d'individus en conjugaison : les conjoints présentent les
caractères de P. aurdid ; l'un d'eux, maintenu en culture, a repris
après la 45'^ génération la forme P. cnudatum. L'auteur en conclut :
ou bien il s'agit d'un cas de mutation avec retour à la forme mère, ou
bien P. C(Uid((tuiii et P. aurelia ne sont que des variétés d'une mêmeespèce, P. aurelin : cette dernière explication lui parait la plus plau-
sible.
300. lUOC).*(T.N.CALiaNs. PatliogenicProtozoa.(Pop.Sci. Mon.,
N. Y., LXIX, pp. 409-21()).
301. l'.iOO. E. Wace Carlier. (Proc. ScoU. Micr. Soc, W
,
\)\). i;j:J-135.)
A observé des vorticelles sur des crapauds : n'y vivent pas en
— 444 —
parasites, mais profitent peut-être de la nourriture donnée aux batra-
ciens.
302. ll'Ot). C. CÉPÈDE. Sui' uiKj Micr()sco[)ori(li(' nouvelle, Plcis'
tophora macrospora. })ai'asite des Loches franches
du Dauphiné. (C.-R. Ac. Se. Paris, CXLII, pp. o<)-58
etC.-R. Soc. Biol., LX, 13-15.)
Un seul cas étudié : tumeur intramusculaire de la paroi latérale de
l'abdomen près de l'anus, chez Cobitis barbatula L., renfermant
d'innombrables spores et pansporoblastes. Description de la spore.
303. 11>0(). C. Ckpède. Svn- la i)rétendue imnnniité des CohUis
à l'égard des infections ravxosporidiennes. (C.-R. Soc.
Biol., LX, i)p.15-16.)
L'auteur rappelle que l'on croyait les Cobitis indemnes de Myxo-
sporidies. Or, il a décrit récemment trois espèces trouvées dans ces
poissons Met en garde à ce propos contre les généralisations hâtives.
A de même découvert une Myxosporidie(My,riW/n/» 6/arv// n.sp.)(lans
l'anguille.
304. lUOG. C. Ckpède. Mijjcidiiim Giardl Cépède et la pré-
tendue immunité des anguilles à l'égard des infections
myxosporidiennes. (C.-R. Soc. Biol., LX, \)\). 17(»-17o.)
Première Myxosporidie connue de l'anguille : dans le rein d'une
anguille pêchée dans le Pas-de-Calais, près de Wimereux. Des-
cription.
305. 1006. *A. L CiiAiiNSKii. Physiologische Beobachtungen
an Paramecien (en russe) (Izv. Varcli. Univ., 1006,
.5-6, pp. 1-88.)
306. 1006. E. CiiATToN. Sur la biologie, la spécification et la
position systômatir|ue des Amcrbidlum. (Arch. Zool.
Exp., [4] V, Notes et Revue, ])p. XVILXXX.)
307. lOOf). E. CiiATToN. Sur la morphologie et l'évolution de
YAma'Mdium i-ecticola, nouvelle esi)èce commensale
des Dauphines. (Arcli. Zool. Exp., [4] V, Notes et
Revu.', pp. XXXin-XXXVIIL)
Amd'liiiliain recticola n. sp., parasite dans le rectum de Cladocères,
nuphnio surtout. Description.
308. 1006. J. A. CusriMAN. Fivshwalei' RhlzoïiOils of Nan-
tucket. (Amer. Natui'., XL, pp. oTl-oTo.)
Enumération de 22 formes de Thécamabiens. Indication des
dimensions.
— 445 —
309. \in)t\. .T. A. fusiiMAX and W. P. Hknderson. A pivlimi-
iiai'j studj of llio finoi' sliiicturc of Arcclla. (Amor.
Xatiir., XL. pp. 797-802.)
Oui étudié Arcellis vulgarh Elir. et Arc. mitrata l-eid. — Il n'y a
pas deux couches dans la paroi de la loge (Heiitwk; et Lesser), mais
une seule. Celle-ci est couverte e.xtérieuretnent d'alvéoles hexagonales
en général, mais n'ayant pas de côtés communs. La croissance se
fait par intercalation d'alvéoles nouvelles.
310. lOOG. J. Daday. Mikruskoi)ische Si'isswassertliiero aus der
Mon-olei. (Matli. Toniii. Erlos., XXIV, i)p. ;il-77.i
311. 100(3. *(3. P. Dellinger. Locomotion ol' Amœbae antl allicd
forms. (.Tourn. Exj). Zool., III, pj). 337-358, 2 pi.)
312. 1000. Cn. H. EdmondsOxN. The Protozoa of lowa. A stndv
of species known [o occnr in tlio waLers of tliis Slate.
(Proc. Uav. Acad. Sci.. XI, p. 1-124.)
313. 1000. P. ExRiQUES. Sidle condizioni clie dctorminano La
conjuuazione negli Infusoi'i, ed il ditfei'enziamento sos-
.suale noi Vorticellidi. (liologne, 1906.)
314. 100(j. EmiAI. Faurk-Fremikt. Sur la structure intime du
pi'otoplasme chez les Protozoaires. (C.-R. Ac. Se. Paris,
exLU, p 58-60.)
Le protoplasme compreml : 1' le cytoplasme vrai ;;2° les spliéro-
plastes (éléments sphérulaires de Kïixstlkii), organes qu'on peut
comparer aux leucites des végétaux et au noyau cellulaire.
315. 100(3. Emm. VAimÈ-FiŒmET. V £2J(.st//l/.s gasterosU'i (Sj).
nov.) et l'origine des Urcéolaires. (C.-R. Soc. Biol.,
LX, i)p. 347-340.)
Sur les branchies de l'Epinoche {Gasterosteus acukalas;). Des-
cription. Dans la structure du péristome et dans la chambre épisty-
lidienne, l'auteur trouve un nouvel argument en faveur de sa théorie,
d'après laquelle les Urcéolarides dérivent des Vorticellides (et nonl'inverse, comme le dit HiiTSCiiLO-
316. lOOO. E.AiM. Fauré-Fre.miet. A profjos de la structui-e du
protoplasma chez les Protozoaires. (C.-R. Soc. Biol..
LX, pp. 380-302.)
Réponse à iviixsiLEit (1905). Défend son interprétation de la struc-
ture sphérulaire du noyau.
— 446 —
317. 10()<). E.MM. Fauré-Fremiet. Phénomènes i)i'oloplasmi(|ues
(lus à l'anesthusie cliez Giaiicoma pijr'tforniis . (f.-lv.
Soc. IJiol.. LX, j))). 4')l-4<)3.)
llésume d'abord ki structure intime de Glaucomapi/rlfoymis.Comme
anesthésiques, emploie les vapeurs d'un mélange alcoolique très
dilué ou une solution faible de cblorhydrate de cocaïne. — Au point
de vue pliysique : cessation des mouvements, réfringence spéciale du
protoplasme (déshydratation). — Au point de vue chimique : diminu-
tion des actions réductrices intraprotoplasmiques, plus.grande péné-
trabililé de cytoplasma et surtout du noyau ù l'égard de certaines
substances solubles. — iMort par coagulation ou par absorption anor-
male de substances solubles.
318. r.tÛO. Emm. Fauré-Fremiet. La puissance de ia i'range
odorale des VoriicelUda et son utilisation. (C.-R. Soc.
Biol., LX. pp. 772-771.)
Ktudie Vorticclla convallaria- La force développée est égale à
0,0U8() microdyne, le 0,000 000 000 OS erg Une très minime partie
seulement de cette énergie est utilisée pour l'alimentation, le courant
d'eau déviant en majeure partie de chaque côté du péristome ; utilité :
renouvellement et aération du milieu. L'énergie aurait peut-être son
origine dans des phénomènes d'oxydation, ce qui expliquerait le fait
que la plupart des Vorticellides d'eaux claires ou courantes ont un
puissant appareil odoral, tandis que celles qui vivent en milieux
putrides l'ont peu développé
319. lOUi). E.MM. Fauré-Fremiet. Sur les bols aliinentaiivs des
VurtlceUklae. (C.-R. Soc. Biol., LX, j). 820-827.)
Décrit l'évolution du bol alimentaire chez un Caixlicsinm iiolmiinnvi
placé dans une solution de rouge Congo. D'abord il est isolé de l'endo-
plasmapar la membrane périvasculaire; mais au bout de deux minutes
environ, la vacuole est devenue sphérique (tension superlicielle), elle
s'est laissé pénétrer par des acides (du cytosome), elle a perdu les
trois quarts de son contenu liquide.
320. lUUO Emm. Fauré-Fremiet. Sur une nouvelle Vorlicellide,
Opisthonecta Benneguiji. (C.-R. Soc. Biol., LX,
pp. 922-023.)
Genre et espèce nouveaux. Organisme nageant, dans mare.
Description. Encystement facile.
321. r.JOC». Emm. Fauré-Fremiet. Sur VOji/n'i/duiy/i ccrsfdilc.
(C.-R. Soc. Biol., LXl, pp. 4()-48.)
Etud^de la structure de cet Infusoire. Le rang parmi les Va(jini-
colinm : Cothuiniak coque gélatineuse et non membraneuse.
— 447 —
322. 100(). lùiM. Faurk-Fremiet. Le commcnsalismo siu'ciliijuc
chez les VorLicoUos d'eau douce. (C.-U.Soe. lîio]., LXI,
pp. 450-458.)
A côté lie Vorlicelliiies commensaux (ecloparasites) sans habitat
préféré, il y en a un grand nombre à habilat spécilique, quecitt! l'auteur (notamment une douzaine d'espèces nouvelles dont les
noms sont indiqués). Ces espèces, bien que voisines, sont bien
distinctes entre elles, et offrent une grande fixité de caractères, et des
faits étudiés il semble résulter qu'il s'agit d'espèces bien définies,
adaptées à leur bute et ne pouvant se former aux dépens d'une autre
espèce par ada|)tation immédiate ou mutation.
323. lOOC». Fmm. FAtiRÉ-FREA[iET. Le ('(minicnsnlismc des Oper-cuhn'ia. Le facteur mou\enicut.(r.-R. Soc. l)i()L,LXI,
pp. 5M-515.)
De diverses expériences il résulte que le mouvement est la seule
condition nécessaire que les Opercvlovia demandent à leur hôte. 1
est toutefois probable que d'autres facteurs moins importants agissent
encore sur le commensal, et déterminent la spécjlicité de son commen-salisme.
324. 1<.)0(), E.M.Ai. Fauré-Fremiet. Le commensalisme des O^ier-
cularia. Les facteui's de La si)écifieité. (C.-R Soc. BioL,
LXL pp. 583-585.)
D'expériences, incom])lèles encore, il résulte qu'un Oi)ercnlaria,
commensal d'un insecte donné, peut vivre sur un autre insecte, et
que dans ces conilitions nouvelles il n'y a pas de variation immé-diate. Il est probable que sur son b()te spécifique l'infusion rencontre
des conditions particulièrement favorables.
325. lOOii.E.MM. Faurj<:-Fre.miet. Variation exjiérinicntale chez
Voriicelln niicmslnma . (Hull. Scient. Fr. lîeli^-., XL,])]). 271-280.)
Espèce des eaux putrides, fort variable. L'auteur a pu, par des
variations de milieu, la transformer en une forme correspondant à
V. Iilans, puis la ramener au type primitif. Interprétation de ces
résultats.
326. lOOC). Fm^[. Fauré-Fre.miet. Sur un cas de monsti'uosilé
spécifique cliez Stento?' (yrr/fleus. (.Vrch. Anat.
Micros3., VIII, p]). (')(')0-66().)
327. lUOC). IvMM. Fauré-Fremiet. Le (ilaHcoïmi pi/r'r/hrmis
et l'organisation de la suhstanc<ï vivante. ((\-R, Assoe.
Anat , VIII, pp. 120-127.)
— 448 —
328. 1000. C. Fraxca et C. Athias. Sur les phénomènes de
division du Tr;ipcmosoma l'otaiorhitn. (C.-R. Soc.
Biol., LX,i»]).
1108-1109.)
l.e matériel provient de Uxjla cirhorea var. mendionalis. Recherches
encore incom|)lètes; le l)lé]iharoplaste jouerait un rôle analogue à
celui du cenlrosome dans la division mitotique. [Cf. BnuETd
329. 190(3. *C. pRANCActC. Athias. Recherches sur les Tryini-
nosomes des Anii)hibiens. I. Les Tryi)anosomes de lu
Rana csculenl(i.(\vQ\\. h\>\. Pv.Bact. Lisl)., I. pj). 127-
10."), ])1. IIMV.)
330. 1900. H. S. Jexxixgs. The beliaviour uf Pdrdiitœchun.
Additional features and gênerai reaclions. (Journ.
Compar.-Neui'ol., XIV, 1 11-510.)
331. 190(5. W. A. Kepxer. Notes on the genus Leji/ophri/s.
(Amer, Xatur., XL., pp. 335-342.)
L. elegans et cinerea Hertwig et Lesser. — Description sommaire
de l'organisme, de la nutrition, encystement (forme du cyste varie
suivant la proie englobée). Les deux formes appartiennent probable-
ment à la mrme espi'-ce. Division. Pas vu de noyaux. — Comme le
suggère Prxard, Lejitophrus doit être mis en synonymie de Vaiu-
p]jyell(t.
332. 1900. E. KoRsciiKLT. l'ber eine eigenartige Form der
Forti)llanzung bei einem Wui'zell'iisser, Pelomt/xa
ji///i(s/)'is. (Xaturw. Rundsch., XXL pp- 503-504.).
333. 1900. G. KKYSSELrrz. Générations- und Wirlswechsel von
Tryplanoplasiiia Borreli Laveran et Mesnil. (Arch.
f. Protist., VII, pp. 1-74.)
Matériel provenant principalement de la Carpe. L'hôte intermé-
diaire est fort probablement Piscicola geometra- Caractères de la
maladie chez les jeunes Carpes; description du Trypanoplasme; évo-
lution de l'infection. Caractères de la maladie chez le Piscola. Trj/pa-
nosovia iiorrcli = iV. Horrcli + Tr. cyprini Plehn.
A trouvé des Trypanosomes et Trypanoplasmes dans Pcvca fhwia-
tUis, Acerina cernna, Lola vulgavis, liarbus llnviatili.% Cyprinus
carpio, Carasins vulgaris, Tinca viUgavis, Abravns brama, Leucis-
cus idns, L. cephalm, L. eruthrophtabmis, L. rulilus, Esox iucins
Cobitis barbaiiUa, Anguilla vulgaris, Siluru<i glanis (ces deux der-
niers, Trypanosomes seuls).
334. 1900. .1. KiixsTLER. A propos de la constitution intime (hi
protoplasme des Protozoaires. (C.-R. Soc. lîiol., LX,
l)p^31 1-315.)
l'.éclame la |)riorité pour le terme « s|)hérules » (ou « sphéridies »)
— 449 —
créé |)ar lui antérieurement à « chondres », « vacuolides », « s|)liéro-
|)lastes », etc. Nature des sphérules.
335. IDOO.J.KiiNSTLEK. Noyaux uni-oti)luiis[)li(''rLilairrs.(C.-R.
Soc. BioL, LX, ])}). 31.5-olG.)
Les deux types existent, le premier chez certaines llactériacées,
notamment. Leur as])ect.
336. IDDC). .T. Ki'iNSTLER. La formaliou des lucnibrancs i)(''ri\a-
cuoiaii'es chez les Inl'usoiivs cilirs. ((\-R, Soc. Iiiol.,
LX, pp. 548-5-1'.».)
Formation de ces membranes par condensation du plasma environ-
nant la vacuole, à sa naissance. FAURK-FiiKMiET,cliez les Vorticellides,
a vu que c'étaient des produits de sécrétion du pharynx : deux types
donc.
337. IIKH"). .]. Ki'iNSTLER et Cri. Gineste. Modifications de con-
siiiulion de la substance vivante consécutives aux
vai'iations de milieu. (C.-R. Soc. BioL, LX, ])[). 813-
8LL)
Mettent en garde contre les modilications ainsi déterminées, chez
les Protozoaires, par exemple, et i)rovoquant des interprétations
fausses si l'on n'y prend attention.
338. IDCX"). .T. KiiNSTLERet Ch. Gixestk. L'orientation du corps
des Opalines. (C.-R. Soc. BioL, LXL p- L!<k)
Ce que l'on décrit chez Opalina dimidiata comme bord droit est
en réalité le bord ventral, le bord gauche est le bord dorsal, etc.
339. 190(3. J. KiiNSTLER et Cii. Gineste. Contribution à la mor-
phologie générale des Protozoaires sui)éi'ieurs. (C.-R.
Ac. Se. Paris, CXLH, pp. 2U-l-2<.t().)
Opalina dimidialti présente à l'extrémité antérieure du bord ven-
tral une petite dépression prostomienue, pouvant être fermée plus ou
moins par contraction. Elle est suivie d'un tube œsophagien à paroi
extrêmement line. En avant de la fente buccale, une dépression cupu-
laire où s'insèrent de longs cils et d'oîi naît un conduit membraneux
d-^licat ('.' excréteur). A la base de cette dépression un corpuscule trrs
. chomopliile. Postérieurement des sortes de papilles CMixatrices). Ana-
logies avec Flagellés.
340. l'.HM). .1. KiiNSTLER et Cil. GiNKSTK. Les cultiu'es de Proto-
zoaires et les variations de la matière vivante. (C.-R.
Ac. Se. Paris. CXLIH, pp. ;U)5-8()7.)
Dans les Opalines provenant de grenouilles gardées en captivité, on
constate que le réseau tégumentairc, fort net normalement, devient
de moins en moins facile à distinguer. Signalent que les Opalines
vivent bien dans l'eau salée physiologique et même dans l'eau pure.
Dans les cultures également la structure intime dis])arait.
— 450 —
341. 190<j. *.T. Ki'iNSTLRRetCii.GiNESTE. Les si)li(''rulos cliroino-
l)liileschez les Protozoaires. (C-R. Assoc. Anat., Mil,
pp. :j-r..)
342. l*Ht(). \i. Lautrrborn. Eine noue Chrvsonionadinen-
Gatiung. {Palatinelldy ctjrtniihord nov. g'en., nov.
Anz., XXX, pp. 423-428.)
Type intéressant, voisin de PedincUu. Extrémité antérieure
entourée d'une couronne de fins et assez longs pseudopodes; au
milieu un flngel fort court- Une loge, fixée. Chromatopliore ; nour-
riture animale également. Division.
343. llMx;. L. LÉGER. Sur une nouvelle maladie inyxos[)()ri-
(lienne de la (mile iudigrnc. (C.-R. Ac. Se., CXLII,
j)]). G.>5-()5().}
Cldoro7niixnm triitlw n. sp., voisin de CM. /hivialile Tliél.
Dans la vésicule biliaire de Trntla fario du poids de 100-300 gr.
Caractères de la maladie.
344. lUOC). L. LÉGER. Sur une nouvelle Mvxosiioridie de la
lanche eonuiiune. (C.-Pv. Ae. Se, CXLII, j)]). lo'.>7-
l(n>8.)
Cliloromuxiiiii crislatio» n. sp. Dans le liquide biliaire de T/»ca
ciUffavis. Description des spores. Voisine de Clil. IJiiviatHeThél- et
Clil. truUiv Léger. Mentionne aussi une maladie de la peau due à
(]lulotlon cjiprini Moroff.
345. l'.KM). L. LÉGER. Etu<le sur Tœn/oci/stis m'ira Léger,
Gi'égarine métamériquc ( Ai'cli. I'. Pi'()tist.,MI,pp..''(>7-
329, ])1. XII-XIII.)
Dans l'intestin moyen des larves de CeialoiJogon solstiliaUf< Winn.
(eaux stagnantes limpitles) Organisme métamérisé, à noyau unique.
Cycle évolutif sommairement décrit.
346. IDOi). *L. LÉGER. Deux nouvelles Myxosporidies parasites
des poissons d'eau d()ue(\ (Bull. Ass, fr. Avane. Se.,
1005, ]). 3;!().)
347. IKiif). L. Léger et E. Hesse. Sur la structure ûo la pai-oi
sporalc des Myxosporidies. (G.-R. Ac. Se. Pai'is, CXLII,
sjiec.) (Zool. pp. 720-722.)
La paroi n'est pus anhyste, mais constituée au début par deux élé-
ments cellulaires propres, les cellules pariétales, qui doinient chacune
une des valves de la spore. Etude chez divers types. Donc, mêmeorganisation générale que chez les .\ctinomyxidies (= famille des
My.vosporidies), et non ordre spécial des Néosporidies.
— 451 ~
348. r.)()(). J. E. Lord. Notes on AcaittJioc//stis poij/and.
(Ti-ans. Manch. Micr. Soc, IIh:)."), pp. Il- 11, 1 pi.)
Etude de l'Héliozoaire, peut-être identique à l'Ac. brericirrhis de
Perty. A trouvé un test squelettique.
349. lltôC). CtR. Manca. Ti'vpanosomes du lapin ot do l'ananilk'
on Sai-daigne. (C.-R. Soc. Biol., LX, p. 191.)
A trouvé un Trypanosome (? Tr. granulosvm) dans le sang d'an-
guilles on Sardaigne.
350. 1906. S. 0. Mast. Liglit réactions in lower organisms.
I. Stentor cœruleus. (.Touni. Exp. Zool., III, pp. 3.59-
;399.)
Description du processus, de In réaction motrice. Positif. Plus sen-
sible à l'extrémité antérieure.
351. 19(H). *(t. Mazzaiielli. Cnpr'ma rn(r(/)Uutca,n. gen.,n.
sp. (1. di Ciliato délia faniiglia délie f'rccolar}(J(t\
parassito délie brancliie d(^gli agoni. (Riv. mens, di
Pesca, VIII, pp. 20.5-208.)
352. 190(5.^G. Mazzarklli. Rappoi'ti tra ilgen.Branchiophaga
MazaiT., e il geu. BlastuHd/Km Per. (Riv. Mens, di
Pesca, VIII, pp. 209-214.)
353. 19()C). L. Mercier. Phénomènes de sexualité chez Myxo-/>ot//s Pfcifferi. (C.-R. Soc. P.iol., LX, i)p. 427-428.)
A la base de la formation des spores il y a phénomène sexuel : ani-
sogamie. Les deux conjoints s'unissent, mais les noyaux ne fusionnent
pas; la chromaline se fnigmente en i;r;iins passant dans le plasma et
aux dépens desqu<^ls se constituent les noyaux des sporohlastes.
354. 190(). H. Nagai. Der Einfluss verschiedener Narcotica,
Gase und Salze auf die Schwinmigeschwindigkeit von
Paramœcium. (Zeitschr. Allg. Phvsiol., VI, ])p. 195-
212.)
355. 190<). II. Pearl. a biometrical studj of conjugation in
Paramœcium. (Proc. R. Soc, LXXVII, P)., pp. .377-
383.)
Paramœcium est un peu plus variable en largeur qu'en longueur.
Les conjoints ditièrent notablement des individus ne conjuguant pas
de la même culture. 11 y a tendance nette à l'homogamie. Importance
de celle-ci comme facteur d'évolution divergente.
356. 19()(). L. Pearl. Variation in Cliilnmonas under l'avou-
rablc and unl'avourable conditions. (Piometr., V, pj). 5.")-
— 452 —
357. IDOC). E. Penard. Etude siii- la {hi\)Ci)lhia indvcj'rndta.
(Airh. f. Protisi., VIII, \,\). ()6-85.)
Description détaillée de l'organisme. Bivalve; lors de la division
chaque individu emporterait une valve du parent et s'en construirait
une deuxième. Sous les valves, une enveloppe interne ou membrane.
Vacuole extrêmement par(>sseuse (mettant peut-être un demi-jour à
atteindre son maximum). En note : a constaté chez Lembadion hulli-
nnm du fond du lac de (îenève une pulsation de la vacuole par deux
secondes.
358. 1906. A. W. Prters et M. H. Recs. Soinc relations of
Pi'otozoa to cei'Lain ions in llicir médium. (Science, N.
Y., XXIII, pp. .527-52,S.)
Iiésumé d'expériences laites sur Payiinuvcium et Colpiiiium-
359. lliUC). H. Prandtl. Die Konjugation von DhViii'niin
nasutrmiCt. F. M. (Ai-eli. f. Protisi., VII, i)p.221»-
25<S.)
Décrit soigneusement les phénomènes de maturation et la féconda-
tion, puis la reconstitution de l'infusoire normal.
360. lOOG. *G. liAYMoMJ. Quelijues mots sur l;i récolte et
l'observation des ini'usoires des eaux douc(\s. (Mici'ogr.
Pi-épar., XIV, pp. 108-106.)
361. IKOC). *T. Pli. IvOBERTSoN. Investigations on tlie réactions
of Infusoria to cliemical and osmotic slimuli. (Journ.
Piol. Chem. N. Y., I, pp. 185-202.)
362. UH)6. *T. 1>R. HoBEirrsoN. Note on the influence of surface-
evapoi^ition \\\nm ilie distribution of Infusoria. (Wood's
Holl, Mar. liiol. Lab. P.ulL, X, ])p. Ilo-IID).
363. 1000. H. ScHouTEDEN.Xotes sur quebfues infusoires Asjjiro-
O'iclies d'eau douce. (Ann. Biol. lac., I, pj). 114-110.)
Description de Cinetochilum Biltschli Schout., Clulcxlon Schriria-
/,o// Schout., Epalxis mirabilis Roux, Didinium.
364. lOOC). H. ScHouTEDEN. Les Rhizopodes testacés d'eau
douce, d'après la Monograi)lne du jjrolesseur S. Awk-
RiNTZEW. (Ann. liiol. lac, I,i)i).
.'!27-;j<S2.)
Tableaux dichotomiques des lihizoi)odes d'eau douce d'après
AWEUI.NTZEW 283.
365. 1006. H. SciiOUTEDEX. Les lufusolres Aspiroliiclics d'cnu
douce. (Ann. Biol. lac. I, pp. 38;-î-l()S.)
Tableaux dichotomiques des Aspirolriches d'eau douce et d'e.ui
saumâtre, principalement d'après Sciiewiakoki', n. yen. pour
Cuénot.
— 453 -
366. 19(H). (). SciiKoDKK. rx'iti'iigc ziii' Kcniilnls xon Canqia-
iit'Jhi )uid)clhirh( {h))is:i/r/x flnricfnis L. sp. +(iriDiiJis Elirbg'.) (Aivli. f. ProlisL, MI, pp. 75-105,
pi. I-II.)
AnUomie fine de l'ectoiilasme et ses tliiï'érencialioiis; eiiiloplasme
et inclusions; noyaux.
367. 1".K)(1. (). SciiRÔDER. P>oitr;ig(^ zui- Kcnnlnis voii /:y>/.s7////.v
jiJtaitiHs (Ehrbg.). (Arcli. f. Protisl., \\\, \)\). 173-
185, pi. YI.)
Etude de l'ectoplasme et ses différenciations.
368. IIKH). ( ). SciiU(")DKR. Ein(^ iiciic M\x()})ori<li('nart ans dcii
Kciiiicii von Acer'nin cerniui [Hcnnegui/a dccrmœII. sp.) (Aivli. 1". Pi-otist., VII, i)p.
186-l'.Hi, pi. VII.)
Branchies de VAcerina cernua, dans tissu conjonctif. Description
descystes, visibles à l'œil iiu, et des spores.
En appendice indifjue Mi/xabolus Midleri Bùtschli des l)ranchies
de Barbus imlgaris et Leuciscus nitilas et des nageoires de Gobio
fhiviutilis ; Mijx. exiguus Thél. des branchies de Chondiostoma
ncmis.
369. 11H)(). 0. SciiRODKR. Boitragv zui'Kenntnis von VorticeU((
inonilata Tat(>m. (Arcli. f. Proiist., VII, ;^95-ll(>,
pi. XVIII.)
Structure générale; étude de l'ectoplasme et diflerencialions.
370. P.K)(i. 0. ScHRODER. I)oiti-;igo vxw Ivcnntiiis von Stcitloi-
cœrnleus Ehrbg. imd St. Rncselii Ehrbg. (Areli. 1'.
Pi'otisi., VIII, i)p. 1-1(), pi. I.)
Etude des myonèmes et membranelles. Contredit Nkresiieimer.
371. P.'OO. A. SeiiuBERG ot W. KuNGE. l'borcinc Coceidienapl
ausdeni Boden von ù\ephelis vulgaris {llerj)()hdclk(
afomaria), Orcheobius herpohdelhv n. gi'n., n. sp.
( Vcrli. D. ZooL Tks., XVI, pp. 2:'.3-25().)
372. lliof». \\mi. Sergent cl Et. SER(iENT. Sui- un FlagoUô
nouveau de l'intestin dos Culeœ et des Slcgomijia
,
Herpeto7nouas aîgeriense. Sur un autre Flagellé oi
sur d(;s Sj)/rochaclœ do l'intestin dos larves de nious-
liipies. (C.-R. Soc. BioL, LX, i)p.-iltl-^'):!.)
llevpetoiuonas aîgeriense n. sp. dans la première partie de l'uitestiti
postérieur sous la lorme mobile, surtout dans les tubes de Malpighi
sous la forme immobile, chez Culex pipiens et Stegoinyia fasciata.
IIerpe(oinonass\)dAns le tubedigestifde larve i\e\'Ano/)lielesvi(icii-
— 454 —
lipennis; ressemble à H.jaculum Léger, de Nepa cinerea : peut-être
y a-t-il rn|>|)ort entre eux.
373. 1000. P. Statkewiïscii. Galvanolropismus uiid Galvano-
laxis dorCiliata. (Zoiisclir. Allg. Pliy.siol., VI, \)\). 13-
43, pi.)
374. l'.KMj. A.Stolc. Plasmo(liogoni(\eino Vcrmelirungsart dcr
niedersten Prolozoen. Nacli den Untersuchungen an
mehrkernigen Formon \on. Ainœba protois. (Arcli. 1".
Entw. Mocli., XXI, pp. 111-125.)
Multiplication du noyau chez Amwba protens quand la nourriture
estrare ou quand elle est en grande abondance. L'amibe devient mul-
tinucléée soit par division du noyau uni(iue primitif soit par fusion
avec d'autres amibes, l'ar division ultérieure redevient uninucléée.
375. 1900. E. ToPSENT. Une station d'Ophrj/dium cersatile
dans la Marne. (IJull. Mns. Paris, j). 570.)
Non encore indiqué de France. L'a trouvé près de Reims.
376. 1900. .T. Vkrslui.ts. ('ber die Konjugation dei' Iid'usorien.
(I3ioL Uentralbl., XXVI, pp. 40-()2.)
D'après l'auteur la conjugaison, ou karyogamie partielle, est dérivée
de la co]»ulation, ou karyogamie totale, par suite de la complication de
structure de l'organisme, empêchant la rai)ide fusion des deux cellules,
que l'on observe chez les tyi)es primitifs.
376A. E. Waiuiex. On Berlrdinid Kirhmaal, sp. nov., a
Myxosporidiuni occuring in a Soulh African IvOtil'er.
(Ann. Natal Govern. Nus. I. p. 7-17, i)I.)
Dans un Copeus récolté à Pietermaritzburg. Description.
376h. '^L. L. Woodruff. An exi)erimental stndy on tlie life-
Inslory of liypotrjchous Infusoria. (.lonrn. Exper.
ZooL, II. p. 585-032.)
N.B.— Le résumé de quelques-uns des travaux mentionnés ci-
dessus, omis par suite d'erreur, paraîtra en même temps que l'analyse
des travaux parus en 1907. (H. S.)
Algues.
377. 1000. .1. IJergiis. Le noyan et la einèse chez le Spirogyra.
(La Cellule, XXIII, p. 55.)
378. 1007. F. Bescansa. Alcunas « Conjugadas •• do la provin-
ciarde Orense. (P.ol. K. Soc. Espan. Hist. nat., \'ll,
p. 05.)
— 455 —
[L'auteur donne une liste de 25 Desmidiacea', 10 Zygnemace.T e
2 Mesocarpaceu; recueillies en Espagne. Il donne les tlimensions et les
localités des espèces recueillies. La Galicie est riclie en algues d'eau
douce, le groupe le mieux représenté est celui des Gonjugatea\]
379. 190(3. 0. Borgc. Si'isswassui'cliloi'oplivcoon von Feuer-
bind und Isla Desolacion. (Bot. Sludiei' (ilUigiiadu F. R.
Kjellman, p. 21.)
[L'auteur étudie les algues rapportées par Dusén de la Terre de
Feu et de l'île de la Désolation. On connaissait jusqu'à présent
31:5 espèces de ces régions, l'auteur en cite 77 dont (> sont tout à fait
nouvelles ainsi qu'un certain nombre de variétés.|
380. 100(3. (). Bouge. Beitnige zui- Algentioi'a \on Sclnveden.
(Ai'chiv f. Botanik, VI, p. 1.)
[ L'auteur publie une liste des algues d'eau douce de la Suède.
H espèces sont nouvelles pour ce pays et espèces et variétés sont
nouvelles pour la science. Ce sont :
Penuuii chriisoilerma, Niissonii, Closterlum gibhnm, Cosma-
rium decmsiferam, polonicum. llac. var. quadrinodosam, inagni-
ficiim iNordst. var. Suecicum, Staurastrmn dilatatiuu Ehrenb. var.
extensum, Spondiilosiaia secedensBdiry,\ar. undulalum, Anabaena
aequalis.]
381. 100(). 0. BoRGE. Algen ans Argentina und P)olivien.
(Ai'cliiv f. Botanik, VI, p. 1.)
[Liste des 80 algues récoltées par R. FriesetG. 0. iMalme en Bolivie
et en Argentine. Pas d'espèces nouvelles.|
382. 1000. F. Branl). Cher die sogenannten Gasvakuolen und
die ditierenten Spitzenzollen der Cyanopliyceen sowie
iUjer Sclinellfàrbung. (Hedwigia, XLV, p. 1.)
383. 1000. F. Brand. (ber die Faserstruktur der Ciadopliora
Mcndji-an. (Ber. Deutsch. Bot. des., XXIV, p. (H.)
384. 1007. J. Brunntiialer. Die Algen und S('liizoi)liyceen der
AltwJisser der Donau bei Wien. (Verli. KK. Zool. Bot.
Wien, LVII, p. 170 )
I
L'auteur étudie les algues et les Schizophycées du vieux Danube
près de Vienne. Son travail est divisé en deux parties : une générale
et une spéciale. Dans la partie générale, Brunnlhaler s'occupe d'abord
des conditions biologiques (température, transparence, couleur de
l'eau, etc.), il donne une carte de la région étudiée et fournit la liste
des phanérogames observés. Il étudie ensuite le plankton et fait un
certain nombre de remarques critiques sur quelques espèces du
phytoplankton, notamment sur les 21 variétés saisonnières qu'il a
— 45G —
observées <liez le Ceraliiim hirundinella. H décrit ensuite la flore
littorale. Un certain nombre de tableaux sont destinés à montrer la
périodicité, fréquence ou rareté de certaines espèces.
Dans la partie spéciale, toutes les algues recueillies sont cataloguées
dans l'ordre systématique.]
385. iyO<). (t. W. F. TaulsoN. Cbci- IJoLrvodicUoii clct^ans
Lemmorm. und rJotrvocoecus bi'onnii Keriz. (liol.
Studiei' tillagnado F. K. Kjcllman, ]>. 111.) «
[ L'auteur croit à la synonymie de ces deux espèces et donne les
raisons de son opinion.|
386. l'.KHj. F. S. CoLLiNS. Aeroluetium and Cliaiitraiisia in
North America. (Rliodom, VIII, p. 18U.)
[8 Acrocha;tium et i Chantransia de l'Amérique boréale ; table
dichotomique.|
387. 1*.»00. ,f. Co.MKKK. Observations snr ia périodieilé du déve-
lopj)enient <le la lioro algologi(|ue dans la région iou-
lousain(>. (lîuU. Soc. bot. de Fi'ancc, ]) 3U0.)
[Ce travail est le résultat de vingt-quatre années d'observations
suivies dans les environs de Toulouse 1/auteur y étudie rinfluence des
saisons sur le développement de telles ou telles algues, la nature des
eaux, etc. Il donne ensuite le catalogue raisonné des algues de la
région toulousaine.]
388. 1907. J. ('(KMÈiiE. Diatomées du lac de Comté, Pvrénées
ariégeoises. (Soc. Hist. nat Toulouse, XXIX, ]). 1.").)
I
La florule diatomique du lac de Comté est composée d'un mélange
de formes pélagiques, néritiques, benllioniques et épiphytes ordi-
naires, accompagnées d'un certain nombre d'autres espèces qui
doivent être accidentelles ou erratiques, .^.j espèces et variétés sont
énumérées, parmi lesquelles 3 sont nouvelles pour la région pyré-
néenne.I
389. 1*.)06. .1. A. CusiiMAN. New England Desmids ol" (lie
Faniilv Saccodermôe. (Bull. Torrev Bot. Club, XXXIII,
p. ;:Î13.)
[Catalogue de 27 Saccoderm;v de New England dont une espèce est
nouvelle : Mesotaniium miuiiinun, ainsi que trois variétés. Le travail
se termine par une table dichotomique des genres et des espèces.|
390. 190(). A. CusiiMAN. Some Desmids iVom New Fuundland.
(Bull. ïoirey lîot. Club, XXXIII, p. 007.)
[i/auteur donne la liste de 72 Desmidiacées appartenant à 17 genres
récoltées dans trois localités de New Foundland, quelques espèces
étaient encore inconnues pour l'Amérique du Nord.J
— 457 —
391. l'JOC). V. E. FiUTscii. Fivsli-walcr Wi^iv in Kcw ( lai'<leiis.
(Kew Bull. add. ser. V. p. 187.)
I
L'auteur étudie les algues d'eau douce du jardin botanique de Kew,
soit 130 genres avec 2'.)i espèces, dans lesquelles il y a environ 25 p. c.
de Cyanopliycées. H n'y a pas de Péridiniens|.
392. lOOi). N. L. (iARDNER. Cvtological studios in lliu Cvano-
])lycote. (Univ. of Calii'ornia Publications (Botany), II .
1). 237.)
393. 1907. II. CtEKNEck. Zur Kenntnis der niodei-en Cliloro-
phyceon. (Beitr. Bot. Centralbl., XXI, p. 221.)
I
L'auteur décrit un certain nombre d'algues inférieures se rappor-
tant aux Chlorophycées et qu'il est parvenu à isoler après une série
de cultures. Le matériel provenait des environs de Gottinyen. L'auteur
donne la composition du milieu de culture et s;i façon d'isoler les
différentes algues, plusieurs espèces nouvelles sont décrites.]
394. lUOO. il. et J. CIkovks. On Cliaracea' from C<\\)ii Peninsula
coUected by Major A. H. WoUey Dod. (Journ. L. S.,
XXXVir, p. 285.)
ILes espèces recueillies sont au nombre de 7 : deux appartiennent
aux plus communes espèces d'Europe, Chava vulgavis et frar/ilis,
les 5 autres sont propre à la faune africaine, une espèce est nouvelle :
G. Tani/glocJds. Le fait le plus intéressant est la présence d'espèces
faisant la transition entre lesDiplostica- et les Triplosticha'. si neUe-
menl séparés dans les autres régions du globe.|
395. l'.HXJ. A. Grillikr.mo^'d. Contribution à rélude eytologi-
(pie des Cyanopliyeées. (Rev. gén. Bot., XVIII, pi).21
1
et 21.5, pp. 332 et 447.)
396. 190(). A. D. Hardy. The Fi'esliwatur Alga' ol'Vicloria, III.
(Victorian Naluralist., XXIII, pp. 18 et 33.)
I
Hardy continue l'étude des algues d'eau douce de Victoria et donne
la description de 1 nouvelles espèces.)
397. 1U0(). T. Hedluni). ï'ber den Zuwachsverlaui' boi kugc-
ligen Algen ^^'a]n•end des Waclistums. (Bot. Stud.
tilliignade F. R. Kjellman, \). 25.)
398. 11)00. \V. Heering. Die Susswassei-algen Sehleswig-
Holsteins und der angrenzenden Gebiete. (Jahrl).
Hamburg. Wiss. Anst., Beitr. 3, p. 01.)
1Heering publie la première partie de son travail sur les algues
d'eau douce du Schleswig-Holstein. Introduction sur l'histoire des
recherches algologiques dans le Schleswig-Holstein, préparation,
— 458 —
récolte et conservation du matériel, bibliographie, Heterokontae et
Uesmidiacées avec tables dicliotomiques des genres et diagnoses des
espèces.I
399. 11)06. K. E. HiRN. Studieii iïbor (Jedogoniaceun. Einc
kritisclie Zusammenstelhmg (1er Untersnclinngvn uiid
Beobaclitungen die in den Jaliren 1901-1'.)05, liber
Oedogoniaceen gemaelit worden sind. (Act. Soc. Se.
Fenn., XXXIV, n" 8.)
I
Supplément à la monographie des Oedogoniaceae publiée par
l'auteur en 1900. Description de toutes les espèces et variétés décrites
depuis son travail, analyse des divers travaux parus.|
400. 19(H). L. HoLTZ. Neue Fuiidorte von ("liaraeeen ans dcA-
Insel Sizilien, von D^' Roos. (Nuov. Notai'., XVII,
1006, p. 57.)
IListe de 14 espèces et variétés, avec une var. nouvelle : Chara
crinita Wall., var. pscudosinnosissima.\
401. 190(). T. KawaiwUii. List of Plants eolleeted in Agin-
coui't Island, Forniosa. (Tokvo l)0t. iMag., XX,
p. 190.)
I^S algues, parmi lesquelles un nouveau Codiwii, sans description,
texte japonais.I
402. 1006. F. G. KoiiL. Die Farbstotie der Diatomeen-Chro-
matophoren. (Ber. Deiitsch. Bot. Gesell., XXIV,
p. 124.)
ILe pigment des Chromatophores des Diatomées est formé par T de
la chlorophylle; 2' de la carotine; 3' de la xanthophylle. L'auteur
critique le travail de Moiisch sur ce sujet et considère la présence
de leucocyanine dans les Diatomées comme très hypothétique.]
403. 1006. 0. KuczEWSKi. jMorphologisclie und lîiologisehe
Untersncliungen an Cliara delicatula f. bulbillil'ei-a
A. lîr. (Beitr. I^ot. Centralbl., XX, p. 25.)
404. 1006. H. Kylin. Zur Kenntnis einiger scliwediseben
Chanti-asia-Ai'ten. (Bot. Studiei' lilliignade, F. K. Kjcll-
man, p. 113.)
IL'auteur décrit en détail l espèces de Chantrasia de Suède, parmi
lesquelles o sont nouvelles : C. pectinata, C- hallandica et
C. parvula.|
405. 1006. E. Lemmermann. Beitriige zur Kenntnis der Plank-
tonalgen, XXII, Anabaena Levanderi nov. spec,
Sjnadra Revaliensis, nov. sp. (Ber. Deutseh. Bot. Ges.,
XXIV, p. 535.)
— 450 —
[Deux espèces nouvelles d'algues pélagiques provenant de
rObersee, près de lleval.|
406. 1<.H)7. K. liEM.MKRMAXN. KrvptojiaiiK'iiflora <l. JNIark ni'uii-
(lonburg, III, Ilfl 1.
ISchizophycées du lirandebourg, avec tables dicbotoniiques,
remarques biologiques, catalogue, synonymie, bibliographie, etc.|
407. 1907. Iv Lkm.mkr.manx. I)i'un(l('nl)iii'i.iis('lic Algvii. (lîcitr.
Mot. (\'ntralbl , XXI, p. 'i*»!').)
I
L'auteur décrit un nouveau Péridiiiien d'eau douce : Gonuaulax
palustris. Il donne la liste de toutes les espèces du genre Gonyaulax
avec les syii )uymes, distribution et citations bibliograpliiques ainsi
qu'une table dicbotomiqae pour leur détermination. Il y a 17 espèces,
dont :2 d'eau douce, i d'eau saumàtre et 11 marins. L'espèce la plus
largement distribuée est G. liolijgranima.\
408. 1907. E. Lk .MMEK.MANN. Die .Myeiiiiora dvi- (Mialliam
Islands. (Englers Mot. Jalirb., XXXVIII., [). o4o.)
I
Le nombre des algues, tant marines que d'eau douce, des îles
Cliatbam, actuellement connues est de 177, parmi lesquelles \0i sont
nouvelles pour la faune de cette région et X complètement nouvelles
pour la science. L'auteur donne la liste avtic localités de toutes les
espèces, avec notes et tables dichotomiques. La plupart des espèces
sont marines.]
409. 1907. J.F. Li-:\vis. Notes on tlicMoi'i)liologv of ColeocliaeLo
NilcUai'Lim. (John Hopkins Univ. Cive, o, \). 2'.».)
410. 190(). A. LoFGREN. fontribuirocs i)ara a algologia pau-
lisla, Familia Oedogoiiiaœac. (Secretaria de Agricul-
tui^a. Boictim do Hoi'to botanico. Sao Paulo, 190(3.)
I
Après avoir exposé d'une manière très succincte la morphologie de
la famille des Oedogoniacées, l'auteur donne une clef analytique des
espèces rencontrées jusqu'ici à S. l'aulo, suivie d'une description
détaillée des espèces (en portugais), avec indication de leur aire
géographique. La richesse en Oedogoniacées est de 3;> espèces parmi
lesquelles 12 sont nouvelles.
J
411. 190(). r. MeiiI'^sciiivOWsivY. Gosetze des Kndocbroms,
Kasan, 190(5, 102 p., 2 pi. (on russe).
IEtude desChromatophores des Diatomées.]
412 1907. A. A. C. E. Merlin. Note on new diatoni structure,
(Journ. Quek. Micr. Club, X, p. 83.)
[Lacis très délicat couvrant l'aire centrale de quelques espèces :
Melosira, Hyalodisciis, Auliscus, Coscinodiscus et Tricevatium.]
— 400 —
413. l'.HH). L. MekkimAxX Mahel. TSuclcar Division in Zvyiicnia.
(I5otan. Craz., XLI, p. 13.)
414. l'.)07. M. MoHius. Xotiz iiber sclilaucliliiidcndc Dialonicen
mit zw'ci Nci-scliiedciien Ai'tcn. (Ber. I)enlsc'li. lîol.
Ges., XXV, p. 247.)
ISchizoneiua et Homoc'Ocladia.\
415. 19U7. M. MuBius. Algologisclic Bcotjaclilnngcn iihci- cine
^yHSsel•blute und eine Cladopliora. (Hedwigia, XLVI,
p. 279.)
I
M()biLis décrit une lloraison de l'eau (Wasserblûte) aux environs de
Francfort, formée de 3 espèces de Cyanophycées : OsciUatovia
A(]ardliii (iom., Anahaena l}Qs.-aquae Brib. et ClatltrocifKHs ainii-
ginosii Henfr. La floraison de l'eau par la première de ces espèces
n'avait pas encore été observée. 11 a observé le même phénomène
avec l'association de Botruococcas Bvannii et (Ui)omulina Rosa-
noffli. L'auteur décrit ensuite une variété intéressante de ClailoiJltoiu
cvispata Kiitz|
416. 19()(i. 0. MuLLER. Pleomorphisnius, Auxospoivn und
Dauersporeii bci Melosira-Ai'ten. (Pringslieim's .lahrh.
Wiss. Bot., XLIII, p. 1'.).)
IL'auteur discute le pléomorphisme, etc., des Melosira. Il décrit une
nouvelle espèce : M. islandica et une nouvelle sous-espèce subarctica
de M- itcUica.\
417. 1900. E. W. ( )LIVE. Notes on tlic occurrence of (Jscillatoria
pi'olifica Goinont in tlie ice of Fine Lake, Wankesia
County. Wisc. (Trans. Wisconsin Acad. Se. Arts,
Lett.,"xV, p. 121.)
418. 1907. C. H. OsTExXFELi). Beitnigc zui- Kenntnis dor Algen-
flora des Kossogol-Beckens in der nordwestlichen
Mongolei, mit spezieller Beriicivsiclitigung des Plivto-
planktons. (Hedwigia, XLVI, p. 3(x).)
i
L'auteur étudie la flore algologique du lac de Kossogol (N. \V.
Mongolie), des marais et rivières avoisinantes. Le travail est divisé en
2 parties : I' Une énuméralion systématique des 90 espèces observées
avec leur habitat et quelques notes critiques; 2' considérations con-
cernant le phytoplankton de la région. Le planUton du lac de Kossogol
est pauvre et de caractère alpin Les spécifts caractéristiques sont :
Dinobri/on KossoQolensis, Spluivroci/fiUs Schroeteri, StichoQloea
olivacca var. splierica- Le plankton des marais avoisinants à un carac-
tère to^t difl'érent et les formes caractéristiques appartiennent aux
Myxophyceae, Dinobryaceae et Peridineae, celui des rivières consiste
— 4(il —
surtout en Diatomaccac et Myxopliyceae. Toutes les espèces citées
sont connues sauf IHnobruon kossogoknsis et une vérité do
Poiiliniiivi nnihonalinit.|
419. lUOt). A. Pascher. Neiiei' Beitnig ziir Algentiura (1rs
siuUiclieii IJolimenvaldcs. (Sitzl)er. deutscli. nat. mcd.
Voi'. l)()lim('n • Lotos 0, }). 1 . )
1L'auteur publie le résumé de ses recherclies sur la niorpliologie et
la reproduction de ditïérenls genres d'algues. H énumère N Helero-
contae, 1H6 Zygophyceae, 121) CKIorophyceae, I lihodophyceae.
3 'llaucophyceae, IS'â Schizopliyceae.|
420. 100(). A. Paschkk. l'bei- die Zoosporeiircprodnklioii bci
Stig-eO(d()nium. (Ostci'. l)ot. Zsclir. LVI, 11, p. 117.)
421. l'.»r)7. A. Paschkk. l'ber di(^ ZwcrginannrlK'ii dci' ( )t'do-
goniaceeii. (HciUvigia, XLM, j). 2<55.)
422. 1*.H)7. K. Pknaud. vSur la kK-oiiiotioii des Diatomccs.
(lînll. d(;riI(M'l). Hoissier. 2. \ll. p. 7.").)
I
l/auteur ne reconnaît au filament supposé propulseur de Bi'itscldi
d'autre valeur que celle d'un mucus inerte et inutile; il croit que le
courant mucilagineux locomoteur ne représente pas un simple
(ilet étroit, mais bien une nappe élargie.]
423. l'.HiC). H. Pkragallo. Sur la ([iicslion dos s])ores des Dia-
loinécs. (Mici'ogr. prépar. 5. XIV. 1. p. 1 14.)
424. 11106. S. Petkofk. riiiquiniie coiilribnlion à réliide des
algues d'eau douée de P)ulgari('. (Xuov. Nolai'isia, XXI,
p.^51.)
I
Liste avec localités de ;} Scliizomycées, 1 Kloridée, "2"i Cyanopliy-
cées, 35 Chloropliycées.)
425. 11)0(3. R. H. Philip. Yorksliire Dialoms. (Naluralisl.
11)06, p. IL)
I
Liste des Diatomées recueillies par le « Yorksliire Naturalisls
Lnion » en 1905.1
426. 1907. R. II. PiiiLiP. XoLes on Dialoms iu 1006. (Trans.
Hullsc. Field Nat. Club. III. Ili07, p. -iOl.)
[Liste de IS espèces et une variété recueillies dans le Yorksliire
en IDOi;.I
427. IDOC). R. H. l'iuLii'. Mieroscopie algae. (Xaluralist IDOO,
pp. 252 et 26:5.)
I
Liste de 3H espèces de Uiatomacées recueillies dans deux localités
du Yorkshire en i90(i 1
— 462 —
428. lOOi). \i II. PiiiLii'. Noie on tlic (lisirihution of Diatomn
lilciiialc in Easi ""l'orksliiro, oie. (Nainralist. 1007,
p. :U2.i
429. l'.KH). U, ll.Pmu]'. Diaioms al Ask('rn.(Xaiuralist. lOCHi,
.7. H), ]). 128.)
I
Liste de i() Diatomées d'Askern|
430. 1007. Cx. I. Playfair. Some new or less known Dcsmids
found in New Soulli Wales. (Piw. L. S. X. S. W.XXXII, p. 160.)
IL'auteur décrit quelques espèces nouvelles ou peu connues de
Desmidiées trouvées dans le i\. S. \V. Le nombre des espèces connues
est actuellement de 350, parmi lesquelles 50 sont douteuses, il y a
50 espèces et 20 variétés nouvelles|
431. 1007. F. (v)UKLLK. Beniei'kungon iiber dun inncivn I>au
cinigoi- Siisswassor-Diatomoon. (Mitili. Uiiii'ing. IJot.
Vei'uin, p. 25.)
[Nitzschia amj)hio.r,jis, N. sigtnoidea et Culindrotheca Gerslen-
hcrgevi-]
432. 1000. S. Quint. Noue BL'itriige zur lîacillaricntiora dos
liomorbades bei P)adapest. (Xovénvi. Kozlom., V,
p. 74.)
(5 nouvelles espèces et variétés.]
433 . 1 1 »0(3. H . R(jGERs.Zum Polymoi'i)liismus der rvanopliycccn
.
(Jahresb. Nat. Verein. Elberfeld, p. .'5.)
\Lhtia crustacea = Rividaria ininutula Born. et Flah.
J
434. 1000. F. UuTTNER. Die Mikroflora dor Pragor \A'assor-
leitung. (Ardi. <1. natur. Landesdui'clif. lîolmions,
p. 17.)
[Examen des eaux alimentaires de la ville de Prague qui contien-
nent une grande quantité de matières ori^aniques. — Procédés utili-
sés pour ces recherches. — H existe deux sortes d'organismes: les
uns qui se développent dans les conduites d'eau (Lcjdothri.v, Crcno-
llivLr, Ctadotlivi.c, etc.), les autres provenant de la Moldau dont la
Hors est bien connue, soit 10 Flagellâtes. 5 Péridiniens, 10 i>iato-
maceai, 31 Ghlorophycea^ et Conjugata- et i Schizophyceaî. L'auteur
examine l'époque d'apparition des diverses espèces.]
435. 1007. A. ScHERKELL.AlgoiogisclieNoiizen.(lî('r. Dciilscli.
Bot. Gesell. XXV, p. 228.)
[Note sur les stigmas de Pandorina niorum, Bulbockacte et Clila-
mijilnmmas sp. — Description d'une espèce oubliée: Carteria dubia
(Perty) Scherf. et d'une espèce nouvelle Chamaesuphon liualinus.\
— 463 —
436. 1907. H. Von Schonkkldt. Diatomaccae Gcrnianiae.
Berlin W. Sunk, 2()3 p., 1<» pis., 45() tigs.
[Flore des Diatomées (J'Alleniagiie. I^e livre est divisé en deux par-
ties, l'une générale, l'autre spéciale. Dans la première, l'autenr donne
la manière de récolter les Diatomées, de les préparer et de les conser-
ver, puis il parle de la structure et de la biologie des Diatomées. Dans
la partie spéciale, il donne des tables dicbotomiques, sur les familles,
genres et espèces, ainsi qu'une courte description de clia([ue espèce
avec un catalogue raisonné. Cet important ouvrage est illustré de
U) planches et de 400 figures.]
437. l'.»0(j. S. Stock.maier. Kleincf IJoitrag znr Kemitnis dor
Siisswasseralgenlioi\a Spil.zbci-gcns. (Ost. lîot. Zoit.
LVI, p. 47.)
I
Liste de 29 espèces, une espèce nouvelle : Eiiastnun ]Vk'sneri.\
438. ll»Oi). E. ÏANNKii. Sur un nouvel organisme du Plankton
du Scliaonenhodensee. (Hidl. Herb. Boissier. \l,
p. 15(5.)
I
Raphidium Cliodaii, nov. sp.J
439. 11)07. E. C. TkoD()1{Rsco. 01)servations m()i'[)liologiques et
biologiques sur le genre Dunaliella (Rev. gén.
Bot. XVII.)
I
Morphologie, lîiologie et développement des DKndliella.\
440. IIKIC). V. ToriKA. Algen der (Jrdnung ('onjugatae aus der
Unigebung von Seliwiebus. (Helios, XXIII, p. *.'l.)
I
Liste desConjugatae de«; environs de Seliwiebus avec descriptions
de nouvelles formes de Closteriwii obtusam liréb. et Micrasterias
(Icnticuldta Hréb.1
441. \\n){\. WToKKA.Baeillariender Provinz Posen. (Deutseli.
(les l'iir Kunst und Wissenseli. Posen, XIII, p. 11.)
I
Liste des Bacillariacées de la province de Posen, avec description
de "2 nouvelles variétés : Navicula pennagna var. oblonga et
Nitzscliia denticula var. curvata.\
442. I".i07. A. Ti{()NDLE. Cber die Kopulalion und Keimung
von Spirogvra. (Bot. Zeit., LX^^ p. 1S7.)
443. BH)!). M. TswKTT. Zur Kenniuisder Pliaeoi)liveeen-Farb-
slotl'e. (Ber. Deutseli. Bot. Ges. XXH', p. •-i:î5.)
I
Les Cliromatopliores des PliReophycea^ renferment de la chloro-
pliyllnie -t etv, fucoxanthine, Caroline et fucoxantliopliylie.|
— 4r.4 —
444. l'.MH). ,1. ViLiiELM. Eiii Beitrag zui' Kenntnis (1er Cliaro-
plnlentiora von Piulgarion, Monténégro und dcr Ailios-
llalhinsel. (Hedwigia, XLYII, p. <,(').)
, |0n lie coniiaissaitjusqu'à présent que 12 espèces de Characea' dans
les lialkans. l/auteur décrit 7 nouvelles espèces des mêmes régions.|
445. H'Oi». A. WiTT. ])0itr;ig(' xur Kenntnis von Cliaracerato-
phvUa Wallr. and Ch. crinitaWellr. Mit Taf. und Fig.
(Zuricli, 8", 100().)
446. IWDT. E.Zaciiarias. l'ber die nciiei'e Cvanoplivcoen-Lite-
ralui". (IM. Zeit., LXV, ]). -iC).".)
jl/aateur donne une revue bibliographique avec résumé de tout
ce qui a para sur les Cyanopbyceo' depuis I'.(0i.|
447. 1000. C. ZiMMiîKMAXN. Catalogue (las Diatomiieeas poi-lu-
guezas(P)i'otcria. \.\). 1.)
I
l.iste de 100 esp("'ces.|
(K- !«•)
Champignons
448. lOO.S. W. (\ CoKER and S. D. Pemi^ertox. .V ik^v specie.s
or Achlva. (Bot. Gaz. XLV, p. U»l.)
[Achliia InjpoQuna sp. nov.|
449. lOOC). (\ (>. Harz. Aclihjii Ilofcr'/, Harz, ein(> neue
Siii)i'oleguiacee aul' lebenden Fisclien (Allgeni.
Fisclierei-Zeitung, pp. ;>()5-;>t)S. )
[Nouvelle espèce de Saprolégniacée parasite de la Carpe.|
(E. il.i
Plankton
450. l'.'OC). If. ]5a(I1MANN. Le plankton des lacs ('cossais.
(Ai'cli. des Se. plivs. (^t nat. Oenève, XX, \). 350.)
[Ces études ont porté sur neuf lacs écossais, dont le plankton (sauf
celui du l.och Leven) a été étudié vivant. Cet examen révéla la pré-
sence conslante des genres Cruptomonas, MoUomonas et Clilamy-
domonas. Kes organismes dominants sont i)our chacun des lacs
étudiés : Lo(.h Leven {Astevionella gnicillhna) ; Earn (Clallirocj/stis
sp.); Eochy [TaheUa lia fcnestrata \av. asU'rioni'Uoidcs) ; Oich (Cera-
lium hirundinella); Ness (Asleriondla finœilUina); Uanagan (t/ro-
(lU'nit Hdvo.r) ; Morar {Sldurastrnm) ; Komond iCIatlirocijstis sp.).
i.es lacs communicants conservent chacun leur propre caractère
— 4rc, —
planUtoniqiie, comme c'est le cas en Suisse. I/au(eiir sig-iml le grnnri
nombre irorganismes épiphytes contenus dans le pinnkton et notam-
ment la présence constante de deux espèces de bactéries sur les
colonies de Clathrocuslis.]
451. l'.KH'.. F. lîiANCiii. Riccrclio su un laghotto aljjiiio (Il Lai^o
Doglio). (Rivista googi-. ital., XIII, j). l-".)
1Conditions physiques, énuméralion des espèces planktoniques et
nerito-benthiquesdu lac Deglio (province de Côme).|
452. 11H»(). V. Breiim. Ziir Plaiikloiil'auna des (iar(las('(>s.
(Aivh. r. Hy(lr(^l). I. p. VMJ.)
(Des échantillons de plankton recueillis en février dans le lac de
(larde ne montraient ni Rotateurs, ni phytoplankton. Diapfouivs
Steueri Rrehna et Zederb. dominait, avec Cnclopa sircnvus, Iktiihnia
PaiH^sii et une nouvelle variété de Bosniina corcgoni, var.
amethystina.]
453. 1000. y. Breilm. Unlei'sucliungon i'ihcr das Zooplankton
einigei' Seen (1(M' ncH'dliclien uiid ostlichen Aljicn.
(Vorh. Zool. Bot. Ges., Wien, lîd. LVI, j). 33.)
[I>es lacs du sud de la Bavière et des environs de Salzbourg forment
deux groupes biologiques différents entre lesquels se trouve le
Konigsee.
Diaptomus gracilis se trouve dans les lacs des environs de
Salzbourg, /). graciloides dans ceux de Bavière et I). bacillifer dans
le Konigsee. Les mêmes faits se reproduisent pour les Daphnia.
Leptodoni et Bulliotrcplics manquent dans le Konigsee. linsniina
corcgoni de Konigsee appartient au groupe Dollfnsi, Ceviodaphnia
qnadrangnla à la var. hamata. Dans le Ramsauer Hintersee,
Boxmina coregoni appartient au groupe Ceresiana.
A la surface du Chiemsee se trouve en abondance Diiiphanosnina,
dans les couches profondes BnHiotrephes, ]A'i)iodoya et Helerocnpc,
Cip'lop-^ strenuHS est remplacé par C. Leuckarti. Dans le Simsee,
/ios-»n'H(»afroco)w/o»? se présente sous la forme nouvelle 6urr/,/n//7//.|
454. IIKH"). V. B)KKii:\i und E. /EDEUiurKU. P)C()l)ac]itungcu
i'ibcr das Plankton in dcn Socn dov OslaljH'n. (Ai'cli. ï.
Hydmb. Pp. KV.>.)
[Le phyloplaiikton de ces lacs (>st très jiauvre en espèces et en indi-
vidus. Parmi les onze lacs situés entre l,"2(10 et "2,500 mètres, il en est
quatre dans lesquels les auteurs n'ont pas trouvé de plankton et trois
dans lesquels ils ont seulement trouvé des algues filamenteuses
(Ziignciint, Spirognia) ; dans les autres, \o plankton varie assez con-
sidérablement. Les lacs situés à une moins grande altitude (LS) ont un
plankton plus uniforme. En h'wt'.r A!>U'}i(>)icUa giarilliiiia et Fragi-
— 4GG —
lavia crotonensis dominenl; en été, c'est Ceratium hirundinella.
Oscillatovia rubesccnn se rencontre en masses dans le I.agoCaldonazzo
et le Zellersee en hiver; il en est de même pour StauraUrum
parado.rum dans le Lunzersee. Au point de vue de la répartition
des Uiaplomides, on peut distinguer deux régions : la région ouest
est caractérisée par la présence de Diaptoimis Zachariasi, celle de
l'est par I). Qracilh.]
455. lUOC). V. lÎRKini nnd E. Zedkrbauer. Bcitrago zur
Planklonuntersuclmni^' ali)in('r Sccn. (V(M'h. Zool. Rot.
Ges. Wien, Bd. LVI, p. 19.)
IRtiide du planklon d'une série de lacs des « Kalkalpen ».
Bosmina covegoni du lac de Lunz, appartient au groupe cevesiana,
les jeunes exemplaires de mai diil'èrent des e.xemplaires de mars,
princii)aleinenl par la taille. Le plankton du lac de Traun se compose
en liiver surtout d'i.s//'r/oȎ'//rt, Fragillaria et Diaptomns onicilis;
au printemps, il comp^-end en plus des Nmqjlius; en été, se dévelop-
pent Ceratium lunuidinella, Dinolnijon iliveygen>i et Daphnia
hualina. Bosmina coregoni est commune en hiver, rare en été et
seulement dans les couches profondes. Le cycle de Daphnia hipilina
est le même que dans l'Achensee. Le lac de HalIsliUter présente les
Bosmina et Daphnia du lac de Traun, mais la répartition saisonnière
de B. Coregoni est différente. Diajitonins gracilis présente un dimor-
phisme saisonnier (Antennes).
L'auteur étudie aussi les Krotensee, Mondsee, Attersee et Zellersee
qui oifrenl un plankton d'hiver et un plankton d'été. Ci/clops strenuus
et Bosmina longiro'>tris se montrent en hiver, Cijclops Leuckarli en
été. Les espèces qui se rencontrent toute l'année montrent du dimor-
phisme saisonnier {Anuraea cochlearis).\
456. 19(H). L. Cah. Das Mikroplaiikloii «Icr Sceii (1<'S Karsics.
(Aiin. P)iol. Lac. I, p. 50.)
457. 1900. A. FmRTI. Alcuiii appniili nclla roniposiziono dcl
plancton cslivo dell' Estaïupic grande ncl ])arco dcl
Bucn lioiiro in Madrid. (Alti dclla Soc. dci Nat. c.
Malem. di Modona., VIII, p. <•>.)
[l'remier travail sur le plankton des eaux douces en Espagne.
L'« Estanque (itande » du parc del Buen lietico à .Madrid est rectan-
gulaire et a une superlicie d'environ ;j()U mètres sur 100, sans végéta-
tion sur ses bords et très pauvre en Chlorophycées, il est par contre
très riche en Cyanophycées (surtout Chroococc aceae) qui constituent
plus de la moitié de la quantité totale du plankton recueilli. L'espèce
la plus commune est Clalhrocustis aeriiginosa Henir. La faune est
assez abondante (5 espèces de Kotifères, Cladocères et Gopépodes).
Pèches verticales et horizontales. Liste de 21 espèces avec notice
particulière sur chacune d'elles.]
— 4G7 —
458. 190(). J. Heusciikr. Beitriige zu oiner Monograpliie des
Acgerisees mit bosondorei' Boi'i'icksicliliuung soiiier
Fiscli('roivei']i;iUniss(\ (Scliwcizeriselic Fiscli-Zcitung,
J;i]irg. XIV.)
459. 190G. H. HuiTFELD Kaas. Planktonun(l(M'S()golser i
Noi'sk(? Vande, Christiana lUOO, sep.
[Reclierches périodiques faites sur les lacs de Padderudvandet,
Sandungen et Sognsvandet des environs de Christiania durant toute
une année pour étudier la variation du plankton. En outre, 5^2 autres
petits lacs des régions méridionales ont également été examinés au
point de vue planktonique.
il"! formes ont été rencontrées, parmi lesquelles sont nouvelles :
Cnsmarium Froilandicnm, Staurastrum pseudopt'lagicmn West var.
bifurcatum, Staurastrum Landmarki, St- Ikiaei, St. Sarsii et var.
loHf/hpimua, Peridinimn Orrei, Tabellaria fenestrata (Lyngb.)
Kueiz. var. Willei, Lithocolla Apsteinii, Acanthocuatis klepica,
Huitfeldtia rectlpes Thor, Daplinia hjialina var. pcllncida
Les espèces présentent un minimum en janvier-février, suivi d'une
augmentation lente jusqu'à la fin de mai; de mai jusqu'à la tin d'août
l'augmentation est rapide et c'est alors qu'apparaît le maximum ; la
diminution est rapide à la fin de septembre et octobre, d'octobre à
janvier le plankton est pauvre.
Les Chlorophycées forment 37 p. c. du volume total du plankton et
(10 p. c. du phytoplankton (48 espèces), les autres groupes riches en
espèces sont encore les Diatomacées (1!)), les Rotifères (30) et les
Crustacés (31).
Les lacs de Norvège peuvent être divisés suivant leur altitude en
lacs alpins (au-dessus de 700 m.) et en lacs de plaine, ceux-ci sont plus
riches en espèces que les lacs de montagne.
La distinction faite par Apstein entre lacs à Dinobryon et lacs à
Chroococcacées ne s'applique pas aux lacs de Norvège. On distingue
des lacs à Sckhophifcées (A) et des lacs à Chlorophycées (environ 40),
les premiers peu profonds et calmes, sont plus riches en plankton que
les seconds, profonds et à eau souvent renouvelée.
Le volume du plankton dépend des caractères hydrographiques et
en particulier de la masse d'eau et de la rapidité de son renouvelle-
ment (les lacs peu profonds et calmes — sans courant — sont plus
riches en jtlankton que les lacs profonds ou agités) ainsi que de sa
température (le maximum de production est dans les mois chauds).
D'autres facteurs interviennent également : la richesse des décompo-
sitions des substances organiques est utile au développement du
plankton, elle est sous la dépendance de la quantité de lumière, donc
de la transparence de l'eau. La forme du lac a aussi son importance :
le renouvellement de l'eau est plus rapide dans les lacs allongés et
étroits que dans les lacs arrondis et le plankton est plus pauvre.
L'auteur étudie aussi les migrations verticales des liotifères et des
Crustacés.
468 —
Il obtient les résultats suivants pour les espaces les plus com-
munes :
Conochilus unicoynis, surface.
Con. volvox, surface.
Nolholca longispina, surface à
5 mètres.
Poljiavlhra plaljiplera, 5 m.
Annnuui cochlearis, 5 à 10 m.
Ploesoma fh'.nUx, 5 à 10 mètres.
Awircwa acnleata, 10 à ^5 m.
liijlhoire'phes. longiwanus, sur-
face.
Pohiphemu jmUculus, surface.
Hrterocope salions, surface à
.5 mètres.
Daphnia galeala, surface à 50 m.
l)ia/ilia)iosonia hrachynrnni, 5 à
10 mètres.
Bosmina obtusirostris, 5 à 25 m.
llolopedmm gihherum, surface à
25 mètres-
Cyclops scutifcr, variable, sur-
face à 100 mètres.
Diaptnmus, de 10 à 25 mètres.
Nauplius, de f à 50 mètres par
soleil, à la surface par temps
de pluie.
I.e planliton ne se montre pas uniformément distribué dans toute la
masse d'eau, la couche allant de la surface à 5 mètres renferme de
33 à ()7 p. c. de la masse totale du plankton. le volume va en dimi-
nuant vers le fond (saul pour les Crustacés).]
460. lOOC). r. .luDAY. Notes on Jake Tahoe, ils troiit and
Imut-fisliin-. (l'.ull. Imr. Fisli. XXVI, p. 133.)
[Le lac Tahoe (Californie 0-, Nevada W.) couvre une surface de
195 milles carrés et a une profondeur de 501 mètres. Après avoir
exposé son origine et donné une description physique et hydrogra-
phique du lac, l'auteur e.xamine le plankton qui est composé principa-
lement (le Nofliolca longispina, Episclmra nevadensis, Diaptomiis,
Daphnia pnlex pnUcaria et une var. de ï). hualina voisine de
Richardi Burck. Iliocruptus actuifrons se rencontre dans la zone
littorale. Les migrations verticales des Copépodes sont assez res-
treintes, il n'en est pas de même pour les Daphnides; les migrations
sont en rapport avec la transparence de l'eau.
Le lac renferme 2 es|ièces de truites dont Fauteur donne la
description, la biologie, la nourriture et la pêche.]
461. 100(). C. .TuDAY. A studv ol' Twin Lakes, Colorado,
with espocial considéra lion of Uie food oï tlie fronts,
(Bnll. bur. Fisli., XXVI, p. 147.)
[ Les deux lacs étudiés sont des lacs de glacier, situés à 2,804 mètres ;
leur surface est de 192 et 582 hectares, leur profondeur de 25 et
23 mètres, la durée des gelées est de 150 jours. Après avoir étudié le
fond et les bords du lac, ses affluents, la transparence, la température,
la végétation, l'auteur examine le plankton. La phytoplankton
— 469 —
comprend surtout Fraflilaria, AstevioncUa, Mt'losiva, Protococcus
et aussi Staurastrniii. [>armi les Eiitomostrncés, on trouve Diaptomus
Jadaiji, Cnclojn pulchcUiis, C. viridis americanus, Lafona setifera,
Drepanolhrix dentata, Plenroxus procuvvatus, Camptocercus recti-
roslris hiseratus. Un lac plus petit et situé plus haut (3,660 m.) ren-
ferme en abondance Gammanis, Macrothri.r hirsuticornis et
Etu-jjcevcits lamellalas- Les Diaptoiitus, Cjiclops et Nauplius ne
présentent pas de migrations verticales, elles sont faibles chez
Daphnia hiinlina, Anvraea cochlearis, Notholca longispina, As-
planchna se rencontrent dans la couche comprise entre la surface
et 10 mètres, Annriiea acnleata et Triarlhra se rencontrent ordi-
nairement en dessous de cette couche et Polijarthra est répandu à
toutes les profondeurs.
Le lac renferme (> espèces de Salmonidés dont l'auteur étudie les
mœurs et la nourriture.]
462. lî>0(j. K. VON Keissler. Bcitrag ziir Kenntnis dor Plank-
loiis einiger kleinerer Seon in Kiirnfon. (( )st. I^ot.
Zeit., LVI, ]). 513.)
[Kecherches sur le plankton de cinq petits lacs de Carinthie avec
remarques sur sa distribution.)
463. lUOC). K. VON Keissler. Xotiz iibcr das Aiigiist Planklon
(hu' Gardascos. (Ost. Bol. Zcitselir., LVI. p. Jll.)
[Résultats de quelques pêches (août 1906, matin, profondeur
10 mètres, température de la surface, 'i'i'\ transparence, 4'"5) :
r le phytoplankton domine; 2° il est formé principalement par Fra-
(jilaria crotonemi^ var. subpyolonf/ata Schroter et Yogi- et Asterio-
ncUa formosal{a.ssk. var. gracillima Grun. On trouve en troisième
ligne Ceratium hinindinella 0. F. M. (forma carinthiacum Zed.),
Botruococcus Bvaunii \ii\lz. ^ouveWe forme d'Ooc//.s//s: 3Mes trois
algues qui dominent dans le plankton d'août se rencontrent aussi
en septembre el décembre suivant Brehm et Zederbauer, mais
Ceratium domine et Asterionella est isolée; 4' le zooplankton se
compose de Crustacés, surtout de Diaptovms, il n'a pas été trouvé
de liotifères.]
464. lUOT. K. VON Keissler. Planktonstudien iibor oinigo
kleinere SeendesSalzkammergutes. (( )st. Bot. Zeitselir.,
LVII, p. 51)
[Etude du plankton de sept lacs du Salzkammergut situés à unealli-
lude inférieure à 1,000 mètres : Langbatlisee (675 m.), Zweite Lang-
bathsee (7"27 m.), Rothelsee (1,000 m.), Olfensee (651 m.), Alt-Ausseer-
see (700 m.), Grûndisee (709 m.), Odensee (7()0 m.). Ces lacs qui sont
pourtant voisins offrent à la même époque une différence considérable
dans la composition de leur plankton.]
— 470 —
465. 1006. F. Krause. Planktonproben ans Ost- uncl West-preussisclion Soen. (Ai'cli. f. Hvdrob, VA II, p. 218.)
[Tables des récoltes de plankton faites dans onze lacs de Prusse,
suivies de notes sur l'apparition et la variation de certains éléments
du plankton {Cerutium hinindinella, Dinobrijon sertulariii, Peridi-
nium talmlatum, etc.). Ponte de Maatigocercu capucina.]
466. 1000. R. Lauterborn. Demonstrationen ans der Faunades Obci'i'lioins und seiner Umgobiiiig. (Vorh. Dciitsch.
Zool. Ges., 10 Vers., p. 265.)
467. 1000). E. Lemmeraiann. Das Plankton oinii^or T(,'icli(' in
dor Umgegend von Bi-cmerhaven. (Ai'cli. f. Ilvbi'ob.
nnd Planktonkundc, I, Heft 3, p. .'^4.5. i
[l/auteur fait l'étude du plankton de trois marais situés près de
Bremerhaven H n'a pas constaté la présence d'espèces persistantes
(perennierender Formen) contrairement à l'opinion de Zacharias et
Lauterborn, d'après lesquels il y a de riches formes persistantes dans
les petites mares, fossés, etc. 17 formes n'ont qu'un maximumde développement pendant l'année, 4. {Phacotus lenticularia, Botri/o-
coccHS Braunli, Eaglena polymorpha, Cuclops spec.) en ont deux.l.e
maximum de développement pour une i^spèce donnée ne se présente
pas en même temps dans les dill'érents marais.]
468. 100<). E. LemiMER.mann. Cbor das Vorkomnicn von Sitss-
wasseii'onnen iin Plytoplankton dos Mcoros. (Arcli. f.
Hjdrob., I, p. 409.)'
[X(l formes d'eau douce s'adaptant à l'eau de mer, modifications
subies.)
469. 1000». E, LEMMEiiiMANX. noiti'Jigc zui' Kennlnis der Plank-
tonalgon, XXII. (Ror. DeiUscdi Rot. G(>s., XXH',p. 535.)
[Anabaena Levanderi, Synedra Revaliemis nn. sp. (Obersee, près
Reval).]
470. RHX). K. M. Levander. Zur Konntnis des Planklons
t'iniger Rinnonseon in lvnssiscb-Lai)pland. (Zeitscbr.
r. ]\alm<ni, p. 1.)
[Examen du plankton de six lacs de la Laponie russe (Kola, région
des forêts), le maximum de température (18') est en juillet. Lo phyto-
plankton comprend 67 espèces, le zooplankton 71.
Le phytoplankton est pauvre en Myxophycées, riche en Chlorophy-
cées. La grande quantité de Diatomées donne au plankton de ces
lacs le caractère d'un Heleoplankton. Melosira manque ou est peu
commune. Parmi les Flagellâtes, Dinobryon et Syniira occupent la
— 471 —
première place. On rencontre encore Pcridiniam. WiUei eiCcrdlium
hinmdinella, quelques lîhizopodes et un nouvel Jnfusoire : Rhub-
dostulu bosniinac nov. spec Les Jlotifères (2(1 espèces) et les Clado"
cères (20 espèces) dominent dans le plankton, mais parmi eux il y a
d'assez nombreuses formes littorales (12 Rotiféres, lo Cladocères), on
trouve aussi Diaptomus gvdcilis, lli'terocojtc appendiculata et
Cjiclops scatifey.]
471. 1<,H)(). Iv. M. Levandkr. Beili'. z. Kenntn. des Sers Valk<'M
Mustajarvi der Fiscliereivorsuchstatioii Evois. (Acta
Soc. pro fauiia oi fi. Feiinica, XXVIII, \). 1.)
1Au point de vue botanique, ce travail présente un triple inlérêt :
1. Une courte introduction sur les associations végétales qui
existent dans le lac et sur ses bords; les associations dominantes son!
indiquées sur la carte (Nupharctum, Potamogetonetum, Phragmi-
tctiunet Caricehun).
2. Observations sur la température de l'eau du lac.
3. La plus grande partie du travail est consacrée au plankton. Le
pliytoplankton est pauvre (27 e.<;pèces), les Myxopliyceae sont rares,
tandis que Dinobiifon et Mallomonas candala prédominent. Le pliyto-
plankton est presque nul de décembre à avril, les Diatomées sont assez
rares, Aslevionella n'est jamais nombreuse, Rhizosolenia longmia
est commune en été. Les Protococcacées et l'éridiniens sont rares.
Le lac est un lac à Dinobryon dans le sens d'Apslein.
Au point de vue zoologique, l'auteur donne quelques notices sur la
nourriture et les parasites de Perça flnviatilis et Leuciscus rutilus.
Le Zooplankton comprend 30 espèces; parmi les Protozoaires,
Tinlinnopsis kicuslris et DilfJugia Umnctica dominent; les Rotiféres
présentent les formes habituelles; parmi les Copépodcs, les formes
dominantes sont : Cyclops strenuiis, Diaptomus gracilis et Hctero-
cope appendiculala : parmi les Cladocères : Daphnia cristata, Bos-
mina oblusirosiris, Holopedimn gibbenini et IHapJianosonm leach-
tcnbergianuiH. On n'a pas trouvé Daphnia cncuUata et Bosmina
coregoni. Le plankton s'appauvrit qualitativement de février à avril
(mois où il n'y a plus de phyloplankton et seulement 3 espèces
composant le zooplankton); à la fonte de la glace, en mai, le plankton
devient plus riche et il présente son maximum en août avec 3!) espèces.
11 va ensuite en diminuant jusque décembre. Quanlitativement, c'est
en mars que se trouve le minimum, en juillet-août le maximum. Un
second minimum se trouve en mai.J
472. lUOiJ. r. H. (;)STENFELD aiid C. Weseni^I'^ik; Lund.
A Uoi^ulaf Foi'tniglitly Exi)loration of (lie Plankton of
tlie hvo Icelandic Lakes Tliingvallatvatn and M_v\aln.
(Proe. R. Soc. Edinb., XXV, p. 1092.)
[Etude du plankton des deux lacs d'Islande. Le Thingvallatvatn
(S.- \V. Islande) couvre une surface de 115 kilomètres carrés, a une
profondeur de 35 à 110 mètres, c'est un lac arctique, dont la tempe-
— 472 —
rature ne monte pas au delà de 1 1" en été. Son plankton ne reiiierme
pas de iMyxophycées, mais surtout des Diatomées (surtout Mcloxira et
AslerioneUa). Fi-agilaria crotoncnsis tie se montre que de temps en
temps et surtout pendant la période chaude. Les Chloropliycées sont
peu nombreuses et on ne trouve pas de Dinobnjon, m de Ceralium.
Le zooplankton l'emporte sur le pliytoplankton. Ouant au lac Myvatn
(Islande N), d'une superficie de Ti kilomètres carrés, il est dépourvu
de pliytoplankton.]
473. l'JUT. ('. H. OsTENKELD. I>eitr;ig(' ziir Kciinliiis dcr
Algeiitioi'a des Kossoliol-Beckens in dcr iiordwcsl-
liclioii Mongok'i; mit speziellci- Bcriicksiclitigtinu- des
Plivtoplanktons. (Ilcdwigia, XLVI, \). oOr;.)
[L'auteur étudie le plankton du lac de Kossogol (N.-W. Mongolie) et
des marais et cours d'eau voisins. Le lac de Kossogol présente les
caractères d'un l;ic de montagne (profondeur, transparence, tempé-
rature). Le Pliytoplankton, sur lequel l'auteur s'étend particulièrement,
comprend 90 espèces (5(1 Chloropliycées, 7 l'haeophycées, 5 Péridi-
niens, tt Myxophycées), parmi lesquelles sont nouvelles : Diiiobrijon
Kossogolensis,Peridminiii umbonatmn xav.Elpatiewskiji. Noms nou-
veaux: Ankitrodesmus lacustre (= Rhaphidium Braunii vnr. lacustre
Cliodat), Coelosphaerimn lacustre (= Gomphosphacria lacustris
Cliodat). Les espèces caractéristiques sont : Uinobryon hossogolensis,
:>pluu'roc!jst.is Schrot'.teri et Stichoglaea oliracea var. sphaericu. I>e
plankton des marais présente un tout autre caractère et n'est nulle-
ment alpin; comme celui du lac il est pauvre en Diatomées.]
474. rjlJT. A Steuer. Xcueiv Arbeiton iibor Plaiiktoii, mil
bcsondci'er Bci'i'icksichtiguiig d(>s Zooplankloiis (Vei'li.
KK. Zool. bot. (les. Wien, XVII, p. 10.)
IPiésumé des derniers travaux parus sur le plankton]
475. r.MHJ. M. Tanner FuLLE.MANN. Suc un nouvel ocganismc
du i)bmkton du Selioeuenbodensee, k' Ivaiibidiuin Clio-
dali Tanner. (Bull. Ilerb. Boissier, Al, p. 15(J.)
476. l'.HJT. M. Tanner Fullemann. Contribution à Télude des
lacs alpins. (Bull. Ilerb. Boissier, MI, pp. l."3, li;iel
225.)
|Le Schoenenbodensee est un des six lacs alpestres de la région de
l'Alpstein, montagne située sur la frontière des cantons de Saint-Ciall
et d'Appenzell. Situé à I,l0i mètres d'altitude et profond de (î mètres
environ, il déverse ses eaux directement dans le Uhin.
Après quelques pages d'introduction sur les généralités se rappor-
tant à l'étude biologique des lacs, l'auteur reprend en détail l'étude du
Schoenenbodensee et donne des renseignemenls précis sur : 1. Situa-
tion, géologie et environs du lac; 2. structure du lac; 3. l'eau (couleur,
— 473 —
an;ilyse chimique, etc.; le lac est très riche en chaux et son oxydahi-
litéest consi(lérahle); ï. cMmatolog'ie; 5. végétation des rives; (>. flon;
algolo^ique des pierres et des rives; 7. leplankton (riche en Chloro-
phycées, Desmidiacées et Diatomées et pauvre en Schizophytes,
Péridiniens et l''lagellates).
L'auteur conclut que le Schoenenbodensee n'a pas le caractère îles
lacs étangs du plateau Suisse et des plaines, mais qu'au contraire il
présente d^s qualités tout à fait différentes qui ne se présentent pas
ailleurs. Il s'agit d'un nouveau type, celui du lac étang alpin, dont les
traits généraux ne pourront toutefois iMre affirmés qu'à la suite d'une
étude approfondie de tous les autres lacs de l'Alpstein.
Ce travail est accompagné d'une carte représentant la succession
des formations végétales au Schoenenbodensee, de six schémas de la
distribution des formations en différents points de la rive, puis de trois
figures accompagnant la description des espèces nouvelles : Dino-
bryon simplex, sessile et Pohiedrium Chodati-]
477. l'.KX). R. VuLiv. Haiiibur^isclie Elb Unlef.suc'liung, VIII.
StiKlicJi i'il)(>r (lie Kinwii'kung der Ti-ockenpei-iodo im
Soinmer 1U04 nul' die blologisclKMi Vei'hiiltnisso dci"
Elbe bei Hamburg, etc. (Mitt. Natui'hisl. Mus. Ham-
bui-g, XXIII.)
[Ktude qualitative et quantitative du plankton de l'Elbe en amont et
en aval de Hambourg et d'Altona, pendant les années 11)04-1905.
Technique employée (nombreux perfectionnements aux méthodes
connues); composition chimique de l'eau; examen qualitatif du plank-
ton et du pseudo-plankton, tables donnant la date, le lieu, la réparti-
tion, la richesse des divers éléments planktuniques. Le plankton de
19Ui comprenait 5"24 espèces de plantes et 2(14 espèces d'animaux,
celui de 1905, 483 plantes et 187 animaux. La richesse plus grande du
plankton de 190i était due à île nombreuses Bacillariacées et d'abon-
dants Ciliates. Les Saprophytes étaient aussi plus nombreux qu'en
l!)l>5 Le phytoplankton était plus abondant en aval d'Hambourg
qu'en amont. Au point de vue quantitatif, le volume du plankton était
aussi plus considérable en 1904 qu'en 1905. L'Elbe supérieure est
plus riche en Kotifères que l'Elbe inférieure, caractérisée par la pré-
sence de nombreux Eurutemora a/finis qui constituent une part
importante de la nourriture des poissons et des jeunes alevins.
Eanjtcmora offre deux maxima de production, l'un au printemps
et l'autre en automne.
Un autre crustacé : Bosmina longirostris cornuta, donne lieu aux
mêmes observations que Eurytemora. Les matières organiques que
reçoit l'Elbe pendant son passage à Hambourg et k Altona constituent
probablement la principale source de nourriture de ces deux
crustacés.]
478. 1U0(). W. West and (t. S. AVest. A eompai'alive stiidv
of the Plankton ut' some Ii'ish Lakcs. (Trans. H. Irisli
acad., vol. XXXIII, p. 77.)
04/,0 3 ~hi\
— 474 —
[Suite de leur étude commencée en 100!2 sur le plankton des lacs
d'Irlande. La llorii des lacs de l'Irlande ^V. et S.-W. est comparée à
celle des lacs étudiés antérieurement (Long Neagh et Long Begj.
Dans la première partie, seize lacs sont examinés au ])oint de vue du
plankton (répartition, formes dominantes, etc.), les auteurs décrivent
ensuite les variations ('.») de Ceratimn InrnwUmUa qui sont plus fié-
quentesen Irlande qu'en Ecosse : il n'est pas rare de trouver deux ou
trois formes distinctes dans un lac. Dans la seconde partie, les auteurs
donnent le catalogue systématique et raisonné des formes rencon-
trées; cinq nouvelles espèces et trois nouvelles variétés. Ce travail est
accompagné de (> planches reproduisant des micropliotoij;rammes.)
479. r.HlT. <). Zac'Iiaiîias. Das Siisswassor-Plankton, Leipzig;-,
Tcubnoi', in-S".
[Excellent petit livre, écrit pour ceux qui désirent s'initier aux
recherches planktologiques. But, tendances, historique de l'Hydro-
biologie. Aperçu sur les stations de Biologie lacustre actuellement
existantes, liecherclie et conservation du Plankton, Zooplankton et
Phytoplanklon, examen des divers organismes qui les composent.
Migrations et variations. Périodicité Becherches qualitatives et quan-
titatives. Importance économique du plankton en pisciculture. Le
chapitre final donne un aperçu sur l'Heleoplankton,le Potamoplankton
et les organismes pélagiques marins, ainsi que sur la station biolo-
gique de Plôn.J
480. IDOi). (_). Zacjiarias. Planktoni'oi'sdinug- und Dnrwiiiis-
iiius. (ZooL Anz., VA XXX, p. :j<si.)
481. l'.H)(3. W. Zykokk. Das Plankton einiiier fu'wiisscr Xui'tl-
litisslands. (ZooL Anz., XXX, j). 168.)
[Zykofl' étudie le plankton de juin du lac de Kubinskoje, situé au
S.-W. du gouvernement de Wologda, d'une superficie d(! Il'.li kilo-
mètres carrés et d'une profondeur variant de :^ à IIJ mètres. L'auteur
cite S Microphytes, dont Asterionella gracilliina prédomine, JHno-
bvjinn slipitatum. 5 lîotifères, dont Notliolcn longhiiiwi est le plus
fréquent, 10 Cladocères, dont Bijthotii'phcs cederslronnii prédomine
et 5 Copépodes. i/auleur fait ensuite certaines observations sur les
variations morphologiques des crustacés de ce plankton, décrit une
nouvelle variété de liiaptomm graciloidi's, la var. Kubinskaja et
termine en donnant la liste des organismes formant le Zooplankton
du lleuve Kubina (o Botateurs, i Cladocères, "2 Copépodes).[
(E. B.)
475
Végétation lacustre, Macrophytes
482. l'.'OG. li. ('iioDAT. Obsei'vatioiis sur le Uiaci-ophinkloii (ks
étangs (lu Paraguay. (IJull. Hcrh. Boi.ssicr, M, p. 1 i:!.)
(Il présente trois plantes intéressantes : 1 \/Uiyicnlaria inIJuta,
dont l'inflorescence est soutenue par des feuilles verlicillées en rubans
horizontaux laciniés aux extrémités et renflés dans le centre ; 2' une
Euphorbiacée simulant une Salviniacée, le PhiiUanthus fhiitans. La
tige de cette plante est courte et porte des feuilles alternes très rap-
prochées, orbiculaires, un peu échancrées au sommet et reposant
horizontalement sur l'eau ou dans l'eau; une marge plate assez large
encercle deux vésicules situées de chaque côté de la nervure médiane
et qui s'élèvent en forme de dôme au-dessus du niveau des bords.
Grâce à cette disposition, l'air peut rester adhérent ou emprisonné
dans la cavité située à la face inférieure. On trouve souvent aussi de
grandes lacunes — permettant l'emmagasinement de l'air — du
chlorenchyme à l'épiderme inférieur; 3 VAlternant Itéra llassleriana
Chodat, plante nageante dont les tiges, qui atteignent 20 centimètres
de longueur, ont les entre-nœuds en forme de cigares, fusiformes,
renflés au milieu, (chaque entre-nœud est largement fistuleux, à écorce
épais>e, mais lacuneuse et entourant une large lacune centrale, sys-
tème très propre à faciliter la flottaison. Les feuilles se dressent vers
le ciel comme le pédoncule floral, tandis que les racines sont disposées
en deux épaisses touffes surtout des deux côtés de la tige aux n(ruds.
C'est ainsi que s'établit l'équilibre de ce singulier bateau.]
483. lUOC). H. Gliick. Biologisdic und uiorpliologisclie Unlcr-
sucliungen iibei- Wasser- und Suni])l'-rT('waclis('. Tlu'il
II : Unlci'suclmngen iilx-r die lulltcllcuropaïsclicn
Ub'icidaria Arten, i"ii)er die ïurioncnbildung l)ci
Wassei'pflanzen, sowic iibci' (\'y(itophj/lluui (250 \)\).,
28 ïextfigu l'en, und G lilli. Doppeltaieln. Verlag von
( tuslav Fischer in .lena).
484. 1<.»U7. (\ IvAUNiviAEii. Planterigvts Livsfoi'njcr og deres
lîetvdning for Geografien. ('openliague.
[Edition danoise, un peu augmentée, du travail du même auteur :
« Types biologiques pour la géographie botanique »• L'auteur donne
une statistique de la répartition des 10 types biologiques en Danemark
et aux Antilles danoises. Les Hélopliytes ou Hydrophytes (à bourgeons
cachés au fond de l'eau) sont au nombre de 11 au iJanemark et de 1
à Saint-Thomas et Saint-Jean.] (E. R.)
— 476 —
Biologie des eaux courantes ou stagnantes,
biologie thermale
485. lUOG. U. II. Franck. Philosophie des Wasseriropleiis.
(Kosmos, Bd. III, p. 1».)
486. 1*.HK). K. IssKL. Sulla tei'iuobiosi iiei^ii aiiiinaU adjualiei.
(Atti Soc. Ligust. Se. Nat. e (leogr., XVII, p. 72.)
[La vie des algues est encore possible à 1)0° dans les eaux lliermales.
Faune et flore des eaux thermales. Hapalosiphon knninosus (Kuelz)
Haiisg., espèce exclusivement thermale et cosmopolite. De quoi
dépend la thermobiose? Uniquement de la température ou bien
encore d'autres facteurs? Adaptation du protoplasme des premiers
infasoires ciliés à une température assez élevée. Influence de la com-
position chimique de l'eau. L'auteur donne une riche bibliographie
de cette question (105 travaux cités)]
487. VMM). M. Thiébaud et J. Favke. Sur hi faune invertébrée
des mares de Pouillerel. (Zool. Anz., lîd. XXX,
p. 155.)
[Cette note est le résumé d'une étude intitulée : « Contribution à
l'étude de la faune des eaux du Jura », parue dans le tome Tdes
Annales de Biologie lacustre.]
488. VMM"). M. Thiébaud. Sur hi faune des Invertébrés (ki lac
<le Saiul-lîlaise. (Zool. Aiiz., 15(1. XXIX, p. 7<.t5.)
[Le lac de Saint-Biaise est un petit lac, de 10°50 de profondeur et
séparé par une moraine du Neuenbûrgersee. L'auteur a recherché
principalement les formes littorales des Protozoaires, Rotateurs,
Turbellariés et Entomostracés; il a recueilli 240 espèces, dont •) sont
nouvelles ou rares en Suisse. Il a trouvé une var. neocovtensis nov.
var. de Metacjjpyis cordata Brady et Hoberts.
La faune littorale varie annuellement en quantité et en qualité :
elle atteint son maximum en été et son minimum en hiver. Les
sociétés animales varient suivant l'endroit considéré.]
489. 1UU(3. 0. Zacharias. liber die niikroskopische Fauna und
Flora eines ini Freien stehenden Taufbeckens. (Aivh.
f. Hydrob.,Bd.II, p. 235.)
[L'auteur a examiné pendant dix ans les organismes peuplant l'eau
contenue dans un vase ornemental dejardin.en granit, d'une capacité
de 5 à t) litres. Malgré le dessèchement survenant de temps en temps,
la faune et la flore gardent à peu près la même constitution : un grand
nombre d'algues et en quantités considérables : Eiiglcna riridis
— 477 —
Elirl)g., Trachclomonas rolvocina Elirbg., Haonatococus lacustris
liost., Amoeba spec. et Pliilodina roseola Ehriig. IJiaschiza scmi
upcrtaGosse et Rolifcr calgaris étaient plus rares.|
490. l'.MMi, F. ZsciioKKE. i'bersieliL i'ibur dir Ticrciit'aun;! des
VicrwalsIîUtorscos. (Arcli. 1'. Ihdrob., 15<1. Il, p. 1.)
|Les prclies faites dans les couclies profondes (île I70à "214 mètres)
(la lac des Quatre-Oantons ont permis de récolter 100 espèces, parmi
lesquelles sont nouvelles : horiilaimm Zschokkci Dad., 1). batlnibius
Dad., Sti/lodrilKS Zschokkci l!utscher,T//j/*//s Zscitokkci W alter. Parmi
les espèces recueillies, il y a des formes typiques d'eau profonde et
d'autres qui sont communes aux régions littorale et abyssale. Consi-
dérations biologiques et zoogéoyraphiques sur la faune et l'orii^ine du
lac des Quatre-Cantons.|
Technique
491 r.ioo. p. DE Beauciiamp. Insli-uctioiis i)our la recolle et
la tixalioii en masse des Rotifères. (Airli. de Zool.
expérini. (4), IV, notes et revue, p}). 27-oo.)
I
Cette méthode a pour but de permettre l'application en voyage et
sans microscope de la technique bien connue de Piousselet qui peut
seule, pour la plupart des espèces de Uotilères, procurer des échan-
tillons déterminables. Les animaux sont rassemblés dans un petit tube,
de préférence en utilisant l'éclairage unilatéral d'un flacon de
planklon ou d'un récipient renfermant des végétaux aquatiques .juste
couverts d'eau pour la faune benthique. On y ajoute alors une solution
anesthésique concentrée (chlorhydrate de cocaïne, 1 gramme; alcool
méthylique, I gramme; eau distillée, 1 gramme) par petites portions
(l à 3 gouttes par centimètre cube de liquide), à intervalle de cinq
minutes environ en mélangeant chaque fois. Au bout de 2 ou o de ces
opérations, les animaux tombent tous dans le fond. Sans attendre
davantage, on ajoute une goutte par centimètre cube, au plus, d'acide
osmique à I p. c, on mélange rapidement, décante au bout d'un quart
d'heure environ et remplit d'eau pure. Cette opération est renouvelée
deux ou trois fois en quelques heures, puis le sédiment conservé dans
l'eau formolée à 1 ou "2 p. c La plupart des Hotifères doivent se
trouver bitni étalés et conservés et peuvent être montés en cellule
directement dans l'eau formolée; beaucoup d'autres organismes
microscopiques se fixent bien aussi en même temps. La récolte de
sédiments secs à mettre en culture ne doit pas non plus être négligée.|
492. 1V)U(3. J. MuRRAY. Tlie Bdelloïd Rotii'ei'a of llie Forlli
Area. (Proc. P. phAs.soc. Edinburg-, vol. XVI, p. 215.)
IL'auteur conseille, pour obtenir les lîJelloïdes et autres Rotifères
habitant les mousses, d'employer le procédé suivant : Récolter les
— 478 —
mousses humides des marais, fossés, tourbières, etc., les agiter et les
laver vigoureusement dans un seau d'eau, l/eau est ensuite passée à
travers deux tamis, le premier formé de mailles assez larges (n"(î)
pour laisser passer les liotifères avec l'eau tout en retenant les
mousses et les débris, le second formé de mailles assez fines (n'" l(j
ou 17) pour laisser passer l'eau et retenir les Rotilères. 11 faut exa-
miner le résidu obtenu le plus vite possible, car beaucoup d'espèces
meurent rapidement dans de telles conditions.|
493. 100(). M. Samter and W. Weltner. Fimy: uiid Koiiscr-
vici'iing der l'elikteii Krebse. (Arcli. Naiiu'g, Jalirg.
LXXII, p. 311.)
494. 11)07. P. Steinmann et E. Graetek. Beiti'iig-czur Kemit-
nis dei' ScliweizcrisclR'u Iliililciiraiina. (Zuol. Aiiz..
XXXI, p. 841.)
I
L'auteur conseille le procédé suivant pour la conservation des
Planaires : placer les animaux pendant deux minutes dans une solu-
tion composée de huit parties d'une solution à ïJOp.c. d'acide nitrique
et de deux parties d'acide picrique. Conserver ensuite dans l'alcool.|
495. r.JOO. 0. Zaciiarias. Ein neiier Plaiiktoii-Suilier. (Zool.
Anz., XXXI, ]). 230.)
lOOC). (). Zaciiarias. Dor Planktoii-Seilici' «Eilmioplior».
(Ai'cli. l'iirHydrol). iiiid Planktonkunde, II, p. 320.)
[Appareil destiné à permettre de recueillir du plankton à bord des
navires à marche rapide.] (P. D. l). et E II.)
Laboratoires, stations biologiques
496. lOOC). Iv. WoLTERECK. MilUioiluiigen aus Acv lîiolo-
gisclioii Station in Lunz. (Piol. Ccntralbl., ]U\. XXVI,
p. 4(33.)
[Ce travail donne un aperçu sur l'histoire naturelle des trois lacs de
Lunz, un catalogue préliminaire de la faune et de la flore de ces lacs
et le but et les travaux de la station biologique de Lunz.J
497. 190(1 0. Zaciiarias. P)iologisclic Laboraiorion an Pin-
nensoen und Teiclien. (Zool. Anz., P>d. XXX. p. 188.)
[L'auteur donne un rapide aperçu sur les diverses stations de bio-
logie lacustre actuellement existantes.]
— 479 —
498. lOOC). T). Zaciiauias. Die lîegi'iindung zwoic nouer Suss-
wasserforsclmiigs stationen in Auslande. (Oiol. Cen-
t.ralbl., P.a. XX^'I, p. 02.
)
IFomlation de deux nouvelles stations de biologie lacustre : en
lielgique, à Overmeire; en Italie, à Milan.) (E. lï.)
Nouveaux périodiques et traités sur rHydrobiologie
499. lUOC). Rivista mensile di Pcsea (laeustre, fliiviatile et
marine). Milan. (Continuation di^ i"A(|uicoltura loni-
barda.)
500. 11H»7. K. La:\[peiit. Das Lebon der Binnen gewi'isser.
2"' édit., Tanclmilz, Leipzig.
[Nouvelle édition de cet excellent traité sur la biologie de nos eaux
douces. F/ouvrage est considérablement augmenté et renferme de
nombreuses figures et planches nouvelles.
l.a modicité de son prix (il paraîtra environ 18 livraisons à 1 mark)
ainsi que le clair aperçu de toutes les questions qui se rapportent à la
biologie lacustre en font un ouvrage indispensable à tous ceux qui
s'intéressent à ce genre de recherches.
Il comprend une partie historique, une partie systématique (faune
et llore) et une partie générale. L'auteur a ajouté tout un chapitre
concernant les poissons, la prche et la pisciculture.] (E. M.)
-5îS-
ANNALESDE
txj L I 8 R A R
BIOLOGIE LACUSTREPUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DU
D^ Ernest ROUSSEAU
TOME II
FASCICULES 1 ET 2 (Juillet 1907)
avec 49 figures dans le texte et 11 planches ho?^s texte
SOMMAIRE :
PAGEfS
J.-G. De Man. — Contribution à la connaissance des Nématodes libres de
la Seine et des environs de Paris 9
P. Steinmann. — Die Tierwelt der Gebirgsbiiche, eine faunistiscli-biolo-
gische Studie 30
S. Awerintzew. — Beitrage zur Kenntnis der Siisswasserprotozoen . . . 163
H. Schouteden. — Les infiisoires aspiroti'iches d'eau douce. — II . . . 171
E. Rousseau et H. Schouteden. — Les Acinétiens d'eau douce 181
A. Boubier. — L'universalité et la cause de la forme sphérique des orga-
nismes inférieurs 212
A. Boubier. — La vésicule contractile, organe hydrostatique 214
M. Le Roux. — Recherches biologiques sur le lac d'Annecy 220
E. Rousseau. — Les Hyménoptères aquatiques, avec description de
deux espèces nouvelles par W. -A. Schulz 388
AVIS. — Le fascicule 3 paraîtra ultérieurement et sera consacré à la
bibliographie, aux comptes rendus et analyses de travaux limnobiologiques
parus depuis 1896.
BRUXELLESIMPRIMERIE F. VANBUGGENHOUDT
5 ET 7, RUE DU MARTEAU, 5 ET 7
1907
COLLABORATEURS
K. Apstein, à Kiel.
S. Averintzew, àSt-Pétersbourg.
H. Bachmann, à Lucerne.
Th. Barrois, à Lille
F.-E. Beddard, à Londres.
E.-A. Birge, à Madison.
R. Blanchard, à Paris.
C. Bommer, à Bruxelles
0. Borge, à Stockholm.
A. Borzi, à Palernie.
G.-L. Brady, à Sunderland.
C. Bruyant, à Clermont.
L. Car, à Agram.R. Chodat, à Genève.
E. von Daday, à Budapest.
R. Dangeard, à Poitiers.
J.-G. De Man, à lerseke.
R. De Toni, à Modène.F. Doflein, à Munich.
C. Eckstein, à Eberswalde.
G. Field, à Boston.
G.-A. Forbes, à Urbana.F.-A. Forel, à Morges.
P. Francotte, à Bruxelles.
0. Fuhrmann, àNeuchâtel.
A. Garbini, à Vérone.
G. Gilson, à Louvain.
P. Girod, à Clermont.
P. Godet, à Neuchàtel.
L. Von Graff, à Graz.
R. Gutwinski, à Cracovie.
J. Heuscher, à Zurich.
B. Hoter, à Munich.C. Hoffbauer, à Trachenberg.
C. Huitteld Kaas, à Christiania.
O.-E. Imhof, à Brugg.
H. -S. Jennings, à Philadelphie.
A. Kemna, à Anvers.
F. Klapalek, à Prague.C.-A. Kotbid, à Berkeley.
G. Lagerheim, à Stockholm.K. Lampert, à Stuttgart.
K.-M. Levander, àJlelsingfors.
R. von Lendenfeld, à Prague.
K. Loppens, à Nieuport.
C.-D. Marsh, à Washington.J. Massart, à Bruxelles.
E. Mazzarelli, à Milan.A. Meunier, à Louvain.W. Michaelsen, à Hambourg.W. Migula, à Eisenach.R. Monti, à Sienne.G.-W. Millier, à Greifswald.
P. Nypels, à Bruxelles.
J. Nusbaum, à Lemberg.
P. Pavesi, à Pavie.
E. Penard, à Genève.L.-H. Plate, à Berlin.
H -C. Redeke, au Helder.L. Roule, à Toulouse.C.-F. Rousselet, à Londres.E. Roux, à Bàle.
M. Sam ter, à Berlin.
G.-O. Sars, à Christiania.
J. Schaffer, à Vienne.A. Schertell, à Iglô.
G. Schneider, à Helsingfors.
H Schouteden, à Bruxelles.
A. Schuberg, à Heidelberg.J. Scourfield, à Leytonstone.H. Simroth, à Leipzig.
A. -S. Skorikow, à St-Pétersbourg.
J. Snow, à Northampton.A. Steuer, à Innspriick.
T. Stingelin, à Olten.
S. Strodtmann, à Helgoland
J. Thallwitz, à Dresde.
R. Timm, à Hambourg.
G. Ulmer, à Hambourg.
H. Van Heurck, à Anvers.D. Vinciguerra, à Rome.
E. Walter, à Saalteld.
H.-B. Ward, à Lincoln,
W. Weltner. à Berlin.
J. Wery, à Bruxelles.
A. Wierzejski, à Cracovie.
N. Wille, à Christiania.
V. Willem, à Gand.
E. Zacharias, à Hambourg.G. Zacharias, à Pion.
C. Zimmer, à Breslau.
W.-F. Zopf, à Miinster.
E. Zschokke, à Bàle.
Les ANNALES DE BIOLOGIE LACUSTRE publient des
travaux sur la Limnobiologie en langue allemande, anglaise,
française et italienne.
Les auteurs de travaux publiés dans les Annales de Biologie
lacustre ont droit à 50 tirés à part; ils peuvent en obtenir
davantage aux prix suivants (par feuille de 16 pages) :
50 exemplaires en plus : fr. 7-50
100 exemplaires en plus : " 11-50
200 exemplaires en plus : ^ 18-50
(Ce prix est augmenté s'il y a des planches ou cartes hors
texte.)
Les ANNALES DE BIOLOGIE LACUSTRE paraissent
iiTégulièrement par fascicules. Chaque tome des Annales aura
de 400 à 500 pages, avec figures et planches.
Le prix d'abonnement à chaque volume est de 30 francs.
Sommaire du premier volume :
Avant-propos.
F. -A. Forel. — Introduction : Programme d'études de Biologie lacustre.
J. Poirier et C. Bruyant. — Les Monts-Dore et la station limnologique de Besse.
G. Ulmer. — Ueber die Larve einer brasilianischen Trichopteren-Species
{Triplectides gradlis Burm.) und verwandte Formen aus Neu-Seeland
und Indien.
K. Loppens. — Sur quelques variétés de Membranipora metnbranacea L.
vivant dans l'eau saumàtre.
G. Schneider. — Ueber den augenblicklichen Stand der Siisswasserforschung
in Finland.
L. Car. — Das Mikroplankton der Seen der Karstes.
M. Thiebaud et J. Favre. — Contribution à l'étude de la faune des eaux du Jura.
H. Schouteden. — Notes sur quelques Infusoires aspirotriches.
R. Monti. — Recherches sur quelques lacs du massif du Ruitor.
R.Gutwinsl<i etZ. Chmielewslci. — Contribution à l'étude des algues du Kameroun.
T. Stingelin. — Cladoceren aus Paraguay ; zweiter Beitrag zur Kenntnis
siidamerikanischer Entomostraken.
B. Scliorler. J. Thaliwitz et K. Schiller. ^— Pflanzen- und ïierwelt des Moritzburger
Grossteiches bei Dresden.
E. Rousseau. — La station biologique d'Overmeire.
S. Awerintzew. — Rhizopodenstudien.
H. Schouteden. — Les Rhizopodes testacés d'eau douce.
H. Schouteden. — Les Infusoires aspirotriches d'eau douce.
488 pages, avec 41 figures dans le texte, 3 cartes et 5 planches
hors texte.
Pour tout ce qui concerne la rédaction et l'administration des
Anna/es, s'adresser au Docteur E. ROUSSEAU, au MuséeRojal d'Histoire naturelle, 31, rue Vautier, à Bruxelles.
TARIF BES ANNONCESPage entièreTSO frs. Demi-page, 30 frs. Quart de page, 20 frs.
ANNALES \^''-»
DE
BIOLOGIE LACUSTREPUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DU
D' Ernest ROUSSEAU
TOME II
FASCICULE 3 (Juillet 1908)
SOMMAIRE :
PAGE
Bibliographie limnologique, littérature, comptes-rendus, analyses. . . . 403
(Spongiaires, Coelentérés, Bryozoaires, Mollusques, Vers, Crustacés,
Insectes, Hydrachnides, Poissons, Batraciens, Mammifères, Proto-
zoaires, Algues, Champignons, Plankton, Végétation lacustre,
Macrophytes, Biologie des eaux courantes ou stagnantes. Biologie
thermale. Technique, Laboratoires, Stations biologiques, Nouveaux
périodiques et Traités sur l'hydrobiologie.)
BRUXELLESIMPRIMERIE F. VANBUGGENHOUDT
5 ET 7, RUE DU MARTEAU, 5 ET 7
1908
COLLABORATEURS
•K. Apstein, à Kiel.
S. Averintzew, àSt-Pétersb.
H. Bachmann, à Lucerne.Th. Barrois, à Lille.
P. de Beauchanip, à Paris.
F.-E. Beddard, à LondresE.-A. Birge, à Madison.R. Blanchard, à Paris.
C. Bommer, à Bruxelles
0. Borge, à Stockholm.A. Borzi, à Palerme.G.-L. Brady, àSunderland.C. Bruyant, à Clermont.
L. Car, à Agram.R. Chodat, à Genève.E. von Daday, à Budapest.R. Dangeard, à Poitiers.
J.-G. De Man, à lerseke.
R. De Toni. à Modène.F. Doflein, à Munich.
C. Eckstein.à Eberswalde.
G. Field. à Boston.G.-A. Forbes, à Urbana.F.-A. Forel, à Morges.P. Francotte, à Bruxelles.
0. Fuhrmann,àNeuchàtel
A. Garbini, à Vérone.G. Gilson, à Louvain.P Girod, à Clermont.P. Godet, à Neuchàtel.L. Von Graff. à Graz.
R. Gutwinski, à Cracovie.
J. Heuscher, à Zurich.
B. Hofer, à Munich.C. Hoffbauer, à Trachenberg.C.Huitfeld Kaas à Christiania.
O.-E. Imliof, à Brugg.
H.-S. Jennings,à Philadelphie,
A. Kemna, à Anvers.F. Klapalek, à Prague.C.-A. Kof'oid, à Berkeley.
G. Lagerheim, à Stockholm.K. Lampert, à Stuttgart.
K.-M. Levander.à Helsingfors.
R. von Lendenfeld, à Prague.K. Loppens, à Nieuport.
P. Magnin, à Besançon.C.-D. Marsh, à Washington.J. Massart, à Bruxelles.
E. Mazzarelli, à Palerme.A. Meunier, à Louvain.W. Michaelsen, à Hambourg.W. Migula, à Eisenach.
R. Monti, à Sassari.
G.-W. Millier, à Greifswald.
P. Nypels, à Bruxelles.
J. Nusbaum, à Lemberg.
E. Penard, à Genève.L.-H. Plate, à Berlin.
H.-C. Redeke, au Helder.
L. Roule, à Toulouse.C.-F. Rousselet, à Londres.
E. Roux, à Bàle.
M. Samter, à Berlin.
G.-O. Sars, à Christiania.
J. Schaffer, à Vienne.A. Scherfell, à Iglô.
G. Schneider, à Helsingfors.
H. Schouteden, k Bruxelles.
A. Schulierg, à Heidelberg.
J. Scourfield, à Leytonstone.H. Simroth, à Leipzig.
A.-S. Skorikow, à St-Pétersb.
J. Snow, à Northampton.A. Steuer, à Innspriick.
T. Stingelin, à Olten.
S. Strodtmann, à Helgoland.
J. Thalhvitz, à Dresde.
K. Thor, Norwège.R. Timm, à Hambourg.
G. Ulnier, à Hamljourg.
H. Van Heurck, à Anvers.
D. Vinciguerra, à Rome.
E. Walter, à Saalfeld.
H.-B. Ward, à Urbana,W. Weltner. à Berlin.
J. Wery, à Bruxelles.
A. Wierzejski, à Cracovie.
N. Wille, à Christiania.
V. Willem, à Gand.
E. Zacharias, à Hambourg.0. Zacharias, à Pion.
C. Zimmer, à Breslau.
W.-F. Zopf, à Miinster.
E. Zschokke, à Bàle.
Les Annales de Biologie lacustre publient des travaux sur la Limnobio-
logie en langue allemande, anglaise, française et italienne.
Les auteurs de travaux publiés dans les Annales de Biologie lacustre ont
droit à 50 tirés à part; ils peuvent eu obtenir davantage aux prix suivants
(par feuille de 16 pages) :
50 ex. en plus fr. 7.50.| 100 ex. en plus fr. 1 1 .50. |
200 ex. en plus fr. 18.50.
(Ce prix est augmenté s'il y a des planches ou cartes hors texte.)
Les Annales deBiologie lacustre paraissent irrégulièrement par fascicules.
Chaque tome des Annales aura de 400 à 500 pages, avec figures et planches.
Le prix d'abonnement à chaque volume est de 30 francs.
Pour tout ce qui concerne la rédaction et l'administration des Aniiales,
s'adresser au Docteur E. ROUSSEAU, au Musée Royal d'Histoire naturelle,
31, rue Vautier, à Bruxelles.
^ TARIF DES ANNONCESPage entière : 50 frs. | Demi-page : 30 frs.
|Quart de page : 20 frs.
DASLEBENDERBINNENGEWÀSSERVON
Professer Dr. KURT LAMPERTVorstand des Koniç'lichen Naturalien-Ka,binetts in Stuttgart
Zweite, vermelirte u. verbesserte Auflagc
mit ca. 17 (meist larbigen) Tal'eln sowie iiber 200 Abbildungen im Text
Vollstandig in ca. 18 Lieferungen à Mk. 1.)
Buchhandlung Herm. TAUCHNITZ, in Leipzig
E. SCHWEIZERBARrsche VERLA6SBUCHHANDLUNG (E. NÀ6ELE) Stuttgart
FORSCHUNGSBERICHTE AUS DER
BIOLOGISCHEN STATION ZU PLON
ANNALES DE BIOLOGIE LACUSTRE
Sommaire du premier volume :
Avant-propos. '
_ ,. ;
F. -A. Forel. — IiitroLluction : Pro;^ramine d'étinles de Biologie lacustre.
J. Poirier et C. Bruyant. — Les Monts-Dore et la station linniologique de Besse.
G. Ulmer. — Ueber die Larve einer hrasilianisclien Trichopteren-Species
[Tripleclides gracilis Burm.) nnd verwandte Formen aus Neu-Seeland
. und Indien.
K. Loppens. — Sur quelques variétés de MeniJiraniponi niembranacea L.
vivant dans Teau saunnUre.
G. Schneider. — Ueher tien augenhlicklichcn .Stand der Susswasserforschung
in Finland.
L. Car. — Das Mikroplankton der Seen der Karstes.
M. Tliiebaud et J. Favre. — Contribution à l'étude de la faune des eaux du Jura.
H. Schouteden. — Notes sur quelques Infusoires aspirotriclies.
R. Monti. — Recherches sur quelques lacs du massif du Ruitor.
R. Gutwinski etZ. Cliniielewski. — Contribution à l'étude des algues du Kameroun.
E. Rousseau. — La station biologique d'Overmeire.
S. Awerintzew. — Rhizopodenstudien.
J.TlialIwitz.— Pflanzen-undTierwelt desMoritzbui-ger Grossteiches beiDresden,
H. Scliouteden. — Les Rhizopodes testacés d'eau douce.
T. Stingelln — Cladoceren aus Paraguay.
H. Schouteden. —• Les Infusoires aspirotriches d'eau douce.
488 pages, avec 41 figures dans le texte, 3 cartes et 5 planches hors texte.
Sommaire du second volume :
J.-G. De Man. — Contribution à la connaissance des Néniatodes libres de la
Seine et des environs de Paris.
P. Steinmann. — Die Tierwelt der Gebirgsbiiche, eine faunistisch-biologische
Studie.
S. Awerintzew. — Beitrage zur Kenntnis der Siisswasserprotozoen.
H. Schouteden. — Lus infusoires aspirotriches d'eau douce. — II.
E. Rousseau et H. Schouteden. — Les Acinétiens d'eau douce.
A. Boubier. — L'universalité et la cause de la forme sphérique des organismes
inférieurs.
A. Boubier. — La vésicule contractile, organe hydrostatique.
IVI. Le Roux. — Recherches biologiques sur le lac d'Annecy.
E. Rousseau. — Les Hyménoptères aquatiques, avec description de deux espèces
nouvelles par W. -A. Schulz.
Bibliographie, littérature, comptes rendus, analyses.
Environ SOCLpages, avec 49 figures dans le texte et 11 planches hors texte.
Prix, cle chsxiue volume : SO fi:*£unes