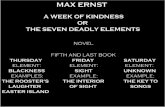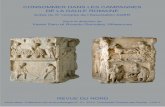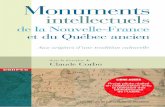Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d'Erétrie
Transcript of Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d'Erétrie
UNE NOUVELLE DÉDICACE À LA TRIADE ARTÉMISIAQUEPROVENANT D'ERÉTRIECédric Brélaz, Stephan G. Schmid
Presses Universitaires de France | « Revue archéologique »
2004/2 n° 38 | pages 227 à 258 ISSN 0035-0737ISBN 9782130548393
Article disponible en ligne à l'adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-archeologique-2004-2-page-227.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!Pour citer cet article :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cédric Brélaz, Stephan G. Schmid, « Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenantd'Erétrie », Revue archéologique 2004/2 (n° 38), p. 227-258.DOI 10.3917/arch.042.0227--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Presses Universitaires de France.
© Presses Universitaires de France. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manièreque ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
UNE NOUVELLE DÉDICACEÀ LA TRIADE ARTÉMISIAQUE
PROVENANT D’ÉRÉTRIE
par Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
À Pierre Ducrey,pour son 65e anniversaire et à l’occasion
du 40e anniversaire du début des fouilles suisses à Érétrie (1964-2004).
Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
INTRODUCTION
Le 9 septembre 1999, les fouilles menées à Érétrie, en Eubée, par l’École suisse d’Archéo-logie en Grèce mirent au jour la face supérieure d’une base de marbre destinée à porter deuxstatues en bronze, aujourd’hui disparues. Une fois dégagée, quatre jours plus tard, la base révéladeux inscriptions sur sa face antérieure. Le texte des inscriptions indique que les deux statues
Résumé. – Publication d’une base inscrite en marbre,découverte en remploi dans le dallage du temple duculte impérial d’Érétrie sur l’île d’Eubée. La double ins-cription gravée sur la face antérieure de la base montreque celle-ci portait à l’origine deux statues de bronzehonorant les membres d’une même famille érétrienneet que l’ensemble était dédié à la triade forméed’Artémis, Apollon et Lêtô. L’analyse paléographiqueet l’examen typologique de la base – dont on connaîtplusieurs parallèles en Grèce centrale –, ainsi que lecontexte politique et économique d’Érétrie à la basseépoque hellénistique, permettent de dater l’érection dumonument de l’extrême fin du IIe s. ou du tout débutdu Ier s. av. J.-C. Ce genre de dédicaces à la triade arté-misiaque est connu par d’autres inscriptions découver-tes dans les environs présumés du sanctuaire d’Artémisà Amarynthos, à l’Est d’Érétrie. La découverte de lanouvelle base en ville d’Érétrie et la mention en pre-mière position d’Artémis suggèrent cependant que lemonument était placé à l’origine dans une chapelleartémisiaque à l’intérieur même des murs de la cité.
Mots clés. – Monde grec. Monde romain. Grèce. Eubée.Érétrie. Amarynthos. Épigraphie. Dédicace. Sculpture.Ronde bosse. Bronze. Culte impérial. Sébasteion. Sanc-tuaire. Artémis. Apollon. Lêtô. Période hellénistique.II
e / Ier s. av. J.-C.
A new dedication to the Artemisiac triad in Eretria
Abstract. – The present publishes an inscribed marblebase, found reused in the pavement of the temple forthe imperial cult at Eretria in Euboea. The doubleinscription on the front shows that the base supportedtwo bronze statues honouring members of an Eretrianfamily, and was dedicated to the triad, Artemis, Apolloand Leto. Palaeography and the typology of the base,which has parallels in Central Greece, and the politicaland economic position of Eretria in the late Hellenisticperiod, allow to propose a date in the last years of the2nd century or earliest 1st century. This type of dedica-tion to the divine triad is well known from otherinscriptions found in the neighbourhood of the sup-posed sanctuary of Artemis at Amarynthos, east ofEretria. The new base, found in the city, and the factthat Artemis is named first, suggest that the monumentstood originally in a sanctuary dedicated to Artemiswithin the city.
Key-words. – Greek world. Roman world. Greece.Euboea. Eretria. Amarynthos. Epigraphy. Dedication.Sculpture. Sculpture in the round. Bronze. Imperial cult.Sebasteion. Sanctuary. Artemis. Apollo. Leto. Hellenisticperiod. 2nd / 1rst century BC.
REV. ARCH. 2/2004
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
furent érigées en l’honneur d’un père et de l’un de ses fils et qu’elles furent dédiées à la triade ar-témisiaque, formée d’Artémis, Apollon et Lêtô. Le bâtiment dans lequel la base fut trouvée a de-puis lors été identifié comme le Sébasteion ou temple local du culte impérial.
Nous nous attacherons ici, dans un premier temps, à décrire le contexte archéologiquede la trouvaille. Dans un deuxième temps, nous présenterons une étude épigraphique de labase, qui permettra d’en préciser la datation. Enfin, dans une troisième partie, nous esquisse-rons une analyse typologique de la base et tenterons de préciser son emplacement origineldans la cité d’Érétrie1.
1. LES CIRCONSTANCES DE LA DÉCOUVERTE
La fouille du Sébasteion d’Érétrie s’est déroulée en deux phases au cours de l’été et del’automne de l’année 19992. Une courte interruption entre les deux phases de la fouille futrendue nécessaire par le fait que la partie Est du bâtiment était située sur un terrain public,plus précisément sous un chemin de terre battue appartenant au réseau routier de la communed’Érétrie. La partie Ouest du bâtiment se trouvait, quant à elle, sur un terrain acquis en 1975par l’École suisse d’Archéologie en Grèce au profit de l’État grec, en prévision de fouilles futu-res. La découverte de la partie Ouest du bâtiment lors de la première phase de la fouille invitaità fouiller aussi la partie Est et à dégager entièrement le monument, ce qui fut fait à l’automnede la même année, grâce à la compréhension et au soutien de la commune d’Érétrie et desautorités archéologiques grecques.
L’édifice comprend une pièce rectangulaire (en blanc sur la fig. 3), dont la constructionremonte à l’époque hellénistique et dont la façade principale donne sur l’un des plus importantscarrefours de la ville antique (fig. 1-2). Au début de l’époque impériale, le mur de fond de cetteconstruction fut partiellement détruit et une deuxième pièce lui fut accolée au Nord. Celle-cidevint alors la pièce principale du bâtiment. Dans cet espace furent mises au jour plusieurs basesqui avaient porté des statues de membres de la famille impériale. Des fragments de ces statuesfurent en effet découverts au milieu de la pièce, dans la couche de destruction visible sur les fig. 4à 6. On estime à six le nombre de statues qui se dressaient à l’origine sur les bases. Une septièmestatue se trouvait sur une base placée devant l’édifice (ST 52 sur fig. 3). Trois des statues qui sedressaient à l’intérieur du temple étaient de taille plus grande que nature (environ 2,30 m), deuxde grandeur nature et une de taille plus petite – il s’agit peut-être de la statue d’un enfant. Si les
228 Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
1. Les auteurs remercient l’Éphorie des antiquités pré-historiques et classiques d’Eubée, et particulièrementMme Amalia Karapaschalidou, directrice, et Mme Athana-sia Psalti, archéologue responsable du site d’Érétrie, de leursoutien. Ils expriment leur reconnaissance à Pierre Ducrey,directeur de l’École suisse d’Archéologie en Grèce (ESAG),à Denis Knoepfler, ainsi qu’à Thierry Theurillat, archéo-logue de l’ESAG, pour leurs suggestions et appui, de mêmequ’à Laurent Gorgerat (Université de Bâle) pour son assis-tance technique. Ils ont bénéficié également du concours
des participants au séminaire d’épigraphie grecque donnépar P. Ducrey à l’Institut d’Archéologie et des Sciences del’Antiquité de l’Université de Lausanne durant le semestred’hiver 1999/2000.
2. Ant. Kunst, 43, 2000, p. 122-127 ; Ant. Kunst, 44,2001, p. 80-83 ; Schmid, 2001, passim. Pour un état de laquestion sur les recherches archéologiques à Érétrie, voirÉrétrie, Guide de la cité antique (École suisse d’Archéologieen Grèce), Gollion, 2004.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
1. Érétrie, plan général de la ville antique. Plan S. Fachard, Th. Theurillat, ESAG.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
230 Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
2.Ér
étri
e,pl
angé
néra
lde
sve
stig
esar
chéo
logi
ques
duqu
artie
rdu
Séb
aste
ion.
Plan
S.
Fach
ard,
Th.
Theu
rilla
t,ES
AG
.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
fragments trouvés devant le temple appartiennent effectivement à une septième statue dresséesur la base ST 52, cette statue devait également être de taille plus grande que nature. Cettesculpture, de même que quatre des six œuvres qui étaient disposées à l’intérieur du bâtiment,appartiennent à la catégorie dite des statues cuirassées. Une telle concentration de statues cui-rassées, dont certaines plus grandes que nature, ainsi que plusieurs éléments iconographiquesdécorant les cuirasses invitent à identifier le bâtiment découvert comme un Sébasteion, c’est-à-dire un temple voué au culte local des empereurs3.
La destruction manifestement intentionnelle et systématique des sculptures, de mêmeque l’absence de toute trace des têtes des statues suggèrent que la destruction pourrait êtreimputable à des chrétiens. Par ailleurs, la monnaie la plus récente de la couche de destructiondate des années 348-358 apr. J.-C., ce qui donne un terminus post quem large, étant donné que
Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d’Érétrie 231
3. Pour de plus amples informations à ce sujet, voirSchmid, 2001, passim.
3. Érétrie, plan du Sébasteion.Plan S. Fachard, Th. Theurillat, ESAG.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
232 Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
4. Érétrie, Sébasteion, base in situ, vue Sud-Ouest. Cl. S. G. Schmid, ESAG.
5. Érétrie, Sébasteion, base in situ, vue Ouest. Cl. S. G. Schmid, ESAG.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
les symboles du culte impérial ont rarement entraîné des destructions iconoclastes avant leVe s. Quant à la construction même du temple, ou plus précisément l’extension du bâtimentd’origine hellénistique, une datation plus précise que le début de l’époque impériale ne peutêtre proposée pour l’instant, faute de données déterminantes.
La base en marbre que nous publions fut trouvée dans la pièce principale, devant lesbases centrales et leurs prolongements du côté Est (ST 53 sur fig. 3 ; fig. 4-5). Le lieu de trou-vaille de notre base ne correspond pas à son emplacement primitif. Car, comme on le constatesur les fig. 4-5, la couche de destruction la recouvrait entièrement lors de sa découverte. Lacouche de destruction passe en effet très exactement au-dessus de la face supérieure de la base.La coupe stratigraphique montre que la partie supérieure de la base devait correspondre auniveau du sol du temple au moment de la destruction de l’édifice : le niveau inférieur de lacouche de destruction à proximité de la base (entre ST 45 et ST 49) se situe entre 6,62 et6,75 m au-dessus du niveau de la mer, alors que la face supérieure de la base se trouveà la cote 6,62 m (fig. 6). Les deux inscriptions étaient donc noyées dans le niveau de marchede la pièce4.
À ces observations stratigraphiques s’ajoute le fait que ce type de base ne reposaitd’ordinaire pas à même le sol, mais sur un socle ou un pilier (voir fig. 16), afin d’améliorer lalisibilité de l’inscription et la visibilité des statues. Une réutilisation de la base, évidemmentdépourvue de ses deux statues, s’explique dans le cadre de l’aménagement de l’espace inté-rieur du temple. Bien que le nombre des bases de statues dressées à l’intérieur du temple aitaugmenté au cours des siècles, ce n’est que lors de la dernière transformation – sans doute àune époque tardive – que les structures ST 46 et 49 ont été construites (fig. 3). Ces structures,ou plutôt les statues posées sur celles-ci, ont dû obstruer la vue que l’on pouvait avoir sur lesstatues de la base principale, qui se dressaient contre le mur de fond de l’édifice. Dans cesconditions, il est hautement improbable que notre base ornée de deux statues ait été poséedevant la base principale, car dans ce cas, cette dernière n’aurait plus été visible du tout. Nousen concluons que notre base a été enfouie dans le sol du temple sans ses statues.
Malgré la longue durée d’utilisation du temple et les multiples extensions et aménage-ments de son espace intérieur, on n’observe qu’un seul niveau de marche. Quelques fragmentsde dalles en marbre blanc ont été trouvés dans la couche de destruction, tous situés à peu dechose près à la même altitude que la surface de notre base (fig. 4-5)5. La majorité des dalles demarbre ont apparemment été retirées avant la destruction du bâtiment, sans doute pour êtreremployées à leur tour6.
Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d’Érétrie 233
4. Seule la coupe stratigraphique passant à l’Ouest dutémoin central, qui traverse le temple assez exactement aucentre du bâtiment dans le sens de la longueur, a été des-sinée au moment de la fouille. Vu que la partie Est del’édifice était située sous une rue moderne, le permis defouille n’avait été accordé qu’à titre exceptionnel pour troissemaines, ce qui a empêché la réalisation de certains rele-vés. C’est la raison pour laquelle la base, trouvée dans lapartie Est de la pièce principale du temple, ne figure passur cette coupe.
5. Sur les décors des sols en Grèce à l’époque romaine,voir A.-M. Guimier-Sorbets, « Le décor des sols dans lesbâtiments publics en Grèce du IIe siècle av. J.-C. au Ier siècleapr. J.-C. », dans J.-Y. Marc et J.-Ch. Moretti éd., Construc-tions publiques et programmes édilitaires en Grèce entre leIIe siècle av. J.-C. et le Ier siècle apr. J.-C. (BCH, Suppl. 39),Athènes, 2001, p. 41-59.
6. Les orthostates en marbre coloré semblent avoir subile même sort, car seul un petit nombre de fragments a étéretrouvé. Ces observations viennent appuyer l’hypothèse
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
En résumé, nous pouvons affirmer que notre base a été réutilisée comme partie du dal-lage de la pièce principale du Sébasteion. Comme l’on ne sait pas si le dallage du temple a subides réparations ou des remaniements, le contexte archéologique dans lequel la base a étédécouverte ne peut contribuer de manière décisive à sa datation.
2. LES INSCRIPTIONS
LE TEXTE DES INSCRIPTIONS7
La face antérieure de la base comporte deux inscriptions complètes, séparées par unintervalle de 6,5 cm (fig. 8). Chaque inscription est gravée d’un côté du champ épigraphique,au-dessous des trous de scellement d’une des deux statues (fig. 7). L’identité des personnageshonorés est ainsi révélée par chacune des inscriptions. Par convention, nous donnons àl’inscription de gauche la lettre A et à l’inscription de droite la lettre B.
234 Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
d’une destruction liée à un acte iconoclaste chrétien : sil’on avait simplement voulu récupérer du matériel pour leréutiliser ou pour produire de la chaux, les fragments destatues que nous avons trouvés n’auraient certainement paséchappé au remploi. En revanche, les dalles en marbre dusol ainsi que les orthostates devraient en principe avoiréchappé à la rage des iconoclastes. Ils pourraient ainsi avoirété réutilisés pour construire une église paléochrétienne,
dont on soupçonne l’existence à Érétrie depuis quelquesannées.
7. Pour l’état des recherches sur l’épigraphie érétrienne,voir D. Knoepfler, « L’épigraphie de la Grèce centro-méridionale (Eubée, Béotie, Phocide et pays voisins, Del-phes), Publications récentes, documents inédits, travaux encours », dans XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca eLatina, Atti, I, Rome, 1999, p. 233-236.
6. Érétrie, stratigraphie principale dans le Sébasteion. Dessin C. Huguenot, S. G. Schmid, ESAG.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d’Érétrie 235
7. Érétrie, base avec dédicaces à la triade artémisiaque,vue générale de la face supérieure. Cl. S. G. Schmid, ESAG.
8. Érétrie, base avec dédicaces à la triade artémisiaque,vue générale de la face antérieure avec les inscriptions. Cl. S. G. Schmid, ESAG.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
Inscription A (fig. 9)
Inscription de cinq lignes. Hauteur des lettres : 1,5-2,1 (l. 1) ; 1,5-2,3 (l. 2) ; 1,6-2,4(l. 3) ; 1,7-2,1 (l. 4) ; 1,6-2,1 cm (l. 5). Interligne moyen : 0,5 cm.
E£aBnetoV PuqBwnoVkaa "gaqpkleia ZwpArou
tqn udqn kaa Z°puroV E£ain@tou tqn 3-4 delfqn PuqBwna E£ain@tou
"rt@midi "ppllwni Lhtob.
Euainétos, fils de Pythiôn, et Agathokléia, fille de Zôpyros (ont dédié cette statue de) leur fils etZôpyros, fils d’Euainétos (cette statue de) son frère Pythiôn, fils d’Euainétos, à Artémis, à Apollon, àLêtô.
Inscription B (fig. 10)
Inscription de quatre lignes. Hauteur des lettres : 1,9-2,4 (l. 1) ; 1,7-2,0 (l. 2) ; 1,6-2,1(l. 3) ; 1,7-2,1 cm (l. 4). Interligne moyen : 0,3 (l. 1-2) ; 0,5 cm (l. 2-3, 3-4).
Z!puroV E£ain@touvac. tqn pat@ra vac.E£aBneton PuqBwnoV
4 "rt@midi "ppllwni Lhtob.
Zôpyros, fils d’Euainétos (a dédié cette statue de) son père Euainétos, fils de Pythiôn, à Artémis,à Apollon, à Lêtô.
OBSERVATIONS SUR LA FACTURE DES INSCRIPTIONS
La base inscrite donne à première vue l’impression de former un tout homogène et bienéquilibré. À y regarder de plus près, on observe cependant que la facture des inscriptions estpeu soignée. La gravure des lettres aussi bien que la disposition du texte dans le champ épigra-phique sont en effet maladroites. De plus, le lapicide a manifestement gravé le texte sans avoirtracé les lettres au préalable et sans s’être aidé de lignes de réglage horizontales. On observedonc de nombreuses imperfections dans la facture des inscriptions. En voici la liste :
1 - La gravure des lettres, qui est pourtant profonde, est tout à fait irrégulière. La hau-teur et la largeur des lettres varient en effet à l’intérieur d’une même ligne, pratiquement delettre à lettre. Par ailleurs, les lettres rondes ou arrondies (thêta, omikron, boucle de l’ôméga)n’ont pas un diamètre constant. Quant aux traits horizontaux, verticaux et obliques, quoiqued’aspect rectiligne, ils ne sont pas parfaitement droits. On ne remarque cependant aucunedivergence de style dans l’écriture des deux inscriptions, ce qui nous conduit à conclure que lamême main a gravé l’inscription A et l’inscription B.
236 Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
2 - La disposition des deux textes sur la pierre n’a pas fait l’objet d’une attention particu-lière. Le lapicide a simplement veillé à ce que chacune des inscriptions tienne dans un espacepresque équivalent, large d’environ 45 cm, afin que chaque texte soit gravé sous la statue àlaquelle il correspond8. L’inscription B comporte cependant une ligne de moins quel’inscription A et contient moins de lettres par ligne. En outre, les intervalles entre les lettres,elles-mêmes plus larges, y sont plus grands que pour l’inscription A.
Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d’Érétrie 237
8. La longueur des l. 1, 2, 4 et 5 de l’inscription A estcomprise entre 42 et 46 cm. La longueur des l. 1, 3 et 4 del’inscription B est comprise entre 44 et 49 cm.
9. Érétrie, base avec dédicaces à la triade artémisiaque, inscription A. Cl. S. G. Schmid, ESAG.
10. Érétrie, base avec dédicaces à la triade artémisiaque, inscription B. Cl. S. G. Schmid, ESAG.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
3 - Dans l’une et l’autre inscription, le texte n’est aligné qu’à gauche, et encore cet ali-gnement n’est-il pas constant. Dans l’inscription A (fig. 9), la l. 3 compte trois lettres à gaucheet quatre lettres à droite qui dépassent d’environ 8,5 cm de chaque côté la marge donnée parl’alignement moyen des autres lignes. Cette symétrie approximative a impliqué que l’on écrivele mot A|DELFON à cheval sur deux lignes (l. 3-4). Dans l’inscription B (fig. 10), la l. 2, quine possède que neuf lettres, a été décalée sur la droite par rapport à la marge de gauche, maiselle n’est pas centrée pour autant. Ces artifices de symétrie devaient avoir pour but un effetd’esthétique dans la disposition des textes. La façon dont ils ont été réalisés montre néanmoinsque le lapicide n’avait guère étudié sa composition à l’avance. Ce n’est que lors de la gravureque le lapicide a tenté des adaptations visant à des effets de symétrie. Cette faiblesse est parti-culièrement visible dans l’inscription B : les dernières lettres du nom EUAINETOU (l. 1) etdu mot PATERA (l. 2) sont beaucoup plus espacées que les premières, manifestement dansle but de remplir le vide de la fin de la ligne.
4 - Dans l’inscription A, les dernières lettres des l. 1 à 3 sont situées plusieurs millimètresau-dessous du niveau des premières. Les l. 4 et 5, quant à elles, ne sont pas droites, mais décri-vent une courbe. L’inscription B, qui ne comporte que quatre lignes, a été grossièrementalignée sur le texte des quatre premières lignes de l’inscription A, comme le montre l’espacevierge laissé sous le texte. L’inscription B a donc été gravée à la suite de l’inscription A.
5 - On note enfin deux erreurs de gravure, corrigées par le lapicide, mais dont la pierre porteencore les traces. Dans l’inscription A (fig. 9), les deux lambda du mot APOLLWNI (l. 5) sontgravés nettement en dessous du niveau des autres lettres. On distingue encore sur la pierre lespremiers coups de ciseau du lapicide, qui amorcent des hastes verticales. S’étant aperçu de sonerreur, le lapicide a ensuite superposé sur ces hastes les deux lambda, en les décalant vers le bas.Dans l’inscription B, au début de la l. 4 (fig. 10), le rhô d’ARTEMIDI porte le signe d’une cor-rection. Le lapicide avait d’abord gravé une barre horizontale au sommet de la ligne pour écrireun gamma, un tau ou, plus probablement, un pi (P). Dans le but de masquer son erreur, il a insé-ré la partie supérieure, plate, de la boucle du rhô (R) dans la barre horizontale qu’il avait tracée,puis inscrit la barre horizontale du tau (T) suivant dans le prolongement de cette dernière9.
DATATION DES INSCRIPTIONS
La forme des lettres, pourvues d’apices bien marqués à l’extrémité des traits rectilignes,est caractéristique de la basse époque hellénistique. Plusieurs éléments paléographiques suggè-rent une datation après le milieu du IIe s. av. J.-C. : la barre brisée de l’alpha, la barre horizon-tale et courte inscrite du thêta, les jambages parallèles et symétriques du mu, du nu et, surtout,du pi, les branches supérieure et inférieure parallèles du sigma.
238 Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
9. Il ne faut pas attacher trop d’importance à ce détailpaléographique, ni en déduire nécessairement que le lapi-cide allait graver APOLLWNI au lieu d’ARTEMIDI (defait, il a commencé à graver AP au lieu de AR, avant decorriger son erreur). Nous ne tiendrons pas compte de
cette erreur dans notre discussion portant sur l’ordre danslequel apparaissent les membres de la triade apollinienneou artémisiaque en ville d’Érétrie et à Amarynthos (voir ci-dessous p. 241-245).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
L’écriture de notre inscription est plus tardive que l’écriture d’une autre inscriptionhonorifique érétrienne hellénistique, l’inscription de l’association des Amphiastes honorantAmphias, fils d’Aristodémos, découverte en remploi dans la Maison Est du Quartier de laMaison aux mosaïques : tout en présentant des traits typiques de la basse époque hellénistique(tels que les apices, l’alpha à barre brisée et le sigma à branches parallèles), l’inscription desAmphiastes comporte pourtant encore le pi à second jambage raccourci et, pour cette raison,elle a été datée du milieu du IIe s. av. J.-C.10. Notons que la gravure de cette base est beaucoupplus soignée que celle de la nôtre.
Notre inscription ne présente pas la forme raffinée des lettres que l’on rencontre dans lesinscriptions érétriennes de la fin du Ier s. av. J.-C. et de l’époque impériale romaine, comme dansl’inscription honorant Kléonikos, fils de Lysandros, personnage que l’on reconnaît générale-ment dans la statue dite de l’ « éphèbe d’Érétrie » (IG, XII 9,281)11. Une écriture comparable àcelle de notre inscription serait à chercher, par exemple, dans plusieurs dédicaces aux dieuxégyptiens provenant de l’Iseion et datées de la fin du IIe s. ou du Ier s. av. J.-C.12 ainsi que dans ledécret de la cité d’Érétrie honorant l’évergète Théopompos, daté d’environ 100 av. J.-C.13.
Par conséquent, une datation oscillant entre l’extrême fin du IIe s. et les premières décen-nies du Ier s. av. J.-C. paraît convenir à notre double inscription.
LA DOUBLE INSCRIPTION HONORIFIQUE D’UNE FAMILLE ÉRÉTRIENNE14
Les inscriptions A et B font connaître quatre membres d’une même famille. Son origineérétrienne découle de l’absence d’ethnique15. Le stemma se reconstitue comme suit :
(Pythiôn)
Euainétos, fils de Pythiôn ∞
Pythiôn, fils d’Euainétos
(Zôpyros)
Agathokléia, fille de Zôpyros
Zôpyros, fils d’Euainétos
Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d’Érétrie 239
10. P. Ducrey, « Les inscriptions », dans Id., I. R. Metz-ger et K. Reber, Eretria, VIII, Le Quartier de la Maison auxmosaïques, Lausanne, 1993, p. 146-147 et fig. 294 (SEG,43, 1993, 592).
11. Republiée par Fittschen, 1995. L’auteur datel’inscription d’environ 100 av. J.-C. Le raffinement de laforme des lettres, comme le trait horizontal de l’epsilon etdu thêta détaché des traits verticaux, invite à abaisser la da-tation à la fin du Ier s. av. J.-C., voire au début du Ier s.apr. J.-C. Cet argument paléographique semble confirmerla thèse de Lehmann, 2001, qui conteste la réunion de lastatue de l’ « éphèbe d’Érétrie » (stylistiquement databled’env. 100 av. J.-C.) et du pilier inscrit IG, XII 9,281 = IG,II2,3924 (voir ci-dessous p. 248-250). Pour sa part,E. Mango, Eretria, XIII, Das Gymnasion, Gollion, 2003,p. 111-115, abaisse la datation de la statue à l’époque au-gustéenne et soutient l’appartenance de l’inscription deKléonikos à la sculpture. Pour la paléographie des stèles fu-néraires érétriennes d’époque impériale, voir Schmid,1999, p. 286-288 et fig. 14-18.
12. IG, XII 9, Suppl. 567 (Bruneau, 1975, p. 75-76,no IV et pl. XXX, 1) ; IG, XII 9, Suppl. 566 (Bruneau,1975, p. 78-79, no VII et pl. XXXI, 2) ; V. Ch. Petrakos,Arch. Delt., 23, 1968, A′, p. 100, no 2 (Bruneau, 1975,p. 91-93, no XIV et pl. XXXIV, 2).
13. Ce décret est connu en deux exemplaires : la copiedu gymnase, en ville d’Érétrie (IG, XII 9,236 ; voirD. Knoepfler, L. Mummius Achaicus et les cités du golfeeuboïque : à propos d’une nouvelle inscription d’Érétrie,Mus. Helv., 48, 1991, p. 253 et n. 7), et la copie affichée ausanctuaire d’Artémis à Amarynthos, découverte à Katô Va-thia (IG, XII 9, Suppl. 553). Voir Knoepfler, 1988, p. 406-407 et fig. 9-11.
14. L’examen onomastique s’appuie sur les listes éta-blies dans les différents volumes du LGPN.
15. La provenance érétrienne de la base est certaine,que l’emplacement originel de la base ait été la ville mêmed’Érétrie ou son territoire. Voir ci-dessous p. 256-257.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
Aucun des membres de cette famille ne peut être identifié de manière sûre avec un per-sonnage déjà connu dans la prosopographie érétrienne.
Agathokléia : le nom Agathokléia ("gaqpkleia), peu répandu par rapport au masculincorrespondant Agathoklès ("gaqoklRV)16, apparaît deux fois à Érétrie même durant la hauteépoque hellénistique sous la forme BAgaqokl@a17.
Euainétos : le nom Euainétos (E£aBnetoV) est également peu répandu18. On endénombre néanmoins deux occurrences en Eubée : la première à Érétrie même, où unEuainétos, du dème de Péraia, apparaît dans un catalogue civique19, la seconde à Carystos20.
Zôpyros21 : le nom Zôpyros (Z!puroV) est, quant à lui, très fréquent22, partout bienreprésenté, mais particulièrement en Sicile, en Illyrie, à Kos, en Béotie et en Eubée même.Hormis quatre attestations à Chalcis23, le reste des occurrences eubéennes s’observe à Érétrie,exclusivement à l’époque hellénistique24. Le nom Zôpyros étant courant à Érétrie à cetteépoque, il n’est pas nécessaire de supposer de lien familial entre les Zôpyros déjà connus et lesZôpyros de notre inscription (le père d’Agathokléia et le fils de celle-ci et d’Euainétos).
Pythiôn : le nom Pythiôn (PuqBwn) fait partie des nombreux noms personnels dérivés del’épiclèse d’Apollon (Apollon Pythien). Même s’il est fréquent, il est tout de même moins courantque d’autres dérivés, comme PuqpdwroV par exemple. Le nom Pythiôn se rencontre de manièreremarquablement fréquente à Thasos, à toutes les époques, depuis le Ve s. av. J.-C.25. Pourl’Eubée, on note un Pythiôn à Chalcis26 et quatre à Érétrie, dont trois du dème de Grynchai27.
240 Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
16. 13 attestations d’"gaqpkleia (y compris sous laforme "gaqpklea et "gaqpklia) sont recensées enAttique contre 183 d’"gaqoklRV. Le total des attestationsdu nom "gaqpkleia dans les volumes du LGPN s’élèveà 52.
17. Ch. Dunant, « Stèles funéraires », dans Eretria, VI,Berne, 1978, p. 28, no 2 et pl. 3 (fin du IVe ou début duIIIe s. av. J.-C. Avec la lecture retenue par D. Knoepflerdans LGPN, I, s.v. « BAgaqokl@a (2) », p. 3) ; ibid., p. 45,no 111 et pl. 22 (IIIe s. av. J.-C.).
18. Le total des attestations du nom E£aBnetoV relevéesdans les volumes du LGPN s’élève à 54. Ajouter SEG, 48,1998, 865 (Thasos). Euainétos est aussi le nom d’un célèbregraveur de coins monétaires siciliens du Ve s. av. J.-C. ;cf. A. Mlasowsky, DNP, 4, 1998, col. 203, s.v. « Euainetos ».
19. IG, XII 9,246 A, 6 (IIIe s. av. J.-C.). Voir aussi lanouvelle lecture du catalogue éphébique d’Érétrie IG, XII9, Suppl. 555, 52 (IIIe s. av. J.-C.) : [E£]aBn[etoV] au lieude [E£]alke[Bdh]V (cf. SEG, 36, 1986, 799, l. 52).
20. IG, XII 9,8, 1 (IIe s. av. J.-C.).21. Le nom Z!puroV signifie « celui qui ranime le feu,
qui enflamme » ; voir W. Pape et G. E. Benseler, Wörter-buch der griechischen Eigennamen, I, Braunschweig, 18703,s.v., p. 449. K. Ziegler, RE, X A (1972), s.v. « Zopyros »,col. 765, l. 15 sq., estime qu’il s’agit là d’une étymologietraditionnelle (zw-, vivant, et p¢r, le feu) et que Z!puroVn’est en réalité qu’un emprunt grec à l’onomastique perse.Cependant, P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de lalangue grecque, Paris, 19992, s.v. « z!w », p. 403 et s.v.« p¢r », p. 957, certifie l’étymologie grecque du verbe zw-pur@w, « ranimer des braises », et de l’anthroponymeZ!puroV qui en dérive.
22. Le total des attestations du nom Z!puroV relevéesdans les volumes du LGPN s’élève à 489. On compte181 occurrences en Attique à toutes les époques.
23. IG, XII 9,919 d, 1 (époque hellénistique : le père etle fils s’appellent Z!puroV) ; IG, VII,388 (IIe s. av. J.-C. :décret de la cité d’Oropos faisant d’un citoyen de Chalcisson proxène) ; IG, XII 9,1147 (époque impériale).
24. Époque hellénistique : IG, XII 9,170 = 622 (cf. IG,XII 9, Suppl., p. 188) ; IG, XII 9,876 ; IG, XII 9,Suppl. 569 (Bruneau, 1975, p. 90, no XII). IIIe s. av. J.-C. :IG, XII 9,245 B, 133. IIe s. av. J.-C. : IG, XII 9,239, 21 ;V. Ch. Petrakos, Arch. Delt., 23, 1968, A′, p. 108, no 56. IIe
ou Ier s. av. J.-C. : IG, XII 9,262. Ier s. av. J.-C. : IG, XII 9,Suppl. 557, 16 et 82 (Bruneau, 1975, p. 79-84, no VIII, 16et 82) ; SEG, 27, 1977, 593 (le père et le fils s’appellentZ!puroV).
25. On relève 51 occurrences thasiennes. Une part ap-préciable de ces attestations est fournie par les timbresamphoriques ; cf. Y. Garlan, Les timbres amphoriques deThasos, I, Timbres protothasiens et thasiens anciens, Athè-nes / Paris, 1999, p. 275. La présence d’un sanctuaired’Apollon Pythien à Thasos est certainement responsablede la floraison de ce nom, qui est en revanche peu répan-du à Athènes (19 attestations). Le total des attestations dunom PuqBwn relevées dans les volumes du LGPN s’élèveà 140.
26. É. Bourguet, FD III 5, 93 II, 5 ; J. Bousquet, CID II,122 II, 5 (naope à Delphes en 274/3 av. J.-C.).
27. IG, XII 9,246 A, 161 (IIIe s. av. J.-C. : PuqBwn pèred’un Puq@aV) ; 184 ; ibid., 246 B, 44 (PuqBwn père d’unPuqpkritoV) ; V. Ch. Petrakos, Arch. Delt., 23, 1968, A′,p. 108, no 57 (IIIe s. av. J.-C.).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
La famille de notables locaux érétriens apparaissant dans cette inscription est suffisam-ment aisée pour offrir une statue et l’inscription honorifique qui l’accompagne à deux de sesmembres. Dans l’inscription A, Euainétos et son épouse Agathokléia ainsi que Zôpyros, un deleurs fils, honorent Pythiôn, le frère de ce dernier. Dans l’inscription B, c’est Zôpyros seul quihonore son père, Euainétos.
Chacun des deux fils d’Euainétos et d’Agathokléia a reçu le nom d’un des deux grands-pères : Pythiôn porte le nom de son grand-père paternel, ce qui fait probablement de lui l’aînédes deux frères, et Zôpyros le nom de son grand-père maternel. Si Pythiôn est effectivementl’aîné, son absence dans l’inscription honorant le père des deux frères est d’autant plus éton-nante (inscription B). Pourquoi seul le cadet des deux frères aurait-il entrepris d’honorer leurpère ? Une explication consisterait à imaginer que Pythiôn, le fils aîné, est décédé. Dansl’inscription A, le reste de sa famille, ses parents et son frère cadet, lui rend hommage en hono-rant sa mémoire. Dans l’inscription B, Zôpyros, le fils restant, remplit ses devoirs de piétéfiliale envers son père. Comme l’a montré l’analyse de l’écriture et de la disposition del’inscription sur la pierre, les deux inscriptions sont contemporaines, c’est-à-dire que les deuxstatues ont été érigées simultanément, peut-être à l’occasion de la mort du fils aîné de lafamille, si l’on retient l’hypothèse émise ci-dessus.
Le texte A et le texte B sont tous deux des inscriptions honorifiques privées. Ils possè-dent une caractéristique supplémentaire, puisque l’un et l’autre se terminent par une dédicaceà la triade artémisiaque, Artémis, Apollon et Lêtô. Cette manière de faire permet d’honorerdes mortels par une statue tout en consacrant le monument à la divinité. Les dédicants s’enremettent ainsi à la protection et à la bienveillance divines28. Cette pratique est courante dansles sanctuaires29.
LES INSCRIPTIONS HONORIFIQUES ÉRÉTRIENNES CONSACRÉES À LA TRIADE ARTÉMISIAQUE
Notre double dédicace trouve plusieurs parallèles dans l’épigraphie érétrienne. Elle peutêtre rapprochée d’un lot de neuf inscriptions honorifiques de type identique30. Gravées sur desbases de statues, ces inscriptions se terminent toutes par une dédicace à la triade artémisiaque("rt@midi "ppllwni Lhtob). Quatre d’entre elles sont des inscriptions honorifiques publi-ques, offertes à titre officiel par la cité d’Érétrie (t dRmoV t²n BEretri@wn) à ses évergètes avecla base et la statue qui les accompagnaient31. Les cinq autres sont des inscriptions honorifiquesprivées et familiales, composées comme notre inscription32. Notons que parmi ces dernières, la
Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d’Érétrie 241
28. Pour un procédé identique à Érétrie, voir l’inscrip-tion des Amphiastes honorant Amphias qui est consacrée àAsclépios et à Hygie (voir ci-dessus n. 10) : Tq koinqnt²n | "mfiast²n | "mfBan | "ristodPmou | "sklhpi²ikaa bUgieBai.
29. Pour des parallèles à Delphes, Épidaure et Olympie,cf. FD III 4 / 2, nos 245 sq. ; IG, IV2 1,208 sq. ; Olympia 5,nos 294, 301 sq.
30. IG, XII 9,97-99 ; 140-142 ; 276-278. Voirl’appendice en fin d’article.
31. IG, XII 9,99 ; 276-278 (avec la formule récurrente :3retRV Gneken kaa e£noBaV tRV ecV Dautqn).
32. IG, XII 9,97-98 ; 140-142. La formule est invaria-blement la même dans ces inscriptions : nom du ou des dé-dicants au nominatif, expression du lien de parenté entre lapersonne honorée et le(s) dédicant(s), nom de la personne
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
base inscrite IG, XII 9,142 est aussi une double inscription honorifique familiale33. La data-tion de toutes ces inscriptions se situe entre la première moitié du IIe s. et le début du Ier s.av. J.-C.34.
Dans son enquête sur la localisation du sanctuaire d’Artémis Amarysia, situé dans le ter-ritoire d’Érétrie à l’Est de la cité, D. Knoepfler a montré que ces neuf dédicaces étaient expo-sées à l’origine dans ce sanctuaire. L’Artémision d’Amarynthos servait en effet de lieud’affichage, d’épiphanestatos topos, des décrets de la cité d’Érétrie et des dédicaces de sa popu-lation, en concurrence avec le sanctuaire intra muros d’Apollon Daphnéphoros35. La démons-tration s’appuie sur deux arguments, que nous résumons ici.
Le premier argument est une preuve a contrario. Il concerne l’ordre dans lequel sontcitées les trois divinités de la triade. D. Knoepfler a observé que lorsqu’il est fait référence à latriade composée de Lêtô et de ses deux enfants divins à l’intérieur du périmètre urbaind’Érétrie, c’est toujours Apollon, le dieu principal intra muros, qui est invoqué en premier36. Cephénomène se remarque d’une part sur les bornes inscrites des chapelles ou des petits sanc-tuaires consacrés à la triade à Érétrie même37, d’autre part dans les serments que prêtent lesÉrétriens. Or ces serments sont transcrits sur des stèles exposées dans l’enceinte du sanctuaired’Apollon Daphnéphoros38. C’est donc la triade apollinienne dans l’ordre Apollon, Lêtô etArtémis, qui prévaut en ville d’Érétrie.
Dans les neuf dédicaces qui nous intéressent plus particulièrement, en revanche, Apol-lon cède le pas à sa sœur, ce qui ne serait par conséquent possible que dans un sanctuaired’Artémis, en l’occurrence à l’Artémision d’Amarynthos. D’ailleurs, les représentations figu-
242 Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
honorée à l’accusatif, triade artémisiaque au datif. Il faut àchaque fois sous-entendre le verbe 3n@qhken. D. Knoepflernous signale que l’inscription IG, XII 9,144, provenant dela colline de Paléoekklisiès, faisait également partie d’unmonument familial très certainement dédié à la triade arté-misiaque, mais de forme curviligne ; il republiera ce blocqu’il a redécouvert.
33. L’inscription IG, XII 9,143 (Lhtob "rt@midiBAppllwni) a fait croire à l’existence d’une dédicace à latriade dans l’ordre Lêtô, Artémis et Apollon, alors qu’ils’agit en réalité de la copie partielle de la dernière ligne dela double inscription IG, XII 9,142, qui comporte deuxconsécrations distinctes à la triade artémisiaque qu’il neconvient pas d’attacher l’une à l’autre : ["rt@midi"pp]llwni Lhtob vac. "rt@midi "ppllwni Lhtob (à cepropos, voir la mise au point de Knoepfler, 1988, p. 413 etn. 123). Seule la dédicace de droite de IG, XII 9,142 estcomplète : Démokrité, fille de Kallistratès, est honorée parson mari Ôrôpiadès, fils de Biottos, et par leur fils Biottos.La dédicace de gauche, mutilée, laisse encore voir deuxliens de parenté (l. 1 : [t]Qn mht@ra ; l. 2 : tQn tPqhn) etun génitif patronymique (l. 3 : Bipttou). On imagine quele père mentionné dans la dédicace de droite, Ôrôpiadès,fils de Biottos, a honoré dans la dédicace de gauche samère, soit sa grand-mère pour son fils Biottos, le seconddédicant. Dans ce cas, cette femme serait elle aussi filled’un Biottos, qui est le nom de son mari.
34. Cette datation, s’appuyant sur la paléographie, pro-
vient d’un examen des pierres pour IG, XII 9,141 et 276-278. Pour les autres inscriptions, non retrouvées, nousnous fions aux indications et aux fac-similés donnés parE. Ziebarth dans les IG.
35. On affichait à l’Artémision d’Amarynthos un exem-plaire des décrets promulgués par la cité d’Érétrie et les trai-tés passés par cette dernière avec une autre cité. La loi sacréedes Artémisia (IG, XII 9,189 ; mais voir Knoepfler, 2001a,p. 140, n. 211) et la loi contre la tyrannie (Knoepfler, 2001cet 2002) y étaient aussi exposées ; voir Knoepfler, 2001c,p. 199 ; 2002, p. 191-192. Les décrets de proxénie et de ci-toyenneté étaient pour leur part affichés en principe au sanc-tuaire d’Apollon Daphnéphoros ; cf. Knoepfler, 1988,p. 383-385 (avec désormais les nuances du même auteur :Knoepfler, 2001c, p. 141).
36. Knoepfler, 1988, p. 411-413.37. IG, XII 9,266-267.38. IG, XII 9,191 A, l. 48 et 54 (contrat passé entre
Chairéphanès et la cité d’Érétrie pour le drainage de l’étangde Ptéchai, vers 318-315 av. J.-C. ; cf. Knoepfler, 2001b,p. 57-59) ; D. Knoepfler, « Une paix de cent ans et un con-flit en permanence : étude sur les relations diplomatiquesd’Athènes avec Érétrie et les autres cités de l’Eubée auIVe siècle av. J.-C. », dans Ed. Frézouls et A. Jacquemin éd.,Les relations internationales, Strasbourg, 1995, p. 362-364,l. 10-11 (fragment d’un traité entre Érétrie et Athènes,IVe s. av. J.-C. : SEG, 45, 1995, 1218 ; le passage en ques-tion est toutefois largement restitué).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
rées de la triade respectent également cette hiérarchie déterminée par le lieu d’exposition.Ainsi, sur la stèle du contrat de Chairéphanès avec la cité d’Érétrie pour le drainage de l’étangde Ptéchai (IG, XII 9,191), qui est ornée d’un relief fragmentaire, la triade – comme il a étérécemment mis en lumière – devait être conduite par Apollon, suivi d’Artémis puis de Lêtô.En effet, la stèle était exposée à l’origine à Érétrie, dans le sanctuaire d’Apollon Daphnépho-ros39. À l’inverse, sur un relief du IVe s. av. J.-C. trouvé à Katô Vathia, autrement dit dans lesenvirons de l’emplacement présumé de l’Artémision d’Amarynthos, c’est Artémis qui se pré-sente la première au mortel, suivie de Lêtô et d’Apollon : la prééminence artémisiaque à Ama-rynthos s’en trouve confirmée40.
Le second argument s’attache à la provenance des pierres. Les lieux de remploi de lamajorité des neuf dédicaces se concentrent dans la plaine du Sarandapotamos, à l’Est du vil-lage moderne d’Amarynthos (Katô Vathia), à une dizaine de kilomètres d’Érétrie (voir appen-dice et fig. 11), dans un cercle dont le centre se trouverait dans la plaine aux alentours de lachapelle d’Agia Kyriaki, emplacement présumé du sanctuaire d’Artémis Amarysia41. Cespierres auraient donc été prélevées de l’Artémision d’Amarynthos42.
Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d’Érétrie 243
39. Knoepfler, 2001b, p. 63-65 (avec une nouvelleidentification de la divinité placée à l’extrémité gauchedu relief).
40. Knoepfler, 1988, p. 409-410 et fig. 12. Cf.L. E. Baumer, Vorbilder und Vorlagen, Studien zu klassi-schen Frauenstatuen und ihrer Verwendung für Reliefs undStatuetten des 5. und 4. Jahrhunderts vor Christus, Berne,1997, p. 131, R 24 avec pl. 29,4.
41. Voir aussi l’inscription fragmentaire IG, XII 9,153, dé-couverte en remploi à Katô Vathia : ARTEM[- - -]. Peut-êtreavons-nous là la mention d’Artémis sur une borne.
42. Sur l’emplacement de l’Artémision d’Amarynthos, voirKnoepfler, 1988, p. 414-418. La thèse de D. Knoepfler a étéconfirmée par la trouvaille d’un dépôt votif révélant des attri-buts artémisiaques (offrandes féminines, objets représentantdes animaux) à Agia Kyriaki ; cf. E. Sapouna-Sakellaraki, Un
11. Carte de répartition des dédicaces à la triade artémisiaque dans les environs présumésde l’Artémision d’Amarynthos, d’après les nos des IG, XII 9. Fond de carte « Eretria 1:50000 (HMGS, 1990) ».
Dessin S. Fachard, Y. Laurent, Th. Theurillat, ESAG.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
La correspondance typologique et chronologique existant entre ces neuf dédicaces etnotre nouvelle inscription est remarquable. Faut-il donc ajouter cette dernière à la « série desdédicaces à la triade artémisiaque, qui forment un tout homogène »43 et ainsi supposer qu’elleétait déposée à l’origine dans l’Artémision d’Amarynthos ? Ou bien peut-on imaginer quecette base était exposée à l’origine dans la ville même d’Érétrie, malgré le fait qu’Artémis soitinvoquée en premier ?
UN ARTÉMISION INTRA MUROS
Si l’on postule que notre base inscrite se trouvait à l’origine à l’intérieur de la villed’Érétrie, où était-elle exposée et comment justifier qu’Artémis ait brusquement usurpé laplace de son frère Apollon, en étant invoquée avant lui dans la dédicace votive ?Comment concilier en effet deux informations apparemment contradictoires : le fait quela base ait été découverte en ville d’Érétrie et le fait qu’elle soit consacrée à la triadeartémisiaque ?
Comme on l’a vu, il est incontestable qu’ « en ville d’Érétrie, c’est Apollon qui a la prio-rité »44, du fait même de l’existence du sanctuaire d’Apollon Daphnéphoros au centre de lacité. Artémis n’en est cependant pas exclue. Il serait par trop hâtif de faire de la ville d’Érétriele domaine exclusif d’Apollon par opposition au sanctuaire d’Amarynthos, propriétéd’Artémis, et de polariser de la sorte la présence et les manifestations des deux divinités. Celaà plus forte raison que les témoignages sur un culte d’Artémis en ville d’Érétrie ne man-quent pas.
Présence indirecte d’abord, à travers les invocations à la triade apollinienne, à laquelleArtémis participe de plein droit, même si elle vient après Apollon, au deuxième ou au troi-sième rang45. Mais également présence directe, dont on note plusieurs traces tangibles. Pre-mièrement, une dédicace à la seule Artémis, découverte probablement en remploi surl’acropole46, ainsi que deux autres dédicaces trouvées en ville d’Érétrie, dont une à Artémis
244 Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
dépôt de temple et le sanctuaire d’Artémis Amarysia enEubée, Kernos, 5, 1992, p. 235-263. D’autres emplace-ments ont été proposés à nouveau ou suggérés récem-ment, mais sans que l’on tienne suffisamment comptedes témoignages épigraphiques et archéologiquesdécouverts dans la plaine du Sarandapotamos ;cf. H..J. Gehrke, Eretria und sein Territorium, Boreas,11, 1988, p. 20-21 et 27-29 (butte de Paléoekklisies-Paléochôria) ; L. A. Tritle, « Strabon, Amarynthos, andthe Temple of Artemis Amarysia », dans J. M. Fosseyéd., Boeotia Antiqua, V, Studies on Boiotian Topography,Cults and Terracottas, Amsterdam, 1995, p. 59-69 (lieu-dit Magoula entre la ville d’Érétrie et le village moderned’Amarynthos). À l’occasion de la publication d’un frag-ment de sculpture d’un monument funéraire de Magou-la, S. G. Schmid, Ein Ungeheuer in Eretria, Mus. Helv.,
55, 1998, p. 193-211, identifie les routes sacrées, ponctuéesde nécropoles, menant d’Érétrie à l’Artémision et confirmel’emplacement suggéré par D. Knoepfler et E. Sapouna-Sakellaraki. La localisation précise du sanctuaire dans la ré-gion d’Amarynthos a fait l’objet, en septembre 2003, d’unenouvelle campagne d’exploration électro-magnétique de lapart de l’ESAG, sous la responsabilité de Pierre Gex, dont lesrésultats seront publiés prochainement.
43. Knoepfler, 1988, p. 411.44. Knoepfler, 1988, p. 413.45. Voir ci-dessus p. 241-243. Noter que, dans le contrat
de Chairéphanès, Artémis est invoquée en troisième positiondans le serment, tandis qu’elle est représentée en deuxièmeposition, avant Lêtô, sur le relief de la stèle.
46. IG, XII 9, Suppl. 561 : NikpstratoV | "rt@midi. Cf.Knoepfler, 1990, p. 120 et n. 34.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
Olympia47, ont suggéré la présence d’un sanctuaire d’Artémis sur les pentes de l’acropole48.Deuxièmement, la provenance érétrienne, et non athénienne, d’une dédicace à Artémis Kolai-nis a été récemment rendue probable49. De plus, une dédicace à Artémis Ilithyie laisse suppo-ser l’existence d’un sanctuaire à cette forme d’Artémis sur l’acropole ou à la palestre, près del’Iseion50. Enfin et surtout, une aire sacrificielle et un dépôt votif de l’époque archaïque, dontles objets révèlent des offrandes essentiellement féminines et font connaître des attributs arté-misiaques, ont récemment été mis au jour au Nord du sanctuaire d’Apollon Daphnéphoros51.Ce sont autant d’éléments concordants qui prouvent qu’Artémis est vénérée aussi en villed’Érétrie, et pas seulement à Amarynthos52.
On en vient même à formuler l’hypothèse qu’un Artémision intra muros ait pu exister,dans la ville basse, à proximité immédiate du sanctuaire d’Apollon Daphnéphoros, voire àl’intérieur même de ce dernier en tant qu’enclos sacré. Il reste maintenant à le découvrir,comme d’ailleurs l’Artémision d’Amarynthos lui-même53. On peut admettre, du fait de leurdécouverte en ville d’Érétrie, que plusieurs décrets érétriens de proxénie mentionnant un Arté-mision comme lieu d’affichage aient été exposés dans cet Artémision urbain plutôt qu’àl’Artémision d’Amarynthos54. En conclusion, et sur la base des éléments qui précèdent, nousestimons que notre base inscrite dédiée à la triade artémisiaque et les statues qui y étaient scel-lées se dressaient à l’origine dans le sanctuaire urbain d’Artémis55.
3. LE TYPE DE LA BASE
La nouvelle base inscrite d’Érétrie mesure 129 × 69 cm sur une hauteur totale de 24 cm(fig. 7-8 et 12). La face antérieure comporte trois parties, soit de bas en haut : une moulure
Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d’Érétrie 245
47. IG, XII 9,260 : CrusallaV SPmiou | BArt@midiBOlumpBai ; IG, XII 9, 261 : [- - -]iV | kaa BE[phkpwi"rt]@midi | e£x0me[n]oi 3n@qhkan.
48. Le sanctuaire de l’acropole appelé Thesmophoreiona d’abord été identifié comme le sanctuaire d’ArtémisOlympia. Voir Knoepfler, 1990, p. 125, n. 60 ; D. Willers,Zwei Thesmophorien in Eretria ?, Mus. Helv., 48, 1991,p. 176-187 (rouvre le débat sur l’identification des sanc-tuaires situés sur les flancs de l’acropole et n’exclut pas unsanctuaire d’Artémis ; voir les réserves de Knoepfler,2001a, p. 140, n. 210).
49. IG, II2,4860 = IG, XII 9,1262 : Kallistr0th |"rt@midi Kole|nBdi CphkpY | e£cPn. Cf. Knoepfler, 1990,
p. 126-127 (cf. SEG, 40, 1990, 1608).50. Knoepfler, 1990, p. 124-126 : ["rt@midi
BIl]eiquei | [- - -] Q@wnoV (SEG, 40, 1990, 762).51. S. Huber, « Une aire sacrificielle proche du sanctuaire
d’Apollon Daphnéphoros à Érétrie, Approches d’un rituelarchaïque », dans R. Hägg éd., Ancient Greek Cult Practicefrom the Archaeological Evidence, Stockholm, 1998, p. 141-155 ; Ead., Eretria, XIV, L’Aire sacrificielle au nord du Sanc-tuaire d’Apollon Daphnéphoros, un rituel des époques géométriqueet archaïque, Gollion, 2003.
52. Sur la place d’Artémis dans le panthéon eubéen etérétrien, voir Knoepfler, 1988, p. 389-391.
53. Pour une proposition d’identification de l’Artémisionintra muros avec des structures archéologiques voisines dusanctuaire d’Apollon Daphnéphoros, voir Cl. Bérard,« Érétrie géométrique et archaïque, Délimitation des espa-ces construits : zones d’habitat et zones religieuses », dansM. Bats et B. d’Agostino éd., Euboica, L’Eubea e la presenzaeuboica in Calcidica e in Occidente, Naples, 1998, p. 152. Onhésite encore entre l’édifice B et l’Aire sacrificielle Nord,tous deux situés au Nord-Est du sanctuaire d’ApollonDaphnéphoros.
54. IG, XII 9,195, l. 11-12 : Cn tZ tRV "rt@midoVde|r²i (cf. Knoepfler, 2001a, no IX, p. 198) ; IG,XII 9,228, l. 7 : [Cn t²i tRV "rt@m]ido[V der²i] (nouvellerestitution de Knoepfler, 2001a, no 9, p. 139-141) ; G.-J.-M.-J. Te Riele, BCH 99 (1975), p. 89-93, l. 18-19 : [Cnt²i tRV "rt@mid]o[V | der²i] (nouvelle hypothèse de resti-tution de Knoepfler, 2001a, no 14, p. 167). Cf. Knoepfler,2001d, p. 1360.
55. Cf. Knoepfler, 2001d, p. 1365, n. 32. S’appuyantsur le parallèle de l’inscription que nous publions ici,Knoepfler, 2001a, p. 141, propose désormais la mêmeorigine pour la base IG, XII 9,278, au vu de son rem-ploi à Chalcis, qui est plus proche d’Érétrie qued’Amarynthos.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
(kyma reversa) haute de 10 cm ; le champ épigraphique, haut de 13 cm ; enfin un bandeau de1 cm. La face supérieure de la base est creusée de quatre trous de scellement, correspondantaux pieds des statues des deux personnages mentionnés dans les inscriptions56. Deux emprein-tes de pieds posés à plat sur la surface de la base, profondes de 3 cm en moyenne, correspon-dent à la statue du père, Euainétos. Les empreintes de la seconde statue, celle du fils, Pythiôn,sont nettement plus petites. Le pied droit ne touchait la surface de la base que de la pointe,comme le suggèrent les dimensions réduites du trou de scellement. Le scellement du piedgauche, en revanche, profond de 3 cm en moyenne, dessine la forme d’un pied complet. Onen déduit que Pythiôn était représenté debout, la jambe gauche tendue, la jambe droite pliée,
246 Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
56. Voir ci-dessous p. 255 sq. pour une discussion del’aspect des deux statues.
12. Érétrie, dessins de la base avec dédicacesà la triade artémisiaque, vues de face et du haut.Dessin C. Huguenot, S. G. Schmid, ESAG.
13. Érétrie, Musée, dessin de la base IG, XII 9,277,vues du haut et de face. Dessin S. G. Schmid, ESAG.
14. Anô Vathia, chapelle de la Panagitsa, dessin de la base IG,XII 9,141, vue de face. Dessin S. G. Schmid, ESAG.
13
14
12
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
dans la position classique du chiasme (contrapposto). Notons que des traces du plomb ayantservi au scellement sont conservées.
En 1902 déjà, H. Bulle observait à propos de la statue dite de l’ « éphèbe d’Érétrie » quele « chapiteau » sur lequel la plinthe est posée correspond à un type dont on trouve plusieursexemples datant pour la plupart de la fin du IIe et du Ier s. av. J.-C.57. Avant de revenir sur lesexemples signalés par le savant allemand, nous mentionnerons quelques autres bases qui peu-vent servir de proches parallèles à la nôtre. Il s’agit des pierres portant les dédicaces à la triadeartémisiaque dont il a été question plus haut58. Des neuf bases inscrites connues jusqu’à cejour, cinq ne sont plus visibles et deux sont très fragmentaires (voir appendice). En revanche,la base IG, XII 9,277 (fig. 13), qui provient de la chapelle d’Agia Trias et qui est conservéedans la cour du Musée d’Érétrie, et la base IG, XII 9,141 (fig. 14), qui sert d’autel dans la cha-pelle de la Panagitsa, sont aisément accessibles. Or ces deux bases sont d’authentiques« jumelles » de la nôtre. La plus petite, celle d’Agia Trias, qui mesure 75 × 68 × 25 cm, pré-sente une partie basse un peu plus profonde et massive, tandis que la plus grande, conservéedans la chapelle de la Panagitsa, est quasiment identique à la nôtre. Bien que la surface de labase de la Panagitsa soit endommagée, ce qui empêche de connaître la position exacte de lastatue de la femme honorée, il est cependant probable qu’il devait s’agir à l’origine d’unestatue en bronze, à l’instar de celle du personnage honoré sur la base IG, XII 9,277 (fig. 13).La position des pieds de cette sculpture était sans doute comparable à celle de la statued’Euainétos sur notre base. On connaît donc une série de trois bases similaires provenanttoutes d’Érétrie ou d’Amarynthos et portant chacune à l’origine des statues de bronze dédiéesà la triade artémisiaque. L’homogénéité de cette série est en outre renforcée par sa datation,car la base IG, XII 9,277 peut être datée par la forme des lettres d’une période de peu anté-rieure à celle de notre inscription, soit du milieu du IIe s. av. J.-C., tandis que la base IG,XII 9,141, toujours d’après l’écriture, paraît contemporaine de la nôtre.
Deux autres pierres provenant d’Érétrie montrent que ce type de base était égalementutilisé pour des statues en marbre. La première (fig. 15)59 a été trouvée non loin de la basedont nous nous occupons. Renversée et posée dans un épais lit de mortier, la base servait, enremploi, comme surface de travail ou comme support pour une colonne de bois (ST 32,fig. 2). Ce remploi remonte à la basse époque hellénistique, comme le montre la couche dedestruction que nous attribuons à la prise d’Érétrie par Sylla, en été 86 av. J.-C., et quirecouvre directement la surface de la base. Cet élément fournit un terminus ante quem pour ladatation de la base elle-même60. La pierre comportait une mortaise large de 60 cm sur unelongueur de 44 cm, pour une profondeur de 6 cm, ce qui suggère qu’elle était destinée à porterune statue de marbre.
Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d’Érétrie 247
57. H. Brunn et F. Bruckmann, Denkmäler griechischerund römischer Sculptur, Fortgeführt und mit erläuternden Textenversehen von Paul Arndt, Munich, 1902, commentaire duno 519 ; cf. Fittschen, 1995, p. 98, n. 2. Pour la base et lastatue, voir maintenant Lehmann, 2001. Cf. I. Schmidt, Hel-lenistische Statuenbasen, Francfort, 1995.
58. Voir ci-dessus p. 241-244.
59. Musée d’Érétrie, no inv. M 1232.
60. Pour la destruction d’Érétrie en 86 av. J.-C. et soncontexte historique, cf. Schmid, 2000. Voir ci-dessousp. 253-255.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
La deuxième base du même type destinée à porter une statue en marbre est celle quel’on a rapprochée de la statue dite de l’ « éphèbe d’Érétrie » (fig. 16-21)61. Récemment, plu-sieurs auteurs ont admis que cette œuvre datait de l’époque hellénistique, probablementde 100 av. J.-C. environ. Leur conclusion s’appuie notamment sur l’analyse stylistique du por-trait du jeune homme62. Or cette interprétation semble à première vue contredite par la data-tion de l’inscription du pilier, que la forme des lettres invite à placer à l’époque augustéenne63.Une solution pourrait avoir été trouvée par S. Lehmann. Ce dernier remet en causel’attribution de la statue à la base et au pilier correspondant64. Une série de photographiesrécemment redécouvertes vient à l’appui de cette opinion (fig. 17-21)65. Ces photographiesmontrent le pilier inscrit et le couronnement avant leur rapprochement et leur réunion avec lastatue. Si l’attribution du couronnement de la base au pilier inscrit, qui avait été proposée en
248 Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
61. Athènes, Musée national, no inv. 244 (statue), autre-fois Musée épigraphique, no inv. 1924 (inscription). Lesauteurs remercient I. Touratsoglou de les avoir autorisés àexécuter le dessin de la fig. 16.
62. Pour les références, cf. Lehmann, 2001, n. 3 sq.63. Voir ci-dessus n. 11.
64. Lehmann, 2001, p. 18 sq.
65. Les photographies des fig. 17-21 ont été redécouver-tes par Caroline Huguenot lors de travaux d’archivage ausiège de l’ESAG à Érétrie. Elles avaient été prises en 1972 auMusée national à la demande de D. Knoepfler.
15. Érétrie, quartier du Sébasteion,dessin d’une base pour une statueen marbre, vues du haut et de face.Dessin S. G. Schmid, ESAG.
16. Athènes, Musée national,dessin de la base
de l’ « éphèbe d’Érétrie », vue de face.Dessin S. G. Schmid, ESAG.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d’Érétrie 249
17. Couronnement de la base de l’ « éphèbe d’Erétrie », vue de face. Cl. archives ESAG.
18. Athènes, Musée épigraphique,no inv. 1924, pilier inscrit de Kléonikos,
vue du haut. Cl. archives ESAG.
19. Athènes, Musée épigraphique,no inv. 1924, pilier inscrit de Kléonikos,
vue de face. Cl. archives ESAG.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
premier lieu par D. Knoepfler, semble certaine66, ces deux éléments formant une base ont sansdoute été déplacés par la suite et réutilisés. En tout état de cause, il n’est pas sûr que la statueque certains ont voulu placer sur la base se dressait bien sur celle-ci à l’origine. Quoi qu’il ensoit, nous pouvons admettre que le couronnement (fig. 17, 20-21) appartient au pilier et qu’ildate de l’époque augustéenne, si l’on en croit l’analyse paléographique de l’inscription. L’écartchronologique que l’on relève par rapport à notre base (fig. 7-10, 12) est en outre confirmé pardes différences dans l’exécution : la moulure est plus accentuée, la partie inférieure plus mas-sive (fig. 17).
Un autre ensemble de bases ou de couronnements de bases très proches de la nôtre pro-vient de l’Amphiareion d’Oropos67. La base érétrienne IG, XII 9,277 (fig. 13) trouve un paral-lèle étroit dans la partie inférieure de la base de la statue de Paula Popilia, femme de Cn. Cal-purnius Piso, dont la statue se dressait juste à côté68. La datation de cette base est à placer auxenvirons de 70 av. J.-C. ou autour de 23 av. J.-C., en fonction de l’identification du Cn. Cal-purnius Piso auquel on relie ces inscriptions69. Une autre base du même type présente des let-tres de forme analogue et doit donc être – à quelques années près – contemporaine de la
250 Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
20. Couronnement de la basede l’ « éphèbe d’Érétrie »,vue du haut. Cl. archives ESAG.
21. Couronnement de la basede l’ « éphèbe d’Érétrie »,
vue du bas. Cl. archives ESAG.
66. Cf. P. Themelis, Praktika, 1978, p. 22 sq.67. Petrakos, 1997 ; C. Löhr, Die Statuenbasen im
Amphiareion von Oropos, AM, 108, 1993, p. 183-212. Lescouronnements de ces bases d’Oropos reposent sur des pi-liers plus anciens qui ont été remployés, mais ont eux-
mêmes été fabriqués en même temps que les statues qu’ilssupportent.
68. Petrakos, 1997, p. 359 sq., no 448, fig. 59.
69. Petrakos, 1997, p. 358.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
nôtre70. Deux bases de statues équestres à Oropos présentent un profil un peu plus accentué etse rapprochent de la base illustrée à la fig. 1371. L’une de ces statues représentait M. VipsaniusAgrippa, ce qui permet de dater le couronnement de la base des années 27 à 12 av. J.-C.72.
Comme nous l’avons indiqué plus haut, H. Bulle ajoutait toute une série de parallèles àla base illustrée aux fig. 17-21, dont la majorité provient d’Olympie. Ces bases acquièrent uneimportance particulière dans notre étude typologique, car plusieurs d’entre elles concernentdes personnages historiques et sont donc datées avec certitude. La plus ancienne, au couron-nement très proche de celui de notre base, fait partie d’un monument comptant plusieurs sta-tues érigées peu après 179 av. J.-C. en l’honneur du magistrat achéen pro-romain Kallikratèsde Léontion73. C’est d’une époque un peu plus récente, autour de 146 av. J.-C., que peut êtredaté un monument portant les statues de L. Mummius Achaicus ainsi que ses dix légats etprésentant également un couronnement similaire74. Par ailleurs, si l’attribution d’une autrebase à C. Marius, datant par conséquent d’environ 100 av. J.-C., est confirmée, nous y trouve-rions encore un autre parallèle contemporain de la base érétrienne75. On trouve encore àOlympie d’autres bases possédant des profils comparables et datant du Ier s. av. J.-C.76, ce quicorrobore notre fourchette chronologique pour l’exécution de ce type de base à Érétrie et àAmarynthos.
Il n’entre pas dans notre propos d’établir un catalogue exhaustif des bases dotées d’unprofil comparable à celui de la nôtre. Nous souhaitons seulement relever quelques exemplescaractéristiques servant à fixer la fourchette chronologique et la distribution géographique del’apparition de ce type de base. Dans cette optique, nous voudrions apporter encore à notredossier quelques exemples provenant pour la majeure partie de Grèce centrale. Ainsi, la basede la statue d’un Tiberius Claudius conservée au Musée épigraphique d’Athènes (fig. 22) per-met de préciser la limite chronologique inférieure de la diffusion de ce type de base77. Pour desraisons aussi bien d’ordre onomastique que paléographique, une datation de cette base àl’époque julio-claudienne s’impose. On remarque aussi que le profil de la moulure est moinsaccentué que pour la plupart des exemples examinés jusqu’ici. De ce point de vue, une baseconservée au Musée de Thèbes (fig. 23) offre un excellent parallèle pour la nouvelle base éré-trienne78. Malheureusement, le contexte archéologique dans lequel elle a été trouvée estinconnu et sa datation reste incertaine faute d’inscription. On trouve d’autres exemples encore
Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d’Érétrie 251
70. Petrakos, 1997, p. 365-367, no 452, fig. 63.71. Petrakos, 1997, p. 370-376, nos 456-457, fig. 65-
66.72. Petrakos, 1997, p. 370 (avec l’argumentation pour
la datation).73. Olympia, 5, p. 423 sq., no 300 ; E. Curtius et
F. Adler éd., Olympia, 2, Berlin, 1896, pl. 94, no 17.74. Olympia, 5, p. 443-448, nos 320-324 ; Curtius et
Adler, op. cit., pl. 94, no 19. À propos des bases érigées enl’honneur de L. Mummius, voir également H. Philipp etW. Koenigs, Zu den Basen des L. Mummius in Olympia,AM, 94, 1979, p. 193-216 ; Eid., « Zu den Basen desL. Mummius in Olympia », dans Nugalia, Werner Philipp
zum siebzigsten Geburtstag, Berlin, 1978, p. 50-78, et, plusgénéralement, Y. Z. Tzifopoulos, Mummius’ Dedicationsat Olympia and Pausanias’ Attitude to the Romans, GRBS,34, 1993, p. 93-100.
75. Olympia, 5, p. 447 sq., no 326 (le profil est cepen-dant un peu moins accentué).
76. Olympia, 5, p. 499 sq., nos 398 et sq.77. Musée épigraphique, no inv. 10320 (IG, II2,3930).
Les auteurs tiennent à exprimer leur gratitude à Ch. Krit-zas, directeur du Musée épigraphique, qui a permis l’étudede cette base.
78. Musée de Thèbes, sans no inv. B. Aravantinos aaimablement autorisé les auteurs à étudier cette base.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
de ce type de base au sanctuaire d’Artémis à Aulis79, à Éleusis et au sanctuaire d’Asclépios àÉpidaure80. La base d’Épidaure provient d’un monument en forme de demi-cercle orné deplusieurs statues. Elle peut être datée d’après la forme des lettres de la fin du IIe s. av. J.-C. Laforme de la moulure est aussi très proche de celle de notre base.
En résumé, le type de base qui nous intéresse semble avoir été assez répandu en Grècecentrale et dans le Péloponnèse à partir de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. et jusqu’à la pre-mière moitié du Ier s. apr. J.-C., avec de petites variations dans la forme de la moulure.
Ces observations ne favorisent pas l’hypothèse de l’existence d’un seul atelier d’où seraitissu ce type de base. Notons cependant qu’une des bases érétriennes dédiées à la triade artémi-siaque peut être attribuée à des sculpteurs connus. À la sixième ligne de l’inscription IG,XII 9,140, autrefois conservée près de Paléoekklisiès et aujourd’hui perdue, on lisait : E¥ceir
252 Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
79. I. Threpsiades, BAnaskafaa Cn A£lBdi, Praktika,1956, p. 102 et sq., pl. 33b. La base est actuellement ex-posée au Musée de Thèbes, no inv. BE 66, et rapprochée dela statue d’une prêtresse d’Artémis (cf. SEG 25 [1971]
542 : la forme des lettres suggère une datation de la base àl’époque augustéenne).
80. IG, IV2 1,218.
23. Thèbes, Musée archéologique,dessin d’une base de statue,
vues du haut et de face.Dessin S. G. Schmid, ESAG.
22. Athènes, Musée épigraphique,dessin de la base IG, II2,3930, no inv. 10320,vues du haut et de face.Dessin S. G. Schmid, ESAG.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
E£boulBdhV "qhnaboi CpoBhsan. La disparition de la pierre empêche de savoir si elle était dumême type que les bases discutées ici. Les deux sculpteurs mentionnés appartiennent à unefamille d’artistes athéniens connue par des signatures sur des bases de statues ainsi que par desmentions dans la littérature antique. Ces deux noms se sont transmis à travers des générationsdu grand-père au petit-fils81. On connaît aux alentours de 150 av. J.-C. plusieurs inscriptionsportant la signature commune d’Eucheir, le père, et d’Euboulidès, le fils82.
Pour notre connaissance d’Érétrie à la basse époque hellénistique, on retiendra surtoutle fait qu’il devait exister dans la cité une élite qui avait non seulement les moyens financiers des’offrir des statues de marbre et de bronze, mais qui pouvait même passer des commandes àdes ateliers de sculpteurs athéniens réputés comme celui d’Eucheir et d’Euboulidès. Onobserve ainsi que même après la prise d’Érétrie par les troupes de L. Quinctius Flamininus etde ses alliés pergaméniens et rhodiens en 198 av. J.-C.83, l’économie érétrienne s’était rétabliede manière appréciable vers 150 av. J.-C. déjà84.
CONSIDÉRATIONS FINALES
L’analyse épigraphique et paléographique des inscriptions gravées sur notre base a per-mis de proposer pour celle-ci une datation à la fin du IIe ou au début du Ier s. av. J.-C.85. Quel-ques réflexions complémentaires sur l’histoire d’Érétrie durant cette période permettront defixer plus précisément la limite inférieure de la datation proposée.
Comme la plupart des villes d’Eubée et de la Grèce centrale, la cité d’Érétrie avait pris partipour le roi du Pont Mithridate VI Eupator contre Rome lors de la première guerre mithrida-tique86. Les conséquences d’un tel choix pour les cités grecques sont bien connues, surtout dansle cas d’Athènes, qui fut prise par les troupes romaines dans la nuit du 1er mars 86 av. J.-C.87.
Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d’Érétrie 253
81. M. Muller-Dufeu, La sculpture grecque, Sources litté-raires et épigraphiques, Paris, 2002, p. 840 sq. ; A. Stewart,Attika, Studies in Athenian Sculpture of the Hellenistic Age,Londres, 1979, p. 157 sq. (tableau) ; G. Cressedi, EAA,III, 1960, p. 512-515, s.v. « Euboulides » et « Eucheir » ;C. Robert, RE, VI, 1909, col. 870-875, s.v. Eubulides ;E. Loewy, Inschriften griechischer Bildhauer, Leipzig, 1885,p. 164-170, nos 222-229 ; J. Overbeck, Die antiken Schrift-quellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen,Leipzig, 1868 (réimpr. Hildesheim, 1959), p. 434 sq.,nos 2235-2244. L’identification des artistes mentionnés surla base IG, XII 9,140 avait déjà été faite par A. Wilhelm,Arch. Eph., 1892, 158.
82. IG, II2,4291-4301.83. Liv., XXXII,16,8 sq. ; XXXIII,34,10 ; Paus.,
VII,8,1 ; Pol., XVIII,45,5 ; 47,10 sq. Cf. C. Brélaz etP. Ducrey, Une grappe de balles de fronde en plomb àÉrétrie, Ant. Kunst, 46, 2003, en part. p. 99-105.
84. Pour la réoccupation de certains bâtiments dans leQuartier de l’Ouest après 198 av. J.-C., voir K. Reber,
« Die Stadt Eretria nach der Eroberung durch LuciusQuinctius Flamininus », dans Actes XIV Congreso Internacio-nal de Arquelogía Clásica, Tarragona, 5-11.9.1993, Tarra-gone, 1994, p. 351 sq.
85. Voir ci-dessus p. 238 sq.
86. App., Mith., 29 ; Memnon, 22,10 (FGr. Hist.,434) ; Plut., Sylla, 11,3 ; Flor., I,40,8.
87. Plut., Sylla, 14,6 ; App., Mith., 38. Pour la datation,voir J. Kromayer, Antike Schlachtfelder in Griechenland,Bausteine zu einer antiken Kriegsgeschichte, II, Berlin, 1907,p. 355 avec n. 2. Pour les événements d’Athènes, voirM. C. Hoff, « Laceratae Athenae : Sulla’s Siege of Athensin 87/6 BC and its Aftermath », dans M. C. Hoff et S. I. Ro-troff éd., The Romanization of Athens, Oxford, 1997, p. 33-51 ; E. Badian, Rome, Athens and Mithridates, AJAH, 1,1976, p. 105-128 ; Chr. Habicht, Zur Geschichte Athensin der Zeit Mithridates’ VI., Chiron, 6, 1976, p. 127-142 ;K. W. Arafat, Pausanias’ Greece, Ancient Artists and RomanRulers, Cambridge, 1996, p. 97-105.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
Depuis un certain temps, on se doutait qu’Érétrie avait pu subir le même sort88, mais ce n’est quedernièrement que des trouvailles archéologiques ont confirmé qu’Érétrie avait été prise par lesRomains durant l’été de l’année 86 av. J.-C.89. Par ailleurs, les vestiges archéologiques aussi bienque les inscriptions postérieures à cet événement semblent manquer à Érétrie pour deux généra-tions au moins. La cité ne recouvre une certaine vitalité qu’au début de l’époque impériale,comme le prouvent les découvertes récentes : nous pensons principalement aux diverses cons-tructions entreprises dans le quartier du Sébasteion90. L’examen des sources littéraires va dans lemême sens, puisque l’on ne trouve à nouveau des mentions d’Érétrie qu’au début de l’époqueimpériale : ainsi Strabon cite Érétrie comme la deuxième ville la plus importante d’Eubée,immédiatement après Chalcis91. On ignore encore si cette prospérité relative d’Érétrie à l’époqueaugustéenne découle directement d’une disposition impériale des environs de 20 av. J.-C.,comme on l’a suggéré récemment92. Entre 21 et 19 av. J.-C., en effet, les relations entre Rome etAthènes connurent quelques tensions. Aussi Auguste décida-t-il de retirer aux Athéniens plu-sieurs de leurs possessions hors de l’Attique, parmi lesquelles Érétrie, si l’on en croit Dion Cas-sius93. Il s’ensuivit probablement pour Érétrie une embellie économique, la cité étant ainsilibérée de l’obligation de verser un tribut aux Athéniens.
Au vu de ce qui précède, le contexte historique général conduit à placer la fabrication denotre base soit avant 86 av. J.-C., soit à partir de l’époque augustéenne. Puisque cette dernièrepériode doit être écartée pour des raisons paléographiques, l’été 86 av. J.-C. peut donc êtreconsidéré comme le terminus ante quem pour l’érection des deux statues. À l’époque hellénis-tique, une statue de bronze coûtait environ 3 000 drachmes, ce qui est une somme importante94.Notre base portait deux statues de bronze érigées simultanément. On en déduit que la familled’Euainétos disposait de moyens considérables. En outre, les frais consentis pour la fabricationde la base interdisent de penser qu’elle aurait pu être réalisée dans une période de difficultés éco-nomiques, comme ce fut le cas durant le demi-siècle faisant suite aux événements de 86 av. J.-C.
Il vaut la peine, dans cette optique, de revenir sur la question de la statue de l’ « éphèbe »trouvée dans le gymnase d’Érétrie95. S’il est exact qu’il faut dissocier la statue du pilier inscrit,on ne disposerait à nouveau que de l’analyse stylistique pour la datation de l’œuvre. Les consé-quences des événements politiques et la situation économique d’Érétrie au Ier s. av. J.-C. tellesque nous venons de les évoquer valent également pour la statue de l’ « éphèbe ». La com-mande et l’exécution – fort coûteuse – d’une statue de cette taille paraissent exclues à uneépoque de récession, voire de crise économique, comme celle des décennies comprisesentre 86 av. J.-C. et l’époque augustéenne. Ce facteur devra être pris en compte à l’avenir pour
254 Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
88. P. Auberson et K. Schefold, Führer durch Eretria,Berne, 1972, p. 37 sq. ; cf. Arch. Delt., 20, 1965, Chron.,p. 280 ; Ant. Kunst, 9, 1966, p. 110.
89. Schmid, 2000.90. Schmid, 1999 ; 2001.91. Strabon, X,1,6-10.92. Schmid, 2001, p. 138.93. DC., LIV,7,2. Pour la datation, voir D. Strauch,
Römische Politik und griechische Tradition, Die Umgestaltung
Nordwest-Griechenlands unter römischer Herrschaft, Munich,1996, p. 79 sq. À ce propos, voir également M. C. Hoff,Civil Disobedience and Unrest in Augustan Athens, Hespe-ria, 58, 1989, p. 267-276.
94. P. C. Bol, Antike Bronzetechnik, Kunst und Handwerkantiker Erzbildner, Munich, 1985, p. 164 ; Stewart, op. cit.ci-dessus n. 81, p. 109.
95. Voir ci-dessus p. 248-250.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
qui voudra dater le portrait de l’ « éphèbe », car le milieu du Ier s. av. J.-C., qui – d’un point devue stylistique – pourrait convenir, ne devrait plus entrer en considération96.
Pour ce qui est de la reconstitution des deux statues de bronze qui se dressaient sur notrebase à l’origine, l’aspect de ces dernières ne peut être imaginé que d’après les trous de scellementdes pieds sur la base. Durant toute l’époque hellénistique, on observe une tendance à puiserdans le réservoir extrêmement riche des types statuaires de l’époque classique pour créer desstatues honorifiques, parfois de manière éclectique, en regroupant des éléments de plusieurs ty-pes en une seule œuvre97. Les trous de scellement des deux statues mettent en évidence les diffé-rences existant entre la statue du père et celle du fils98. Euainétos était un homme adulte, père dedeux fils. La longueur des ouvertures pour l’emplacement des tenons (pied gauche : 23 cm ;pied droit : 25 cm), ainsi que la longueur totale des empreintes réservées aux pieds (environ32 cm pour chaque pied), montrent que la statue d’Euainétos était de taille normale, quoiquegrande, puisqu’elle pouvait atteindre environ 1,80 à 1,90 m. En revanche, Pythiôn dont le tenonservant à fixer le pied gauche de la statue mesure 18 cm de longueur et l’empreinte environ23 cm, n’avait pas encore atteint la taille adulte. La forme courbée et étroite du pied gaucheindique qu’il ne portait pas de chaussures99. Le scellement de plomb très mince servant à fixer lepied droit indique un chiasme fortement accentué100. Si l’on considère le jeune âge de Pythiôn, ilest évident qu’il n’a pu être représenté ni comme militaire, ni comme citoyen. Il convient parconséquent d’imaginer sa statue sous la forme d’un jeune sportif, d’un éphèbe101. Des proto-types classiques comme l’éphèbe Westmacott ou l’éphèbe de Dresde étaient très en vogue àl’époque et ont pu servir de modèle pour la statue de Pythiôn102. On citera, comme caractéris-tiques principales de ce type de statue, la nudité, un chiasme accentué et, d’une manière géné-rale, une représentation idéalisée de la jeunesse. C’est de cette façon que sont représentés lesathlètes de la base de Daochos à Delphes, en particulier le jeune Agélaos103.
D’après les trous de scellement des pieds de la statue d’Euainétos, étroits et courbés, celui-ci
Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d’Érétrie 255
96. Sur les portraits de cette époque en général, voirK. Fittschen, Pathossteigerung und Pathosdämpfung, Be-merkungen zu griechischen und römischen Porträts des 2.und 1. Jahrhunderts v. Chr., AA, 1991, p. 253-270 ;G. Neumann, Ein späthellenistisches Tondo-Bildnis, AM,103, 1988, p. 221-238 ; L. Giuliani, Bildnis und Botschaft,Hermeneutische Untersuchungen zur Bildniskunst der römi-schen Republik, Francfort, 1986 ; G. Hafner, Späthelleni-stische Bildnisplastik, Versuch einer landschaftlichen Gliede-rung, Rome, 1973.
97. Voir par ex. S. Lehmann, Der Thermenherrscherund die Fussspuren der Attaliden, Zur Olympischen Sta-tuenbasis des Q. Caec. Metellus Macedonicus, NürnbergerBlätter zur Archäologie, 13, 1996-97, p. 112 sq.
98. Pour la technique du coulage de plomb pour la fixa-tion de statues en bronze, voir Bol, op. cit. ci-dessus n. 94,p. 109.
99. À ce sujet, cf. Lehmann, op. cit. ci-dessus n. 97,p. 109.
100. Pour le principe du chiasme, voir A. H. Borbein,« Polykleitos », dans O. Palagia et J. J. Pollitt éd., PersonalStyles in Greek Sculptures, YClS, 30, 1996, p. 66-90, surtout
p. 70-74 ; E. Berger, « Zum Kanon des Polyklet », dans Poly-klet, Der Bildhauer der griechischen Klassik, Mayence, 1990,p. 156-184.
101. La dédicace à la triade artémisiaque montre qu’ilne s’agit pas de statues funéraires. Pour la connaissance destypes statuaires, il importe peu de savoir si au moment de ladédicace honorifique, l’un des personnages représentés oumême les deux étaient déjà morts (à ce propos, voir ci-dessus p. 241).
102. A. Linfert, « Aus Anlass neuer Repliken des West-macottschen Epheben und des Dresdner Knaben », dansH. Beck et P. C. Bol éd., Polykletforschungen, Berlin, 1993,p. 141-192 ; G. Hafner, Der Westmacottsche Ephebe, RdA,17, 1993, p. 14-17 ; Lehmann, op. cit. ci-dessus n. 97,p. 119 sq.
103. Ch. M. Edwards, « Lysippos », dans Palagia et Pol-litt, op. cit. ci-dessus n. 100, p. 135 sq. ; T. Dohrn, DieMarmor-Standbilder des Daochos-Weihgeschenks in Delphi(Ant. Plastik, 8), Berlin, 1968, p. 33-53, surtout pl. 17-20 ;K. E. Evans, The Daochos Monument, thèse Princeton (dis-ponible sur microfiches à Ann Arbor, Michigan), 1996,surtout p. 11 sq. Dernièrement, W. Geominy, Zum Dao-
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
était vraisemblablement représenté pieds nus, tout comme son fils104. Contrairement à ce dernier,Euainétos avait les deux pieds posés sur le sol, la jambe gauche légèrement avancée. C’est dansune position similaire que sont figurés par exemple l’ « éphèbe d’Érétrie » ou encore Daochos Ier àDelphes. Pour un homme de son âge, on songe à une représentation en tenue militaire ou en ci-toyen vêtu d’un manteau. Dans les deux cas, les pieds nus sont inhabituels, à moins que l’on songeà une héroïsation, donc à une statue dressée après la mort du personnage représenté105.
La nouvelle dédicace érétrienne témoigne de l’utilisation accrue, à l’époque hellénis-tique, d’un type de monuments à comprendre comme « dédicaces familiales ». Les antécédentsde ce type de dédicace remontent à l’époque archaïque, mais ce n’est qu’à partir de la fin duIVe s. av. J.-C. et surtout à l’époque hellénistique que les dirigeants politiques y ont de plus enplus recours pour leurs besoins de représentation106. Pour l’époque hellénistique tardive, àlaquelle appartient notre base, des recherches détaillées à ce sujet font encore défaut. Parconséquent, la signification des groupes familiaux de cette période est encore peu connue,mais l’adaptation de ce type de monument par la famille d’Euainétos laisse supposer qu’ellecomptait parmi la haute société d’Érétrie.
Un dernier point reste à aborder, celui du lieu d’où provient notre base avant son déplace-ment dans le Sébasteion. Comme l’a montré l’examen des inscriptions dédiées à la triade arté-misiaque, il faut admettre l’existence à Érétrie d’une chapelle artémisiaque intra muros, situéeprobablement non loin du temple d’Apollon Daphnéphoros (cf. fig. 1)107. En outre, les informa-tions archéologiques, épigraphiques et littéraires concernant le sanctuaire d’Apollon Daphné-phoros s’interrompent à la basse époque hellénistique. Il est vraisemblable qu’il faille mettre enrelation ce silence des sources avec le déclin économique provoqué par les destructions sylla-niennes de 86 av. J.-C. évoquées plus haut108. De plus, contrairement au gymnase et à certainesautres parties de la ville où l’on perçoit les traces d’une nouvelle vitalité dans l’habitat et les acti-vités artisanales à partir de l’époque augustéenne109, les informations attestant une continuité del’activité au sanctuaire d’Apollon font défaut. Par ailleurs, des blocs provenant d’un grand bâti-ment, probablement un bâtiment public, ont été remployés pour la construction du temple duculte impérial110. Pour l’heure, il est impossible de savoir avec précision d’où proviennent ces
256 Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
chos-Weihgeschenk, Klio, 80, 1998, p. 369-402, a proposéune datation tardive au début du IIIe s. av. J.-C. du monu-ment delphique ; voir aussi H. v. Steuben, « Zur Komposi-tion des Daochos-Monumentes », dans Id. éd., AntikePorträts, Zum Gedächtnis von Helga von Heintze, Möhnesee,1999, p. 35-38 ; A. Jacquemin, D. Laroche, Le monumentde Daochos ou le trésor des Thessaliens, BCH, 125, 2001,p. 305-332.
104. Les statues en bronze de personnages représentésavec des chaussures laissent habituellement des empreintesnettement plus larges à la surface de la base, comme c’est lecas, par ex., pour la base du Musée de Thèbes (fig. 23).Voir aussi ci-dessus p. 255 avec n. 99.
105. Cf. Lehmann, 2001, p. 21 sq. ; Fittschen, 1995,p. 102. Pour la possibilité qu’au moins une des deux statuesait été érigée post mortem, voir ci-dessus p. 241 etn. 101.
106. C. Löhr, Griechische Familienweihungen, Untersu-
chungen einer Repräsentationsform von ihren Anfängen bis zumEnde des 4. Jhs. v. Chr., Rahden, 2000 ; H. L. Schanz,Greek Sculptural Groups, Archaic and Classical, thèse Har-vard, 1969, p. 14-41 ; B. Hintzen-Bohlen, Die Familien-gruppe, Ein Mittel zur Selbstdarstellung hellenistischerHerrscher, JDAI, 105, 1990, p. 129-154 ; Ead., Herrscher-repräsentation im Hellenismus, Cologne, 1982, en part.p. 197. Pour le monument de Daochos, fondamental pourla genèse de ce type, voir ci-dessus n. 103.
107. Voir ci-dessus p. 244 sq.108. Voir ci-dessus p. 253-255 ; Schmid, 2000.
Cf. Knoepfler, 2001a, p. 326 avec n. 377.109. Schmid, 1999. Pour le gymnase, voir E. Mango,
Ant. Kunst, 37, 1994, p. 100 avec n. 8 ; Ant. Kunst, 38,1995, p. 120 ; Ant. Kunst, 39, 1996, p. 120 avec n. 20 ;A. S. Chankowski, Date et circonstances de l’institution del’éphébie à Érétrie, DHA, 19.1, 1993, p. 17-44.
110. Schmid, 2001, p. 117 sq.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
blocs, mais ils ont nécessairement été arrachés à un bâtiment qui n’était plus en fonction au plustard à l’époque augustéenne. Le même raisonnement peut être allégué pour notre base qui a ser-vi de dalle à l’intérieur du Sébasteion. Il est probable qu’à l’époque impériale, les Érétriens nesont pas allés chercher loin à la ronde les matériaux de construction dont ils avaient besoin. Il estdonc raisonnable de placer le lieu d’exposition primitif de la base portant les statues d’Euainétoset de Pythiôn dans les environs du Sébasteion. Jusqu’à maintenant, toutes les informations surl’occupation du site d’Érétrie à l’époque romaine se concentrent au Nord de la ville antique, aupied Sud de l’acropole. À l’inverse, les parties basses de la ville, par exemple les environs del’agora, étaient apparemment abandonnées ou utilisées comme nécropoles111. Dans ces condi-tions, on est tenté de faire l’hypothèse que le sanctuaire d’Apollon était lui aussi abandonné, ycompris le sanctuaire, tout proche, d’Artémis. On comprendrait, dans cette hypothèse, com-ment notre base aurait pu être transportée de la chapelle artémisiaque attachée au sanctuaired’Apollon pour être remployée comme élément du dallage du Sébasteion.
Cédric BRÉLAZ, Stephan G. SCHMID,École française d’Athènes,Odos Didotou, 6,GR-10680 Athènes (Grèce),[email protected]
Université de Montpellier III - Paul-Valéry,Département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie,
Route de Mende,34199 Montpellier,
CNRS, UMR 5140,[email protected]
Appendice
Inscriptions honorifiques consacrées à la triade artémisiaque112
IG, XII 9,97 : découverte à Alivéri, non retrouvée113. Inscription honorant un homme, offerte par sesdeux fils et sa fille.
IG, XII 9,98 : découverte à Alivéri, non retrouvée. Inscription honorant un homme, offerte par sonépouse et ses deux fils114.
IG, XII 9,99 : découverte à Alivéri, non retrouvée. Inscription honorant un citoyen, offerte par la citéd’Érétrie.
IG, XII 9,140 : découverte sur la colline de Paléoekklisiès, non retrouvée. Inscription honorant unhomme, offerte par son cousin et son épouse.
IG, XII 9,141 (fig. 14) : découverte dans la chapelle de la Panagitsa. La base y sert toujours de table deculte. Inscription honorant une femme, offerte par ses deux frères et sa mère.
IG, XII 9,142 : découverte entre Katô Vathia et Paléoekklisiès ; actuellement en remploi dans l’églised’Anô Vathia. La pierre, qui était encore visible lors de travaux récents effectués dans l’église, nesemble désormais plus accessible (selon les informations que nous a communiquées un prêtre enseptembre 2000). Double inscription honorifique familiale.
Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d’Érétrie 257
111. Voir à ce propos, et en attendant une publicationplus détaillée, A. Psalti, « W makroA biotoA, w tac@oVqan0tou : Me aformP thn anaskafP dAo t0fwn auto-kratorik!n crpnwn app thn Er@tria », dans Praktik0hmerBdaV sthn mnPmh tou "ggelou Cwr@mh, Chalcis,2003, p. 17-20.
112. Plusieurs des inscriptions mentionnées ici sont ré-pertoriées par G. Schörner, Votive im römischen Griechen-land, Untersuchungen zur späthellenistischen und kaiserzeit-
lichen Kunst- und Relionsgeschichte, Stuttgart, 2003, Kat.1215-1217, 1228, 1231, 1240.
113. Sur le remploi à Alivéri de plusieurs inscriptions pro-venant d’Amarynthos, voir Knoepfler, 2001c, p. 197-199.
114. Cette famille descend visiblement d’Arkérimos, filsde Xénocharès, connu par IG, XII 9,97. Nous suivons surce point A. Wilhelm, Arch. Eph., 1892, p. 160, no 55,contre G. A. Papavasiliou, Arch. Eph., 1905, p. 19, no 5,qui estime que IG, XII 9,98 est antérieure à IG, XII 9,97.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance
IG, XII 9,276 : découverte à la chapelle de la Panagitsa. La pierre est toujours scellée dans le mur exté-rieur de la chapelle. Inscription honorant un citoyen, offerte par la cité d’Érétrie.
IG, XII 9,277 (fig. 13) : découverte dans la chapelle d’Agia Trias, entre la ville d’Érétrie et le villagemoderne d’Amarynthos ; conservée dans la cour du Musée d’Érétrie. Inscription honorant uncitoyen, offerte par la cité d’Érétrie.
IG, XII 9,278 : découverte dans l’église d’Agia Paraskevi à Chalcis. La pierre servait autrefois de degrédans l’escalier du clocher. Lors de récents travaux de restauration à l’intérieur du clocher,l’inscription a été descellée pour être replacée dans le mur externe de l’église. La pierre sembleavoir été brisée et seul un fragment de la première ligne est actuellement encore visible([D]HMOS TWN ERETRIEWN THCIPPON[- - -])115. Inscription honorant un citoyen,offerte par la cité d’Érétrie.
ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
Bruneau, Ph., 1975 Le sanctuaire et le culte des divinités égyptiennes à Érétrie, Leyde, 1975.Fittschen, K., 1995 Zur Bildnisstatue des Kleonikos, des “Jünglings von Eretria”, Eirene, 31, 1995,
p. 98-108.Knoepfler, D., 1988 Sur les traces de l’Artémision d’Amarynthos près d’Érétrie, CRAI, 1988, p. 382-
421.Knoepfler, D., 1990 Dédicaces érétriennes à Ilithyie, Ant. Kunst, 33, 1990, p. 115-128.Knoepfler, D., 2001a Eretria, XI, Décrets érétriens de proxénie et de citoyenneté, Lausanne, 2001.Knoepfler, D., 2001b « Le contrat d’Érétrie en Eubée pour le drainage de l’étang de Ptéchai », dans
P. Briant éd., Irrigation et drainage dans l’Antiquité, qanats et canalisations souter-raines en Iran, en Égypte et en Grèce, Paris, 2001, p. 41-79.
Knoepfler, D., 2001c Loi d’Érétrie contre la tyrannie et l’oligarchie (première partie), BCH, 125,2001, p. 195-238.
Knoepfler, D., 2001d La cité d’Érétrie et ses bienfaiteurs : réflexions en marge d’un nouveau recueilépigraphique, CRAI, 2001, p. 1355-1390.
Knoepfler, D., 2002 Loi d’Érétrie contre la tyrannie et l’oligarchie (seconde partie), BCH, 126, 2002,p. 149-204.
Lehmann, S., 2001 Der bekleidete Gymnasiast – eine neue Deutung zum Jüngling von Eretria, Ant.Kunst, 44, 2001, p. 18-23.
LGPN P. M. Fraser et E. Matthews éd., A Lexicon of Greek Personal Names, Oxford,1987-2000, 4 vol.
Olympia, 5 W. Dittenberger et K. Purgold, Olympia, 5, Die Inschriften von Olympia, Berlin,1896.
Petrakos, 1997 V. Ch. Petrakos, Oi epigraf@V tou WrwpoA, Ath nes, 1997.Schmid, S. G., 1999 Decline or Prosperity at Roman Eretria ? Industry, Purple Dye Works, Public
Buildings, and Gravestones, JRA, 12, 1999, p. 273-293.Schmid, S. G., 2000 Sullan Debris fromEretria (Greece) ?,ReiCret.Rom.Faut., 36,2000,p.169-180.Schmid, S. G., 2001 Worshipping the Emperor(s), A New Temple of the Imperial Cult at Eretria and
the Ancient Destruction of its Statues, JRA, 14, 2001, p. 113-142.
258 Cédric Brélaz et Stephan G. Schmid
115. Les auteurs remercient Sylvian Fachard, secrétairescientifique de l’ESAG, d’avoir bien voulu se rendre à Chal-
cis pour rechercher cette inscription et de leur avoir trans-mis ces renseignements.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
tras
bour
g -
- 1
30.7
9.16
8.10
7 -
13/1
0/20
15 2
3h23
. © P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Université de S
trasbourg - - 130.79.168.107 - 13/10/2015 23h23. © P
resses Universitaires de F
rance