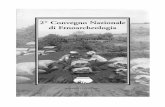Un bilan historiographique en histoire locale et régionale : Sherbrooke 1850-1950
-
Upload
wwwusherbrooke -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Un bilan historiographique en histoire locale et régionale : Sherbrooke 1850-1950
Site stratégique, lieu de spéculations et de colonisations,
Sherbrooke devient rapidement une ville à fonction industrielle
avec l’injection de capitaux sous l’impulsion de la British American
Land Company au tournant du 19e siècle. L’arrivée du chemin de
fer, l’aménagement intensif de la rivière Magog et l’émergence
d’une bourgeoisie propulse la ville au sommet des centres de
production du Canada. L’histoire de Sherbrooke a généré nombre
d’études pointues et même un ouvrage global. Dans ces conditions,
comment peut-on renouveler l’intérêt pour la question de
l’industrialisation en apportant une dimension supplémentaire? Le
développement économique, les mouvements sociaux et les
régulations sociales ont été les thèmes privilégiés par les
auteurs ayant écrits sur Sherbrooke. L’usage exclusif des sources
écrites pour la totalité de ces travaux n’est pas une limite pour
la compréhension d’un objet d’étude. Néanmoins, l’introduction de
la spatialité pourrait enrichir ces études et apporter des
nuances supplémentaires.
En effet, dans le cadre de cet essai, l’approche en système
d’information géographique (SIG), le recours aux cartes
d’assurances incendies de 1881, 1907 et 1951 (Sherbrooke) ainsi
2
que l’ajout de données géo référencées donnent la possibilité de
créer un matériel inédit pouvant illustrer l’implantation
industrielle dans le temps et l’espace. Cette réflexion se situe
dans le courant historiographique du tournant spatial tel que proposé
par Anne Kelly Knowles1 ainsi que la Social Science History Association2. Un
exemple concret de cette approche conceptuelle est bien expliqué
dans le livre Denny Regrade (1893-2008) : A Case Study In Historial GIS3.
Pour résumé cette angle, l’auteur énonce que la question
historique fait l’objet d’une cueillette de données et de la
création d’une base de données digitales. Au travers de ce
filtre, le chercheur peut valider, interpréter et aussi créer de
nouvelles informations autrement inconnues sans le recours à la
spatialité. Ce bilan historiographique a pour objectif de faire
un inventaire des connaissances sur l’objet historique de
Sherbrooke. Nous allons mettre de l’avant l’interprétation des
auteurs et apporter une critique au besoin.
1 Anne Kelly Knowles et Amy Hillier, Placing History: How Maps, Spatial Data, and GIS are Changing Historical Scholarship, ESRI Press, 2008, 313 pages.2 SSHA, Social Science History Association, Site officiel [en ligne], Boston,MIT, http://ssha.org/networks/historical-geography3 Aaron Raymond, Denny Regrade (1893-2008): A Case Study in Historical GIS, University ofWashington, 2009, 106 pages.
3
L’écriture de l’histoire de Sherbrooke
Les balbutiements (fin 19e siècle)
L’écriture de l’histoire de Sherbrooke débute avec Mme Catherine
M. Day à l’aide d’observation de première main4 des Cantons de
l’Est. Elle publie un ouvrage en 1869 dans lequel elle aborde la
configuration de la ville de Sherbrooke. De plus, l’auteur semble
avoir un préjugé favorable pour l’avenir de la communauté5 et
fait l’éloge de la British American Land Company6 . Jean-Pierre
Kesteman, spécialiste des Cantons de l’Est du 19e siècle, déclare
au sujet de ces auteurs un certain aveuglement volontaire et une
incapacité à remettre en question l« les aspects économiques et
sociaux de l’ascension des groupes au pouvoir7».
La période canadienne-française (Première moitié du 20e
siècle)
Dans un bilan historiographique, produit lors de sa thèse de
doctorat8, au sujet de la bourgeoisie sherbrookoise, Kesteman
4 Jean-Pierre Kesteman, Une bourgeoisie et son espace: industrialisation et développement ducapitalisme dans le district de Saint-François (Québec), 1823-1879, thèse de doctorat,Montréal, UQAM, 1985, page 6.5 Catherine M. Day, History of the Eastern Township, Province of Quebec, Dominion of Canada,Civil and Descriptive in Three Part, Lovell, 1869, p. 384.6 Ibid., page 384.7 Jean-Pierre Kesteman, Une bourgeoisie et son espace, page 6.8 Jean-Pierre Kesteman, Une bourgeoisie et son espace, page 6.
4
ajoute que : « L’historiographie de langue française sur les
Cantons de l’Est a presque un siècle d’existence, puisqu’elle
remonte aux articles de l’abbé Pierre Girard sur l’histoire des
catholiques à Sherbrooke9 ». Cette écriture de l’histoire reprend
un second souffle avec l’enthousiasme d’auteurs issus du clergé
catholique dont Albert Gravel10 ainsi que Jean Mercier11 qui ont
participé à la construction d’une mémoire locale. La pratique
historienne reste à s’affranchir, comme l’exprime Kesteman : «
Cette historiographie de langue française, qui a fleuri jusqu’à
la fin des années 1960, demeure fidèle à une interprétation
catholique et nationale. Elle laisse ainsi des pans importants du
passé de la région dans l’ombre, particulièrement en ce qui a
trait aux questions sociales et économiques12 ».
La période scientifique (1967-2015)
La création d’un département d’histoire à l’université de
Sherbrooke en 1964 a été doublement bénéfique : elle a permis de
normaliser les pratiques historiennes et aussi, faire exploser
les champs de recherche. Il est possible de retracer nombre de9 Ibid., page 6.10 Albert Gravel, Vade Mecum du Sherbrookois, La tribune, 177 pages.11 Jean Mercier, L'Estrie: préface de Lionel Groulx, Québec, 1964, 264 pages.12 Jean-Pierre Kesteman, Une bourgeoisie et son espace, page 7.
5
thèses sur Sherbrooke et les Cantons de l’Est dès 1967 ainsi que
la mise en valeur de l’histoire locale et régionale par l’état
québécois13 qui propulse la production historienne sherbrookoise.
Ici s’arrête le recours au bilan historiographique de Jean-Pierre
Kesteman où il l’avait laissé dans Histoire de Sherbrooke14. Nous avons
découpé la période dite scientifique en trois parties : l’intérêt
pour la période préindustrielle, l’étude de la période du
capitalisme industriel naissant ainsi que l’objet d’étude de la
période industrielle.
L’intérêt pour la période préindustrielle
La période précédant l’industrialisation de Sherbrooke a fait
l’objet d’un intérêt soutenu entre les années1977 et 2013. De
plus, la colonisation a été l’objet d’étude privilégié pour cette
période. En effet, l’auteur J.I Little a produit une thèse de
doctorat intitulée The Peaceable Conquest15 publiée en 1977 dans
laquelle il rétablit les faits concernant la reconquête des
13 Jean-Pierre Kesteman, Peter Southam et Diane St-Pierre, Histoire des Cantons del’Est, Institut québécois de recherche sur la culture, collection les régions duQuébec,Québec, 829 pages. 14 Jean-Pierre Kesteman, Histoire de Sherbrooke, tome 1 : De l’âge de l’eau à l’ère de la vapeur(1802-1866), Sherbrooke, Édition GGC, 2000, page 2.15 J. I. Little, French Canadian Colonization in the Eastern Township during the NineteenthCentury, thèse de doctorat, Ottawa, Université d’Ottawa, 1977, 616 pages.
6
Cantons de l’Est telle que proposé par les clercs dans les années
1960.
D’abord, en 1980, Michel Morin produit une biographie, de type
socioreligieuse, dont le protagoniste Calixte Marquis se mesure à
région difficile d’accès, en proie aux spéculateurs et sans
encadrement16. Cette thèse semble s’apparente aux ouvrages
pédagogiques des clercs et semble inspirée par le travail de
Little. De plus, Morin indique qu’un arbitrage était nécessaire
pour protéger les squatters17 et les coupes de bois illégales18.
Étant donné que les occupants illégaux étant pour la plupart
francophone, il aurait été intéressant de connaître la version
des grands propriétaires terriens dans ce litige. Ensuite, J. I.
Little, publie un autre ouvrage dans lequel il met en relief la
convergence d’intérêt entre l’Église catholique et l’entreprise
privée. Cette aide mutuelle est sans équivoque : le parasitage
des spéculateurs doit prendre fin pour laisser place au
développement. L’accès routier durable représente la
16 Michel Morin, Calixte Marquis, colonisateur des Cantons de l’Est, 1850-1870, mémoire demaîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1980, page 53.17 Michel Morin, Calixte Marquis, colonisateur des Cantons de l’Est, 1850-1870, p. 66.18 Ibid., page 66.
7
participation de l’État19 pour achever l’hégémonie de l’industrie
ligneuse dans la région. L’intervention concertée, d’une Église
en crise et d’une entreprise privée qui a faim de nouveaux
ouvriers, est motivée par l’exode vers les USA. Le résultat de
cet arrangement porte fruit. La prise de possession de la BALC
sur la région pose les bases pour un mode d’exploitation du
territoire plus intensif. Dans le même ordre d’idée de la
colonisation, Gilles Parent, ajoute l’indifférence de la
métropole20 ainsi que le gaspillage des terres21 malgré un exode
massif des francophones vers les USA. Il conclut à un propos
similaire à Little : la BALC22 a un rôle majeur pour briser le
verrou de la spéculation foncière. L’auteur ne semble pas
questionner le fait que la BALC devient un propriétaire
gargantuesque dont les dirigeants sont pour la plupart à Londres.
L’objet de la colonisation glisse vers le développement d’une
conscience locale dans State and Society in Transition, 1835-185223 de J. I.
Little. En effet, au lendemain de la révolte patriote, les19 Ibid., page 80.20 Gilles Parent, Deux efforts de colonisation française dans les Cantons de l’Est, 1848 et 1851, mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1990, page 11.21 Ibid., page 12.22 Ibid., page 12.23 Jack. I. Little, State and Society in Transition, the Politics of Institutional reform in the EasternTownship, 1835-1852, Montreal & Kingston, McGill-Queen’s Press, 1997, 320 pages.
8
Cantons de l’Est sont en quête pour sortir de l’isolement.
L’enjeu des voies de communication durable a été moteur d’une
prise de conscience régionale. Cette étude culturelle apporte un
argument intéressant : l’intervention de l’État est exigée par
des instances locales conservatrices. Cette dynamique qui émerge
lentement est en opposition avec la thèse de J.M.S Careless dans
Frontier and Metropolis24 qui privilégie une compréhension
d’exploitation métropolitaine entre les grands centres et les
régions.
L’initiative régionale, nouveau cheval de bataille, fait l’objet
d’un ambitieux projet25 en histoire socioéconomique. En effet,
Jean-Pierre Kesteman dans son ouvrage Histoire de Sherbrooke (en
quatre tomes) démontre la proactivité d’un milieu. Ces livres
font suite à la thèse de doctorat Une bourgeoisie et son espace parue
en 1985 du même auteur. De plus, Kesteman perpétue en quelque
sorte l’œuvre d’Albert Gravel avec son Vade Mécum du Sherbrookois
dans l’objectif commun de vulgariser l’histoire de Sherbrooke.
Cependant, l’auteur apporte une couche supplémentaire dans la24 J.M.S Careless, Frontier and Metropolis: Region, Cities, and Identities in Canada before 1914,Toronto, Université de Toronto, 1991, 132 pages.25 Jean-Pierre Kesteman, Histoire de Sherbrooke, Tome 1 : De l’âge de l’eau à l’ère de la vapeur(1802-1866), Sherbrooke, Production GGC, 2000, 353 pages.
9
compréhension des enjeux du développement : la fin de l’emprise
des spéculateurs ne met pas fin aux monopoles fonciers26. Si
Kesteman promeut le dynamisme régional, J. I. Little vise plus
haut avec le développement de l’identité nationale tributaire des
Cantons de l’Est. Borderland Religion27 est une thèse originale, en
histoire socioreligieuse et des phénomènes identitaires, qui
suggère rien de moins que la région des Cantons de l’Est est un
creuset de l’identité canadienne. Il suggère que la métamorphose
confessionnelle vécue à Sherbrooke, à la moitié du 19e siècle,
entre les émigrants nouvellement installés et une Église
méthodiste bien organisée, a une part majeure dans la définition
de la culture canadienne naissante. En parallèle du débat de la
colonisation et du développement d’une identité, nous retrouvons
une thèse en histoire rurale de Rémi Soullière sur le moulin
d’Ulverton. Celui-ci pose le problème des rapports économiques
dans l’environnement du moulin. L’auteur émet l’hypothèse d’une
double identité au moulin : producteur et commerçant-créditeur28.
26 Ibid., page 84. 27 Jack I. Little, Borderland Religion. The Emergence of English Canadian Identity, 1792-1852,Toronto, University of Toronto Press, 2004, 386 pages.28 Rémi Soullière, Les activités économiques au moulin de George Henry Goddard, manufacturierde laine et marchand, mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke,2010, page 2.
10
L’étude d’un seul moulin est une limite que l’auteur aurait pu
combler dans une étude comparée. En contrepartie, le
développement d’une économie régionale est repris plus en détail
dans le dernier livre de Jean-Pierre Kesteman La laine de nos moutons:
l’industrie lainière traditionnelle en Estrie paru en 2013. En effet, Kesteman
fait un inventaire des méthodes de production, une liste des
établissements et donne des explications sur l’économie
informelle qui se développe de part et d’autres des Cantons de
l’Est.
En résumé, les angles conceptuels privilégiés pour la période
couvrant l’ère préindustrielle de Sherbrooke et des Cantons de
l’Est ont été la colonisation, l’identité locale et dans une
moindre mesure, l’industrie lainière. On constate que le thème du
développement engage les auteurs couvrant cette période. Les
champs historiographiques sollicités ont été l’histoire
socioreligieuse, les identités, l’histoire socioéconomique, les
mentalités, les phénomènes identitaires ainsi que l’histoire
rurale. La plupart des liens de ces différents ouvrages sont en
amont de mon objet d’étude sauf le chapitre 7 d’Histoire de
11
Sherbrooke de Jean-Pierre Kesteman qui propose une carte des
barrages et manufactures de la rivière Magog29.
L’étude de la période du capitalisme industriel naissant
L’intérêt de l’initiative locale est lancé par Ronald Rudin dans
The Development of Four Quebec Town, 1840-191430 dans cette période du
démarrage industriel qui a servi de trame de fond pour plusieurs
auteurs de 1978 jusqu’à 2013. En premier lieu, une consultante
et historienne auprès d’organisation non gouvernementale,
Charlotte Thibault a écrit en 1978, une thèse de maîtrise de type
biographique sur Samuel Brooks, un homme impliqué dans
l’implantation de la BALC, la promotion du chemin de fer ainsi
que dans la politique canadienne.
La transition d’une élite anglophone à une bourgeoisie
canadienne-française fait l’objet d’un article scientifique de
Ronald Rudin portant sur la banque des Cantons de l’Est, une des
banques les plus dynamiques du Canada développé par la communauté
primordiale de Sherbrooke. Rudin se questionne sur le lent déclin
de cette communauté; il appert que le changement de natures des
29 Jean-Pierre Kesteman, Histoire de Sherbrooke, page 164.30 Ronald Rudin, The Development of Four Quebec Town, 1840-1914, thèse de doctorat, Toronto, Université York, 1977, 310 pages.
12
activités économiques, le besoin constant de nouvelles liquidités
et la création de nombreuses succursales bancaires vont diluer le
pouvoir des élites locales (L’approche en système d’information
géographique peut certainement apporter une nouvelle
compréhension de la dynamique démographique dans la région). En
1985, Jean-Pierre Kesteman, dans une approche socioéconomique
s’inspirant des travaux de Rudin et de Little, va produire une
thèse de doctorat s’intitulant Une bourgeoisie et son espace:
industrialisation et développement du capitalisme. Entre 1820 jusqu’à 1880,
l’auteur identifie deux phases d’exploitation (artisanale et
industrielle) séparée par l’arrivée du chemin de fer en 185131
qui seront déterminante pour le développement de l’élite locale.
En 1988, ce même auteur produit La ville électrique: Sherbrooke 1880-1988
qui appartient cependant à un registre plus politique et
technique.
Dans une optique des régulations sociales, Thierry Nootens,
spécialistes en histoire sociale et récipiendaire de plusieurs
prix, produit une thèse en 1997 portant sur la construction de la
normalité à partir de l’exclusion des malades mentaux de la
31 Jean-Pierre Kesteman, Une bourgeoisie et son espace, page 88.
13
sphère publique dans la ville de Sherbrooke lors de la période
industrielle (1886-1930) . Il avance l’hypothèse que
l’industrialisation apporte son lot de valeurs dont la
pénalisation de la folie qui ne cadre pas avec l’individu
productif32. L’asile s’ajoute à l’éventail d’infrastructure
permettant de réguler cette société en transition. Il aurait été
intéressant d’en connaitre d’avantage sur le traitement de la
folie en Nouvelle-Angleterre à titre comparatif pour tracer une
carte du transfert du savoir.
Par après, vers 1998, l’Histoire des Cantons de l’Est, un ouvrage fruit
d’un long processus participatif, sera produit par les
professeurs Jean-Pierre Kesteman, Peter Southam ainsi que Diane
St-Pierre. Cet ouvrage commandité par l’institut québécois de
recherche sur la culture met de l’avant les défis rencontrés, le
développement industriel précoce33et l’originalité de la région.
Logeant à la même enseigne de la spécificité, Jean-Pierre
Kesteman écrit le tome 2 de son Histoire de Sherbrooke qui fixe son
32 Thierry Nootens, To be quiet, ordely, obedient and industrious : la normalité dans le districtjudiciaire de Saint-François entre 1880 et 1920 d’après l’interdiction des malades mentaux, mémoirede maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1997, page 76.33 Jean-Pierre Kesteman, Peter Southam et Diane Saint-Pierre, Histoire des Cantons de l’Est, page 274.
14
attention sur l’énergie et la municipalisation du réseau
électrique.
L’enjeu de l’émergence d’une conscience collective refait surface
avec les travaux de Sarah Geneviève Perreault. Cette étudiante en
histoire et journalisme a tenté de retracer aux travers la
littérature régionale, les origines d’une âme des Cantons de
l’Est. Il semble que l’environnement complexe, une forte
superposition culturelle ainsi que des mythes de fondation ont
aidé à forger une identité régionale atypique. L’auteure ajoute
que le développement de journaux sert de tremplin identitaire
pour une région à la frontière de plusieurs mondes.
Délaissant les champs historiographiques usuels, le chercheur
Stéphane Castonguay emprunte le chemin de l’histoire
environnementale dans un essai paru en 2007 : The Construction of
Flood as Natural Catastrophe. Castonguay démontre que durant la période
industrielle à Sherbrooke, le management du débit d’eau du réseau
hydraulique pose problème. En effet, le manque ou le surplus
d’eau menace la demande énergétique des industries locales. Les
populations riveraines doivent occasionnellement assister à un
15
spectacle de l’inondation. L’auteur conclut qu’une main humaine
est derrière ce que l’on croyait une saute d’humeur de la nature.
Dans la suite du type biographique, Karl Bourassa (consultant en
histoire ayant un intérêt dans l’histoire des Cantons de l’Est)
propose une thèse sur Charles C. Colby. Cette thèse participe au
débat de la contribution régionale dans le grand ensemble
canadien. Ainsi, l’auteur met de l’avant les stratégies d’un
homme pour s’élever dans l’échelle sociale : le recours à la
famille élargie, une forte présence ainsi que les relations
politiques vont permettent à Colby un rayonnement dépassant le
cadre de sa communauté d’adoption.
Finalement, l’environnement visuel de Sherbrooke fait l’objet
d’une étude en histoire des représentations (The Electric City, 2013).
Rémi Guillemette pose le problème de la perception de
l’envahissement de l’électricité dans le paysage quotidien34.
L’auteur émet l’hypothèse que les individus intègrent et
interagissent de manière favorable35 envers ce que l’on
considère un progrès36. Jean-Pierre Kesteman ayant travaillé sur34 Rémi Guillemette, The Electric City, Sherbrooke et son paysage hydroélectrique (1880-1930),mémoire de maîtrise, Sherbrooke, 2013, page 2.35 Ibid., page 2.36 Ibid., page 80.
16
le passage à l’électricité, sur l’enjeu de l’énergie et sur les
aspects techniques de celle-ci, Guillemette apporte une
contribution supplémentaire au débat. Ce texte aborde aussi
l’industrialisation et identifie les barrages comme lieu de
plantage industriel.
En bref, la période du démarrage industriel a généré des
réflexions variées ayant un dénominateur commun : le
développement endémique. De plus, le spectre des champs
historiographiques s’est élargi avec l’apport de l’histoire des
régulations sociales (L’asile de Nootens) ainsi que des
représentations (The Electric City de Guillemette). Le contexte d’une
société en transition, mis de l’avant dans ces ouvrages, sont en
lien avec mon travail.
L’objet d’étude de la période industrielle
En dernier lieu, l’écriture de la période touchant une société
industrielle en plein essor s’est produite sur une vingtaine
d’année jusqu’en 2002. Tout d’abord, la condition ouvrière dans
les Cantons de l’Est a fait l’objet d’une thèse au début des
années 1970. En effet, Louise Lavoie-Brunelle, historienne
17
impliquée dans la culture et l’histoire locale et régionale,
s’est interrogé sur paupérisation et les difficultés des ouvriers
à créer des syndicats jusqu’en 1919. En hypothèse, une masse
critique de travailleurs, un activisme continu et la croissance
économique soutenue ont été nécessaire pour la création d’une
union stable : le club ouvrier de Sherbrooke. Au travers de
politiques, de club de lecture et d’un régime coopératif, le
mouvement ouvrier a pu protéger les ouvriers et même les citoyens
notamment dans la promotion d’inspection alimentaire.
Par après, nous retrouvons le mémoire de maîtrise de Jean-Pierre
Kesteman dans ses débuts à l’université de Sherbrooke après ses
études classiques en Belgique : paru en 1979, Le Progrès, fait
l’étude d’un journal sherbrookois au bord de la faillite.
Kesteman démontre que le journal du clan Bélanger s’est adapté
pour éviter la faillite : il a misé sur un discours plus
interventionniste37, se rapprochant des Libéraux de Laurier,
tout en ménageant les sensibilités de ses lecteurs en sollicitant
des publicités conservatrices.
37 Jean-Pierre Kesteman, Le Progrès 1874-1878, étude d’un journal de Sherbrooke, mémoire demaîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1979, page 117.
18
En 1987, Richard Choquette, un autre étudiant à la maîtrise de
l’université de Sherbrooke a travaillé sur l’intégration
difficile des nouveaux arrivants qui éventuellement devient un
défi pour la communauté d’accueil. L’apport des associations
volontaires a permis, selon Choquette, le développement du
pluralisme culturel sherbrookois et la création d’une
sociabilité38 communautaire. Ensuite, la grippe espagnole a été
abordée par Denise Rioux (étudiante émérite) avec l’optique
régionale : lors de l’épidémie de la grippe espagnole, après la
Première Guerre Mondiale, la communauté médicale de Sherbrooke
est prise au dépourvue. Pourtant, Sherbrooke sera la première
ville à se débarrasser de ce virus mortel. L’engagement de la
ville ainsi que les mesures sanitaires préventives39 peuvent
expliquer le succès de Sherbrooke dans la lutte contre la
contagion.
Par après, l’intérêt pour les mouvements sociaux s’amplifie avec
La mort violente à Sherbrooke (1993) ainsi que le genre de la pauvreté (1994).
D’abord Michel Sharpe (consultant en histoire) évoque les risques38 Richard Choquette, Les associations volontaires et le changement social : Sherbrooke 1855-1901, mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1987, page 9.39 Denise Rioux, La grippe espagnole à Sherbrooke et dans les Cantons de l’Est, mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1993, page 17.
19
de mort violente à Sherbrooke durant l’ère industrielle. On
constate qu’il y a peu de meurtre à Sherbrooke, cependant, on
observe d’avantage de suicide et aussi des morts reliés à des
accidents de travail. De plus, l’augmentation du risque est
fortement liée à la condition sociale. Cette étude d’un phénomène
social apporte un éclairage intéressant sur les actions
rationnelles rattachées à des valeurs (Le travail vaut plus que
la vie).
Ensuite, Rachelle Pelletier, qui travaille dans le domaine des
communications, cherche à définir la pauvreté selon les genres.
L’auteure émet l’hypothèse que les femmes sont plus à risque
durant la période d’essor industrielle en raison de la fonction
maternelle et la disponibilité de revenu moindre. En réponse à la
problématique de pauvreté, l’état et les instances municipales40
vont prendre des mesures visant cette clientèle particulière.
L’action sociale catholique est mise à l’avant plan dans une
thèse socioreligieuse de Steve Roussel. Sa recherche tente de
démontrer jusqu’à quel point l’activité paroissiale influe sur la
40 Rachelle Pelletier, Le genre de la pauvreté l’assistance aux indigents à Sherbrooke de 1922 à 1940, mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1994, page 22.
20
vie communautaire à Sherbrooke entre 1921 à 1952. Il énonce que
l’apparition de plusieurs confréries et d’association au début
des années 1940 a facilité la rétention de la communauté et
renforcé le rôle de la paroisse comme pivot de la vie sociale.
Une foi commune, la célébration de la messe et la sociabilité ont
servi aussi de base dans la manifestation d’une élite locale41.
Un autre essai en histoire des femmes sera produit en 2000 : La
violence conjugale dans le district judiciaire de St-François entre 1866 et 1893.
Catherine Gélinas mentionne que vers la fin du 19e siècle, les
femmes victimes de violence conjugale à Sherbrooke font face à un
double défi : l’inégalité juridique ainsi que l’épreuve de la
justice42.
L’auteure pose la question de la problématique de la séparation
de corps dans une société où le droit de correction de l’époux
représente la norme. En réponse, l’auteure révèle d’abord deux
stratégies des femmes violentées face à des époux abusif : la
passivité et la résistance. Ensuite, celle-ci fait la
41 Steve Roussel, Encadrement religieux et vie associative dans une paroisse ouvrière Sainte Jeanned’Arc de Sherbrooke de 1921 à 1952, mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université deSherbrooke, 1998, page 26.42 Catherine Gélinas, La violence conjugale dans le district judiciaire de St-François entre 1866 et 1893 d’après les procès en séparation de corps, mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 2000, page 74.
21
démonstration d’une prise de risque des femmes qui osent dénoncer
et s’exposer aux jugements des pairs (La perception de la
violence et de son acceptabilité fait partie du champ des
mentalités).
Les mouvements sociaux sont repris de plus bel mais dans
l’optique de l’histoire des familles avec Les familles ouvrières œuvrant
dans le secteur du textile à Sherbrooke, 1881-1901. Philippe Allard a étudié
les impacts de l’industrialisation sur les conditions de vie des
ouvriers du textile à Sherbrooke vers la fin du 19e siècle. Il
conclut que l’industrialisation a forcé l’adaptation des ménages
(Cette thèse est similaire à Family in Transition43 de Peter Gossage
parue en 1999). Néanmoins, la position dans l’industrie ainsi que
la composition du voisinage immédiat influe sur les stratégies
d’adaptation envisagée par les familles. Les thématiques mises de
l’avant sont les transformations sociétales44 ainsi que le
changement du rôle des femmes quoique l’essai se limite à
l’industrie du textile. En dernier lieu, vers 2001, la prison
Winter a été l’objet d’une thèse en histoire des mentalités.43 Peter Gossage, Families in Transition: Industry and Population in Nineteenth-Century Saint-Hyacynthe, Montréal, McGill-Queen’s Press, 1999, 299 pages.44 Philippe Allard, Les familles ouvrières œuvrant dans le secteur du textile à Sherbrooke, 1881-1901, mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 2001, p. 13.
22
François Gagnon (travailleur dans le domaine des arts) explore la
relation entre l’évolution de la population carcérale et l’essor
du capitalisme industriel à Sherbrooke vers la fin du 19e siècle.
L’auteur découvre que face à une population carcérale de plus en
plus francophone et étant victime de crime d’alcool, la
communauté prend des mesures telles que la tempérance et les
maisons de correction pour mettre un frein à l’improductivité. La
régulation sociale ainsi que la construction d’une prison moderne
sont des thèmes similaires à l’asile de Nootens qui accompagne le
capitalisme industriel en devenir.
Pour conclure sur la période de l’essor industriel; les unions,
un journal en faillite, la rétention sociale, les mesures
sanitaires, le risque de mort violente, la vulnérabilité des
femmes à la pauvreté, l’action sociale catholique, la séparation
de corps, les stratégies familiales ainsi que la régulation
sociale ont été les thématiques mise de l’avant par les auteurs.
Les mouvements sociaux et l’histoire des mentalités semblent
avoir été le champ privilégié pour cette période étudiée. Les
liens de ces essais sont en aval de mon objet d’études.
23
En conclusion
Nous avons produit un bilan historiographique couvrant
particulièrement la période 1967 à 2015. La période classique
(L’optimisme exprimé par Catherine M. Day) et la période
cléricale (Le devoir de mémoire d’Albert Gravel) étant déjà
couvert dans le bilan de Jean-Pierre Kesteman, nous avons donc
décidé de poursuivre là où il l’avait laissé.
L’histoire problème produite à la fin des années 1960 est
empreinte du développement (période pré industrielle), des
valeurs bourgeoises (période de démarrage industrielle) ainsi que
des mouvements sociaux (période industrielle). Du large éventail
des champs historiographiques retenus par les auteurs, nous
pouvons retenir une certaines préférences pour l’histoire des
identités, des mentalités et des régulations sociales. Si nous
élargissons notre lunette, nous pouvons observer de nombreuses
thèses dont celle de Patrick Houde (Le massacre de la mission de St-
François, 201245) couvrant la période britannique. Cependant, parmi
les autres travaux répertoriés, peu semble vraiment s’intéresser
45 Patrick Houde, Le massacre de la mission de Saint-François : mécanismes de domination etallégeance des Abénaquis à l'autorité coloniale britannique (1754-1814), mémoire de maîtrise,Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 2012, 152 pages.
24
à l’essor industriel en soi même si cette époque est primordiale
pour la ville de Sherbrooke. Néanmoins, notons que le 13 et 14
mai 1994, se tenait à Sherbrooke le 7e congrès de l’Association
québécoise pour le patrimoine industriel46. En clôture de
l’événement, Louise Brunelle-Lavoie énonce la nécessité de
préserver le patrimoine industriel, de relever le défi du
désengagement financier de l’état et du besoin pression de faire
des choix judicieux47.
L’angle de la reconversion du patrimoine industriel à Sherbrooke
semble la voie empruntée depuis quelques années si l’on pense à
la récupération de la Paton et de la Kayser. Si le contenant est
sauvegardé, on ne peut en dire autant du contenu qui tend à
disparaître. À la lumière de ce bilan, des interactions entre les
auteurs et des pistes de recherches déjà engagées, nous pouvons
nous poser la question : est-il possible de renouveler l’intérêt
pour l’histoire industrielle de Sherbrooke?
46 Un patrimoine industriel régional, Sherbrooke et les Cantons de l’Est, Actes du 7e congrès del’Association Québécoise pour le patrimoine industriel, Sherbrooke, 13 et 14mai, 1994, avril 1995, 80 pages.47 Un patrimoine industriel régional, page 70.
25
Mon essai en informatique appliquée en histoire veut en quelques
sortes combler cette lacune et enrichir de manière visuelle le
formidable travail de Jean-Pierre Kesteman en utilisant le
système d’information géographique (SIG). L’apport de la
spatialité n’est une nouveauté, elle a été utilisé abondamment au
département de géomatique de l’université de Sherbrooke dans
nombre de travaux originaux, mon souhait réside dans une plus
grande complémentarité entre histoire et géographie.
26
BibliographieThèses
ALLARD, Philippe. Les familles ouvrières œuvrant dans le secteur du textile à
Sherbrooke, 1881-1901. Mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université
de Sherbrooke, 2001, 124 pages.
BOISVERT, Érica. Environnement, savoir médical et institutionnalisation de la
santé des enfants dans une ville en processus d’industrialisation, Sherbrooke, 1885-
27
1935, mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke,
2006, 90 pages.
BOURASSA, Karl. Charles C. Colby, la vie professionnelle et le réseau d’affaire d’un
bourgeois des Cantons de l’Est du XIXe siècle. Mémoire de maîtrise,
Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 2012, 137 pages.
CHOQUETTE, Richard. Les associations volontaires et le changement social :
Sherbrooke 1855-1901. Mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de
Sherbrooke, 1987, 191 pages.
KESTEMAN, Jean-Pierre. Le Progrès 1874-1878, étude d’un journal de
Sherbrooke. Mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de
Sherbrooke, 204 pages, 1979.
KESTEMAN, Jean-Pierre. Une bourgeoisie et son espace : industrialisation et
développement du capitalisme dans le district de Saint-François (Québec), 1823-1879.
Thèse de doctorat, Montréal, UQAM, 1985, 272 pages.
GAGNON, François. La population carcérale de l’établissement de détention de
Sherbrooke 1891-1931. Mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de
Sherbrooke, 2001, 132 pages.
GÉLINAS, Catherine. La violence conjugale dans le district judiciaire de St-
François entre 1866 et 1893 d’après les procès en séparation de corps. Mémoire de
maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 2000, 133 pages.
GUILLEMETTE, Rémi. The Electric City : Sherbrooke et son paysage hydroélectrique
(1880-1930). Mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de
Sherbrooke, 2013, 118 pages.
28
LAVOIE-BRUNELLE, Louise. Le mouvement ouvrier à Sherbrooke jusqu’à 1919.
Mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1972,
136 pages.
LITTLE, John I. French Canadian Colonization in the Eastern Township during the
Nineteenth Century. Thèse de doctorat, Ottawa, Université d’Ottawa,
1976, 616 pages.
MORIN, Michel. Calixte Marquis, colonisateur des Cantons de l’Est, 1850-1870.
Mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1980,
133 pages.
NOOTENS, Thierry. To be quiet, ordely, obedient and industrious : la normalité
dans le district judiciaire de Saint-François entre 1880 et 1920 d’après l’interdiction des
malades mentaux. Mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de
Sherbrooke, 1997, 163 pages.
PARENT, Gilles. Deux efforts de colonisation française dans les Cantons de l’Est,
1848 et 1851. Mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de
Sherbrooke, 1990, 168 pages.
PELLETIER, Rachelle. Le genre de la pauvreté l’assistance aux indigents à
Sherbrooke de 1922 à 1940. Mémoire de maîtrise, Sherbrooke,
Université de Sherbrooke, 1994, 153 pages.
PERREAULT, Sarah Geneviève. La conscience historique dans la région des
Cantons de l’Est entre 1850 et 1960. Mémoire de maîtrise, Sherbrooke,
Université de Sherbrooke, 2003, 163 pages.
29
RIOUX, Denise. La grippe espagnole à Sherbrooke et dans les Cantons de l’Est.
Mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1993,
132 pages.
ROUSSEL, Steve. Encadrement religieux et vie associative dans une paroisse
ouvrière Sainte Jeanne d’Arc de Sherbrooke de 1921 à 1952. Mémoire de
maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1998, 153 pages.
SHARPE, Michel. La mort violente à Sherbrooke de 1901 à 1930. Mémoire de
maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1993, 195 pages.
SOULLIÈRE, Rémi. Les activités économiques au moulin de George Henry Goddard,
manufacturier de laine et marchand. Mémoire de maîtrise, Sherbrooke,
Université de Sherbrooke, 2010, 96 pages.
THIBAULT, Charlotte. Samuel Brooks, entrepreneur et homme politique du XIXe
siècle. Mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke,
1978, 135 pages.
Monographies
CARELESS, J.M.S. Frontier and Metropolis: Region, Cities, and Identities in Canada
before 1914. Toronto, Université de Toronto, 1991, 132 pages.
DAY, Catherine M. History of the Eastern Township, Province of Quebec, and
Dominion of Canada, Civil and Descriptive: in Three Part. Lovell, 1869, 475
pages.
30
GRAVEL, Albert. Vade-Mecum du Sherbrookois. La Tribune, 1961, 177
pages.
KESTEMAN, Jean-Pierre. La ville électrique. Un siècle d’électricité à Sherbrooke,
1880-1988. Sherbrooke, Éditions Olivier, 1988, 234 pages.
KESTEMAN, Jean-Pierre, Peter SOUTHAM et DIANE St-PIERRE. Histoire
des Cantons de l’Est. Institut québécois de recherche sur la culture,
collection les régions du Québec, Québec, 829 pages.
KESTEMAN, Jean-Pierre. Histoire de Sherbrooke. Sherbrooke, GGC
éditions, 2001, 353 pages.
KNOWLES, Anne Kelly et Amy HILLIER. Placing History: How Maps, Spatial
Data, and GIS are Changing Historical Scholarship. ESRI Press, 2008, 313
pages
LITTLE, Jack I. Borderland Religion. The Emergence of English Canadian
Identity, 1792-1852. Toronto, University of Toronto Press, 2004, 386
pages.
LITTLE, Jack I. State and Society in Transition, the Politics of Institutional reform
in the Eastern Township, 1835-1852. Montreal & Kingston, McGill-Queen’s
Press, 1997, 320 pages.
LITTLE, Jack I. Nationalism, Capitalism and colonization in Nineteenth Century
Quebec, The Upper St-Francis District. Montréal & Kingston, McGill-
Queen’s Press, 1989, 306 pages.
MERCIER, Jean. L'Estrie: préface de Lionel Groulx. Québec, 1964, 264
pages.
31
RAYMOND, Aaron. Denny Regrade (1893-2008): A Case Study in Historical GIS.
University of Washington, 2009, 106 pages.
Articles scientifiques
RUDIN, Ronald. Naissance et déclin d’une élite locale: la Banque
des Cantons de l’Est, 1859-1912. Revue d’histoire de l’Amérique française,
vol. 38, no 2, 1984, p. 165-179.