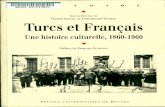Traduction vers l’arabe des termes médicaux constitués autour d’un éponyme du phrasème au...
Transcript of Traduction vers l’arabe des termes médicaux constitués autour d’un éponyme du phrasème au...
0BTraduction vers l’arabe des termes médicaux constitués autour d’un éponyme : du
phrasème au dérivé.
1BSAID Mosbah
2BISL Tunis (Université de Carthage)
3BTIL : 00/UR/02-01
4BRLM
5BRésumé 6BLa traduction des termes médicaux du français (ou l’anglais) vers l’arabe donne souvent lieu
à des noms composés auxquels correspondent en L1 des unités simples. La raison en est que,
lors du passage de la première langue dérivationnelle à l’arabe fonctionnant par schèmes, les
contenus affixaux, très fréquents dans la terminologie médicale, sont rendus par des unités
morphématiques autonomes.
425BLa structure syntaxique de telles combinaisons lexicalisées varie selon le degré
d’explicitation des relations logiques et sémantiques (cause, emplacement, etc.) reliant les
affixes d’origine à leurs bases. Cette diversité structurelle se trouve doublée dans le cas de
la traduction des noms composés comportant un éponyme, véhiculant lui-même des
informations relatives à une technique, un organe, une réaction, etc.
7BL’explicitation de ces deux types de données aboutirait à de longues paraphrases, à l’encontre
du besoin d’économie et de condensation devant normalement caractériser une unité
dénominative terminologique.
8BA partir d’un corpus puisé dans Unified Medical Dictionary, nous nous proposons de :
9B- décrire la diversité des structures équivalentes en arabe en vue de délimiter les
frontières ente la combinatoire libre et celle figée de ces dénominations ;
10B- analyser les procédés mis en oeuvre pour traiter la surcharge d’informations due à
l’autonomisation en L2 des contenus affixaux de départ.
1
11BAbstract
12BThe translation of french (or English) medical terms into Arabic often leads to compound
nouns to which correspond in L1 simple units. This is due to the fact that in transition from
the derivational L1 into Arabic that functions by schemes, the affixed contents which are very
frequent in medical terminology, are rendered by autonomous morphemic units.
13BThe syntactic structure of such lexicalized combinations varies according to the clarification
degree of the logical and semantic relations (cause, position, etc.) that links the original
affixes to their basis. This structural diversity is doubled in the case of the translation of
compound nouns comprising an eponym conveying itself information related to a technique,
an organ, a reaction, etc.
14BThe clarification of these two types of data would result in long paraphrases, contrary to the
principal of economy and condensation which should normally characterizez a terminological
denominative unit.
15BStarting from a corpus taken from Unified Medical Dictionary, we propose to:
- 16Bdescribe the diversity of the equivalent structures in Arabic in order to determine the
limit between the free combinatory and the fixed one of these denominations
- 17Banalyse the process used to treat the redundancy of informations due to the
automization in L2 of the affixed contents of the source language.
2
18B0. Introduction
19BL’unité terminologique polylexicale est une combinatoire syntagmatique de mots désignant
un concept. Traduisant l’univocité de la relation terme-concept, ce rapport de désignation,
fortement normalisé et institutionnalisé, fonde le statut phraséologique de cette combinatoire.
De fait, le degré de compactage des éléments constitutifs de l’unité et de leur solidarité
lexicale (Cf. les travaux de Sylvia Pavel, 1993-1995) permet aisément de vérifier les critères
de figement de ces formations à savoir notamment l’impossibilité de :
- 20Bla substitution : veine pariétale →*veine de la paroi
- 21Bl’insertion : diète pauvre en ions →*diète très pauvre en ions
- 22Bl’effacement : canal neurentérique →*canal
23BDans le domaine de la médecine, un grand nombre de ces unités comporte parmi leurs
constituants un éponyme. Selon les langues, les structures syntaxiques les rattachant à la base
sont plus ou moins variées :
24B-en français : - N …de EP : dent de Moun
25B- N…d’après EP (rare) : mastectomie radicale d’après Halsted
26B- N…+adj (dérivé de EP) : canal haversien (rare)
27B- en anglais : - EP’s + N : Pott’s aneurysm
28B- EP + N : Fournier teeth
29B- N…of EP : circular folds of Kerckring
30BCette diversité structurelle ne véhicule souvent aucune charge sémantique particulière. Une
lecture de ces suites selon les règles de la combinatoire libre permet d’identifier au plus la
relation d’appartenance qui les sous-tend :
3
- 31BLa maison de Pierre→ qui appartient à Pierre
- 32BAngine de Vincent→ dont la découverte revient à Vincent.
33BBien que cette interprétation soit pertinente, elle ne rend pas compte d’une autre fonction que
joue le nom propre dans les unités terminologiques polylexicales, Sarah (2004). En effet, si
l’on compare la définition d’une base simple et celle de cette même base suivie d’un éponyme
(1) ou les définitions d’une même base suivie de deux éponymes différents (2), on constate
que les définitions des termes formés avec un nom propre disent plus que le simple
rattachement du contenu notionnel de la base à l’éponyme :
34B(1)- artérite : « Terme désignant étymologiquement une altération de la paroi
artérielle, d'origine inflammatoire, dont la signification a été étendue à toutes les
altérations de la paroi artérielle, quelle qu'en soit l'origine »
35B- artérite de Takayasu : « Affection qui se caractérise par des lésions d'artérite
segmentaire de l'aorte et de ses branches, accompagnées de granulomes et d'une
inflammation diffuse avec des infiltrats de lymphocytes et de plasmocytes ». (Le Grand
Dictionnaire Terminologique).
36B
37B(2)- incision de Jalaguier : « Variété de laparotomie comportant successivement une
incision cutanée sur le relief externe du grand droit dans la fosse iliaque, l'incision du
feuillet antérieur de sa gaine, la réclinaison du grand droit en dedans, puis l'incision
du feuillet postérieur de la gaine et du péritoine ».
38B- incision de Mac Burney : « Variété de laparotomie, pratiquée essentiellement pour
appendicectomie, comportant une incision cutanée iliaque droite oblique en bas et en
dedans, centrée sur le point de Mac Burney, l'incision de l'aponévrose du grand
4
oblique suivant la même ligne, la dissociation transversale des fibres musculaires du
petit oblique et du transverse, puis l'ouverture verticale du péritoine ».
39BDans le premier cas, l’apport du nom propre dans le signifié global du terme est manifeste
dans l’ajout de sèmes nouveaux précisant des symptômes spécifiques de la maladie. Dans le
second, il est exprimé par le contenu différentiel des sèmes suivant l’hyperonyme « Variété de
laparotomie… ». Ce constat permettrait de considérer que le nom propre renvoie non
seulement à l’idée d’appartenance mais également à la description du contenu notionnel du
terme. Celle-ci peut porter sur :
40B- la localisation et/ou la composition :
41B(3) - aire de Broka : « L'aire de Broca correspond aux aires 44 et 45 de Brodmann,
dans l'hémisphère gauche du droitier. Située au pied de la troisième circonvolution
frontale gauche, elle comporte une portion operculaire et se trouve immédiatement en
avant du tiers inférieur de la circonvolution frontale ascendante à laquelle elle est reliée
par de courtes fibres d'association » ;
42B- la typologie :
43B(4)- apraxie de Liepmann : « Liepmann a été conduit à distinguer (1907) trois types
d'apraxie… »
44B-l’effet et/ou la manifestation :
45B(5)- abcès de Brodie : « Variété d'ostéite chronique entraînant la formation, à
l'intérieur d'un os (métaphyse d'un os long ou os court), d'une cavité contenant du pus et
parfois un ou plusieurs séquestres en grelot. Il se présente radiologiquement comme
une zone transparente arrondie intra-osseuse avec ostéosclérose de pourtour ».
46B-etc.
5
47BToutefois, il est vrai que ce rôle descriptif du nom propre n’est souvent identifiable que par le
recours au contenu définitionnel du terme et se trouve parfois explicité par d’autres
composants de l’unité terminologique (adjectifs, complément du nom : ligament inférieur du
col de la côte de Henle). Dans l’ensemble, le caractère mixte du statut de l’éponyme (comme
désignateur d’une relation d’appartenance et comme descripteur) ne donne pas lieu à des
données analytiques : celle qui paraît la plus évidente (la relation d’appartenance) n’est pas
spécifiée. Dans une structure du type N de EP, on ne sait pas si cette relation renvoie à la
découverte du phénomène, à son étude ou bien à un type de diagnostic particulier. De ce fait,
on peut conclure au caractère opaque du nom propre dans le cadre de ces formations.
48BLa traduction de ce type de termes du français (ou de l’anglais) vers l’arabe est souvent
associée à une complexification de la structure accueillante en L2 (par rapport à ce qui est en
L1), ce qui semble dans ce cas affecter le statut du nom propre au sein de l’unité
terminologique traduite. Cette complexification trouve son origine dans deux spécificités du
système de l’arabe :
- 49Bcontrairement au français qui est une langue compositionnelle, l’arabe est une langue
dérivationnelle fonctionnant par schèmes. De là, les contenus affixaux, très fréquents dans la
terminologie médicale, sont rendus dans des unités morphématiques autonomes, d’où la
diversité des structures correspondant à une même structure en L1 :
50B(6)
6
51B- L’expression de la relation d’appartenance se réalise en arabe à travers plusieurs structures.
L’arabe distingue dans ce sens deux procédés syntaxiques et sémantiques : la détermination et
la spécification.
52BLa détermination par un génitif (alʔida:fa) est exprimée soit par :
53B-l’ajout d’un nom à un autre :
54B(7) ʔiltiha:bi- ddima:ɤ /التھاب الدماغ(encéphalite) ; litt. Inflammation le cerveau
55Briba:t biʃa/ رباط بيشا (ligament de Bicha) ; litt. Ligament Bicha
56B-soit par l’ajout d’un nom à un autre moyennant une préposition (dans ce cas li dite de
spécification الم االختصاص) :
57B(8) riba:Ut Uwibar al-asli: li-lrukba/ رباط ويبر األصلي للركبة (ligament commun du
genou de Weber) ; litt.ligament Weber l’original pour le genou
58Bʔiltiha:bi-lʕasab ligumbult/ اب العصب لغومبلت التھ (névrite de Gombault)
59BQuant à l’attribution (annisba), elle est soit structurelle par l’ajout du suffixe attributif ja
(masculin) ou ja et t (féminin) à la base nominale :
60B(9) ʔiltiha:b riʔawi: / التھاب رئوي (pneumonie) = inflammation relative au poumon ;
litt. Inflammation pneumonique
61Bʔiltiha:bi-llaɵɵa altansa:ni:/ التھاب اللثة الفنساني (gingivite de Vincent) = inflammation
de la gingivite relative à Vincent ; litt. Inflammation la gencive vincienne
7
62Bsoit lexicalisée :
63B(10)-alasna:ni-ssamʕijja almansu:ba lihu:ʃk/ األسنان السمعية المنسوبة لھوشك (dents
acoustiques de Huschk) ; litt. Les dents acoustiques attribuées à Huschk.
64BIl existe par ailleurs une autre structure récurrente qui n’est ni proprement déterminative, ni
attributive :
65B(11) ʔiltiha:bi-lʒira:b bihsb turinfald/ التھاب الجراب بحسب تورنفالد (bursite de
Tornwaldt) ; litt. Inflammation de la bourse selon Tornwaldt.
66BTous ces facteurs, pris ensemble, donneraient lieu lors de la traduction des termes médicaux à
de longues paraphrases qui seraient à l’encontre du besoin d’économie et de concision devant
normalement caractériser une unité terminologique. En plus, ces constructions ne sont pas
toujours substituables l’une à l’autre puisque pèsent sur leur emploi des contraintes
syntaxiques et sémantiques, ce qui peut affecter le statut du nom propre dans cette unité.
67BA partir d’un corpus puisé dans Le Dictionnaire Mondial de la Santé (UMD), nous
avons tenté de combiner plusieurs critères dont notamment :
68B- l’analyse de la décomposition des affixes en morphèmes,
69B- la définition des significations des schèmes de la base,
70B- l’établissement des correspondances entre les structures de départ et les structures
équivalentes,
71B- la définition de la classe sémantique de la base,
72B- la définition des procédés d’introduction des noms propres,
8
73B- la détermination du statut du nom propre (locatif ou personnel).
74BL’objectif est de :
- 75Brecenser les régularités syntaxiques et sémantiques lors du passage de L1 à L2,
- 76Bdéterminer les cas problématiques auxquels correspondent en L2 plus d’une solution,
- 77Bdélimiter l’incidence de la diversité des outils syntaxiques introduisant les éponymes
sur leur statut et leur apport sémantique (s’il y en a) dans le signifié global des unités.
78B1- Régularité des structures et contraintes syntaxiques
79BNous nous proposons pour décrire le fonctionnement de ces outils syntaxiques de les opposer
l’un à l’autre afin d’en dégager les régularités et les contraintes :
80B- li/ N+N/mansu:b li : la préposition li ( الم االختصاص dite li de spécification) a un sens très
général de spécification, d’où sa valeur déterminative dans une structure du type N+li+N :
81B(12)
84B غومبولتل التھاب العصب
liab saʕl- bu : IltihaB85
gumb
86BLitt.Inflammation le nerf li Gombault
u :lt
82BGombault's neuritis 83Bnévrite de Gombault
87BCette même valeur sous-tend l’idée de détermination dans un type particulier de construction
N+N dite ʔidafa maʕnawijja (vrai détermination) par opposition à ʔidafa lafdijja
(pseudo-détermination). Dans ce cas, l’arabe fait l’économie de la préposition par souci
d’économie linguistique :
9
88B(13)
89Bventricle of Arantius 90Bventricule d'Arantius
91Bبطين أرانتيوس
s:arantjuʔayn tbuB92
93Blitt. ventricule Arantius
94B بطين رانتيوسأل
s:arantjuʔ li*ayn tbuB95
96BElle est également explicite dans la structure mansu:b li où la relation d’attribution
lexicalisée vient s’ajouter à l’idée de détermination contenue dans li. De ce fait, dans tous les
exemples relevés, les deux structures N+LI+N et N+ mansu:b li +N sont substituables l’une à
l’autre faisant ainsi selon la structure apparaître ou estomper la relation d’attribution :
10
97B(14)
98Bterme anglais 99Bterme français 0Btraduction arabe
101Bclasse
sémantique
de la base
102Bstructure de la
base (arabe)
103BKummell's
spondylitis
104Bspondylite de
Kummell
105Bلكومل ◌ التھاب الفقار
106BIltihab –lfuqa:r li k u:mil
107Bétat 108BN indéf + N
déf.+ li+EP
109BForster's uveitis 110Buvéite de Forster 111Bة المنسوب لفورستر لتھاب العنبي
112BIltiha:b- lʕajnijja
lmansu:b litu:star
113Bétat
114BN indéf + N
déf.+mansu:b
li+EP
115Brestiform
process of
Henle
116Bprocessus
restiforme de Henlé
117Bاتئ المرسي الشكل لھنلي الن
118Bannatiʕu-lmarsijju-ʃakl li
hanli
119Bpartie du
corps 120BN+NC+li+EP
121Btuberculum
cuneiforme
(Wrisbergi)
122Btubercule
cunéiforme
(Wrisberg)
123B ة الشكل سوبة المن (الحديبة اإلسفيني
)لرويسبيرغ
125Bpartie du
corps
126BN+NC+mansu:b
li+EP
10
-nijjatu: isfiʔl-udajbahAlB124
ʃakl (almansu :ba li
rwisbu:rg)
127BSchiotz'
tonometer
128Btonomètre de
Schiotz
129B ر العين المنسوب مقياس توت
لشيوتز
130BMiqja:s tawatturi-lʕajni-
lmansu:b liʃju:tz
131Binstrument 132BN+NC+li+EP
133BJohnson's
contouring pliers
134Bpinces à contourner
de Johnson
135Bة ھندمة الكفاف لجونسون زردي
136BZaradijjatu handamati-
lkafa:f liʒu:nsu:n
137Binstrument 138BN+NC+mansu:b
li+EP
139BLe dépouillement du corpus a montré une certaine régularité d’ordre syntaxique qui fait
qu’aux équivalents en L2 ayant la structure N+EP correspondent en français et en anglais des
syntagmes formés autour d’une base simple accompagnée d’un éponyme :
140B(15)
141BBourgery's ligament 142Bligament de Bourgery
143B بورجيري رباط
:ri:iʒr: but:RibaB144
145Bprocess of Blumenbach
147B بلومنباخناتئ
146Bprocessus de Blumenbach 148BNa:tiʔ blu:minba:x
149BBittner virus 150Bvirus de Bittner
151Bبيتنر يروسف
152Bfi:ru:s bi:tnar
153BPar contre, à une exception près, les termes ayant en L1 une base composée sont traduits dans
une structure du type SNE + mansu:b li + EP :
11
154B(16)
155BWolman's xanthomatosis 156Bxanthomatose de Wolman
157B فر المنتشرة المنسوب لولمانداء األورام الص
iraʃlmunta-ufriUssU-mi:awraʔl-uʔ:DaB
almansu:b lilu:ma:n
158
159BGombault's neuritis
161B لغومبولت العصب التھاب
160Bnévrite de Gombault lt:umbuɤ li absaʕl-bi:IltihaB162
163BRiedel's thyroiditis 165B رقية المنسوب لريدلالتھاب الد
164Bthyroïdite de Riedel 166BIltiha:bi-ddaraqijja-lmansu:b liri:dal
167Btuberculum scaleni
(Lisfranci)
169B المنسوبة للسيفرانك (ة األخمعية حديبة العضل(
ijjaʕaxmaʔl-alatidaʕl-udajbatuHB170
(almansu:batu lilisfra:nk)
168Btubercule du scalène
(Lisfranc)
171BCette solution s’impose du fait que le nom composé est une entité formée d’éléments
solidaires et compacts dont la suite n’admet aucune insertion entre les éléments. Cette règle
n’est pas toujours respectée par les traducteurs qui choisissent, quand cela est possible, de ne
pas paraphraser tous les contenus affixaux du nom composé et se contentent d’un seul
composant élémentaire :
172B(17)
173BMcLean tonometer 174Btonomètre de McLean 175B ماك لينمقياس
176BMiqja:s (mesure) ma:k li:n
177BRecklinghausen's tonometer 179B 178 ريكلنغھاوزن مقياسBtonomètre de Recklinghausen
180BMiqja:s ri:klinɤhawzin
181BMusken's tonometer
183B ر العرقوب المنسوب لموسكينمقياس توت
182Btonomètre de Musken 184BMiqja:s tawatturi-lʔarqu:b li muski:n
12
187B ر العين المنسوب لشيوتزمقياس توت
188BMiqja:s tawatturi-lʕajni-lmansu:b
liʃbu:tiz
185BSchiotz' tonometer 186Btonomètre de Schiotz
189BCependant, il y a parfois hésitation entre les deux structures en L2 quand le SN en L1 est
formé d’un N + adj +EP. Dans ce cas, ou bien l’adjectif est considéré comme une simple
extension tout comme le complément du nom comportant le nom propre ce qui permet
l’antéposition de celui-ci :
190B(18)
191BFowler's angular incision 192Bincision angulaire de Fowler 193B اوي ر فاولشق الز
194Bʃaq fa:wliri-zzawi:
195Bparietal vein of Santorini
197B الجداري سانتورينيوريد
196Bveine pariétale de Santorini 198BWari:d sa:tu:ri:ni: alʒida:ri:
199BKuhnt's postcentral vein 201B خلف المركزي كونت وريد
200Bveines postcentrales de Kuhnt 202BWari:d ku:nt xalfi-lmarkazi:
203Bou bien il est considéré comme solidaire du nom qui le précède et dans ce cas, nous
retrouvons la structure du type NC (N+N attributif) + mansu:b li+ EP :
204B(19)
205Bvena basalis Rosenthali 206Bveine basale de Rosenthal 207B المنسوب الوريد القاعدي
لروزنثال
208BAlwari:di-lqa:ʕidi:
almansu:b liru:zinta:l
209Bzonula ciliaris NA (zonula
ciliaris Zinnii)
210Bzonula ciliaris NA (zonula ciliaris Zinnii) 211B طيقة الھدبية المنسوبة لزينالن
-lhadabijja-ajqat:AnnuB212
13
lmansu:ba lizi:n
213BPar ailleurs, il est possible théoriquement de faire suivre un nom composé d’un éponyme sans
l’emploi d’une quelconque préposition, mais dans certains cas, quand le sens de ce nom est
compositionnel, cette construction peut prêter à confusion du fait que la portée de l’éponyme
peut être interprétée comme portant sur le seul deuxième composant :
214B(20)
215BVincent's gingivitis 216Bgingivite de Vincent
219Blitt. inflammation de la gencive de Vincent
uction reste possible quand le sens global du nom composé n’est pas
compositionnel :
221B(21)
2BCooley's anemia 223Banémie de Cooley litt. Pauvreté du sang de
225BFiqr dam ku:li:
s de contraintes
particulières sur la nature de la base ; celle-ci peut être simple ou composée :
227B(22)
brownian movement movement brownien araH
217B* فنسانة لث التھاب
218BIltiha:b-laɵɵat-fansa:n
220BUne telle constr
224B كوليفقر دم Cooley22
- 226Bnom attributif (N + ja)/ li/ N+N/mansu:b li : En principe, syntaxiquement, il est
possible en arabe d’exprimer l’idée d’attribution en ajoutant le suffixe ja (+ t pour le féminin)
au nom propre (entre autresFTP
PTF). Contrairement aux cas précédents, il n’ y a pa
228B 229B
230B يةـ براونحركة
jjawni:braka B231
canal haversien 234BAn
232B
233B ي ـ الھافيرسالنفق
nafaq alha:fa:ri:si
TP
PT Tous les adjectifs en L1 sont rendus par un nom attributif en arabe.
14
237B
235BVienna encephalitis 236Bencéphalite de Vienne 238BIlti
ofacial
dysostosis
se acrofaciale de
Nager lqimmi-umiδ
ماغ التھاب ي الفييناو الد
ha:bi-ddima:ɤ alfinna:wi:
239BNager's acr 240Bdysosto 241B م خلل عظ ي الوجھي الناجر الت ي القم
: alwaʒhi: aʕtta-XalaluB242
atta:ʒiri:
t difficile quand la base présente un emboîtement de noms
osés, source d’ambiguïté :
244B(23)
s applanation
tonometer
aplanissement
de Goldmann
ن
243BToutefois, cette structure devien
comp
246Btonomètre par
247B المنسوب لغولدمابالتسطيح العين توتر مقياس
h:itajn bittasʕ-uri
245BGoldmann'
s tawatt:MiqjaB248
الغولدماني سطيح
250B(*goldmanien)
and elle comporte deux noms coordonnés :
25
253BScardino ureteropelvioplasty 254Burétéropelvioplastie de Scardino
almansu:b liɤu:ldma:n
249B بالت العين توتر مقياس
251Bou qu
2B(24)
255B الحويضة بحسب سكاردينو ورأب الحالب
asb ha biduwh aj-lib wal:ahl-biʔraB256
257B يسكاردينوال *الحويضة ورأب الحالب
ska:rdinu:
258B- bihasb/mansu:b li : ces deux structures sont les seules substituables l’une à l’autre dans la
plupart des termes qui les comportent à l’exception de ceux relatifs aux dénominations
’instrument, ce qui est l’indice d’une différence sémantique que nous décrirons par la suite : d
15
260BRaymond's type of apoplexy 261Btype d'apoplexie de Raymond 262Bن
263BNamatu-ssaka alm d
264B كتة نمط الس
asbh
259B(25)
كتة المنسوب إلى ريموند مط الس
ansu:b ʔila: ri:mu:n
ريموندبحسب
nd:mu: ri bissaka-NamatuB265
266B كتة يمور لـنمط الس
267BNamatu-ssakata liri:mu:nd
es noms
ne nuance ou d’une contrainte sémantique.
nc d’interroger l’emploi de ces différentes structures pour pouvoir les opposer
une certaine fréquence de l’emploi de ce procédé dans le cas des noms propres
locatifs :
ند
268BA côté de ces distributions syntaxiques, le procédé adopté pour la traduction d
propres peut, dans certains cas, être révélateur d’u
269B2- Moules syntaxiques et charges sémantiques
270BIndépendamment du débat sur la signification du nom propre, il est indéniablement admis que
les outils syntaxiques orientent pour le moins l’interprétation sémantique des constituants
dont ils assurent la connexion. De fait, la substitution des structures syntaxiques, évoquée ci-
dessus, ne signifie nullement leur équivalence sémantique ; tout comme dans le cas contraire
où l’on ne peut prétendre que derrière toute variation syntaxique, il y a du sens. Nous nous
proposons do
par la suite.
- 271BLe nom attributif (équivalent à l’adjectif relationnel) : Le dépouillement du corpus
a montré
16
272B(26)
273BSt Louis encephalitis 274Bencéphalite de Saint-Louis 275Bانت لويسي ماغ الس التھاب الد
276BIltiha:bu- ddima:ɤ alsa:nt lwi:si:
277BLitt.inflammation (masc.) le cerveau la saint-
louisienne
278BCalifornia encephalitis 279Bencéphalite de Californie 280B ماغ الكاليفورني التھاب الد
281BIltiha:bu- ddima:ɤi-lkalifu:rni:
282BLitt. Inflammation le cerveau la
californienne
283BVenezuelan equine
284Bencephalitis
285Bencéphalite équine du
286BVenezuella
287B ماغ الخيلي الفنزويلي التھاب الد
288BIltiha:bu- ddima:ɤi-lxajli: alfini:zwilli:
289BLitt.inflammtion le cerveau l’équine la
vénézuélienne
290Bet une rareté dans son emploi personnel avec parfois une autre structure concurrente :
291B(27)
292BVincent's gingivitis 293Bgingivite de Vincent 294Bالتھاب اللثة المنسوب لفنسان
295BIltiha:bu-llaɵɵa almansu:b
litansa:n
296BVincent's gingivitis 297Bgingivite de Vincent 298B ھاب اللثة الفنساني الت
299BIltiha:bu-llaɵɵa-ltansa:ni:
300Bhaversian canal 301Bcanal haversien 302B فق الھافيرسي الن
303BAnnafaqi-lha:fi:ri:si:
304BLitt. Le canal le haversien
305Bhaversian canal 306Bcanal haversien 307Bنفق ھافيرس
17
308BNafaq ha:fi:ri:s
309BCanal Havers
310Bbrownian movement 311Bmovement brownien 312Bحركة براونية
araka brawnijjaHB313
314BLitt. Mouvement brownien
315BL’explication en est que «le nom propre doit être notoire pour qu’un adjectif puisse être
créé » (Chapman, 1939 : 73, cité dans Jean-Louis Vaxelaire, 2005 : 226). Les noms de pays,
des régions le sont. Pour les noms propres personnels, si les personnes qu’ils désignent sont
célèbres (Hyacinthe Vincent avait eu plusieurs décorations, Havers cumule plusieurs
découvertes qui porte son nom : haversian glands, haversian system, haversian lamellae,
haversian canal, etc.) et que la variation syntaxique n’explicite pas une charge sémantique
autre que la notoriété des personnes désignées, on ne peut pas s’empêcher de mentionner la
typicité des référents notionnels auxquels renvoient ces termes :
391B- Le mouvement brownien sert à décrire le comportement HTthermodynamiqueTH des HTgazTH
(HTthéorie cinétique des gazTH), le phénomène de HTdiffusionTH et est utilisé dans des modèles de
HTmathématiques financièresTH. Il sert également de modèle mathématique pour les processus
aléatoires ;
392B- le canal haversien, cercle artériel très inconstant, est un élément d’une classe ; il désigne
n'importe lequel des nombreux canaux minuscules qui contiennent des vaisseaux sanguins et
le tissu connectif formant un réseau dans l'os ;
393B- l’angine de Vincent est typique puisqu’elle « est relativement rare 427Bmême si c'est
l'angine ulcéreuse la plus fréquente » ;
394B-Etc.
18
395BPeut-on dans ce cas conclure que l’emploi de l’adjectif relationnel et son équivalent en arabe
est un indice, à côté de la notoriété du nom propre originel, de la typicité du phénomène ou de
l’objet désigné ?
396B- mansu:b li/li : outre la différence très générale entre l’attribution et la spécification
qu’expriment respectivement les deux outils syntaxiques, il y a lieu de mentionner que la
lexicalisation de la relation d’attribution par mansu:b (attribué) véhicule originellement une
structure prédicative passive :
397BX mansu:b li Y équivaut à X est attribué à Y ou On attribue X à Y
429B428B398BDe ce fait, l’énonciateur présupposé ne prend pas en charge cette attribution et par
conséquent marque une certaine distance vis-à-vis de son propos. Par contre li paraît plus
confirmatif. Dans nos exemples, certains termes justifient l’emploi de cette structure :
399B(28)
316BHashimoto's thyroiditis 317Bthyroïdite de Hashimoto
318Bة المنسوب لھاشيموتو رقي التھاب الد
319BIltiha :bi-ddaraqijja almansu:b liha:ʃi:mu:tu:
320BInflammation la thyroïde attribuée à Hashimoto
400BLa thyroïdite d'Hashimoto est également « appelée thyroïdose chronique de Hakaru, struma
lymphomatosa de Hashimoto, thyroidose involutive de Klotz, thyréose involutive de
Bastenié » (Le Grand Dictionnaire Terminologique).
401B- bihasb : cet emploi particulier de bihasb est problématique étant donné qu’il relève de
l’arabe moderne en grande partie non décrit. A l’origine, on peut également y voir un emploi
prédicatif du type : bihasb wasf X, Y huwwa (litt. D’après la description de X, Y est…).
Toutefois, l’analyse du corpus a révélé au moins trois emplois de cette structure :
402B- l’emploi où elle équivaut à selon/d’après :
19
403B(29)
mastectomie d'après Meyer
ماير بحسب استئصال الثدي
istiʔsa:li-ɵɵadj bihasb ma:jir
excision la poitrine d’après Mayer
repas de beurre d'après Knoepfelmacher
بدة كنوبفيلماخربحسبوجبة الز
waʒbatu-zzubda bihasb knu:bfi:lma:xir
repas le beurre d’après Knoepfelmacher
404B-l’emploi le plus récurrent concerne une base relative au même phénomène (généralement
appartenant aux classes sémantiques des actions ou des états) variant par la cause, les
symptômes, les effets, la technique ou la localisation . Bihasb paraît dans ce cas comme un
opérateur de sous-catégorisation paradigmatique :
405B(30)
321BPette-Doring
panencephalitis 322Bpanencéphalite de Pette-Doring
323B ماغ الشامل بيتي دورينغ بحسب التھاب الد
ɤn:ri: du:ti:ibasbhbi ɤ:ddima-bu: IltihaB324
325BEconomo's
encephalitis
326Bencéphalite d'Economo
327B(encéphalite léthargique)
328B ماغ أكونومو بحسب التھاب الد
:mu:nu: akuasbh biɤ:ddima-bu: IltihaB329
330BBinswanger's
encephalitis
331Bencéphalite de Binswanger
332B(démence de Binswanger)
333B ماغ بينز فانغر بحسب التھاب الد
arɤn:nsfa: biasbh biɤ:ddima-bu: IltihaB334
335BSchilder's encephalitis 336Bencéphalite de Schilder
337B(maladie de Schilder)
338B ماغ شيلدربحسب التھاب الد
ldar:iʃ asbhbi ɤ:ddima-bu: IltihaB339
340BEtc. 341BEtc.
342Bالخ
343BAlanson's amputation 344Bamputation d'Alanson 345B ائري (بتر بحسب آالنسون )الد
:)iriʔ:adda(n :nsu: alaasbhbiBatr B346
20
347BAmputation selon Alanson (circulaire)
348BAlouette's amputation 349Bamputation d'Alouette 350B في الحوض(ب آلويت بتر بحس(
)dawhl-fi (t:alwi asbhbiBatr B351
352BAmputation selon Alouette (au bassin)
406B-Dans le cas précédent, bihasb présente le contenu notionnel du terme comme étant une
variable dans un ensemble d’autres notions à noyau commun. Chaque terme présuppose dans
ce sens l’existence d’un autre partageant avec lui le même hyperonyme. Logiquement, un
phénomène ou un objet singulier ne peut être désigné par une telle structure :
407B(31)
354Btonomètre de Musken
355Btonomètre *d’après Musken
356B ر العرقوب مقياس موسكينل المنسوب توت
357BMiqja :s tawatturi-lʕurqu:b almansu:b limu:ski:n
358BLitt. Mesure tension le jarret attribuée à Musken
359B
353BMusken's
tonometer
ر العرقوب م◌ موسكين بحسب*قياس توت
408BQuand il l’est, l’idée de variabilité contenu dans bihasb est portée sur les constituants internes
du syntagme (notamment les qualificatifs) et oblige à procéder à une lecture compositionnelle
du terme :
409B(32)
364B ة بحسب بروكا الباحة المجاو ي م رة للباحة الش
360BBroca's parolfactory area 362Baire parolfactive de Broca
361B(area subcallosa) 363B(aire sous-calleuse)
-ahwira lilba:aʒa almuh:AlbaB365
ka:asb bruhammijja biʃʃ
366BL’aire proche de l’aire olfactive
selon Broka
367Btriple response (of Lewis) 368Bréponse triple (de Lewis)
369B بحسب ليويس لرض الجلد(استجابة ثالثية(
)s…:sb lwihbi(ijja ɵ:aulɵba :aʒistiB370
21
371Bréponse triple (selon Lewis…)
372Bdirect cerebellar tract of Flechsig
373Bfaisceau cérébelleux direct
374Bde Fleischig
375Bبيل المخيخي المباشر بحسب فليكسيغ الس
l le cérébelleux le direct :AssabiB376
ɤ:ksiasb flihbi
410BUn tel effet affecte la solidarité lexicale des constituants des termes et les ramène à des
pseudo-paraphrases :
411B-l’aire qui selon Broca est à côté de l’aire olfactive
412B-la réponse qui selon Lewis est triple
413B-le faisceau cérébelleux qui selon Fleischig est direct.
414BContrairement à mansu:b li, bihasb confirme ici l’attribution mais marque une distance vis-à-
vis de son contenu.
415BConclusion
416BNous retenons provisoirement deux éléments pour conclure :
417B-a) concernant le statut du nom propre dans les dénominations multi-termes :
418BEn arabe, la distinction entre structures attributives et structures de spécification s’ajoute à
l’emploi de certains outils syntaxiques (du type mansu:b li/bihasb) incluant des unités
lexicales significatives et non synonymiques pour imposer plus d’une lecture de l’apport du
nom propre dans la signification du terme médical. En effet, la substitution d’une structure par
une autre est souvent porteuse de sens. Même si ce sens reste très général et convient plus à
un cadre d’interprétation, il est suffisant pour remettre en question pour le moins l’idée d’un
nom propre fonctionnant comme une simple étiquette dans les termes.
419B-b) concernant la traduction vers l’arabe des termes comportant des éponymes :
420BSi la polylexicalité est normalement de nature analytique, elle tend dans ce cas de la
terminologie vers la synthèse vu le degré de cohésion du terme polylexical, l’univocité de son
22
lien la notion qu’il désigne et l’opacité du nom propre. Cette affirmation demande quand
même à être nuancée. Nous avons vu que contrairement à l’arabe, la variation de la
détermination par un nom propre, n’est le plus souvent en anglais et en français que
syntaxique. En arabe, â côté de ce qui a été dit à propos de la signifiance des outils
introducteurs des NP, il est à noter que certains de ces outils (bihasb/mansu:b li) sont le foyer
d’une prédication non actualisée qui vient souvent s’ajouter à celle véhiculée par la base
d’origine verbale :
421B(33)
377BDoyne's familial
honeycombed
choroiditis
378Bchoroïdite familiale alvéolée de Doyne 379B ة العائلي التھاب بيه المشيمي بعش النحل الش
دوانبحسب(
380BIltiha:b almaʃajmijja alʕa:ʔili:
n:asb dwahl bihnna-iʃʃuʕh bi:abiʃʃa
381BInflammation familiale de la
choroïde ressemblant à la ruche
d’abeille selon Doyne
422BCette multiplicité des structures pro-prédicatives et cette diversité sémantique des outils
introducteurs du NP, tracent une tendance inverse en arabe vers l’analycité des formations
terminologiques construit autour d’un éponyme.
23
24
t, 217 p.
382BBibliographie
383BCHAPMAN Robert (1939) Adjectives from proper names, SPE, Tract n°LII, Oxford,
Clarendon press, 90 pages
384BDictionnaire médical de l’OMS
385BLEROY Sarah (2004) Le nom propre en français, Ophrys, 137 pages
386BPAVEL Sylvia (1993) : «Vers une méthode de recherche phraséologique en langue de
spécialité», L'Actualité terminologique, 26-2. pp. 9-13.
387BPAVEL Sylvia (1993) : «Neology and Phraseology as Terminology-in-the-Making», Te-
rminology Applications in Interdisciplinary Communication. Sonneveld, H..
Loening. K. ledsl, Amsterdam, John Benjamins, pp. 21-34.
388BPAVEL Sylvia (1993) : «La phraséologie en langue de spécialité», Terminologies
nouvelles. 1(1, Bruxelles. Rint, 67-82.
389BPAVEL, S. & BOILEAU. M. (1994) : Vocabulaire des systèmes dynamiques et de
l'imagerie fractale, Ottawa, Rin
390BVAUXLAIRE Jean Louis (2005), Les noms propres. Une analyse lexicologique et historique,
Honoré Champion, 952 pages
423BLe Dictionnaire Mondial de la Santé (UMD),
424BLe Grand Dictionnaire Terminologique
























![[Review] Avicenne (Ibn Sīnā), Commentaire sur le livre Lambda de la Métaphysique d’ Aristote (chapitres 6-10)..., Édition critique, traduction et notes par M. Geoffroy, J.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6339a37bcd16b69ca70b8c78/review-avicenne-ibn-sina-commentaire-sur-le-livre-lambda-de-la-metaphysique.jpg)