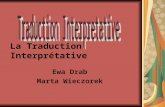L'art et la conscience aujourd'hui, Nirmal Verma, présentation et traduction par Annie Montaut
Faire le genre - traduction de Doing Gender (C. West & D. Zimmerman)
Transcript of Faire le genre - traduction de Doing Gender (C. West & D. Zimmerman)
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
1
Faire le genre*
Candace West et Don H. Zimmerman** Au début, il y avait le sexe et il y avait le genre. Celles et ceux d’entre nous qui, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, donnèrent des cours dans le domaine distinguaient ces notions avec beaucoup de soin. Le sexe, disions-nous aux étudiant⋅e⋅s1, est ce qui est imputable à la biologie : l’anatomie, les hormones, et la physiologie. Le genre, enseignions-nous, est un statut acquis : il est ce qui est construit par le truchement du psychologique, du culturel, et du social. Pour présenter la différence entre les deux, nous alignions les unes près les autres les études de cas singulières sur les hermaphrodites (Money, 1968, 1974 ; Money and Ehrhardt, 1972) et les enquêtes anthropologiques portant sur d’« étranges et exotiques tribus » (Mead, 1963, 1968). Inévitablement (et comme on pouvait s’y attendre), la confusion dans laquelle baignaient nos étudiant·e·s à la fin de chaque semestre augmentait au fil des semaines. Dans le contexte des recherches qui illustraient le caractère parfois ambigu et souvent conflictuel des critères conduisant à la détermination du sexe, il devenait difficile de considérer ce dernier comme un « donné ». Et dans le contexte des impératifs anthropologiques, psychologiques et sociaux que nous étudiions – la division du travail, le formation des identités de genre, et la subordination sociale des femmes par les hommes –, le genre apparaissait de moins en moins comme quelque chose d’« acquis ». En outre, la thèse la plus répandue parmi les théories sur la socialisation selon le genre transmettait le message fort selon lequel le genre, tout « acquis » qu’il était, se fixait probablement à l’âge de cinq ans, devenant dès lors invariant et statique – tout comme le sexe. Dans les années 1975, la confusion avait gagné en intensité et s’était diffusée bien au-delà de nos salles de classe. D’un côté, nous apprîmes que les processus biologiques et culturels étaient liés entre eux de manière bien plus complexe – et réflexive – que nous l’avions supposé au premier abord (Rossi, 1984 : 10-14 en particulier). De l’autre, nous découvrîmes que certains arrangements structurels, entre le travail et la famille par exemple, produisaient en réalité ou permettaient la formation d’un certain nombre de capacités, notamment de maternage, que nous avions associées dans un premier temps à la biologie (Chodorow, 1978 versus Firestone, 1970). Pour couronner le tout, la notion de genre entendu comme quelque chose relevant d’une acquisition par couches successives fut peu à peu abandonnée. Cet article a pour objectif de proposer une appréhension ethnométhodologiquement informée – et par conséquent proprement sociologique –, du genre, que nous comprenons comme un accomplissement
* Candace West et Don H. Zimmerman (1987). « Doing gender ». Gender and Society, 1 (2), 125-151. Copyright © 1987 Sage Publications, Inc. Cet article est traduit avec l’aide de la rédaction de la revue Gender and Society et l’aimable autorisation des auteur⋅e⋅s. Nous remercions l’éditeur, qui nous a cédé gratuitement les droits de reproduction (N.d.é). ** Cet article est en partie basé sur un papier présenté à la Rencontre Annuelle de l’Association Américaine de Sociologie de septembre 1977 à Chicago. Pour leurs suggestions pertinentes et leurs aimables encouragements, nous remercions Lynda Ames, Bettina Aptheker, Steven Clayman, Judith Gerson, feu Erving Goffman, Marilyn Lester, Judith Lorber, Robin Lloyd, Wayne Mellinger, Beth E. Schneider, Barrie Thorne, Thomas P. Wilson, et plus particulièrement Sarah Fenstermaker Berk. 1 Par principe, NQF a adopté et promeut la féminisation du langage. Cette traduction met en œuvre cette politique partout où cela est possible et souhaitable, tout en se réservant par endroits de ne pas l’appliquer, c’est-à-dire quand la correction grammaticale pourrait oblitérer une question sociologique. Ainsi, quand des catégories telles que « ami », « conjoint » ou encore « citoyen » ne sont pas féminisées, c’est paradoxalement pour traduire au mieux la réflexion que développent les auteur⋅e⋅s sur la catégorisation de sexe, envisagée ici comme processus prenant place au sein d’une interaction, au sens goffmanien du terme (N.d.t).
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
2
routinier, méthodique et récurrent. Nous avançons que le « faire » du genre est réalisé par des femmes et des hommes dont les compétences de membres de la société sont les otages de sa production2. Accomplir le genre implique un ensemble d’activités socialement orientées, qui ont trait au perceptuel, à l’interactionnel et au micro-politique et qui modèlent des cours d’action particuliers en expressions des « natures » masculine et féminine. En considérant le genre comme un accomplissement, une propriété en cours de réalisation de l’action située, nous nous éloignons de tout ce qui touche de manière interne à l’individu pour focaliser notre attention sur les arènes interactionnelles, sur tout ce qui relève, en dernière instance, de l’institution. En un sens, bien sûr, ce sont les individus qui « font » le genre. Mais il s’agit d’un faire situé, réalisé en la présence virtuelle ou réelle d’autres individus qui sont présumés être orientés en direction de sa production. Plutôt que comme une propriété des personnes, nous concevons le genre comme un trait émergent des situations sociales : tout à la fois comme étant un principe et une conséquence des divers arrangements sociaux, et comme un moyen pour légitimer l’une des divisions les plus fondamentales de la société. Pour asseoir notre argument, nous mènerons un examen critique de ce que les sociologues ont pu signifier par genre, y compris son traitement en tant que performance d’un rôle, pris au sens conventionnel, et en tant que « parade », dans la définition que Goffman (1976) a donnée à ce terme. Les notions de rôle de genre et de parade de genre se focalisent toutes deux sur les aspects comportementaux du fait d’être une femme ou un homme (en opposition, par exemple, aux différences biologiques entre les deux). Néanmoins, nous avançons que concevoir le genre comme un rôle masque le travail qui est impliqué dans la production du genre dans les activités courantes, tandis que le considérer comme une parade relègue ce travail à la périphérie de l’interaction. Selon nous, les individus en interaction organisent leurs activités diverses et variées de manière à refléter ou à exprimer le genre, et elles/ils sont disposé⋅e⋅s à percevoir les comportements d’autrui selon la même perspective. En guise de préalable au développement de notre réflexion, nous suggérerons de tenir compte d’une distinction importante mais souvent négligée, celle entre sexe, catégorie de sexe, et genre. Le sexe est une détermination établie au travers de l’application des critères biologiques socialement admis pour classer les personnes en tant que femelles ou mâles3. Le critère de classification peut s’avérer être les organes génitaux à la naissance, ou la détermination chromosomique après la naissance, et tous ces critères peuvent ne pas concorder nécessairement l’un avec l’autre. La distribution dans une catégorie de sexe est effectuée par l’application des critères de sexe, mais dans la vie de tous les jours, la catégorisation est établie et maintenue par les parades d’identification socialement requises qui proclament l’appartenance à l’une ou l’autre des catégories. Dans ce sens, la catégorie de sexe dont un individu est titulaire présume son sexe et l’incarne, par procuration, dans beaucoup de situations, mais le sexe et la catégorie de sexe peuvent varier indépendamment ; autrement dit, il est possible de revendiquer l’appartenance à une catégorie de sexe quand bien même les critères de sexe manqueraient. Le genre, par contraste, est l’activité consistant à gérer des cours d’actions situées à la lumière des conceptions normatives des attitudes et des activités appropriées à la catégorie de sexe à laquelle on appartient. Les activités de genre émergent des revendications d’appartenance à une catégorie de sexe, et les renforcent.
2 La notion de « membre », propre à l’ethnométhodologie, est utilisée non pas tellement pour faire référence à une personne, mais pour souligner le fait que les individus, du fait de leur appartenance à une communauté sociale donnée, possèdent un certain nombre de compétences ordinaires à catégoriser, à classer, à expliquer, à faire des inférences, à raisonner à toutes fins pratiques. Ces compétences ou ces ethnométhodes sont indissociables du fait que les individus maîtrisent le langage naturel de la société dans laquelle ils et elles vivent et possèdent, via cette maîtrise langagière, une connaissance de sens commun de ses structures sociales et us et coutumes (N.d.t.). 3 Cette définition sous-estime bien des complexités du rapport entre biologie et culture (Jaggar, 1983 : 106-113). Cependant, ce qu’il faut retenir ici est que la détermination de la classe de sexe d’un individu est un processus social de part en part.
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
3
Reconnaître l’indépendance analytique du sexe, de la catégorie de sexe et du genre est selon nous essentiel pour appréhender la manière dont ces trois éléments sont liés entre eux, ainsi que pour saisir le travail interactionnel impliqué dans le fait d’« être » une personne genrée en société. Si notre objectif principal est théorique, nous aurons l’occasion, après avoir exposé notre conception du genre, de présenter quelques axes de recherche qui pourraient être développés dans le cadre de travaux empiriques. Commençons par une évaluation des définitions les plus répandues du genre, en nous intéressant en particulier à la manière dont cette notion est enracinée dans le biologique, origine communément admise des différences entre femmes et hommes. Conceptions du sexe et du genre Dans les sociétés occidentales, il est socialement accepté que les femmes et les hommes sont des catégories d’individus définies en nature et sans équivoque aucune (Garfinkel 1967, pp. 116-18), qui présentent des dispositions comportementales et psychologiques distinctes pouvant être inférées à partir des fonctions reproductives. Les membres adultes et compétents de ces sociétés considèrent que les différences entre femmes et hommes sont fondamentales et durables – des différences qu’attestent, en apparence, la division des activités entre travail féminin et travail masculin et une différenciation entre des attitudes et des comportements féminins et masculins si souvent méticuleuse qu’elle en devient un trait saillant de l’organisation sociale. Les choses sont ce qu’elles sont en vertu du fait que les hommes sont des hommes et les femmes des femmes – une division qui est perçue comme étant naturelle et enracinée dans le biologique et qui aurait à son tour de profondes conséquences psychologiques, comportementales, et sociales. Les arrangements structurels de la société sont censés répondre à ces différences. Les analyses du sexe et du genre en sciences sociales, bien qu’elles soient moins susceptibles d’accepter sans réserve le déterminisme biologique naïf sous-jacent au point de vue présenté à l’instant, retiennent souvent une conception du genre au sein de laquelle les comportements et les caractéristiques liées au sexe sont considérées comme des propriétés essentielles des individus (pour un état des lieux bien informé de la littérature, voir Hochschild, 1973 ; Tresemer, 1975 ; Thorne, 1980 ; Henley, 1985). L’« approche par les différences de sexe » [sex differences approach] (Thorne 1980) est plus communément attribuée aux psychologues qu’aux sociologues, mais le/la chercheur⋅e qui, dans le cadre d’une enquête par questionnaire, détermine le « genre » des répondant⋅e⋅s sur la base du son de leur voix au téléphone effectue également une série de suppositions qui prennent appui sur des traits individuels. Or, réduire le genre à une série fixe de traits psychologiques ou à une « variable » discrète empêche l’examen sérieux des façons dont il est utilisé pour structurer les différents domaines de l’expérience sociale (Stacey et Thorne, 1985 :307-8). Prenant un angle différent, la théorie des rôles a prêté attention à la construction sociale des catégories de genre, ce qu’elle a appelé « rôles de sexe » ou plus récemment « rôles de genre », et a analysé comment ceux-ci sont appris et mis en œuvre. La théorie des rôles, qui a débuté avec Linton (1936), puis s’est poursuivie dans les travaux de Parsons (Parsons, 1951 ; Parsons et Bales, 1955) et Komarovsky (1946 ; 1950), a mis l’accent sur la dimension sociale et dynamique de la construction et de la performance des rôles (Thorne, 1980 ; Connell, 1983). Mais au niveau de l’interaction en face-à-face, l’application de la théorie des rôles au genre pose des problèmes qui lui sont propres (pour des états bien informés et/ou critiques de la littérature, voir Connell, 1983, 1985 ; Kessler, Ashendon, Connell et Dowsett, 1985 ; Lopata et Thorne, 1978 ; Thorne, 1980 ; Stacey et Thorne, 1985). Les rôles sont des identités situées [situated identities] – endossées ou abandonnées selon que la situation l’exige – plutôt que des identités majeures [master identities] (Hughes, 1945), lesquelles, les catégories de sexe en font partie, ne dépendent pas des situations. À la différence de la plupart des rôles, tels que « infirmière », « médecin » et « patient » ou « professeur » et « étudiant », le genre n’a en effet aucun site spécifique ou contexte organisationnel.
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
4
En outre, nombre de rôles sont déjà marqués par le genre, de sorte que des qualificatifs spécifiques – tels que « médecin femme » ou « garde-malade homme » – doivent êtres ajoutés aux exceptions à la règle. Thorne (1980) note que le fait de concevoir le genre comme un rôle rend difficile à évaluer l’influence qu’il peut avoir sur les autres rôles, et réduit son pouvoir explicatif relativement aux questions du pouvoir et des inégalités. S’appuyant sur Rubin (1975), Thorne en appelle à une reconceptualisation des femmes et des hommes comme groupes sociaux distincts, constitués dans « des relations concrètes, socialement et historiquement situées – et généralement inégales » (Thorne, 1980 :11). Selon nous, le genre n’est pas une série de traits individuels, ni une variable, encore moins un rôle, mais le produit de faits et gestes sociaux d’une certaine sorte. Qu’est-ce donc que ce faire social du genre ? C’est plus que la création continue de la signification du genre au travers des actions humaines (Gerson et Peiss, 1985). Nous avançons que le genre lui-même est constitué dans les interactions4. Afin de développer les implications d’une telle affirmation, tournons-nous maintenant vers ce que Goffman (1976) a pu dire de la « parade de genre ». Nous tâcherons en particulier d’examiner dans quelle mesure il est possible de considérer que le genre est montré ou (re)présenté dans les interactions de telle sorte qu’il apparaisse comme quelque chose de « naturel », alors même qu’il s’agit d’une représentation dont la production est socialement organisée. La parade de genre Selon Goffman, quand des êtres humains interagissent dans leur environnement avec d’autres, ils assument que chaque individu possède une « nature essentielle » – une nature qui peut être discernée à travers les « signes naturels émis ou exprimés par eux » (1976 : 75). La féminité et la masculinité sont considérées comme étant « les prototypes d’une expression essentielle – quelque chose qui peut être communiqué fugitivement dans n’importe quelle situation sociale et qui a trait cependant à la caractérisation la plus élémentaire des personnes » (1976 : 75). Les dispositifs au moyen desquels nous réalisons de telles expressions sont « des actes formels et ritualisés » (1976 : 69), qui font savoir aux autres l’estime dans laquelle nous les tenons, indiquent notre alignement quand nous faisons une rencontre, et établissent de manière provisoire les termes de la prise de contact pour cette situation sociale. Mais nous considérons aussi que ces actes sont des comportements expressifs : ils témoigneraient de nos « natures fondamentales ». Pour Goffman (1976, 69-70), les parades sont des comportements extrêmement ritualisés, dont la structure correspond aux échanges conversationnels à deux parties du type déclaration-réplique, au sein desquels la présence ou l’absence de symétrie peut instaurer la déférence ou la dominance. Ces rituels sont distincts d’activités plus conséquentes, telles accomplir une tâche ou s’engager dans une conversation, mais articulées à elles. En conséquence, nous assistons à ce que Goffman appelle l’« ordonnancement » des parades aux points de jonction des activités, au début ou à la fin d’une activité par exemple, de sorte à éviter les interférences avec les activités elles-mêmes. Goffman (1976 : 69) définit la parade de genre comme suit :
« Si le genre peut être défini comme l’ensemble des corrélats culturellement constitués du sexe (que ceux-ci s’ensuivent de la biologie ou de l’apprentissage, peu importe), alors la parade de genre renvoient aux interprétations ritualisées de ces corrélats ».
Ces expressions genrées pourraient témoigner de la dimension fondamentale, souterraine, du féminin et du masculin, mais elles sont, dans la perspective de Goffman, des performances facultatives. La
4 Ce qui ne veut pas dire que le genre est une « chose » singulière, omniprésente sous la même forme dans le temps ou dans chaque situation. Dans la mesure où les conceptions normatives des attitudes et des activités appropriées aux catégories de sexe peuvent varier selon les cultures et les moments historiques, la gestion des conduites en situation peut prendre, à la lumière de ces attentes, des formes diverses et variées.
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
5
courtoisie masculine peut être offerte ou ne pas l’être, et si elle est offerte, elle peut être déclinée tout comme elle peut être acceptée (1976 : 71). Par ailleurs, les êtres humains « eux-mêmes font recours au terme ‘expression’, et se comportent de manière à correspondre à leurs propres idéaux d’expressivité » (1976 : 75). Les représentations du genre sont moins une conséquence de nos « natures sexuelles essentielles » que des évocations, produites dans l’interaction, de ce que nous aimerions communiquer au sujet de nos natures sexuelles, en usant de gestes ritualisés. De par notre nature humaine, nous avons la capacité à apprendre à produire et à reconnaître des parades de genre masculines et féminines – « une compétence que [nous] détenons en vertu de notre appartenance au genre humain, et non pas du fait que nous sommes des hommes et des femmes » (1976 : 76). De prime abord, il semble que la conceptualisation de Goffman offre un correctif sociologiquement engageant eu égard aux définitions préexistantes du genre. Suivant sa conception, le genre est une dramatisation socialement scénarisée des idéalisations culturelles des natures féminines et masculines, jouée devant une audience bien informée des codes de la représentation. Pour filer la métaphore, les performances de genre sont agencées et présentées dans des lieux spécifiques, et comme les pièces de théâtre, elles sont le prélude ou le postlude d’activités plus sérieuses. Mais cette perspective n’est pas sans contenir d’importantes ambiguïtés. En séparant la parade de genre des affaires sérieuses qui ont cours dans les interactions, Goffman rend opaques les effets qu’a le genre sur une large gamme d’activités humaines. Le genre n’est pas seulement quelque chose qui apparaît aux coins et recoins de l’interaction, qui est casé ici ou là et qui n’interfère pas avec les affaires sérieuses de la vie. S’il est plausible d’affirmer que les parades de genre – en tant qu’elles sont des expressions ritualisées – sont des éléments interactionnels à option, il semble peu recevable d’affirmer que nous avons le choix d’être vus par autrui comme une femme ou comme un homme. Dès lors, il est nécessaire d’aller au-delà de la notion de parade de genre pour considérer ce qui est impliqué dans la fabrication du genre en tant que cette production relève d’un faire, une faire à concevoir comme une activité continue, enchâssée dans les interactions de la vie courante. C’est pourquoi nous allons revenir aux distinctions entre le sexe, la catégorie de sexe et le genre que nous avons introduites plus haut. Sexe, catégorie de sexe, et genre L’étude de cas que Garfinkel (1967 : 118-140) a consacrée à Agnès, une transsexuelle qui, ayant été élevée comme un garçon, a adopté à l’âge de 17 ans une identité féminine et a entrepris une opération de réassignation de sexe quelques années plus tard, montre comment le genre est produit dans et à travers les interactions, des interactions qu’il contribue dans le même temps à structurer. Avant comme après son opération chirurgicale, Agnès, que Garfinkel définit comment étant une « méthodologue pratique », a développé tout un ensemble de procédures afin de passer pour une « femme naturelle, normale ». Elle avait la tâche pratique de gérer le fait de posséder des organes génitaux masculins ainsi que d’être dépourvue, dans les interactions de la vie courante, des ressources sociales dont on peut supposer que la trajectoire de vie propre à une jeune fille aurait fourni le principe. En résumé, elle devait paraître aux yeux des autres comme une femme en même temps qu’elle apprenait ce qu’être une femme était. Inévitablement, cette entreprise de chaque instant prenait place à un moment où les identités de genre de la plupart des gens avaient été pleinement ratifiées et étaient devenues des affaires routinières. Agnès devait s’arranger pour faire consciemment ce que la grande majorité des femmes faisaient sans y penser. Elle n’« imitait » pas ce que les femmes « réelles » font naturellement. Elle était obligée d’analyser les situations, de manière à parvenir à saisir comment agir dans le cadre de circonstances socialement structurées et en fonction de conceptions de la féminité que les femmes nées avec les référents biologiques appropriés prennent très tôt pour allant de soi. À l’instar d’autres personnes contraintes à « passer », telles que les travesti⋅e⋅s, les acteurs du théâtre Kabuki, ou le personnage de « Tootsie » joué par Dustin Hoffman, le cas d’Agnès rend visible ce que la culture a rendu invisible – l’accomplissement du genre.
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
6
Dans son analyse du cas Agnès, Garfinkel (1967) ne sépare pas explicitement trois concepts qui, bien qu’ils se recoupent à un niveau empirique, sont distincts d’un point de vue analytique – le sexe, la catégorie de sexe, et le genre. Le sexe Agnès ne possédait pas les critères biologiques socialement requis à sa catégorisation en tant que personne titulaire du sexe féminin. Pour autant, elle se considérait comme étant de sexe féminin, même si elle était une femme avec un pénis, un appendice qu’une femme ne devrait pas posséder. Son pénis, insistait-elle, était une « erreur » à laquelle il était nécessaire de remédier (Garfinkel, 1967 : 126-127 ; 131-132). À l’instar des autres membres compétents de notre société, Agnès honorait l’idée selon laquelle il existe des critères biologiques « essentiels », qui distinguent sans ambiguïté les femmes des hommes. Toutefois, si nous prenons de la distance avec le point de vue du sens commun, nous découvrons que la fiabilité de ces critères est loin d’être indiscutable (Money et Brennan, 1968 ; Money et Erhardt, 1972 ; Money et Ogunro, 1974 ; Money et Tucker, 1975). En outre, un certain nombre de cultures autres que la nôtre ont reconnu l’existence de personnes ayant « changé de sexe » [« cross-genders »] (Blackwood, 1984 ; Williams, 1986), ainsi que la possibilité de l’existence de plus de deux sexes (Hill, 1935 ; Martin et Voorhies, 1975 : 84-107 ; mais aussi Cucchiari, 1981 : 32-35). La remarque suivante de Kessler et McKenna (1978 : 1-6) est un élément encore plus décisif apporté à cet argument : les organes génitaux sont par convention dissimulés à l’inspection publique dans la vie courante ; ce qui ne nous empêche pas, rencontre sociale après rencontre sociale, de continuer à « observer » un monde naturellement et normalement composé de personnes des deux sexes. Au principe de la catégorisation de sexe, il y a donc la présomption selon laquelle des critères fondamentaux existent et seraient là, ou devraient être là, si nous les cherchions. S’inspirant de Garfinkel, Kessler et McKenna avancent que les êtres « femelle » ou « mâle » sont des événements culturels – les produits de ce qu’elles appellent le « processus d’attribution de genre » – plutôt que des collections de traits, de comportements, ou même d’attributs physiques. Pour illustrer ce point, elles citent l’enfant qui, contemplant l’image d’un individu vêtu d’un complet et d’une cravate, précise : « C’est un homme, parce qu’il a un zizi » (Kessler et McKenna, 1978 : 1549). Ce qu’il faut traduire par : « Il doit avoir un zizi [une caractéristique essentielle] parce que je vois un complet et une cravate, qui en sont les signes ». Ni l’assignation de sexe initiale (le fait de déclarer, à la naissance, qu’un bébé est femelle ou mâle), ni l’existence effective des critères essentiels en vue de cette assignation (la possession d’un clitoris et d’un vagin ou d’un pénis et de testicules) n’a grand-chose à voir – si ce n’est rien – avec l’identification de la catégorie de sexe dans la vie courante. Là, comme le relèvent Kessler et McKenna, nous spéculons à partir de la certitude morale d’un monde bi-catégorisé selon le sexe. Nous ne nous disons pas : « La plupart des individus avec pénis sont des hommes, mais certains peuvent ne pas en être » ; ou « La plupart des individus habillés comme des homme ont un pénis ». Nous tenons plutôt pour allant de soi que le sexe et la catégorie de sexe sont congruents – que connaissant la catégorie de sexe, nous pouvons en déduire le reste. La catégorisation de sexe La revendication d’Agnès au statut catégoriel de femme, qu’elle maintenait par le bais de parades d’identification appropriées ainsi que d’autres caractéristiques, aurait pu être discréditée avant son opération de changement de sexe s’il avait été rendu public qu’elle possédait un pénis, et après également, en raison de ses organes génitaux reconstruits par le truchement de la chirurgie (voir Raymond, 1979 : 37, 138). À cet égard, Agnès se devait de rester constamment vigilante vis-à-vis des menaces réelles ou potentielles qui pesaient sur la sécurité de sa catégorie de sexe. Son problème n’était pas tant de s’efforcer à correspondre à une sorte de prototype de « la » féminité, que de préserver sa catégorisation en tant que femme. Une ressource à l’efficacité redoutable lui rendait la tâche plus facile : le processus de catégorisation de sens commun dans la vie courante.
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
7
La catégorisation des êtres sociaux dans des catégories indigènes telles que « fille » ou « garçon », ou « femme » ou « homme », opère selon une logique typiquement sociale. L’acte de catégorisation n’implique pas la mise en œuvre d’un test formel, dans le sens où procéder à une identification nécessiterait préalablement qu’une série bien définie de critères soit explicitement remplie. Dans les interactions ordinaires, la mise en application des catégories d’appartenance repose plutôt sur un test du type « si, alors » (Sacks, 1972 : 332-335). Ce test prescrit la règle suivante : si des personnes peuvent être vues comme les membres des catégories qui s’appliquent à elles, alors procédez à la catégorisation qui s’impose. Autrement dit, utilisez la catégorie qui semble appropriée, sauf en la présence d’une information contradictoire ou d’éléments évidents qui en excluraient l’usage. Cette procédure est globalement conforme avec l’attitude naturelle qui nous fait prendre, à moins d’avoir des raisons particulières d’en douter, les apparences pour la réalité (Schütz, 1943 ; Garfinkel, 1967 ; 272-277 ; Bernstein, 1986)5. Il faut ajouter que c’est précisément quand nous avons de bonnes raisons d’en douter que l’application de critères stricts devient un problème ; mais il est rare, en dehors des contextes légaux ou bureaucratiques, de rencontrer des personnes qui s’adonnent avec obstination aux tests formels (Garfinkel, 1967 : 262-283 ; Wilson, 1970). La première ressource sur laquelle Agnès pouvait s’appuyer était la prédisposition manifestée par les personnes qu’elle rencontrait à prendre son apparence (sa silhouette, ses vêtements, sa coupe de cheveux, etc.) pour l’apparence incontestable d’une femme normale. L’autre ressource sur laquelle elle pouvait compter est notre croyance de sens commun des propriétés des « personnes naturelles, normalement sexuées ». Garfinkel (1967 : 122-128) relève que dans la vie de tous les jours, nous vivons dans un monde composé de deux – et seulement deux – sexes. Cette division du monde a un statut moral, dans le sens où nous nous y incluons, ainsi que les autres, en tant que nous sommes « essentiellement, originellement, en tout premier lieu, soit « homme » soit « femme » ; nous l’avons toujours été, nous le serons toujours, une fois pour toutes et en dernière analyse » (Garfinkel, 167 : 122). Considérons le cas suivant : « Cette question me rappelle la brève incursion que j’ai faite, il y a de cela quelques années, dans un magasin de matériel informatique. La personne qui répondait à mes questions faisait clairement partie du personnel de vente. Je ne pouvais cependant pas le/la catégoriser comme femme ou homme. Qu’ai-je passé en revue ? (1) Poils du visage : elle/il était glabre, mais certains hommes ont peu ou pas du tout de poils au visage (ça varie selon la race, les Amérindiens et les Noirs Américains n’en ont souvent pas). (2) Poitrine : elle/il portait une chemise ample qui tombait depuis ses épaules. Et, comme nombre de femmes qui ont été adolescentes durant les années 1950 le savent, tant elles en ont retiré de la honte, il est fréquent pour une femme d’avoir le buste plat. (3) Épaules : les siennes étaient petites et rondes pour un homme, larges pour une femme. (4) Mains : doigts longs et fins, articulations un peu trop anguleuses pour une femme, trop effacées pour un homme. (5) Voix : tonalité moyenne, inexpressive pour une femme, absolument dénuée des accents exagérés que certains gays affectent. (6) Sa manière de me traiter : ne me donnait aucun signe qui pouvait m’indiquer que je possédais un sexe différent ou identique au sien. Il n’y avait même aucun signe montrant qu’il/elle savait que son sexe était difficile à catégoriser et je m’en étonnais bien que je fisse de mon mieux pour dissimuler ma confusion, de manière à ne pas l’embarrasser tandis que nous discutions d’un papier pour impression informatique. Je quittai le magasin toujours sans connaître le sexe de la personne qui m’avait servie, toute perturbée (enfant de ma culture que j’étais) d’avoir laissé cette question sans réponse » (Diane Margolis, communication personnelle). Que peut nous dire ce cas des situations telles que celles vécues par Agnès (cf. Morris, 1974 ; Richards, 1984), ou du processus de catégorisation de sexe plus largement ? En premier lieu, nous pouvons inférer de cette description que la parade d’identification de la vendeuse/du vendeur était 5 Bernstein (1986) rapporte un cas inusuel d’espionnage, au cours duquel un homme qui se faisait passer pour une femme convainquait un amant qu’il/elle avait donné naissance à « leur » enfant, un enfant dont l’amant pensait qu’il lui « ressemblait ».
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
8
ambiguë, dans la mesure où elle/il n’était pas vêtu⋅e ou orné⋅e dans un style univoquement féminin ou masculin. C’est quand une telle parade échoue à fournir une base solide à la catégorisation que des éléments tels que les poils du visage ou le son de la voix sont évalués dans la perspective de déterminer l’appartenance à une catégorie de sexe. En deuxième lieu, au-delà du fait qu’il s’agit là d’un incident qui peut être rapporté même après « plusieurs années », on peut noter que la cliente n’était pas seulement « perturbée » par l’ambiguïté de la catégorie d’appartenance de sexe de la vendeuse/du vendeur ; elle estimait également que reconnaître l’existence de cette ambiguïté aurait pu mettre son vis-à-vis dans l’embarras. C’est que non seulement nous voulons connaître la catégorie de sexe des personnes à l’entour (la distinguer d’un coup d’œil, peut-être) ; nous présupposons aussi que les autres l’exhibent à notre adresse de manière aussi convaincante et tranchante que possible. Le genre Agnès essayait d’être une « femme à 120% » (Garfinkel, 1967 :129), autrement dit d’être féminine sans contestation possible aucune, en tout temps et en tout lieu. Elle pensait qu’en se comportant de manière féminine, elle pouvait se protéger des aveux qu’elle-même aurait pu commettre à son insu, avant et après l’opération chirurgicale ; mais exagérer la performance aurait pu a contrario faire œuvre de révélation. La catégorisation de sexe et l’accomplissement du genre ne sont pas une seule et même chose. La catégorisation d’Agnès pouvait être indubitable ou douteuse, mais elle ne dépendait pas du fait qu’elle respectât ou non une quelconque conception idéale de la féminité. Certaines femmes peuvent être jugées non-féminines, mais cela ne fait pas d’elles des « non-femmes ». Agnès était confrontée à la tâche continue d’être une femme – quelque chose qui va au-delà du style de vêtement (une parade d’identification) ou de l’activité ritualisée qui consiste à permettre aux hommes d’allumer sa cigarette (une parade de genre). Son problème était de produire des configurations de comportements reconnaissables par autrui comme étant des comportements de genre appropriés, à savoir conformes à la catégorie de sexe à laquelle elle revendiquait appartenir. « Apprendre en secret », prêter par exemple une grande attention au jugement critique auquel son fiancé soumettait les autres femmes et apprendre ce faisant en quoi consistaient les convenances auxquelles une femme doit normalement se conformer, était la stratégie que suivait Agnès. Cette stratégie était un moyen de masquer ses incompétences et simultanément d’acquérir les savoir-faire requis (Garfinkel, 1967 : 146-147). C’est par le biais de son fiancé qu’Agnès apprit que se dorer au soleil sur la pelouse devant son appartement était un acte « déplacé » (parce que cela l’exposait au regard des autres hommes). Elle apprit également des critiques que ce dernier émettait à l’endroit d’autres femmes qu’il n’était pas de bon ton qu’elle insiste pour faire les choses à sa façon, qu’elle fasse état de ses opinions ou encore revendique l’égalité avec les hommes (Garfinkel, 167 : 147-148). (Comme d’autres femmes dans nos sociétés, Agnès apprit au cours de son « éducation » un certain nombre de choses sur le pouvoir). La culture médiatique populaire est riche en livres et magazines où sont compilées des représentations idéalisées des relations entre femmes et hommes. Les ouvrages qui se focalisent sur le cérémonial des rendez-vous amoureux (hétérosexuels) ou sur les standards en vigueur en termes de comportements féminins sont destinés à fournir une aide pratique en ces matières. Toutefois, l’utilisation de n’importe laquelle de ces sources à la manière d’un manuel de procédures suppose nécessairement l’hypothèse suivante : faire le genre impliquerait simplement l’usage d’un lot de comportements bien définis, bien séparés, qui pourraient tout bonnement être annexés aux situations interactionnelles afin de produire des performances reconnaissables de la masculinité et de la féminité. L’homme « produirait » son identité d’homme en tenant par exemple une femme par le bras pour la guider le long d’une rue, et celle-ci « produirait » son identité de femme en consentant à être guidée et en ne prenant pas d’initiative semblable avec un homme. Il est possible qu’Agnès ait eu recours à des ouvrages tels que ces manuels mais, selon nous, faire le genre n’est pas quelque chose d’aussi réglementé (Mithers, 1986 ; Morris, 1974). De telles sources d’informations peuvent lister et décrire les types de comportements qui sont la marque du genre, ou
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
9
qui l’affichent, mais elles sont nécessairement incomplètes (Garfinkel, 1967 :66-.75 ; Wieder, 1974 : 183-214 ; Zimmerman et Wieder, 1970 : 285-298). Pour qu’elles soient couronnées de succès, les activités qui consistent à marquer ou à afficher le genre doivent être adaptées avec beaucoup de soin aux situations, et modifiées ou transformées quand les circonstances l’exigent. Faire le genre consiste à gérer les circonstances de telle sorte que, quelles que soient les particularités des situations, ce qui en ressort soit vu et visible comme étant, dans le contexte, approprié ou inapproprié au genre, accountable6 autrement dit. Genre et accountability Comme Heritage (1984 : 136-137) l’a noté, les membres de la société entreprennent régulièrement de « s’adresser les un·e⋅s aux autres des comptes rendus visant à décrire et à rapporter ce qui est en train de se passer », des comptes rendus qui sont à la fois sérieux et non sans conséquences. Ces descriptions du monde consistent à nommer, caractériser, formuler, expliquer, excuser, condamner, ou simplement à relever telle ou telle circonstance ou activité, et à ranger ces dernières à l’intérieur d’un certain cadre social (de manière à les situer par rapport à d’autres activités, analogues ou différentes). Ces activités ordinaires [de description du monde] ont pour propriété d’être elles-mêmes accountable, [c’est-à-dire intelligibles, observables, descriptibles, rapportables, visibles, reconnaissables, à toutes fins pratiques,] et les membres de la société s’orientent en fonction du fait que leurs activités sont sujettes à commentaire, [à explication, à reproduction]. Les actions sont souvent configurées en regard de leur accountability : en d’autres termes, les activités sont réalisées en fonction de la forme sous laquelle elles pourraient apparaître et de la manière dont elles pourraient être interprétées. La notion d’accountability encapsule aussi celles parmi les actions entreprises qui sont parmi les plus routinières et les plus anodines, qui ne méritent pas plus d’attention qu’une remarque faite en passant, et ceci parce qu’elles sont vues comme étant en accord avec les standards culturellement approuvés. Heritage (1984 : 179) observe que le processus qui consiste à rendre quelque chose accountable [un individu, une activité, un événement] a un caractère proprement interactionnel : « [Ceci] permet aux acteurs de configurer les actions en fonction des circonstances pratiques de leur réalisation, de manière à permettre à autrui, par le fait même de rapporter les actions aux circonstances, de reconnaître les actions pour ce qu’elles sont. » Le terme clé ici est celui de circonstances. La catégorie de sexe d’un individu est une circonstance qui est présente dans pratiquement toutes les actions, dans toutes les interactions. Comme Garfinkel (1967 : 118) le note : « [L]es efforts entrepris par [Agnès] pour « passer » [passing], et les occasions socialement organisées où elle avait à maintenir le statut sexuel de son choix résistaient obstinément à toute tentative de routinisation du cours des activités de la vie quotidienne. Cette résistance obstinée indique à quel point 6 Difficilement traduisibles étant donné leur polysémie, les termes « account », « accountable » ou encore « accountability » sont au cœur du projet ethnométhodologique, qui souligne par là le fait que les membres de la société agissent rationnellement et avec méthode, de telle sorte à rendre leurs activités ordinaires disponibles et reconnaissables pour ce qu’elles sont. En ce sens, les activités de la vie quotidienne, au travers desquelles les membres réalisent sur un mode routinier, sans y penser, l’objectivité des faits sociaux (en l’occurrence ici l’objectivité de l’identité de genre), sont dotées de réflexivité. Par « accountable », Garfinkel entend observable et rapportable, ou encore visible et dicible, intelligible et racontable, explicable, justifiable. Il est commun de traduire « account » par compte rendu ou description, « accountable » par descriptible et « accountability » par descriptibilité (cf. Garfinkel, 2007, note 1, p. 45). Un tel choix, que nous suivrons ici, respecte le principe suivant : se trouver devant la nécessité de rendre des comptes, de répondre ou encore de justifier ses actes ou de son identité suppose au préalable que ses actes ou son identité soient intelligibles, reconnaissables, descriptibles, etc. Aussi, comme le soulignent West et Zimmerman dans la dernière section de l’article, quand nous échouons à faire le genre de manière intelligible, quand nous exhibons une incompétence manifeste et observable à accomplir le genre, nous courons le risque de devoir rendre des comptes au sujet de notre identité (N.d.t.).
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
10
le statut sexuel est omnipertinent dans les activités courantes, où il constitue un arrière-plan invariant mais inaperçu dans la trame des pertinences qui composent les scènes réelles et changeantes de la vie quotidienne (mis en italique par nous) ».7 Si la catégorie de sexe est omnipertinente (ou presque), alors, dans pratiquement n’importe quelle activité, la performance de la personne engagée dans l’activité en question peut être rapportée à la performance d’une femme ou d’un homme, et son appartenance à l’une ou l’autre des catégories de sexe peut être utilisée pour légitimer ou discréditer ses autres activités (Berger, Cohen et Zelditch, 1972 ; Berger, Conner et Fisek : 1974 ; Berger, Fisek, Norman et Zelditch, 1977 ; Humphreys et Berger, 1981). En conséquence, pratiquement n’importe quelle activité peut être évaluée en termes de féminité ou de masculinité. Et soulignons-le, « faire » le genre ne consiste pas toujours à se conformer aux conceptions normatives de la féminité ou de la masculinité ; c’est s’engager dans une action au risque d’une évaluation de genre. Si ce sont les individus qui font le genre, le principe de cette activité est fondamentalement interactionnel et institutionnel : l’accountability est en effet un trait des relations sociales et elle puise ses codes d’expression dans l’arène institutionnelle au sein de laquelle ces relations se déploient. Si tel est bien le cas, pouvons-nous alors ne pas faire le genre ? Dans la mesure où une société est organisée en fonction des différences qu’elle estime « fondamentales » entre femmes et hommes, et où placer une personne dans une catégorie de sexe est une procédure tout à la fois appropriée et appliquée, faire le genre est inévitable. Les ressources mobilisées pour faire le genre Faire le genre signifie créer des différences entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, des différences qui ne sont ni naturelles, ni essentielles ou encore biologiques. Une fois que les différences ont été produites, elles sont mobilisées en retour pour faire valoir la « naturalité » du genre. Dans un passage tout à fait délicieux de l’« arrangement entre les sexes », Goffman (1977) note l’existence de toute une variété de cadres sociaux institutionnalisés au sein desquels notre « appartenance de sexe normale, naturelle » peut être mise en scène. Les éléments matériels dont sont constitués ces cadres sociaux fournissent indéniablement des ressources à l’expression de nos différences « fondamentales ». Par exemple, les toilettes publiques en Amérique du Nord distinguent les « dames » des « messieurs », comme s’il y avait en cette matière des raisons proprement biologiques à séparer les sexes, alors que femmes et hommes « sont plutôt similaires relativement à la question de la production et de l’élimination des déchets » (Goffman, 1977 : 315). Ces cadres institutionnels sont équipés de dispositifs dimorphes (tels les urinoirs pour les hommes versus les lieux de toilette équipés de tables de coiffage et de maquillage pour les femmes), quand bien même les deux sexes peuvent parvenir aux mêmes fins par des moyens identiques (et le font apparemment dans l’intimité de leurs propres foyers). Ce qui est à relever ici est le fait que : « Le fonctionnement d’organes sexuellement différenciés est en cause, mais il n’y a rien dans ce fonctionnement qui nécessite, pour des raisons biologiques, la ségrégation sexuelle des individus ; ce dispositif est en totalité un phénomène culturel. […] La séparation des toilettes est présentée comme une conséquence naturelle de la différence entre les catégories de sexe, alors qu’en fait il s’agit plutôt d’un moyen d’honorer, sinon de produire, cette différence » (Goffman, 1977 : 316). S’agissant de la production des « natures féminine et masculine essentielles », les situations sociales normalisées constituent également des lieux où s’entraîner à les évoquer. Les activités sportives organisées sont un exemple que donne Goffman de ces cadres sociaux institutionnalisés où la masculinité peut s’exprimer. Dans ce cas, les qualités qui, « selon les normes en usage », devraient être
7 Comme le souligne Garfinkel (1967 [2007]), « passer » relève, dans le cas d’Agnès, d’un véritable travail de tous les instants : elle devait s’assurer continûment et dans toutes les situations de l’apparence qu’elle exhibait, de sorte à ce que son appartenance à la catégorie « femme » ne puisse jamais être mise en défaut. Aussi, Agnès n’avait jamais « passé » une bonne fois pour toutes ; au contraire, chaque situation était une situation nouvelle où elle avait à « passer » (N.d.t.).
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
11
associées à la masculinité, telles que l’endurance, la force physique et l’esprit de compétition, sont glorifiées par toutes les parties concernées par la scène – par les participant⋅e⋅s, qui pourraient être vu⋅e⋅s en train de manifester de tels traits, et par les spectateurs et les spectatrices, qui applaudissent à leurs démonstrations réfugié⋅e⋅s en lieu sûr sur la ligne de touche (1977 : 322). Ajoutons que les pratiques d’appariement des couples hétérosexuels, qui suivent une logique bien spécifique, constituent un dispositif supplémentaire de création et de maintien des différences entre les femmes et les hommes. Par exemple, et bien que la taille, la corpulence et l’âge soient des éléments qui tendent à être distribués de façon normale (en courbe de Gauss) tant chez les femmes que chez les hommes (avec d’importants recouvrements entre les deux groupes), la façon sélective dont les catégories de sexe s’associent garantit la formation de couples au sein desquels les garçons et les hommes sont manifestement plus grands, plus robustes et plus vieux (si ce n’est plus « sages ») que les filles et les femmes. De telle sorte que si des situations exigeant une taille ou une force supérieures ou encore une grande expérience devaient se présenter, les garçons et les hommes seront toujours prêts à afficher ces qualités, et les filles et les femmes disposées à apprécier à leur juste valeur leurs mises en scène (Goffman, 1977 : 321 ; West et Iritani, 1985). Dans certaines situations, il arrive que le genre soit façonné sans qu’on y prête la moindre attention, de la manière la plus routinière qui soit. Il s’agit des situations qui, en regard des conventions, semblent se prêter immédiatement à son expression, celles qui présentent des femmes « sans défense » aux côtés d’objets lourds ou de pneus crevés par exemple. Cependant, comme le note Goffman, il est possible d’élaborer et d’entreprendre des activités pénibles, salissantes et précaires, à partir de n’importe quelle situation sociale, « même si, relativement aux standards propres à d’autres cadres sociaux, ces mêmes situations impliqueraient quelque chose de léger, de propre, et qui ne présente aucun danger » (Goffman, 1977 : 324). Etant donné ces ressources, il est clair que toute situation d’interaction offre potentiellement une scène aux représentations de nos natures sexuelles « essentielles ». Au fond, ces situations « ne permettent pas tant l’expression des différences naturelles entre femmes et hommes qu’elles ne rendent possible la production même de cette différence » (Goffman, 1977 : 324). De nombreuses situations ne sont pas a priori clairement catégorisées selon le sexe, et il n’est pas non plus évident que ce qui s’y passe soit pertinent relativement au genre. Pour autant, toute rencontre sociale peut être enrôlée au service de l’accomplissement du genre. Ainsi, la recherche que Fishman (1978) a consacrée aux conversations informelles entre membres de couples hétérosexuels a montré l’existence d’une « division du travail » asymétrique dans les échanges. Les femmes se retrouvaient à poser plus de questions, à remplir plus fréquemment les silences, et à chercher plus souvent à attirer l’attention au moment d’engager la conversation, de sorte à être entendues. Les conclusions de cette étude sont particulièrement pertinentes ici : « Dans la mesure où le travail interactionnel est lié à ce en quoi être une femme consiste, à ce qu’est une femme, l’idée selon laquelle prendre part à une interaction est du travail perd de sa netteté. Ce travail n’est pas vu comme quelque chose que les femmes font, mais comme une partie de ce qu’elles sont (Fishman, 1978 : 405). » Nous aimerions avancer que c’est précisément un tel travail qui permet de constituer la nature essentielle des femmes en tant qu’elles sont des femmes dans les situations d’interaction (West et Zimmerman, 1983 : 109-111 ; voir également Kollock, Blumstein et Schwartz, 1985). Les individus ont plusieurs identités sociales qui peuvent être, selon les situations, endossées ou délaissées, atténuées ou rendues saillantes. On peut appartenir à la catégorie « ami », « conjoint », « employé », « citoyen » et beaucoup d’autres encore pour beaucoup de personnes différentes – ou pour la même personne à différents moments. Mais nous sommes toujours soit des femmes soit des hommes – à moins que nous passions d’une catégorie de sexe à l’autre. Ceci signifie que nos parades d’identification recèlent, en vue de l’accomplissement du genre, des ressources à jamais disponibles dans un ensemble infini de circonstances diverses et variées.
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
12
Certaines occasions sont organisées de sorte à exhiber et à glorifier de façon routinière des comportements conventionnellement liés à l’une ou l’autre des catégories de sexe. En de telles occasions, chacun⋅e connaît sa place dans l’ordre interactionnel des choses. Si un individu qui a été identifié comme appartenant à une catégorie de sexe s’engage dans un comportement habituellement associé à l’autre catégorie de sexe, cette routinisation est contestée. Hughes (1945 : 356) a livré une excellente illustration de ce type de dilemme : « [U]ne jeune femme […] était devenue membre de la profession, pour le moins virile, d’ingénieur. En général, le dessinateur qui a conçu les plans d’un avion participe au vol inaugural du premier exemplaire construit. Il (sic) organise ensuite un dîner pour les ingénieurs et les ouvriers qui ont travaillé au nouveau modèle – il s’agit naturellement d’un dîner entre hommes. La jeune femme en question avait dessiné le plan d’un nouvel avion. Ses collègues la prièrent de ne pas prendre le risque – que seuls les hommes sont censés pouvoir prendre – du premier vol. En fait, ils lui demandaient d’être une femme plutôt qu’un ingénieur. Elle choisit d’être un ingénieur. Elle organisa ensuite le dîner, et le paya comme un homme. Après le repas et la première tournée bue à sa santé, elle s’en alla comme une dame ». À cette occasion, les parties en présence ont abouti à un arrangement qui a permis à une femme d’adopter des comportements tenus pour masculin. Toutefois, il est à noter que ce compromis a permis au final la démonstration de la féminité « essentielle » de l’ingénieure, dans la mesure où il fut possible de rendre compte de sa conduite comme étant la conduite typique d’une femme « bien élevée, raffinée et respectable ». Hughes (1945 : 357) suggère que de telles contradictions peuvent être contrebalancées en contenant les interactions dans une voie très étroite, notamment « en maintenant la relation sous des auspices formels et spécifiques ». Mais le fond du problème est que même – surtout, peut-être – si la relation est d’ordre formel, le genre reste quelque chose dont une personne est comptable. Aussi, il arrive que l’on accorde au médecin femme (notons l’ajout de l’épithète spécifique dans ce cas) le respect dû à son savoir-faire, et même que l’on s’adresse à elle en usant du titre approprié. Cela n’empêche pas qu’elle soit soumise à évaluation et jugée sur la base des conceptions normatives des attitudes et des activités appropriées à sa catégorie de sexe, et qu’elle soit mise en demeure de prouver qu’elle est « fondamentalement » une femme, malgré les apparences qui tendraient à dire le contraire (West, 1984 : 97-101). On fait appel à sa catégorie de sexe pour discréditer sa participation à des activités médicales importantes (Lorber, 1984 : 52-54), tandis que son investissement dans la médecine est utilisé pour déconsidérer son engagement envers les responsabilités qui lui échoient en tant que mère et épouse (Bourne et Wilker, 1978 : 435-37). Dans un même mouvement, son exclusion de la communauté constituée par ses collègues médecins est maintenue et son accountability en tant que femme est garantie. Dans ce contexte, « le conflit de rôles » peut être considéré comme un aspect dynamique de notre « arrangement entre les sexes » (Goffman, 1977) actuel, un arrangement qui aménage des occasions au sein desquelles des personnes appartenant à une certaine catégorie de sexe peuvent « voir » assez nettement qu’elles ne sont pas à leur place, et que les problèmes qu’elles rencontrent n’existeraient pas si elles ne l’occupaient pas. Ce qui se joue ici est, au plan de l’interaction, la gestion de nos natures « essentielles », et, au niveau de l’individu, l’accomplissement continu du genre. Car si les catégories de sexe sont présentes dans toutes les situations de la vie courante, comme nous l’avons avancé, alors chaque situation, qu’elle soit conflictuelle ou non, offre des ressources pour faire le genre. Nous avons cherché à montrer que les catégories de sexe et le genre sont des propriétés orientées du comportement, qui sont arrangées suivant une logique propre, à savoir en fonction du fait que les autres vont nous juger et nous répondre selon des modalités spécifiques. Nous avons affirmé que le genre d’un individu n’est pas simplement une dimension de ce qu’il est ; il est, plus fondamentalement, quelque chose que l’on fait, et que l’on fait de manière répétée, en interagissant avec autrui.
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
13
Quels sont les champs d’interrogation ouverts par cette conceptualisation ? En l’occurrence, si les individus s’efforcent d’accomplir le genre en situation de co-présence, comment une culture s’y prend-elle pour instiller le besoin de le réaliser ? Comment l’accomplissement du genre, qui se situe au niveau de l’interaction, est-il lié aux arrangements institutionnels, dont celui de la division sociale du travail ? Et la question la plus importante peut-être, dans quelle mesure accomplir le genre contribue-t-il à la subordination des femmes par les hommes ? Axes de recherche Puisqu’il s’agit de soumettre la production sociale du genre à un examen empirique minutieux, nous pourrions commencer par le commencement, soit par reconsidérer le processus au travers duquel les membres d’une société donnée acquièrent l’équipement catégoriel ainsi que les autres compétences nécessaires au fait de devenir des êtres humains genrés. L’enrôlement dans les identités de genre La socialisation par les rôles de sexe est l’approche classique à partir de laquelle le processus consistant à devenir « fille » ou « garçon » est abordé. Ces dernières années, les problèmes récurrents que cette approche soulève ont été associés aux insuffisances inhérentes à la théorie des rôles sociaux en soi – son emphase sur « le consensus, la stabilité et la continuité » (Stacey et Thorne, 1985 : 307), sa perspective anhistorique et dépolitisante (Thorne, 1980 : 9), et le fait que sa dimension « sociale » repose sur « la présupposition générale selon laquelle les individus font le choix de maintenir les us et coutumes existants » (Connell, 1985 : 263). Prenant le contre-pied de cette approche, Cahill (1982, 1986a, 1986b) a analysé les pratiques d’enfants en âge préscolaire en s’appuyant sur la théorie de l’enrôlement dans les identités de genre normalement attendues. Cahill montre que les pratiques de catégorisation sont essentielles aux processus d’apprentissage et de mise en œuvre des comportements féminins et masculins. En premier lieu, observe-t-il, les enfants sont prioritairement préoccupés par le fait d’établir une distinction entre eux-mêmes et les autres, une distinction dont le critère déterminant est celui de la compétence sociale. Indiscutablement, leur préoccupation se ramène à l’opposition entre la catégorisation « fille/garçons » versus la catégorisation « bébé » (cette dernière catégorie désignant les enfants dont le comportement social est problématique et nécessite une surveillance rapprochée). Ce sont donc les inquiétudes éprouvées par les enfants à être vus comme des individus socialement compétents qui suscitent leurs revendications initiales d’appartenance aux identités de genre : « Durant la phase préliminaire de la socialisation enfantine […] les enfants apprennent que seules deux identités sociales leur sont systématiquement disponibles, l’identité de « bébé » ou, selon l’apparence de leurs organes génitaux externes, celle de « grand garçon » ou celle de « grande fille ». En outre, leur entourage les informe par de subtils biais que l’identité de « bébé » est une identité qui pourrait les discréditer. Quand les enfants s’engagent dans des activités réprouvées, on les apostrophe souvent par des « Ne fais pas le bébé ! » ou « Sois un grand garçon ! ». Au fond, ces adresses verbales, qui sont des réponses typiques aux agissements des enfants, sont une manière de leur communiquer qu’ils/elles devraient choisir, au niveau des comportements qu’ils/elles adoptent, entre l’identité dénigrante de « bébé » et leur identité de sexe, ici déterminée en fonction de l’anatomie » (Cahill, 1986a : 175). Par la suite, les petits garçons s’approprient l’idéal de genre de « l’efficacité », être capable d’influer sur l’environnement social et physique par l’exercice de la force physique ou d’autres savoir-faire adaptés à cette fin. À l’opposé, les petites filles apprennent à évaluer « l’apparence », à faire en sorte de devenir elles-mêmes des objets ornementaux. Les deux classes d’enfants [les garçons et les filles] apprennent que reconnaître et utiliser les catégories de sexe en situation d’interaction n’est pas quelque chose de facultatif, mais d’obligatoire (voir aussi Bem, 1983).
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
14
Aussi, être une « fille » ou un « garçon » ne revient pas seulement à être plus compétent qu’un « bébé » ; c’est aussi être une fille ou un garçon de manière compétente, autrement dit apprendre à produire et à exhiber les comportements liés aux identités « essentielles » de fille et de garçon. À cet égard, la tâche à laquelle sont confrontés les enfants de 4 à 5 ans est assez similaire à celle d’Agnès : « Prenons pour exemple cette interaction qui s'est déroulée dans la cour de récréation d’une école maternelle. Un garçon âgé de 55 mois (D) était en train d’essayer de dégrafer le fermoir d’un collier quand une éducatrice de la petite enfance s’approcha de lui. A : Aimerais-tu le mettre ? D : Non. C’est pour les filles. A : Tu n’as pas besoin d’être une fille pour porter des choses autour de ton cou. Les rois portent des choses autour de leur cou. Tu pourrais faire comme si tu étais un roi. D : Je ne suis pas un roi. Je suis un garçon (Cahill, 1986a : 176). » Comme Cahill l’a noté au moment de commenter cet exemple, bien que D pût ne pas connaître exactement le statut sexuel lié à l’identité de « roi », il savait manifestement que les colliers sont utilisés pour exhiber l’identité « fille ». Ayant revendiqué son appartenance à l’identité « garçon », et ayant développé un engagement, en matière de comportement, envers cette identité, il se méfiait de toute conduite qui aurait pu fournir des raisons de mettre en doute sa revendication. Ainsi, dès qu’ils commencent à orienter leurs conduites ainsi que celles des autres en regard de leurs implications de genre, les nouveaux membres de la société en viennent à être engagés dans un processus d’autorégulation. Le processus d’« enrôlement » implique non seulement l’appropriation des idéaux de genre (à travers l’évaluation de ces idéaux en tant qu’ils sont des façons d’être et d’agir propres aux revendications d’appartenance identitaire), mais aussi l’appropriation des identités de genre qui importent aux individus et qu’ils s’efforcent de maintenir. Aussi, les différences de genre, ou le façonnage socioculturel des « natures féminines et masculines essentielles », se voient doter du statut de faits objectifs. Ces identités sont rendues normales, comme si elles étaient des traits individuels naturels, fournissant ce faisant des raisons tacites pour opérer une distinction, au niveau de l’ordre social, entre la destinée des femmes et celle des hommes. Etudier de manière plus approfondie les activités de jeu des enfants, en tant qu’elles sont des situations de la vie quotidienne où s’expriment les comportements appropriés au genre, peut éclairer sous des angles inédits la manière dont nos « natures essentielles » sont construites. En particulier, la transition entre ce que Cahill (1986a) appelle « l’apprentissage par participation » dans les mondes ségrégués selon le sexe, communs aux enfants à l’école primaire, et « la participation en toute bonne foi » au monde hétérosocial que craignent tant les adolescent⋅e⋅s est probablement, dans la perspective de la compréhension du processus d’enrôlement, un objet clé d’investigation (Thorne, 1986 ; Thorne et Luria, 1986). Genre et division du travail Chaque fois que des individus font face à des problèmes d’attribution – qui doit faire ou obtenir quoi, qui doit planifier ou exécuter l’action, guider ou être guidé⋅e –, il apparaît que l’appartenance à des catégories aussi socialement significatives que celles de « femme » ou d’« homme » devient hautement pertinente. La manière dont ces questions sont résolues conditionne l’exhibition, la dramatisation, ou la célébration de nos « natures essentielles » de femme ou d’homme. Ce point est démontré avec beaucoup d’élégance par Berk (1985), dans son enquête sur la répartition du travail domestique et sur les attitudes des couples mariés à l’égard de la division des tâches domestiques. Elle a observé peu de variation entre les conjoint⋅e⋅s, tant à l’égard de la répartition effective des tâches qu’au niveau de la perception, en termes d’équité, de cette répartition. Les
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
15
épouses, mêmes si elles exercent une activité professionnelle, effectuent la grande majorité du travail domestique et des tâches liées aux soins et à l’éducation des enfants. En outre, épouses et époux tendent à percevoir cette répartition comme étant un arrangement « juste ». Prenant acte de l’incapacité de la sociologie classique ou des théories économiques à expliquer ce qui semble bien être une contradiction, Berk suggère que ce qui est impliqué dans la production des biens et des services domestiques est plus complexe qu’un arrangement fondé sur la rationalité : « ‘Qui dispose de plus de temps pour le faire ?’, ‘Le temps de qui est-il le plus précieux ?’, ‘Qui est le/la plus compétent⋅e ou possède le plus de pouvoir ?’ : dans la mesure où la question se pose rarement en ces termes, il est clair que ce qui détermine la distribution du temps des individus entre le temps de travail professionnel et le temps consacré à l’unité domestique ressortit en dernière instance au lien complexe qui se noue entre la structure des impératifs de travail et la structure des attentes normatives, relativement au genre, attachées au travail (Berk, 1985 : 195-196). » Berk observe notamment que le facteur qui a le plus d’influence sur la contribution des épouses au travail domestique est la quantité totale de travail que demande ou que semble demander la gestion de l’unité domestique ; l’établissement de cette somme ne se base en aucune manière sur la contribution des époux. Les épouses font état de raisons (les leurs et celles de leurs époux) variées pour justifier leur niveau de contribution et, de manière générale, ne dérogent pas au présupposé selon lequel la réalisation du travail domestique est d’abord de la responsabilité des femmes. Berk (1985 : 201) précise qu’il est difficile d’expliquer la manière dont les individus « s’accordent pour établir les arrangements qu’ils mettent en œuvre uniquement à partir de la production des biens et des service domestiques » – ça l’est encore plus si l’on tient compte du fait que ces arrangements sont tenus pour « justes ». Elle avance alors que nos présents arrangements quant à la division conjugale du travail prennent appui sur deux processus de production : celle des biens et des services domestiques (les repas, les soins aux enfants, etc.) et celle, simultanément, du genre. Comme elle le formule : « Les individus « font » le genre en même temps qu’ils « effectuent » les tâches domestiques et les activités de soins et d’éducation envers les enfants, et ce qu’on appelle [a été appelé] « la division du travail » pourvoit à la production conjointe du travail domestique et du genre ; c’est le mécanisme au travers duquel les biens matériels et symboliques de l’unité domestique sont réalisés » (1985 : 201). Ce n’est pas tellement que le travail domestique est considéré comme un « travail féminin », mais plutôt que s’y engager pour une femme et ne pas s’y engager pour un homme revient à s’aligner sur les « natures essentielles » correspondantes, et à les afficher. Ce qui est produit et reproduit n’est pas seulement l’activité domestique et les biens et services qui lui sont liées ; il y a là également incarnation matérielle des rôles de bonne épouse et de bon époux, et par dérivation, d’un comportement digne d’une femme versus d’un homme (voir Beer 1983 : 70-89). Souvent, ce sont aussi les statuts dominant et subordonné des catégories de sexe qui sont produits et reproduits. Comment le genre est-il accompli dans les situations de travail en dehors de l’unité domestique, là où la dominance et la subordination sont des sujets de première importance ? Les analyses que Hochschild (1983) a consacrées au travail du personnel de cabine dans les avions offrent à ce propos de prometteuses perspectives. Celles-ci mettent en effet en évidence que les tâches réalisées par les membres du personnel de cabine sont complètement différentes selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes : « Résorber l’agitation des passager⋅ère⋅s en perdition étant la principale activité de la compagnie d’aviation, les émotions des membres du personnel de cabine étaient soumises à rude épreuve. De surcroît, être exposée la journée durant à des personnes qui résistent à l’autorité est une expérience qui diffère selon que l’on est femme ou homme […]. À cet égard, être une femme est un désavantage. Et dans ce cas, les hôtesses de l’air ne sont pas simplement des femmes au sens biologique du terme. Elles sont aussi l’émanation exprimée à la perfection des conceptions de la féminité de la classe
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
16
moyenne américaine. Elles symbolisent « la Femme ». Dans la mesure où la catégorie « femme » est mentalement associée avec le fait d’avoir un statut inférieur et une autorité moindre, les hôtesses de l’air sont plus volontiers considérées comme étant « réellement » féminines que ne le sont les autres femmes (Hochschild, 1983 : 175). » En réalisant ce que Hochschild nomme « le travail émotionnel » nécessaire au maintien des profits des compagnies aériennes, les hôtesses de l’air produisent simultanément des mises en acte de leur féminité « essentielle ». Sexe et sexualité Comment l’accomplissement du genre et l’injonction culturelle à « l’hétérosexualité obligatoire » (Rubin, 1975 ; Rich, 1980) sont-ils reliés ? Comme Frye (1983 : 22) l’a observé, gérer les pulsions sexuelles que l’on éprouve devant une personne membre de la catégorie de sexe appropriée exige, « avant de permettre à son cœur de battre à la chamade ou à son sang d’affluer dans le plaisir érotique éprouvé à la vue de cette personne », d’avoir préalablement reconnu celle-ci comme telle. L’apparence de l’hétérosexualité est produite au travers d’indices qui signifient sans conteste et sans ambiguïté l’appartenance à une catégorie de sexe, des indices dont la combinaison a quelque chose d’encore plus probant (Fyre, 1983 : 24). Aussi, les lesbiennes et les gays soucieuses et soucieux de passer pour des hétérosexuel⋅le⋅s peuvent s’appuyer sur ces marqueurs pour se camoufler ; à l’inverse, celles et ceux qui voudraient éviter la présomption d’hétérosexualité peuvent préférer afficher des indices ambigus de leur statut catégoriel, et ceci à travers leurs vêtements, leurs comportement et leur allure. Mais les indices « ambigus » d’une catégorie de sexe n’en demeurent pas moins des indices de cette catégorie. Si une personne désire être reconnue en tant que lesbienne (ou femme hétérosexuelle), elle doit d’abord fonder son appartenance à la catégorie de sexe « femme ». Même si dans l’imagerie populaire les lesbiennes sont représentées comme des « femmes qui ne sont pas féminines » (Frye, 1983 :129), leur accountability en tant qu’elles sont des personnes « normalement, naturellement sexuées » est préservée. La procédure qui consiste à décrire les individus en les rapportant aux catégories de sexe n’est pas non plus menacée par l’existence d’« opérations de changement de sexe » – qui représentent sans doute la mise à mal la plus radicale de nos croyances culturelles sur le sexe et le genre. Bien que personne ne force les transsexuel⋅le⋅s à subir des thérapies hormonales, à se soumettre à des traitements par électrolyse ou à des opérations chirurgicales, les alternatives dont ils et elles disposent sont indéniablement limitées : « Quand les expert⋅e⋅s des questions de transsexualité soutiennent qu’ils et elles ont recours aux procédures de changement de sexe uniquement avec les personnes qui en ont fait la demande et qui ont fait la preuve de leur capacité à « passer », ils et elles masquent la réalité sociale. Étant donné les injonctions patriarcales à être soit un homme soit une femme, la liberté du choix est limitée (Reymond, 1979 : 135, nos italiques). » La reconstruction chirurgicale de critères de sexe est le tribut ultime à payer au « caractère essentiel » de nos natures sexuelles – de femme ou d’homme. Genre, pouvoir et changement social Reprenons la question déjà énoncée plus haut : pouvons-nous éviter de faire le genre ? Nous avons avancé précédemment que faire le genre était inévitable, dans la mesure où les catégories de sexe sont utilisées comme des critères fondamentaux de différenciation. C’est inévitable en raison des conséquences sociales de l’appartenance à une catégorie de sexe, à savoir l’attribution du pouvoir et des ressources non seulement dans les sphères domestique, économique et politique, mais aussi au sein du vaste cercle des relations interpersonnelles. Dans pratiquement n’importe quelle situation, la
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
17
catégorie de sexe dont on est titulaire peut s’avérer pertinente, et la performance que l’on réalise en tant que membre de cette catégorie (i.e., le genre) être soumise à évaluation. Pour qu’une assignation statutaire à ce point envahissante soit maintenue de façon constante tout au long de la vie, il faut qu’elle soit considérée comme légitime. Mais faire le genre rend également les arrangements sociaux basés sur les catégories de sexe intelligibles, visibles et observables en tant qu’ils sont normaux et naturels, en tant qu’ils sont des moyens légitimes d’organiser la vie sociale. Les différences entre femmes et hommes créées à travers ce processus peuvent alors être présentées comment relevant de dispositions fondamentales et durables. En retour, il est possible de voir dans les arrangements institutionnels propres à une société des réponses à ces différences – comme si l’ordre social était simplement une adaptation à l’ordre naturel. En d’autres termes, si, en faisant le genre, les hommes accomplissent la dominance et les femmes la déférence (cf. Goffman, 1967 : 47-95), l’ordre social qui en résulte, qui est supposé refléter « les différences naturelles », renforce et légitime puissamment les arrangements hiérarchiques. Frye note : « Ce qui est recherché, pour assujettir efficacement, est que la structure sociale n’apparaisse pas comme un artefact culturel maintenu en place par décision humaine ou en raison des mœurs, mais au contraire comme quelque chose de naturel – comme si elle découlait presque directement de faits bruts qui seraient hors de portée de la manipulation humaine […] Que nous soyons, en tant que femmes et hommes, entraîné·e·s à nous comporter si différemment et à agir si différemment envers les autres femmes et les autres hommes, contribue de lui-même considérablement à l’apparition d’un dimorphisme extrême ; mais en retour, la façon dont nous agissons en tant que femmes et hommes, et la façon dont nous agissons à l’égard des femmes et à l’égard des hommes modèlent nos corps et nos esprits, qui prennent alors la forme de la subordination et de la dominance. Nous devenons en fait ce que nous nous entraînons à être » (Frye, 1983 : 34). Si nous faisons le genre de façon appropriée, nous soutenons, reproduisons et rendons simultanément légitimes les arrangements institutionnels basés sur les catégories de sexe. Si nous échouons à faire le genre convenablement, il est possible que nous soyons appelé⋅e⋅s, en tant qu’individus – ce ne sont pas des arrangements institutionnels dont il s’agit ici –, à rendre des comptes (au sujet de notre identité, de nos raisons d’agir, et de nos prédispositions). Les mouvements sociaux tels que le féminisme peuvent fournir l’idéologie et l’impulsion propres à questionner les arrangements sociaux existants, ainsi qu’à procurer aux individus le soutien social nécessaire à l’exploration d’alternatives sociétales. Par ailleurs, les changements législatifs, tels ceux proposés par l’Amendement des Droits Egaux [Equal Rights Amendment], sont susceptibles de restreindre la légitimité à recourir aux catégories de sexe pour décrire les comportements, rendant possible ce faisant un relâchement plus étendu de l’accountability en général. Mais ce qui est certain, c’est que l’égalité devant la loi ne garantit pas l’égalité dans les autres arènes institutionnelles. Comme Lorber (1986 : 577) l’a souligné, pour qu’elle soit assurée, « l’égalité en tous points des catégories de personnes considérées comme étant essentiellement différentes nécessite une vigilance constante ». Ce que les types de changements proposés là peuvent réaliser, c’est alors de garantir le droit à énoncer ce type d’interrogations : si traiter les femmes et les hommes comme des êtres égaux est ce que nous voulons, pourquoi aurions-nous encore besoin de deux catégories de sexe (voir Lorber, 1986 : 577) ? La mise en rapport entre les catégories de sexe et le genre vient relier les niveaux institutionnel et interactionnel, un appariement qui légitime les arrangements basés sur les catégorie de sexe et reproduit leur asymétrie dans les interactions en face-à-face. « Faire le genre » fournit l’échafaudage de la structure sociale, et cet accomplissement est accompagné d’un mécanisme interne de contrôle social. En reconnaissant que ce sont bien des forces institutionnelles qui maintiennent des distinctions entre femmes et hommes, nous ne devons pas perdre de vue que c’est une validation située au niveau interactionnel qui confère à ces distinctions leur caractère de « naturalité » et de « normalité ».
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
18
Le changement social doit alors être appréhendé aussi bien au plan institutionnel et culturel, celui des catégories de sexe, qu’au niveau interactionnel du genre. Un telle conclusion n’a rien d’original. Néanmoins, nous suggérons qu’il est important de se rappeler que la distinction analytique entre les domaines institutionnels et interactionnels n’est pas, quand il s’agit du problème du changement social en cours de réalisation, une question à poser en termes de choix. Revoir la conceptualisation du genre, en concevant ce dernier non pas comme une simple propriété des individus mais comme une dynamique en soi de l’ordre social implique l’adoption d’une autre perspective sur le réseau tout entier des relations de genre : « [L’]assujettissement social des femmes, et les pratiques culturelles qui contribuent à le maintenir ; la politique qui gouverne le choix du/de la partenaire sexuel·le, et plus particulièrement l’oppression des homosexuel⋅le⋅s ; la division sexuelle du travail, la formation des identités et des raisons d’agir, dans la mesure où ces dernières sont organisées autour de la féminité et de la masculinité ; le rôle du corps dans les relations sociales, plus spécifiquement la politique qui régule l’enfantement ; et la nature des stratégies des mouvements de libération sexuelle (Connell, 1985 : 261) ». Le genre est un puissant dispositif idéologique, qui produit, reproduit, et légitime les choix et les restrictions fondés sur les catégories de sexe. Comprendre comment le genre est produit dans les situations sociales permettra de clarifier l’échafaudage interactionnel de la structure sociale, ainsi que les processus de contrôle social qui le soutiennent.
Traduction de l’anglais (américain) par Fabienne Malbois
Références Beer, William R. (1983). Househusbands : Men and Housework in American Families. New York : Praeger.
Bern, Sandra L. (1983). « Gender Schema Theory and Its Implications for Child Development : Raising Gender-Aschematic Children in a Gender-Schematic Society ». Signs, 8, 598-616.
Berger, Joseph, Thomas L. Conner et Morris Zelditch (1972). « Status Characteristics and Social Interaction ». American Sociological Review, 37, 241-255.
Berger, Joseph, Thomas L. Conner, et M. Hamit Fisek (Éds) (1974). Expectations States Theory : A Theoretical Research Program. Cambridge : Winthrop.
Berger, Joseph, M. Hamit Fisek, Robert Z. Norman et Morris Jr. Zelditch (1977). Status Characteristics and Social Interaction : An Expectation States Approach. New York : Elsevier.
Berk, Sarah F. (1985). The Gender Factory : The Apportionment of Work in American Households. New York : Plenum.
Bernstein, Richard (1986). « France Jails 2 in Odd Case of Espionage ». New York Times, May 11.
Blackwood, Evelyn (1984). « Sexuality and Gender in Certain Native American Tribes : The Case of Cross-Gender Females ». Signs, 10, 27-42.
Bourne, Patricia G. et Norma J. Wikler (1978). « Commitment and the Cultural Mandate : Women in Medicine ». Social Problems, 25, 430-440.
Cahill, Spencer E. (1982). Becoming Boys and Girls. Ph.D. dissertation, Department of Sociology, University of California, Santa Barbara.
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
19
Cahill, Spencer E. (1986a). « Childhood Socialization as Recruitment Process : Some Lessons from the Study of Gender Development ». In Patricia Adler et al. (Éds), Sociological Studies of Child Development (pp. 163-168). CT : JAI Press.
Cahill, Spencer E. (1986b). « Language Practices and Self-Definition : The Case of Gender Identity Acquisition ». The Sociological Quaterly, 27, 295-311.
Chodorow, Nancy (1987). The Reproduction of Mothering : Psychoanalysis and the Sociology of Gender. Los Angeles : University of California Press.
Connell, R. W. (1983). Which Way Is Up ? Sydney : Allen et Unwin.
Connell, R. W. (1985). « Theorizing Gender ». Sociology, 19, 260-272.
Cucchiari, Salvatore (1981). « The Gender Revolution and the Transition from Bisexual Horde to Patrilocal Band : The Origins of Gender Hierarchy ». In Sherry B. Ortner et al. (Éds), Sexual Meanings : The Cultural Construction of Gender and Sexuality (pp. 31-79). New York : Cambridge.
Firestone, Shulamith (1970). The Dialectic of Sex : The Case for Feminist Revolution. New York : William Morrow.
Fishman, Pamela (1978). « Interaction : The Work Women Do ». Social Problems, 25, 397-406.
Frye, Marilyn (1983). The Politics of Reality : Essays in Feminist Theory. Trumansburg, NY : The Crossing Press.
Garfinkel, Harold (1967). Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall. (Recherches en ethnométhodologie, traduit par Michel Barthélémy, Baudouin Dupret, Jean-Manuel de Queiroz et Louis Quéré, Paris, PUF, 2007).
Gerson, Judith M. et Kathy Peiss (1985). « Boundaries, Negociation, Consciouness : Reconceptualizing Gender Relations ». Social Problems, 32, 317-331.
Goffman, Erving (1967 [1956]). « The Nature of Deference and Demeanor ». In Interaction Ritual (pp. 47-95). New York : Anchor/Doubleday.
Goffman, Erving (1976). « Gender Display ». Studies in the Anthropology of Visual Communication, 3, 69-77. (Le déploiement du genre, traduit par Frédérique Beuzon et Sébastien Sengenes, Terrain, 42, pp. 109-128, 2004).
Goffman, Erving (1977). « The Arrangement Between the Sexes ». Theory and Society, 4, 301-331.
Henley, Nancy M. (1985). « Psychology and Gender ». Signs, 11, 101-119.
Heritage, John (1984). Garfinkel and Ethnomethodology. Cambridge, England : Polity Press.
Hill, W. W. (1935). « The Status of the Hermaphrodite and Travestite in Navaho Culture ». American Anthropologist, 37, 273-279.
Hochschild, Arlie R. (1973). « A Review of Sex Roles Research ». American Journal of Sociology, 78, 1011-1029.
Hochschild, Arlie R. (1983). The Managed Heart : Commercialization of Human Feeling. Berkeley : University of California Press.
Hughes, Everett C. (1945). « Dilemmas and Contradictions of Status ». American Journal of Sociology, 50, 353-359.
Humphreys, Paul et Joseph Berger (1981). « Theoretical Consequences of The Status Characteristics Formulation ». American Journal of Sociology, 86, 953-983.
Jaggar, Alison M. (1983). Feminist Politics and Human Nature. Totowa, NJ : Rowman et Allanheld.
Kessler, S. D. J. Ashendon, R. W. Connell, et G. W. Dowsett (1985). « Gender Relations in Secondary Schooling ». Sociology of Education, 58, 34-48.
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
20
Kessler, Suzanne J. et Wendy McKenna (1978). Gender : An Ethnomethodological Approach. New York : Wiley.
Kollock, Peter, Philip Blumstein et Pepper Schwartz (1985). « Sex and Power in Interaction ». American Sociological Review, 50, 34-46.
Komarovsky, Mirra (1946). « Cultural Contradictions and Sex Roles ». American Journal of Sociology, 52, 184-189.
Komarovsky, Mirra (1950). « Functional Analysis of Sex Roles ». American Sociological Review, 15, 508-516.
Linton, Ralph (1936). The Study of Man. New York : Appleton-Century.
Lopata, Helen Z. et Barrie Thorne (1978). « On the Term ‘Sex Roles’ ». Signs, 3, 718-721.
Lorber, Judith (1984). Women Physicians : Careers, Status and Power. New York : Tavistock.
Lorber, Judith (1986). « Dismantling Noah’s Ark ». Sex Roles, 14, 567-580.
Martin, M. Kay, et Barbara Voorheis (1975). Female of the Species. New York : Columbia University Press.
Mead, Margaret (1963). Sex and Temperment. New York : Dell.
Mithers, Carol L. (1982). « My Life as a Man ». The Village Voice, 27, October 5 : 1 ff.
Money, John (1968). Sex Errors of the Body. Baltimore : Johns Hopkins.
Money, John (1974). « Prenatal Hormones and Postnatal Sexualization in Gender Identity Differenciation ». In James K. Cole et al. (Éds), Nebraska Symposium on Motivation (pp. 221-295) (vol. 21). Lincoln : University of Nebraska Press.
Money, John et John G. Brennan (1968). « Sexual Dimorphism in the Psychology of Female Transsexuals ». Journal of Nervous and Mental Disease, 147, 487-499.
Money, John et Anke A. Erhard (1972). Man and Woman/Boy and Girl. Baltimore : John Hopkins.
Money, John et Charles Ogunro (1974). « Behavioral Sexology : Ten Cases of Genetic Male Intersexuality with Impaired Prenatal and Pubertal Androgenization ». Archives of Sexual Behavior, 3, 181-206.
Money, John et Patricia Tucker (1975). Sexual Signatures. Boston : Little, Bronw.
Morris, Jan (1974). Conundrum. New York : Harcourt Brace Jovanovich.
Parsons, Talcott (1951). The Social System. New York : Free Press.
Parsons, Talcott et Robert F. Bales (1955). Family, Socialization and Interaction Process. New York : Free Press.
Raymond, Janice G. (1979). The Transsexual Empire. Boston : Beacon.
Rich, Adrienne (1980). « Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence ». Signs, 5, 631-660.
Richards, Rennee (avec John Ames) (1983). Second Serve : The Rennee Richards Story. New York : Stein and Day.
Rossi, Alice (1984). « Gender and Parenthood ». American Sociological Review, 49, 1-19.
Rubin, Gayle (1975). « The Traffic in Women : Notes on the ‘Political Economy’ of Sex ». In Rayna Reiter (Éds), Toward an Anthropology of Women (pp. 157-210). New York : Monthly Review Press.
Sacks, Harvey (1972). « On the Analyzability of Stories by Children ». In John J. Gumperz et al. (Éds), Directions in Sociolinguistics (pp. 325-345). New York : Holt, Rinehart et Winston.
Schütz, Alfred (1943). « The Problem of Rationality in the Social World ». Economics, 10, 130-149.
Traduction publiée dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n°2, 2009, sans la NBP 6 (sa suppression a été exigée par les rédactrices responsables de la revue).
21
Stacey, Judith et Barrie Thorne (1985). « The Missing Feminist Revolution in Sociology ». Social Problems, 32, 301-316.
Thorne, Barrie (1980). Gender… How Is It Best Conceptualized ? Unpublished manuscritpt.
Thorne, Barrie (1986). « Girls and Boys Together… But Mostly Apart : Gender Arrangements in Elementary Schools. In Willard Hartup et al. (Éds), Relationships and Development (pp. 167-182). Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum.
Thorne, Barrie et Zella Luria (1986). « Sexuality and Gender in Children’s Daily Worlds ». Social Problems, 33, 176-190.
Tresemer, David (1975). « Assumptions Made About Gender Role ». In Marcia Millman et al. (Éds), Another Voice : Feminist Perspectives on Social Life and Social Science (pp. 308-339). New York : Anchor/Doubleday.
West, Candace (1984). « When the Doctor is a ‘Lady’ : Power, Status and Gender in Physician-Patient Encounters ». Symbolic Interaction, 7, 87-106.
West, Candace et Bonita Iritani (1985). « Gender Politics in Mate Selection : The Male-Older Norm ». Paper presented at the Annual Meeting of the American Sociological Association, August, Washington, DC.
West, Candace et Don H. Zimmeran (1983). « Small Insults : A Study of Interruptions in Conversations Between Unacquainted Persons ». In Language, Gender and Society, Barrie Thorne (Éds), Language, Gender and Society (pp. 102-117). Rowley, MA : Newbury House.
Wieder, D. Lawrence (1974). Language and Social Reality : The Case of Telling the Convict Code. The Hague : Mouton.
Williams, Walter L. (1986). The Spirit and the Flesh : Sexual Diversity in American Indian Culture. Boston : Beacon.
Wilson, Thomas P. (1970). « Conceptions of Interaction and Forms of Sociological Explanation ». American Sociological Review, 35, 697-710.
Zimmerman, Don H. et D. Lawrence Wieder (1970). « Ethnomethodology and the Problem of Order : Comment on Denzin ». In J. Jack Douglas (Éds), Understanding Everyday Life (pp. 287-295). Chicago : Aldine.