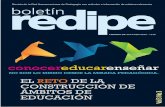NORMA INTERNACIONAL Traducción oficial Official translation Traduction officielle
Traduction audiovisuelle 3
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Traduction audiovisuelle 3
Traduction audiovisuelle : le sous-titrage
Claudia Scaramozzino
MATR.
Introduction
Dans cet essay on focalisera sur un phénomène très actuel à
l’intérieur du champ d’études de traduction : la traduction
audiovisuelle (TAV), qui a subi une évolution rapide au cours des
dernières décennies, grâce aussi aux grands progrès technologiques.
Les typologies principales de TAV seront analysées, tenant en compte
la grande importance que le rôle de l’image et des produits
audiovisuels possède dans la vie quotidienne de la société
d’aujourd’hui. Les principales caractéristiques du phénomène seront
présentées, en s’arrêtant à observer la polysémie inhérente au
produit audiovisuel. En effet, il s’agit d’un produit qui joint codes
différents à l’intérieur de lui-même : l’image et le son se
combinent, créant un multicode qui peut poser beaucoup de problèmes à
le traduire. Mon étude donc se concentrera spécifiquement sur le
sous-titrage, en partant de sa naissance, contemporaine à celle du
cinéma sonore, pour permettre aux spectateurs étrangers d’accéder au
produit cinématographique. Par la suite on analysera les aspects
principaux du sous-titrage et de la traduction pour le sous-titrage…
1.La traduction audiovisuelle (TAV)
Cette expression fait référence à toutes les modalités de
transfert linguistique qui se proposent de traduire les
dialogues originaux des produits audiovisuels, c’est-à-dire des
produits qui communiquent simultanément à travers le canal
acoustique et celui visuel, dans le but de les rendre
accessibles à un plus ample publique.1
Comme Perego affirme, la traduction audiovisuelle fait partie de
notre vie quotidienne, car à travers ce moyen beaucoup de films,
téléfilms, documentaires et programmes télévisés sont accessibles
dans notre écran. Cette manière particulière de traduction trouve
ses origines contextuellement à la naissance du cinéma sonore
dans les années ’30, et avec le temps elle est évoluée de manière
consistante grâce à l’évolution de la technologie et grâce à
l’expansion des produits audiovisuels à traduire. Perego explique
que, dans un premier temps, les traductions pour les films
1 Perego E., La traduzione audiovisiva, Carocci 2005, p.7 (mia traduzione)
étaient effectuées par des personnes inexpertes, qui ne
possédaient pas une préparation approprié : en effet, le rôle
professionnel du traducteur audiovisuel remonte aux temps
récents, signe d’une recherche de qualité dans les traductions.
En effet, avec le temps le publique a développé une sensibilité
particulière à l’égard de la traduction des films ou des séries
télévisés, au point de mettre en discussion la qualité de la
traduction d’un film car lointaine de la réplique originale.
Mais, les critiques à une traduction d’un professionnel, très
souvent, sont inexactes. On doit, plutôt, se demander s’il y a
des facteurs qui peuvent influencer les choix faits pendant le
travail de traduction.
La traduction audiovisuelle est devenue objet de discussion
seulement dans ces derniers temps. En Europe, pendant les années
’80 et ’90 du XX siècle, on assiste à une reconsidération des
minorités linguistiques et on peut considérer les media comme les
instruments utiles pour faciliter la communication et pour
promouvoir et renforcer l’identité linguistique-culturelle.
Après, l’époque de la digitalisation simplifie et accélère le
travail du traducteur audiovisuel et change la manière avec
laquelle les films sont tournés, perçus et distribués. La TAV
représente un secteur assez particulier dans le domaine de la
théorie de la traduction ; en effet, sa composante
intersémiotique est ce qui la caractérise et la distance d’autres
cadres d’études sur la traduction. Toutefois, cette discipline
est devenue objet d’étude au niveau académique et théorique
seulement à partir des années ’50, car jusqu’à ce moment-là elle
était considérée au dehors du domaine de la traduction. Diàz
Cintas cite comme première publication qui s’occupe de la
traduction audiovisuelle au niveau théorique Le sous-titrage de films. Sa
technique. Son esthétique du 1957, écrite par Simon Laks. L’étude
scientifique de la traduction a désormais conquit l’autonomie
comme discipline d’étude et la traduction audiovisuelle, vue
comme un des moyens principaux à travers lesquels un film
s’insère dans le patrimoine culturel d’un autre pays, occupe un
rôle de plus en plus important dans la communication moderne. A
cause des difficultés que la traduction audiovisuelle implique,
il est difficile de l’encadrer à l’intérieur du domaine de la
théorie de la traduction. Ces nombreuses difficultés générales,
que l’étude de la traduction filmique présente, dérivent de la
combinaison de plusieurs facteurs, qui embrassent un laborieux
retracement du matériel (film, liste des dialogues, etc.) et la
nature a-théorique ascripte à beaucoup d’études entrepris dans le
champ. Les difficultés concernent aussi le rayon d’action où ce
domaine de recherche intervient ; dans le cas du doublage, par
exemple, le caractère obligatoire de la synchronisation,
conditionne la traduction du texte à tel point que le passage de
la langue de départ et la langue cible n’est pas considéré à
l’unanimité un processus traductif analysable de manière
scientifique. Pour qui entreprend une analyse dans le champ de la
traduction filmique, il y a des complications objectives, d’ordre
pratique et théorique.
2.Caractéristiques de la TAV
Le terme « traduction audiovisuelle » (TAV) a été introduit dans
le champ académique pendant les années ’90. Cette définition
possède l’avantage d’inclure la composante sémiotique que la
traduction filmique implique. En effet, ce terme est utilisé pour
englober différentes pratiques traductives, utilisées dans les
moyens audiovisuels où il y a un transfert d’une langue à une
autre, qui implique une sorte d’interaction entre son et image. Le
sous-titrage et le doublage sont les méthodes de traduction
audiovisuelle, les plus diffusés, mais il y a aussi d’autres
typologies de TAV comme le « voice-over », la narration ou
l’interprétation. Le mot clé pour une traduction audiovisuelle de
succès est introspection et compréhension du produit et de la
fonction qu’il doit avoir, combinés avec la volonté de s’adapter.
2.1. Le traducteur audiovisuel
Dans le cadre d’évolution continue où cette discipline se
trouve, le rôle du traducteur aussi a été réévalué, à tel point
qu’aujourd’hui il est reconnu comme vrai professionnel. En
effet, la conscience de la nécessité de traducteurs qualifiés a
augmenté, à fin de garantir l’accès à des produits de qualité,
même si dans certains pays, surtout où il y a peu de ressources
économiques, le rôle du traducteur audiovisuel est encore
attribué à n’importe qui connait plus d’une langue, sans une
préparation professionnelle2. En réalité, le traducteur
audiovisuel représente une figure déterminante qui nécessite
d’une préparation appropriée pour répondre aux exigences
qualitatives demandées. Attributs fondamentaux pour un bon
traducteur audiovisuel, en effet, sont des solides bases
théoriques combinées avec une expérience pratique sur le
terrain.
2.2. Typologies de traduction audiovisuelle
Le but principal de la traduction audiovisuelle est celui de
rendre le spectateur capable de consommer de manière immédiate
et compréhensible le produit qu’il a choisi de regarder. Chaque
produit audiovisuel présente des difficultés à envisager pour
garantir une compréhension correcte, par exemple variantes
dialectaux, vélocité d’élocution, impossibilité de réécouter les
parties qui ne sont pas comprises, bruits externes,
superpositions de dialogues (Diaz Cintas, Ramael 2007 :89). La
globalisation dans le marché audiovisuel a amené chaque pays à
choisir les méthodes de traduction audiovisuelle que l’on pense
soient les plus appropriés à la médiation linguistique des
produits audiovisuels. Comme Diaz Cintas (2007) explique, la
traduction audiovisuelle compte nombreuses typologies de
transfert et d’adaptation linguistique. Il distingue, en effet,
différentes formes de traduction audiovisuelle, entre lesquelles
on peut mettre en évidence 8 typologies dominantes :
2 Perego E. 2005
Interprétation simultanée ;
« Voice over » ;
Commentaire libre ;
Traduction simultanée ;
Production multilingues.
L’étudiante ajoute autres cinq typologies de transfert
linguistique qui sont définies « challenging », c’est-à-dire
plus difficiles, mais très stimulantes :
Traduction des scripts ;
Sous-titrage simultanée ;
Sur-titrage (sopratitolazione) ;
Description audiovisuelle ;
Sous-titrage intralinguistique pour sourds.
On va analyser en détail les méthodes, les plus utilisés, pour
éclairer le domaine d’études, auquel il se réfère et quelles
sont ses applications.
2.2.1. Le Doublage
Le doublage est la typologie de traduction et diffusion
audiovisuelle, la plus diffusée en Italie. Elle consiste
dans la substitution de la colonne sonore originale avec
une autre nouvelle, contenante les dialogues traduits et
joués dans la langue de destination. Ce système implique
une grande précision dans la synchronisation aussi pour ce
qui concerne les mouvements labiaux des acteurs qui doivent
coïncider le plus possible, en pouvant de cette façon
donner au spectateur l’impression que les acteurs soient en
train de parler vraiment dans leur langue. Le doublage
représente une des modalités de transfert linguistique pour
les produits audiovisuels, une des plus dispendieuses soit
pour le nombre de personnel qui implique soit pour les
temps plus longs de réalisation3.
2.2.2. Le sous-titrage et le sous-titrage simultané
Le sous-titrage permit une traduction condensée des
dialogues originaux des films sous forme d’un texte écrit,
colloqué dans la partie basse de l’écran. Tandis que, le
sous-titrage simultané est une procédure qui est réalisée
simultanément à la reproduction d’un programme. Un
interprète réfère le message pendant qu’un technicien écrit
très vite ce qui aura visualisé comme sous-titre du
spectateur. Mais, cette typologie de traduction est
utilisée principalement pour transmettre des interviews ou
des nouvelles que pour la traduction filmique (Diàz Cintas
2009 :86).
2.2.3. Le « voice over »
Le « voice-over » est une méthode de traduction qui est
habituellement utilisée pour transmettre des interviews,
nouvelles, documentaires pourvus d’une traduction
simultanée au dialogue original. Les dialogues traduits
sont lus par des lecteurs professionnels ou, plus
fréquemment, par des journalistes. Il est difficile de3 Diàz Cintas J. 2009
colloquer cette typologie de traduction à l’intérieur de la
traduction audiovisuelle ; en effet elle est parfois
considérée comme une typologie intermède entre doublage et
sous-titrage. En réalité, c’est une version allégée du
doublage, étant donné que le texte traduit est proposé
oralement comme dans le doublage, mais l’élaboration des
contenus est effectuée à travers un travail de synthèse
comme pour le sous-titrage. Cette procédure ne crée pas
l’illusion que les personnages soient en train de
s’exprimer dans la langue du publique, mais selon Diàz
Cintas (2009) le « voice-over » est une typologie
traductive moins complexe respect au doublage, étant donné
qu’elle n’implique pas la synchronisation labiale, ni
l’embauchage des acteurs, en réduisant de cette façon le
prix de production, mais dans tous les cas en garançant au
spectateur l’accès d’un produit dans la propre langue.
2.3. La sémiotique de la TAV
On a déjà dit que la TAV représente une typologie particulière
de traduction et une de ses particularités réside dans le fait
que le transfert linguistique arrive sur des typologies
textuelles qui représentent une interrelation parmi codes
différents : visuel, verbale, et sonore4. La traduction
audiovisuelle se caractérise comme une activité polysémiotique,
4 Ranzato, I. 2010. La Traduzione Audiovisiva: Analisi degli Elementi
Culturospecifici. Roma: Bulzoni editore.
dont le lien principale est la présence simultanée d’images et
de dialogues, donc il est important de ne pas créer des
contrastes entre la traduction et les images originales. En
effet, s’il existait une discordance entre les deux codes, la
correcte réception du message original pourrait être compromise.
Chaume5 propose une liste de codes qui caractérisent les textes
audiovisuels, en les rapportant avec le travail du traducteur :
Le code linguistique : c’est l’élément principal d’un
texte, donc c’est où le traducteur travaille directement.
Le code linguistique d’un produit audiovisuel simule le
langage parlé, dont but est stimuler la spontanéité de la
conversation. Donc le traducteur doit essayer de donner la
même spontanéité au texte cible, en utilisant les
caractéristiques de la langue parlée.
Les codes paralinguistiques : ils concernent les éléments
suprasegmentaux « qui rendent complète et organique la
communication verbale humaine »6 . ces éléments peuvent
être pauses, silences, intonation de voix, etc.
Le code musical : à l’intérieur d’un film ou d’un
téléfilm, il est possible de trouver aussi des chansons.
Dans ce cas, le traducteur doit décider quelles
5 Chaume, F. 2004. Film Studies and Translation Studies: Two disciplines at Stake
in Audiovisual Translation, in Meta: Journal des traducteurs / Meta: Translators’
Journal, Volume 49, numéro 1, avril 2004, pp.12-24. Traduction Audiovisuelle /
Audiovisual Translation Sous la direction de Yves Gambier Direction: André Clas
(directeur) éditeur: Les Presses de l’Université de Montréal. 6 Canepari, L. 1985. L’intonazione. Linguistica e paralinguistica. Napoli: Liguori.Op. cit. in La Traduzione Audiovisiva, Perego (2007). P. 87
conventions utiliser : si le film est doublé, il peut
choisir si utiliser une colonne sonore différente pour les
parties chantées, ou utiliser la même chanson. Dans le cas
du sous-titrage, à l’intérieur du texte des chansons,
souvent le texte est en italique pour se différencier des
parties parlées.
Le code d’arrangement sonore : il se réfère aux sons du
texte audiovisuel. En effet, les sons peuvent être
diégétiques, c’est-à-dire qui appartiennent à l’histoire,
ou non-diégétiques, c’est-à-dire qui n’appartiennent pas
proprement à l’histoire, par exemple les voix off.
Le code iconographique : c’est le code, le plus
significatif au niveau visuel, et c’est le principal lien
pour le traducteur, qui doit adapter les dialogues au
labial des acteurs et aussi au contexte.
Le code photographique : il concerne les changements de
couleur, d’illumination et de prospective. Ca présente
deux problèmes pour le traducteur : le premier est la
différente connotation culturelle que certaines couleurs
peuvent avoir, laquelle peut varier de culture à culture.
Le second problème est le changement d’illumination, qui
dans le cas du sous-titrage, peut faire recourir à un
changement de la couleur du sous-titre.
Le code de typologies de cadrage : il se réfère surtout
aux cadrage de près ou aux gros plans sur les acteurs,
donc le traducteur doit choisir scrupuleusement les mots
qui s’approchent le plus au mouvement labial du texte
original, sans changer drastiquement le signifié.
Le code de mobilité : il est lié au code précédent et il
concerne les codes proxémiques et cinétiques. Respecter ce
code signifie coordonner les gestes et les expressions des
acteurs avec les mots.
Le code graphique : il concerne la présence de titres,
didascalies, soustitres, et objets qui contiennent des
inscriptions qui normalement sont traduites quand elles
représentent un élément fondamental pour une compréhension
complète du message.
Le code syntactique : il s’agit de l’association des
images et de la manière avec laquelle elles sont liées
l’une à l’autre. En effet, parfois la fonction de
certaines images est fonctionnelle au développement de la
trame. Pour comprendre pleinement le texte il est utile de
tenir en compte ces connexions.
De cette liste, on peut souligner le degré de difficulté du travail
du traducteur. Pour obtenir un résultat satisfaisant, le traducteur
doit faire attention à la dimension linguistique et aussi à tous ces
éléments transmis à travers le canal visuel.
3.Le sous-titrage
Dans cette section on présente les caractéristiques du sous-
titrage. La principale caractéristique de cette pratique de
traduction audiovisuelle consiste dans reproduire les dialogues de
la colonne sonore en forme écrite. (par écrit ?)
3.1. Classification des sous-titres
Diàz Cintas (2009) classifie les sous-titres en trois différentes
typologies : inter-linguistiques, intralinguistique et bilingues.
On va les analyser plus en détail :
Sous-titres inter-linguistiques : ils offrent la traduction
des dialogues dans sous forme de texte, qui est après
présenté comme sous-titre dans une langue différente de celle
des dialogues originaux ;
Sous-titres bilingues : ils sont applis dans les pays où on
parle deux (ou plus) langues, comme par exemple la Belgique,
ou dans les festivals cinématographiques internationaux.
Sous-titres intralinguistiques : ils ne donnent pas une
traduction, car le texte présenté sur l’écran est dans la
même langue de la colonne sonore originale ; plutôt ils
reproduisent, à l’intérieur de la même langue, les dialogues
oraux en forme écrite. Cette typologie de sous-titres est
adressée principalement à deux destinataires : pour les
personnes avec des problèmes acoustiques et pour les
étudiants de langues étrangères. Dans ces cas, les sous-
titres sont présentés de manière différente sur la base des
destinataires.
3.2. Origines du phénomène
Le cinéma, au temps de sa naissance en 1895, est muet et reste tel
jusqu’à la fin du ‘900, quand le cinéma sonore fait son apparition et
avec lui aussi l’intégration d’image et son, en donnant vie à la
dichotomie audiovisuelle qui le caractérise dans son état actuel7.
Dans un premier temps, le mot qui accompagnait l’image était désigné
comme « intertitre ou didascalie » et il est le précurseur direct du
sous-titre. Les premiers expérimentes avec les intertitres ont eu
lieu au début du XX siècle. Ils peuvent être décrits comme une
portion de film contenant un texte qui était projeté entre deux
scènes. Les intertitres étaient très utilisés dans les films muets et
ils étaient des phrases blanches sur un fond noir. Avec l’arrive du
son, ils étaient principalement éliminés. Dès 1927 l’emploi des
intertitres disparait, de cette façon les spectateurs peuvent écouter
la version originale et de la comprendre à travers les sous-titres.
Mais avec l’introduction de l’élément sonore, les difficultés
techniques et pratiques augmentent. La première solution prise pour
rendre les travails sonores accessibles dans autres langues, fut
celle des éditions multiples ; c’est-à-dire un film était tourné
entièrement de nouveau dans des versions linguistiques différentes,
souvent aussi avec des acteurs et directeurs différents8. Mais, cette
pratique fut abandonnée très bientôt à cause des couts et temps de
réalisation remarquables, et elle fut presque immédiatement
7 In Baccolini, R., Bollettieri Bosinelli R.M., Gavioli L. a cura di il doppiaggio:
Trasposizioni Linguistiche e culturali. Biblioteca della Scuola Superiore di Lingue Moderne per
Interpreti e Traduttori, Forlì 5- 19948 Ibidem 1994.
substituée par le sous-titrage. Dès le début du XX siècle
jusqu’aujourd’hui, le processus de sous-titrage s’est évolué
considérablement grâce aussi à l’amélioration des techniques
impliquées dans sa réalisation, qui aujourd’hui comprennent des
moyens qui assurent vitesse de réalisation, des couts limités et
qualité du produit.
3.3. Le sous-titrage dans les études sur la traduction
Beaucoup des spécialistes ne sont pas concordants dans la définition
du sous-titrage comme forme de traduction, due sa nature complexe et
multiforme. Tandis que, d’autres spécialistes voudraient atteindre la
reconnaissance du sous-titrage comme traduction, comme Pavesi (2007 :
112) qui, au fin d’atteindre ce but, focalise sa discussion sur la
dimension concernant la réduction textuelle. Evidemment un processus
de cette typologie-là varie de ce que l’on définit traduction réelle,
en effet presque jamais il est possible de traduire tout ce qu’il y a
dans l’original. En réalité, le public a tendance à analyser
principalement l’aspect traductif dans le sous-titre, lequel
effectivement constitue un aspect fondamental du sous-titrage, même
s’il est défini de manière différente car il s’agit d’une typologie
de traduction extrêmement spécialisée. Donc, il est évident comme le
sous-titrage représente une typologie particulière de traduction, et
en tant que tel, il applique des stratégies spécifiques, parmi
lesquelles, les plus caractéristiques sont simplification et
réduction textuelle. Maria Pavesi suggère (2002 : 128) :
Cambiano le intenzioni alla base del testo tradotto, che non
nasce come il testo originale, con lo scopo di accompagnare un
doppio canale le immagini accompagnate sullo schermo, ma con lo
scopo di assistere lo spettatore della comunità di arrivo nella
comprensione integrale del film. La traduzione, non sostituendo
il testo originale, ma aggiungendosi ad esso, ne perde così le
intenzioni, le motivazioni originali.
3.4. La variation diamésique dans le sous-titrage
Le sous-titrage implique une variation du code oral au code écrit,
dont le sous-titre aura des caractéristiques différentes de celles
qui caractérisent le texte oral de départ. Théoriquement, le sous-
titre devrait avoir les caractéristiques appartenant aux deux codes.
Mais, souvent le sous-titre évite d’utiliser des structures
typiquement orales, faisant prédominer les caractéristiques du texte
écrit. Comme Perego affirme (2002 : 52-7), pour éviter d’obtenir un
texte non naturel, il est fondamental de :
S’arrêter sur la portée communicative de chaque sous-titre ;
Considérer que les sous-titres sont textes de support ;
Reproduire des variétés linguistiques sociolinguistiques, en
comprenant aussi les expressions du registre soutenu et
familier ;
Se concentrer sur le signifié que certaines expressions
obtiennent en ce qui concerne le contexte ;
Rappeler que le public accepte a priori la synthèse des
dialogues et donc il tache d’éviter qu’ils aient un caractère
improbable et inadéquat.
C’est normal que les dialogues, transportés dans la forme écrite,
perdent l’authenticité de l’oralité, donc ce que le sous-titreur peut
faire est essayer de représenter les éléments syntactiques et
lexicaux du discours oral. En effet, la langue écrite ne peut pas
transférer correctement les situations où les voix se superposent, et
même pas quand les voix ont une fonctionne communicative spécifique.
Dans ces cas, la seule solution est une sélection forcée des éléments
à traduire.
3.5. La sémiotique dans le sous-titrage
Les films sont des textes avec une complexité sémiotique notable, où
systèmes différents coopèrent pour créer une cohérence narrative.
Dans le film, la lumière et le son créent deux systèmes fondamentaux
d’espace, de temps et d’interaction causale. Ça signifie que, comme
Diàz Cintas et Ramael affirment, même si le langage parlé d’un
programme audiovisuel est la source à traduire, le sous-titrage doit
tenir en compte aussi des autres systèmes sémiotiques du texte et
être pleinement conscient de l’apport qu’ils donnent au développement
de l’histoire comme un ensemble. D’un point de vue traductif, la
situation, la plus difficile, se manifeste quand un signe
linguistique (par ex. une phrase), se réfère métaphoriquement à un
signe iconographique ou à une image que la culture d’origine et celle
de destination ne partagent pas. De plus, les sous-titres ne doivent
pas seulement tenir en compte de l’information véhiculée à travers
des éléments visuels, mais le canal acoustique d’un film ne peut pas
être rendu seulement en le traduisant à travers des signes verbaux.
Il est important de tenir en compte certains paramètres comme la
cohésion sémiotique, la multi-modalité du langage, les mouvements de
la caméra et le montage, la variabilité linguistique, le langage
marqué, les dialectes, les sociolectes et les idiolectes, les mots
avec chargées émotivement.
3.6. La vulnérabilité du sous-titrage
Il est intéressant de noter comment beaucoup de personnes ont une
opinion négative des sous-titres, et ça est dû principalement à le
fait qu’un produit sous-titré donne la possibilité d’accéder soit aux
dialogues dans la langue originale, soit à ceux traduits en forme de
texte écrit. Ca amène les observateurs à faire immédiatement une
confrontation entre l’original et la traduction, amenant à ce que
Diàz Cintas et Ramael définissent comme « gossiping effect ». C’est-
à-dire, quand dans les sous-titres il n’y a pas des signes lexicaux
localisables aussi dans le sonore, les spectateurs tendent à penser
que le sous-titreur a omit des éléments, ne pas traduisant tous les
mots du dialogue, et cette perception est un des facteurs de
criticisme à l’égard de cette pratique. Trouver la solution au
problème est encore plus difficile à cause de la concurrence
d’internet et le streaming, qui imposent à l’adaptation une vitesse
d’accès impossible à achever avec l’organisation actuelle. Il est
évident que le métier de sous-titreur implique une préparation
spécifique à cause du nombre de compétences à maîtriser qui ne sont
pas seulement linguistiques mais, en plus d’une sensibilité au niveau
culturel, comprennent aussi des capacités techniques9. On peut penser
au phénomène du sous-titrage de séries télévisées étrangères produit
et diffusé en internet par les fansubber, qui est une pratique
désormais consolidée, mais qui ne garantit pas qualité ni précision
de la traduction exactement à cause de la formation d’amateur de qui
s’en occupe, en rendant le produit adéquat à une consommation vite et
peu exigeante.
Conclusions
Dans ce texte on a parlé de l’intéressant champ de la
traduction qui se configure dans la Traduction Audiovisuelle
9 Diàz Cintas J. Et Ramael A. 2007
(TAV), en commentant l’actualité du phénomène, encouragé par
les nouvelles technologies et par une volonté de rendre
accessibles les produits à un public, le plus ample possible,
dans une société de plus en plus globalisée et intéressée aux
exigences du marché. On a focalisé le discours plus en détail
sur le sous-titrage, une des typologies de TAV analysée, pour
se concentrer sur les caractéristiques typiques de la
traduction pour le sous-titrage et sa dimension
polysémiotique. Dans ce domaine, l’étude a successivement
continué avec la discussion des difficultés principales que
les sous-titreurs doivent envisager quad ils sont en train de
traduire la version sous-titrée d’un produit audiovisuel
étranger.
Bibliographie
Baccolini R., Bollettieri Bosinelli R. M., Gavioli L., (1994) a cura
di il doppiaggio : Trasposizioni linguistiche e culturali. Biblioteca della Scuola
Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, Forlì 5 -
1994.
Canepari L., (1985). L’intonazione. Linguistica e paralinguistica. Napoli :
Liguori 1985. Op. cit. in La traduzione audiovisiva, Perego (2005).
Chaume, F., Film Studies and Translation Studies : Two Disciplines at Stake in Audiovisual
Translation, (2004) in Meta : Journal des traducteurs / Meta :
Translator’s Journal, Volume 49, numéro 1, avril 2004, pp. 12-24.
Traduction audiovisuelle /Audiovisual Translation Sous la direction
de Yves Gambier Direction : André Clas (directeur) Editeur : Les
Presses de l’Université de Montréal.
Diàz Cintas J., Ramael A., (2007) Audiovisual Translation : Subtitling, St.
Jerome Publishing Manchester.
PAVESI
Perego E., (2005). La traduzione audiovisiva, Carocci.
Ranzato I., (2010). La Traduzione Audiovisiva : Analisi degli Elementi Culturospecifici.
Roma : Bulzoni editore.