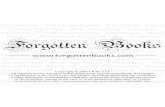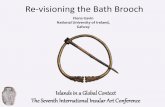LA TRADUCTION LITTERAIRE EN TANT QU’UN ACTE DE LIRE, DE RE-CREER ET DE RE-ECRIRE
Transcript of LA TRADUCTION LITTERAIRE EN TANT QU’UN ACTE DE LIRE, DE RE-CREER ET DE RE-ECRIRE
LA TRADUCTION LITTERAIRE EN TANT QU’UN ACTE DE LIRE,
DE RE-CREER ET DE RE-ECRIRE
Pour citer cette article: Günay, V. Doğan (Mars-Avril 2001) “Le traducteur, un co-auteur” dans Le Français Dans Le Monde, Paris: Hachette, n° 314
V. Dogan GÜNAY*
0. Préliminaire
Par la traduction, nous comprenons la transmission des significations (et des
symbolisations) textuels d’une langue en une autre. Pour ce faire, il nous faut lire, analyser, et
comprendre d’une part, et re-créer et re-écrire de l’autre. Dans cette article nous voulons relever
les phases de ces actes. D’autre part, nous voulons analyser théoriquement la traduction de
l’univers sémantique littéraire d’un domain dans un autre. Il faut lire le texte littéraire dans la
langue par laquelle on écrit, le concevoir au moyen de cette langue et l’analyser à l’aide des
methodes appartenant à l’analyse du texte littéraire. Par le terme d’analyse nous comprenons la
signification du texte littéraire: commenter la suite d’actions, la formation de l’intrigue.
Avant tout, nous voulons définir le texte littéraire. Nous suivons la définition faite par
Anne Hénault. C’est un “type particulier de production de messages qui se définit par son
autonomie et sa clôture” (Hénault 1979:185). Tous les textes, littéraires ou non, sont pour la
transmission d’un message de l’émetteur à un récépteur. Dire qu’il y a communication, c’est
dire qu’un locuteur produit un message destiné à un récepteur. Mais la relation entre l’émetteur
et son récépteur montre des particularités. Nous savons que, pour le texte littéraire, il faut
comprendre à la fois ce qui est dit, ce qu’on veut dire et la façon de le dire; parce que l’auteur
situe les règles et apporte un commentaire différent à la vie. C’est pourquoi l’auteur du texte
littéraire ne veut (ou peut) pas refléter, à la surface du texte, tout ce qu’il veut dire. De toute
façon c’est lui qui rédige le texte littéraire à sa façon.
Dans le texte, il y a une intrigue principale qui est formée par des actions et qui s’attache
à la construction des événements. Autrement dit, l’intrigue est l’ensemble des processus
textuels qui marquent une exposition, une transposition et un dénouement. Pour le lecteur, il est
nécessaire (et important) de résoudre l’énigme formulée de différents points de vue par l’auteur
et d’analyser cet ensemble d’événements. Par conséquent, avant de traduire, le lecteur doit
comprendre le texte littéraire.
Le traduction est une opération entre des cultures et un type de communication
interculturelle. Elle est une fonction linguistique qui se réalise dans tous les temps et dans
2
toutes les cultures, une activité qui instaure un pont entre différentes civilisations, qui approche
l’une de l’autre les peuples différents, qui porte des valeurs culturelles hors des environnements
historiques et sociaux, qui fournit aux peuples qui ne connaissent pas la culture et
l’environnement où l’on a écrit le texte de la langue, ainsi de suite... La traduction est
“l’entreprise humaine qui tente de limiter, sinon d’abolir, les conséquences du courroux divin”
(Bouton, 1984:58). En bref la traduction est un moyen de communication mutuelle entre les
groupes sociaux et à l’intention d’un autre public.
Chaque type de texte peut être subit à une opération traduisante. Il ne s’agit pas d’un
grand problème à propos du texte scientifique, parce que, dans ce type de textes, la langue n’est
qu’un moyen pour pouvoir transmettre la réalité scientifique. Mais dans un texte littéraire, nous
savons que la langue est à la fois un moyen et un but. Le problème découle de cette ambiguïté.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas de grand problème à propos de la compréhension et de la traduction
des textes hors littéraires.
Le traducteur a conscience de deux langues, du moins hypothétiquement. Il ne peut pas
se borner à connaître l’une d’elles. Il a pour but de refléter et de transmettre ce qui est dit et ce
qui est voulu dire dans la langue d’arrivée (on dit aussi langue cible). Par conséquent, la
fonction du traducteur se caracterise surtout par sa réussite dans la langue d’arrivée. Il
n’empêche que sa capacité de commenter le texte de la langue de départ (on dit aussi langue
source, langue d’origine) tient une place importante. Le traducteur a au moins deux tâches
essentielles: comprendre le texte de la langue naturelle dont il est le produit et pouvoir refléter
tout ce qui se place dans la langue de départ en langue d’arrivée.
1. Signification du texte littéraire
Il n’y a pas de vrai sens d’un texte.
Paul Valery
Pour comprendre ce qui se passe dans un texte littéraire, il faut le lire attentivement.
C’est la première tâche du traducteur. Lire un texte littéraire. Comment et pourquoi? Lire c’est
de suivre des yeux en identifiant un texte écrit, une écriture; lire c’est de remplir les espaces de
non-dit, c’est de déchiffrer ce qu’il est inscrit dans le texte, ainsi de suite... On comprend que
l’acte de lire (ou bien de voir, écouter, comprendre, transmettre, communiquer,...) forme la
relation entre le sujet (lecteur, spectateur, auditeur) et son objet (texte, film, chanson). C’est le
sujet qui doit mettre en évidence la signification et la symbolisation du texte littéraire. Le
lecteur conscient vise à déchiffrer la technique de la production du sens. Par la technique de
narration, il s’agit de la façon de raconter un texte littéraire. Ce mot est en relation avec la
production et l’analyse du texte.
* Yrd. Doç. Dr., Université Dokuz Eylül, Faculté de Pédagogie, Département de Français. 35150 Buca-
IZMIR.
3
Pourquoi lisons-nous un texte littéraire? Avant tout, pour le lecteur-réel, il n’y a pas de
résultat concret et appliquable immédate à la vie quotidienne. Son utilité se dessine en général
dans une longue période. D’ailleurs, celui qui le lit n’en attend pas un résultat immédiat (sauf le
lecteur-traducteur). En tout cas, on lit un texte littéraire, parce qu’il tend au lecteur en quelque
sorte un piège, une surprise que le lecteur essaie de concevoir et d’analyser pendant la lecture
(Günay 1993:7). Cependant un texte littéraire vise à plaire au lecteur, l’intéresser, le
convaincre, en bref retenir l’attention du lecteur de telle ou telle manière. De plus, chaque
lecteur forme un nouvel univers fictif (plurivocrité) du même texte littéraire. Dans la
comprehension du texte, chaque signifiant peut gagner des sens divers suivant le lecteur, ayant
chacun un niveau différent de l’expérience, de l’âge, du point de vue, de savoirs, d’habitudes,
de capacité, de culture; bref chacun a des compétences de lecture différentes. Comme
l’affirment Schmitt et Viala “on peut considérer qu’il y a des «figures de lectures» déterminées
par les acquis culturels, les préjugés, les schémas de pensée, les échelles de valeur, les
fantasmes de chacun” (1992:23). Il s’agit donc de la multiplicité des perspectives. Un même
signe textuel peut être interprété sous des angles différents. En définitive, un texte littéraire a
autant d’interprétations que le nombre de ses lecteurs. Mais le but du lecteur-traducteur est
différent de celui du lecteur-réel. Nous allons expliquer cette différence dans les paragraphes
suivants.
Pour la signification du texte, il y a deux possibilités: celle de l’auteur et celle du lecteur.
L’écrivain est le contemporain et le souverain de son texte. Une fois le texte promis à la
publication il cède la place au lecteur. Puisque l’auteur n’écrit pas uniquement pour lui-même
(c’est une forme d’expression) mais aussi pour le lecteur, il est évident que ce que comprennent
les lecteurs l’emporte sur ce que veut exprimer l’auteur. L’auteur communique quelque chose
au lecteur potentiel. “Expliquer consistera à montrer l’effet qu’a l’énoncé d’intention: il oriente
le lecteur vers certaines interprétations, lui fournit une clef pour décoder le texte” (Riffaterre,
1981:149). Nous comprenons que l’auteur a une force, parce que c’est lui qui est responsable
de la phase de l’acte d’énonciation du texte produit. Le parcours de la signification de texte est
schématisé par Todorov (1980:180) de la manière suivante:
1. Récit de l'auteur 4. Récit du lecteur
2. Univers imaginaire 3. Univers imaginaire
évoqué par l'auteur construit par le lecteur
Dans ce schéma, nous voyons deux interprétations: celle de l’auteur et celle du lecteur.
Ces deux stades sont différents l’un de l’autre. Les deux premiers stades appartiennent à
l’auteur qui est l’énonciateur du texte (surtout du texte littéraire ou du récit). Mais dès le
4
troisième stade, la responsabilité de l’auteur semble se terminer. La relation entre les stades 2 et
3 est donc une relation de symbolisation. Si l’univers sémantique évoqué par l’auteur (stade 2)
était dominant, le texte ne serait pas un texte artistique, au contraire un texte scientifique par
exemple, (parce que l’univers imaginaire construit par le lecteur coïncidait avec celui de
l’auteur “stade 2 = stade 3”). Dans la lecture de l’article technique, ce qui compte, c’est
d’obtenir une information aussi exacte que possible dans un temps aussi réduit que possible. Le
message compte plus que la forme. Les mots sont une vitre transparente qui laisse voir les idées
ou les choses elles-mêmes.
Dans la littérature, au contraire, la compréhension n’est possible qu’à travers une forme.
L’auteur attend que son texte soit compris par son lecteur potentiel. Mais le plus souvent le
lecteur peut trouver quelque chose de tout différent de celui de l’auteur (stade 2 vs stade 3). Il
n’a pu donner le message (stade 2: univers imaginaire évoqué par l’auteur) sur lequel il insiste,
ou bien le lecteur n’a pu trouver la signification à laquelle visait l’auteur. Bien au contraire, les
lecteurs virtuels y ont trouvé des valeurs (stade 3: univers imaginaire construit par le lecteur)
hormis du message ambitionné de l’auteur. La littérature est une interprétation, faite par une
personne un interprète qui a un propre point de vue. L’auteur traduit d’abord le réel, la vie, la
nature; puis le public (le lecteur) traduit cet univers sémantique à son tour indéfiniment. Là, le
lecteur qui a utilisé le même roman a projetté à son tour dans sa lecture sa propre façon de voir.
De ce point de vue, les deux univers sémantiques ne coïncident pas (stade 1 vs stade 2). Dans le
roman, il y a aussi, sans doute, le message perçu par le lecteur, mais du point de vue de l’auteur
ce n’était pas au premier plan (on peut dire l’inverse aussi). En tout cas, c’est l’univers
sémantique, formé par le lecteur, qui est au premier plan. Si ce n’était pas vrai (c’est-à-dire, si
l’univers sémantique construit par l’auteur était vrai), un texte littéraire aurait un seul univers
sémantique et le texte littéraire ne pourrait pas être lu depuis des siècles. Nous pouvons donner
le titre d’un roman de Blaise Cendrars. Jean-Pierre Goldestein demande que signifie le titre de
ce roman:
Blaise Cendrars nomme un de ses romans Le Plan de l’aiguille. Le titre renvoie quant au
référent extralinguistique à un lieu-dit dans les Alpes, au-dessus de Chamonix. Pour Louis
Parrot, il s’agit du plan d’une aiguille aimantée. Pour l’auteur lui-même, le titre s’inscrit
dans une autre cohérence: «Dans mon esprit, c’est la surface d’un disque de phonographe.
(Goldestein, 1990: 81).
En définitive, un texte littéraire a autant d’interprétations que le nombre de ses lectures.
La variation de l’interprétation vient de l’élargissement et de l’élasticité du deuxième système
(système textuel ou littéraire). Quand Valery dit qu”il n’y a pas de vrai sens d’un texte”, il veut
exprimer la polysémie du texte. De la sorte, nous pouvons redire ce que dit Valery de la
manière suivante: le sens que chaque lecteur trouve dans le même texte est son vrai sens, parce
que le travail artistique met en jeu l’imaginaire qui est polyvalent. On peut considérer qu’un
texte stimule l’imagination et qu’il ouvre des portes toutes différentes qui ne sont pas
5
strictement celle de l’interprétation. Puisqu’il est possible d’interpréter un fait littéraire de
différents points de vue, un lecteur-traducteur pourrait apporter sa propre interprétation.
1. 1. Perception du texte littéraire
La langue n’est pas seulement la syntaxe des signes et des sons, mais elle est un produit
homogène qui est formé par des signes et des significations. Dans les langues naturelles, il y a
très peu de mots (signifiants) qui ne signifient que les objets (signifiés) représentés. Le plus
souvent un mot a plus d’un sens (signifiés) ou bien un seul sens (signifiés) est signifié par plus
d’un mot (signifiant). Dans ce cas, il y a toujours une ambiguïté sémantique dans la relation
entre signifiant et signifié. Cette ambiguïté découle le plus souvent de l’homophone du
signifiant. Dans le cas où la langue serait à la fois le moyen de communication et le but de la
communication (par exemple telles sont les situations dans les textes littéraires) cette ambiguïté
peut être au premier plan et un problème à resoudre.
La littérature (ou le texte littéraire) est composée de deux systèmes homogènes: langue et
texte. Il doit comprendre à la fois le système linguistique et le système littéraire. Dans tous les
deux cas, le lecteur doit trouver des équivalents connus auparavant par lui-même. Autrement
dit, il doit changer les signes inconnus par des signes connus. Comme dit Jakobson, “le sens
d’un mot n’est rien d’autre que sa traduction par un autre signe qui peut lui être substitué,
spécialement par un autre signe” (1963:79). Nous savons que la production du texte littéraire
est une affaire de créer, réaliser, produire, inventer, imaginer une totalité (un complexe) à partir
d’un segment, d’un détail.
Le texte littéraire est écrit suivant les deux systèmes à la fois: le système linguistique et
le système littéraire. Pour la traduction on doit tenir compte de ces deux systèmes. On peut
ajouter aussi des relations qui concernent le texte et ses environnements: “les relations qui
existent entre le texte et ses contextes socio-culturels, celles que le relient à la langue naturelle
dont il est le produit; celle qui existent entre le texte et le genre littéraire ou autre qui est censé
le prendre en charge enfin, celles qui existent dans le texte même entre ses différents éléments”
(Yücel, 1992:199-200). Les divers éléments du hors texte (environs socio-culturels, nom de
l’auteur, titre de l’ouvrage, appartenance générique, épigraphe, dédicace, préface, postface,...)
doivent s’introduire dans la lecture.
Il est impossible de déduire le texte littéraire à la langue. Autrement dit on ne peut pas
identifier le texte littéraire à l’un de ses deux composants. Le texte littéraire n’est pas composé
par le composant linguistique ni par le composant textuel, mais par les deux. Il s’ensuit que les
textes littéraires concernent le problème de langue par rapport à l’action humaine perceptible.
2. Place des texte littéraires dans les types de textes
6
Dans des textes différents, l’émetteur veut informer son récépteur, le persuader, ou lui
prédire quelque chose. En suivant cette relation (la façon de présenter), on peut faire une
distinction entre les moyens de communication écrits, à savoir, les textes écrits. Jean-Michel
Adam (1985:39-43) parle de huit types de texte: argumentatif, descriptif, expositif (explicatif),
instructif, narratif, rhétorique et conversationnel.
Par le type textuel argumentatif, il s’agit de l’acte de convaincre, de persuader et de faire
croire. Tous les discours de persuasion concernent ce type de texte. Par exemple les articles
communiqués de presse, publicités écrites. Dans un article communiqué de presse, il ne s’agit
pas d’un but littéraire; tout au contraire, par ces types de discours, il est question d’un but
d’information, de renseignements. Ses contenus seraient probablement réflechissant, transferts.
Un journaliste n’a pas en vue la littérarité. C’est pourquoi la langue utilisée n’a pas une
fonction comme dans le fait de la littérature. Les mots et les phrases expriment quelque chose
au lecteur, renseignent le lecteur à propos d’un sujet. Ces types de textes sont consommés, pour
une seule fois, par les lecteurs dès qu’ils les lui ont livrés. Ils ne sont pas reproduit dans un
autre temps parce qu’il ne s’agit pas de la polysémie dans ce type de textes. A la phase de la
perception du lecteur, il n’est pas question de représenter ou d’imaginer. Dans un texte hors
littéraire, le discours est celui de renseignements et d’informations; le contenu est réflechissant
et transporteur; sa langue est une langue de transporteur, un moyen d’informer. Il sera
relativement facile de traduire un tel texte, parce qu’il ne s’agit pas de la littérarité de la
symbolisation ou de l’interprétation. A ce propos, nous pouvons nous souscrire à la
classification faite par Barthes, qui distingue l’écrivain de l’écrivant. Celui-ci (écrivant)
considère la langue comme un simple moyen de communication, c’est un auteur attaché à un
effet passager: “transmission d’une information, d’une connaissance, persuasion et
modification de l’attitude du destinataire” (Demougin 1986/I:486). L’écrivain, quant à lui, vise
la littérarité. Il est abandonné à une écriture esthétique. Dans les deux cas, l’écrivain est le
souverain de son texte, mais les buts de leurs messages sont différents: écrivain est celui qui
sert au langage (et ne pose donc aucune question, ne défend aucune thèse). “Ecrivain est un
homme qui absorbe radicalement le pourquoi du monde dans un comment écrire” (Barthes,
1964:148) Quant à l’écrivant, il est celui qui sert du langage pour dire quelque chose: informer,
interroger, justifier. “Les écrivants (...) posent une fin (temoigner, expliquer, enseigner) dont la
parole n’est qu’un moyen; pour eux, la parole supporte un faire, elle ne constitue pas” (Barthes,
1964:151). La signification du texte, produit par l’écrivant, est perceptée directement par le
lecteur. A la fin de la perception, le lecteur est renseigné à un sujet précis. Le lecteur peut
entraîner dans une situation imaginaire et sentimentale, mais cette situation ne donne pas le
plaisir esthétique, tandis que le texte littéraire de l’écrivain (selon le terme de Barthes) donne
des goûts esthétiques, parce que c’est une écriture esthétique qui attend à être signifié.
7
Le type textuel descriptif expose la description en tant que des événements authentiques
et des arrangements dans l’espace: inventaire, document, guide touristique, dictionnaire en
constituent des exemples.
Quant au type textuel expositif (ou explicatif), il “est associé à l’analyse et à la synthèse
de représentations conceptuelles” (Adam 1985:40). Dans ce type de texte, il s’agit d’un acte
d’explication ou de faire comprendre un texte au lecteur. On peut donner, pour ce type, les
exemples suivants: discours (didactique, scientifique, politique), harangues, textes
philosophiques, manuels scientifiques,... La langue que l’on choit pour exprimer une situation
scientifique doit être claire et comprehensible. Dans la langue quotidienne (courante), les mots
(signifiants) ont le plus souvent des sens (signifiés). Cette pluralité n’est pas une situation
souhaitable pour et dans la langue scientifique. C’est pourquoi, la science s’applique, de jour en
jour, à employer une langue mathématique (ou bien systématique), car celle-ci ne cause pas une
nébulosité sémantique qui appartient aux langues naturelles, des malentendus dérivant de la
polysémie. Les mathématiques se doivent de définir leurs vocables, de l’isocèle à la dérivée.
Les valeurs (symboles) de la langue mathématique sont précises et limitées. C’est pour cela que
les textes scientifiques sont exprimés à l’aide des symboles mathématiques. Dans ce cas, la
langue littéraire et la langue scientifique sont des pôles opposés.
Le type textuel instructif incite à faire faire quelque chose à quelqu’un. Par ces types de
textes, il s’agit d’ordonner: recette de cuisine, notice de montage, consignes en général,
invectives d’automobiliste, avis officiels. Au contraire nous savons que le texte littéraire n’a
pour but d’inciter le lecteur à agir de telle ou telle manière.
Le type textuel rhétorique englobe l’acte de la fonction poétique. (poème, prose
poétique, chanson, slogan, graffiti, fable et toute pratique du titre).
Le type textuel conversationnel est une conversation, un dialogue: réquisitoire,
plaidoyer, remerciement, discours politique, dialogue d’idée, interview, conversation courante,
récit théâtral sont des types conversationnels.
Quant au type textuel narratif, il est concentré sur des déroulements dans le temps. Selon
Adam, “l’assertion (acte de discours par lequel on pose un état de choses comme étant vrai dans
un monde réel) semble à la source des [types narratif, descriptif et explicatif]” (1985:40). Le
type narratif asserte donc des énoncés de faire. Nous pouvons donner beaucoup d’exemples
pour ce type: bande dessinée, conte, cinéma (récit filmique), histoire drôle, nouvelle, parabole,
publicité narrative, récit mimé, roman,...
Dans cette article, il est question de la traduction de types de textes narratifs, mais surtout
des textes littéraires. Ce type de texte est tout différent d’autres textes, surtout des textes
scientifiques.
3. Traduire et/ou Interpréter
8
On a pu remarquer que, la compréhension du texte littéraire est difficile, il en reste que sa
traduction portera encore ses difficultés probables. Avant tout il nous faut expliquer ce que
c’est la traduction. Pour cette activité culturelle et artistique, il est possible de trouver de
différents types de définition. Nous citons ici celles les plus remarquables. Georges Mounin
définit la traduction comme “l’interprétation des signes d’une langue au moyen des signes
d’une autre langue” (Mounin, 1986:7). Même dans cette explication, nous voyons qu’il s’agit
d’une interprétation de signes. C’est l’art de pouvoir refléter les particularités et les usages
différents de la langue de départ dans la langue d’arrivée. Pour définir cette opération Greimas
insiste sur l’équivalence des énoncés de deux langues. Pour lui, la traduction est une “activité
cognitive qui opère le passage d’un énoncé donné en un autre énoncé considéré comme
équivalent” (Greimas, Courtés, 1979:398). L’auteur donne au lecteur/traducteur un énoncé
accomplit de différents points de vue, mais c’est le lecteur/traducteur qui doit trouver un
énoncé, en langue d’arrivée, équivalent dans différents points de vue. Du texte de la langue de
départ on peut emprunter les sentiments, les impressions, les perceptions, les sensibilités, les
pensées, les images prêts,.... Mais il n’y a pas une règle, une restriction que les équivalents de
ces éléments se placent, se trouvent dans chaque langue (à la fois dans la langue d’arrivée et
dans la langue de départ). L’équivalence entre deux langues est précisée par Charles Bouton de
la manière qui suit:
Il est rare et peut-être impossible d’être équivalent à cent pour cent dans deux langues pour toutes
les zones de la communication verbale telle qu’elle s’effectue chez tous les sujets parlants. La
langue A répond à certaines fonctions de la communication verbale sociale, la langue B à d’autres
et ainsi de suite. Entre ces deux pôles toutes les nuances de situations sont possibles, et il est
parfois difficile de réduire à une description fonctionnelle nette les rôles assignés à chacune des
langues en contact” (Bouton, 1984:54).
Dans cette définition, on introduit aussi la stylistique qui peut se placer dans chaque type
de texte mais le plus souvent dans les textes littéraires ou artistiques. En tout cas, traduire, c’est
énoncer dans une autre langue (ou langue cible) ce qui a été énoncé dans une langue source. Au
cours de cet acte, on essaie de conserver les équivalences sémantiques et stylistiques. Nous
pouvons dire que la traduction est une affaire de recréer un énoncé dans une autre langue, ou de
trouver les équivalents de cet énoncé dans la langue d’arrivée.
Dans le texte littéraire, il y a une relation mutuelle entre l’auteur et le lecteur. Mais
quand nous parlons de la traduction, la relation sera multipliée. Il nous faut parler d’une
relation entre l’auteur et le traducteur (en tant que lecteur du texte dans la langue de départ)
d’une part, et entre le traducteur (en tant qu’auteur simulacre du texte dans la langue d’arrivée,
ou bien porte-parole de l’auteur dans une autre langue inconnue le plus souvent par l’auteur) et
le lecteur de l’autre. Comme dit Kýran, dans le texte traduit, on voit deux auteurs en même
temps: “On peut entendre simultanément la voix de l’écrivain et de traducteur dans le texte
traduit. Dans la traduction, c’est le traducteur qui explique toujours la valeur et l’orientation de
la traduction” (Kýran, 1992:205). En vérité, il n’y a pas une relation entre l’auteur (de la langue
9
de départ) et le lecteur (dans ce sens, nous parlons du lecteur qui lit le texte dans la langue
d’arrivée). A ce propos nous sommes d’accord avec Eco: “La coopération textuelle est un
phénomène qui se réalise entre deux stratégies discursives et non pas entre deux sujets
individuels” (Cité Ryngaert 1991:125). Suivant cette explication, nous pouvons prétendre qu’il
n’y a de relation ni entre l’auteur et le traducteur-lecteur d’une part, et ni entre le traducteur-
auteur simulacre et le lecteur virtuel dans la langue d’arrivée d’autre part. Il s’agit des strategies
discursives qui appartiennent à deux personnes différentes.
Il faut mettre en évidence la différence et/ou la ressemblance entre:
* l’univers imaginaire de l’auteur
* le canevas de l’univers imaginaire du lecteur-traducteur,
* l’univers imaginaire, recréé dans une autre langue, du traducteur-auteur simulacre et
* l’univers imaginaire du lecteur réel.
On peut discuter s’il est possible de traduire correctement le premier stade (l’univers
imaginaire de l’auteur) dans la langue d’arrivée (Nous pouvons nous demander aussi jusqu’à
quel degré l’auteur a pu transmettre le premier stade dans son énoncé accompli: deuxième
stade). Comme nous le voyons, l’univers imaginaire que l’on veut traduire n’est pas celui de
l’auteur mais celui du lecteur-traducteur (le canevas de l’univers imaginaire du lecteur-
traducteur). Ce que veut faire le traducteur est une traduction interlinguale. Il doit interpréter
les signes linguistiques ou littéraires au moyen d’autres signes en employant la même langue.
En définitive, il doit comprendre et commenter le texte à l’aide des signes de la langue par
laquelle est écrit le texte. C’est pourquoi Greimas met l’accent sur la traductibilité. Pour lui,
c’est une question des systèmes sémiotiques: “La traductibilité apparaît comme une des
propriétés fondamentales des systèmes sémiotiques et comme le fondament même de la
démarche sémantique” (Greimas, Courtés, 1979:398). En tout cas, l’acte de traduire s’appuie
sur les particularités et les qualités (facultés, capacité, connaissance, savoir,...) du traducteur.
Nous savons qu’il est porte-parole de l’auteur. Il ne se passe jamais l’auteur du texte. Même
l’auteur du texte traduit son propre texte, dans ce cas, il n’est pas l’auteur, mais le traducteur du
texte. Dernièrement, il est possible de dire que le plus grand écrivain n’est pas toujours le
meilleur traducteur. André Matinet appelle le traducteur comme bilingue professionnel (Cité
par Bouton, 1984:51). Nous partageons à ce que dit Martinet, et de plus, nous pouvons parler,
pour le traducteur, d’un biliguisme coordonné où “le sujet maintient ses deux langues
fonctionnellement séparées” (Fishman, 1971:10). Il doit distinguer les frontières de deux
langues. Autrement dit, il n’a pas le droit d’écrire (ou de traduire) le texte dans la langue
d’arrivée suivant les critères de la langue de départ. Nous pouvons prétendre que le problème le
plus important dans la traduction vient de ce fait. Dans la traduction des textes scientifiques
plus particulièrement, le traducteur-auteur simulacre ne connait pas très bien le système
(syntaxe, sémantique, morphologie, style,...) de la langue d’arrivée (même si elle est sa langue
10
maternelle), il subit le plus souvent l’influence de la langue de départ. Pour le vérifier, on peut
étudier la syntaxe de quelques textes scientifiques traduits.
En conclusion, nous pouvons mettre en évidence les principaux stades d’une traduction
littéraire. Nous avons répété plusieurs fois que notre but est de mettre en évidence la possibilité
de traduire l’univers sémantique du texte dans la langue de départ en langue d’arrivée.
De prime abord, nous pouvons schématiser les stades de l’acte de traduire de la manière
suivante:
Acte
traduire
Langue de Départ Langue d'Arrivée
stade I stade II stade III stade IV
de
L'univer imaginairecréé par l'auteur
dans la Langue deDépart
L'univers imaginairerecréé par le lecteur-traducteur dans laLangue de Départ
La transformation del'univers imaginaire
par le traducteurdans la Langue
d'Arrivée
Le dernier universimaginaire reproduit
par le lecteur réeldans la Langue
d'Arrivée
Dans ce schéma, nous voyons les principaux stades d’une traduction littéraire. Pour
chaque langue il est necessaire de deux phases. D’autre part, il y a une ressemblance entre le
premier et le troisième stades d’une part; et entre le second et le quatrième stades de l’autre. Il y
a quand même des différences entre ces groupes. Par exemple, dans le stade II, le lecteur-
traducteur essaie d’analyser le texte pour traduire dans une autre langue, tandis que dans le
quatrième stade, le lecteur n’a pas un tel souci. Son but est de comprendre ce qui se passe. Nous
allons expliquer les stades et les relation probables entre eux.
3. 1. Premier stade
C’est la phase de l’énonciation du texte littéraire réalisé par l’auteur. Nous pouvons
accepter l’écriture du texte comme le premier stade. Qui dit ce texte? C’est l’auteur qui raconte
ou commente le texte. Raconter un texte emmène l’auteur d’apporter des informations sur les
événements qu’il raconte. Ainsi il vise à modifier le comportement, la pensée ou bien la
croyance de son lecteur. Il peut informer son lecteur, le faire rire, le convaincre, l’émouvoir,...
En conclusion, tout texte a un auteur (même s’il porte un nom dissemblable). Cet auteur forme
son texte en imaginant un lecteur potentiel, ou bien un lecteur-modèle. Le lecteur réel déchiffre
le texte en utilisant un code. Il ne l’écrit jamais pour qu’un traducteur le traduisse dans une
autre langue, mais pour un lecteur potentiel, virtuel et un lecteur modèle.
Pour la compréhension, du point de vue des indices actantiels, spatio-temporels,
énonciatifs, l’univers sémantique créé intentionnellement, rédigé et exprimé par l’auteur à sa
guise, est déictique. Il raconte ce qu’il veut prononcer en suivant une démarche cohérente. Il a
un pouvoir illimité et il est libre de former son texte autant que les règles de la narration le lui
permettent (Günay, 1993:12). Il peut emprunter son sujet, ses référents à un sujet réel et
historique. Ce texte est quand même le produit d’une histoire narrée par une vision qui
11
commente à sa façon le réel ou la fiction. En visant à donner des informations sur des
événements, il peut raconter donc la suite d’événements passés ou fictifs dans une chronologie
cohérente. Du point de vue de la technique narrative, ces événements doivent s’inscrire dans un
déroulement temporel et causal. Pour le texte, un acte d’énonciation (manière de narrer quelque
chose) et la succession d’événements sont nécessaires.
Dès que l’auteur exprime sous la forme d’un texte publié pour le lecteur, il n’aura aucun
droit d’y ajouter quelque chose. Il s’ensuit que sa liberté se termine par la remise du livre au
lecteur, autrement dit par son édition. Jusqu’à présent, il est le souverain de son texte mais pas
du livre, parce que l’écrivain ne produit pas des livres mais des textes.
3. 2. Deuxième stade
Dans ce stade, nous comprenons un énoncé produit et accompli de différents points de
vue. Dès à présent, c’est le critique et/ou le lecteur qui reconstruit l’univers sémantique, avec
son point de vue, mais en partant toujours des structures déictiques du texte dont il s’agit. Pour
l’acquisition des mécanismes du langage et de la communication littéraire nous nous adressons
à la lecture parce qu’elle joue un rôle essentiel dans la relation à la langue et à la culture. C’est
le texte écrit qui crée le concept du lecteur. Autrement dit, un individu devient le lecteur en
face d’un texte produit. De même, le mot texte existe par la lecture. Il y a une relation
réciproque entre ces deux termes. On peut parler donc d’un texte quand le sujet qui le lit
construit le sens de ce texte ou bien quand il lui donne une signification à la fin d’un acte de
lire. Ainsi l’acte d’écrire est toujours suivi par l’acte de lire. “Le texte est lu après un délai qui
suit le moment de sa rédaction (éloignement dans le temps), que ce délai soit de quelques
minutes ou heures (une note de service, une article d’actualité) ou de plusieurs siècles...”
(Schmitt, Viala 1988:14). Dans ce cas le lecteur se trouve toujours en face d’un texte déjà
produit, et il est toujours le consommateur d’un texte, produit avant la lecture.
Le lecteur décode la signification du texte. Il doit analyser la disposition des composants
d’un texte. “La reconnaissance du statut privilégié des langues naturelles n’autorise pas leur
réification en tant que lieux du «sens construit»: la signification est d’abord une activité (ou une
opération de traduction) avant d’être son résultat” (Greimas, Courtés, 1979:398). Nous savons
que chaque composant du texte peut être défini par rapport à la signification de l’ensemble du
texte. Par conséquent, la structure des textes littéraires est formée par la réalité de l’auteur, mais
aussi par la représentation et l’imagination du lecteur. “En posant le problème de la place du
lecteur dans tout texte, Umberto Eco rappelle que la lecture exige toujours un travail
d’actualisation de la part du destinataire” (Cité par Ryngaert, 1991:5). Le texte a noué des
relations complexes que le lecteur essaie de démêler. A la fin de ces explications, du point de
vue de la perception du texte littéraire, nous voyons que le lecteur a plus de fonctions que
l’auteur. Lui aussi, il doit analyser et lire, étap par étap, ceux qu’écrit, encode, énonce l’auteur.
12
Quel est le but de l’acte de lire: construire, produire et/ou consommer? Le but de la
lecture est de mettre en évidence les sens d’un texte, de décrire systématiquement un texte et
ses structures. Au cours de cet acte, le lecteur essaie de produire un sens par l’activité de
structuration, c’est-à-dire de mise en rapport de signes les uns avec les autres. Pour l’acte de
lire il s’agit de “suivre les instructions d’un texte, (...) [d’]établir des relations entre des
connaissances préalables et une expérience nouvelle, [et d’]anticiper sur la base d’un savoir,
pour vérifier ensuite pas à pas des hypothèses” (Adam 1990:41). Celui qui établit ces relations
pourra être, le plus souvent, un personnage hors du texte ou un narrataire dans le texte. Il
cherche la construction qu’il produit lors de la lecture. Il en ressort que le lecteur est un
producteur de sens de ce texte donné, et doit faire toujours quelque chose pour le comprendre.
Néanmoins il est un consommateur du texte déjà produit par l’auteur, parce qu’il cherche à
déchiffrer toujours un texte écrit et produit auparavant. “Le lecteur perçoit le texte en fonction
de son comportement habituel dans la communication ordinaire: un texte non figuratif sera
reconstitué, rationalisé comme figuratif” (Riffaterre, 1981:149). Le lecteur ne cherche pas des
éléments hors de l’univers créé par l’auteur. Mais puisque la symbolisation dépend des
interprétations qui varient d’un sujet à l’autre (Todorov, 1980:180), la difficulté de la
traduction provient des interprétations personelles. Chaque traducteur se limite à transmettre
l’univers sémantique construit par lui-même.
Le lecteur-traducteur1 lit d’abord le texte publié dans la langue de départ. Avant de le
traduire, il essaie de construire un monde imaginaire, parfois différent de celui de l’auteur
propre de ce texte. A la fin de sa construction, il essaie de traduire, de transformer son monde
imaginaire dans une autre culture. Par conséquent, il est d’abord un consommateur (du texte
produit par l’auteur dans la langue de départ), puis producteur du monde imaginé par l’auteur et
ensuite un créateur (traducteur) de ce monde imaginé dans une autre langue et une autre
culture.
3. 2. 1. Relation entre les deux stades (premier et deuxième)
Nous savons que chaque texte littéraire porte “un savoir, plus ou moins vaste, plus ou
moins explicite, plus ou moins convaincant, plus ou moins subversif, etc.” (Dumortier, Plazanet
1980:12). Le texte ne nous donne pas donc le renseignement sur la vie réelle, mais il nous
donne le savoir propre à l’auteur. Clement distingue la vérité du savoir de la manière suivante:
“la vérité est un rapport qui nous est barré; le savoir est le rapport indirect qui nous est acquis”
1 Dans ce stade, nous nommons cette personne lecteur-traducteur, parce qu'il lit d'abord le texte, mais
ensuite il essaie de traduire ce texte dans une autre langue. Par conséquent, c'est au cours de la
traduction qu'il est un traducteur. Avant la traduction il est un lecteur et après cette opération il
serait probablement un lecteur quelconque encore. Dans le deuxième stade, nous l'appelerons
comme lecteur-traducteur, mais dans le troisième stade, traducteur-auteur simulacre. En vérité,
13
(1981:129). Par conséquent, le lecteur ne cherche pas la vérité dans le texte littéraire, mais le
savoir parce que le texte de l’auteur n’exprime pas la vérité, mais donne surtout un ensemble de
processus textuels. En tout cas nous pouvons accepter que la réalité peut être le contexte dans le
schéma communicatif du texte littéraire. “Parler de la vérité ou de la non-vérité d’un tel texte
n’a aucune pertinence: nous ne pouvons pas l’expliquer qu’en évaluant son degré de conformité
au sysytème verbal, en nous demandant s’il obéit aux conventions du code ou s’il le
transgresse” (Riffaterre, 1981:149). Le lecteur est à la suite du “repérage et de l’interprétation
de réseaux de sens, par une série artificiellement séparées qu’il emporte de combiner”
(Ryngaert 1991:127). Le lecteur ne cherche pas la vérité qui est un rapport entre cause et sujet
ou bien entre sujet et objet. Il cherche le plus souvent le savoir qui est “une appropriation
constitutive de la vérité (...) le rapport indirect qui nous est acquis: la science, dans ce savoir,
consiste dans la réduction de l’imaginaire qui offusque tout le symbolique” (Clement,
1981:128-129). Précisons ici que le savoir peut exprimer la vérité ou non. Pour le lecteur cela
n’a pas une valeur nécessaire ou importante.
La fonction du lecteur-traducteur est remarquable: en lisant le texte de l’auteur, il
imagine un univers fictif et il traduit à la fois le système linguistique et le système littéraire de
la langue de départ en langue d’arrivée. Ýl s’ensuit qu’il n’est pas un lecteur quelconque et il se
distingue du lecteur-modèle dans la langue de départ, parce qu’il vise à faire accepter son
monde imaginaire au deuxième lecteur dans la langue d’arrivée.
Durant la lecture, le lecteur-traducteur est un lecteur attentif qui recherche la
signification du texte littéraire, les causes et les effets des phénomènes littéraires. Mais ici
aussi, il est attentif parce qu’il vise à refléter ces causes et effets dans la langue d’arrivée.
3. 3. Acte de traduire
C’est l’étap du processus d’interprétation du texte par le traducteur. L’opération de
traduire est de trouver les équivalents dans la langue d’arrivée, les unités linguistiques, les
valeurs culturelles de la langue de départ par l’intermediaire du traducteur qui a pour but de
former un texte dans la langue d’arrivée. C’est cette traduction qui donne le sens du texte dans
une autre langue. Il faut affirmer que parallèlement aux facteurs linguistiques, les facteurs
individuels et sociaux favorisent beaucoup la compréhension du message aussi bien que au
niveau de la communication intralinguale qu’à celui de la communication interlinguale. Il nous
faut dire que les connaissances du traducteur de deux langues doivent être parfaites. En plus, le
traducteur doit avoir des qualités et des capacités nécessaires, si bien qu’il vise à voir et à lire
entre les lignes.
lecteur-traducteur ou traducteur-auteur simulacre sont la même personne. C'est sa fonction qui
change.
14
Le malentendu, ou bien l’échec de la traduction peut résulter du fait que le traducteur se
passe pour un bilingue composite où “le sujet traite l’une de ses deux langues, voire les deux,
comme un code qui doit se comprendre en fonction de l’autre” (Fishman, 1971:10). Dans ce
cas, il y a évidemment plus d’interférence, mais moins de problèmes psychologiques
d’identification. “Le traducteur bilingue par définition est le lieu privilégié et conscient du
contact des langues, mais aussi le cas d’exception où ce contact est constamment évité au cours
même de l’opération de traduction” (Bouton, 1984:60). Il doit interpréter les signes
linguistiques au moyen d’une autre langue.
Le traducteur, à côté d’analyse correcte de la structure textuelle, doit analyser le
contexte hors-textuel en tant que la culture où l’on a produit le texte, les particularités de la
culture, les coutûmes, les mœurs, les traditions du peuple qui appartient à cette culture. Lui qui
fait fonction du lecteur prend en charge l’auteur (simulacre de l’auteur?) du texte de la langue
d’arrivée: “La traduction peut (...) résulter d’une collaboration entre un bon connaisseur de la
langue étrangère et un excellent écrivain qui se borne à la deviner. Le texte original s’achemine
ainsi vers sa transposition par l’intermédiaire d’un mot à mot commenté: d’abord vidé de sa
substance poétique, il est ensuite ré-animé” (Brunel, Pichois, Rousseau, 1983:44). Transmettre
le contenu et la forme du message linguistique et trouver l’équivalence formelle qui vise la
compréhension directe dans le contexte de la langue cible sont des problèmes à être résolus par
le traducteur. “La traduction implique la recherche de l’équivalence dans la différence, en
d’autre termes, l’équivalence des signifiés dans la différence des signifiants” (Kýran,
1992:204). Avant de traduire, il faut que le texte soit compris d’une manière correcte, en tant
que tel et que l’on le commente consciemment. Le traducteur est partagé entre la soumission au
texte et son tempérament, et entre le critique et la création.
L’auteur peut écrire son texte depuis des années, mais pour le traducteur, il n’y a pas une
telle restriction. Un auteur écrit un roman depuis deux années, dès qu’il obtient un prix de
Nobel par exemple, un traducteur le traduit dans un peu de temps, parce que son éditeur le
commande afin de gagner beaucoup d’argent.
A la fin de ce stade, nous avons un autre texte, dit texte traduit. Le lecteur virtuel de la
langue d’arrivée trouvera ce texte pour lire.
3. 4. Troisième stade
Dans le troisième stade, le lecteur-traducteur, à la fin de la fonction de consommer du
texte produit du deuxième stade, devient un producteur et un créateur: “Le traducteur fournit
une illustration presque parfaite de la situation d’un bilinguisme individuel vécu au plus
profond de la conscience” (Bouton, 1984:51). Il se passe pour un autre auteur ou bien un auteur
simulacre. Comme l’auteur du texte dans la langue du départ, il ne sait non plus son lecteur
potentiel. Le traducteur-auteur simulacre doit refléter dans la langue d’arrivée ce que insiste
15
l’auteur. “D’une langue à l’autre les signifiants postulent des signifiés, ou des économies
complexes de signifiés dont les organisations sont si spécifiques que l’identifications signifiant
(A) (L1) ou langue d’origine à signifiant (A’) (L2) ou langue cible n’est jamais possible”
(Bouton, 1984:60). Il doit traduire les figures de styles, fournir les équivalences
morphologiques et syntaxiques. Mais de temps en temps, pour pouvoir transmettre les valeurs
sémantiques, le traducteur morcèle les phrases de l’auteur. Il a pour but de pouvoir exprimer le
style ou le sens du texte.
On peut s’interroger sur ce que le traducteur traduit: la forme ou le contenu? Selon
Greimas, “la littérature (...) se présente comme la forme linguistique de la communication des
contenus” (1981:24). Nous pouvons dire que la traduction littéraire est une opération propre à
elle-même. Il fait la traduction à la fois de la forme et du contenu; ou bien il ne fait la traduction
ni la forme ni le contenu. On peut confirmer cette idée suivant ce que dit E. Cary. Pour lui, “la
traduction littéraire n’est pas une opération linguistique, c’est une opération littéraire, la
traduction poétique est une opération poétique” (Cité par Bouton, 1984:64). Dans le troisième
stade, le traducteur vient de créer un autre texte ou bien il a écrit un énoncé considéré comme
équivalent de l’énoncé déjà donné par l’auteur.
3. 4. 1. Relation entre premier et troisième stades
Le traducteur a conscience de deux langues. Pour le lecteur il n’y a pas une telle
restriction. Quand l’auteur écrit son texte, il est influencé toujours d’une seule langue. Mais
quand le traducteur essaie de traduire le texte de l’auteur, il devient un bilingue. “L’intérêt
proprement linguistique des situations de bilinguisme s’explique par les contacts que ces
situations déterminent entre les langues qu’elles mettent en cause. Mais ces contacts naissent
toujours de facteurs individuels” (Bouton, 1984:49). Dans l’acte de traduire, nous voyons
toujours la capacité, la faculté individuelles du traducteur. “Le lieu de contact des langues,
c’est-à-dire le lieu où se réalisent des interférences entre deux langues-interférences qui
peuvent se maintenir ou disparaître- est toujours un locuteur individuel” (Mounin, 1986:3).
Dans les deux stades les lecteurs virtuels trouvent toujours deux textes différents.
L’auteur ne sait pas le contenu du texte traduit par son simulacre (traducteur). En vérité,
le texte énoncé par l’auteur est la base, tandis que le texte traduit par un autre est
l’interprétation des signes, la signification et la symbolisation du texte de l’auteur. “Les
conduites verbales [du tracteur] mettent en évidence, dans les deux langues qu’il pratique
simultanément, l’existence de phénomènes d’interférence qui vont généralement de la langue
source à la langue cible d’une façon unidirectionnelle. En d’autres termes, on peut toujours
constater l’influence de la langue qui est traduite sur celle dans laquelle on traduit” (Bouton,
1984:51. Souligné par nous). On peut prétendre que c’est un problème sur lequel insistent les
théoriciens à la traduction.
16
3. 4. 2. Relation entre deuxième et troisième stades
Dans ces deux stades, il y a un point important: dans le deuxième stade le lecteur-
traducteur lit le texte et essaie de le comprendre. Mais dans le troisième stade, il tâche de
réfleter ce qu’il a compris, la signification et la symbolisation du texte de la langue de départ.
On peut se demander si l’univers sémantique décodé par le lecteur-traducteur coïncide avec
l’univers sémantique encodé par le traducteur-auteur simulacre. Les traducteurs manifestent
“les goûts des néologismes étrangers, la tendance aux emprunts, aux calques, aux citations en
langue étrangère, le maintien dans le texte une fois traduit de mots et de tours non traduits”
(Mounin, 1986:4). Nous savons que les deux textes ne sont pas le même parce qu’une autre
personne a intervenu dans la communication littéraire. Le lecteur réel ne trouve pas l’auteur
comme l’énonciateur du texte.
3. 5. Quatrième stade
Du point de vue linguistique, la communication qui est l’action de transmettre une
information à quelqu’un exige la simple présence de l’émetteur et du récepteur, présence qui
suffit pour que la communication s’établisse. Cette opération correspond à l’établissement
d’une correspondance univoque entre deux systèmes de référence (ou univers) spatio-
temporels, l’émetteur et le récepteur. Dans le cas où il y aurait une communication littéraire,
c’est l’auteur qui encode le texte. Le lecteur, à ce moment-là, sera le décodeur du message: “Le
schéma traditionnel de la communication qui analyse le processus «d’encodage» et de
«décodage» d’un message ne tient pas assez complexe du fait que les codes du destinataire
peuvent différer, totalement ou en partie, des codes de l’émetteur” (Ryngaert, 1991:124-5).
Dans chaque texte il y a toujours ces deux systèmes de références spatio-temporels. Même s’il
s’agit de l’absence de l’auteur dans son texte, il faut accepter toujours l’existence de l’auteur.
Dans le cas où l’auteur ne serait pas dans le texte, le lecteur réel l’imagine sans peine et l’y
replace, par comparaison avec la communication ordinaire, où l’existence d’un encodeur est
toujours manifesté. Pour un texte traduit, du point de vue de l’émetteur, il y a une malentendu.
Qui est son émetteur? Son auteur et/ou son traducteur? Nous pouvons accepter que tous les
deux sont l’émetteur (ou destinateur) du texte traduit. Quant au récepteur, nous savons qu’il
“constitue une classe de variables et que le contenu à communiquer peut passer ou ne pas
passer dans le processus ainsi constitué. La notion de transmission complète dès lors celle de
communication, dans la mesure où la transmission, tout en présupposant la communication,
comporte le contrôle du transfert des contenus investis” (Greimas, 1981:21). Nous trouvons le
lecteur de qui nous venons de parler et que nous venons de définir dans le chapitre 1. Signifier
du texte. C’est lui qui lit le texte qui vise à lui plaire et qui retient l’attention du lecteur de telle
ou telle manière.
17
Dans ce stade, nous sommes en face d’une lecture à proprement parler. La lecture d’un
texte littéraire ne ressemble pas à celle d’un texte hors-littéraire (scientifique, argumentatif,
descriptif,...). Le texte littéraire n’est pas un système qui est limité par le domaine de la langue
(un système primaire). Néanmoins il utilise toujours ce système déjà existant. En définitive, ce
système n’est pas suffisant pour la lecture d’un texte littéraire. La définition de texte proposée
par Umberto Eco est à noter à cet égard: “le texte est une machine paresseuse qui exige du
lecteur un travail coopératif acharné pour remplir les espaces de non-dit ou de déjà dit resté en
blanc, (...) le texte n’est pas autre chose qu’une machine présuppositionnelle” (Cité par
Ryngaret 1991:5). Pour le remplissement des espaces de non-dit, Il faut introduire donc un
autre système, différent du premier: système textuel. En partageant le point de vue de Tzvetan
Todorov, nous devons préciser:
on lit des textes entiers, et non des phrases. On compare donc les phrases entre elles du
point de vue de l’univers imaginaire qu’elles contribuent à construire; et on découvre
qu’elles diffèrent à plusieurs égards, ou encore, selon plusieurs paramètres (...) le temps, la
vision et le mode (Todorov, 1980:177).
Ce sera la deuxième modification de l’univers sémantique créé par l’auteur. On peut
conclure qu’il y aura beaucoup de sens perdu ou ajouté.
Pour comprendre un texte littéraire, il faut donc tenir compte de deux systèmes à la fois:
ce qui est écrit par voie du système de la langue (percevoir la série de signes visuels), et ce qui
n’est pas écrit mais qui y existe virtuellement, d’une manière cachée, sous-jacente (déchiffrer
par l’abstraction ce qui se passe, mettre en rapport les signes les uns avec les autres,...). A ce
propos, Barthes nous confirme comme suit:
comprendre un récit [ou bien un texte littéraire], ce n’est pas seulement suivre le
dévidement de l’histoire, c’est aussi y reconnaître des «étages», projeter les enchaînements
horizontaux du «fil» narratif sur un axe implicitement vertical; lire (écouter) un récit ce
n’est pas seulement passer d’un mot à l’autre, c’est aussi passer d’un niveau à l’autre.”
(1977:14-15).
Comprendre le texte, c’est donc de concevoir la combinaison de plusieurs séquences,
plusieurs systèmes de communication. Le lecteur réel doit faire quelque chose pour le
comprendre. Avant tout, il déchiffre le texte en utilisant un code, un système complexe, il doit
connaître la date de l’écriture à une époque donnée. Il y a un droit du lecteur à l’interprétation,
c’est-à-dire à l’activation de pistes qu’il repère dans le texte et qui y ont été prévus par l’auteur.
Mais il faut préciser que toutes ces pistes ne sont pas activées de la même façon par les
différents lecteurs à différentes époques. Nous avons parlé du droit de lecteur. Mais la
puissance du lecteur dépend de sa capacité.
3. 5. 1. Relation entre premier et quatrième stades
Le lecteur-réel se trouve en face d’un monde imaginé une deuxième fois. Lui aussi,
comme le fait du lecteur-traducteur, il essaie de construire le nouveau modèle d’imagination.
En vérité il ne connaît pas l’auteur, de la sorte il n’y a pas une relation entre premier et
18
quatrième stades. D’un autre point de vue, il y a une relation intime entre ces deux stades.
Puisque l’auteur écrit son texte pour un lecteur potentiel, c’est ce lecteur réel qui est son
destinataire. Si nous acceptons ce dernier, le traducteur sera un moyen, un intermediaire entre
le premier et le quatrième. Nous avons vu que le deuxième et le troisième stades appartiennent
au traducteur pour pouvoir réaliser son acte de traduire. En conclusion, c’est lui qui répond à
une question telle que: que dit ce texte ou bien comment dit ce texte ce qu’il dit?
En partant d’un point de vue, chaque lecteur (qui lit le texte dont il s’agit) peut répondre
à une question telle que: que dit ce texte? Le lecteur va probablement commencer à repondre
par une expression telle que: “d’après moi, dans ce texte, il s’agit de....”. Le concept de d’après
moi existe toujours dans la réponse de cette question, parce que chaque lecteur qui forme son
propre point de vue, peut y trouver quelque chose de différent des autres. Lire un texte c’est de
recréer un univers sémantique et discursif, (parfois) différent de celui de l’auteur concret, déjà
formé pendant son écriture. Mais celui-ci ne coïncide pas toujours avec celui-là recréé par le
lecteur.
En vérité le lecteur réel (de la langue d’arrivée) essaie de signifier ce que veut dire
l’auteur à la fois du texte de la langue de départ et du texte reproduit par le lecteur-traducteur.
3. 5. 2. Relation entre deuxième et quatrième stades
C’est le redoublement de la signification du même texte par des lecteurs dont les buts
sont différents. En vérité, les premiers buts de ces deux lecteurs sont les mêmes: ils cherche
comment l’auteur “s’efforce de transcrire le monde extérieur et intérieur à l’aide de simple
petits signes noirs couchés sur le papier” (Brunel, Pichois, Rousseau, 1983:140). Chacun va
apprendre probablement la réponse, mais le second l’atteindra par l’intermédiaire du premier
(lecteur-traducteur). Le premier lecteur (traducteur) lit le texte afin de le comprendre
correctement et de le traduire dans une autre langue, tandis que le second le lit pour remplir les
espaces de non-dit, déchiffrer ce qu’il est inscrit dans le texte. Nous pouvons aisément dire que
le premier a toutes les fonctions du second.
3. 5. 3. Relation entre troisième et quatrième stades
C’est le redoublement de la relation entre le premier et le deuxième stades. Mais le but
de deux lecteurs sont différents: alors que le lecteur-réel lit le texte pour éprouver le plaisir, le
lecteur-traducteur le lit afin de le traduire dans une autre langue, de l’imposer au lecteur-réel et
d’essayer de devenir un autre auteur, du moins un porte-parole de l’auteur. En plus il a une
fonction très importante: traduire. Dans ce cas, la fonction du traducteur est aussi significative
que celle de l’auteur. En tout cas nous pouvons apporter notre critique: un auteur d’une autre
culture, d’une autre civilisation devient connu par l’intermédiaire d’un traducteur. Et nous
avons dit que les fonctions de ces deux personnes sont à peu près équivalentes. Tout le monde
19
peut citer quelques noms d’auteur connus tandis que personne ne peut dire deux ou trois noms
de traducteur qui fait connaitre les auteurs cités.
4. Conclusion
La traduction n’est pas la langue elle-même, mais une trasmission de l’usage de la
langue. Le traducteur fait des choix sémantiques, stylistiques, syntaxiques et morphologiques.
La théorie de la traduction est une opération en ce qui concerne les particularités
communicatives de deux langues et la traduction s’appuie sur les usages différents des langues,
cultures, coûtumes et des valeurs locales. Ce sera alors un essaie de les comparer. L’opération
de traduire est un acte d’écrire un autre texte dans la langue d’arrivée à partir du texte de la
langue de départ, par le traducteur ayant le souci de trouver les équivalents, dans la langue
d’arrivée, des unités linguistiques du texte dans la langue de départ. En conclusion, la
traduction consiste à passer d’un code à un autre, dans le processus de communication. Mais
chaque traduction a besoin d’un traducteur, qui, pour le texte littéraire, aura une valeur
importante.
Si nous acceptons que la traduction est un art, nous devrons accepter qu’elle changera
suivant le changement social. De la sorte, chaque texte littéraire sera traduit dans de différents
temps. Cela veut dire que l’acte de la traduction interlinguale durera toujours. Ce sont le
traducteur, le temps, l’espace, le texte qui changeront. La traduction n’est pas une transmission
de la langue mais une transmission des usages linguistiques. Chaque traducteur trouvera des
usages différents l’un de l’autre.
Pour le texte littéraire, on peut parler de deux types de traductions. La traduction
interlinguale est nécessaire. Mais avant tout le lecteur-traducteur doit faire une traduction
intralinguale: commenter et signifier le texte dans sa langue écrite. La signification et la
symbolisation de la langue de départ ont le plus souvent une polysémie. Il doit choisir le
meilleur sens parmi ces valeurs. Le traducteur doit choisir l’une de ces valeurs. D’autre part la
signification ou la symbolisation faites dans la langue d’arrivée aurait aussi une polysémie. De
la sorte, il y a absolument une perte de sens dans le texte transmis.
En conclusion, de peur de la perte de sens, ne faut-il pas faire la traduction? Non.
L’intéraction entre des peuples, des cultures, des langues dureraient toujours. Nos
applaudissements sont pour les traducteurs.
BIBLOGRAPHIE
ADAM, Jean-Michel (1990) Le Texte Narratif, Traité d’Analyse Textuelle des Récits. Paris:Nathan-
Université
BARTHES, Roland (1964) Essais Critiques. Paris: Seuil.
20
--------- (1977) “Introduction à l’Analyse Structurale des Récits.” in Poétique du Récit. œuvre collective,
Paris: Editions du Seuil , [7-57].
BOUTON, Charles, (1984) La Linguistique Appliquée. Paris:PUF, 2è édition.
BRUNEL, P.; Cl. PICHOIS, A.-M. ROUSSEAU (1983) Qu’est-ce que la Littérature Comparée? Paris:
Armand Colin.
CLEMENT, Catherine, “La Science Psychanalytique” in L’Enseignement de la Littérature. œuvre
collective, Sous la direction de: Serge Doubrosky et Tzvetan Todorov, Paris/Bruxelles: A. De
Boeck/Duculot [126-133].
DEMOUGIN, Jacques (Sous la direction de -) (1986) Dictionnaire Historique, Thématique et
Technique des Littératures Française et Etrangères, Anciennes et Modernes. 2 volumes.
Paris: Larousse
DUMORTIER, J.-L., Fr. PLAZANET (1980) Pour Lire le Récit. Bruxelles. Paris/Gembloux: A. De
Boeck/J. Duculot..
FISHMAN, Joshua A. (1971) Sociolinguistique. Paris/Bruxelles: Nathan/Université, Collection:
“Langage et Culture”.
GOLDENSTEIN, Jean-Pierre, (1990) Entrées en littérature, Paris: Hachette, Collection: F.L.E.
GREIMAS, Algirdas-Julien (1981) “Situation de la Littérature dans l’Enseignement” in L’Enseignement
de la Littérature. œuvre collective, Sous la direction de: Serge Doubrosky et Tzvetan Todorov,
Paris/Bruxelles: A. De Boeck/Duculot [20-32].
GREIMAS, Algirdas-Julien, Joseph COURTES (1979) Sémiotique. Dictionnaire Raisonné de la
Théorie du Langage. Vol.I. Paris: Hachette-Université.
GÜNAY, V. Doðan (1993) La Technique de Narration Dans la Pièce de Siegfried de Jean
Giraudoux. Thèse de Doctorat inédite, Université de Hacette, Institut des Sciences Sociales,
Ankara.
KIRAN, Ayþe, Prof. Dr., (1992) “Les Problèmes Sémantiques de la Traduction” in Frankofoni. No:4,
Ankara, [203-214].
JAKOBSON, Roman, (1963) Essais de Linguistique, Paris: Minuit.
MOUNIN; Georges, (1986) Les Problèmes Théoriques de la Traduction. Paris:Gallimard,
collection:Tel.
PINGAUD, Bernard, (1981) “Situation de l’Écrivain”, in L’Enseignement de la Littérature. œuvre
collective, Sous la direction de: Serge Doubrosky et Tzvetan Todorov, Paris/Bruxelles: A. De
Boeck/Duculot [33-45].
RIFFATERRE, Michael (1981) “L’Explication des Faits Littéraires” in L’Enseignement de la
Littérature. œvre collective, Sous la direction de: Serge Doubrosky et Tzvetan Todorov,
Paris/Bruxelles: A. De Boeck/Duculot
RYNGAERT, Jean-Pierre (1991) Introduction à l’Analyse du Théâtre. Paris: Bordas.
SCHMITT, M.-P.; A. VIALA (1988) Savoir-lire, Précis de Lecture Critique. Paris: Didier, 5e édition
--------- (1992) Faire/Lire. Paris: Didier.
TODOROV, Tzvetan (1980) Poétique de la Prose. Paris: Editions du Seuil.
YÜCEL, Tahsin, Prof. Dr., (1992) “Zazie en Turquie” in Frankofoni. No:4, Ankara, [199-202].
21
Özet yerine
Bu çalışmamızda yazınsal bir metnin çevirisinde karşılaşılan güçlükleri açıklamaya çalıştık.
Konumuzu yazınsal metinle sınırlandırmamızdaki amacımız; bu tür metinlerin günlük hayatta
karşılaştığımız diğer tür yazılı anlatımlardan farklı olmasındandır. Zira yazınsal metinlerin öncelikle
kaynak dil içinde anlaşılır hale getirilmesi gereklidir. Bir başka deyişle, yazınsal metinlerin öncelikle dil
içi (fr. traduction intralinguale) bir çeviriden geçtikten sonra bir başka dile çevrilmesi (fr. traduction
interlinguale) gereklidir. Yazınsal bir metnin kaynak dilde anlamlandırılmasını ve bir başka dilde (amaç
dilde) yeniden yaratılmasını (üretilmesi) açıklamaya çalıştık. Kaynak dildeki yazınsal bir metni anlamaya
çalışan okuyucu olan, ve amaç dilde bu okuduğu imgelemsel dünyayı yeniden yaratmaya çalışan bir ara-
yazar (ya da sözde yazar) olan çevirmen’in durumunu, işlevinini ve karşılaştığı güçlükleri sorguladık.
Bu çalışmamızda çeviri edimine bir: okuma, yeniden yazma ve yeniden yaratma edimi olarak
yaklaştık. Yazınsal metinlerin kaynak dilde okunup, o dille algılanması ve çözümlenmesi gereklidir.
Çevirmen söz konusu metinde anladığı kadarını amaç dile aktaracaktır. Bu da yazın çevirisinde yeterli
değildir. Çevirmen yazınsal metini anlayabildiği ve simgeleri yerleştirebildiği, açıklayabildiği kadarıyla
okuma ediminde başarılıdır. Aynı başarıyı çeviride gösterecek veya göstermeyecek diye zorunluluk
yoktur. Belki ideal olanı kaynak dilde okuduğu metni tam çözümleyip bu anladığını gerek sözdizim
düzeyinde gerekse anlam düzeyinde amaç dilde yansıtmasıdır.
Yazınsal bir metin herhangi bir söylemden farklıdır. Günlük konuşmalar dil dizgesi içinde
çözümlenebilir. Halbuki yazınsal bir metni çözümleyebilmek için sadece dil dizgesi yeterli değildir. Dilsel
yapının yanında metnin kendi örgüsünden gelen belki de metinsel yapı diyebileceğimiz bir yapıyı da göz
önünde bulundurmamız gerekir. Kaynak dildeki yazınsal metni çözümlemeye çalışan çevirmen öncelikle
bir okurdur. Okuyucunun ilk görevi okuduğu metni dil düzleminde çözümlemektir. Bu Tzvetan
Todorov’un metin inceleme yönteminde ilk aşamayı belirtir. Yani metinin öncelikle anlamlandırılması
(signification) gerekmektedir. Ama yazınsal bir metnin kendiliğinden doğan dil dışı bir özelliği de vardır.
Bu da Todorov’un anlatımıyla simgeleştirme (fr. symbolisation) aşamasının çözümlenmesidir. Tzvetan
Todorov’un yazınsal metinlerin algılanmasında sözünü ettiği anlamlama (signification) ve
simgeleştirmelerin (symbolisation) eş zamanlı olarak amaç dile aktarılması, edebi metin çevirisinde
başarıyı getirir. O halde bir yazınsal metnin dilsel ve yazınsal çözümlemesinden sonra anlama edimi
gerçekleşir. Çevirmen dediğimiz kişi bu aşamaya kadar bir okurdur. Yazarın oluşturduğu düşsel evrenden
farklı ya da aynısı bir düşsel evren yaratmıştır.
Bu aşamadan sonra okuyucu artık bir ara yazar durumuna dönüşmüştür. Yani amaç dilde yeniden
yaratması sözkonusudur. İşte bu yeniden yaratma çeviridir. Burada şunu belirtmeliyiz: Kaynak dildeki
yazınsal metni okuyan çevirmen, yazarın kurduğu imgelemsel dünyayı kendisi yeniden oluşturur. Bu iki
imgelemsel dünya çakışmayabilir. Bir de başka dile aktarılırken iki dilin kullanıldığı toplumsal özellikler,
kültürel farklılıklar, gelenek ve görenek gibi yan etmenlerin olumlu ya da olumsuz yanlarıyla amaç dilde
yeniden yaratılır.
İki dil arasındaki çeviri serüvenini şu şekilde şemalaştırabiliriz:
22
K a y n a k d i l A ma ç d i l
Yazarın kaynak Çevirmen-okurun Çeviri Çevirmenin bir Amaç dildeki
dilde oluşturduğu kaynak dilde başka dilde ya- okuyucunun son
düşsel evren oluşturduğu düşsel edimi rattığı ikinci kez oluşturduğu
evren düşsel evren düşsel evren
aşama I aşama II aşama III aşama IV
Gerçekte çevirmen kaynak dildeki metni amaç dilde yeniden yaratmıştır. Bu yaratmayı yeniden
yazma olarak da tanımlayabiliriz. Klasik örnektir: Sabri Esat Siyavuşgil, Edmond Ronstard’ın Cyrano de
Bergerac çevirisindeki “No Merci!” yi “istemem eksik olsun” diyerek çevirmesi, bu bağlamda yeniden
yazma işidir. Yani Siyavuşgil, amaç dildeki metni kendi bağlamı içinde anlamlandırmış ve amaç dilde
yeniden üretmiştir. Buradaki üretme, çeviri (özellikle geleneksel anlamdaki bir dilden diğer dile çevirme
edimi) aşamasını aşmaktadır. Yine Can Yücel’in şiir çevirileri dikkate değerdir. Yücel, bir başka dilde
okuduğunu Türkçe’de yeniden yazmıştır. Belki de Can Yücel’in şiir çevirilerinde anlam çevirisi vardır
diyebiliriz. Bu Todorov’un incelemesiye dilsel çeviri (traduction de la signification) yerine simgelerin
çevirisi (traduction de la symbolisation) olarak görmek gerekiyor.
Burada I.aşama ile II, I ile III, I ile IV, II ile III, II ile IV ve hatta III ile IV. aşamalar arasında
farklılıklar, anlam kayıpları, fazlalıkları olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Ama arzu edilen bu kayıpları,
fazlalıkları en az düzeyde olmasıdır. Hiç olmazsa metnin genel anlamının aktarılması gerekmektedir.
Bütün bunların sonunda çeviri edimi yapmayalım mı? Hayır, kültürlerarası etkileşim hep sürecek.
Alkışlarımız çevirmen için.