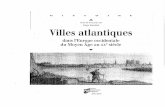Thèmes agro-bucoliques gravés sur les épitaphes romaines. Entre iconographie du réel et...
Transcript of Thèmes agro-bucoliques gravés sur les épitaphes romaines. Entre iconographie du réel et...
81
Aurélien CAillAud
Thèmes agro-bucoliques gravéssur les épiTaphes romaines:
Entre iconographie du réel et iconographie eschatologique
la vie champêtre a durant plusieurs siècles constitué une source d’inspiration quasi intarissable pour les poètes et les artisans romains, nourrissant de façon continue les arts littéraires et figuratifs. Le personnage du paysan et le monde haut en couleur du fundus rusticus, spécialement dans ses dimensions animalières, architecturales et paysagistiques, fournirent inlassablement aux artistes des scènes de genre variées, souvent reprises et abondamment diffusées. Le monde rustique était en effet une réalité bien connue des contemporains, mais souvent vue à travers le prisme déformant du citadin, propriétaire se rendant de façon temporaire dans ses possessions suburbaines ou voyageur de passage glanant des tranches de vie pittoresque au gré de ses pas. Ce précoce processus d’idéali-sation de la vie paysanne nous conduit souvent à hésiter, selon le contexte, entre une in-terprétation réaliste, liée à l’activité pratiquée par le commanditaire, et une interprétation idyllique, voire symbolique, de ces scènes rustiques. Cette hésitation se révèle d’autant plus légitime lorsqu’on s’approche du monde enchanteur des bergers, soumit à une idéa-lisation encore plus forte.
au cours du iiie siècle ces thématiques agrestes et bucoliques se taillèrent une place de choix dans le panorama de l’art funéraire romain, de manière parallèle à l’abandon progressif du mythe comme source d’inspiration primordiale des artifices1. Progressive-ment ces thématiques envahirent l’ensemble des catégories du décor funéraire, jusqu’aux épitaphes elles-mêmes. La faveur dont a joui la figure du pasteur dans l’art funéraire de l’Antiquité Tardive est en effet une donnée bien connue. Mais si ce thème a été ample-ment étudié en ce qui concerne les fresques et les sarcophages, on ne peut en dire autant des « arts mineurs », parmi lesquels on compte les dalles gravées. Il manque en effet une étude d’ensemble de l’utilisation de cette figure comme appareil décoratif des épitaphes. Au contraire les références aux thèmes agricoles en milieu catacombal furent réunies et analysées, pour le cas de Rome, par le professeur F. Bisconti2.
Cette enquête se propose donc d’analyser conjointement les typologies iconogra-
1 Sur la question du déclin du mythe et de l’émergence de nouvelles thématiques dans l’iconographie funérai-re de l’antiquité Tardive, voir BrAndenBurg 2004 et ZAnker, ewAld 2008, spécialement pp. 247-266.
2 BisConti 2000, pp. 183-191.
82 aurélien caillaud
phiques agrestes et pastorales. En ce qui concerne la figure du berger on tentera de com-bler la lacune évoquée plus haut en exploitant le riche répertoire que nous offre l’Urbs. nous présentons ici les résultats d’une enquête qui a eu comme point de départ un dé-pouillement systématique des Inscriptiones Christianae Urbis Romae (ICUR).
Notre recherche a conduit à l’identification, pour le contexte romain, de 220 dalles gra-vées pouvant se référer à la thématique agro-bucolique (fig. 1). Parmi celles-ci, seulement 35 renvoient à des thèmes purement agricoles, tandis que près de 185 sont pleinement bu-coliques. Au sein de cette seconde catégorie nous pouvons distinguer 115 artefacts avec des représentations de bergers et 70 présentant des ovins ou des caprins isolés. Dès ces premiers résultats nous pouvons d’ores et déjà percevoir à quel point la thématique pasto-rale semble prévaloir sur celle strictement agricole. Nous chercherons donc, au fil de ces pages, à comprendre cette disparité, en analysant non seulement la forme que prennent les images gravées sur ces dalles, mais également les liens que celles-ci entretiennent – sur un même artefact – avec les autres thèmes figurés et avec l’inscription elle-même. En croisant ces données nous proposerons également quelques hypothèses interprétatives de ces thématiques agro-pastorales à la lumière des textes anciens.
trAnChes de vie rustique: entre iConogrAphie du réel et idéAlisAtion
de lA vie à lA CAmpAgne
Les représentations les plus simples qui évoquent l’activité agricole sont les différents outils que l’on retrouve sur les tombes des défunts, comme autant d’emblèmes des mé-tiers que ceux-ci exercèrent au cours de leur vie. Nous avons pu en comptabiliser près de 23 exemples pour Rome. Nous pouvons relier les différentes typologies d’outils gravés sur ces dalles funéraires, aussi bien à d’autres représentations de l’art gréco-romain, qu’à des objets en métal découverts lors de fouilles archéologiques3.
nous trouvons tout d’abord des bêches et des pioches utilisées pour le travail de la terre, comme celle qui apparait sur l’épitaphe de Vincentius conservée aux musées du vatican ou celle de Leonties au musée lapidaire de saint-paul-hors-les-murs4. Suivent ensuite les faucilles (falces faenariae), utilisées pour la moisson, comme par exemple sur la dalle de Cartorius Vestinus au cimetière de castulo ou sur le titulus de Primianus dans la catacombe de Domitille, où deux faucilles encadrent le texte funèbre de manière symé-trique5. Enfin les serpes, utilisées pour la taille et la greffe, ne sont pas non plus absentes comme dans le cas de l’épitaphe de Flavia Carita où une serpe est associée à un oiseau posé sur une grappe de raisin6. Les comparaisons avec les outils utilisés par les paysans ou les génies dans les scènes de moissons ou de vendanges, abondent évidemment dans la
3 Sur ce sujet voir white 1967 et, par exemple, toro 1985.4 ICUR III 8730; BisConti 2000, Id9.15., p. 176.5 ICUR VI 15899 et BisConti 2000, II b2.10; ICUR III 7759 et BisConti 2000, II b2.4.6 ICUR I 1613 et BisConti 2000, IIb21; ICUR IV 10806f (catacombe de Saint-Callixte); ICUR VIII 22424
et 22433, c (Cimetière Maius).
83Thèmes agro-bucoliques gravés sur les épiTaphes romaines
sculpture, la peinture et les mosaïques contemporaines. Il parait ainsi intéressant de faire une comparaison avec un bas-relief de l’autel de Lucius Cornelius Atimetus conservé dans la galerie lapidaire des Musées du Vatican, qui représente la boutique d’un marchand d’outils en métal, où l’on distingue nettement, exposés à la vente, les mêmes instruments que nous venons d’évoquer7.
En dehors de ces simples symboles, nous possédons également quelques scènes plus articulées (12 exemples), qui égrènent les différentes facettes du métier d’agriculteur. Une dalle gravée, conservée au Musée national romain, au sein des Thermes de Dio-clétien, représente par exemple un paysan en train de semer dans un champ8. Dans la catacombe de saint-calixte, Valerius Pardus9 est représenté avec une serpe dans une main et un légume qu’il vient de cueillir dans une autre, tandis que dans la catacombe de domitille, Vi(c)torinus est en train de scier un arbuste, vers lesquels accourent deux animaux qui semblent être un lièvre et une chèvre10. Sur une dalle provenant du cimetière d’aproniano sur la Via Latina, un ouvrier agricole livre un fagot de bois au procurator de la villa qui s’empresse de lui payer son dû11. Parmi les épitaphes les plus représentatives des fonctions tant agricoles que pastorales se trouve certainement celle de Leone, conser-vée au Musée archéologique d’Urbino, mais provenant de la catacombe de Saint-Calixte à Rome (fig. 2)12. Sur cette dernière le paysan porte un bâton muni de crochets (pour la taille ou la cueillette des fruits), tandis qu’à sa droite sont gravées une serpe, ainsi qu’une bêche dotée d’appuis pour y caler les pieds. À sa gauche un bélier au pied d’un arbre regarde dans sa direction. Le défunt devait donc vraisemblablement remplir les rôles tant d’agriculteur travaillant la terre, que de pasteur, veillant sur son troupeau, preuve s’il en est que ces deux fonctions étaient complémentaires, même si l’iconographie funéraire ne nous fournit que peu d’exemples combinant travail de la terre et élevage13.
Jusqu’à maintenant les exemples que nous avons évoqués semblaient tous nous par-ler du métier exercé par le défunt au cours de sa vie terrestre. Les choses s’annoncent plus ambigües quand on évoque le cas de l’épitaphe de Pontiana (fig. 3), étudiée par D. Calcagnini, qui semble bien nous emmener, selon les mots de F. Bisconti, « aux confins de l’iconographie professionnelle »14. Les extrémités et le centre de cette dalle funéraire sont occupés par des figures proportionnellement plus grandes que le reste des scènes :
7 Musei Vaticani, n. inv. 9277, Ier siècle ap. J.-C.8 ICUR I 2060 et BisConti 2000 II b1.1.9 ICUR III 7876 et BisConti 2000, II b1.4.10 ICUR IV 9450 et BisConti 2000, II b1.6.11 ICUR VI 15584 et BisConti 2000, II b1.7.12 ICUR III 8988 et BisConti 2000, II b1.5.13 La classe des sarcophages « à grandes pastorales » qui s’est développée entre la fin du IIIe et le début du
ive siècle constitue de fait une exception dans le panorama de l’art funéraire romain où scènes de quiétude pastorale et de labeur agricole sont généralement séparées : voir BAyet 1962. Sur les représentations agro-pastorales dans l’art funéraire romain, voir musso, sApelli 1985. L’association de l’élevage et des travaux des champs est plus fréquente sur les mosaïques de villae, comme par exemple, sun celle des Laberii à oudna, en Tunisie (début du iiie siècle, Inventaire des mosaïques, II, n° 362).
14 «Ai confini dell’iconografia professionale»: BisConti 2000, pp. 73-78. ICUR I 1723; CAlCAgini 1993 et CAlCAgini 2006, pp. 31-32.
84 aurélien caillaud
un pasteur criophore à gauche, Adam et Ève au centre et Daniel dans la fosse aux lions à droite. Entre ces personnages aux dimensions majorées se développent différentes scènes agrestes : une femme qui file assise devant une villa rustica, une poule et ses poussins (?), un paysan qui fait rentrer trois bœufs récalcitrants dans un enclos. Sous l’inscription augurale (Vibas Pontian(a) / in aeterno), on aperçoit une scène de labour et un monstre marin qui devrait être celui de Jonas, probablement utilisé ici comme symbole de l’en-semble du cycle.
La scène de la femme en train de filer renvoie tout d’abord à différentes dalles gravées arborant des fuseaux ou des métiers à tisser, emblèmes de l’activité de la défunte15. Mais, s’il s’agit bien de gallinacées qui s’agitent à ses pieds, on peut également comparer la scène à un couvercle de sarcophage, conservé aux Musées du Vatican (fig. 4), sur lequel une paysanne semble nourrir ses poules, tandis qu’un peu plus loin un bœuf et des ovins paissent tranquillement sous la garde placide d’un pasteur appuyé sur son baculum et accompagné de son chien16. En ce qui concerne la scène de labour, on pourra observer des scènes similaires incisées sur plusieurs stèles du musée de nicée en Turquie, tandis que, si l’on reste en milieu romain, un graffite pratiqué sur enduit dans la catacombe de saint-calixte fourni un point de comparaison intéressant17.
la composition de l’ensemble du décor de la dalle funéraire semble avoir subit l’in-fluence des sarcophages « à grandes pastorales », classe de sarcophages produite en mi-lieu romain entre la fin du IIIe et la première moitié du ive siècle18. On distingue en effet de la même manière des figures d’angles et une figure centrale, entres lesquelles s’intercalent des de scènes de la vie rustique. En confrontant par exemple cette dalle à un sarcophage « à grandes pastorales » aujourd’hui conservé aux Musées du Vatican19 (fig. 5) on trouve dans les angles les figures du pasteur criophore et de l’orante, tandis que s’alternent scènes bucoliques et agricoles : dans la partie droite du sarcophage on aperçoit par exemples des paysans qui piochent dans la vigne, tandis qu’un char tiré par des bœufs est guidé par d’autres.
Il s’agit de scènes réalistes, inspirées tant du vécu suburbain que de « cartons » qui devaient circuler entre les artifices de l’époque. Mais comme dans le cas des sarcophages « à grandes pastorales » les organisateurs du programme décoratif voulaient probable-ment, à travers le medium d’images réalistes, compréhensibles à tout un chacun, faire allusion à des réalités eschatologiques supérieures.
en effet, dans le cadre urbain au sein duquel s’est développé le christianisme la litté-rature antique, grecque comme romaine, ne cessait de louer la vie simple et paisible des paysans. Au cours de la période augustéenne Virgile dans ses Géorgiques célébrait le
15 BisConti 2000, IX a1.1.-IX c2.1, pp.215-217. Sur une mosaique du IVe siècle de musée Tabarka, conservée au Musèe du Bardo (CMA, A. 26), une femme file sa quemouille au milieu de moutons devant une villa.
16 Quelques poules et coqs figurent également sur les dalles funéraires romaines : par exemple ICUR III 7196 et 7254 (catacombe de Domitille); ICUR IV 9495; ICUR IX 26281, a (catacombe de Priscille).
17 ICUR IV 9524, 18.18 BAyet 1962.19 Bovini 1967, n. 2 (ex Lat. 150).
85Thèmes agro-bucoliques gravés sur les épiTaphes romaines
sain travail rustique, fondement de la romanité20. La vie sans artifices du paysan, gardien de l’antique morale (le mos maiorum) devenait ainsi un modèle de vertu et un exemple à suivre. Dans la littérature romaine le citadin, surtout celui qui habitait dans la Rome chaotique que nous décrit par exemple Juvénal21, semble comme assoiffé de la quiétude campagnarde, à tel point qu’il se plait à jouer au paysan. Ainsi Tibulle dans ses Elégies af-firme ne pas craindre de manier la pioche ou de s’emparer de l’aiguillon pour conduire les bœufs, nous rappelant ainsi certaines scènes pittoresques représentées sur les sarcophages « à grandes pastorales » (fig. 5)22. Dans ses textes, comme dans ceux de tant d’autres la vie à la campagne devint ainsi la vie heureuse par excellence.
C’est à cette paix agreste chantée par les poètes que désiraient également goûter les aristocrates lors de leurs séjours d’otium litteratum23. P.-A. Février définissait l’otium comme « une vie retirée d’étude, à la campagne, en un lieu qui assure le rafraichissement et la quiétude, parfois sur le rivage : un séjour au contact de la nature, libre des devoirs habituels et des ennuis de l’humanité »24. La campagne devenait ainsi un lieu de refuge des préoccupations citadines, le lieu par excellence où se concentrait le bonheur, idéalisé au point d’en venir à rassembler toutes les conditions requises pour pouvoir fixer de façon concrète l’imaginaire paradisiaque. Dans ce processus d’exaltation du monde agreste on retenait qu’un personnage plus que tous les autres conduisait une vie proche de la béati-tude : le berger.
les sCènes BuColiques : imAges de lA vie Bienheureuse dAns l’Au-delà
La figure du pasteur est omniprésente dans l’art, spécialement funéraire, de l’Antiqui-té Tardive25. Cet état de fait se vérifie également dans le cas du décor des dalles funéraires. En effet près de 84% des épitaphes prises en considération lors de notre enquête présen-tent des éléments reconductibles à des scènes bucoliques, et plus de la moitié comportent des représentations de bergers.
Ceux-ci peuvent adopter une grande variété d’attitudes, à commencer par celle du repos, comme par exemple dans le cas de l’épitaphe de Gerontius (fig. 6). Le pasteur y est assis sur un rocher à l’ombre d’un arbre, tenant le pedum d’une main, et approchant la flûte de Pan de ses lèvres sous le regard affectueux de sa brebis. Les bergers munis de
20 Sur la question de l’idéalisation de la figure du paysan dans l’œuvre virgilienne, voir par exemple SAdA 2000.
21 par exemple, ivven., III, 232-267.22 tiB., Eleg. I, 1, 29-31 : « nec tamen interdum pudeat tenuisse bidentem / aut stimulo tardos increpuisse
boves ».23 sur la question de l’otium dans la culture romaine, voir Bertelli 2008 et dosi 2006. Cf. aussi ZAnker,
ewAld 2008, pp. 170 -173 et 258-261.24 Février 1985, p. 78 : «una vita ritirata in campagna, in località che danno refrigerio e quiete, talvolta in riva
al mare, un soggiorno a contatto con la natura, liberi dai compiti usuali e dai fastidi dell’umanità».25 Sur la question de la figure du berger dans l’art antique, voir sChumACher 1977, provoost 1978, himmel-
mAnn 1980, engelmAnn 1990 et en dernier lieu CAillAud 2008.
86 aurélien caillaud
cet instrument sont effet loin d’être rare sur nos dalles, comme en écho aux compétitions poético-musicales auxquelles se livraient les bergers dans la littérature bucolique, de-puis les pasteurs d’Arcadie de Théocrite jusqu’aux Tityre et Mœlibée des Bucoliques de Virgile. Le pasteur au repos, en pleine contemplation de la nature, pouvait ainsi devenir un penseur, si ce n’est un philosophe, comme nous le rappelle au début de notre ère le stoïcien Musonius Rufus quand il affirme que la vie du pasteur offre d’idéales facilités aux plus hautes méditations du philosophe26. Cela pourrait expliquer l’attitude pensive de certains bergers, le menton appuyé contre la paume de la main, comme par exemple sur l’épitaphe de Gentianus27. L’image du berger mollement appuyé sur son baculum, le plus souvent les jambes croisées, en train de surveiller son troupeau ou de jouer un air de flûte, est également assez fréquente (fig. 7). Enfin, les scènes de traite sont plus rares, bien que nous puissions citer le cas de deux plaques de marbres, conservées dans l’église des saints-nérée-et-achillée, au seir de la catacombe de domitille, qui pourraient peut-être constituer les deux petits côtés d’un sarcophage (fig. 8). Mais le type iconographique le plus attesté reste indubitablement celui du pasteur criophore, c’est-à-dire portant un ovin sur les épaules, représenté dans près de 68% des cas, dans des proportions assez proches de celles observées pour les sarcophages et les peintures catacombales (77%)28.
Si nous observons les thèmes les plus fréquemment associés au personnage du berger, là aussi nous pouvons observer une situation similaire à celle rencontrée dans le cas des arts dits “majeurs” : le pasteur se trouve souvent représenté en compagnie de thématiques cosmiques, naturalistes et paradisiaques29. Ovins, oiseaux et arbres constituent son en-vironnement immédiat, son cadre naturel de représentation, évoquant ainsi, de manière drastiquement abrégée, le monde paradisiaque par le biais allégorique de l’idylle buco-lique30. Fréquemment apparait, au sein de ce locus amoenus rudimentaire, la figure de l’orant ou de l’orante, insérant ainsi cette image de l’âme du défunt dans la béatitude d’un monde paradisiaque connoté de manière bucolique. La meilleure illustration de ce phénomène se trouve dans une fresque peinte dans la lunette de fond d’un arcosolium du
26 muson. ruF., Xi = hense 1905, pp. 58, 9 - 59, 2 ; Festugière 1978, pp. 91-92 : « Quant au métier de berger, de même qu’il n’a pas déshonoré hésiode et ne l’a pas empêché d’être cher aux dieux et poète, de même il ne saurait empêcher nul autre. À mes yeux c’est même le plus agréable de tous les travaux rustiques parce qu’il donne plus de loisir à l’âme pour nous livrer à la réflexion et à la recherche sur ce qui touche à l’édu-cation. […] Pour cette raison je loue principalement le métier de berger. Mais généralement si quelqu’un mène à la fois la vie de philosophe et de paysan je ne saurais y comparer nulle autre vie et je ne préférerais nul autre moyen de ressources à celui-là».
27 ICUR I 1635. Sur la question de l’accointance entre bergers et philosophes dans l’art funéraire de l’An-tiquité Tardive, voir en dernier lieu : CAillAud 2011, pp. 216-220. Les images de bergers discutant à la manière de philosophes existent également dans la production sculpturale romaine. Le meilleur exemple est sans doute un sarcophage de la nécropole de l’Isola Sacra, entre Porto et Ostie : cf. Bovini 1967, n. 66.
28 CAillAud 2008, pp. 73 et 97 : 77% pour les fresques et 77,5 % pour les sarcophages. Pour des pistes d’explications concernant la préférence accordée à la figure du pasteur criophore, voir CAillAud 2011, pp. 215-216.
29 Bien plus rare résulte en revanche l’association du berger avec les scènes bibliques, de la même manière que ce qui se produit dans le reste de l’art funéraire de l’Antiquité Tardive.
30 pour la conception du paradis dans l’antiquité Tardive, voir BisConti 1990, AmAt 1985 et toynBee 1973, pp. 283-299.
87Thèmes agro-bucoliques gravés sur les épiTaphes romaines
cimetière Maius, où l’on aperçoit la défunte orante, placée entre deux arbres dans un pa-radis caractérisé par un berger qui traie une brebis à sa droite et un pasteur criophore à sa gauche31. La raison de la présence des bergers autour de la défunte ne fait ici aucun doute : ils servent à la situer dans un lieu paradisiaque dont ils sont la clef de lecture.
la métaphore bucolique, était en effet, avec celle de l’hortus conclusus, jardin clos planté de milles fleurs, une des formes du paradis les plus répandues dans l’imaginaire collectif de l’époque. Le berger, par le processus d’idéalisation qu’il avait subit dans la culture gréco-romaine au cours de plusieurs siècles était devenu l’image de l’homme heu-reux et le symbole de la vie heureuse elle-même, celle de l’Âge d’Or originel où hommes et animaux vivaient en paix dans une nature bienveillante32. L’homme de l’aube de l’hu-manité ne pouvait être qu’un berger, comme nous le confirme Tibulle : « Il n’y avait point de citadelles, point de palissade et le gardien du troupeau s’endormait tranquille au milieu de ses brebis à la toison tachetée », tandis que « spontanément les brebis venaient offrir le lait de leurs mamelles aux hommes qui n’avaient pas de soucis »33. « Sous le règne de saturne », l’harmonie cosmique entre les hommes, la nature et les animaux était à la base de leurs conditions de vie bienheureuse. Le parallélisme avec le jardin d’Eden biblique où adam vivait sereinement au milieu des animaux est inévitable34.
Mais les hommes aspiraient à revivre cette harmonie originelle perdue depuis si long-temps, que ce soit par l’intermédiaire de la propagande impériale annonçant le retour du saeculum Aureum à grand renfort de métaphores pastorales, ou par les visions prophé-tiques d’Isaïe ou de Virgile annonçant la venue d’un monde pacifié jusqu’au règne ani-mal35. La sémantique de la figure du berger nourrie par des siècles de littérature bucolique s’enrichit également du mythe des prés fleuris des jardins élyséens, des loca amoena de Virgile, pour dépeindre un paradis où tout abonde et où rien ne manque36. Les visions de la martyre Perpétue reprennent en effet ces deux images traditionnelles du paradis : celle du locus amoenus bucolique et celle de l’hortus conclusus fleuri37. Ces deux thèmes, que l’on retrouve fréquemment dans l’art funéraire romain, trouvent peut être leur meilleur illustration dans la lunette d’un arcosolium de la catacombe des saints-pierre-et-marcel-lin où un berger criophore et une orante évoluent ensemble au milieu d’un jardin fleuri, décoré de guirlandes de pétales de roses38.
si nous nous penchons désormais sur les inscriptions que nos scènes bucoliques ac-
31 nestori 1993, n. 4, p. 32; wilpert 1903, n. 117, 1.32 Sur le mythe de l’Âge d’or et son importance dans la formation d’un imaginaire bucolique du Paradis, voir
minois 2009 et toynBee 1973, pp. 283-299.33 tiB., Eleg. I, 3, 45-46 : « ipsae mella dabant quercus, ultroque ferebant /obvia securis ubera lactis oves » ;
tiB., Eleg. I, 10, 9-10 : « non arces, non vallus erat, somnosque petebat / securus varias dux gregis inter oves ».
34 sur le lien entre les scènes de quiétude pastorale, orphée charmant les animaux et adam au milieu des animaux, voir BisConti 1988.
35 Is 11, 5- 9; virg., Ecl. IV, 18-25. 36 virg., Aen. VI, 638-642.37 AmAt 1996, 4, 7-10, pp. 117-119 : « et vidi spatium immensum horti et in medio sendentem hominem ca-
num, in habitu pastoris, grandem oves mulgentem ».38 nestori 1993, n. 57, p. 58; wilpert 1903, n. 102, 1.
88 aurélien caillaud
compagnent nous pouvons faire quelques observations. Un cas intéressant d’onomastique est celui de l’épitaphe conservé dans la catacombe de saint-sébastien, sur laquelle on peut lire le texte Pastori / baenemaerenti /fecit mater accompagné de l’image d’un berger appuyé sur son baculum39. Il s’agit du seul exemple que nous ayons pu identifier où le nom du défunt (Pastor) est illustré par la représentation d’un berger.
En ce qui concerne le formulaire épigraphique en lui-même Schumacher dans sa mo-nographie Hirt und Guter Hirt émettait, bien qu’à partir d’un échantillon de dalles gravées assez réduit, l’hypothèse d’une association courante entre les représentations de bergers et la formule in pace40. Toutefois, si l’on observe l’ensemble de la production romaine, en en excluant les simples fragments, lacunaires d’un point de vue épigraphique, nous trouvons sur les 67 épitaphes restantes, seulement 23 cas où cette formule est présente, c’est-à-dire dans 34% des cas. Cette hypothèse de Schumacher, même si intéressante d’un point de vue sémantique, nécessite donc toutefois d’être relativisée pour le contexte romain. En revanche, d’autres formules sont également présentes à la suite des données biométriques, comme in deo41, in aeterno42, spirito tuo bono43, deus refrigeret spiritum tuum44.
ovins et CAprins isolés : ABréviAtions extrêmes d’idylles BuColiques et ContextuA-lisAtion des déFunts en milieu pArAdisiAque
nous avons choisi d’insérer parmi les scènes à caractère bucolique les dalles ac-cueillant la représentation d’ovins et de caprins isolés, supposant qu’elles aussi voulaient nous parler d’une certaine dimension eschatologique. Sur les 70 cas relevés, si nous excluons les 27 fragments qui ne nous permettent pas de reconstruire l’ensemble de la décoration, nous pouvons, parmi les 43 exemples restants, identifier différents modes d’utilisation de la figure ovine. Le quadrupède peut avant tout être utilisé comme une allusion générique au cosmos, comme cela arrive fréquemment dans la peinture parié-tale, aussi bien celle classique (décoration de maisons ou d’édifices publiques) que ca-tacombale. De plus, sur certains sarcophages à thématique cosmique du IIIe siècle, le bélier constitue l’animal-symbole de Tellus, en opposition au dragon marin d’Okeanos, allant jusqu’à remplacer parfois complètement la déesse de la Terre pour faire face au Ketos marin, comme par exemple sur un sarcophage conservé dans la glyptothèque de Ny Carlsberg à Copenhague45. À l’aide de ce même processus la figure isolée de l’ovin, dont les faibles proportions s’adaptent parfaitement à l’espace exigu généralement disponible sur les dalles funéraires, ainsi qu’à leur langage symbolique, pouvait résumer à elle seule
39 ICUR V 13195.40 sChumACher 1977, pp. 176-180.41 ICUR III 6727 et IV 9700.42 ICUR I 1723.43 ICUR VII 17777.44 ICUR X 27108.45 sChumACher 1977, tav. 11, f.
89Thèmes agro-bucoliques gravés sur les épiTaphes romaines
l’ensemble des significations d’une idylle bucolique conceptuellement et graphiquement plus articulée.
En outre, un groupe de dalles funéraires présente la particularité de rassembler des éléments identiques : une ancre, un oiseau et un ovin (fig. 9), comme s’il s’agissait de proposer de manière synthétique les principales composantes cosmiques (terre, eau, air) qui apparaissent sur la classe des sarcophages dits « du paradis », qui se développe de manière parallèle au cours du iiie siècle46. Le meilleur exemple est certainement le sar-cophage de La Gayole, en Provence, où l’on retrouve clairement ces trois éléments de l’ancre, des ovins et des volatiles47.
Au-delà d’une référence à la symbolique cosmique l’ovin, en tant qu’abréviation ex-trême d’une scène pastorale, pouvait également servir à placer le défunt dans un milieu paradisiaque, connoté de façon bucolique, exactement comme dans les cas où l’image du berger est associée à celle de l’orante. On pourrait effectivement interpréter de cette ma-nière les ovins placés à proximité du défunt, comme dans la scène de jugement d’Aurelios Theodoulos48, ou même dans certains cas disposés autour des jambes de l’orant dans une composition similaire à celle utilisée pour les pasteurs criophores (fig. 10)49. Ce genre de disposition se retrouve également en milieu catacombal sur la voûte de différents cubi-cula, comme par exemple au cimetière Maius où quatre orants entourés chacun de deux brebis forment une couronne de bienheureux autour du Christ enseignant représenté dans le médaillon central50.
ConClusions
En conclusion nous pouvons dire que scènes strictement agricoles et scènes buco-liques ne se rencontrent que rarement sur les dalles funéraires de l’antiquité Tardive issues du contexte romain. À Rome l’imagerie agreste revêt surtout l’aspect d’un témoi-gnage réaliste du métier exercé par le défunt durant son séjour terrestre, généralement sous la forme d’une reproduction fidèle de ses outils agricoles. Toutefois il semblerait que pour certaines de ces gravures, comme par exemple la dalle de Pontiana, nous nous trou-vions « aux confins de l’iconographie professionnelle » et devant la transposition figurée d’une condition spirituelle de vie bienheureuse, semblable à celle chantée par les poètes dans leurs églogues ou leurs élégies. Certaines scènes nécessitent donc une clef de lecture qui doit certainement dépasser la stricte reproduction d’une réalité champêtre.
46 Pour ce groupe de dalles, voir par exemple, ICUR IV 9399 et ICUR V 14845. Sur la classe des « sarco-phages paradisiaques », voir BisConti 2004.
47 Cf. BisConti 2004, fig. 29.48 ICUR IV 12185.49 par exemple, de rossi 1867, tav. L, 14 et ICUR IX 23.931. L’Agneau mystique sur le Mont Paradisiaque
apparait quant à lui à deux reprises sur les dalles funéraires : une fois de manière isolée, la tête surmontée d’un staurogramme, sur un fragment provenant de Saint-Hyppolite (ICUR VII 20329, e) et une autre fois au milieu de la Traditio Legis de la dalle d’Anagni (ICUR IX 24303).
50 nestori 1993, p. 35; wilpert 1903, n. 168.
90 aurélien caillaud
nous devons adopter une attitude similaire face aux scènes bucoliques qui ornent la grande majorité de nos épitaphes. Nous trouvons peu de scènes complexes et au contraire une grande proportions de figures plus ou moins isolées (bergers ou ovins), qui constituent très probablement des contractions de scènes bucoliques plus développées, qu’on adapte à la destination et à la forme d’un support parfois exigu. Parmi celles-ci on constate une domination du pasteur criophore, presque dans les mêmes proportions que celles obser-vées dans la peinture catacombale et sur les sarcophages (environ 70 %).
La vogue de la figure du berger dans l’art funéraire de l’Antiquité Tardive peut proba-blement s’expliquer en partie par le fait que, sous l’influence de la poésie bucolique, spé-cialement celle de Théocrite, Virgile et Calpurnius Siculus, celle-ci avait revêtu pour les romains le rôle de symbole de la Felicitas, de la Quies, de la Tranquillitas51. Ainsi la vie idéalisée des paysans, et plus spécialement des bergers, en était venu à représenter, pour une société urbaine avide de la paix des campagnes, l’image de la vie bienheureuse et sereine, que certains aristocrates goûtaient déjà lors de leurs séjours d’otium litteratum au sein de leurs villae rusticae, fragments d’un Âge d’Or disparu et parcelles d’un bonheur à venir dont ils espéraient jouir dans l’autre monde. Ce n’est pas un hasard si Nemesianus dans ses Églogues comparait la vie pastorale à la vie bienheureuse dans l’au-delà52.
Aurélien CAillAud
51 Sur l’importance de ces notions dans la symbolique de la figure du berger, voir sChumACher 1977.52 Cf. duFF 1982, pp. 456-464.
91Thèmes agro-bucoliques gravés sur les épiTaphes romaines
BIBLIOGRAFIA
AmAt 1985 = J. AmAt, Songes et visions. L’au-delà dans la littérature latine tardive, Paris 1985.
AmAt 1996 = J. AmAt (trad.), La passion de Perpétue et Félicité suivie des Actes, Paris 1996.
BAyet 1962 = J. BAyet, Idéologie et plastique, III, Les sarcophages chrétiens à «grande pastorale», in Mélanges d’archéologie et d’histoire 74, 1962, pp. 171-213.
Bertelli 2008 = C. Bertelli, l. mAltAni, g. monteveCChi, ‘Otium’. L’arte di vivere nelle ‘domus’ romane di età imperiale, Milano 2008.
BisConti 1988 = F. BisConti, Un fenomeno di continuità iconografica: Orfeo citaredo, Davide sal-mista, Cristo pastore, Adamo e gli animali, in Augustinianum 28, 1988, pp. 429-436.
BisConti 1990 = F. BisConti, Sulla concezione figurativa dell’ ‘habitat’ paradisiaco: a proposito di un affresco romano poco noto, in Rivista di Archeologia Cristiana 66, 1990, pp. 25-80.
BisConti 2000 = F. BisConti, Mestieri nelle catacombe romane. Appunti sul declino dell’iconogra-fia del reale nei cimiteri cristiani di Roma, Città del Vaticano 2000.
BisConti 2004 = F. BisConti, I sarcofagi del paradiso, in F. BisConti, h. BrAndenBurg (edd.), Sar-cofagi tardoantichi, paleocristiani e altomedievali, Città del Vaticano 2004, pp. 53-74.
Bovini 1967 = F. w. deiChmAnn, h. BrAndenBurg, g. Bovini, Repertorium der christlich-antiken Sarkophage, I, Rom und Ostia, Wiesbaden 1967.
BrAndenBurg 2004 = h. BrAndenBurg, Osservazioni sulla fine della produzione e dell’uso dei sar-cofagi a rilievo nella tarda antichità nonche sulla loro decorazione, in F. BisConti, h. BrAndenBurg (edd.), Sarcofagi tardoantichi, paleocristiani e altomedievali, Città del Vaticano 2004, pp. 1-34.
CAillAud 2008 = A. CAillAud, La figure du “Bon Pasteur” dans l’art funéraire de Rome et la pen-sée chrétienne des IIIe-IV e siècles, mémoire de Master 2, sous la direction de F. Hurlet, Université de Nantes, 2008.
CAillAud 2011 = A. CAillAud, Criofori e pastore-filosofo nell’ipogeo degli Aureli, in F. BisConti (ed.), L’ipogeo degli Aureli in Viale Manzoni. Restauri, tutela, valorizzazione e aggiornamenti in-terpretativi, Città del Vaticano 2011, pp. 213-222.
CAlCAgnini 1993 = D. CAlCAgnini, Nuove osservazioni sulla lastra di ‘pontiana’ del Museo Pio Cristiano, in Rivista di Archeologia Cristiana 69, 1993, pp. 161-177.
CAlCAgnini 2006 = D. CAlCAgnini, ‘minima biblica’. Immagini scritturistiche nell’epigrafia fune-raria di Roma, Città del Vaticano 2006.
de rossi 1867 = g. B. de rossi, La Roma sotterranea cristiana, II, Roma 1867.
dosi 2006 = A. dosi, ‘Otium’. Il tempo libero dei Romani, Roma 2006.
duFF 1982 = J. w. duFF (trad.), Minor Latin Poets, Harvard 1982.
engelmAnn 1990 = J. engelmAnn, s. v. Hirt, in Reallexikon für Antike und Christentum 116, 1990, cc. 577-607.
Festugière 1978 = A. J. Festugière (trad.), Deux prédicateurs de l’Antiquité. Télès et Musonius, Paris 1978, pp. 48-127.
92 aurélien caillaud
Février 1985 = p.-A. Février, La morte Cristiana: immagini e vissuto quotidiano, in J. delumeAu (ed.), Storia vissuta del popolo cristiano, Torino 1985, pp. 61-92.
hense 1905 = o. hense, ‘C. Musonii Rufi reliquiae’, Leipzig 1905.
himmelmAnn 1980 = N. himmelmAnn, Über der Hirten-Genre in der antiken Kunst, Opladen 1980.
minois 2009 = g. minois, L’Âge d’or. Histoire de la poursuite du bonheur, Paris 2009.
musso, sApelli 1985 = l. musso, m. sApelli, Rappresentazioni di carattere agricolo e pastorale nella produzione funeraria urbana, in AA. vv., Misurare la terra: centurazione e coloni nel mondo romano. Città, agricoltura, commercio: materiali da Roma e dal suburbio, Modena 1985, pp. 155-158.
nestori 1993 = A. nestori, Repertorio topografico delle pitture delle catacombe romane, città del Vaticano 1993.
provoost 1978 = A. provoost, Il significato delle scene pastorali del terzo secolo d.C., in Atti del IX Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana (Roma, 21-27 settembre 1975), città del Vaticano 1978, pp. 407-431.
sAdA 2000 = e. sAdA, Paesaggi ideali. La natura nelle Bucoliche e nelle Georgiche di Virgilio, Milano 2000.
sChumACher 1977 = w. n. sChumACher, Hirt und Guter Hirt. Studien zum Hirtenbildes in der römischen Kunst vom zweiten bis zum Anfang des vierten Jahrunderts unter besonderer Berück-sichtigung der Mosaiken in der Südhalle von Aquileja, Freiburg 1977.
toro 1985 = A. toro, Gli strumenti agricoli, in AA. vv., Misurare la terra: centurazione e coloni nel mondo romano. Città, agricoltura, commercio: materiali da Roma e dal suburbio, modena 1985, pp. 138-142.
toynBee 1973 = J. m. C. toynBee, Animals in roman life and art, London 1973.
ZAnker, ewAld 2008 = p. ZAnker, B. C. ewAld, Vivere con i miti. L’iconografia dei sarcofagi ro-mani, Torino 2008.
white 1967 = k. d. white, Agricultural Implements of the Roman World, Cambridge 1967.
wilpert 1903 = J. wilpert, Le pitture delle catacombe romane, Roma 1903.
93Thèmes agro-bucoliques gravés sur les épiTaphes romaines
Fig. 1 - Tableau récapitulatif des scènes agro-pastoralesprésentes sur les épitaphes romaines.
Fig. 2 - Épitaphe de Leone. Musée archéologique d’Urbino (d’après BisConti 2000).
94 aurélien caillaud
Fig. 3 - Épitaphe de Pontiana. Musée Pio Cristiano (photo archivio PCAS).
Fig. 4 - Couvercle de sarcophage avec scènes rustiques. Musées du Vatican (photo de l’auteur).
Fig. 5 - Sarcophage « à grandes pastorales ». Musée Pio Cristiano (d’après Bovini 1967).
95Thèmes agro-bucoliques gravés sur les épiTaphes romaines
Fig. 6 - Épitaphe de Gerontius. Catacombe de Domitille (photo archivio PCAS).
Fig. 7 - Fragment de dalle avec berger. Catacombe de Saint-Calixte (photo archivio PCAS).
96 aurélien caillaud
Fig. 8 - Dalles avec scènes bucoliques. Catacombe de Domitille (photo de l’auteur).
Fig. 9 - Dalle fragmentaire avec éléments cosmiques. Catacombe de Prétextat (photo archivio PCAS).
97Thèmes agro-bucoliques gravés sur les épiTaphes romaines
Fig. 10 - Dalle fragmentaire avec orant et ovin. Catacombe de Saint-Calixte (photo archivio PCAS).