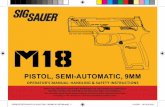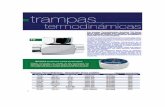Support de cours - TD Méthodologie SIG
-
Upload
u-bordeaux3 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Support de cours - TD Méthodologie SIG
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
1
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION »
Production d’un protocole méthodologique et cartographique – SIG Cas du Parc Naturel des Landes de Gascogne – PNRLG
L’occupation des sols de la partie Sud du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
(Traitement cartographique automatique d’après les données CORINE Land Cover niveau 3 sur le département des Landes, 2006)
Le module méthodologique « INITIATION » vise à préparer les étudiants, débutants en cartographie,
géomatique et SIG, aux principales manières d’observer, d’analyser et de manipuler l’information géographique afin de produire une réflexion qui soit compatible avec les demandes formulées par un commanditaire, ici le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG). En adoptant une vision critique et en étant force de proposition, cet exercice d’application vous propose de réaliser un protocole méthodologique et cartographique liant des bases d’informations géographiques avec les thématiques proposées par la commande. Les données et les méthodes sont variées puisqu’il peut s’agir d’images aériennes, d’images satellites, de bases d’occupation du sol, de relevés de photo-interprétation, zonages, etc.).
Il s’agit pour vous de proposer une démarche logique reposant sur la mise en avant d’un problème par
rapport aux thématiques proposées, aux données mise à disposition, celles que vous pourrez trouver et celles que vous pouvez fabriquer dans le cadre de ce travail. Les résultats devront introduire un certain nombre d’éléments, notamment une réflexion approfondie sur la manière de critiquer et d’améliorer les bases existantes, ainsi que les connaissances sur les thématiques retenues en faisant plusieurs propositions de représentations cartographiques, et la production d’un rapport final qui mettra en avant le protocole méthodologique et cartographique qui doit être adapté aux consignes du commanditaire, ainsi qu’au cadre géographique et thématique choisi au départ.
Le présent document propose une restitution complète des grandes étapes de traitement abordées dans ce
module. Il ne comporte cependant aucune considération sur le fond thématique ou méthodologique du dossier qui sera à remettre à la fin du semestre. Il appartient donc aux lecteurs de faire des choix sémiologiques et méthodologiques réfléchis et pertinents pour réaliser ce travail et construire un protocole de démonstration rigoureux.
Bon courage
Guilhem Mousselin
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
3
SOMMAIRE SUJETS DE TRAVAIL 4 MODALITES D’EVALUATION 5 DONNEES A DISPOSITION 6 CADRE METHODOLOGIQUE DE LA DEMARCHE 7 PRESENTATION GENERALE DU LOGICIEL MAPINFO 9 DEMARRAGE ET PREMIERE EXPLORATION DU LOGICIEL 10 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 11 OUVERTURE DU PREMIER FICHIER ET OPTIONS D’AFFICHAGE 15
MANIPULATIONS DU LOGICIEL 19 CALER UNE IMAGE 20 CREATION D’UNE TABLE MAPINFO 28 PHOTO-INTERPRETATION ET NUMERISATION 33 CLES D’INTERPRETATION 33 MODELES DE DONNEES GEOGRAPHIQUES 35 STRUCTURATION DES DONNEES GEOGRAPHIQUES 35 GESTION VISUELLE DES TABLES SOUS MAPINFO 37 NUMERISATION DES POLYGONES 38 CREER DES OBJETS GRAPHIQUES 41 MODIFIER DES OBJETS GRAPHIQUES 41 NUMERISER ET RENSEIGNER SIMULTANEMENT 59 METTRE A JOUR AUTOMATIQUEMENT DES COLONNES 60
IMPORTER ET OUVRIR D’AUTRES SUPPORTS 65 OUVRIR UN FICHIER RECONNU 65 IMPORTER / EXPORTER UN FICHIER 65 TRADUCTEUR UNIVERSEL 65
OPERATIONS DE SELECTION 70 REQUETE SIMPLE 70 REQUETE MULTIPLE : SELECTION SQL 74
REALISER UNE ANALYSE THEMATIQUE 77 CREER UNE CARTE THEMATIQUE EN TROIS ETAPES 77
ANALYSE THEMATIQUE DE LA CARTE D’OCCUPATION DES SOLS 81 MISE EN PAGE D’UNE ANALYSE THEMATIQUE 83 CREER UNE MISE EN PAGE 84 CREER UNE LEGENDE EN TROIS ETAPES 86 MANIPULATION DES OBJETS DE LA MISE EN PAGE 88
ENREGISTRER LA CARTE 89 CAPTURE D’ECRAN 89 EXPORTER LA FENETRE 89
ORGANIGRAMME DE TRAITEMENT 91
CONCLUSION 92 INDEX GENERAL 93
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
4
SUJETS DE TRAVAIL
Extraits du partenariat technique et scientifique entre le Parc Naturel des Landes de Gascogne et les étudiants (et encadrants) du Master 1 du Département de Géographie de l’Université Bordeaux Montaigne
(version du 1er octobre 2014)
SUJET 1 : Évolution de l’urbanisation Le territoire du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne subit d’importantes mutations et
notamment du fait de l’urbanisation croissante. La pression urbaine se fait sentir sur plusieurs secteurs du territoire. Elle est d’autant plus importante que les infrastructures de transport et les agglomérations voisines se développent.
Conscient de cette dynamique, le Parc cherche à déterminer les secteurs les plus touchés et à quantifier la superficie construite. Une méthodologie précise retenant les données les plus fiables devra être proposée.
SUJET 2 : Identification des prairies Les prairies jouent un rôle majeur tant au niveau des fonctionnalités écologiques qu’au niveau paysager.
Qu’elles soient relictuelles, pâturées ou cultivées, elles entrent dans les milieux que le Parc souhaite préserver.
Le Parc souhaiterait avoir une représentation spatiale fine de ces milieux, tout en différenciant celles qui sont anciennes à proximité des bourgs de celles qui sont cultivées ou isolées dans la matrice forestière.
SUJET 3 : LES AIRIAUX L’airial, clairière habitée au cœur de la forêt était aussi conçu comme un espace de protection contre les
risques de feu sur le modèle des villages ou hameaux du Sud-Est entourés (et protégés) de leurs jardins. Cet espace, où s’agencent harmonieusement le bâti traditionnel et le végétal, constitue une image emblématique du mode d’habitat traditionnel et, de ce fait, un patrimoine exceptionnel qu’il faut préserver.
Le Parc vient de lancer un inventaire des airiaux. Il semble indispensable de constituer une couche d’information les représentants. Comment représenter l’airial ? Quelles limites doivent être retenues ? Quelles sont ceux qu’il faut préserver en priorité ?
SUJET 4 : IDENTIFICATION ET REPRÉSENTATION DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES La connaissance acquise au cours des dix dernières années a permis de mettre en exergue l’enjeu et
l’importance de zones nodales et de corridors répartis sur l’ensemble du territoire. La mise en place des Trames Vertes et Bleues (TVB) à l’échelle de l’Aquitaine et du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) permet d’initier le travail qui doit être décliné et précisé à l’échelle locale. Une fois identifiées, les trames devront faire l’objet de mesures de préservation à de multiples niveaux (documents d’urbanisme et de planification, plans de gestion, sensibilisation, etc.).
Une méthodologie adaptée à l’échelle du territoire devra être proposée. Elle devra permettre d’identifier et de représenter clairement et simplement les continuités écologiques.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
5
MODALITES D’EVALUATION
Les modalités d’évaluation de ce module sont organisées autour de deux étapes : DOSSIER DE GROUPES
Rendu des dossiers de groupes entre 20 et 30 pages avec une problématique clairement formulée.
La présentation est libre mais doit comprendre un certain nombre d’éléments à savoir : Le choix des données traitées, rajoutées et/ou créées ; Le protocole méthodologique complet et détaillé (organigramme de traitement et explications de la
procédure) ; Les résultats obtenus ; Les commentaires et des perspectives possibles à propos de ce travail, en pointant en particulier les
atouts tout comme les limites de la démarche. ORAL INDIVIDUEL
Présentation orale sous forme de diaporama avec cinq diapos maximum, soit 10 minutes d’oral et 5 à 10
minutes de questions. La présentation du travail ; La contribution de l’étudiant (individuel) aux choix collectifs (dynamique du groupe) ; Les apports de l’atelier au projet de formation de l’étudiant ; La capacité d’intégrer les apprentissages théoriques et pratiques au grand oral ou à un projet de stage.
Moyenne de l’UE = Note collective + Note individuelle / 2
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
6
DONNÉES MISE A DISPOSITION Synthèse du catalogue de données disponibles d’après le partenariat technique et scientifique (version du
1er octobre 2014)
Sujet n°1 Sujet n°2 Sujet n°3 Sujet n°4
Données disponibles
Corine Land Cover 1990, 2000, 2006 X X X X
Ortho-photos 2009 X X X X
IGN BD Parcellaire X X
IGN BD Topo 2009, 2012, 2014 X X X
Couche Prairies X
Couche Airiaux X
Carte de Belleyme X
Zonages et inventaires X
Données disponibles sous réserve
BD MAJIC 2011 X
Couche OS GIP Littoral 2012 X X
Couche OS CG40 X
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
7
CADRE METHODOLOGIQUE DE LA DEMARCHE Le cadre méthodologique du module « Initiation » est propre à chaque groupe de travail, même s’ils
partagent tous le même objectif de départ qui est de répondre de manière satisfaisante aux demandes formulées par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Afin de diversifier les possibilités de réponses, chaque groupe démarre au départ avec un socle commun (données, nomenclatures, etc.) et est invité à travailler sur les thématiques de son choix.
Afin de choisir une thématique porteuse qui soit en accord avec les demandes du PNRLG, il convient de se poser une série de questions en amont du projet. Il est dès lors possible de se référer à une règle méthodologique générale et transversale, reposant sur quatre principes fondamentaux et/ou quatre questions à se poser pour répondre de manière réfléchie au sujet proposé :
Choix méthodologiques : « Comment vais-je m’y prendre ? » ; Choix sémiologiques : « Comment vais-je montrer les choses ? » ; Choix sémantiques : « Qu’est-ce que je veux montrer ? » ; Choix scalaires : « Quelle peut être l’échelle la plus pertinente ? ». Ces principes et ces questionnements constituent des lignes directrices qui peuvent guider le travail au fur
et à mesure de son élaboration. Ils doivent être invoqués aussi souvent que cela paraît nécessaire. L’ordre de ces éléments varient bien évidemment et les choix qui sont faits ne sont jamais immuables et sont amenés à évoluer dans le temps imparti du module, c’est-à-dire avant le rendu du dossier et la présentation des propositions.
CHEMINEMENT DU TRAVAIL
Six séances de TD dont, une réservée à une sortie de terrain
Travail préalable :
o Critères d’interprétation et clés de lecture ressortant des premières heures du module « Initiation » (cours et TD) ;
o Réfexions sur le choix de la ou des thématiques pouvant être traitées ; o Sortie de terrain pour confronter les premières pistes de l’observation ;
Validation des critères et construction du protocole sur un terrain test Construction de la démarche méthodologique et de la cartographie ; Préparation pour l’épreuve d’examen.
Le calendrier du travail est modulable en fonction de l’avancée de chaque groupe.
Il est possible d’approcher cet exercice par la combinaison de trois dimensions : La question dynamique ; La question scalaire ; La question thématique. Chacune de ces dimensions fait référence à un découpage méthodologique qui doit être réfléchi.
L’ensemble devant être cohérent. Chaque dimension porte en elle des choix méthodologiques qu’il convient de faire au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
La question dynamique (l’évolution diachronique et/ou rétrospective) interroge :
o La nomenclature ; o La résolution spatiale ;
La question scalaire (le jeu des échelles) interroge :
o La nomenclature ; o La résolution spatiale ;
La question thématique (mono ou plurithématique) interroge :
o La nomenclature ; o La résolution spatiale.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
8
Il est également possible de se poses plusieurs types de questions :
Questions
Thématique(s)
- Que décider de représenter à l’échelle de la CCM ? - Quels sont les objets qui apparaissent en commun dans les bases et comment
sont-ils définis ? - A quel niveau doit-on replacer telle ou telle définition plutôt qu’une autre ? - Comment définir les entités observées que l’on souhaite reproduire alors qu’elles
n’apparaissent pas dans les bases ? - …
Echelle(s)
- A quelle échelle doit-on se placer ? - Echelle fixe ? - Démarche pluriscalaire ?
- Quelle pourrait être la surface du plus petit objet ? - Cette mesure doit-elle être :
- Uniforme à tous les niveaux ? - Fixe et qui doit obéir aux principes de nivellement de l’observation ? - Mouvante au gré des objets observés ?
- …
Dynamique(s)
- Comment faire figurer les formes d’évolution ? - Comment faire figurer les interfaces et les zones de contacts ? - …
En définitive, ces questions, séparées par soucis de commodité et de compréhension interrogent les mêmes
choses mais de manière un peu différente. La combinaison de ces trois questions doit aboutir à la production d’un ou de plusieurs résultats concrets. Il ne faut pas oublier de présenter la démarche qui a été suivie du début à la fin, c’est-à-dire durant les différentes étapes du travail.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
9
PRESENTATION GENERALE DU LOGICIEL MAPINFO PROFESSIONAL Le logiciel MapInfo Professional permet d’exploiter les possibilités d’un Système d’Information
Géographique (SIG).
DEFINITIONS D’UN SIG
Trois définitions pour se faire une idée sur les SIG
Un SIG est « l’ensemble des structures, des méthodes, des outils et des données constitué pour rendre compte des phénomènes localisés dans un espace spécifique et faciliter les décisions à prendre sur cet espace » (JOLIVEAU, cité dans POIDEVIN, 1999, p. 351) ;
Les SIG sont « des systèmes incluant à côté des outils matériels et logiciels, d’autres constituants tout aussi fondamentaux : les structures, les méthodes et les données. Ces constituants interagissent et sont à la base de la puissance des SIG pour l’analyse, l’explication, la prévision et la planification » (POIDEVIN, 1999, p. 35) ;
Un SIG est « un système informatisé permettant d’acquérir et d’organiser, de gérer et d’interroger, d’analyser et de restituer des informations localisées. C’est un outil d’aide à la décision » (AMELOT, 20092).
Un SIG permet de développer une démarche autour des « cinq A » :
o ACQUERIR ; o ARCHIVER ; o ACCEDER ; o ANALYSER ; o AFFICHER.
Autrement dit, le logiciel de SIG permet l’acquisition et le stockage, la manipulation et le traitement de
données géographiques. Il permet enfin de faire de l’analyse spatiale, de la cartographie ainsi que toute une foule possibilités.
Les pages qui suivent ne dévoilent que quelques procédures techniques qui sont autant de possibilités qui peuvent être utiles dans le cadre de la réalisation de ce travail et pouvant être mises à profit plus tard. Chacune des démonstrations reprend des éléments abordés durant les premières séances de TD, et ce, avec les données visualisées durant les différents modules. Certains points sont abordés en surface, et d’autres le sont plus en profondeur.
LES MANIPULATIONS QUI SUIVENT ONT TOUTES ETE EFFECTUEES AVEC LA VERSION 7.83 DU LOGICIEL MAPINFO PROFESSIONNAL ET SOUS WINDOWS 7. CERTAINES OPTIONS PRESENTEES CI-APRES, NE SONT PAS DISPONIBLES SUR LES VERSIONS ANTERIEURES DU LOGICIEL. NÉANMOINS, IL SEMBLERAIT N’Y AVOIR PAS DE GRANDES DIFFÉRENCES AVEC LES VERSIONS LES PLUS RÉCENTES NOTAMMENT LA 8.5.
1 POIDEVIN Olivier, La carte, moyen d’action : Guide pratique pour la conception & la réalisation de cartes, Ellipses, 199p. 2 D’après les cours de Méthodologie dispensé au cours de la troisième année de Licence par Xavier AMELOT au premier semestre 2009. 3 La version MapInfo Professional 7.8 date de 2004. La version actuelle du logiciel est MapInfo Professional v. 12.0.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
10
DEMARRAGE ET PREMIERE EXPLORATION DU LOGICIEL
Démarrer le logiciel MapInfo Professional grâce au menu Démarrer ou par le biais d’un raccourci à l’écran si celui-ci existe.
« Démarrer – Tous les programmes – MapInfo – MapInfo Professional 7.8 ou 8.54
Raccourci à l’écran
Le logiciel MapInfo Professional permet d’ouvrir une couche d’information monothématique brute
nommée « Table » (nom du fichier *.TAB) ou un espace de travail nommé « Workspace » ou plus communément appelé « Document » (nom du fichier *.WOR).
Table Document
- La table est un plan vectoriel constitué de points, de lignes ou de polygones, auxquels sont associés des attributs stockés dans un tableau ;
- La table peut ne contenir que le tableau de données, sans objet vectoriel associé ;
- La table peut être constituée d’une image, c’est-à-dire d’une couche d’information raster.
- Le document permet d’ouvrir un espace de travail préalablement sauvegardé ;
- L’espace de travail peut contenir plusieurs couches d’information, soit plusieurs tables), ainsi que des annotations, des analyses thématiques, des couleurs, des symboles personnalisés, des fenêtres de mise en page, etc.
La première étape du travail est de se familiariser avec le logiciel MapInfo en parcourant les différentes
options disponibles grâce à l’exploration de l’environnement de travail en ouvrant successivement les deux jeux de données fournies lors du premier TD.
4 Les versions du logiciel peuvent varier suivant les salles de cours.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
11
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
MapInfo possède une interface assez basique. Il est composé d’une barre des menus qui permet d’accéder à la plupart des fonctionnalités du logiciel, et de barres d’outils spécifiques, activant des options spéciales en fonction des besoins (voir tableaux pages suivantes). Des options supplémentaires sont disponibles au fil du travail et sont spécifiques à chaque type de traitement.
CONSEIL
Prendre un peu de temps pour appréhender l’environnement de travail de MapInfo est une étape primordiale pour connaître l’interface générale du logiciel. Pour cela, il est possible de se référer à tout moment à ce document, à l’aide du logiciel, au Guide de l’utilisateur et au Manuel de Référence, tous deux disponibles dans le dossier d’installation du logiciel.
BARRE DES MENUS
Fichier Ouverture, fermeture, enregistrement, impression…
Edition Fonctions d’édition (annuler, couper, copier, coller, effacer…)
Outils Modules complémentaires du logiciel (.MBX) [Fonction « Exécuter »] et outils MapBasic
Objets Opérations de transformations des objets géographiques sélectionnés (assemblage, découpage, suppression…).
Sélection Opérations et requêtes attributaires simples ou complexes, fonctions de recherche et statistiques.
Table Opérations de transformation d’une couche d’information (gestion, modification, mise à jour de structure…).
Options Options d’affichage des styles (lignes, polygones, symboles, textes) et d’outils (légende, statistiques, palette de couleurs…).
Fenêtre Fonctions de visualisation des fenêtres (données, carte, graphique, mise en page, sectorisation).
Aide Contenant toutes les informations utiles qui manquent dans ce document.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
12
MapInfo possède des options communes à la plupart des logiciels (fonctions d’édition et de gestion principalement). Un logiciel de SIG permet de gérer et créer de l’information, et peut être appréhendé comme un logiciel à la croisée de nombreuses possibilités de création et d’analyse. Chaque menu possède ses propres spécificités. Certaines options ne sont activées ou activables qu’à certains moments, d’autres apparaissent (options noires) ou disparaissent (options grisées) au gré des manipulations, de l’activité de l’environnement de travail (etc.).
LE DETAIL DES MENUS DU LOGICIEL MAPINFO
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
13
Différence entre une fenêtre « Carte » active (encadré rouge), une fenêtre « Données et une fenêtre
« Légende » inactives
A NOTER QUE CERTAINES FENETRES OU BOITES DE DIALOGUE N’APPARAISSENT QUE LORSQUE LA FENETRE A LAQUELLE ELLES SONT ASSOCIEES EST ACTIVE. Cette limitation concerne les menus « Données », « Carte », « Graphique », « Mise en page » ou « Sectorisation ». Les actions spécifiques à chacun de ces menus ne peuvent être réalisées qu’à condition que les fenêtres soient actives :
La modification d’une base graphique n’intervient que lorsque la fenêtre « Carte » est active ; La modification d’une base de données attributaire s’effectue lorsque la fenêtre « Données » est
active ; …
BARRES D’OUTILS MapInfo dispose de trois barres d’outils :
LA BARRE D’OUTILS « STANDARD »
Nouvelle Table (CTRL+N) Coller (CTRL+V)
Ouvrir (CTRL+O) Annuler (CTRL+Z)
Ouvrir WMS Nouvelles Fenêtres « Données »
Ouvrir une table WFS Nouvelle Fenêtre « Carte »
Enregistrer Table (CTRL+E) Nouvelle Fenêtre « Graphique »
Ouvrir un document Nouvelle Fenêtre « Mise en page »
Imprimer (CTRL+P) Sectorisation
Couper (CRTL+X) Aide
Copier (CTRLC)
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
14
LA BARRE D’OUTILS « GENERAL »
Sélection d’objets dans les fenêtres
Outil pointeur et curseur par défaut Sélection par Rectangle Sélection d’objets dans un rectangle
Sélection par Distance Sélection d’objets dans un cercle
Sélection par Polygone Sélection d’objets dans un polygone
Sélection par Forme Libre Sélection d’objets dans une forme quelconque
Tout désélectionner dans la sélection
courante
Inverser la sélection courante Sélection dans un graphique
Zoom avant
(PAVNUM+ ou Scroll souris) Zoom arrière
(PAVNUM- ou Scroll souris)
Zoom Afficher fenêtre Zoom
Déplacements (Flèches directionnelles)
Informations Visualiser les données associées à un objet
Hotlink Ouvrir un fichier ou une URL associé à un objet
Etiquettes Affecter aux objets un libellé extrait de la BD
Dupliquer Fenêtre Carte au sein de MIP o
dans une application OLE (Word, Excel…)
Contrôle des Couches Organisation et propriétés des tables
Distance Déterminer la distance entre deux points
Légende Afficher la légende associée à la carte
Statistiques Afficher la fenêtre stats des objets sélectionnés
Définir Secteur Cible d’un objet sélectionné comme nouveau secteur cible
Affecter Sélection Affecter la sélection au secteur cible
Activer / Désactiver Pochoir Visualiser la carte intégralement ou non
Définir Pochoir Pochoir de visualisation de la carte active
LA BARRE D’OUTILS « DESSINS »
Symbole Placer des symboles ponctuels sur la carte
Ligne Tracer des lignes droites
Polyligne Tracer des polylignes
Arc de cercle Tracer un arc de cercle
Polygone Tracer des polygones
Ellipse Tracer des ellipses ou des cercles (SHIFT)
Rectangle Tracer des rectangles ou des carrés (SHIFT)
Rectangle arrondi Tracer des rectangles ou des carrés arrondis
Texte Outil texte (titre, libellés…)
Cadre Créer des cadres
Modifier Objets Activer/désactiver la modification des formes Ajout/suppression de nœuds aux polygones, lignes et polylignes
Ajouter Nœud Ajouter des nœuds à des polygones, lignes ou polylignes lorsque le mode « Modifier Objets » est activé
Style Symbole Modifier style, couleur, taille du symbole
Style ligne Modifier style, couleur, épaisseur de la ligne
Style Polygone Modifier style, couleur, épaisseur du polygone
Style Texte Modifier style, couleur, fond du texte
CONSEIL
Il est possible à tout moment d’ancrer, c’est-à-dire de fixer les différentes barres d’outils au lieu qu’elles soient flottantes. Pour cela, il faut maintenir le clic gauche enfoncé sur la barre d’outils sélectionnée et la faire glisser jusqu’au niveau de la Barre des Menus. Il est possible de faire la manipulation inverse pour rendre les barres d’outils flottantes. Au redémarrage de l’ordinateur, les paramètres par défaut du logiciel reprennent leurs droits. Pour les modifier et garder le mode de présentation souhaité, il faut l’indiquer au logiciel via le menu « Options > Barres d’Outils… » pour faire apparaître la boîte de dialogue « Options Barres d’Outils ».
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
15
OUVERTURE DU PREMIER FICHIER ET OPTIONS D’AFFICHAGE
Ouvrir dans un premier temps la table com_33_fla.TAB (0_TD_Introductif – Gironde ou 2_Données - Gironde5).
Il existe deux manières d’ouvrir une table MapInfo (.TAB). Par le biais du logiciel : « Fichier – Ouvrir », chercher le dossier de destination contenant la table à
ouvrir (ici com_33_fla.TAB, soit une couche d’information des communes de la Gironde) ou cliquer sur la petite icône « Ouvrir Table » dans la barre d’outils « Général ».
Ouvrir la table (com_33_fla.TAB) directement dans le dossier de destination la contenant. Repérer l’icône .TAB et/ou regarder l’extension du fichier. Si cela s’avère utile, il est possible de modifier les propriétés d’affichage des icônes sous Windows pour repérer plus facilement les fichiers en affichant leurs extensions.
5 Les chemins d’accès peuvent changer en fonction des visuels et du texte, mais les manipulations restent les mêmes.
Parcourir les données
Sélection du type de fichier
Modes de visualisation
Modification des paramètres d’affichage :
Icônes ; Listes ; Détails ; Etc.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
16
COMMENT AFFICHER LES EXTENSIONS D’UN FICHIER CONNU ?
Par défaut, l’OS de l’ordinateur n’affiche par les extensions des fichiers qu’il connaît. L’icône ne suffit pas toujours pour trouver le fichier recherché. Il est dès lors possible d’afficher les extensions cachées. Cette option permet d’ajouter un facteur de différenciation supplémentaire très appréciable lorsque l’on dispose d’une multitude de fichiers différents, notamment dans le cadre d’un travail sous MapInfo.
Pour afficher l’extension des fichiers, il faut se rendre dans une fenêtre
Explorer de l’OS et sélectionner le menu « Outils – Options des dossiers », Onglet « Affichage » et décocher l’option « Masquer les extensions de fichiers dont le type est connu », « Appliquer » et OK.
La table est ouverte par défaut sous la forme d’une fenêtre « Carte » (visualisation de la table graphique)
de taille assez réduite. Une table MapInfo .TAB est constituée de différents éléments à l’affichage. Par défaut, seule la table graphique s’affiche. Or sur un SIG, la table graphique est étroitement liée à une table attributaire.
Il est possible de jouer avec les options d’agrandissement (1) de la fenêtre « Carte » pour avoir une vue en
pleine écran, ou mettre à la taille souhaitée en utilisant les poignées d’agrandissement/réduction qui apparaissent en survolant les bord de la fenêtre (2).
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
17
Pour afficher la table attributaire qui se rapporte à la couche d’information active, il suffit de cliquer sur les
paramètres d’affichage de la barre d’outils « Standard ».
Le bouton de gauche « Nouvelle Fenêtre Données » permet d’afficher autant de fois que nécessaire la
table attributaire. Le bouton de droite « Nouvelle Fenêtre Carte » permet quant à lui d’ouvrir autant de fois que nécessaire la table graphique.
Il est ensuite possible de jouer avec les options d’affichage du logiciel pour réduire/agrandir,
maximiser/minimiser, modifier la taille, bouger, etc. les fenêtres de manière à être le plus à l’aise en fonction des besoins. Comme la plupart des logiciels MapInfo possède deux options d’affichage automatique : en « Mosaïque » ou en « Cascade » (« Fenêtre – Mosaïque » [SHIFT+F4] ou « Fenêtre – Cascade » [SHIFT+F5]).
A NOTER QUE CERTAINES FENETRES OU BOITES DE DIALOGUE N’APPARAISSENT QUE LORSQUE LA FENETRE A LAQUELLE ELLES SONT ASSOCIEES EST ACTIVE. Cette limitation concerne les menus « Données », « Carte », « Graphique », « Mise en page » ou « Sectorisation ». Les actions spécifiques à chacun de ces menus ne peuvent être réalisées qu’à condition que les fenêtres soient actives :
La modification d’une base graphique n’intervient que lorsque la fenêtre « Carte » est active ;
La modification d’une base de données attributaire s’effectue lorsque la fenêtre « Données » est active ;
… Dans ce cas de figure, c’est la fenêtre de la table ouverte
« Données » qui est active, donc la table attributaire.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
18
LES FENETRES UTILES SOUS MAPINFO
FENETRE CARTE La fenêtre « Carte » permet d’afficher les objets géographiques contenus dans la table ouverte. Il est
possible d’ouvrir simultanément en superposant les informations graphiques de plusieurs tables, chaque table représentant une couche distincte, ou alors de juxtaposer les fenêtres « Carte » les unes à côté des autres. Il est possible d’afficher, de créer ou modifier des cartes existantes.
FENETRE DONNEES
La fenêtre « Données » permet de visualiser et de manipuler les tables sous la forme de tableaux de lignes et de colonnes, utilisés de manière habituelle dans les bases de données et les tableurs. Chaque colonne contient des informations sur un champ spécifique (identifiant, nom, superficie, etc.). Chaque ligne contient toutes les informations se rapportant à un objet graphique6 visible sur la table graphique.
6 Dans le langage du logiciel, l’objet graphique est appelé enregistrement, car le terme renvoie à la fois à l’objet dessiné sur la fenêtre « Carte » et à la position en ligne qu’il occupe dans la table attributaire.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
19
MANIPULATIONS DU LOGICIEL
Les procédures qui suivent reprennent les éléments qui ont été énoncés lors des séances du module « Initiation ». Elles permettent d’apprendre à saisir les différentes données à disposition, à numériser et à interpréter les objets. Elles s’organisent autour du plan défini qui ne reprend pas les étapes chronologiques du cours et en fonction de l’avancée de chaque groupe de TD.
PLAN DE LA DEMONSTRATION SUIVI DURANT LES MODULES
1. CALAGE D’UNE IMAGE
2. CREATION D’UNE TABLE MAPINFO
3. PHOTO-INTERPRETATION ET NUMERISATION
4. IMPORTER ET OUVRIR D’AUTRES SUPPORTS
5. OPERATIONS DE SELECTION
6. REALISER UNE ANALYSE THEMATIQUE
7. REALISER UNE ANALYSE THEMATIQUE DE LA CARTE D’OCCUPATION DES SOLS
8. MISE EN PAGE D’UNE ANALYSE THEMATIQUE
9. ENREGISTRER LA CARTE
Les manipulations effectuées ci-après reprennent quelques manipulations techniques d’un travail basé sur la réalisation d’un protocole méthodologique d’une carte d’occupation des sols sur la commune de Cadaujac en Gironde. Les manipulations techniques reposant à peu près sur les mêmes logiques de fonctionnement d’un sujet à un autre, il faut contextualiser ces manipulations techniques par rapport au cas d’étude du PNRLG et aux différents sujets abordés. De plus, l’organisation chiffrée ci-dessus ne présage en rien de l’ordre des manipulations à effectuer pour répondre aux demandes du commanditaire.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
20
CALER UNE IMAGE7 Les images rasters (ex. : deux images satellites SPOT5 été 2003 et hiver 2004) sont des compositions
colorées qui peuvent être superposées. Afin d’arriver à un résultat concluant, il faut assigner un système de projection commun, c’est-à-dire qu’il faut placer les deux images au cœur d’un référentiel identique et leur attribuer des coordonnées communes (X ; Y) à des points remarquables contenus entre les deux images. Les fichiers SCAN 25 (ex. 33_0609.TIF ainsi que les autres dalles numériques de la carte topographique du périmètre d’étude) et les tables qui sont associées, servent de point de référence pour pouvoir caler les deux images rasters par rapport à ce référentiel (ex. : images satellites SPOT5 été 2003 et hiver 2004).
LE SYSTEME DE PROJECTION
La projection fait référence au « Système de correspondance entre les points de la surface du globe et ceux de la surface plane de la carte » (POIDEVIN, 1999, 199). La projection conique conforme de Lambert est la projection officielle utilisée pour représenter la France Métropolitaine.
Démarrer le logiciel MapInfo Professional. Ouvrir la table de calage de l’image SCAN 25 concernant la zone d’étude (différente pour chacun des
groupes) : « Fichier – Ouvrir », chercher le dossier de destination contenant la table de calage du SCAN25 (ex. :
33_0609.TAB) et l’image SCAN25 qui lui est associée (ex. : 33_0609.TIF).
Ou
Ouvrir la table du SCAN25 (ex. : 33_0609.TAB) directement dans le dossier de destination où elle est sauvegardée (ex. : Cartes_Topo_SCAN25). Repérer l’icône .TAB et/ou regarder l’extension du fichier.
7 Un cas similaire a été traité durant le cours en prenant comme référence de calage le zonage administratif des communes de la Gironde et des Landes par rapport à la carte du PNRLG.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
21
Ouvrir ensuite une image raster à caler.
(ex. : des compositions colorées satellites d’été 2003 et de d’hiver 2004, ici SEL_SPOT0304.jpeg et SEM_SPOT0803.jpeg) :
SEL_SPOT0304.jpeg Ou
SEL_SPOT0803.jpeg Dans le Menu « Ouvrir », choisir le type de fichier « Raster image… », pour sélectionner la composition colorée choisie (exemple des figures suivantes SEL_SPOT0304.jpeg).
Cliquer sur OK.
Une nouvelle boîte de dialogue s’ouvre : CLIQUER SUR CALAGE ET NON SUR AFFICHAGE (sinon refermer et recommencer la manipulation).
Deux fenêtres sont ouvertes : le fichier raster SCAN25 sert de référence au raster (ex/ : images satellites traitées ci-après) qu’il faut caler.
Cliquer successivement sur les boutons « Projections… » et « Unités… », pour faire apparaître les boîtes de dialogue « Choisir projection » et « Unités ».
Définir le système de projection (Système français RGF93 – France Lambert-938) et les unités (mètres).
LE SYSTEME DE PROJECTION EN FRANCE METROPOLITAINE9
La projection Lambert93 est la projection officielle pour les cartes de France métropolitaine. Elle est liée au système géodésique RGF93. Son intérêt principal réside dans son référentiel RGF93, qui est d’une part commun aux voisins européens de la France et d’autre part compatible avec le WGS84 utilisé notamment par le système GPS de positionnement par satellite. Cette projection est normalement peu utilisée, en partie du fait des altérations linéaires qui y sont associées. C’est pourquoi, neuf projections coniques conformes sécantes, couvrant neuf zones du nord au sud, dont la projection L93CC45.
8 Le système de projection Lambert II Carto est périmé, mais est encore utilisé en France Métropolitaine. De plus, il s’agit du système de projection inclus dans les tables associées aux différentes dalles SCAN 25. Le Lambert II Carto a dès lors servi de système de référence pour caler les images satellites. La plupart des données étant fournies en Lambert 93CC45, ces dernières sont superposables au système de projection initial du calage des images satellites par rapport aux dalles SCAN 25 (Lambert II Carto). De plus, la projection L93CC45 ne semble pas être disponible dans la version 7.8 du logiciel, auquel cas il faut se rapporter à la projection RGF93. 9 http://www.certu.fr/fr/_information_géographique-n32/Géoréférencement_et_RGF93-n795/IMG/pdf/RGF93_theorie_et_concept.pdf
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
22
Caler les deux images grâce à des points de repères communs sur le raster à caler (ex. : image satellite) et sur le SCAN25. Il s’agit de faire à chaque fois des allers-retours entre la fenêtre « Calage Image » et la fenêtre « Carte » active où est ouvert la dalle SCAN25. Pour cela, MapInfo propose de créer des points de calage.
Cliquer sur « Nouveau »
Choisir un point remarquable sur la carte topographique numérisée (Option « Cliquer sur la carte » dans la boîte de dialogue « Calage Image ») et cliquer dessus.
Une nouvelle boîte de dialogue (« Modifier Points de Calage » apparaît, et affiche les coordonnées du point de calage sur la carte (Coordonnées Carte X ; Y) (1). Une fois cette opération effectuée, la petite boîte de dialogue « Modifier Points de Calage » réapparait avec cette fois les coordonnées de la composition colorée (Coordonnées Image X ; Y) (2).
1 2 Cliquer sur OK.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
23
La correspondance est établie entre les coordonnées géographiques de la carte topographique numérisée qui sert de référence et les coordonnées (X ; Y) de l’image à caler. Le point de calage n°1 apparaît.
NE PAS OUBLIER DE CLIQUER A CHAQUE FOIS SUR « NOUVEAU » POUR SAISIR CHAQUE POINT DE CALAGE, SINON LA MANIPULATION EN COURS VA MODIFIER LE POINT D’ANCRAGE DEJA SAISI.
RAPPELS SUR LES POINTS DE CALAGE Trois points sont nécessaires au minimum pour caler une image ; Quatre points sont nécessaires pour avoir une estimation de l’erreur de calage sur les points choisis,
c'est-à-dire le décalage en termes de pixels entre les deux fichiers.
CONSEILS
Pour avoir un calage efficace, il est préférable d’utiliser au moins cinq ou six points de calage qui seront pris de préférence aux quatre coins de l’image et vers le centre. Un bon calage nécessite un DEGRE D’ERREUR DE CINQ PIXELS AU MAXIMUM.
La sélection des points de calage doit s’effectuer sur des objets géographiques remarquables et facilement identifiables de la source cartographique (SCAN 25) à la cible raster (image satellite). Il est possible de se référer à :
Des unités terrestres particulières telles que des croisements de routes ; Des formes singulières d’organisation telles que le tracé des zones urbaines ou des parcelles agricoles,
les unités marines avec le tracé des berges ou les accidents de rivage ; …
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
24
Il faut maintenant créer d’autres points de calage. Ne pas oublier de cliquer à chaque fois sur « Nouveau ». Lorsque la saisie des points est terminée, c'est-à-dire qu’il faut avoir beaucoup de points et peu d’erreurs, cliquer sur OK (exemple SEL_0304.jpeg) (1). Procéder de la même manière pour d’autres rasters à caler au besoin (exemple SEL_0803.jpeg) (2).
1 2 Le(s) raster(s) est(sont) calé(s) sur le SCAN25. Il(s) est(sont) superposé(s) sur la carte topographique numérisée. Il est possible de faire apparaître successivement chacune des images en faisant monter ou descendre les couches d’informations au gré des besoins, en cliquant sur le « Contrôle des Couches ».
LA SUPERPOSITION DES COUCHES D’INFORMATION EST TRES IMPORTANTE DANS LES REGLES D’AFFICHAGE DU LOGICIEL MAPINFO. Il faut prendre garde à cette question, car très souvent certaines couches sont placées sous la première. C’est le cas de l’image satellite d’été qui est placée sous l’image d’hiver.
Le calage de l’image raster (ex. : les compositions colorées été 2003 ou hiver 2004) créé automatiquement
dans le répertoire de destination des fichiers raster un fichier .TAB contenant l’ensemble des coordonnées des images calées (ex. : SEL_SPOT0304.TAB pour l’image d’hiver et SEL_SPOT0803.TAB pour l’image d’été). Ce fichier permet de garder les images calées ouvertes dans le même système de référence, premier préalable pour travailler correctement.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
25
FAUSSE MANIPULATION DANS LE CALAGE : IL FAUT EFFACER LE FICHIER .TAB CREE AUTOMATIQUEMENT DANS LE DOSSIER DE DESTINATION DES IMAGES RASTER ET REFAIRE INTEGRALEMENT LE CALAGE. CONSEIL
Noter progressivement dans un tableau les coordonnées des points de calage (Carte X ; Y et Image X ; Y) pour éviter de refaire entièrement la manipulation (reconnaissance des points et sélection).
SOLUTION de calage possible pour l’image SPOT5 hiver 2004 (« SEL_SPOT0304.jpeg »)
Point Carte X Carte Y Erreur Image X Image Y
Pt 1 371 983,67 1 976 532,61 1 64 184
Pt 2 372 013,86 1 973 941,84 1 70 699
Pt 3 374 200,63 1 974 319,96 0 509 625
Pt 4 374 706,71 1 977 116,32 1 610 66
Pt 5 372 422,17 1 976 258,00 1 154 238
Pt 6 372 967,79 1 975 424,13 1 263 406
SOLUTION de calage possible pour l’image SPOT5 été 2003 (« SEL_SPOT0803.jpeg »)
Point Carte X Carte Y Erreur Image X Image Y
Pt 1 371 674,56 1 976 450,66 1 12 214
Pt 2 372 012,42 1 973 943,28 1 74 717
Pt 3 374 590,25 1 974 830,35 1 590 543
Pt 4 374 708,14 1 977 116,32 1 615 82
Pt 5 372 818,98 1 976 263,75 0 238 252
Pt 6 373 395,51 1 974 738,34 1 350 560
La première étape du travail est accomplie. Une dernière manipulation utile à effectuer est l’enregistrement
du travail sous la forme d’un WORKSPACE ou DOCUMENT .WOR. L’enregistrement du Workspace permet de sauvegarder une session de travail (exemple de la session de travail Calage).
Lors de la prochaine ouverture, il suffira de cliquer sur le fichier .WOR ou l’ouvrir directement sous MapInfo pour redémarrer la session de travail où elle s’est arrêtée. Cette petite subtilité permet de gagner du temps en créant un fichier unique qui enregistre toutes les manipulations et les tables ouvertes. Si la session n’est pas enregistrée, l’utilisateur devra à chaque fois ouvrir les tables qui lui sont utiles. Dans le cadre d’un travail de numérisation, l’utilisateur a besoin au minimum d’ouvrir simultanément :
Les(s) SCAN25 ; Les images rasters et leurs tables de calage respectives ; Les autres fichiers annexes nécessaires à l’analyse, notamment le tracé de la zone d’étude.
La sauvegarde d’un Document de travail permet d’ouvrir simultanément l’ensemble de ces fichiers en un seul clic. Pour enregistrer la session de travail sous un WORKSPACE :
« Fichier – Enregistrer Document Sous », (boîte de dialogue « Enregistrer Document »)
Saisir un nom de fichier approprié (et valider (ou CTRL+D).
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
26
LE WORKSPACE
Le fichier .WOR est un format de fichier unique sous MapInfo qui permet de sauvegarder une session de travail. Le WOKSPACE ne contient aucune information géographique contrairement à une table MIP classique. Il renferme néanmoins toute une série d’indications qui permet de préciser au logiciel les tables utilisées au cours de la session sauvegardée.
Le .WOR sauvegarde : Les chemins d’accès des tables ; La (ou les) mise(s) en forme des fenêtres « Carte » et « Mise en page » ; Le choix des styles définis pour les objets géographiques ; Les analyses thématiques ; …
Le .WOR permet de sauvegarder plusieurs analyses à partir des mêmes tables.
Le document de travail contient des informations sur les tables à utiliser, notamment les chemins d’accès. IL EST IMPERATIF DE PRESERVER LES TABLES TELLES QU’ELLES SONT LORS DE L’ENREGISTREMENT DU WORKSPACE. Si une table est déplacée ou renommée, et que le document de travail n’est pas enregistré suite à ces modifications :
Le logiciel propose à l’utilisateur de rechercher la table manquante dans le cas d’un déplacement de fichier ;
Si le fichier est introuvable, le logiciel ne pourra pas ouvrir le .WOR et affichera un message d’erreur pour inviter l’utilisateur à essayer de nouveau (1)., au contraire si le fichier est introuvable (suppression…), MapInfo affiche un second message d’erreur (2), puis un troisième indiquant définitivement que le .WOR ne peut être ouvert (3).
1 2
3
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
27
Le WORKSPACE possède une icône particulière qui le différencie des autres fichiers MapInfo.
La sauvegarde de cette première étape permet de reprendre la session de travail ultérieurement. Ce type d’enregistrement peut être effectué à tout moment.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
28
CREATION D’UNE TABLE MAPINFO Une fois le calage des fichiers raster terminé, il faut créer une table graphique vierge pour pouvoir
numériser des objets sur la zone d’étude choisie. Cette table graphique vierge sera superposable aux images rasters calées (ex. : images satellites SPOT5), aux dalles SCAN25, etc.
La condition préalable à respecter est que l’ensemble des fichiers se rapportent bien au même système de projection (Lambert-93). La table vierge étant créée sur la base de la carte topographique numérisée et/ou de la composition colorée qui vient d’être calée, le logiciel conserve normalement le système de projection assigné aux fichiers initiaux. Effectivement, MapInfo impose le système de projection du fichier raster ouvert.
Si cela n’est pas déjà fait, afficher les fichiers rasters par le biais des tables de calage et la (ou les) dalles
SCAN25 IGN, ou ouvrir directement le WORKSPACE (sauvegarde de la session de travail). Cliquer dans le menu « Fichier », « Nouvelle Table » [CTRL+N]. La boîte de dialogue « Nouvelle Table » s’affiche.
LA TABLE MAPINFO
Une base de données MIP est constituée d’une succession de tables constituée par une table graphique (carte) et une table attributaire (tableau). Une table attributaire est formée de lignes et de colonnes :
Une ligne contient des informations concernant une caractéristique géographique particulière ; Une colonne contient un type particulier d’informations sur les données de la table.
LA TABLE FAIT REFERENCE A CE QUE L’ON APPELLE CLASSIQUEMENT UNE COUCHE D’INFORMATION.
Choisir les options :
« Créer une nouvelle fenêtre de données » ; « Ajouter à la fenêtre active » ; « Créer » une nouvelle structure Décocher l’option « Ouvrir une nouvelle fenêtre Carte ».
Cliquer sur Créer. La boîte de dialogue « Structure de la nouvelle table » s’affiche.
Construire la structure de la base de données d’occupation du sol
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
29
Cliquer sur « Ajouter Champ »
LE CHAMP
« Le champ d’une table correspond à la colonne d’un tableau. Un champ contient un type spécifique d’informations sur un objet (…). L’enregistrement d’un objet correspond aux valeurs de cet objet pour chacun des champs de la base de données ».
La structure d’une table est plus ou moins complexe (ex. la création d’une couche d’occupation des sols basée sur la nomenclature Corine Land Cover – CLC, comportant quatre champs) :
Un champ « ID » pour identifier les objets géographiques à numériser ; Un champ « Code_CLC » pour définir les codes de la nomenclature enrichie ; Un Champ « Type_OS » pour traduire en termes clairs les codes de la nomenclature en libellés ; Un champ « Area » ou « Superficie » pour le calcul de la superficie des polygones identifiés.
FAIRE ATTENTION A LA MISE EN FORME DES CHAMPS
Une fois que les différents champs sont définis, il faut sélectionner le type de variable, c'est-à-dire la nature des données à inclure dans chaque champ.
QUELLE EST LA NATURE DES DONNEES ?
D’ordinaire on distingue deux grands types de variables : qualitatif et quantitatif regroupant quatre sortes de mesures : nominale, ordinale, numérique sur une échelle d’intervalles et numérique selon une échelle de rapports (BEGUIN & PUMAIN, 201010).
Une variable qualitative représente une donnée à laquelle on peut attribuer une valeur ou un caractère : La variable peut être définie par un caractère qualitatif nominal compris comme « un ensemble de
modalités n’ayant entre elles aucun ordre à priori. Ces modalités s’expriment le plus souvent par des
10 BEGUIN Michèle & PUMAIN Denise, 2010, La représentation des données géographiques statistiques en cartographie, Paris, Armand Colin, coll. « Cursus – Géographie », 192p.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
30
mots (par exemple : le caractère d’une couleur, ou la branche d’activité) ou parfois par des nombres (par exemple : un code numérique) » (BEGUIN & PUMAIN, 2010, p. 50) ;
La variable peut être définie par un caractère qualitatif ordinal compris comme « un ensemble de modalités que l’on peut ranger par ordre croissant ou décroissant. Elles s’expriment verbalement (petit, moyen, grand ou encore, pauvre, riche, très riche), par des rangs (notons alors que le rang 1er, 2e, 3e… ne dit rien quant à l’importance de la différence qui sépare le 1er du 2e, le 2e du 3e, etc., différence qui peut par ailleurs fortement varier d’un rang à l’autre – c’est pourquoi, bien que le rang soit un nombre, il s’agit d’un caractère qualitatif) » (ibid.) ;
Une variable quantitative représente des données qui peuvent être mesurées et auxquelles on associe des chiffres et des unités de mesure :
La variable peut être définie par un caractère quantitatif mesuré sur une échelle d’intervalle compris comme « un ensemble de valeurs numériques entre lesquelles on peut opérer des différences, mais pas de rapports. Les échelles d’intervalle sont des échelles numériques sur lesquelles la position zéro est arbitraire : par exemple la latitude, la longitude, l’altitude, la température, la date sont mesurées sur de telles échelles. N’importe quelle mesure quantitative peut être évaluée de cette façon : chaque fois que l’on veut situer des unités géographiques en termes d’écarts à une valeur donnée (par exemple, écarts à une valeur moyenne), on ramène la mesure à une échelle d’intervalle » (ibid.) ;
La variable peut être définie par un caractère quantitatif proprement dit, mesuré sur une échelle dite de « rapport » compris comme « un ensemble de valeurs qui correspondent à des quantités bien définies, que l’on peut additionner et dont la somme est alors significative, et dont on peut évaluer le rapport. Par exemple, le nombre d’habitants des villes, la quantité de blé produite par régions, sont des caractères quantitatifs, leurs sommes constituent la population urbaine ou la production de blé nationales. » (ibid., p. 51).
Chaque objet géographique stocké dans une couche d’information est doté d’un certain nombre d’attributs.
Ces derniers doivent être définis lors de la création ou de la modification de la structure de la table. Il convient de définir judicieusement le type de chaque champ en fonction de la nature des données ou des variables qui figureront dans le tableau.
MapInfo propose sept « types » pour qualifier les champs de la base de données : « Caractère », « Entier », « Entier court », « Flottant », « Virgule fixe », « Date » et « Logique ».
Type Description
Caractère Caractères alphanumériques (Limitation à 254 caractères)
Entier Nombres entiers sans partie décimale compris entre – et + 2 milliards
Entier court Nombres entiers compris entre – et + 32.768
Flottant Nombres décimaux à virgule flottante
Virgule fixe Nombres décimaux à virgule fixe
Date Date sous le format Windows
Logique Informations logiques (vrai/faux ou oui/non)
Les quatre champs de la base de données d’occupation des sols sont de nature différente :
ID Caractère (aucun calcul arithmétique)
Code_CLC Caractère (aucun calcul arithmétique)
Type_CLC Caractère (aucun calcul arithmétique)
Area Virgule fixe (calcul arithmétique)
CONSEIL
Penser à définir une largeur suffisante afin que la saisie de l’information ne soit pas tronquée. La largeur est définie par le nombre maximum de caractères pouvant être entrés dans la colonne du tableau.
Une largeur de 4 permet de rentrer quatre caractères. Privilégier des longueurs assez longues pour les champs accueillant les libellés.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
31
VEILLER A CE QUE LES FICHIERS SOIENT DANS LE MEME SYSTEME DE PROJECTION. .
Cliquer sur CREER. La boîte de dialogue « Créer une Nouvelle Table » apparaît pour enregistrer la nouvelle table. Veiller à choisir un nom de table pertinent (par défaut « Sans_nom.TAB ») et un chemin d’accès approprié (par défaut « Mes Documents »).
LES EXTENSIONS MAPINFO
En créant la table d’occupation des sols, MapInfo créé automatiquement quatre ou cinq fichiers (parfois plus) portant le même nom, mais des extensions différentes :
Extension Signification
*.DAT Fichier contenant la base de données
*.ID Fichier regroupant l’information permettant d’établir le lien entre les vecteurs et la BD
*.IND Fichier contenant l’index des données descriptives. (Ce fichier existe seulement si au moins un champ de la table est indexé)
*.MAP Fichier regroupant les données géométriques décrivant les entités géographiques (position, formes des objets…)
*.TAB Fichier principal reliant l’ensemble des fichiers afin de les ouvrir dans MapInfo
LES FICHIERS .TAB, .DAT, .ID, .IND, .MAP ONT LE MEME PREFIXE DONNE LORS DE LA CREATION DE LA TABLE. ILS SONT INDISSOCIABLES :
ILS NE PEUVENT SE TROUVER DANS DES REPERTOIRES DIFFERENTS ; IL NE FAUT JAMAIS LES RENOMMER EN DEHORS DU LOGICIEL MAPINFO ; SI UN DES FICHIERS EST SUPPRIME, L’ENSEMBLE NE FONCTIONNERA PLUS.
Il est possible de manipuler et d’exploiter les données d’une table MapInfo dans un logiciel de statistiques
ou dans un tableur. Pour cela, il suffit de sauvegarder le fichier .DAT en fichier .DBF (« Fichier », « Enregistrer sous »). Le .DBF peut quant à lui être importé dans le logiciel et joint à une couche d’information.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
32
La table vierge est affichée avec le fond à digitaliser (Affichage des fenêtres en mode « mosaïque »). Il s’agit d’un calque numérique (table graphique) muni d’une table attributaire. Il faut dès à présent commencer à photo-interpréter et à numériser, et remplir progressivement la base de données.
CONSEIL
Penser à enregistrer la session de travail. Il est également possible de créer une sauvegarde générale, et garder une copie des fichiers source nécessaires pour ce travail.
Le logiciel offre une autre possibilité pour représenter des objets en passant par la Couche de Dessin via le Contrôle des Couches. La Couche de Dessin est un calque virtuel présent de manière permanente et disponible à n’importe quel instant en activant l’option de modification de la couche.
Travailler sur la Couche de Dessin permet de représenter directement les objets sur la fenêtre Carte sans
passer par la création de la structure de la base de données attributaires. Il faudra néanmoins réaliser cette manipulation par la suite.
Pour enregistrer la Couche de Dessin, il faut passer par le menu « Carte > Enregistrer la couche de dessin… ». Il faudra choisir le nom et le répertoire de destination. Pour créer la structure de la table, il faut ensuite passer par le menu « Table > Gestion Tables > Modifier Structure… ». La boîte de dialogue Modifier la Structure de la Table : XXX (XXX faisant référence au nom de la table). Il faudra ajouter les champs et modifier le type des données en fonction de la structure à créer.
Dans les deux cas, il convient de ben réfléchir à la structuration de la base de données attributaire. Il est possible de revenir à tout moment sur la structuration de la base de données, par le même moyen. Cette manipulation permet d’ajouter de nouveaux champs ou d’en supprimer certains, et de modifier le type, etc. Néanmoins, il vaut mieux éviter de le faire.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
33
PHOTO-INTERPRETATION ET NUMERISATION
OCCUPATION DU SOL : METHODE GENERALE Les principes de la photo-interprétation sont particulièrement simples. Il s’agit d’identifier et de numériser
des objets spatiaux par rapport à d’autres supports d’information (ex. : images satellites d’été 2003 et d’hiver 2004, images aériennes) et à partir de l’interprétation réalisée. La vectorisation des objets visibles et identifiés se fait directement sur l’image raster, en pratiquant une méthode de « décalquage numérique » sur la couche d’occupation des sols.
La question posée est de savoir « comment définir les entités que l’on souhaite reproduire ? »
LES CLES D’INTERPRETATION La représentation des objets géographiques à partir d’une photo-interprétation d’images satellites passe
par l’étape de décryptage de l’information visible sur la photo. Quelques pistes ou clés d’interprétation peuvent être utiles pour dresser une Carte d’Occupation des Sols (ex. : visuels du bocage humide de Cadaujac).
La COULEUR ou les couleurs des objets spatiaux permettent de connaître la nature des objets identifiés
Tableau de correspondance des couleurs des compositions colorées
Couleur Interprétation
Noire Eau profonde et pure
Bleu clair-cyan Eau trouble et peu profonde
Magenta foncé Habitat aéré
Cyan foncé Habitat dense et contigu
Rouge vif Végétation saine et dense
Rouge clair Végétation en automne et hiver
Rouge sombre Conifères
Cyan très clair Sols nus, routes
Blanc Sable, carrières, chantiers
… …
La TEXTURE est utilisée pour décrire la surface de l’objet sur une image (satellite, aérienne…), indépendamment des relations qu’il peut avoir avec les autres objets spatiaux, de sa couleur et de sa luminosité. Il existe différents adjectifs pour qualifier la structure des objets : grossière, fine, lisse, rugueuse, granuleuse, régulière, irrégulière…
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
34
La STRUCTURE correspond à l’agencement spatial des objets visiblement discernables sur une image, et à leur organisation entre eux.
La FORME correspond à la géométrie des objets spatiaux (géométrique, lanière, aréolaire…).
La TAILLE des objets spatiaux est fonction de la définition de l’échelle d’observation.
La PHENOLOGIE ainsi que la date de prise de vue des images (août 2003 et mars 2004) sont très utiles pour comparer l’évolution des objets en fonction des saisons ou des années (évolution saisonnière des végétaux, conditions climatiques particulières…)
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
35
LES MODELES DE DONNEES GRAPHIQUES Traiter l’information géographique grâce à un SIG fait intervenir deux modèles de données graphiques,
c'est-à-dire de manières de représenter graphiquement l’information spatialisée :
Le mode « vectoriel » ou « objet » Le mode « raster » ou « image »
Le mode vectoriel permet de représenter tous les objets géographiques à l’aide de points, lignes et polygones. La base du langage vectoriel repose sur trois primitives graphiques bases des possibilités de dessin sous MapInfo :
Le point définit les éléments ponctuels isolés (coordonnées X ; Y) ;
L’arc et le nœud construisent des lignes et des polylignes définis comme une succession de segments avec un point de départ et un point d’arrivée ;
Les polygones sont des formes pleines, composées de lignes dont les nœuds de départ et d’arrivées sont identiques.
La mode raster définit la structure de l’information géographique selon un découpage régulier de l’espace en unités spatiales élémentaires de forme carrée : les pixels.
La position de chaque pixel est définie par un numéro de ligne et un numéro de colonne (ses coordonnées). Chaque pixel a une valeur propre (ou un attribut)
Données raster Données vectorielles
Avantages Acquisition facile Utilisable sans description explicite Analyse spatiale simple
Faible encombrement mémoire Qualités graphiques supérieures Analyse possible
Inconvénients Encombrement mémoire important Qualité de visualisation médiocre en cas de zoom
Acquisition complexe Besoins de données écrites explicitement pour pouvoir les exploitées (métadonnées)
LA STRUCTURATION DES DONNEES GEOGRAPHIQUES
Les données géographiques sont structurées sous la forme de couches d’informations monothématiques dans une base de données spatiale géoréférencée et attributaire.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
36
Les objets graphiques ont des attributs qualitatifs (alphanumériques) ou quantitatifs (numériques).
Les cartes numérisées sont structurées en couches, qui sont autant de tables d’informations superposées. Chacune de ces couches contient un aspect particulier de la carte générale et/ou un type d’information spécifique. Chaque table MIP représente une couche différente.
La carte ci-contre fait intervenir cinq couches d’informations géographiques différentes :
La couche Gironde.TAB représentant les contours du département (polygones);
La couche Communes33.TAB représentant les limites communales girondi-nes (polygones);
La couche Cours_eau_33.TAB (polylignes) ; La couche de localisation33.TAB (points) ; La couche Toponymes33.TAB (étiquettes)
Les couches d’informations sont forcément monothématiques, c'est-à-dire qu’elles ne doivent contenir qu’un seul type d’information.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
37
Il convient de réfléchir à la manière de représenter les différents éléments identifiés sur les images satellites (espaces, réseaux, points isolés…).
LA GESTION VISUELLE DES TABLES SOUS MAPINFO L’organisation des tables sous MapInfo répond à une logique de superposition, qui est accessible par le
« Contrôle des Couches » disponible dans le menu « Carte » [CTLR+L] ou dans la barre d’outils général. Le « Contrôle des Couches » est une option primordiale qui permet de gérer les options de visualisation et
l’apparence des couches dans la fenêtre « Carte » active (ex. : carte OS sur un secteur de Cadaujac, Gironde).
Une couche d’information peut être affichée ou non dans la fenêtre « Carte », modifiée (la modification porte sur une seule couche à la fois), ses objets peuvent être sélectionnés et étiquetés. Le « Contrôle des Couches » permet d’ajouter et/ou d’enlever des couches, mais également de modifier la superposition des couches grâce aux options « Monter » et « Descendre ».
GARDER A L’ESPRIT QUE L’ORGANISATION DES COUCHES EST MONOTHEMATIQUE : Un type d’information par couche ; Le logiciel MapInfo arbitre des choix de visibilité pour afficher les couches d’informations. Les
couches ponctuelles se superposent aux couches linéaires et aux couches « polygones » ; Les cases grisées représentent les choix non modifiables pour l’action en cours. Le « Contrôle des Couches » permet également de modifier l’affichage des couches d’informations et
des objets qui y sont associés grâce à l’option « Affichage » et « Modifier Style » (modifier la trame intérieure, le contour et son épaisseur, les couleurs…) (1). Il permet également d’ajouter automatiquement des étiquettes en fonction d’une colonne prédéfinie (2).
Rendre la couche « Visible »
Rendre la couche « Modifiable »
Rendre la couche « Sélectable »
Etiqueter la couche
Modifier la représentation des entités de la couche affichée
Modifier les étiquettes
Insérer des Hotlinks ou hyperliens
Ajouter ou enlever des couches. Les couches enlevées restent ouvertes dans le logiciel
Modifier l’ordre de superposition des couches affichées
1 2
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
38
CONSEIL MapInfo propose des options de visualisation par défaut en noir et blanc, avec un contour simple (1).
Privilégier des couleurs vives pour différencier les différentes couches ainsi qu’une trame transparente (N) pour tracer les objets à numériser. Il est également possible de définir une gradation dans l’épaisseur des contours pour différencier encore plus facilement les couches d’informations (2).
1 2
LES MODIFICATIONS DE STYLE SONT UNIQUEMENT VISUELLES. ELLES NE SONT PAS ENREGISTREES SUR LES TABLES. Pour garder la mise en forme en cours, il est possible d’enregistrer la session de travail sur le Workspace, autrement il faudra à nouveau recommencer la mise en forme lors de la prochaine utilisation.
LA NUMERISATION DES POLYGONES Pour commencer la numérisation, il faut rendre la
couche d’occupation des sols modifiable par le « Contrôle des Couches ». Cette manipulation permet de rendre la couche de digitalisation active et les autres inactives.
Dessiner le premier polygone à l’aide des outils de
dessin de MapInfo sur la couche spécialement créée pour dresser la Carte d’Occupation des Sols (« Etude_OS ») ou sur la « Couche de Dessin » (équivalent à un calque vierge) en la rendant modifiable dans le « Contrôle des Couches ». La « Couche de Dessin » est une bonne alternative lorsqu’il faut rajouter de nouveaux éléments sur la carte, notamment quand la couche créée précédemment n’est pas définie par le même type de données géographiques.
ATTENTION, LA COUCHE DE DESSIN N’EST PAS ENREGISTREE DIRECTEMENT.
Pour enregistrer la « Couche de Dessin » : Sélectionner l’option « Enregistrer Couche
Dessin » dans le menu « Carte ». La boîte de dialogue « Enregistrer les
Objets dans la Table » apparaît. Enregistrer la table dans un dossier
approprié.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
39
REGLES DE NUMERISATION Le dessin des polygones doit respecter plusieurs règles :
1. Les polygones ne doivent pas se chevaucher ; 2. Il ne doit y avoir aucun « trou » ou « manque » dans la numérisation ; 3. Les polygones doivent être « coalescents » ou « jointifs », c'est-à-dire que les limites des polygones
doivent être parfaitement superposables. 4. Deux espaces de même type, c'est-à-dire dont l’occupation des sols est équivalente ne doivent pas
être coalescents, ils doivent former un seul et même objet 5. La somme des superficies des polygones doit être égale à la surface totale définie par la zone d’étude
choisie sur l’ensemble du territoire de la CCM.
PENSER A NUMERISER LA COUCHE DE DIGITALISATION ET A REMPLIR LA BASE DE DONNEES SIMULTANEMENT.
RESPECTER L’ECHELLE DE DEFINITION (Cas d’un travail spécifique basé sur l’enrichissement d’une nomenclature spécifique pour des objectifs méthodologiques particuliers)
Un des points méthodologiques les plus importants est de veiller à respecter le rapport établi entre les principes méthodologiques et le discriminant scalaire défini par l’échelle d’analyse du protocole de la nomenclature enrichie. Par exemple, le niveau 3 de la nomenclature CORINE Land Cover fixe un niveau d’analyse à une échelle de 1.100.000ème, soit la représentation d’objets spatiaux ne devant pas mesurer moins de 25 hectares. Par exemple, si l’on fixe un discriminant spatial équivalent à des polygones de taille minimale de un hectare :
Comment représenter les objets situés sous ce discriminant ? Doivent-ils figurer ou doivent-ils disparaître de la carte d’occupation des sols ? Peuvent-ils être classés au sein d’une classe mixte ? … ?
CONSEIL
Il est possible de se servir de l’outil « Distance » pour obtenir la distance entre deux points en cliquant successivement sur ces points à l’écran, ou calculer un itinéraire ou un périmètre.
Il est possible de connaître la surface d’un objet en effectuant un double clic sur le polygone tracé ou sélectionné. La fenêtre « Objet Polygone » apparaît, donnant des informations utiles sur le polygone sélectionné.
Par défaut, MapInfo définie le calcul des unités de surface en « sq km » ou « sq mi ». Il est possible de changer les unités de mesures en cliquant sur les « Options » de la fenêtre « Carte ».
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
40
AFFICHER DES DONNEES A L’ECRAN L’ouverture des fenêtres attributaires et spatiales s’effectue par le menu « Fenêtre » :
Sélectionner l’option « Données » [F2] ou cliquer sur l’outil pour afficher une nouvelle table attributaire ;
Sélectionner l’option « Carte » [F3] ou cliquer sur l’outil pour afficher une nouvelle fenêtre graphique.
Plusieurs fenêtres « Carte » et « Données » peuvent être ajoutées dans la fenêtre active.
NOTER QUE LA MISE EN FORME DES STYLES N’APPARAIT PAS DANS LES NOUVELLES FENETRES CARTES. A chaque nouvelle fenêtre « Carte » ouverte correspond une superposition dans le « Contrôle des Couches » qui lui est propre. Par exemple, la figure ci-contre fait intervenir deux couches d’informations (ex. : ZE.TAB et POS_Cadaujac.TAB), tandis que celle du dessus fait intervenir une seule couche d’information, organisation singulière que l’on retrouve dans les options de structuration propres à chaque fenêtre active.
NOTER QUE DANS LES TABLES ATTRIBUTAIRES LES ATTRIBUTS ALPHANUMERIQUES APPARAISSENT DE DIFFERENTES MANIERES :
Les attributs en caractères sont justifiés à gauche ;
Les attributs numériques sont justifiés à droite.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
41
La visualisation de la fenêtre « Carte » peut être altérée au fur et à mesure des manipulations
(réduction/agrandissement des fenêtres, zoom/dézoom…). MapInfo propose une option de recentrage automatique des fenêtres.
Sélectionner l’option « Afficher toute la couche » [CTRL+K] dans le menu « Carte »
Sélectionner le mode de visualisation choisi : o « Toutes les couches » permet de centrer la carte en
prenant en compte toutes les couches ouvertes ; o « Couches ouvertes » permet de centrer la carte en
prenant en compte uniquement une des couches ouvertes. L’affichage de plusieurs fenêtres sous MapInfo, notamment durant la période simultanée de numérisation
et de remplissage de la base de données, peut faire intervenir des modes d’affichage différenciés dans le menu « Carte » :
Affichage en « Mosaïque » ; Affiche en « Cascade ».
CREER DES OBJETS GRAPHIQUES
PENSER A RENDRE LA COUCHE DE NUMERISATION MODIFIABLE (« Contrôle des Couches »).
RAPPEL : SUR UNE COUCHE D’INFORMATION, ON AJOUTE UNIQUEMENT DES ELEMENTS GEOGRAPHIQUE DE MEME TYPE :
Pour une table de polygones : ; ; ;
Pour une table linéaire : ; ;
Pour une table ponctuelle : La suppression des objets est disponible en sélectionnant un objet et en appuyant sur les touches « Suppr »
ou « Retour » du clavier.
Lorsque la numérisation est terminée : Décocher la case « Modifiable » dans le « Contrôle des Couches » Enregistrer la table si cela n’a pas déjà été fait
o « Fichier », « Enregistrer Table » [CTRL+E] ou o « Fichier », « Enregistrer la Table sous » pour enregistrer une copie de sauvegarde.
CONSEIL
Penser à faire des sauvegardes régulières afin de minimiser les risques de perte du travail en cas d’erreur ou de plantage du matériel informatique.
MODIFIER DES OBJETS GRAPHIQUES Dresser une Carte d’Occupation des Sols fait intervenir un grand nombre d’objets en fonction des règles
méthodologiques préalablement définies, mais aussi un risque d’erreur important lors de la numérisation et du tracé des polygones. Au lieu de supprimer simplement un objet graphique lorsque l’on s’est trompé, MapInfo propose une série de manipulations et d’outils qui permettent de corriger les erreurs de dessin. LA SELECTION MANUELLE DES OBJETS GRAPHIQUES ET DE LEURS ATTRIBUTS
La modification des données attributaires se fait toujours en lien avec les objets géographiques correspondants. La sélection d’un objet sur une carte entraîne la sélection de son entité attributaire dans le tableau de données.
Dans MapInfo, la sélection se matérialise de deux manières :
Sous la forme de hachure rouge sur la carte pour l’objet sélectionné (table graphique)
Sous la forme d’un carré noir devant la ligne coïncidant à l’objet sélectionné (table attributaire)
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
42
La sélection de l’objet dans la fenêtre « Carte » entraîne la sélection de la ligne de l’objet et de ses attributs
dans la fenêtre « Données ».
MapInfo propose différentes options de sélection manuelle :
Sélection d’objets dans les fenêtres
Outil pointeur et curseur par défaut Sélection par Rectangle Sélection d’objets dans un rectangle
Sélection par Distance Sélection d’objets dans un cercle
Sélection par Polygone Sélection d’objets dans un polygone
Sélection par Forme Libre Sélection d’objets dans une forme quelconque
Tout désélectionner dans la sélection
courante
Inverser la sélection courante Sélection dans un graphique
LES OPERATIONS D’AGREGATION DES DONNEES
Les opérations d’agrégation des données sont des manipulations graphiques qui permettent de modifier le dessin grâce à la définition d’une « Cible » et d’un « Pochoir » :
La « Cible » désigne le ou les objets qui subissent les modifications ; Le « Pochoir » désigne le ou les objets qui orientent les modifications.
La sélection d’une « Cible » et d’un « Pochoir » apparaît de manière différenciée :
Sous la forme de hachure rouge sur la carte pour l’objet sélectionné comme « Cible ».
Sous la forme d’un damier rouge sur la carte pour l’objet sélectionné comme « Pochoir ».
La correction des objets est une étape indispensable du travail afin de rendre la Table propre. Cela nécessite de faire attention à ce que tous les objets soient parfaitement coalescents entre eux et que la somme des parcelles identifiées au sein du périmètre soient égales à la superficie totale de la zone d’étude.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
43
TRACER DES DELIMITATIONS PARFAITES o Dessiner attentivement les limites de l’objet identifié à l’intérieur d’un périmètre (exemple de
la zone d’étude) et grossièrement à l’extérieur (1). o Sélectionner le polygone qui vient d’être créé (couche d’occupation des sols) o Définir une « Cible » dans le menu « Objets » (2). o Revenir à la carte et sélectionner le périmètre d’étude comme cible. Noter que les deux
polygones sont sélectionnés, mais que le figuré de sélection est différent. Le premier prend la forme d’un damier et le second la forme figurative de la sélection classique, soit des hachures sur la figure sélectionnée.
o Retourner dans le menu « Objets » et sélectionner l’option « Supprimer extérieur ». Cette option correspond à la suppression de la partie du polygone dessinée à l’extérieur de celui qui a été défini comme pochoir, soit le périmètre d’étude (3).
1 2 3
TRACER DES OBJETS PARFAITEMENT COALESCENTS o Dessiner les contours de l’objet identifié à l’extérieur du polygone voisin et grossièrement à
l’intérieur de manière à le fermer (1). o Sélectionner le polygone qui vient d’être créé (couche d’occupation du sol) o Définir une « Cible » dans le menu « Objets » (2). o Revenir à la carte et sélectionner le périmètre d’étude comme cible. Noter que les deux
polygones sont sélectionnés, mais que le figuré de sélection est différent. Les deux polygones sont sélectionnés(2).
o Retourner dans le menu « Objets » et sélectionner l’option « Supprimer intérieur ». Cette option correspond à la suppression du polygone dessiné à l’intérieur de celui qui a été défini comme pochoir, soit le polygone voisin (3).
1 2 3
EVIDER UN POLYGONE : Dans certains cas de figures, certains objets identifiés sont situés au cœur d’un objet spatial plus important (cas d’un plan d’eau au milieu d’une parcelle agricole…). Il convient donc de supprimer des grands polygones la surface des plus petits compris dedans.
o Dessiner les contours de l’objet identifié et situé à l’intérieur d’un plus grand polygone (1). o Sélectionner le plus grand polygone o Définir une « cible » dans le menu « Objets » (2). o Revenir à la carte et sélectionner le petit polygone comme cible. Les deux polygones sont
sélectionnés (2). o Retourner dans le menu « Objets » et sélectionner l’option « Supprimer intérieur ». Cette
option permet de supprimer le plus petit polygone sélectionné de l’intérieur du plus grand (3).
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
44
1 2 3
ASSEMBLER DES OBJETS ENTRE EUX : L’assemblage d’objets spatiaux entre eux intervient lorsque deux polygones ont été dessinés alors qu’ils sont caractérisés par la même occupation du sol (cas de deux prairies situées côte à côte). Il convient dès lors d’assembler les polygones entre eux pour qu’ils n’en forment qu’un.
o Dessiner les contours des objets identifiés (1). o Sélection du premier polygone. o Définir une « cible » dans le menu « Objets » (2). o Revenir à la carte et sélectionner le second polygone comme cible. Les deux polygones sont
sélectionnés (2). o Retourner dans le menu « Objets » et sélectionner l’option « Assembler ». Cette option
permet de regrouper plusieurs objets cartographiques distincts en une seule entité (3).
1 2 3
2
LORS DE CHAQUE OPERATION DE MODIFICATION DES OBJETS, IL FAUT SELECTIONNER LA « METHODE » D’AGREGATION DES DONNEES DANS LA FENETRE « AGREGATION DES DONNEES ».
La fusion des objets offre plusieurs options d’agrégation :
Somme Cumulation des valeurs contenues dans les champs des objets d’origine afin de fournir un total placé dans le champ du nouvel objet
Moyenne Calcul de la moyenne des champs des objets d’origine
Moyenne pondérée
Calcul par affectation d’un facteur de pondération à chaque valeur pendant le calcul des moyennes
Valeur Valeur spécifique dans le champ du nouvel objet
Aucune Conserve la valeur de l’objet cible dans un nouvel objet
La suppression ou le découpage fait apparaître d’autres options de d’agrégation des données.
Blanc Suppression de la valeur initiale de l’objet
Valeur Conserver la valeur initiale de l’objet cible
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
45
Dans les deux cas, il est possible de ne déplacer aucune donnée en activant la case
L’assemblage de deux polygones entre eux intervient à la fois sur la base graphique et sur la base attributaire
FUSIONNER DES OBJETS : L’option « Fusion » permet de modifier des données géographiques pour créer de nouveaux objets cartographiques contenant des données se rapportant à un groupe.
o Dessiner les contours des objets identifiés (1). o Sélection du premier polygone. o Définir une « cible » dans le menu « Objets » (2). o Revenir à la carte et sélectionner le second polygone comme cible. Les deux polygones sont
sélectionnés (2). o Retourner dans le menu « Table » et sélectionner l’option « Fusionner des objets depuis une
colonne… ». Cette fonction regroupe les objets. Elle affiche des objets cartographiques fusionnés qui étaient auparavant des entités isolées (3).
1 2
o La fenêtre Fusion d’Objets apparaît.
Il faut à présent indiquer la colonne qui contient les informations de regroupement par rapport à la colonne de groupement, et enfin il faut indiquer où vont être crées les objets fusionnés. Il est possible de créer une nouvelle table, contenant uniquement les objets fusionnés ou les créer en ajout dans la table existante.
o Indiquer au logiciel la méthode d’agrégation des données.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
46
Une fois que l’opération de Fusion est effectuée, regarder attentivement la structure de la table. Le choix des options de la commande de fusion a privilégié la création d’objets fusionnés sur la couche d’Occupation des Sols, soit la table POS_Cadaujac.TAB. Dès lors, la section concernée par la fusion contient trois objets cartographiques sur la base attributaire : les polygones 1 et 2, base de la création de l’objet fusionné, et l’objet fusionné qui recouvre les deux précédents (1).
1
2
Afin de respecter les règles de construction de la Carte d’Occupation des Sols, il est possible de Supprimer les anciens polygones pour ne garder que celui qui est intéressant, en l’occurrence l’objet fusionné (2).
FUSIONNER DES OBJETS ISSUS DE COUCHES EXTERNES
La création de secteurs d’objets fusionnés est une manipulation pouvant intervenir avec des couches de données externes. L’opération de fusion permet de créer des secteurs en fusionnant plusieurs petits polygones pour en créer un de taille plus grande11 (ex. : cas traité ci-après fusion des treize communes composant la CdC Montesquieu pour obtenir le zonage d’action administrative de cette intercommunalité).
NE PAS OUBLIER QUE LORSQUE L’ON ASSEMBLE DES OBJETS, LES DONNEES ASSOCIEES AUX POLYGONES (LES COMMUNES…) SONT EGALEMENT ASSOCIEES ELLES-AUSSI. SI L’ON ASSEMBLE DES OBJETS SANS AGREGER LES DONNEES QUI LEUR CORRESPONDENT, LES DONNEES SERONT DEFINITIVEMENT PERDUES.
FUSION D’OBJETS SELECTIONNES : La fusion d’objets sélectionnés est disponible dans le menu « Objet
– Assembler ». Lorsque cette option est sélectionnée, le logiciel exécute deux opérations : o Il assemble géographiquement les objets sélectionnés. Le nouvel objet représente l’union
géographique des objets d’origine. Si les treize communes de la CCM sont sélectionnées, le logiciel les regroupe en un seul objet, et les limites séparant chaque polygone disparaissent ;
o Il exécute une opération d’agrégation des données, c’est-à-dire qu’il calcule les valeurs des colonnes du nouvel objet en effectuant la somme ou la moyenne des attributs associés aux objets initiaux.
11 Fusion des communes du PNRLG afin d’obtenir un polygone plus grand définissant la zone d’action administrative du PNRLG, sélection des communes constituant le PNRLG Zonage_COM_PNRLG_FLA.TAB et enregistrement Zonage_PNRLG_FLA.TAB.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
47
FUSION D’OBJETS DEPUIS UNE COLONNE : La fusion des objets cartographiques associés à leurs valeurs attributaires fait intervenir la « Fusion d’objet depuis une colonne… » (déjà introduit ci-avant), car il convient d’avoir des informations de regroupement, c’est-à-dire en fonction d’une modalité commune, qui est le Code_Canton.
La fonction Fusionner est disponible dans le menu « Table – Fusionner des objets depuis une colonne… ». La fenêtre « Fusion d’Objets » apparaît. Il convient de choisir les bonnes options :
o « Fusionner les objets » : choisir la table dans laquelle il faut aller chercher l’information (ici ComCDC_Montesquieu.TAB résultat de la sélection à l’échelle de la CdC) ;
o « Grouper par la colonne » : permet de définir la colonne par laquelle les objets vont être regroupé (ici Code_Canton) ;
o « Mettre le résultat dans la table » : Placer la fusion dans la table existante (ici ComCdC_Montesquieu.TAB) ou dans une Nouvelle Table = <Nouveau>. Le but étant ici de créer le zonage de l’intercommunalité, choisir l’option « Nouveau ».
Voulant fusionner tous les secteurs couverts par l’intercommunalité en un secteur unique, il convient de sélectionner la colonne « Code_Canton » dans la fenêtre déroulante « Grouper par la colonne ». Le logiciel va ensuite procéder à la fusion de l’ensemble des enregistrements en les associant au même représentant : le Code du canton 27.
Une fois que les options sont sélectionnées poursuivre en cliquant sur Suivant. La boîte de dialogue « Nouvelle table » s’affiche.
CREER UNE TABLE OU SE SERVIR DE LA STRUCTURE D’UNE TABLE EXISTANTE La boîte de dialogue « Nouvelle Table » est la première étape pour
créer une nouvelle couche d’information sous MapInfo. Mais avant de « Créer » la table, le réglage de certaines options est indispensable à ce stade du travail.
« Créer une nouvelle table » « Ouvrir une nouvelle fenêtre Données » : permet d’ouvrir une
nouvelle fenêtre « Données » lors de la création de la table ; « Ouvrir une nouvelle fenêtre Carte » : permet d’ouvrir une
nouvelle fenêtre « Carte » ; « Ajouter à la fenêtre active » : permet d’ajouter la création à
la couche d’information active ; « Structure » « Créer… » : permet de créer manuellement la structure d’une
table en ajoutant un certain nombre de champs en fonction du nombre d’attributs et en choisissant la nature des attributs qui figureront dans la table (cas de la création de la table de numérisation, etc.) ;
« Utiliser comme modèle de structure la table » : permet de se servir de la structure d’une table déjà existante.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
48
Pour créer la table dans laquelle va figurer la couche d’information contenant la zone occupée par l’intercommunalité, soit la fusion des treize communes, il convient de choisir :
o D’ « Ouvrir une nouvelle fenêtre Données » ; o D’ « Ouvrir une nouvelle fenêtre Carte » ; o De sélectionner la structure de la table
ComCdC_Montesquieu.TAB servant de modèle pour la création de la table Lim_CDC_Montesquieu.TAB.
La boîte de dialogue « Structure de la nouvelle table » apparaît.
A ce stade, la structure de la table est déjà prête, grâce à l’utilisation d’une base existante comme modèle de structuration. Il ne sert donc à rien de modifier les types de données. Cette étape permet en définitive de nettoyer la table de tous les champs qui sont inutiles grâce à la commande « Supprimer Champ ».
Il convient pour cela de réfléchir aux champs qui sont utiles pour créer le polygone intercommunal.
Une fois que les modalités inutiles ont été
supprimées, cliquer sur « Créer… » pour valider les choix et afficher la nouvelle table. MapInfo invite
l’utilisateur à sauvegarder nouvelle table. Choisir un nom (par défaut « Sans_Nom.TAB ») et un chemin d’accès appropriés (par défaut « Mes Documents ») (exemple : Lim_CdC_Montesquieu.TAB).
ATTENTION, TOUTE SUPPRESSION EST DEFINITIVE DANS LE CADRE DE LA SESSION DE TRAVAIL. POUR REVENIR EN ARRIERE, IL FAUT ANNULER LA CREATION DE LA STRUCTURE ET RECOMMENCER LA MANIPULATION « FUSION » DEPUIS LE DEBUT.
Une fois l’enregistrement effectué, la boîte de dialogue « Agrégation des Données » apparaît avec les champs sélectionnés (1). A ce stade il est nécessaire d’indiquer à MapInfo la méthode d’agrégation des données à utiliser (2).
1 2
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
49
MapInfo propose quatre méthodes d’agrégation des données : « Blanc », « Valeur », « Somme » et « Moyenne ». Dans les cas de figure « Somme » et « Moyenne », il convient d’activer dans un premier temps la case « Valeur », sélectionner ensuite dans l’ascenseur la colonne « source » (celle de la base modèle) correspondant à la colonne « Destination » (celle de la nouvelle base). Le choix de la colonne « source » permet de désactiver la case « Valeur » et d’activer les fonctions arithmétiques « Somme » et « Moyenne ».
CHEMINEMENT POUR LA VARIABLE « POPULATION » : La variable « Population » est une donnée quantitative absolue, c’est-à-dire une donnée sur laquelle il est possible de procéder à des opérations arithmétiques pour calculer par exemple la somme des habitants de la CCM.
o L’affichage par défaut du logiciel au premier stade sélection la méthode « Blanc » (1) ; o La sélection de la case « Valeur » active une case permettant d’entrer les valeurs que l’on
désire lorsque la modalité « Aucun » est définie (2).
1 2
o Le but n’étant pas d’entrer des valeurs démographiques au hasard, il est possible de sélectionner la modalité « Population » de la base « source » dans l’ascenseur où est visible la modalité « Aucun » (3) ;
o Une fois que le champ « Population » de la base « source » est sélectionné, il apparait dans la catégorie « Champ source » (4) ;
o Il faut ensuite choisir la méthode d’agrégation « Somme » en activant la case afin de pouvoir additionner les populations des communes du « Champ source » provenant de la table ComCdC_Montesquieu.TAB à « Destination » du champ « Population » de la nouvelle table Lim_CdC_Montesquieu.TAB. La méthode d’agrégation des données change dans le tableau récapitulatif en passant d’une méthode « Valeur » à une méthode « Somme » (5).
3
4 5
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
50
Pour le champ « Superficie », la méthode est équivalente à celle du champ « Population » puisqu’il s’agit de faire la somme des superficies communales contenues dans le « Champ source » de la base « ComCdC_Montesquieu.TAB » à « Destination » du champ « Superficie » de la nouvelle table Lim_CdC_Montesquieu.TAB, afin de calculer la superficie totale de la CdC Montesquieu. Pour les autres champs, il existe deux possibilités :
o Se servir des valeurs contenues dans les champs « source » à « Destination » des champs « cible » de la nouvelle table, afin de remplir les cases de la table attributaire sans erreur ;
o Entrer directement les valeurs manuellement. Cette méthode est pratique lorsque la base fournie contient des manques (cas des champs « Nom_Département » et « Nom_Région ») (6 et 7).
6 7
PRENDRE GARDE A LA NATURE INTRINSEQUE DES DONNEES GEOGRAPHIQUES QUI SONT SOIT QUANTITATIVE (ABSOLUE OU RELATIVE), SOIT QUALITATIVE (NOMINALE OU ORDINALE).
DECOUPER DES OBJETS L’option de découpage des objets géographiques permet de découper l’objet cible en portion plus petites,
en utilisant un autre objet comme pochoir. Le découpage permet de diviser un grand secteur agricole en parcelles plus petites par rapport à un autre objet géographique identifié sur les images.
SUPPRIMER DES OBJETS
o Sélectionner les objets cartographiques 1 et 2 sur la base attributaire (cas de la fusion).
o Appuyer simplement sur la touche « Suppr » ou « Retour arrière » du clavier.
Les objets cartographiques sont supprimés à la fois sur la base graphique et la base attributaire. L’ancien emplacement des objets supprimés est matérialisé par des lignes grisées.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
51
RENDRE UNE TABLE PROPRE Le caractère primordial de tout travail, notamment sous forme numérique est d’arriver à un rendu net. Les
opérations de modification des polygones produisent un certain nombre de lignes grises qui correspondent aux lignes supprimées suite à des modifications ou à des suppressions d’objets.
Pour effacer les lignes grisées, il faut compacter les tables.
o Sélection de l’option « Gestion Tables » dans le menu « Table », puis « Compacter Table… ». o La fenêtre « Compacter Table » apparaît. Il faut sélectionner la table « à nettoyer » et
sélectionner l’option de nettoyage de la table choisie : Compacter les données permet de nettoyer la base de données attributaire ; Compacter les Objets Géographiques permet de nettoyer la base graphique ; Compacter les Deux permet de nettoyer à la fois la base de données attributaire et
la base graphique.
o Valider le compactage. MapInfo affiche automatiquement un message pour inviter à sauvegarder la table. Une fois la sauvegarde effectuée, MapInfo ferme automatiquement la couche compactée, qu’il faut ouvrir de nouveau.
CREER DES TAMPONS Les Zones Tampons désignent les transformations graphiques obtenues sur des objets géographiques suite
à une analyse de proximité. Cet outil particulièrement intéressant peut être utile pour représenter des objets dont la taille est variable. Les tampons sont définis en fonction d’une distance précise ou peuvent être générés pour un ensemble d’objets à partir de valeurs attribuées aux objets cartographiques (sélection d’un champ en particulier). Les Zones Tampons obtenues prennent la forme d’une enveloppe entourant l’objet sélectionné et représentant la distance spécifiée autour de l’objet (Valeur du Rayon de l’enveloppe x 2) Exemple d’application sur la représentation du réseau bocager de Cadaujac
Le bocage représente un point important qui peut figurer sur la nomenclature enrichie de la Carte d’Occupation des Sols. Comment représenter le bocage de Cadaujac ?
Il existe deux grandes possibilités : Raisonner en fonction de l’emprise au sol du réseau ; Représenter les haies comme un réseau linéaire.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
52
La première solution consiste à représenter l’interface entre la haie et la parcelle comme limite externe de
la parcelle agricole, et d’appliquer un polygone unique pour le poste du réseau bocager. Cette manipulation nécessite de corriger les erreurs liées aux recouvrements des objets cartographiques « parcelle » avec le polygone « bocage ».
o Dessiner les contours des objets identifiés (parcelles). o Dessiner un polygone unique ou plusieurs en fonction de l’organisation du périmètre d’étude. o Le(s) polygone(s) « bocage » recouvre(nt) les polygones « parcelle ». o Sélectionner le plus grand polygone. o Définir une « cible » dans le menu « Objets ». o Revenir à la carte et sélectionner les petits polygones comme cible. L’ensemble des
polygones sont sélectionnés. o Retourner dans le menu « Objets » et sélectionner l’option « Supprimer intérieur ». Cette
option permet de supprimer les polygones « parcelle » sélectionné de l’intérieur du plus grand polygone « bocage » (1).
La deuxième solution consiste à créer un réseau de polylignes reprenant le tracé du réseau bocager (2).
ATTENTION, IL S’AGIT D’UNE NOUVELLE COUCHE D’INFORMATION.
La troisième solution consiste à créer des zones tampons en se servant du réseau de polylignes tracé précédemment (3).
3 Pour créer des tampons :
o Sélectionner les objets cartographiques à modifier. o Sélectionner l’option « Tampon » dans le menu « Objets ». o La boîte de dialogue Tampons apparaît. o Définir les mesures de la zone tampon.
Représenter le bocage en fonction de son emprise au sol (couche polygones) (1).
1
Représenter le bocage par un réseau linéaire (couche polylignes) (2).
2
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
53
o Choisir la Valeur de la Zone Tampon. La Valeur correspond à la mesure du rayon que l’on veut donner à la zone tampon (exemple = 10).
(Si l’on ne veut pas attribuer de valeur arbitraire et si l’objet d’étude le permet, il est possible de sélectionner une colonne pour calculer la taille du buffer).
o Choisir l’unité de mesure de la Zone Tampon (exemple : mètres)
o Choisir le degré de Lissage. Le nombre de segments par cercle correspond à la précision de la Zone Tampon (Valeur minimale = 12). Plus la valeur est importante et plus le temps de création est long.
o Choix de création des tampons : Un seul tampon pour chaque objet ; Un tampon pour tous les objets (création
d’un polygone unique) o Choix du mode de calcul : Sphérique (référence à
la surface courbe de la terre) ou Cartésien (référence à la projection sur une surface plane)
ATTENTION : LA MODIFICATION DES OBJETS SPATIAUX ENTRAINE UNE MODIFICATION DE LEURS ATTRIBUTS DANS LA FENETRE GRAPHIQUE ET DANS LA BASE DE DONNEES ATTRIBUTAIRES. Ces opérations dites d’ « Agrégation des Données » opèrent des modifications sur la structure. Il convient donc de sélectionner correctement les champs pour opérer une modification correcte de la base. LES OUTILS DE TRACAGE ET DE CORRECTION
L’outil « Fusion » [FUS] à activer en appuyant sur la touche [F] active le magnétisme des points de calage des polygones. L’outil de sélection basique se transforme. Lorsque l’on déplace le curseur sur un nœud, l’outil de sélection se transforme en matérialisant une crois indiquant exactement la position du nœud.
L’outil « Autotrace » [AUTOTRACE] à activer en appuyant sur la touche [T] active le magnétisme des
lignes en passant par chacun des nœuds d’un polygone. Lorsque l’outil « Autotrace » est activé, le survol des limites de la zone d’étude fait apparaître une fine ligne appliquée au tracé du polygone et passant par tous les nœuds qui ont été créés pour délimiter ce périmètre (1). Lorsque l’ « Autotrace » est désactivé le magnétisme est altéré et le traçage automatique ne fonctionne plus (2).
1 2
CONSEIL Penser à activer ces deux outils pour réaliser la numérisation représente un gain de temps assez important
et garantie la coalescence des polygones entre eux. Pour s’en assurer, regarder dans la barre d’état, si « Fusion » et « Autotrace » sont activées.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
54
AJOUTER DES NŒUDS AUX POLYGONES DEJA TRACES POUR CORRIGER RECOUVREMENTS ET LACUNES Il est possible de modifier manuellement le tracé des polygones pour corriger des erreurs de recouvrement
ou de manque. A une échelle très large, il est assez difficile de remarquer ces erreurs, il faut très souvent zoomer car les erreurs sont quasi imperceptible dans une fonction de recentrage automatique de la carte. Il est également possible de modifier les paramètres d’affichage à sa guise pour identifier les secteurs à corriger.
Zones de lacune Zones de recouvrement
Les propriétés d’affichage du style des polygones disponible dans le « Contrôle des Couches » permettent de jouer sur les nuances en affichant la trame des polygones de différente façon.
L’affichage de la trame des polygones par contraste avec un fond (image satellite) permet de découvrir les lacunes. La sélection des objets et l’affichage de la trame par contraste permet de découvrir les facteurs de recouvrement.
L’affichage de la trame des polygones par transparence permet de remarquer les facteurs de recouvrement. La sélection des polygones affiche la trame de sélection et permet d’afficher les facteurs de recouvrement.
FONCTION MANUELLE
Le format vectoriel permet de modifier les objets tracés à volonté. MapInfo dispose d’un outil permettant
de modifier les objets et d’ajouter au besoin de nouveaux nœuds . L’activation de l’outil « Modifier Objets » dans la barre de « Dessins » permet d’afficher les nœuds des polygones (2), et permet d’ajouter de nouveaux nœuds aux objets cibles.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
55
1 2
Le comblement des vides ou la correction des recouvrements des polygones intervient par sélection des nœuds dans un premier temps et par glissement des nœuds existants dans un second temps, pour corriger les zones problématiques. Il peut être intéressant d’ajouter de nouveaux nœuds pour corriger les erreurs, lorsqu’il n’existe aucun moyen de raccorder le nœud sélectionné à un nœud existant.
1 Dans ce cas de figure, la sélection du polygone en bas à droite fait apparaître ses nœuds respectifs (1).
2 La sélection du polygone supérieur ne fait apparaître aucun point de raccordement possible, hormis le nœud à l’extrême droite. Il faut créer un point de raccordement dans la zone signalée afin de recouvrir le manque (2).
3 Cliquer sur l’outil « Ajouter Nœud » et cliquer sur la fenêtre « Carte » à l’endroit souhaité (3).
4 Effectuer ensuite la modification par glissement en sélectionnant le nœud opposé à celui qui vient d’être créé (4).
5 Le manque est comblé pour la section concernant le polygone sélectionné. Il s’agit de procéder de la même manière pour le polygone de gauche et faire glisser son sommet vers le nœud créé sur le polygone supérieur (5).
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
56
6 Le vide est comblé (6).
Pour les zones de recouvrement, il faut procéder de la même manière. Créer un nouveau nœud sur le polygone opposé (1), sélectionner un à un les nœuds opposés et les faire
glisser pour éliminer la zone de recouvrement (2 et 3)
1 2 3
FONCTION AUTOMATIQUE La fonction automatique permet de créer des nœuds manquants, aux points d’intersection entre la cible et
le pochoir. o Sélectionner le premier polygone (1). o Définir une « cible » dans le menu « Objets ». o Revenir à la carte et sélectionner le second polygone comme cible. Les deux polygones sont
sélectionnés (2). o Retourner dans le menu « Table » et sélectionner l’option « Ajouter Nœuds ». Cette fonction
ajoute de nouveaux nœuds à l’intersection entre la cible et le pochoir. (3) o Sélectionner le nœud à déplacer pour combler le vide (4). o Procéder par glissement sur le nœud afin de corriger le recouvrement (5).
1 2
3 4
5
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
57
CONSEIL Il est possible d’afficher les nœuds de manière permanente lors du
traitement graphique. Pour cela, aller dans les paramètres d’affichage de la couche d’occupation des sols, via le « Contrôle des Couches » et activer l’option « Afficher les Nœuds ». Il est également possible d’afficher les « Centroïdes » des polygones et le « Sens des Lignes ».
VERIFICATION DES REGIONS
Le logiciel MapInfo dispose d’une fonction qui permet de « Vérifier les objets régions » afin de détecter et corriger des particularités géométriques pouvant générer des résultats incorrects lors de traitements ultérieurs. Cette fonction permet de vérifier :
Les zones de recouvrement ; Les lacunes ; Les auto-intersections.
La figure ci-contre présente la numérisation d’objets
géographiques avec un grand nombre d’erreurs (recouvrements et lacunes)
Sélectionner les objets géographiques à contrôler. Il est possible de jouer avec les styles de présentation pour voir les erreurs en alternant une trame vide (1) et une trame pleine (2). Les effets de transparence avec l’image satellite permettent de faire ressortir les lacunes, tandis que l’affichage des sélections laisse entrevoir les recouvrements.
1 2
Sélectionner l’option « Vérification des Régions… » dans le menu « Objets ». La boîte de dialogue « Vérification des objets » apparaît.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
58
1 2
Activer ou désactiver les options en cochant les différentes cases pour effectuer les opérations suivantes (1) :
o « Activer la détection des Auto-intersections » (activation par défaut) ; o « Activer la détection de Recouvrements » ; o « Activer la détection des Lacunes ».
Possibilités de modifier le style des polygones (trame, couleur, ligne…). Modifier les options en fonction des besoins (2).
Les zones de recouvrement et les lacunes apparaissent sous forme de sélections et/ou bien sous les formes colorées définies par les modifications de style :
Jaune pour les trois zones de recouvrements ; Bleu foncé pour les six lacunes.
La vérification identifie les objets à corriger et les individualise sous forme d’objets individuels dans la base de données attributaire.
ATTENTION, CETTE OPTION NE PERMET PAS DE CORRIGER LES ERREURS. ELLE PERMET SEULEMENT DE DETECTER LES ERREURS EN LES AFFICHANT A L’ECRAN.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
59
La correction des erreurs s’effectue grâce à la fonction « Corrections ». Sélectionner tous les objets à corriger. Cliquer sur l’option « Corrections » dans le menu « Objets ». La boîte de dialogue « Correction d’Objets » apparaît.
Cocher les options en fonction des objets à corriger (dans le cas de cet exemple les deux options sont
traitées simultanément). Les erreurs sont corrigées.
ATTENTION, LE VERIFICATION ET LA CORRECTION DES OBJETS NE PEUT INTERVENIR QUE LORSQUE LES OBJETS GEOGRAPHIQUES SONT FERMES. SINON UN MESSAGE D’ERREUR APPARAIT.
ATTENTION, LES CORRECTIONS APPORTEES NE RETABLISSENT PAS LA REALITE DES ENTITES IDENTIFIEES. Au début de cette manipulation, les objets se recouvraient et il existait des vides. Les zones de recouvrement et les lacunes deviennent des objets graphiques et attributaires à part entière sur les fenêtres « Carte » et « Données ». Autrement dit, la correction individualise les erreurs identifiées et crée des objets distincts :
Les objets jaunes caractérisant les zones de recouvrement entre deux ou plusieurs polygones sont découpés pour former des polygones individuels ;
Les objets bleus caractérisant les vides entre les polygones deviennent des objets matériels à part entière alors qu’ils n’étaient pas sélectables auparavant.
Il convient d’opérer des opérations d’agrégation des données pour assembler les parties et/ou modifier manuellement les objets qui doivent l’être.
NUMERISER ET RENSEIGNER SIMULTANEMENT La photo-interprétation, la numérisation et le remplissage de la base de données doivent intervenir en
même temps. Lorsqu’un objet est identifié, il doit être numérisé et la ligne lui correspondant doit être complétée.
Deux possibilités existent : Renseigner directement la base de données en passant de la fenêtre « Carte » à la fenêtre
« Données ».
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
60
CONSEIL Sélectionner l’option d’affichage des fenêtres en mode « Mosaïque » permet de faciliter le passage de l’une
à l’autre des fenêtres.
Utiliser l’outil « Informations » , permet de faire apparaître la boîte de dialogue « Infos » représentant un affichage restreint correspondant à la sélection graphique et attributaire. Cette petite fenêtre permet de disposer des informations dans la fenêtre « Carte » et ce, uniquement pour le l’objet sélectionné
PENSER A FAIRE DES SAUVEGARDES REGULIEREMENT.
La combinaison interprétation, numérisation et remplissage représente un investissement assez important, surtout si la base de données à renseigner est très détaillée, en nombre de champs (ex. : quatre champs pour le cas de la base d’occupation des sols) et en nombre d’objets. Il faut rappeler qu’à chaque objet identifié correspond une ligne dans le tableau de données. Or le remplissage de toutes les colonnes (ID, Code_CLC, Type_CLC, Area…) peut s’avérer extrêmement long. Il est possible de gagner du temps en renseignant uniquement la colonne des Codes_CLC et appliquer une mise à jour automatique pour les trois autres champs de la base de données.
METTRE A JOUR AUTOMATIQUEMENT DES COLONNES L’application de la mise à jour automatique porte donc sur les colonnes « Type_CLC », « ID » et « Area ».
MISE A JOUR DE LA COLONNE « TYPE_CLC » A L’AIDE DES CODES CLC
Créer une nouvelle table qui contiendra le codage des objets spatiaux identifiés. Le codage permet d’établir une correspondance entre les codes d’occupation du sol et les libellés des types.
Créer une nouvelle table « Fichier – Nouvelle Table » [CTRL+N], la fenêtre « Nouvelle Table » apparaît. Changer les options de configuration
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
61
o Sélectionner « Ouvrir une nouvelle fenêtre de données » pour créer une nouvelle base attributaire
o Désélectionner « Ouvrir une fenêtre Carte » (l’ajout d’une nouvelle fenêtre carte n’est pas nécessaire car cette table sert uniquement à mettre à jour une base de donnée existante qui possède déjà une base graphique)
o Sélectionner « Ajouter à la fenêtre active » o A ce stade, au lieu de créer une nouvelle structure de table, il est possible de se servir de la
structure existante de la table d’occupation des sols à mettre à jour. Sélectionner « Utiliser comme modèle de structure de table » ainsi que la table d’occupation des sols « POS_Cadaujac.TAB ».
La boîte de dialogue « Structure de la Nouvelle Table » apparaît. Supprimer les champs « ID » et
« Area » qui sont inutiles pour cette opération.
Enregistrer la table avec un nom (« Legende_Carte_OS.TAB ») et dans un dossier de destination approprié. Cliquer sur « Créer ».
SI LES CHAMPS INUTILES « ID » ET « AREA » NE SONT SUPPRIMER A CETTE ETAPE, IL EST POSSIBLE D’Y REVENIR AU COURS D’UNE SESSION DE TRAVAIL.
MODIFIER LA STRUCTURE D’UNE TABLE
La « Modification de la structure de la Table » peut intervenir à n’importe quel moment du travail, si l’utilisateur a besoin d’ajouter de nouvelles colonnes à la base de données attributaires ou des modifications sur la structure de la donnée en elle-même. Cette option est disponible à partir du menu « Table », « Gestion des Tables ». Noter qu’il est également possible de renommer, de supprimer une table et les fichiers qui lui sont associés
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
62
LES MODIFICATIONS APPORTEES A LA STRUCTURE DE LA TABLE SONT IMMEDIATES ET IRREVERSIBLES.
La nouvelle base de données apparaît avec seulement deux
champs possédant la même structure que la base attributaire d’occupation des sols.
Une fois la table créée, renseigner manuellement les colonnes à l’aide des codes et des libellés caractérisant les objets identifiés à partir des images satellites et des autres supports d’informations, en créant une ligne pour chaque code, c'est-à-dire pour chaque occupation du sol différente.
Clic droit dans la fenêtre de données et sélection de l’option « Nouvelle Ligne » ou [CTRL+Y] (1). Remplir la ligne avec le code et son libellé (2).
Répéter l’opération autant de fois que nécessaire. Enregistrer la table.
Maintenant, il faut mettre à jour la table d’occupation des sols avec les données de la table « Légende_Carte_OS.TAB ».
Dans le menu « Table », sélectionner l’option « Mettre à jour Colonne ». La boîte de dialogue « Mettre à jour Colonne » apparaît.
1
2
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
63
L’opération de mise à jour fait intervenir deux tables attributaires. Il s’agit d’utiliser la première comme une table source servant à alimenter la table cible. Pour cela, il faut définir une « condition de jointure ». La jointure dans MapInfo désigne un procédé qui consiste à créer une relation réciproque permettant de faire le lien entre la table Légende et la table d’occupation des sols. Il faut trouver un point commun entre les deux tables : le Code_CLC.
Sélectionner la « Table à mettre à jour », soit la table cible (table d’occupation des sols) et la table qui
va servir à la mise à jour, soit la table source (table légende).
Définir la Jointure, en cliquant sur « Jointure ».
La boîte de dialogue « Définir Jointure » apparaît. Sélectionner la condition de jointure ou point de correspondance entre les deux tables : le Code_CLC pour la table POS_Cadaujac.TAB et la table Legende_Carte_OS.TAB.
Sélectionner le mode de calcul en
fonction des valeurs de la colonne « Type_CLC »(variables qualitatives) de la colonne et non du « Count » (pour les variables quantitatives)
OK.
MISE A JOUR DE LA COLONNE « ID »
Dans le menu « Table », sélectionner l’option « Mettre à jour Colonne ». La boîte de dialogue « Mettre à jour Colonne » apparaît.
La colonne « Type_CLC » est mise à jour automatiquement.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
64
Cette mise à jour diffère de la précédente, car l’opération se fait uniquement en se servant de la table d’occupation des sols sans fichier annexe. Il n’y a pas de condition de jointure à définir. La Table source est en même temps la Table cible.
Cliquer sur « Expression » pour définir la « Valeur » de mise à jour. La boîte de dialogue « Expression » apparaît. Il faut taper une expression qui permette de mettre à jour la colonne « ID ». Dans ce cas de figure, la solution est assez simple, il suffit juste de taper « Rowid » qui correspond à une fonction de numérotation automatique.
MISE A JOUR DE LA COLONNE « AREA »
Dans le menu « Table », sélectionner l’option « Mettre à jour Colonne ». La boîte de dialogue « Mettre à jour Colonne » apparaît.
Cette fonction de mise à jour correspond à s’y méprendre à l’opération de mise à jour précédente. Seule l’expression à entrer diffère.
Cliquer sur « Expression » pour calculer la superficie. Cliquer sur les « Fonctions » pour entrer l’expression de calcul de la superficie. Sélectionner « CartesianArea ». Par défaut, MapInfo résonne en « square miles ». Il suffit de remplacer « ‘‘sq mi’’ » par « ‘‘hectare’’ » afin de modifier l’unité de mesure
La colonne « ID » est mise à jour automatiquement.
La colonne « Area » est mise à jour automatiquement.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
65
IMPORTER ET OUVRIR D’AUTRES SUPPORTS
Comme tous les logiciels, les extensions de fichiers diffèrent d’un logiciel à l’autre. La démarche de méthodologique (ex. : démarche de photo-interprétation) peut être accompagnée par l’importation et l’ouverture d’autres sources d’informations qui peuvent aider à la compréhension et à l’interprétation. Il existe de nombreux sites Internet regorgeant de bases de données pouvant être utiles (ex. : IGN, PIGMA, etc.). L’importation des fichiers sous MapInfo peut s’opérer de différentes manières :
Lorsque les données externes sont disponibles au format natif de MapInfo, c'est-à-dire en .TAB ou dans un format reconnu par le logiciel (.MIF, format raster…), il suffit de les ouvrir par les voies classiques pour afficher les différentes couches d’informations.
Lorsque les données sont disponibles dans un autre format, il faut passer par le Traducteur Universel qui permet de convertir certains types de fichiers en format natif MapInfo .TAB.
Il est possible d’importer l’information géographique sous MapInfo grâce à trois formules.
OUVRIR UN FICHIER RECONNU
La première possibilité, la plus usitée consiste à ouvrir des fichiers en fonction des possibilités offertes lors de l’ouverture d’un fichier.
Menu « Fichier », « Ouvrir ».
IMPORTER / EXPORTER UN FICHIER
La deuxième possibilité consiste à importer ou à exporter des fichiers. Les fonctions d’importation ou d’exportation nécessitent un format d’échange MapInfo Interchange (.MIF).
Menu « Table » o « Importer… »
o « Exporter… »
LE TRADUCTEUR UNIVERSEL
Les données à disposition dans le catalogue de la Communauté de Communes Montesquieu ou sur le site de partage des données du CG33 sont disponibles au format « Shapefile » (.SHP), format natif du logiciel ArcGIS de ESRI.
Les fichiers ESRI se présentent et fonctionnent de la même manière que les fichiers MapInfo, c'est-à-dire sous la forme d’un quadruplet indissociable :
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
66
Extension Signification
.SHP Fichier principal équivalent ESRI de la table MapInfo
.DBF Fichier contenant la base de données attributaire
.PRJ Fichier définissant le système de projection des Shapefile
.SHX Fichier contenant l’index de la géométrie
TRADUCTEUR UNIVERSEL OU SYSTEME D’OUVERTURE CLASSIQUE ?
L’importation des fichiers .SHP peut s’effectuée par les voies classiques de l’ouverture d’un fichier. En effet MapInfo peut ouvrir le Shapefile directement (exemple de ZONE_VEGETATION.SHP). Une fois le fichier sélectionné, le logiciel demande d’enregistrer une table (ZONE_VEGETATION.TAB) et de spécifier les caractéristiques du fichier (Styles des caractères défini par défaut en « Windows US & Ouest
Europe [‘‘ANSI’’] et des polygones, et le système de projection). Une fois que le paramétrage est terminé, MapInfo analyse les objets géographiques contenus dans le ShapeFile et crée des objets MIP. Plus le nombre d’objet présent sur la table est important est plus le temps de conversion est long. Une fois la conversion terminée, les objets sont affichés sur l’environnement de travail.
Lors de la fermeture de la table, MapInfo ne propose pas de sauvegarder la table, alors que des fichiers .MAP et .ID sont crées dans le répertoire de la table sauvegardée, mais temporairement. Il faut enregistrer la table sous un autre nom, afin de pouvoir sauvegarder définitivement la la conversion. Le logiciel entame dès lors un deuxième chargement nécessaire pour savegarder définitivement la transformation.
Sinon, l’ouverture de la table va relancer le processus de conversion. Il est donc impératif, d’enregistrer la table sous un nouveau nom à chaque fois que l’on ouvre un Shapefile par cette voie, afin de figer les fichiers temporaires et ne plus avoir à faire à chaque fois la conversion des enregistrements shapefile en objets MIP.
L’oubli des sauvegardes systématiques des tables MapInfo, constitue le principal défaut de cette méthode. Il convient de faire très attention et penser à enregistrer les fichiers annexes nécessaires à la lecture de l’information géographique, sous peine de lancer plusieurs chargements pouvant être assez longs en fonction du nombre d’objets présents sur la couche. Temps de chargement renouvelé lors de la sauvegarde finale de la table MapInfo. Il est plus prudent de passer par le « Traducteur Universel » qui offre une solution plus sûre, car il invite l’utilisateur à convertir le fichier
importé et à l’enregistrer dans le format choisi dans le même temps. Il y a donc qu’un seul temps de chargement. L’avantage est qu’il conserve le système de projection du fichier
Le traducteur universel va permettre de modifier le Shapefile en Table MapInfo (exemple d’application à l’ensemble de fichiers « BATI_INDIFFERENCIE.SHP » disponible dans le répertoire de base fourni par la CCM).
Ouvrir le « Traducteur Universel » par le biais du menu « Outils ». La boîte de dialogue « Traducteur Universel » apparaît. Elle se présente en deux parties :
La « Source » correspond au format natif des fichiers externes à transformer
La « Destination » correspond au format de transformation ou de sortie, ainsi que le répertoire de destination du fichier.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
67
Sélectionner le format de fichier à importer : ESRI Shape et les fichiers à convertir. Sélectionner le format de conversion et un répertoire de destination approprié.
ATTENTION AU SYSTEME DE PROJECTION. Par défaut MapInfo sélectionne l’option « Utiliser la projection du fichier ». Si l’utilisateur n’est pas sûr du système de projection, il est possible de se référer aux métadonnées des fichiers, ou se rendre dans la « Gestion des Tables – Modifier la Structure » et sélectionner l’option « Projection » pour connaître le système du fichier ouvert.
Valider, la conversion démarre. A noter que plus le nombre d’objets est grand et plus le processus de traitement.
DANS LE CAS OU LE SYSTEME DE PROJECTION N’EST PAS DEFINI, LE RESULTAT DE L’AFFICHAGE CARTOGRAPHIQUE PEUT ETRE DESASTREUX (SUPERPOSITION FAUSSEE, DECALAGES…).
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
68
Pour s’assurer d’être dans le bon système de projection une fois la conversion effectuée, il faut vérifier la projection de la table dans l’option « Gestion des Tables – Modifier la Structure » et sélectionner l’option « Projection » pour connaître le système du fichier ouvert. Dans certains cas, l’importation n’est définie par aucun système de projection.
Pour choisir une nouvelle projection, il faut : Enregistrer la table sous. En créant une nouvelle table, le système de projection devient modifiable.
Ou Recommencer l’importation grâce au « Traducteur Universel et choisir le bon système de projection
(Système français RGF93 – France Lambert-93 dans le cas de la base de données BATI_INDIFFERENCIE.TAB).
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
69
ATTENTION DANS CERTAINS CAS, UN MESSAGE D’ERREUR SURVIENT LORS DU CHANGEMENT DU SYSTEME DE PROJECTION VIA LE TRADUCTEUR UNIVERSEL. DANS CE CAS DE FIGURE, PRIVILEGIER LA PREMIERE METHODE A LA SECONDE12.
MapInfo a créé la table BATI_INDIFFERENCIE.TAB et les fichiers associés, résultat de la conversion du
Shapefile de la BD_Topo BATI_INDIFFERENCIE.SHP.
Il est maintenant possible d’ouvrir le fichier « BATI_INDIFFERENCIE.TAB » dans la fenêtre courante de la
carte d’occupation des sols. Les couches sont parfaitement superposées.
12 L’ensemble des fichiers disponibles dans le SR « 2_Données » fournies en .SHP, ont subi une importation par le biais du traducteur universel avec une version logicielle plus récente qui garantit le transfert u système de projection contenu dans le fichier .PRJ. Il ne doit y avoir aucun problème. Néanmoins, il est envisageable dans certains cas de figures de devoir passer par le traducteur universel et l’ensemble des phases d’importation pour garantir la superposition des fichiers.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
70
OPERATIONS DE SELECTIONS
L’importation et/ou l’ouverture de données externes peuvent faire l’objet de requêtes simples ou multiples afin de sélectionner les données intéressantes dans le cadre de cet exercice. En raisonnant, à l’échelle d’un l’intercommunalité, les données à disposition ont très souvent tendance à dépasser les limites mêmes de la CCM et de la zone d’étude définie. Il est dès lors possible d’opérer différents types de requêtes pour sélectionner les données qui intéressent uniquement le périmètre d’étude, c'est-à-dire opérer un choix scalaire sur un secteur donné (ex. : sélection de la commune de Cadaujac sur la base des communes de la Gironde com_33_fla.TAB). La double nature de l’information géographique autorise trois types de sélection (AMELOT, 2009) :
A partir de l’information thématique grâce à des requêtes attributaires ; A partir de l’information graphique grâce à des requêtes spatiales A partir des deux grâce à des requêtes spatio-thématiques
REQUETE SIMPLE La requête simple permet de sélectionner des informations sur une seule couche, autrement dit une seule
table. Il existe différentes manières pour sélectionner des objets : LA SELECTION PAR CLIC est la solution la plus simple, qui peut être utilisée lorsque l’on sait ce que l’on
cherche où que l’on connaît la localisation approximative de l’objet. Cette difficulté est accrue par la problématique des échelles et de la connaissance du territoire : situer la commune de Cadaujac à l’échelle de la Gironde et à l’échelle de la Communauté de Communes n’est pas la même chose. Ce type de sélection peut s’opérer directement sur la fenêtre graphique et/ou sur la base attributaire.
CONSEIL
Utiliser l’outil « Informations » pour faire apparaître une fenêtre « Infos » qui présente le résultat de la sélection, reprenant les données de la base attributaire propre à la ligne du tableau définissant les attributs de l’objet en question. La sélection par clic est plus simple dans la base de données attributaires, car d’ordinaire les noms des communes constituent un critère de recherche très apprécié. De plus, ces modalités sont très souvent classées par ordre alphabétique, ce qui facilite la recherche pour peu que la base de données soit limitée à un cadre géographique assez restreint.
LES OUTILS DE SELECTION de la barre d’outils « Général » : ;
; ; ; ; . … LA SELECTION ATTRIBUTAIRE SIMPLE permet de sélectionner des
objets en opérant des requêtes attributaires sous forme d’expressions.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
71
o Définir une « Sélection… » dans le menu « Sélection ». La boîte de dialogue « Sélectionner » apparaît.
o Choisir la Table sur laquelle va être effectuée la requête attributaire. o Taper ou sélectionner les Critères de sélection en cliquant sur l’option « Expression » pour
faire apparaître la boîte de dialogue « Expression » permettant d’opérer des choix de requêtes.
o Jouer avec les trois ascenseurs afin de fabriquer une expression de sélection attributaire simple.
o Sélectionner la commune de Cadaujac grâce à la variable « Nom_Commune »
LES EXPRESSIONS DE SELECTION
Les expressions sous MapInfo fonctionnement comme des règles de calcul. Elles font intervenir trois types d’outils :
Colonnes Sélectionner et faire apparaître dans l’expression les colonnes de la base de données attributaire choisie lors de l’étape précédente (« com_33_fla.TAB »)
Opérateurs Les opérateurs mathématiques permettent d’opérer des opérations arithmétiques : = ; <> ; > ; < ; >= ; <= ; + ; – ; * ; / Les opérateurs logiques d’établir des relations entre les différents objets de la sélection :
AND = ET NOT = NON OR = OU LIKE = COMME
Les opérateurs spatiaux permettent d’opérer des sélections spatiales : Contains ; Contains Entire ; Within ; Entirely within ; Intersects
Fonctions Différentes fonctions permettant de calculer des surfaces, des distances… ez
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
72
CONSEIL Avant d’effectuer la moindre sélection, prendre connaissance de la structure de la base de données en
affichant la fenêtre « Données » et repérer les champs qui semblent être interessants.
FAIRE ATTENTION A LA « SYNTAXE » DE L’EXPRESSION. PENSER A VERIFIER L’ECRITURE DE L’EXPRESSION A L’AIDE DU BOUTON « VERIFIER ».
Si la syntaxe de l’expression est correcte, MapInfo affiche un message
de validation
Si la syntaxe est incorrecte, MapInfo affiche
un message d’erreur
Pour que la syntaxe de l’expression soit correcte : Eviter de taper directement les modalités et préférer le système des ascenseurs afin de minimiser le
risque d’erreur ; Veiller à respecter la structure de la table (casse, espacement, orthographe…) ; Faire attentention au type de modalité à traiter :
o Les modalités qualitatives (« Caractère ») comme les noms de communes sont toujours écrites entre des guillemets
Exemple : Sélection par statut de commune. Expression : Statut = ‘‘Commune simple’’ permet d’afficher les communes dont le statut correspond à « Commune simple ».
Exemple : Sélection des communes de Cadaujac et de Léognan. Expression : Nom_Commune = ‘‘CADAUJAC’’ Or Nom_Commune = ‘‘LEOGNAN’’.
o Les modalités quantitatives sont écrites normalement : Exemple : Selection par Population. Expression : Population = 2.0 permet d’afficher
les communes dont la population est égale à 2.000 habitants. Exemple : Sélection par superficie. Expression : Superficie >= 600 permet d’afficher
les communes dont la superficie est supérieure ou égale à 600 km².
Sélectionner les communes de la CdC Montesquieu sur la base de données des communes de la Gironde afin de délimiter les contours de l’intercommunalité. Expression : Nom_Commune = ‘‘AYGUEMORTE-LES-GRAVES’’…
CONSEILS En prenant en compte la structure de la base de données attributaire, il est possible dans certains cas de
trouver une modalité utile qui permette de simplifier grandement l’écritude de la sélection. Dans ce cas la variable « Code_Canton » se révèle particulièrement utile. Au lieu d’écrire une très longue expression comprenant l’ensemble des noms de communes, il suffit de faire la requête de sélection par rapport au code du canton qui est 27. La plupart du temps, il vaut mieux sélectionner les communes grâce au Code Officiel Géographique.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
73
Il est également possible de sélectionner les propriétés d’affichage sous lesquelles apparaissent la sélection attributaire. MapInfo propose en effet d’individualiser la sélection attibutaire simple dans une « Nouvelle Fenêtre Données », ce qui évite d’avoir la liste entière des communes de la Gironde.
Il est possible d’enregistrer la sélection dans une nouvelle table : « Fichier – Enregistrer la Table Sous » et sélectionner la Query correspondant à la sélection effectuée.
Veiller à choisir un nom de table pertinent (par défaut
Query1.TAB) (ex : ComCDC_Montesquieu.TAB) et un chemin d’accès approprié.
Cette sauvegarde conserve uniquement la sélection (les treize communes de la CdC) et supprime le reste des communes hors du périmètre de la sélection.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
74
FAIRE ATTENTION, CAR SI LES SELECTIONS NE SONT PAS ENREGISTREES AVANT LA FERMETURE DU LOGICIEL ELLES SERONT DEFINITIVEMENT PERDUES. IL FAUDRA DONC RECOMMENCER LES MANIPULATIONS DE SELECTION AUTANT DE FOIS QUE NECESSAIRE.
PLUS IL Y A EU DE SELECTIONS SIMPLES OU DE REQUETES ATTRIBUTAIRES SIMPLES QUI ONT ETE REALISEES DURANT LA SESSION DE TRAVAIL ET PLUS LE NOMBRE DE QUERY SERA IMPORTANT. CONSEILS
Penser à sauvegarder les sélections utiles avant de fermer la session ou le logiciel, car MapInfo ne tiendra pas compte de ces opérations et n’invitera par l’utilisateur à sauvegarder, car ces opérations sont des manipulations temporaires qui n’affectent par les enregistrements de la couche d’information.
Si le nombre de sélection est trop important lors de l’enregistrement de la manipulation qui est intéressante, il est possible d’être perdu dans la liste des manipulations qui ont été réalisées. Il est possible de refaire la manipulation en question une nouvelle fois afin qu’elle apparaisse à la fin de la liste numérotée. La dernière sélection effectuée est la query portant le chiffre/nombre le plus élevé.
REQUETE MULTIPLE : LA SELECTION SQL La sélection SQL est une sélection complexe de données provenant de deux tables. Cette requête permet
de croiser deux couches d’informations différentes et de sélectionner les objets qui peuvent servir à l’interprétation, c'est-à-dire les objets situés à l’intérieur de la zone d’étude (exemple d’application à l’ensemble de fichiers « BATI_INDIFFERENCIE.TAB » => importation par le traducteur universel obligatoire).
L’ouverture d’une base de données importée comme la
BATI_INDIFFERENCIE.TAB ou toute autre table permet d’obtenir des informations qui peuvent être un appui très utile au travail de photo-interprétation. La visualisation de la base graphique montre des objets spatiaux dépassant le périmètre de la zone d’étude. La requête multiple repose sur les mêmes principes que la sélection simple. Sa spécificité propre porte sur une sélection non plus attributaire mais spatiale. C'est-à-dire que la sélection prend en compte les objets et/ou leurs attributs. Il s’agit dès lors de sélectionner les objets spatiaux compris à l’intérieur de la zone d’étude.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
75
LA SELECTION DES OBJETS GRAPHIQUES PEUT SE FAIRE MANUELLEMENT, MAIS DANS LE CAS DE PETITES UNITES, IL EST TRES DIFFICILE DE NE PAS EN OUBLIER. LA SELECTION SQL PERMET DE SELECTIONNER L’ENSEMBLE DES OBJETS SITUES A L’INTERIEUR D’UN PERIMETRE DEFINI, QUELQUE SOIT LEUR TAILLE.
Choisir l’option « Sélection SQL… » dans le menu « Sélection ». La fenêtre « Sélection SQL » apparaît. La sélection des différentes options répond à une certaine logique :
o Sélectionner les tables : l’ordre des tables est très important. Il faut choisir dans un premier temps la table source, c'est-à-dire la table où l’on va chercher l’information, puis la table cible, c'est-à-dire la table à renseigner (1).
o Sélectionner les colonnes : les colonnes sont les bases de la structure d’une table. Il faut choisir avec soin les colonnes lors de cette opération pour pouvoir poursuivre le travail dans les phases ultérieures du traitement. Par défaut, le logiciel place un astérisque « * » (2).
o Les critères correspondent à la formule ou l’expression de la sélection attributaire. Les opérateurs et les fonctions sont identiques à la sélection précédente. Seules les options « Agréger » se rajoutent (3).
Un outil de sélection attributaire qui se révèle particulièrement efficace dans le cadre de la requête attributaire multiple est l’opérateur spatial. MapInfo propose cinq opérateurs spatiaux :
Opérateur Description Illustration
Contains « L’objet A contient l’objet B si le centroïde de B se trouve dans le
polygone de A ».
Contains Entire
« L’objet A contient entièrement l’objet B si le polygone de B est entièrement inclus dans le polygone de A ».
Within « L’objet A est contenu dans l’objet B si son centroïde est dans le
polygone de B ».
Entirely Within
« L’objet A est entièrement dans l’objet B si le polygone de A est entièrement dans le polygone de B ».
Intersects « L’objet A rencontre l’objet B si ils ont au moins un point
commun ».
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
76
En gardant l’exemple de la table « BATI_INDIFFERENCIE.TAB » et du tracé du périmètre d’étude, il faut procéder par requête SQL. Cette requête spatiale a pour but de sélectionner des objets spatiaux de petite taille situés à l’intérieur de la zone d’étude. Cette démarche est identique pour toutes les tables externes qu’il est possible d’utiliser (base de données végétation, route, hydrologie, occupation du sol…).
o Sélectionner la table source puis la table cible : BATI_INDIFFERENCIE.TAB, Zone_Etude.TAB. o Choisir les colonnes servant à sélectionner les objets spatiaux compris dans le périmètre
d’étude. En fonction des tables qui ont été sélectionnées, deux colonnes sont particulièrement utiles : BATI_INDIFFERENCIE.obj et Zone_Etude.obj.
o Sélectionner les différents éléments pour écrire une Expression de sélection.
Dans le cadre de la sélection SQL créée entre les tables BATI_INDIFFERENCIE. TAB et Zone_Etude.TAB, l’objet de la requête multiple porte sur l’identification des objets bâtis compris à l’intérieur du périmètre d’étude. Le choix de l’opérateur spatial s’est porté sur Contains Entire, car les objets de la base BATI_INDIFFERENCIE sont de taille assez réduite. Il est primordial de choisir les objets totalement inclus dans la zone d’étude.
L’Expression choisie est « Zone_Etude.obj Contains Entire BATI_INDIFFERENCIE.obj »
o Cliquer sur Vérifier pour s’assurer que la syntaxe est correcte.
o OK o Enregistrer la sélection dans
une nouvelle table (BATI_INDIFFERENCIE_CCM.TAB).
Il faudra procéder de la même manière lorsqu’une zone d’étude plus précise sera définie.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
77
REALISER UNE ANALYSE THEMATIQUE
L’Analyse thématique est une opération de traitement numérique automatisée de l’information géographique. En fonction de critères prédéfinis, elle permet de créer des cartes, qui sont des outils d’analyse et de visualisation des données très efficaces. Elle permet de représenter graphiquement les données sur le fond cartographique.
En cartographie, la représentation des données représente un choix méthodologique particulièrement important. La représentation de la donnée géographique doit respecter les règles de la sémiologie graphique13. Selon le type de variables, il existe différentes manières de représenter les données.
CREER UNE CARTE THEMATIQUE EN TROIS ETAPES
QUELLE METHODE CHOISIR POUR ETABLIR UNE CARTE D’OCCUPATION DES SOLS ?
La représentation des données géographiques est fonction de la nature des données. Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des règles de représentation en cartographie. En l’occurrence, la création d’une Carte d’Occupation des Sols fait intervenir des variables zonales devant être représentées par des couleurs, comme c’est le cas pour les cartographies d’occupation des sols CORINE Land Cover.
Le type d’analyse thématique le plus propice pour traiter ce genre de données est l’analyse thématique par valeurs individuelles. Chaque parcelle identifiée par photo-interprétation est définie par son emprise au sol (caractère zonal) et son type (variable qualitative).
Sélectionner l’option « Analyse Thématique… » dans le menu « Carte ». La fenêtre « Créer Carte Thématique » apparaît.
L’analyse thématique permet de créer une carte simplement en trois étapes :
1. Sélection du type d’analyse thématique ; 2. Sélection des valeurs de l’analyse thématique ; 3. Personnalisation de l’analyse thématique.
13 Pour aller plus loin, voir :
BEGUIN Michèle & PUMAIN Denise, 2010, La représentation des données géographiques statistiques en cartographie, Paris, Armand Colin, coll. « Cursus – Géographie », 192p.
POIDEVIN Olivier, 1999, La carte, moyen d’action : Guide pratique pour la conception & la réalisation de cartes, Ellipses, 199p.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
78
ETAPE N°1 – SELECTIONNER LE TYPE D’ANALYSE THEMATIQUE : ANALYSE THEMATIQUE PAR VALEUR INDIVIDUELLE
La fenêtre « Créer Carte Thématique – Etape 1/3 » est organisée en trois parties : Les « Types » de méthodes d’analyse thématique ; Les « Modèles » du type d’analyse thématique sélectionnée ; L’ « Aperçu » de la légende.
Le logiciel MapInfo propose sept méthodes d’analyse thématique qui possèdent plusieurs variantes et options.
Type Description rapide Modèle Exemple d’aperçu
Affichage des données en fonction de classes définies par l’utilisateur. Les classes sont colorées à l’aide de couleurs ou de trames
24
Affichage d’un graphique à barre en fonction des variables thématiques pour chaque enregistrement de la table
3
Affichage d’un graphique à secteur en fonction des variables pour chaque enregistrement de la table
3
Affichage d’un symbole pour chaque enregistrement de la table. La taille des symboles est proportionnelle aux valeurs des données
10
Affichage des valeurs sous forme de points sur la carte. Chaque point équivaut à un nombre et le nombre total des points dans un polygone est proportionnel à la valeur des données du polygone
4
Affichage des polygones et des objets par coloration en fonction des valeurs individuelles des données
11
Affichage d’une analyse thématique de surface de grille. Il s’agit d’une grille raster produite par une interpolation des données de point
6
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
79
Sélectionner le type d’analyse thématique « Valeurs Individuelles ». Sélectionner le modèle « Valeurs individuelles de régions par défaut ». Cliquer sur « Suivant > ».
ETAPE N°2 : SELECTIONNER LES VALEURS THEMATIQUES DE L’ANALYSE A cette étape, il faut choisir la table et la variable à représenter sur la carte.
Sélectionner la Table source de l’analyse thématique (SEL_CLC06_Zone_Etude.TAB). Sélectionner le Champ qui va servir à renseigner la carte et les attributs des objets géographiques
(exemple des codes CLC). Cliquer sur « Suivant > ».
ETAPE N°3 – PERSONNALISER L’ANALYSE THEMATIQUE Le traitement automatique attribue des valeurs par défaut (couleurs, styles...) (1). Différentes possibilités
s’offrent à l’utilisateur pour améliorer la Carte d’Occupation des Sols (2).
1 2
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
80
MODIFIER LES STYLES o Cliquer sur l’option « Styles… ». o La boîte de dialogue « Définir Styles Individuels » apparaît.
Il faut maintenant définir les valeurs pour chacune des modalités en cliquant sur le polygone rouge située à droite de la fenêtre pour faire apparaître la boîte « Style Polygone ».
o Procéder ainsi pour tous les polygones qui nécessitent un changement de la variable couleur. o Fermer ensuite la boîte « Définir Styles Individuels » pour revenir à la fenêtre précédente et
cliquer sur l’option « Légendes… ». La boîte de dialogue « Définir Légende » apparaît.
MODIFIER LA LEGENDE ET LES LIBELLES Il est possible d’ajouter et/ou modifier :
o Le titre : par défaut MapInfo affiche comme titre le traitement effectué sur la table grâce au champ sélectionné à l’étape précédente (SEL_CLC06_Zone_ Etude par CODE_06).
o Le sous-titre. o Les libellés : par défaut MapInfo
affiche les données du champ sélectionné pour l’analyse attributaire (CODE_06).
o Les styles et couleurs de police.
Une fois que les modifications sont
terminées, valider le traitement pour obtenir la carte. Il est possible de modifier à tout moment l’analyse thématique en sélectionnant l’option « Modifier Analyse Thématique » dans le menu « Carte ».
PENSER A SAUVEGARDER L’ANALYSE THEMATIQUE DANS UN WORKSPACE AFIN D’ENREGISTRER LES MODIFICATIONS VISUELLES DES POLYGONES ET LA LEGENDE.
>
<
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
81
ANALYSE THEMATIQUE DE LA CARTE D’OCCUPATION DES SOLS Pour créer l’analyse thématique de la Carte d’Occupation des Sols créée à partir de la photo-interprétation
et/ou de l’importation de données externes, reprendre les mêmes étapes et les mêmes options. Afin de respecter les logiques de construction de la nomenclature CLC, il est possible de se référer au tableau de correspondance des couleurs pour avoir une idée plus précise du calibrage des nuances de couleurs en RVB.
TABLEAU DES CORRESPONDANCES THEMATIQUES ET COLORISTIQUES
Thème Couleurs
Territoires artificialisés Territoires agricoles Forêts et milieux semi-naturels Zones humides Surfaces en eau
TABLEAU DETAILLE DES CORRESPONDANCES COLORISTIQUES
Code_CLC3 Libellé Couleur Rouge Vert Bleu
111 Tissu urbain continu 230 000 077
112 Tissu urbain discontinu 255 000 000
121 Zones industrielles et commerciales 204 077 242
122 Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 204 000 000
123 Zones portuaires 230 204 204
124 Aéroports 230 204 230
131 Extraction de matériaux 166 000 204
132 Décharges 166 077 000
133 Chantiers 255 077 255
141 Espaces verts urbains 255 166 255
142 Equipements sportifs et de loisirs 255 230 255
211 Terres arables hors périmètres d’irrigation 255 255 168
212 Périmètres irrigués en permanence 255 255 000
213 Rizières 230 230 000
221 Vignobles 230 128 000
222 Vergers et petits fruits 242 166 077
223 Oliveraies 230 166 000
231 Prairies 230 230 077
241 Cultures annuelles associées aux cultures permanentes 255 230 166
242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 255 230 077
243 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels 230 204 077
244 Territoires agro-forestiers 242 204 166
311 Forêts de feuillus 128 255 000
312 Forêts de conifères 000 166 000
313 Forêts mélangées 077 255 000
321 Pelouses et pâturages naturels 204 242 077
322 Landes et broussailles 166 255 128
323 Végétation sclérophylle 166 230 077
324 Forêt et végétation arbustive en mutation 166 242 000
331 Plages, dunes et sable 230 230 230
332 Roches nues 204 204 204
333 Végétation clairsemée 204 255 204
334 Zones incendiées 000 000 000
335 Glaciers et neiges éternelles 166 230 204
411 Marais intérieurs 166 166 255
412 Tourbières 077 077 255
421 Marais maritimes 204 204 255
422 Marais salants 230 230 255
423 Zones intertidales 166 166 230
511 Cours et voies d’eau 000 204 242
512 Plans d’eau 128 242 230
521 Lagunes littorales 000 255 166
522 Estuaires 166 255 230
523 Mers et océans 230 242 255
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
82
Pour modifier les nuances de couleurs plus précisément, il est
possible de changer les valeurs RVB comprises entre 0 et 255, en ouvrant la boîte de dialogue « Style Polygone » et cliquer sur les « »en bas de l’ascenseur des couleurs pour faire apparaître la fenêtre « Choisir Couleur ».
L’enrichissement de la nomenclature grâce à l’ajout de postes supplémentaires nécessite de jouer davantage sur les nuances de couleurs.
LES NUANCES DE COULEURS DE LA CARTE DOIVENT ETRE SUFFISAMMENT TRANCHEES POUR QUE L’ON PUISSE DISTINGUER FACILEMENT LES OBJETS, SURTOUT SI DEUX OBJETS PROCHES POSSEDENT DES CARACTERISTIQUES D’OCCUPATION DES SOLS ASSEZ SIMILAIRES ET COULEURS ASSEZ EQUIVALENTES.
Dans certains cas, les couleurs sont assez semblables alors que les valeurs RVB sont différentes.
123 Zones portuaires 230 204 204
124 Aéroports 230 204 230
CONSEIL
Veiller à bien trancher les couleurs pour faciliter l’identification des objets et leur nature.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
83
MISE EN PAGE D’UNE CARTE THEMATIQUE
La mise en page de la carte est la dernière étape du travail à réaliser. Elle consiste à finaliser le travail en vue d’un rendu sur différents supports et doit comporter un certain nombre d’éléments.
LES ELEMENTS INDISPENSABLES DE LA CARTE
T – TITRE
O – ORIENTATION
L – LEGENDE
E – ECHELLE
S – SOURCES
(N) – NOMS
CONSEILS Penser à indiquer le nom de la ou des personnes et la date de réalisation sur la carte et les supports créés ;
privilégier l’utilisation d’échelle graphique à l’échelle numérique, pour garder le rapport de proportionnalité du document en cas de réduction / agrandissement ; indiquer clairement les sources qui ont servis à établir la carte… SOIGNER LA PRESENTATION DE LA CARTE.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
84
CREER UNE MISE EN PAGE Le logiciel MapInfo permet d’enrichir la cartographie et de créer une mise en page. Sélectionner l’option
« Mise en page » dans le menu « Fenêtre » pour affiche la boîte de dialogue « Nouvelle Fenêtre de Mise en Page » afin d’ajouter des options de création de « Cadre » pour la ou les fenêtres actives.
Il est possible de modifier les paramètres de la mise en page, les options d’affichage de certains outils
(règles, orientation…). Pour compléter la carte avec les éléments nécessaires, utiliser la barre d’outils « Dessins ». AJOUTER UN TITRE
L’outil « Texte » permet de créer du texte à l’endroit souhaité. La modification du texte intervient par double-clic sur le
texte inséré. L’outil « Styles Textes » permet de modifier la police, la couleur, la taille, le fond et les effets du texte.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
85
AJOUTER UNE ORIENTATION
L’outil « Symbole » permet d’ajouter un symbole d’orientation en modifiant la police « MapInfo
Arrows » grâce à l’outil « Styles Symboles » . MapInfo propose dix symboles d’orientation différents (flèche, rose des sables…) (1).
1 2
L’outil « Fleche Nord » (NorthArrow.MBX) exécutable dans le menu « Outils – Gestionnaire d’Outils… » offre dix-neuf possibilités supplémentaires de représentation de l’orientation (2).
LES OUTILS .MBX
Le logiciel MapInfo est livré avec une suite d’outils basé sur le langage de programmation MapBasic. Ces modules complémentaires sont développés pour rajouter des options au logiciel, options visualisables dans le menu « Outils ».
Pour ouvrir un outil .MBX, sélectionner l’option « Gestionnaire d’Outils » dans le menu « Outils ». La fenêtre du gestionnaire apparaît avec une liste d’applications annexes pouvant être chargée sous MapInfo. Cette fenêtre permet de
Connaître les outils à disposition dans le répertoire « Tools » de MapInfo, comprenant les outils fournit directement avec la version commerciale du logiciel, et de leurs possibilités grâce à une rapide description ;
Charger automatiquement ou non les outils lors de la session de travail ; Ajouter, modifier ou retirer des outils de la liste du gestionnaire.
Il est également possible de lancer un outil par le biais de la commande « Exécuter » du menu « Outils » lorsque l’on télécharge un fichier .MBX sur un site internet.
Une fois l’outil activé, il faut le lancer par le biais du menu « Outils ».
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
86
AJOUTER UNE ECHELLE GRAPHIQUE Utiliser l’outil « Echelle » (SCALEBAR.MBX) dans la commande « Exécuter » du sous dossier « Tools » de
MapInfo.
L’OUTIL ECHELLE N’EST MALHEUREUSEMENT PAS TRES
STABLE ET SON FONCTIONNEMENT EST SUJET A QUELQUES
PROBLEMES, SI JAMAIS LES PARAMETRES D’AFFICHAGE
CHANGENT.
Il est également possible de se servir de l’outil « Distance »
afin de déterminer la distance entre deux points et créer une échelle graphique à l’aide de lignes ou de polygones sur une nouvelle couche de dessin.
CREER UNE LEGENDE EN TROIS ETAPES L’analyse thématique permet de créer une légende qui apparaît sous la forme d’une nouvelle fenêtre
correspondant à l’activation de l’outil « Légende » .
MapInfo propose une commande spécifique permettant de créer une légende. Pour cela sélectionner
l’option « Créer Légende… » dans le menu « Carte » pour créer une légende en trois étapes. ETAPE n°1 : SELECTION DES TABLES DE LA LEGENDE
o La fenêtre « Créer une Légende – Etape 1 sur 3 » apparaît, il faut sélectionner les couches qui vont apparaître dans la fenêtre « Légende ». MapInfo puise par défaut dans la table d’occupation du sol et de son analyse thématique, mais il est également possible de faire figurer d’autres tables pouvant être intéressantes à figurer sur la carte (zonages…).
o Cliquer ensuite sur « Suivant > ».
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
87
ETAPES n°2 : CHOIX DES STYLES ET DES LIBELLES
o La fenêtre « Créer une Légende – Etape 2 » permet de sélectionner des options générales concernant les styles des titres de la légende, des tables, des libellés ; la taille des pavés de la légende ; l’orientation… (1).
o Cliquer sur « Suivant > ». o La fenêtre « Créer une Légende – Etape 3 sur 3 » apparaît pour finaliser la mise en forme
pour chaque élément de la légende. Dans le cas d’une analyse thématique, la définition des styles reprend les valeurs définies lors de l’analyse thématique. Il suffit de reprendre le style et le type de l’objet. Ecrire un titre accompagné ou non d’un sous-titre (2).
o Valider la légende.
1 2
Une nouvelle fenêtre « Légende » apparaît avec les informations entrées dans les étapes précédentes.
ETAPE N°3 : INTEGRER LA LEGENDE DANS LA FENETRE « MISE EN PAGE »
La légende peut être intégrée à la fenêtre « Mise en page » en créant un « cadre actif » pour y insérer la légende. Pour créer un cadre, retourner dans la fenêtre « Mise en page » en gardant la fenêtre « Légende » toujours ouverte.
o Sélectionner l’outil « Cadre » et tracer un cadre. La fenêtre « Objet Cadre » apparaît.
o Sélectionner la légende créée dans l’ascenseur de la boîte de dialogue.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
88
MANIPULATIONS DES OBJETS DE LA MISE EN PAGE Tous les objets de la fenêtre « Mise en page » peuvent être manipulés et modifier à volonté, d’où
l’immense avantage de travailler en vectoriel. Il est possible de : Dessiner à l’aide des outils de dessins afin de personnaliser la carte. Disposer et déplacer les objets comme on le souhaite en les faisant glisser sur l’ensemble de la page,
ou bien les disposer avec ordre grâce aux options d’alignement. Il faut sélectionner le ou les objets, faire un clic droit et choisir l’option « Aligner Objets » pour faire apparaître la boîte de dialogue « Alignement des objets ».
Redimensionner les objets en sélectionnant les poignées (qui s’apparentent aux nœuds des polygones) et les faire glisser.
Supprimer les objets.
VEILLER A ADAPTER LES PARAMETRES D’IMPRESSION, L’ORIENTATION DE LA PAGE AINSI QUE LES MESURES DE LA CARTE ET CELLE DES OBJETS : TAILLE, POLICE, COULEUR, STYLE, EFFETS…
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
89
ENREGISTRER LA CARTE Lorsque la carte est terminée, il est possible d’exporter la carte vers d’autres supports et l’inclure dans
divers types de documents. Comme la plupart des logiciels, MapInfo propose à l’utilisateur d’imprimer ou d’exporter la mise en page ou les étapes intermédiaires du traitement cartographique, à insérer dans la présentation et le dossier à rendre à la fin du semestre.
CAPTURE D’ECRAN La solution la plus basique consiste à faire une capture d’écran de la fenêtre MapInfo pour exporter la carte
dans un format image : Touche Imp. Ecran et copie dans un logiciel de dessin (par défaut Paint) ou un traitement de texte.
Ou Utiliser un logiciel de capture (Outil Capture, logiciel FastStone Capture, etc.).
EXPORTER LA FENETRE MapInfo propose d’exporter les fenêtres actives vers plusieurs formats.
Sélectionner l’option Exporter Fenêtre dans le menu Fichier. La boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre dans un fichier apparaît.
Format Descriptif
Bitmap *.BMP Format raster ne dégradant pas l’image et n’utilisant généralement pas de compression
MetaFile *.WMF Format vectoriel
Enhanced Metafile *.EMF
Format vectoriel, version améliorée du *.WMF
JPEG *.JPG Format raster de compression avec ou sans pertes
Portable Network Graphics *.PNG
Format raster spécialement adapté pour l’export d’images plutôt simples comprenant généralement des aplats de couleurs
VEILLER A ETRE PLACE SUR LA BONNE FENETRE, CAR CETTE OPTION EXPORTE TOUJOURS LA FENETRE ACTIVE. CONSEIL Penser à faire plusieurs essais pour voir quelle solution d’export paraît la meilleure en fonction du support de
présentation. Lors de l’export, il est possible d’améliorer sensiblement la qualité des images en augmentant
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
90
la résolution du fichier, autrement dit le nombre de pixels dans l’image. Par défaut, la résolution proposée par MapInfo est de 96 dpi (1).
100% 900%
1 Exportation de la fenêtre carte dans un format
d’image raster avec une résolution par défaut de 96
dpi (.JPEG)
2 Exportation de la fenêtre carte dans un format
d’image raster avec une résolution de 600 dpi
(.JPEG)
3 Exportation de la fenêtre carte dans un format
d’image vectorielle avec une résolution par défaut
(.EMF)
L’augmentation de la résolution lors de l’opération d’exportation par rastérisation de la carte permet de limiter les effets indésirables de pixellisation de l’image lors d’un zoom très important (2). Le format vectoriel n’est pas soumis aux contraintes de la pixellisation de la carte (3). De plus, le poids d’un export en vectoriel est près de dix fois moins important à la taille d’un fichier raster exporter avec une résolution par défaut (9,16 ko pour un vectoriel en .EMF contre 137 ko pour un raster en .JPEG).
NOTER QUE PLUS LA RESOLUTION EST GRANDE ET PLUS LE POIDS DE L’IMAGE EST IMPORTANT. A PARTIR D’UNE CERTAINE VALEUR, LE MATERIEL INFORMATIQUE MANQUE DE MEMOIRE VIRTUELLE. IL EST INCAPABLE D’EXPORTER LE FICHIER A LA RESOLUTION FIXEE PAR L’UTILISATEUR. LA RESOLUTION DE L’IMAGE ET LE TYPE DE FICHIER IMAGE JOUE ENORMEMENT SUR LA TAILLE ET LA QUALITE DE L’IMAGE. LA QUALITE D’UNE IMAGE INFLUE DES LORS FORTEMENT SUR LES MODES DE PRESENTATION (DOSSIER, POSTER, PROJECTION…).
Résolution Nombre de pixels Poids
96 794 x 1.122 137 ko
150 1.240 x 1.752 238 ko
300 3.481 x 3.506 626 ko
600 4.962 x 7012 1.730 ko
1.200 9.925 x 14.025
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
91
MapInfo est un logiciel qui n’offre pas beaucoup d’alternatives de mise en page de la carte. Si l’on veut aller plus loin dans l’amélioration et les finitions de la mise en page, il est possible d’exporter la fenêtre active en format vectoriel et de l’importée sous un logiciel de dessin vectoriel comme Illustrator (payant) ou Inkscape (gratuit).
ORGANIGRAMME DE TRAITEMENT La carte d’occupation des sols produite est le résultat de traitements et de choix méthodologiques dans les
assemblages thématiques. L’organigramme du processus de traitement est une figure très utile pour faire apparaître les étapes essentielles d’un travail sur l’information géographique. Il existe plusieurs manières de représenter le processus de traitement :
Réaliser un organigramme synthétique du processus reprenant les éléments clés (fichiers, sources…) et les grandes étapes du traitement (méthode, outils…).
Réaliser un organigramme complet reprenant toutes les étapes du traitement.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
92
CONCLUSION
La démonstration du logiciel MapInfo est terminée. Les procédures techniques présentées ci-dessus représentent un point d’entrée synthétique des possibilités offertes par un logiciel de SIG comme MapInfo, en fonction d’une thématique donnée.
Le choix des données et leur organisation sont deux éléments très importants qui doivent rester au cœur
d’une démarche cohérente du processus de traitement de l’information géographique. Il faut toujours garder à l’esprit toutes les implications sémantiques, sémiologiques et méthodologiques formulées dès le début du travail.
Les cartes produites ne constituent qu’un résultat ou plusieurs résultats. Ils doivent être accompagnés d’un
commentaire méthodologique complet visant à analyser la démarche entreprise (mise en place du protocole) pour arriver au résultat escompté, tout en validant l’ensemble des postulats servant de fil directeur pour ce travail. Les options retenues doivent être pertinentes, justifiées à l’écrit et justifiables le jour de l’oral individuel.
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
93
INDEX GENERAL
SOMMAIRE 3
SUJETS DE TRAVAIL 4
MODALITES D’EVALUATION 5
DONNEES A DISPOSITION 6
CADRE METHODOLOGIQUE DE LA DEMARCHE 7
CHEMINEMENT DU TRAVAIL 7
PRESENTATION GENERALE DU LOGICIEL MAPINFO 9
DEFINITIONS D’UN SIG 9
DEMARRAGE ET PREMIERE EXPLORATION DU LOGICIEL 10 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 11 BARRE DES MENUS 11 DETAIL DES MENUS DU LOGICIEL MAPINFO 12
BARRES D’OUTILS 13 BARRE D’OUTILS « STANDARD » 13 BARRE D’OUTILS « GENERAL » 13 BARRES D’OUTILS « DESSINS » 13
OUVERTURE DU PREMIER FICHIER ET OPTIONS D’AFFICHAGE 15 COMMENT AFFICHER LES EXTENSIONS D’UN FICHIER CONNU 16 LES FENETRES UTILES SOUS MAPINFO 18
MANIPULATIONS DU LOGICIEL 19
CALER UNE IMAGE 20 SYSTEME DE PROJECTION 20 SYSTEME DE PROJECTION EN FRANCE METROPOLITAINE 21 RAPPELS SUR LES POINTS DE CALAGE 23 WORKSPACE 26
CREATION D’UNE TABLE MAPINFO 28 TABLE MAPINFO 28 CHAMP 29 NATURE DES DONNEES 29 EXTENSIONS MAPINFO 31
PHOTO-INTERPRETATION ET NUMERISATION 33 OCCUPATION DES SOLS : METHODE GENERALE 33 CLES D’INTERPRETATION 33 COULEUR 33 TEXTURE 33 STRUCTURE 34 FORME 34 TAILLE 34 PHENOLOGIE 34
MODELES DE DONNEES GEOGRAPHIQUES 35 STRUCTURATION DES DONNEES GEOGRAPHIQUES 35 GESTION VISUELLE DES TABLES SOUS MAPINFO 37
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
94
NUMERISATION DES POLYGONES 38 REGLES DE NUMERISATION 39 RESPECTER L’ECHELLE DE DEFINITION 39 AFFICHER LES DONNEES A L’ECRAN 40 CREER DES OBJETS GRAPHIQUES 41 MODIFIER DES OBJETS GRAPHIQUES 41 SELECTION MANUELLE DES OBJETS GRAPHIQUES ET DE LEUR ATTRIBUTS 41 OPERATIONS D’AGREGATION DES DONNEES 42 TRACER DES LIMITATIONS PARFAITES 43 TRACER DES OBJETS PARFAITEMENT COALESCENTS 43 EVIDER UN POLYGONE 43 ASSEMBLER DES OBJETS ENTRE EUX 44 FUSIONNER DES OBJETS 45 FUSIONNER DES OBJETS ISSUS DE COUCHES EXTERNES 46 FUSION D’OBJETS SELECTIONNES 46 FUSION D’OBJETS DEPUIS UNE COLONNE 47 CREER UNE TABLE OU SE SERVIR DE LA STRUCTURE D’UNE TABLE EXISTANTE 47 CHEMINEMENT POUR LA VARIABLE POPULATION 49 DECOUPER DES OBJETS 50 SUPPRIMER DES OBJETS 50 RENDRE UNE TABLE PROPRE 51 CREER DES TAMPONS 51 OUTILS DE TRACAGE ET DE CORRECTION 53 FUSION 53 AUTOTRACE 53 AJOUTER DES NŒUDS POUR CORRIGER RECOUVREMENTS ET LACUNES 54 FONCTION MANUELLE 54 FONCTION AUTOMATIQUE 56 VERIFICATION DES REGIONS 57
NUMERISER ET RENSEIGNER SIMULTANEMENT 59 METTRE A JOUR DES COLONNES 60 MISE A JOUR DE LA COLONNE « TYPE_CLC » A L’AIDE DES CODES CLC 60 MODIFIER LA STRUCTURE DE LA TABLE 61 MISE A JOUR DE LA COLONNE « ID » 63 MISE A JOUR DE LA COLONNE « AREA » 64
IMPORTER ET OUVRIR D’AUTRES SUPPORTS 65 OUVRIR UN FICHIER RECONNU 65 IMPORTER / EXPORTER UN FICHIER 65 TRADUCTEUR UNIVERSEL 65 TRADUCTEUR UNIVERSEL OU SYSTEME D’OUVERTURE CLASSIQUE 66
OPERATIONS DE SELECTION 70 REQUETE SIMPLE 70 SELECTION PAR CLIC 70 SELECTION ATTRIBUTAIRE SIMPLE 71 EXPRESSIONS 71
REQUETE MULTIPLE : SELECTION SQL 74 OPERATEURS SPATIAUX 75
REALISER L’ANALYSE THEMATIQUE D’UNE IMPORTATION 77 CREER UNE CARTE THEMATIQUE EN TROIS ETAPES 77 QUELLE METHODE CHOISIR POUR ETABLIR UNE CARTE D’OCCUPATION DES SOLS 77 ETAPE N°1 : SELECTIONNER LE TYPE D’ANALYSE THEMATIQUE 78 METHODES D’ANALYSE THEMATIQUE 78
TD METHODOLOGIE – MASTER 1 GEOGRAPHIE – MODULE « INITIATION » – 2014-2015
95
ETAPE N°2 : SELECTIONNER LES VALEURS THEMATIQUES DE L’ANALYSE 79 ETAPE N°3 : PERSONNALISER L’ANALYSE THEMATIQUE 79 MODIFIER LES STYLES 80 MODIFIER LA LEGENDE ET LES LIBELLES 80
ANALYSE THEMATIQUE DE LA CARTE D’OCCUPATION DES SOLS 81 TABLEAUX DES CORRESPONDANCES COLORISTIQUES 81
MISE EN PAGE D’UNE ANALYSE THEMATIQUE 83 ELEMENTS INDISPENSABLES DE LA CARTE 83
CREER UNE MISE EN PAGE 84 AJOUTER UN TITRE 84 AJOUTER UNE ORIENTATION 85 OUTILS .MBX 85 AJOUTER UNE ECHELLE GRAPHIQUE 86
CREER UNE LEGENDE EN TROIS ETAPES 86 ETAPE N°1 : SELECTION DES TABLES DE LA LEGENDE 86 ETAPE N°2 : CHOIX DES STYLES ET DES LIBELLES 87 ETAPE N°3 : INTEGRER LA LEGENDE DANS UNE FENETRE « MISE EN PAGE » 87
MANIPULATION DES OBJETS DE LA MISE EN PAGE 88
ENREGISTRER LA CARTE 89 CAPTURE D’ECRAN 89 EXPORTER LA FENETRE 89 ORGANIGRAMME DE TRAITEMENT 91
CONCLUSION 92
INDEX GENERAL 93