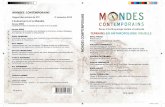Statut de la compétence
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
12 -
download
0
Transcript of Statut de la compétence
1
RECHERCHE ENDIDACTIQUE
Yann BoucletDoctorant, enseignant formateur FLEIRFLE, Université de Nantes
Le statut de la compétencedans l’analyse d’une situation cible professionnelle
L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues peut difficilement faire l’économie d’une réflexion sur la notion de compétence, indissociable des notions de tâche et de situation. Cet article propose des pistes d’intégration de la notion dans la pratique du FOS, des réflexions sur les composantes de la compétence communicative dans un milieu professionnel, un modèle d’analyse des besoins centré sur les compétences, et un schéma synthétisant la démarche analyse/programmation.
Yann Bouclet est enseignant et formateur de formateurs à l’IRFFLE. Il assure un cours sur le FOS et les enseignements en langue à des publics spécifiques dans le cadre du Master 2 FLE de l’IRFFLE. Il a exercé quelques années dans le contrôle de gestion, le commerce et le conseil. Il a également vécu et travaillé en Angleterre et au Japon.
La notion de compétence est délicate à manipuler dans un contexte d’enseignement/apprentissage des langues. En effet, les définitions généralement en vigueur depuis Chomsky jusqu’à Canale et Swain, et Moirand, en passant par Hymes, ne l’ont pas nécessairement rendue plus opérationnelle en termes d’analyse des besoins et de programmation pédagogique, elles sont souvent trop globales pour être directement utilisables dans le cadre de l’analyse d’une situation de communication. Or il nous paraît essentiel d’intégrer cette notion decompétence dans l’enseignement du FLE, et du FOS, puisque selon nous, elle est consubstantielle à l’approche actionnelle.
Il nous faut donc réduire la maille d’analyse, et envisager une acception plus restreinte de la compétence, identifiable, observable et évaluable en situation.
Pour cela, nous allons tenter d’établir le caractère indissociable de la compétence et de l’approche actionnelle, de préciser comment peut être comprise la compétence de communication en situation professionnelle. Enfin, nous proposerons un modèle d’analyse des besoins communicationnels induits par une situation cible, avec les compétences au cœur de ce que nous appellerons le
« périmètre pédagogique », ainsi qu’un schéma synthétisant l’ensemble de la démarche analyse/programmation et les relations situation/tâches/compétences/ressources.
I. La compétence au cœur de l’approche actionnelle
1. Compétence et action
Si l’action peut exister sans la compétence, la réciproque n’est pas vraie, ainsi la définition que proposent Barbier et Galatanu (2004 : 317-318) met en exergue l’inscription des compétences dans le champ de l’action :
Compétences : propriétés conférées à des sujets individuels et/ou collectifs par attribution de caractéristiques construites par inférence à partir de leur engagement dans des activités situées, contingentes, finalisées et parvenues à leurs fins. Les compétences sont des constructions représentationnelles ou discursives porteuses d’évaluation. Elles sont souvent décrites en termes de combinaison de ressources préexistantes.
2
RECHERCHE ENDIDACTIQUE
Les deux auteurs rejoignent ainsi Guy Le Boterf (1994 : 16) pour qui : « il n’y a de compétence que de compétence en acte ».
Dans la même perspective, Nunan, dans son ouvrage sur le TBLT1 (Task Based Learning and Teaching2), présente « l’experiential learning »3, comme une importante base conceptuelle à ce que nous appelons l’approche « par les tâches », ou approche actionnelle. Et le cœur de cet « apprentissage expérientiel est le « learning by doing »4, qui autant au niveau de la forme que du fond, nous rappelle, avec Le Boterf (1994 : 43), que « la compétence se conjugue au gérondif », c’est-à-dire qu’elle émerge et existe en faisant.
Ainsi la compétence se construit dans, par et pour l’action. L’émergence de la compétence, son existence même, et sa mise en œuvre, ne sont pas dissociables de l’action.
2. Compétence et situation
Le terme de « situation »5 est très présent dans le CECR, et la notion de situation est essentielle dans l’approche actionnelle, en effet, c’est à partir de l’analyse de la situation que l’on identifie les tâches à effectuer dans cette situation. Or, la compétence fait corps avec cette situation dans laquelle elle est censée être mise en œuvre, comme l’écrit Le Boterf (1994 : 20) :
S’il n’y a de compétence que mise en acte, la compétence ne peut être que compétence - en - situation. Elle est contingente. Il y a toujours « compétence de » ou « compétence pour ». Ce qui revient à dire que toute compétence est finalisée (ou fonctionnelle) et contextualisée.
L’analyse de la situation de communication nécessite par conséquent l’analyse des compétences en jeu dans cette situation, a fortiori l’analyse de la situation cible en FOS, en tant qu’examen concret d’une situation réelle de communication professionnelle.
1 Voir bibliographie.2 « Enseignement et Apprentissage par les Tâches ».3 « Apprentissage expérientiel ».4 « Apprendre en faisant ».5 La notion de situation-cible, centrale en FOS, est elle aussi le lieu où s’effectuent les tâches, mais outre qu’elle est dûment identifiée, et pas seulement probable ou plausible, elle revêt également, comme nous allons le voir, d’autres aspects, culturels en particulier, du fait de son inscription dans un environnement professionnel.
3. Compétence et tâche
Dans son étude effectuée en 2001 sur les programmes d’éducation post-secondaire aux États-Unis, la NPEC (National Postsecondary Education Cooperative) a choisi de définir la compétence comme « a combination of skills, abilities and knowledges needed to perform a specific task »6 (Le Boterf, 2008 : 19). La compétence ainsi envisagée nous semble assez éloignée des « quatre compétences », ou même des « compétences communicatives langagières » évoquées dans le CECR (CECRL, 2005 : 86). C’est une compétence opératoire, localisée, orientée vers la tâche.
Situation, tâche et compétence sont donc étroitement liées dans l’analyse d’une activité communicationnelle. Une séquence pédagogique actionnelle cohérente se doit d’intégrer ces trois notions clés. De par l’inscription de la compétence dans l’action et la situation, et de par son rapport consubstantiel à la tâche, on ne peut pas parler d’approche actionnelle sans parler de compétences communicatives : dans la situation s’inscrit la tâche, qui peut s’analyser en compétences requises par son exécution.
Que recouvre alors la compétence communicationnelle, en général, et dans une situation professionnelle en particulier ?
II. Aspects des compétences communicationnelles
1. Multicanalité et multimodalité
Les compétences communicationnelles ne s’expriment pas seulement « langagièrement », mais aussi à travers les gestes, les postures. Les éléments non langagiers de la communication font partie de ce qu’on peut appeler la « langue culture », comme l’explique Louis Porcher (Calbris & Porcher, 1989 : 25) : « La gestualité appartient au capital culturel incorporé », ou encore : « Les gestes expriment, à travers une culture incorporée ou apprise, une appartenance sociale, l’identité d’un groupe. »(1989 : 26). Pourtant, même si pour lui « une compétence de communication est composée de compétences linguistiques et de compétences non-linguistiques » (1989 : 9), Porcher précise aussitôt que « dans la communication concrète […] le geste et la parole, le gestuel et le linguistique, sont liés de manière multiple et complexe, mais, systématique […]. » Il n’envisage le langage corporel que du point de vue du « parallélisme phono-gestuel », pour lui geste et parole sont indissociables. On pourrait sans doute discuter du
6 « Une combinaison de techniques, de capacités et de savoirs, requis pour l’accomplissement d’une tâche spécifique ».
3
RECHERCHE ENDIDACTIQUE
rapport de certaines postures, certaines expressions, effectuées en silence, avec le langagier ; il semble que des éléments du « langage du corps » échappent à la logique du discours, et constituent une sorte d’infra-langage, purement émotionnel et difficile à contrôler, mais dont l’importance communicationnelle est pourtant cruciale. Quoi qu’il en soit, on ne peut aborder l’analyse des compétences de communication que d’un point de vue linguistique.
Toutefois, la communication « multicanale » dont parle Porcher ne rend pas compte de tous les facteurs entrant en jeu dans une situation de communication, et ce tout particulièrement en FOS, où celle-ci est, en principe, réelle et analysable physiquement7, comme la « scène » goffmanienne où vont se jouer les interactions. En effet, l’espace, le contexte au sens concret, est présent dans la communication, au niveau de la proxémie, dont Hall considère qu’elle est spécifique à chaque culture (1966 : 142) : « Les modèles de l’espace informel […] jouent un rôle fondamental dans la définition des cultures ». Mais il modèle également les communications verbales et non verbales dans la relation homme-espace (1966 : 131) : « Le territoire est au plein sens du terme un prolongement de l’organisme ». Et (1966 : 136) : « Il est essentiel de comprendre que l’espace à caractère fixe constitue le moule qui façonne une grande partie du comportement humain ».
Goffman (1981 : 45) insiste d’autre part sur l’importance du contexte matériel dans les interactions humaines :
On observera également que le monde matériel peut faire plus que de brèves incursions dans le monde parlé. Il est très courant, en effet, que la structure même du contact social mette en jeu des mouvements matériels plutôt que verbaux (ou gestuels). Les paroles qui se trouvent alors prononcées s’ajustent alors dans une séquence dont la configuration est étrangère à la parole.
Il insiste aussi sur l’importance du contexte social (Goffman, 1981 : 62) :
On doit être prêt également à se rendre compte que la scène sociale de la parole, non contente de fournir ce que l’on appelle le contexte, peut pénétrer jusque dans la structure même de l’intérieur et la déterminer.
7 Sauf dans certains cas où l’accès à la situation cible est réduit.
Le Boterf de son côté (1994 : 122) évoque un « système socio-technique » influant directement sur la mise en œuvre des compétences professionnelles, et donc inévitablement sur l’émergence et la mise en œuvre des compétences communicationnelles. La compétence de communication, pour avoir toute son épaisseur, son authenticité, doit donc prendre en compte cette « multimodalité », dont parle David Block, pour qui (2010 : 158) « toute communication est multimodale – de manière variable et différente selon les contextes et les interlocuteurs – mais multimodale de toute façon ». Il reprend la définition de la multimodalité de Goodwin et Goodwin (2004 : 239), comme « l’entrejeu entre les ressources sémiotiques fournies par le langage d’un côté, et les outils, les documents, les artefacts de l’autre » (inBlock, 2010 : 158), et considère « qu’il faudrait réorienter la compétence de communication vers le multimodal et l’incorporé. » (Block 2010 : 162)
Nous pouvons quant à nous envisager la dimension « multimodale » de la communication professionnelle, notamment à travers :
l’interaction homme-homme l’interaction homme machine8
l’interaction homme-espace l’inscription des interactions dans un espace donné l’interdépendance de ces interactions
2. Communication et cultures en situation professionnelle
Les compétences communicationnelles s’inscrivent dans une situation spécifique, mais également dans un contexte culturel complexe, où se croisent différentes strates et différents axes, qu’il convient de prendre en compte, d’une manière ou d’une autre. Elles sont « doublement situées » (Pekarek-Doehler, 2005 : 47) :
En ce sens, la cognition – et avec elle les compétences – est doublement située : elle est située dans les contingences locales des activités quotidiennes et dans la définition historique, socioculturelle de la situation.
Les cultures en jeu dans la situation cible sont donc cruciales pour l’analyse des compétences. Si on retrouve les mêmes caractéristiques que dans l’enseignement des langues cultures en général, les cultures professionnelles s’y ajoutent, et en premier lieu, celle de l’organisation qui « héberge » la situation cible (Crozier & Friedberg, 1977 : 196) :
8 Que l’on peut rapprocher de l’ « interface homme-machine »des ergonomes.
4
RECHERCHE ENDIDACTIQUE
le phénomène organisationnel apparaît en dernière analyse comme un construit politique et culturel9, comme l’instrument que des acteurs sociaux se sont forgé pour “régler” leurs interactions de façon à obtenir le minimum de coopération nécessaire à la poursuite d’objectifs collectifs, tout en maintenant leur autonomie d’agents relativement libres.
La communication en entreprise reflète pour partie la culture de l’organisation, mais d’autres flux culturels traversent le milieu professionnel. Selon Florence Osty (2003 : 104), l’acteur professionnel s’inscrit dans une « double socialisation par le métier et l’entreprise », elle distingue ainsi (2003 : 103) deux axes d’intégration de l’acteur, celui de l’intégration professionnelle (au métier) et celui d’intégration à l’entreprise, en fonction desquels l’acteur se positionne. Françoise Pioter (2002 : 14) parle d’une inscription horizontale, et d’une inscription verticale de l’acteur :
Cet ensemble de dimensions qui caractérise le métier va autoriser des modes d’action collectives et individuelles positionnés « horizontalement » par opposition à une conception verticale des emplois.
Il ne faut bien sûr pas oublier, dans les strates horizontales de la culture, le secteur d’activité de l’organisation (grande distribution, automobile, banque, assurance, tourisme…) qui véhicule lui aussi des valeurs, des représentations, des modes de comportement, influant forcément sur l’émergence et la mise en œuvre des compétences.
Nous pouvons alors schématiser l’inscription culturelle des compétences dans la situation cible comme suit :
9 Au sens où « culturel » s’oppose à « naturel » (note des auteurs).
3. Les « compétences plurielles »
Enfin les compétences communicationnelles ne sont pas isolées des autres compétences en action dans la situation professionnelle, elles émergent et entrent en jeu de manière simultanée. Goffman (1981 : 151) parle ainsi de « tâches conjointes », fixant la nature des échanges :
Bien souvent, le contexte de l’énonciation n’est pas réellement une conversation, mais plutôt quelque entreprise matérielle dont des événements non linguistiques forment le centre.
Il prend pour illustration certaines prestations de service, où « c’est la transaction matérielle qui forme le contexte significatif en même temps que l’unité d’analyse pertinente. » (Goffman, 1981 : 151). Richer (2009 : 31), quant à lui, parle de « compétences plurielles » :
La compétence ne se présente jamais seule, mais constamment couplée à d’autres compétences car l’activité professionnelle requiert toujours des compétences plurielles.
Cette pluralité des compétences pose le problème de l’identification et de l’articulation des actes communicationnels en jeu dans les interactions, et des modalités de leur prise en compte et de leur analyse dans le cadre des compétences à acquérir durant la formation, comme l’indique Daniel Coste (2009 : 16) :
D’une manière générale, la didactique des langues, tout comme l’analyse linguistique, n’a que relativement peu pris en compte l’action dans sa complexité et en particulier le fait que les activités langagières, lorsqu’elles accompagnent, commentent ou dépendent d’autres activités intervenant dans l’action, se trouvent de facto structurées par celles-ci plus que par une forme de cohérence (progression thématique, organisation discursive ou conversationnelle) “interne”.
Elle pose également le problème de distinguer compétence professionnelle et compétence communicationnelle, alors que les deux sont intimement liées, en particulier dans les relations de service.
5
RECHERCHE ENDIDACTIQUE
III. Un modèle d’analyse de la situation cible par les tâches, les compétences et les ressources
1. Compétences et ressources
Barbier et Galatanu10 définissent la compétence comme une « combinaison de ressources préexistantes ».Il faut alors s’interroger sur ce que doivent être ces ressources. Il nous semble qu’on peut en distinguer trois sortes principales dans notre cas : les ressources strictement langagières, les ressources non verbales (kinésiques, proxémiques…), et les ressources culturelles au sens large également (voir le schéma en 3). Bien sûr ces ressources s’entremêlent dans la pratique. Il faut les identifier pour l’analyse, mais concevoir leur mobilisation sur le mode « combinatoire » :
La compétence ne réside pas dans les ressources (connaissances, capacités…) à mobiliser mais dans la mobilisation même de ces ressources. La compétence est de l’ordre du « savoir-mobiliser ». Pour qu’il y ait compétence, il faut qu’il y ait mise en jeu d’un répertoire de ressources (connaissances, capacités cognitives, capacitésrelationnelles…). Cet équipement est la condition de la compétence. C’est l’amont qui la rend possible” (Le Boterf, 1994 : 17).
Richer (2009 : 34-35) synthétise ce que doit être la compétence dans une approche actionnelle de l’enseignement/apprentissage des langues :
« un ensemble de ressources que le sujet peut mobiliser pour traiter une situation avec succès11 ».
Les ressources langagières, non verbales, culturelles, sont donc indispensables, mais subordonnées à la compétence, puisque la compétence les mobilise de manière combinatoire en vue de l’action, et que ces ressources n’ont pas d’efficacité actionnelle hors du cadre de leur mobilisation par la compétence12.
10 Voir supra, I, 1.11 On peut même préciser ce dernier point : « pour accomplir avec succès les tâches induites par la situation. »12 Chaque enseignant de FLE sait par exemple que maîtriser les paradigmes verbaux des temps du passé ne rend pas les étudiants capables de raconter une histoire ; il faut pour cela d’autres ressources, et surtout savoir les combiner de manière efficace.
2. Compétences et tâches
La compétence est le pivot, l’articulation entre les ressources, et la tâche, qu’elle soit :
« pédagogique » : lieu d’émergence et d’entraînement de la compétence « en classe »ou
« cible »13 : finalité actionnelle de la formation, et lieu de l’« évaluation externe » des compétences réelles du stagiaire FOS.
Ce que vise l’apprentissage, c’est bien l’acquisition de compétences, pas l’accomplissement de tâches : ces dernières sont, soit un moyen, soit une finalité externe à la formation. De plus si les compétences sont situées et contingentes, elles n’en sont pas moins transférables, et donc garantes d’autonomie, et de succès dans l’exécution des tâches cibles en situation réelle :
Être compétent, c’est « savoir transférer ». La compétence ne saurait se limiter à l’exécution d’une tâche unique et répétitive à l’identique. Elle suppose la capacité d’apprendre et de s’adapter (Le Boterf, 1994 : 22).
Il nous semble alors que ce sont bien les compétences qui sont la clé de l’approche actionnelle, elles donnent du sens aux savoirs et savoir-faire langagiers, communicationnels et culturels, leur donnent une validité, une efficacité dans l’action, et elles permettent d’effectuer les tâches de manière performante et autonome :
Être compétent, c’est répondre à la question : « Que faire, lorsqu’on ne me dit plus comment faire ? » (Zarifian, 2004 : 45)
13 Nous empruntons la distinction « target task » (« tâche cible ») / « pedagogical task » (« tâche pédagogique ») à Nunan (voir bibliographie).
6
RECHERCHE ENDIDACTIQUE
3. Un modèle d’analyse de la situation cible
Ainsi envisagées, les compétences doivent être au cœur de l’analyse des besoins en communication : l’objectif est de permettre en classe de FOS l’émergence de compétences indispensables à la performance en situation cible. C’est donc le rôle de l’enseignant/formateur de s’assurer à travers ses pratiques de classe que les étudiants conceptualisent et s’autonomisent.
L’analyse de la situation cible consiste donc ici à identifier les « tâches cibles » à effectuer dans cette situation, puis à identifier et sélectionner les compétences à faire émerger, à consolider, ou simplement à vérifier chez les stagiaires, en vue de la performance dans l’exécution des tâches de la situation cible14. Cela implique du discernement, et des choix, dans lesquels il faut prendre en compte l’aspect « partiel » de certaines compétences, la transférabilité de compétences d’une tâche à une autre, d’une situation cible à une autre, le niveau initial et les manques réels des apprenants, entre autres facteurs. La définition du « périmètre pédagogique », en termes qualitatifs et quantitatifs, va donc au-delà de la première analyse des besoins15, et elle est, bien sûr, évolutive.
14 Compétences qui constituent, avec les ressources requises, le « périmètre pédagogique ».15 Voir la distinction entre « nécessités » (« necessities ») et « manques » (« lacks ») chez Hutchinson et Waters (voir bibliographie).
4. Un cas d’analyse de situation cible
L’illustration pratique qui suit a été élaborée par des enseignants et spécialistes du français médical16
dans le cadre d’un séminaire organisé par l’AUF17. Ce séminaire avait pour objectif une réflexion théorique et pratique sur l’approche actionnelle et ses mises en œuvre pédagogiques : exercices, activités, tâches, projets, simulations. La première session a eu lieu à Cluj, en Roumanie, en décembre 2009, la seconde à Plovdiv, en Bulgarie, en juin 2010. Voici une proposition d’analyse d’une situation cible18 par les tâches, les compétences et les ressources, faite par un des groupes d’enseignants et médecins lors de la seconde session19.
Situation cible : Consultation d’un patient pendant le stage clinique de fin d’études médicalesLieu : cabinet dentaireActeurs : étudiant, patient, médecin-enseignantApprenants : étudiants de 4e année, niveaux B1-B2
Tâches induites par la situation cible (tâches cibles) :T1 : établir l’anamnèseT2 : réaliser la consultation proprement diteT3 : remplir la fiche d’observation
Compétences requises par les tâches cibles :
Tâche 1 :C1 : obtenir des informations sur l’état général de santé du patientC2 : obtenir des informations sur l’historique de la pathologie du patient en utilisant le vocabulaire spécialisé
Tâche 2 :C3 : vulgariser un discours scientifique C4 : donner des consignes au patient pendant qu’on l’observe, le palpe, l’écoute…C4 : commenter les actes et les gestesC5 : rassurer, mettre en confiance
Tâche 3 :C6 : maîtriser les notions clés pour la fiche d’observation
16 A l’articulation entre FOU, FOS et FLP.17 Nous tenons vivement à remercier Vincent Henry coordinateur de projets pour l’AUF, Adriana Rosu, Chargée des Relations Internationales à l’Université de Médecine et Pharmacie « Iuliu Hatieganu » de Cluj-Napoca, et Aneta Tosheva, enseignante en français médical à l’Université Médicale de Plovdiv, principaux organisateurs de ce séminaire, ainsi que tous ses participants.18 Il s’agit d’une première version, non définitive et non complète, mais éclairante nous semble-t-il.19 Ce groupe était composé de : Adriana Rosu, Aneta Tosheva, Sanda Tomoiaga, enseignante de français médical à Cluj, et Andreea Kurtinecz, docteur en odontologie et enseignante en français médical à Cluj.
7
RECHERCHE ENDIDACTIQUE
Ressources : Lexique spécifique (antécédents personnels et
familiaux, historique de la maladie courante) Modalisateurs d’atténuation du discours : « pourriez-
vous me dire… », « mettez-vous à l’aise », « qu’est-ce qui vous amène aujourd’hui ? », « vous n’avez rien à craindre »…
Temps du passé Futur et futur proche : « cela ne prendra que quelques
minutes », « on va soulager votre souffrance », « vous n’aurez plus d’ennuis par la suite »…
Impératif : « ouvrez », « fermez », « serrez », « ne bougez pas »…
5. Synthèse de la démarche : analyse et mise en œuvre
Le modèle d’analyse, « descendant », constitue le travail d’ingénierie qui fait prélude à la phase « ascendante »20, pédagogique, d’émergence et d’entraînement des compétences, à travers une approche actionnelle basée sur les tâches pédagogiques « d’activation »21, les projets pédagogiques, et les simulations de « tâches cibles », ou tâches « de répétition »22, une approche motivante et créatrice de sens « centrée sur l’apprentissage ».23 Nous pouvons schématiser l’ensemble de la démarche par un parcours circulaire dont le point de départ et le point d’arrivée est la situation cible :
20 Puisque remontant du périmètre pédagogique vers la situation cible.21 Cette typologie est empruntée à Nunan (voir bibliographie).22 Voir Nunan23 La « learning-centred approach » de Hutchinson et Waters (voir bibliographie).
Conclusion
Le modèle et les schémas proposés ici ont pour objectif de replacer la compétence au centre de l’analyse, et de clarifier les relations entre les notions clés de l’approche actionnelle et certaines notions clés du FOS. Le statut premier de la compétence dans la pratique pédagogique permet alors comme nous l’avons dit, de donner du sens à la forme, aux savoirs et savoir-faire communicationnels. Elle permet aussi d’éviter le risque de psittacisme pédagogique dénoncé chez Munby par Hutchinson et Waters.
Nous avons ainsi essayé de montrer en quoi la prise en compte des compétences peut être considérée comme essentielle à l’approche actionnelle. La compétence naît dans l’action, et rend seule capable d’être performant dans l’action, d’effectuer les tâches de manière satisfaisante : un individu non compétent n’est pas en mesure d’effectuer les tâches cibles. Ces dernières sont au départ de l’analyse des besoins, et les tâches d’activation, projets pédagogiques et simulations des tâches cibles sont des moyens pour faire émerger et mettre en œuvre ces compétences en tant que combinaisons de ressources orientées vers l’action. Mais les tâches de répétition/simulations ne sont pas la réalité, ce sont donc bien les compétences, transférables, qui permettront aux apprenants de s’adapter aux variations inévitables entre la pratique pédagogique24 et la réalité toujours en partie insaisissable de la situation cible à laquelle ils seront confrontés à l’issue de la formation. Toutefois, les compétences communicationnelless’inscrivent dans des réseaux complexes de contextes, d’activités, de cultures, qu’il faut prendre en compte. Il n’est pas évident alors d’identifier les tenants et les aboutissants de ces compétences. Cela peut rendre le travail d’analyse des besoins plus complexe, mais peut-être aussi plus riche, plus cohérent, voire plus pertinent, en tout cas dans le cadre d’une perspective actionnelle.
24 Fût-elle soigneusement modelée sur les tâches cibles, voire effectuée sur le lieu même de la situation cible.
8
RECHERCHE ENDIDACTIQUE
Bibliographie
BARBIER J.-M., GALATANU O. (dir.) (2004), Les savoirs d’action : une mise en mots des compétences ?, Action et Savoir, L’Harmattan.
BLOCK D. (2010), « La compétence de communication revisitée : multimodalité et incorporation », in Le Français dans le monde, Recherches et Applications n°48, Interrogations épistémologiques en didactique des langues.
CALBRIS G. & PORCHER L. (1989), Geste et communication, LAL (Langues et apprentissage des langues) Crédif Hatier/Didier.
CONSEIL DE L’EUROPE (2005), Cadre Européen Commun de Référence pour les langues, Didier.
COSTE D. (2009), « Tâche, progression, curriculum », in Le Français dans le monde, Recherches et Applications, in Le Français dans le Monde, Recherches et Applications n°45, La perspective actionnelle et l’approche par les tâches.
CROZIER M., FRIEDBERG E. (1977), L’acteur et le système, Éditions du Seuil.
GOFFMAN E. (1981), Façons de parler, Collection Le sens commun, (1987 pour la traduction française), Les Éditions de Minuit.
HALL E. T. (1966), La dimension cachée, Doubleday & C°, New York, (1971 pour la traduction française), Seuil.
HUTCHINSON T., WATERS A. (1987), English for Specific Purposes. A Learning centred Approach, Cambridge University Press.
HYMES D. H. (1973), Vers la compétence de communication, LAL (Langues et apprentissage des langues) Crédif Hatier/Didier (1991 pour la traduction française).
LE BOTERF G. (1994), De la compétence. Essai sur un attracteur étrange, Les Editions d’organisation.
LE BOTERF G. (2009), Repenser la compétence, Pour dépasser les idées reçues : 15 propositions, Eyrolles, Éditions d’organisation (4e édition).
NUNAN D. (2004), Task-Based Language Teaching, Language Teaching Library, Cambridge University Press.
OSTY F. (2003), Le désir de métier. Engagement, identité et reconnaissance au travail, Collection « des Sociétés », Presses Universitaires de Rennes, Rennes.
PEKAREK-DOEHLER S. (2005), « De la nature située des compétences en langue », in J.-P.Bronckart, E. Bulea, M. Pouliot (éds), Repenser l’enseignement des langues : comment identifier et exploiter les compétences, Presses Universitaires du Septentrion.
PIOTET F. (2002), « Introduction. La révolution des métiers », in F. Piotet (dir.), La révolution des métiers, Le lien social, PUF, Paris.
PUREN C. (2009), « Variation sur la perspective de l’agir social en didactique des langues cultures étrangères », in Le Français dans le Monde, Recherches et Applications n°45, La perspective actionnelle et l’approche par les tâches.
RICHER J.-J. (2009), « Lectures du Cadre : continuité ou rupture ? », in M.-L. Lions-Olivieri & P. Liria (coord.) L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues, Difusión FLE, Barcelone.
ZARIFIAN P. (2004), Le modèle de la compétence, Editions Liaisons (2e édition).