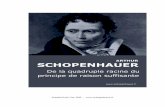Les Règles de composition par M.r Charpentier : statut des sources
-
Upload
paris-sorbonne -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Les Règles de composition par M.r Charpentier : statut des sources
LES RÈGLES DE COMPOSITION PAR MONSIEUR CHARPENTIER :STATUT DES SOURCES
Théodora PSYCHOYOU
Tous les musiciens et musicologues qui s’intéressent à la musique du XVIIe siècleconnaissent les Règles de composition de Marc-Antoine Charpentier, du moinsl’« Énergie des modes », une typologie originale de propriétés expressives des dif-férentes transpositions des modes majeur et mineur. Si le contenu de ce texte n’apas retenu l’attention dans son intégralité, il occupe néanmoins, selon la perceptionmusicologique actuelle, une place de choix dans le paysage théorique français deson temps, circonscrit par la monumentale Harmonie universelle de Marin Mersennede 1636, et le Traité de l’harmonie de Jean-Philippe Rameau de 1722, œuvres-phareschacune en son siècle. Mais quel rapport entretiennent ces Règles avec le discourscontemporain, celui de la fin du XVIIe siècle, autrement dit avec les écrits qu’ontpubliés des maîtres de musique tels Nivers, Masson, Loulié ou Brossard ?Autrement dit encore, quelle « densité » extraire de ce texte connu par une sourcemanuscrite 1, non autographe, probablement lacunaire et sans doute désordonnée?Dans quelle mesure permet-elle de considérer et de mesurer le statut de théoriciende la musique que revêt Charpentier ? Et le statut de pédagogue? Et, dans ce cas,quelles acceptions donner à ces désignations : « théoricien », « pédagogue » ? L’avisde Sébastien de Brossard esquisse le « statut théorique de Charpentier » : le musi-cien a été considéré par ses contemporains comme un musicien « sçavant » et, dumoins par Brossard, comme un théoricien de la musique. Cela non pas du fait de sesRègles, en vérité inconnues en dehors d’un cercle de personnes extrêmement réduit,mais par à sa musique. La façon exceptionnelle dont Brossard, un des rares àconnaître les Règles, commente, dans le Catalogue de sa collection 2, l’unique parti-tion imprimée de Charpentier dont il possédait un exemplaire, celle de Medée, estfort significative, mais également déroutante, tant elle questionne la vocation nor-mative du « théoricien » :
— « C’est celui de tous les opéras sans exception dans lequel on peut apprendre plus dechoses essentielles à la bonne composition. C’est ce qui fait que j’ai douté longtemps sije ne devais pas le mettre plutôt parmi les théoriciens, c’est-à-dire parmi les maîtres del’art de la musique, que dans le rang des simples opéras. » 3
87
1. Il existe également un second manuscrit, dont il sera question plus loin, qui est la copie tardive du premier.2. Sébastien de Brossard, Catalogue des livres de Musique, manuscrit autographe (1724), F-Pn/ Mus. Rés.
Vm8. 20 ; il existe une seconde source manuscrite, copie de l’autographe (F-Pn/ Mus. Rés. Vm8. 21) etune édition moderne, La Collection Sébastien de Brossard 1655-1730 : Catalogue édité et présenté par Yolandede Brossard, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1994. Nos renvois concernent la pagination de lapremière source, référencée dans l’édition moderne.
3. Ibid., p. 228. Notons qu’ailleurs, dans l’article « Theorico » de son Dictionnaire de musique (Paris, 1703),Brossard donne une définition bien différente de celle induite ici : « THEORICO, en François THEORICIEN,
La réception si ample, aujourd’hui, des Règles de composition, texte qui est devenuun outil d’intention interprétative de la musique baroque, dans l’exécution commedans l’analyse, est aux antipodes d’une réception inexistante à l’époque de sa rédac-tion, mais la postérité en a créé, comme pour bien d’autres domaines de l’activitéhumaine, son propre mythe. Le destin extraordinaire de ces Règles de composition res-semble à celui de son auteur : longtemps oublié, redécouvert lors du renouveau dela musique baroque, il est considéré à présent comme étant l’un des compositeursles plus géniaux du XVIIe siècle. Du reste, l’autorité qu’est Charpentier en matièrede composition musicale, une auctoritas aujourd’hui incontestée, par rapport auxauteurs de traités de musique de la fin du XVIIe siècle – René Ouvrard, Bénigne deBacilly, Jean Rousseau, Charles Masson, Étienne Loulié, Michel L’Affilard et biend’autres – participe certainement au statut très particulier de ces Règles de composi-tion 4. Il sera question dans cet article essentiellement de la source documentaire àtravers laquelle nous connaissons ce texte, les quelques précisions qui seront misesen évidence se donnant ici pour objectif d’apporter un éclairage méthodologiquesupplémentaire sur la façon de considérer le contenu. Rappelons-le, si les Règles etl’« Énergie des modes » sont très largement connues aujourd’hui, elles eurent uneréception quasi nulle de leur temps. Pour souligner cela et afin de mieux circons-crire le texte, il est important de considérer non seulement le texte dans son conte-nu, mais aussi le manuscrit dans l’étonnante aventure de sa transmission.
L’histoire de la réception actuelle commence en 1945, lorsque Claude Crussard 5,musicologue et musicienne pionnière du renouveau baroque, consacre un travailspécifique aux Règles de composition de Charpentier. Dans son « Marc-AntoineCharpentier théoricien » 6, elle propose une présentation systématique et commen-
LES MANUSCRITS AUTOGRAPHES DE MARC-ANTOINE CHARPENTIER
88
qui ne s’applique qu’à la Théorie. Musico Theorico, selon les Italiens est un Musicien, non seulement quine s’attache qu’à la Théorie, mais aussi qui n’a écrit ou donné au Public que des Traitez touchant laMusique, quoyque d’ailleurs il fût peut-être un excellent Pratticien. »
4. Un exemple analogue de cette sorte d’auctoritas, tout aussi fascinant, est celui du Compendium musicæ deRené Descartes, écrit en 1618, premier texte connu d’un jeune homme âgé alors de vingt-deux ans.Resté inédit, ce bref texte ne fut publié pour la première fois qu’en 1650, de manière posthume: laréception extraordinaire qu’il connut dès sa première édition n’était plus celle d’un bref essai qu’unjeune homme offrit à son maître, mais d’un traité écrit par l’auteur du Discours de la méthode et desMéditations métaphysiques, par un philosophe qui fut reçu comme un véritable monument dès la secondemoitié du XVIIe siècle.
5. Les travaux précurseurs de Claude Crussard (1893-1947) annoncent le retour à la musique baroque, enun temps où peu de gens y portaient attention. Tout d’abord, elle fait revivre cette musique au concertavec l’ensemble instrumental Ars Rediviva, qu’elle fonde et dirige. Elle fait partie des premiers chefs àenregistrer le répertoire de la « musique ancienne » à partir de 1935, à la Boîte à musique, un des premierslabels spécialisés dans ce domaine avec l’Oiseau-lyre et l’Anthologie sonore, créés dans les années 1932-1935. Rappelons que l’avènement du disque participe alors à l’évolution de l’écoute et des pratiquesmusicales, octroie la reconnaissance du public à l’égard de ce répertoire peu exploré et encourage larecherche musicologique, domaine auquel Claude Crussard a également contribué, avec notamment sonouvrage, Un musicien français oublié, Marc-Antoine Charpentier, 1634-1704, Paris, Fleury, 1945. Elle mourutprématurément dans un accident d’avion au Portugal, en 1947. Sur Claude Crussard, voir le recueil col-lectif Ars rediviva (1935-1947), Paris, La Boîte à musique, 1951 ; voir par ailleurs Norbert Dufourcq, « Ledisque et l’histoire de la musique. Un exemple : Marc-Antoine Charpentier », ‘Recherches’ sur la musiquefrançaise classique, III (1963), p. 207-220.
6. Revue de musicologie, XXIV/74-75 (2e-3e trimestres 1945), p. 49-68.
tée des règles, nourrie de la confrontation de plusieurs points avec d’autres traités,en remontant, notamment pour certaines questions de contrepoint, des Institutioniharmoniche (1558) de Zarlino jusqu’au Gradus ad Parnassum (1725) de Johann JosephFux, dont la formulation des règles concernant l’enchaînement des accords est éton-namment proche de celle de Charpentier. Les Règles de composition de Charpentierétant toujours inédites en 1947 et, de ce fait, inconnues, Claude Crussard s’était fixépour but de « tourner les quelques feuillets sur lesquels se sont inscrites les recom-mandations d’un maître dont la pédagogie s’est révélée tour à tour imprécise, minu-tieuse et souvent fort originale » 7. Elle n’établit pas l’édition du texte stricto sensu,mais rapporta plusieurs extraits dont la liste des propriétés expressives attribuéesaux différentes transpositions des modes majeur et mineur ou, selon les termes deCharpentier, l’« Énergie des modes » 8. Plus de vingt ans plus tard, en 1967, LillianRuff, musicologue britannique, auteur d’une thèse inédite sur les théoriciens de lamusique anglais du XVIIe siècle 9 et correspondante régulière de la revue Consort surdivers sujets de musique ancienne, publia, dans cette revue, une traduction enlangue anglaise ainsi que la reproduction en fac-similé de la copie qu’ÉtienneLoulié avait faite des Règles 10. Il a fallu attendre encore une vingtaine d’années pourvoir paraître, en 1988, la première édition annotée de ce texte, en annexe à la mono-graphie de référence que Catherine Cessac a consacrée à Marc-AntoineCharpentier, récemment rééditée, en 2004 11. Depuis cette étude incontournablelargement diffusée, rares sont les essais d’analyse de la musique française de cetteépoque qui tiennent compte, de près ou de loin, de la désormais célèbre « Énergiedes modes » due à Charpentier.
La source des Règles constitue un exemple unique en son genre ; c’est la raisonpour laquelle son contenu ne suit pas tout à fait la norme du traité de compositiontelle qu’elle se dessine dans la seconde moitié du siècle, autrement dit selon lemodèle qui se met en place dans les traités de La Voye Mignot 12, de Nivers 13 avantlui, et de Charles Masson 14 un peu après. Ces trois noms recouvrent à eux seulsl’essentiel de la production française de cette époque en termes d’édition de traitéde composition. Le genre est alors assez rare, pour une raison liée sans doute à laréception de telles publications par le potentiel public amateur. On rencontrera, eneffet, plus volontiers des méthodes de musique, ainsi que des traités d’accompagne-
THÉODORA PSYCHOYOU : LES RÈGLES DE COMPOSITION PAR MONSIEUR CHARPENTIER
89
7. Ibid., p. 68.8. Notons à ce sujet la petite erreur de Crussard, au sujet de mi mineur, « efféminé, amoureux et plaintif » :
il s’agit, dans le manuscrit, d’« effeminé » et non d’« effemmé », comme l’écriture de la main de Louliéa pu le laisser penser.
9. Lillian M. Ruff, The Seventeenth-Century English Music Theorists, Ph.D. Dissertation, NottinghamUniversity, 1962.
10. Lillian M. Ruff, « Marc-Antoine Charpentier’s Règles de composition », The Consort, XXIV (1967), p. 233-270.11. Catherine Cessac, Marc-Antoine Charpentier, Paris, Fayard, 1988, 2/2004, p. 471-496.12. Le sieur de La Voye Mignot, Traité de musique, pour bien et facilement apprendre à chanter & composer, Paris,
1656 ; réémissions 1659, 1666.13. Guillaume Gabriel Nivers, Traité de la composition de musique, Paris, 1667 ; réédition, 1712 ; réédition bilin-
gue français-flamand à Amsterdam, 1697.14. Charles Masson, Nouveau traité des règles de la composition de la musique, Paris, 1697 ; réédition, 1699, 1700,
1701, 1705, 1738 ; réédition, Amsterdam, ca 1708.
ment et de basse continue, du reste sensiblement plus nombreux à l’aube du XVIIIe
siècle et souvent, il est vrai, combinés avec quelques rudiments élémentaires de lacomposition, du moins dans la déclaration d’intention 15. En revanche, seuls Nivers,La Voye Mignot et Masson firent paraître des traités consacrés à l’art de composerdans la seconde moitié du XVIIe siècle. À côté de ceux-là, nous pouvons encore consi-dérer l’édition de René Ouvrard intitulée Secret pour composer la musique par un artnouveau qui parut de façon anonyme en 1658, puis fut réémise avec nom d’auteuren 1660. Cet ouvrage reste toutefois marginal, puisqu’il expose une méthode decomposer ou, plus précisément, de faire superposer des sons et de juxtaposer desaccords de manière correcte, par le moyen de la combinaison de nombres 16. Outreles exemples cités, il existe quelques sources manuscrites de règles de composition,telles celles de René Ouvrard, d’Étienne Loulié, de Sébastien de Brossard et, enfin,de Marc-Antoine Charpentier.
La différence du support a son importance, puisque, surtout à cette époque où lapratique amateur est en plein essor, la méthode imprimée s’adresse, en général, à unlecteur qui souhaite très précisément apprendre à réaliser un acte musical, plutôtque méditer sur la matière musicale elle-même, maîtriser ses codes composition-nels, étudier sa science ou connaître son histoire. Les résultats devront être satisfai-sants en peu de temps et, de préférence, sans beaucoup de peine. De plus, détailfondamental, le manuel doit tendre, dans la mesure du possible, à dispenser l’élèvelecteur de la nécessité d’un maître de musique. Les titres et les préfaces des traitéstémoignent de cette attitude, dont la dialectique frise souvent l’imposture :
— « Secret pour composer en musique par un art nouveau, que ceux mesmes qui ne sçaventpas Chanter, pourront en moins d’un jour composer à quatre parties sur toute sorte deBasse ». 17
ou
— « Mon dessein est de donner au Public la Methode la plus courte pour mettre un Ecolieren état de se passer de Maître. Je ne me sers d’aucun terme qui ne soit clair par luy même
LES MANUSCRITS AUTOGRAPHES DE MARC-ANTOINE CHARPENTIER
90
15. À commencer dès 1700, avec le Traité abregé de l’Accompagnement pour l’Orgue et pour le Clavecin, avec uneExplication facile des principales Regles de la Composition, une démonstration des Chiffres, & de toutes les manié-res dont on s’en sert ordinairement dans la Basse-Continuë, de Jacques Boyvin. Notons que l’ouvrage necomporte en tout que 16 pages, qui ne permettent pas une approche approfondie de la composition, déjàpériphérique à l’objectif principal de l’auteur.
16. Issue d’un défi double, d’abord intellectuel pour le compositeur féru de mathématiques que futOuvrard, puis pédagogique pour le maître de musique de la Sainte Chapelle du Palais qu’il fut égale-ment, cette idée est inspirée des théoriciens philosophes, tels Mersenne et Kircher, qui s’y étaient déjàintéressés. Cette méthode de composer par les nombres enchanta également Sébastien de Brossard, quil’a apprise grâce à la Musurgia universalis (Rome, 1650) de Kircher, comme il témoigne dans ses notespersonnelles : « Ce secret [celui de Kircher] au reste est d’autant plus admirable qu’il donne le moyende composer le sujet et les 3 autres parties tout a la fois [...]. Je vins à bout de penetrer ce secret a l’aagede 23 a 24 ans, et je ne faisois point en ce tems la de musique a 4 parties que par ce moyen, et cela sansavoir qu’une tres legere teinture de musique » (Catalogue, op. cit., p. 284).
17. René Ouvrard, Secret pour composer la musique par un art nouveau, Paris, 1658, page de titre.
ou que je n’explique. Je ne dis rien de ce qui regarde l’esprit qui ne se puisse entendresans le secours d’un Maître ». 18
Si les rudiments du chant – c’est-à-dire le solfège d’alors – ainsi que les grillespour l’accompagnement peuvent être circonscrits « sans le secours d’un Maître »,certes avec plus ou moins de bonheur, l’apprentissage de la composition ne peut enfaire l’économie. Les traités de composition ne peuvent du reste garantir au lecteurque l’art de composer sans fautes dans la syntaxe musicale, et non l’art de biencomposer la musique, la limite étant généralement suggérée dès les préfaces ouavertissements. Cette particularité n’encourage pas la production de tels manuels,de fait beaucoup moins nombreux que les ouvrages du type « principes de musi-que ». L’art de composer est en effet réservé, en principe, au professionnel ; celui-ciy accède par un chemin qui ne passe généralement pas par le manuel écrit mais viaun cursus qui lui dispense un enseignement complet, dans la plupart des cas dès sonplus jeune âge au sein d’une maîtrise. C’est un enseignement de terrain, et ladémarche du jeune apprenti ne passe pas par l’étude d’un code écrit mais par l’exer-cice pratique, quand bien même l’utilisation du traité viendrait la consolider. Dansla seconde partie du siècle pourtant se fait sentir la nécessité d’un changement, d’unélargissement dans la transmission de l’art de composer, l’existence de jeunes pro-digues tant de la composition que de l’instrument et, de surcroît, de femmes,comme Élisabeth Jacquet de La Guerre, étant à la fois le signe et la conséquencede cette nouvelle demande. Progressivement, l’art de composer ne semble plusconstituer une activité réservée exclusivement aux seuls jeunes pages des institu-tions religieuses (ou, dans un genre tout autre, aux ménétriers). Cette manifestationd’un public désireux de manuel de composition correspond chronologiquement auchangement dans le langage et dans la manière de composer ; la demande concerneessentiellement la musique concertante, où la construction dessus/basse l’emportesur la texture contrapuntique imitative, ce qui d’ailleurs rend la musique plus acces-sible, plus simple du point de vue de sa perception et de sa compréhension par lepublic 19. Est-ce cette impression de simplicité qui incite le public à vouloir, luiaussi, s’initier et pratiquer l’art non plus de Claudin Le Jeune ou de Roland deLassus mais de Jean-Baptiste Lully ? L’apparition des traités de composition de la« nouvelle mouture » coïncide plus ou moins à celle de la basse continue et des trai-tés d’accompagnement, celui de La Voye Mignot en étant le premier.
Les Règles de composition de Charpentier n’ont pas été rédigées dans la perspectived’une publication et ne subissent donc pas les contraintes ni les limites du genre.Le compositeur les a rédigées à l’intention du duc de Chartres, le futur ducd’Orléans puis Régent, qui fut son élève sans doute entre octobre 1692 etjuin 1693 20 ; elles viennent donc compléter et préciser des points abordés pendant
THÉODORA PSYCHOYOU : LES RÈGLES DE COMPOSITION PAR MONSIEUR CHARPENTIER
91
18. Étienne Loulié, Éléments ou Principes de Musique, Paris, 1696, p. 3.19. Claude Perrault souligne ce caractère plus accessible de la nouvelle musique, à la fin de son essai De la
Musique des anciens, vol. 2 de ses Essais de physique, Paris, 1680.20. Sur le duc de Chartres, « disciple » de Charpentier, voir Patricia M. Ranum, « Étienne Loulié (1654-
1702) : Musicien de Mademoiselle de Guise, Pédagogue et Théoricien », ‘Recherches’ sur la musique fran-çaise classique, XXV (1987), p. 71-75, et C. Cessac, op. cit., p. 405-406.
le cours. Le protocole logique, habituel, de définitions des termes du langage musi-cal (intervalles, modes, mesures, etc.) n’y figure pas, mais les nombreux conseils,synthèses, aide-mémoire et astuces pour parvenir à l’art de bien composer lui confè-rent un caractère unique. Est-ce cette simplicité efficace qui exprime le succès dutraité aujourd’hui ? Dans le même temps, il y a un intermédiaire entre nous et lapensée de Charpentier : la main et, a fortiori, le discernement et les choix d’ÉtienneLoulié, musicien et théoricien, ami et proche collaborateur de Charpentier alorsqu’ils étaient tous les deux au service de la musique de Mademoiselle de Guise 21.Il s’agit d’un cas unique parmi les sources théoriques françaises du XVIIe siècle.Outre la nature originale du savoir transmis effectivement par Marc-AntoineCharpentier qu’il est impossible de connaître précisément, notre savoir est condi-tionné par l’« interférence » de Loulié ; car ce qui est conservé aujourd’hui ne sontpas des Règles rédigées par Charpentier lui-même mais un manuscrit intitulé Règlesde composition par M.r Charpentier.
Le texte nous est physiquement connu grâce à deux manuscrits. Le premier faitpartie d’un volumineux recueil écrit de la main d’Étienne Loulié, et fut compilé endeux temps, vers 1693, puis augmenté et annoté avant 1701, toujours par Loulié. Lesecond, plus tardif, puisqu’il fut copié vraisemblablement après 1742, fait partie d’unrecueil qui est en partie la copie de certaines pièces du recueil de Loulié ; pour ce quiregarde les Règles de Charpentier, le contenu de la copie est identique à la version deLoulié, à quelques détails insignifiants près, de l’ordre de la mise en page, de la nor-malisation de l’orthographe et, parfois, de l’omission d’un exemple musical. Cetteseconde copie 22 anonyme ne nous apprenant rien de plus sur ce texte que le manus-crit autographe de Loulié, il sera donc question ici exclusivement de ce dernier.
Les quelques feuillets qui renferment les Règles de Charpentier font partie d’uncorpus composé des notes personnelles de Loulié, que le musicien légua à son amiSébastien de Brossard par ordre testamentaire, ainsi que Brossard le rapporte dansune note qui précède la description des documents dans son Catalogue ; ces papierspersonnels de Loulié se trouvent donc dans la collection musicale de Brossard. Unregard sur l’ensemble de ce corpus peut nous éclairer sur la façon dont procèdeLoulié dans la constitution de son fonds de notes et de copies d’extraits. Si le ou lesoriginaux du texte de Charpentier est/sont perdu(s), la comparaison d’autres copiesque Loulié a effectuées avec leurs sources respectives, essentiellement imprimées,montre que, dans les plus de huit cent pages écrites de sa main qui sont aujourd’huiconservées, il n’a jamais copié un texte dans son intégralité, mais a effectué deschoix de longueur variable, et dans un ordre relatif. Par ailleurs, il a une démarchecritique et n’hésite pas à commenter les discours rapportés, généralement en margede sa copie, en approuvant des propos, en admirant des exemples ou, au contraire,moins souvent, en les contestant ou les jugeant peu clairs. Ainsi, dans les Règles, les
LES MANUSCRITS AUTOGRAPHES DE MARC-ANTOINE CHARPENTIER
92
21. Sur Loulié voir les travaux de P. M. Ranum qui lui a consacré de nombreux articles, principalement« Étienne Loulié… », op. cit., XXV (1987), p. 28-76 ; XXVI (1988-1990), p. 5-49.
22. Pour la description de ce manuscrit, la justification de la datation, ainsi que la note de contenu, voir l’AN-NEXE II.
commentaires explicatifs de plusieurs exemples viennent très probablement deLoulié et non de Charpentier 23.
Ce corpus est parvenu jusqu’à Brossard sous la forme de deux liasses de papiersqu’il a classées dans sa collection, dans la section des « manuscrits », partie des« théoriciens », format « in folio » 24 ; il a – comme toujours – numéroté avec deschiffres romains les différentes pièces à l’intérieur de chaque recueil, puis il les adécrites dans son Catalogue des livres de musique en ajoutant plusieurs commentaires,des renvois à la partie des imprimés de sa collection, ainsi qu’une petite introduc-tion très instructive en hommage à son ami défunt 25. Longtemps conservées ensem-ble au Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, lesdeux liasses furent reliées en deux volumes ; l’organisation des cahiers qui les com-posent est restée fidèle à la disposition des divers fascicules décrite par Brossard 26,même si l’on peut déjà constater quelques incohérences dans l’ordre des certainespièces (voire de certains feuillets), essentiellement dans la partie des notes person-nelles de Loulié : Brossard les a probablement reçues dans cet ordre, et il a peut-êtrerestitué une partie de l’ordre de ses pièces aussi, mais pas l’ensemble. À sa décharge,les notes personnelles de Loulié sont généralement des brouillons avec de nom-breux renvois et redondances, souvent des essais différents sur le même sujet : dansla seconde liasse, qui contient l’essentiel des écrits de Loulié, la suite ou une nou-velle version d’un début de méthode de contrepoint ou un essai sur les modes peutse trouver une centaine de feuillets plus loin, mêlée à autre chose… 27
Les deux volumes furent séparés au XIXe siècle, lorsque François-Joseph Fétisemporta celui qui correspondait à la première liasse ; ce volume est actuellementconservé à la Bibliothèque royale Albert Ier à Bruxelles, Fétis lui ayant légué sa col-lection personnelle. La disparition temporaire de cette première liasse fit qu’unautre manuscrit, qui est en réalité une copie partielle et bien plus tardive de laseconde liasse, a pu un temps être considéré comme étant la première liasse man-quante. Mais un regard précis sur le contenu de ce manuscrit suffit pour dissiper ledoute : la copie partielle de la seconde liasse n’aurait pu correspondre à la premièreliasse, dont Brossard donnait une note précise de contenu. La découverte de cette
THÉODORA PSYCHOYOU : LES RÈGLES DE COMPOSITION PAR MONSIEUR CHARPENTIER
93
23. Pour citer quelques exemples, les commentaires au f. 5 : « Cet exemple. Bon parce que la premiereNotte de la Basse est accompagnée de la sexte, et la seconde de la Quinte, ce qui diversifie lesAccords » ; ou au f. 6 : « Ces trois Exemples sont bons parce que le Dessus ne chemine que d’un degréquand la Basse se meut de quarte, ce qui fait diversité » sont plus vraisemblablement de Loulié que deCharpentier, tout comme, au f. 8, la remarque, en marge d’une énumération des dissonances, « Notaqu’il ne parle point de la 2e sup[erflue] ou tres grande », qui est clairement un commentaire ajouté.
24. Sur l’organisation des traités manuscrits dans le Catalogue de la collection de Brossard, voir l’ANNEXE I.25. Loulié décède en 1702 et Brossard rédige son catalogue en 1724.26. À l’exception de deux fascicules qui furent déplacés et reliés par la suite dans d’autres recueils (voir la
note de contenu donnée en ANNEXE II).27. Pour une proposition de restitution d’un ordre cohérent dans les pièces de Loulié, qu’il me soit permis
de renvoyer à ma thèse, L’évolution de la pensée théorique en France, de Marin Mersenne à Jean-PhilippeRameau ; vol. 2 : Écrits concernant la musique, en France, 1623-1722 : catalogue, thèse, université de Tours,2003, en particulier les notices concernant les écrits de Loulié (LOUL1 à LOUL11), ainsi que les noticesconsacrées à ses deux recueils (rec. LOUL1 et rec. LOUL2).
première liasse à Bruxelles par Yolande de Brossard et Patricia Ranum 28 mit fin àl’énigme et permit de reconstituer l’ensemble des « papiers Loulié », trace pré-cieuse du travail et de la réflexion d’un musicien et pédagogue intéressé par la théo-rie, à la démarche empirique parfois déroutante mais symptomatique du paysage dela pensée théorique de son temps. C’est ce partisan des praticiens, dans une que-relle entre Théoriciens et Praticiens, avatar de celle des Anciens et des Modernes,qui copia les Règles de composition par M.r Charpentier, règles qui ouvrent la secondeliasse de ses papiers. Et c’est à lui que nous devons aujourd’hui le succès, tout aussilégitime qu’historiquement ‘impropre’, des Règles de composition et de l’« Énergiedes modes » de Marc-Antoine Charpentier.
DESCRIPTION CRITIQUE DE LA SOURCE DE LOULIÉ
A. Les deux liasses autographes :
a. Première liasse[sans titre général].Manuscrit autographe de LouliéDivers formats, 27,7 à 28,7 x 17 à 17,8 cm; 116 F.B-Br/ Ms. II. 4167 (Fétis 6668)
Collection Sébastien de Brossard. - Ancienne cote B-Br (collection Fétis) : F 6668. - Auxf. 77 et 83, à l’encre : « Vm. 9 », ancienne cote de la BnF; cette ancienne cote est absentedes pages de garde et du f. 1, tout comme le cachet de la bibliothèque d’origine, sansdoute supprimés par Fétis (ces éléments sont présents dans la seconde liasse, qui portel’ancienne cote Vm. 8, ce qui montre que les deux manuscrits furent initialement classésensemble à la BnF).
La première liasse comporte des extraits de divers traités que Loulié a copiés (Zarlino,Galilei, Descartes, Nanino, Parran, Ouvrard, etc.). À plusieurs endroits, Loulié a disposéses pages en deux colonnes (un tiers/deux tiers) avec, à droite, les extraits du texte origi-nal et, à gauche, ses propres remarques et commentaires. Le cas de la copie qu’il fit desextraits de l’édition française de l’Abrégé de musique de Descartes (f. 93-98v) est sans doutele plus caractéristique, par sa rareté et par l’ampleur des commentaires, très intéressantspour la réception de ce texte.
Pour la note de contenu détaillée, voir ci-après Annexe, II.
b. Seconde liasse[sans titre général].Manuscrit autographe de Loulié27,5 x 17,5 cm et divers formats ; 300 f.F-Pn/ ms n.a. fr. 6355
LES MANUSCRITS AUTOGRAPHES DE MARC-ANTOINE CHARPENTIER
94
28. C’est Yolande de Brossard qui, lors de son travail d’édition du catalogue de la collection Brossard, avaitlocalisé à Bruxelles des manuscrits issus cette collection, dont les titres n’excluaient pas l’hypothèse despapiers Loulié perdus jusqu’alors. Explorant cette piste, Patricia Ranum a pu, sur place, confirmer l’ap-partenance à la collection de Brossard et effectuer la concordance avec la main de Loulié (je dois ces pré-cisions à Patricia Ranum).
- Collection Sébastien de Brossard. - Ancienne cote : Vm. 8.
La seconde liasse contient, pour l’essentiel, des écrits inédits de Loulié lui-même; plu-sieurs de ces essais sont suivis de notes, compilations et extraits de textes d’autres auteursrelatifs aux sujets traités. Ainsi, la pièce (fascicule) nº IV est un extrait de Zarlino semblable aux compilations contenues dans la première liasse, des extraits de Glarean etd’Yssandon viennent compléter les notes de Loulié du nº XXVI, alors que les citations etextraits plus ou moins longs de Mersenne sont récurrents. La méthode de viole de Loulié(nº XXI) est suivie de quelques brefs choix du Traité de la viole de 1687 de Jean Rousseau ;on y trouve également de très brefs extraits de l’Art de chanter (1685) de Claude Lancelot(nº II) ou des Principes de clavecin (1702) de Michel de Saint-Lambert (nº XVI). Du reste,la présence à cet endroit de la liasse des extraits de la méthode de Saint-Lambert, paruel’année même du décès de Loulié, ainsi que l’organisation de l’ensemble, tend à exclureune disposition chronologique de ce corpus dans l’ordre de la numérotation de Brossard.Pour finir, à côté des notes personnelles de Loulié et de ses extraits choisis d’ouvragesimprimés, se trouvent les Règles de composition par M.r Charpentier suivies de l’Abregé desrègles de l’accompagnement (nº I). Contrairement à tous les autres extraits copiés ici, le ou leséventuels « originaux » de ces Règles étaient des sources manuscrites aujourd’hui perdues.Toutefois, la disposition interne de ces Règles, combinée avec la façon de faire de Loulié,tant dans le choix des extraits que dans son habitude de commenter les passages copiés,telle qu’elle apparaît dans la confrontation de ses copies aux originaux, laisse entendre quecette source unique n’est certainement pas conforme à l’original.
Pour la note de contenu détaillée, voir ci-après ANNEXE II.
B. Les Règles de composition par M.r Charpentier
La copie a été réalisée à partir de deux sources : aux f. 2 à 12v, on trouve les Règles.Elles sont suivies, f. 13-15v, par une seconde partie distincte, intitulée« Augmentations tirées de l’Original de M.r le Duc de Chartres ». Nous pouvonssupposer que la première partie a été compilée vers 1693, au moment oùCharpentier dispensa les cours de musique à l’attention de Philippe d’Orléans ; lesaugmentations ont dû être effectuées au plus tard avant juin 1701, date de la mortde Monsieur, frère du roi : après cet événement, Loulié aurait désigné son fils, lefutur Régent, comme duc d’Orléans, et non plus duc de Chartres. La première par-tie du manuscrit, c’est-à-dire le corps principal du texte, a été elle-même modifiéeà partir de l’original du duc, à l’évidence consultée par Loulié après la premièrecopie. Cette première partie comprend donc, outre les commentaires en marge deLoulié, dont il a déjà été question, des ajouts ou variantes dans la formulation decertaines règles qui proviennent de cet « original » du prestigieux élève deCharpentier 29. Et si la provenance est spécifiée pour un seul de ces ajouts 30, plu-sieurs autres sont d’une nature tout à fait semblable, certains étant de l’ordre dudétail insignifiant. Pourquoi Loulié aurait-il pris la peine de les signaler ? Cette atti-
THÉODORA PSYCHOYOU : LES RÈGLES DE COMPOSITION PAR MONSIEUR CHARPENTIER
95
29. Pour une hypothèse concernant la chronologie des événements, ainsi que sur la relation de Loulié avecle milieu du duc de Chartres, voir P. Ranum, « Étienne Loulié… », op. cit. Voir aussi la présentation desécrits théoriques de Charpentier dans C. Cessac, op. cit., p. 461-465.
30. Au f. 6 : « Dans l’original de M.r Le Duc de Chartres il dit que cette 4.e R[ègle] est sans exception ».
tude interroge le statut de l’original de la première partie, tant celui du duc semblefaire autorité. Si l’origine des « augmentations » semble claire, il est en revanche dif-ficile de savoir quelle fut la première source de Loulié. Afin de mieux percevoir lerapport qu’entretiennent ces deux parties, voici le schéma de la copie de Loulié,avec les deux parties disposées en vis-à-vis.
Le manuscrit est composé de :– la page de titre du cahier (f. 1).– les Règles de composition par M.r Charpentier (f. 2-12v).– les Augmentations tirées de l’Original de M.r le Duc de Chartres (f. 13-15v).– l’Abrégé des règles de l’accompagnement de M.r Charpentier (f. 16).
Règles de composition par M.r Charpentier
Quatre Vers qu’il est bon de sçavoir par cœur [aide-mémoire pour l’enchaînement des intervalles].
Consonances parfaites. Octave, Quinte, Quartes. Consonances Imparfaites. Tierces et Sixtes Majeures
et Mineures.De la fausse Relation.Du Ton et Demy Ton favory. Du Mode et de la
Cadence.De la fausse Relation permise.Recapitulation.
Du Mouvement [id est progression des accords]Pratique des consonances parfaictes ou imparfaictes.1.ere Regle. De l’o ne passe a l’O que par chemin
contraire.2.e Regle. Qui de l’O passe a l’A ne manque aucunement.3.e Regle. De l’a passant a l’O suis mesme mouvement.4.e Regle. Mais de l’a passe a l’a sans crainte de
mal faire.Pratique de la Sixte.Pratique de la Sixte maje[ure].Sixte mineure.Des Dissonances.Des Temps forts et foibles.Les Mesures.Pratique des Dissonances.Dissonances Superflues.Pratique de la Quarte.Dissonances Diminuées.Quinte fausse ou diminuée.Quarte fausse ou diminuée.Pratique de la Seconde.De la Tenue.Recapitulation. Fin des Regles.
Routines.Du Mode.
Augmentations tirées de l’Original deM.r le Duc de Chartres.
Exemple sur les sixtes et sur les tierces.
Définition de la Musique.
Pourquoi les Transpositions de Modes.
Energie des Modes.
Des Cadences.
Des Cordes Essentielles des Modes.Mode de b mol.Mode de Bequarre.
Des Tons et Demi Tons favoris des Modes oudes Cadences qu’on a dessein de faire.
Cadence de l’UT.Cadence du Re.
Dominante du Mode b mol.
De la fausse Relation.
Recapitulation.
Des beautez de la Musique.
Abrégé des règles de l’accompagnement deMr Charpentier
LES MANUSCRITS AUTOGRAPHES DE MARC-ANTOINE CHARPENTIER
96
La disposition de la copie des Règles par Loulié appelle plusieurs remarques.D’abord, l’ordre choisi par Loulié ne suit pas rigoureusement la logique d’une pro-gression pédagogique. Plus exactement, Loulié a retenu des propos parfois dedétail, souvent donnés, de surcroît, dans un certain désordre. Ainsi, les « Quatre versqu’il est bon de sçavoir par cœur », relatifs à la « progression des accords » (c’est-à-dire l’enchaînement des intervalles) sont énoncés au début du texte mais dévelop-pés plus loin, après un passage sur la définition des intervalles, les modes et lescadences 31. De même, le paragraphe sur les « Dissonances » est séparé de celui surla « Pratique des Dissonances » par deux brefs passages concernant les « Tempsforts et foibles » et les « Mesures », et ainsi de suite. La seconde partie, celle desAugmentations, suit la même logique des rubriques autonomes exemptes d’unevision normative ou pédagogique d’ensemble. Comme cela a été évoqué, non seu-lement Loulié n’a copié que les parties qui l’intéressaient, que ce soit pour leur ori-ginalité ou pour leur formulation, mais, de plus, ces notes sont venues compléter desleçons données par Charpentier, et ne visaient donc ni à l’autonomie utopique dutraité ni même à l’exhaustivité.
Bien que très brèves, les augmentations qui viennent de l’original du duc compor-tent certains des plus beaux passages de la production théorique de la fin du XVIIe
siècle, l’« Énergie » de dix-huit transpositions des modes majeur et mineur, maisaussi de belles synthèses générales qui mettent la technique du langage musical enperspective de l’objectif de bien composer. Les conseils pratiques de Charpentier, àla fois généreux et humbles, outrepassent le niveau de la simple assimilation derègles ; ils les rendent intelligentes :
— « La seule diversité en fait toutte la perfection, comme l’uniformité en fait tout le fade etle desagrement. Les Changements de mouvement et de Mode faits bien à propos, contri-buent merveilleusement à cette diversité que la Musique demande. […] Une Musiquequi ne seroit composée que de Consonances seroit fade ; et trop pleine de Dissonancesserait dure, parce que ces deux extremitez pechent contre la Diversité ; evitez aussi soi-gneusement la fausse Relation que le manque de Tierce entre les Parties ou contre laBasse. » 32
ou
— « Des beautez de la MusiqueLa Modulation regulière c’est a dire les accords si bien enchainez ensemble qu’ils sortentnecessairement les uns des autres en font toute la douceur. Les Intervalles deffendus evi-tez contribuent extremement a cette belle modulation. Dénombrement des Intervallesdéfendus qu’il faut éviter [exemple de seize intervalles] neanmoins l’expression du sujetoblige quelque fois a se servir de ces faux intervalles, alors ce sont des coups de maitre.[…] Les Italiens ne font jamais une fugue seule mais deux, trois et quatre en mêmetemps, ce qui rend leur musique admirable. La fugue qui se fait mieux sentir en entrant
THÉODORA PSYCHOYOU : LES RÈGLES DE COMPOSITION PAR MONSIEUR CHARPENTIER
97
31. Notons par ailleurs qu’une telle entrée en matière, à savoir directement sur l’enchaînement des accords,est assez abrupte pour un traité de composition.
32. Règles, op. cit., f. 13.
est qui est la plus pressée est la plus belle. C’est pourquoi il ne faut jamais faire reposerune partie pour faire la fugue de ce qu’elle a chanté.La pratique en apprend plus que touttes les Règles. » 33
À côté de telles synthèses, l’on rencontre de nombreuses redondances entre lesaugmentations et la partie initiale, dont voici deux exemples :
Ici encore l’attitude du copiste est déroutante : pourquoi avoir recopié ces propo-sitions puisque leur sens est identique? Qu’est-ce que cela précise du statut dessources dont disposait Loulié ? Si l’exemplaire du duc de Chartres était un « origi-nal », qu’en est-il de la première source dont Loulié s’est servi ? Par ailleurs, quesait-on exactement de la façon dont se passait un cours particulier de compositionen France, à la fin du XVIIe siècle ? Faut-il exclure l’hypothèse de notes de cours pri-ses par un élève? L’« Énergie des modes », étonnamment longue, mais dont la pré-cision heurte la subjectivité de la perception, fait insolite dans le cadre normatif dutraité, n’a-t-elle pas pu être le résultat d’un exercice sur la sensation sonore queCharpentier fit éprouver au duc 35 ? Certes, l’attention que Loulié accorde aux mots,
Première version Augmentations
f. 3v
On dit communement qu’après tous les Dieses, ilfaut toujours monter d’un demi Ton ; mais c’estparler trop generallement. Cela ne se doit enten-dre que quand les Dieses sont les Demi Tonsfavoris d’un Mode ou d’une Cadence qu’on veuttraitter. La Regle qui enseigne aussi qu’apres tousles Bemols il faut descendre toujours d’un DemiTon ou d’un Ton n’est pas assez generalle parcequ’on doit aussi descendre toujours d’un Tonaprès les Diesis quand ils sont les Tons favoris audessus de la finale du Mode ou de la Cadencequ’on traitte.
f. 14v
On dit ordinairement qu’il faut toujours monter,apres un Diezis et descendre après un b mol deDemi ton, mais la Regle est trop generale, et cen’est qu’apres le Diezis ou Demi ton favory audessous d’une Cadence qu’on veut faire, qu’ilfaut toujours monter de Demi Ton. Et ce n’estqu’apres le b mol ou le Demi Ton favory d’audessus de la Dominante d’un Mode de Bemol oùl’on veut tomber qu’il faut toujours descendre deDemi Ton.
f. 3La fausse relation se fait quand on vient d’enten-dre une Notte dans une partie superieure qui faitTriton contre une Notte qu’on entend immedi-atement après dans une partie inferieure ou dansla Basse.
[exemples musicaux]En mettant un Bemol au si ou un Diesis au fa oneviteroit la fausse Relation.
f. 14v
La fausse Relation est l’Intervalle du Triton,formé par une notte dans une partie superieurecontre une notte des parties inferieures ou de laBasse meme qui vient immediatement apres pours’y reposer.
[exemples musicaux] 34
Pour éviter ces fausses Relations il faudroit met-tre un b mol au si ou un Diezis au fa pour faireRelation de bonne quarte.
LES MANUSCRITS AUTOGRAPHES DE MARC-ANTOINE CHARPENTIER
98
33. Ibid., f. 15v.34. Les exemples ne sont pas identiques mais parfaitement équivalents.35. Notons qu’une autre liste de propriétés expressives des modes, la seule avec celle de Charpentier à pro-
poser des facultés expressives propres aux différents modes (et non pas des groupements de plusieursmodes, comme firent Jean Rousseau et, plus tard, Jean-Philippe Rameau), se trouve dans la première édi-tion du traité de Charles Masson (1697) et disparaît dans la seconde édition (1699), dédiée précisémentau duc de Chartres, dont Masson fut également le professeur de musique, après Charpentier. Sur le sta-tut de ces « Énergies » et leur rapport avec l’éthos antique, voir T. Psychoyou, L’évolution de la pensée
ainsi que la nature de ses propres commentaires, écartent l’hypothèse d’une prisede notes directe, mais pas celle d’une reformulation après coup, par un auditeur descours, secrétaire ou élève, à la manière des reportationes médiévales, textes que lemaître lui-même pouvait corriger 36.
In fine, si rien ne peut attester explicitement de la forme et du contenu d’un« vrai » original des Règles de Charpentier, il nous est possible d’entr’apercevoir,grâce à Loulié, les points de vue d’un très grand compositeur du XVIIe siècle sur lacomposition et sur la façon de l’enseigner.
Deuxième liasse des papiers Loulié, page de titre des Règles de Charpentier (F-Pn/ ms n. a. fr. 6355, f. 1). Titre de la main de Loulié, sous-titre biographique et
numérotation de la pièce (N° I°.) de la main de Brossard, cachet, ancienne et nouvelle cotes de la Bibliothèque nationale de France.
THÉODORA PSYCHOYOU : LES RÈGLES DE COMPOSITION PAR MONSIEUR CHARPENTIER
99
théorique en France, op. cit., vol. 1, p. 83-92 et « Quelques réflexions sur les paroles en musique, les paro-les de musique et le modèle antique au XVIIe siècle », Analyse musicale, 42 (2002), p. 20-35. Pour uneapplication musicale de l’« Énergie des modes » de Charpentier, voir la contribution de Thomas VanEssen et de Frédéric Michel dans le présent recueil.
36. Nous avons l’exemple des deux sources manuscrites du Traité de la théorie de la musique de JosephSauveur, qui sont des transcriptions du cours qu’il professa au Collège royal en 1697 (F-Pn/ ms n.a.fr.4674 et US-Cn/ Case MS 4A 6).
ANNEXES
LES « PAPIERS LOULIÉ » DE LA COLLECTION DE SÉBASTIEN DE BROSSARD :SOURCES ET NOTE DE CONTENU
I. LES « MANUSCRIPTS THÉORICIENS » DE LA COLLECTION BROSSARD ET LES « PAPIERS
LOULIÉ »
À l’image de la partie du Catalogue 37 de la collection de Sébastien de Brossard qui est consa-crée aux imprimés, la partie qui décrit les manuscrits commence par les « Théoriciens »,c’est-à-dire les écrits sur la musique, par opposition aux « Praticiens » qui suivent, à savoir lesœuvres musicales à proprement parler. Ces textes théoriques manuscrits sont, tout d’abord,les écrits de Brossard lui-même; ils composent le corpus inédit, dans sa majeure partie, d’uneœuvre importante mais inachevée, œuvre dont les seuls textes imprimés (en dehors de pré-faces de recueils musicaux), à savoir le Dictionnaire de musique 38, largement diffusé de sontemps, ainsi que la brève Lettre en forme de dissertation à M. Demoz 39, ne donnent qu’un aper-çu 40. En dehors de ces textes, sont aussi incluses dans cette partie de la collection de fortnombreuses copies d’extraits d’ouvrages d’autres théoriciens de la musique, réalisées géné-ralement de la main de Brossard lui-même à partir d’originaux imprimés qu’il eut l’opportu-nité de consulter dans diverses bibliothèques et collections, à Strasbourg, à Paris ou àMeaux 41. Le compositeur et théoricien Brossard a réuni de cette façon plusieurs extraits detraités, méthodes, préfaces ou articles de périodiques (tels le Journal des savants, le Mercuregalant ou le Journal de Trévoux) dont il ne pouvait se procurer un exemplaire, auquel cas ledocument aurait rejoint la collection des imprimés, riche quant à elle de cent cinquante-deuxouvrages. Un exemple est révélateur de la démarche de Brossard dans son choix et son tra-vail de copiste de traités. Brossard projetait de copier systématiquement les mémoiresd’acoustique de Joseph Sauveur, ainsi que les comptes rendus critiques qu’en fit Fontenelledans les volumes de l’Histoire de l’Académie royale des sciences. En réalité, Brossard copia les rap-ports détaillés de Fontenelle, plus courts et moins abscons que les longs mémoires deSauveur 42. On comprend son intention de recopier les Principes d’acoustique et de musique ousystème général des intervalles des sons, au titre qu’il a placé dans un cahier de ses papiers.Brossard s’en explique :
LES MANUSCRITS AUTOGRAPHES DE MARC-ANTOINE CHARPENTIER
100
37. Le titre complet du manuscrit est instructif : Catalogue des livres de Musique Theorique et Prattique, vocalleet Instrumentale, tant imprimée que manuscripte, qui sont dans Le Cabinet du S.r Sebastien de Brossard, chanoinede Meaux, et dont il supplie très humblement Sa majesté d’accepter le Don, pour être mis et conservez dans saBibliothèque. Fait et escrit en l’année 1724, manuscrit autographe, op. cit., voir note 1.
38. Paris, Christophe Ballard, 1701, 1703 et 1705 ; Amsterdam, Étienne Roger, 1708 ; et Pierre Mortier, 1709.39. Paris, Jean-Baptiste-Christophe Ballard, 1728.40. Pour une présentation et une description détaillée des écrits de Sébastien de Brossard, voir Jean Duron,
L’œuvre de Sébastien de Brossard (1655-1730). Catalogue thématique, Versailles, Éditions du CMBV; Paris,Klincksieck, 1995.
41. La liste de tous les auteurs concernés se trouve dans l’édition de ce Catalogue, assortie d’une descriptionde la collection, avec les concordances des cotes du fonds Brossard conservé majoritairement à laBibliothèque nationale de France ; voir La Collection Sébastien de Brossard (1655-1730), op. cit.
42. Ces copies sont conservées dans le recueil F-Pn/ ms n.a. fr. 545.
— « On trouve dans la page 297 des memoires de l’academie Royalle des sciences pour l’an-née 1701. Jusques a la page 365. exclusivement le Traitté entier touchant un nouveau sys-teme de musique dont on a raporté cy dessus l’histoire ou l’extrait qui en a esté fait par m.r
de Fontenelle sec.re de cette academie. Ce Traitté a pour titre Systéme general desIntervalles des sons et son aplication a tous les systemes et tous les Instrumens de musique.Par m.r Sauveur. Mais comme cet Illustre autheur m’en a fait present d’un Exemplaire, Jene l’ay point copié Icy, comme aussi principalement a cause de sa longueur » 43.
C’est ainsi que le traité de Sauveur rejoint la collection des imprimés, la copie manuscriten’ayant plus lieu d’être. Brossard, comme Loulié et d’autres, avaient ainsi l’habitude de sup-primer les copies manuscrites lorsqu’ils venaient à posséder un original imprimé ; cela valaitaussi pour les manuscrits de leurs propres textes dès lors qu’ils étaient imprimés 44.
La description de la section des « Théoriciens » de la partie « Manuscrits » de la collectionde Brossard, riche d’une centaine de documents, aurait pu s’arrêter ici, si deux autres volu-mineux recueils manuscrits n’étaient venus s’y ajouter, très précisément les deux liasses des« papiers Loulié ».
II. NOTE DE CONTENU DES « PAPIERS LOULIÉ » PAR BROSSARD
La place exceptionnelle que Brossard a réservée à la personne et au travail de son ami ÉtienneLoulié se manifeste à travers la description qu’il a faite, dans le Catalogue de sa collection, desdeux liasses des papiers et notes de travail que lui a léguées le musicien et proche collabora-teur de Charpentier. C’est la raison pour laquelle il nous a semblé opportun de présenter lecontenu de ces documents à partir de la description de Brossard 45 ; notes et renvois, donnésentre crochets, viennent préciser l’extrait du Catalogue de Brossard retranscrit ici 46. Les Règlesde composition par M.r Charpentier constituent la première pièce de la seconde liasse.
[p. 273] 47 CINQUIÊME PARTIE. MANUSCRITS
Théoriciens.
CollectionManuscripts ou In folio
Recueil
Ouvrages et Recueils de feu M.r Loulié maître de musique dans Paris. A l’occasion de deuxtraittés imprimés raportez cy dessys parmi les Theoriciens in 8.° pag. [blanc], j’ay promis deparler plus amplement de cet illustre. Je m’acquitte de ma promesse.
THÉODORA PSYCHOYOU : LES RÈGLES DE COMPOSITION PAR MONSIEUR CHARPENTIER
101
43. F-Pn/ ms n.a. fr. 545, f. 5044. Voir notamment ci-après, le n° XXII° de la seconde liasse des « papiers Loulié ».45. Yolande de Brossard a déjà proposé la transcription de ce passage dans La Collection Sébastien de Brossard,
op. cit., p. 384-387. Les renvois et concordances sont ici mis à jour. Pour un commentaire de la notice bio-graphique de Loulié par Brossard, voir Y. de Brossard, op. cit., p. 384.
46. Brossard, Catalogue, op. cit., p. 273-277. Pour la concordance détaillée entre extraits copiés et passagesconcernés dans les originaux imprimés, voir les notices consacrées à ces deux recueils (rec. LOUL1 et rec.LOUL2), ainsi que leurs renvois dans T. Psychoyou, op. cit. vol. 2.
47. Brossard a l’habitude de séparer les rubriques, les différentes pièces, ses numérotations voire sa pagina-tion, par des lignes obliques, qui ont été omises ici ; en revanche, les passages soulignés sont transcritsen italiques. La pagination du manuscrit autographe de Brossard a été signalée entre crochets.
Ce M.r Loulié estoit de Paris et avoit esté elevé enfant de chœur à la S.te Chapelle de lad. villesous M.rs Ouvrard et Chaperon. Comme M.r Ouvrard estoit aussi bon theoricien que praticien,ce fut apparemment de luy que M.e Loulié tira ce gout et cette inclination pour la Theoriede la musique qu’il a conservé jusques a la fin de sa vie. Bien different en cela de presquestous les musiciens qui se contentant, a la sortie des maitrises, de la pratique ou, pour mieuxdire de la routine qu’ils y ont acquise ne songent pas seullement a penetrer dans les raisonsqui font que cette routine est bonne. De sorte qu’entre tous les musiciens de Paris, il estoitpresques le seul avec qui on pût raisonner sur la musique. C’est ce qui luy attira la connois-sance de M.rs Sauveur, Dodart &ca et ce qui me* (* à de Brossard) donna aussi occasion decontracter amitié avec luy, amitié fort etroitte et tres sincere de part et d’autre, car enfin,exempts l’un et l’autre de cette basse et sotte jalousie dont ceux d’une même proffession,sont presque tous animez, nous nous communiquions bonnement nos decouvertes et cela allasi loin que nous nous promimes reciproquement que le premier qui mourroit de nous deux,laisseroit ses memoires au survivant, ce qu’il ne manqua pas d’ordonner par son testament, etl’executeur de ce testament me remit de sa part il y a 17 à 18. ans, le pacquet de papiers dontil s’agit icy et que j’ay toujours conservé depuis d’autant plus [p. 274] précieusement qu’ilcontient quantité de pieces tres curieuses, parties dud. S.r Loulié, partie extraittes de diversauteurs, partie copiées toutes entieres, le tout en deux liasses ou parties dont chaque pieceest numerottée par les chiffres Romains I. II. III. IV. &ca, et dont voicy le détail.
Premiere Liasse.Cette premiere liasse contient neuf pieces, sçavoirI°. Abrégé des principes de musique des Anciens (c’est à dire de ceux qui ont composé de la
musique depuis environ 1300 jusques vers l’an 1600) pour sçavoir lire et chanter leurmusique– [f. 1-14v].
II°. Extraict du P. Mersenne (son livre est cy dessus parmi les Theoriciens in folio pag.[blanc] 48)– [f. 15-35, divers extraits de l’Harmonie universelle, 1636].
III°. Extraict de la musique de Zarlin (on trouverra cy dessus parmi les Theoriciens in foliopag. 3. trois editions différentes des ouvrages de cet auteur).– [f. 36-51, extraits de Zarlino ; f. 52-53v, « Extrait de Sermes » (Mersenne, Traité de l’harmonie uni-verselle, 1627) ; f. 54-59v, extraits de Zarlino].
IV°. Extraict de Galilée.– [f. 61-67v, extraits de Vincenzo Galileo, Dialogo della musica antica e moderna, 1581].
V°. Regole del contrapunto del Signore Belardino Nanino (Italien dont on trouverra une autrecopie cy dessous pag. 280 plus ample et plus exacte dans les meslanges In folio n° I). 49
LES MANUSCRITS AUTOGRAPHES DE MARC-ANTOINE CHARPENTIER
102
48. Brossard a laissé en blanc plusieurs renvois internes à son Catalogue manuscrit, la pagination définitiven’étant sans doute pas établie au moment de la rédaction des différentes notices (les renvois précis, lors-qu’ils existent, ont été généralement ajoutés a posteriori). Il a par ailleurs établi les concordances entreles extraits copiés par Loulié et les originaux imprimés dont il possédait un exemplaire. Son renvoi « cydessus parmi les Theoriciens » est, en réalité, « parmi les Imprimés Théoriciens », qui sont en premièrepartie du Catalogue.
49. Il s’agit d’une copie de la main de Brossard, qui fait également partie de la collection (copie conservéedans le recueil F-Pn/ ms n.a. fr. 5269) et qu’il décrit donc dans son catalogue, effectivement à la p. 280 :« Regole del contrapunto del S.gre Belardino Nanino. Ce traitté est tout en Italien, ancien, mais fort bonet curieux. Il me fut communiqué à Strasbourg par Pesqueriel de la Comedie Italienne et qui à lamaniere des Italiens me le vanta au dessus des nües, il en faisoit lui même beaucoup de cas, et je lecopiay tres exactement. Il y en a une autre copie cy dessus pag. 274. n°. V°. dans la premiere liasse desrecueils de M.r Loulié, mais elle n’est ni si ample ny si correcte que celle cy ».
– [ce fascicule n’a pas été relié dans ce volume, mais se trouve dans un autre recueil de lacollection, composé essentiellement de copies de la main de Brossard, et conservé sous lacote F-Pn/ ms n. a. fr 4673, aux f. 54-57 ; le manuscrit de Bruxelles passe donc directe-ment du nº IVº au nº VIº].
VI°. Choses dont il faut convenir pour les demonstrations de musique (ce sont tous principestirés des mathematiques).– [f. 69-72, vingt propositions en latin et en français suivies de treize définitions en latin et en français].
VII°. Extrait du Traitté de musique du P. Parrant Jesuite. Ce traitté est cy dessus parmi lesTheoriciens in 4° p. [blanc].– [f. 73-74, extraits d’Antoine Parran, Traité de musique, 1639].
VII°. 2. extraict du livre de Composition de M.r Ouvrard, maitre de musique de la S.te
Chapelle de Paris. Je ne crois pas que ce livre de M.r Ouvrard ait jamais été imprimé ;comme il est mort chanoine de la Cathedralle de Tours, ce livre pourroit bien estre entreles mains de quelque curieux de cette ville.– [f. 77-82, extraits de René Ouvrard, Secret pour composer en musique, 1658, réédition, 1660, dont Brossardignorait donc l’existence; notons toutefois que l’édition de 1658 ne porte pas de nom d’auteur].
VII°. 3. extrait du livre intitulé Historia musica d’Angelino Bontempi (ce livre est cy dessusparmi les Théoriciens, in folio, p. … et je l’avois presté a feu M.r Loulié)– [f. 83-83v, Historia musica, 1695. Loulié a donc copié sur l’exemplaire de Brossard].
VIII°. Musique de Descartes (on en trouvera cy dessous p. … une copie sur l’imprimé aAmsterdam 1656, dans le 1.er tome de mes recueils in 4°. n°. VI°.) cy dessous pag. 286.n°. VI.– [f. 93-98v, extraits notablement annotés de l’Abbregé de la musique composé en latin, trad. NicolasPoisson, 1668].
IX°. Musique ancienne voyez sur cela cy dessus n° I°. et cy dessous dans la 2.e liasse depuisle n° xxjv. jusques à la fin, dans la page suivante.– [f. 99-116v, divers extraits, dont certains de Zarlino, relatifs au système métrique des prolations ;Loulié tente à la fin une synthèse, « La Musique Pratique Ancienne ou caracteres de la Musiqueancienne reduite aux caracteres d’aujourd’huy » avec de nombreux exemples de ligatures et leurséquivalences].
[p. 275] Seconde Liasse.La seconde liasse contient vingt et neuf et neuf pieces sçavoirI°. Regles de composition par M.r Charpentier (Il fit ce petit traitté pour M.gr le duc de
Chartres, depuis Duc d’Orléans et Regent de France, auquel il monstroit la compositionet qui le fit recevoir maître de musique de la S.te Chapelle de Paris l’an 1696 ou 97 ; et ouil mourut le 24. février 1704. Ce traité tout excellent qu’il est n’a jamais été imprimé, c’estce qui le rend plus rare et plus estimable.– [f. 1-15v, Regles de Composition par Monsieur Charpentier ; f. 16, Abregé des Regles de l’accompagnement deM.r Charpentier].
II°. Extrait de l’art de chanter du S.r Lancelot (on trouvera ce traitté cy dessus parmi lesTheoriciens in 4° pag. [blanc]).- [f. 17, extraits de L’Art de chanter, 1685, de Claude Lancelot].
III°. La musique naturelle par le S.r Durand Advocat. (Ce sont 12. pages imprimées avec troisplanches gravées par lesquelles l’autheur pretend donner une methode et des nottes nou-velles pour la musique &ca mais je ne vois pas que cette nouvelle invention, ait eu aucu-ne suitte et pour dire veritablement ce que j’en pense c’est une idée des plus chimeri-ques de pretendre detruire un usage de cinq ou six siecles par une methode contraire etqui n’est pas moins sujette a autant d’embarras &ca. Car, si je voulois pousser mesreflexions plus loin, j’irois au dela des bornes prescrittes a un catalogue).
THÉODORA PSYCHOYOU : LES RÈGLES DE COMPOSITION PAR MONSIEUR CHARPENTIER
103
– [ces planches n’ont pas été reliées dans ce volume ; le seul exemplaire conservé (F-Pn/V. 18045, aucun ex-libris) pourrait être l’exemplaire de Loulié puis de Brossard. Le recueilms. passe donc directement du nº IIº au nº IVº].
IV°. Regles de composition de Zarlin (voyez cy dessus dans la premiere liasse n° iij°.)– [f. 18-29v ; autres extraits des Institutioni harmoniche, notamment des règles contrepoint].
V°. Elemens de musique ou methode qu’il faut tenir pour en apprendre la composition. (Jecrois ce cahier et plusieurs des suivants de la composition du S.r Loulié).– [f. 30-31v, « Elements de Composition de Musique » ; f. 32-32v, « Explication de quelques ter-mes » ; f. 33-40v, « Contrepoint »].
VI°. Autres elements de la composition de musique que je crois du même auteur.– [f. 41-54, « Elements de Composition de Musique »].
VII°. Autres elements de la composition de musique que je crois du même auteur.– [f. 55-57v, « Elements de Composition de Musique ou Methode qu’il faut observer pour appren-dre la Composition de Musique » ; f. 58-68, « Regles Generales du Contrepoint Simple » ; f. 69-69v,« Fugue »].
VIII°. Methode qu’il faut tenir pour aprendre la composition de musique, du meme auteur.- [f. 70-71v].
IX°. Autre methode plus courte du meme.– [f. 72, « Methode pour apprendre la Composition de Musique » ; f. 72v-75v, « Regles du contrepointsimple »].
X°. Abbregé d’un traitté de Composition de musique d’un autre tour par le meme.- [f. 76-76v, « Abregé d’un Traitté de Composition de Musique » ; f. 77-79v, « Regles Generales duContrepoint Simple » ; f. 80-80v, « Cadences »].
[p. 276]XI°. Suitte des definitions, lignes et espaces de musique du meme M.r Loulié en deux seul-
les pages.– [f. 81-81v].
XII°. Ordre des accords que je crois du même auteur.– [f. 82-88v].
XIII°. Regles du contrepoint simple, et dans le même cahier, Plan, dessein, Travail,Recherches, Richesses, Jeux, beautez de musique, comme aussi du canon, de la fugue,consequence, reditte, imitation &ca du meme.– [f. 89-92, « Regles du Contrepoint simple » ; f. 93-95, « Plan, Dessein, Travail, Recherche,Richesses, Jeux, beautez de Musique » ; f. 96-98, « Fugue » ; « Des Sons », notes originales (?) etpassages tirés de Mersenne, pour ce dernier point].
XIV°. Contrepoint figuré ou prattique des dissonances [Loulié].– [f. 101-103v].
XV°. Essay d’un Traitté de Compositon ou musique prattique [Loulié].– [f. 104-109v, « Musique Pratique. Essay d’un Traitté de Composition » ; f. 110-110v, « Explicationde quelques Termes » ; f. 111-113, « Regles Generales du Contrepoint simple » ; f. 113-116, «Pratiques des Regles cy dessus » ; f. 116v-117v, « Regles qu’il faut observer Lorsqu’on ne suit pas l’or-dre naturel des accords » ; f. 118-119v, « Cadence de Basse » ; f. 120, « Une Piece peut plaire pardifferents endroits » ; f. 121-123v, « Suitte des Regles du Contrepoint simple »].
XVI°. Extraict du livre de M.r de S. Lambert sur les principes du clavessin (ce livre est cydessus parmi les Theoriciens in 4°. oblongo pag. 25).– [f. 124-126v, extraits de Michel de Saint-Lambert, Les principes du clavecin, 1702].
XVII°. Regles ou methode pour trouver quelle clef il se faut figurer ou concevoir lorsqu’onveut executer une piece sur un autre ton qu’elle n’est écritte, sur quelque instrument quece soit, ce qu’on apelle transposer.– [f. 127-128v].2°. methode pour apprendre a notter un air qu’on sçait par cœur ou qu’on entend chanter.– [f. 129-129v].
Je crois tout cela du S. rLoulié.
LES MANUSCRITS AUTOGRAPHES DE MARC-ANTOINE CHARPENTIER
104
3°. Suplemens aux elemens de musique.– [f. 130-141v, ce passage comporte des augmentations prévues pour certaines parties des Éléments ouprincipes de musique de Loulié, publiés en 1696 (le ms. est donc postérieur à janvier 1696, d’aprèsl’« achevé d’imprimer »), en vue probablement d’une réédition. L’auteur localise précisément cesendroits avec de nombreux renvois aux pages concernées de l’ouvrage imprimé].
XVIII°. 1° Accords ; 2° Intervalles de musique mathematiques ; ° Battement ; 4° du son ; 5°Intervalles ordinaires de musique [Loulié].– [142-146, « Accords », étude des consonance du point de vue de leurs vibrations, avec extrait duCompendium musicæ de Descartes ; f. 147-147v, « L’objet de la Musique est le Son. Son, Notte,Dieze » ; f. 148-148v, « Definitions ou Explications de quelques termes de Musique pratique.Musique. Musicien » ; f. 149-151v, « Intervalles de Musique Mathematique » ; f. 152-154v,« Battement » ; f. 154v-155v, « Maniere d’accorder » ; f. 156-163v, « Du Son » ; f. 164-164v, « Son » ;f. 165-168v, « Intervalles de Musique » ; f. 169-169v, « Contrepoint simple »].
XIX°. Methode pour apprendre a joüer de la flûte douce (C’est un petit in 4° oblongo)[Loulié].– [f. 170-184v, « Methode pour apprendre a jouer de la flute douce » ; f. 185-185v, [Des modeshomonymes, feuillet sans doute mal classé] ; f. 186-192, « Methode pour apprendre a jouer de laflute douce », compléments].
XX°. Autre methode pour le meme sujet. In folio.– [f. 193-209v, autre version].
XXI°. Methode pour apprendre à joüer de la violle [Loulié].– [f. 210-218v, « Methode pour apprendre a jouer de la Violle » ; f. 219-221, « Extrait deM.r Rousseau », de Jean Rousseau, Traité de la viole, 1687 ; f. 222, « Methode qu’il faut tenir pourconduire un Ecolier qui veut apprendre a jouer de la Violle », de Loulié].
XXII°. Methode pour apprendre a chanter sur le livre [Loulié].– [f. 223-224v, « Methode pour apprendre à chanter sur le Livre » ; f. 225-225v, « Fausse relation » ;f. 225v-226v, « Regles pour faire deux nottes pour une » ; f. 227-230v, « Fugue » ; f. 231-232, « Reglespour faire deux nottes pour une » ; f. 232v, « Fugue »]
XXIII°. Il y a rien ici sous ce chiffre. Il y a apparence que c’estoit un des deux traittez qu’il afait imprimer chez Ballard et qui sont dans ce catalogue parmi les Theoriciens in 8°, etqu’il aura ôté de cette liasse, après qu’il aura esté public.– [Loulié a en réalité publié trois ouvrages : les Éléments ou principes de musique, en 1696(réédition, 1698), le Nouveau système de musique ou nouvelle division du monocorde, en 1698,ainsi qu’un Abrégé des principes de musique, en 1696. Quoi qu’il en soit, le recueil ms. passedirectement du nº XXIIº au nº XXIVº].
[p. 277]XXIV°. Musique prattique des Anciens (Il entend icy par le mot d’anciens les grecs & les
latins jusques vers l’an 1300 qu’on a commencé de composer a plusieurs parties. Les huitdernieres pages de ce cahier sont tres curieuses) [Loulié].– [f. 233-246, « Musique Pratique des Anciens ou Progrez de la Musique Pratique des Anciens jus-qu’a la Notre » ; f. 247-248v, « Origine de la Musique a plusieurs parties differentes » ; f. 249-250v,« Mathematicien Musicien » ; f. 251-251v, Discours [sur les Anciens et les Modernes, la théorie et lapratique] ; ces deux dernières pièces synthétisent les prises de position très virulentes de Louliécontre la composition par les nombres, contre les « Anciens » et contre les « Théoriciens » dans laquerelle Anciens/Modernes et son avatar Théoriciens/Praticiens].
XXV°. Modes Anciens (il explique icy fort bien ce mot et partage ces anciens musiciens encinq classes.Dans la premiere il met les grecs et les latins dont la musique estoit si pleine de miracleset qui a été perdüe.La 2e. est des Latins plusieurs siecles avant Guy l’Aretin, c’est a d. avant l’an 1024, etquelques siecles aussi aprez, ce sont ceux qui ont composé la plus part de nos plains
THÉODORA PSYCHOYOU : LES RÈGLES DE COMPOSITION PAR MONSIEUR CHARPENTIER
105
chants. Ils ne chantoient pas alors a plusieurs parties, mais peut estre, et surtout apres GuyAretin, en Bourdon.La 3e. comprend ceux qui ont commencé a composer a plusieurs parties dans le genreDiatonique seullement et sans accompagnement depuis environ 1300 jusques en 1600.Ce sont ceux la qu’on pourroit apeller les anciens modernes.La 4e. comprend ceux qui depuis Viadana se sont servi d’acompagnement et par conse-quent des chordes chromatiques. On peut les appeler modernes.La 5e. qui a commencé vers 1650 sont les nouveaux modernes tels sont Carissimi, Foggia,Benevoli, Tarditi, &ca.J’en adjouterois volontiers une 6e sur tout pour la France que les operas de Lully ont sus-citée &ca.– [f. 252-254v].
XXVI°. Modes des Anciens de ce siecle et du siecle passé (NB. le S.r Loulié écrivoit cecyavant 1700).– [f. 256-256v, « Modes des anciens de ce siecle » ; f. 257-258, « Modernes anciens du siecle passé »].
XXVII°. Questions et Responses.– [f. 259-265, « Questions et Propositions » ; f. 266-269, « Mode de Musique » ; f. 269v-272v, « NomsGrecs des Modes des Anciens », Loulié avec extrait de Mersenne].
XXVIII°. Exemples de tous les signes de mesure dont se servoient les Anciens (de la 3e classecy dessus).– [f. 273-284v]
XXIX°. Extraict d’Ysandon (cest auteur est parmi les théoriciens in folio pag. … cy dessus).On y a joint un extrait latin de Glarean.– [f. 285-296v, « Extrait d’Yssandon » ; f. 297-300v, « Extrait de Glarean »].
III. LE RECUEIL F-Pn/ ms n.a. fr 6356, COPIE PARTIELLE DE LA SECONDE LIASSE
[sans titre général].Ms., [entre 1742 et 1760], 27,5 x 17,5 cm et divers formats, 57 f.F-Pn/ ms n.a. fr. 6356, f. 1-45v.
Ce manuscrit est composite : il comporte une première grande partie qui est partiellement lacopie de pièces contenues dans les papiers Loulié, complétée par des documents absents deces papiers, dont deux beaucoup plus tardifs. Plus précisément, cette première partie durecueil factice est suivie des Réflexions sur la maniere de former la voix, et d’apprendre la Musique,et sur nos facultés en général pour tous les Arts d’Exercice (f. 46-53v), d’une main plus tardive (finXVIIIe siècle), puis d’une Description de la Lyre d’Alexandre Quellé (f. 54-57), copiée d’une troi-sième main (début XIXe siècle).
La partie qui nous occupe (f. 1-45v) contient, de la même main, des renvois à la Dissertationsur l’état des sciences (Paris, 1734 ; réédition 1741) de l’abbé Jean Lebeuf (f. 13-25v). Par ailleurs,la marque du papier des feuillets qui composent respectivement les f. 2 et 11, 3 et 10, 4 et 9,5 et 8, 16 et 19 porte la date 1742 ; en revanche, le papier sur lequel sont copiées les Règles, aufiligrane de Malemenaide, ne porte pas de date, mais la copie est de la même main. En syn-thèse, les pièces numérotées ci-après de 1 à 14, copiées sur trois (et peut-être quatre) papiersdifférents, composent un ensemble homogène et, par conséquent, beaucoup plus tardif quecertains auteurs ont pu le croire, du fait que, comme il a été évoqué ci-dessus, ce recueil alongtemps été considéré comme faisant partie des « papiers Loulié » de la collection deSébastien de Brossard.
LES MANUSCRITS AUTOGRAPHES DE MARC-ANTOINE CHARPENTIER
106
Contient :note : pour les extraits issus des papiers Loulié, sont donnés, entre parenthèses les renvois correspondants
1 · f. 1-10 Musique Prattique ou Progrés de la musique pratique des anciens jusqu’à lanotre (seconde liasse, f. 233-246).
2 · f. 10v-11v Origine de la musique a plusieurs differentes parties (seconde liasse, f. 247-248v).3 · f. 11v-12 Idée du Musicien Loulié (seconde liasse, f. 249-250v).4 · f. 12-12v Discours [sur les Anciens et les Modernes, la théorie et la pratique ; Loulié]
(seconde liasse, f. 251-251v).5 · f. 12v Extrait de la methode de musique et de plainchant, par M.r Lancelot (seconde
liasse, f. 17).6 · f. 13-25v Extraits […] auteurs qu’on a pour juger par la l’estat des anciens traittés de
musique. 50 (première liasse, n°ix et seconde liasse, f. 285-296v).7 · f. 26-33v Regles de composition par M.r Charpentier (seconde liasse, f. 2-15v).8 · f. 33v Abregé des regles de l’accompagnement par M.r Charpentier (seconde liasse,
f. 16).10 · f. 34-34v Méthode qu’il faut tenir pour apprendre la composition de la musique (secon-
de liasse, f. 70-71v).11 · f. 35-36v Extraits de la dissertation de l’abbé Le Boeuf.12 · f. 37-40 Methode pour apprendre a chanter sur le livre.13 · f. 40v-42 Fugue [Loulié] (seconde liasse, f. 227-230v).14 · f. 43-45v Pour l’antiquité de la musique dans l’Eglise [Anonyme].15 · f. 46-53v Réflexions sur la manière de former la voix… [fragment d’un texte (manque le
début), suite du recueil factice, autre papier, fin XVIIIe siècle]16 · f. 54-57 Description de la Lyre… conçue et exécutée par Alexandre Quellé artiste
attaché à la Musique de sa Majesté l’Empéreur et Roi et Corriphée du théâtre impérial de l’Opéra comique [suite du recueil factice, autre papier,début XIXe siècle, papier azuré].
THÉODORA PSYCHOYOU : LES RÈGLES DE COMPOSITION PAR MONSIEUR CHARPENTIER
107
50. En marge : « L’abbé Leboeuf dit les 3.e dissert. Sur l’etat des sciences » (Jean Lebeuf, De l’État dessciences dans l’étendue de la monarchie française sous Charlemagne, dissertation, Paris, 1734 ; réédition, 1741) ;f. 24 : « Suitte du Cahier cotté n°. IX ».