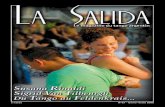Le personnage éclaté: Traces de l'inquiétude du sujet dans le cinéma contemporain
Le rôle du contexte d’expression et du statut social des intervenants de santé dans la...
-
Upload
thisisastupidsignupprocess -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Le rôle du contexte d’expression et du statut social des intervenants de santé dans la...
Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386
Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com
Article hors thème
Le rôle du contexte d’expression et du statut socialdes intervenants de santé dans la production d’un
discours normatif : le cas de la relationdes jeunes à l’alcool
The role of expression context and social status ofhealth actors in the production of a normative
speech: The case of young people’srelationship with alcohol
G. Lo Monaco a,∗, F. Lheureux a, L. Chianèse b,1,C. Codaccioni a, S. Halimi-Falkowicz a, P. Cano c,2
a Laboratoire de psychologie sociale (EA 849), université de Provence, Franceb Unité hospitalière sécurisée inter-régionale (UHSI), hôpital Nord, Marseille, France
c Association nationale pour la prévention en alcoologie et addictologie desBouches-du-Rhône (ANPAA13), Marseille, France
Recu le 1er novembre 2007 ; accepté le 1er fevrier 2008
Résumé
Notre objectif était de montrer que, lors de l’élaboration d’une campagne de prévention, les individusinterrogés vis-à-vis d’un objet sensible produisent un discours normatif, dans les conditions habituellesd’interaction, tandis que d’autres conditions favorisent l’émergence d’un discours plus authentique. Dansnotre étude, des étudiants devaient se livrer à des associations verbales vis-à-vis de l’alcool, confrontés àdeux types d’enquêteurs : un agent de santé ou un étudiant (première variable indépendante). Par ailleurs, ils
∗ Auteur correspondant. 22, traverse Marcel, laboratoire de psychologie sociale, université de Provence, 29, avenueRobert-Schuman, 13621 Aix-en-Provence cedex 1, France.
Adresse e-mail : [email protected] (G. Lo Monaco).1 Psychologue sociale de la santé.2 Animateur/formateur chargé de prévention.
1269-1763/$ – see front matter © 2008 Société francaise de psychologie. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.doi:10.1016/j.prps.2008.02.002
368 G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386
devaient s’exprimer soit en leur nom propre, soit comme le feraient les étudiants en général (seconde variableindépendante). Conformément à nos attentes, les résultats montrent que, face à un acteur de santé et lorsqueles étudiants s’expriment en leur nom propre, le discours produit vis-à-vis de l’alcool traduit une vision« pro-santé » (prise en compte du risque alcool). Les implications de ces résultats, concernant notamment lapréparation des actions de prévention, sont discutées.© 2008 Société francaise de psychologie. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Abstract
The objective of this research is to show that, under usual conditions of interaction between an agent ofhealth and of its public intervention, the individuals produce a “pro-health” speech which can lead astray thisagent, concerning the representation which they have of alcohol. Students, producing verbal associationsabout this object, were confronted either with an agent of health or with a student, and were speaking eitherfor themselves or as the students would do in general. The results show that the individuals, placed in frontof an agent of health and directly implied in the beliefs that they express, tend to adopt the speech wishedby this agent. However, this manifest adhesion only appears to be circumstantial, insofar as the speech ofthe individuals is different when they are expressed vis-a-vis a member of its group and in the name of thisone. The implications of these results with regard to the interventions of prevention are discussed.© 2008 Société francaise de psychologie. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Alcool ; Prévention des risques ; Discours normatif ; Contexte d’expression ; Communication
Keywords: Alcohol; Risk prevention; Normative discourse; Expression context; Communication
1. Introduction
La prévention de l’abus d’alcool mobilise, en France, l’attention et les forces de nombreuxacteurs de santé. La mise en œuvre des « états généraux de l’alcool » par le ministère de la Santé etdes Solidarités, par exemple, reflète les préoccupations actuelles en ce qui concerne la préventiondu risque alcool. En effet, cinq millions de Francais déclarent une consommation d’alcool régulièreet excessive en regard des recommandations de l’OMS (à savoir deux verres par jour pour lesfemmes, trois pour les hommes, et quatre par occasion de boire, cf. INPES, 2006) ce qui place laFrance au onzième rang mondial en termes de consommation d’alcool par habitant. Celle-ci seraiten outre la seconde cause de mortalité évitable après la consommation de tabac (Houssin, 2006).Cette situation, loin d’être anodine, pose la question de l’efficacité des campagnes de préventiondu risque alcool.
C’est dans ce cadre général que notre étude se situe, avec pour objectif principal d’attirerl’attention sur les aspects normatifs présents dans les relations établies entre acteurs de santé etles publics visés par les campagnes de prévention.
D’un point de vue général, lorsqu’il s’agit de répondre à une enquête, plusieurs études ont misen évidence que les personnes interrogées sont sous l’influence des attentes qu’elles attribuent à lapersonne qui les interroge. On peut citer, par exemple, un effet bien connu en psychologie socialeportant sur l’anticipation des attentes : l’effet Pygmalion (Rosenthal et Fode, 1963 ; Rosenthal etJacobson, 1968). Il s’agissait de montrer, pour Rosenthal et ses collaborateurs, que les réponsesdes individus sont fonction des attentes qu’ils infèrent à leur interlocuteur ou concernant l’objet deleurs jugements. Ces attentes dépendent elles-mêmes de la catégorisation a priori de l’interlocuteurou de la cible (i.e., l’objet). Ainsi, Rosenthal et Fode (1963) mettent en scène des rats dansun labyrinthe, et montrent qu’une catégorisation a priori et arbitraire de ces rats, en termes de
G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386 369
lignées (bonne versus mauvaise), influence radicalement les comportements des étudiants à l’égarddes rongeurs, et consécutivement, des rongeurs eux-mêmes. En condition « bonne lignée », lesétudiants accordent davantage d’attention et de comportements d’aide aux rats, ce qui amélioreleurs performances et confirme la catégorisation formulée a priori par l’expérimentateur. Uneautre recherche, conduite cinq années plus tard par Rosenthal et Jacobson (1968), aborde laquestion de l’attribution (toujours aléatoire) d’un score de QI à des élèves. Suite à de faussesindications données aux enseignants sur le QI de certains de leurs élèves, ceux ayant arbitrairementbénéficié d’un score de QI élevé font l’objet d’une meilleure évaluation enseignante, en termes decompétences. Ces recherches illustrent par conséquent l’influence que peut avoir le statut sociald’un interlocuteur sur les jugements produits par des individus.
La présente recherche se situe dans la lignée des travaux qui s’intéressent aux « effets decontexte » sur les réponses déclarées par les participants. Selon Schwarz et al. (Schwarz, 1999 ;Schwarz et Oyserman, 2001), les réponses déclaratives sont une source de données peu fiableset largement dépendantes des « effets de contexte ». Ces auteurs les appréhendent selon deuxvoies de compréhension. D’une part, dans le cadre d’un questionnaire, toute question poséedoit s’envisager en regard, plus large, de l’ensemble des questions posées, afin d’éviter les biaiscognitifs inhérents à ce type de questionnement : par exemple, l’effet de « halo », l’ordre desquestions, les problèmes de compréhension, type de formulation, etc. (cf. Schwarz, 1999, pourune revue). D’autre part, Schwarz et Oyserman (2001) proposent d’appréhender le phénomènede désirabilité sociale comme un facteur notable dans l’orientation que donnent les participantsà leur réponse. Ce phénomène n’est pas exclusivement lié à l’orientation normative de certainsitems, mais aussi parfois à la catégorisation dont l’enquêteur fait l’objet.
Dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes focalisés, sur les phénomènes de désirabi-lité sociale prenant place lors des échanges entre le porteur d’un message préventif et celui qui lerecoit. Plus précisément, nous souhaitons sensibiliser les psychologues, ou plus généralement toutacteur de santé impliqué dans une démarche de prévention, à deux des déterminants de la relationentre acteurs de santé et cibles d’une démarche de prévention : le statut social de l’enquêteur ainsique le degré d’implication du sujet dans ses réponses. Mieux connaître les déterminants d’unetelle relation peut, en effet, permettre aux praticiens, alors plus clairvoyants, d’optimiser leurdémarche, tant du point de vue de la communication, que de l’action. Dans cette perspective, etavant d’exposer la recherche empirique qui illustre notre propos, il nous semble indispensable deprésenter un certain nombre de travaux ayant démontré l’importance des phénomènes normatifsdans le cadre d’une interaction sociale.
2. De la préservation de son image sociale à la production d’un discours normatif
Une situation de prévention « directe » (en face-à-face) est une situation de communication.Comme toutes situations de communication, elle est influencée par plusieurs facteurs. Parmiceux-ci (cf. Abric, 1999), le statut social des interlocuteurs s’avère particulièrement important.L’individu adapte, en effet, son discours en tenant compte du statut de la personne à laquelleil s’adresse en vue de recevoir une approbation et/ou d’éviter une réprobation sociale (Ross etMirowsky, 1983 ; Friedlander et Schwartz, 1985 ; Gilbert et Hixon, 1991 ; Ferrari et al., 2005 ;Flament et al., 2006). Les individus mettent en œuvre, de fait, des stratégies de présentation de soivia ce qu’ils donnent à percevoir à autrui (Goffman, 1973, 1974). De ce point de vue, les travauxde Stangor et al. (2002) réalisés auprès de deux groupes d’étudiantes (afro-américaines versustype européen) sont particulièrement illustratifs. Ils s’intéressent à l’explication d’un échec parune discrimination percue (discrimination exercée à l’encontre des étudiantes afro-américaines),
370 G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386
en fonction du contexte d’expression (privé versus public1). Ils observent que les étudiantes afro-américaines expliquent beaucoup moins leur échec par une discrimination en contexte publiclorsqu’elles sont confrontées à des américaines de type européen (versus afro-américaines) ;aucune variation n’apparaît en revanche, pour les étudiantes de type européen. Ces résultatssoulignent tout l’enjeu, pour les étudiantes afro-américaines, à déclarer publiquement qu’ellesse sentent victimes de discrimination, l’explication tenant au fait qu’elles sont noires. En effet,déclarer une telle chose reviendrait à laisser supposer qu’une différence existe précisément. Ainsi,ce sont les étudiantes qui percoivent une menace en termes de stigmatisation (i.e., étudiantes afro-américaines) qui modifient davantage leurs réponses en fonction de l’interlocuteur et du contexted’expression dans lequel se situe l’interaction.
Dans cette perspective, plusieurs travaux s’inscrivant dans le cadre de la théorie des représenta-tions sociales (Moscovici, 1961) ont établi que les individus amenés à s’exprimer à propos d’objetsdits sensibles, ne manifestent qu’avec prudence leur accord avec certaines idées contre-normatives.Ce phénomène, étudié récemment sous l’angle des représentations sociales, a trouvé sa validationempirique depuis l’utilisation récente de deux types de procédures dites de « décontextualisationnormative » et de « substitution ». Envisageons ces deux types de procédures.
Concernant la décontextualisation normative, Flament et al. (2006) manipulent à l’instar deStangor et al. (2002) la présentation de l’enquêteur. Ils montrent, en situation d’enquête, quelorsque les individus sont amenés à exprimer leur représentation de « l’Islam », ils manifestentdavantage d’accord avec l’idée selon laquelle cette religion va à l’encontre des valeurs démocra-tiques de la France, face à une enquêtrice affirmant s’appeler « Céline », que face à une enquêtriceaffirmant s’appeler « Yamina ». Ce type de procédure « consiste à jouer sur le destinataire, le récep-teur auquel s’adresse le sujet lorsqu’il répond à une enquête » (Abric, 2003, p.78). Elle permetainsi de faciliter l’expression de certaines opinions faisant l’objet d’une stigmatisation sociale, desopinions pour ainsi dire contre-normatives, lorsque les individus se trouvent face à la « bonne »personne, celle qui ne devrait pas ou peu juger négativement l’émetteur de ces opinions. Ainsi,pour Guimelli et Deschamps (2000), il existerait « des sous-ensembles spécifiques de cognitions,qui tout en étant disponibles, ne seraient pas exprimées par les sujets dans les conditions normalesde production ». Ces cognitions nécessiteraient la mise en œuvre de procédures adaptées pourêtre exprimées. De facon parallèle, les individus « affichent » une adhésion aux croyances socia-lement désirables lorsque cela leur paraît utile, même s’ils n’y souscrivent pas nécessairement.Par exemple, dans l’étude de Flament et al. (2006), lorsqu’un individu est face à une enquêtrices’appelant « Yamina », il manifeste davantage son accord avec l’idée que l’Islam est une religionde tolérance que lorsqu’il est face à une enquêtrice s’appelant « Céline ».
Parmi les procédures qu’il est possible d’utiliser pour mettre en évidence de tels phénomènes,une autre technique dite « de substitution » consiste à ne plus solliciter l’expression des parti-cipants selon leur nom propre, mais au nom d’un autrui de substitution. Ainsi, Deschamps etGuimelli (2004) montrent que les individus manifestent plus facilement leur accord avec l’idéeque « l’insécurité » est liée aux banlieues, aux jeunes et/ou aux étrangers, lorsqu’ils s’expriment« comme le feraient les Francais/Suisses en général » (deux populations ayant été interrogéesdans cette étude, l’une francaise et l’autre suisse), que lorsqu’ils s’expriment à titre personnel.En s’exprimant par un autrui de substitution, les individus sont moins personnellement impli-qués dans les croyances qu’ils déclarent partager. Ils ressentent moins le besoin de protéger leur
1 En contexte privé, les réponses étaient anonymes et les étudiantes répondaient isolément ; en contexte public, lesétudiantes donnaient leurs réponses face à une autre personne, de même origine ethnique ou non.
G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386 371
image sociale, ce qui facilite chez eux l’expression des croyances contre-normatives et les amèneà exprimer dans une moindre mesure des croyances normatives auxquelles ils n’adhèrent pas oupeu.
Les travaux de Flament et al. (2006) ont également montré que le croisement des deux procé-dures de « décontextualisation normative » et de « substitution » (i.e., lorsque les sujets s’exprimentnon seulement face à la « bonne » personne, mais aussi par le biais d’un autrui de substitution) per-met : (a) de faciliter l’expression des aspects faisant l’objet d’un contrôle normatif, et (b) d’inhiberl’expression des croyances « politiquement correctes » auxquelles les individus ne souscriventapparemment pas réellement.
La question est de savoir si effectivement de telles stratégies sont mises en œuvre par les indi-vidus, lorsque des praticiens les sollicitent à propos de thèmes comme la sexualité, les conditionsde vie, la vie affective, la consommation de substances psychotropes, etc. Dans le cas présent,nous nous focaliserons sur l’alcool et sa consommation dans une situation où les individus sontsollicités à ce sujet dans le cadre des campagnes de prévention. Dans les enquêtes menées habi-tuellement à propos de diverses problématiques de santé publique, se présenter comme acteur desanté représente une facon récurrente de procéder. Pour exemple, une étude réalisée auprès des13–20 ans par l’institut de recherches scientifiques sur les boissons (Ireb) en 2001 (publiée parChoquet et al., 2003) concernant l’alcool, fait état, dans la partie méthodologique, de l’usage dece type de pratiques. En témoigne cet extrait du rapport (p. 24) : « Les enquêteurs étaient formés(sur le questionnaire) pour ne pas influencer les réponses. Ils présentaient le sujet de l’enquêteainsi que l’Ireb, et assuraient les interviewés sur l’anonymat des réponses. » Ainsi, en présentantl’Ireb, il est très probable qu’ait été activé un cadre normatif pouvant modifier l’orientation donnéeaux réponses des participants (i.e., générer un effet de contexte). Une autre recherche nationalemenée en 2005 par la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (FNORS) enpartenariat avec l’Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes régionales (USEM)2 solli-citait les mutuelles de santé en vue d’interroger les étudiants à propos de leur santé. Ici encore,le cadre normatif est rendu saillant par l’étiquette « acteur de santé » de l’enquêteur. En outre,les individus s’exprimaient ici en leur nom propre, avec les conséquences potentielles évoquéesprécédemment.
3. Problématique et objectifs de l’étude
Dans la suite logique des travaux présentés, on peut légitimement se poser les questionssuivantes : lorsque des individus sont interrogés par un acteur de prévention à propos de cequ’ils pensent de l’alcool, expriment-ils des opinions conformes à ce que leur interlocuteurdésire supposément entendre (opinions valorisées socialement), faisant ainsi preuve de désira-bilité sociale ? D’un point de vue plus pratique, l’utilisation des deux procédures précédemmentcitées occasionneraient-elles des variations dans les croyances évoquées au sujet de l’alcool ?Plus précisément, face à un acteur de prévention du risque alcool et en s’exprimant en leur nompropre, les individus déclarent-ils significativement plus que cette substance est « dangereuse »,qu’elle génère une « dépendance », etc. (discours normatif), que lorsqu’ils s’adressent à une per-sonne quelconque ? Dans le même ordre d’idée, masquent-ils face à ce même agent de santé, lesopinions pro-alcool telles que « l’alcool, c’est la fête », « l’alcool, c’est un plaisir », etc. (discourscontre-normatif) ? C’est pour tenter de répondre à ces questions que notre étude a été entreprise.
2 L’Usem fédère les mutuelles étudiantes régionales ; en France, elles comptent 150 agences pour dix mutuellesrégionales.
372 G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386
D’une facon générale, l’objectif poursuivi en termes d’application consiste à mettre en évidenceque les campagnes de prévention peuvent ne pas prendre suffisamment en compte ce que pensentréellement les personnes ciblées. La présente démontrera que l’alcool est bien un objet sensibleau sens où s’exprimer à son propos tend à activer une norme de « bonne conduite » qui sera rendueplus ou moins saillante par le contexte d’expression ainsi que le degré d’implication des sujetsdans leurs réponses.
4. Méthode
4.1. Participants
Cent trente-huit étudiants d’une université du sud de la France ont librement accepté de prendrepart à la recherche : 86 étudiantes et 52 étudiants, tous en fin de première année universitaireet approximativement du même âge (M = 19,60 ; ET = 0,90). Soixante-deux ont été recrutés enpsychologie, 36 en langues étrangères appliquées, 40 en sociologie.
4.2. Procédure
Un questionnaire leur était proposé dans le cadre d’une pré-enquête, en vue de la mise enplace d’une action future de prévention sur le campus avec différents partenaires institutionnelset associatifs. La passation se déroulait en groupes de travaux dirigés. L’anonymat ainsi que lecaractère confidentiel des réponses était assuré avant le début de la passation, la première pagedu questionnaire étant réservée à cet effet. L’information était donnée deux fois : à l’oral parl’enquêteur, puis par écrit sur le questionnaire.
Nous avons eu recours à une méthodologie d’enquête éprouvée dans le cadre de l’approchestructurale des représentations sociales : l’évocation hiérarchisée (Abric, 2003 ; Gaymard, 2006 ;Guimelli et Abric, 2007 ; Guimelli et Deschamps, 2000). Concrètement, selon cette méthodo-logie, on demandait aux participants d’associer quatre mots ou expressions au terme inducteur« alcool ». Ensuite, chaque participant devait hiérarchiser ses réponses par ordre d’importance,en leur affectant un chiffre allant de 1 à 4, où (1) représentait l’association verbale jugée commela plus importante et (4) l’association verbale jugée comme la moins importante. Enfin, chaqueparticipant devait indiquer, sur une échelle sémantisée en sept points, la valence attitudinale dechaque évocation, (1) représentant la réponse « très négatif », (7) représentant la réponse « trèspositif », (4) renvoyant à une position intermédiaire de neutralité.
4.3. Plan expérimental
Nous l’avons vu, plusieurs études révèlent un enjeu quant à la facon de s’exprimer à proposd’un objet problématique selon que l’on est face à tel ou tel type d’enquêteur (cf. Flament etal., 2006 ; Stangor et al., 2002 ; Gilbert et Hixon, 1991). De plus, cet enjeu peut être égalementmodulé selon que le participant est amené à répondre en son nom propre ou au nom d’un groupesocial d’appartenance plus élargi (cf. Chokier et Moliner, 2006 ; Deschamps et Guimelli, 2004 ;Flament et al., 2006 ; Guimelli et Deschamps, 2000). En référence à ces études, deux facteursindépendants de variation à deux modalités ont été croisés selon un plan expérimental intersujetcomportant quatre conditions (2 × 2).
Le premier facteur indépendant consistait à manipuler le contexte discursif dans lequel lesparticipants étaient invités à s’exprimer. Certains avaient pour consigne de répondre en leur nom
G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386 373
Tableau 1Plan expérimental de l’étude
Type d’enquêteur
Master Cetam
Consigne d’expressionStandard Condition expérimentale 1 Condition expérimentale 3Substitution Condition expérimentale 2 Condition expérimentale 4
propre (modalité « consigne standard »), d’autres comme le feraient d’après eux les étudiantsen général (modalité « consigne de substitution »). Ce facteur sera désormais nommé « consigned’expression » dans la suite du texte.
Le second facteur indépendant manipulait la présentation de l’enquêteur (procédure de décon-textualisation normative) en amenant les participants à répondre soit face à un enquêteur étudianten Master de sociologie, faisant un mémoire de recherche (modalité « Master »), soit face à unenquêteur se présentant comme appartenant au centre d’étude des toxicomanies alcooliques deMarseille (modalité « Cetam », structure fictive inventée pour les besoins de l’enquête, cf. Annexepour une présentation du logo utilisé). Ce facteur sera nommé désormais « Type d’enquêteur »,dans la suite du texte.
Ainsi, un questionnaire différent a été élaboré pour chaque condition expérimentale.(cf. Tableau 1 pour une présentation du plan expérimental).
4.4. Analyses des données
Les informations recueillies par le biais de la procédure précédemment décrite ont été analyséesselon trois modes.
4.4.1. Analyses prototypique des associations verbalesSelon Abric (2003), la méthodologie utilisée dans le cadre de ce questionnaire permet de croiser
l’importance moyenne du mot associé avec sa fréquence d’apparition, autorisant notammentle repérage de mots conjointement fréquents et jugés importants par les participants. Dans cebut, pour chaque condition expérimentale, un tableau synthétisant les données recueillies a étéconstitué : quatre tableaux (un par condition) ont donc été construits. Il s’agit de tableaux àdouble entrée (fréquence d’apparition des croyances/importance hiérarchique), comprenant quatrecases à l’intérieur desquelles sont reportés les mots associés au terme inducteur. En effet, lesassociations verbales obtenues dans chaque condition sont distinguées dans le tableau sur la based’une fréquence d’apparition de 10 % et d’une importance moyenne théorique de 2,5. Du point devue de la signification de ces valeurs, un mot ayant été associé par 10 % ou plus de l’échantillonest considéré comme parmi les plus fréquents du corpus. Par ailleurs, un mot ayant un rangd’importance moyen inférieur ou égal à 2,5 est considéré comme important (car généralementclassé en rangs 1 ou 2).
En procédant ainsi, on obtient quatre groupes d’associations verbales :
• celles à la fois peu fréquentes et peu importantes (évoquées par moins de 10 % de l’échantillonet ayant rang moyen supérieur à 2,5, soit plus souvent classées en position 3 et 4 que 1 et 2) ;
• celles étant fréquentes et peu importantes (évoquées par 10 % ou plus et ayant un rang moyensupérieur à 2,5) ;
374 G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386
• celles étant peu fréquentes et importantes (évoquées par moins de 10 % de l’échantillon et ayantun rang moyen inférieur à 2,5, soit plus souvent classées en position 1 et 2 que 3 et 4) ;
• celles à la fois fréquentes et importantes (évoquées par 10 % ou plus et ayant un rang moyeninférieur à 2,5).
Notons que le repérage des mots simultanément fréquents et importants permet alors deconnaître les croyances les plus fortement associées à l’objet concerné par l’étude.
Ces valeurs (10 % et 2,5) sont définies par défaut par le logiciel Evoc 2000© développé parVergès dont nous avons fait usage. La définition de ces valeurs revêt en soit un caractère arbitraire.Cependant, cela ne représente pas pour notre part une véritable limite, dès lors qu’elles sontmaintenues constantes dans les différentes analyses effectuées (ce qui est le cas pour les quatretableaux présentés plus loin).
Cette méthode élaborée dans le cadre du champ théorique des représentations sociales rendpossible la formulation d’hypothèses sur le statut central ou périphérique, au sein d’une représen-tation, des mots évoqués par les individus (Abric, 2003). Cependant, il n’est pas question, dansla présente étude, d’analyser de facon fine la structure représentationnelle telle qu’Abric (1994)l’a décrite. On s’attache davantage ici à étudier les variations éventuelles en termes de fréquencesd’apparition et d’importance moyenne des croyances associées à l’alcool, en fonction de la mani-pulation de certains contextes d’expression (variables indépendantes). On considère dans cetteoptique que les mots les plus fréquemment associés et considérés comme les plus importants sontles plus représentatifs de la manière dont les participants percoivent un objet précis.
4.4.2. Connotations positives et négatives des termes associés dans les différentes conditionsexpérimentales
Le second mode d’analyse se focalise en particulier sur les mots conjointement fréquents etimportants. Dans chaque condition, on a tout d’abord pris en considération le sous-corpus qu’ilsreprésentent (par exemple, 110 associations verbales pour la première condition, 124 pour laseconde condition, 97 pour la troisième, etc.). Ensuite, on a établi une distinction entre les termes àconnotation positive et négative à l’aide des évaluations produites par les répondants. Pour ce faire,l’évaluation attitudinale moyenne de chaque terme a été calculée, permettant une catégorisationa posteriori de chaque terme associé. Nous avons ensuite construit une variable indépendanteque l’on nommera dans la suite du texte « connotation attitudinale des termes associés », selondeux modalités « connotation positive versus connotation négative ». Le but étant de pouvoirétudier l’importance de chaque type d’association en fonction des modalités de nos variablesindépendantes. Par exemple, sur 110 associations verbales (celles relatives aux termes fréquents etimportants), on peut obtenir 44 associations « positives » (40 %) pour 66 associations « négatives »(60 %). Il est alors intéressant de savoir si les proportions de mots à connotation positive etnégative concernant les termes fréquents et importants sont significativement différentes selon laconsigne d’expression et le type d’enquêteur. Pour s’en assurer, on a testé le lien de dépendanceentre chaque variable indépendante (i.e., « consigne d’expression » et « type d’enquêteur ») et lavariable « connotation attitudinale des termes associés » au moyen du test du khi-deux.
4.4.3. Attitudes positives et négatives développées par les sujets selon les conditionsexpérimentales
On se souvient que les participants ont fourni chacun quatre associations et les ont ensuiteclassées par ordre d’importance. Par ailleurs, plus une association est considérée comme impor-tante, plus elle est représentative de l’univers mental de la personne concernée au sujet du thème
G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386 375
choisi. Suivant cette logique, nous avons considéré que les deux associations jugées comme lesplus importantes en sont les plus représentatives. On se souvient également que chaque partici-pant devait évaluer chacune de ses associations sur une échelle d’attitude en sept modalités allantde (1) absolument négatif par rapport à l’alcool à (7) absolument positif par rapport à l’alcool.On peut dès lors calculer, pour chaque participant, la valence attitudinale moyenne des deuxassociations les plus importantes qu’il a produites. Un score moyen élevé est alors considérécomme correspondant à une attitude générale positive, tandis qu’un score moyen faible fera étatd’une attitude générale négative. Ce score moyen, constituant une variable dépendante continue,est ensuite soumis à une analyse de la variance (Anova, dans la suite du texte) faisant interve-nir chaque variable (i.e., « consigne d’expression » et « type d’enquêteur ») en tant que variableindépendante nominale ou catégorielle.
4.5. Hypothèses
Conformément aux recherches précitées en introduction, nous prévoyions que les contextesd’expression ainsi manipulés entraîneraient des variations quant à l’expression des participants.Nous supposions que les participants modifieraient leurs réponses en fonction du type d’enquêteuret de la consigne d’expression.
4.5.1. Hypothèse no 1Le fait de répondre en son nom propre implique plus fortement les participants dans la situa-
tion d’interaction, et donc les confrontent davantage à une potentielle réprobation sociale s’ils nemanifestent pas leur adhésion à une norme « pro-santé » (i.e., une norme soulignant le caractèrepotentiellement néfaste de la consommation d’alcool). Partant, on a considéré les termes les plusreprésentatifs de la facon dont l’alcool est percu (termes conjointement fréquents et importantspour le calcul du khi-deux, ainsi que les deux associations les plus importantes de la suite associa-tive pour l’Anova). On s’attendait à ce que les participants ayant à s’exprimer dans la condition« standard » (i.e., en leur nom propre) associent davantage de termes négatifs et moins de termespositifs que ceux qui ont la possibilité de s’exprimer par le biais de leur groupe d’appartenance(modalité « consigne de substitution »).
4.5.2. Hypothèse no 2On s’attendait à ce que les participants, étant à la recherche d’une approbation de la part
de l’agent de santé ou dans l’évitement d’une potentielle réprobation, produisent des réponsescompatibles avec la norme véhiculée par leur interlocuteur. Plus précisément, en considéranttoujours les termes les plus représentatifs, on s’attendait à voir apparaître davantage de termesnégatifs vis-à-vis de l’alcool face à un représentant du Cetam (modalité « Cetam ») que lorsqueles participants sont confrontés à un étudiant de Master (modalité « Master »). Parallèlement, enréférence aux constats effectués concernant le rapport des jeunes à l’alcool, placé sous le signe del’abus, de la fête et de la convivialité,3 on s’attendait à voir apparaître, en proportion, davantagede termes traduisant une vision positive de l’alcool face à un étudiant de Master, que face à unreprésentant du Cetam.
3 Cf. article paru dans « Le Figaro » en date du 12 septembre 2006.
376 G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386
4.5.3. Hypothèse no 3Dans le prolongement des hypothèses posées précédemment, on s’attendait à ce que,
dans les conditions habituelles d’interaction entre agent de santé et individu ciblé (condition« Cetam/consigne standard »), les réponses données correspondent le plus aux attentes des inter-venants faisant de la prévention, à savoir des réponses globalement en accord avec les discoursde santé publique et donc plutôt normatives. Au contraire, dans la condition inverse (condition« Master/consigne substitution ») on s’attendait à ce que les associations produites par les sujetsà propos de l’alcool soient bien plus positives (favorables à l’alcool) et ainsi moins compatiblesavec une norme « pro-santé ». Dans les deux autres conditions expérimentales, on s’attendait àobtenir des réponses plus mitigées, intermédiaires entre les deux conditions précédentes.
4.6. Résultats
En premier lieu sera présentée l’analyse du corpus par le biais des tableaux à double entrée(croisant la fréquence d’apparition avec le rang moyen). Ensuite, viendront les résultats relatifsaux tests statistiques.
4.6.1. Analyse du corpus obtenu dans chaque condition expérimentaleLes résultats révèlent un certain dualisme sur l’ensemble des réponses. Indépendamment des
conditions, on observe en effet un univers d’associations verbales bipolarisé, comportant un pôlenégatif et un pôle positif.
Le pôle négatif renvoie à une dimension regroupant des termes tels que « danger »,« dépendance », « mauvaise santé » ou encore « accidents de la route », reflétant les risques engen-drés par la consommation d’alcool sur le plan sanitaire et social.
Le pôle positif renvoie, quant à lui, à une dimension plus festive, dont la prégnance a pu êtremise en évidence par d’autres auteurs (cf. Choquet et Ledoux, 1994). Cela se traduit par des termestels que « fête », « amis » ou « détente ». Dans ce cas, la consommation d’alcool est percue commefestive, récréative, contextualisée (« amis », « bar », « boîte »), et semble renvoyer à un momentde détente et/ou de loisir.
Suite à l’identification de ces deux « pôles », on étudiera systématiquement dans quelle mesureils sont plus ou moins représentés dans les productions verbales des individus selon les différentesconditions expérimentales (cf. Tableau 1 pour rappel de ces conditions). On s’intéressera toutparticulièrement, dans chacune des conditions, aux associations verbales présentes dans la « case »résultant d’une fréquence et d’une importance toutes deux élevées.
4.6.1.1. Condition « Cetam/consigne standard ». Envisageons tout d’abord les résultats obtenuslorsque les participants ont été amenés à s’exprimer en leur nom propre et face à un enquêteurdu Cetam (cf. Tableau 2). Rappelons que cette condition est celle qui correspond ici le plus auxconditions habituelles d’interaction entre un agent de santé et son public d’intervention.
En résumé, les résultats montrent que, face à un acteur de prévention, et lorsque l’on s’exprimeen son nom propre, « toute chose n’est pas bonne à dire », ou plus exactement, que certaineschoses sont meilleures à dire que d’autres. On observe, en effet, que les participants axent prin-cipalement leur production (fréquence et importance élevées) sur un registre tout à fait normatif,faisant intervenir des termes clairement négatifs. Ce sont des mots comme « mauvaise santé »,« accidents », « dépendance », « danger » qui sont fréquemment associés à l’alcool et considéréscomme importants. On serait tenté de penser être en présence d’individus « modèles », car décla-rant envisager l’alcool sous l’angle de la méfiance et de la rationalité médicale. En entendant de
G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386 377
Tableau 2Évocations liées à l’inducteur alcool pour les sujets répondant en leur nom propre face à un acteur de santé (conditionexpérimentale 3, Cetam/consigne standard)
Fréquence d’apparition Rang d’importance moyen
Forte (< 2,5) Faible (> 2,5)
Forte (> 10 %) Mauvaise santé (11/2,5) Mal de tête (5/3,2)Plaisir (11/2,45)Fête (10/2,00)Dépendance (8/2,12)Danger (8/2,5)Accident (7/2,00)Ivresse (5/2,2)
Faible (< 10 %) Mauvais goût (3/2,00) Mal être (3/2,66)Amis (3/2,33) Perte de contrôle (3/3,00)Capacités visuelles diminuées (2/2,00) Boîte de nuit (2/3,00)Occasion (2/2,50)Destruction (2/2,50)
Les chiffres entre parenthèses présentent dans l’ordre : la fréquence d’apparition et l’importance moyenne accordée parles participants. Pour rappel, plus le rang d’importance moyen est proche de 1, plus la croyance est considérée commeimportante.
telles productions, un agent de santé peut légitimement se dire qu’il a en face de lui des personnesqui, disposant déjà de certaines informations, sont susceptibles de bien intégrer et appliquer sesrecommandations préventives. En supplément, on peut noter la présence de deux termes positifsà côté de ceux instamment cités. Il s’agit des mots « fête » et « plaisir » qui renvoient à une dimen-sion festive et récréative de l’alcool, que les participants associent même en présence d’un acteurde santé. Cette dimension festive, nous le verrons, apparaît de facon transversalement fréquenteet importante dans toutes les conditions. On gardera à l’esprit, en guise d’explication, que cettedimension festive revêt un fort ancrage culturel que l’on peut faire remonter à l’Antiquité (Grappe,2006). Ainsi, l’identification d’un terme comme « fête » amène à se demander s’il appartient aurépertoire symbolique culturellement et historiquement associé à l’alcool. Cette dimension festiverecouvrerait nécessairement selon nous un caractère collectif, de par cet ancrage culturel. Danscette perspective, il pourrait constituer un des éléments de la mémoire collective (cf. Halbwachs,1950), qui a pour fonction d’être fédératrice et fait donc l’objet d’une acception sociale forte.
4.6.1.2. Condition « Master/consigne de substitution ». Envisageons maintenant, à titre compa-ratif, les résultats obtenus lorsque les participants s’exprimaient comme le feraient les étudiants engénéral (consigne de substitution) et face à un enquêteur se présentant comme étudiant en Mastersociologie (cf. Tableau 3). Rappelons que, selon nous, la production verbale obtenue s’inscrivaitdans un contexte d’expression diamétralement opposé au précédent.
En étudiant les termes apparus comme conjointement fréquents et importants, on relève immé-diatement ce qui constitue pour nous une observation essentielle. On note, en effet, que le caractèrenéfaste et « menacant » de l’alcool est absent. Seul un élément négatif est présent, le terme« ivresse ». Des termes comme « danger », « dépendance » et « accidents » sont désormais consi-dérés comme secondaires, étant donné qu’ils sont en moyenne jugés comme moins importants.Par ailleurs, l’association « mauvaise santé » apparaît moins fréquemment dans le corpus verbalrecueilli. L’inversion des conditions de production des associations verbales semble donc donner
378 G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386
Tableau 3Évocations liées à l’inducteur alcool pour les sujets répondant au nom des étudiants en général face à un étudiant deMaster (condition expérimentale 2, Master/consigne de substitution)
Fréquence d’apparition Rang d’importance moyen
Forte (< 2,5) Faible (> 2,5)
Forte (> 10 %) Fête (30/1,34) Danger (11/2,90)Détente (22/2,46) Accident (8/3,25)Amis (7/2,00) Dépendance (5/2,80)Ivresse (6/2,28) Bar (4/2,75)
Mal de tête (4/3,25)Faible (< 10 %) Boîte de nuit (2/2,00) Mauvaise santé (2/3,00)
Vin (2/2,50)Repas (2/2,50)
Les chiffres entre parenthèses présentent dans l’ordre : la fréquence d’apparition et l’importance moyenne accordée parles participants. Pour rappel, plus le rang d’importance moyen est proche de 1, plus la croyance est considérée commeimportante.
un apercu radicalement différent des croyances associées à l’alcool par notre population. Ce der-nier résultat est tout à fait intéressant dans la mesure où le caractère potentiellement néfaste et« menacant » de l’alcool constitue le plus souvent le cœur des campagnes de prévention. Il inter-roge grandement sur la réelle adhésion des individus aux messages préventifs dont ils constituentles récipiendaires réguliers, surtout lorsqu’ils sont confrontés à un cadre festif de consommation.Cette interprétation est d’autant plus soutenue par le fait que trois des quatre éléments associés fré-quemment et jugés comme étant importants sont évalués positivement. On peut en effet observerque les mots « fête », « détente » et « amis » traduisent toujours l’aspect festif de la consommationd’alcool, généralement en groupe avec des amis et comme étant un moyen de détente.
En définitive, on a donc bien observé des productions verbales contrastées entre les deuxconditions « extrêmes » de notre plan expérimental, ce qui va dans le sens de notre hypothèseprincipale.
Les deux conditions expérimentales suivantes étaient censées induire une production« intermédiaire », reflétant chacune un compromis entre deux éléments de contexte, l’un (Cetam,ou consigne standard) incitant à la production d’un discours normatif du point de vue « pro-santé », l’autre (Master, ou consigne de substitution) ne l’incitant pas. Dans ces deux conditions,on constate en effet la présence d’une production relativement ambivalente. Ce qui va dans lesens, ici encore, de notre hypothèse principale. Envisageons dès lors les résultats relatifs à cesconditions.
4.6.1.3. Condition « Master/consigne standard ». Devant un étudiant de Master et lorsqu’ilss’expriment en leur nom propre (cf. Tableau 4), les participants donnent à penser que l’alcoolest certes pour eux un « danger », une source « d’accidents », qui amène à « l’ivresse » ou encoregénère de la « dépendance », sans affirmer clairement que l’alcool génère une « mauvaise santé ».
D’autres éléments sont également fréquents et importants : « fête » et « amis ». Ces éléments,connotés positivement, renvoient à une consommation généralement groupale, entre amis, oùune consommation excessive peut parfois être autorisée car se déroulant dans un cadre festif oùle groupe deviendrait porteur d’une norme de consommation libre. D’une manière générale, laproduction verbale observée alterne entre termes positifs et négatifs, avec une prépondérancerelative de ces derniers.
G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386 379
Tableau 4Évocations liées à l’inducteur « alcool » pour les sujets répondant en leur nom propre face à un étudiant de Master(condition expérimentale 1, Master/consigne standard)
Fréquence d’apparition Rang d’importance moyen
Forte (< 2,5) Faible (> 2,5)
Forte (> 10 %) Fête (29/2,48) Détente (18/3,00)Amis (16/1,93) Mal être (5/3,00)Ivresse (13/2,38) Mal de tête (5/3,00)Danger (14/1,86)Accident (12/1,83)Dépendance (8/1,63)
Faible (< 10 %) Excès (4/2,50) Retrait permis (2/3,50)Occasion (3/1,66) Boîte de nuit (2/3,50)Ridicule (2/2,00)Destruction (2/2,50) Bêtise (2/3,00)Repas (2/2,50) Mauvaise santé (2/3,50)
Les chiffres entre parenthèses présentent dans l’ordre : la fréquence d’apparition et l’importance moyenne accordée parles participants. Pour rappel, plus le rang d’importance moyen est proche de 1, plus la croyance est considérée commeimportante.
4.6.1.4. Condition « Cetam/consigne de substitution ». Lorsque les participants s’exprimentcomme l’auraient fait les étudiants en général et face à un représentant du Cetam (cf. Tableau 5),les termes « danger » et « ivresse », renvoyant aux risques et conséquences de consommer del’alcool, ainsi que les termes « fête » et « détente » renvoyant à une consommation de l’alcooloù seuls les aspects positifs sont percus, figurent comme étant fréquemment évoqués et jugésimportants.
Par contraste, « mauvaise santé », « dépendance » et « accidents » apparaissent secondaires,ce qui traduit assez bien l’idée que les discours habituels de santé n’ont pas autant d’influenceque souhaitée auprès des étudiants en général, malgré la forte négativité et la prégnance de ceséléments dans les médias. Comme attendu, les associations verbales obtenues dans les deux
Tableau 5Évocations liées à l’inducteur alcool pour les sujets répondant comme le feraient les étudiants en général face à un acteurde santé (condition expérimentale 4, Cetam/consigne de substitution)
Fréquence d’apparition Rang d’importance moyen
Forte (< 2,5) Faible (> 2,5)
Forte (> 10 %) Fête (29/1,72) Dépendance (11/2,64)Détente (20/2,35) Accident (7/3,10)Danger (21/2,33) Mal de tête (4/2,75)Ivresse (7/2,14)
Faible (< 10 %) Mort (3/1,66) Abus (3/3,33)Désinhibition (2/1,50) Modification du comportement (2/3,00)Boîte de nuit (2/2,50) Mauvaise santé (2/3,50)
Bêtise (2/4,00)
Les chiffres entre parenthèses présentent dans l’ordre : la fréquence d’apparition et l’importance moyenne accordée parles participants. Pour rappel, plus le rang d’importance moyen est proche de 1, plus la croyance est considérée commeimportante.
380 G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386
dernières conditions expérimentales envisagées donnent un apercu global ambivalent descroyances relativement constituées vis-à-vis de l’alcool.
L’analyse plus « qualitative » des corpus respectivement obtenus dans les quatre conditionsexpérimentales a globalement confirmé nos trois hypothèses. Il est toutefois utile, voire nécessaire,pour s’en convaincre d’étudier les résultats fournis par une approche plus « quantitative ».
4.7. Tests statistiques
Pour chaque hypothèse posée plus haut, les résultats obtenus par le test du khi-deux et l’Anovavont être dès à présent exposés.
Conformément à notre hypothèse no 1, il existe une relation de dépendance entre les variables« connotation attitudinale des termes associés » et « consigne d’expression ». Pour rappel, on adécidé de distinguer, dans chaque condition expérimentale, les termes à connotation positivedes termes à connotation négative. Cette distinction nous a permis de construire une variableindépendante que nous avons nommée « connotation attitudinale des termes associés », selondeux modalités « connotation positive versus connotation négative ». En procédant de la sorte, ilétait dès lors possible d’étudier la relation entretenue entre la fréquence d’apparition de chacundes types de mots et les variables indépendantes mobilisées.
Cette relation est hautement significative [χ2(1) = 22, 97 ; p < 0,00001]. On constate, en effet,
qu’en consigne de substitution, davantage de termes positifs (101 sur les 142 que représententles termes fréquents et importants en substitution, soit 71,1 %) que de termes négatifs (41 sur142, soit 28,9 %) sont associés à l’alcool. En revanche, on remarque que cela n’est pas le cas enconsigne standard (positifs : 66 sur 152, soit 43,4 % ; négatifs : 86 sur 152, soit 56,6 %). Précisonsqu’en consigne standard, parmi les termes apparus comme fréquents et importants, et sur la basede l’évaluation faite par les participants, ont été considérés comme positifs « plaisir », « fête »et « amis », et comme négatifs « mauvaise santé », « dépendance », « danger », « accident » et« ivresse ». En consigne de substitution, « plaisir », « fête » et « amis » ont été appréhendés commepositifs versus « danger » et « ivresse » comme négatifs.
Pour rappel, on a calculé pour chaque participant la valence attitudinale moyenne des deuxassociations les plus importantes produites par celui-ci, chaque participant ayant évalué chacunede ses associations sur une échelle d’attitude en sept modalités allant de (1) absolument négatifpar rapport à l’alcool à (7) absolument positif par rapport à l’alcool. Nous obtenions donc, dansce cadre, une variable dépendante continue. De plus, comme nous avons pu en faire état supra,nous disposions de deux variables indépendantes nominales (« consigne d’expression » et « typed’enquêteur »). Partant, il était possible d’envisager des traitements se situant dans le cadre del’Anova.
Les résultats de cette Anova révèlent une moyenne attitudinale plus élevée (donc davantagepositive) pour la modalité « consigne de substitution » (M = 4,48) que pour la modalité « consignestandard » (M = 3,48), la différence étant très significative [F(1,136) = 9,07 ; p < 0,01]. Sur la basede l’ensemble de ces résultats, la première hypothèse semble donc validée.
Concernant à présent la seconde hypothèse, il semblerait qu’il existe une relation de dépen-dance entre les variables « connotation attitudinale des termes associés » et « type d’enquêteur» [χ2
(1) = 3, 41 ; p = 0,065]. Ce résultat étant tendanciel, nous restons donc prudents quant à soninterprétation. On soulignera toutefois à ce sujet qu’un effectif plus large aurait sans doute lar-gement augmenté sa significativité. Cela dit, face à un étudiant de Master, davantage de termespositifs (97 sur 157, soit 61,8 %) que de négatifs (60 sur 157, soit 38,2 %) sont associés par lesparticipants, que face à un représentant du Cetam (positifs : 70 sur 137, soit 51,1 % ; négatifs :
G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386 381
Fig. 1. Évolution des proportions de termes fréquents et importants à connotations positive et négative en fonction desdifférentes conditions expérimentales.
67 sur 137, soit 48,9 %). Sur la base de ces résultats, il apparaît que notre seconde hypothèse estvalidée, même si elle reste à confirmer sur un échantillon plus large.
Par ailleurs, comme pour la première hypothèse, l’Anova révèle une moyenne attitudinale plusélevée (donc davantage positive) pour la modalité « Master » (M = 4,40) que pour la modalité« Cetam » (M = 3,38), la différence étant très significative [F(1,136) = 9,52 ; p < 0,01].
En ce qui concerne l’examen statistique de la troisième hypothèse, il est possible d’illustrer demanière très probante le phénomène observé en comparant les quatre conditions expérimentales.En effet, on peut observer des proportions de termes positifs et négatifs nettement contrastéeslorsqu’on croise les modalités des deux variables (cf. Fig. 1).
Les variations de la connotation attitudinale des termes associés sont significativement dépen-dantes de la condition expérimentale considérée [χ2
(3) = 17, 29 ; p < 0,001].Les proportions de mots à connotation négative augmentent jusqu’à atteindre un maximum
pour la condition « Cetam/Consigne standard » (39 sur 60, soit 65 %). En revanche, leur minimumse situe en condition « Master/Consigne de substitution » (13 sur 65, soit 20 %). Concernant lesproportions de mots à connotation positive, on observe strictement l’inverse (21 sur 60 pourCetam/Standard, soit 35 % ; 52 sur 65 pour Master/substitution, soit 80 %). Ce résultat est tout àfait consistant avec les résultats mis en évidence tout au long de cette recherche.
L’étude des valences attitudinales (cf. Fig. 2) mesurées selon les conditions (Anova), confirmele résultat précédent. Elle montre qu’effectivement le type de condition expérimentale déterminele score attitudinal moyen de facon hautement significative [F(3, 134) = 7,14 ; p < 0,001].
Le test PLSD de Fisher révèle une différence significative entre toutes les conditions hormisentre deux d’entre elles : « Master/standard » et « Cetam/substitution ». Les résultats confirmentdonc les différences observées en termes de moyennes sur la Fig. 1. En effet, les termes associés àl’alcool par les sujets confrontés à un étudiant, et qui de surcroît répondent au nom des étudiantsen général, sont connotés plutôt positivement (M = 4,94), comparativement aux réponses de ceux
382 G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386
Fig. 2. Effet du type de condition sur la moyenne attitudinale calculée pour chaque condition expérimentale concernantles termes fréquents et importants.
qui s’expriment en leur nom propre et face à un acteur de santé (M = 2,76). Les réponses recueilliesdans les deux autres conditions expérimentales sont intermédiaires et ne diffèrent pas entre elles defacon significative (M = 3,97 pour « Master/Standard » et M = 3,95 pour « Cetam/Substitution »).
Au vu de l’ensemble des résultats, nous pouvons donc considérer que l’hypothèse principaleayant guidé notre expérience est confirmée.
5. Discussion
Conformément à nos prédictions, les deux variables manipulées dans la présente étude (consi-gne d’expression et type d’enquêteur) occasionnent des variations dans les discours produits parles étudiants sur le thème de l’alcool. Ainsi, la comparaison générale « Master versus Cetam »(première variable indépendante manipulée) prend tout son sens lorsque l’on considère la ques-tion des effets de l’alcool sur la santé. Le résultat obtenu traduit bien l’idée selon laquelle c’estuniquement face à un acteur de santé que la question sanitaire semble importante pour les étu-diants. D’une manière plus précise, ce constat ne peut se faire que lorsqu’on amène les étudiantsà répondre en leur nom propre. En termes explicatifs, on peut envisager qu’une personne possèdeplusieurs facettes identitaires. Goffman (1973, 1974, 1975) pose, en effet, que les individus dis-posent d’un faisceau d’identités possibles dont « une » serait actualisée en fonction des contraintesgénérées par la situation d’une part, et les intérêts sociorelationnels du sujet, d’autre part. Enfin,l’idée que notre identité puisse être malléable et adaptative semble être également partagée parMartinot (2002, p. 25), selon laquelle « le Soi est fortement influencé par les facteurs sociaux.Notre facon de penser et d’essayer de nous présenter est, en effet, largement dépendante desindividus qui nous entourent. » Or il semblerait que le statut d’acteur de santé active chez lesétudiants la sphère de la santé et de ses relations avec l’alcool, notamment les aspects négatifsde l’alcool sur l’organisme et sur la conduite automobile. Par conséquent, en l’absence de cesacteurs de santé et en étant peu impliqué dans les réponses données, l’activation de ce registre
G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386 383
sanitaire liée à la consommation d’alcool aura moins de chance de se produire. De même, l’idéeque l’alcool a des conséquences sur la santé sera sans doute facilement minimisée au profit desaspects liés à la fête, l’évasion et le plaisir. Ainsi, pour qu’une action de prévention soit efficace, ilserait utile d’avoir davantage connaissance des réponses obtenues lorsque le répondant s’exprimepar le biais d’un autrui plus général et de même appartenance sociale, ainsi que face à un pair.En ce sens, ces résultats permettent d’ores et déjà de conclure que les modalités d’enquête, surdes sujets aussi sensibles que l’alcool, doivent prendre en compte ce genre de variations. Rienne permettrait, a priori, d’inférer que ce que disent les étudiants au nom des étudiants en généralreflète ce qu’ils pensent effectivement. Cependant, comme le soulignent Flament et al. (2006, p.8),« ces résultats montrent (outre la pertinence des deux variables) que la consigne de substitution nesaurait être interprétée comme faisant jouer uniquement un effet de transparence ». En effet, selonces travaux, les deux procédures (i.e., décontextualisation normative et substitution) expliquentde facon unidimensionnelle les variations observées dans les réponses fournies par les individus.
En outre, deux arguments permettent de soutenir les résultats observés en termes de variationsd’expression selon les conditions expérimentales. Tout d’abord, l’absence d’équivalence du pointde vue attitudinal entre les deux conditions de « substitution » (cf. Fig. 1) démontre qu’il ne peuts’agir d’un effet d’inférence ou de connaissance du système de pensée partagé par le groupede référence. Ensuite, la manipulation de la consigne d’expression permet de montrer clairementl’utilisation de stratégies mises en œuvre par les participants afin de donner la meilleure image pos-sible d’eux-mêmes. En effet, conformément à la littérature, on constate que le fait de s’exprimeren son nom propre amène les étudiants à verbaliser un contenu assez négatif allant dans le sensde ce qu’il faut dire « pour être bien vu ». Des mots comme « danger », « accident » ou encore« dépendance » apparaissent (car retranscrivant les notions de responsabilité et de rationalité indi-viduelles, fortement valorisées dans nos sociétés), alors qu’en revanche, dès lors que les sujetss’expriment au nom des étudiants en général, ces mots deviennent secondaires pour laisser placeà un registre positif. En effet, on observe que seuls les mots « fête », « détente » et « amis » sonttrès fréquemment associés à l’alcool et jugés comme très importants. On relève également quela référence aux méfaits de l’alcool sur la santé est totalement secondaire lorsque les participantssont amenés à répondre face à un pair. Force est de constater que ce résultat renvoie à une réalitéproblématique lorsque l’on mène une action préventive.
Les différences importantes relevées entre les deux conditions « Cetam/consigne standard »et « Master/consigne de substitution », tant au niveau des termes produits que de leur valenceattitudinale, justifient pleinement, selon nous, la réflexion menée en introduction. Ces différencesiraient donc dans le sens d’une stratégie de présentation de soi visant, comme ont pu le noter denombreux auteurs, l’influence des impressions potentielles que les autres peuvent avoir à notrepropos à partir de ce que nous déclarons penser et faire (cf. notamment Goffman, 1973 ; Leary etKowalski, 1990 ; Lewis et Neighbors, 2005 ; Schlenker, 1980 ; Tedeschi et Lindskold, 1976).
Ici, il s’agissait du cas particulier des stratégies mobilisées par les étudiants lorsqu’ils sontsollicités à propos de l’alcool. Certes, les résultats obtenus dans cette étude ouvrent, en ce sens,de nouvelles perspectives en termes de campagnes de prévention. Mais pas seulement.
La prise en compte du contexte d’expression ainsi que du degré d’implication des individusdans leurs réponses pourrait également s’avérer pertinente dans d’autres cadres que ceux de laprévention du risque alcool. Prenons l’exemple de l’observance thérapeutique. On peut, en effet,imaginer sans difficultés que le discours tenu par les patients à propos de leur suivi du traitementne sera pas le même s’ils s’adressent à un membre du corps médical ou à un autre patient.De nombreux paramètres bio-psychosociaux peuvent entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agitdu respect d’un traitement. Si, d’un point de vue physique et psychologique, on peut trouver
384 G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386
les « effets secondaires » ou le « vécu de la maladie », du côté social, on aura bien entendu, lepoids incontournable d’une « norme sociale ». Cette norme aura tendance, comme dans le cas del’alcool, à faire barrage à l’expression authentique de conduites contre-normatives. « Commentdire à son médecin qu’hier, on a oublié deux fois son traitement alors qu’on s’était engagé à leprendre sérieusement, et qu’en plus il en va de notre santé, etc. » Là encore, le recours à la variablede substitution permettrait aux patients d’exprimer leurs difficultés potentielles par le biais d’unautrui plus général, dans un discours qui serait, de fait, beaucoup moins impliquant.
Cette nouvelle piste d’application permet à son tour d’élargir le champ de la réflexion. Dansle cas de l’observance, rappelons que la relation médecin/patient est par essence asymétrique,ne serait-ce que parce que l’un détient le savoir scientifique et l’autre pas (cf. Morin, 2004). Surcette base, nous pouvons envisager différentes situations d’interaction dans lesquelles les statutsne sont pas symétriques. Imaginons le cas d’un service de relations humaines d’une entreprisequi voudrait mieux connaître les motivations de ses employés. Faire appel à un cabinet de conseilest déjà une facon d’activer la décontextualisation normative : les employés ne répondent pasdirectement à leur direction, garante de la « norme travail », mais à une instance extérieure sansrelation directe a priori avec leurs supérieurs hiérarchiques, avec laquelle ils produiront un dis-cours peut-être plus authentique. Leur demander de répondre en leur nom propre versus au nomdes employés de l’entreprise en général, pourrait apporter de nouveaux éléments de réponses. Onpourrait, par exemple, mieux comprendre des situations contradictoires fréquemment observées,dans lesquelles les niveaux performances ne sont pas à la hauteur de ce qu’on pourrait attendre auvu des enquêtes de motivations. On pourrait également contourner de la sorte de facon très cir-constancielle et momentanée les effets de norme d’internalité (cf. Beauvois, 1984, 1994 ; Beauvoiset Le Poultier, 1986 ; Beauvois et Dubois, 1987 ; Dubois, 1994). En effet, dans le cadre des situa-tions de recrutement la possibilité de faire intervenir ces variables serait un gage d’évitement del’expression de cette norme qui consiste à surestimer les facteurs dispositionnels dans le but deprésenter une image désirable (cf. Beauvois et al., 1991, pour un exemple de recherche portantsur les effets de la norme d’internalité dans les situations de recrutement). De facon plus générale,il nous semble que la méthode présentée dans cette étude permettrait d’approfondir le recueild’informations concernant la plupart des situations d’interaction dans lesquelles les interlocu-teurs occupent des positions asymétriques. Les situations dans lesquelles l’un des interlocuteursest porteur d’une norme sociale rendue saillante par l’objet même de l’interaction et que lesindividus n’ont pas « intérêt » à contredire publiquement. On peut penser à titre d’exemple à lacommunication entre élève et professeur, aux relations entre citoyens et policiers, etc.
6. Conclusion
L’objectif de cet article n’est pas de remettre en question le travail des acteurs de santé,mais bien au contraire, de contribuer à l’optimisation des stratégies mises en œuvre par cesderniers, en tentant d’approfondir la compréhension des enjeux rendus saillants dans les situationsd’interactions directes. En définitive, cette étude a permis de mettre au jour que les actions deprévention concernant l’alcool ne sont probablement pas suffisamment « ajustées » aux croyancesréellement associées à l’alcool, puisque les sujets semblent n’exprimer qu’en partie ce qu’ilspensent sur ce thème. Par ailleurs, l’efficacité d’un message dépend de sa capacité à s’adapter auxreprésentations des cibles de l’action de prévention. Il se doit d’être en phase avec elles. Or cen’est pas le cas puisque les acteurs de santé n’ont, d’après cette étude, pas accès à l’ensemble de lareprésentation qu’ont les étudiants interrogés de l’alcool et des conséquences de sa consommation.Aussi, il serait préférable d’analyser plus finement cette représentation en prenant donc en compte
G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386 385
les croyances, protections, défenses et résistances qui sont liées à sa verbalisation. Cela permettraitde prendre en considération les variations discursives lors de campagnes/actions de prévention enadaptant les messages pour optimiser leur impact.
Annexe
Logo utilisé dans les deux conditions expérimentales où l’enquêteur déclarait appartenir aucentre d’étude des toxicomanies alcooliques de Marseille.
Références
Abric, J.-C., 1994. Les représentations sociales : aspects théoriques. In: Abric, J.-C. (Ed.), Pratiques sociales et représen-tations. Presses Universitaires de France, Paris, pp. 11–35.
Abric, J.-C., 1999. Psychologie de la communication. Armand Colin, Paris.Abric, J.-C., 2003. La recherche du noyau central et de la zone muette des représentations sociales. In: Abric, J.-C. (Ed.),
Méthodes d’étude des représentations sociales. Ramonville Saint-Agne, Erès, pp. 59–80.Beauvois, J.-L., 1984. La psychologie quotidienne. Presses Universitaires de France, Paris.Beauvois, J.-L., 1994. Traité de la servitude libérale. Une analyse de la soumission. Dunod, Paris.Beauvois, J.-L., Bourjade, A., Pansu, P., 1991. Norme d’internalité et évaluation professionnelle. Rev. Int. Psychol. Soc.
1, 9–28.Beauvois, J.-L., Dubois, N., 1987. The norm of internality in the explanation of psychological events. Eur. J. Soc. Psychol.
18, 299–316.Beauvois, J.-L., Le Poultier, F., 1986. Norme d’internalité et pouvoir en psychologie quotidienne. Recherches sur la
psychologie de tous les jours. Psychol. Fr. 31, 100–108.Chokier, N., Moliner, P., 2006. La « zone muette » des représentations sociales, pression normative et/ou comparaison
sociale ? Bull. Psychol. 59 (3), 483, 281-286.Choquet M., Com-Ruelle L., Lesrel J., Leymarie N., 2003. Les 13-20 ans et l’alcool en 2001. Comportements et contextes
en France, Institut de Recherches scientifiques sur les Boissons, Paris, 128 pages. Consultable en intégralité sur le sitewww.ireb.com.
Choquet, M., Ledoux, S., 1994. Adolescents. Enquête nationale. Éditions INSERM.Deschamps, J.-C., Guimelli, C., 2004. L’organisation interne des représentations sociales de la sécurité/insécurité et
l’hypothèse de la « zone muette ». In: Beauvois, J.-L., Joule, R.V., Monteil, J.-M. (Eds.), Perspectives cognitives etconduites sociales (IX). Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 105–130.
Dubois, N., 1994. La norme d’internalité et le libéralisme. Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble.Ferrari, J.R., Bristow, M., Cowman, S.E., 2005. Looking good or being good ? The role of social desirability tendencies
in student perceptions of institutional mission and values. Coll. Stud. J. 39 (1), 7–13.Flament, C., Guimelli, C., Abric, J.-C., 2006. Effets de masquage dans l’expression d’une représentation sociale. Cah.
Int. Psychol. Soc. 69, 15–31.Friedlander, M.L., Schwartz, G.L., 1985. Toward a theory of strategic self-presentation in counselling and psychotherapy.
J. Couns. Psychol. 32 (4), 483–501.Gaymard, S., 2006. The representation of old people: Comparison between the professionals and students. Int. Rev. Soc.
Psychol. 19 (3–4), 69–91.Gilbert, D.T., Hixon, J.G., 1991. The trouble of thinking: activation and application of stereotyping beliefs. J. Pers. Soc.
Psychol. 60 (4), 509–517.
386 G. Lo Monaco et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 367–386
Goffman, E., 1973. La Mise en Scène de la vie quotidienne. Tome 1 « la présentation de soi ». Les éditions de minuit,Paris.
Goffman, E., 1974. Les rites d’interaction. Les éditions de minuit, Paris.Goffman, E., 1975. Stigmate. Les éditions de minuit, Paris.Grappe, V., 2006. L’histoire longue de l’ivresse. Sociétés 93, 77–82.Guimelli, C., Abric, J.-C., 2007. La représentation sociale de la mondialisation : rôle de l’implication dans l’organisation
des contenus représentationnels et des jugements évaluatifs. Bull. Psychol. 60 (1), 487, 49–58.Guimelli, C., Deschamps, J.-C., 2000. Effets de contexte sur la production d’associations verbales. Le cas de la représen-
tation sociale des Gitans. Cah. Int. Psychol. Soc. 47–48 (3–4), 44–54.Halbwachs, M., 1950. La mémoire collective. Presses Universitaires de France, Paris.Houssin, D., 2006. Alcool et santé : un bilan pour renforcer une politique de santé efficace. Bull. Epidemiol. Hebd. 34–35,
251–252. http://www.invs.sante.fr/beh/2006/34 35/beh 34 35 2006.pdf.Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 2006. L’alcool et les idées recues. Équilibre, la lettre de la
prévention et de l’éducation pour la santé, 16. http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/pdf/Lettre16.pdf.Leary, M.R., Kowalski, R.M., 1990. Impression management: A literature review and two-component model. Psychol.
Bull. 107, 34–47.Lewis, M.A., Neighbors, C., 2005. Self-Determination and the Use of Self-Presentation Strategies. J. Soc. Psychol. 145
(4), 469–489.Martinot, D., 2002. Le soi. Les approches psychosociales. Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble.Morin, M., 2004. Parcours de santé. Armand Colin, Paris.Moscovici, S., 1961. La psychanalyse, son image et son public, 2e Édn. Presses Universitaires de France, Paris, 1976.Rosenthal, R., Fode, K., 1963. The effect of experimenter bias on the performance of the albino rat. Behav. Sci. 8, 183–189.Rosenthal, R., Jacobson, L., 1968. Teacher expectations for the disadvantaged. Sci. Am. 218, 19–23.Ross, C.A., Mirowsky, J., 1983. The worst place and the best face. Soc. Forces 62 (2), 529–536.Schlenker, B.R., 1980. Impression management: The self-concept social identity and interpersonal relations. Brooks/Cole,
Monterey, CA.Schwarz, N., 1999. Self-reports: How the questions shape the answers. Am. Psychol. 54, 93–105.Schwarz, N., Oyserman, D., 2001. Asking questions about behavior: Cognition, communication and questionnaire cons-
truction. Am. J. Eval. 22, 127–160.Stangor, C., Van Allen, K.L., Swim, J.K., Sechrist, G.B., 2002. Reporting discrimination in public and private contexts.
J. Pers. Soc. Psychol. 82 (1), 69–74.Tedeschi, J.T., Lindskold, S., 1976. Social psychology: Interdependence, interaction, and influence. Wiley, New York.USEM/FNORS, 2005. La santé des étudiants en 2005, 4ème enquête. http://www.usem.fr/contenu PDF/
enquete sante 2005.pdf.