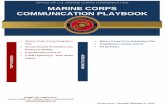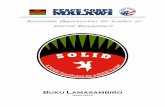Le corps du roi
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Le corps du roi
2
« Ecquid futura dico ? Hic nempe tibi terram caelum fecit hoc mysterium…
Quod enim illic omnium pretiosissimum est, hoc tibi in terra iacens monstrabo.
Sicut enim in regis quod omium magnificentissimum est, non muri sunt,
non tectum, sed reguium corpus in solio sedens : sic et in caelis regium corpus.
Absterge igitur anima, praepara mentem ad horum mysterium perceptionem ».
« Et pourquoi parler du futur ? Dès ici-bas, assurément, ce mystère fait pour toi de la terre un ciel…
Ce qu’il y a là-haut d’infiniment précieux, je te le montrerai ici-bas sur la terre.
De même que dans un palais, ce ne sont pas les murailles,
ni le toit, mais le corps du roi, siégeant sur le trône, qui plus que tout resplendit de gloire et de beauté,
de même dans les cieux, c’est le corps du roi.
Purifie donc ton âme, prépare ton intelligence à la réception de ces mystères ».
Saint Jean Chrysostome, Homélie sur la première Lettre aux Corinthiens
3
Debout devant la cheminée où il venait d’allumer un bon feu, Côme de
Lambrefaut réfléchissait. Il en était à la troisième pipe et songeait à un whisky tout en
appliquant son esprit à l’idée de l’infini. « Quelque chose de tel que rien de plus grand
ne se puisse penser », dit Anselme : soit. C’est une idée, ou plutôt, un Nom, qui désigne
quelque chose qui est au moins dans la pensée. Anselme a raison : cela doit exister
aussi en dehors de la pensée, sinon, ce n’est pas vraiment grand. Or, sa grandeur
dépasse ma pensée. Mais qui suis-je pour affirmer que ce Quelque chose existe bien,
pour cette raison que je pense qu’il ne peut pas être seulement dans ma pensée ? Je
n’affirme l’existence des êtres qu’à partir d’une expérience : pas des raisonnements de
ma pensée…
Côme s’enfonça dans le canapé de cuir, qu’il caressa machinalement. « Un
canapé parfait ne peut pas ne pas exister…, donc il n’existe pas seulement dans ma
pensée» : voilà bien une idée que Gaunilon avait objectée à Anselme, à l’époque (mais
c’était avec une « île »). Un canapé qui ne serait pas contingent, mais nécessaire… C’est
impensable : tous les êtres sont contingents. De Dieu seul nous disons avec justesse
qu’il est nécessaire et même plus que nécessaire. C’est tout de même incroyable, cette
idée-là : unique entre toutes, les surplombant toutes, dépassant aussi la faculté qui la
conçoit sans jamais l’embrasser. Côme éprouvait souvent un sentiment d’admiration
et d’enthousiasme, quand son esprit tendait vers Cela dont plus grand ne se puisse
penser. Ce désir à lui seul ne suffisait-il pas à prouver l’existence de Dieu ?
Ce soir-là encore, comme depuis plusieurs semaines, il veilla tard dans la
nuit, assis à sa table ronde. Il y était comme en famille, ou comme à un bon dîner entre
amis. Il y avait là les onze volumes des œuvres de Descartes, plus quatre ou cinq livres
sur lui empruntés à la bibliothèque. Puis Husserl et l’idée de Dieu, tout récemment paru.
La lampe éclairait bien, mais il se demandait s’il ne mettrait pas à la place une vieille
lampe à pétrole ramenée de Bretagne l’hiver dernier : plus pittoresque… Il était minuit
déjà et aucune envie d’aller dormir. La musique aussi le tenait éveillé. Elle agissait sur
son esprit comme un souffle revigorant, ou comme un éloge tacite à son effort de
pensée. Il était bien content de cette petite radio de poche qui ne faisait aucun bruit
grâce aux oreillettes qu’il suffisait de se mettre pour être aussitôt transporté maison de
la radio, opéra Bastille, salle Cortot ou Carnégie Hall à New-York.
Bien que ce fût l’hiver, il faisait doux : le Loir et cher a ceci de charmant, qu’il
ne subit ni les longues journées de grisailles et de pluie de l’ouest, ni les interminables
mois de neige de l’est. Ajoutez à cela que vous êtes près de Paris et c’est la région la
plus heureuse de France, puisqu’on y chasse autant qu’on veut. Côme sortit voir le ciel
étoilé. Il avait gardé la radio et l’on passait du Haendel : « Music for the Royal
Fireworks », puis le Psaume 2 du Messie. Avec les étoiles, il pensait à la Majesté du
Créateur. De si lointain habituellement, il lui semblait à présent étrangement proche,
intime. « Dieu est plus intime que mon intime et plus haut que mon propre sommet »,
dit S. Augustin. L’univers soudain lui parut léger, d’une façon intense, presque
4
insoutenable : comme si au monde rien n’existait qu’un seul Etre, qui seul avait le poids
d’une présence infinie, universelle, aux êtres qu’il soutenait comme les images d’un
rêve. « Nous sommes de l’étoffe des songes », disait Shakespeare… On passa ensuite
Scarlatti : la Sonate 75, par Alexandre Tharaud. Par l’une de ces coïncidences qui
n’arrivent dans votre vie qu’une ou deux fois, cette Sonate exprimait à merveille tout
ce que Côme avait senti et goûté intérieurement de l’idée de l’infini. Et cependant, il y
avait encore quelque chose de plus dans l’infini lui-même, quand son esprit s’y arrêtait,
ou plutôt, y vaquait paisiblement : « Vacate et videte quoniam ego sum Deus »1. « Vacare
Deo », s’étaient dit Côme et un ami, pour définir leurs « vacances ». Dans ce Psaume
45, Dieu arrête les puissances en guerre qui défont le monde. Vaquer à Dieu, n’est-ce
pas alors soumettre les idoles et les passions néfastes qui nous séduisent mais font la
guerre à l’âme ? Il veilla encore un bon moment au lit, comme bercé par cet infini qui
envahissait tout autour de lui et à côté duquel tout semblait disparaître, et dormit
jusqu’à ce que la lumière le réveillât.
En ce froid matin de décembre, le givre avait couvert les prés d’un fin
manteau de lin et dans les ornières, la glace avait pris. L’étang aussi était gelé. Mais les
lumières matinales réjouissaient Côme et il ne pensait pas que ce fût de l’oisiveté,
puisqu’il égrenait les cinq dizaines de son chapelet tout en marchant. Sur le chemin, il
s’étonna de voir courir vers lui un lièvre, puis un second. Chaque jour ou presque, il
rencontrait des animaux : faisans, chevreuils, martins-pêcheurs, ragondins, martres. Il
n’avait vu cette année une biche qu’une seule fois. Quant aux sangliers, il n’en voyait
que les méfaits et cela lui faisait penser à ce Psaume : « Debout, Seigneur : un sanglier
ravage tes vignes ! » : le diable lui aussi savait ne jamais se montrer, mais on se doutait
de son existence, à constater les succès de ses ruses, même parmi les prêtres et les
religieux. Côme se demandait pourquoi Dieu laissait vivre une créature aussi abjecte :
était-ce parce qu’il espérait sa conversion ? Mais cette théorie et celle de l’apocatastase
avait été condamnée par un Concile. Etait-ce parce qu’à l’origine, Satan était un ange
et qu’il avait gardé la dignité de créature ? Mais étant donné sa détermination à nuire
universellement, il eût été juste et prudent de le jeter sans attendre dans le feu préparé
pour lui… Côme ne voyait qu’une solution : Dieu donnait aux hommes de bonne
volonté la grâce de résister librement aux séductions du diable, pour leur plus grand
honneur. « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », avait dit le grand Corneille.
C’était bien vrai : la vie n’était qu’un combat, du début jusqu’à la fin.
L’hiver était déjà bien installé, et sur le chemin, les feuilles tombées avaient
perdu leurs couleurs dorées. Côme pensait à son ami Herbert, dont on lui avait
annoncé la mort. Un de ces hommes cultivés qui faisaient l’honneur de l’Allemagne :
philosophie, musique, théâtre : on s’instruisait de tout auprès de lui. Il l’avait connu
en même temps que Christoph, le violoncelliste qu’il accompagnait au piano, et Knut,
l’acteur de théâtre. Avec Herbert, Côme avait parlé deux ou trois fois de Heidegger.
Le philosophe de l’Etre et du Dasein avait donné une belle leçon d’humilité à tous ces
savants qui négligeaient la différence fondamentale entre théologie et ontologie. Mais
1 « Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu. »
5
pourquoi n’avait-il eu lui-même l’humilité d’étudier davantage la théologie après sa
thèse sur Duns Scot ? « Ce n’était pas son domaine », avait répondu Herbert. Réaction
bien allemande ! Pour Côme, l’histoire de la pensée occidentale était un long dialogue
entre philosophie et théologie, qu’il fallait étudier aussi bien l’une que l’autre et même
y ajouter l’exégèse. Il disait cela non seulement en tant que chrétien, mais simplement
aussi en tant que scientifique.
Les concerts avec Christoph lui manquaient. Ou plutôt, le temps qu’ils
passaient ensemble : ces après-midi à déchiffrer tout le répertoire Baroque… Christoph
avait une qualité exceptionnelle : il était tout entier dans le moment présent. Avec lui,
c’était comme si vous étiez la seule personne existant au monde. Chaque instant
devenait un cadeau qu’il vous faisait, par la seule attention qu’il y mettait. Les concerts
étaient donc particulièrement appréciés de tout un réseau d’amis, en Finistère.
Christoph présentait toujours avec enthousiasme les compositeurs et les morceaux et
l’on se sentait tous invités dans son jardin intérieur. C’était sans doute le secret des
grands artistes : cultiver si bien la vie intérieure, par tous les moyens qu’offre la vie,
que les œuvres, créées ou interprétées, reçoivent d’elle des lumières nouvelles et un
surcroît de sens.
Un cancer avait emporté Christoph dans la jeunesse de ses quarante ans.
C’était la version officielle, mais Côme n’avait jamais pu y croire. D’abord, parce qu’il
avait vu en son ami un tel courage qu’il paraissait évident, à son avis, que la vertu, qui
donne sens à la vie presque autant que la foi quand on l’a, menait l’histoire de
Christoph. Elle et non la maladie. Ce n’était pas scientifique : c’était spirituel. C’était
bien le problème de Côme, d’ailleurs : sa vision du monde était faite de théories de ce
genre, si bien que l’univers d’une maîtrise universelle par la science et la technique lui
était totalement étranger. Il en concevait les bénéfices, mais ne s’était jamais résolu à
en faire le paradigme d’une interprétation du monde et de l’histoire. Côme ne se
demandait pas d’où venait le cancer : le mal était pour lui une réalité infondée. Bien
sûr, une maladie a des causes, mais sur le plan spirituel, elle n’a pas d’origine. « Ils
m’ont haï sans raison », dit Dieu dans un Psaume. Allez demander à Lucifer la raison
de son orgueil, qui l’avait poussé à vouloir se faire Dieu à la place de Dieu : elle est
absurde : s’aimer soi-même plutôt que Dieu, qui est on ne peut plus digne d’être
révéré, loué et servi. C’était donc sa vertu, qui selon Côme, avait emporté Christoph
au ciel, dans la paix et la lumière et dans une vie plus intense. « Quand on meurt, on
va encore vers la vie », disait de Gaulle, mais parce qu’il était chrétien.
La vie ! Ce petit mot avait bien plus d’impact sur Côme que « l’Etre », depuis
qu’il avait dévoré les œuvres de Michel Henry. Chaque fois qu’il y repensait, elle était
là, en lui, devant lui, comme une lumière. « L’Etre en tant qu’être » l’avait bien fasciné,
un temps, mais à présent lui paraissait si fade, à côté de la « vie », qui lui promettait
un je-ne-sais-quoi de plus, d’infiniment plus beau, plus grand, plus joyeux. Mais peut-
être avait-il tort, aussi, de penser l’être en tant qu’être comme figé dans une éternité,
ou encore comme problématiquement divin… Quoi qu’il en soit, chez Henry, on
sortait mieux du monde que chez Heidegger. Il en avait fait l’expérience ! Un jour, de
passage à Paris, il était même allé s’asseoir dans un couloir du Centre Sèvres, chez les
6
jésuites, pour mieux lire C’est moi la Vérité. Juste en face de la « cellule » du père Corbin.
Et quand celui-ci était sorti, accompagné d’une ou deux personnes, Côme n’avait
même pas levé la tête, par hommage à Henry : il y avait dans les lignes qu’il lisait une
lumière différente, celle-là même qui l’avait toujours secrètement accompagné à son
intime, et dont à présent il suivait la trace – invisible – d’une façon si sûre, quoique
fébrile. Le livre était cependant ardu et il avait dû y revenir dix ans plus tard. Marion
avait raison : il ne faut pas hésiter à se confronter à des textes difficiles : ils mûrissent
en nous, du moins leurs grandes questions, celles qui traversent l’histoire de la pensée
et pour cela préludent à une compréhension des débats encore actuels. Dans la foulée,
il avait alors lu le reste. Incarnation avait quelques pages très idéalistes dans la réflexion
sur les qualités sensibles des phénomènes, avec lesquelles il n’était pas entièrement
d’accord, mais c’était un grand livre. Dans sa réflexion sur la vie, Henry laissait percer
l’espérance chrétienne de l’éternité, mais sans la dissocier de l’immanence de l’absolu
à notre vie terrestre. De sorte que l’homme n’était plus cet « être-pour-la-mort », dont
parle Heidegger, mais exactement, au contraire, un être-pour-la-vie, un être dans le
secret de la vie, dans sa transcendance même. Alors, nécessairement, on se sentait chez
Henry libéré de l’angoisse provoquée par la pensée de la mort, ou du néant. Il n’y avait
plus rien, après le hiatus de la mort, que la vie, plus intense peut-être au ciel que sur
terre. Le ciel n’avait pas le goût d’un arrière-monde : c’était, déjà avant la mort, le lieu
du cœur, de l’intime, du hors-monde. La phénoménologie de Husserl nous avait
appris à passer de ce côté du miroir, reprenant certaines intuitions augustiniennes,
passées aussi chez le Descartes des Méditations métaphysiques. Il suffisait donc, pour
être philosophe, de demeurer là, sur l’invitation du Christ :
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera, et nous viendrons
à lui, et nous ferons chez lui notre demeure » (Jn 14, 23).
De son petit-déjeuner aux tartines de mirabelle à l’heure de régler un réveil
qu’il devançait souvent, ou bien éteignait pour prolonger la nuit, Côme vivait ainsi,
habité par Dieu. Pourtant, ses grandes questions portaient plus sur le monde que sur
la vie spirituelle. Ainsi, le traitement des qualités sensibles par Henry : pourquoi tout
ramener à la subjectivité ? Le goût de la mirabelle, par exemple, qu’il avait découvert
à l’âge de quinze ans avec émerveillement et action de grâce pour le Créateur, ne se
trouvait-il pas dans la relation de son palais et de sa conscience à la mirabelle ? Certes,
on aurait eu tort de vouloir objectiver ce goût par une formule chimique, référée au
sucre, à la sève du fruit cuisiné : le goût n’a pas de réalité sans l’action consciente de
celui qui goûte. Mais dans l’autre sens, ne pas lier cette réalité à celle de l’admirable
matière et de ses molécules, n’était-ce pas se couper de l’extériorité du monde, donc
du sens créé des choses elles-mêmes ? Pour Côme, la relation était une notion clé pour
la compréhension du réel, parce qu’elle était le lieu de naissance du sensible. Celui-ci
n’était dans les objets qu’à la manière dont les signes sont sur la page, et dans la
subjectivité que comme dans cette faculté de lire ces signes.
Le midi, Côme recevait souvent à déjeuner son ami Charles Margotant,
depuis que celui-ci refaisait sa vie après un échec à l’abbaye de Fontgombault. Charles
lui parlait de ses inventions, qui commençaient à se vendre. Ainsi, le boîtier connecté
7
pour bureau, sur lequel on pouvait voir affichés en temps réel les musiques que vos
amis écoutaient à la radio ou en cd chez eux. On pouvait actionner un cœur rouge pour
signaler une musique qui vous plaisait particulièrement. Ou encore, la machine à
chance pour les casinos : on savait qu’on ne pouvait pas y gagner d’argent, mais
seulement un bout de papier recyclé sur lequel était marqué : « Félicitations ! Vous
avez une chance exceptionnelle ! ». La commercialisation avait été un peu laborieuse,
au début, mais Charles avait eu la bonne idée d’embaucher son beau-frère Manolo,
excellent commercial, qui avait toujours des tonnes d’arguments. Pour cette machine,
il démontrait l’attirance de tout une nouvelle clientèle pour une occupation ludique et
vertueuse dans un milieu jugé plus ou moins corrompu par l’appât du gain : ce n’était
qu’une mise en scène de ce que l’on pensait vivre dans le monde quotidien, au travail,
encerclés par les réseaux d’une finance déréglée et ceux de l’évasion fiscale. Mais
Charles était avant tout un designer : il inventait des nouvelles chemises de luxe pour
une entreprise belge qui les vendait par correspondance sur le net. Sa dernière
trouvaille, la chemise « Sagesse », allait probablement faire le tour du monde ! Il y avait
une version festive : colorée, avec des versets du livre de la Sagesse et une autre, plus
sobre, avec un extrait du chapitre 6, versets 12 à 16 :
« La Sagesse est resplendissante, elle est inaltérable. Elle se laisse aisément
contempler par ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance
leurs désirs en se montrant à eux la première. Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera
pas : il la trouvera assise à sa porte.
Ne penser qu’à elle prouve un parfait jugement, et celui qui veille en son honneur
sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient pour rechercher ceux qui sont dignes d’elle; au
détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant; chaque fois qu’ils pensent à elle,
elle vient à leur rencontre. »
En plus des chemises, il y avait les draps et housses de couette avec des
Psaumes (22, 61, 4, 90…), sans oublier son préféré : la taie d’oreiller « Je dors mais mon
cœur veille », extrait du Cantique des cantiques. Ce qui se vendait bien aussi, c’était le
jeu de douze serviettes de table dont chacune avait le verset d’un Psaume. La nappe
décorée de citations et de références bibliques plaisait bien, même s’il fallait se munir
d’une Bible pour la déchiffrer entièrement. N’empêche que pour les réunions
bibliques, l’entrée en matière était réussie !
Charles refaisait donc son monde bien à lui et bien à Dieu : dormir, manger,
s’habiller dans le Verbe. « A quand un contrat avec des voitures ?! », s’amusa Côme,
mi- sérieux, mi- goguenard. Mais Charles n’aimait guère les voitures. En fait, il s’était
décidé à vivre comme au XVIIe. Pour faire un peu comme Fontgombault, qui
entretenait depuis le XIe siècle une tradition et des coutumes à peu de choses près
identiques. Là-bas, le grégorien avait le mérite d’avoir été conservé intact, aussi bien
que la basilique qu’il emplissait royalement du matin jusqu’au soir. Pour cela, Charles
avait été disposé à tous les sacrifices. Il ne s’attendait pas à ce qu’il y en eût autant, ni
de si surprenants ! A tel point qu’il s’était inquiété, certaines heures où son
enthousiasme de novice faiblissait sous le coup de la fatigue accumulée, se demandant
si l’on n’était pas bien proche de certaines pratiques de la franc-maçonnerie, ou d’un
8
autre genre de secte, visant à faire sentir le poids d’une autorité qui avait oublié que
servir était sa seule raison d’être. Quinze jours après lui avoir solennellement remis
l’habit et admis au noviciat, on l’avait congédié par charité, eu égard aux trop
nombreux sacrifices dont il s’était ouvert (humblement, sans s’en plaindre) :
impossibilité de lire les livres qu’il avait apportés, ni d’avoir accès à la bibliothèque, de
travailler l’orgue, d’écouter de la musique. On lui avait accordé de jouer du piano :
quelle joie ! Mais pour lui préciser aussitôt qu’il n’en ferait qu’une demi-heure par
semaine… Il s’était alors consolé de pouvoir encore lire ses partitions de Chopin et
Debussy le soir au lit, en imaginant la musique, mais cela aussi lui fut demandé « en
sacrifice, car le noviciat est un temps de désert. Vous les retrouverez dans deux ans,
avec permission de l’abbé ». Le coup était rude, mais Charles, assez rationnel, avait
tenu bon : une raison était donnée, valable à ses yeux. Seulement, le maître des novices
sentait bien que tout cela réclamait de sa part un déploiement d’énergie qui l’épuisait.
Sans parler de ces fois où il manquait matines sans permission : n’était-il pas sensé,
dans ces cas-là, se lever aussitôt que les cloches le réveillaient, pour demander à se
recoucher ? Charles espérait que la situation s’améliorerait, seulement, il avait une
passion : l’étude de la philosophie. Il écrivit donc à son frère pour lui donner un code
secret – car le courrier était lu à l’arrivée et au départ – grâce auquel il lui
communiquerait les titres des livres à lui apporter sous le manteau : la dernière lettre
des mots clé serait légèrement allongée et s’inclinerait. Bien sûr, il était allé lui-même
au village poster la lettre, franchissant illégalement la porte du fond du verger.
Seulement, on l’avait vu et l’abbé avait rappelé, de façon neutre, à toute la
communauté, au chapitre, qu’il fallait veiller à bien tenir les portes fermées et respecter
la clôture. L’affaire ne serait pas allée plus loin si par l’un de ces malheurs dont la
nature a le triste secret, Charles n’avait eu besoin de poster une seconde lettre une
semaine plus tard. Il s’inquiétait en effet d’une irritation de la peau à l’extrémité de son
sexe, craignait un eczéma et avait besoin rapidement d’une pommade. Or il n’avait
aucune envie de consulter le moine médecin à ce sujet, trop intime. Il écrivit donc à sa
mère, profitant de l’occasion pour lui demander deux livres de Michel Henry. Il sortit
par une porte, ayant déposé au passage sa tunique, et revint par une autre. Il aperçut
un frère à une cinquantaine de mètres et espéra n’avoir pas été surpris en train de
passer la porte ou au moins, n’être pas reconnu. Malheureusement, c’était le cas. Le
frère avait bon œil et il était allé avertir l’abbé aussitôt après. Un autre vint pendant la
messe dire au même abbé que l’on avait laissé une porte du verger entrouverte : les
bergers allemands auraient pu s’échapper ! Le maître des novices convoqua Charles,
qui invoqua les raisons qu’il avait jugées suffisantes, mais le verdict de l’abbé était déjà
tombé. Malgré les efforts de Charles, durant près d’une demi-heure, pour convaincre
celui-ci qu’il avait bien la vocation et que cet « incident » avait des raisons d’être qui
ne relevaient pas d’une volonté de désobéir au règlement, il fut décidé que c’était au
contraire le signe évident qu’il n’avait pas l’esprit d’un moine de Fontgombault. Alors
le ciel s’ouvrit et dans une avalanche de lumière, Charles commença à réaliser qu’en
effet, si c’était ainsi qu’on prenait la chose, il n’avait jamais eu « l’esprit ». Quelques
absurdités qu’il avait supportées lui revenaient : demander la permission de faire pipi
9
en promenade, même à un autre novice qui représentait leur maître en son absence ;
écrire durant les cours tout ce qui était dit, sans jamais poser aucune question (les
réserver pour un entretien particulier) ; ne pas prendre de notes autrement qu’en des
lignes bien resserrées, par sens de la pauvreté ; ne prendre qu’une seule douche par
semaine et sans laisser couler ; le jour de la prise d’habit, découvrir que les autres
novices ont pris le temps de « ranger » toute votre cellule, et qu’il n’y a plus sur le
bureau qu’une couronne d’épines ; recevoir ce même soir des mains du maître des
novices un fouet en peau de bœuf pour se flageller le vendredi soir en récitant le
Miserere ; ne pas prendre le petit-déjeuner avant 7h45, après s’être levé à 4h45 ;
marcher avec les autres novices chaque jeudi après-midi à un rythme effréné ; copier
chaque matin un Commentaire des Psaumes non d’un Père de l’Eglise, mais de Dom
Delatte, auteur bien moins grand, à l’évidence ; manger des plats à base d’œuf au
moins tous les deux jours, à cause du nombre de poules. Enfin, pour couronner le tout,
on lui avait imposé une confession générale, dans laquelle il avait dû énumérer de
façon exhaustive tous les péchés de sa vie dont il se souvenait. Cela sans autre
préparation qu’une brève explication, trop brève pour qu’il comprît le sens
authentique de cette pratique, ce qui l’avait contrarié en sa conscience, bien qu’il eût
admis volontiers qu’on pouvait agir ainsi par pure obéissance et dans la confiance.
Lorsque la somme de ces pratiques apparut en arrière-plan de la
conversation qu’il avait eue avec l’abbé, Charles comprit que l’Esprit de Dieu
intervenait en sa faveur et voulait le conduire au-delà de ses propres manières de voir.
Sa lutte acharnée pour accepter l’absurde sous le concept lapidaire du « sacrifice » était
arrivée à sa fin. Mais ce qui l’emportait, c’était le bonheur : il serait plus libre
désormais. Lui qui s’était juré de participer à relever la France par le chant grégorien
et la prière, voilà qu’on lui offrait de vivre de nouveau au contact du pays et de mener
ce projet par d’autres moyens, qu’il saurait bien trouver…
Côme et Charles avaient passé ensemble une partie de l’après-midi à marcher
dans les bois. Trois chevreuils, deux faisans, deux canards colvert. Le soir, après avoir
allumé le feu, Côme avait donné à lire à son ami une nouvelle de sa composition, qui
mettait en scène un stoïcien, un épicurien et un hédoniste. Elle était intitulée : « Journée
de vacances de deux philosophes ».
« Ils se levèrent à la même heure. Le stoïcien, parce qu’il ne s’accordait jamais
plus de huit heures par nuit ; l’épicurien, parce qu’il avait envie de profiter pleinement
d’une belle journée de vacances qui s’annonçait. Au petit-déjeuner, ils mangèrent
autant l’un que l’autre. Le stoïcien s’accorda un peu de confiture à l’orange en mémoire
des anglais, lesquels incarnaient à son sens l’esprit du flegme constant, imperturbable
et, surtout, rationnel. L’épicurien savoura une tartine de miel en remerciant le
Créateur, s’il existait, d’avoir pensé aux abeilles et aux apiculteurs.
Ils firent le ménage ensemble, l’un avec la joie de remplir un devoir qui
s’impose universellement à ceux qui savent prendre soin des biens que Dieu leur
accorde ; l’autre, avec le plaisir d’entretenir une belle maison qui lui rappelait ses
souvenirs d’enfance (il n’oublia pas d’astiquer les meubles avec la cire des moines
olivétains de Maylis).
10
Ils passèrent l’après-midi à lire et à écrire. A l’heure de l’apéritif, ils reçurent
la visite d’un de leurs amis hédonistes. Celui-ci leur offrit une bouteille de whisky (du
Glenmorangie), qu’ils ouvrirent aussitôt, pour lui faire plaisir. L’épicurien s’accorda
une bonne larme, le stoïcien se contenta d’un soupçon, quantité qui lui parut suffisante
puisqu’ainsi, la chair ne l’emportait pas sur l’esprit et l’amitié était entretenue
symboliquement. D’habitude, il prenait un pamplemousse, auquel il ajoutait parfois
du Martini pour ne pas paraître orgueilleusement austère et dépourvu de joie de vivre.
Quant à l’épicurien, il aimait découvrir de nouveaux apéritifs, par curiosité. Il en
parlait aussi bien que des œuvres littéraires, poétiques et philosophiques, ce que son
ami disciple de Sénèque et d’Epictète n’approuvait guère, l’alcool n’ayant à son sens
rien à voir avec l’édification de l’homme et de la cité. L’hédoniste s’accorda un second
verre et évita de justesse le troisième « pour la route », sur l’avis éclairé de l’épicurien,
qui lui fit remarquer que cela lui permettrait de savourer un peu plus de l’excellent
Médoc qui les attendait au dîner. Les mini tomates et les dés de féta grecque rapportés
la veille du marché firent l’unanimité. Seul l’hédoniste s’attrista pour lui-même de
n’avoir pas pensé apporter des olives, puisqu’il arrivait du midi.
On prolongea tard le dîner, l’un par pure générosité, l’autre pour la joie de
vivre l’une de ces trop rares soirées entre vrais amis, le troisième pour le plaisir de
bavarder sans mesure (ses idées, d’ailleurs, n’étaient pas très édifiantes). Après avoir
refait le monde, on promit de se donner plus souvent des nouvelles. L’épicurien se
coucha aussitôt, avec cette prière qui était devenue la sienne au fil des ans : « Merci, ô
le Créateur, si tu existes, pour les biens que tu dispenses généreusement ! Fais que je
continue d’en user sobrement chaque jour ! »
Seul le Stoïcien fit l’effort de résumer sa journée devant Dieu, de demander
pardon pour quelques négligences et d’adorer en silence l’ineffable Présence en son
cœur de ce Père qui l’entraînait chaque jour à mieux être homme. Il n’oublia pas de lui
confier ses deux amis et de le remercier pour tous ceux qui cultivent l’art du bien. Il
relut pour finir un passage de La Providence, de Sénèque. »
La cloche retentit : c’était Benoît. Côme l’accueillit d’un grand sourire :
« - Décidément, le monde monastique a trouvé refuge au château ! Charles de
Gigord est là, vous allez pouvoir discuter ! »
Ils s’étaient connus en prépa à Paris et s’écrivaient de temps à autre. Aussitôt
après sa maîtrise de philo, Benoît avait fait son entrée à Landévennec. Rarement, on
avait vu une telle détermination : il s’était décidé à seize ans et n’avait jamais laissé
percer dans son esprit la moindre suggestion d’une autre vie possible. Après tous ces
week-ends passés à l’abbaye avec ses parents, qui l’emmenaient depuis qu’il avait onze
ans, après deux stages d’un mois qu’il avait vécus comme sur un nuage, il était prêt à
cette nouvelle vie, exigeante mais belle. Se lever à cinq heures moins vingt ? Il s’y
ferait ! Vivre dans une communauté âgée où il serait le seul jeune ? C’était un honneur,
au contraire, d’habiter parmi tant de sages ! Un an et demi s’était écoulés, où tout allait
bien. Puis un jour, la profession simple approchant à l’issu de la fin du noviciat, un
nouveau rapport au temps, à la durée, s’était fait en lui. Il avait toujours vécu tendu
vers un avenir fait d’une vie absolument différente, dans la prière et le travail. Il lui
11
fallait à présent se tendre vers une vie qui serait identique à ce qu’il vivait depuis son
arrivée à l’abbaye. La jouissance de rêver d’un autre monde avait disparu, remplacée
par le choix de se fixer dans le Même, l’acceptation de renoncer aux joies des choses
qui changent. Alors, la vie des autres religieux lui était apparue peut-être plus
heureuse. Car bien qu’ayant toujours placé son bonheur en Dieu seul, il se rendait
compte que ceux-là vivaient aussi pour Dieu, mais dans des conditions moins austères.
Il y avait ceux qui voyageaient pour annoncer la joie de l’Evangile à tous les peuples
et vivaient des aventures incroyables. Ainsi, son ancien professeur jésuite, Henry
Daviau de Ternay, qui lui avait transmis sa passion pour Kant et Kierkegaard : n’avait-
il pas été dans les bidonvilles de Rio, au Brésil, dans ces favelas où l’on entendait
quotidiennement siffler des balles perdues ? Mais il y avait aussi ceux qui se
consacraient à l’aventure intellectuelle, longuement éprouvés par les plus sérieux
problèmes de la philosophie et de la théologie, et très au fait en même temps des
questions politiques du monde moderne. C’était son ami Michel Corbin, un autre
jésuite, dont la traduction commentée des œuvres de saint Anselme était désormais
dans les rayons de toutes les bonnes bibliothèques diocésaines et monastiques de
France. Il y avait enfin ceux qui avaient la chance d’avoir des vacances : ces jeunes
prêtres qu’on envoyait accompagner un groupe d’ados en camp « Bible et ski », ces
biblistes qui servaient de guides au Liban ou en Terre Sainte (tel son parrain, exégète
et professeur à la Catho de Paris). Lorsque Benoit y pensait, il ne se disait pas que tous
ceux-là avaient plus de chance que les moines, mais simplement qu’étant fait pour être
heureux – combien de fois ne le lui avait-on pas répété dans ces groupes pour les jeunes
vocations ! – il lui suffisait peut-être tout simplement de frapper à la porte des jésuites
ou de son évêque pour vivre autrement l’Evangile. Comme la date de sa profession
simple n’avait pas encore été fixée, et que manifestement la communauté ne le traitait
pas encore, à juste titre, comme faisant réellement partie d’elle, l’hésitation s’instilla
tout doucement en son esprit. Il avait perdu sa belle assurance comme on égare ses
lunettes : bêtement, sans s’en apercevoir. Impossible de la retrouver, ni non plus cette
joie qui l’avait accompagnée depuis le début et que les frères avaient plaisir à voir sur
son visage et entendre dans sa voix. La tristesse l’avait gagné jusqu’aux os, comme un
cancer l’aurait rongé, comme un gaz qui envahit un immeuble et, passant sous les
portes, arrive, invisible, jusqu’à la chambre durant la nuit. Il le sentait bien, mais
comment s’en défaire ? Comment demander une prolongation de noviciat pour aller
rencontrer les jésuites ou son évêque ? Cette possibilité n’existait pas : le noviciat n’était
pas le temps de discerner entre plusieurs états de vie possible dans l’Eglise. Pour en
changer, il fallait abandonner ce projet dont l’idée le travaillait depuis qu’il avait dix
ou onze ans et auquel il s’était arrêté depuis huit ans déjà. Bientôt, à la tristesse due à
cette incertitude où son bonheur semblait compromis, s’ajouta l’angoisse de s’engager
très exactement à une vie malheureuse. La nuit qui jusque-là comptait encore au moins
quelques étoiles, s’était noircie au point qu’il trébuchait à chaque pas sur le chemin :
manger, boire, dormir, prier, travailler, choisir un livre, tout lui devenait éprouvant.
Ces actes si simples, si évidents en eux-mêmes, devenaient lourds, insupportables
parfois du seul fait qu’à l’abbaye, ils s’accomplissaient avec l’idée d’une répétition
12
indéfinie, d’un engagement de toute la personne dans une durée exigeant de soi un
don généreux, total. Maintenant que cette idée était devenue une question impossible
à résoudre et qui risquait de rester telle toute sa vie, Benoît sentait ses forces
l’abandonner. Il l’avait compris en découvrant par hasard ce mot de médecine tiré du
grec : asthénie. Le stress et la fatigue s’ajoutant, il eut bientôt des bouffées délirantes,
dans lesquelles son imagination s’emballait et où il perdait le sens du réel : un aigle
invisible venait se poser sur les épaules des moines durant les offices, il « sentait » la
présence de son frère durant un repas, et autres choses semblables. Son comportement
parfois étrange, puis des rires intempestifs, alertèrent les frères, et l’on s’avisa de
l’envoyer dans une maison de repos tenue par un psychiatre.
Il emporta un antiphonaire pour chanter du grégorien. La clinique était une
vraie cour des miracles. Il réalisa qu’il allait mal quand il se vit au milieu de grands
malades. Heureusement, il prenait ses repas dans sa chambre. Cela dura une semaine,
au cours de laquelle il reçut la visite (éclair) d’un prêtre, puis de ses parents, peinés de
le voir dans cet état, mais ne voulant pas le montrer. Revenu au monastère, les effets
du médicament qu’on lui avait donnés (un antipsychotique) durèrent quelques
semaines. On l’envoya alors à Lourdes pour l’aider à retrouver sa pleine forme
spirituelle. Là, seul avec lui-même, les symptômes reprirent : il alla saluer une vieille
dame en la prenant pour une apparition de sainte Bernadette, il donna quelques coups
sur une grosse cloche, à la cité saint Pierre, pour sonner la fin des complies, enfin, il
prit son voisin de chambre pour un envoyé de René Descartes. Par chance, son maître
des novices décida de le rejoindre et de faire avec lui le voyage du retour.
Dans un sursaut d’héroïsme, il décida un matin qu’il fallait qu’il reste moine,
par amour pour son Seigneur, dont la vie avait été si noble et courageuse et qui n’avait
pas fui devant la croix quand il avait réalisé qu’elle serait le seul moyen par lequel il
sauverait l’humanité. Après avoir prié, il alla trouver son abbé. Stupeur : celui-ci
objecta qu’après tant d’hésitations, il était plus prudent, de son avis et de celui du
maître des novices, de remettre à plusieurs années un engagement qui n’avait de sens
que vécu sereinement. « Tu reviendras si tu veux. Pour le moment, c’est encore trop
tôt ».
Lorsqu’en philosophie, on doute méthodiquement de tout, on est loin de
penser qu’il est impossible de douter de la volonté des autres, lorsqu’elle impose des
limites à l’exercice de votre liberté. Descartes le fait si peu dans la première Méditation,
qu’il lui faut recourir à la fiction d’un certain malin-génie « non moins rusé et trompeur
que puissant et qui a employé toute son industrie à me tromper ». C’est-à-dire qu’il
fait venir sur la scène où même les autres hommes avaient été éliminés un autre être
et une autre volonté, à partir de laquelle sa propre volonté, et sa pensée, éprouveront
leur parfaite autonomie.
Benoît était alors allé à la communauté du Chemin Neuf, plein d’espoir, sur le
conseil de son abbé. Quand un abbé parle, c’est sûrement Dieu à travers lui… Au bout
d’une semaine, on le trouva « très bénédictin » : « on sent que tu es très sûr de toi, que
tu as intégré un cadre, dont tu ne veux pas te défaire ». Le vent tournait, malgré toute
sa bonne volonté pour se montrer agréable à tous, participer aux conversations,
13
travailler de tout son cœur. Il ne critiquait rien, mais parce qu’il avait exprimé son désir
d’avoir du temps pour lire et, s’il restait dans la communauté, un bureau pour écrire,
il paraissait déjà bien différent. Avait-il bien fait de confier cela ? Evidemment, il ne
pouvait éviter de se présenter tel qu’il était, et d’autre part, il était convaincu que la
différence était une valeur respectée par toute communauté. Sur ce point cependant, il
était bien naïf. En réalité, la différence est toujours aussi appréhendée avec crainte et
suscite la prudence, parfois excessive, des responsables. Ceux qui ont eu quelques
soucis de santé dans le passé en font la triste expérience : même si leur médecin atteste
qu’ils n’ont aucune fragilité structurelle, on préfère les orienter ailleurs. Benoît n’avait
pu pour cette raison entrer dans une nouvelle abbaye : on se disait qu’il ne tiendrait
pas. Au bout de trois semaines au Chemin Neuf, enchanté par l’ambiance
internationale, ses progrès en anglais et en allemand, ravi de pouvoir se promener le
dimanche dans la forêt de Sénart, de montrer des marcassins et des chevreuils à ses
amis, sans oublier les longues soirées autour d’un feu à partager une bière en écoutant
de la musique, Benoît ne demandait qu’à rester. Il avait un pressentiment, pourtant.
L’une de ces idées infondées, qui vous viennent seulement de se souvenir que dans le
passé, ce qui marchait très bien était soudain tombé à l’eau par la bêtise humaine d’un
autre plus haut placé. Durant l’entretien, Benoît ne manifesta aucune surprise. Il se
servit de la seule arme qui lui avait toujours parue efficace dans ce genre de situation :
l’usage raisonné d’idées claires et distinctes. L’autre parlait avec hésitation, n’ayant
d’idée claire que la volonté d’annoncer à Benoît que l’essai devait s’arrêter et qu’il ne
passerait même pas Pâques avec eux. Il invoqua tout de même un argument – il fallait
bien : « Plusieurs t’ont trouvé trop fermé, trop distant. On se dit que tu risquerais de
souffrir d’être dans une communauté où tous sont au contraire très ouverts. » Benoît
n’eut qu’à répondre qu’étant à peine arrivé, il était naturellement moins ouvert que les
autres. De plus, il lui arrivait souvent, ces temps-ci, de penser à l’avenir proche, de
chercher des idées pour l’an prochain. L’idée de « fermeture » confirmait le premier
jugement : « très bénédictin ». Benoît sentait qu’il n’y avait plus rien à faire. Il fit tout
de même remarquer que la Bible est traversée par l’idée du devoir d’accueillir le
pauvre et l’étranger, qui sont deux figures annonçant le Christ. Il ajouta que tout
chrétien avait le devoir de chercher l’intelligence de sa foi, ne serait-ce que parce que
Dieu nous a donné l’intelligence comme une faculté devant s’épanouir. Ils se quittèrent
sur ces mots. La différence : valeur ou épreuve pour une communauté ?
Côme n’en revenait pas de voir, à travers ses amis, l’indifférence de l’Eglise,
sa violence et sa froideur à l’égard des jeunes, pourtant peu nombreux, désireux de se
consacrer au service d’une communauté. Non, l’Evangile, ce n’était pas cela, s’il devait
en rester quelque chose au XXIe siècle. Il lui revenait à l’esprit cette parole du Christ :
« Le Fils de l’homme, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ? » Il trouvera
certainement une tradition entretenue sur le mode de l’ultra-émotivité, une autre par
un sens exacerbé de la tribu, une autre par celui de l’Histoire et de la tradition,
sacralisée par peur des nouveautés.
Côme se sentait bien plus proche de ceux qui n’avaient d’autres principes que
ceux du respect des différences, de la charité, du partage. La charité n’est-elle pas le
14
seul ordre qui vaille, la source qui alimente toutes les autres valeurs ? Chez Blaise
Pascal, n’est-elle pas le seul ordre à même de dépasser la métaphysique, les deux autres
étant ceux du sensible et de la pensée ? Pascal, cependant, frôlait les pentes d’un certain
fanatisme, quand il dévalorisait l’évidence (seul critère retenu par Descartes) et
prétendait que l’on pouvait se convaincre soi-même par des raisons encore obscures,
à cause de l’espoir qu’il y avait à les suivre, quant au salut de l’âme. On était plus
rassuré chez Descartes, quand il présentait la lumière de la grâce, qui porte à la foi
chrétienne, comme souvent plus assurée et plus forte que la lumière naturelle de la
raison. Au reste, pour être convaincu par le raisonnement pascalien, il fallait encore
discerner que l'espérance qui porte l’homme à la foi – et à son pari – se proposait à
l’esprit avec la force de l’évidence. Le christianisme se contredirait s’il se teintait
d’obscurantisme, celui-ci n’étant au fond que la tentation d’une violence imposée à
l’intellect. « Dieu est amour » (1 Jn 4, 8) : cela se traduit même « Dieu est tendresse »,
d’après le grec αγαπη.
Du grec, Côme de Lambrefaut en faisait de temps en temps, les jours où il était
réveillé vers cinq heures du matin, ou bien pour se détendre à un moment libre de la
journée. Il copiait lentement, appuyant son attention sur chaque mot dont sa plume
calligraphiait les lettres. Parfois aussi il imaginait : Іησου se traçait en commençant par
une croix de saint Pierre, unie à celle du Christ, en un iota majestueux qui évoquait le
lien de son âme jusqu’au plus haut des cieux… Il se terminait par la ponctuation de
l’upsilon à la manière du signe de l’infini…
Ce n’était pas la culture ambiante qui allait encourager l’étude des langues
anciennes ! Lorsqu’un jour, il avait préparé un CV en vue de se faire embaucher à la
mise en rayon d’un grand supermarché des environs, son frère, dont le sens
commercial avait longtemps été éprouvé au cours de plusieurs séjours à l’étranger,
l’avait bien averti de supprimer « tout ce qui risquait de faire trop intello, trop savant ».
Côme avait obéi sans broncher : « Larvatus prodeo ! », comme disait Descartes ! Il
n’avait jamais béni ces temples de la consommation, qui étaient selon lui les principaux
responsables de la perte du lien social. Il ne se faisait pas à l’idée d’acheter sans savoir
à qui il achetait, avec qui, au fond, il partageait non seulement son bien, de l’argent,
mais le Bien, la vie elle-même. Où était la relation humaine, si elle se résumait à une
chaîne anonyme, depuis un gérant invisible jusqu’à une caissière dont on se demandait
ces temps-ci combien d’années encore elle serait à ce poste sans être remplacée par les
nouvelles caisses automatiques ? Pourquoi les hommes construisaient-ils une manière
d’échanger les biens qui voilait complètement le premier bien qui nous humanise, la
relation, par laquelle une fraternité est entretenue concrètement, et offre l’occasion de
ce que Paul Ricoeur appelle un « parcours de la reconnaissance » ?
Bien sûr, une fraternité sans Père, c’était le vieux rêve incohérent du
Communisme : une manière de solidarité contre la transcendance de la vie elle-même.
Un capitalisme qui refusait de se réformer en soumettant l’ordre économique à celui
de la politique et de l’éthique, remplaçait donc la fraternité par une solidarité du désir
effréné de la propriété privée. Comme pour se garantir contre le spectre de ce
Communisme, dont le souvenir encore présent dans l’inconscient collectif hantait les
15
esprits. Seul le Christianisme, à la suite du Judaïsme, revendiquait la priorité du Bien,
la transcendance de valeurs cohérentes et fondatrices, sur l’appétit des vanités et des
plaisirs passagers. « Ad supernae semper intenti », comme disait saint Paul : sans cesse
tendus vers les réalités d’en-haut. Le ciel ? Non pas un arrière-monde, ainsi que le
définissait Nietzsche, mais le seul centre du cœur, la lumière à la cîme de l’âme, celle
qui révèle la vérité et la bonté à l’entendement pour que la volonté y adhère
fermement, avec constance. Heureux l’homme qui habite ainsi plus haut que lui-
même, s’il a compris du moins que cette hauteur est le strict renversement de l’orgueil
et de la superbe qui brisent l’élan tranquille de la vie pour y substituer le tournoiement
de l’activisme aveugle, oublieux du prochain comme de Dieu ! Heureux cet homme
qui, étant relié à la vie, aime les relations humaines, non pour ce qu’elles offrent de
richesses éphémères, mais pour le partage de Dieu qui s’y réalise : « La charité
fraternelle non seulement vient de Dieu, mais elle est Dieu », disait saint Augustin.
Côme étant loin d’être un saint, il faisait régulièrement quelques entorses à
l’ordre de la charité. Surtout quand c’était pour le plaisir de rigoler. Un samedi matin
au marché, avec Charles, il était passé à la boucherie. Il n’y était allé jusqu’ici qu’une
seule fois, car il n’achetait jamais que du poisson, trouvant la viande le dimanche en
famille, et de temps à autre aux dîners auxquels on l’invitait. Or, se souvenant de ce
que le boucher s’était adressé à lui comme font parfois certains commerçants : « Qu’est-
ce qu’il aurait voulu ? », mais aussi de ce qu’il avait été fort mal reçu en présentant un
billet de vingt un lundi matin au lieu d’une pièce de deux, Côme eut l’idée de
plaisanter un peu avec le bonhomme qui ne manqua pas en effet de lui demander :
« - Qu’est-ce qu’il aurait voulu ?
Côme fit mine de réfléchir intensément.
- Eh bien, il aurait voulu deux belles tranches de gigot, (le boucher prit son
couteau), du plus tendre si possible, (le boucher découpait vite : une tranche), ç’aurait
été pour ce midi (la deuxième arriva), plus un pot de rillettes (il le posa aussitôt sur le
comptoir), mais étant donné que cette semaine, plusieurs de ses élèves ne sont pas
venus à ses cours de piano,… il préfèrerait se contenter de deux pattes de poulet froid.
Le boucher le regarda, médusé. L’irritation ne s’était pas encore emparée de
son esprit. Côme enfonça le clou :
-ça fera moins cher.
Charles, qui retenait son fou rire depuis le début, s’éloigna pour ne pas ajouter
d’huile sur le feu qui à présent consumait dans l’âme du commerçant une once de
patience préservée par miracle de trente années de froideur et de désintérêt pour la
courtoisie. Ce dernier prit les cuisses sans rien dire d’autre que : « Alors ça lui fera trois
euros ».
Là-dessus, ils passèrent chez le poissonnier, car faute d’huîtres, en Bretagne,
on mange des palourdes, dit le dicton.
Le dîner, bien arrosé, inspira à Charles une nouvelle invention : pourquoi ne
pas connecter un téléphone mobile à des puces placées sur le corps, qui vibreraient en
fonction d’un numéro de téléphone sélectionné ? Décidément, pensa Côme, il y a une
grande proximité entre les progrès de la technique et l’ivresse éthylique…
16
Le lendemain, c’était dimanche et Côme s’en fut à la messe comme une fois
par mois, selon un rythme qu’il pensait être celui du Grand Siècle de Pascal et de
Racine, à défaut d’être celui de ses contemporains. Il avait mis du temps à trouver un
prêtre dont les homélies fussent assez approfondies et créatives, mais il avait fini par
le trouver.
« - Le Royaume ne consiste pas seulement à organiser une société parfaite,
mais d’abord à laisser Dieu vivre en nous comme la lumière à travers les vitraux. Si
nous ne commençons pas par là, nous aurons beau râler comme tous les français de
France, le monde ne s’améliorera pas ».
C’était tout à fait le genre d’idée qui plaisait à Côme : se recentrer sur la qualité
de sa vie spirituelle, plutôt que de s’inquiéter au sujet de l’organisation diocésaine, ou
de l’institution ecclésiale. C’était d’ailleurs le seul moyen efficace qu’il avait découvert
contre la solitude, à une période éprouvante où il en avait souffert. La solitude
renversée par la charité : c’était devenu son principe. A tel point que son esprit, de
mieux en mieux entraîné au souci premier de la charité, avait appris à sentir ces
instants troubles qui précèdent l’apparition de pensées contraires à la charité que l’on
doit à Dieu, au prochain et à soi-même et qui viennent d’un monde obscur où
dominent le mensonge et la mort. En méditant quelques pages de Spinoza sur la joie,
si fortement liée à l’éthique et à la vie vertueuse, Côme s’était souvent senti transporté,
arraché à l’empire des ténèbres, transféré dans un royaume de lumière, jusqu’à siéger
avec Dieu comme Moîse au Sinaï. Ces matins-là, quand il se regardait dans la glace, il
s’étonnait de voir son visage plus gai que d’ordinaire et sentait bien que ses yeux
communiqueraient par un éclat nouveau, plus intense, la tonalité de ses méditations
nocturnes.
Côme avait toujours baigné dans la foi catholique, reçue de ses pères. Il avait
ainsi organisé sa vie selon cinq déclinaisons, qu’il reprenait inlassablement : le pardon,
la gratitude, la demande, l’offrande et le combat ou la résistance. Il préférait ce
pentagone ignatien au binôme que la pensée populaire prêtait à S. Benoît : « Ora et
labora ». En réalité, S. Benoît n’ayant jamais écrit cela nulle part, il eût mieux valut
résumer sa pensée en citant « Nihil amorem Christi praeponere » : « Ne rien faire
passer avant la charité du Christ ». Quoi qu’il en soit, le monde païen était éloigné de
tout cela, avec sa devise de profit, auquel la vertu elle-même était manifestement
soumise la plupart du temps, puisque la technique, source de profits immenses,
imposait son dictat aussi bien au politique à travers une économie sauvage, qu’à
l’éthique, allant jusqu’à l’invention de lois iniques signées par les grands de ce monde.
Côme ne diabolisait ni le profit, ni le capitalisme. Simplement, il pensait qu’il fallait
réguler le premier et réformer le second. Il rejoignait pleinement Michel Henry
écrivant : « Les formes fondamentales de la culture traditionnelle sont l’art, l’éthique,
la spiritualité ». C’était à partir de cette conception de la culture que l’on pouvait bien
vivre le profit et continuer d’organiser l’économie selon la structure capitaliste.
Le temps passait et Côme observait le monde avec une inquiétude
grandissante. Un matin, il lut dans une chronique économique :
17
"l'économie américaine est censée être toujours en croissance... les marchés boursiers
approchant de sommets record. Pourtant, un ménage sur cinq aux Etats-Unis ne gagne
aucun salaire. Parmi la population noire, masculine et urbaine âgée de 20 à 24 ans,
seules quatre personnes sur 10 ont un emploi. La moitié des ménages américains
comptent sur l'argent du gouvernement pour joindre les deux bouts. Et 50 millions
reçoivent des bons alimentaires".
Il se demanda alors si la mondialisation n’était pas devenue, depuis la « crise »,
le champ désolé d’une gigantesque bataille des économies. Etions-nous donc en
« guerre », plutôt qu’en crise ? Qui étaient les ennemis ? Impossible d’en déterminer
une catégorie. Il semblait plutôt que la célèbre phrase de Hobbes avait trouvé son
illustration parfaite, universalisée : « Homo homini luppus ». Puisque presque aucun
contrôle politique ne maîtrisait une économie de plus en plus détachée de l’économie
réelle, la bestialité la plus sauvage aurait libre cours dans le cœur de l’homme, tant que
le sens de la vertu et donc de la vie ne reprendrait pas place dans les intelligences et
dans les cœurs. Côme n’étant pas du genre à se lamenter sans rien faire, il mit en place
son armée, avec les moyens du bord. Il y avait donc fort à faire : se mettre soi-même
en-dehors du grand courant de l’inquiétude, que Heidegger appelle le souci, c’était le
premier défi. Et puisque c’étaient la pauvreté, voire la misère, qui nourrissaient le souci
des peuples, il fallait pouvoir être « pris » sans être « moralement vaincu », comme
disait si subtilement Sénèque. L’esprit est ce qu’il y a de plus grand en l’homme et ce
qui ne dépend pas de lui ne peut être une cause réelle de son malheur. Mais par l’esprit,
il dépend de l’homme de se conduire en Juste, de mener une vie bonne, de se « rendre
digne du bonheur » - mot de Kant – et d’une immortalité bienheureuse, pour le cas où
elle existe (c’était à « parier »…). Tel serait le premier acte militaire de Côme. Le second
consisterait à venir en aide au prochain dans sa quête de Dieu et dans ses progrès dans
la vertu. Côme, toujours saisi d’inquiétude, éprouvait en même temps une paix plus
forte encore, soutenue par une espérance qui allait contre le spectre et les ombres qui
affolaient les esprits à l’heure même, un peu partout sur la planète, comme s’ils eussent
été l’un de ces pieds qui frappent une fourmilière. Après tout, depuis fort longtemps,
la guerre était l’état habituel de l’humanité, bien que la paix eût été son état normal.
L’individualisme, d’un gage de liberté, était devenu la source d’un esclavage
universel, qui empêchait la vie, car il destituait ses droits et sa gloire à la charité. Celle-
ci, usée par le soupçon, était combattue par une pensée utilitariste, qui se ruinait à
vouloir absolument tout expliquer de l’agir humain par des motifs qui s’inspiraient du
mécanisme : profit, jouissance gratuite ou payante, vanité, pouvoir. L’ego était censé
vivre de ces valeurs, être mu par elles, soit malgré lui, dans le meilleur des cas, soit
selon sa volonté. De là un soupçon universel, qui jetait jusque sur le sens de l’Histoire
l’implacable sentence d’une impuissance à se dérouler autrement que d’après la
tragique répétition des erreurs du passé, emportant avec elle les restes d’humanité qui
surgiraient comme pour accentuer la noirceur du tableau d’un sentiment de désespoir.
Pourquoi la vie n’aurait-elle jamais plus le dessus, dans cette pensée-là, questionnait
Côme ? Tout simplement parce que depuis Hegel, l’homme ne la concevait plus
autrement qu’impersonnelle : une force qui va, qui nous emporte, dénuée de
18
subjectivité. C’était ce que Michel Henry avait montré, par exemple dans C’est moi la
vérité. En tuant la vie, l’humanité ne pouvait plus concevoir autrement son Histoire
que comme celle d’un grand Corps malade, émietté, voué au néant et – pire – à
l’humiliation de ne pouvoir se redresser, en dépit de ses efforts. Il fallait donc épouser
la vie, la vraie, celle que l’on s’était habitué à méconnaître. Il fallait non seulement en
faire mémoire, en lui offrant l’encens et la prière de la foi, si l’on était religieux, mais
aussi y adhérer de tout son cœur, de tout son esprit et de toutes ses forces, renouvelant
à chaque occasion qui serait donnée par l’événement l’énergie qui ferait briller l’étoile
de la Rédemption, jusqu’à ce que le Jour se lève : éternité pour l’âme parvenue dans
son repos auprès de Dieu, ou bien avènement, Parousie du Christ en gloire, appelant
au Jugement et à la vie l’universelle humanité des pécheurs. S’arracher au visible, ou
du moins ne voir et ne vivre plus que de l’invisible à travers lui, plonger dans la douce
clarté de l’infini, l’abîme de la Rédemption répondant à l’abîme de la détresse
humaine : Dieu ferait le reste, soit tout, absolument tout ce qui ne dépend pas de nous,
dans tel ou tel contexte d’existence. « Demeurez dans mon amour ».
Côme substitua à partir de cette méditation la notion d’ « être-pour-la-vie », à
celle, heideggérienne, d’ « être-pour-la-mort ». La première raison était à son sens que
même dans la conscience d’être voué à mourir, il n’avait pas à laisser la mort prétendre
au dernier mot de son temps ici-bas. S’il y avait un dernier Logos, il appartenait à la
vie, dans une sorte de fruit mûr, offert pour que d’autres humains aient la place de
vivre sur cette terre, dans ce grand cloître qui avait ses limites. Plus précisément, il
appartiendrait donc à la charité, puisqu’il fallait donner, perdre, pour que d’autres
reçoivent. La mort aurait eu ce dernier mot si les générations ne s’étaient pas succédé,
si la vie n’avait pas la possibilité de se perpétuer indéfiniment. La seconde raison était
son espérance de l’immortalité bienheureuse, car il prenait à son compte le mot du
général de Gaulle : « Quand on meurt, on va encore vers la vie ». Donc, dans tous les
cas de figure, Côme n’avait plus que la vie en tête et au cœur, elle venait brûler dans
son esprit l’angoisse face à la mort et même celle que cause la possibilité offerte à la
liberté, parce qu’en laissant vivre la vie en lui, non seulement il savait qu’il travaillerait
toujours – le travail n’étant pas d’abord le fait d’une économie, mais de la vie de la
subjectivité à travers l’effort et la relation au monde, aux autres – mais encore, que par
là, il laissait l’Esprit et l’intelligence de Dieu plus grand conduire ses pensées, réaliser
ses rêves au-delà de toute mesure, inspirer ses décisions selon ce qui réellement est le
meilleur. La vie portait en elle la « fonction méta », chère au dominicain Stanislas Breton
et à Jean Greisch : elle n’était pas seulement invisible et spirituelle, elle était aussi
métaphysique et c’était bien rassurant pour un philosophe attaché aux grands
classiques….
L’esprit du temps ne connaît que la vie biologique. Faut-il pour cela lui
opposer la vie spirituelle ? En moi, l’un est-il séparé de l’autre ? Ce sont deux choses
distinctes, car je puis, selon ma volonté, devenir plutôt « psychique » et « charnel » que
« spirituel ». Mais pour qui explore la cause de l’un et l’autre, l’on remonte à l’Unique,
à la source qu’est Dieu. C’est pourquoi l’analyse de la sexualité que fait Schopenhauer
19
dans Le monde comme volonté et comme représentation, paru en 1819 est pertinente, mais
demande à être complétée. La voici :
« L’instinct sexuel est cause de la guerre et but de la paix ; il est le fondement
de toute action sérieuse, l’objet de toute plaisanterie, la source inépuisable de tous les
mots d’esprit, la clef de toutes les allusions, l’explication de tout signe muet, de toute
proposition non formulée, de tout regard furtif, la pensée et l’aspiration quotidienne
du jeune homme et souvent aussi du vieillard, l’idée fixe qui occupe toutes les heures
de l’impudique et la vision qui s’impose sans cesse à l’esprit de l’homme chaste ; il est
toujours une matière à raillerie toute prête, justement parce qu’il est au fond la chose
du monde la plus sérieuse. Le côté piquant et plaisant du monde, c’est que l’affaire
principale de tous les hommes se traite en secret et s’enveloppe ostensiblement de la
plus grande ignorance possible. (…) l’instinct sexuel est la substance de la volonté de
vivre, il en représente ainsi la concentration »
« le désir des désirs de l’homme est un acte de copulation, et seul cet instinct rattache
et perpétue l’ensemble de ses phénomènes. »
« l’instinct sexuel est le manifestation la plus parfaite de la volonté [qu’a l’espèce de se
conserver] »
« toute satisfaction de cet instinct (…) est comme le comble et le faîte de son bonheur,
le but dernier de ses efforts naturels : en y atteignant, il croit avoir tout atteint, en le
manquant, il croit avoir tout manqué. De même (…) nous trouvons dans la volonté
objective, c’est-à-dire dans l’organisme humain, le sperme comme la sécrétion des
sécrétions, la quintessence de tous les sucs, le produit dernier de toutes les fonctions
organiques, et nous avons là une nouvelle preuve de ce que le corps n’est autre chose
que l’objectivité de la volonté, c’est-à-dire la volonté même sous la forme de la
représentation. » p. 1265
Chez Schopenhauer, la volonté est une force aveugle, loin d’être une fin
représentée. Elle est cause efficiente et puissance. La seule puissance et la seule force
qui soient au monde, l’action qui mène l’un et le tout. Cette action, ce vouloir,
constituent la seule réalité. La religion, tout en apportant des indications précieuses à
l’homme dans la recherche de la vérité et de la sagesse, est étrangère à la volonté de
vivre, dans la mesure où celle-ci épouse le monde pour y demeurer perpétuellement.
Tout naturellement, la sexualité n’est au mieux considérée par l’homme religieux que
comme un symbole du désir de la vraie vie, de Dieu, qui est ailleurs. Sans vouloir la
refouler du côté des mauvaises choses, la religion entend en dompter le caractère
sauvage, bestial, pour mettre de l’ordre. Et saint Augustin de juger que si Adam et Eve
n’avaient pas péché, l’espèce n’aurait jamais procréé avec le désir charnel et la
jouissance, mais par le seul effet de la volonté, mouvant les membres du corps sans
que l’âme éprouve ce plaisir jugé superflu. Mais saint Augustin était, comme saint
Paul, dans la mouvance stoïcienne, n’est-ce pas ?
La limite de l’analyse de Schopenhauer vient de ce qu’il assigne au sujet la
même structure que celle de l’objet : la représentation. Ainsi, le corps, ce corps vivant,
subjectif, dont je dis « moi » aussi bien que mon esprit le dit de lui-même, « ce corps
entier n’est que la volonté objectivée c’est-à-dire devenue perceptible » (p. 141). Etant
20
la représentation de la volonté et sa manifestation dans le monde, il subit le régime
d’une force aveugle, incapable de nous éclairer sur son propre sens, ni d’être au moins
pareille au vecteur qui fait signe vers ce qu’il vise, ou au symbole qui évoque ce qu’il
représente. Ainsi l’homme moderne, s’il se met à penser le corps et la sexualité de cette
façon-là, peut-il réinstaurer ce culte du phallus, dont saint Augustin rapporte qu’on
transportait en procession, publiquement, de grands objets pour le représenter, lors
des fêtes du dieu Liber. Durant ces fêtes, qui duraient un mois dans certaines cités
romaines, on se livrait aux propos lascifs, à la débauche. La cérémonie culminait avec
l’offrande d’une gerbe de fleurs déposée au sommet de la sculpture par une femme de
la ville. Plein d’indignation pour cet usage, saint Augustin s’écrie, en nous instruisant
des motifs de cette cérémonie : « Ainsi, pour apaiser le dieu Liber, pour obtenir une
récolte abondante, pour éloigner des champs les maléfices, une femme vénérable est
obligée de faire en public ce qu’elle ne devrait pas permettre sur le théâtre à une
prostituée ! » « De quelle honte, de quelle confusion, dit-il ailleurs, ne devrait pas être
saisi le mari de cette femme si, par hasard, il était présent à ce couronnements! » Saint
Augustin témoigne du virage opéré par le christianisme dans l’histoire de l’antiquité,
où en quelques siècles, une culture considère comme une idole ce qu’elle avait
jusqu’alors vénéré ostensiblement comme la source de la vie. Parce qu’il apporte une
réponse différente à la question « Qu’est-ce que la vie ? », l’Evangile substitue
l’exigence de la chasteté à la licence charnelle, confirmant, mais au nom de Jésus, les
intuitions vertueuses des anciens philosophes.
De sorte que si la culture occidentale voulait faire marche arrière, il ne lui
suffirait que de reprendre sa visée originelle, cet axe de la vie réduite au biologique, et
de jouir de l’ivresse de tourner autour, sans plus penser à la vie elle-même, mais en se
laissant dévaler la pente du monde sans penser à demain.
Anselme en vacances écrivait dans des conditions déplorables. Autour de
lui, les voix, les reproches, surtout le matin. Pourquoi tant de gens se réveillent-ils de
mauvaise humeur, ou bien décidés à rendre justice autour d’eux ? Les moines, eux,
qu’Anselme avait connus pendant six ans, commencent la journée avec, à Laudes, le
Psaume 50, de la pénitence, pour faire de leur journée une ascension et un retour vers
la Jérusalem où nous attend le Père des miséricordes.
Trois jours, qu’il avait passés à se préparer à une nouvelle chimio, persuadé
qu’il était d’avoir un second cancer ! Outre l’idée de devoir peut-être mourir d’ici trois
ans, il y avait la perspective de l’hôpital, de la fatigue des traitements, d’un lieu sans
piano, sans orgue, sans bibliothèque, sans internet (il n’avait pas les moyens). Imaginer
tout cela l’avait fatigué, et mis dans une humeur irritable dont ses proches avaient fait
les frais – il ne les avait pas mis au courant, les deux premiers jours. « C'est amusant,
se dit-il, de revoir soudain son espérance de vie redevenue normale. Et quelle
expérience, depuis vendredi : je regardais tout comme si je devais tout quitter bientôt.
J'avais choisi mes derniers morceaux de piano à apprendre d'urgence avant l'hôpital.
Cette manière de vivre la perception du monde fut très enrichissante, d'ailleurs : une
mise à distance forcée, et un refuge en Dieu. "Les violents s'emparent du royaume" :
21
seule violence que Jésus a bénie : le détachement d'un amour désordonné du monde
par le désir véhément du "réel qui n'est que réel" Platon, République (VI ou VII ?).
Prochain projet : récitals à Ouessant, fin août. Curieusement, les parents sont de
mauvaise humeur, ce soir (stress d'avoir tous les enfants et petits-enfants ; dose
hédoniste de whisky). Je viens de leur annoncer, avec une bouteille de cidre (de
Fouesnant), que ma "tumeur" est en fait ce gonflement de veines très commun aux
personnes qui restent assises longtemps chaque jour ! Accident de travail, en somme.
Opération possible, on verra d'ici 15 jours. J'ai ainsi rencontré leur médecin, qui m'a
fait la meilleure impression qui soit, d'autant qu'il apprécie manifestement que je sache
un peu de latin et de grec. S'il a du temps, il étudierait le piano (mais heureusement il
a des enfants, alors on ne sait jamais). C'est vraiment étrange, cette modification du
rapport au temps, ainsi qu'à la perception en général, que produit l'annonce de la
maladie : en un instant, tout est ramené aux forces vives, celles grâce auxquelles on
survit, dans ces situations de l’existence qu’ordinairement nul né désire. On désire la
paix et la réconciliation avec ses proches (ceux-là qu'on blesse le plus souvent, et qu'on
aime aussi le plus). Belle leçon, finalement, car moi qui croyais habiter ce niveau
d'existence, je réalise combien j'en suis loin. Cela me rappelle certains moines, du
Finistère et d'ailleurs, qui ont su réaliser ce qu'on appelle ici la sagesse. » Le lendemain,
il était debout à six heures, tel un phénix, et partit dire Matines dans les champs après
un petit-déjeuner cistercien (café, charcuterie…), où des vaches intriguées vinrent
renifler « L’eau boisée » - Guerlain - de leurs énormes museaux.
Anselme se demandait quelle folie l’avait poussé à venir chez ses parents en
vacances, sachant d’avance à quelles tempêtes il s’exposait. Mais il y avait son filleul,
qu’il ne pouvait revoir autrement. Par conséquent, le risque s’imposait. Il était grand,
car les maux qu’on s’inflige en famille sont autrement plus grands que ceux qu’on
reçoit des relations professionnels (ou pré-professionnelles, circum-professionnelles,
post…). Anselme, au bout de 48 heures, écrivit à son ami moine Silouane : « (..)
phénomène assez bizarre : on s'aime, on sait qu'on s'aime, mais on se dispute, se juge,
s'accuse 1000 fois par jour. Ma mère se lève d'une humeur massacrante et au moindre
détail qui cloche, s'est Hervé Bazin Vipère au poing (j'exagère, heureusement !). Je mets
2h de piano à récupérer après le déjeuner entre frères et sœurs, qui tient plus des joutes
verbales, ou des arènes de Nîmes, que d'une honnête et sympathique réunion de
famille comme on en rêve toute l'année, avant les sacro saintes vacances d'été, où
chacun espère qu'on cesse de lui casser les pieds. En fait, à part le soleil, tout est pareil.
Relire l'Etranger, de Camus... Je suis accusé de ne pas être serviable, de ne pas
travailler, ni chercher de travail, d'annoncer une maladie avant d'avoir fait vérifier
cette certitude par un médecin et de trop penser, trop parler de Dieu aussi. Respirer,
j'ai le droit... le problème, c'est qu'ils fument tous et que j'en ai horreur en mangeant et
que... je le leur dis ! [Je mets tout ça dans mon roman, ça me fait rire de te l'écrire - Deo
gratias !] » Seulement, une fois cela dans le livre, la réalité apparaissait, brute,
irrécusable : ce que l’on vivait ici, ces jours d’été, ce n’était pas l’amour. On vivait
l’agressivité, on s’entraînait pour de futurs combats, on s’exerçait à l’art de juger, de
dominer aussi, à l’habileté des rhéteurs capables de convaincre leurs auditeurs de
22
voter contre Dieu, puis de persécuter les vendéens, ou encore, de voter pour un
Camarade qui conduirait le Peuple à un idéal de fraternité, puis de persécuter les
nobles et les intellectuels, ou encore, de se rallier à un Führer, adoré comme le premier
de la première des races, puis de persécuter et pourquoi pas d’éliminer un peuple
considéré comme inférieur, animal, auquel on ferait subir toutes les humiliations avant
d’en brûler la chair. Fascinant pouvoir de la parole ! Car si le Bien façonne, quand il
crée, quand il sauve, guéri, pardonne, le Mal, lui, fascine, quand il frappe, se refuse au
pardon, perd l’autre. Or, tout cela se dit en paroles, comme un courant entraîne la
barque dans un bras mortel de la rivière. Tout ce qui se pense peut se dire, tout ce qui
se dit peut se suggérer, et ce qui se suggère peut s’insinuer comme un poison ou
comme un gaz : invisible, imperceptible et pourtant efficace, tel le glaive à deux
tranchants. Croyez-vous qu’on interdira les futurs discours des futurs dictateurs par
la force physique ? Cette recette traditionnelle, légitime, est loin d’être satisfaisante !
Lorsque ces discours apparaissent, c’est que le poison s’est déjà propagé largement,
par la diffusion de paroles, puis d’articles et de livres qu’il aurait fallu dénoncer et
avoir eu l’humanité de censurer (à partir d’avis bien argumentés !). Qu’a-t-on fait,
lorsque Beaumarchais a publié Le mariage de Figaro, et que Voltaire s’est mis à répandre
ses idées contre les principes chrétiens qui faisaient la paix du royaume depuis plus
loin que S. Louis ? Qu’avait-on fait quand Engels, par une interprétation qui n’aurait
jamais dû être publiée ni enseignée, a réduit en poussières déformantes, en une
tempête de sables mortifère l’œuvre admirable de Marx, pour convaincre un peuple
de théories qui n’avaient rien de philosophique ? Que faisait-on en Europe les années
où Mein Kampf circulait en Allemagne, puis en France, horrifiant les esprits sains,
séduisant les faibles ?
Anselme ne connaissait qu’un remède, qu’on lui reprochait assez souvent :
se rattacher à Dieu aussi souvent que possible. Bien sûr, il ne connaissait pas Dieu aussi
bien que les saints, les anges aussi, le connaissent. Mais comment faire autrement que
manifester le même effort, jusqu’à la mort, que celui de la carpe qui lutte contre
l’hameçon qui la ramène à l’air qui signera son étouffement ? N’arrive-t-il pas à une
vieille carpe de s’être ainsi libérée quantité de fois du morceau d’acier dans sa longue
vie – pas si paisible ? Les hommes croient respirer le Bien dans le monde et ils se
trompent : c’est hors du monde que celui-ci demeure, en tant que principe. La
confusion du Bien et du monde recouvre l’esprit du monde, celui de son prince, celui
des ténèbres. Sans cette confusion, les êtres, le monde, sont bons. Il y a une bonté
essentielle de l’être. Mais c’est plonger dans le mensonge que d’oublier que cette bonté
est aussi sur-essentielle, en reniant la transcendance du Bien, son caractère sacré,
éternel, immuable, divin. Le Bien n’est pas le sommet d’une vision étagée des
substances, ou plutôt jamais seulement : il sur-émine, dans un rapport à la mesure qui
domine, mais d’une domination si étrangère à la superbe et à la violence du logos
humain que ce rapport n’a plus rien à voir avec l’éminence des grands de ce monde.
« Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi » : le Bien est caché dans le service qui échappe
à la pensée, et même à l’intuition, parce qu’il précède la perception même des paroles
et des événements. L’idée de service n’est qu’une pâle lueur, mais elle est la seule dont
23
l’homme puisse se servir pour sortir du monde, pour échapper à son emprise le temps
qu’il y demeure. Venir pour être servi, procède de l’idolâtrie : de cette pensée qui
confond l’être créé et le bien, la créature et Dieu, au point de mêler l’être et le néant, de
trébucher par l’absurde chaque fois qu’il faudrait résister pour s’élever vers le sens par
l’ordre des raisons. « Un homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est à genoux pour
aider un autre homme », dit Pythagore. Et combien d’hommes n’ont dû leur salut à la
décision qu’ils firent de se mettre au service des autres, jusqu’à l’oubli croissant de
leurs intérêts propres, parce que sur ce chemin, ils oubliaient aussi leurs anciennes
passions et devenaient capables de dénoncer les pensées des tyrans inconscients – ou
non – de leurs contradictions et de leur violence ? Menaçant la justice et la paix, le
pardon et le caractère sacré de toute vie humaine, depuis les prémisses qui la
promettent, jusqu’au decrescendo des forces, ces paroles dignes des Führers, des
tyrans, des Duce, ont-elles disparu parce qu’ « on est au XXIe siècle », (et qu’il ne faut
surtout pas « vivre comme avant ») ou que « l’Histoire n’a qu’un intérêt médiocre »
(au regard des actualités, dont les journaux nous abreuvent pour mieux nous faire
croire que les réponses à l’action que nous devons mener sont là…) ?