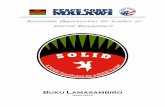Le corps, du De opificio dei aux Institutiones diuinae : philosophie chrétienne et martyre chez...
Transcript of Le corps, du De opificio dei aux Institutiones diuinae : philosophie chrétienne et martyre chez...
1
Le corps, du De opificio dei
aux Diuinae institutiones :
martyre, philosophie chrétienne et religion chez Lactance
L’ouvrage d’anthropologie de Lactance qui fut aussi son premier écrit chrétien, le De
opificio dei, contient les savoirs que l’auteur pouvait posséder sur le corps –et l’âme–
considérés a priori, en fonction de la providence de Dieu, et certaines de ces données ont pu
être reprises et exploitées par l’auteur par la suite1. Ainsi, de sujet d’étude qu’il était et après
la présentation presque complète qui en est faite dans le De opificio dei, le corps est devenu
objet de réflexion dans l’œuvre des Institutions Divines écrite immédiatement après, et c’est
ce que nous considérerons ici en tenant compte du changement de perspectives qui s’opère
d’un écrit à l’autre. Dans ce deuxième ouvrage, qui est aussi le plus ample et le plus
développé de l’ensemble de son oeuvre, Lactance aborde en effet ce qui a trait au corps sous
une forme non plus systématique et « scientifique », mais dans une visée directement
apologétique, qui entre dans le domaine général de la pragmatique. Dans le discours, il s’agit
désormais pour Lactance de faire valoir le christianisme contre la réalité des attaques et des
poursuites, des ignorances et des incompréhensions païennes, autant sur un plan théorique et
pratique, philosophique et religieux, différents angles que nous envisagerons ici à notre tour.
C’est que Lactance écrit dans le contexte prégnant des persécutions -les dernières qui sévirent
dans l’Empire, et dont la durée et la sévérité furent bien moindres dans l’Occident de
Constance Chlore puis de Constantin -, persécutions où le martyre occupe évidemment une
place centrale et en fonction de quoi l’apologiste fait de la question du corps un support de
discussion pertinent2. De fait, il nous semble qu’il y a lieu de rechercher ce qui, de l’œuvre
première, pouvait maintenant valoir argument, pour Lactance, aux yeux et donc à l’encontre
de ses lecteurs païens.
Lui-même, éloigné de Nicomédie lors les persécutions, où il avait été appelé comme
rhéteur par Dioclétien, mais qui connaissait donc de près les lieux du pouvoir, était intéressé
par la conquête d’un droit général à accorder aux chrétiens, dans le domaine de la loi, mais
aussi, d’un point de vue propre, dans celui de la pensée3. Ce qui nous importe donc ici est que
nous soyons attentifs au positionnement épistémologique et social du discours lactancien,
plutôt que de nous en référer au seul critère de la vérité ontologique du christianisme qui était
2
le sien. Car tel que Lactance se présente, il semble revendiquer un statut pour lui-même au
moment où, dans l’Histoire, émerge la question de la légitimation juridique du christianisme
en tant que religio dans l’Empire. Si l’on veut bien se rendre compte que la rédaction des
Institutions divines est liée à une époque, celle où le fait d’une légitimation du christianisme
par le pouvoir politique a dû être concevable pour pouvoir se réaliser, il s’agit au fond de se
demander selon quel acquis épistémologique cet auteur chrétien considérait que la vérité
chrétienne pouvait se montrer valide et démontrable, en s’appliquant, par exemple, au
problème du corps, dans son combat dialectique avec les païens4.
***
Dans les Institutions divines, on retrouve l’opposition fondamentale qui avait été établie
dans le De opificio dei entre corps et âme, mais devenue cette fois un motif entraînant la
réflexion sur les thèmes binaires de la mort et de l’immortalité, de la souffrance et de la
patientia, à quoi il faut joindre celui plus discret et pourtant essentiel, nous semble-t-il, de la
fragilité du corps et de la force de l’âme. Lactance ayant accordé, dans le De opificio dei, une
attention certaine à la fragilité propre à ce corps humain dépourvu des défenses attribuées aux
animaux pour la sauvegarde de leur espèce, privés, quant à eux, de la raison utile à la
conservation de l’homme, il continue d’exploiter cette question dans les Institutions divines,
mais dans une démarche nouvelle, que nous nous proposons donc d’examiner ici5. Eu égard
au thème de la patientia, qui occupe une place centrale au moment de l’oeuvre où Lactance
évoque les persécutions et leurs tormenta, il convient de préciser, d’autre part, que jamais
Lactance n’emploie dans ce contexte le mot de martyrium pour évoquer l’épreuve du chrétien
dans l’expression de sa foi, ou celui de martyr qui lui correspond ; alors que ses prédécesseurs
Tertullien et Cyprien, qui avaient l’un et l’autre écrit un traité sur la patientia, s’étaient pour
leur part servis des termes grecs6. Or, prenant enseignement de l’histoire des mots, il n’est
sans doute pas inutile de rappeler que l’évolution du terme martyr est de son côté achevée au
IVe siècle, et notamment avec Eusèbe de Césarée, l’auteur grec exactement contemporain de
Lactance, chez qui il est devenu un terme classique : le « martyr » est le chrétien qui témoigne
publiquement de sa foi au Dieu unique et à la divinité de Jésus-Christ, et qui porte ce
témoignage jusqu’à la mort7. La comparaison avec Eusèbe est instructive, parce qu’en
employant des expressions telles que « les bienheureux martyrs » ou « la confession des
martyrs », il apparaît que ce dernier valorise les personnes selon une catégorie
théologiquement identifiée8. Tandis que Lactance s’en tient à un récit, on va le voir, qui met
3
en présence de manière circonstanciée aussi bien les païens persécuteurs que les chrétiens
persécutés de son temps, qu’il s’attache, autrement dit, à tenir un propos plus globalisant dont
la dimension anthropologique et morale reste marquée, et sur l’intentionnalité duquel on est
amené à s’interroger.
Ainsi, on peut déjà admettre que l’emploi du terme latin patientia représente un choix
délibéré de la part de Lactance, qui lui permet de valoriser sa réflexion à la fois en termes
philosophiques et par contraste avec les traités chrétiens de Tertullien et Cyprien. De ce
dernier point de vue, il apparaît en effet qu’il ne s’agissait pas pour Lactance, comme l’avait
fait Cyprien, d’approfondir le concept de la patientia chrétienne selon l’enseignement
biblique de l’υπομονή. Ni non plus de méditer sur la notion de patientia en tant que « principe
caractéristique des grandes étapes du ‘dessein de salut ‘ » à la manière de Tertullien9. Si l’on
peut déceler dans la pensée de Tertullien une influence certaine de la conception stoïcienne de
la patientia comme domination de soi et apathie dans sa propre conception de la notion10
, et si
Lactance n’est pas pour sa part indifférent à celle-ci, bien au contraire, la différence
fondamentale semble bien résider dans le fait que ce dernier n’a pas écrit un traité tout entier
sur le sujet mais a abordé la question de la patientia dans une apologie. La réflexion s’y
engage par double référence de pensée, païenne et chrétienne, chacune renvoyant l’une à
l’autre et se présentant avec une plus grande acuité l’une par rapport à l’autre, et pour se
focaliser, en l’occurrence, sur le cas particulier des persécutions11
. Comme le souligne M.
Spanneut, « Lactance, qui présente sa pensée de manière beaucoup plus philosophique et
moins spirituelle <que Tertullien et Cyprien>, fait encore plus du martyre une réalisation de la
patience »12
. Certes, si l’on voulait y parvenir, on pourrait retrouver différents éléments des
traités de Tertullien ou Cyprien chez Lactance, mais dispersés, et distribués autrement13
, mais
il resterait que l’absence de citations scripturaires chez Lactance pour illustrer le thème de la
patientia le maintient radicalement à part14
.
En abordant le thème de l’immortalité de l’âme comme celui de la patientia, il est
d’autre part manifeste que Lactance faisait en sorte d’introduire les arrière-plans platonicien et
stoïcien dans le propos, et cela, notons-le, comme s’il faisait appel avec la plus grande aisance
à un fonds de notions, voire de « valeurs », commun aux païens et aux chrétiens de son
époque. Lactance fait même d’emblée valoir, au moment d’entamer son chapitre sur la
patientia, que «< la> célèbrent également par leurs éloges les plus flatteurs la voix du peuple,
celle des philosophes, celle des orateurs », en se rapprochant sur ce point de ce qu’avait dit
Tertullien, toutes proportions gardées cependant15
. Car une telle approche vient renforcer,
4
dans le cas de Lactance, la démarche propre et inédite de cet apologiste, qui s’adressant à la
fois aux païens, ceux du moins qui étaient curieux de la religion chrétienne, et aux chrétiens,
qui pour certains se sentaient encore chancelants dans leur foi, réunit en quelque sorte « tout
le monde » dans un seul lectorat16
. Il était question désormais de réfléchir à une notion morale
a priori concevable par tous, et pouvant interpeller tout le monde dans la mesure où le
contexte général des persécutions –elles furent décidées par édit impérial à partir du IIIe
siècle, et donc généralisées à tout l’Empire quand elles se produisaient- la mettait
manifestement en jeu, et d’affirmer alors qu’elle était conçue dans sa juste réalité par les seuls
chrétiens parce que réellement vécue par eux seuls.
*
En centrant ainsi sa réflexion sur le corps et le martyre qu’il subit, et la patientia dont le
corps fait alors preuve, Lactance, sans aucun doute, portait haut son idée selon laquelle la
sapientia chrétienne est la seule vraie philosophie, parce qu’une philosophie « en acte ». Cela,
par opposition avec ce qui représentait pour lui la fausse philosophie des païens, et tout
spécialement celle des stoïciens, premiers chantres de la patientia mais incapables d’en
donner l’exemplum, à la différence des chrétiens instruits par l’exemplum du Christ lui-
même17
. Quels que soient les points de convergence possibles, l’approche de Lactance n’est
pourtant pas assimilable à celle de Tertullien évoquée plus haut. Car, pour Lactance, cette idée
de philosophie « en acte » était d’abord à même, corrélativement, de redéfinir la philosophie
et, dans son rapport à elle, la religion, ce qu’il faut entendre dans une dimension non
seulement cultuelle, mais également sociale et politique, en rapport avec l’actualité de
l’histoire.
Semblablement au thème de l’immortalité de l’âme, qui est établi dans le De opificio dei
mais se trouve traité ensuite à quatre reprises dans les Institutions divines, la question du corps
est elle-même abordée en plusieurs fois dans cette seconde oeuvre, d’abord au livre IV (De
uera sapientia et religione), où Lactance développe un exposé christologique, puis au livre V
(De iustitia), où il traite de justice, et enfin au livre VII (De uita beata), qui ouvre la
perspective eschatologique18
. Rappelons qu’à la fin du De opificio dei, Lactance annonçait
déjà son œuvre future des Institutions divines et précisait qu’elle porterait sur le bonheur, ce
que le titre du livre VII, qui en est le sommet, permet effectivement d’attester. Dans cette
économie, les six livres précédents se présentent comme les étapes progressives d’un
cheminement dialectique menant jusqu’à lui. Ainsi, et pour présenter les choses de manière
5
synthétique, une condition du débat est posée : c’est la question du bonheur ; sa « solution »,
affirmée : il s’agit de l’immortalité. Et l’apologiste chrétien Lactance veut faire apparaître à
ses lecteurs cette solution comme l’issue d’un processus de pensée qui fait effectivement ses
preuves.
Cela suppose que Lactance commence par se positionner lui-même en tant que
philosophe chrétien, un positionnement censé regarder la philosophie en général, ce dont il se
préoccupe tout spécialement au livre III des Institutions divines. De ce fait, voyons d’abord
comment cette idée de bonheur est appréhendée. C’est bien par le livre III, De falsa sapientia,
qui porte sur « la fausse philosophie » des philosophes païens, que l’on doit commencer à cet
égard, où Lactance, mettant à mal les différentes écoles philosophiques païennes, en
s’autorisant de ce qu’il appelle la « vraie sagesse et religion »19
du christianisme, se réfère
aussi aux évidences partagées par le commun des mortels, lequel se passe de démonstration en
la matière. C’est en effet l’immortalité qui, pour l’apologiste chrétien, se révèle au centre de
tous les espoirs de bonheur de la part de tous les hommes, et comme la forme du bonheur
spécifique à ces mêmes hommes. C’est alors d’après l’expression classique de summum
bonum que l’idée de bonheur se trouve affirmée :
Summum igitur bonum sola inmortalitas inuenitur, quia nec aliut animal nec corpus adtingit nec potest
cuiquam sine scientia et uirtute id est sine dei cognitione ac iustitia prouenire. Cuius adpetitio quam
recta, quam uera sit, ipsa uitae huiusce cupiditas indicat, quae licet sit temporalis et labore plenissima,
expetitur tamen ab omnibus et optatur : hanc enim tam senes quam pueri, tam reges quam infimi, tam
denique sapientes quam stulti cupiunt20
.
Donc le souverain bien se trouve uniquement dans l’immortalité, puisqu’elle n’échoit à aucun animal
ni aucun corps et ne peut advenir à personne sans le savoir et la vertu, autrement dit sans la connaissance
et la justice de Dieu. Combien le désir d’immortalité est chose exacte et réelle, l’envie de cette vie-ci
le montre, laquelle, quoique temporelle et pleine de souffrances, est cependant recherchée et souhaitée
par tous : autant les vieillards, en effet, que les enfants, les rois que les pauvres hères, les sages,
enfin, que les non sages en entretiennent l’envie.
L’idée d’unanimité est ici fortement marquée et l’on ne peut que déceler, à cette occasion,
sous l’emploi des termes dichotomiques sapientes et stulti, une remise en cause assez
ironique de la part de Lactance des catégorisations « extrémistes » du stoïcisme qu’il entend
de la sorte démentir, soutenant que la sagesse est une réalité accessible, et accessible à tous.
Il existe, par ailleurs, dans le De opificio dei, de nombreux passages traitant de
l’immortalité de l’âme, de sa nature céleste, en opposition au corps, mortel et terrestre. Mais
arrêtons-nous sur celui où Lactance reprend l’argument platonicien de l’automotricité pour
preuve d’éternité. Car il est intéressant d’y relever la façon dont Lactance, loin de s’aventurer
dans les questions métaphysiques, laisse apparaître et même souligne ses propres limites dans
le domaine de la connaissance, après avoir affirmé qu’elles étaient probablement inévitables à
tous les hommes, du fait qu’ils sont hommes, précisément, les philosophes y compris21
:
6
Superest de anima dicere, quamquam percipi ratio eius et natura non possit. Nec ideo tamen inmortalem
esse animam non intellegimus, quoniam quidquid uiget moueturque per se semper nec uideri aut tangi
potest, aeternum sit necesse est.2 Quid autem sit anima nondum inter philosophos conuenit nec umquam
fortasse conueniet. …4. Vnde apparet animam nescio quid esse deo simile22
.
Il reste à parler de l’âme bien que sa manière d’être et sa nature ne puissent être perçues. Ce qui ne nous
empêche pas pour autant de comprendre que l’âme est immortelle, car ce qui a vie et mouvement par soi-
même et toujours, sans qu’on puisse le voir ni le toucher, est nécessairement éternel. 2. Or, sur la nature
de l’âme, il n’y a pas encore d’accord entre les philosophes, et peut-être n’y en aura-t-il jamais. …4. D’où
il apparaît que l’âme est un je ne sais quoi semblable à Dieu.
Or il y a tout intérêt à rapprocher ces lignes du prologue de l’ouvrage, où Lactance
dénonce la témérité des philosophes païens, qui cherchent, écrit-il, « à pénétrer les choses que
Dieu a voulu laisser tout à fait secrètes et cachées et à s’enquérir de la nature des choses
célestes et terrestres, celles que leur éloignement rend inaccessibles à nos yeux, intouchables à
nos mains, imperceptibles à nos sens »23
. L’important étant de remarquer que cette même
limite dans le domaine du savoir se trouve affirmée dans un autre passage du livre III
considéré, où, par opposition aux philosophes, l’homme commun, qui compose le uulgus est
mis en valeur :
Nam uulgus interdum plus sapit, quia tantum quantum opus est sapit. A quo si quaeras utrum sciat
aliquid an nihil, dicet se scire quae sciat, fatebitur nescire quae nesciat24
.
Car les gens du peuple sont parfois plus savants, parce qu’ils ne savent qu’autant qu’il est nécessaire
de savoir. Si on leur demande s’ils ont quelque connaissance ou aucune, ils diront qu’ils connaissent ce
qu’ils connaissent, et avoueront ne pas connaître ce qu’ils ne connaissent pas.
On voit ainsi que la question du bonheur et de l’immortalité qui est au cœur de la vérité
du christianisme est l’occasion pour Lactance de déterminer une forme de savoir qui ne vaut
qu’autant qu’il rassemble des données philosophiques couramment admises en son temps
(principe platonicien de l’immortalité de l’âme), étayée par une disposition psychologique
générale (bonheur placé dans l’immortalité), et la position épistémologique élémentaire, en
quelque sorte, du uulgus, respectueuse des limites de sa condition, condicio, et parmi lequel
Lactance se compte, précisément, lui, philosophe chrétien25
. Et c’est en termes inverses que la
philosophie des païens, représentée ici à travers Cicéron, est d’ailleurs évoquée :
Summus ille noster Platonis imitator existimauit philosophiam non esse uulgarem, quod eam non nisi
docti homines adsequi possint. Non est ergo sapientia, si ab hominum coetu abhorret, quoniam
sapientia si homini data est, sine ullo discrimine omnibus data est26
.
Notre plus grand imitateur de Platon a considéré que la philosophie n’était pas chose du peuple, parce
que seules les personnes doctes pouvaient y prétendre. (…) C’est donc que cette philosophie n’est
pas une sagesse puisqu’elle se tient à l’écart de l’ensemble des hommes ; or, dès lors que la sagesse a
été donnée à l’homme, c’est sans discrimination qu’elle l’a été.
S’il est vrai, comme nous l’avons rappelé, que Lactance s’emploie a priori à réunir
païens et chrétiens dans un même lectorat, une distinction radicale est ainsi, en tout cas,
introduite. L’idée d’une universalité de la sagesse, offerte à tous les hommes, est privilégiée,
7
qui place en l’occurrence les chrétiens en position de force. Cela d’ailleurs avait été dit
d’emblée au livre I, où Lactance avait exprimé cette idée de l’accessibilité d’une sagesse
proportionnée aux capacités de tous :
Nobis autem, qui sacramentum uerae religionis accepimus, cum sit ueritas reuelata diuinitus, cum
doctorem sapientiae ducemque uirtutis Deum sequamur, uniuersos sine ullo discrimine uel sexus uel
aetatis ad caeleste pabulum conuocamus27
.
Mais nous, qui avons reçu le dépôt sacré de la vraie religion, puisque la vérité nous a été révélée de façon
divine, et que notre maître de sagesse, le guide que nous suivons vers la vertu, c’est Dieu, nous appelons
tous les hommes, sans aucune distinction de sexe ou d’âge, à une nourriture céleste.
Mais il faut ici être attentif au fait que Lactance évoquait alors le « privilège » chrétien
de pouvoir posséder une sagesse universelle révélée, alors qu’il déplace ensuite son
affirmation sur un plan philosophique et dialectique. Car Lactance met aussi les chrétiens en
position de force dans la mesure où la théologie qui a été révélée aux chrétiens se présente
pour lui à la manière d’un système logique, qui explique le devenir de l’homme de sa
naissance jusqu’au bonheur final qu’est l’immortalité, et qu’il peut effectivement résumer sur
un mode démonstratif au livre VII :
Nunc totam rationem breui circumscriptione signemus. Idcirco mundus factus est ut nascemur ; ideo
nascimur, ut adgnoscamus factorem mundi ac nostri deum : ideo adgnoscimus, ut colamus, ideo colimus,
ut immortalitatem pro laborum mercede capiamus, quoniam maximis laboribus cultus dei constat : ideo
praemio immortalitatis adficimur, ut similes angelis effecti summo patri ac domino in perpetuum
seruiamus et simus aeternum deo regnum28
.
A présent, établissons en une brève récapitulation tout le raisonnement. Nous sommes nés pour
reconnaître dieu comme l’artisan du monde et le nôtre ; nous le reconnaissons pour l’honorer, nous
l’honorons pour recevoir l’immortalité en rétribution de nos efforts, puisque le culte de dieu exige les
plus grands efforts : nous sommes gratifiés de la récompense de l’immortalité pour que, rendus
semblables à des anges, nous servions pour l’éternité le père et maître suprême et soyons pour Dieu son
royaume éternel.
Soulignons incidemment que lorsque Lactance dit que les hommes sont « nés pour le
culte », il y aurait lieu de distinguer d’un côté l’aspect social et moral de cette affirmation,
qu’il développe autour de la notion de pietas, en portant sa réflexion dans le domaine de la
philosophie du droit, du droit naturel et qui explique que le culte se définit d’abord pour
l’apologiste comme « pratique de la justice ». Ce propos regarde en l’occurrence le livre V
dans son aspect dominant, consacré à la justice, lui-même en relation avec le livre VI, qui
s’intitule De uero cultu29
. Alors qu’ici, il s’agit du culte qui s’exerce dans la mise à l’épreuve
de soi, laquelle se rencontre de manière extrême dans les persécutions, et débouche sur
l’eschatologie, traitée au livre VII : le culte implique en ce cas très directement la notion de
fides30
.
Ainsi donc, pour marquer un premier pallier dans notre analyse, dans le De opificio dei,
Lactance avait annoncé qu’il allait consacrer sa prochaine œuvre au bonheur : il s’agit des
Institutions divines. Dans cette apologie qui procède cette fois d’une démarche pragmatique, il
8
fait alors valoir l’unanimité des hommes à désirer l’immortalité et présente le
christianisme comme la réponse universelle à cette attente. Or, s’il appuie cette réponse sur
une forme d’équation logique au livre VII, comme on vient de le voir, au livre V, Lactance
cherche à montrer que la logique qui est au fond de la vérité chrétienne est démontrée, en
quelque sorte, en pratique par les persécutés eux-mêmes :
Cum autem noster numerus semper de deorum cultoribus augeatur, numquam uero, ne in ipsa quidem
persecutione minuatur …qui est tandem tam excors tamque caecus quin uideat in utra sit parte
sapientia ? 31
Puisque notre nombre augmente sans cesse au dépens des adorateurs des dieux, et que jamais il ne
diminue, même en pleine période de persécution … y a-t-il enfin quelqu’un d’assez dément et d’assez
aveugle pour ne pas voir de quel côté se trouve la sagesse ?
Certes, on peut ne voir dans ces lignes qu’un discours polémique, et à fin de
propagande, même s’il n’est pas interdit de penser que Lactance envisage de manière
sincèrement enthousiaste une progression effective du nombre des chrétiens ainsi que sa
propre capacité de persuasion alors qu’il était le premier auteur latin à délivrer sa pensée « en
grand », dans une véritable somme, au titre de philosophe chrétien32
. Mais ce serait de toute
façon en faire une lecture insuffisante, alors que dans une même inspiration, Lactance soutient
ailleurs un propos encore plus appuyé et circonstancié :
Cum uero, “ ab ortu solis usque ad occasum ”, lex diuina suscepta sit et omnis sexus, omnis aetas et gens
et regio unis ac paribus animis deo seruiat, eadem sit ubique patientia, idem contemptus mortis,
intellegere debuerant aliquid in ea re esse rationis quod non sine causa usque ad mortem defendatur,
aliquid fundamenti ac soliditatis quod eam religionem non tantum iniuriis et uexatione non soluat, sed
augeat semper et faciat firmiorem33
.
Mais puisque “ du levant jusqu’au couchant ” la loi divine a été adoptée, et que des gens de l’un et l’autre
sexe, de tout âge, de toute race et de tout pays servent Dieu d’un même coeur et montrent partout la
même endurance et le même mépris de la mort, ils auraient dû comprendre qu’il y a dans cette attitude
quelque chose de raisonnable que l’on ne défend pas sans motif jusqu’à la mort, qu’elle repose sur
un fondement solide qui non seulement empêche notre religion d’être détruite par les injustices et les
mauvais traitements mais sans cesse la fait grandir et l’affermit.
Comme donc il apparaît, alors que dans le De opificio dei, en disant que l’âme et la raison
distinguent l’homme en propre, Lactance affirmait un principe, l’apologiste s’emploie
désormais, dans les Institutions divines et en particulier au livre V, à mettre en évidence la foi
raisonnante et agissante, en quelque sorte, du chrétien. Ainsi, la croyance chrétienne se trouve
mise en valeur comme une forme de philosophie en acte, qui fait posséder la maîtrise que
l’esprit exerce sur le corps, et permet à l’âme de gagner l’immortalité34
.
Insensiblement, c’est donc la question de l’exercice effectif de la sagesse qui est traitée,
avec en son centre la notion de patientia à laquelle se rattache à son tour celle, fondamentale,
de uirtus. Or, il existe, selon Lactance, une formation philosophique chrétienne en ce
domaine, qu’illustre le fait que le Christ est considéré et présenté par lui comme un doctor
9
uirtutis. La profonde originalité de l’apologiste, en effet, réside dans sa manière
d’appréhender le mystère de l’incarnation comme une opération de philosophie pratique, en
quelque sorte, susceptible d’être appréhendée intellectuellement par ses interlocuteurs35
. C’est
d’ailleurs cette approche épistémologique du mystère chrétien par l’apologiste qui explique, à
notre sens, que la présentation du Christ comme exemplum de la patientia figure de manière
anticipée, au livre IV qui lui est consacré, plutôt que d’apparaître dans la présentation
théologique de la patientia qui est faite au livre V, où Lactance ne veut mêler à sa méthode
argumentative aucune citation scripturaire36
. Et c’est bien ce phénomène de l’incarnation
comme « réalisation » philosophique qui assure pour l’apologiste la supériorité de la « vraie
sagesse et religion » du christianisme, pour reprendre le titre de son livre IV, sur la
philosophie païenne. De fait, affirme Lactance, « tu vois combien un maître mortel, parce
qu’il peut être un guide pour un mortel, est plus parfait qu’un maître immortel, parce que celui
qui n’est pas soumis aux passions ne peut enseigner la patience »37
.
Ainsi, vis-à-vis des mises en causes païennes, juives également, concernant la nature du
Dieu chrétien incarné dans un homme, Lactance expose le raisonnement suivant. D’abord,
c’est la correspondance effective entre théorie et pratique qui est soulignée :
Inde euenit ut philosophorum praeceptis nullus obtempret. Homines enim malunt exempla quam uerba,
quia loqui facile est, praestare difficile…9 Superest ut factis uerba firmentur : quod philosophi facere
nequeunt. …10 Nemo enim post mundum conditum talis extitit nisi Christus, qui et uerbo sapientiam
tradidit et doctrinam praesenti uirtute firmauit38
.
C’est pour cette raison que …nul ne se soumet aux préceptes des philosophes. Car les hommes aiment
mieux les exemples que les paroles, parce qu’il est facile de parler mais difficile d’accomplir… 9 Il reste
donc à confirmer les paroles par des actes : ce que les philosophes ne peuvent pas faire. …10 Car
…personne de tel, depuis la fondation du monde, n’a existé, sinon le Christ, qui par son verbe nous a
transmis la sagesse et qui a corroboré son enseignement par une pratique réelle de la vertu.
Cela répondant donc aux questions suivantes des païens :
Cur igitur, aiunt, ad docendos homines non ut Deus uenit ? Cur se tam humilem imbecillumque constituit
ut ab hominibus et contemni et poena adfici posset ? …Cur non maiestatem suam sub ipsa saltem morte
patefecit, sed ut inualidus in iudicium ductus est, ut nocens damnatus, ut mortalis occisus 39
?
Pourquoi donc, disent-ils, se proposant d’enseigner les hommes, n’est-il pas venu comme Dieu ? Pourquoi
s’est-il fait si humble et si faible, au point de se laisser mépriser et supplicier par les hommes ?
…Pourquoi n’a-t-il pas fait apparaître sa majesté, fût-ce à l’instant de sa mort, mais a-t-il été traîné en
jugement comme un pauvre type, condamné comme un coupable, exécuté comme un mortel ?
Ensuite, c’est donc la question fondamentale portant sur la condition même d’homme
assumée par Dieu dans le Christ qui est développée par Lactance :
Vides ergo quanto perfectior sit mortalis doctor, quia dux esse mortali potest, quam immortalis, quia
patientiam docere non potest qui subiectus passionibus non est. …19 Liquido igitur apparet eum qui
uitae dux et iustitiae sit magister corporalem esse oportere … ipsum autem subire carnis et corporis
imbecillitatem uirtutemque in se recipere cuius doctor est, ut eam simul et uebis doceat et factis ; item,
subiectum esse morti et passionibus cunctis, quoniam et in passione toleranda et in morte subeunda
uirtutis officia uersantur. Quae omnia, ut dixi, consummatus doctor perferre debet, ut doceat posse
perferri40
.
10
Tu vois combien un maître mortel, parce qu’il peut être un guide pour un mortel, est plus parfait qu’un
maître immortel, parce que celui qui n’est pas soumis aux passions ne peut pas enseigner la patience.
…19 Il apparaît donc clairement que celui qui est le guide de la vie et le maître de justice doit avoir un
corps… doit aussi se soumettre à la faiblesse de la chair et du corps et recevoir en lui la vertu qu’il
enseigne, afin de l’enseigner en même temps par des paroles et des actes ; il doit également être soumis à
la mort et à toutes les passions, parce que les devoirs de la vertu consistent à supporter les passions et
à se soumettre à la mort. Et tout cela, comme je l’ai dit, le maître achevé doit le supporter, afin de
montrer qu’on peut le supporter.
Pour résumer cela un peu trivialement, nous dirions ainsi que si le Christ est bien, selon
Lactance, un doctor uirtutis, c’est à condition d’avoir été mortalis doctor, d’avoir, autrement
dit, assumé carnis et corporis imbecillitatem pour pouvoir passionem tolerare, mortem subire
et alors patientiam docere. Bref, c’est un Christ humilis et à la fois exemplum qui en fait un
doctor uirtutis.
Ainsi donc, la fragilité du corps est une donnée qui paraît primordiale dans la pensée de
Lactance. Revenons sur ce point au De opificio dei, où Lactance affirmait que cette fragilité
de l’homme appartient au plan providentiel de Dieu, qui offre l’immortalité à qui est passé par
la mort terrestre :
Fragilia sunt omnia quae uideri ac tangi possunt. Superest ut aliquid ex caelo petant, quoniam in terra
nihil est quod non sit infirmum. Cum ergo sic homo formandus esset a deo ut mortalis esset aliquando,
res ipsa exigebat ut terreno et fragili corpore fingeretur41
.
Tout ce qui peut être vu et touché est fragile. Il leur (= les épic.) reste à demander une nature céleste,
puisque sur terre il n’est rien que de fragile. Puisqu’il fallait donc que Dieu eût façonné l’homme de
sorte qu’il finît par mourir, la réalité même exigeait qu’il fût pétri d’un corps terrestre et fragile.
Cum enim deus animal quod fecerat sua sponte ad mortem transire cognouisset, ut mortem ipsam, quae
est dissolutio naturae, capere posset, dedit ei fragilitatem, quae morti aditum ad dissoluendum animal
inueniret42
.
Dieu savait, en effet, que l’être vivant qu’il avait créé de son propre chef tendait vers la mort. Aussi, pour
lui permettre de recevoir la mort même, qui est une dissolution naturelle, Il lui a donné la fragilité, qui
ouvre à la mort un accès pour dissoudre l’être vivant.
Or on constate que, loin d’être abandonné, le thème de la fragilité du corps humain s’affirme
de nouveau dans les Institutions divines, mais dans une nouvelle dynamique, où celle-ci
représente la base d’un retour aux données vraies de l’anthropologie. Sans qu’il y ait lieu de
développer, je signalerai seulement ici que la distribution du verbe suscipere dans les
Institutions divines est extrêmement éclairante à cet égard, dans la mesure où ce verbe a pour
compléments d’objet aussi bien les termes condicionem, mortem, ou encore rationem, que
officium, sacra et cultum et assure ainsi une forme d’isotopie du discours qui souligne sur
quelle base consciente se développe l’existence chrétienne.
11
Mais voyons, à présent, qu’à cette fragilité du corps humain considérée par Lactance, est
liée une dimension majeure de l’homme, à savoir la dimension sociale, elle-même illustrée, en
toute cohérence, par l’exemple du Christ :
Idcirco enim accepit sapientiam, ut aduersus nocentia fragilitatem suam muniat… 17…Infirmitas autem
habet in se mortis condicionem… 18 Praeterea si mors certae constituta esset aetati, fieret homo
insolentissimus et humanitate omni careret. Nam fere iura omnia humanitatis, quibus inter nos
cohaeremus, ex metu et conscientia fragilitatis oriuntur43
.
Aussi a-t-il (=l’homme) justement reçu la sagesse pour protéger sa fragilité contre ce qui lui nuit. … 17
Or la faiblesse comporte en elle-même la condition mortelle… 18 En outre, l’homme deviendrait fort
effronté et manquerait de tout sentiment humain, si la mort avait été fixée à un âge donné. Car presque
tous les droits de l’humanité, qui nous lient réciproquement, naissent de la crainte et de la conscience
de notre fragilité.
De même, s’agissant du « vrai philosophe » du De opificio dei que l’on retrouve, mais cette
fois identifié au Christ, au livre IV des Institutions divines, il est dit :
Quicumque praecepta dat hominibus ad uitam moresque fingit aliorum, quaero debeatne ipse facere quae
praecipit an non debeat. Si non fecerit, soluta praecepta sunt. Si enim bona sunt quae praecipiuntur, si
uitam hominum in optimo statu collocant, non se debet ipse praeceptor a numero coetuque hominum
segregare inter quos agit, et ipsi eodem modo uiuendum est quo docet esse uiuendum, ne, si aliter
uixerit, ipse praeceptis suis fidem detrahat… 44
Si quelqu’un donne aux hommes des recommandations pour leur vie et veut façonner les mœurs d’autrui,
doit-il, je le demande, mettre personnellement en pratique ce qu’il recommande, ou ne le doit-il pas ? S’il
ne le fait pas, ses recommandations sont annulées. 2 Car, si les recommandations qu’il donne sont bonnes,
si elles mettent la vie des hommes au niveau le plus élevé, l’auteur des recommandations ne doit pas,
lui, se placer en dehors du groupe et de la communauté des hommes parmi lesquels il vit ; et il doit
vivre exactement comme il enseigne qu’il faut vivre, de peur que, s’il vivait autrement, il n’enlève lui-
même tout crédit à ses recommandations…
Remarquons d’abord que l’on trouve dans ce passage du livre IV le syntagme de coetus
humanum que l’on a vu plus haut employé au livre III, où il était question de dénier la qualité
de philosophie à celle, érudite et élitiste, des philosophes païens45
. Et pour poursuivre le
raisonnement lactancien ici en cause, on voit aussi que le fait pour un homme de ne pas
accepter sa fragilité de condition revient pour lui, à l’inverse, à tomber dans la sauvagerie :
Homo quoque si eodem modo haberet ad propulsanda pericula suppetens robus nec ullius alterius auxilio
indigeret, quae societas esset, quae reuerentia inter se, quis ordo, quae ratio, quae humanitas ? Aut
quid esset tetrius homine, quid efferatius, quid inmanius ? 21 Sed quoniam inbecillus est nec per se
potest sine homine uiuere, societatem adpetit, ut uita communis et ornatior fiat et tutior. 22 Vides igitur
omnem hominis rationem in eo uel maxime stare, quod nudus fragilisque nascitur, quod morbis adficitur,
quod inmatura morte multatur. Quae si homini detrahantur, rationem quoque ac sapientiam detrahi
necesse est46
.
De même, si l’homme aussi avait à sa disposition une vigueur suffisante pour repousser les périls, et s’il
n’avait besoin du secours d’aucun de ses semblables, quelle société y aurait-il, quel respect mutuel, quel
ordre, quelle raison, quels sentiments humains ? Ou alors, qu’y aurait-il de plus horrible que
l’homme, de plus sauvage, de plus monstrueux ? 21 Mais puisqu’il est faible et ne peut par lui-même
vivre sans l’homme, il recherche la société pour que la vie commune soit mieux armée et plus sûre. 22
Tu vois donc que toute l’économie de l’homme consiste surtout en ce qu’il naît nu et fragile, qu’il est
affecté de maladies, qu’il est puni d’une mort prématurée. Si l’on enlevait cela à l’homme, on lui
enlèverait nécessairement aussi la raison et la sagesse.
12
Or, si l’on en vient maintenant au livre V des Institutions divines, qui fait directement
référence aux persécutions, il est clair que les persécuteurs représentés prennent place dans la
dialectique lactancienne puisqu’ils sont bien, dans ce livre l’objet du propos, qui donnent
l’illustration saisissante d’hommes sauvages parce que pris dans le refus de leur condition.
Ainsi, et dans le renvoi mutuel des problèmes les uns aux autres, puisque du débat
philosophique on passe aux implications religieuses, aux attitudes, aux actes, où païens et
chrétiens se combattaient, Lactance écrit :
Cum talibus nunc congredi et disputare contendimus, hos ad ueritatem ab inepta persuasione traducere,
qui sanguinem facilius hauserint quam uerba iustorum47
.
Tels sont les gens avec qui nous tentons maintenant une confrontation et une discussion, et que nous
cherchons à arracher à leurs absurdes convictions pour les acheminer vers la vérité : des gens qui boivent
plus facilement le sang que les paroles des justes.
Hoc uero inenarrabile est quod fit aduersus eos qui malefacere nesciunt, et nulli nocentiores habentur
quam qui sunt ex omnibus innocentes. Audent igitur homines improbissimi iustitiae facere mentionem,
qui feras immanitate uincant, qui placidissimum dei gregem uastant, « lupi ceu raptores atra in nebula,
quos improba uentris exegit caecos rabies ». Verum hos non « uentris », sed cordis « rabies » efferauit
nec « atra in nebula », sed aperta praedatione grassantur nec eos umquam conscientia scelerum
reuocat, ne sanctum ac pium nomen iustitiae ore illo uiolent, quod cruore innocentium tamquam rictus
bestiarum madet48
.
Mais il n’y a pas de mot pour décrire les traitements infligés à des gens qui ne savent pas faire le mal, et
nul au monde ne passe pour plus criminel que ceux qui sont innocents de tout crime. Et voilà comment
osent parler de justice les gens les plus malhonnêtes qui soient, plus cruels que les bêtes sauvages, qui ravagent le paisible troupeau de Dieu, « comme des loups ravisseurs dans l’ombre noire, quand
l’insatiable rage de leur ventre les excite en aveugles »49
. 5 Ce n’est pas cependant « la rage de leur
ventre », mais celle de leur cœur qui a fait d’eux des bêtes sauvages ; ce n’est pas « dans l’ombre noir »,
mais au grand jour qu’ils exercent leur brigandage, et jamais la conscience de leurs crimes ne les retient
de violer le saint et vénérable nom de la justice, avec une bouche, qui comme la gueule des fauves,
ruisselle du sang des innocents.
Aussi, et corrélativement, sur le plan des considérations philosophiques, ces persécuteurs
païens sont-ils des hommes, selon le chrétien Lactance, qui ignorent les données vraies de
l’anthropologie, en même temps qu’ils se privent de l’usage de la raison :
Quid aliud dicam quam « miseros » qui praedonum suorum instigationibus parent, quos deos esse
opinantur ? Quorum neque condicionem neque originem neque nomina neque rationem sciunt, sed
inhaerente persuasione uulgari libenter errant et stultitiae suae fauent. 3. A quibus si persuasionis eius
rationem requiras, nullam possint reddere, sed ad maiorum iudicia confugiant, quod illi sapientes fuerint,
illi probauerint, illi scierint quid esset optimum, seque ipsos sensibus spoliant, ratione abdicant, dum
alienis erroribus credunt50
.
Comment appeler autrement que « misérables » ceux qui obéissent aux instigations de leurs ravisseurs,
qu’ils prennent pour des dieux ? Ils ne savent pourtant ni leur condition ni leur origine, ni leurs noms
ni leur raison d’être, mais, sous l’emprise des croyances populaires, prennent plaisir à se tromper et
se complaisent dans leur folie. 3 Si on leur demande la raison de cette croyance, ils ne peuvent en
présenter aucune, mais ils ont recours à l’autorité des ancêtres, en disant que c’étaient des sages, qu’ils
avaient approuvé, qu’ils connaissaient ce qui est le meilleur ; et eux, ils se dépouillent eux-mêmes de
leurs propres idées et renoncent à l’usage de leur raison pour croire aux erreurs des autres.
Enfin, il y a lieu de constater que l’idée de la fragilité du corps envisagée dans sa
dimension sociale est rapportée d’une deuxième manière à la situation concrète des
13
persécutions. Or je soulignerai préalablement que nous avons vu par deux fois déjà et qu’on
aurait pu en rencontrer bien d’autres occurrences, notamment au livre VII, des énoncés où
Lactance oppose le fait que le corps, fragile et terrestre, peut être vu et touché, et inversement
que l’âme, immortelle, non fragile, ne peut l’être51
.
…terrenum est fragile corpus, anima quae fragilis non est52
Corpus autem si ideo mortale est, quia uisui pariter et tactui subiacet, ergo et anima idcirco inmortalis
est, quia nec tangi potest nec uideri53
.
Car si cette caractéristique de l’âme renvoie aussi à la question des limites de la
connaissance humaine posée par Lactance, dans les domaines inaccessibles aux yeux et aux
sens, il se trouve que l’idée que l’on peut toucher et en tout cas voir le corps est exploitée tout
à fait positivement lorsqu’il s’agit de parler du spectacle que donnaient de fait, dans l’arène,
les persécutés.
Ita fit ut, data diuinitus pace, et qui fugerunt uniuersi redeant et alius propter miraculum uirtutis nouus
populus accedat. 11 Nam cum uideat uulgus dilacerari homines uariis tormentorum generibus et inter
fatigatos carnifices inuictam tenere patientiam, existimant, id quod res est, nec consensum tam multorum
nec perseuerantiam morientium uanam esse, nec ipsam patientiam sine deo cruciatus tantos posse
superare. 12 Latrones et robusti corporis uiri eiusmodi lacerationes perferre non queunt, exclamant et
gemitus edunt, uincuntur enim dolore, quia deest illis inspirata patientia : nostri autem, ut de uiris
taceam, pueri et mulierculae tortores suos taciti uincunt et exprimere illis gemitum nec ignis potest…:
Ecce sexus infirmus et fragilis aetas dilacerari se toto corpore urique perpetitur non necessitate, quia
licet uitare si uelint, sed uoluntate, quia confidunt deo54
.
Ainsi, dès que Dieu nous redonne la paix, ceux qui ont fui reviennent tous, et un autre peuple tout
nouveau vient à nous en raison de l’effet extraordinaire que produit la force d’âme. 11 Car lorsque le
peuple voit des gens tourmentés par toutes sortes de supplices conserver, au milieu de leurs bourreaux
épuisés, une endurance indomptée, il estime, et avec raison, que cette attitude commune à tant de gens
et leur persévérance au moment de mourir ne sont pas vaines et que la seule endurance physique, sans
l’aide de Dieu, ne peut dominer pareils tourments. 12 Les brigands et les gens robustes ne peuvent
supporter d’être déchirés de la même façon, ils poussent des cris et des gémissements car ils sont vaincus
par la douleur, parce qu’il leur manque la patience envoyée du ciel : chez nous au contraire, sans parler
des hommes, les enfants et les faibles femmes triomphent sans un mot de gémissement. …14 voici que
des personnes du sexe faible et d’un âge tendre, endurent jusqu’au bout d’être complètement déchirées et
brûlées, et cela non pas sous l’effet de la contrainte car elles peuvent l’éviter si elles le désirent, mais
volontairement, parce qu’elles ont confiance en Dieu.
Il est inutile, je crois, de commenter longuement ce passage. Il suffit de relever d’abord
la remarquable force du syntagme miraculum uirtutis dont le premier terme, apte à dénoter,
pour le chrétien, un phénomène surnaturel ressortissant à la transcendance et la puissance de
Dieu, désigne avant tout, d’après le sens commun de miraculum, un fait saisissant offert à la
vue de tous55
. Il faut relever aussi l’importance des expressions uideat uulgus, existimant id
quod est… qui montrent clairement la mise en valeur par Lactance d’une scène où le tout le
uulgus peut voir le martyr chrétien, par son corps, faire ses preuves, autrement dit faire la
preuve d’une sapientia authentique, et à partir de là en retirer réflexion et même conviction.
14
Or c’est que l’on retrouve encore dans le dernier extrait qui va suivre, avec l’accent
davantage mis sur la réflexion et le travail d’intelligence des spectateurs, tels qu’ils sont
provoqués par ce qui se manifeste comme l’évidence de la sapientia chrétienne, dès lors que
celle-ci est prouvée en acte, à travers l’épreuve du corps :
Deinde placet quibusdam uirtus ac fides ipsa. Nonnulli suspicantur deorum cultum non sine causa
malum putari a tam multis hominibus, ut emori malint quam id facere quod alii faciunt ut uiuant. Aliquis
cupit scire quodnam sit illum bonum quod ad mortem usque defenditur, quod omnibus quae in hac uita
iuncunda sunt et cara praefertur, a quo nec bonorum nec lucis amissio nec dolor corporis nec uiscerum
cruciamenta deterrent. Valent haec plurimum, sed illae maxime causae nostrorum numerum semper
auxerunt : audit circumstans populus inter ipsa tormenta dicentes non sacrificare se lapidibus humana
manu facti, sed deo uiuo qui sit in caelo. Multi hoc uerum esse intellegunt et in pectus admittunt. 22
Deinde, ut fieri solet in rebus incertis, dum inter se inuicem quaerunt quae sit huius perseuerantiae
causa, multa quae ad religionem pertinent diuulgata ac per rumorem uicissim aucupata discuntur :
quae quia bona sunt, placeant necesse est56
.
Ensuite, certains sont séduits simplement par notre courage et notre confiance. Quelques-uns
soupçonnent que ce n’est pas sans raison que le culte des dieux est mauvais aux yeux de tant
d’hommes, au point qu’ils aiment mieux mourir que de faire ce que font les autres pour avoir la vie sauve.
Un autre désire savoir en quoi consiste au juste ce bien que l’on défend jusqu’à la mort, que l’on préfère
à tout ce qui est agréable et cher dans cette vie, et dont ne peuvent détourner ni la perte des biens ni celle
de la vie, ni la torture du corps, ni les entrailles que l’on déchire. Toutes ces raisons ont une très grande
valeur, mais voici essentiellement pourquoi notre nombre augmente sans cesse : le peuple qui se trouve là
les entend dire, au milieu même des tourments, qu’ils ne sacrifient pas à des pierres taillées de main
d’hommes, mais au Dieu vivant qui est dans le ciel. Beaucoup comprennent que cela est vrai et
l’admettent au fond de leur cœur. Ensuite, comme cela se produit d’ordinaire quand on hésite, tout en
recherchant entre eux la cause de cette persévérance, ils apprennent bien des choses qui touchent à
la religion, qu’elles soit répandues dans le peuple ou qu’ils en guettent ça et là les échos : et comme ces
choses-là sont bonnes, elles leur plaisent nécessairement.
Ainsi, l’anthropologie lactancienne n’est pas seulement porteuse de sens, selon le plan
providentiel de Dieu, mais révélatrice de sens, selon une logique que l’auteur s’est employé à
construire. Le corps lui-même se fait « témoin »57
dans la mesure où sa fragilité mise à
l’épreuve jusqu’à l’expérience de la mort est contenue dans un savoir, un savoir en quelque
sorte sur le bonheur, qui l’assiste, enseigné par le Christ, et qui représente la foi chrétienne en
Dieu et en l’immortalité.
*
Comme il apparaît donc, docti comme indocti instruits par le Christ doctor ont foi en
l’immortalité. Aussi, la démarche philosophique de Lactance, conçue comme un
raisonnement dialectique allant du livre I jusqu’au livre VII de ses Institutions divines, qui
s’ouvre sur la croyance en l’immortalité chrétienne, peut-elle s’appuyer sur les faits pour se
prouver elle-même. C’est cette tautologie entre conduite et système théorique que Lactance
semble avoir voulu, précisément, mettre en œuvre et en évidence58
. La patientia stoïcienne
était une notion prégnante pour Lactance, comme elle l’avait été pour Tertullien. Mais si,
comme le souligne M. Spanneut, « chez tous ces auteurs, contemporains de la persécution, il y
a une sorte de confusion entre patience et martyre : le martyre est la perfection de la patience
15
ou la perfection par la patience », on a constaté que Lactance plus que tout autre a focalisé sa
réflexion sur la notion sur la situation concrète des persécutions qui lui était contemporaine.
Ainsi, Lactance a fait en sorte de se démarquer de la philosophie stoïcienne dans la mesure où
elle se présente pour lui comme une théorie manquant de la garantie absolue de la pratique, à
la différence de sa « science » chrétienne, et qu’il la considère de ce fait, et par définition,
comme non valide. Cela de manière d’autant plus percutante que les stoïciens entendaient
eux-mêmes, souligne-t-il après avoir dénoncé l’élitisme cicéronien, que la philosophie fût
exercée par tous59
.
Sur un plan dialectique, l’enjeu était précis. Rappelons-nous d’abord que Lactance n’a
pas mêlé le thème de l’imitatio Christi -qu’il avait juste effleuré au livre IV où était évoquée
la passio du Christ- à celui de la patientia traité au livre V, comme l’avaient fait Tertullien et
Cyprien60
, de sorte qu’il est raisonnable de penser qu’il a souhaité traiter de manière
intentionnellement autonome de la patientia en tant que « signifiant » stoïcien. Cela,
précisément, pour la soustraire à l’erreur du stoïcisme. Ainsi, Lactance préfère mettre en
lumière un critère épistémologique selon lequel le vrai philosophique chrétien peut être
opposé à la représentation de la patientia stoïcienne, et l’on sait maintenant que pour ce faire
le discours lactancien s’est effectivement servi de l’exemplum de la patientia des martyrs
comme preuve de son propre discours. Loin de relever d’une simple facilité rhétorique, cette
démarche touchait à l’épistémologie même, en mettant en jeu la problématique conjonction
entre rhétorique et philosophie posée par Cicéron et poursuivie après lui, dans la philosophie
romaine, par le stoïcisme61
. Alors que cette dernière philosophie avait conçu une « rhétorique
du vrai » dans laquelle étaient privilégiées les figures de l’évidence que sont notamment la
prosopopée, l’allégorie ou l’hypotypose62
, on voit tout différemment, en effet, Lactance
mettre en présence la vertu de patientia par l’évocation même des scènes de persécution
sévissant en son temps. De fait, il intègre dans le discours apologétique un récit dont le
référent est un réel effectivement constatable par tous. Certes, la philosophie païenne avait
tenté à sa manière de soutenir l’évidence du discours par l’évidence du fait, le verbum par la
res, en recourant à l’exemplum de héros comme Régulus, Tubéron, ou le stoïcien Caton
surtout63
. Mais il s’agissait alors de personnages isolés, isolés dans leur héroïsme romain et
républicain, et dans leur héroïsme tout court, car si tant est que cet héroïsme eût représenté
entièrement la sagesse et prouvé que celle-ci était effectivement réalisable64
, il les cantonnait
en quelque sorte hors de l’universalité commune du uulgus65
.
Corrélativement à cela, enfin, et avec plus de conséquence pour la conscience qu’il avait
de l’histoire en son temps, Lactance pensait qu’une telle unanimité philosophique entre
16
indocti et docti permettait d’asseoir, précisément, sur de nouvelles bases l’universalité de la
religion chrétienne à Rome, au sens socio-politique du terme66
. Ainsi, la nouveauté de
l’époque de Lactance transparaît dans son épistémologie : sa pensée est inscrite dans l’espace
de Rome, « quae adhuc omnia sustentat »67
, comme elle est inscrite par ailleurs dans le temps
de l’eschatologie. Dans la vision millénariste de l’apologiste, exposée au livre VII à la suite
du développement sur l’immortalité de l’âme, celui-ci prévoit la fin des temps dans un délai
de deux cents ans, avec la destruction de l’Empire romain. Mais Lactance n’espérait-il pas,
précisément, que dès maintenant, du fait de « l’autorisation politique » du christianisme,
l’Empire lui-même, ouvert à la conversion, allait pouvoir préparer au regnum sanctum 68
?
***
Je ne saurai conclure cette étude sans me référer à cette réflexion d’Aline Rousselle qui
dit à sa manière ce que j’ai souhaité dégager : « Le paradoxe sera donc l’affirmation que le
succès des cultes à mystères et du christianisme repose sur un besoin intellectuel et non,
comme on l’a répété, sur une démission de l’intelligence »69
. En effet, Lactance est un auteur
qui illustre parfaitement cette expérience. Mais il le fait d’une manière qui nous montre que
celle-ci, en ce qui concerne le développement propre du christianisme, s’est affirmée aussi en
fonction d’un contexte social, politique et religieux, autrement dit historique particulier. Il est
question avant tout, pour son auteur, de faire valoir la force acquise de sa pensée elle-même,
sa légitimité en son temps70
. A notre sens, nous l’avons dit, cette conquête épistémologique
n’était concevable qu’en relation avec le fait que la question de la légitimation du
christianisme par le pouvoir politique était elle-même posée en ce début du IVe siècle. Ainsi,
par exemple, il est notable que la réalité des lapsi ne donne lieu à aucun développement
propre au livre V des Institutions divines où Lactance traite de la patientia et des
persécutions71
. Ce problème doctrinal et disciplinaire interne à l’Eglise ne retient aucunement
son attention. C’est qu’il s’agissait fondamentalement pour lui, à l’adresse de la société
romaine tout entière, de concevoir et proposer une leçon religieuse nouvelle. En véritable
auctor, Lactance s’autorisait à présent à reconnaître sa pensée de chrétien et à la faire
reconnaître comme vraie philosophie, sans restriction. Et cela regardait aussi la religion, au
sens où il concevait que l’inscription du Royaume dans l’espace terrestre universel, par la
pratique du culte chrétien, pût, selon une conception politico-religieuse propre à son époque,
prendre la place de l’empire païen de Rome.
18
Résumé : Du De opificio dei aux Diuinae Institutiones, Lactance change de perspective : dans
son apologie, il aborde directement la question des persécutions. D’un livre à l’autre des sept
livres qui la composent, il change aussi de problématique : si le couple dichotomique corps-
âme est au coeur du développement eschatologique du livre VII, avec la question de la
patientia dans le martyre, au livre V, et son arrière-plan stoïcien, c’est en tant que philosophie
mais avec la supériorité qu’elle « fait ses preuves » et peut donc universellement convaincre
que le christianisme est revendiqué. C’est la dimension sociale et politico-religieuse du
christianisme, comme religio dans l’Empire, qui est alors pensée.
Mots-clés : persécutions, patientia, condition humaine, philosophie chrétienne, docti et
indocti, religio licita.
19
Bibliographie :
J. Alexandre, 2001, Une chair pour la gloire. L’anthropologie réaliste et mystique de
Tertullien, Paris.
Becker C., (1968), art; “Fides”, dans RLAC, 7, 800-839.
A. Blaise, 19672, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, Turnhout.
P.-Th. Camelot, 1979, « Martyr, Martyre » dans G. Mathon, G.-H. Baudry, P. Guilluy (édd.),
Catholicisme, Hier, aujourd’hui, demain, Paris, pp. 770-776.
J.-M. Carrié et A. Rousselle, 1999, L’Empire romain en mutation, des Sévères à Constantin
192-337, Paris.
B. Colot, 2001(a), « Pietas, argument et expression d’un nouveau lien socio-religieux dans le
christianisme romain de Lactance », Studia Patristica, vol. XXXIV, Louvain, p. 23-32.
B. Colot, 2001(b), « Considérations sur la forme et le sens des mots de la langue latine chez
Lactance », De lingua latina.Nouae Quaestiones, Actes du Xè Colloque International de
Linguistique Latine Paris-Sèvres, 19-23 avril 1999, C. Moussy et alii (éd.), Louvain-Paris-
Sterling-Virginia, p. 699-709.
B. Colot, 2006 (à paraître), « Les prophètes et le Christ messager(s) dans les Institutions
divines de Lactance (250-325) : faire lire et entendre la Révélation aux païens », Travaux du
C.E.R.I.E.C., Presses Universitaires de Rennes.
Cyprien, De bono patientiae, éd. J. Molager, 1982, Lyon, SC (291).
A. L. Fisher, 1983, « Lactanctius’ideas relating christian truth and christian society », JHI, 43,
pp. 355-377.
J. Dross, 2004, La représentation de la philosophie à Rome, de Cicéron à Marc-Aurèle,
Thèse, Université Paris IV-Sorbonne, dir. C. Lévy.
J.-C. Fredouille, 1972, Tertullien et la conversion de la culture antique, Paris.
G. Freyburger G., 1986, Fides. Etude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu'à
l'époque augustéenne, Paris.
P. Hadot, 1995 [2006], Qu’est ce que la philosophie antique ?, Paris.
A. M. Ioppolo, 1986, Opinione e scienza : il dibattito tra stoici e Accademici nel III e nel II a.
c., Naples.
H. J. Kunick, 1955, Der lateinische Begriff patientia bei Laktanz, (mémoire dactylographié),
Fribourg-en-Brisgau.
R. Lane Fox, 1997, Païens et chrétiens. La religion et la vie religieuse dans l’empire romain
de la mort de Commode au concile de Nicée, trad. frse, Toulouse, (Pagans and Christians,
1986)
C. Lévy, 1992, Cicero academicus. Recherches sur les Académiques et sur la philosophie
cicéronienne, Rome.
V. Loi,1970, Lattanzio nella storia del linguaggio e del pensiero teologico preniceo, Zurich.
P. Monat (éd., trad.), 1973 ; 1986 ; 1987 ; 1992, Lactance, Institutions divines, livre V, t. I ;
livre I ; livre II ; livre IV, SC, Paris.
P. Monat (commentaire), 1973, Institutions divines, livre V, t. II, SC, Paris.
M. Perrin (éd.), 1974, Lactance, L’ouvrage du dieu créateur, t. I, SC, Paris.
M. Perrin (commentaire), 1974, t. II, Lactance, L’ouvrage du dieu créateur, SC, Paris.
M. Perrin, 1981, L'homme antique et chrétien. L'anthropologie de Lactance (250-325), Paris.
M. Perrin, 1993, « L’image du stoïcien et du stoïcisme chez Lactance », Valeurs dans le
stoïcisme. Du Portique à nos jours, Textes réunis en hommage à M. Spanneut, M. Laëtard
(éd.), Lille, p. 113-129.
M. J.-L. Perrin, 2001, « Lactance, de opificio Dei (303-304) : le savoir médical au début du
IVe siècle », dans Imaginaire et modes de construction du savoir antique dans les textes
scientifiques et techniques, édd. M. Courrént et J. Thomas, Perpignan, p. 71-86.
20
M. J.-L. Perrin, 2005, « Médecine, maladie et théologie chez Lactance », dans Les Pères de
l’Eglise face à la science médicale de leur temps , dir. V. Boudon-Millot et B. Pouderon,
Paris, p. 335-350.
M. Spanneut, 1990, « Patience et martyre chez les Pères de l’Eglise », dans Pléroma. Salus
carnis. Homenaje a Antonio Orbe, éd. E. Romero-Pose, St Jacques de Compostelle, p. 545-
560.
Tertullien, 1984 [1999], De patientia, éd., trad., comm. J.-C. Fredouille, Lyon, SC (310).
A. Wlosok, 1993, « Lactance », dans R. Herzog (éd), Nouvelle histoire de la littérature latine,
t. 5 Restauration et renouveau 284-374, Turnhout, §570, pp. 426-459.
21
1 Pour une forme de bilan sur ces savoirs, voir Perrin, 2001 et 2005.
2 Sur l’emploi dominant du couple lexical corpus/anima chez Lactance, plutôt que caro/spiritus que l’on trouve
plus volontiers chez Tertullien (très présent toutefois en Inst., IV, 25, s’agissant du Christ), voir Perrin, 1981,
Première partie, chapitre 1. 3 Pendant les persécutions, on pense généralement à présent que Lactance resta dans la région de Nicomédie, et
non plus qu’il s’enfuit en Gaule : voir Wlosok, 1993, p. 430. Sur le fait d’envisager la fuite devant les
persécutions, voir ci-dessous note 66. 4 Selon Wlosok, 1993, p. 429, le De opificio dei a été composé en 303 ou 304, au moment où les persécutions ont
été déclenchées, les Institutions divines entre 304 et 311, date de l’Edit de Galère (à moins que, selon Perrin
2005, p. 335, l’on retienne comme terminus post quem l’année 313). 5 Voir la note de Perrin sur ce thème dans le De opificio dei, 1974, t. II, p. 248.
6 Voir Blaise, 19672, s.u. ainsi que Tertullien, De patientia, XV, 2 et Cyprien, De bono patientiae, 20.
7 Voir Camelot, 1979, p. 771. Pour une réflexion d’ensemble sur le martyre et la patience, voir Spanneut, 1990.
8 Id., p. 772.
9 Voir Cyprien, 1982 et Tertullien, 1984 (extrait ici de l’Introduction p. 29) et, plus généralement, sur Tertullien
et en comparaison avec Cyprien, Fredouille, 1972, p. 363-410. 10
Voir Fredouille, 1972, p. 363-410. 11
Le développement que Lactance consacre à la patientia occupe le chapitre 22 du livre V. Après un propos
général sur l’importance reconnue par tous à cette vertu, sa fonction dans la mise à l’épreuve que Dieu demande
à l’homme, Lactance traite de la patientia dans le contexte spécifique des persécutions aux § 17 à 21, en clôture
pour ainsi dire du livre V. Sur la différence qui sépare Lactance de son prédécesseur Tertullien, dont Cyprien
sera proche au contraire, voir Introduction au De patientia de J.-C. Fredouille, 1984, p. 35, qui signale par
ailleurs, p. 28, le mémoire de H. J. Kunick, 1955. 12
Spanneut, 1990, p. 548. 13
Cf. livre IV, passim, sur l’exercice de patience du Christ, encore que Lactance emploie pour en traiter du terme
de passio ; cf. livre V, 22 sur la primauté de la vertu de patientia dans la pratique chrétienne de la vie, comme
une constante mise à l’épreuve offerte par Dieu contre la récompense de l’immortalité ; cf. livre VI, 18 pour la
disciplina patientiae, autrement dit l’exercice pratique de cette patientia. 14
De ce fait, le thème de l’imitatio Christi se trouve lui-même éludé. Précisons par ailleurs que les citations
scripturaires que Lactance introduit néanmoins au livre IV ne sont jamais extraites du Nouveau Testament. 15
Inst., V, 22, 2 : Nempe magna et praecipua uirtus est patientia, quam pariter et uulgi publicae uoces et
philosophi et oratores summis laudibus celebrant. Cf. Tert., Pat., I, 7 : Bonum eius (= patientiae) etiam qui
caeca uiuunt summae uirtutis appellatione honorant. 16
Voir Inst., V, 1-9. 17
Voir Inst., IV, 23, 4, où sont désignées les passions condamnées par les Stoïciens, dont la peur de la douleur, à
quoi succède Inst., IV, 23, 9 où il est dit qu’aucun sage accompli (perfectus sapiens) n’a pu se rencontrer hors
du christianisme (voir ci-dessous note 38). Or cela renchérit en quelque sorte sur la question qui avait été posée
par Cicéron, alors en débat sur les principes de la philosophie stoïcienne, dans Tusc., II, 33 : Non ego dolorem
dolorem esse nego (cur enim fortitudo desideratur ?), sed eum opprimi dico patientia, si modo est aliqua
patientia ; si nulla est, quid exornamus philosophiam aut quid eius nomine gloriosi sumus ? lequel s’était aussi
demandé, au début du livre (Tusc., II, 11) : Quotus enim quisque philosophorum inuenitur, qui sit ita moratus,
ita animo ac uita constitutus, ut ratio postulat ? qui disciplinam suam non ostentationem scientiae, sed legem
uitae putet ? qui obtemperet ipse sibi et decretis suis pareat ? 18
M. Perrin, 1981, p. 341, souligne en effet que si l’immortalité de l’âme est un acquis dans le De opificio dei, la
question donne lieu à quatre étapes de réflexion dans les Institutions divines, qui se rapportent à l’automotricité
de l’âme, à l’erreur des épicuriens à ce sujet, au consensus omnium contre les épicuriens, à la perspective
eschatologique du livre VII. 19
Titre du livre IV, comme cela est rappelé plus bas dans notre développement. 20
Inst., III, 12, 19. (Sauf indication spéciale, nous reprenons la traduction de P. Monat aux SC) 21
Cela est sans doute à rapprocher de ce que Lactance dit par ailleurs, en Inst., I, 8, 1, où il cite le Timée, sur
l’impossibilité de connaître Dieu (cf. note de Monat, 1986, ad loc., à propos de cette citation). Sur le scepticisme
qu’avait exprimé pour sa part Cicéron quant à la possibilité d’avoir des certitudes sur la nature de l’âme, voir
Tusc., I, 18-23 et commentaire, C. Lévy, 1992, p. 457-459. 22
Opif., 17, 1. 5. (Nous reprenons la traduction de M. Perrin aux SC) 23
Opif., I, 15 : …uideas tanta temeritate homines extitisse…ut ea quae abstrusa prorsus atque abdita deus esse
uoluit, scrutarentur ac naturam rerum caelestium terrenarumue conquirerent, quae a nobis longe remotae neque
oculis contrectari neque tangi manu neque percipi sensibus possunt. 24
Inst., III, 5, 4.
22
25
Voir l’extrait Inst., I, 1, 19 note 27. 26
Inst., III, 25, 1. 27
Inst., I, 1, 19. 28
Inst., VII, 6, 1. (C’est nous qui traduisons) 29
Voir Colot, 2001 (a). 30
Voir ci-dessous Inst., V, 13, 14, note 54, avec l’expression confidunt deo qui clôt la phrase. 31
Inst., V, 13, 1. 32
Sur l’expansion du christianisme, sa réalité et sa représentation, voir Lane Fox, 1997, p. 282-288. 33
Inst., V, 13,5. 34
On peut aussi se référer à des passages du De opificio dei qui explicitent le fait que la domination sur le corps
se fait grâce à l’animus, ou à la mens diuina. Mais Lactance se limite ailleurs à évoquer simplement
l’intervention de Dieu dans une épreuve telle que celle du martyre (voir ci-dessous note 54). Dans les limites de
cette étude, je me contenterai de souligner sur ce point qu’on peut mesurer une différence importante entre
Lactance et Tertullien dans le fait que ce dernier a fortement développé, dans sa théologie du martyre, le rôle du
Saint Esprit (Lactance ne distingue guère, pour sa part, l’Esprit du Fils de Dieu) : voir Alexandre, 2001, p. 465-
486. 35
Voir Inst., IV, 16, 4 : …quoniam ipse uirtus et ipse iustitia est, descendit ut eam doceret hominemque
formaret, quo magisterio ac Dei legatione perfunctus, ob eam ipsam uirtutem, quam simul et docuit et fecit, ab
omnibus gentibus et meruit et potuit Deus credi. Sur la dénomination de magister ou de doctor rapportée au
Christ, voir not. V. Loi, 1970, p. 252-264 ; Colot, 2001 (b), p. 703-704. 36
Voir ci-dessus note 13. C’est par souci d’efficacité auprès des païens que Lactance explique ne pas vouloir
recourir au témoignage des Ecritures, mais plutôt à celui des philosophes (voir Inst., I, 5, 1-2 ; Inst., V, 4, 4). Sur
la singularité du livre IV qui en ressort, consacré à la christologie et le seul à compter des citations bibliques,
voir Colot, 2006. 37
Inst., IV, 24, 17 : Vides ergo quanto perfectior sit mortalis doctor, quia dux esse mortali potest, quam
immortalis, quia patientiam docere non potest qui subiectus passionibus non est. 38
Inst., IV, 23, 8-10. 39
Inst., IV, 22, 5. 40
Inst., IV, 24, 17 (voir ci-dessus note 37) & 19. 41
Opif., 4, 6-7. 42
Opif., 4, 2. 43
Opif., 4, 16-18. 44
Inst,,IV, 23, 1-2. 45
Voir note 26. 46 Opif., 4, 20-22. 47 Inst., V, 1, 8. 48 Inst., V, 9, 4. 49
Virg, En., 355-357. 50 Inst., V, 19, 2-3. 51
Cf. note 21 et 41, par exemple. 52
Inst., VII, 12, 8. 53
Inst., VII, 11, 10. 54
Inst., V, 13, 10-12 &14. Traduction Monat modifiée sur un point : voir note suivante. 55
Sur ce terme, que nous avons choisi de traduire autrement, voir le commentaire de Monat, 1973, t. II, ad loc. 56
Inst., V, 22, 19-22. Traduction Monat modifiée sur le terme fides de la première phrase. Hautement
polysémique, nous nous sommes appuyée sur son rapprochement avec le confidunt de Inst., V, 13, 14 (note 54),
pour choisir la traduction par confiance (et non « fidélité » comme Monat, ni « foi », certes tentant, mais trop
univoque dans son sens chrétien.) 57
Tel est le sens premier du mot « martyr ». 58
Remarquer le parallèle que l’on peut établir avec Inst., I, 5, 2 : Ex his (= poetae et philosophi) unum Deum
probemus necesse est, non quod illi habuerint cognitam ueritatem, sed quod ueritatis ipsius tanta uis est, ut
nemo possit esse tam caecus, quin uideat ingerentem se oculis diuinam claritatem. 59
Voir Inst., III, 25, 5&7 (qui fait suite de quelques lignes au passage cité note 24) : Quodsi natura hominis
sapientiae capax est, oportuit et opifices et rusticos et mulieres et omnes denique qui humanam formam gerunt
doceri, ut sapiant, populumque sapiientium ex omni lingua et condicione et sexu et aetate conflari. […]
Senserunt hoc adeo Stoici, qui et seruis et mulieribus philosophandum esse dixerunt [...]. Ce que souligne Perrin,
1993, p. 120. Il convient de signaler qu’Epicure et Platon sont eux aussi évoqués à la suite des Stoïciens par
opposition à la position cicéronienne. Mais il faudrait dans les deux cas ouvrir la réflexion selon une autre
problématique que celle en jeu ici. En ce qui concerne les premiers, leurs positions philosophiques étant au
23
départ erronées pour Lactance, leur attitude à l’égard des hommes compris dans leur ensemble lui importe
finalement peu. En ce qui concerne le second, on peut dire que c’est en fait Augustin qui portera son intérêt, dans
le De uera religione, à montrer l’avantage du christianisme par rapport au platonisme sur la question de la
conversion des masses : voir Hadot, 1995, p. 376-77. 60
Voir ci-dessus note 14. 61
Voir J. Dross, 2004. Je remercie Juliette Dross de m’avoir permis de prendre connaissance de son travail,
encore inaccessible par microfiches. 62
Ibid., IIème partie, chapitre I. 63
Ibid., IIème partie, chapitre II. 64
Voir Ioppolo, 1986, p. 78. Et cf. ci-dessus, p. 5, notre remarque sur la dichotomie établie par les stoïciens
entre sapientes et stulti. 65
Voir en écho la comparaison faite plus haut (note 15) entre Lactance et Tertullien ; mais la référence au uulgus
à côté des philosophi et des oratores faite uniquement par Lactance ajoutait une idée qui prend tout son relief à
présent. 66
Mieux que les philosophes païens, et stoïciens en l’occurrence, Lactance a pensé sans doute que sa religion
unifiait religion civique, religion des philosophes et religion des poètes, selon la division tripartite de Varron. 67
Inst., VII, 25, 8. 68
Sur la relation qu’entretiennent par ailleurs les livres V et VII à travers le motif de l’Age d’or, traité d’un point
de vue historique puis eschatologique, voir Fisher, 1983. 69
Carrié et Rousselle, 1999, p. 435. 70
Lactance utilise fréquemment la rétorsion d’arguments mais l’on voit que la dialectique qui est au cœur de sa
rhétorique intervient à un niveau beaucoup plus fondamental. 71
Simple allusion en Inst., IV, 18, 2, où la fuite des persécutions est vue comme imitation de Jésus se mettant à
l’écart avec ses disciples avant la trahison de Judas : …secessit tamen cum discipulis suis, non ut uitaret quod
necesse erat perpeti ac sustinere, sed ut ostenderet quod ita fieri oporteat in omni persecutione, ne sua quis
culpa incidisse uideatur ; ac denuntiauit fore ut ab uno eorum proderetur.





























![Vermand/ Saint-Quentin [topographie chrétienne]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631846cf831644824d03d38d/vermand-saint-quentin-topographie-chretienne.jpg)