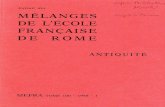La naissance de la monnaie de bronze en Grande Grèce et en Sicile
Sociologie de la ville (2014) - Cours n°1 - De l'Ecole de Chicago à l'Ecole de Los Angeles - I....
Transcript of Sociologie de la ville (2014) - Cours n°1 - De l'Ecole de Chicago à l'Ecole de Los Angeles - I....
Aspects pratiques - Tous les mercredis de 10h45 à 12h45 - Pas de syllabus: slides et lectures. - iCampus: LSOC2090 – clé: chicago Participation au cours - Lectures et vidéos en vue de préparer les cours - Exercices Evaluation - Travail de terrain: « description dense » d’un milieu urbain - Examen oral
Plan du cours 1. Introduction à la sociologie urbaine 2. Les échelles de l’urbain 3. Les régimes de l’urbain 4. Les expériences de l’urbain
Plan du cours 1. Introduction à la sociologie urbaine 2. Les échelles de l’urbain
2.1. Quartiers 2.2. Métropoles 2.3. Mégapoles et villes globales
3. Les régimes de l’urbain 4. Les expériences de l’urbain
Plan du cours 1. Introduction à la sociologie urbaine 2. Les échelles de l’urbain 3. Les régimes de l’urbain
3.1. Périurbanisation 3.2. Relégation 3.3. Gentrification 3.4. Sécession
4. Les expériences de l’urbain
Plan du cours 1. Introduction à la sociologie urbaine 2. Les échelles de l’urbain 3. Les régimes de l’urbain 4. Les expériences de l’urbain
4.1. Habiter : l’espace familier et l’espace commun 4.2. Côtoyer : interaction avec des étrangers, exposition de soi 4.3. Endurer : l’expérience négative de l’urbain 4.4. Se mobiliser : participation et démocratie urbaine
1. Sociologie et ville
La naissance de la sociologie au XIXème s. est directement liée à l’urbanisation (immigration, hétérogénéité socio-ethnique, criminalité, sans-abrisme). La majeure partie de la sociologie est « urbaine » dans la mesure où la famille, l’école, l’habitat, le travail… sont des champs s’étudient dans la ville. Sociologie de la ville: n’étudie pas seulement les rapports sociaux qui se déroulent dans la ville, mais qui se trouvent modelés par la ville, sa morphologie, son organisation. En France, la ville n’apparaît comme « champ en soi » que tardivement. Aux USA, ce champ a émergé en même temps que la discipline sociologique elle-même.
2. Le Chicago des années 1920
Simple bourgade en 1830, Chicago compte 1M d’habitants en 1890 et plus de 3M en 1920. 1920: Plus grand nœud de voies ferrées, plus grand centre industriel et économique des USA Flux migratoires abondants et diversifiés: - Centaine de milliers de migrants venus d’Europe - Noirs fuyant le Sud : 44.000 en 1910, 234.000 en 1930. Une urbanisation effrenée sur fond de déracinements, d’extrême hétérogénéité, et de tensions raciales Devient le symbole de la délinquance et de la criminalité Le « laboratoire social » par excellence! (R. Park)
- William Thomas - Robert E. Park - Ernest W. Burgess - Everett Hughes - Louis Wirth
3. Le Département de sociologie
- William Thomas - Robert E. Park - Ernest W. Burgess - Everett Hughes - Louis Wirth
3. Le Département de sociologie
- William Thomas - Robert E. Park - Ernest W. Burgess - Everett Hughes - Louis Wirth
3. Le Département de sociologie
- William Thomas - Robert E. Park - Ernest W. Burgess - Everett Hughes - Louis Wirth
3. Le Département de sociologie
- William Thomas - Robert E. Park - Ernest W. Burgess - Everett Hughes - Louis Wirth
3. Le Département de sociologie
3. Le Département de sociologie
Nombreuses études entre 1920 et 1940, sous l’impulsion de W.I. Thomas, puis de R. Park. Thème central: les « petits mondes sociaux » Les relations de voisinage, de quartier (McKenzie) La ségrégation spatiale des minorités (Burgess) La vie au sein d’enclaves, de ghettos (Wirth, W.F. Whyte) Les marginaux, les SDF (Anderson) Les milieux de la délinquance, de la criminalité et du vice (Thrasher) Le travail, les métiers (Hughes) La presse (Park) Les moblités quotidiennes Les trajectoires de migrants (Thomas/Znaniecki)
Fin des années 1930, l’Ecole de l’écologie urbaine avait cessé d’exister. Une « deuxième Ecole de Chicago allait voir le jour autour de la perspective interactionniste.
Ces sociologues travaillent chacun sur des thèmes sensiblement différents, mais ils se trouvent unis par: - un « laboratoire » commun : Chicago - un même souci pour le fieldwork - une problématique commune : l’écologie urbaine The City (1925) édité par Park et Burgess, constitue l’ouvrage fondateur de la sociologie urbaine
3. Le Département de sociologie
4. L’invention du fieldwork
Pour les sociologues de Chicago, l’apport de la recherche à la résolution des problèmes sociaux passe par l’observation rigoureuse des faits et la production de savoirs établis selon des règles explicites.
Pour autant, ils ne ne posent aucune rupture épistémologique entre enquête sociologique et d’autres modalités d’enquête, comme le journalisme par exemple. Pour Park, « la science est simplement un peu plus persistante dans sa curiosité, un peu plus exigeante et exacte dans ses observations que le sens commun. »
Thomas et Znaniecki sont les premiers à développer un travail de terrain suivant ces prescrits méthodologiques, dans une enquête qui encore aujourd‘hui impressionne par son ampleur et sa rigueur. 15.000 lettres échangées par des migrants polonais, afin d’étudier leurs trajectoires et le sens qu’ils leur accordent. C’est Hugues qui a formalisé les règles méthodologiques de l’enquête « made in Chicago » dans des enseignements particulièrement exigeants. Ce fieldwork maniaque, obsessionnel a un but précis: dégager le tendanciel du singulier.
4. L’invention du fieldwork
R. Park et ses collègues (Burgess, McKenzie) fondent une perspective commune: l’écologie urbaine. Une épistémologie nouvelle des sciences sociales où il s’agit d’étudier l’ensemble des relations entre les citadins dans leur « milieu de vie ». Les rapports sociaux ont une dimension spatiale et biotique.
5. L’écologie urbaine
Une perspective influencée par une science naissante, l’écologie végétale (Heckel, 1878) et animale (Wheeler, 1900), La ville est approchée comme « le milieu naturel de l’homme moderne ». Influencée également par l’évolutionnisme (Darwin, Spencer): cadre de référence pour penser des relations de compétition, de dominance, de crise, d’invasion-succession, de symbiose.
5. L’écologie urbaine
Symbiose
Sun-Biosis: Vie avec, vie ensemble. Dans un biotope, les plantes, les animaux, les humaines sont liés par une « toile de vie » (web of life). Leurs destinées sont interdépendantes; ils forment une communauté symbiotique. Ex: Le trèfle rouge et les vieilles filles Les niches écologiques, les biotopes sont eux-mêmes connectés et interdépendants. Ils forment ensemble un super-organisme Park essaie d’appliquer cela à la vie en ville à travers ce qu’il appelle une « écologie humaine » biotopes).
6. Quelques concepts
Coopération compétitive
La vie en ville marquée par la lutte pour l'existence et la survie des plus aptes : - régulation statistique - distribution territoriale des groupes ethniques Interdépendance mutuelle, destins liés: la compétition des membres d’une communauté symbiotique passe par des formes de coopération : - spécialisation fonctionnelle des différents groupes - accommodement entre groupes
6. Quelques concepts
6. Quelques concepts
Croissance – Complexité - Différenciation Condensation de la vie sociale Complexification de la vie sociale Différenciation de la vie sociale La ville : - « établissement relativement important, dense et
permanent d’individus socialement hétérogènes » (Wirth).
- « a mosaic of little worlds that touch but do not interpenetrate » (Park)
6. Quelques concepts
Différenciation Chicago: mosaïque de groupes sociaux et de communautés ethniques inscrits dans des secteurs ou quartiers très typés, voire cloisonnés. Ces quartiers sont pour Park à la fois aires naturelles (résultats du regroupement, de la concurrence) et régions morales (chacune exprime et renforce les manières d’être et de vivre qu’elle valorise). Chacune a son intérêt, ses inconvénients et avantages propres (Park dénonce l’ « indice de bien-être »). La figure de l’étranger cosmopolite sert d’analyseur (Simmel).
e) Dominance, Centralité
• En créant de la densité, la ville crée de l’interdépendance. Tenus de fonctionner ensemble, ses acteurs, espaces, équipements, institutions produisent de la centralité.
- Centralité du marché qui permet et régule les échanges économiques
- Centralité du pouvoir qui contrôle et institue des règles de coexistence
- Centralité des dispositifs qui organisent la division du travail - Centralité des lieux de culte, de culture, de loisirs. - Centralité des différents services offerts par la ville
• L’espace central fait valoir sa « dominance » sur le reste de la ville qui se développe par rapport à lui: modèle de représentation concentrique de la ville de Burgess.
Equilibre – Crise – Succession
La communauté symbiotique tend vers l’équilibre, reconstitue constamment les conditions d’un équilibre Cette équilibre symbiotique du milieu est régulièrement « mis en crise » Cet équilibre est bousculé par des petits ou grands events: - Famine - Epidémie - Invasion
La crise est un phénomène constant, banal Valorisation de la nécessité de l’ordre et de la nécessité du changement
Trajectoires
Etudier des individus, des populations, des réseaux de manière dynamique, longitudinale, à travers leurs trajectoires ou, comme le fera Becker, à travers leurs « carrières » La capacité des êtres sociaux à redéfinir au cours de leur existence le sens des situations auxquelles ils sont confrontés et les enjeux qui leur importent (position dans le cycle de vie, ruptures dans les appartenances, changement d’espaces de vie…) Thomas & Znaniecki: Deux immigrés peuvent vivre dans une situation objectivement comparable, mais vont la définir très différemment, notamment pour des raisons de projection temporelle.
- Individus particuliers (récits de vie) - Cohortes plus ou moins homogènes (lettres…)
Mentalité – Etat d’esprit Multiplication des rencontres/interactions et la grande mobilité des citadins produit de nouvelles manières d’être et d’agir.
Georg Simmel est le premier, dans « Métropoles et mentalités » (1903), à chercher à établir une corrélation entre les structures d’un espace et les structures d’une mentalité -> une éthique de l’attitude blasée, de l’indifférence polie, de la mise à distance et de la méfiance. Louis Wirth, dans « Le phénomène urbain comme mode de vie » (1938), propose un modèle de la personnalité urbaine exprimant les effets désintégrateurs de la division du travail et de la mobilité urbaine:
- Prédominance des « rapports secondaires » (Cooley, Tönnies): relations sociales anonymes, superficielles, fugaces, segmentées, spécialisées, utilitaires.
- Préservation de l’intimité et réserve comme conditions de l’interaction (approfondi par Goffman).
- Un citadin aux rôles/appartenances multiples -> des relations qui n’engagent chaque fois qu’une dimension particulière de l’être.































































![Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632443be4d8439cb620d4d1d/tressan-jusquen-1914-la-naissance-dun-village-viticole-en-languedoc-version.jpg)