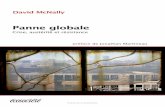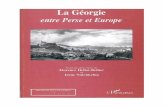S’inscrire dans l’espace public en tant que musulman en Suisse
Transcript of S’inscrire dans l’espace public en tant que musulman en Suisse
Social Compass2015, Vol. 62(2) 199 –211
© The Author(s) 2015Reprints and permissions:
sagepub.co.uk/journalsPermissions.navDOI: 10.1177/0037768615571690
scp.sagepub.com
socialcompass
S’inscrire dans l’espace public en tant que musulman en Suisse
Christophe MONNOT Université de Lausanne, Suisse
RésuméEn Suisse, comme dans de nombreux pays européens, l’exigence d’une représentation musulmane impose une forme d’inscription d’acteurs emblématiques de l’islam dans l’espace public. Cette contribution entend éclairer les différentes contraintes institutionnelles qui poussent les musulmans à s’inscrire différemment dans l’espace public. On distingue d’une part, une tendance s’efforçant d’apparaître dans l’espace public comme une structure confessionnelle garante de la communitas islamica. Elle est composée de communautés de la diaspora qui ont obtenu des accords auprès de la Confédération suisse et de communautés qui se fédèrent au niveau cantonal pour constituer une représentation auprès des autorités de régulation religieuse. D’autre part, des acteurs parviennent à imposer leurs exigences d’un homo islamicus idéalisé en s’inscrivant pleinement dans l’espace médiatique au risque de prétériter la « représentation » chèrement acquise par des acteurs institutionnels.
Mots-clésespace public, institutionnalisation, Islam, mosquée, Suisse
AbstractIn Switzerland, as in many European countries, Muslims are required to be represented in the public sphere. The author clarifies the various institutional constraints that lead Muslims to present themselves differently in the public sphere. He identifies, on the one hand, a tendency for representatives to present themselves as part of a confessional
Pour toute correspondance :Christophe MONNOT, ISSRC, Anthropole, Université de Lausanne, 1015 Lausanne, Suisse Email : [email protected]
571690 SCP0010.1177/0037768615571690Social CompassMonnot : S’inscrire dans l’espace public en tant que musulman en Suisseresearch-article2015
Article
at University of Lausanne on June 4, 2015scp.sagepub.comDownloaded from
200 Social Compass 62(2)
structure embodying the communitas islamica. This structure consists of communities from the diaspora that have reached an agreement with the Swiss Confederation and communities that federate at the level of the canton to form a representative body in the eyes of the authorities responsible for religious regulation. There are, on the other hand, actors who manage to impose their will to create an idealized homo islamicus by becoming directly involved in the media, at the risk of damaging the hard-won ‘representation’ of the institutional actors.
Keywordsinstitutionalization, Islam, mosque, public, sphere, Switzerland
Introduction
Le soir de la votation sur l’interdiction des minarets en Suisse, l’émission télévisée d’analyse politique Mise au point invitait un docteur en sciences politiques d’origine macédonienne et directeur d’Albinfo, un organe d’information suisse pour la commu-nauté albanaise. Assez rapidement au cours de l’émission, la journaliste reprochait à cet invité de ne pas avoir fait entendre la voix des albanophones plus tôt dans le débat sur les minarets, tenant les musulmans pour responsables du résultat du vote.
Quelques jours plus tôt, le débat politique à Infrarouge, sur la même chaîne de télévision publique, avait invité sa nouvelle coqueluche pour représenter la voix musulmane, un Suisse converti qui porte tous les attributs du musulman prétendument « authentique » comme la barbe non coupée. Une représentation emblématique puisque son islam se veut être la voix de « la communauté » des musulmans de Suisse en faisant abstraction des différentes tendances et traditions ethnico-nationales qui la composent.
Dans le premier cas, c’est une voix parmi la « majorité silencieuse » (Salzbrunn, 2013 : 246 ; Gianni, 2005 : 38-39) des plus de 80 % des musulmans de Suisse qui ne pratiquent pas (Monnot, 2013a : 184) que les médias présentent comme celle de la « communauté modérée ». Dans le second cas, il s’agit de la représentation pour les médias de la « communauté croyante ». En dehors d’une dynamique propre aux besoins des médias, cet article s’intéresse à comprendre, du point de vue des collectifs musulmans, pourquoi certains acteurs s’inscrivent visiblement dans l’espace public alors que d’autres non. Ces inscriptions contrastées sont dictées par des besoins de légitimité auprès des pouvoirs publics, de la société et de la communauté musulmane elle-même.
À partir des données provenant d’une enquête ethnographique menée dans des salles de prière de la partie francophone de Suisse, nous expliciterons les pressions tant externes (le cadre légal et les contraintes de représentations) qu’internes (maintient d’une tradition particulière pour les communautés de premières générations, par exemple) qui les poussent à apparaître différemment dans l’espace public.
On conclura sur l’observation d’une dynamique différenciée qui se traduit par différents modes de représentation de l’islam dans l’espace public. Les problèmes de représentations « déplorés » par les instances politiques en Suisse (Bennani-Chraibi et al., 2011) traduisent en fait des dynamiques plus profondes qui traversent l’islam européen : les tenants d’un héritage à maintenir et les tenants d’un islam recomposé qui
at University of Lausanne on June 4, 2015scp.sagepub.comDownloaded from
Monnot : S’inscrire dans l’espace public en tant que musulman en Suisse 201
cherche à supplanter les divergences internes. Cette contribution permettra de dépasser le problème de la représentation de l’islam en Europe, déjà abondamment discutée, pour en montrer les dynamiques poussant les acteurs à suivre des modes différenciés d’inscription dans l’espace public
Adaptation par les pressions internes et externes
Dans la ligne des « congrégationalistes américains » (Johnson et Chalfant, 1993) qui s’attachent à montrer, premièrement, comment une communauté religieuse locale s’adapte à son environnement pour maintenir ses activités (Ammerman, 1997) et, deuxièmement, comment les contingences internes influencent la façon dont les entités locales se conforment aux pressions environnementales (Demerath III et al., 1998), les spécialistes se sont intéressés aux communautés issues de la migration sous l’angle de l’adaptation à l’environnement. Ils s’accordent à dire que les communautés de migrants reproduisent le modèle existant dans le « pays d’accueil » pour s’organiser comme « une convergence vers un congrégationalisme de facto » (Warner, 1994 : 54). Pour l’islam, c’est l’appel à la prière qui rassemble les membres dans un lieu, en s’organisant en Europe, sur l’épure paroissiale préexistante (Césari, 2004 : 183-205; Frégosi, 2006 : 65-67). En Suisse, ces lieux correspondent en grande majorité à des communautés diasporiques, c’est-à-dire fortement distribuées selon les appartenances d’origines des membres (Banfi, 2013 ; Behloul, 2012).
Un second phénomène est constitué des différentes pressions internes aux communautés qui les poussent à suivre un modèle plutôt qu’un autre. Chaves (1997) s’est penché sur la question de l’ordination des femmes dans les Églises chrétiennes pour montrer que des valeurs internes soutenues par une structure confessionnelle forte permettent aux communautés de résister à une pression de la société. Pour l’Islam, Frégosi (2008) montre que, derrière les tensions bien réelles que l’on observe entre la République française et la présence islamique, se cache en fait un long processus d’accommodement, c’est à dire de mise en conformité avec les normes associatives et institutionnelles en vigueur. Un des effets de cet accommodement est la répartition des rôles, constatée par Sèze (2013), entre l’imam pour la direction spirituelle à l’interne des communautés et celle du recteur – le président de l’association – qui représente la mosquée à l’extérieur de la communauté.
Quels sont alors les facteurs qui permettent de comprendre les différents niveaux « d’adaptation » au contexte institutionnel helvétique pour saisir les divers modes d’inscription des communautés musulmanes dans l’espace public ?
« S’inscrire dans l’espace public » : une enquête ethnographique
Pour éclairer cette question, nous nous appuierons sur des données découlant principalement d’une enquête ethnographique 1, menée à partir de septembre 2010 auprès des organisations islamiques, d’abord au Canton de Vaud étendus ensuite à d’autres aires géographiques principalement francophones. Elle repose sur un protocole de recherche par observation participante (Cefai, 2003). Nous avons assisté à la prière ordinaire, aux repas communautaires, aux conférences, aux discussions avec les fidèles dans les
at University of Lausanne on June 4, 2015scp.sagepub.comDownloaded from
202 Social Compass 62(2)
réfectoires des centres. Plus d’une trentaine d’entretiens semi-directifs ont été menés avec des responsables associatifs locaux ou supra-locaux. Deux niveaux d’action des associations musulmanes ont été investigués, le plan le local, les mosquées, et le niveau supra-local, les fédérations représentatives.
Sur le plan local, l’enquête s’intéressait aux communautés et associations religieuses, c’est-à-dire avec une salle de prière pour la pratique régulière (Monnot, 2013a : 30-34). En Suisse, il s’agit essentiellement de communautés à importante population issue de l’immigration, en grande majorité en provenance des Balkans ou de la Turquie2. Ces collectivités sont nettement marquées par la culture et la langue de provenance. Les quelques communautés dont la composition est majoritairement maghrébine comptent également des Suisses convertis3. Au-delà de l’origine régionale, les groupes se distinguent par le fait que certains, comme les centres turcs, rassemblent une part importante de fidèles de seconde génération ; ils sont par conséquent plus établis et comptent des responsables scolarisés en Suisse. D’autres, comme les Bosniaques ou les Kosovars, sont presque exclusivement des membres de première génération. Les dynamiques de socialisation dans ces diverses associations sont donc différentes et dépassent largement la question religieuse.
Des communautés issues de la migration
Comme dans de nombreux pays européens, la présence de l’islam en Suisse découle avant tout de flux migratoires. Selon l’enquête du National Congregations Study (Stolz et al., 2011), les communautés musulmanes sont constituées par un taux de deux tiers de ressortissants extérieurs à l’Union européenne, contre 15 % en moyenne en Suisse, soulignant par là son étroite interrelation avec les flux migratoires des dernières décennies.
Les communautés s’organisent principalement par ressortissants de mêmes régions, de mêmes langues ou de mêmes traditions avec une prise de conscience d’une identité particulière à perpétuer (Sainsaulieu et Salzbrunn, 2007). La communauté fonctionne comme un important nœud de communication et de transmission entre plusieurs contextes culturels. Ainsi que le relève Piettre (2012 : 43) le caractère « installant » ne doit pas cacher le rôle de « sas » vers des « contacts secondaires » que jouent alors ces communautés. Elles sont un lieu « d’interpénétration » des cultures (Göle, 2005), ce qui explique pourquoi elles sont très soucieuses d’une part de conserver un héritage et d’autre part de se conformer au cadre juridique en place et de tisser des relations avec le voisinage.
Sur le plan local, les associations devront s’organiser dans le cadre juridique à disposition. Même s’il n’est pas très contraignant, l’article 60 et les suivants du Code civil suisse4 dessinent le cadre des associations « qui n’ont pas un but économique ». Les associations religieuses sont incluses. Il est nécessaire de s’y conformer pour obtenir le moindre compte bancaire ou louer un local pour les activités communes. Dans ces circonstances, dès qu’une entité sort de l’espace exclusivement privé, elle est contrainte de s’organiser selon des statuts associatifs. Cette formalisation se fait alors en Suisse sur au moins deux niveaux : le cantonal et le fédéral. Pour ce dernier, le ministre des Affaires religieuses de certains pays a signé des accords avec la Confédération. Un lien qui offre
at University of Lausanne on June 4, 2015scp.sagepub.comDownloaded from
Monnot : S’inscrire dans l’espace public en tant que musulman en Suisse 203
une nécessaire assurance de soutien de la part du pays ou de la région de provenance tout en ralentissant celui d’une représentation des associations sur le niveau local.
Les accords avec la Confédération
Dans le contexte d’un accord avec un réseau national (lié au ministère des Affaires religieuses de son pays d’origine), la mosquée locale privilégiera le lien supra-local, car il permet des procédures particulières pour le séjour des imams en Suisse. Ainsi une communauté qui désire organiser son culte en engageant un imam a fortement intérêt à s’apparenter à un réseau national. La plupart des imams qui officient en Suisse sont formés dans les écoles encadrées par les réseaux nationaux. Si les communautés bosniaques ont pu engager des imams, c’est bien que « tous les imams en fonction dans [cette] diaspora sont désignés par le Rijaset, qui impose évidemment une conformité à ses statuts et objectifs à toutes les mosquées. » (Behloul, 2013 : 90). Il en va différemment pour la diaspora albanophone où il n’existe pas d’accord-cadre avec le Kosovo (mufti de Pristina) ou la Macédoine (mufti de Skopje) et qui impose à chaque communauté de faire des demandes spécifiques pour bénéficier d’un permis de travail pour un imam venant des Balkans. Cependant, si cette étroite relation avec un réseau national facilite l’obtention de visas pour des imams qualifiés, elle reste problématique pour la représentation des musulmans qui se joue à un autre échelon. L’imam est formé selon les standards du pays de provenance. Il va officier dans sa langue d’origine et permettra à la communauté de demeurer attachée à la culture du pays d’origine par la pratique religieuse. L’imam, bien que central pour le rite, se maintiendra dans le cercle exclusivement communautaire. Maitrisant mal la langue et les us de la société d’accueil, l’imam envoyé par un réseau national ne pourra aisément représenter la mosquée, tâche qui incombera alors au président de l’association locale.
Les fédérations cantonales
Juridiquement, dans le contexte institutionnel helvétique, c’est sur l’échelon cantonal que se situent les enjeux de la régulation religieuse avec ses instances représentatives. Avec une convention sur le plan fédéral pour disposer d’imams formés (au travers de leur réseau national), il est difficile pour ces associations de saisir les enjeux d’une fédération cantonale avec les autres groupes musulmans. Ainsi plus une association s’organise pour obtenir un imam par un réseau national, plus l’imam représentera une spécificité ethnico-nationale qu’il s’agira de défendre. Les mosquées dans ce cas auront intérêt à conserver un profil bas en demeurant invisibles. Leur inscription dans l’espace public ne se fait pas localement, mais plus généralement, sur le plan fédéral, au travers de leur réseau national. De plus, cette formalisation autour du réseau migratoire ne pousse pas à l’organisation sur le plan cantonal en structure de type confessionnel et représentatif. Cela sera d’autant plus fort pour les premières générations de fidèles.
Une autre conséquence de ce cloisonnement est la méconnaissance des associations musulmanes avoisinantes géographiquement (qui contraste fortement avec l’amitié des autres associations de la même diaspora, peu importe leur localisation en Suisse). En conséquence, ces mosquées ne cherchent pas à s’inscrire dans une logique de
at University of Lausanne on June 4, 2015scp.sagepub.comDownloaded from
204 Social Compass 62(2)
représentation musulmane sur le plan cantonal, mais dans une logique de représentation d’une diaspora spécifique. Comme le relève Behloul (2013 : 77), « l’islam bosniaque » a pu relever le double stigmate du « Yougo » et du musulman pour apparaître comme « européen et modéré » face aux pouvoirs publics. Mais ces derniers, dans un souci de dialogue et de régulation, exigent pourtant des différentes communautés religieuses qu’elles dépassent les cloisonnements ethnico-nationaux pour être représentées par une instance cantonale de type confessionnel.
En conséquence, sur le plan local, les communautés sont prises dans un paradoxe : celui de rester fortement attachées à un réseau national de migration pour bénéficier de personnel spirituel qualifié tout en faisant abstraction de leurs origines pour représenter « la confession musulmane » auprès des institutions publiques. C’est pourquoi, comme le relèvent Mesgarzadeh et al. (2013 : 53), on déplore un manque d’organisation du côté des musulmans de la part des pouvoirs publics qui cherchent « de ‘bons’ interlocuteurs individuels ou collectifs qui soient ‘représentatifs’ de l’islam en Suisse ».
Deux mosquées, deux inscriptions
Afin d’éclairer ces contraintes fédérales et cantonales, arrêtons-nous quelques instants sur deux cas d’associations musulmanes qui fournissent une certaine lisibilité du paradoxe d’une réalité complexe. Les deux communautés sont issues de l’immigration et sont liées formellement à des réseaux nationaux. Tout d’abord, une communauté turque fondée en 1980 dans une bourgade de moins de 5000 habitants. À l’époque, elle constituait l’unique centre islamique de la région en dehors de celui de Lausanne, la capitale du canton. Ses ressortissants sont des personnes de deuxième génération ou de génération 1.5. Certains membres sont engagés dans la politique municipale et dans les différents organes représentatifs des commissions d’intégration sur le plan cantonal. Le second est un centre bosniaque fondé en mai 1993, dans la foulée de la guerre en Bosnie-Herzégovine. Ses membres actifs sont exclusivement de première génération, les liens avec le pays de provenance et le réseau des dix-huit autres associations bosniaques de Suisse sont très serrés (Behloul, 2013 : 90). Les circonstances de la guerre et l’émergence de la religion comme facteur d’identité nationale ont permis à ce réseau d’associations bosniaques de se fédérer sur le plan fédéral5 en lien avec le Reis de Sarajevo (Rijaset). Ainsi, depuis 1998, cette communauté bénéficie d’un imam venu de Bosnie. Pour les Turcs, la situation est différente, il aura fallu presque 34 ans pour bénéficier d’un imam de la Diyanet. Ces deux exemples nous permettent de relever l’effet du réseau formel national sur leur inscription différenciée dans l’espace public.
Dans le canton de ces deux mosquées, une Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM) a permis de fédérer la grande majorité des associations. Cependant, l’implication du groupe turc est très différente du groupe bosniaque. Ce dernier ne comprend pas très bien pourquoi une instance vient « représenter » les musulmans, tandis que les Bosniaques se sont très bien débrouillés seuls pour obtenir ce dont ils avaient besoin. Les représentants sont ainsi vus comme des « personnes qui représentent alors qu’elles n’ont rien fait » selon les dires du président de l’association. La seule représentation valable auprès des autorités est alors celle de la fédération bosniaque. D’ailleurs, lors de la fête du vingtième anniversaire de l’association, en octobre 2013, il
at University of Lausanne on June 4, 2015scp.sagepub.comDownloaded from
Monnot : S’inscrire dans l’espace public en tant que musulman en Suisse 205
n’y avait que les représentants fédératifs bosniaques et ceux des communautés religieuses avoisinantes. Pour cet anniversaire, le niveau cantonal était totalement escamoté, et l’UVAM absente.
Pour le groupe turc, après trente ans d’attente, l’association peut enfin bénéficier d’un imam en relation avec la Diyanet. Pourtant, cette association, du point de vue strictement religieux, contribue, avec les autres centres turcs, à l’affermissement de l’UVAM, dans laquelle elle fonctionne en tant que pair pour les communautés de primo-arrivants comme celles des ressortissants de l’ex-Yougoslavie. Bien qu’affiliée à la Diyanet, cette mosquée n’a pu bénéficier d’un imam, puisque jusqu’en 2013, le ministère des Affaires étrangères limitait à 20 le nombre d’imams envoyés par la Turquie. Au lieu de se centrer sur le maintien de l’activité d’un imam dans la bonne tradition turque, cette association a été contrainte de se tourner vers d’autres associations islamiques pour perpétuer une tradition. Les responsables de la mosquée se sont organisés sur le plan local pour entrer dans les instances politiques municipales afin de défendre la bonne intégration de la diaspora turque. Mais sur le plan religieux, ils ont été poussés à dépasser leur stricte nationalité pour s’associer avec d’autres musulmans afin d’assurer le maintien de la tradition religieuse de leurs familles. Cette communauté s’inscrira différemment dans l’espace public, puisqu’elle sera plus visible pour défendre une minorité turque localement, mais également pour représenter un islam confessionnel, c’est-à-dire un islam qui transcende les différences musulmanes pour être représenté en face aux autorités. D’ailleurs, quand finalement, la communauté a pu obtenir un imam, cet encadrement spirituel fourni par la Turquie n’a pas été reçu comme une solidarité d’un pays vers sa diaspora, mais comme un service pour la communauté musulmane de toute la région. L’imam ne fonctionnant pas exclusivement pour la communauté, mais également pour celles des bourgs voisins, spécialement pour la formation de la jeunesse et pour l’administration des rites lors des fêtes. Une attitude que la Dyanet a des difficultés à comprendre ! Pourquoi un réseau national fournirait-il un imam qui fonctionnerait aussi en dehors de ce réseau ? On perçoit ici le paradoxe par l’autre bout. Une communauté qui a dû, pour sa survie, fortement s’impliquer au niveau local et cantonal, s’est inscrit dans l’espace public en différenciant ses origines et sa religion afin d’obtenir une forme de reconnaissance de la part de la population et des acteurs politiques communaux. Elle ne peut ensuite retourner dans un réseau exclusivement national qu’elle ressent comme un ghetto.
Ces deux cas de figure montrent bien le paradoxe dans lequel sont prises les communautés musulmanes en Suisse. Pour bénéficier d’un imam, elles ont intérêt à s’associer au niveau fédéral en communautés nationales, en restant invisibles, aux marges de l’espace public. Les autres sont contraintes de sortir des barrières linguistiques et ethnico-nationales pour s’allier du point de vue pratique et fédérer à l’échelle cantonale en vue d’une (unique) représentation (confessionnelle). Ces associations ont dès lors avantage à se rendre visibles dans l’espace public pour faire entendre leur voix. Elle portera d’autant plus, si elle « représente » une confession plutôt qu’une communauté locale singulière. Ces deux mosquées figurent ainsi deux types d’inscriptions dans l’espace public, mais plus important encore, deux positionnements à l’intérieur de l’islam. Cette inscription différenciée découle notamment du fait que ces communautés n’ont pas eu les mêmes facilités pour bénéficier d’un imam.
at University of Lausanne on June 4, 2015scp.sagepub.comDownloaded from
206 Social Compass 62(2)
Confédération et imams
La figure de l’imam se situe au croisement d’une appartenance religieuse et d’un héritage culturel. En Suisse, son statut est précaire : il est bénévole, à temps partiel ou envoyé par un réseau national. Dans ce dernier cas, son contrat est à durée limitée, sa maîtrise de la langue et sa connaissance des institutions helvétiques sont faibles. L’imam est alors presque totalement dépendant du comité local qui l’engage. Selon les dernières enquêtes, moins d’un imam sur cinq est actuellement de nationalité suisse (Monnot, 2013b : 36). D’ailleurs, cette situation ne devrait pas changer rapidement : les conventions entre les réseaux nationaux et la Confédération empêchent fréquemment les imams d’acquérir la nationalité suisse. Pour Akgönül (2009 : 43-45), cette situation soutient une stratégie de « première génération perpétuelle ». Cet auteur souligne l’inscription de la communauté qui est alors organisée en vue de la perpétuation d’une tradition particulière en situation de diaspora. Elle a pour conséquence de cantonner l’imam dans la communauté, mais elle conduit la communauté à s’inscrire dans une politique de la discrétion, en outsider, et non en tant que citoyens prenant part aux affaires de la cité. Cet état de fait est encore renforcé par un usage presque exclusif de la langue de la communauté diasporique. L’islam constitue l’ensemble confessionnel suisse qui recourt le moins fortement aux trois langues nationales helvétiques pour mener ses rencontres religieuses. Ceci n’est pas étonnant, puisque les imams sont en immense majorité des primo-arrivants, soit prêtés pour quelques années par des réseaux nationaux, soit formés à l’étranger avec un permis de travail limité. L’imam représente donc cette tradition que les mosquées cherchent à perpétuer. Il constitue une passerelle entre une tradition spécifique, une langue, une origine et la communauté de la diaspora. Dans ces circonstances, son rôle se cantonnera à la mosquée et au service d’une diaspora spécifique. L’association qui l’engage, si elle dépend d’un réseau national, aura ainsi intérêt à se montrer publiquement comme la représentante d’une tradition particulière.
Cantons et présidents
Bien que constituées essentiellement dans la motivation de perpétuer une tradition, les communautés musulmanes épousent les formes associatives en vigueur pour transmettre cet héritage, elles « s’inculturent » pour le dire avec Roy (2008 : 87). En s’organisant, elles nomment des présidents d’association qui ont alors la charge d’assurer la bonne marche de la communauté, mais également de la représenter auprès des instances tant musulmanes que non musulmanes. Ainsi l’inscription de la communauté dans la sphère publique est prise en charge par le président de l’association. Comme le relève Sèze (2013), l’imam préserve la cohésion spirituelle interne et le président assure la représentation de la communauté. Dans l’exemple de la mosquée bosniaque précitée, c’est le président qui représente la communauté envers la commune, mais également qui participe au groupe de dialogue interreligieux de la ville. Pour la mosquée turque, les présidents successifs se sont battus non seulement pour obtenir un imam, mais également pour faire entendre leur voix dans la communauté musulmane du canton. Les présidents fédérant alors les groupes autour de l’idée d’une représentation commune à l’instar des corporations ecclésiastiques (chrétiennes) existantes.
at University of Lausanne on June 4, 2015scp.sagepub.comDownloaded from
Monnot : S’inscrire dans l’espace public en tant que musulman en Suisse 207
En conséquence, le président aura deux types d’inscriptions dans l’espace public, en relation avec les objectifs de la communauté. Le premier sera de s’insérer dans un réseau national et de maintenir des relations fortes avec les autres communautés de la diaspora en Suisse. Les présidents qui peuvent s’appuyer sur ce type de réseau trouvent donc leur légitimité dans des accords-cadres que la Confédération a signés avec leur pays de provenance. S’ils bénéficient d’un imam, ils n’auront pas besoin des autres groupes pour se légitimer. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire dans l’espace public, puisque les instances politiques ont déjà accordé une confiance et un statut particulier.
Les autres présidents, ceux qui n’ont pas d’imam, ou qui n’ont pas d’accords-cadres, seront poussés à s’inscrire dans un discours de représentation de l’islam comme une confession qui dépasse les traditions ethnico-nationales. Ils seront dès lors des figures centrales de la communauté. Ils devront d’ailleurs aller au-delà de leur association locale pour trouver des alliés afin d’en assurer la perpétuation de la pratique.
En réponse aux pressions légales et normatives, les présidents se fédéreront dans un réseau de mosquées ou d’associations religieuses en vue de constituer une représentation, un vis-à-vis, pour les pouvoirs publics. L’inscription de ces présidents dans l’espace public correspond à une représentation religieuse institutionnelle plus ou moins unique de l’islam dans une région. Dans ces conditions, elle transmet une tendance vers un islam générique ou « réformiste générique » comme le définit Saint-Lary (2012 : 464-465). Cependant, cette direction prise ne va pas dans une inscription radicale, puisqu’elle est liée à un processus de légitimation institutionnelle. Elle rencontre des processus de réélaboration de la pratique musulmane d’un « renouveau islamique » (Piettre, 2013) en dehors de tout lien avec un pays. Cependant, en s’unissant, leur fédération devient un organe central pour la discussion avec les autorités cantonales qui cherchent d’abord des interlocuteurs constitués pour négocier le vivre ensemble. Cette « confessionnalisation » est visible dans une version institutionnelle de l’islam.
Ainsi les contingences institutionnelles renforcent le rôle du président comme représentant de la communauté et cantonnent le rôle de l’imam à celui du spécialiste d’une tradition pour la communauté locale. De plus, les communautés qui sont en réseaux nationaux défendront une tradition peu visible, mais qui jouit des faveurs des instances confédérales et les communautés qui se fédéreront autour de leurs présidents s’inscriront dans une démarche de visibilité pour acquérir la légitimité d’une représentation confessionnelle auprès des autorités cantonales.
La représentation hors mosquée
Ces contingences ne permettent pas aux communautés locales de se profiler dans le débat public tel que celui du vote contre les minarets (Lindemann et Stolz, 2014). C’est du moins à partir de ce constat que Nicolas Blancho, un Suisse converti à l’islam cité en introduction, a eu pour objectif de fonder une association pour représenter les (individus) musulmans : le Conseil central islamique suisse (CCIS). Président de cette nouvelle entité qui n’émane pas des mosquées, il désire représenter les musulmans de Suisse et « défendre leurs intérêts en tant que musulman-e-s » (Schneuwly Purdie, 2013: 151).
Ce projet s’inscrit dans une perspective de rendre visibles les attentes et demandes des musulmans de Suisse. Il cherche à dépasser les barrières des traditions locales pour
at University of Lausanne on June 4, 2015scp.sagepub.comDownloaded from
208 Social Compass 62(2)
défendre un « vrai islam » (Janson, 2007 : 79) comme entité confessionnelle. Affranchi des contraintes des communautés locales, il peut pleinement entrer dans une publicisation d’un islam « réformiste générique » (Saint-Lary, 2012). Il est donc peu étonnant d’observer un président présentant une apparence vestimentaire qui collectionne tous les attributs islamiques (barbe non coupée, couvre-chef, pantalons coupés) et côté féminin, une Suissesse convertie, Nora Illy qui porte le niqab. Ils font figure de représentants iconiques de l’islam affranchi des craintes des communautés issues de la migration (Behloul, 2012).
En fait, c’est bien pour cette raison que les médias les privilégient pour parler des minarets, de la burqa et de la lapidation, lors de débats télévisés. Ils peuvent bien mieux que les présidents de mosquées s’avancer dans des conjectures sur l’islam, puisqu’ils ne représentent pas (théologico-juridiquement) un groupe de fidèles. Tout au plus, une association de personnes qui ont fait de la visibilité dans l’espace public un signe de leur piété et des discours sans concession s’apparentant à un « salafisme politique » (Schneuwly Purdie, 2013 : 167). « Que l’islam soit plus visible et plus public est un phénomène inhérent au succès du réformisme » (Saint-Lary, 2012 : 461) pour lequel le marquage corporel « relooké » est central pour apparaître comme musulman légitime dans l’espace public.
Ces acteurs, débarrassés des contraintes de mosquées ou de communautés de croyants traditionnels, peuvent, par conséquent, poursuivre dans une direction « réformiste », c’est-à-dire représenter les musulmans comme une confession unitaire. Pourtant l’exposition médiatique de ces acteurs « représentatifs » dessert les fédérations musulmanes cantonales, car l’immense majorité des musulmans ne se reconnaissent pas dans cette représentation, sinon de façon très ambivalente. Ces nouveaux acteurs que l’on voit émerger partout en Europe ne se fondent pas tellement sur une légitimité à l’intérieur de la communauté musulmane organisée, mais auprès d’individus qui perçoivent, par leur apparition dans l’espace public ou médiatique, des représentants « authentiques » de l’islam ou, pour le dire avec Göle (2011), attirés par « le caractère cosmopolite du leurre fondamentaliste ».
Conclusion
On distingue trois types de dynamique dans l’islam helvétique qui reposent sur autant d’exigences. La première est celle qui se fonde sur les besoins d’un imam et qui pousse les communautés à défendre une tradition ethnico-nationale particulière. La seconde se base sur les exigences d’une représentation confessionnelle auprès des autorités (cantonales), une responsabilité qui incombe aux présidents. Ils doivent outrepasser les différences ethnico-nationales pour obtenir une légitimité représentative. La troisième s’appuie sur les impératifs d’une représentation de l’islam dans l’espace médiatique qui doit alors se présenter comme « une » communauté. Elle pousse des acteurs, souvent indépendants de la vie des mosquées, à se démarquer corporellement pour afficher leur religiosité et s’inscrire visiblement dans l’espace public. L’enquête que nous avons menée souligne un autre point : le type d’inscription dans l’espace est contingent des postures des acteurs musulmans.
at University of Lausanne on June 4, 2015scp.sagepub.comDownloaded from
Monnot : S’inscrire dans l’espace public en tant que musulman en Suisse 209
On relève avec Rodier (2014), qui remarque qu’en France la nourriture halal met en exergue un islam « moderniste » prétendu « authentique » et un islam jugé « traditionnel », qu’un courant « traditionaliste » tourné vers un objectif de maintien des traditions des pays de provenance se distingue d’un courant « moderniste » qui désire traverser les spécificités pour composer une tradition « authentique » dans le contexte européen. Ainsi l’islam en Suisse s’institutionnalise en se centrant, d’une part, sur son réseau de migration au niveau confédéral, motivé par la perpétuation des traditions spécifiques et, d’autre part, avec une volonté de constituer sur le plan cantonal une représentation fédérative « confessionnelle » qui dépasse les traditions ethnico-nationales. Cette dynamique ne s’oppose pas forcément sur le terrain des mosquées, les acteurs institutionnels oscillant entre ces deux voies, car en train de négocier, avec difficulté, l’obtention d’imams (sur le plan fédéral) ou alors l’intégration de leur fédération cantonale « confessionnelle » dans le dialogue avec les pouvoirs publics (cantonaux). Cependant, dans les médias, cette représentation institutionnelle est supplantée par une représentation « individualiste », celle de l’homo islamicus. Découplée de la vie associative des mosquées, elle cherche à figurer le musulman « authentique » aux attributs « wahhabites relookés ».
Nous constatons que, derrière la question de la « représentation » de l’islam, il y a une dynamique parfois contradictoire et paradoxale des communautés locales, des acteurs et des demandes ou exigences des pouvoirs publics. L’inscription dans l’espace public de protagonistes plutôt que d’autres découle de postures différenciées, celles qui représentent des collectifs qui s’organisent autour d’une tradition, d’autres s’inscrivant dans une ligne « moderniste », mais s’efforçant toujours de poursuivre la structuration de communautés de fidèles (Janson, 2007). Ceux-ci sont (parfois) éclipsés par l’émergence d’individus musulmans qui cherchent à s’inscrire visiblement dans l’espace public et spécialement médiatique comme musulmans affranchis des contingences communautaires. Des acteurs de la communitas islamica font ainsi face aux contingences institutionnelles pour s’inclure au mieux dans une société dans laquelle les associations islamiques s’installent pour la durée, tandis que d’autres s’attachent à représenter les musulmans comme une communauté imaginaire de l’homo islamicus. En Suisse, les niveaux des pouvoirs publics fédéraux ne privilégient pas les mêmes interlocuteurs que les niveaux cantonaux. Des niveaux encore brouillés par des acteurs qui, au travers d’une inscription essentiellement médiatique, tentent de représenter « la » communauté musulmane visible, en la « formatant » (Roy, 2008 : 264) par des attributs islamiques masquant les sensibilités et traditions spécifiques, alors que les dynamiques communautaires sont précisément celles qui légitiment la visibilité de l’islam dans l’espace public en l’inscrivant durablement dans les espaces sociaux locaux.
Financement
La Fondation du 450e anniversaire de l’Université de Lausanne a soutenu la recherche dans le cadre du programme « Vivre ensemble dans l’incertain ».
Notes
1. La recherche, « S’inscrire dans l’espace public. Approches sociologiques et géographiques des nouveaux paysages religieux », était dirigée par L Kaufmann (2013) et P Gonzalez (2014) de l’Université de Lausanne.
at University of Lausanne on June 4, 2015scp.sagepub.comDownloaded from
210 Social Compass 62(2)
2. Selon le relevé structurel de la population suisse de 2012 organisé par l’Office fédéral de la statistique (OFS): 43 % des musulmans ont une nationalité de l’ex-Yougoslavie, 15 % ont une nationalité turque et 32 % ont acquis la nationalité suisse ou sont Suisses (OFS, 2012).
3. Bien qu’aucune statistique ne soit disponible sur le sujet, relevons que la proportion de Suisses convertis à l’islam reste faible (la plupart du temps, dans le cas d’un couple à l’origine bi-confessionnel).
4. http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html (consulté le 23 janvier 2014).
5. Le nom de leur fédération en Suisse n’est même pas traduit : Islamska zajednica Bošnjaka Švicarske.
Références
Akgönül S (2009) Appartenances et altérités chez les originaires de Turquie en France. Le rôle de la religion. Hommes et Migrations 1280 : 34-49.
Ammerman N (1997) Congregation and community. New Brunswick : Rutgers University Press.Banfi E (2013) Snowboarding on Swiss Islam. Neuchâtel : Alphil-Presses universitaires suisses.Behloul S (2012) Negotiating the ‘genuine’ religion: Muslim diaspora communities in the context
of the Western understanding of religion. Journal of Muslims in Europe 1 : 7-26.Behloul S (2013) Les mosquées bosniaques face au double stigmate du « Yougo » et du musulman.
In : Monnot C (ed.) La Suisse des mosquées. Derrière le voile de l’unité musulmane. Genève : Labor et Fides, 77-95.
Bennani-Chraibi M, Nedjar S et Mesgarzadeh S (2011) L’émergence d’acteurs associatifs musulmans dans la sphère publique en Suisse. Berne : Fonds national suisse.
Cefai D (2003) L’enquête de terrain. Paris : La Découverte-MAUSS.Césari J (2004) L’islam à l’épreuve de l’Occident. Paris : La Découverte.Chaves M (1997) Ordaining women: Culture and conflict in religious organizations. Cambridge :
Harvard University Press.Demerath III N J, Peter D and Terry S (eds) (1998) Sacred companies: Organizational aspects of
religion and religious aspects of organizations. Oxford : Oxford University Press.Frégosi F (2006) L’exercice du culte musulman en France. Lieux de prière et d’inhumation. Paris :
La documentation française.Frégosi F (2008) Penser l’islam dans la laïcité. Les musulmans de France et la République. Paris :
Fayard.Gianni M (ed.) (2005) Vie musulmane en Suisse. Profils identitaires, demandes et perceptions des
musulmans en Suisse. Berne-Wabern : Commission fédérale des étrangers.Göle N (2005) Interpénétrations. L’Islam et l’Europe. Paris : Galaade.Göle N (2011) The lure of fundamentalism and the allure of cosmopolitanism. Princeton : Markus
Wiener.Gonzalez P (2014) Que ton règne vienne ! Genève : Labor et Fides.Janson M (2007) Appropriating Islam: The tensions between ‘traditionalists’ and ‘modernists’ in
the Gambia. Islam et sociétés au sud du Sahara, nouvelle série 1 : 61-79.Johnson D and Chalfant H (1993) Contingency theory applied to religious organizations. Social
compass 40(1) : 75-81.Kaufmann L (2013) Le silence des agneaux. L’hospitalité libérale à l’épreuve du fonda-
mentalisme. Sociologies. Disponible sur : http://sociologies.revues.org/4526.Lindemann A and Stolz J (2014) Use of Islam in the definition of foreign otherness in Switzerland:
A comparative analysis of media discourse between 1970–2004. Islamophobia Studies Journal 2 : 44-58.
at University of Lausanne on June 4, 2015scp.sagepub.comDownloaded from
Monnot : S’inscrire dans l’espace public en tant que musulman en Suisse 211
Mesgarzadeh S, Nedjar S et Bennani-Chraibi M (2013) L’ « organisation » des musulmans de Suisse. Dynamiques endogènes et injonctions de la société majoritaire. In : Monnot C (dir.) La Suisse des mosquées. Derrière le voile de l’unité islamique. Genève : labor et Fides, 53-76.
Monnot C (2013a) Croire ensemble. Analyse institutionnelle du paysage religieux en Suisse. Zurich : Seismo.
Monnot C (2013b) La Suisse des mosquées. Derrière le voile de l’unité musulmane. Genève : Labor et Fides.
OFS (2012) Relevé structurel de la population suisse. Appartenance religieuse. Neuchâtel : Office fédéral de la statistique (OFS).
Piettre A (2012) Islamisation d’un espace social et sémiotisation d’une colorline. In : Turpin B (ed.) Discours et sémiotisation de l’espace. Les représentations de la banlieue et de sa jeunesse. Paris : L’Harmattan, 37-60.
Piettre A (2013) Le renouveau islamique dans l’expérience politique du Kollectif de Bondy (2000-2001). Revue européenne de migrations internationales 29 : 111-132.
Rodier C (2014) La question halal. Sociologie d’une consommation controversée. Paris : PUF.Roy O (2008) La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture. Paris : Seuil.Sainsaulieu I et Salzbrunn M (2007) La communauté n’est pas le communautarisme. Esprit
critique 10 : 1-12.Saint-Lary M (2012) Du wahhabisme aux réformismes génériques. Renouveau islamique et brouillage
des identités musulmanes à Ouagadougou. Cahiers d’études africaines 206-207 : 449-470.Salzbrunn M (2013) Être musulman en Suisse hors mosquée. In : Monnot C (ed.) La Suisse des
mosquées. Derrière le voile de l’unité musulmane. Genève : Labor et Fides, 243-248.Schneuwly Purdie M (2013) Performer l’islam, dessiner les contours de la « communauté
musulmane » de Suisse. Le Conseil central islamique suisse comme performance de l’islam « authentique ». In: Monnot C (ed.) La Suisse des mosquées. Derrière le voile de l’unité musulmane. Genève : Labor et Fides, 151–171.
Sèze R (2013) Être imam en France. Les transformations du « clergé » musulman en contexte minoritaire. Paris : Cerf.
Stolz J, Chaves M, Monnot C et al. (2011) Die religiösen Gemeinschaften in der Schweiz: Eigenschaften, Aktivitäten, Entwicklung. [Les communautés religieuses en Suisse. Caractéristiques, activités et développement]. Berne : Fonds national suisse.
Warner R (1994) The place of the congregation in the contemporary American religious configuration. In : Wind J and Lewis J (eds) American congregations. Chicago : University of Chicago Press, 54-99.
Biographie de l’auteur
Christophe MONNOT est docteur en sciences des religions et sociologie des religions de l’Université de Lausanne et de l’École pratique des hautes études (Sorbonne, Paris). Depuis 2012, il est professeur remplaçant en sociologie des religions à l’Université de Lausanne et exerce plusieurs charges de cours à l’Université de Genève. Il est également associé au Groupe sociétés religions laicités (EPHE-CNRS) à Paris. Il est en outre membre du conseil du Research Network 34 (Sociology of Religion) de l’European Sociological Association (ESA) depuis sa création en 2011. Ses travaux portent sur les différentes formes d’institutionnalisation du religieux, les communautés religieuses et leurs relations avec leur environnement social et politique. Parmi ses derniers ouvrages : Religion in times of crisis (2014), publié chez Brill, co-dirigé avec G Ganiel et H Winkel, Croire ensemble. Analyse institutionnelle du paysage religieux en Suisse (2013, Seismo) et La Suisse des mosquées. Derrière le voile de l’unité musulmane (2013, Labor et Fides).Adresse : ISSRC, Anthropole, Université de Lausanne, 1015 Lausanne, SuisseEmail : [email protected]
at University of Lausanne on June 4, 2015scp.sagepub.comDownloaded from