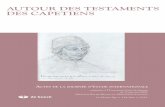Circulations et émissions monétaires dans l’espace du Royaume de Bourgogne aux XIe et XIIe...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Circulations et émissions monétaires dans l’espace du Royaume de Bourgogne aux XIe et XIIe...
Circulations et émissions monétaires dans l’espace du Royaume de Bourgogne aux XIe et XIIe siècles (1148)
VINCENT BORREL
3
Circulations et émissions monétaires dans l’espace du Royaume de Bourgogne aux XIe et XIIe siècles (1148)
INTRODUCTION Les comtes de Maurienne, futurs comtes de Savoie, bien qu’originaires du Viennois, n’auraient monnayé au XIe siècle que dans la vallée de la Maurienne, et ceci concurremment aux évêques. Deux ateliers auraient ainsi frappé : Aiguebelle et Saint Jean de Maurienne. La question de retrouver les premières monnaies émises par la Maison de Savoie n’est pas nouvelle. Les textes contemporains faisaient mention de l’utilisation de deniers dits « aquabellenses ». Au XVIIe siècle, Samuel Guichenon donnait déjà quelques gravures de ce qu’il présentait comme les premières monnaies frappées par les Humbertiens. Au XVIII e siècle, le chanoine valaisan Pierre de Rivaz affirmait posséder une monnaie portant la légende AQUABELLA que l’on a attribuée à l’évêque de Maurienne Thibault. En 1843 lors de la démolition du clocher de l’église de St Paul hors les murs à Rome, une monnaie portant explicitement le nom de « MAURIENNE » fut retrouvée pour la première fois. Alors que depuis longtemps les textes la mentionnaient, la première monnaie portant le nom d’ « AIGUEBELLE », ne fut pourtant retrouvée qu’en 1858 à Montagnole près de Chambéry. OBJECTIFS DE L’ETUDE
Comme le laisse à penser l’introduction ci-dessus, cette étude était focalisée initialement sur le monnayage de Maurienne au XIe siècle, afin d’essayer de comprendre les raisons de l’implantation et l’évolution d’un ou plusieurs ateliers monétaires dans cette vallée. Cette implantation semblait en effet aller de pair avec l’arrivée dans cette vallée des premiers Humbertiens. Cependant, il nous a rapidement paru nécessaire d’étendre notre champ d’investigation, afin d’appréhender plus globalement le phénomène d’une évolution monétaire perceptible en réalité sur l’ensemble du Royaume de Bourgogne : le passage d’un monnayage royal à un monnayage que l’on pourrait qualifier de « local ».
Nous avons étendu l’espace temporel : le XIe siècle est, pour la région, la période de transition qui voit la fin de la dynastie rodolphienne et l’émergence de nouveaux pouvoirs, c’est le siècle de passage « du royaume aux principautés
1 ». Mais pour comprendre cette évolution et sa traduction concrète au niveau des
émissions monétaires, il nous a semblé utile de commencer par la description rapide des monnaies des deux derniers Rodolphiens : Conrad le Pacifique et Rodolphe III. Nous avons ensuite décidé de fixer la fin de la période d’étude lorsque les monnaies des nouvelles principautés, et notamment de la principauté savoyarde ont été définitivement reconnues et utilisées. Nous avons donc choisi pour terminus la date de 1148, qui correspond au décès d’Amédée III : désormais les Humbertiens et leur monnaie sont solidement implantés de part et d’autre des Alpes. Une raison supplémentaire à ce choix du milieu du XIIe siècle comme terminus est le fait que nous nous trouvons alors juste dans la période antérieure à nombre de concessions monétaires aux évêques ou aux laïcs de la part des empereurs germaniques, notamment Frédéric Ier.
Au niveau géographique, afin d’essayer d’avoir une vision plus cohérente, l’espace de l’ancien Royaume de Bourgogne nous a paru le plus approprié. Le champ d’étude correspond à une grande partie de l’espace occupé par le Royaume de Bourgogne Provence, plus précisément il correspond au territoire où le Roi de Bourgogne Rodolphe III peut encore prétendre exercer une influence à la fin de son règne. La Provence en a été exclue, mais nous avons ajouté la Comté de Bourgogne, même si l’influence de Rodolphe III y fut très faible. Pour établir une continuité avec l’évolution des possessions territoriales des Humbertiens, nous avons inclus également le versant oriental de la chaine alpine, à savoir la Vallée de Suse et la région proche de Turin.
L’idée sous-jacente de cette étude est de préciser, d’affiner, les connaissances actuelles de l’évolution
monétaire régionale pour cette période XIe-XIIe siècles. Cette démarche est assez difficile, principalement du fait qu’à partir des années 1030 la majorité des monnaies devient anonyme. Il n’est dès lors plus possible de connaitre le nom de l’évêque ou du seigneur laïc qui l’aura faite frapper. Nous allons donc essayer d’agir de manière comparative, en faisant appel à plusieurs sources : les documents écrits, essentiellement les cartulaires monastiques, mais également les monnaies elles-mêmes.
Dans un premier temps, nous nous attacherons à essayer de préciser la circulation monétaire au sein de cet espace bourguignon à travers les mentions monétaires retrouvées dans différents cartulaires régionaux, ces résultats étant corrélés aux dépôts monétaires ou trésors retrouvés et publiés, et à certains résultats de fouilles archéologiques.
Dans une deuxième partie, nous ferons le point des connaissances actuelles sur les émissions monétaires des ateliers bourguignons pour la période étudiée. Pour ce faire, nous commencerons par les émissions des deux derniers rois de Bourgogne, Conrad et Rodolphe III, puis étudierons au cas par cas les
1 Ripart Laurent : Du Royaume aux Principautés, in Le Royaume de Bourgogne autour de l’an Mil 2008
4
évolutions de chaque atelier. Nous nous sommes attachés à essayer de retrouver le contexte de ces émissions. Cette partie pourra peut-être apparaitre au lecteur comme un « catalogue », mais il nous a paru nécessaire de synthétiser les éléments concernant ces différents ateliers, souvent dispersés dans de multiples ouvrages ou articles.
Enfin, la troisième partie sera plus spécifiquement consacrée au monnayage dans la vallée de la Maurienne ainsi qu’à celui d’un de ces lignages émergents, celui des Humbertiens. Nous essaierons, entre autres, de déterminer s’il est possible de savoir qui de l’évêque de Maurienne ou du comte a pu émettre à Aiguebelle. Cette partie sera également l’occasion de procéder à quelques comparaisons avec les monnayages épiscopaux présentés dans la partie précédente.
5
FABRIQUER LA MONNAIE
Il nous a paru nécessaire de fournir quelques éléments sur les monnaies et le fonctionnement d’un atelier monétaire médiéval afin de faciliter la compréhension des parties suivantes, consacrées à la description de plusieurs monnayages. Ce passage s’inspire fortement de l’ouvrage de Marc Bompaire et Françoise Dumas « Numismatique Médiévale
2 ».
LE DENIER MEDIEVAL : PRESENTATION ET DESCRIPTION D’UNE MONNAIE Aux XIe et XIIe siècles la monnaie utilisée dans toute l’Europe occidentale est encore le denier d’argent issu des réformes carolingiennes. Dès le IXe siècle en effet, on cesse de monnayer l’or, principalement par pénurie de métal disponible. Les carolingiens Pépin et Charlemagne établissent progressivement à partir de 754 un système monétaire fondé sur le denier d’argent et les ratios suivants à partir de 793/794
3 : 1 livre = 20 sols =
240 deniers. Les sous multiples du denier, les oboles, n’apparaissent qu’à la fin du IXe siècle4.
Cette étude va décrire un nombre important de monnaies, c’est la raison pour laquelle nous présentons ici un exemple d’un denier, afin de faciliter au lecteur la compréhension des descriptions ultérieures. Une monnaie régionale des Xe- XIe siècles : un denier du Comté du Maine au nom d’Herbert « Eveille-chien » (1014-v1035) Cette monnaie est un denier dit « immobilisé» au nom du Comte du Maine Herbert Ier. L’immobilisation provient du fait que ce type monétaire a continué d’être frappé pendant une longue période après la mort du Comte Herbert, ici, jusqu’au XIIIe siècle.
Description : P/ + COMES CENOMANIS Monogramme d’Herbert Ier dit Eveille Chien C/ + SIGNUM DEI VIVI Croix pattée cantonnée de 2 points en 1 et 2, et de l’alpha et l’oméga en 3 et 4 Les deux faces de la monnaie : avers et revers. Les faces des monnaies portent les noms d’avers et de revers. En toute rigueur, l’avers est le côté le plus important de la monnaie, portant souvent le nom de l’autorité émettrice. Cependant, en numismatique, traditionnellement, l’avers est le côté présentant le plus d’intérêt, donc celui portant un motif autre que la croix qui se retrouve quasiment sur toutes les monnaies médiévales. Pour lever toute ambiguïté, nous avons choisi de reprendre les termes médiévaux de « côté pile » et « côté croix », peut être plus évocateurs. Le grenetis Le grenetis est cette série de perles ou grains qui marque la séparation entre les légendes et le motif central. Le module de la monnaie, qui est le diamètre extérieur de l’empreinte monétaire, est donné par le grenetis extérieur Motif central : le champ Le champ représente un motif, qui va permettre de reconnaitre la monnaie. Dans le cas présent il s’agit d’un monogramme, celui d’Herbert Ier dit Eveille-chien comte du Mans
2 Bompaire Marc – Dumas Françoise : Numismatique médiévale
3 Depeyrot, Georges. Le Numéraire Carolingien. Paris: Maison Florange, 2008. P 72
4 Bompaire-Dumas P290
6
Légendes En règle générale les légendes se situent sur le pourtour extérieur de la monnaie. Le début de lecture est donné par la présence d’une petite croisette, et le sens de parcours est le sens horaire. Il n’y a pas forcément de ponctuation entre les différents mots.
+ COMES CENOMANIS : Comte du Mans + SIGNVM DEI VIVI : signe du Dieu vivant Lecture de la monnaie Pour la bonne compréhension de la monnaie, il ne faut pas nécessairement séparer la lecture du champ de celle de la légende. En effet ici, la lecture complète du côté pile est à envisager de manière à associer le monogramme d’Herbert et la légende :
« Erbertus Comes Cenomanis » : Herbert, comte du Mans
Pourquoi émettre de la monnaie ?
Le droit monétaire fait partie par essence même des droits dits régaliens. Seuls les rois et les empereurs ont en théorie le droit de battre monnaie et de décider de la valeur de leur cours. En pratique ces droits ont souvent été concédés plus ou moins officiellement aux représentants de l’autorité royale ou impériale. Les églises, notamment en France, se feront « concéder » ces droits monétaires
5. En ce qui concerne les
seigneurs laïcs, notamment les comtes, la situation est plus complexe. Par délégation du pouvoir central, la frappe monétaire est considérée comme une prérogative des possesseurs des droits comtaux. Les comtes contrôlaient donc les ateliers au nom du roi. Progressivement ils vont s’émanciper de ce pouvoir royal et faire émettre les monnaies à leur propre nom. De ce fait, il est assez difficile de parler d’usurpation de la monnaie, puisqu’en réalité ces changements correspondaient à l’évolution de la situation politique concrète, le comte exerçant le pouvoir et émettant les monnaies à son nom. La décision pour une autorité médiévale d’émettre de la monnaie parait donc une décision politique. Par ce geste elle revendique un certain degré de souveraineté. C’est ainsi que beaucoup de seigneurs ou de prélats, ne possédant pas initialement les droits monétaires ni les prérogatives comtales, se les arrogeront. Pour éviter les contestations, ils feront souvent « régulariser » cette situation et confirmer ces droits usurpés quelques décennies plus tard par une autorité supérieure, souvent l’empereur germanique pour l’espace du Royaume de Bourgogne. (Valence, concession en 1157, Dauphins en 1155, Vienne en 1196, Die en 1178, Grenoble en 1161…)
6
Cependant, il semble bien que plus pragmatiquement, le prestige engendré par l’émission monétaire ne soit pas le principal moteur de l’ouverture d’ateliers. Le droit de monnaie est considéré comme un revenu, une source de bénéfice. L’émetteur reçoit une certaine partie de la monnaie émise, le seigneuriage. Pour les églises, notamment, ces bénéfices monétaires seront utilisés à la construction des édifices religieux
7. La
monnaie était assimilée à une partie du domaine seigneurial8, donc considérée comme concessible ou
échangeable. La décision d’émettre de la monnaie est également censée répondre à un besoin économique.
L’émetteur désirant faciliter le commerce et les échanges sur le territoire sur lequel il a autorité décide de faire ouvrer de la monnaie. Mais, pour qu’elle circule, il faut que cette dernière soit acceptée par le marché. C’est la raison pour laquelle lorsque les évêques ou les comtes commenceront à émettre à leur nom, ils copieront souvent un type connu et couramment accepté, afin de faciliter l’insertion de leurs deniers dans le système économique. Se greffant sur ce besoin économique, la monnaie peut également être vecteur de propagande politique, c’est ce que nous verrons avec la concurrence de Lyon et Vienne pour obtenir le titre de primat des Gaules
9.
Ou installer un atelier ?
L’émission monétaire étant une décision « régalienne », il apparait cohérent d’établir un atelier
monétaire sur un territoire dont l’autorité est certaine de sa fidélité. C’est ainsi que les ateliers épiscopaux seront principalement ouverts au cœur même des cités. Cependant, il est préférable qu’un atelier monétaire soit situé dans un lieu de passage, au contact de la population. Les villes situées sur des routes commerciales, ou
5 Nous avons mis « concéder » entre guillemets car il semblerait qu’une grande partie des diplômes présentés par ces
églises étaient des forgeries réalisées dans l’intention de justifier a posteriori l’existence de leur atelier (Depeyrot P 26 et
Bompaire-Dumas P 388 -389.) 6 Bompaire Dumas P 389-390 7 Depeyrot P 14 cite l’exemple de St Martial de Limoges qui aurait été construite en partie avec les revenus concédés en
1095 8 Lafaurie le trésor du Puy P 71 9 Cf partie II les monnayages des archevêques de Lyon et de Vienne
7
possédant un marché, étaient de ce fait bien placées. Ainsi les monnaies émises peuvent directement être mises en circulation et le passage permet également à l’atelier d’être suffisamment alimenté en matières premières. Une dernière possibilité : l’autorité peut envisager de placer son atelier tout près d’un lieu d’extraction minière, afin de disposer directement du minerai et du métal. Ce fut le cas de l’atelier de Melle en Poitou, situé directement à côté de gisements de plomb argentifère. La frappe monétaire : fonctionnement de l’atelier
Représentation d’un atelier monétaire
Au XIe siècle, les responsables des émissions de monnaie sont encore quelquefois appelés
« monétaires », comme pour les siècles précédents10
. L’atelier est confié à un maitre d’atelier, qui accepte moyennant un bail de frapper de la monnaie pour le compte de l’autorité. C’est lui qui est chargé de négocier l’achat des matières premières et de s’assurer du fonctionnement de l’atelier. Les ouvriers vont travailler le métal précieux : ils vont fondre le métal et réaliser progressivement les flans, c’est-à-dire les petits disques de métal vierge, destinés à recevoir l’empreinte monétaire. Le graveur ou tailleur, va graver les coins monétaires. Ce sont les pièces d’acier, sur lesquelles l’empreinte monétaire sera gravée en négatif et quoi serviront à imprimer le motif sur les flans d’argent. La personne exerçant cette charge ne devait prendre part à aucun autre aspect de l’activité monétaire. On remarquera d’ailleurs que le graveur est absent de la scène. Les monnayers vont assurer la frappe de la monnaie à l’aide des coins fournis par le graveur et des flans fournis par les ouvriers. La frappe est réalisée « au marteau » à l’aide d’un coin fixe ou dormant, et d’un coin mobile, entre lesquels est placé le flan à frapper. L’essayeur est la personne chargée de la vérification du métal apporté à la frappe ainsi qu’au contrôle de la qualité des monnaies émises. Toutes ce processus se déroule sous la surveillance d’un ou plusieurs agents de l’autorité émettrice afin de contrôler chaque étape.
Frappe au marteau et coins monétaires usagés
10 Cf partie II la liste des ateliers mérovingiens. Un des plus célèbres monétaires est Eloi qui officia sous Dagobert. Il était
responsable de l’émission des monnaies. Sur les monnaies mérovingiennes, des VIe et VIIe siècles ce n’est pas le nom du
roi qui apparait mais celui du monétaire. Cependant, il faut prendre garde au fait que le nom monétaire n’est pas celui de
l’autorité politique qui exerce réellement le pouvoir sur la région où est situé l’atelier.
8
Techniques de gravure – points secrets Le graveur, généralement un orfèvre, doit « concrétiser » le dessin de la monnaie. Il a la difficile charge
de graver les motifs sur des coins d’acier. C’est lui qui va devoir placer également certains signes, qui permettront immédiatement à un œil averti de reconnaitre si la monnaie est bonne ou fausse, ou si elle provient de tel ou tel atelier, c’est ce qu’on appelle les points secrets.
La gravure se réalise principalement au XIe siècle à l’aide d’un burin et d’une série de poinçons. En effet, au moins depuis le Xe siècle, l’usage des poinçons s’est répandu. Ils représentaient une partie d’une lettre ou des motifs (triangle, demi-cercle, barre…), et évitaient de graver le motif dans son intégralité. En « imprimant » sur le coin le poinçon à l’aide d’un marteau, le graveur pouvait gagner un temps considérable
11.
La gravure commençait par la délimitation au compas des cercles dans lesquels la monnaie serait inscrite et qui allaient supporter les grenetis. Une fois ces délimitations obtenues, le grenetis était réalisé ainsi que le motif central et les lettres de la légende.
Les points secrets sont encore très peu relevés pour les XIe et XIIe siècles, notamment en l’absence de documents d’ordonnance qui précisaient ces détails obligatoires d’une part, mais également à cause des préjugés qui ont longtemps eu cours sur la gravure « barbare » de ce genre de monnaies. En effet, les érudits des XIXe et XXe siècles ont souvent considéré que ces graveurs étaient des personnes illettrées, se contentant de reproduire des formes sans rien y comprendre. Nous en avons pour notre part relevés quelques-uns en annexe 6.
Exemple de lettre gravée au burin ou poinçonnée : cas d’un « S »
Les coins s’usent très vite à la frappe, sous l’effet des coups de marteau. Pour un coin fiché dans le billot (coin dormant), il y avait souvent 2 ou 3 coins mobiles de gravés, ce qui permettait d’assurer la frappe durant toute la durée de vie du coin dormant. En effet, les coins mobiles recevant directement les coups de marteaux, leur durée de vie était plus réduite. Lorsqu’ils sont usés mais non cassés, tous ces coins peuvent être regravés afin de récupérer l’empreinte originale et d’éviter l’achat d’une nouvelle pièce. De même, le graveur réalise plusieurs « paires » de coins avant de démarrage de la frappe, afin de pouvoir occuper plusieurs monnoyers et de pallier aux défaillances éventuelles et aux usures. Les coins usagés sont détruits et le plus souvent refondus, ce qui explique le peu de coins subsistant aujourd’hui. Quantités frappées
12
Estimer les quantités frappées par une « paire » de coins est assez difficile. Dans le cas de notre étude, en l’absence de documents (comptabilité, baux de frappe…) nous avons repris l’estimation citées par Françoise Dumas et Marc Bompaire : une « paire » de coins frappe entre 5000 et 30000 monnaies. Plus la teneur en cuivre est élevée, plus le nombre de monnaies frappées par un coin diminue, le cuivre étant moins malléable que l’argent. Teneur en métal précieux : aloi
Le titre ou aloi de la monnaie est sa teneur en métal précieux Le titre de métal des monnaies d’argent s’exprimait en deniers : une monnaie d’argent pur était ainsi d’un titre ou d’une loi de 12 deniers. Chaque denier d’argent fin se subdivisait en 24 grains (initialement grain de blé ou d’orge). Aujourd’hui la teneur en argent est plus généralement exprimée en millièmes.
1 once = 24 deniers = 288 grains Une monnaie est dite en argent si elle contient plus de 6/12 d’argent fin, en billon si le cuivre est présent au-delà de ce rapport. Pour la période qui nous concerne, les monnaies sont encore quasiment toutes en argent, le titre allant en baissant progressivement. Cet aspect se remarque immédiatement : les monnaies d’argent sont blanches (monnaies blanches) alors que les monnaies de billon prennent un aspect noir (monnaies noires).
11 Bompaire-Dumas p 501 : un graveur affirmait qu’il lui fallait 1 semaine pour graver une paire de coins avec le seul burin,
alors que dans le même laps de temps il pouvait en réaliser quatre grâce au poinçonnage. 12 Bompaire-Dumas P531
9
La taille à la livre - au marc L’unité pondérale monétaire de référence utilisée depuis Charlemagne était la livre d’argent issue de la
livre romaine (327g). La détermination exacte de la valeur de cette livre utilisée sous Charlemagne fait l’objet de nombreuses discussions. Cependant, une estimation pour les années 794 lors de la réforme monétaire serait de 408 g
13. A partir du Xe siècle, une nouvelle unité d’origine anglo saxonne ou scandinave fait son apparition :
le marc d’argent, pesant environ 240 grammes, qui va devenir progressivement l’unité de référence en matière monétaire (Marc de Cologne 233.5g, Marc de Troyes 244.752g). Le marc de Cologne va devenir l’unité de poids d’Empire
14. Les ateliers monétaires vont progressivement adopter cette nouvelle mesure. Les cartulaires
régionaux font état de l’adoption de ce nouveau système au XIe siècle, en 1035 à Lyon15
, en Dauphiné en 1096.
Afin d’avoir un premier aperçu sur les poids des monnaies, nous pouvons estimer les poids moyens des deniers en fonction de l’unité pondérale dans laquelle ils sont calculés : Une taille de 240 deniers à la livre de 408 g donnerait une masse moyenne de 1.70 g par denier, tandis que nous obtenons la masse moyenne de 1.36 g par denier pour une taille de 240 à la livre romaine de 327 g. Pour le marc, une taille de 240 deniers nous donne une masse moyenne de 0.97 g pour le marc de Cologne et 1.02g pour le marc de Troyes.
Cependant, on retrouve dans les textes certaines mentions de taille de monnaies au marc. Il est nécessaire de faire la distinction entre le marc d’argent fin et le marc de métal d’alliage cuivre-argent qui sera utilisé pour réaliser effectivement les monnaies. Par exemple à Vienne, en 1100-1110 il est stipulé que les monnaies sont taillées à 20 sols du marc
16. A la fin du siècle, on précise qu’elles ne sont plus taillées qu’à 40
sols du marc. Cela ne signifie pas que le poids des deniers a été réduit de moitié, mais qu’on a réduit de moitié leur contenance en métal précieux. Le rédacteur parle du marc d’argent fin et de la quantité concrète d’argent présente dans les monnaies, pas de leur poids sur la balance. LE DENIER AU TEMPLE : MODELE REPRIS PAR UNE GRANDE PARTIE DES MONNAYAGES REGIONAUX DE L’EX EMPIRE CAROLINGIEN Afin de comprendre un des principaux types monétaires que nous allons retrouver tout au long de cette étude, il est nécessaire de présenter le denier dit « à la légende chrétienne ». Charlemagne est le premier à émettre, lors de la réforme de 812, un denier portant un temple romain pour motif, avec une légende dite « chrétienne » « XPISTIANA RELIGIO ». Son fils, Louis le Pieux va généraliser ce monnayage à l’échelle de l’Empire. Alors qu’auparavant, les ateliers émettaient des monnaies portant clairement le nom du lieu de fabrication, ces émissions au temple et à la légende chrétienne vont ôter toute référence locale, créant une sorte de monnaie unique, rendant du même coup beaucoup plus difficile toute tentative d’identification précise. Ce type connaitra un grand succès et perdurera sous forme dégénérée dans une grande partie de l’Europe, de la Normandie à l’Italie, jusqu’au XIV e siècle. Deniers carolingiens
Denier originel de Charlemagne Le denier de Louis le Pieux
Denier de Charles le Chauve pour Paris Denier au nom de Lothaire Ier (840-855), frappé à Dorestaadt
13 Depeyrot P 17 14
Ladé Les deniers mauriçois, leçon inaugurale , Bulletin de la Société Suisse de Numismatique 1890 15
Jeanprêtre J. : Les deniers épiscopaux de Genève et Lausanne d’après les documents du XIe au XIIIe siècle. Pour Lyon
cartulaire de Savigny Paris 1853 T1 P701, pour le Dauphiné, cartulaire de l’abbaye st Chaffre du Monastier P 141 « unum
marcum argenti » 16 Cartulaire C de Grenoble charte n° CXV
10
France
Normandie : denier au nom de Richard Ier (942-996) Lothaire II (954-986) denier de Bourges
Tours : denier de l’abbaye Saint Martin
Royaume de Bourgogne
Denier de Rodolphe III pour Lyon Genève, denier de l’évêque Conrad
Empire Germanique
Otton II (973-983) , denier de Regensburg Cologne : Conrad II et l’archevêque Pilgrim Italie
Conrad II Empereur : Venise Henri III Empereur : Venise





















![[Ed]. Où en est l’histoire du temps présent ? Notions, problèmes et territoires, Dijon, Université de Bourgogne, 1998.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633562d302a8c1a4ec01bf3f/ed-ou-en-est-lhistoire-du-temps-present-notions-problemes-et-territoires.jpg)