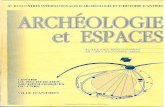Rencontres d'ethnographie 2015_Panel Ethnométhodologie et Analyse Conversationnelle
-
Upload
univ-paris5 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Rencontres d'ethnographie 2015_Panel Ethnométhodologie et Analyse Conversationnelle
Rencontres Annuelles d’Ethnographie de l’EHESS
Atelier « Ethnométhodologie, analyse conversationnelle et ethnographie : des affinités sélectives ? »
Jeudi 15 octobre 2015, 9h-12h, 105 boulevard Raspail – salle 4 Organisé par Yaël Kreplak (Labex CAP, associée CEMS-IMM, EHESS) & Chloé Mondémé (ANR Licornes, GEMASS) Discutante : Julia Velkovska (SENSE – Orange Labs, associée CEMS/IMM – EHESS) PROGRAMME NB. 35 minutes par présentation (25 minutes de présentation + 10 minutes de questions) Déroulé 9h-9h10 Ouverture, par Yaël Kreplak & Chloé Mondémé 9h10-9h45 Hélène Guiéry 9h45-10h20 Maëlle Meigniez 10h20-10h30 pause 10h30-11h05 Alexander Lutsenko 11h05-11h35 Lucie Alidières-Dumonceaud 11h35-12h Discussion, par Julia Velkovska TEXTE DE L’APPEL Pour participer à la réflexion sur le renouveau de l’ethnographie en sciences sociales, cet atelier se propose d’examiner quelques-uns de ses enjeux tels qu’ils se formulent dans le domaine de l’ethnométhodologie et de l’analyse conversationnelle (EM/AC). Ces approches nous semblent en effet apporter une contribution majeure – quoique relativement méconnue – au renouvellement de l’enquête ethnographique, qui ne tient pas seulement à l’introduction de méthodes et d’outils d’analyse, comme l’usage de la vidéo et la pratique de la transcription des échanges conversationnels, mais aussi à une conception réflexive et potentiellement critique de la démarche ethnographique, susceptible d’accompagner une interrogation sur ses fondements, transformations et limites. La relation de l’EM/AC à l’ethnographie est en effet, depuis l’origine, caractérisée par une forme de tension qui a trait aux manières de prendre en compte, dans la description et l’analyse, éléments contextuels et connaissances d’arrière-plan. D’un point de vue interne à la discipline, cette tension entre approches plus ou moins internalistes et externalistes a pu occasionner des lignes de partage fortes : entre ethnométhodologie et analyse conversationnelle d’une part, mais aussi entre les différentes manières de pratiquer l’une et l’autre. Elle a également favorisé le développement d’un appareil notionnel, dont la discussion est au cœur de l’identification de la mentalité propre à ces approches : la compétence de membre, le principe d’adéquation unique, l’indifférence ethnométhodologique, le regard non motivé sur les données... Dans la continuité des affinités « mutuelles », « limitées » et « additionnelles » évoquées par Maynard (2003), on aimerait donc rendre compte de dynamiques actuelles, en partant des manières qu’ont les chercheurs de combiner ethnométhodologie, analyse conversationnelle et ethnographie, et de problématiser les liens entre ces démarches. Les enjeux de l’atelier seront ainsi principalement de deux ordres.
D’une part, il s’agira de réfléchir aux spécificités de la pratique ethnométhodologique et conversationnaliste de l’ethnographie, à partir d’exemples concrets d’enquête et en s’appuyant sur la discussion précise de certains concepts au cœur de ces démarches. On attend sur ce point que les contributeurs explicitent leurs méthodes, à différents niveaux : relation au terrain, production des données et analyse. D’autre part, on sera sensible aux propositions qui interrogent, par exemple, la nature proprement ethnographique d’opérations telles que la production de vidéos ou la transcription : il s’agira par là d’examiner en quoi les approches EM/AC peuvent apporter un éclairage sur les transformations contemporaines de l’ethnographie, en revisitant certaines de ses caractéristiques (telles que l’observation directe ou la prise de note). RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS 1/ Hélène Guiéry (GRAP, Université Libre de Bruxelles et CEMS-IMM, EHESS) La posture d’analyste-en-tant-que-membre : Vers un renouvellement radical du recueil de données dans l’enquête ethnographique ? Les luttes contre les « grands projets inutiles et imposés » (GPII) se développent aujourd’hui sous une forme nouvelle d’action politique : l’occupation illégale du terrain destiné à accueillir une grosse infrastructure. Les recherches menées conduisent l’analyste à s’impliquer dans plusieurs environnements extrêmement conflictuels où se côtoient différents imaginaires politiques en tension. Cette implication a une première conséquence de méthode : renoncer à parler d’ « enquêtés », terme qui marque une asymétrie entre l’observateur et observé (Clifford, 1986) ou de « terrain », qui marque une forme d’exorcisation de l’empirisme (Müller, 2015). Les données produites ne sont pas « des données de première main » (Platt, 1994) mais des données constituées dans un second temps sous la forme de compte-rendu analytique personnel. Elles sont ainsi bien loin des standards figés de l’ethnographie puisque le travail de l’analyste-en-tant-que-membre est au centre de la démarche ethnographique. Par la diversité de leurs points de vue, les membres-participants-à-la-lutte produisent un ordre que l’on pourrait qualifier, à la suite de Lena Jayyusi, de conflictuel. Pour cette dernière, le « conflit » peut être considéré comme « une caractéristique de l’organisation, de la descriptabilité et justifiabilité des activités des participants » dans un environnement marqué par un affrontement politique. La position d’analyste-en-tant-que-membre permet de « démontrer comment les membres eux-mêmes, dans pareils environnements, découvrent, expliquent et parlent des règles, procédures et principes locaux par lesquels de tels environnements sont organisés [...] en vue de régler les affaires qui les concernent » (Jayyusi, 2010). Mon intervention dans cet atelier entend rendre compte et débattre de la démarche d’enquête réflexive et critique qui place en son cœur l’un des fondements de l’approche ethnographique dont « le principal médium de l’enquête est ainsi l’expérience incarnée de l’enquêteur » (Cefaï, 2010). Elle permettra également d’interroger deux points aveugles de la démarche ethnographique au prisme de l’ethnométhodologie : celle de possibilité même d’être membre et analyste dans une activité politique et celui de la trahison, compris comme ce qu’il est possible de décrire dans une situation conflictuelle sans porter atteinte à ceux qui conduisent la lutte. À partir de quelques descriptions du site à partir duquel je réalise mes recherches empiriques par implication directe, je voudrais apporter des éléments de réponse à une question : que veut dire "manifester une adéquation unique" (Garfinkel, 2007) lorsque la pratique étudiée est celle d'un groupe de militants politiques ?
Mots-clés : situation conflictuelle, membre, adéquation unique, expérience incarnée, compte-rendu analytique personnel Notice biographique : Hélène Guiéry est actuellement doctorante en science politique et sociale au Groupe de Recherche sur l’Action Publique (GRAP) de l’Université Libre de Bruxelles et en sociologie au Centre d’Étude des Mouvements Sociaux (CEMS-IMM) de l’EHESS. Croisant philosophie morale, herméneutique et sociologie de l’action, son travail de thèse est consacré aux liens entre imaginaire politique et expérience contestataire. Inscrites dans une démarche ethnographique, ses recherches empiriques interrogent la conception du chercheur, du « terrain » et l’ « enquêté » lorsque l’analyste est elle-même prises dans les cours d’action vécus/observés. 2/ Maëlle Meigniez (Institut des Sciences Sociales, Université de Lausanne) Ethnographier l’institution : participer et devenir membre dans une association d’aide Prendre pleinement parti de la participation de l’ethnographe sur son terrain est l’un des nombreux apports que l’ethnométhodologie et l’analyse de conversation peuvent offrir à l’approche ethnographique. Plus qu’une simple méthode d’observation-participante, il s’agit alors de penser l’ethnographie comme une véritable démarche d’enquête, impliquant un positionnement épistémologique particulier. En participant, le chercheur peut ainsi devenir et être considéré comme membre, mettant en évidence le processus par lequel non seulement il se familiarise avec son terrain, mais acquiert également des savoirs ordinaires propres au groupe étudié et qui constituent son objet d’étude. A partir d’une enquête ethnographique dans une association d’aide en Suisse romande, je montrerai la variété des places occupées par l’ethnographe et les implications des divers degrés de participation. Mes analyses, prenant appui sur l’ethnométhodologie et l’analyse de conversation, permettent en effet de rendre compte des différentes manières dont les acteurs se rapportent à moi sur le terrain, tantôt observatrice externe, tantôt membre à part entière. Au delà de ces considérations méthodologiques, mon intervention visera également à revenir sur une question sociologique fondamentale, celle de l’institution. En effet, la démarche ethnographique telle que proposée ici ouvre des pistes pour réinvestir ce grand être. Ethnographier l’institution, ce n’est pas seulement observer et décrire les différents lieux d’action et d’apparition de l’association étudiée, c’est également rendre compte de la manière dont cet être est rendu présent et peut agir sur les situations. Mots-clés : Association d’aide, Institution, Ethnométhodologie, Membre, Participation. Notice biographique : Doctorante et assistante d’enseignement et de recherche à l’Institut des Sciences Sociales de l’Université de Lausanne, Maëlle Meigniez mène, dans le cadre de sa thèse en sociologie, une enquête ethnographique au sein d’une association d’aide en Suisse romande. Dans une démarche combinant plusieurs approches (principalement l’ethnométhodologie, l’analyse de conversation et la sociologie pragmatique), sa recherche vise à interroger l’action politique de l’association en ce qu’elle participe à la constitution et au traitement de certains problèmes publics, par une analyse des expériences situées des acteurs. 3/ Alexander Lutsenko (LIER-IMM, EHESS et Institut de sociologie de l’académie des sciences de Russie) Les oligarques en direct : mobiliser l’analyse de conversation comme dispositif de description pour l’étude d’interviews télédiffusées
La présentation se fonde sur la recherche, que je mène dans le cadre de ma thèse de doctorat, sur la nouvelle élite économique russe à travers l’interview télédiffusée. Elle vise à examiner à quel point la recherche sociologique à orientation ethnographique peut bénéficier de l’application de l’appareil de l’analyse conversationnelle. Cette dernière est ainsi prise non pas comme un programme analytique auto-suffisant, focalisé sur ses questionnements traditionnels de l’analyse d’organisation de l’interaction verbale, mais comme un dispositif de description particulièrement fin. Celui-ci permet de mieux comprendre la structure de l’action et les orientations qui la sous-tendent. Je me suis inspiré de l’argument selon lequel le questionnement sur la nécessité de prendre en compte un contexte élargi n’est pas pertinent pour l’AC. Mieux vaut traiter les phénomènes que cette dernière prend en considération - les modes d’organisation de conversation - comme contexte sur le fond duquel les autres activités en lien avec les exigences pragmatiques de la situation se déploient (Schegloff 1987). Ceci m’a mené à me demander en quoi les modalités de déploiement de l’interaction verbale et surtout les défauts, les blocages et les troubles qui l’accompagnent peuvent être révélateurs de contraintes pratiques qui pèsent sur l’acteur. Mots-clés : Analyse de conversation, interview télédiffusée, élite économique russe, trouble, contrainte Notice biographique : Alexander Lutsenko, diplômé de l’Université d’Etat de Moscou en linguistique appliquée et ayant obtenu un Master 2 en sociologie à l’EHESS est actuellement doctorant en sociologie au LIER-IMM-EHESS et à l’Institut de sociologie de l’Académie des sciences de Russie. Une grande partie de sa recherche de thèse, consacrée à l’étude de la nouvelle élite économique russe, est fondée sur l’analyse des interviews télédiffusées avec les représentants de ce groupe. Combinant l’analyse conversationnelle avec les approches de la sociologie pragmatique, il vise à montrer que l’interview n’est pas seulement une interaction verbale entre l’interviewer et l’interviewé, mais aussi un lieu ou se déploient des rapports de pouvoir et des logiques de publicité. 4/ Lucie Alidières-Dumonceaud (Praxiling) Caméra et expérience de terrain : processus de recherche en analyse de conversation Les recherches ethnographiques, utilisant l’enregistrement vidéo comme mode de captation de situations, révèlent le caractère « sensible » (Christin & Pasquali 2011) de certains terrains, parce qu’ils « portent sur des pratiques illégales ou informelles, des individus faisant l’objet d’une forte stigmatisation et sur des situations marquées par la violence, le danger et/ou la souffrance » (Bouillon et al. 2005 : 13-14). Dès lors, la caméra permet de saisir des moments spécifiques de la situation enquêtée. Du point de vue de l’analyse de conversation d’inspiration ethnométhodologique, l'usage de la caméra s’inscrit dans un processus complexe d’entrée sur le terrain, de recueil des données, de leur analyse et restitution. Dans ces deux dernières phases de l’enquête, la caméra peut être perçue comme un prolongement de l'expérience du chercheur in situ, voire caractérisée comme prothèse perceptive, c’est-à-dire permettant au chercheur de retrouver les concrétudes des activités sociales enregistrées. Le chercheur examine maintes fois les enregistrements, se concentre sur des phénomènes inhérents à la structuration des interactions. Nous souhaitons contribuer à cette réflexion générale en présentant une série de séquences interactionnelles au cours desquelles les participants prennent en compte la caméra. Nous analysons plusieurs phénomènes particuliers multimodaux. Par exemple, celui du body torque (Schegloff 1998), une distorsion du corps qui permet aux participants de considérer des foyers d’attention multiples, ici un enseignant prend en compte à la fois l’interaction pédagogique et le dispositif de recherche (chercheur et caméra). Ces données sont examinées dans des activités pédagogiques, elles-mêmes
enregistrées au cours de deux études ethnographiques en contexte carcéral. La première est menée dans une prison de haute sécurité ; les activités enregistrées sont des enseignements de disciplines et de niveaux différents, des entretiens et des réunions pédagogiques. La seconde est conduite en maison d’arrêt dans le cadre de l’expérience Cyber Base justice. Plusieurs entretiens et activités de formation à l’usage d’Internet sont filmés. Toutes ces données sont anonymées de façon à conserver les indices visuels, corporels et sonores. Mots clés : caméra, interaction pédagogique, prison, analyse de conversation. Notice biographique : Post-doctorante en sciences du langage au laboratoire Praxiling UMR 5267 Université Paul-Valéry Montpellier 3 – CNRS dans le cadre du projet d’excellence IDEFI UM3D, mes axes de recherche s’inscrivent dans le champ de l’analyse de conversation, de la linguistique interactionnelle et de l’ethnographie. Elles intégrent des thématiques comme la pédagogie numérique, l’environnement carcéral ou encore l’addiction au jeu.