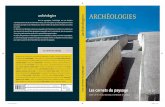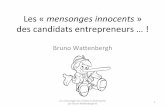« Les forteresses urbaines de Málaga dans les récits des voyageurs arabes (Xe-XVe siècles) »,...
Transcript of « Les forteresses urbaines de Málaga dans les récits des voyageurs arabes (Xe-XVe siècles) »,...
Sommaire
Avant-propos ...................................................................................... 9Christine Mazzoli-Guintard, Les forteresses urbaines de Málaga dans
les récits des voyageurs arabes (xe-xve siècles) ................................. 11Iris Maer De Souza Taveira, Châteaux et voyages dans la littérature
vernaculaire du xiie siècle ........................................................... 29Philippe Mignot, Jean l’aveugle, un roi en mouvement (1311-1346) ..... 41Hervé Mouillebouche, Le château dans les récits des grands
voyageurs au Moyen Âge ............................................................ 57Tadeusz Poklewski-Koziell, Le voyage dans les châteaux royaux de
Grande Pologne de trois députés polonais en service (1564-1565) 93Guillaume Poisson, Le château de Chillon sous la plume des voyageurs
à l’époque moderne ................................................................... 99Antoine Eche, Des murs empourprés de sang : l’imaginaire du château
de Blois dans les écrits de voyages français et anglais des xviie et xviiie siècles ............................................................... 113
Alain Sebbah, Un voyageur sans nostalgie ? ........................................... 127Claude Petitfrère, La visite à Chanteloup, ou la cour de Choiseul ........... 141Thomas Fouilleron, Miroir du prince. Le palais de Monaco vu par
les voyageurs français (xvie-xixe siècles) ........................................ 157Milena Lenderová, Châteaux de voyageuses (1782-1914) ..................... 179Grégoire Franconie, Voyage au château et mariage dynastique
dans la France de Louis-Philippe ............................................... 191Claude-Isabelle Brelot, La monarchie retrouvée : l’Allemagne
dans les voyages d’un légitimiste français (1837-1848) ................ 205Juliette Glikman, Le tour de France de Louis-Napoléon, de l’esquive
des châteaux à la conquête des Tuileries ...................................... 225Christina Egli, Le château d’Arenenberg, en Suisse, et ses visiteurs célèbres 241Bertrand Goujon, Voyageurs et visiteurs dans les châteaux du
département de la Marne au xixe siècle ....................................... 259Laure Hennequin-Lecomte, Pèlerins du château de Vizille : itinéraires
d’une géographie sensible et citoyenne au tournant de la période contemporaine ...................................................... 275
Yves-Marie Bercé, Conclusion .............................................................. 289
Actualités de l’archéologie en Aquitaine
Bilan de l’archéologie médiévale en Aquitaine pour l’année 2008, extraits réunis par Hélène Mousset .......................................... 297
Les forteresses urbaines de Málaga dans les récits des voyageurs arabes (xe-xve siècles)
Christine Mazzoli-Guintard
Voyages et voyageurs ont souvent retenu l’attention des médiévistes1, attention toujours vive, comme en témoignent le 40e Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, consacré aux Déplacements de populations et mobilité des personnes au Moyen Âge (Nice, 4-7 juin 2009), la XIXe Semana de Estudios Medievales (Nájera, 4-8 août 2008), autour de Viajar en la Edad Media, le 130e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, paru en 2008 et intitulé Les voyageurs au Moyen Âge ou encore, et pour donner quelques exemples, les collectifs Voyageurs au Moyen Âge et Ciudades y viajeros, publiés respectivement en 2007 et 2005. À cette thématique du voyage, les Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord suggèrent une voie de réflexion nouvelle, celle du couple châteaux-voyages, décliné sur le thème du regard extérieur que portent des voyageurs sur les châteaux : cadres de vie au départ du voyage, sur le chemin ou au terme du déplacement, les châteaux deviennent des impressions de voyageurs qui en dessinent les formes et les remodèlent au gré de leurs souvenirs, souvent fixés dans des récits de voyage.
Al-Andalus, terre de forteresses2, peut contribuer à la réflexion, d’autant que les voyageurs arabes, qui la parcourent dès le xe siècle, ont laissé de leurs déplacements un certain nombre de témoignages, bien connus au demeurant3 : nombre de récits de voyages ont fait l’objet d’études, portant sur un voyageur ou offrant une vision plus large des liens entre récits de voyage et al-Andalus, voire entre voyage et Islam4. Les motifs du voyage en al-Andalus ont été signalés à maintes reprises. Ils sont à chercher dans la quête de savoirs que mènent inlassablement les ulémas, mais aussi dans le commerce ou dans le service de l’État, voire dans des raisons strictement personnelles, celles qui poussent à rechercher des eaux thermales, celles qui unissent départ et vie sauve : Ibn al-Ḫaṭīb (1313-1375), figure littéraire majeure du royaume naṣride, vizir de Muḥammad V (1354-1359/1362-1391), voyage dans le royaume de Grenade et à l’extérieur de celui-ci autant pour parfaire ses connaissances
1 Parmi les colloques des années 1980-1990, citons L’homme et la route 1982, Viajeros, peregrinos, mercaderes 1992, Voyages et voyageurs au Moyen Âge 1996.
2 Al-Andalus ne connaissant ni la seigneurie ni le système féodo-vassalique, il est préférable de désigner le lieu fortifié qui défend un territoire ou une ville par forteresse et non par château.
3 Il existe également de nombreuses études sur les voyageurs d’al-Andalus partis vers l’Orient en pèlerinage ; si elles n’entrent pas directement dans notre thématique, elles peuvent l’enrichir d’une dimension comparatiste.
4 Ghouirgate 1995 ; Touati 2000.
12C
hris
tine
Maz
zoli-
Gui
ntar
d
que pour inspecter les places fortes de la frontière5 ou pour remplir des missions diplomatiques. Ambassadeur du sultan au Maghreb et sans doute également auprès des rois chrétiens de la Péninsule, ses voyages suivent les vicissitudes de la carrière politique de Muḥammad V6. Après le coup d’état de 1359, il le suit dans son exil au Maghreb et revient à Grenade lorsque Muḥammad V reprend le trône en 1362, puis, ayant suscité des jalousies à la cour, Ibn al-Ḫaṭīb se voit contraint à un dernier voyage vers le Maghreb en décembre 1371, voyage qu’il présente comme un besoin de méditation spirituelle7. Connaître les raisons, réelles ou invoquées, qui président au déplacement permet d’analyser le regard que le voyageur porte sur les forteresses qu’il visite ou qu’il aperçoit au bord du chemin ; la distorsion entre le récit et les réalités est inévitable car, dans la description d’une forteresse par le voyageur, sont esquissés tout autant les traits de celui qui voyage que les formes de la forteresse observée. Cette distorsion peut être en partie jaugée en rapprochant le récit du voyageur des données matérielles, des vestiges de la forteresse, qu’ils soient conservés en élévation ou enfouis dans le sol et mis au jour par l’archéologie.
Si al-Andalus peut aisément contribuer à la réflexion, encore faut-il limiter l’enquête à un cas de figure permettant de croiser les sources et les regards : le choix de Málaga tient à la présence de ses forteresses dans plusieurs récits de voyageurs arabes, dont l’un, celui de `Abd al-Bāsiṭ, contient un témoignage remarquable par le regard posé sur l’intérieur de l’Alcazaba ; il tient aussi à ces tours et courtines qui dominent toujours le paysage malaguène et qui forment l’une des plus imposantes et des plus complexes fortifications du legs andalusí, certes maintes fois remaniée au fil des siècles, voire entièrement reconstruite par endroits : la porte de Los Arcos, détruite au xixe siècle, a ainsi été complètement refaite dans les années 19308. Commençons donc par planter le décor, celui des forteresses de Málaga, sur lesquelles se pose le regard des voyageurs.
Sous l’œil du voyageur, les forteresses de Málaga
Les faiblesses de l’historiographie : des forteresses mal connues
Málaga offre toujours au regard du visiteur ses deux imposantes forteresses, l’Alcazaba et le Castillo de Gibralfaro9, placées sur des buttes à l’est de la ville, reliées
5 Bosch Vilá & Hoenerbach 1981-1982.6 Damaj 2005. 7 Ibid., 115-116.8 Torres Balbás 1985, 499.9 Nous utilisons pour les désigner les termes en usage aujourd’hui. Dans les textes
médiévaux, la première est dite al- qaṣaba, le second ḥiṣn.
13Les forteresses urbaines de M
álaga
l’une à l’autre par une double ligne de murailles, la coracha10, ce qui les rend encore plus présentes dans le paysage urbain (fig. 1) : elles ne peuvent échapper au regard, que le voyageur arrive par la mer ou par la terre.
Ces forteresses, en revanche, n’ont suscité que tardivement l’attention des érudits : la description de l’Alcazaba qui figure dans l’ouvrage sur Málaga musulmane publié par F. Guillén Robles en 1880 n’est qu’une “vaste compilation des descriptions des auteurs médiévaux et modernes” selon A. Orihuela Uzal11. Pour J. Ordóñez Vergara, l’historiographie relative à l’Alcazaba est “partiale, insuffisante, parfois inadéquate”12, et, comme l’affirme plus brutalement et plus globalement C. Peral Bejarano, Málaga est “une ville sans tradition historiographique, qui s’est trouvée à l’écart de la tradition humaniste”13. Cette indifférence aux traces du passé laisse disparaître la muraille urbaine, démolie en 1907 sans aucun relevé préalable. Les forteresses de la ville suivent le même sort, l’Alcazaba ayant déjà perdu une partie
10 Il est d’usage de désigner ainsi cette ligne de murailles à Málaga, même s’il ne s’agit pas d’une coracha au sens strict : le terme renvoie d’ordinaire à une muraille perpendiculaire à l’enceinte urbaine, descendant jusqu’à la rivière et permettant l’approvisionnement en eau.
11 Orihuela Uzal 1996, 357. Sur les érudits de l’époque moderne qui ont, dans le meilleur des cas, produit une description visuelle sommaire de l’édifice : Ordóñez Vergara 2000, 95-111.
12 Ibid., 111.13 Peral Bejarano 1994, 101.
Fig. 1. Plan de Málaga
14C
hris
tine
Maz
zoli-
Gui
ntar
d
de son enceinte méridionale lorsque R. Amador de los Ríos recense les monuments historiques et artistiques de la province de Málaga14.
En 1951, M. Gómez-Moreno consacre quelques pages à l’Alcazaba du xie siècle dans un ouvrage général d’histoire de l’art15 et la première publication scientifique qui envisage l’Alcazaba comme un ensemble monumental date de 196016 : elle est due à l’architecte L. Torres Balbás, chargé des fouilles et de la restauration de l’Alcazaba à partir du moment, en juin 1931, où celle-ci est déclarée Monument Historique National17. En 2000, J. Ordóñez Vergara fait paraître une synthèse qui envisage l’Alcazaba dans une perspective historique. Il met en lumière les phases constructives du monument et les étapes de restauration qui affectent plus de la moitié du monument, la quasi totalité des éléments architectoniques des patios provenant des travaux de reconstruction18. Si la connaissance du monument a progressé, beaucoup reste à faire, à commencer par “l’étude approfondie des murs en élévation [d’autant que] les interventions archéologiques n’ont jamais été publiées correctement [et qu’il] n’existe toujours pas de Plan Directeur qui organise et hiérarchise les opérations de fouilles et de conservation”19.
Les insuffisances signalées à propos de l’Alcazaba sont encore plus criantes autour du Castillo de Gibralfaro : comme l’écrivaient, en 1995, Ma I. Calero Secall et V. Martínez Enamorado, “faute d’une étude globale sur le château, il faut suivre les considérations exposées par L. Torres Balbás”20, autrement dit en rester aux données mises en forme en 1960. Si nos connaissances des forteresses de Málaga demeurent bien insuffisantes, elles peuvent toutefois jeter quelque lumière sur les distorsions observables entre les récits et les réalités : la reconstruction des années 1930-1940 se fit certes avec force licence décorative, mais elle s’effectua sur les bases des murs, de telle sorte que la disposition des pièces ressemble à ce qu’elle devait être à la fin du Moyen Âge21.
Au cœur du dispositif fortifié : l’Alcazaba
Pour s’en tenir à leur histoire andalusí, les forteresses de Málaga résultent d’une série de processus constructifs qui s’étalent entre le xe et le xive siècles ; la pièce
14 Ordóñez Vergara 2000, 107.15 Gómez-Moreno 1951, 243-250, décrit les palais des souverains du xie siècle.16 Torres Balbás 1960. 17 Sur les étapes des travaux menés de 1933 à 1944, Orihuela Uzal 1996, 364-366.18 Ordóñez Vergara 2000, 155. Pour une mise au point bibliographique récente sur Málaga :
Viguera Molins 2009. 19 Pérez-Malumbres Landa & Martín Ruiz 2009, 71.20 Calero Secall & Martínez Enamorado 1995, 376.21 Pérez-Malumbres Landa & Martín Ruiz 2009, 70. Il faut renoncer à parler de
restauration comme l’a écrit avec justesse L. Torres Balbás (1960, 38) : “on ne peut parler de restauration pour les Cuartos de Granada, puisqu’il en subsistait à peine quelques vestiges”.
15Les forteresses urbaines de M
álaga
maîtresse en est l’Alcazaba dont la mise en place comme enceinte défensive débute avec le califat, lorsque Málaga devient chef-lieu de district22 : à la base de certains parements est présent l’appareil a soga y tizón, si caractéristique du xe siècle23. Ce n’est toutefois qu’au xie siècle qu’est édifié un ensemble à la fois palatin et militaire, lorsque Málaga devient le siège du califat ḥammūdide, dont les souverains font d’importants travaux dans leur capitale, en particulier dans la citadelle qui abrite non seulement leur résidence, mais aussi une garnison pour laquelle est mis en place un petit quartier résidentiel24. Vers 1057, Málaga est annexée par Bādīs, le souverain zīride de la taifa de Grenade ; il poursuit les travaux d’urbanisme entrepris dans la citadelle, “comme personne d’autre n’aurait pu le faire, l’approvisionnant de tout le nécessaire pour résister aux pires épreuves”25. Sous les Naṣrides (1237-1492), Málaga devient, après la capitale, la ville la plus importante du royaume de Grenade et son principal port : la citadelle est fortifiée par l’ajout de structures défensives, par le renforcement des parements des murs, alors revêtus de maçonnerie, par la croissance en hauteur et en tapial de certains éléments26. La Puerta de Cristo, entrée en coude ouverte dans une tour, est ainsi refaite à l’époque naṣride, mais son passage intérieur présente toujours des vestiges d’appareil du xie siècle27. Après la conquête castillane de 1487, l’Alcazaba perd son rôle de centre névralgique pour la ville, ce qui va entraîner une progressive détérioration de l’ensemble fortifié, détérioration qui s’accentue à l’époque moderne jusqu’à sa démilitarisation, ordonnée en 1786, et la construction de maisons dans l’ancienne citadelle : ce quartier, qui comptait quelque 500 habitants vers 1820, existe jusqu’en 193128.
L’Alcazaba reproduit la forme de la butte parallèle à la côte qui la porte, celle d’un prisme allongé, orienté d’est en ouest ; elle est constituée de trois enceintes fortifiées et emboîtées, donnant à l’ensemble un aspect complexe de murs enchevêtrés qui ne peut manquer de frapper le regard29 (fig. 2). L’enceinte extérieure, dont la disposition originale est maintenue, forme la seule voie d’accès depuis la ville : ses 191 m de périmètre enferment une série d’éléments défensifs, la Puerta de la Bóveda,
22 Íñiguez Sánchez et al. 2003, 35. Málaga devient le chef-lieu de la cora de Rayya à la place d’Archidona dès 919 selon Calero Secall & Martínez Enamorado 1995, 20.
23 Pavón Maldonado 1992 ; Íñiguez Sánchez et al. 2003, 43.24 Les Ḥammūdides (1013-1056), qui prétendent à la succession des Omeyyades, tentent
de s’installer à Cordoue, avant de se replier sur Málaga à partir des années 1020 ; sur cette histoire politique complexe, Bosch Vilà 1987. Le quartier, né au xie siècle, est toujours occupé au xiie siècle (Torres Balbás 1945).
25 `Abd Allāh 1981, 114.26 Ordóñez Vergara 2000, 160-162.27 Ibid., 175.28 López Guzmán coord. 2002, 884.29 L’Alcazaba est décrite par Puertas Tricas 1987, Pavón Maldonado 1992, Calero Secall &
Martínez Enamorado 1995, 315-373, Ordóñez Vergara 2000, López Guzmán coord. 2002, 883-887, Íñiguez Sánchez et al. 2003, 43.
16C
hris
tine
Maz
zoli-
Gui
ntar
d
Fig. 2. Plan de l’Alcazaba (d’après Gómez Moreno 1951).
1 : Entrée. – 2 : Puerta de la Bóveda. – 3 : Puerta de las Columnas. – 4 : Arco del Cristo. — 5 : Place d’armes. – 6 : Torre de la Vela. – 7 : Arcos de Granada. – 8 : Cuartos de Granada (xiie s.). – 9 : Salle du xvie s. – 10 : Palais nasrides (xiiie - xive s.). – 11 : Citerne. – 12 : Bain. – 13 : Quartier
des maisons.– 14 : Torre del Homenaje. – 15 : Accès au Gibralfaro.
17Les forteresses urbaines de M
álaga
à l’extrémité de l’ensemble, qui donne sur une rampe d’accès coudée, puis la Puerta de las Columnas qui ferme cette rampe et s’ouvre sur un espace plus large donnant accès, par la Puerta de Cristo, à la deuxième enceinte. Celle-ci est une ceinture défensive de quelque 700 m de long, dotée de nombreuses tours de flanquement, rectangulaires, massives et de faible saillant qui rappellent l’époque califale, sans pour autant indiquer une chronologie aussi haute30 : cette enceinte, qui protégea peut-être une mosquée31, est mise en place au xie siècle et consolidée à l’époque naṣride ; à l’extrémité orientale, une porte permet de se diriger vers le Castillo de Gibralfaro. Au cœur de cette fortification se trouve la troisième enceinte, à laquelle donne accès la porte dite Arcos de Granada32.
Cette enceinte intérieure, de 440 m de périmètre, protège la zone palatine et la zone de services qui la dessert. La première, dite Cuartos de Granada après la conquête castillane, compte trois palais placés en enfilade et organisés autour d’un patio rectangulaire33 : le Patio de los Surtidores, réformé aux époques almohade et naṣride, remonte au xie siècle34 ; le Patio de los Naranjos et le Patio de la Alberca sont édifiés à l’époque naṣride, dans la seconde moitié du xiiie siècle ou dans la première moitié du xive siècle35. Quant à la zone de services, un réseau de ruelles donne accès à une citerne, à des bains, et à un ensemble de maisons destinées à la garnison36 ; c’est aujourd’hui la partie la moins bien conservée de l’Alcazaba, les restes du petit bain ayant disparu sous la végétation et ayant perdu une partie des matériaux utilisés pour le restaurer37. L’enceinte intérieure s’achève, à son extrémité orientale, par la Torre del Homenaje, édifiée à l’époque naṣride sur une tour antérieure plus petite ; de dimensions imposantes – 12,3 m sur 12,15 m –, pourvue de trois étages, elle protège la voie d’accès vers le Castillo de Gibralfaro, ouverte dans la deuxième enceinte38.
30 Ces tours indiquent simplement le maintien de modèles précédents : Ordóñez Vergara 2000, 174.
31 Les sources textuelles indiquent la présence d’une mosquée du vendredi dans l’Alcazaba, édifice cultuel qui fonctionne au moins jusqu’au xive siècle : il faut la chercher dans le Castillo de Gibralfaro selon Martínez Enamorado 1991-92, ou, ce qui paraît plus plausible, et selon Ordóñez Vergara 2000, 179-180, dans la partie basse de la deuxième enceinte de l’Alcazaba, soit vers la place d’armes. Qu’elle ait été édifiée au viiie siècle par un traditionniste syrien comme le veut le géographe al-Ḥimyarī relève du mythe : Calero Secall & Martínez Enamorado 1995, 203-207.
32 López Guzmán coord. 2002, 883-887.33 Une belle présentation de ces palais figure dans Orihuela Uzal 1996.34 Orihuela Uzal 1996, 357-361 : il remonte au règne de Yaḥyā (1023-1035) selon Gómez-
Moreno (1951, 248). Pour d’autres, il date du règne de Bādīs (López Guzmán coord. 2002, 885).
35 Orihuela Uzal 1996, 361-364.36 Torres Balbás 1945 ; Puertas Tricas 1990.37 López Guzmán coord. 2002, 887.38 Torres Balbás 1985, 498.
18C
hris
tine
Maz
zoli-
Gui
ntar
d
Le couronnement de la défense : le Castillo de Gibralfaro et la coracha
Le mont de Gibralfaro, à 200 m au nord-est de la butte couronnée par l’Alcazaba, sur lequel il existe une rábita dès le xiie siècle39, se trouve assez éloigné de la ville pour que des archers ne puissent l’atteindre ; mais les transformations de la poliorcétique obligent à élever une forteresse en haut de la butte afin de protéger l’Alcazaba, située à une altitude inférieure : la paternité de la construction est attribuée à Yūsuf I (1333-1354), peut-être à partir d’une structure antérieure qui remonte à la fin du xiiie siècle40, Muḥammad V achevant les travaux41. Son importance stratégique lui vaut d’être maintenue en état par la couronne de Castille après la conquête, pour surveiller la côte.
Le Castillo de Gibralfaro, érigé sur la partie la plus élevée du mont éponyme42, offre au regard une enceinte au tracé irrégulier et allongé, adapté au terrain43. En maçonnerie de gros blocs de schiste recouverts d’un enduit décoré de fausses pierres de taille et de motifs circulaires sur laquelle se lève un mur de tapial44, l’enceinte est pourvue de rares tours de flanquement, les ruptures du tracé de la muraille constituant l’essentiel de sa défense avec l’avant-mur qui la protège sur l’ensemble de son périmètre, seul exemple conservé d’avant-mur d’époque naṣride45. Sur le flanc sud-ouest, l’entrée, à l’origine en coude simple et alignée sur la courtine, est transformée pour prendre un aspect plus monumental, sur le modèle des portes d’apparat représentatives du pouvoir naṣride, dont le paradigme est la Puerta de la Justicia de l’Alhambra46 : couverte d’une coupole, richement décorée de céramique vernissée rouge et verte, l’entrée du Castillo de Gibralfaro est protégée par une tour albarrana, la Torre Blanca. Sur le point le plus élevé, à l’est, se trouvait la Torre del Viento, haute d’environ 25 m47.
39 Rábita : lieu fortifié d’où l’on surveille la côte tout en se livrant à des pratiques pieuses. Les textes relatifs à la rábita placée sur le Gibralfaro se trouvent dans Calero Secall & Martínez Enamorado 1995, 380-383.
40 Selon López Guzmán coord. 2002, 889, le Castillo de Gibralfaro existe dès le xiie siècle ; il se fonde sur le témoignage d’al-Idrīsī selon lequel “la ville (madīna) de Málaga est belle et bien fortifiée. La montagne (ğabal) de Faro la surplombe et elle est dotée (la-hā) d’une citadelle imprenable”. Or, c’est la ville de Málaga qui est dotée d’une citadelle et non la montagne de Faro : la-hā renvoie à un féminin, donc à madīna, et non à ğabal, terme masculin. la montagne.
41 Calero Secall & Martínez Enamorado 1995, 376-377, 382-383 ; Pérez-Malumbres Landa & Martín Ruiz 2009, 72.
42 Sur les étymologies de ce terme hybride, de l’arabe ğabal, mont, et du grec Farós : Calero Secall & Martínez Enamorado 1995, 375-376.
43 Ibid., 376-378 ; López Guzmán coord. 2002, 888-891 ; Pérez-Malumbres Landa & Martín Ruiz 2009, 71-73.
44 Ibid., 71.45 Torres Balbás 1985, 528.46 Acién Almansa 1991, 366.47 López Guzmán coord. 2002, 890.
19Les forteresses urbaines de M
álaga
Le Castillo de Gibralfaro possédait une mosquée dont les vestiges sont apparus lors des fouilles de 1996 visant à la restauration de la poudrière du xviiie siècle. Après la conquête, la mosquée est consacrée à San Luis Obispo, avant d’être démolie et remplacée par une église48. L’approvisionnement en eau était assuré par des puits et par une grande citerne de plan octogonal recueillant les eaux canalisées depuis la partie haute49.
Enfin, le Castillo de Gibralfaro est relié à l’Alcazaba par une coracha, élément de fortification qui a une fonction de protection logistique puisqu’il met en communication les deux forteresses de Málaga. Il est constitué d’une double ligne de murailles dont les murs se brisent en une série de redans en zig-zag qui assurent le flanquement et économisent des tours ; en haut de la muraille, large de 1,5 m, court un chemin de ronde50 (fig. 3).
Alcazaba, Gibralfaro, coracha : le décor est brossé. Quel regard les voyageurs arabes du Moyen Âge ont-ils porté sur ces forteresses ? Qu’ont-ils vu de cette imposante et complexe masse fortifiée et quelles impressions ont-ils transcrites dans leurs récits ? Le regard est certes commandé par ce qui doit être vu, mais il l’est tout
48 Pérez-Malumbres Landa & Martín Ruiz 2009, 73.49 Id.50 Torres Balbás 1985, 528 ; Gozalbes Cravioto 1981 ; López Guzmán coord. 2002, 895-
897.
Fig. 3. Depuis le Castillo de Gibralfaro, l’Alcazaba et la coracha (cl. Cl. Guintard, avril 2009).
20C
hris
tine
Maz
zoli-
Gui
ntar
d
autant par ce qu’on choisit de voir ; autrement dit, le regard que les voyageurs arabes portent sur les forteresses de Málaga est lié à leur personnalité.
Sous le calame du voyageur, les forteresses de MálagaLes sources textuelles arabes sur Málaga ont été rassemblées par Ma I. Calero
Secall et V. Martínez Enamorado dans leur étude monographique sur l’urbanisme de la ville51 : dans ce corpus de textes, il faut opérer un distinguo entre la description du géographe, souvent voyageur en chambre qui rédige à partir de textes antérieurs ou de témoignages qu’il recueille sur des localités qu’il n’a jamais vues, et le véritable récit du voyageur qui a réellement observé les courtines qu’il décrit. En privilégiant les auteurs qui font usage du ‘je’, l’on constate que les voyageurs arabes ayant laissé leurs impressions sur Málaga ne sont finalement guère nombreux.
Du xe siècle au xiiie siècle, quelques notes laconiques
Pour s’en tenir aux géographes, les œuvres arabes les plus anciennes signalant Málaga remontent au ixe siècle ; elles ont été produites par des auteurs orientaux et appartiennent au genre littéraire “des routes et des royaumes”. Les références à Málaga, extrêmement brèves, sont la plupart du temps fournies par des auteurs qui n’ont jamais voyagé dans la Péninsule ibérique. Et même Ibn Ḥawqal, qui pourtant se trouve en al-Andalus au milieu du xe siècle, n’apporte rien de neuf aux quelques mots que son devancier al-Iṣṭaḫrī avait consacrés à Málaga52 : il se contente de citer Málaga comme étant un territoire de la Péninsule et d’évoquer la cora de Rayya dont Archidona est le chef-lieu ; il s’inscrit bien dans son temps, celui où le centre du district glisse d’Archidona à Málaga53. La notice que le Cordouan al-Rāzī (m. 955) consacre à Málaga contient une allusion à une “muraille (sūr) qui brille au-dessus de la mer”54, impression qui émane d’un voyageur qui découvre la ville depuis son port, anonyme silhouette qui constitue l’une des sources du Cordouan. Cette muraille appartient selon toute vraisemblance à la citadelle califale, puisque l’enceinte qui enferme le noyau urbain de Málaga n’est mise en place que dans la première moitié du xie siècle55.
51 Calero Secall & Martínez Enamorado 1995, 24-52.52 Ibid., 27. 53 Ibn Ḥawqal 1938, 109-110.54 Al-Rāzī 1953, 98 ; Calero Secall & Martínez Enamorado 1995, 28. Je n’ai pu éclaircir
l’origine de ce passage : dans sa reconstitution du texte d’al-Rāzī, Lévi-Provençal dit avoir tiré du manuscrit du Muġrib d’Ibn Sa`īd qu’il avait alors à sa disposition quelques lignes d’al-Rāzī, mais celles-ci ne figurent pas dans l’édition du Muġrib parue en 1953 au Caire.
55 Íñiguez Sánchez et al. 2003, 43-46 ; Pérez-Malumbres Landa & Martín Ruiz 2009, 66-67. Au sud-ouest de la ville sont apparus deux pans de muraille quelque peu antérieurs, de la seconde moitié du xe siècle (Íñiguez Sánchez et al. 2003, 46).
21Les forteresses urbaines de M
álaga
Al-Bakrī, mort à Cordoue en 1094, dont le père fut à partir de 1012 le souverain de l’éphémère royaume de taifa de Huelva et de Saltés, annexé en 1051 par Séville, mène une carrière de lettré entre Cordoue, Alméria et Séville où il semble passer une bonne partie de son existence. Il est l’auteur d’une description de la Péninsule, qui s’inscrit dans le genre “des routes et des royaumes” ; il n’y fait aucune allusion à Málaga tandis que Séville est la ville la plus longuement décrite. Or, al-Bakrī connaît Málaga ; il s’y trouve en 1066, lorsque le souverain de Séville fait le siège de la ville ; il déclare : “Tous ces vestiges, au pouvoir desquels Málaga devait sa soi-disante sécurité et sa durée, je les ai examinés et passés en revue dans l’année 459 (1066-67), au moment où cette ville était assiégée par `Abbād Ibn `Abbād et où les Berbères de sa citadelle infligeaient à la population les pires vexations”56. Impression fugitive : la citadelle, pourtant observée par le voyageur, s’est dérobée, a échappé au récit. Les modes d’écriture, en particulier la pratique de la compilation, expliquent sans doute en partie la distorsion : la note d’al-Bakrī sur le siège de Málaga est transmise par un géographe tardif qui a enchâssé le texte du xie siècle dans le sien, selon des modalités qui nous échappent.
La description de Málaga que rédige al-Idrīsī au milieu du xiie siècle n’évoque que sommairement les fortifications de la ville et rien n’indique que le géographe de Palerme, qui pourtant voyage en al-Andalus, les ait observées : “La ville de Málaga est belle et bien fortifiée. La montagne de Faro la surplombe et la ville est dotée d’une citadelle imprenable”57. Son contemporain al-Zuhrī, géographe d’Almería, “écrivain sédentaire qui ne connaît d’al-Andalus que son environnement proche”58 selon D. Bramón, a-t-il voyagé jusqu’à Málaga ? Il ne dit rien des fortifications de la ville et n’en décrit que le port, dans la logique de son discours : il est en effet l’auteur d’une géographie du genre “merveilles” où l’extraordinaire l’emporte. De Málaga, il ne signale que la digue qui se trouve sur la côte, faite d’énormes blocs de pierre amoncelés dont certains pèsent jusqu’à 100 quintaux et conclut : “cette construction constitue une merveille”59.
Ibn Sa`īd (Grenade 1214-Tunis 1286), auteur d’une anthologie poétique qui adopte un plan géographique pour présenter les auteurs andalusíes, inclut dans son œuvre, à l’entrée relative à Málaga, quelques impressions de voyage :
“J’entrai dans Málaga et y résidais à l’aise en pleine jeunesse ; je profitais de ses sessions littéraires. C’était la ville préférée de mon père et il aimait y séjourner, surtout lors de ses fêtes ou lorsque les Malaguènes allaient à leurs vignes et à leurs figueraies. Nous nous rendîmes dans une villa où nous restâmes le temps que dura la récolte et le souvenir de ce séjour demeure pour nous l’un de nos plus heureux moments”60.
56 Al-Bakrī, conservé par al-Ḥimyarī 1938, 214-215.57 Al-Idrīsī 1975, § 108.58 Al-Zuhrī 1991, XXXIII.59 Ibid., 164-165.60 Ibn Sa`īd 1953, 423-424 ; Calero Secall & Martínez Enamorado 1995, 34.
22C
hris
tine
Maz
zoli-
Gui
ntar
d
Ibn Sa`īd ignore-t-il qu’il existe des fortifications à Málaga ? Non point ! Son anthologie achève une œuvre littéraire qui court sur plusieurs générations et débute avec la rédaction, par al-Ḥiǧārī (1106-1155), de notices géographiques ; et à propos de Málaga, Ibn Sa`īd commence par reproduire ce qu’écrivit son prédécesseur dans le Mushib à savoir que la ville “possède une citadelle inaccessible, dont la muraille couronne les collines”61. De son séjour à Málaga, Ibn Sa`īd ne retient donc que les cercles littéraires : du ‘je’, se dégage un reflet plus net de l’auteur que du paysage urbain. Toutes ces notes proviennent d’un même regard, celui qui se porte sur l’Alcazaba depuis l’extérieur de la forteresse et qui n’en retient que le rôle défensif.
Au xive siècle, des notices étoffées et diversifiées
Il faut attendre le xive siècle pour qu’un géographe fournisse une description un peu plus précise des fortifications de Málaga, alors même qu’il ne les a jamais vues. Al-Ḥimyarī, mort à Tunis vers 1326, décrit ainsi l’Alcazaba62 : “La citadelle se trouve à l’est de la ville proprement dite : elle est entourée d’un rempart de pierre remarquablement solide. Dans cette alcazaba, se trouve une mosquée qui fut bâtie par le juriste et traditionniste Mu`āwiya b. Ṣāliḥ al-Ḥimṣī”.
Deux Égyptiens, al-`Umarī et al-Qalqašandī, rédigent chacun une description de Málaga sans l’avoir visitée ; elles reproduisent sans surprise les savoirs antérieurs et n’apportent rien de nouveau sur les fortifications malaguènes63. Le Tangerinois Ibn Baṭṭūṭa (1303-1377), l’un des plus célèbres voyageurs de l’Islam médiéval, se trouve à Málaga en 1350 ; ses Voyages sont rédigés à deux mains, d’où un texte fait de l’imbrication de notices descriptives et d’impressions personnelles. En se promenant dans Málaga, il observe l’animation des souks : “j’ai vu dans ses marchés vendre les raisins au prix d’une petite drachme les huit livres. Ses grenades, appelées de Murcie et couleur de rubis, n’ont leurs pareilles dans aucun autre pays du monde. Quant aux figues et aux amandes, on les exporte de Málaga et de ses districts dans les contrées de l’Orient et de l’Occident”64. Voyageur en quête de spiritualité – à l’origine, son œuvre est un récit de pèlerinage – il se rend à la grande-mosquée de la ville, “pourvue d’une cour sans pareille en beauté et contenant des orangers d’une grande hauteur”65, où il trouve son juge “entouré des jurisconsultes et des habitants les plus notables”. Des fortifications qui entourent et dominent la ville, Ibn Baṭṭūṭa ne dit mot ; ses impressions sur le paysage urbain de Málaga tiennent en deux images, le marché et la grande-mosquée.
61 Id.62 Al-Ḥimyarī 1938, 214.63 Calero Secall & Martínez Enamorado 1995, 42-43.64 Ibn Baṭṭūṭa 1922, 366.65 Ibid., 367.
23Les forteresses urbaines de M
álaga
Bien plus riche est l’éloge de Málaga dû à Ibn al-Ḫaṭīb, composé sous la forme d’une comparaison entre les mérites respectifs de Málaga et Salé. Cet homme, qui a multiplié les voyages en al-Andalus, évoque ainsi l’Alcazaba66 :
“Sa citadelle est posée sur le mont comme sur un trône et Dieu lui a donné une place excellente. Ses murs et ses enceintes sont doubles ; son phare se dresse sur la cime de ce mont béni ; ses tours sont proches les unes des autres ; ses escaliers sont élevés et ses portes bien défendues. La ville est entourée par la muraille, par les ponts et par le fossé. […] L’œil n’y trouve aucun point vulnérable, aucune brèche par laquelle on pourrait accéder aux faubourgs”.
Dans une autre de ses œuvres, le Grenadin livre ces impressions sur l’Alcazaba : “La citadelle est entourée d’une double muraille, si ancienne que les siècles l’ont liée. Elle est mise en évidence par l’excellence de son emplacement, sur la plus belle des montagnes, trône d’un ancien royaume, resplendissant sentier de musc. Ses palais étaient comme ceux de Chosroés, semblables à un nid d’aigle”67. Derrière l’emphase poétique apparaît une forteresse dont une partie des éléments défensifs est aisément reconnaissable et, surtout, se dessine pour la première fois la fonction aulique de la citadelle, livrée par un voyageur qui fut aussi vizir et ambassadeur.
Au xve siècle, un récit original
C’est au voyageur égyptien `Abd al-Bāsiṭ que nous devons la description la plus originale des fortifications de Málaga68. Fils d’un haut fonctionnaire mamlouk, ce commerçant quitte Alexandrie en juillet 1462 et arrive à Málaga sur un navire génois en 1465 ; historien, il est l’auteur d’une chronique des pays d’Islam, dont la partie relative à al-Andalus s’inscrit dans le genre littéraire du récit de voyages. Il séjourne quelque temps à Málaga, en visite la citadelle sur laquelle il livre un certain nombre d’impressions :
“[Le 19 décembre 1465] je montai vers la citadelle (al-qaṣaba) de Málaga qui est la forteresse (al-qal`a)69. Elle est le siège du gouvernement (dār al-imāra). Elle était alors dépeuplée, car elle n’avait plus de gouverneur. Elle m’apparut comme une citadelle énorme avec des monuments grandioses, résultat de la restauration menée à bien par le sultan Abū l-Ḥasan al-Marīnī, roi du Maghreb et de Fès qui régna sur tout le Maghreb et al-Andalus avec le laqab d’al-Manṣūr70. Puis je vis dans cette citadelle une construction faite pour
66 García Gómez 1934.67 Cité dans Calero Secall & Martínez Enamorado 1995, 328.68 Éd. Levi della Vida 1933, Brunschvig 1936. Trad. Levi della Vida 1933, Sánchez
Albornoz 1974, Calero Secall & Martínez Enamorado 1995, 329-331. 69 La citadelle est dite al-qal`a dans les textes de l’Orient, al-qaṣaba dans ceux de l’Occident.70 Selon Levi della Vida (1933, 318), il ne s’agit pas d’Abū l-Ḥasan (1331-1349) qui ne fait
qu’une rapide expédition en al-Andalus, mais du premier Mérinide, Abū Yūsuf Ya`qūb (1258-1286), qui porte aussi le laqab d’al-Manṣūr. Il prend Málaga en 1278 et il y reste plus de deux mois (Calero Secall & Martínez Enamorado 1995, 332).
24C
hris
tine
Maz
zoli-
Gui
ntar
d
l’eau où il y avait trois grosses cruches (zīr71) en céramique de Málaga. Je n’avais jamais rien vu de semblable, ni n’en avais entendu parler. Les trois cruches étaient disposées les unes à côté des autres dans cette construction destinée à l’eau potable, à l’intérieur du vestibule de l’Alcazaba [suit une description précise des céramiques]. Elles étaient merveilleusement fabriquées et extraordinairement décorées de reliefs admirables. Il en existe de ce genre dans notre pays, mais elles n’ont pas la même splendeur artistique”72.
L’originalité du récit tient, bien entendu, à l’évocation de ces cruches qui fournissaient l’Alcazaba en eau : notons surtout que le regard de l’Égyptien est unique en cela qu’il se pose sur l’intérieur de la citadelle. Au total, et comme on s’y attendait, la place des fortifications diffère d’un récit à l’autre ; modalités et motifs du voyage expliquent en partie la variation observée, un voyageur en quête de spiritualité comme Ibn Baṭṭūṭa ayant gommé les courtines et les tours au profit de la mosquée73.
Du regard aux réalités, effets de filtreLe contraste est donc bien net entre la masse imposante des forteresses de Málaga
et le regard distrait que lui lancent les voyageurs, entre lesquels s’interposent des effets de filtre qu’il faut essayer de déchiffrer.
Un regard distrait et positif sur l’Alcazaba
Les voyageurs arabes regardent en fin de compte d’un œil distrait et admiratif les forteresses de Málaga. Ce regard rapide, qui glisse sur l’Alcazaba et oublie le Castillo de Gibralfaro, est d’autant plus surprenant que les mêmes auteurs décrivent avec un certain luxe de détails la ville et son territoire. Al-Idrīsī, qui se contente de signaler la présence d’une citadelle imprenable, ajoute ceci :
“belle, prospère et peuplée, [Málaga] abrite de nombreuses demeures et a un vaste territoire […] Ses marchés sont bien achalandés, ses marchandises circulent et ses ressources sont multiples. Le territoire environnant est couvert de tous côtés par des figuiers […] La ville de Málaga a deux grands faubourgs : celui de Fontanella et celui des marchands de paille. Les habitants boivent l’eau de puits […] Un fleuve y coule pendant l’hiver et le printemps”74.
Et, plus loin : “Ses deux faubourgs sont dépourvus d’enceinte, mais on y trouve des hôtelleries et des bains. Elle est entourée de figuiers, uniques sur terre, qui
71 Dozy 1881 : grande cruche à fond très étroit et munie de deux petites anses.72 Levi della Vida 1933, 312 (texte) et 318-319 (trad.).73 L’œuvre du cadi Abū Yaḥyā b. `Ᾱṣim (xve s.), Jardin de la satisfaction qu’il y a à accepter le
dessein et le décret de Dieu, contient aussi des données sur la citadelle, selon Calero Secall & Martínez Enamorado 1995, 49, mais nous n’avons pu avoir accès ni à l’éd. de Ṣalāḥ Ǧarrār, ni à celle de M. Charouti Hasnaoui.
74 Al-Idrīsī 1999, 285.
25Les forteresses urbaines de M
álaga
produisent la figue de Reiya car Málaga est à la tête du territoire de Reiya”75. Al-Ḥimyarī, qui compile la description d’al-Idrīsī sur les champs couverts de figuiers, l’approvisionnement en eau et l’existence de deux faubourgs, ajoute une description du port et de la grande-mosquée, donne les noms des portes de la muraille, signale la présence de jolis bains et de nombreux bazars bien achalandés et ajoute quelques notes sur des luttes armées, le siège de 1066 et la révolte de 114576.
Par ailleurs, le regard sur l’Alcazaba s’avère toujours positif, comme apparaît toujours remplie d’admiration l’opinion des auteurs arabes sur les forteresses et les villes d’al-Andalus77 : la citadelle est imprenable et inaccessible, son emplacement excellent, ses portes bien défendues, ses murs doubles, ses tours rapprochées, etc. Derrière le poncif se dissimule un ressort propre à une littérature de courtisans : la forteresse est œuvre du prince. En valorisant la forteresse, le discours valorise le prince. Ma J. Viguera avait bien mis en valeur ce procédé rhétorique à travers la manière dont le paysage est décrit dans les chroniques arabes d’al-Andalus : la présence du calife va de pair, dans le discours, avec de beaux édifices et des arbres qui offrent les meilleurs fruits, tandis que les terres de l’ennemi ne sont que champs de ruines. Elle conclut ainsi : “le chroniqueur se complaît à rapporter comment le pouvoir légitime vivifie et fait prospérer le paysage naturel ou construit qui se trouve sous son obédience et comment il l’attaque et le détruit s’il lui est rebelle ou hostile”78.
Un regard épuré
Le regard de nos voyageurs, peu commandé par ce qu’ils doivent voir, l’est bien plus par ce qu’ils veulent voir : dans l’œil de celui qui voyage, se reflète d’abord l’homme, puis le paysage observé, le regard informant presque davantage sur le locuteur que sur la forteresse. Chargé par Roger II de Sicile de réunir les connaissances du temps sur l’ensemble de l’œcoumène, al-Idrīsī brosse en quelques touches le portrait de la ville de Málaga, portuaire, commerçante et fortifiée ; en quête de merveilles, al-Zuhrī ne considère que la digue formée de pierres impressionnantes ; à la recherche de lettrés, Ibn Baṭṭūṭa ne voit même pas la citadelle de Málaga (fig. 4).
Par ailleurs, le regard des voyageurs se pose presque toujours sur le seul système défensif de l’Alcazaba, observé depuis l’extérieur des murailles, ce qui réduit la citadelle à sa fonction militaire et gomme ses fonctions palatine et administrative, créant ainsi une profonde distorsion entre discours et réalités. Comment un filtre aussi épais s’est-il interposé entre l’œil et la citadelle ? Il est une évidence à rappeler : le regard des voyageurs est commandé par ce qu’ils sont autorisés à regarder. Les
75 Ibid., 289.76 Al-Ḥimyarī 1938, 213-215. Ibn Ḥassūn se révolte contre le pouvoir almoravide en 1145
et reste indépendant à Málaga jusqu’en 1153 (Viguera Molins 1992, 191).77 Mazzoli-Guintard 2001 et 2004.78 Viguera Molins 2004, 109-110.
26C
hris
tine
Maz
zoli-
Gui
ntar
d
observations faites depuis l’extérieur de l’Alcazaba par des voyageurs qui ne font que passer au pied des courtines, ces observations qui se répètent, loin d’être des stéréotypes sans intérêt, reflètent une réalité de la vie politique : la citadelle est le domaine du prince et le voyageur n’est pas invité à en franchir les portes. Il est symptomatique que le seul voyageur à être entré dans l’Alcazaba, `Abd al-Bāsiṭ, y ait pénétré lorsque la citadelle était dépeuplée et dépourvue de gouverneur, situation exceptionnelle due au conflit qui oppose alors le naṣride Sa`d à son fils Muley Hacén79.
Enfin, le regard est commandé par les attentes des lecteurs que la mention d’une citadelle imprenable satisfait ; elle signifie pour eux la présence d’une autorité qui tient la ville en main et peu importe que le regard ne franchisse pas la porte de la citadelle : pas plus que le voyageur, les lecteurs ne sont admis à la franchir, ce qui peut expliquer le système de représentations choisi.
Les forteresses de Málaga, l’Alcazaba et le Castillo de Gibralfaro, forment une masse imposante de courtines et de tours couronnant des buttes placées au-dessus
79 Levi della Vida 1933, 318. Ce n’est qu’un épisode parmi tant d’autres des guerres qui déchirent le royaume de Grenade au xve siècle : en août 1464, Muley Hacén, allié aux Abencérages, renverse son père Sa`d ; la citadelle de Málaga, qui servait de refuge à ce clan, s’en trouve momentanément désaffectée (Arié 1973, 145). En 1470, les Abencérages se révoltent de nouveau et se retranchent dans Málaga (ibid., 147).
Fig. 4. L’Alcazaba de Málaga (cl. Cl. Guintard, avril 2009).
27Les forteresses urbaines de M
álaga
de la ville. Qu’en ont vu les voyageurs arabes ? La seule Alcazaba, réduite à sa fonction défensive et observée depuis l’extérieur des murailles. Dans ce regard, se reflète en premier lieu celui qui voyage ; au-delà, ce qui apparaît comme un cliché se répétant autour de bien des citadelles urbaines d’al-Andalus traduit une réalité – la forteresse est le fait du prince, où le voyageur n’est admis que dans des circonstances particulières –, tout en s’inscrivant dans un système de représentations où des murailles infranchissables, tant pour l’assaillant que pour le regard du voyageur, suffisent à signifier la forteresse. Y a-t-il là distorsion avec la réalité, par l’absence de la fonction aulique de la citadelle, ou bien plutôt, ancrée dans les mentalités, une fonction palatine signifiée par la puissance de la forteresse ?
Références bibliographiques
Acién Almansa, M. (1991) : “Recientes estudios sobre la arqueología andalusí en el sur de al-Andalus”, Aragón en la Edad Media, n° IX, 355-370.
`Abd Allāh (1981) : El siglo XI en 1a persona, trad. É. Lévi-Provençal et E. García Gómez, Madrid.Al-Ḥimyarī (1938) : La Péninsule ibérique au Moyen Âge d’après le Kitāb ar-rawḍ al-miṭār, É. Lévi-
Provençal trad., Leyde. Al-Idrīsī (1975) : Opus geographicum, fasc. 5, E. Cerulli et al. éds., Naples - Rome.— (1999) : La première géographie de l’Occident, trad. Jaubert revue par A. Nef, Paris. Al-Rāzī (1953) : “La Description de l’Espagne d’Aḥmad al-Rāzī”, par É. Lévi-Provençal, Al-Andalus,
n° 18, 51-108.Al-Zuhrī (1991) : El mundo en el siglo XII, El tratado de al-Zuhrī, D. Bramón trad., Barcelone. Arié, R. (1973) : L’Espagne musulmane au temps des Naṣrides (1232-1492), Paris.Bosch Vilá, J. et W. Hoenerbach (1981-1982) : “Un viaje oficial de la corte granadina (año 1347)”,
Andalucía islámica, Textos y Estudios, n° II-III, 33-69.Bosch Vilá, J. (1987) : “Mālaḳa”, EI², t. VI, 214-217.Brunschvig, R. (1936) : Deux récits de voyage inédits en Afrique du nord au xve siècle : `Abdalbasit b. Halil
et Adorne, Paris.Calero Secall, Ma I. et V. Martínez Enamorado (1995) : Málaga, ciudad de al-Andalus, Málaga.Damaj, A.-C. (2005) : “El último viaje de Ibn al-Jaṭīb. Circunstancias, causas y consecuencias”, Entre
Oriente y Occidente : ciudades y viajeros en la Edad Media (J. P. Monferrer Sala et Ma D. Rodríguez Gómez éds.), Grenade, 103-132.
Dozy, R. (1881) : Supplément aux dictionnaires arabes, I-II, Leyde.García Gómez, E. (1934) : “El parangón entre Málaga y Salé”, Al-Andalus, n° 2, 81-103.Gómez-Moreno Martínez, E. (1951) : El arte árabe español hasta los Almohades, Arte mozárabe, Ars
Hispaniae, vol. III, Madrid.Gozalbes Cravioto, C. (1981) : “Las corachas hispano-musulmanas de Málaga”, Jábega, n° 34, 61-70.Ghouirgate, A. (1995) : “Al-Andalus en la literatura de viaje marroquí”, Granada 1492-1992 (M. Barrios
éd.), Grenade, 219-227.Ibn Baṭṭūṭa (1922) : Voyages, éd. et trad. C. Defrémery et B. R. Sanguinetti, t. IV, Paris.Ibn Ḥawqal (1938) : Kitāb ṣūrat al-arḍ, J.H. Kramers éd., Leyde.Ibn Sa`īd (1953) : Al-Mugrib fī hulā al-Maġrib, Š. Dayf éd., Le Caire, vol. 1.Íñiguez Sánchez, C., Cumpián, A. et P. Sánchez Banderas (2003) : “La Málaga de los siglos X-XI. Origen
y consolidación del urbanismo islámico”, Mainake, n° XXV, 33-67.L’homme et la route en Europe occidentale au Moyen Âge et aux Temps Modernes (1982) : 2e journées
internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (20-22 sept. 1980), Auch.Les voyageurs au Moyen Âge (2008) : 130e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques (La
Rochelle, 2005), Paris.
28C
hris
tine
Maz
zoli-
Gui
ntar
d
Levi della Vida, G. (1933) : “Il regno di Granata nel 1465-66 nei ricordi di un viaggiatore egiziano”, Al-Andalus, n° 1, 307-334.
López Guzmán, R. coord. (2002) : Arquitectura de al-Andalus (Almería, Granada, Jaén, Málaga), Grenade.Malaqa entre Malaca y Málaga (2009) : Catálogo de la Exposición (Salas de Exposiciones del Rectorado,
Universidad de Málaga, 7 de mayo-27 de junio de 2009), Málaga.Mazzoli-Guintard, Chr. (2001) : “Les châteaux d’al-Andalus dans l’imaginaire d’al-Idrīsī (première
moitié du xiie siècle)”, Château et imaginaire (A.-M. Cocula et M. Combet éds.), Bordeaux, 57-77.— (2004) : “Les villes d’al-Andalus sous l’œil des voyageurs (xe-xve s.)”, Annales de Bretagne et des Pays
de l’Ouest, n° 111, 25-45.Orihuela Uzal, A. (1996), “Cuartos de Granada”, Casas y palacios nazaríes (siglos XIII-XV), Grenade,
357-366.Pavón Maldonado, B. (1992) : “La primitiva alcazaba de Málaga (s. X y XI) : procedimientos
constructivos”, Jábega, n° 72, 3-22.Peral Bejarano, C. (1994) : “La Arqueología urbana en Málaga (1986-1992) : una experiencia a debate”,
Arqueología y Territorio Medieval, n° 1, 101-116.Pérez-Malumbres Landa, A. et J.-A. Martín Ruiz (2009) : “Arqueología de una ciudad : de Malaca a
Malaqa”, Malaqa entre Malaca y Málaga, 59-82.Puertas Tricas, R. (1987) : “La alcazaba de Málaga y su distribución superficial”, Jábega, n° 55, 27-40.— (1990) : “El barrio de viviendas de la Alcazaba de Málaga”, La casa hispanomusulmana, Aportaciones
de la arqueología/La maison hispano-musulmane, Apports de l’archéologie, J. Bermúdez López et A. Bazzana coord., Grenade, 319-340.
Sánchez Albornoz, Cl. (1974) : La España musulmana según los autores islamitas y cristianos medievales, Madrid, 4e éd., t. II, 571-576.
Torres Balbás, L. (1944) : “Excavaciones y obras en la Alcazaba de Málaga”, Al-Andalus, n° 9, 173-190. — (1945) : “El barrio de casas de la Alcazaba malagueña”, Al-Andalus, n° 10, 396-409. — (1985) : Ciudades hispanomusulmanas, Madrid, 2e éd. Touati, H. (2000) : Islam et voyage au Moyen Âge, Paris.Viajeros, peregrinos, mercaderes (1992) : Actas de la XVIII Semana de Estudios Medievales de Estella (22-26/
VII/1991), Pampelune.Viguera Molins, Ma J. (1992) : Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes, Madrid.— (2004) : “El paisaje en las crónicas andalusíes”, Paisaje y Naturaleza en Al-Andalus (F. Roldán Castro
éd.), Grenade, 83-113.— (2009) : “Malaqa : entre Malaca y Málaga”, Malaqa entre Malaca y Málaga, 19-57.Voyages et voyageurs au Moyen Âge (1996) : Actes du XXVIe congrès de la SHMESP (Limoges-Aubazine, mai
1995), Paris.Voyageurs au Moyen Âge (2007) : F. Novoa Portela et al., Paris.