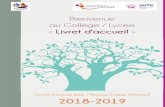Regards sur la société d'accueil et stratégies citoyennes des personnes d'origines africaines en...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Regards sur la société d'accueil et stratégies citoyennes des personnes d'origines africaines en...
Regards sur la société d’accueil et stratégies citoyennes des
personnes d’origines africaines en Suisse 2000-‐2012
par Jules BAGALWA MAPATANO (HETS-‐SO/Genève)
Colloque annuel de la Société Suisse d’Ethnologie (SSE) Panel Na#on, na#onalité, citoyenneté I
à l’Université de Lucerne le 2-‐3 novembre 2012.
I. IntroducBon (ProblémaBque, quesBonnement, méthodologie)
Durant les 6 dernières décades, pour diverses raisons et trajectoires (économiques, poliSques, stratégies de réseaux de «parentés»…), des millions de immigrants sont arrivés et installés (après diverses procédures d’admission) dans les démocraSes occidentales dont la Suisse. Où l’immigraSon postcoloniale d’origine africaine, et plus récente, se met en place depuis les années 1980 via l’asile poliSque suite à aux crises d’Etats en Afrique (Bagalwa Mapatano, 2007).
Même si le terme assimilaSon est tombé en désuétude, la préoccupaSon majeure d’une grande parSe des élites et des opinions publiques est de voir les populaSons d’origines immigrées devenir des membres producSfs de leurs sociétés d’accueil. Les démocraSes occidentales comme la Suisse font ainsi face à des grands défis de permeare aux immigrés de devenir parSe une intégrante de leurs communautés poliSques naSonales. Donc réaliser l'intégraSon culturelle, économique, sociale et poliSque de ces nouvelles populaSons.
PopulaSons suscepSbles d’être confrontées aux regards ambigües des sociétés d’accueil (Mollenkopf, Hochschild, 2009: 3-‐5) : appréciaSon de la capacité de travailler dur des immigrés VS anxiété quant à l’ajustement culturel faisable entre ceux-‐ci et les autochtones, sur les possibilités d’intégraSon des immigrés, loyauté VS leurs liens avec les pays d’origines… A propos de l’intégraSon poliSque et de la citoyenneté, Hollifield, Hunt, et Tichenor (2008) et Carens (2000) pensent que l’équilibre entre assimilaSon et l'exclusion des immigrés remet profondément en quesSon les démocraSes libérales. Ainsi dans des contextes naSonaux aujourd’hui marqués par des procédures de naturalisaSon plus restricSves (OECD, 2007), les systèmes électoraux privent les immigrés non naturalisés du droit formel de parScipaSon poliSque et donc d’acSon / expression citoyennes, en dépit des droits de vote aux élecSons locales qui sont reconnus dans certains pays. Suggérant là l’interrogaSon en cours de l’Etat-‐naSon, de la citoyenneté (de sa concepSon classique aux concepSons nouvelles en gestaSon). En même temps l’appariSon de ces nouveaux naSonaux-‐citoyens issus de l’immigraSon, leurs descendants majeurs, et celle d’une réserve consStuée par ceux suscepSbles de les devenir de part leur installaSon durable dans les pays interrogent. Car même si l’incorporaSon poliSque vient généralement plus tard que les autres formes d'assimilaSon, il est essenSel de donner aux immigrés un pied parScipaSf dans leur nouveau pays leur permeaant de contribuer à façonner ses poliSques et ses praSques (Mollenkopf, Hochschild, 2009: 10). Mais dans des contextes de manque de de la naSonalité, il y a peu d’engagement des populaSons d’origines immigrées par exemple dans le système poliSque convenSonnel.
QUESTIONS: v Comment ces populaSons d’origines étrangères s’incorporent ou sont incorporées, parScipent-‐elles à (différentes arènes) de la vie (p.ex.4 civique) de leurs sociétés d’accueil, et au travers de quels espaces? Quelles ressources mobilisées pour quelle fins? v Si elles n’accèdent et ne parScipent pas à l’espace poliSque convenSonnel, comment construiraient-‐elles d’éventuels espaces (a)poliSques non convenSonnels d’interacSon alternaSfs? v Quels regards et par rapport à quels enjeux portent-‐t-‐elles sur leurs sociétés d’accueil, et ainsi quelles acSons -‐ et comment -‐ meaent-‐t-‐elles en œuvre en écho à ces regards et au nom de quelles valeurs?
Mon propos aborde rapidement les deux dernières quesSons s’agissant des populaSons d’origines africaines subsahariennes en Suisse. Où elles consStuent une peSte diaspora esSmée en 2011 à 53000 (à 72000 si on inclus les naturalisés depuis 1981) résidents. PeSte diaspora dont les naSonalités composantes les plus importantes sont l’Erythrée, la Somalie, l’Ethiopie, la République DémocraSque du Congo (RDC, RD Congo) et l’Angola. Elles vivent essenSellement dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel en Romandie et Zurich et Berne en Suisse alémanique (Efionayi-‐Mäder, Pecoraro, Steiner, 2011:7-‐11).
Ma réflexion s’appuie sur des données qualitaSves (observaSons parScipantes lors des acSvités associaSves publiques, entreSens p.e. avec des « leaders ethniques ») récoltées et la mince liaérature (scienSfique, presse écrite) disponible notamment sur ces communautés d’origines africaines les plus importantes en Suisse.
II. Regards sur la société d’accueil. Le croisement de données récoltées depuis 2000 à ce jour nous meaent devant diverses opinions appréciaSves sur la société d’accueil, mais aussi en écho sur « soi communautaire » dans ceae société, en considérant des enjeux individuels et « communautaires » d’intégraSon en Suisse. Ces regards peuvent être synthéSsés provisoirement à autour des 8 axes suivants (Bagalwa Mapatano, 2012: 23-‐35) : 1. Entre intégraSon et non-‐acceptaSon; 2. « VicSmes » d’une mauvaise percepSon; 3. Le racisme à l’embauche comme grand défi; 4. L’école et la mercanSlisaSon non rentable des esprits des jeunes (donc faible préparaSon au marché de l’emploi); 5. L’imposture et le paternalisme médiaSques (Naki, 2006; Batumike, 2006:9); 6. La non-‐reconnaissance de l’apport des étrangers notamment des Africains au pays d’accueil (Batumike, 2006:9); 7. La sociabilité distante ou minimale avec les autochtones?; 8. La solidarisaSon intra(inter)communautaire; 9. déficiente (Bagalwa Mapatano, 2007: 202-‐204).
-‐
III. Stratégies citoyennes III.1. Les structuraBon et réseaux d’acteurs : 1. regroupements « communautaires » (culturels, sporSfs, religieux, « transnaSonaux » de développement ou de droits de l’homme…); 2. Micro presses souvent temporaires, à faible Srage, et « tribunes médiaSques » tentant de capitaliser un « capital argent dérisoire » et un « capital volonté considérable » pour informer et communiquer (Batumike, 2006a: 149-‐165). 3. Les réseaux d’individus (militants, « leaders » et porte-‐paroles « ethniques » de fait vers l’espace public dominant). Avec quels capitaux? : naturalisé ou permis C et B, compétences linguisSques, formaSon supérieure et universitaire, et connaissances poliSques uSles pour l’intégraSon, parfois posiSon socio-‐professionnelle sécurisée. III.2. Quelques stratégies, enjeux et fins. 1. InvesSr les espaces d’expression et de dialogue autour de l’école ( p.e. les associaSons de parents d’élèves ou les conseils d’établissement…).
Pour préparer des meilleures réalisaSons éducaSves et socio-‐économiques de jeunes généraSons. «…nos jeunes doivent se baare ici parce qu’ici ils sont chez eux. Ils sont nés ou grandis très tôt ici et ne connaissent que ce pays, ce n’est pas le cas de nous leurs parents venus de loin avec parfois sans chance d’une bonne éducaSon (…) Leur réussite ou échec se passera ici ». (Mme M.). ===è contradicSon avec la percepSon dominante d’une volonté de non appartenir au pays d’accueil. 2. InvesSr les opportunités sociales locales d’une meilleure présentaSon de soi (Goffman, 1967) « communautaire », de s’exprimer, de s’affirmer comme parSe de la société, d’enrichir la compréhension interculturelle mutuelle : -‐ InvesSr et mulSplier les manifestaSons publiques fesSves (fêtes scolaires, fêtes communales…) pour des objecSfs de rencontrer, de partager et de se montrer auprès des autochtones sous d’autres jours et « nous tenons le plus possible des stands pour (…) faire aussi découvrir que nous apportons quelque chose peSt soit-‐il à ceae Suisse qui en principe est ouvert à la diversité culturelle harmonieuse .» (M. SK). -‐ « Seules occasions de rencontrer, d’échanger avec des décideurs, de parler et de poser nos problèmes … » (Monsieur LL.).
3. AcSons de plaidoyer et de pression protestataire légales même sporadiques vers les poliSques (parSs, communes, cantons, ConfédéraSon) sur au moins 2 axes : -‐ CriSques de posiSonnement diplomaSque suisse face aux évoluSons poliSques dans les pays d’origines ===è appropriaSon du principe du primat des valeurs démocraSques et humanistes suisses comme meilleur défenseur des intérêts suisses (et de leurs). -‐ CriSques du républicanisme civique qui en répugnant à priori de considérer la différence ethnique ou « raciale » comme critère de parScipaSon et catégorisaSon, méconnait en même temps son potenSel d’exclusion sociale et poliSque ===è mobilisaSons contre les discriminaSons, le racisme et pour la dignité humaine. 4. Rechercher des souSens et des partenariats des réseaux sociaux autochtones potenSellement favorables par le dialogue convergent: «…Tout le monde n’est pas Blocher. Même lui, si je l’aurais rencontré j’aurais discuté avec lui et lui montrer que nous avons plus des choses à faire ensemble malgré que nous soyons venus d’horizons différents… » (M. EKN, juin 2012, revient sur l’affiche publicitaire des « moutons noirs » du parS UDC de septembre 2007).
III.3. Résultats et contraintes. III.3.1. Résultats à apprécier dans la durée? Début d’un processus ouvert des stratégies citoyennes de proximité qui profitent aussi d’une certaine maturaSon d’une prise de conscience (dans le sillage des poliSques d’intégraSon) dans la société dominante d’offrir des fenêtres d’expression et de parScipaSon inclusive des « outsiders » (mais comment?). (Maigres?) résultats provisoires aujourd’hui : découverte, mise en œuvre et expérimentaSon des acSons et des moyens d’acSons et faire circuler vers la société dominante leurs ressources, besoins et désirs. III.3.2. Contraintes en ressources des engagements «…militants pour le changement..». Stratégies et acSons déployées par des « élites » ou « leaders » communautaires bénévoles capables de beaucoup d’invesSssement et d’engagement individuels ou associaSfs ou parfois les deux, demandent temps, du capital culturel, et assez d’argent.
pas forcément disponibles auprès des populaSons (surtout les primo-‐migrants) passant par des condiSons iniSales de séjour défavorables, au chômage avec des taux au dessus des moyennes suisses, aux emplois méSers peu ou pas qualifiés, à à la non-‐reconnaissance de diplômes obtenus en Afrique ou hors de Suisse, à la déqualificaSon professionnelle et aux discriminaSons à l’emploi (Pecoraro, 2011:28-‐31; Bolzman, Bagalwa, 2012). ==è inserSon sociale hétérogène et faiblesse de prise en charge du poids financier de ces acSons.
Conclusion provisoire
Terminons par ceae aspiraSon, ce rêve de Monsieur GB (Lausanne, juin 2012) , comme d’autres ci-‐dessus, d’entrer dans la communauté des citoyens (Schnapper, 2003) suisses : « Une quesSon à laquelle je n’ai pas répondu ? Peut-‐être pourquoi moi, en tant que Noir et longtemps sans-‐papier, je m’acharne franchement à faire de la poliSque en Suisse (…) Je veux m’aaeler à faire en sorte que le Noir puisse avoir la possibilité d’aller sieger au parlement en tant que Noir et puisse parler librement de choses qui sont celles du pays où il a grandi, dans lequel il vit, défendre peut-‐être sa communauté noire mais défendre franchement toute la populaSon sans que ça soit communautaire. Et les gens doivent comprendre qu’on sait raisonner, qu’on raisonne pour tout le monde et pas seulement pour la communauté. Moi c’est ça. ».
Bibliographie citée
• Bagalwa Mapatano, J., 2012, « Regards des personnes immigrées d’origines africaines sur la Suisse comme pays d’accueil au début du XXIème siècle », in: l’Africain, no 254, avril-‐mai 2012, Charleroi, p.23-‐35.
• Bagalwa Mapatano J.-‐M., 2007, Crise de l’Etat et migraJons. La diaspora congolaise-‐zaïroise en Suisse 1980-‐2005, Paris, édiSons Publibook université.
• Batumike, C., 2006, « Noirs africains en Suisse. De l’intégraSon et de l’entre-‐deux cultures », in: Interdialogos, no 1, 2007-‐2008, La Chaux-‐de-‐Fonds, p.7-‐10.
• Batumike, C., 2006, Etre noir africain en Suisse. IntégraJon, idenJté, percepJon et perspecJves d’avenir d’une minorité visible, Paris, l’Harmaaan.
• Bolzman, C., Bagalwa Mapatano, J., 2012, Modalités d’accès des diplômés d’origines africaines au marché de l’emploi suisse (recherche en cours, Genève, HETS).
• Efionayi-‐Mäder, D., Pecoraro, M., Steiner, I., 2011, La populaJon subsaharienne en Suisse : un aperçu démographique et socio-‐professionnel, Neuchâtel, Swiss Forum for MigraSon and PopulaSon /Université de Neuchâtel, (études du SFM-‐57).
• Goffman, E., 1956, La mise en scène de la vie quoJdienne (traducSon par A.Accardo et A. Khim, Paris, édiSons du Minuit, 1979).
• Goffman, E., 1967, Les rites d’interacJon (traducSon par A. Khim, Paris, édiSons du Minuit, 1984). • Hochschild, J. L., Mollenkopf, J.H., 2009, (eds.), Bringing outsiders in: transantlanJc perspecJve on immigrant poliJcal incorporaJon, Cornell University. • Naki, I., 2006, Sois parfait ou retourne chez toi, Lausanne, édiSons Swiss MéSs. • Schnapper, D., 2003, La communauté des citoyens, Paris, Gallimard, collecSon Folio essais. • Wieviorka, M., 1997, Une société fragmentée? Le mulJculturalisme en débat, Paris, édiSon La Découverte. Internet • hap://www.academia.edu/1314577/Regards_des_personnes_dorigines_immigrees_africaines_sur_la_Suisse_comme_pays_daccueil_au_debut_du_XXIeme_siecle