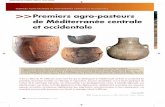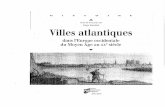Les nouvelles voix de l’Europe? Analyses des consultations citoyennes
-
Upload
iass-potsdam -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Les nouvelles voix de l’Europe? Analyses des consultations citoyennes
Introduction
Raphaël Kies and Patrizia Nanz
Afin de surmonter la crise politique de 2005, lorsque le
Traité Constitutionnel a été rejeté par les référendums
Français et Néerlandais, l'Union européenne (UE) a promu
plusieurs programmes participatifs ambitieux comme le Plan
D et Debate Europe visant à améliorer l'information et
l’implication européenne des citoyens. Ceci a mené à
l'apparition d'une grande variété d'expériences
consultatives innovantes à différents niveaux géographiques
(local, national, transfrontalier et pan-européen), et à
l’expérimentation d’une large variété de méthodes
participatives. Ces expériences visent à explorer de
manière délibérative les priorités et les préférences des
citoyens européens, de les (re)connecter avec la sphère
politique dirigée par des élites de Bruxelles et, de
manière plus ambitieuse, d'inclure les citoyens ordinaires
dans le processus décisionnel européen. Pour les
institutions de l'UE, et en particulier la Commission, ces
expériences participatives devraient servir de remède au
déficit de démocratie ou de légitimité de l'UE tandis que
pour les universitaires, elles constituent un terrain
d'enquête privilégié pour analyser la délibération des
1
citoyens dans un contexte transnational.
Les politologues et les juristes ont mis en garde de la
faiblesse démocratique de l'UE bien des années avant la
crise politique de 2005. D'un point de vue normatif, les
citoyens européens sont dans les conditions actuelles
seulement les récipiendaires de règlements communautaires
contraignants et coercitifs, et ne sont pas les auteurs
responsables des lois et principes constitutionnels qui
forment un régime politique (voir par ex., de Burca 1996,
Gerstenberg 1998, Weiler 1999). Alors que ce système est
basé sur des traités internationaux et, de par cela, tire
sa source suprême de légitimité dans la souveraineté des
Etats membres, le pouvoir des Etats-nations a parallèlement
été sapé par l'accroissement du pouvoir substantiel des
institutions européennes: les Etats-membres ne contrôlent
pas le contexte constitutionnel et légal dans lequel le
processus de prise de décision a lieu; Qui plus est, la
législation de l'UE se développe graduellement vers un
ordre légal supranational distinct et indépendant, dont les
dispositions priment sur les lois nationales et sont
directement applicables aux citoyens des Etats-membres. Le
déficit démocratique qui en résulte peut donc être défini
comme l'écart entre les effets omniprésents du pouvoir
régulateur de l'UE et la faible approbation de ce pouvoir
par les citoyens des Etats-membres qui sont directement
impactés par ces régulations (Nanz 2006).
2
D'un point de vue empirique, différentes études mettent en
évidence l’existence un manque de soutien populaire envers
les institutions de l'Union (Hix, 2008) et un manque
d'identité européenne (voir Risse 2010 pour une approche
critique). On peut dès lors se demander si les citoyens
européens reconnaissent que l'UE fournit un cadre de normes
qui les relient aux institutions européennes dans une
chaîne de droits et d'obligations réciproques. En tout cas,
il y a une importante divergence - plus visible dans
certains pays que dans d'autres - entre les positions des
élites et celles des masses envers l'UE (Bruter 2004). Pour
les élites politiques et économiques européennes l'UE est
certainement très réelle alors que pour les citoyens
ordinaires, l'UE est une communauté politique éloignée.
L'image dominante de la gouvernance européenne est celle
d'un processus opaque et technocratique qui imbrique des
fonctionnaires et des officiels dans un réseau politique de
proximité, plutôt que celle d'un processus de délibération
et de prise de décision ouvert à une large participation de
tous ceux qui sont concernés par son résultat.
Afin de traiter le problème de la légitimité de manière
efficace, la Commission européenne a voulu expérimenté de
nouveaux mécanismes participatifs (Abels 2009: 3). Cet
ouvrage vise d’une part à présenter les raisons de leur
apparition et d’autre part d’offrir une analyse critique de
3
leur potentiel légitimant. A cette fin, il tentera de
répondre aux deux questions suivantes: 1) Est-ce-que le
tournant participatif dans la communication européenne est
purement rhétorique ou y-a-t-il une volonté politique
réelle d'institutionnaliser des nouveaux modes
d’implication des citoyens ? 2) Est-ce-que ces procédures
participatives peuvent être considérées comme un pas en
direction d'une Europe plus légitime et plus démocratique?
L'émergence d'un régime de citoyenneté européenne
Un point crucial dans la légitimation de l’UE par les
citoyens est la citoyenneté européenne, une innovation
conceptuelle issue du Traité de Maastricht. La création de
ce statut légal va au-delà de l'intégration fonctionnelle
des économies des Etats-membres par les libertés
(économiques) élémentaires: la libre circulation des biens,
des services, des capitaux et de la main-d'œuvre. Jusqu'à
1992, les citoyens des pays membres de l'UE étaient les
"citoyens d'un marché commun"; ils étaient considérés comme
des étrangers quand ils voyageaient ou résidaient en dehors
de leur pays dans l'Union. La citoyenneté européenne a
établi un statut légal pour chaque ressortissant d'un pays
membre1 ce qui constitue un immense défi par rapport à la
conception conventionnelle de la citoyenneté.1 Le statut légal confère quatre droits essentiels : (1) le droit de libre circulation et de résidence dans les autres pays membres; (2) le droit de voteet de se présenter aux élections municipales et européennes dans l'état-membrede résidence; (3) la protection dans un pays non-UE par les représentants des instances diplomatiques ou consulaires d'autres pays membres si un état membre n'y est pas représenté; et (4) le droit d'adresser une pétition au Parlement européen et de faire appel à l'Ombudsman européen
4
Dans les Etats-nations, la citoyenneté est nationale: seuls
les ressortissants peuvent prétendre appartenir à la
communauté politique (démos). Il y a deux critères basiques
selon lesquels les Etats modernes définissent normalement
la nationalité, à savoir: l'ius sanguinis (critère
ethnique/culturel) et l'ius solis (critère territorial). Ces
critères sont censés incarner les éléments sociaux
d'attachement étroit à une nation particulière.
Ils servent de schéma de justification pour exclure les
non-ressortissants de la citoyenneté. La citoyenneté de
l'Union, bien que conditionnée à la citoyenneté nationale
est un statut qui n'est pas basé sur une appartenance
préalable à un Etat en particulier. Elle est liée au
concept de politique unique (Preuss et Requejo 1998) mais
ne présuppose pas un lien sous-jacent du citoyen à l'Union,
c'est à dire qu'elle ne véhicule pas de quelconque identité
européenne culturelle ou nationale. La citoyenneté
européenne abolit la hiérarchie entre les différentes
allégeances (nationale, européenne) et offre aux citoyens
une pléiade de relations associatives sans pour autant les
lier à une nationalité spécifique, de sorte que la
nationalité (l'appartenance) et la citoyenneté (le statut
légal) sont progressivement dissociées dans l'Union.
Alors que le corps législatif européen, composé du Conseil
européen et du Parlement européen, a été réticent à doter
le concept de citoyenneté européenne de droits
5
substantiels, la Cour de Justice de l’Union Européenne
s'est montrée bien plus réceptive à une interprétation plus
large de ce concept. Sa jurisprudence a joué un rôle majeur
en incluant graduellement les citoyens européens dans la
matrice des droits et devoirs des Traités et a ainsi promu
une vision transnationale de la citoyenneté UE (Nanz 2009).
En élargissant le principe de non-discrimination à celui
d'interdiction de toute discrimination due à la
nationalité, la Cour a reconstruit la citoyenneté
européenne d'une façon qui transforme les étrangers en
associés. Les personnes, qui sont séparées par leurs
identités nationales différentes, sont en même temps des
concitoyens de par la citoyenneté européenne qu'ils
partagent (Offe et Preuss 2006). Qui plus est, il y a eu
une expansion continue du statut de citoyenneté européenne
de sorte que celui-ci permet de profiter d'avantages et
d'allocations dans un autre pays membre (p.ex.:
l'allocation du demandeur d'emploi dans le pays de
résidence du citoyen européen).
La citoyenneté européenne n'envisage pas un démos
supranational mais une sphère plus abstraite de coopération
entre non-compatriotes, qui dépend de sa capacité à
collaborer dans des pratiques de citoyenneté
transnationales. La question qui en découle est: Est-ce que
les expériences de l'UE de ces dernières années en matière
de participation des citoyens offrent de bonnes
6
possibilités pour de telles pratiques transnationales?
Peuvent-elles être considérées comme le cadre
institutionnalisé d'une sphère publique européenne dans
laquelle les citoyens émettent des opinions sur des sujets
généraux et en fin de compte décident d'une action
collective? Une deuxième question est: Ces nouveaux types
de forums transnationaux peuvent-ils contribuer à donner de
la substance à la citoyenneté européenne? Pourraient-ils
mener à l'émergence d'une citoyenneté qui serait basée non
seulement sur les nouveaux droits et devoirs mais aussi sur
une meilleure connaissance des autres citoyens de l'UE et
empathie envers ces derniers?
Cas de participation transnationale de citoyens dans
l'Union Européenne
Depuis le début du 21ème siècle, il y a eu un accroissement
exponentiel de consultations citoyennes promues par le
Parlement et la Commission Européenne dans le cadre de
différents labels stratégiques (voir chapitre 1).
Face à cette grande diversité, plusieurs critères ont été
utilisés pour sélectionner les cas étudiés dans cet
ouvrage. Un premier critère a été l'importance du soutien
financier et politique de l'UE. La raison étant que les
consultations citoyennes qui sont d’avantage subventionnées
par l'UE sont plus susceptibles de faire partie, dans un
futur plus ou moins proche, du processus décisionnel de
l’Union européenne. Les deux projets appartenant à cette
7
catégorie sont la Consultation Européenne des Citoyens
(ECC09), et Europolis. Ceux-ci ont été financés à deux
reprises pour un montant dépassant le million d'Euros. Un
deuxième critère a été celui de l'attention portée à
l’inclusion et la participation des citoyens, l’implication
directe du citoyen correspondant à la nouvelle voie suivie
par l’UE afin d’accroitre sa légitimité après avoir tenté
de le faire (sans succès) en renforcement du rôle du
Parlement Européen et des associations de la société civile
dans le processus décisionnel. Tous les cas examinés dans
cet ouvrage se concentrent sur la participation des
citoyens, à l'exception de l'Agora, une consultation
organisée par le Parlement Européen avec les associations
de la société civile. Il nous a semblé important d'inclure
ce projet, implémenté dans la même période, car
l'implication directe de la société civile est souvent
présentée comme la meilleure solution pour renforcer la
légitimité de l'UE (voir par ex. Smismans 2006). La
comparaison de ces deux approches (société civile /
citoyens ordinaires) est utile pour évaluer s'il y a des
différences majeures en ce qui concerne la dynamique
discursive et l'impact des consultations, et à quel point
elles sont complémentaires. Un troisième critère est celui
de l'interactivité. Presque toutes les études de cas sont
des procédures de consultation basées sur des interactions
discursives, que ce soit en ligne, en face-à-face, ou les
deux à la fois. « Your Voice in Europe », la procédure de
8
consultation de la Commission, est une exception car elle
n'est pas basée sur une interaction discursive. Il s’agit
d’un cas d’étude néanmoins intéressant car c’est la seule
procédure consultative ouverte aux citoyens européens qui a
un impact tangible sur la prise de décision de l'UE. En vue
d’une institutionnalisation des consultations citoyennes au
niveau européen, son analyse se justifie afin d’évaluer
comment un tel impact peut s’étendre à d’autres formes de
consultation. Le dernier critère a été celui de la nature
transnationale de la participation, c’est-à-dire de
l'inclusion de participants de différents pays européens.
La nature transnationale d'un forum peut se matérialiser de
deux façons. La première est la participation de citoyens
de différents pays de l'UE dans un même forum, soit grâce
au service d’interprètes soit grâce à la maîtrise
suffisante d’une lingua franca (en général l'anglais). La
seconde est la combinaison de forums nationaux parallèles
qui traitent d'un même sujet et dont les résultats sont
synthétisés dans un document commun. Tous les cas
sélectionnés appartiennent à l'une ou l'autre de ces deux
catégories et rassemblent des participants d'au moins trois
pays.
Critères d'évaluation
Afin d’évaluer l’utilité et la qualité démocratique de ces
expériences participatives et leur capacité à connecter les
citoyens européens entre eux et avec les institutions
9
européennes, on a demandé aux auteurs de cet ouvrage
d'évaluer les consultations sur la base des critères issus
de la théorie délibérative. Il est important de noter
qu'une marge de liberté leur a été laissée quant au choix
et l’opérationnalisation des critères afin d’appréhender au
mieux les spécificités des cas analysés. Malgré cette
acception plutôt œcuménique de la délibération, les
contributeurs ont adopté les mêmes critères délibératifs
bien que sous diverses étiquettes et à travers différentes
méthodes d'opérationnalisation. On peut les classer sous
quatre catégories.
La première catégorie est l’inclusion qui se réfère à trois
exigences complémentaires. Premièrement, une inclusion par
auto-sélection impliquant que tous les individus intéressés
par un sujet devraient avoir la possibilité de prendre part
aux consultations citoyennes. Deuxièmement, une forme
d’inclusion plus progressiste suivant laquelle les
individus qui ne prendraient pas part spontanément à la
consultation mais dont les opinions pourraient être
profitables au résultat de la consultation devraient être
encouragés à le faire. Cela est particulièrement important
dans le contexte du processus de prise de décision de l'UE
qui est perçu par une vaste majorité de citoyens comme
particulièrement distante et opaque en raison de la
complexité des sujets traités, de la nature impénétrable du
mécanisme de prise de décision et de l'absence d'une
10
communication appropriée. Pour ce second type d'inclusion
le processus de sélection est fondamental et complexe car
il devrait viser à inclure des citoyens dont les opinions
sont représentatives des points de vue nationaux par
rapport aux sujets de la consultation. Enfin la notion
d'inclusion requiert que les individus qui ne sont pas
directement impliqués dans le processus consultatif soient
informés de ses tenants et aboutissants, afin que les
bénéfices issus du processus de consultation ne soient pas
confinés à ses seuls participants. Cet aspect de
l'inclusion est souvent assimilée à la notion de
"publicité" (au sens latin du terme; divulgation, rendre
public).
La seconde catégorie de critères normatifs concerne la
qualité de l'information et des échanges discursifs. Elle a
été inspirée par la théorie discursive de Jürgen Habermas
(1989,1996) qui définit un idéal délibératif dans un
contexte donné. Est-ce que les participants ont reçu une
information équilibrée? Ont-ils eu une chance égale de
s’exprimer? Ont-ils suffisamment justifié leurs opinions ?
Etaient-ils disposer à changer d’opinion ? Les débats ont-
ils été respectueux? Etc. Ces critères nous permettent
d'évaluer la valeur épistémique des consultations, la
dynamique des débats (sont-ils interactifs et réflexifs ?)
ainsi que celle de leur capacité à approfondir les liens
sociaux entre les citoyens de l'UE.
11
La troisième catégorie concerne l'impact civique (ou impact
interne) sur les personnes qui ont été impliquées dans les
consultations ainsi que sur celles qui n’ont pas
directement participé aux consultations (sphère publique au
sens large). Les analyses portent sur l’évolution des
connaissances, perceptions et opinions envers l’Union
européenne et envers les sujets débattus. Le potentiel
civique de ces expériences est généralement évalué à
travers des sondages et des entretiens.
Une dernière catégorie concerne l'impact sur la prise de
décision. Celle-ci mesure d'une part, si les propositions
et opinions exprimées au cours de la consultation sont
prises en considération par les décisionnaires (impact
direct) et d’autre part si les médias et leaders d'opinion
ont pris en considération les résultats produits par la
consultation (impact indirect). Bien que la nature
expérimentale des consultations et leur absence de lien au
processus décisionnel nous invite à avoir des ambitions
limiter quant à l’impact, il devrait y avoir un niveau
minimum d'impact correspondant au droit des participants à
recevoir un « feedback » de la part des autorités visées
par les consultations.
Plan du l'ouvrage
Cet ouvrage est divisé en trois parties. La première partie
12
offre une vue d’ensemble des pratiques délibératives de
l'UE. Le chapitre de Mundo Yang reprend l’ensemble des
consultations citoyennes qui ont été financées par les
institutions de l'UE depuis 2001 et offre une analyse
pointue de l'évolution de la stratégie de communication de
l'UE depuis le Livre blanc sur la gouvernance (EC 2001)
jusqu’au Livre blanc sur une politique de communication
européenne (EC 2006). Sur base de cette analyse il
argumente que la stratégie de communication de l’UE est
passé d’un modèle « du haut vers le bas » ayant pour
objectif d'élargir la légitimité des institutions
européennes en informant mieux ses citoyens de leurs
travaux à un modèle du « bas vers les haut » qui considère
que le processus de décision dans l'UE devrait être
légitimé par une implication directe et discursive de ses
citoyens. Cependant il relève de faiblesses dans
l’implémentation de ces stratégies. En particulier, il
critique qu'il n'existe pas de synergies efficaces dans et
entre les institutions de l'UE, et que le soutien financier
à la promotion des consultations citoyennes a été marginal.
De même il observe qu'avec l'arrivée de la deuxième
Commission Barroso, la volonté politique en faveur des
consultations citoyennes a fortement décliné. Yang en
conclut que le paradigme communication unidirectionnel du
haut vers le bas perdurera. Les consultations citoyennes et
les nouvelles stratégies de communications n’auront été
qu’une phase d’expérimentation transitoire sans lendemain.
13
Le deuxième chapitre, de Dawid Friederich, réexamine et
analyse les nouvelles pratiques de la gouvernance
européenne d'un point de vue délibératif. Cette étude
permet non seulement d’appréhender le caractère innovant
des consultations citoyennes par rapport aux pratiques
existantes de gouvernance européenne (Comitologie, Méthode
Ouverte de Coordination et Dialogue Civil), mais aussi
d’établir dans quelle mesure et sous quelles conditions
elles pourraient renforcer la légitimité du processus
décisionnel européen. L’auteur conclut que les
consultations citoyennes pourraient contribuer à renforcer
le caractère délibératif de l’UE sous certaines conditions
(sélection des participants, visibilité, impact, etc…) qui
seront brièvement analysées dans la dernière partie de
cette introduction.
La seconde partie est axée sur l’analyse empirique des cas
d’études sélectionnés. Les deux premiers chapitres traitent
des deux consultations majeures du point de vue de la
participation et de l’engagement financier et humain. La
première, la Consultation européenne des Citoyens (ECC09), par
Raphaël Kies, Monique Leyenaar et Kees Niemöller, est une
méthode consultative inspirée par méthode du « 21st century
meeting »2. Elle est fondée sur une procédure complexe qui
2 Le « 21st century meeting » est un évènement à grande échelle sur uneseule journée qui utilise les technologies de la communication et de l’information afin de permettre la participation d’un grand nombre de participants (pour plus d’information, voir à ce sujet les chapitres de John Gastil et Graham Smith)
14
invite un grand nombre de citoyens des 27 Etats membres à
débattre et élaborer des propositions en ligne et en face à
face sur la question du « futur social et économique de
l’Europe ». L’étude conclut que l’impact civique de la
consultation était positif et pointe sur des améliorations
à apporter pour améliorer la qualité délibérative et
l’impact de la consultation sur la décision, celle-ci ayant
été au mieux symbolique. Le deuxième cas, par Pierangelo
Isernia, James Fishkin, Jürg Steiner et Danilo Di Mauro,
est le sondage d’opinion européen délibératif Europolis qui a
réuni à Bruxelles un échantillon de 348 citoyens
représentatifs de la population européenne afin d’y
échanger et exprimer leurs opinions sur « l’immigration »
et « le changement climatique ». A la différence d’ECC09,
les citoyens participant à Europolis n’avaient pas été tenus
à élaborer des propositions, mais d’exprimer leurs opinions
sur un questionnaire prédéfini avant, pendant et après une
discussion équilibrée et informée. Les auteurs considèrent
positivement la structure, l’implémentation et l’apport
civique de cette expérience. Ils remarquent en ce sens que
les participants ont changé d’avis sur les sujets débattus
et que leur perception de la légitimité de l’UE et de
l’appartenance à celle-ci s’est améliorée.
Le troisième cas analysé par Julien Talpin et Laurence
Monnoyer-Smith est Ideal-EU, qui comme ECC09 est aussi
inspiré le « 21st century meeting ». Cependant, alors que
15
la structure et l’objectif de la consultation sont
similaires, Ideal-EU diffère de ECC09 en beaucoup de
points: le sujet est différent (changement climatique), la
population ciblée est plus restreinte (des jeunes gens
entre 14 et 30 ans dans trois régions européennes), la
sélection est faite sur base volontaire et non de manière
aléatoire, et les participants n’ont pas été invités à
élaborer des recommandation mais, à la place, d’exprimer
leur points de vue dans un questionnaire à choix multiples
qui avait été élaboré par avance par les organisateurs.
Similairement à ECC09 les auteurs observent que l’absence
d’impact mène à une frustration des participants et risque
de discréditer le projet délibératif de l’UE dans son
ensemble. Une contribution originale de ce chapitre est sa
tentative de définir les facteurs pouvant influencer la
qualité de la délibération à l’intérieur de la même
procédure consultative. Ils constatent que l’objet de la
discussion, qu’ils distinguent entre local et global, a eu
un plus grand impact sur la qualité de la délibération que
ne l’avait eu la distinction entre les débats face à face
et en ligne.
Le quatrième cas d’étude, par Romain Badouard, est « Your
Voice in Europe ». Comme nous l’avons mentionné auparavant,
c’est la seule procédure parmi les consultations citoyennes
analysées à être institutionnalisée et à avoir par
conséquent un impact minimal garanti sur la prise de
16
décision. Son analyse empirique porte sur la consultation
réalisée sur l’Initiative citoyenne européenne (ICE) qui
est entrée en vigueur avec le Traité de Lisbonne. Alors que
l’impact est important et visible, Badouard déplore
l’absence d’une dimension discursive interactive. Plus
généralement, il remarque que la participation des citoyens
à travers cette méthode est plutôt faible en regard de
celle des groupes d’intérêt et autres acteurs
institutionnels. Il en arrive à la conclusion que le taux
de participation des citoyens à ce type de consultation est
lié à la complexité du sujet débattu. Le dernier cas
empirique par Léa Roger est Agora. Il s’agit de la deuxième
des trois consultations lancées par le Parlement Européen.
Le sujet de la consultation était le “ changement
climatique” et le public ciblé était exclusivement composé
d’acteurs de la société civile. Une découverte intéressante
dans cette étude est que la consultation a montré des
faiblesses similaires à celles observées pour la plupart
des consultations: il n’y a pas eu d’impact sur le
Parlement Européen et il y a eu d’importants
dysfonctionnements dans la manière dont la consultation a
été organisée (manque de temps, groupe de discussions trop
grands, et modération non-professionnelle).
L’ouvrage se conclut par les chapitres de deux spécialistes
de la démocratie délibérative, Graham Smith et John Gastil.
Ces derniers ont été chargés de comparer et évaluer ces
17
expériences. Graham Smith compare le caractère délibératif
de leur modèle ainsi que celui du « Futurum », un forum
internet qui a été mis en place pour permettre aux citoyens
de débattre dans n’importe quelle langue européenne sur le
processus constitutionnel européen (Wright 2007). Il
élabore une matrice analytique permettant de distinguer les
cas étudiés et de les évaluer de quatre critères
délibératifs. Comme Mundo Yang, Smith est plutôt pessimiste
quant au futur des consultations citoyennes dans l’UE. De
son point de vue, les méthodes délibératives expérimentées
dans l’UE disparaitront en faveur de la voie plébiscitaire
incarnée par l’ICE. C’est une évolution qu’il regrette, car
elle ne va pas favoriser une interaction équitable entre
les citoyens européens, mais risque de devenir un autre
instrument qui sera exploité par des groupes d’intérêts
organisés.
Le chapitre de John Gastil analyse ces expériences à l’aune
des innovations participatives et pratiques appliquées dans
d’autres contextes nationaux. Il développe un cadre
analytique qui distingue le niveau d’influence (sur les
participants; sur le grand public; sur les officiels) de la
phase du processus de prise de décision dans laquelle ceux-
ci interviennent (élaboration de l’ordre du jour; analyse
du problème; encadrement du choix; prise de décision).
Ensuite il utilise ce même cadre pour présenter un large
éventail de pratiques de délibération publique existantes
pour illustrer des possibilités alternatives et
18
complémentaires aux projets délibératifs démocratiques
existants de l’UE. Ce dernier chapitre qui fournit une vue
d’ensemble clairement structurée des modes existants de
délibération citoyenne est d’une grande valeur pour
élaborer des solutions complémentaires et innovatrices pour
favoriser son développement dans le contexte européen.
Complémentarité avec l’Initiative citoyenne européenne ?
Avec la crise économique qui s’est installée à la suite de
la crise financière de 2007, la politique européenne a été
mise à rude épreuve. Alors que les leaders européens
courent d’un sommet à l’autre, l’attention politique et
médiatique s’est portée sur les choix économiques en
laissant de côté le problème de la légitimité démocratique.
L’urgence de la crise économique, en d’autres termes, a
détourné l’attention de la plupart des leaders de la
nécessité de relier les citoyens aux affaires européennes.
Le seul progrès notable en termes de démocratie
participative depuis la reconnaissance de l’échec en 2005
est l’introduction de l’ICE qui permet à un million de
citoyens originaires d’au moins sept pays membres de
soumettre une proposition à la Commission à condition
qu’elle tombe dans le champ de ses compétences, qu’elle
respecte les valeurs fondamentales de l’UE et qu’elle ne
soit manifestement pas injurieuse, frivole ou vexatoire.
Il est de toute évidence trop tôt pour tirer une conclusion
19
même partielle sur le fonctionnement et l’impact
démocratique de l’ICE vu que celle-ci a été introduite très
récemment (1er Avril 2012) et qu’à ce jour seulement une
initiative (pour un droit à l'eau et à l'assainissement) a rassemblé le
nombre nécessaire de soutiens pour qu’elle puisse être
considérée par la Commission. Cependant, il est clair que
l’ICE doit résoudre plusieurs problèmes pour son
implémentation (pour un compte rendu, se reporter à De
Witte et al. 2010) et ne vise pas les mêmes objectifs
démocratiques que les consultations citoyennes.
Premièrement, l’ICE ne facilite pas l’inclusion de citoyens
ordinaires qui ne sont pas intéressés aux affaires
européennes. Elle concerne en premier chef les groupes
organisés qui disposent de suffisamment de ressources
humaines et financières pour rassembler un million de
signatures en seulement douze mois (voir le chapitre de
Smith). A l’inverse, les consultations citoyennes ciblent
précisément les citoyens ordinaires, ceux qui sont
généralement détachés de la politique européenne.
Deuxièmement, l’ICE n’est pas spécifiquement conçue pour
promouvoir un véritable espace de discussion pan-européen
comme le prétendent la plupart de ses partisans. Certaines
propositions sont susceptibles d’être discutées dans
différents espaces publics nationaux, mais il s’agira d’un
public restreint aux élites nationales intéressées aux
affaires européennes. Il est aussi peu probable que les
débats autour de l’ICE soient aussi délibératifs que ceux
20
observés dans la plupart des consultations citoyennes. Car
à l’inverse de celles-ci, l’ICE n’est pas conçue pour
promouvoir un débat délibératif transnational des citoyens.
Troisièmement, il est faux de penser que l’ICE serait un
instrument participatif plus légitime que les consultations
citoyennes, car influencer le processus de prise de
décision de l’UE en récoltant un million de signatures (sur
500 millions de citoyens européens) sous l’impulsion de
groupes bien structurés ne constitue pas une base
démocratique plus forte que les propositions élaborées à
travers les consultations citoyennes. On pourrait même dire
que ces dernières sont plus légitimes en ce qu’elles
cherchent à établir des propositions issues d’interactions
qualitatives et inclusives. En dernier lieu, l’ICE, peut
également apporter son lot de frustrations si les
propositions sont jugées non-admissibles, si elles ne se
traduisent pas en actes législatifs ou si elles ne
réunissent pas un million de signataires en à peine douze
mois. Ce danger a été souligné par le groupe « Campagne
ICE »3 qui considère que le délai de récolte des signatures
devraient être prolongé (de 12 à 18 mois) et que les
critères de recevabilité des initiatives devraient être
mieux précisés afin d’éviter que la Commission ne les
bloque à un stade précoce.
3 La Campagne ECI est une coalition populaire de défendeurs de la démocratie et de plus de 120 ONG visant à la création et à l’implémentation du droit d’initiative populaire des citoyens de l’UE.Disponible à : http://www.citizens-initiative.eu/?page_id=2 [Accessed:7 June 2011].
21
Pour la promotion de la légitimité démocratique de l’UE il
serait erroné de mettre en compétition ces deux approches
car celles-ci sont complémentaires: l’ICE est un mode de
participation plus approprié pour réunir les souhaits des
groupes organisés tandis que les consultations citoyennes
sont plus adaptées pour favoriser la participation des
« simples » citoyens européens. Ces nouvelles procédures
sont elles-mêmes complémentaires des autres canaux
d’opinions que sont les médias, les partis politiques, les
syndicats, les lobbies et les enquêtes d’opinion (ex:
Eurobaromètres).
Défis à venir
Les différentes analyses des consultations citoyennes
s’accordent sur le fait que ces nouveaux instruments ont un
véritable potentiel civique: les citoyens impliqués ont
généralement exprimé de la satisfaction quant à leur
fonctionnement et signalé un accroissement de leur niveau
de connaissance de l’UE et des sujets traités. En d’autres
termes, les consultations citoyennes ont le potentiel
d’améliorer la légitimité de l’UE et de promouvoir une
citoyenneté européenne plus substantielle. Cependant,
l’analyse empirique montre aussi plusieurs faiblesses en ce
qui concerne leur fonctionnement et leur implémentation
ainsi que de leur impact sur le processus politique
européen. Celles-ci peuvent se résumer en trois défis que
les concepteurs des consultations européennes de demain
22
devraient prendre en considération.
Le premier de ces défis la promotion de l’inclusion des
citoyens, qui devrait être aussi large que possible en
favorisant la participation de citoyens - qui ne sont pas
impliqués dans la politique européenne. Il ressort des
analyses effectuées dans cet ouvrage que celles-ci peut au
mieux être promue à travers la combinaison de méthode
participative (à la fois en ligne et en co-présence) et par
le choix des questions débattues. Ainsi les expériences
ECC09 et Ideal-EU qui combinent le interactions
« virtuelles » avec les « réelles » mettent en évidence
qu’une phase ouverte en ligne permet à un grand nombre de
citoyens et/ou de membres de la société civile d'exprimer
leurs opinions, alors que des consultations en face à face
bien organisées et basées sur des critères de sélection
soigneusement définis, enrichissent la consultation avec
des opinions de citoyens qui ne débattraient spontanément
de questions européennes. Comme le montrent Talpin et
Monnoyer (voir chapitre cinq), "l'articulation de différents cadres de
la discussion pourraient par cette perspective permettre une plus grande
inclusion, en permettant de réaliser le potentiel entier de la démocratie
délibérative". Il va sans dire qu'un tel potentiel ne pourra
être réalisé que si un pont entre ces deux phases est
prévu. Dans les deux cas précités, ce pont était absent ou,
trop étroit. La seconde manière pour augmenter l'inclusion
est le sujet du débat. Badouard montre que des thèmes qui
23
sont techniques et d'intérêt spécifique sont plus
susceptibles d'attirer des groupes organisés alors que les
sujets d'intérêt général et facilement abordables, sont
susceptibles d'attirer l'opinion des simples citoyens. En
d'autres termes, il y a une tension entre la complexité des
sujets débattus et la participation spontanée des citoyens
dans le processus d'auto-sélection de ces derniers. Une
telle tension devrait être prise en considération dans
l’élaboration des consultations afin de déterminer la
meilleure méthode pour favoriser l'inclusion du plus grand
nombre.
Un deuxième défi concerne le caractère multilingue et
multiculturel des débats propre aux consultations pan-
européennes. Les consultations analysées ont répondu à ce
défi en favorisant des échanges discursifs entre des
citoyens de pays différents ou bien en favorisant des
échanges discursifs entre les citoyens du même pays sur une
même thématique. Alors qu'une approche pan-européenne
multilingue peut sembler plus attirante du point de vue
humain et civique, elle est particulièrement coûteuse car
elle entraine d’importants frais de transport, de
traduction, et d’hébergement. Ceci implique qu'elle ne peut
que rarement être réalisée et ne profite qu'à un nombre
restreint de personnes. Qui plus est, la « multilinguisme »
présente d’autres dangers. En cas d’absence de traduction
(voir Futurum), il y a un danger que le débat soit dominé
par des locuteurs anglophones natifs. A l’inverse la
24
traduction des débats ralentit en limite la spontanéité et,
ne permet en tout état de cause, que certaines combinaisons
de langues (voir Europolis ou ECC09). C'est pour ces
raisons qu'une consultation pan européenne se basant
principalement sur des consultations nationales, dans
lesquelles les propositions d'autres pays sont discutées
est probablement la solution la plus réaliste sur le long
terme.4
Un troisième défi est l'impact externe des processus
participatifs sur les décisions politiques et/ou sur la
sphère publique au sens large (media, leaders d'opinion,
etc...). Quand bien même les standards pour évaluer
l'impact des consultations européennes devraient être
indulgents en raison de leur nature expérimentale, une
absence totale d'impact n'est pas acceptable. Ce n'est pas
seulement problématique en raison de la frustration que
cela engendre parmi les participants (voir dans cet ouvrage
les chapitres trois, cinq, et sept) mais aussi en ce qui
concerne la qualité des débats. Roger cite l'étude de Ryfe
et celui de Hibbings et Theiss-Morse qui ont trouvé que les
personnes en contexte de face à face5 sont plus enclines à
s’engager dans des consultations de manière critique et à
en accepter les conséquences et si le processus consultatif
4 Il faudrait noter qu'une telle solution n'exclut pas la possibilité d'avoir à un stade postérieur un débat pan-européen, qui se tiendrait en anglais ou, si plus d'inclusion est souhaitée en plusieurs langues de travail. Dans ce cas il est très important de créer une relation claire entre les deux phases de la consultation.5 Il est intéressant de noter que des résultats similaires ont été observés dans le cas de web-débats (Kies 2010)
25
a un impact réel sur la décision. Alors qu'il semble clair
pour tout un chacun que les consultations européennes
devraient, comme tout type de consultation, être au minimum
prises en considération dans le processus décisionnel, il
est inquiétant de noter que les concepteurs des
consultations analysées ainsi que les autorités
destinataire de ces consultations n'aient pas conçue des
procédures garantissant que les consultations soient
considérées. Comme le montrent différentes contributions
dans cet ouvrage, il existe différentes voies à explorer
pour assurer la prise en considération des consultations
européennes par les autorités. La première, probablement le
plus évidente, est de les intégrer en tant que nouvel
instrument participatif officiel dans le processus
décisionnel de l’UE (comme Your Voice in Europe). La table
analytique de Gastil (voir chapitre neuf) peut ici se
révéler un précieux outil pour définir à quel niveau du
processus décisionnel une telle consultation devrait être
introduite. La seconde consiste à s’assurer que la
consultation soit utile pour l'autorité qui la sollicite.
En d'autres termes, une consultation ne devrait pas se
résumer à un acte performatif dont le seul but serait
d'améliorer l'image des institutions européennes, mais
devrait au contraire répondre à un réel besoin d'expertise
que seuls les citoyens peuvent fournir. Si ce n'est pas le
cas, ces consultations encourent le risque d'être perçues
comme un pur exercice de marketing ce qui ne desservirait
26
l’image des autorités européennes. La troisième concerne le
choix de la thématique de la consultation. Le sujet des
consultations devrait être restreint et concret à la fois
dans le but d’engranger des opinions et des propositions
qui soient utiles aux décideurs. Si de simples citoyens ou
même des organisations de la société civile sont invités à
débattre sur des sujets très vastes tels que "le futur
économique et social de l'Europe" (ECC09), "la politique
migratoire en Europe" (Europolis) ou "le changement
climatique" (Ideal-EU), les opinions exprimées ne peuvent
être que très générales et, en conséquence, apparaître
inutiles aux décideurs. Bien que des propositions concrètes
soient recherchés, cela n’implique pas les désaccords
observés entre les citoyens des différents pays soient
ignorés, car l’objectif des consultations européennes ne
doit pas être celui d'obtenir un consensus général parfait
mais celui d'améliorer la délibération entre citoyens et
d'enrichir l'information disponible pour les décideurs.
Comme le dit Gastil dans son chapitre: "les consultations
européennes analysées dans ces ouvrages ne disent pas aux
décideurs comment décider mais pourquoi il est souhaitable
d’arriver à certaines décisions. En fin de compte,
transmettre des recommandations politiques brutes sans
justifications serait le summum de l'ironie pour un
processus délibératif attaché par essence aux règles de la
raison et de l'argumentation".
Enfin les consultations européennes doivent faire face à un
27
problème de crédibilité qui découle de leur mission souvent
imposée par les institutions européenne à travers leur
appel d’offre de contribuer à l’amélioration de leur image
auprès de ses citoyens. Ceci implique donc qu'elles ont été
choisies plutôt pour leur potentiel promotionnel que pour
leur capacité à intégrer à intégrer les voix des citoyens
le processus décisionnel. En conséquence certains choix ont
dû être faits qui sont en décalage avec les principes
délibératifs. Pour commencer, les organisations -
essentiellement des ONG, des think tanks et des universités
- qui ont implémenté les procédures consultatives étaient
généralement en faveur de l'intégration de l'UE ou étaient
directement concernées par le sujet de la consultation.
Dans le cas d'Ideal-EU, par exemple, certains débats en
ligne sur le changement climatique étaient guidés par un
activiste écologiste soupçonné d’avoir volontairement
orienté les débats. Un autre problème connexe est le choix
du sujet qui pourrait avantager certains acteurs politiques
par rapport à d'autres. Dans le cas d'Europolis, par
exemple, il est apparu que les débats sur les changements
climatiques ont influencé de manière significative les
intentions de vote en faveur du parti écologiste. Un
dernier défi possible quant à la crédibilité de ces
évènements est qu’ils ont été évalués dans plusieurs cas
par des chercheurs qui étaient directement impliqués dans
leur implémentation ou qui sont connus pour promouvoir les
méthodes délibératives. Alors que tout a été fait pour
28
s’assurer que les consultations analysées dans cet ouvrage
l’aient été de manière professionnelle et autonome, il
serait souhaitable que dans le futur l'implémentation et
l'évaluation des consultations fussent réalisées par des
personnes différentes afin de ne pas laisser l’espace à des
sentiments de suspicion
Futur des consultations citoyennes européennes?
Les chercheurs et praticiens dans le domaine de la
participation européenne partagent le sentiment que
suffisamment de matériel d'expérimentation a été accumulé
et que le temps est venu pour les autorités européennes de
prendre une décision sur l’opportunité d’institutionnaliser
les consultations des citoyens à l'échelle européenne. Cela
n’est cependant pas susceptible de se produire dans les
années qui viennent. Les consultations européennes
continueront à être expérimentées à travers le plan
d'action comme " citoyens actifs pour l’Europe" (se
terminant en décembre 2013) et la contribution pour leur
implémentation sera réduite en comparaison des programmes
précédents. Ceci implique que des projets importants
transnationaux tels que ECC09 et Europolis ne pourront plus
être implémentés et que les prochains projets participatifs
risquent d'être de plus en plus perçus comme des
instruments promotionnels sans réel impact sur le processus
décisionnel. Un tel déroulement ne pourra porter qu’à plus
frustration parmi les citoyens à une critique grandissante
29
des stratégies participative et plans d’actions dans le
domaine de la citoyenneté européenne.
2013 est l'année européenne de la citoyenneté. C'est une
chance unique pour discuter et décider de la manière
d’exploiter dans l’intérêt des citoyens européens le
matériel et connaissances démocratiques extraordinaires qui
ont été engendrés à travers les différentes consultations
européennes. Nous espérons que cet ouvrage apportera une
contribution valable à ce débat complexe mais nécessaire.
Bibliographie
Abels, G. 2009. Citizens’ Deliberations and the EU’s
democratic deficit. Is there a model for participatory
democracy ?, Tübinger Arbeitspapiere, TAIF Nr. 1. Available
at: http://aei.pitt.edu/11419/1/Abels_TAIF1_2009.pdf
[accessed: 9 July 2012].
Bruter, M. 2004. Civic and Cultural Components of a
European Identity: A Pitot Model of Measurement of
Citizens’ Level of European Identity, in Transnational
Identities. Becoming European in the EU, edited by R.H.
Herrmann, T. Risse and M.B. Brewer. New-York: Rowman &
Littlefield, 186–213.
De Burca, G. 1996. The Quest of Legitimacy in the European
Union. The Modern Law Review 59(3), 349–76.
De Witte, B., Trechsel, A., Damjanovic, D., Hellquist, E.,
30
and Ponzano P. 2010. Legislation after Lisbon: New
Opportunities for the European Parliament. Study
prepared in the framework of the European Union Observatory (EUDO),
Available at:
http://www.eui.eu/Projects/EUDO/Documents/EUDO-
LegislatingafterLisbon%28SD%29.pdf [accessed: 3 July
2012].
European Commission. 2001. European Governance. A White Paper,
COM(2001) 428 final. Brussels: EC.
——— 2006. White Paper on a European Communication Policy. Brussels:
EC.
Gerstenberg, O. 1998. Private Ordering, Public Intervention
and Social Pluralism, in Private Governance,
Democratic Constitutionalism and Supranationalism
edited by O. Gerstenberg and C. Joerges. Brussels:
European Communities, 205–18.
Habermas, J. 1989. The Structural Transformation of the Public Sphere.
Cambridge: MIT Press, Cambridge
——— 1998. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of
Law and Democracy. Cambridge: MIT Press.
Kies, R. 2010. Promises and Limits of Web-Deliberation. New York:
Palgrave.
Nanz, P. 2006. Europolis. Consitutional Patriotism beyond Nation–State.
Manchester: Manchester University Press.
——— 2009. Mobility, Migrants, and Solidarity: Towards an
Emerging European Citizenship in Migrations and Mobilities –
31
Citizenship, Borders and Gender, edited by S. Benhabib and L.
Resnik. New York: New York University Press, 410–38.
Offe, C. and Preuss, U. K. 2006. The Problem of
Legitimacy in the European Polity: Is Democratization
the Answer ?, in Diversity of Democracy: Corporatism, Social
Order, and Political Conflict, edited by C. Crouch and W.
Streeck. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 175–204.
Preuss, U. K. and Ferran, R.1998. European Citizenship.
Multiculturalism, and the State. Baden-Baden: Nomos Verlag.
Reding, V.2010. Europe for Citizens and Citizens for Europe – Delivery and
Participation. Paper to the Citizen Consultation in the
Light of the Lisbon Treaty: Conference held by the
European Policy Center and the King Badouin
Foundation, Brussels, September 14th.
Risse, T. 2010. A Community of Europeans? Transnational Identities and
Public Spheres. Ithaca: Cornell University Press.
Smismans, S. 2006. Civil Society and legitimate European Governance.
Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Weiler, J. 1999. The Constitution of Europe: “Do the New
Clothes Have an Emperor?” And Other Essays, Cambridge:
Cambridge University Press.
32