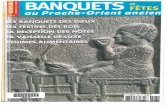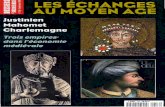IPC Definition Project Files/Dossiers de projet de ... - WIPO
MANEN C. 2012. Premiers agro-pasteurs de Méditerranée centrale et occidentale. In : J. Guilaine...
Transcript of MANEN C. 2012. Premiers agro-pasteurs de Méditerranée centrale et occidentale. In : J. Guilaine...
46 / Les Dossiers d’Archéologie / n°353
>>Premiers agro-pasteursde Méditerranée centrale et occidentale
C’est au début du VIe millénaire avant notre ère que se développent en Méditerranée centrale et occidentale lespremières économies fondées sur l’élevage et l’agriculture. Souvent rassemblées sous le terme générique deCulture de la céramique imprimée, ces communautés n’en développent pas moins, à l’échelle régionale, uneidentité propre, qui évolue au fil des générations et des déplacements. Adaptant leur savoir-faire aux nouveauxespaces rencontrés, recomposant régulièrement leur organisation socio-économique ou leurs équipements, cespremières communautés paysannes nous livrent un paysage culturel multiforme.
PREMIERS AGRO-PASTEURS DE MÉDITERRANÉE CENTRALE ET OCCIDENTALE
Claire MANEN
>> Chargée de recherche au CNRS, UMR 5608 « Traces », Toulouse
Diverses poteries décorées d’impressions emblématiques des premières sociétés paysannes de Méditerranée centrale et occidentale.1. Ripabianca di Monterado (Marches, Italie). D’après G. Radi, Les séquences de la céramique imprimée en Italie, dans : Premières sociétés paysannesde Méditerranée occidentale. Structures des productions céramiques, Paris, Société préhistorique française, Mémoire 51, 2010, p. 136, fig. 2.2. Pont de Roque-Haute (Hérault). Cliché C. Manen. 3. Fontbrégoua (Var). D’après J.-P. Demoule, La France de la Préhistoire, Paris, Nathan, 1990, p. 69.4. Cova de l’Or (Région de Valencia, Espagne). D’après B. Martí Oliver, Museo de Prehistoria « Domingo Fletcher Valls ». Diputacion de Valencia, 1995, p. 63.
DARCH-353-46-51-Manen 23/07/12 13:32 Page46
n°353 / Les Dossiers d’Archéologie / 47
REPÈRES HISTORIOGRAPHIQUES ET QUESTIONNEMENTS ACTUELS
n Méditerranée centrale et occidentale, lesrecherches sur le passage d’un monde dechasseurs-collecteurs à un monde paysan,
ou processus de néolithisation, ont pris leur essordurant la première moitié du XXe siècle. Le débat sesitue alors autour de deux modèles. L’un favorise lesmigrations progressives, depuis le Proche-Orient, decommunautés néolithiques détentrices des savoir-faire liés à l’économie agro-pastorale. Le second pri-vilégie, au contraire, les derniers chasseurs-cueilleursindigènes et leur capacité à initier ou adopter lesinnovations techniques et économiques du mondeagro-pastoral. Le premier modèle, dit diffusionniste,a notamment été défendu par V. Gordon Childe etL. Bernabò Brea, tandis que le second, dit autochto-niste, a plus particulièrement été développé parP. Bosch-Gimpera. À la jonction de ces deux concep-tions on verra ensuite la construction, durant lesannées 1960 et 1970, d’un système qui, sans rejeterles influx allogènes, nuance le concept de diffusion/colonisation en utilisant celui de l’emprunt techno-logique induisant progressivement l’acculturationdes derniers chasseurs. Durant les années 1980, lecaractère exogène des céréales et des ovicaprinés,domestiqués au Proche-Orient, est définitivementdémontré tandis que les synthèses régionales sesubstituent aux approches globalisantes. Enfin, plus
récemment, en mettant l’accent sur les séries d’adap-tation aux environnements et les recompositionsculturelles qui ont façonné le premier Néolithiqueeuropéen, J. Guilaine a élaboré l’hypothèse d’unediffusion arythmique de l’économie agricole alorspré sentée comme irrégulière et polymorphe. Aujour -d’hui, ce sont donc autour des dynamiques de dif-fusion des nouveautés techniques et économiquesnéolithiques (animaux et plantes domestiques, pote -rie, pierre polie, etc.) et de leur transformation pro-gressive que vont se concentrer les questionnements.Pour rendre compte de la complexité de ce proces-sus de néolithisation, divers facteurs doivent êtremobilisés : facteurs environnementaux ou clima-tiques (variété des environnements plus ou moinsfavorables à exploiter, impact des épisodes froids ouhumides ayant émaillés le VIe millénaire avant notreère), économiques, socioculturels (par exemple laconfrontation avec les dernières sociétés de chasseurs-collecteurs autochtones) ou démographiques (parexemple une croissance impliquant la conquête denouvelles terres cultivables).
CHRONOLOGIE, RYTHMES ET CHEMINS DELA NÉOLITHISATION MÉDITERRANÉENNE
Dans les restitutions de la dynamique généralede la néolithisation méditerranéenne, les donnéesissues de la chronologie absolue prennent évidem-ment une place importante. Elles permettent en
E
Le gisement de Peiro Signado(Hérault) en cours de fouille,matérialisant les restes d’unpetit habitat dont l’ossaturese composait de poteaux périphériques entre lesquelss’inséraient des parois faitesde panneaux en clayonnagesde branches enduits de torchis. Fouille et cliché F. Briois.
DARCH-353-46-51-Manen 23/07/12 13:32 Page47
effet de traduire la vitesse d’expansion des premièreséconomies paysannes et d’en observer les rythmeset les cheminements. Le corpus de datations radio-carbone fiables (dont le lien avec l’évènement quel’on souhaite dater ne fait aucun doute) est encoreactuellement bien faible mais il permet malgré toutde tracer les grandes lignes de ce vaste périple. EnMéditerranée centrale et occidentale, les premièrestraces de l’économie agro-pastorale apparaissent auxenvirons de 6000 avant notre ère en Italie du Sud-Est, au sein de la sphère culturelle dite de l’Impressa(car caractérisée par une poterie décorée d’impres-sions réalisées à l’aide d’instruments variés). La ques-tion de l’origine de l’Impressa reste un enjeu desrecherches futures et il nous manque encore denombreuses pièces du puzzle pour aborder, d’unepart, les relations de ces premiers Néolithiques avecles dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs autoch -tones et, d’autre part, les liens génétiques avec lesfaciès néolithiques plus orientaux.
Peu après, entre 5900 et 5700 avant notre ère, ladistribution des sites archéologiques livrant les témoi -gnages de pratiques agricoles se densifie au sud de
48 / Les Dossiers d’Archéologie / n°353
PREMIERS AGRO-PASTEURS DE MÉDITERRANÉE CENTRALE ET OCCIDENTALE
l’Italie. Durant ce même laps de temps, il a été pos-sible, notamment sur les côtes languedociennes(sites de Peiro Signado et de Pont de Roque-Haute,à Portiragnes près de Béziers dans l’Hérault), de documenter l’implantation de petits groupes pion-niers en provenance de l’Italie centro-méridionale.Tout en important leur mode de vie (économiebasée sur l’élevage des chèvres et des moutons etla culture du blé amidonnier) et leur savoir-faire(manière de façonner et décorer la céramique, detailler le silex), ces populations se sont adaptées auxpotentialités offertes par leur nouvel environne-ment. Divers indices, dont ceux délivrés par la resti-tution des réseaux de circulation de l’obsidienne(roche volcanique vitreuse notamment présente surles îles de Sardaigne, Lipari et Palmarola), démon-trent que l’espace tyrrhénien est dès cette périodeparcouru et exploité, soulignant de fait le rôle im-portant de la navigation, permettant des mouve-ments de grande ampleur dans cet espace denéolithisation (l’obsidienne de Palmarola et de Sar-daigne est par exemple présente sur les sites langue-dociens de Portiragnes.
Carte schématique illustrant les différentes aires d’influence du site de Pont de Roque-Haute (Hérault, France). CommePeiro Signado, ce gisement témoigne de l’implantation sur les côtes languedociennes d’un petit groupe humain enprovenance de l’Italie au début du VIe millénaire avant notre ère. D’après J. Guilaine et C. Manen, 2007, p. 304, fig.128.
Deux fragments de lamesen obsidienne provenantde Palmarola. Ces lamesont été découvertes sur lesite de Peiro Signadodans l’Hérault. Fouille etcliché F. Briois.
DARCH-353-46-51-Manen 23/07/12 13:32 Page48
n°353 / Les Dossiers d’Archéologie / 49
Puis c’est à partir de 5700 avant notre ère quese met progressivement en place le monde cardial(dénommé ainsi en raison de l’utilisation d’unecoquille de Cardium pour décorer la poterie) quiintroduira l’élevage, l’agriculture, la poterie, lesoutils de moissons et la pierre polie dans un espacegéographique élargi couvrant d’abord le domainetyrrhénien puis le sud de la France et la péninsuleIbérique. Ces données restituent donc un chemine-ment de l’économie néolithique du sud de l’Italievers le sud de la France et l’Espagne. De récentesdécouvertes pourraient également permettre d’envi-sager une route nord-africaine mais ces élémentsdemandent à être renforcés. Bien que la réso lutionchronologique sur laquelle nous nous fondonsnécessite un affinement, on doit souligner la rapi ditédu développement de l’économie paysanne enMéditerranée occidentale, de même que la précocitédes pénétrations continentales le long des grandsaxes f luviaux et des milieux insulaires. L’arrière-payset les domaines montagneux seront exploités dansun deuxième temps.
LE NÉOLITHIQUE ANCIEN À CÉRAMIQUEIMPRIMÉE : ENTRE UBIQUITÉ ET POLYMORPHISME
Si la céramique décorée d’impressions constituele dénominateur commun des premières sociétéspaysannes de Méditerranée occidentale, celles-ci pré-sentent cependant des particularités économiquesou matérielles traçant les contours d’identités régio -nales. Dans les gisements de l’Impressa, la quasi-totalité des ossements d’animaux consommésappartiennent à des bêtes domestiques tandis quele blé (engrain et amidonnier) et l’orge vêtus consti-tuent le fondement de l’alimentation végétale. Deséléments de macro-outillage (meule, molette) sontutilisés pour broyer ces céréales. Les poteries sontornées de décorations couvrant la quasi-totalitédes parois et réalisées à l’aide d’outils variés (tigede bois, coquille, lame de silex…). Dans les gise-ments cardiaux du sud de la France, les fondementsde l’économie de subsistance semblent plus diversi-fiés, fai sant appel aux ressources carnées domes-tiques (mou tons et chèvres principalement), mais
Extrémité de meule en basalte provenant du gisement de Pont de Roque-Haute (Hérault, France) dont l’analyse tracéologique a démontré l’utilisation pour le broyage des céréales. Clichés et dessins C. Hamon, fouille de J. Guilaine.
DARCH-353-46-51-Manen 23/07/12 13:32 Page49
50 / Les Dossiers d’Archéologie / n°353
PREMIERS AGRO-PASTEURS DE MÉDITERRANÉE CENTRALE ET OCCIDENTALE
imprimée en rubans ; cet outil sera progressivementremplacé par d’autres dont le poinçon utilisé pourinciser la pâte. En Espagne, la décoration de la pote-rie cardiale présente des particularités exception-nelles par la réalisation de motifs anthropomorpheset zoomorphes. D’une manière générale, il nous estpossible, dès cette période, d’identifier l’effet exercépar l’homme sur le milieu (ouverture des forêts) no-tamment aux alentours des habitats. La caractérisa-tion des réseaux de circulation de certaines matières
également sauvages (sanglier, cerf…) et à la culturedu blé nu et de l’orge nue. De même, la diversité desespaces investis (plaines, zone littorales mais égale-ment garrigue ou plateau) et des types de sites ha-bités ou fréquentés (sites de plein air, grotte, abri),témoignent d’une réorganisation des systèmessocio-économiques. Les systèmes de bâti semblentlégers et font appel au bois et à la terre. La poterieprésente désormais une décoration presqu’exclusi-vement réalisée à l’aide d’une coquille de Cardium
Fragments de poteries décorées à l’aide d’une coquille de Cardium imprimée dans la pâte du vase avant cuisson. Ces impressions forment des représentations anthropomorphes et zoomorphes. Ils proviennent du gisement de la Cova de l’Or (région de Valencia, Espagne).D’après B. Martí Oliver, 1995, p. 68 et 71.
La batterie de récipients en céramique du Néolithique ancien du sud de la France. Ces récipients étaient utilisés pour la préparation et la cuissondes aliments, pour la consommation quotidienne mais également pour le stockage de liquides et de solides. Dessins J. Coularou.
DARCH-353-46-51-Manen 23/07/12 13:32 Page50
n°353 / Les Dossiers d’Archéologie / 51
• BERNABEU AUBÁN (J.), ROJO GUERRA (M. A.), MOLINABALAGUER (L.) dir. — Las primeras producciones cerámicas. El VImilenio cal AC en la Península Ibérica. Sagvntvm-extra 12, Universidadde Valencia, 2011.
• BINDER (D.) — Le radiocarbone et la Néolithisation en Méditerranéecentrale et occidentale, Les Dossiers d’archéologie 306, 2005, pp. 30-37.
• GUILAINE (J.), MANEN (C.), VIGNE (J.-D.) dir. — Pont de Roque-Haute(Portiragnes, Hérault). Nouveaux regards sur la néolithisation de la Franceméditerranéenne. Toulouse, Archives d’Écologie préhistorique, 2007.
• PESSINA (A.), TINÉ (V.) — Archeologia del Neolitico. L’Italia tra VI eIV millennio a.C., Manuali universitari 57, Rome,Carocci editore, 2008.
>> Bibliographiepremières (obsidienne, silex ou roches tenaces pourl’outillage poli) des sine les contours de communau-tés socialement liées les unes aux autres.
Bien que génétiquement liées, les premièrescommunautés paysannes de Méditerranée centraleet occidentale présentent ainsi des modèles culturelsdiversifiés. C’est ce polymorphisme que le préhisto-rien doit déchiffrer pour percevoir et expliquer lesrecomposions locales induites par les nouveauxenvironnements naturels et humains auxquels lespremiers paysans ont été confrontés au fil de leurscheminements. ■
Reste de faucille utilisée pour la moisson des céréales découverte dans le gisement lacustre deLa Draga (Catalogne, Espagne). Cette pièce composite comprend un manche en sureau danslequel est insérée une lame de silex. © archives Draga
Lame de hache polié découvertesur le gisement du Taï (Gard,France) et probablement façonnéeà partir d’une roche alpine. Fouilleet cliché C. Manen
DARCH-353-46-51-Manen 23/07/12 13:32 Page51









![Verso un'edizione del ms. magliabechiano VII-353 [Antologia poetica di Girolamo da Sommaia]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/630bdb14191f33c3d30917fa/verso-unedizione-del-ms-magliabechiano-vii-353-antologia-poetica-di-girolamo.jpg)