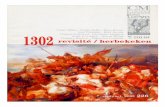« Onomastique et recrutement de l’armée byzantine d’Afrique : l’épitaphe du soldat Buraido...
Transcript of « Onomastique et recrutement de l’armée byzantine d’Afrique : l’épitaphe du soldat Buraido...
ANTIQUITÉS AFRICAINES
L’AFRIQUE DU NORD DE LA PROTOHISTOIREÀ LA CONQUÊTE ARABE
Les Antiquités africaines publient des études historiques et archéologiques intéressant l’Afrique du Nord depuis la Protohistoire jusqu’à la conquête arabe.
FondateursJ. Lassus, M. Le Glay, M. Euzennat, G. Souville
Directeur de publicationMarc Griesheimer
Directeur-adjointJacques Gascou
Comité de RédactionMaria Giulia Amadasi Guzzo, François Baratte,
Véronique Brouquier-Reddé, Marie-Brigitte Carre, Salem Chaker, Jehan Desanges, Ginette Di Vita Evrard,
Jérôme France, David Mattingly
RédactionVéronique Blanc-Bijon
Illustrations : Christine Durand
© CNRS Éditions, Paris, 201315, rue Malebranche – F 75005 PARIS
Tél. : 01 53 10 27 00 – Fax : 01 53 10 27 27Courriel : [email protected]
Site Internet : http://www.cnrseditions.fr
Centre national de la Recherche scientifiqueRevue Antiquités africaines
Centre Camille Jullian - MMSH5, rue du Château de l’Horloge - B.P. 64713094 Aix-en-Provence cédex 2 (France)tél. : 04 42 52 42 73 - fax : 04 42 52 43 75
couriel : [email protected] Internet : http://sites.univ-provence.fr/ccj/
ISBN : 978-2-271-07974-9ISSN : 0066-4871
En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralementou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans autorisation de l’éditeur
ou du Centre français d’exploitation du droit de copie, 20 rue des Grands Augustins, F – 75006 PARIS.
Antiquités africaines, 49 | 2013
sommaire
Christine HAmDOune, Les distiques élégiaques de Césarée et la familia des rois de Maurétanie .............. 5
Michel cHristOl, Une inscription du musée de Philippeville (Skikda) relative à l’aménagement de la route entre Rusicade et Cirta (CIL, VIII, 10311 et p. 2138) : Caius Velleius Paterculus, légat de l’empereur ................................................................................................................................. 19
Lotfi nADDAri, Recherches sur la signification du terme EMERITA dans la nomenclature de la colonia Flauia Augusta Emerita Ammaedara (Haïdra, Tunisie) .................................................................. 27
Zeineb BenzinA Ben ABDAllAH et Elsa rOccA, Les inscriptions militaires d’Haïdra (Tunisie) dans le fonds Poinssot (INHA) ......................................................................................................................... 39
Michel BOnifAy et Claudio cApelli, avec la collaboration de Carmela frAncO, Victoria leitcH, Laurent riccArDi et Piero Berni millet, Les Thermes du Levant à Leptis Magna : quatre contextes céramiques des IIIe et IVe siècles ................................................................................................ 67
Dan DAnA, Onomastique et recrutement de l’armée byzantine d’Afrique : l’épitaphe du soldat Buraido révisée (ILAlg, I, 81) ................................................................................................................. 151
Annick stOeHr-mOnjOu, Une ekphrasis tardive entre traditions poétique et iconographique : le char de Médée, symbole du Mal (Dracontius, Romul. X, 556-569) .................................................... 161
DOSSIER : « À l’ORIgInE DES amphORES ROmaInES D’afRIquE »
Imed Ben jerBAniA, Observations sur les amphores de tradition punique d’après une nouvelle découverte près de Tunis ........................................................................................................................... 179
Claudio cApelli et Michele piAzzA, Annexe. Analyses en microscopie optique d’amphores de types Maña C et « Tripolitaine ancienne » provenant du dépotoir de Mnihla ..................................... 193
Claudio cApelli et Alessia cOntinO, Amphores tripolitaines anciennes ou amphores africaines anciennes ? ............................................................................................................................. 199
nOtES Et ChROnIquES
Duncan fisHwick, On the Origins of Africa Proconsularis, IV : The Career of M. Caelius Phileros again ..... 211
Mounir fAntAr, Iulia Regula siue Stolata : une matrona neapolitana ? ................................................. 215
Vincent micHel, L’activité récente de la Mission archéologique française en Libye pour l’Antiquité ..... 219
Naidè Ferchiou nous a quitté
Début juillet 2013, le Comité de lecture, la Direction et la Rédaction d’Antiquités africaines ont appris avec une grande tristesse le décès de Mademoiselle Naidè Ferchiou. En se reportant aux indices de la revue, chacun pourra constater à quel point Naidè Ferchiou était l’auteur le plus prolixe d’Antiquités africaines.
Chercheur de l’Institut national du Patrimoine (Tunis), chercheur associé à l’Institut de recherche sur l’architecture antique (CNRS – Aix Marseille Université) et au Deutsches Archäologisches Institut à Rome, ses très nombreuses publications garderont le témoignage de son grand engagement pour l’étude de l’architecture antique en Tunisie. Partageant avec tous ses découvertes et ses réflexions, elle aura contribué à la diffusion de la recherche tunisienne.
Les Africanistes ont perdu en elle une amie fidèle et un grand chercheur.
151
Ant
iqui
tés
afric
aine
s, 4
9, 2
013,
p. 1
51-1
60
Une épitaphe latine d’époque byzantine d’Hippone mérite qu’on s’attarde sur les conditions de sa découverte, sur les éditions successives et plus encore sur les commentaires qu’elle a pu susciter. De plus, pour la première fois cette « pierre errante », conservée actuellement au Musée de Châteaudun, est publiée avec une photographie1. Elle fait partie du petit dossier épigraphique qui concerne les soldats thraces de l’armée byzantine d’Afrique.
Tout commence par une copie prise en juin 1874, par Antoine Héron de Villefosse et par Alexandre Papier, alors vice-président de l’Académie d’Hippone à Bône, avant d’être son président durant vingt ans. La pierre se trouvait dans un jardin situé près de la route de Souk-Ahras, à 1 km de Bône/Annaba, très près du chemin de fer qui desservait les
* CNRS - Centre ANHIMA, 2 rue Vivienne, 75002, Paris.
1. Je remercie vivement, pour l’autorisation de republier cette inscription et de reproduire les clichés généreusement fournis, Mireille Bienvenu, du Musée municipal des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle de Châteaudun, et Marie-France Cimiano, adjointe au maire de Châteaudun chargée de la culture, ainsi que Peter Thonemann (Wadham College, Oxford), pour ses renseignements au sujet de l’épitaphe MAMA XI 72, et Monique Dondin-Payre (CNRS - ANHIMA), pour sa relecture attentive.
mines de fer de Mokta el-Hadid ; elle fut découverte par les ouvriers terrassiers. Aussitôt, elle fut transportée2 au musée de Châteaudun (Eure-et-Loir) à l’initiative d’Adolphe Gouin, maire de cette ville de 1872 à 18783. De retour d’un voyage en Algérie, celui-ci l’emporta avec d’autres pièces déterrées à cette époque par les ingénieurs des mines de Mokta el-Hadid4. Regnard-Lespinasse en transmit un estampage
2. De même, l’épitaphe chrétienne d’Aprilia (ILAlg, I, 83, datant de 556/557), envoyée de Bône à Paris en 1833, fut incrustée dans un mur, sous l’entrée du département des livres imprimés de la Bibliothèque nationale (Richelieu) ; d’autres inscriptions furent envoyées au Louvre, et des mosaïques à Paris, Alger et Bordeaux. Pour cette dispersion, courante à l’époque, voir brièvement Delestre X., Hippone, 2005, p. 55-56. Pour le contexte, voir Dondin-Payre M., Voyage, 2011, en partic. p. 277-280 (« les amateurs au pouvoir ») et p. 280-283 (sur la mise en place d’institutions savantes).3. Adolphe (1823-1901), entrepreneur en bâtiment, était le frère aîné de Jules-Édouard Gouin (1846-1908), ingénieur des chemins de fer, qui prit part comme administrateur aux travaux du réseau de Bône-Guelma et de la section du chemin de fer Souk Ahras-Ghardimaou, en qualité de vice-président de la Compagnie des chemins de fer Bône-Guelma.4. Cf. la lettre de Papier A., Lettres, 1887, p. 9, à A. Héron de Villefosse, évoquant la découverte, en 1874, d’une « belle et grande dalle en marbre blanc sur laquelle était gravée une inscription latine surmontée d’une croix
onoMastique et reCruteMent de L’arMée Byzantine d’afrique : L’épitapHe du soLdat Buraido révisée (ilalg, i, 81)Dan dana*
Mots-clefs : Armée byzantine ; Hippone ; épigraphie ; onomastique ; paléographie ; Thraces.
Résumé : L’épitaphe chrétienne d’un soldat de l’armée byzantine d’Afrique, provenant d’Hippone et conservée depuis 1874 au musée de Châteaudun (CIL, VIII, 5229 = CIL, VIII, 17401 = ILCV, I, 549 = ILAlg, I, 81), est publiée pour la première fois avec une photo et un fac-similé, car la paléographie du document est instructive. L’inscription permet d’étoffer le petit dossier épigraphique et littéraire concernant la présence des militaires thraces dans l’armée byzantine, lors et après la conquête du royaume vandale par le général Bélisaire. Le nom du soldat (Buraido) et la mention de son unité militaire (numerus Hipponensium Regiorum ou Hipponis Regii) sont commentés à l’aide des anciennes et nouvelles données qui affinent notre image de l’Afrique du Nord byzantine.
Keywords: Byzantine army; Hippo Regius; epigraphy; onomastics; paleography; Thracians.
Abstract: The Christian epitaph of a soldier of the Byzantine army from Africa, coming from Hippo Regius and kept since 1874 in the museum of Châteaudun (CIL, VIII, 5229 = CIL, VIII, 17401 = ILCV, I, 549 = ILAlg, I, 81), is published for the first time with a photo and a facsimile, because the paleography of the document is instructive. The inscription allows to increase the small epigraphic and literary dossier concerning the presence of Thracian soldiers in the Byzantine army, during and after the conquest of the Vandal kingdom by the general Belisarius. The name of the soldier (Buraido) and the mention of his military unit (numerus Hipponensium Regiorum or Hipponis Regii) are commented in the light of older and recent evidence, improving our image about Byzantine North-Africa.
152
Ant
iqui
tés
afric
aine
s, 4
9, 2
013,
p. 1
51-1
60
en 1875 à Antoine Héron de Villefosse, qui enverra une lettre à la séance de l’Académie d’Hippone (présidée par Alexandre Papier), le 16 décembre 18785. À partir des estam-pages envoyés de Châteaudun, d’autres éditions sont préparées par Edmond Le Blant, René Cagnat et Alexandre Papier6.
S’ensuivent, dans l’espace d’une dizaine d’années, une correspondance et des communications (par voie épistolaire), lues et par la suite publiées dans les périodiques scientifiques de Bône, de Châteaudun et de Paris. Il importe de noter que, pour les savants français, le document était intéressant puisqu’il fournissait un témoignage du christianisme à Hippone, ville où saint Augustin fut évêque7. Néanmoins, l’apport du document réside aussi dans ses renseignements historiques et onomastiques.
Description : Dalle rectangulaire de marbre veinée, soigneu-sement travaillée, trouvée en 1874 à 1-2 km de Hippone/Bône/Annaba, dans le jardin de Jean Galéa (comme les épitaphes ILAlg, I, 82, 84, 85), près du croisement des chemins de fer de Bône à Guelma et de Bône à Mokta el-Hadid, c’est-à-dire à l’extrémité Sud-Ouest d’Hippone8, près de la colline Gharf el-Atran, au Nord de l’ancienne propriété Borgeaud9. Le champ épigraphique de sept lignes est surmonté d’une petite croix grecque, aux branches épaisses.Dimensions : 75 x 63 cm. Hauteur des lettres : de 4,5 à 6 cm.Écriture : Grandes lettres carrées et irrégulières, gravées à la pointe. Plusieurs lettres caractéristiques (fig. 2) : A à jambages écartés et à liaison angulaire, souvent haute (l. 3, surmonté d’un
grecque légèrement pattée » ; à peine déchiffrée, elle fut prise le lendemain par A. Gouin, en route vers Marseille. C’était la deuxième des quatre pièces données à la Société Dunoise par le maire, de retour d’Algérie : « une dalle en marbre sur laquelle a été gravée une inscription funéraire latine surmontée d’une croix à branches égales, également gravée. Cette inscription n’a pas été encore entièrement déchiffrée » [BullSocDunoise, 2, 1870-1874, Châteaudun, 1875 (= n° 22, oct. 1874, parmi les « Objets de collection »), p. 328]. À la lecture de cette notice, A. Héron de Villefosse réagit : « Le rédacteur de ce Bulletin s’est trompé : l’inscription a été lue en 1874 par M. Papier et par moi ; et son interprétation est des plus simples. Il est très regrettable qu’elle ne soit pas restée à Bône comme document », conclut-il avec raison (BullAcadHippone, 13, 1878, p. 137).5. Héron de Villefosse A., BullAcadHippone, 13, 1878, p. 135-136.6. Selon Edmond Le Blant, l’estampage envoyé par la Société Dunoise « laisse quelques parties douteuses ; un second, que j’ai demandé direc-tement à M. le conservateur du Musée de Châteaudun, ne m’a pas mieux renseigné, le papier se moulant mal sur la gravure qui est peu profonde » [Revue des Sociétés Savantes des Départements, 6e série, t. 5, 1877, p. 247 = BullSocDunoise, 3, 1875-1880, Châteaudun, 1881, p. 143].7. « M. Papier m’avait signalé cette pierre dont il appréciait toute l’importance ; son intention était de la faire transporter en lieu sûr, afin de la conserver comme un document précieux de l’histoire du chris-tianisme à Hippone » (Héron de Villefosse A., BullAcadHippone, 13, 1878, p. 136).8. À l’époque byzantine, ce quartier avait reçu une affectation reli-gieuse, autour d’un édifice cultuel (basilique, martyrium ou chapelle funéraire) ; dans son voisinage se situait un cimetière qui a fourni une quinzaine d’inscriptions, recensées par Marrou H.I., Épitaphe, 1953, p. 215-217. Pour Hippone chrétienne, voir Duval N., Hippo Regius, 1989 ; Gui I., Duval N. et Caillet J.-P., Basiliques, 1992, p. 346-349, n° 346 ; Laporte J.-P., dans Delestre X., Hippone, 2005, p. 37-40 (Hippone vandale et byzantine). Pour la présence militaire byzantine, voir Pringle D., Defence, 1981, I, p. 200-201.9. Gsell S., AAA, 1902-1911, f. 9 (Bône), texte p. 8B, n° 11.
petit triangle) ; B avec la panse inférieure plus grande (ll. 1, 5) ; D de formes variables (arrondi l. 1, angulaire l. 6) ; des E bien carrés ; L parfois presque semblable à un I (l. 4) ; M à jambes obliques bien écartées et à liaison haute ; des O plus petits ; Q à l’aspect d’un C, mais plus ouvert vers le bas (l. 5) ; T parfois avec une barre à la base, similaire à un I (l. 3). Chiffres : le chiffre VI est figuré par la ligature caractéristique (VI), dans une forme évoluée semi-circulaire10, à savoir une grande panse (le chiffre V), avec un trait ondulé qui se prolonge vers le bas (le chiffre I) ; les trois hastes qui suivent sont beaucoup plus petites que les chiffres précédents (l. 5) ; le chiffre L (l. 4) est différent de la lettre L, avec la base oblique s’échappant vers le bas. Les seules ligatures concernent les chiffres : XL (l. 4), XV (l. 5). Abréviations courantes. On remarque des signes d’abré-viations : un tilde horizontal surmonte la lettre M dans NVM (l. 2) ; sur la même ligne, deux tildes ondulés verticaux, en forme de petit S, le premier inséré par erreur avant le second P de la séquence Hipp(onensium). Lieu de conservation : Musée municipal des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle de Châteaudun (Eure-et-Loir), sans numéro d’inventaire ; la dalle est scellée sous le porche à l’entrée du musée.Éditions11 : Le Blant E., Revue des Sociétés Savantes des Départements, 6e série, t. 5, 1877, p. 247-248 [article repris en octobre 1878 dans BullSocDunoise, 3, 1875-1880 (Châteaudun, 1881), p. 143-144 (« Une antique épitaphe chrétienne »)] ; Héron de Villefosse A., BullAcadHippone, 13, 1878, p. 135-137 [reprise : BullSocDunoise, 5, 1885-1887 (Châteaudun, 1888), p. 51-53] ; Cagnat R., Notice, 1882, p. 41-42, n° 6 ; Papier A., Lettres, 1887, p. 196-197, n° XXXIX ; CIL, VIII, 5229 (G. Wilmanns ; et p. 962) = CIL, VIII, 17401 (J. Schmidt) ; ILS, 2811 ; ILCV, I, 549 (E. Diehl, et add.) ; ILAlg, I, 81 (S. Gsell) ; Pringle D., Defence, 1981, I, p. 333, n° 44.Illustrations : mention de plusieurs estampages ‒ l’un transmis en 1875 par Regnard-Lespinasse à A. Héron de Villefosse ; d’autres envoyés par la Société Dunoise et par le conservateur du musée de Châteaudun à E. Le Blant ; phototypie publiée par Papier A., Lettres, 1887, pl. XXIX, et d’autres envoyées par A. Héron de Villefosse à G. Wilmanns (CIL, VIII, 5229, a. 1881), et par A. Papier à J. Schmidt (CIL, VIII, 17401, paru en 1891) ; lecture « révisée sur la phototypie publiée par Papier », précise S. Gsell (1922).Date : après 546 apr. J.-C.
10. Voir Duval N. et Prévot Fr., Haïdra I, 1975, p. 367-368.11. Autres mentions : BullSocDunoise, 2, 1870-1874 (= n° 22, oct. 1874, Châteaudun, 1875), II (Mémoires), p. 328 ; BullAcadHippone, 13, 1878, p. 112-113 (lettre du maire Gouin, annonçant l’envoi d’un fac-similé) ; BullAcadHippone, 14, 1879, p. IX (mention de l’édition d’E. Le Blant) ; Tauxier H., BullAcadHippone, 14, 1879, p. XIV-XVI ; Héron de Villefosse A., BullAcadHippone, 14, 1879, p. XX (critique de H. Tauxier) ; Papier A., Lettres, 1887, p. 9 ; Schwarze A., Untersuchungen, 1892, p. 85 ; ThLL, II, col. 2246, s.u. Buraido (« nom. vir. barb. ») ; Gsell S., AAA, 1902-1911, f. 9 (Bône), texte p. 7B ; Cagnat R., Armée romaine d’Afrique, 1913, t. II, p. 731 (sur le numerus Hipponensium Regiorum) ; Marrou H.I., Épitaphe, 1953, p. 217 (= Id., Christiana tempora, 1978, p. 131) ; Marec E., Monuments, 1958, p. 59 n. 2 ; Durliat J., Lettre L, 1979, p. 165, n° 70 ; Pringle D., Defence, 1981, I, p. 73, 200 ; Laporte J.-P., dans Delestre X., Hippone, 2005, p. 191.
153
Ant
iqui
tés
afric
aine
s, 4
9, 2
013,
p. 1
51-1
60
Fig. 3 : Épitaphe de Buraido (Hippone). (© Musée de Châteaudun – dépôt de la Société Dunoise d’Archéologie,
cliché musée de Châteaudun).
Fig. 1 : Phototypie (PaPier A., Lettres, 1887, pl. XXIX). Fig. 2 : Fac-similé de l’épitaphe de Buraido.
154
Ant
iqui
tés
afric
aine
s, 4
9, 2
013,
p. 1
51-1
60
† Buraido, milex de num(ero) Hipp(onensium) Reg(iorum), vixit in pace ann(os) XL, milita-5 bit XVIII, quiebi(t) s(u)b d(ie) III N(onas) Iul(ias), indi(c)- t(i)on(e) nona.
1. Burai (Bural ?) Héron de Villefosse (1878) : Buraldo ? Le Blant (suivi par H. de Vill., 1879) || 2 regiensium Le Blant : rec(iorum) Diehl : Hipp(onis) Reg(ii) Pringle || 5 cuiebi(t) éds. : quiebi(t) Schmidt Diehl.
« † Buraido, soldat du numerus Hipponensium Regiorum (ou Hipponis Regii), a vécu en paix quarante ans, a servi dix-huit ans, a reposé le troisième jour avant les nones de juillet, la neuvième année de l’indiction ».
La croix grecque, ainsi que les formules vixit in pace et quiebit, auxquelles s’ajoute la date indictionnelle, indiquent une épitaphe chrétienne12. Quelques brèves remarques :l. 1 : sur le nom thrace Buraido, voir infra. Milex : variante assez rare de miles, causée par une tendance à l’assimilation, d’où la correction « miles non milex » dans l’Appendix Probi l. 30 Heraeus13.ll. 1-2 : miles de numero est la formule habituelle à cette époque.l. 2 : pour l’identité du numerus Hipp. Reg., voir infra.l. 3 : vixit in pace, formule chrétienne habituelle.ll. 4-5 : notons l’âge très vraisemblablement arrondi du défunt, mais la mention plus exacte du service militaire accompli (18 ans), qui implique un recrutement autour de 20 ans, selon l’usage14. Militabit et quiebi(t) : -b- pour -v- (l. 5, deux fois), graphie très courante à cette époque.l. 5 : quiebit, la forme employée le plus fréquemment et le plus longtemps à Hippone15.ll. 6-7 : le troisième jour avant les nones de juillet (= 5 juillet) de la 9e indiction. Mention très importante pour la chronologie du document (voir infra).
La date de l’épitaphe peut être établie avec plus de certitude16 : généralisée par les Byzantins en Afrique du
12. Pour les inscriptions chrétiennes d’Hippone, voir Marrou H.I., Épitaphe, 1953 ; Duval N., L’épigraphie funéraire, 1988 ; Duval N., Hippo Regius, 1989, col. 464-465 ; Laporte J.-P., dans Delestre X., Hippone, 2005, p. 189-192 (l’épigraphie tardive).13. Je donnerais un seul exemple, sur la stèle d’un légionnaire d’origine thrace, mort en Maurétanie vers 297-298, mais dont l’épitaphe a été érigée à Aquilée, en Italie du Nord (CIL, V, 893 = I. Aquileia, II, 2772) : D. M. Aurel(ius) Dizo, milex leg(ionis) XI Claud(iae), vixit ann(os) XXVII, milit(avit) ann(os) quinque, obitus in Mauretania, bene merenti cives et commanipuli de suo fecerunt.14. Ravegnani G., Soldati, 1988, p. 15 et n. 9, cite l’épitaphe de Buraido comme témoignage de l’âge du recrutement.15. Marec E., Monuments, 1958, p. 59.16. D’autres dates : entre 450 et 580 (A. Héron de Villefosse) ; fin du IVe-début du Ve s. (R. Cagnat). La plupart des autres commentateurs optent avec plus de raison pour le VIe s.
Nord17, l’indiction est ici un indice indubitable de la présence byzantine. C’est à cette époque qu’Hippone, dotée d’un évêché, était protégée par une garnison byzantine, sans doute à mettre en rapport avec une probable fortification sur la colline du Gharf el-Atran. Mais peut-on aller plus loin quant à la chronologie de l’épitaphe ? La date de la campagne de Bélisaire et de la reconquête byzantine de l’Afrique du Nord (533/534) constitue le terminus post quem. Il s’ensuit que la première date possible est le 5 juillet 546, les autres possibles candidats étant, dans la seconde moitié du VIe siècle, 561, 576 et ainsi de suite. Une date au milieu du VIe s. est, à mon avis, la plus probable : la paléographie ne s’y oppose pas ; l’origine thrace du défunt (d’après les renseignements onomastiques) renforce une date plus proche de la campagne de Bélisaire. On ignore si la mort du soldat fut en rapport avec les troubles et les confrontations dans les territoires récemment conquis : en 536 et, plus intéressant comme date, en 545-54618.
La pierre tombale du défunt d’Hippone omet son gentilice19 ; il était sans doute Flavius, nomen devenu un marqueur du statut social pour les individus au service de l’appareil administratif de l’État ou dans l’armée, et attribué à tous les militaires20.
L’onomastique du soldat a suscité une multitude d’hypo-thèses, des plus confuses. Les premières lectures étaient chancelantes : « Burai (ou Bural ?) Domilex », par A. Héron de Villefosse (1878) ; « Buraldo ? » par E. Le Blant (1877), lecture acceptée par Héron de Villefosse (1879). En 1922, Stéphane Gsell écrivait (ILAlg, I, p. 8) : « Nom barbare, à moins que ce ne soit une altération de Boraivdh" (cf. Procope, Bell. Pers., I, 24, 53 ; Bell. Goth., III, 31, 17) ». Mais aucune précision quant au terme vague de « barbare » n’est esquissée. George G. Mateescu, par ailleurs très généreux dans l’attribution de noms thraces, cite ce nom, mais avec des réserves. Enfin, pour les connaisseurs de cette onomas-tique particulière, le caractère thrace du nom est soutenu par Dimităr Dečev, Ion I. Russu et Veselin Beševliev, qui le mettent en rapport avec le plus fréquent Buraides / Boraides21. C’est la raison pour laquelle notre Buraido d’Hippone est par la suite cité parmi les porteurs de noms thraces22.
17. Voir en dernier lieu Duval N., Dates, 2003, p. 89-91, sur l’indic-tion comme comput rendu obligatoire par la novelle 47 (§ 1) du 31 août 537, sous Justinien (527-565).18. Voir, en général, Cameron A., Vandal, 2008.19. Puisque la règle générale dans la nomenclature courante africaine de cette époque est le nom unique ; voir Duval N., Observations, 1977.20. Voir Keenan J.G., Names, 1973 ; Id., Names, 1974 ; Id., Afterthought, 1983. Pour ce marqueur social, voir infra, l’épitaphe de Fl. Ziper.21. Mateescu G.G., Traci, 1923, p. 175 (et n. 3) ; Detschew D., Sprachreste, 1957, p. 80 (suffixe -d-, à partir de Bouri", Burus, -bori") ; Beševliev V., Die Thraker, 1961, p. 256 (sur Boraides, sans connaître l’exemple d’Hippone) ; Id., Untersuchungen, 1970, p. 78-79 (Boraides) ; Russu I.I., Die Sprache, 1969, p. 35, 193 ; Id., Elementele, 1976, p. 60 n. 118, 101 (et n. 49), 99-101.22. Fol A., Thraces, 1968, p. 252, n° 1136, en se demandant : « Thrace (?) » ; Beševliev V., Untersuchungen, 1970, p. 79 ; Pflaum H.-G., Pannoniens, 1976, p. 64 ; Russu I.I., Elementele, 1976, p. 131 (et n. 140) ; Samsaris D.C., Relations, 1988, p. 424, n° 131 [Buraides (sic !)] ; Minkova M., Personal Names, 2000, p. 128.
155
Ant
iqui
tés
afric
aine
s, 4
9, 2
013,
p. 1
51-1
60
Mais un retour en arrière, ou plutôt l’ignorance de cette bibliographie onomastique particulière, entraîna une autre hypothèse, celle d’une origine nord-africaine du nom (et de son porteur), jugée probable en raison aussi bien du lieu de trouvaille que de la sonorité étrange de l’anthroponyme : pour Denys Pringle, il pourrait s’agir d’un nom maure (et donc d’un indice du recrutement local), pour Karel Jongeling, d’un nom nord-africain, pour Gabriel Camps d’un nom libyque23. Pour des raisons plus obscures encore, on a fait de Buraido un nom celtique24 !
De plus, Buraido était pour tous ces commentateurs un nom hapax. Or, il se trouve qu’il n’est plus un unicum, puisqu’un second exemple vient d’être identifié, grâce à la relecture d’une inscription latine de 390 apr. J.-C. (AÉ, 1984, 849)25. Dans cette épitaphe de Sébastè, en Phrygie Pacatienne, le nom et le statut du défunt sont correctement lus par Peter Thonemann26 : il est question d’un autre soldat, Flavius Buraido, protector dans la schola peditum. Son origine n’est pas précisée, mais l’attribution thrace est indu-bitable (voir plus loin).
Des trois militaires d’époque byzantine dont on connaît l’unité27, attestés par des épitaphes en Afrique du Nord, deux sont certainement d’origine thrace, en se fiant à leur onomastique caractéristique : Buraido et Fl. Ziper (voir infra). De fait, Procope de Césarée (BV 1.11.10) précise que la plupart de l’armée de 18.000 hommes de Bélisaire, plus précisément les soldats tirés des pedites comitatenses et des katalogoi, était originaire de Thrace. Par conséquent, il est vraisemblable que les premières unités laissées dans les garnisons, voire regroupées, ainsi que d’autres constituées sur place (tel le numerus Hipponensium Regiorum), ont puisé dans ces effectifs, où les soldats originaires de Thrace étaient si nombreux. Par ordre impérial, Bélisaire avait installé des limitanei milites dans les territoires conquis, sérieusement mis à l’épreuve dès l’été 534, avec une première rébellion maure28.
23. Pringle D., Defence, 1981, I, p. 73 (« Buraido could be a Moorish name, and therefore be taken to represent evidence for local recruitment into the comitatenses »), avec des réserves (« mis-spelling of the Greek names Boria vdh" or Boraivdh" ») ; Jongeling K., North-African Names, 1994, p. 28 ; d’où la présence abusive dans le livre récent de Kerr R.M., Latino-Punic, 2010, p. 62 (bvraido parmi les noms libyens dans les inscriptions latines) ; Camps G., Liste, 2002-2003, p. 257. Pour une critique des « faiblesses inhérentes » du répertoire de Jongeling, voir Solin H., Présence, 2012, sur « un grand nombre de noms d’origine grecque ou bien latine, ou dont l’étymologie est moins claire ».24. Boraides comme nom celtique chez Ellis Evans D., Gaulish, 1967, p. 155 ; il citait en réalité les microfiches de Whatmough J., Dialects, 1970, p. 1262 (avec un certain nombre de noms thraces et d’autres origines pris pour des noms celtiques) ; Ellis Evans a été suivi par Sacco G., Iscrizioni, 1999, p. 273 n. 28.25. Speidel M., Roman Army, 1984, p. 381-389, photo p. 383, dessin p. 382.26. MAMA XI 72 : Fl(avius) Buraido,| [prote]ctor escole ped[i|tum]. Voir une première édition en ligne : http://mama.csad.ox.ac.uk.27. Sur la composition de l’armée byzantine d’Afrique, voir Pringle D., Defence, 1981, I, p. 65-71.28. Pour ces vicissitudes, voir Zuckerman C., Hiérarchie, 2002 ; pour le contrôle militaire byzantin, voir Ferdinandi S., Organizzazione
Qui plus est, le même Procope (BV 1.16.9) cite le nom d’un officier de la garde personnelle de Bélisaire, envoyé vers la fin août 533 avec un groupe de soldats afin de prendre Syllektos (auj. cap Salakta), une cité en direction de Carthage : là où les éditeurs ont choisi la variante d’un manuscrit, « Boriadès », il convient de préférer la leçon d’autres manuscrits, qui présentent la forme BORAIDHS (voir note 37). C’est manifestement un nom de la même famille. En effet, Buraido n’est qu’une variante diversement suffixée d’un nom beaucoup plus populaire. On connaît jusqu’à présent au moins sept porteurs du nom Buraides / Boraides, connus uniquement durant l’Antiquité tardive29 :(1) Buraides, presbyter, enterré à Serdica, en Thrace (prov.
Dacia Mediterranea)30 (Ve-VIe s.).(2) Boraidh", fils du tribunus Paulus, enterré à Hadrianopolis,
en Thrace (prov. Haemimontus)31 (Ve-VIe s.).(3) Bouraeidei" / Bouradi" / Boraeidei", fils du caliga-
rius Zourazi", originaire de Thrace, plus précisément d’Hadrianopolis (prov. Haemimontus), décédé à 7 ans à Scythopolis, en Palestine Seconde32 (IVe/Ve s. ?).
(4) Borai>dh" Be vsso", bucellarius à Oxyrhynchos, en Égypte (P. Oxy. XVI 1903
9 et XVI 2046), vers 560.
(5) Boraidès, neveu de Justinien, frère de Iustus33 et de Germanus34, actif au milieu du VIe s. (PLRE III.A 245-246).
(6) le fils de Germanus, proche parent de Justinien, neveu de Boraidès. Il fut consul en 540, et magister utriusque militiae (en Lazique et Thrace) vers 557-566 (PLRE III.A 750-754, Iustinus 4). Sur le diptyque consulaire de l’an 54035, son nom complet est, dans la tradition
militare, 2012, et Kuhoff W., Das spätrömische Afrika, 2012, p. 553-563. D’autres soldats et hauts responsables en Afrique origi-naires de Thrace sont : – Himerius (PLRE III.A 599-600, Himerius 1), dux Byzacenae en 544 (PLRE III.A 599-600, Himerius 1) ;– Petrus (PLRE III.B 998-999, Petrus 7), ancien dorufo vro" de Solomon, participant au banquet où fut assassiné Guntharis, dux Numidiae, début 546 ;– Rufinus (PLRE III.B 1097-1098, Rufinus 1), membre de la maison (oi jki va) de Bélisaire, sans doute ancien garde du corps (dorufo vro") de Bélisaire et son bandofo vro" / bandifer lors de la guerre contre les Vandales ; en 533, il est l’un des quatre commandants de cavalerie envoyés par Bélisaire contre les Vandales. Il reste en Afrique, comme subalterne en Byzacène de Solomon, magister militum, et lutte contre les Maures (534-536), avant d’être tué en été 534 par le chef maure Medissinissa, qui le décapite.29. Dans le récent LGPN, IV, sont inclus nos 2, 4 (p. 73, s.u. Borai?dh") et 3 (p. 74, s.u. Boura vdi"), comme s’il s’agissait de noms différents.30. ILCV, I, 1666 ; Beševliev V., Spätgriechische, 1964, n° 12.31. Ebersolt J., Mission, 1921, p. 52-53, n° 9.32. Giron N., Notes, 1922, p. 81-84, n° 11.A ; Mouterde R., Syria, 6, 1925, p. 224 ; SEG, VIII, 45 ; voir les corrections décisives de Torrey Ch.C., Tablet, 1944.33. Procope de Césarée, BP 1.24.53 (et Photius, Bibl., cod. 63, 24 b), à l’occasion de la révolte Nika, en 532 : Borai?dh" [boria vdh" G].34. Procope de Césarée, BG 3.31.17 : Borai?dh".35. CIL XIII 10032.9 = Ravegnani E., Consoli, 2006, p. 91 et 156, fig. 16.
156
Ant
iqui
tés
afric
aine
s, 4
9, 2
013,
p. 1
51-1
60
des polyonymies36 : Fl(avius) Mar(ianus?) Petr(us) Theodor(us) Valent(inus) Rust(ic(i)us) Boraid(es) Germ(anus) Iust(inus), v(ir) [i]nl(ustris), c(omes) dom(esticorum) et cons(ul) ord(inarius).
(7) un garde du corps de Bélisaire lors de la guerre contre les Vandales, envoyé afin d’occuper Syllectum, après le débarquement en Afrique, en 533 (PLRE III.A 246-247 : Boriades [sic]) : tw dorufo vrw e {a Borai> vdh37 a {ma tw u Jpaspistw tisi e [stelle.
[8] une huitième occurrence, en Afrique, est douteuse, même si la correction du nom d’un défunt SORAIDES en Boraides est très tentante (voir infra).
On remarque parmi ces porteurs une origine thrace suggérée par le lieu d’attestation (1-2), par l’ethnique (4, « Besse » avec le sens générique de « Thrace ») et même l’origine plus précise [3 : patrivdo" Qra/;kh", po vlew" JAdr(i)-aopo vlei], ainsi que par le patronyme, à son tour indigène (3). Quant à leur statut, la plupart sont des militaires ou des membres de l’administration : un bucellaire (4) et un doryphore (7) ; l’un est fils d’un tribunus (2) ; se détachent les deux hauts officiels (5-6), des parents de l’empereur Justinien ; enfin, un prêtre (1) et le fils d’un bottier, fabricant de chaus-sures lacées, ou plutôt d’un cordonnier militaire (3). Ajoutons que les deux porteurs du nom Buraido sont des militaires, ce qui renforce la nette prééminence, dans la documentation dont nous disposons, du personnel militaire. Buraido et Buraides forment donc une série onomastique prisée par les Thraces pendant l’Antiquité tardive38, à l’instar de deux autres noms dont il sera question plus loin, Zimarcus et Ziper.
Buraido était un simple soldat, puisqu’aucune mention supplémentaire n’est faite à une époque où les gradés sont nombreux dans les troupes, et encore plus nombreux à faire état de leur fonction.
Plus intéressante est, en revanche, la mention de son unité, un numerus, terme générique qui désignait alors toute unité militaire39 qui, à cette époque, comprenait entre 300 et 500 soldats. Il est défini par rapport à son lieu de garnison, Hippone : c’était le numerus des Hipponenses Regii. D. Pringle a même proposé de restituer numerus Hipp(onis) Reg(ii), conformément à la pratique d’appeler les
36. Sur la polyonymie des dignitaires, voir l’étude de Laniado A., Onomastique romaine, 2004.37. Procope de Césarée, BV 1.16.9. Les éditeurs ont choisi la graphie Boria vdh, présente dans le ms. V ; il convient de lui préférer la graphie Borai?dh (mss. PO) ; pour cette correction, voir aussi Russu I.I., Elementele, 1976, p. 115 (et n. 89).38. Il doit s’agir d’une formation tardive, à partir de l’élément -buris, fréquent dans les noms thraces (et daces) à l’époque impériale : le nom simple Buris, le nom suffixé Bour(e)ila", les noms composés Moukabouri", Pueriburis et Zibouri". Certains de ces noms présentent la forme -bor- : ainsi, Moukabori" et Pirobor, auxquels s’ajoute le nom féminin Dutuboris.39. À l’époque de sa découverte, un lecteur du périodique de Bône avait proposé de reconnaître la mention d’une legio XII (Henri Tauxier, capitaine de recrutement, correspondant à Saint-Lô, dans BullAcadHippone, 14, 1879, p. XIV-XVI), aussitôt critiqué par Héron de Villefosse A., BullAcadHippone, 14, 1879, p. XX.
unités du nom de la ville où elles étaient affectées, comme en Égypte40, ce qui est très séduisant. On connaît ailleurs d’autres numeri appelés d’après leurs garnisons : ainsi, un Numerus Tarvisianus, d’après Tarvisium (Trévise)41. Trévise se trouvait sous la domination ostrogothe, puis byzantine en 540, mais elle ne fut occupée de manière effective qu’en 556, après la réorganisation par Narsès de l’Italie reconquise. Dans cette unité servait, après le milieu du VIe s., un officier d’origine thrace, comme nous l’enseigne une mosaïque42 de l’église Santa Maria delle Grazie de Gradum (auj. Grado)43 : † Zimarcus | primicirius | nomiri Tar|bisiani vo|tum solbit.
Ce numerus des Hipponenses Regii (ou Hipponis Regii) était une création postérieure à la conquête, sans doute à partir des soldats de l’armée de Bélisaire. Hippone était une place dont le contrôle impérial, par une garnison, était nécessaire : port, et première capitale des Vandales, avant Carthage ; c’est à Hippone que Bélisaire captura le trésor royal des Vandales, après la victoire sur le roi Gélimer à Tricamarum, à la fin de l’année 533.
L’on connaît de manière assez vague la nouvelle configu-ration des forces byzantines en Afrique du Nord. Un grand nombre de prisonniers de guerre vandales furent par la suite recrutés dans cinq unités de Vandali Iustiniani et envoyés en Orient (Procope, BV 4.14.17) ; de même, après les confronta-tions avec les populations locales, on connaît un numerus de Numidae Iustiniani (voir infra). Outre l’unité en garnison à Hippone, deux autres numeri sont connus à cette époque en Afrique du Nord byzantine :– Bis Electi : toujours à Hippone, l’épitaphe de Maxenti(u)s, senator de numeru Bis Elect(or)um, décédé à 70 ans, pendant la quinzième indiction, sans doute après le milieu du VIe s. (en 537, 552, 567 etc.)44. La plupart des éditeurs et des com-mentateurs ont transcrit senator de numer(o) bis elect(or)um, puisque le M final, surmonté d’un tilde horizontal, est donc une abréviation ; ils avaient également en tête les mentions d’un numerus electorum, attesté en Numidie et en Maurétanie Césarienne à l’époque impériale45. De toute façon, une conti-nuité entre les deux unités est interdite par la parenthèse
40. Pringle D., Defence, 1981, I, p. 73 ; mais son idée d’un tribunat de la cité, avec le développement Rusguniarum, est rejetée par Duval N., AntTard, 10, 2002, p. 46.41. On connaît trois mentions de ce numerus Tarvisianus (CIL, V, 1593 = ILCV, I, 559 = I. Aquileia, II, 3344) / Tarbisianus (CIL, V, 1614 = ILCV, I, 488 A ; AÉ, 1961, 93).42. PLRE III.B, 1417, Zemarchus 5 ; Pros. Chrét. Italie, II, 2379 : CIL, V, 1614 = ILCV, I, 488 A ; Rugo P., Iscrizioni, 1975, n° 64 a ; Caillet J.-P., Évergétisme, 1993, p. 210-211 (fig. 158).43. Toujours à Gradum sont connus des Persoiustiniani et un numerus Cadisianum (des prisonniers de guerre perses, après la victoire de Bélisaire en 541) ; pour ces trois unités, voir Ravegnani G., Unità, 2005, p. 195-197 ; Id., Soldati, 2007, p. 527-529.44. CIL, VIII, 17414 = ILCV, I, 495 = ILAlg, I, 82 ; Pringle D., Defence, 1981, I, p. 72-73 et 332-333 (n° 43) ; bonne photo dans Delestre X., Hippone, 2005, p. 36. Le senator est un officier subal-terne, le plus élevé en grade parmi les ducénaires ; voir Janniard S., Centuriones, 2007, p. 391.45. Cette hypothèse énoncée par Speidel M.P., Numerus Electorum, 1987, est peu convaincante, d’autant plus qu’il date l’épitaphe de Maxentius au IVe s., alors que la paléographie et la présence de l’indic-
157
Ant
iqui
tés
afric
aine
s, 4
9, 2
013,
p. 1
51-1
60
vandale ; et, malgré les spéculations des commentateurs, je ne mettrai pas en rapport les bis electi avec une réitération à partir des premiers electi.
Or, il se trouve qu’on connaît une unité d’élite avec un nom similaire (mais pourvue de l’épithète impériale), et vers la même époque, en Égypte : dans la Thébaïde, sans doute à Antaiopolis, quelques papyrus grecs datés entre 539/540 et 551/552 attestent d’un numerus de Bis Electi Iustiniani, sous la graphie Bise vlektoi, parfois Bisivlektoi46. En sa compagnie sont mentionnés les Numidae Iustiniani, unité constituée après la reconquête byzantine de la Numidie (534), ainsi que les Scythae Iustiniani, probablement des Goths faits prison-niers lors de la reconquête de l’Italie (après 536). Les Bis Electi, les Numidae et les Scythae, tous trois des numeri avec l’épithète impériale Iustiniani, sont arrivés en Égypte le plus vraisemblablement à l’occasion de l’expédition de Narsès contre Philae en 536/537.
Des commentateurs récents identifient ces Bis Electi Iustiniani aux Bis Electi d’Hippone : ainsi, le numerus serait arrivé d’Afrique en Égypte vers 536/537, ce qui daterait l’épi-taphe du senator Maxentius avant 53747. Cela pose pourtant problème, car il reste un trop court laps de temps (534-536) pour un stationnement en Proconsulaire de cette unité et pour la fin de Maxentius. Qui plus est, son âge avancé (70 ans) implique au moins deux décennies de retraite ; pour un décès avant 537, Maxentius aurait quitté son unité bien avant la reconquête byzantine ! Une seule solution s’impose alors, si les deux unités sont identiques : les Bis Electi, dont on ignore l’origine géographique et la date de création, arrivent dans la Thébaïde vers 537, pour la quitter peu après le milieu du siècle, sans doute pour la Proconsulaire. C’est à Hippone, après des années de retraite, que Maxentius finit ses jours, ce qui nous oriente vers une date après 570.– Primi Felices Iustiniani : ce numerus est attesté dans l’épi-taphe de Flavius Ziper, tribun en garnison à Rusguniae (auj. Tamentfoust), port antique de la baie d’Alger, en Maurétanie Césarienne48, toujours au milieu du VIe s. : † Mem(oria)
tion témoignent de l’époque byzantine (VIe s.) ; critique déjà exprimée par C. Zuckerman (voir infra).46. P. Stras. K 283 B
4 (a. 539/540) ; P. Cair. Masp. II 67139 Vr
4
(a. 543/544) ; SB XX 1449418
(= P. Freer 08.4 c-d) (a. 546-548 : str(atiw vtai") Bisele vktw jIoustiiaw) ; P. Cair. Masp. I 67058 I
15 (a. 549/550) ; P. Cair. Masp. I 67057 I
6 et II
7 (ca. 551-552).
Voir en dernier lieu Mitthof F., Annona, 2001, I, p. 264 (et II, p. 555-556, n° 191, sur SB XX 14494) ; Zuckerman C., Village, 2004, p. 170-172 ; Mitthof F., Das Dioskoros-Archiv, 2008, p. 251-253 ; Gascou J., Fiscalité, 2008, p. 312-313 et 344-345 ; Kaiser A.M., Rekrutierungspraxis, 2012, p. 118.47. C. Zuckerman met en avant un lien très probable entre Electi et Bis Electi : une unité « recréée » en Numidie, comme une réplique d’une unité locale (d’époque impériale), après la reconquête justinienne, puis expédiée en Égypte avec les Numidae (p. 171) ; de même, Pringle D., Defence, 1981, I, p. 73. Même hypothèse dans plusieurs publications de G. Ravegnani : Soldati, 1988, p. 30-31 ; Bizantini, 2004, p. 40-41 ; Unità, 2005, p. 192-194 (transfert en Égypte, décès de Maxentius avant 537) ; Soldati e guerre, 2009, p. 48.48. CIL, VIII, 9248 (= 20849) = ILS, 2812 = ILCV, I, 442 ; réédition et commentaire de Duval N., Byzantins, 1985, p. 341-344 (photo p. 343, fig. 2) ; sur ces Primi Felices Iustiniani, voir Ravegnani G.,
Fl(avii) Ziperis,| trib(u)n(i) n(umeri) Pr(i)m(orum) Fel(icium) | Iust(inianorum). Depositus est | in p(a)c(e) agens tribu|natu Rusg(uniis) ann(os) XII. La plupart des éditeurs et des com-mentateurs ont restitué n(umeri) Pr(i)m(anorum) Fel(icium) Iust(inianorum), alors que Jean Durliat et Noël Duval optent pour un numerus de Pr(i)m(i), voire, selon Duval, Pr(i)m(i) M., par exemple M(aurorum). On connaît par ailleurs des Primi Theodosiani en Italie, lors de la guerre gothique49. Le cognomen du tribun est un nom indubitablement thrace, à son tour fréquent et typique de l’Antiquité tardive50. Qui plus est, dans la Johannide, rédigée vers 550, Corippe mentionne un militaire (officier ?) byzantin homonyme, Ziper, qui doit être une autre personne ; armiger (donc dorufo vro") de Jean Troglita, il trouva la mort dans la guerre contre les Maures (546-548)51. Sur la foi des seuls renseignements ono-mastiques, nous pouvons avoir une meilleure idée du poids des recrues originaires de Thrace dans l’armée byzantine en Afrique du Nord.
Récapitulons à présent les connaissances certaines sur les trois numeri de l’armée byzantine après la fin du royaume vandale :1) Numerus Hipponensium Regiorum (ou Hipponis Regii)
en garnison à Hippone, en Afrique Proconsulaire, attesté par l’épitaphe du soldat Buraido.
2) Numerus Bis Electum, attesté par l’épitaphe du senator Maxentius, toujours à Hippone.
3) Numerus Primorum Felicium Iustinianorum, en garnison à Rusguniae, en Maurétanie Césarienne, attesté par l’épitaphe du tribun Fl. Ziper.
La présence byzantine à Hippone est en outre illustrée par l’épitaphe érigée pour le fils d’un ressortissant d’Asie mineure, plus précisément de Lycie, inscription précisément datée du 13 décembre 587 apr. J.-C. : il s’agit de l’épitaphe bilingue de Tehodosius (sic), décédé à 10 ans – Qewdo vsi" (sic), u Jio ;" Stefa vou Koivdou Lukivou52.
Les données sur la présence de militaires d’origine thrace en Afrique du Nord byzantine sont donc fournies par les deux épitaphes d’Hippone et de Rusguniae, ainsi que par plusieurs passages de Procope et de Corippe. À ce dossier assez consistant on pourrait ajouter trois autres épitaphes citant des porteurs de noms thraces. Fort malheureusement,
Unità, 2005, p. 193-194. À Rusguniae se trouvait peut-être le siège du dux Mauretaniae, voir en dernier lieu Duval N., AntTard, 10, 2002, p. 46-47.49. CIL, XI, 1693 = ILCV, I, 486 (an 547) : Macrobis, primicerius Primi Th(e)odosianorum numeri.50. Voir n. 60.51. Corippe, Ioh. 4.395, 6.535, 6.538, 6.638, 6.671 ; voir, en général, Modéran Y., Corippe, 1986 ; Zarini V., Mauri, 2005.52. AÉ, 1928, 35 = SEG, IX, 872 ; republiée avec une photo par Duval N., L’épigraphie funéraire, 1988, p. 291, fig. 23 ; une autre photo dans Delestre X., Hippone, 2005, p. 190 ; le papponyme a été corrigé en K(r)oivdou par Feissel D., BÉ, 1990, p. 962 (= Id., Chroniques, 2006, n° 1087).
158
Ant
iqui
tés
afric
aine
s, 4
9, 2
013,
p. 1
51-1
60
la lecture ou la restitution sont incertaines, et l’absence d’illustration53 rend leur témoignage problématique :
1) Colline Kheloua, près d’Ammaedara (auj. Haïdra), dominant la route de Carthage à Theveste, au-dessus du cimetière de l’est, épitaphe chrétienne sur une dalle (36 x 52 cm ; lettres de 5 cm)54 :
† Zimarcusin pace bixitann(os) LXV, [m(enses)?] IX,d(e)p(ositus) [---][---].
Les lectures divergent : Piganiol transcrit X Limarcus, en considérant le X comme une croix, et Limarcus comme un cognomen (or, ce serait un nom hapax) ; Diehl propose XLI Marcus, avec la première séquence à lire comme Chri(sti), ce qui est difficilement explicable au début d’une inscription funéraire55 ; Duval transcrit XLIMARCUS, et, après avoir passé en revue les variantes possibles, conclut : « Si on a bien le début de l’épitaphe et si la lecture est correcte, la première ligne paraît peu compréhensible ». La correction « Zimarcus », suggérée naguère par I.I. Russu56, est extrê-mement séduisante. Si elle est justifiée, alors la date retenue (fin du Ve-VIe s.) est à revoir, d’autant plus qu’à Haïdra l’on connaît par ailleurs une garnison byzantine57.
2) Carthago Iustiniana / Carthage, épitaphe chrétienne frag-mentaire sur marbre (25 x 23 x 18 cm ; lettres de 7 cm)58 : Zim[--- ---]es in p[ace vixit][------------].
C’est la dernière éditrice, Liliane Ennabli, qui propose comme première possibilité de restitution Zim[arcus], en renvoyant à à Zimarcus sur la mosaïque de Grado (ILCV, I, 488 A), citée ci-dessus.
53. Malgré mes efforts, je n’ai retrouvé aucune trace de ces pierres, perdues ou égarées.54. Piganiol A. et Laurent-Vibert R., Recherches, 1912, p. 173-174, n° 115 ; ILCV, II, 2648 A (adn.) ; Leclercq H., Haïdra, 1925, col. 2032 ; ILTun, 473 ; Duval N. et Prévot F., Haïdra I, 1975, p. 316-317, n° 506, fig. 275 (copie de Piganiol) (« elle n’a pas été retrouvée »). Pour la muraille d’époque byzantine, voir Pringle D., Defence, 1981, I, p. 179-181. Et l’épi-taphe d’un optio, Maurianus, trouvée dans la Basilique I.55. Ben Abdallah Z. et Ladjimi Sebai L., Index, 1983, p. 36-37, Limarcus ou Marcus, avec des réserves.56. Russu I.I., Zemarchos, 1970, p. 412 n. 5.57. Baratte Fr. et Béjaoui F., Fortifications, 2011, p. 513-538.58. Édition princeps : Delattre A.-L., Inscriptions, 1920, p. 293, n° 230, sans photo : ZIM////////////////////|ES IN Pace, avec le Z barré ; ILTun, 1147 ; Ennabli L., Inscriptions, 1975, p. 309, n° 268 ; Ben Abdallah Z. et Ladjimi Sebai L., Index, 1983, p. 48 : Zim[–]. Pour la présence militaire byzantine à Carthage, voir Pringle D., Defence, 1981, I, p. 171-178.
3) Thuburbo Maius (auj. Henchir-Kasbat), épitaphe chré-tienne précédée d’une croix latine sur une dalle trouvée dans l’église du VIe s. (temple de Cérès, transformé en basilique chrétienne)59 :
† Boraides fide- lis in pac(e) vi[xit an]- no(s) LXXXV, [depositus est ---] Apriles, i[ndict(ione) ---].
L’édition princeps donne SORAIDES, qui est de toute façon un nom hapax. Il est cependant possible qu’on ait lu, à la place d’un B (de Boraides), un S, mais seule la redécou-verte de l’épitaphe pourrait le confirmer.
* * **
L’Afrique post-vandale nous renseigne ainsi sur l’impor-tance des Thraces dans l’armée romaine tardive, mais aussi sur la persistance dans l’espace balkanique d’une onomas-tique de tradition indigène. On voit ainsi se préciser avec plus de vigueur le groupe de trois noms thraces les plus popu-laires pendant l’Antiquité tardive : Buraides (et sa variante Buraido), Zimarcus et Ziper, chacun attesté désormais par une dizaine d’occurrences60. Cet usage de noms épicho-riques61, en osmose, il importe de le souligner, avec des noms chrétiens, latins et grecs, n’est pas le propre des Thraces, citoyens de l’Empire depuis des siècles déjà : des Syriens et des Micrasiates, actifs dans l’armée et arrivés parfois aux plus hautes dignités, portent souvent, même vers la fin de l’Antiquité tardive, de noms indigènes. Il suffit de citer le cas des Isauriens en Asie mineure, avec, entre autres, la vogue du nom Illou", typiquement isaurien62.
Janvier 2013
59. Merlin A., BCTH, 1912, p. CCLXXVIII ; Id., Histoire municipale, 1933, p. 223 ; ILTun, 737 ; Maurin L., Thuburbo Majus, 1967, p. 235 et n. 50 ; Ben Abdallah Z. et Ladjimi Sebai L., Index, 1983, p. 44 (Soraides).60. Pour les porteurs de ce nom thrace, voir Russu I.I., Zemarchos, 1970, p. 411-418. La liste actualisée des occurrences sera donnée dans mon répertoire Onomasticon Thracicum, en cours de publication.61. Pris par la plupart des historiens modernes pour des noms « barbares », en accord donc avec la thèse d’une « barbarisation » de l’armée.62. Voir en dernier lieu Feissel D., Inscriptions, 2012, p. 9.
159
Ant
iqui
tés
afric
aine
s, 4
9, 2
013,
p. 1
51-1
60
Baratte Fr. et Béjaoui F., 2011, Les fortifications byzantines d’Am-maedara, CRAI, p. 513-538.
Ben Abdallah Z. et Ladjimi Sebai L., 1983, Index onomastique des inscriptions latines de Tunisie, Paris (Études d’Antiquités africaines).
Beševliev V., 1961, Die Thraker im ausgehenden Altertum, StudClas, 3, p. 251-263.
Beševliev V., 1964, Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien, Berlin.
Beševliev V., 1970, Untersuchungen über die Personennamen bei den Thrakern, Amsterdam.
Cagnat R., 1882, Notice sur les inscriptions romaines découvertes jusqu’à ce jour à Bône et aux environs, BullAcadHippone, 17, p. 31-76.
Cagnat R., 1913, L’armée romaine d’Afrique et l’occupation militaire de l’Afrique sous les Empereurs², t. I-II, Paris.
Caillet J.-P., 1993, L’évergétisme monumental chrétien en Italie et à ses marges d’après l’épigraphie des pavements de mosaïque (IVe-VIIe s.), Rome (CÉFR, 175).
Cameron A., 2008, Vandal and Byzantine Africa, dans CAH², XIV, Cambridge, p. 552-569.
Camps G., 2002-2003, Liste onomastique libyque. Nouvelle édition, AntAfr, 38-39, p. 211-257.
Delattre A.-L., 1920, Inscriptions trouvées dans la basilique voisine de Sainte-Monique à Carthage, RT, 27, p. 203-207, 287-293.
Delestre X. éd., 2005, Hippone, Aix-en-Provence.
Detschew D., 1957, Die thrakischen Sprachreste, Vienne (réimpr. 1976).
Dondin-Payre M., 2011, Du voyage à l’archéologie : l’exemple de l’Afrique du Nord, dans Du voyage savant aux territoires de l’archéologie. Voyageurs, amateurs et savants à l’origine de l’archéologie moderne, M. Royo et alii (éds.), Paris, p. 273-290.
Durliat J., 1979, La lettre L dans les inscriptions byzantines d’Afrique, Byzantion, 49, p. 156-176.
Duval N., 1977, Observations sur l’onomastique dans les inscriptions chrétiennes d’Afrique du Nord, dans L’onomastique latine. Actes du colloque de Paris, 13-15 octobre 1975, Paris, p. 447-455.
Duval N., 1985, Les Byzantins à Rusguniae. Études d’archéologie chré-tienne nord-africaine, X, dans IIe Colloque international sur l’His-toire et l’Archéologie de l’Afrique du Nord (Grenoble, 5-9 avril 1983), Paris (BCTH, n.s., 19B, Afrique du Nord, 1983), p. 341-360.
Duval N., 1988, L’épigraphie funéraire chrétienne d’Afrique : tra-ditions et ruptures, constantes et diversité, dans La terza età dell’epigrafia. Colloquio AIEGL – Borghesi (Bologna, ottobre 1986), A. Donati (éd.), Faenza, p. 265-314.
Duval N., 1989, s.u. Hippo Regius, dans RAC, XV, col. 442-466.
Duval N., 2003, Les dates régnales des Vandales et les structures du royaume vandale, AntTard, 11, p. 85-96.
Duval N. et Prévot F., 1975, Recherches archéologiques à Haïdra, I. Les inscriptions chrétiennes, Rome (CÉFR, 18).
Ebersolt J., 1921, Mission archéologique de Constantinople, Paris.
Ellis Evans D., 1967, Gaulish Personal Names. A Study of Some Continental Celtic Formations, Oxford.
Ennabli L., 1975, Les inscriptions funéraires chrétiennes de la basilique dite de Sainte-Monique à Carthage, Rome (CÉFR, 25).
Feissel D., 2006, Chroniques d’épigraphie byzantine 1987-2004, Paris.
Feissel D., 2012, Inscriptions of Early Byzantium and the Continuity of Early Onomastics, dans Epigraphy and the Historical Sciences, J. Davies et J. Wilkes (éds.), Oxford (Proceedings of the British Academy, 177), p. 1-14.
Ferdinandi S., 2012, Organizzazione militare dell’Africa bizantina (533-709) : strategie e incastellamento, dans L’Africa romana, 19, t. 2, Sassari, p. 1203-1220.
Fol A., 1968, Les Thraces dans l’empire romain d’Occident (Ier-IIIe siècles). Deuxième partie : Documentation épigra-phique, Godišnik na Sofijskija Universitet. Istoriko-filologičeski Fakultet, 62, p. 193-274.
Gascou J., 2008, Fiscalité et société en Égypte byzantine, Paris.
Giron N., 1922, Notes épigraphiques, Journal Asiatique, XIe série, 19, p. 63-93.
Gsell S., 1902-1911, Atlas archéologique de l’Algérie, Alger-Paris (abrégé AAA).
Gui I., Duval N. et Caillet J.-P., 1992, Basiliques chrétiennes d’Afrique du Nord, I (Inventaire de l’Algérie), Paris (Études augustiniennes).
Janniard S., 2007, Centuriones ordinarii et ducenarii dans l’armée romaine tardive (IIIe-VIe s. apr. J.-C.), dans The Late Roman Army in the Near East from Diocletian to the Arab Conquest. Proceedings of a Colloquium Held at Potenza, Acerenza and Matera, Italy (May 2005), A.S. Lewin et P. Pellegrini (éds.), Oxford (BAR Intern. Ser., 1717), p. 383-393.
Jongeling K., 1994, North-African Names from Latin Sources, Leyde.
Kaiser A.M., 2012, Rekrutierungspraxis im spätantiken Ägypten, dans Le métier de soldat dans le monde romain. Actes du cinquième congrès de Lyon organisé les 23-25 septembre 2010 par l’Université Jean Moulin Lyon 3, C. Wolff (éd.), Lyon (CEROR, 42), p. 99-120.
Keenan J.G., 1973, The Names Flavius and Aurelius as Status Designations in Later Roman Egypt, ZPE, 11, p. 33-63.
Keenan J.G., 1974, The Names Flavius and Aurelius as Status Designations in Later Roman Egypt, ZPE, 13, p. 283-304.
Keenan J.G., 1983, An Afterthought on the Names Flavius and Aurelius, ZPE, 53, 1983, p. 245-250.
Kerr R.M., 2010, Latino-Punic Epigraphy. A Descriptive Study of the Inscriptions, Tübingen.
BiBLiograpHie
160
Ant
iqui
tés
afric
aine
s, 4
9, 2
013,
p. 1
51-1
60
Kuhoff W., 2012, Das spätrömische Afrika und seine Militärbefehlshaben, dans L’Africa romana, 19, t. 1, Sassari, p. 541-564.
Laniado A., 2004, L’onomastique romaine dans le monde protoby-zantin : quelques témoignages négligés, AnTard, 12, p. 325-245.
Leclercq H., 1925, s.u. Haïdra, dans DACL, VI, col. 2010-2032.
Marec E., 1958, Monuments chrétiens d’Hippone ville épiscopale de Saint Augustin, Paris.
Marrou H.I., 1953, Épitaphe chrétienne d’Hippone à réminiscences virgiliennes, Libyca, 1, p. 215-230.
Marrou H.I., 1978, Christiana tempora. Mélanges d’histoire, d’ar-chéologie, d’épigraphie et de patristique, Rome (CÉFR, 35).
Mateescu G.G., 1923, I Traci nelle epigrafi di Roma, Ephemeris Dacoromana, 1, p. 57-290.
Maurin L., 1967, Thuburbo Majus et la paix vandale, CT, 15, p. 225-254.
Merlin A., 1933, L’histoire municipale de Thuburbo Majus, dans Actes du Cinquième Congrès international d’Archéologie, Alger, 14-16 avril 1930, Alger, p. 205-225.
Minkova M., 2000, The Personal Names of the Latin Inscriptions in Bulgaria, Francfort (Studien zur klassischen Philologie, 118).
Mitthof F., 2001, Annona militaris. Die Heeresversogung im spätantiken Ägypten. Ein Beitrag zur Verwaltungs- und Heeresgeschichte des Römischen Reiches im 3. Bis 6. Jh. n. Chr., I-II, Florence (Papyrologica Florentina, 32).
Mitthof F., 2008, Das Dioskoros-Archiv und die militärischen Reformen Justinians in der Thebais, dans Les archives de Dioscore d’Aphrodité cent ans après leur découverte. Histoire et culture dans l’Égypte byzantine. Actes du colloque de Strasbourg (8-10 décembre 2005), J.-L. Fournet et C. Magdelaine (éds.), Paris, p. 247-259.
Modéran Y., 1986, Corippe et l’occupation byzantine de l’Afrique : pour une nouvelle lecture de la Johannide, AntAfr, 22, p. 195-212.
Papier, A., 1887, Lettres sur Hippone, Bône.
Pflaum H.-G., 1976, Pannoniens et Thraces en Afrique du Nord romaine à l’époque du Haut-Empire, Pulpudeva, 2, p. 53-67.
Piganiol A. et Laurent-Vibert R., 1912, Recherches archéologiques à Ammaedara (Haïdra), MÉFR, 32, p. 69-101.
Pringle D., 1981, The Defence of Byzantine Africa from Justinian to the Arab Conquest. An Account of the Military History and Archaeology of the African Provinces in the Sixth and Seventh Centuries, I-II, Oxford (BAR Intern. Ser., 99) (réimpr. avec des ajouts bibliographiques en 2011).
Ravegnani E., 2006, Consoli e dittici consolari nella Tarda Antichità, Rome.
Ravegnani G., 1988, Soldati di Bisanzio in età giustinianea, Rome.
Ravegnani G., 2004, I Bizantini e la guerra. L’età di Giustiniano, Rome.
Ravegnani G., 2005, Le unità dell’esercito bizantino nel VI secolo tra continuità e innovazione, dans Alto Medioevo mediterraneo, S. Gasparri (éd.), Florence, p. 185-205.
Ravegnani G., 2007, Soldati di Bisanzio in Italia nelle epigrafi del VI secolo, dans Studi in ricordo di Fulvio Mario Broilo. Atti del Convegno Venezia, 14-15 ottobre 2005, G. Cresci Marrone et A. Pistellato (éds.), Padoue, p. 523-530.
Ravegnani G., 2009, Soldati e guerre a Bisanzio, Bologne.
Rugo P., 1975, Le iscrizioni dei secoli VI-VII-VIII esistenti in Italia, II, Padoue.
Russu I.I., 1969, Die Sprache der Thrako-Daker, Bucarest.
Russu I.I., 1970, Zemarchos. Ein Beitrag zur byzantinischen Prosopographie (6. Jh.), Dacia, n.s., 14, p. 411-418.
Russu I.I., 1976, Elementele traco-getice în Imperiul Roman şi în Byzantium (veacurile III-VII) [en roum. : Les éléments thraco-gètes dans l’Empire Romain et à Byzance (IIIe-VIIe siècles)], Bucarest.
Sacco G., 1999, Due nuove iscrizioni latine di interesse onomastico (Altera, Cenebes), ZPE, 126, p. 269-274.
Samsaris D.C., 1988, Relations entre la Péninsule Balkanique et l’Afrique romaine. Population et onomastique balkanique en Afrique, dans L’Africa romana, 5, Sassari, p. 403-430.
Schwarze A., 1892, Untersuchungen über die äussere Entwicklung der afrikanischer Kirche mit besonderer Verwetung der archäo-logischen Funde, Göttingen.
Solin H., 2012, Sur la présence de noms puniques et berbères en Afrique, dans Visions de l’Occident romain. Hommages à Yann Le Bohec, B. Cabouret, A. Groslambert et C. Wolff (éds.), I, Paris, p. 327-343.
Speidel M., 1984, Roman Army Studies, I, Amsterdam (Mavors, 1).
Speidel M.P., 1987, Numerus Electorum in Africa and Mauretania, AntAfr, 23, p. 193-196.
Torrey C.C., 1944, A Greek Mortuary Tablet Belonging to Yale University, Berytus, 8 (2), p. 94-96.
Whatmough J., 1970, The Dialects of Ancient Gaul, Cambridge (Mass.).
Zarini V., 2005, Mauri, Romani, Afri : le regard de Corippe sur l’Afrique byzantine et l’identité de ses populations, dans Identités et culture dans l’Algérie antique, Cl. Briand-Ponsart (éd.), Rouen, p. 407-422.
Zuckerman C., 2002, La haute hiérarchie militaire en Afrique byzantine, AntTard, 10, p. 169-175.
Zuckerman C., 2004, Du village à l’Empire. Autour du registre fiscal d’Aphroditô (525/526), Paris.