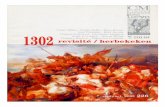Hathor d’ imAw ( Kom El-Hisn), La première Conférence Albehera pour Tourisme et des...
Transcript of Hathor d’ imAw ( Kom El-Hisn), La première Conférence Albehera pour Tourisme et des...
1
Hathor d’imAw ( Kom El-Hisn) Adel Zine Al-Abedine Département d’archéologie
Faculté des Lettres -Université de Tanta
Imaou( Kom El- Hisn ) se situe au centre de Kom Hamada au gouvernorat
d’El-Béhéra(1)
. Il se trouve loin de Damanhour d’environ 30 Km au sud du
désert ouest d’environ 4 Km et de Kom Freine de 13 Km(2)
. C’est une des plus
grandes collines de l’ouest de la Basse–Egypte dont la superficie est évaluée à
140 fiddains(3)
. Imaou (Kom El-Hisn) était la capitale de la troisième région de
la Basse Egypte(4)
(Figure 1).
Hathor a été adorée sous plusieurs formes dans ce lieu comme déesse
d’amour, de beauté et de musique. En effet, les anciens égyptiens ont fait une
relation entre certaines déesses et l’arbre. Il était un foyer de l’âme de Hathor. Ils
ont également cru que l’arbre était le corps vivant de la déesse Hathor sur la
terre(5)
. D’où la croyance en son existence en tant que déesse protectrice dans
les arbres qui protège le défunt et l’aide à monter vers le ciel afin de vivre entre
les étoiles brillantes (6)
.
D’ailleurs nous voyons souvent dans Le livre des morts et sur les murs des
tombes, des inscriptions qui représentent la déesse Hathor sous la forme d’une
femme qui apparaît parmi les branches d’un arbre , portant dans une main un
plateau de nourriture et dans l’autre une vase d’eau de magnanimité sur les
morts(7)
. Les décès ont compté sur elle car Hathor a annoncé qu’elle donnera la
vie au défunt à l’ouest d’où il rêve de la rencontrer quand il arrive à l’ouest (au
1 Gauthier, H., Dictionnaire des noms géographiques contenus les textes hiéroglyphiques, T. 1 , (Le
Caire, 1925), p. 70; Porter, B.& Moss, R., Topographical bibliography of ancient Egyptian Hieroglyphic texts,
reliefs and painting, IV, Lower and Middle Egypt, (Oxford, 1934), p. 51. 2 Gardiner, A., Ancient Egyptian Onomastica, vol. II,Oxford 1947, p. 140; Griffith , F., Egyptological Notes
from Naukratis and the Nieghbourhood,in Naukratis , II , (London, 1888), p. 77. 3 Daressy, G., Rapport sur Kom el-Hisn, ASAE IV, 1903, p. 281.
4 Helck, H., W., Die altagyptischen Gaue , (Wiesbaden, 1974), p. 154.
La troisième région s’étend à longue distance et se situe au nord des frontières de la deuxième région
jusqu’au Méditerranée tout au long de la rive ouest du branche ouest du Delta “El- Kanoby”. Et cela l’a rendu à
plusieurs divisions administratives à cause du développement de l’agriculture et de la croissance
démographique. Pendant l’Ancien Régime, elle était une seule région puis elle est devenue deux régions dans
la cinquième dynastie.
De Rouge, Géographie ancienne de la Basse Egypte , (Paris, 1891), p. 11- 13; Al-Saady, S., Les gouverneurs
des régions en Egypte pharaonique, étude de l’histoire des régions jusqu’à la fin du Moyen Empire, (Alexandrie,
1991), p. 56;Voire, elle a été divisée pendant l’Époque grecque en trois régions : région Andropolice , région de
Mariotte et la région Libyen. Elle se trouve à l’ouest du désert libyen et pour cette raison ;les grecques l’ont
surnommé «la région Libyen», à l’Époque pharaonique (= Helck, H., op cit., p. 154). Et son nom était
Momemphis chez Hérodote, II, 163; Strabon 17,803; Diodor, I, 66. 5 Barguet, P., Le livre des morts des anciens Egyptiens, Paris 1967, ch. 57, 59.
6 Buhl, M., L., The goddesses of Egyptian tree cult, JNES VI, (1947), p. 80 ff.
7 Saleh, A., L’histoire de la religion en ancien Egypte, en Al-mégéla 23, (Le Caire, 1958), p. 53.
2
nécropole)(8)
. Pour cette raison son adoration était publique et par conséquence
ses temples étaient plus nombreux que ceux de dieu Horus.
Hathor et sa relation avec la 3ème
région dès le début de l’histoire :
Hathor était lié à la région, dès le début de l’histoire, par l’existence du
symbole de la vache dans le nom de la région « Hwt iHyt ». Ce symbole
est apparu dans la période Thinite pendant la Ie dynastie, règne de Den dans sa
tombe numéro VI de Merneith du cimetière d’Abou Roach(9)
. Également, ce
symbole existait à la IIIe dynastie dans la mastaba de Pehernefer, groupe nord, à
Sakkarah (10)
et à la fin de la même dynastie, dans la mastaba de Meten, groupe
septentrional, au-delà de la voie menant de la pyramide de Téti au Sérapeum à
Sakkarah(11)
.
Nous trouvons à la VI dynastie à Sakkarah que l’ancien nom
« Hwt iHyt » est remployé sur la stèle de la fausse-porte de la mastaba de
Sdementi(12)
et de Merou, derrière la mastaba de Mererouka(13)
.
Le nom de la région était encore employé au Moyen Empire dans la
chapelle de Sésostris I qui se trouve au musée ouvert de Karnak « Hwt iHyt »
(14).
Hathor et sa relation avec Sekhmet à Imaou
Hathor a apparu sous la forme de Sekhmet à Imaou. La liaison entre les
deux revient, peut-être, au mythe de la destruction des êtres humains (15) qui a
donné à Hathor la forme sauvage de Sekhmet (16). Donc Sekhmet était adoré
à Imaou (Kom El-Hisn) et elle prend l’allure et le titre de Hathor. Sous Le
Nouvel Empire, nous trouvons sur une statue de la XVIIIe dynastie du règne du
roi Amenhetep III, dans son temple funéraire, le texte suivant:
sxmt nbt imAw «sekhmet, dame d’Imaou
(17)».
8 Lurker, M., The gods and symbols of ancient Egypt, (London, 1988), p. 59.
9 Perdu, O., Imaou , une capitale oubliée des confins Libyques , (Paris, 1976), p. 1f ; Mentet, P., Tombeau de I
er
et de la IV dynastie A Abou Roach, Keme 7 , (1938), pl. 1.
10 Perdu, O., op. cit. p. 2; Maspero, op cit., II, (1890), p. 267.
11 Perdu, O., op. cit. p. 2f; LD II, pl. 3-7; Maspero, G., Etudes Egyptiennes, II, (1890), p. 115- 246; Urk. I, p.1-7;
PM III2, p. 124.
12 Drioton, I., Description Sommaire des chapelles funéraires de la Vie dynastie récemment Découvertes
Derrière le Mastaba de Mérérouka à Sakkarah , ASAE 43, (1943), p .456, pl. 507. 13
Saad, Z., Preliminary report on the excavations of the department antiquities at Saqqara 1942-1943, ASAE
43, (1943), p. 456, pl. 46; Kees, H., op cit., p. 509. 14
Lacau& Chevrier, Une chapelle de Sesostris I à Karnak, I, (Paris, 1956), pl.232; Idem, II, (1969), p. 40;
Kees, H., Anubis , Herr von Sepa und der 18 oberägyptischen Gau, ZÄS 58 , (1923), p. 92. 15
Griffith, F., op. cit., p.78,79; Herodot, II, 60. 16
Helck, W., Das Bier im Alten Agypten , (Berlin, 1971), p. 82- 83. 17
Hoenes, S., E., Untersuchungen Zu Wesen und Kult der Göttin Sahmet, (Bonn 1976), p. 104.
3
En outre, à Gabal Silsileh, le titre de la dame d’Imaou est inscrit sur le
groupe de Ramsès II dont l’aspect redoutable de Hathor local se confond avec
le nom de Sekhmet (18).
Le titre de « dame d’Imaou » est également inscrit sur une statue–bloc au
Musée du Louvre numéro E.10295 qui revient à l’époque de transition entre les
25 et 26 dynasties, où il y a le texte suivant :
ImAxw xr sxmt wrt nb(t) tAwy….. nb(t) pr di nb(t) imAw ,……
«( Le féal ) auprès de Sekhmet, la grande dame des deux pays …… la dame de
la maison Di – nb – Imaou ………(19)
».
Les titres de Hathor à Imaou
Hathor avait plusieurs titres à ImAw : sxAt Hr, maîtresse de musique, de
danse et maîtresse d’Imaou. Nous allons traiter chaque titre en détail:
1) sxAt Hr Ce titre montre la liaison entre Hathor, Horus et le désir de commémorer
celui-ci dans cette région (20). Hathor était surnommé par«sxAt Hr», mentionné sur
les textes des pyramides. Il signifie la vache adoratrice (mère de Horus) (21), par
suite la mère des rois. Il désigne également « celle qui commémore Horus» (22).
D’autre part, la vache céleste « sxAt Hr » est évoquée comme nourrice
d’Horus ; enfant auquel elle donne la vie et la prospérité afin d’exercer sa
souveraineté sur le désert occidental (23). Ce thème est magnifiquement illustré
par de nombreux contrepoids de menat dont la décoration est souvent constituée
par une scène d’allaitement (24).
D’après un mythe propre à Imaou, sxAt Hr, est la vache qui met bas son
veau Apis (25). On trouve souvent les vaches célestes associées aux divinités
18
Griffith, op cit., p. 77- 8; Hoenes, op cit., p.105; Leonard, A.& Coulson, W., Cities of Delta, part 1, Naukratis,
ARCE 1981, p. 81. 19
De Meulenaere, H., Cultes et sacerdoces à Imaou ( Kom El Hisn ) au temps des dynastie Saite et perse,
BIFAO 62, p.161, pl. XXXII. 20
Montet, P., Géographie de l’Egypte ancienne, T. I, (Paris, 1957), p. 58. 21
Hassan, S., Les régions géographiques d’Égypte, (Le Caire, 1944), p. 70. 22
De Rouge, Géographie ancienne de la Basse Egypte, (Paris, 1891), p. 11- 13; Wb IV, p. 235; Bleeker, C., J.,
Hathor and Thot, two key figures of ancient Egyptian religion, (Leiden, 1973), p. 33. 23
De Meulenaere, H., op. cit., p. 163. 24
Barguet, P., L’origine et la signification du contrepoids du collier menat , BIFAO 52 , (1935), p. 104. 25
Perdu, O., op. cit, II, p. 346; Brugsch, H., Eine geographische studie, ZÄS 17, (1879), P. 25.
4
tutélaires comme«sxAt Hr»(26). A la fin de la Ve dynastie, dans la mastaba de Ti,
« sxAt Hr » est absorbée par Hathor qui devient divinité principale d’Imaou(27) .
Sur la stèle de sA ra, la sœur du sculpteur, de la 2e dynastie au Raqaqnah, a
pris le titre « sAt sxAt Hr» (28). Ainsi, l’idée de naissance et de tout ce qui peut en
découler, était attachée, à cet objet typiquement Hathorien et très répandu dans
la 3e région (29).
Pendant la dix-neuf dynastie, le titre était noté sur le tombeau de PAsr
n°106 à Cheikh Abd Al-kurna (30)
et également au temple de Idfou
(31).
2) Hathor, maîtresse de musique et danse en Imaou
Hathor, maîtresse de musique et danse, est un titre qui manifeste dans la
tombe du prêtre xsw wr à Kom El-Hisn(32), à travers les titres de ce dernier(33)
:
« sbA xsw wr » Hry tp nfrt imy-r xnrwt
«L’instituteur xsw wr» « En tête des belles » «surveillant des harems»
Le prêtre a probablement eu les titres suivants : l’instituteur, le chef des
chanteurs, des musiciens, le maître surveillant et en tête de belles femmes parce
qu’il a pour rôle d’apprendre les belles jeunes filles à danser, chanter et de jouer
de la musique pour amuser leurs patrons(34)
. Les belles filles revivent les fêtes de
Hathor(35)
. Le titre du chef des chanteurs et des musiciens était normalement
attribué à un grand employé dont peu pouvait l’avoir car il exige un doué.
L’utilisation des sistrum et minyt est une preuve de l’adoration de Hathor en
tant que maîtresse de musique et danse(36)
.
3) hthr pr nb(t) ImAw L’une des épreuves la plus ancienne sur l’adoration de cette déesse
26
Gomaà, F., Hathor, LÄ II, 1025 27
Goyon, G., Le tombeau de Ti , fascicule I, MIFAO 65, (1966), pl. 63. 28
Gauthier, H., Die Agyptischen Personennamen, I, (Glückstadt, 1935), p. 319. 29
Barguet, op. cit., p. 104. 30
Wb IV, p. 235; Davies, Rx - mi - ra , (London, 1933), taf. 64. 31
Dümichen, J.Monuments Géographique, III, (Leipzig, 1885), pl. XXIX 32
Edgar, Recent discoverier at Kom El Hisn,in Maspero , Le musée Egyptien 3, (1924), p. 54- 61. 33
Silverman, D., The tomb chamber of hsw-wr the elder: the inscribed material at Kom el–Hisn, (ARCE
1988), p. 146 ff; Allam, Sh., op. cit., p. 90. 34
Hickman, E., LÄ IV, 238 35
Erman, A., op. cit, p. 37; Manniche, L., Music and Musician in Ancient Egypt, (London, 1991), p. 57- 73. 36
Brunner–Traut, T., Der Tanz im alten Ägypten nach bildlichen und inscriftlichen zeugnissen, (Hamburg
1938), p. 30- 31.
5
est l’existence de ce titre dans la Mastaba de « Ti » à l’époque du roi « Nfr ir kA ra », de la cinquième dynastie à Saqqarah, où sa femme a eu le titre de
prêtresse de Hathor dans la capitale de Memphis « Hthr Hm nTr nbt nht » et de
prêtresse d’Imaou comme l’indique le texte ci-dessous(37) :
HtHr Hm nTr ImAw «Prêtresse d’Hathor, dame d’Imaou»
(38).
En outre, ce titre existe dans les textes des pyramides (39), sur les inscriptions
du roi « Ny wsr ra » de la cinquième dynastie, du roi «Titi », de la 6e dynastie (
40)
et à la chapelle de Desi à Sakkarah dont sa femme a eu le titre de prêtresse
d’Hathor :
« HhtHr Hm nTr nbt ( nht , imAw ) » (41)
.
Nous voyons que ce signe désigne, plutôt nht, parce que le nom d’imAw
paraît souvent au pluriel.
D’autre part, au Moyen Empire, nous trouvons la tombe du prêtre xsw wr (figure 2 ), qui a eu des titres liés à la déesse Hathor à ImAw, pendant le règne
du roi Amenemhat III, à Kom El-Hisn (42)
.
«imAxw xr Hthr imAw sbA xsw wr»
«Le glorifié auprès de Hathor, maîtresse d’Imaou, l’instituteur xsw wr»(43).
Il y a aussi à Kom El-Hisn une statue de basalte noir (JE 43104 Caire)
composée de trois personnages : le roi Amenemhat premier, la déesse Hathor et
le roi Senusert premier (44)
(Figure 3). Ce titre existe également sur quatre blocs
de linteau de la chapelle du roi Snwsrt II (45) et sur la tête d’une autre statut de
37
Steindorf, G., Das Grab Des Ti, (Leipzig, 1913), taf. 52. 38
Goyon, G., op. cit., Pl. 63; Wild, Le tombeau de Ti, La chapelle ( deuxième partie ), fascicule III, MIFAO 65,
(1966), p1. 64. 39
Pyr. 699c, 1723c. 40
Gomaa, F. , op. cit., p. 81. 41
Drioton, E., Derciption Sommaire des chapelles , Funéraires de la vie Dynastie récemment Découvertes ,
Derrière la Mastaba de Mérérouka à Sakkarah, ASAE 43, (1943), P. 505. 42
Edgar, op. cit., p. 54 -61; Vandier, J., Manuel d’archéologie egyptienne, IV, (Paris 1964), P. 749. 43
Silverman, D., op. cit., p.146 ff; Allam, Sh., Beiträge zum Hathorkult bis zum ende des Mittleren Reiches,
Münchner Ägyptologische Studien 4, (Berlin, 1964), p. 90. 44
composé d’une base sur laquelle, Griffith découverte faite par les chercheurs de Sabbakh au cours de leurs
travaux en 1911 ;Evers,H.,Staat aus Stein ,I, Munchen 1929 ,Pls.99,100. 45
Gauthier, H., Le livre des Rois d’Égypte, III, (Paris, 1914), p. 366, pl. XXII.
6
basalte noir ( JE 42995 Caire ) du roi Amenemhat III (46)
(Figure 4) où il y a un
texte qui montre que Hathor est la maîtresse d’Imaou(47)
.
HtHr nbt ImAw « Hathor, maîtresse d’Imaou »
En plus, il y a sur les deux linteaux de sA - HtHr- nhy, le texte suivant :
HtHr nbt imAw «Hathor, maîtresse d’Imaou»
(48).
L’importance d’Imaou continue comme une résidence de l’adoration de la
déesse Hathor. Nous trouvons à partir des fouilles de Hamada et Farid que cette
région a été exploitée pendant la deuxième époque de transition(49) où ils ont
découvert un scarabée portant une inscription hiéroglyphique «voir Musée du
Caire (JE 87417)»(50).
Pendant le Nouvel Empire, le roi Thoutmosis III a entamé des activités
dans cet endroit et il a noté que Hathor est la maîtresse d’ Imaou (51)
. En outre,
nous trouvons cette épithète, sur l’une des statuts du roi Amonhetep II(52)
.
Petrie a également trouvé : certains blocs colossaux qui revient à l’époque
du roi Ramsès II, sur lesquels est gravée l’épithète de la déesse « château de
Hathor, maîtresse d’ Imaou»(53)(Figure 5 ).
D’autre part, le titre « Hathor, maîtresse d’Imaou » a été inscrit sur une
stèle trouvée en Sérapéum de Memphis et conservée au Musée de Louvre.
L’utilisation de ce titre était encore employée pendant la vingt-cinquième
dynastie ou vingt-sixième sur une statue de calcaire n°10802 existant à l’Institut
Oriental de Chicago:
46
Evers, H., op. cit. , pls. 101. 47
Evers, H., op. cit., p.101; Caminos, R. A., Nitocris adoption steals, JEA 50, (1964), p. 92; Leonard, A.
& Caulson,w., Apreliminary survey of the Naukratis region in the western delta, JEA 6, (1979), p. 169;
Beckerath, J., V., Amenemhet III, LÄ I, 191. 48
Simpson, The lintels of Si – Hathor – Nehy in Boston and Caire, BdE 24, (1972), p. 169- 173, pl. 15 ;
Perdu, O., op. cit., P. 124. 49
Hamada, A.& Farid, Sh., Excavations at Kom el-Hisn, ASAE L , (1950), pp. 367- 399. 50
Hamada, A.& Farid, Sh., Excavations at Kom el-Hisn, ASAE XLVI , (1947), p. 199, pl. 60. 51
Urk IV, 1443, 11 52
Gomaa, F., Die Libyshen Fürstertümer der Deltas,vom tod Osorkons II. Bis zur wiedervereinigung
Agyptens durch Psametik I, (Wiesbaden, 1974), p. 1 ff. 53
Griffith, F., op. cit., p. 78.
7
Htp di nsw HtHr .. ir ra nb pt «proscynème à Hathor, dame d’( Imaou ), oïl de Ra, maîtresse du ciel…….»
(54).
Nous trouvons le titre « pr nb imAw »sur une statue d’un employé du règne
du roi Psammétique I(55)
. D’ailleurs, dans la liste d’Edfou, la déesse Hathor est
mentionnée par son appartenance à la ville d’ Imaou:
(Hthr) imAw di.s wn.f ib nb
«( Hathor) Imaou, elle est la cause de chaque désir»(56).
Il est à notre que dans la dynastie Sait, sur le fragment de statue
n°16.580.15 au musée de Brooklyn, le texte suivant est cité (figure 6):
Htp di nsw HtHr nb imAw nb pt Hnwt nTrw « proscynème à Hathor, dame d’Imaou, maîtresse du ciel, régente de tous les
dieux » (57)
.
Ajoutons aussi que sur une statue de Saïs, qui fut déplacée du
temple de Neith au musée du Caire, il y a, toutefois, un texte écrit du prophète
de Hathor, dame d’Imaou (58)
.
Hathor est apparue décorée par les arbres d’Imaou sous la forme d’une
bande sur sa tête (59)
.
La forme d’Imaou
Dans les textes des pyramides, « imA » est apparu comme un arbre sacré ;
l’arbre des dieux (60)
:
iAm nTr Smsw wsir « l’arbre des dieux, partisans de Osiris »
54
Yoyotte, J., op. cit., pl. XXX-XXXI. 55
Ranke, H., Statue eines hohen Beamten unter Pasmmatich I, ZÄS XLIV, p. 49- 50. 56
Chassinat, E., La Mammisi D’Edfu, (Le Caire, 1939), P. 11. 57
De Meulenaere, H., op. cit., p. 158, pl. XXVII-XXIX . 58
El-Sayed, R., Au sujet de la statue Caire CG. 662 , BIFAO 77, (Le Caire, 1977), P. 101 f. 59
Brugsh, H., Dictionnaire Géographique de l’ancienne Égypte contenant ordre alphabétique la
nomenclature comparée des noms propres géographiques, (Paris, 1879), pp. 1025, 1131 60
Pyr. 1803 b; Sethe, K., Urgeschichte und Älteste religion der Ägypter, (Leipzig, 1930), p. 14- 15; Germer, R.,
Untersuchung über Arzneimittelpflanzen im Alten Ägypten, (Hamburg, 1979), p. 235- 237; Kees, H.,
Der gotterglaube im Alten Ägypten, (Berlin, 1956), p. 86; Il était mentionné comme arbre du ciel à côté
de l’arbre « iSd »
8
L’image de l’arbre comporte un tronc épais, une charpenté composée
d’une branche mère droit ou fortement incurvée et des branches latérales
nombreuses irrégulières qui se ramifient à leur tour. La frondaison est conique
ou légèrement pyramidale (61)
. C’est un xérophile vivant dans les zones semi–
désertiques de la bordure du Delta occidental et du désert de Libye, où il forme
des peuplements (62)
.
La catégorie est beaucoup plus vaste, déterminatif et modèle
iconographique d’une série impressionnante d’espèces. Le signe se lit
couramment « imA » et pourrait se rattacher à l’arbre (63).
Le mot désignant un arbre croissait en Égypte déjà sous l’Ancien Empire
et faisait certainement partie de la flore primitive du pays (64). Dans une époque
indéterminée, le sens général d’arbre, de même son déterminatif est aussi
appliqué à d’autres végétaux de même nature ; le même signe est employé
phonétiquement pour désigner la syllabe iAm(65).
Type de l’arbre
En ce qui concerne le type de l’arbre, nous trouvons plusieurs points de
vue : certains savants l’ont considéré comme un sycomore, d’autres comme une
dattier ou à la fois un sycomore et un dattier.
Jaquier voit qu’il s’agissait d’un arbre ressemblant en forme et en aspect
général au sycomore(66) mais les documents ne sont pas suffisants pour permettre
de déterminer l’espèce exact d’ImA.
Tandis que Griffith l’a considéré comme dattier, peut-être, parce que la
capitale est proche du désert ou bien lors de sa visite, il a trouvé beaucoup de
dattiers (67)
. Gauthier et De Rouge ont le même avis que Griffith(68)
.
Selon Keimer, la déesse apparaît d’un arbre d’un bas-relief dans le musée
Hanovre(figure 7), d’autre part, elle sort d’un dattier d’un bas-relief du musée de
Berlin (figure 8), le texte suivi de deux bas-reliefs mentionne « nbt nht».
61
Baum, N., Arbres et arubustes de l’Égypte ancienne ,la liste de la tombe Thébaine d’Ineni (n°81),OLA
31, (Leuven, 1988), p. 184. 62
Ibid, p. 192. 63
Ibid, p. 15- 16 64
Jequier, M., Matériaux pour servir à l’établissement d’un dictionnaire d’archéologie égyptienne, BIFAO
19, p. 14- 15. 65
Ibid, p.15 66
Ibid, P.15 67
Griffith, F., op. cit., p. 80. 68
Gauthier, H., Dictionnaire des noms géographiques contenue dans les textes Hiéroglyphiques ,tome
premier; (Le Caire, 1925), p . 70; De Rouge, op. cit., p. 13.
9
Également, il y a un bas-relief au musée du Caire JE52542, où la déesse apparaît
d’un arbre et dattier en même temps ( figure 9) où il y a le texte « nbt nht ». Il
indique dans ce même article qu’il y a un bas-relief au musée de Munch, d’un
dattier entourée d’un arbre(69)
(figure 10). Cet article a eu une grande influence
sur l’avis des savants(70).
Parmi eux, nous citons « Wallert » qui en voit le signe d’un arbre et dattier
(71). Il constate que la forme « imA » est un arbre de datte, et la forme est
un arbre sans datte. Enfin, il voit que le signe est en même temps « arbre et
palmier ». Il a présenté toutes les formes d’Imaou (72) comme ci-dessous:
(73) , (74), (75), (76), (77),
(78) , (79) , (80), (81) , (82),
(83) , (84) , (
85) .
Mais dans sa représentation de la forme d’Imaou, le signe de ( ) (d’un
palmier avec datte on sans) n’est pas paru.
En analysant la forme du signe de l’arbre qui est apparu avec Imaou, nous
trouvons que la forme suivante désigne un arbre mais étant entouré d’un
cadre par l’artiste égyptien, il a pris la forme suivante . Mais pour le palmier,
le tronc n’est pas très épais, il est long et les branches sont élevées, comme ils
sont figurés dans le dessin suivant: . Cette distinction est très flagrante sur les
scènes des jardins dessinés dans les tombeaux. A titre d’exemple, dans la
69
Keimer, L., sur un bas – reliefs en calcaire représentant la déesse dans le sycomore et déesse dans le
dattier, ASAE 29, (1929), p. 86. 70
Sethe, K., Urgeschichte und älteste religion der Agypter,Leipzig 1930, § 18,33; Kees, H. Götterglaube im
alten Ägypten, (Berlin, 1956), p. 86; Schott, S.,Untersuchungen zum ursprung der schrift,
(Wiesbaden, 1950), p. 118. 71
Wallert, I., Bezeichnete ima eine palmenart des alten Ägypten Deutsch Orientalistentag , (Göttingen, 1961)
, P. 383; Bruijning, F., The tree of the Herakleopolite nome, (London, 1922), p. 3 f. 72
Wallert, I., Die Palmen im Alten Ägypten, MÄS 1, (Berlin, 1962), p. 54- 62. 73
Pyr. 699 (c) (N). 74
Pyr. 699(M); 1723; 808(N). 75
C.T VI, 106h(blbo). 76
Pyr. 808a(pund M). 77
C.T VI, 160h(8H10x). 78
Pyr. 699c (T). 79
Urk. IV, 73. 80
Eb. 46.11. 81
Pap. Anstasi IV, 12.8. 82
Naville, E., Les quatre stèles orientées de musée de Merseille, (Lyon,1880), p. 8. 83
Naville, E., Das Aegyptische todtenbuch der XVIII bis XX dynastie aus verschiedenen urkunden, II, (Berlin,
1886), p. 146(bp). 84
Mariette, A., Dendérah : description générale du grand temple ,IV, (Paris, 1875), pl. 71. 85
Chassinat, E., Le temple d’Edfou, XI, (Le Caire, 1933), pl. 318.
10
chapelle funéraire de Nébamon où il y a dans le jardin une variété d’arbres et de
palmiers(86)
.
Citons encore, un autre exemple : dans la tombe d’Inini N°81 à Sheihk
Abd El-Gourna, à Thèbes, l’arbre (imA ) est mentionné dans la liste des arbres de
son jardin. Par précision, nous remarquons qu’il y a plusieurs formes d’arbres
désignés par le même déterminant comme ( nht). D’autre part, il y avait
plusieurs genres de palmiers comme( 70 bnrt )« qui signifie dattier
et également(87)
( 120 mAmA )» palmiers des Doum(88)
(Figure 11 ).
Mais nous trouvons que le mot imA n’a pas la figure du palmier dans
toutes les écritures hiéroglyphiques(89). L’ancien égyptien avait une précision
dans ses écritures des objets.
Donc, quel type d’arbre représente Ima ?
Pour répondre à cette question, nous trouvons trois points de vue :
1- Certains savants voient qu’il s’agit d’un sycomore car il était probablement
utilisé sur beaucoup de scènes des tombeaux. La déesse Hathor apparaît d’un
sycomore quand elle donne à boire et à manger au défunt ( figure 12 )(90)
. Ces
scènes sont accompagnées de textes qui montrent qu’elle est la dame de
sycomore. Par conséquent le sycomore appartient à «nht» non à «Imaou». En
plus, nous voyons qu’il y a, probablement, une relation entre la déesse Hathor en
tant que déesse du sycomore et son temple au sud de Memphis(91)
.
Mais il est à noter que ce signe est utilisé pour désigner tous les genres
des arbres et non seulement pour un sycomore.
2- Cet arbre est probablement un olivier. Selon Newberry l’olivier était déjà
connu en Égypte à l’époque protohistorique, et que cet arbre avait valu à la
partie nord-ouest du Delta sous le nom de « pays de l’olivier »(92)
. Il revient
peut-être au tableau des dépouilles où il y a un ensemble d’oliviers que les
égyptiens apportent de leurs dépouilles de guerre de l’ouest(93)
. Mais Imaou est
la capitale de troisième région, une des régions de la basse Égypte, depuis le
début de l’histoire. Alors, elle n’est pas la terre de TA Thnw « pays de l’olivier ».
Un autre élément appuie notre point de vue : Hathor était chargée de la
86
Silverman, D., P., Au cœur de l’egypte ancienne , (Paris, 2001), P. 72. 87
Manniche , L., An Ancient Egyptian Herbal, (London, 1989), P. 108- 109. 88
Dziobek, E., Das Grab des Ineni, Theben Nr. 81, (Mainz am Rhein, 1992), P. 61- 62. 89
Daressy, G., Une inscription D’archmoun et la Géographie du Nome Libyque, ASAE XVI, (Le
Caire, 1916), p. 236; Gauthier, H., op cit., p . 70. 90
Moftah, R., Die Urlate sykomore und andera, Erscheinungen der Hathor, ZÄS 92, (1965), p. 40- 47. 91
Breasted, J., H., Ancient Records of Egypt, Part I, (Chicago, 1906), p. 78. 92
Newberry, M. P. E., Ta Tehenu, Oliver-Land in Ancient Egypt , (1915), p. 97- 102. 93
Montet, P., op cit., P. 58, 64; Keimer, L., A propos d’une palette protohistorique en schiste conservée au
Musée du Caire, BIFAO 31, (Le Caire, 1931), p. 123.
11
protection de la région de l’ouest contre El-Tehnu(94). Elle répand la terreur
parmi les rebelles en Nubie(95).
3- Il s’agit, probablement d’une vigne parce que la région, sous l’administration
de Meten pendant la IVè dynastie, était connue par l’existence des raisins et de
sa production (96)
.
En outre, d’après le mythe de la destruction des êtres
humains, on a présenté le vin à la déesse Hathor afin d’apaiser sa soif de sang,
en la plongeant dans un sommeil. En buvant du vin, la déesse devient ivrogne,
et par conséquent elle ne pouvait pas tuer tous les êtres humains (97). On lui
consacre ainsi une fête religieuse annuelle qui se déroule à Imaou avec les
jarres du vin (98)
. Dans ce mythe, nous trouvons que le dieu Ra a donné l’épithète
de « iAmt » à Hathor. De plus, les déesses ; Hathor et Sekhmet sont devenues très
liées, surtout quand Hathor a pris la forme de Sekhmet(99)
. Et à l’époque de
Gerce- Romain, le nome a été renommée par la production du vin(100)
. Nous
trouvons aussi que le mot ( KAnw ), qui signifie une vigne, apparaît une fois
avec le déterminant ( ) et une autre fois ( )(101)
.
Le temple de Hathor à Imaou
Le temple de la dame d’ImAw, la maîtresse du château de la vache, appelé
aussi le château de « sxAt Hr », est pris comme désignation du temple local dont
Griffith a découvert l’enceinte à Kom El-Hisn (102); 116m de l’ouest à l’ouest, 64
m du nord au sud et dont la hauteur est 3,70m (Figure 13)(103)
.
Certains voient que ce temple revient au Moyen Empire, le prétexte en est
que xsw wr était aussi surnommé par le chef des prêtres du château de Hathor et
le surveillant de son temple(104)
où les rois présentaient des statuts pour être
proches de la déesse Hathor. Tel l’indique les monuments découverts dans la
région du temple : la statue de trois personnages, la tête du roi Amenemhat III,
la tombe du prêtre xsw wr, les blocs colossaux et les statuts du roi Ramsès II(105)
.
94
Brugsh, H., Dic. Geog., p.1064. 95
Perdu, O., op cit., p. 347. 96
Basta, M., Les monuments les plus importants dans la région de Sakara et Meet rahina , (Le Caire, 1978),
p.36. 97
Griffith, F., op.cit., p.78- 79. 98
Helck, W., op cit., p. 82- 83. 99
Erman, A., Die Littarture Der Aegypter. (translated) by Blackman, The Literature of the ancient
Egyptians, P. 47 ff. 100
J. Dümichen, op. Cit., pl. XXIX 101
Wb V, p. 107. 102
Griffith, F., op.cit., p. 78; Koefoed, P., Catalogue des bas – relief et peinture égyptienne, 1956, P. 44-45 103
Griffith,F., op cit., P.78 104
Silverman, D., op cit., p.146 ff; Manniche, op cit., p. 57- 73. 105
Leonard, A.& Coulson, W., Cities of the Delta, part 1, Naukratis, (ARCE 1981), p. 81.
12
D’autre part, à la dix-huitième année de règne du roi Chéchonq III, il a fait un
élargissement de ce temple (106)
.
Mais nous remarquons que ce temple revient à l’Ancien Empire. Nous
appuyons notre point de vue sur les fouilles de l’expédition de l’Université
d’Alexandrie, branche Damanhour, en Egypte. Dans cette expédition, on a
découvert des briques cuites mesurées de 40 x20 x10. Ces mesures sont les
mêmes des briques déjà utilisées dans l’Ancien et le Moyen empire. Cela a mené
à croire en l’existence des restes d’un ancien petit temple établi sur une couche
de cailloux et de sable grossier, transporté à ce lieu dans le désert(107)
.
Ce fait de transfert est considéré comme une rite de purification de la terre
avant l’établissement du temple (108)
. D’où, nous pouvons constater que le temple
est plus ancien que est la tombe de xsw wr. Il y a une autre épreuve affirme notre
point de vue: l’existence d’un sacerdoce pour cette déesse à l’Ancien Empire (109)
, à titre d’exemple, l’obtention de la femme de «Ti» de la cinquième dynastie
au titre de prêtresse de Hathor à Imaou(110)
.
D’ailleurs, il y a les deux linteaux de calcaire de sA - HtHr- nhy, dont un bloc
n°1971.17 existe à Boston et les trois autres n°162411,16249 et 162410 au
musée du Caire. Outre les quelques indications relatives à la vie religieuse
d’Imaou, données par ces linteaux, elles ont pour avantage direct les preuves
matérielles de l’existence d’une chapelle funéraire sur le site de Kom El
Hisn(111)
.
D’autre part, il y a le décret royal de Weserkaf de la cinquième dynastie
qui organise le travail des prêtres de Hathor à l’intérieur de l’un des temples(112)
.
Il est à ajouter que les prêtres et les prêtresses de cette déesse étaient
répandus dans plusieurs lieux dans l’Ancien Empire(113)
. A la preuve en est
l’option de l’épouse de « Ti » sur le titre de la prêtresse d’Imaou(114)
. Également,
les fouilles du centre américain des recherches en Égypte, ont démontré que
cette région revient à l’Ancien Empire d’après les monuments qu’ils ont trouvé :
outils en pierre et tampons(115)
. Il est prévu qu’on va découvrir d’autres
106
Chassinat, E., Textes provenant du Sérapéum de Memphis , Rec. Trav. XXII, (Paris, 1900), P. 9- 11;
Gauthier, H., Les rois Chéchanq, BIFAO 11, (1911), p. 209 ff; Helck, W., LÄ III, Kom el-Hisn, 1100-1101. 107
AL-Shariff, H., Al-Ensaniat, Journal of Faculty of Arts, Alexandria Uni., Damanhour Branch, Vol. XI, 2002,
p. 23 108
Bonnet, H., Reallexikon der agyptischen Religiongischichte, (Berlin, 1952) ,S. 263 f. 109
Allam, Sh., op. cit., p. 90. 110
Steindorf, G., op. cit., taf. 52. 111
Simpson, The Lintels of Si- Hathor- Neh in Boston and Cario, BdE 24, (1972), p. 124. 112
Breasted, J. H., Ancient Records of Egypt, part I, (London, 1988), p. 102. 113
Urk IV, 323, 5; 324 ,1 114
Galvin, M., The prêtresses of Hathor in the old kingdom and the 1st intermediate period, (Michigan USA
1981), p. 98ff. 115
Voir: Wenke, R.& Buck, P.& Hamroush, A.& Kobusiewicz, M.& Kroeper, K., Kom el-Hisn: Excavation of
an kingdom settement in the Egyptian Delta, JARCE XXV, (1988), p. 5- 34.
13
monuments qui vont mettre en lumière l’existence de ces prêtres à Imaou.
D’autres découvertes pourront s’effectuer dans ce leiu.
Conclusion
De tout ce qui précède, nous pouvons dégager que l’adoration de Hathor
existait depuis l’Ancien Empire ou au moins depuis la cinquième dynastie. D’où
son temple qui revient à l’Ancien Empire.
Il est à signaler que Nht désigne arbre et dattier en même temps, mais
Imaou n’est pas apparu sous la forme d’un dattier. Le titre de Hathor à Kom El-
Hisn « HtHr pr nb(t) imAw» désigne château de Hathor, maîtresse des arbres
d’ImAw. . Par conséquent Hathor est la femme d’arbre d’Imaou.
D’autre part, Hathor a été adoré dans cette région sous plusieurs épithètes:
vache, arbre et maîtresse de danse, de musique et de chant, cela donne
l’impression que cette région était l’un des centres les plus importants de son
adoration.
Ajoutons aussi que le nom ImAw quand il est suivi du nom de Hathor est
toujours mentionné au pluriel, tandis que nht est au singulier. Cela montre
que la région d’ImAw est plein d’arbres.
Pour la détermination du genre d’Imaou, il y a trois points de vues : vigne,
olivier et sycomore. A notre avis, il s’agit plutôt d’une vigne, et cela revient à la
réputation de l’agriculture de vigne pendant la quatrième dynastie et dans les
deux époques : polémique et romaine.
14
Figure 1
Carte de la Basse Égypte
Vernus,P.&Yoyotte,J., Les Pharaons, Paris 1988,Les cartes "1"
Figure 2
Silverman,D.,The tomb chamber of hsw-wr the elder : the inscribed matériel
at Kom el – Hisn , ARCE 1988,Pl.9
15
Figure 3
statue de trois personnages
du roi Amenemhat premier, la déesse Hathor et la déesse local
Evers,H.,Staat aus Stein ,I, Munchen 1929 ,Pls.99,100
Figure 4
la tête d’une statut du roi Amenemhat III
Evers,H.,op cit.,Pl.101
16
Figure 5
blocs colossaux à l’époque du roi Ramsès II
Griffith ,F.,Egyptological Notes from Naukratis and the Nieghbourhood,in Naukratis , II
,London 1888,P.78
Figure 6
le fragment de statue n°16.580.15 au musée de Brooklyn
De Meulenaere,H.,Cultes et sacerdoces à Imaou ( Kom El Hisn ) au temps des dynastie
Saite et perse, BIFAO 62 , P.161 ,Pl.XXVII
17
Figure 7
bas-relief dans le musée Hanovre Figure 9
Keimer,L., sur un bas – reliefs en calcaire bas-relief au musée du Caire représentant la déesse dans le sycomore et Keimer,L.,op cit.,Pl.1
déesse dans le dattier , ASAE 29,1929,P.86
Figure 8
bas-relief du musée de Berlin
Keimer,L.,op cit.,P.86
18
Figure 10
bas-relief au musée de Munch
Keimer,L.,op cit.,Pl.II
Figure 11
liste des arbres de jardin Inini
Dziobek, E.,Das Grab des Ineni, Theben Nr. 81,Mainz am Rhein 1992,P.61-62



















![Saillance visuelle des maillages 3D par patches locaux adaptatifs [Anass Nouri - Christophe Charrier - Olivier Lézoray] (Conférence Reims-Image, 2014, France)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632364ad48d448ffa006a732/saillance-visuelle-des-maillages-3d-par-patches-locaux-adaptatifs-anass-nouri-.jpg)