Regards sur la recherche en interprétation de conférence
Transcript of Regards sur la recherche en interprétation de conférence
Daniel Gile
Regards sur la recherche en
interprétation de conférence
PRESSES UNIVERSITAIRES DE LILLE
© Presses Universitaires de Lille, 1995
En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage sans autorisation, de l'éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de Copie.
(6 bis, rue Gabriel Laumain - 75010 Paris)
ISBN 2-85939-470-2 / ISSN 1242-4625
introduction
Dans sa progression vers l'investigation scientifique, la réflexion sur l'interprétation de conférence a suivi depuis sa naissance il y a une quarantaine d'années un chemin tortueux. Issue de la pratique, et non pas d'une discipline scientifique mère, elle a pendant longtemps été menée par des personnalités fortes et des intuitions dominantes davantage que par l'effet cumulatif des résultats d'une recherche au sens plus scientifique. Par ailleurs, cette réflexion était souvent localisée, avec une communication en pointillé entre les protagonistes, et une absence marquée d'axes de progression bien définis.
Le tableau résultant est une mosaïque de travaux, de centres, de chercheurs individuels, de circuits de communication partiels, d'influences. Dans un important article de D. Gerver (1976), ainsi que dans plusieurs thèses soutenues depuis les années 70, on trouve des synthèses partielles des travaux réalisés sur l'interprétation, mais aucune tentative d'analyse globale de la situation ne semble avoir été entreprise jusqu'ici.
Le présent ouvrage se place sur cette toile de fond. Il essaie de faire une synthèse des principales tendances passées et présentes en matière de recherche sur l'interprétation, et, sur la base d'une réflexion analytique, tourne son regard vers l'avenir avec quelques propositions.
Ce livre se compose de quatre parties : la présentation d'un cadre d'analyse général (chapitre 1), une analyse 'historique' (chapitres 2 et 3), cinq présentations thématiques (chapitres 4, 5, 6, 7 et 8), et une réflexion méthodologique et stratégique' (chapitre 9).
Le chapitre 1 propose un cadre d'analyse à travers une grille d'observation qui classe en plusieurs catégories les auteurs de
DANIEL GILE
publications et chercheurs, ainsi que les types de textes et ; démarches de recherche qui se sont manifestés jusqu'ici dans le domaine de l'interprétation de conférence.
Les chapitrés 2 et 3 sont consacrés à un historique de l'évolution de la réflexion sur l'interprétation. Le chapitre 2 retrace en grandes lignes l'histoire de la recherche depuis les-années 50 et jusqu'au début de la période de renouveau qui a pris naissance vers le milieu des années 80. Le chapitre 3 analyse cette période, dont le mouvement se poursuit actuellement.
Les cinq chapitres suivants abordent successivement cinq thèmes que nous considérons comme importants dans et pour la recherche sur l'interprétation, et que nous avons choisis comme vecteurs pour quelques idées centrales. Au chapitre 4, nous présentons nos modèles d'Efforts, outils de recherche et d'enseignement pour l'analyse des difficultés de l'interprétation, qui illustrent bien la nécessité d'un travail interdisciplinaire dans certains secteurs d'investigation, avec d'importantes questions posées à la psychologie cognitive et à la psycholinguistique. En revanche, le chapitre 5, qui analyse les stratégies et tactiques de l'interprète, est construit à partir d'une observation de la pratique sans l'apport d'éléments de connaissance extérieurs. Il illustre à notre sens la possibilité d'arriver à des résultats non triviaux par une démarche naturaliste (d'observation sur le terrain sans manipulations expérimentales), donc accessible à des praticiens ne disposant pas d'un bagage théorique. Le chapitre 6 aborde le thème de la qualité du travail, et montre que, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sujet essentiel a pendant longtemps été délaissé par les chercheurs, pour être enfin attaqué de front depuis quelques années seulement. Le chapitre 7 traite de la formation, principale application de la recherche sur l'interprétation et principal environnement fournisseur de chercheurs, et met en relief l'absence remarquable d'une véritable recherche y afférant. Enfin, le chapitre 8, dernier de cette section thématique, aborde les questions linguistiques, longtemps rejetées par les chercheurs en interprétation, et tente de démontrer leur pertinence, notamment en matière de formation.
Le neuvième et dernier chapitre analyse sur la base des chapitres précédents des questions d'ordre méthodologique, et propose des strategieß pour l'avenir.
Soulignons que ce livre n'est pas un panorama de la recherche sur l'interprétation, mais une analyse de cette recherche. Il ne saurait être exhaustif, d'une part en raison de difficultés d'accès à des textes, notamment ceux provenant des
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 9
ex-« pays de l'Est », et d'autre part en raison de la rapidité de la production actuelle des publications sur l'interprétation. On pourra d'ailleurs suivre cette évolution et disposer ainsi des éléments bibliographiques les plus récents à travers la revue triestine The Interpreters Newsletter, qui paraît en moyenne une fois par an, et à travers le IRTIN Bulletin, qui est préparé deux fois par an à Paris. Dans cet ouvrage, nous nous concentrons sur les tendances de fond, en indiquant des références qui permettront au lecteur désireux de mieux connaître les travaux dans des domaines particuliers et de trouver par ce biais des faits et chiffres plus précis. La présentation des travaux est plus détaillée dans les parties thématiques, ainsi que dans la partie historique portant sur les travaux des chercheurs scientifiques pendant les années 60 et 70, étant donné leur importance dans l'évolution qui a conduit à la « période des praticiens » et l'accès plus difficile à ces publications.
Notre vœu est que ce livre puisse aider le lecteur à mieux connaître et comprendre la situation et la dynamique passées et présentes de la recherche sur l'interprétation de conférence, et que, ayant montré l'étendue des possibilités de progression qui s'offrent, i l encourage de jeunes praticiens, ainsi que d'éventuels chercheurs issus d'autres disciplines qui le liraient, à se lancer à leur tour dans l'exploration de l'interprétation.
Chapitre 1
La recherche sur l'interprétation : un cadre général
Le présent chapitre sert d'introduction à l'analyse de l'activité de recherche sur l'interprétation et aux considérations méthodologiques qui sont développées dans les chapitres suivants. Il présente un cadre général d'observation de la recherche en interprétation, en précisant quelques caractéristiques de l'activité d'interprétation de conférence, quelques aspects problématiques de la recherche sur l'interprétation, et quelques traits marquant le profil des chercheurs, et introduit quelques concepts désignant les types de textes et démarches de recherche qui sont utilisés dans les analyses subséquentes.
1. L ^interprétation de conférence : rappels
Pour mieux situer l'objet des activités de recherche présentées et analysées dans ce livre, i l apparaît intéressant de rappeler les principales caractéristiques de l'interprétation de conférence ainsi que certains traits pertinents des professionnels qui l'exercent.
L'interprétation de conférence est une activité récente, qui est née entre les deux guerres mais qui a véritablement pris son essor après la deuxième guerre mondiale (Herbert 1978). Si elle concernait pendant les premières années les seules conférences internationales, et notamment les conférences tenues au sein des organisations internationales, elle a évolué depuis pour toucher de nombreux types de réunions interlinguistiques : conférences, colloques, séminaires, visites de personnalités, émissions de radio et de télévision, etc., qui se dis-
12 DANIEL GILE
tinguen! non seulement par leur thème, mais aussi par les flux d'information qui y interviennent : quantité et technicité de l'information transmise, échanges ou flux unidirectionnels, chronologie des flux, etc. (voir une typologie des réunions auxquelles interviennent les interprètes de conférence dans Gile 1989b). L'on peut considérer qu'à l'heure actuelle, l'interprétation de conférence se distingue des autres types d'interprétation de langue par deux aspects. Par ses modalités fondamentales, qui sont la simultanée, la consécutive et la chuchotée (voir ci-dessous), et par le niveau de la prestation : en effet, contrairement aux autres formes d'interprétation, telles que l'interprétation dite 'de liaison', l'interprétation 'd'affaires' et l'interprétation 'communautaire' ('community interpreting' ou 'dialogue interpreting' en anglais), l'interprétation de conférence correspond en principe à la substitution d'un discours de haut niveau formel et conceptuel en langue de départ par un discours en langue d'arrivée qui le restitue dans son intégralité au même haut niveau.
La simultanée est un mode d'interprétation où l'interprète, assis dans une 'cabine', écoute l'orateur à travers un casque' et restitue son discours dans le microphone en même temps, avec un décalage moyen de l'ordre de une à quelques secondes entre le moment de la réception de l'information et le moment de sa restitution. En consécutive, l'interprète est assis dans la même salle que l'orateur. Ce dernier prononce son discours ou un segment de discours d'au moins quelques phrases pendant que l'interprète l'écoute, en prenant des notes le cas échéant. Puis l'orateur s'interrompt pour permettre à l'interprète de traduire son discours en langue d'arrivée ; l'interprétation terminée, l'orateur reprend son discours, et ainsi de suite. La 'vraie' consécutive se distingue de l'interprétation de liaison, qui est la forme d'interprétation la plus générale, par le niveau théoriquement très élevé de la qualité du discours restitué et par la longueur des segments que traite l'interprète ; en général plusieurs minutes à quelque dix minutes, et parfois plus, alors que dans l'interprétation de liaison, la traduction se fait quasiment phrase par phrase. Enfin, la chuchotée est une simultanée sans cabine : l'interprète est assis à côté de son 'client' et lui chuchote à l'oreille la traduction d'un discours fait en salle à mesure qu'il l'entend.
Dans la plupart des pays, l'interprétation de conférence n'est pas réglementée. Il arrive qu'elle soit pratiquée par des traducteurs* par des interprètes de,liaison, mais aussi pa^ des diplomates et autres interprètes occasionnels, surtout en ce qui
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 13
concerne la consécutive, surtout dans les langues rares' pour lesquelles i l n'existe pas un marché d'interprétation de conférence régulier. En l'absence d'un contrôle réglementaire de ces activités, i l est difficile d'évaluer l'importance quantitative de cette interprétation de conférence occasionnelle ou d'amateurs'. En revanche, on estime à quelques milliers (probablement moins de dix mille) le nombre d'interprètes de conférence professionnels se définissant comme tels. La plupart d'entre eux ont leur domicile professionnel dans les pays européens, surtout en France, en Suisse, en Belgique et dans d'autres pays d'Europe occidentale, mais i l en existe aussi un petit nombre, de l'ordre de quelques centaines par région, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et dans le Pacifique-sud (où ils ne sont que quelques dizaines). Les interprètes de conférence professionnels ont également constitué en 1953 un organisme professionnel international, l'AIIC (Association internationale des interprètes de conférence), qui en regroupe quelque 3 000, et qui a contribué de manière déterminante à modeler l'image de la profession dès les années cinquante, à lui donner une déontologie, et à constituer des programmes de formation dans des écoles professionnelles.
Ces écoles, par lesquelles passent actuellement la majorité des candidats à l'interprétation de conférence, sont des établissements d'enseignement supérieur, qui sont le plus souvent rattachés à une université. Il s'agit d'écoles de traduction et d'interprétation, mais par commodité, nous les désignerons comme « écoles d'interprétation », dans la mesure où, sauf indication contraire explicite, nous nous référons dans cet ouvrage à la seule interprétation. Notons aussi que contrairement à la traduction, qui est le plus souvent enseignée dès le premier cycle universitaire, l'interprétation est généralement enseignée en troisième cycle (cinquième ou sixième année d'études supérieures — voir Ch. 7).
Les écoles d'interprétation sont très sélectives, et ne décernent le diplôme qu'aux candidats ayant atteint une compétence opérationnelle, c'est-à-dire ceux qui sont en mesure d'interpréter à titre professionnel dès l'obtention du diplôme. L'expérience montre que la proportion des candidats qui, une fois admis dans les écoles après sélection, parviennent à ce niveau, est très faible, souvent inférieure à 25 %. Si upe partie non négligeable de ces échecs est attribuable à une maîtrise insuffisante des langues de travail, i l semble indubitable à la communauté dés enseignants que l'interprétation de conférence requiert des aptitudes intellectuelles et psychologiques
14 DANIEL GILE
particulières, qui n'ont pas encore été clairement identifiées scientifiquement, et que l'on ne trouve que chez une faible proportion des candidats (voir Ch. 7).
La recherche sur l'interprétation de conférence porte donc sur une activité pratiquée par une population de très petite taille, impliquant des mécanismes linguistiques et cognitifs peu connus à ce jour, qui sont apparemment accessibles à une fraction seulement de la population bilingue ou multilingue.
2. L'interprétation de conférence comme objet de recherche
2.1 La recherche sur l'interprétation dans son cadre propre
2.1.1 Traduction et interprétation : quelques différences
L'interprétation se distingue de la traduction écrite par plusieurs aspects importants :
a. L'oralité
La différence la plus évidente - entre les deux types de Traduction (le T majuscule identifie l'hyperonyme recouvrant la traduction écrite et l'interprétation) tient au caractère oral de l'interprétation, dont la signification va bien au-delà de la nature du support physique de l'énoncé : elle implique aussi des normes linguistiques différentes de celles de l'écrit, ainsi qu'une participation de la prosodie et d'éléments non verbaux que l'on ne trouve pas dans la traduction écrite.
b. Les contraintes temporelles
L'interprétation se déroule soit « en temps réel », en simultanée, soit en temps « quasi-réel », en consécutive. Ces contraintes ont des incidences pratiques importantes. En effet, elles privent l'interprète des possibilités tactiques d'information et de documentation dont disposent les traducteurs en cours de traduction, que ce soit par voie de documents, écrits ou sonores ou par consultation de spécialistes, et l'obligent à une préparation maximale avant même de commencer l'interprétation proprement dite (voir Ch. 5). Par ailleurs, elles sollicitent lourdement son appareil cognitif et sont à notre avis les principales responsables de la difficulté d'interpréter, d'une part en raison du rythme imposé de compréhension, de production et de gestion des décisions qu'elles imposent, et d'autre part en
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 15
raison de la simultanéité des opérations qu'elles - impliquent, avec nécessité de partager l'attention (Ch. 4).
c. La situation de communication
L'interprétation se distingue aussi de la traduction au regard de certains autres paramètres importants de la situation de communication. Comme i l est indiqué ci-dessus, contrairement à la traduction, où la communication se déroule en différé' par rapport à la production de l'auteur, et où les réactions des lecteurs ne peuvent intervenir que bien plus tard, en interprétation, la communication est immédiate, avec tout ce que cela implique en termes d'interaction entre orateurs, délégués et interprètes.
2.1.2 Champs d'investigation
On peut définir plusieurs champs d'investigation de l'interprétation à partir du modèle de communication suivant (Fig. 1) :
Orateur —+-Déléj jués écoutant la Langue Source
Interprète -—> -Délégués écoutant la Langue Cible
Client/Recruteur
Figure 1 : Schéma de la communication avec interprétation en réunion multilingue
En amont, i l est intéressant d'étudier les situations où l'on fait appel à l'interprétation : types de réunions, types de 'clients' (les donneurs d'ouvrage), ce qu'ils attendent de l'interprétation, considérations économiques, procédures de recrutement, contraintes organisationnelles, types et comportements des orateurs, notamment vis-à-vis des participants qui les écoutent à travers les interprètes et vis-à-vis des interprètes eux-mêmes.
En aval, i l importe de connaître les réactions des 'délégués' (les participants qui écoutent les orateurs, soit en langue de départ, soit en langue d'arrivée, à travers l'interprétation), car c'est pour eux que travaillent les interprètes. Un aspect a priori essentiel de la recherche est l'étude de la nature et des variables déterminant la qualité de l'interprétation. Comment les
16 DANIEL GILE
délégués évaluent-ils la qualité du travail, en fonction de quels critères ? Leurs appréciations varient-elles d'un individu à l'autre, d'un groupe à l'autre, dans quelle mesure et de quelle manière ? Quelle est la corrélation entre leur évaluation et une éventuelle mesure objective' des différentes variables déterminant une qualité' de l'interprétation ? L'état de la recherche sur la qualité du travail est présentée au Ch. 6.
Par ailleurs, comme i l est expliqué au Ch. 4, l'interprétation est souvent associée à des pertes d'information pour les délégués écoutant en langue cible du fait des erreurs et omissions de l'interprète. Il serait intéressant non seulement d'étudier la nature et l'étendue de ces pertes, mais aussi de les comparer à celles intervenant dans l'écoute directe de l'orateur par les délégués ne passant pas par l'interprétation. En effet, ces pertes peuvent différer sensiblement, d'où des incidences que l'on ne sait déterminer à l'avance sur le rendement' du discours pour les délégués écoutant en langue cible. A notre connaissance, i l n'existe aucune recherche là-dessus à ce jour, de même que nous ne connaissons pas de recherches visant à déterminer les pertes intervenant dans l'écoute directe de l'orateur par les délégués.
En réalité, l'essentiel des investigations réalisées jusqu'à présent se situent non pas en amont ou en aval de l'interprétation, mais dans le processus central. En effet, c'est le processus qui est le plus spectaculaire et le plus spécifique des aspects de l'interprétation. Contrairement à la traduction, dont on imagine, à tort comme le soulignent de manière répétée les spécialistes, qu'il suffit de connaître les langues pour pouvoir la pratiquer, l'interprétation recèle des « mystères » qui frappent dès le premier abord. En consécutive, c'est ce qui apparaît aux yeux de l'observateur extérieur comme un exploit de mémoire ou de prise de notes. En simultanée, plus spectaculaire encore, la i< capacité d'écouter dans une langue et de parler dans une autre en même temps ». Les investigateurs ont depuis toujours cherché à comprendre les mécanismes mentaux qui rendent possible l'interprétation.
Les champs d'investigation en amont et en aval du processus relèvent en grande partie de l'économie, de la sociologie, de la théorie de la communication. L'étude du processus intéresse d'autres disciplines, notamment la psychologie cognitive, la neurophysiologie, la psycholinguistique et d'autres branches de la linguistique, ou plus généralement l'ensemble des sciences cognitives.
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 17
En effet, le processus central de Finterprétation englobe l'écoute, le traitement et la restitution du discours original en langue d'arrivée, avec des opérations de décodage linguistique, de mise en oeuvre de différents types de mémoire, de production linguistique. Ce processus implique un partage de l'attention, ainsi que des prises de décisions avec gestion de risques et gestion de difficultés. En consécutive, i l est intéressant d'étudier les mécanismes techniques, en particulier les notes prises lors de l'écoute, ainsi que les processus mentaux qui permettent à l'interprète de restituer dans son intégralité un discours de plusieurs minutes qu'il n'a entendu qu'une seule fois. On se penchera aussi sur l'effet des variables caractérisant le discours de l'orateur (type, composition informationnelle, langue, débit, prosodie, indices non verbaux) sur les tactiques et la performance de l'interprète. De même, on peut chercher à déterminer l'influence, qu'exerce sur sa prestation l'environnent extérieur (espace, son, éclairage, température, qualité de l'air, vue sur l'orateur, vue sur l'écran).
L'acquisition de la capacité de réagir de manière professionnelle à ces stimulus et contraintes appelle une étude des règles professionnelle des interprètes, au niveau pratique et au niveau déontologique, ainsi que des investigations sur l'évolution dans le temps des étudiants ou bilingues vers la compétence d'interprète débutant, puis d'interprète confirmé. On peut également s'intéresser aux aspects sociologiques et psychologiques de la profession : quelle est l'image qu'ont d'elle les praticiens eux-mêmes ? Les clients organisateurs de conférences ? Les délégués, utilisateurs directs des services d'interprétation ? Quel est le statut des interprètes dans la société ? Quelle est leur attitude à l'égard des orateurs qu'ils interprètent ? Quels sont les effets à long terme de la pratique d'un métier où ils ne font que répéter' (en réalité — interpréter) les idées des autres sans avoir la possibilité d'être créatifs autrement qu'en tant qu'exécutants ? Comment le fait de parler a la première personne' au nom de personnalités de tout premier plan dans les domaines politique, scientifique, artistique ou technologique influe-t-il sur l'image qu'ils se font d'eux-mêmes ? Quelles sont l'étendue et la structure des connaissances qu'ils acquièrent au cours de leurs pérégrinations à travers les différentes sphères de la connaissance humaine au fil des conférences ?
Cette liste n'est certes pas limitative, mais elle suffit à montrer la variété des approches possibles. En fait, toutes ces questions ont déjà été posées par les interprètes eux-mêmes, et ont
18 DANIEL GILE
engendré des réflexions nombreuses, dont certaines ont été consignées par écrit, de manière intuitive et personnelle, dans les livres et articles écrits sur l'interprétation depuis les années 50. En revanche, en matière de recherche, comme le montre l'analyse dans les chapitres suivants, ce sont essentiellement les processus d'interprétation eux-mêmes qui ont été étudiés et qui le sont actuellement.
2.2 La recherche sur l'interprétation comme cas particulier de communication verbale
Au-delà d'une recherche interpréto-centrique, l'interprétation peut être considérée comme un cas singulier d'activité de communication à dominante linguistique. C'est ce que cherche à montrer à travers quelques exemples un article de D. Gile (1990e) sur le rôle « proligère » de la traduction et de l'interprétation.
Dans cette optique, on notera que l'exigence de fidélité oblige l'interprète et le traducteur à suivre de très près la pensée de l'orateur ou de l'auteur telle qu'elle s'exprime dans son discours, c'est-à-dire à le « comprendre », comme le soulignent à satiété tous les praticiens et les enseignants de l'interprétation et de la traduction. Malheureusement, pour l'instant, ils ne définissent et ne décrivent pas avec précision la nature et l'étendue de cette « compréhension ». En fait, l'obligation à laquelle sont soumis les interprètes de reformuler intégralement une pensée immédiatement après son énonciation initiale par l'orateur est potentiellement très intéressante pour quiconque cherche à étudier la compréhension chez l'homme, dans la mesure où l'interprétation révèle, surtout en consécutive, des phénomènes de compréhension et d'incompréhension qui sont difficilement observables dans la plupart des autres circonstances naturelles' (par opposition à des situations expérimentales en laboratoire).
Dans le cas de l'interprétation des discours spécialisés s'ajoute le problème posé par le déficit en connaissances de l'interprète par rapport à l'orateur et au délégué destinataire du message. C'est là une occasion d'étudier les mécanismes de compréhension des exposés spécialisés par des non spécialistes (voir à ce sujet Gile 1986c).
De telles études de la compréhension peuvent conduire à quelques nouveaux concepts. Ainsi, la pseudo-compréhension', concept qui s'est cristallisé lors d'enquêtes auprès d'interprètes
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 19
sur le degré de compréhension qu'ils estimaient avoir atteint par rapport à différents discours. La pseudo-compréhension', sentiment de comprendre ne correspondant pas à une réelle assimilation des idées, est entre autres fonction de la familiarité de l'auditeur ou du lecteur avec la structure linguistique qui véhicule le message. Le seuil de confort' est un niveau de compréhension suffisant pour que le récepteur n'éprouve pas une gêne subjective liée au sentiment de «ne pas comprendre » ; ce seuil lui permet de satisfaire les besoins fonctionnels éventuellement liés au message du locuteur, même s'il ne saisit qu'une fraction du message. D. Gile (1986d) évoque le cas des étrangers vivant au Japon qui auraient, par un mécanisme psychologique inexploré, développé ' une tolérance à l'incompréhension associée à un seuil de confort qui leur donne l'impression erronée de « tout comprendre » en écoutant les émissions japonaises de radio et de télévision, alors qu'un examen plus objectif permet de constater qu'ils ne saisissent qu'une partie du discours. La pseudo-compréhension' est corrélée avec le seuil de confort, mais ce dernier est fonction d'un besoin fonctionnel, alors que la première est définie dans l'absolu. Nous ne connaissons pas d'études sur ces types de compréhension, et a fortiori, aucune exploitation des possibilités offertes par l'interprétation ne semble avoir été réalisée à l'exception d'une étude de M . Dillinger (1989).
De même, les contraintes inhérentes à l'interprétation sollicitent lourdement la capacité de production linguistique des praticiens et permettent l'observation de différents phénomènes, tels que les hésitations (Goldman-Eisler 1980, Ovaska 1987) ou les interférences linguistiques.
Enfin, pour les neurolinguistes, l'interprétation présente un champ d'investigation potentiellement intéressant au regard de la latéralisation des fonctions linguistiques. Cette piste commence d'ailleurs à être exploitée (Ch. 3). L'interprétation peut aussi intéresser les psychologues cogniticiens en tant que cas singulier du partage de l'attention (voir Ch. 4).
2.3 Les effets sociologiques et culturels de l'interprétation
L'incidence de la traduction écrite sur les transferts culturels est capitale, puisque la traducticn a permis l'importation et l'exportation d'une importante partie de la production de connaissances et d'idées à travers le monde entier. A une échelle bien plus modeste, l'interprétation a peut-être des effets
20 DANIEL GILE
qui sont passés jusqu'ici inaperçus et qu'il pourrait être intéressant d'étudier de près.
L'interprétation permet à des personnes appartenant à des cultures différentes et ne parlant pas la même langue de se rencontrer et de dialoguer face à face. Au début du siècle, les interprètes étaient relativement peu nombreux, et l'essentiel des échanges interlinguistiques se faisaient soit par voie écrite, soit à travers des personnes qui s'étaient préalablement familiarisées, en raison des circonstances de leur vie ou à la suite d'une démarche volontariste, avec une langue et une culture étrangère. Depuis les années 60, l'interprétation de conférence s'est banalisée et touche un public de plus en plus grand. Le fait que des contacts interculturels et interlinguistiques directs soient maintenant à la portée de personnes qui n'ont pas fait l'effort d'apprendre une langue et une culture étrangères et qui a priori restent bien à l'intérieur de leur propre culture a-t-il des effets sur l'image qu'ils ont de la culture étrangère, voire sur leur comportement à l'intérieur de leur propre culture ? Les comportements s'internationalisent-ils davantage que par le passé ? Dans quels secteurs ? Dans quel sens ? Ces effets sont-ils grandement accélérés du fait de la rapidité des échanges en interprétation par rapport à la traduction ? Ou l'interprétation reste-t-elle marginale dans ses effets étant donné le petit nombre de personnes qu'elle concerne, excepté dans l'interprétation pour les média ? Il s'agit là d'un vaste champ de recherche qui pour le moment reste totalement inexploré.
3. Auteurs et chercheurs dans les publications sur l'interprétation
3.1 Les interprètes-chercheurs
Pour mieux comprendre les mécanismes et l'évolution de la recherche sur l'interprétation, i l est important de connaître l'identité et les traits caractéristiques de ses acteurs, qui se démarquent sensiblement des caractéristiques que l'on trouve dans les communautés de chercheurs dans d'autres disciplines.
Il convient de distinguer en premier lieu les chercheurs interprètes des chercheurs extérieurs'. En effet, contrairement à la situation dans la plupart des autres disciplines, à de rares exceptions près, la recherche sur l'interprétation est menée par des interprètes praticiens, et non pas par des chercheurs pro-
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 21
fessionnels'. Pour emprunter l'expression de D. Seleskovitch, ancienne directrice de l'Ecole Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs (ESIT) de Paris, «les poissons deviennent ichtyolo-gues », ce qui ne manque d'ailleurs pas de poser des problèmes :
3.1.1 La disponibilité
La pratique de l'interprétation est un travail irrégulier et saisonnier, qui peut demander de nombreux déplacements. Les praticiens ne disposent donc pas de plages de temps régulières qu'ils pourraient consacrer à la recherche.
Les enseignants dans les écoles professionnelles, qui sont a priori plus motivés que leurs collègues praticiens n'exerçant pas une activité de formation, enseignent en sus de leurs journées d'interprétation ordinaires. En effet, un consensus existant au sein de la profession et officialisé par l'AIIC à travers sa Commission de la formation veut que la formation à la profession soit assurée par des professionnels en exercice (voir Ch. 7). Cette règle est suivie dans les principales écoles, où la quasi-totalité du personnel enseignant se compose d'interprètes professionnels qui sont chargés d'un ou deux cours par semaine. En fait, leur activité professionnelle limite déjà leur disponibilité pour la formation, qui est insuffisamment rémunérée pour qu'ils puissent renoncer à des conférences pour assurer leurs cours régulièrement. Dans la pratique, cela implique des annulations de cours et des rattrapages' ultérieurs. En outre, la prestation en conférence demande une préparation à domicile ou en bibliothèque, et en saison, c'est-à-dire essentiellement à l'automne et au printemps, les interprètes-enseignants ' sont souvent occupés en cabine, en préparation ou en classe d'interprétation 10 ou 12 heures par jour. Si l'enseignement, essentiellement pratique, peut se faire avec un minimum de préparation, la recherche, elle, demande un temps considérable. De toute évidence, i l faut être fortement motivé pour se ménager le temps nécessaire à la recherche dans de telles conditions.
3.1.2 La motivation
Actuellement, la quasi-totalité des interprètes-chercheurs sont interprètes d'abord, et chercheurs accessoirement. Il n'existe d'ailleurs pas de véritable cadre institutionnel pour la recherche en interprétation, bien que certaines écoles l'encou-
22 DANIEL GILE
ragent, moralement surtout (notons tout particulièrement l'école de Trieste, dont l'activité de recherche est importante — voir Ch. 3 et 9).
Pour les interprètes, la recherche n'apporte donc pas une rémunération financière. Bien au contraire, dans la plupart des cas, ils doivent la financer eux-mêmes : ordinateurs, équipements d'enregistrement et autres, papeterie, déplacements, frais d'inscription à des conférences traductologiques ne sont pris en charge par les écoles que rarement et partiellement.
Sur le plan universitaire, la recherche permet l'obtention d'un titre de M.A. ou de doctorat, parfois (mais pas toujours) nécessaire à l'obtention d'un poste universitaire, mais une fois ce ritre acquis, elle ne joue pas dans l'avancement. En effet, la plupart des écoles d'interprétation se considèrent comme des écoles professionnelles dont la vocation est de former des praticiens à travers un enseignement pratique, et la règle « publish or perish » ne s'applique pas (voir Ch. 9).
Précisons tout de même que dans certaines écoles, notamment ' à Heidelberg, à Trieste et à Vienne, les étudiants en interprétation ont l'obligation de préparer des mémoires de fin d'études pour obtenir leur diplôme, et que certains réalisent à cette occasion de véritables projets de recherche, qui peuvent donner lieu à des publications (voir par exemple Gran et Taylor 1990 ainsi que les articles parus dans The Interpreters Newsletter).
Sur le plan sociologique, l'activité de recherche de l'interprète n'offre pas non plus de récompenses très motivantes. En effet, la communauté des interprètes dans son ensemble ne voit pas la recherche d'un œil très favorable (voir Ch. 2).
Il reste donc la motivation que donne le plaisir intellectuel accompagnant l'observation, la réflexion, et la création qu'implique la recherche. Toutefois, l'expérience montre que cette motivation ne résiste pas longtemps non plus dans la plupart des cas au rythme de travail du praticien. C'est probablement la principale raison pour laquelle de nombreux travaux, notamment ceux réalisés pour l'obtention d'un titre universitaire tel qu'un M.A. ou un doctorat, sont restés sans lendemain. Les interprètes dont l'activité de recherche se poursuit au-delà sont peu nombreux : une poignée de praticiens qui sont attirés par la recherche, et quelques chercheurs qui ont la chance d'être encadrés dans un environnement favorable. A l'ESIT à Paris, la personnalité de D. Seleskovitch a motivé un petit groupe de praticiens pendant de nombreuses années, jusque vers le milieu des années 80. Dans le cas le plus général, toute-
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRETATION DE CONFÉRENCE 23
fois, les conditions extérieures ne sont pas favorables au maintien de la motivation.
3.13 La formation à la recherche
Des problèmes d'un tout autre genre se posent du côté de la formation des interprètes-chercheurs. La plupart ont fait des études de lettres ou de langues étrangères. Peu d'entre eux ont été formés à la recherche en tant que telle. La plupart ont commencé leur activité de chercheurs parce qu'ils se sont trouvés dans le cadre d'une école d'interprétation universitaire et ont été soit stimulés par l'environnement, soit contraints en raison de règles universitaires de réaliser un projet de recherche. On peut distinguer deux générations d'interprètes-chercheurs :
a. Les interprètes-chercheurs de la première génération :
Ce sont les pionniers dont l'entrée en scène se situe dans les années 60 et 70. Leur personnalité et leurs motivations étaient fortes, ce qui leur a permis de lancer un mouvement qui perdure. Toutefois, ayant pour la plupart étudié les langues vivantes, ils n'avaient pas bénéficié d'une formation à la recherche (à quelques exceptions près), et leurs connaissances étaient généralement faibles dans des domaines tels que la linguistique, la psychologie et la psycholinguistique.
b. Les jeunes' interprètes-chercheurs :
Ce sont les élèves des interprètes-chercheurs de la première génération. Eux aussi sont pour la plupart des littéraires, et eux non plus n'ont pas suivi de formation structurée à la recherche. Toutefois, ils bénéficient de l'expérience de leurs aînés : ils peuvent s'appuyer sur leurs résultats et s'inspirer de leurs méthodes, en les améliorant le cas échéant là où ils les trouvent faibles.
Dans l'ensemble, les interprètes-chercheurs attendent de la recherche une meilleure compréhension de l'interprétation, et accordent une grande importance aux applications en matière de formation. Leur préférence se porte nettement sur la recherche appliquée.
24 DANIEL GILE
3.2 Les étudiants en interprétation
Paradoxalement, les étudiants en interprétation sont souvent plus proches de la recherche véritable que les chercheurs de la première génération. En effet, contrairement aux pionniers, ils sont pris en charge par des directeurs de recherche souvent motivés et plus ou moins expérimentés, et ce dans des écoles offrant des conditions favorables à la recherche. A Trieste, notamment, une grande partie de la production vient des étudiants.
Notons que si les étudiants-chercheurs connaissent moins bien l'interprétation que les praticiens chevronnés, sur le plan de la disponibilité, de la motivation, de l'encadrement et de l'ouverture d'esprit, ils sont souvent mieux placés.
3.3 Les interprètes non chercheurs
D'assez nombreux textes sur l'interprétation cités dans des textes de recherche sont rédigés par des praticiens qui ne se définissent pas eux-mêmes comme chercheurs. Il peut s'agir d'enseignants comme P. Longley (1978), W. Weber (1984), la plupart des auteurs japonais, ou d'interprètes écrivant en tant que praticiens (Coleman-Holmes 1971, Wesenfelder 1982), qui parlent de leur expérience professionnelle et développent les réflexions qu'elle leur inspire. Ces textes peuvent être 'anecdo-tiques', 'informatifs' ou normatifs' (voir plus loin).
3.4 Les chercheurs 'extérieurs'
Les chercheurs 'extérieurs' sont dans leur grande majorité des spécialistes de la psychologie, la psycholinguistique, la linguistique, la sociologie, la neurophysiologie (qui co-signent parfois des textes avec des interprètes). Ils n'ont pas de formation ou d'expérience en interprétation de conférence, bien que la plupart d'entre eux aient une bonne connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères et que certains aient pratiqué la traduction ou certaines formes d'interprétation en amateurs'.
Les chercheurs extérieurs' ne semblent pas attendre de leur recherche des applications concrètes. Elle est plutôt intellectuelle et vise la compréhension d'éléments spécifiques dans l'interprétation, souvent en rapport avec des préoccupations psy-
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 25
chologiques, psycholinguistiques et linguistiques dépassant le cadre de l'interprétation. •
Il y a donc dans l'approche fondamentale une assez grande divergence entre chercheurs interprètes et chercheurs extérieurs', ce qui s'est manifesté de manière répétée par des difficultés de communication entre les deux communautés (voir Ch. 2).
4. Types de textes et démarches de recherche
Une deuxième dimension de, la grille que nous proposons pour l'étude de la recherche sur l'interprétation porte sur les types de démarches de recherche que l'on y trouve. La gamme est en effet très variée, avec des textes allant des plus personnels et des plus libres dans la forme et dans le fond jusqu'aux textes les plus conformes aux us et coutumes universitaires. En fait, comme on peut le deviner d'après la typologie des auteurs et chercheurs présentée ci-dessus et comme i l est expliqué plus loin, dans les travaux sur l'interprétation, les genres se mélangent. D'ailleurs, beaucoup de textes qui reflètent une démarche intuitive et non scientifique sont abondamment cités et pris pour référence dans des publications relevant de la recherche proprement dite ; la réciproque est moins vraie. Nous présentons ici par commodité une classification mixte de textes et de démarches, en commençant par des textes personnels, 'libres' et non universitaires, et en nous rapprochant progressivement de ceux qui correspondent aux critères usuels de la recherche.
4.1 Les textes introductifs
Il s'agit de textes qui présentent des informations et idées générales sur l'interprétation à l'intention du grand public ou des étudiants en début de cursus. Ils évoquent parfois des éléments pratiques, déontologiques, psychologiques et linguistiques intéressants, mais ne les développent pas. Ils sont rédigés tantôt par de simples praticiens', tantôt par des enseignants, tantôt par des chercheurs. Les textes introductifs sont des livres ou des chapitres de livres (notamment dans les guides sur les métiers des langues'), des articles dans la presse non scientifique, des plaquettes. A titre d'exemples, citons Longley 1968, Seleskovitch 1968, Nishiyama 1983).
26 DANIEL GILE
Les textes iñtroductifs ne présentent en général pas beaucoup d'intérêt dans le domaine de la recherche. Ils ne seront pas analysés ici en détail.
4.2 Les textes factuels professionnels
Cette deuxième catégorie désigne les textes dont le but est d'apporter des informations factuelles sur l'interprétation : statistiques professionnelles, normes ISO pour les cabines d'interprétation, autres informations sur les conditions de travail, sur des stages de formation, etc. On les trouve surtout dans les publications de l'AIIC et de différentes associations de traducteurs et d'interprètes, parfois dans les actes de colloques sur la traduction, dans les textes des employeurs d'interprètes.
Au regard de la recherche, ces textes ont essentiellement une fonction de référence informationnelle.
4.3 Les textes anecdotiques
Ce genre, qui relève de la petite histoire', existe en Europe et aux Etats-Unis (voir les articles anecdotiques dans The Jerome Quarterly de l'université de Georgetown), mais se signale surtout au Japon où quelques interprètes ont atteint le statut de vedettes grâce aux medias, ce qui assure un bon succès commercial à leurs textes anecdotiques. Ainsi, Muramatsu (1978, 1979), Nishiyama (1970, 1979), et plus récemment Shinoda et Shinzaki (1992), ont écrit des livres sur leur expérience professionnelle truffés d'anecdotes personnelles. De temps en temps sont également publiés dans la presse générale des articles anecdotiques sur l'interprétation.
Au regard de la recherche, ces textes ont eux aussi une valeur essentiellement informative, en ce sens qu'ils contiennent des indications pouvant aider les chercheurs à reconstituer les environnements professionnels, sociologiques et psychologiques dans lesquels ûs se situent.
4.4 Les textes historiques
A côté des textes anecdotiques, i l existe un certain nombre d'articles qui traitent de l'histoire de l'interprétation de conférence, essentiellement depuis les procès de Nuremberg, ainsi
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 27
que de l'histoire de l'interprétation sous ses formes plus générales depuis l'antiquité et jusqu'à l'époque contemporaine. Plusieurs textes de ce type figurent parmi les publications de Ingrid Kurz énumérées dans la bibliographie en fin d'ouvrage. " Les textes historiques représentent une démarche quelque
peu isolée dans la recherche sur l'interprétation. Ils y constituent un système fermé et n'interagissent pas beaucoup avec les autres types de textes.
4.5 Les textes réflexifs ' ou 'de réflexion '
Nous classons dans cette catégorie, quantitativement très importante parmi les publications sur l'interprétation, les textes dans lesquels leurs auteurs développent des réflexions et des opinions de principe sur l'interprétation, fondées sur leur expérience personnelle et leurs intuitions plutôt que sur la base de l'étude systématique d'un corpus ou d'un ensemble de travaux scientifiques, observationnels ou expérimentaux.
Les textes de réflexion portent sur une large gamme de sujets liés aux mécanismes de l'interprétation, à sa pratique professionnelle, à la formation. Citons à titre d'exemples Capaldo (1980) dans une plaidoirie pour la consécutive, Cartel-lieri (1983) sur la qualité du travail, Eberstark (1982) dans une comparaison de la traduction et de l'interprétation, Galer (1974) qui défend la sténographie, Kurz (1988) sur la spécialisation des interprètes, Namy (1978) sur la formation, Quicheron (1985) sur la préparation des conférences, Romer (1985) sur le passé et l'avenir de la profession, Thiéry (1985) sur le secret professionnel chez l'interprète, Coleman-Holmes (1971) dans une mordante. description de l'univers sociologique des interprètes.
La démarche reflexive peut être qualifiée de pré-scientifique', en ce sens qu'elle implique une réflexion souvent approfondie, mais sans la rigueur et le caractère systématique de la démarche scientifique. Il est d'ailleurs difficile d'établir une ligne de démarcation entre les textes de. réflexion et les textes théoriques (voir plus loin). C'est pourquoi nous ne tenterons pas une analyse statistique de la production théorique par opposition à la production reflexive. Signalons cependant que les textes de réflexion continuent à être très nombreux, notamment dans les actes de colloques et conférences de traduction et d'interprétation.
28 DANIEL GILE
4.6 Les textes normatifs
Il s'agit des publications dont le contenu consiste essentiellement en des conseils, des instructions ou des normes, qu'ils soient ou non formulés explicitement sur un ton normatif : en effet, sans prendre un ton impératif, un auteur peut présenter des normes d'une manière telle que son texte est une prise de position.
Les auteurs des textes normatifs sont des praticiens et des enseignants. On notera tout particulièrement les textes de l'AnC §ur la déontologie professionnelle (par exemple AJQC 1982), de nombreux articles publiés dans le Bulletin de l'AIIC, et d'autres documents destinés aux organisateurs et participants aux conférences internationales pour leur indiquer la bonne marche à suivre pour profiter pleinement des services de l'interprétation.
La démarche normative sous-tend également de nombreux autres textes réflexifs et /théoriques, surtout ceux traitant de la formation, qui a par essence un important côté normatif, la démarche scientifique n'étant pas encore solidement établie au sein de la communauté des interprètes-chercheurs. Il s'agit d'ailleurs d'une caractéristique que l'on trouve aussi dans les textes sur la traduction (voir notamment Toury 1980).
4.7 Comptes rendus et bibliographies
Nous désignons par cette catégorie de textes les comptes rendus de travaux et de publications, ainsi que les listes bibliographiques. Ces textes sont restés peu nombreux pendant une longue période, mais, sous l'impulsion de la tendance actuelle à l'ouverture, ils se sont multipliés depuis 1989. Notons en particulier la bibliographie non publiée, mais périodiquement mise à jour de la Commission de la recherche de l'AIIC, les listes bibliographiques figurant dans la revue triestine The Interpreters Newsletter, le IRTIN Bulletin, qui est composé dans sa quasi totalité d'informations bibliographiques, et les nombreux comptes rendus de Gérard Ilg dans la revue Parallèles de l'Ecole de Traduction et d'Interprétation de l'université de Genève.
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 29
4.8 Les textes théoriques
• Les textes théoriques se distinguent des textes de réflexion par un degré d'abstraction et de formalisation plus poussé, qui les place dans la catégorie des textes universitaires. • De nombreuses thèses de doctorat sur l'interprétation relè
vent de la démarche théorique. Cette démarche est particulièrement saillante dans les pays germanophones, mais elle figure aussi en bonne place dans les travaux français du groupe des théoriciens de l'ESIT.
4.9 Les textes relevant de la recherche empirique
Plus proches de la démarche scientifique qui caractérise les sciences naturelles et de nombreux travaux modernes dans les sciences sociales, les 'textes empiriques' sont ceux qui rendent compte d'une observation systématique de phénomènes sur le terrain, qu'ils soient naturels ('démarche observationnelle' ou naturaliste') ou provoqués par le chercheur dans un environnement contrôlé' (démarche expérimentale).
4.9.1 Les textes observationnels
La démarche observationnelle ou 'naturaliste' consiste à étudier systématiquement par une observation rigoureuse une situation naturelle telle qu'elle se produit sur le terrain. Dans la démarche observationnelle, nous englobons aussi bien le simple enregistrement d'une situation que la recherche active de renseignements, par exemple à travers des questionnaires et interviews.
Les textes observationnels se distinguent essentiellement des 'textes factuels professionnels' non pas nécessairement par leur contenu, mais par la démarche qui les sous-tend, en ce sens qu'ils ne sont pas produits par désir d'informer, mais à la suite de l'étude systématique d'un phénomène à travers l'observation d'une situation, le texte étant le reflet des résultats et non pas un véhicule d'information conçu en tant que tel.
30 DANIEL GILE
4.9.2 Les textes expérimentaux
Il s'agit de textes rendant compte des résultats de l'observation systématique de situations provoquées délibérément par le chercheur pour être étudiées dans des conditions pré-définies. Nous incluons dans la démarche expérimentale non seulement les expériences de vérification d'hypothèses telles qu'elles ont acquis un quasi-monopole dans certaines disciplines, mais aussi l'expérimentation dite 'ouverte', dans laquelle i l n'y a non pas une hypothèse à vérifier, mais l'exploration d'une situation nouvelle avec tentative de recueillir des informations.
Les deux chapitres suivants analysent la recherche sur l'interprétation depuis ses débuts en utilisant les concepts ainsi définis.
Chapitre 2
Historique de la recherche sur l'interprétation
Un cadre général pour l'étude de la recherche sur l'interprétation de conférence ayant été présenté au chapitre 1, ce deuxième chapitre retrace l'historique des écrits sur l'interprétation depuis les débuts de la réflexion théorique sur la profession et jusqu'à la période actuelle de renouveau, qui est analysée au chapitre 3.
1. Les premiers écrits
Les premiers écrits sur l'interprétation de conférence, qui datent des années 50, voire de la fin des années 40, n'ont pas encore une optique universitaire, théorique ou expérimentale. Ce sont pour la plupart des textes d'introduction et des textes normatifs, rédigés par des praticiens, pour la plupart enseignants mais non chercheurs. Certains de ces écrits méritent pourtant une mention particulière, dans la mesure où ils posent déjà une grande partie des principes et problèmes de fond qu'abordèrent par la suite les théoriciens et chercheurs, et autour desquels les débats ne sont pas encore clos. Les premiers articles parus durant cette période dans différentes revues, surtout en Suisse, dans L interprète, et en Belgique (voir la bibliographie à la fin de Van Hoof 1962, qui en cite plus de cent datant d'avant 1961), sont devenus introuvables. En revanche, quelques livres datant de cette période ornent encore les rayons des bibliothèques des écoles de traduction et d'interprétation. '
32 DANIEL GILE
Le Manuel de l'interprète de Jean Herbert (1952), qui est considéré comme un classique, est essentiellement un ouvrage pratique. Il aborde, de manière didactique et normative, la pratique de l'interprétation, et notamment le comportement professionnel, la préparation des conférences et la prise de notes en consécutive. Jean Herbert indique que l'interprète doit être «vif d'esprit », avoir une bonne mémoire et disposer d'un « énorme vocabulaire » très disponible (p. 5). Si le concept de vivacité d'esprit peut paraître vague, et si la nécessité d'avoir une bonne mémoire ne fait plus l'unanimité parmi les chercheurs, la notion de disponibiüté du vocabulaire, négligée pendant près de 30 ans, reprend une place importante actuellement ; elle occupe notamment une place importante dans nos modèles d'Efforts (Ch. 4) et dans notre modèle gravitationnel de la disponibilité linguistique (Ch. 8). Jean Herbert pose aussi que les métiers de traducteur et d'interprète sont radicalement différents et dans une grande mesure inconciliables, que rares sont les interprètes capables de bien traduire et les traducteurs capables de bien interpréter (p. 6). Cette idée continue à faire l'objet de débats parmi les chercheurs contemporains (voir par exemple Schjoldager 1993). J. Herbert postule aussi la compréhension du discours par l'interprète au-delà des mots (p. 19), idée qui continue à être étudiée, mais de manière plus précise (voir entre autres Gile 1986c et Dillinger 1989), note l'existence des interférences linguistiques (p. 36), déclare que le discours original doit être bien analysé avant d'être interprété (p. 34), et, à propos de la formation, propose déjà la répétition avec décalage ou shadowing', sur lequel la polémique entre les enseignants ne semble pas près de s'éteindre (voir Ch. 7).
On n'oubliera pas non plus dans la série des premiers écrits marquants sur l'interprétation le petit manuel de prise de notes de Jean-François Rozan (1956), lui aussi un classique. Ouvrage didactique et pratique, i l n'en énonce pas moins des principes méthodologiques de portée plus générale, tels que celui de la restitution des idées et non pas des mots dans le discours d'arrivée (p. 14), et l'importance de la compréhension des enchaînements logiques dans le discours.
Henri Van Hoof, qui enseigna l'interprétation à Bruxelles, reprend dans son livre didactique (1962) une grande partie des idées de J.-E Rozan et de Jean Herbert. Il y ajoute quelques observations et affirmations d'ordre théorique et pratique qui restent elles aussi d'actualité dans la recherche sur l'interprétation. Il affirme par exemple (p. 36, p. 39) que la consécutive est plus précise que la simultanée, èans toutefois étayer cette affir-
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 33
mation par des études empiriques. Il pose aussi, comme J. Herbert (1952:66), que la simultanée n'est qu'une consécutive accélérée. Cette idée, reprise depuis par de nombreux enseignants (bien que contestée actuellement —voir les explications au Ch. 4), a d'importantes incidences en matière de formation. Elle justifie notamment l'idée qu'il est indispensable de bien maîtriser la consécutive avant d'aborder l'apprentissage de la simultanée (voir à ce sujet le Ch. 7). Toujours à propos de la simultanée et de la consécutive, H. Van Hoof affirme que la prise de décisions (le « jugement ») est au centre même de la consécutive, alors qu'elle est quasiment inexistante en simultanée, dans laquelle l'interprète est « irrémédiablement enchaîné à l'orateur qu'il suit presque mot à mot» (p.39). Cette conception des choses est contraire aux idées actuelles et aux méthodes d'enseignement en cours (voir par exemple Namy 1979). Autre question ayant une grande portée théorique, H. Van Hoof parle du partage de l'attention requis lors de la simultanée et de la consécutive. Il ne tente pas toutefois d'approfondir l'idée. Il évoque aussi le bagage cognitif de l'interprète, qui comporte des « notions superficielles, mais néanmoins précises, dans un grand nombre de branches » (p. 64). Cette qualification, qui s'en tient à un énoncé vague, concorde bien avec l'idée du modèle flottant' de Gile (1986c), défini comme une structure sémantique isomorphe à la structure sémantique de l'original, mais ayant des nœuds nominaux moins précisément définis, et moins bien intégrée dans le réseau sémantique des connaissances générales du locuteur. Enfin, dernier élément à portée théorique que nous citerons ici, H . Van Hoof parle de la production « automatique » d'« équivalents » linguistiques (p. 65). L'idée du 'transcodage' est contraire à la 'théorie du sens' ; elle est combattue par le groupe de l'ESIT (voir plus loin), mais les 'automatismes' semblent bien intervenir en interprétation, et sont probablement indispensables dans une charge cognitive lourde comme celle de la simultanée, comme l'explique H. Nowak-Leeman (1993). Le débat reste donc d'actualité.
Si Jean Herbert, J.-F. Rozan et Henri Van Hoof sont essentiellement des enseignants et ont des préoccupations pratiques, Dánica Seleskovitch, de Paris, a d'emblée des visées plus théoriques et plus ambitieuses. Dans son livre L interprète dans les conférences internationales (1968), elle précise que son but est « ...d'essayer de mettre en lumière le processus mental qui rend possible la transmission quasi instantanée d'un message oral dans une autre langue » (p. 36).
34 DANIEL GILE
Le livre présente effectivement les intuitions de son auteur à propos du fonctionnement mental- de l'interprétation. On y trouve d'ailleurs une petite bibliographie qui témoigne d'une certaine fermentation intellectuelle parmi les interprètes pendant les années 60. Soulignons toutefois que cet ouvrage, qui a lui aussi connu une grande popularité et qui a été traduit dans plusieurs langues, ne va pas au-delà des intuitions. Il n'apporte pas de données empiriques, expérimentales ou observation-nelles pour étayer les idées qui y sont présentées, et ne se réfère pas non plus aux travaux récents (à l'époque) des linguistes et psychologues. En cela, i l reste réflexif.
Parallèlement à ces publications européennes commencent à paraître des textes sur l'interprétation dans différents pays du monde. On notera en particulier la parution de plusieurs publications japonaises :
Le premier livre japonais sur l'interprétation, Eigotsûyaku no jissai (dont le titre a été traduit en anglais par An English Interpreters Manual par ses auteurs, H. Fukuii et T. Asano), paraît en 1961. Il présente des similitudes marquées avec le Manuel de l'interprète de Jean Herbert par sa démarche générale et par les principes qui y sont soulignés : nécessité d'une bonne connaissance de la langue de départ, d'une analyse du contenu du discours de l'orateur, de la préparation. Le livre comporte également des éléments d'information intéressants sur l'interprétation à partir du japonais : les auteurs disent entre autres que les orateurs japonais ont tendance à employer des structures linguistiques vagues et « illogiques », que le sentiment premier d'avoir compris un segment de discours peut être démenti par la difficulté qu'on éprouve à le traduire, que les différences syntaxiques entre l'anglais et le japonais font que la simultanée entre les deux appelle d'importants efforts de mémoire (voir notre compte rendu dans Gile 1992d). Ces affirmations ne sont pas étayées elles non plus par des travaux scientifiques, mais elles constituent des témoignages intéressants, surtout compte tenu des affirmations contraires de certains théoriciens occidentaux. En tout état de cause, ces idées sont actuellement elles aussi fortement débattues au sein de la communauté des chercheurs en interprétation.
Un autre livre japonais sur l'interprétation, peut-être le plus intéressant de cette période, est l'ouvrage intitulé Tsûyaku : Eikaiwa kara dôjitsûyaku made {L'interprétation : de la conversation en anglais à la simultanée), qui a été rédigé par trois interprètes très connus au Japon (Masao Kunihiro, Sen Nis-hiyama et Nobuo Kanayama), et publié par l'organisme de
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 35
radio et de télévision japonais N H K Ce livre, riche dans son contenu, comporte quelques erreurs importantes et idées reçues sur l'interprétation entre les langues occidentales (voir Gile 1988b), mais reste remarquable, notamment par sa démarche bien plus pragmatique que celle des livres occidentaux publiés à la même époque, à l'exception de celui d'Henri Van Hoof. Parmi les idées importantes qui y figurent, notons l'évocation de la perte qui accompagne toute transmission d'information et l'application du principe à l'interprétation; les auteurs rendent d'ailleurs les orateurs partiellement responsables de la réussite ou de l'échec de la communication à travers l'interprétation. Cette démarche contraste fortement avec le point de vue quelque peu idéalisé' des auteurs occidentaux, pour qui l'information devait passer' dans son intégralité, et dont l'univers de référence était très interpréto-centrique. Le livre reprend lui aussi la question de l'interprétation entre anglais et japonais, explique que dans les conférences japonaises, i l y a relativement peu de véritables débats et que toutes les décisions se prennent à l'avance, que les Japonais répugnent à être « trop clairs » dans l'expression de leurs idées, que dans l'interprétation du japonais se pose le problème des homophones (voir sur cette question Gile 1986e —voir aussi le chapitre 8). ,
Soulignons encore une fois que si les premiers textes sur l'interprétation ne se conformaient pas aux règles des écrits universitaires ou de recherche, leurs auteurs étaient pour la plupart des professionnels et enseignants chevronnés dont l'expérience et les préoccupations étaient sensiblement les mêmes que celles des auteurs des textes de recherche actuels. Dès les années 50, la formation y occupe une place prépondérante, et l'on y parle déjà des limites et difficultés de la simultanée {Le petit journal 1957, Hedinger 1955), de la consécutive et de la prise de notes (Fuchs-Vidotto 1961, Priacel 1957).
Les deux principaux pôles de réflexion sur l'interprétation en Occident à l'époque sont Genève et Bruxelles. ' Et pourtant, le premier travail universitaire sur l'interprétation, une 'thèse' de M A introspective de l'interprète Eva Paneth, est soutenue à l'université de Londres en 1956. En 1959 paraît un article de Gérard Ilg, praticien et enseignant à Genève, sur la formation à l'interprétation. C'est le début d'une première série d'articles qui se dirigent peu à peu vers la théorie, puis vers la recherche. Le mouvement va rapidement se diviser en deux: une courte poussée de la recherche expérimentale réalisée par des scientifiques (décrite ci-dessoijs), et parallèlement, une acti-
36 DANIEL GILE
vité de réflexion (Section 3). C'est vers le milieu des années 80 qu'apparaîtra une deuxième vague de recherche plus proche de ce qu'il est convenu d'appeler l a démarche scientifique', en même temps que se poursuivront la réflexion et la théorisation personnelles (Ch. 3).
2. La période expérimentale des années 60
2.1 Présentation des travaux
Les premières tentatives de recherche proprement dite sur l'interprétation viennent de la psychologie et de la psycholinguistique. Conformément à la démarche de recherche qui a cours dans ces disciplines, les travaux qu'elles suscitent portent sur des éléments spécifiques de l'interprétation, sans viser l'intégration dans un modèle global du processus, à l'exception d'un modèle de D. Gerver (1976) — voir plus loin.
Les premiers travaux empiriques sur l'interprétation datent du milieu des années 60. Les psychologues français Oléron et Nanpon (1964), intrigués par le chevauchement de l'écoute et de la production dans la simultanée, prennent des enregistrements de discours et de leur interprétation en simultanée pour examiner l'EVS ou 'Ear-Voice Span', c'est-à-dire le décalage temporel entre le moment où une information est formulée par l'orateur et le moment où elle est restituée par l'interprète. Oléron et Nanpon trouvent un décalage se situant généralement entre 2 et 10 secondes, variation qu'ils attribuent à la difficulté d'organiser mentalement l'information avant de pouvoir la restituer. Notons que E. Paneth (1956) avait déjà observé des décalages de 2 à 4 secondes, et que des chiffres analogues ont été trouvés par la suite par d'autres chercheurs. Oléron et Nanpon pensent qu'étant donné la capacité limitée de la mémoire à court terme de l'interprète, i l ne peut se permettre un décalage trop élevé. Cette idée elle aussi correspond à l'intuition des praticiens (les effets d'un EVS trop long sont notamment analysés à travers les modèles d'Efforts au Ch. 4 du présent ouvrage). Oléron et Nanpon ont également étudié les erreurs de traduction (omissions et additions), et ont noté que l'interprétation avait tendance à être plus longue que la traduction écrite des mêmes textes.
A. Treisman (1965) a mesuré la rapidité avec laquelle des sujets bilingues pouvaient traduire d'anglais en français et inversement. D'après elle, l 'EVS est fonction des contraintes
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 3 7
grammaticales et des 'transformations' nécessaires entre discours en langue de départ et discours en langue d arrivée. On trouvera au Ch. 3 l'évocation de quelques résultats plus récents concernant ces transformations.
En 1967 sont également parus deux autres articles qui concernaient l'interprétation simultanée, mais à titre accessoire. Dans l'un, E.A. Lawson, qui s'intéressait à l'attention sélective, a utilisé des écouteurs pour acheminer alternativement deux discours différents vers l'oreille droite et l'oreille gauche de ses sujets (qui n'étaient pas interprètes), et leur a demandé d'interpréter de l'anglais en néerlandais ou inversement le discours qu'ils entendaient dans l'oreille droite ou l'oreille gauche. Son analyse a porté sur l'interférence entre les deux canaux telle qu'elle s'est manifestée par des 'erreurs d'interprétation'. Dans le deuxième article, F. Goldman-Eisler (1967) a comparé les paramètres rythmiques de la parole et des pauses dans des discours spontanés, des discours lus, et des interprétations simultanées entre français, anglais et allemand. Un premier résultat de cette étude fait apparaître que dans les trois conditions expérimentales, les pauses représentent au moins 30 % du temps total de parole. Dans sa synthèse de la recherche empirique sur l'interprétation, D. Gerver (1976:171) note que ces résultats ont été critiqués en tant qu'artefacts possibles de la méthode de mesure utilisée.
Une variable considérée comme très importante par l'ensemble des praticiens de l'interprétation, le débit de l'orateur, a également attiré l'attention des chercheurs (Treisman 1965, Barik 1973 et 1975, Goldman-Eisler 1967 et 1972, Oléron et Nanpon 1964, Chernov 1969, Gerver 1969). D'après les interprètes, ce débit serait optimal aux alentours de 100 à 120 mots/minutes (Seleskovitch 1968). Plusieurs chercheurs ont cherché à le manipuler expérimentalement pour en voir les effets sur les interprètes. Il ressort de ces expériences que face à des débits rapides, les interprètes ont tendance à prendre un recul plus grand, à faire davantage de pauses et à « parler moins » en maintenant un débit régulier (Gerver 1976:172). Face à un débit très élevé qui menace de saturer la capacité de l'interprète, Chernov (1969) évoque des tactiques de « compression de texte » qui seraient utilisées par les praticiens. Pour appuyer cette idée, ü présente les résultats d'une expérience au cours de laquelle i l a compté les syllabes dans trois textes anglais, puis les a fait interpréter en simultanée vers le russe par des étudiants, et a compté les syllabes dans l'interprétation. Il s'est avéré que le russe comprenait davantage de syllabes
38 DANIEL GILE
que l'original anglais. En outre, les versions traduites par écrit étaient plus courtes que les versions interprétées. La même expérience répétée avec des interprètes confirmés à abouti à un nombre de syllabes en russe inférieur au nombre de syllabes en anglais. Chernov en conclut que les interprètes chevronnés ont usé de tactiques « de compression » leur permettant de diminuer le volume global de leur discours en langue d'arrivée.
Dans une démarche analogue, A. Krusina (1971) a comparé la longueur de versions anglaises, françaises et allemandes d'un discours en tchèque. En nombre de mots, les traductions étaient toutes de 30 à 40% plus longues que l'original. Toutefois, en nombre de syllabes, le rapport s'inversait. Il en conclut qu'il vaut mieux mesurer le débit en syllabes qu'en mots. D. Gerver (1976:174) conteste la validité de ce choix, en soulignant que les syllabes ne constituent pas nécessairement des unités sémantiques, et que la traduction porte sur le sens, et non pas sur le son.
Un important aspect des conditions de travail de l'interprète est le bruit environnant. D. Gerver a réalisé une étude expérimentale sur cette question (Gerver 1972, 1974a). Son montage consistait en une expérience avec douze interprètes de conférence qui ont interprété en simultanée vers l'anglais ou répété avec décalage un discours français lu sous trois niveaux de bruit : nul, modéré et fort. L'augmentation du nombre des erreurs en fonction du bruit s'est avérée plus grande en simultanée que dans le shadowing. Par ailleurs, l 'EVS est resté le même pour les trois niveaux de bruit. Gerver en déduit que, pour garder un EVS constant, les interprètes affrontant de difficiles conditions d'écoute préfèrent accepter de commettre davantage d'erreurs sans tenter de les corriger.
Gerver a également étudié l'effet du bruit sur la capacité des auditeurs de comprendre et de se rappeler une version en langue d'arrivée de textes interprétés en simultanée et en consécutive en la présence de différents types de bruit. Les résultats font apparaître une certaine différence dans la compréhension en faveur de la consécutive.
Une autre question étudiée par les chercheurs psychologues et psycholinguistes est celle de la segmentation du discours source par l'interprète. Pour H. Barik (1969), les pauses dans le discours de l'orateur marquent peut-être les frontières des unités de sens' pour l'interprète et l'aident à segmenter le discours source en vue de sa restitution en langue d'arrivée. F. Goldman-Eisler (1972) pense que cette segmentation peut se
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 39
faire selon trois modalités : 1'« identité », qui consiste à coder l'ensemble du segment. de discours se situant entre deux pauses voisines, la « fission », qui consiste à commencer à coder ce même segment avant même qu'il soit terminé, et la « fusion », qui est le codage d'un enchaînement de deux ou plusieurs segments de discours bornés par des pauses voisines. Les résultats de son expérience font apparaître que la fréquence relative d'occurrence de chacune de ces modalités dépend notamment de la langue de départ et de la langue d'arrivée dans chaque combinaison spécifique ; dans l'interprétation à partir de l'allemand, les segments stockés en mémoire avant d'être restitués en langue d'arrivée étaient plus longs que dans l'interprétation à partir du français et de l'anglais.
Gerver (1971) a demandé à des étudiants en fin de cursus d'interprétation de traduire en simultanée les enregistrements de deux types de discours lus en français : les uns étaient présentés tels quels ; dans d'autres, le, relief prosodique avait été affaibli, et toutes les pauses de plus d'un quart de seconde avaient été éliminées. Dans les discours en langue de départ, 80 % des pauses intervenaient au début ou à la fin de constituants majeurs et 20 % au début ou à la fin de constituants mineurs. Dans la première condition, les pauses dans le discours en langue d'arrivée étaient situées à 55 % après des mots marquant le début ou la fin de constituants majeurs en langue d'arrivée, dont 89 % au même endroit qu'en langue de départ ; 30 % étaient situées au début ou à la fin de constituants mineurs, et 15 % à l'intérieur des constituants. Dans la deuxième condition expérimentale, dans laquelle les pauses en langue de départ avaient été supprimées, les pourcentages respectifs étaient de 32 %, 42 96 et 26 %. Par ailleurs, la restitution du contenu s'est avérée plus complète dans la première condition (avec pauses) que dans la seconde. Gerver en conclut que les pauses dans le discours en langue d'arrivée aident les interprètes à segmenter, à comprendre et à reformuler le discours en simultanée.
F. Goldman-Eisler (1972) a analysé la structure linguistique des segments de discours correspondant à l 'EVS. Il s'est avéré que la majorité de ces segments comprenaient au moins une expression predicative complète (NP + VP). F. Goldman-Eisler définit parmi ces segments EVS' sept types de structures grammaticales, et présente des statistiques sur leurs fréquences d'occurrence selon les langues de départ, à savoir l'anglais, le français et l'allemand.
40 DANIEL GILE
D'après certains chercheurs, les interprètes essaieraient de réduire l'intensité de l'effort qui leur est demandé en simultanée en profitant des pauses dans le discours en langue de départ pour y insérer autant d'informations que possible en langue d'arrivée (voir par exemple F. Goldman-Eisler 1968). H. Barik (1973) a examiné cette hypothèse en étudiant par ordinateur le déroulement temporel des discours de départ et d'arrivée, et notamment les pauses de plus de 0,60 secondes y intervenant. Il a calculé la durée totale de chacun des 4 états suivants : l'orateur parle et l'interprète parle, l'orateur parle et l'interprète fait une pause, l'interprète parle et l'orateur fait une pause, l'interprète et l'orateur font une pause tous les deux. H. Barik a ensuite calculé statistiquement la proportion de temps de pause de l'orateur pendant lequel l'interprète devrait parler si les pauses de son discours étaient indépendantes de celles de l'orateur. Il s'est avéré que le chiffre théorique escompté différait sensiblement du chiffre obtenu à partir des mesures effectuées sur les discours du corpus, ce qui, pour Barik, tend à corroborer l'hypothèse d'une utilisation par les interprètes des pauses dans le sens évoqué plus haut. Barik propose une explication de la fréquence élevée de l'état où l'orateur fait une pause pendant que l'interprète parle. Il note que dans le discours source, les pauses onftendance à intervenir entre des unités de sens ; les interprètes écouteraient des unités de sens entières avant de commencer à les interpréter, et seraient donc davantage susceptibles de parler pendant les pauses de l'orateur que pendant que se déroulerait l'unité de sens dans le discours original.
Ce raisonnement est contesté par D. Gerver (1976 :182), qui fait remarquer que la plupart des pauses mesurées par F. Goldman-Eisler (1968) chez des orateurs dans différentes situations étaient d'une durée inférieure ou égale à une seconde, et qu'elles avaient une durée moyenne d'environ une à près de deux secondes dans les discours étudiés par H. Barik (1969). Il considère qu'étant donné ces ordres de grandeur, la stratégie postulée par ce dernier serait peu efficace, car l'on ne peut pas dire grand-chose en une à deux secondes.
Il n'en reste pas moins que l'état où l'orateur et l'interprète parlent tous les deux en même temps est très fréquent: 64% de la durée du discours de départ selon une étude de cas de Gerver (1972a). Dans les années 70, plusieurs chercheurs soviétiques, notamment Irina A. Zimnyaya, Ghelly Chernov et Ana-toly Shiryaev, ont procédé à des vérifications et ont trouvé que l'interprète parlait en même temps que l'orateur environ 70 %
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 41
du temps (voir Chernov 1992). Une étude plus récente sur l'interprétation entre le russe et le tchèque .de I. Cenkova de Prague (1985) fait apparaître des chiffres analogues. La simultanéité du discours original et du discours cible sur une partie importante de la durée du discours est l'un des rares résultats factuels qui soient bien documentés dans la recherche sur l'interprétation. En revanche, la question de savoir dans quelle mesure cette simultanéité affecte la qualité de la prestation de l'interprète n'a pas été abordée.
I. Pinter (Kurz), la première interprète de conférence à soutenir une thèse de doctorat sur l'interprétation (en psychologie, à l'université de Vienne, 1969), a étudie expérimentalement la capacité d'écouter et de parler en même temps chez quatre groupes de sujets : des interprètes chevronnés, des étudiants en fin de cursus d'interprétation, des étudiants en début de cursus d'interprétation, et de jeunes étudiants non inscrits en interprétation. Les sujets devaient répéter des phrases et répondre à des questions sous différentes conditions expérimentales, dont deux impliquaient une superposition temporelle de l'écoute et de la production. Il s'est avéré que les interprètes professionnels et les étudiants en fin de cursus d'interprétation avaient des résultats sensiblement meilleurs que les deux autres groupes, ce qui semble corroborer l'hypothèse d'une amélioration de la capacité d'écouter et de parler en même temps au fil de l'entraînement.
D. Gerver (1974b) a réalisé une expérience avec des étudiants en fin de cursus d'interprétation qui ont écouté, interprété en simultanée ou répété avec décalage des discours enregistrés, puis subi un examen de compréhension et de rappel des passages concernés. Les résultats étaient meilleurs après l'écoute qu'après l'interprétation et la répétition avec décalage, ce qui semble indiquer une interférence due à la simultanéité de l'écoute et de la production. Ce résultat est corroboré par une récente étude de M . Viezzi (1990).
S'agissant du contenu du discours de l'interprète, H. Barik (1971) a fait une analyse détaillée de ce qu'il considère comme des erreurs de traduction. Il définit entre autres quatre catégories d'omission :
1. Omission de segments d'un mot, tels que des qualificatifs. 2. Omission de segments plus importants pour cause
d'incompréhension. 3. Omissions dues à un EVS trop important. 4. Omissions dues au regroupement d'éléments provenant de
propositions différentes dans le discours de départ.
42 DANIEL GILE
Barik classe les erreurs sémantiques en deux catégories, lune où l'interprète restitue le sens de l'original, et l'autre où il l'altère sensiblement. Il classe aussi, parmi les erreurs et omissions, les changements dans l'ordre de présentation de l'information dans le discours d'arrivée par rapport au discours de départ.
Une autre question importante traitée par plusieurs auteurs est celle de l'anticipation. Cette idée est évoquée intuitivement par plusieurs auteurs, notamment • 0. Kade et C. Cartellieri (1971), qui parlent d'un modèle stochastique du discours construit par l'interprète avec une incertitude décroissante à mesure qu'il se déroule. G. Chernov (1973) a demandé à des sujets d'interpréter du russe en anglais des discours comprenant des passages fallacieux, en ce sens que leur début laissait présager une suite dans un sens particulier, et que leur fin allait dans un autre sens. Dans son expérience, 75 % des interprétations des passages se sont avérées conformes aux attentes induites, et non pas au contenu réel du discours.
Enfin, D. Gerver (1976) présente un modèle du processus d'interprétation simultanée, qui, curieusement, n'est que rarement cité. Ce modèle se fonde sur une démarche psychologique axée sur le traitement de l'information, avec des opérations de stockage et de retrait d'informations réalisées sur une mémoire tampon, différentes opérations de codage et de décodage, et des transformations de structures superficielles en structures profondes et inversement.
2.2 Un examen critique des travaux expérimentaux
En résumé, la recherche sur l'interprétation pendant les années 60 et le début des années 70 peut se caractériser comme suit : •
1. Elle provient presque exclusivement des psychologues et psycholinguistes, et la grande majorité des textes sont publiés dans des revues relevant de ces deux domaines.
2. Elle est empirique, et essentiellement expérimentale. 3. La somme des travaux reste très modeste et très disper
sée. On note parmi les auteurs un Américain, un Britannique, quelques Soviétiques, une Autrichienne, deux Allemands, mais pas de groupe constitué en laboratoire ou appartenant à un institut de recherche.
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 43
4. Comme on pouvait s'y attendre, les phénomènes étudiés sont ponctuels et correspondent aux préoccupations des psychologues plutôt qu'à des questions pratiques posées par des interprètes et directement applicables dans la pratique.
5. En ce qui concerne les résultats, on ne relève pas de nouveautés ou de grandes découvertes, ce qui n'est guère surprenant compte tenu du très petit nombre d'études réalisées.
6. La plupart des travaux présentent des faiblesses méthodologiques assez importantes (voir ci-dessous).
Nous ne nous attarderons pas sur les problèmes techniques de la recherche expérimentale des années 60 tels que ceux posés par les appareils de mesure ou par les méthodes statistiques particulières utilisées. Ce dernier point est évoqué dans Gile 1990g. Ce qui nous semble mériter de retenir l'attention plus longtemps, ce sont les faiblesses qui caractérisent la démarche des chercheurs 'extérieurs' de cette époque de manière plus fondamentale, à savoir les problèmes liés à la méconnaissance qu'ils avaient des principes mêmes de l'interprétation.
Ces faiblesses peuvent être classées en plusieurs catégories, qui tournent autour des éléments suivants :
2.2.1 Les sujets - v
Au cours de cette première période de recherche, les expérimentateurs ont beaucoup recruté comme sujets non pas des interprètes professionnels, mais des étudiants, voire des «bilingues » sans formation ni expérience en interprétation. La question est de savoir dans quelle mesure les performances de tels sujets reflètent les processus intervenant chez les professionnels.
A cette interrogation i l n'existe pas de réponse absolue, et i l nous semble que le rejet catégorique et a priori de toute expérience dont les sujets ne sont pas interprètes professionnels, comme il se manifeste au sein de certains groupes d'interprètes chercheurs, est injustifié. Pour prendre deux exemples à titre illustratif, i l ne semble pas déraisonnable de prendre des étudiants ou des « bilingues » pour une première exploration expérimentale sur la fatigue des yeux lors de la lecture des transparents et diapositives projetés à l'écran, ou sur la qualité
44 DANIEL GILE
de l'air en cabine au cours d'une journée d'interprétation, bien qu'il puisse exister des différences entre les interprètes professionnels et des étudiants ou amateurs. Compte tenu de la rareté des. interprètes mobilisables comme sujets pour la recherche (voir Ch. 9), i l apparaît au contraire intéressant de commencer l'exploration par des non-professionnels pour ménager les ressources potentiellement mobilisables à un stade ultérieur.
En revanche, en ce qui concerne la recherche sur les processus centraux de l'interprétation, des doutes sont permis. Il suffit pour s'en convaincre de considérer deux faits :
— Le faible taux de réussite à l'école d'interprétation :
Parmi les 'bilingues' venant se présenter aux examens d'admission des principales écoles d'interprétation, candidats qui, en France, sont déjà titulaires d'au moins une licence, mais plus souvent d'une maîtrise universitaire, seule une minorité est admise en première année. Parmi eux, comme i l est mentionné au Ch. 1 (voir aussi le Ch. 7), seule une fraction de la cohorte obtiendra le diplôme. Il est vrai que certains trouveront un autre chemin pour accéder à la profession (d'ailleurs, i l existe aussi des interprètes autodidactes), mais ils représentent une minorité très faible, statistiquement peu significative et qui, dans les pays occidentaux, tend à disparaître. Or, le diplôme d'interprétation n'est pas un concours, mais un examen de l'aptitude du candidat à exercer la profession d'interprète.
Sur cette base, i l ne semble pas déraisonnable de penser qu'un sujet choisi par l'expérimentateur sans raison autre que son 'bilinguisme' et sa disponibilité a moins d'une chance sur cinq d'avoir l'aptitude nécessaire à l'interprétation, et que même un étudiant en dernière année de cursus d'interprétation a moins d'une chance sur deux d'avoir cette aptitude.
— L'effet d'apprentissage :
Indépendamment de la question des aptitudes linguistiques et intellectuelles intervient l'effet de l'apprentissage. En effet, la formation dure deux ans dans la plupart des écoles, et six mois dans les stages intensifs proposés par les Nations Unies et la Commission des Communautés européennes. Pendant cette période, les étudiants apprennent un certain type d'écoute, une certaine forme d'analyse, le partage de l'attention, le contrôle de la production en langue d'arrivée en la présence auditive de
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 45
la langue de départ, la lutte anti-interférences plus particulièrement, un ensemble de tactiques pour faire face aux autres difficultés (présentées au Ch. 4). Certaines différences dans les performances entre sujets se situant à différentes étapes de l'apprentissage ont d'ailleurs été documentées, notamment par I. Pinter (1969), G. Chernov (1969) et P. Gerver (1974b), qui affirme d'ailleurs lui-même au début de sa synthèse sur la recherche en interprétation (1976:167) que les aptitudes qui se développent chez les interprètes ne: se retrouvent pas dans la population générale des bilingues.
En conséquence, i l apparaît également risqué de partir de l'hypothèse selon laquelle la prestation de sujets non formés ou en cours d'apprentissage serait un bon reflet des processus intervenant chez les professionnels confirmés, même s'ils présentent les aptitudes linguistiques et intellectuelles de base.
2.2.2 Les matériaux
De nombreux discours utilisés dans les expériences décrites ci-dessus sont des textes écrits. Or, généralement, ceux-ci diffè-rent sensiblement des discours spontanés par leur structure grammaticale, leur densité informationnelle, et (parfois) leur lexique (Halliday 1985). Il pourrait en résulter des différences sensibles, tant qualitatives que quantitatives, dans les processus engendrés dans l'interprétation. S'y ajoute le côté prosodique qui, comme le soulignent les^ chercheurs psychologues, peut influer fortement sur ces processus. L'importance pour l'interprète de la différence entre discours spontanés et discours lus est régulièrement soulignée par les praticiens, et a fait l'objet d'une thèse de doctorat (Déjean Le Féal 1978). Les expériences utilisant des discours lus ne sauraient donc a priori être considérées comme représentatives de situations sur le terrain autres que celles où l'interprète a affaire à des orateurs lisant des discours préparés à l'avance. "
S'y ajoute la question du type même de texte utilisé. En effet, en conférence, les textes lus appartiennent à un nombre restreint de catégories. Ce sont le plus souvent des discours officiels, des communiqués de presse, de courts extraits de textes réglementaires et judiciaires, des résolutions, des communications scientifiques, dont chacun présente peut-être des difficultés spécifiques et donne peut-être lieu à des processus et tactiques d'interprétation différents. On peut se demander dans quelle mesure les proce3sus engagés lors de la traduction
46 DANIEL GILE
des textes utilisés dans les expériences des années 60, tels que des articles du Courrier de l'UNESCO,/voire des phrases isolées ou des mots isolés (Treisman 1965), sont comparables à ceux qui interviennent dans 1 interprétation simultanée sur le terrain.
2.2.3 Les conditions expérimentaies
Un autre problème réside dans le fait que dans plusieurs expériences, les interprètes n'ont pas travaillé dans leur combinaison linguistique habituelle (Barik 1973, 1975, Oléron et Nanpon 1964), ce qui est susceptible d'avoir modifié certains processus, les sujets n'ayant pas nécessairement dans ces combinaisons linguistiques inhabituelles les mêmes réflexes et tactiques que dans leurs prestations usuelles (voir Nowak-Leeman 1990).
De manière plus générale se pose la question de savoir si les processus intervenant en laboratoire, c'est-à-dire dans un environnement artificiel, où l'interprète ne réagit pas à un véritable objectif de communication et à l'ensemble des stimulations présentes en salle de conférence, y compris les réactions du public, sont comparables à son travail en situation réelle. Il s'agit là de l'un des problèmes les plus fondamentaux de la recherche expérimentale en général, qui se pose dans bien d'autres disciplines, surtout dans les sciences humaines (voir Gile 1990g).
2.2.4 Les définitions, inferences et évaluations
Dans ces premiers travaux des psychologues apparaissent aussi des problèmes ayant trait à des définitions et des raisonnements. Certains relèvent du simple bon sens. Il en est notamment ainsi de l'idée de l'utilisation des pauses de l'orateur par l'interprète pour réduire le temps où i l devra parler et écouter en même temps, postulée par H. Barik et F. Goldman-Eisler, et contestée par D. Gerver (voir plus haut).
D'autres faiblesses ont une nature plus fondamentale. Ainsi, dans une analyse de la recherche sur l'interprétation simultanée, C. Stenzl (1983) note des problèmes dans la définition de la qualité du travail en interprétation. ' Sont concernées plus spécialement les « erreurs et omissions », définies par Barik et par Gerver — de manière « purepient subjective » de l'aveu de ce dernier (1976: 186). Pour objectiver quelque peu ces cri-
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 47
teres, i l fait appel à deux évaluateurs, qui avaient une expérience « de la correction de traductions écrites jusqu'au niveau de la première année d'université ». On peut douter de l'équivalence a priori de l'évaluation à la lecture de textes écrits avec l'évaluation à l'écoute de discours oraux. Les différences ne tiennent pas seulement à des critères purement linguistiques (on sait que l'oral est plus tolérant que l'écrit à la grammaire formelle, et que des informations peuvent passer sans être verbalisées à travers des indices visuels ou vocaux), mais aussi aux stratégies de fidélité des interprètes (Ch. 5), qui ne correspondent pas nécessairement à celles des traducteurs. Ainsi, les interprètes peuvent décider de modifier quelque peu un texte tout en lui préservant sa valeur sémantique (l'une des catégories d'erreurs' selon Barik) là où les traducteurs hésiteraient. De même, les interprètes peuvent vouloir ajouter' un mot ou une expression par rapport à ce qu'a dit l'orateur pour être plus clairs au bénéfice des destinataires, par exemple s'ils supposent que ces délégués n'ont pas une très bonne connaissance de la langue d'arrivée, là où les traducteurs hésiteraient à prendre la même liberté. La question n'est pas de savoir si les définitions et stratégies des interprètes sont bonnes dans l'absolu, mais quand on examine l'effet de facteurs perturbateurs sur l'interprétation, i l paraît raisonnable de cerner et de mesurer les déviations par rapport aux buts recherchés par les interprètes dans leur discours, et non pas les écarts par rapport à des définitions de tiers, dont on ne sait pas dans quelle mesure elles correspondent à ce que recherchent les interprètes. On notera aussi, à propos de H. Barik, qu'il prend le risque de déterminer non seulement la nature des erreurs, mais aussi leur origine (notamment l'incompréhension et le retard excessif pris par l'interprète par rapport à l'orateur), sans toutefois indiquer comment i l trouve celle-ci.
On évoquera aussi l 'EVS ou décalage temporel entre la réception d'un message par l'interprète et sa reformulation en langue d'arrivée. Comme le souligne C. Stenzl en citant M. Lederer (1981a), l 'EVS est difficile à mesurer, car un mot peut être restitué par une paraphrase, par un trait prosodique ou par d'autres moyens, et non pas par un mot précis en langue d'arrivée. En revanche, i l est possible de mesurer l 'EVS pour les débuts et fins de phrase, ce qui peut présenter un certain intérêt : en effet, la mise en évidence d'une différence sensible entre l'EVS moyen selon le couple langue de travail-langue d'arrivée pèserait en faveur de l'hypothèse de la dépendance de l'interprétation à l'égard de la combinaison linguisti-
48 DANIEL GILE
que, thèse combattue par certains théoriciens (voir Ch. 8). Toujours à propos de l'EVS et de l'hypothèse de D. Gerver (1976 :175) selon laquelle les interprètes accepteraient de sacrifier la précision au maintien dun EVS constant, i l n'est pas déraisopnable de penser que les interprètes cherchent un équilibre entre un EVS court ne risquant pas de surcharger leur mémoire à court terme d'une part, et un recul suffisant leur permettant de reformuler une information suffisamment complète et bien assimilée d'autre part. Toutefois, considérer le maintien d'un EVS constant comme un but en soi s'opposant à la recherche de la fidélité informationnelle, c'est méconnaître profondément la mission et les priorités des interprètes telles qu'ils les voient (Ch. 5).
C'est donc bien essentiellement la méconnaissance de l'interprétation qui fait la faiblesse de ces travaux expérimentaux de la première génération. Ces insuffisances, mais aussi, peut-on penser, le fait même que des chercheurs scientifiques se soient intéressés à l'interprétation, ont poussé les praticiens à réaliser leurs propres tentatives.
3. La période des praticiens : les années 70 et 80
3.1 Introduction
Les recherches menées par les psychologues et psycholinguistes sur l'interprétation ne satisfaisaient pas les praticiens, en ce sens qu'elles n'apportaient pas de résultats applicables susceptibles d'aider ces derniers à améliorer leur prestation ou à mieux former leurs futurs confrères. Les praticiens étaient également déçus au vu des faiblesses méthodologiques que présentaient ces premiers travaux expérimentaux. Dans le même temps, la réflexion personnelle et théorique sur l'interprétation prenait de l'essor dans les écoles rattachées à des universités, notamment à Paris. C'est ainsi que naquit un mouvement parallèle d'interprètes, essentiellement des enseignants, qui décidèrent de chercher des réponses à leurs questions par leurs propres moyens.
Dans plusieurs pays, les praticiens commencèrent à réfléchir sur les mécanismes sous-tendant l'interprétation. De nombreux articles parurent dans les organes des écoles, puis dans le Bulletin de l'AIIC, ainsi que dans différentes revues de traduction et autres périodiques. Puis les thèses d'interprètes se multiplié-
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 49
rent, avec notamment la mise en place d'un cursus de 3 e cycle en traduction et en interprétation h l'ESIT à Paris.
En 1977 fut organisée à Venise, à l'initiative de deux psychologues, D. Gerver et H. Wallace Sinaiko, une réunion entre chercheurs dans les sciences linguistiques et comportementales d'un côté, et les interprètes de l'autre, en vue d'échanger des idées et d'élaborer des projets de coopération dans la recherche entre les deux communautés (Gerver et Sinaiko 1978). Sur ce plan, le colloque fut un,échec, les praticiens rejetant la démarche des scientifiques, et i l n'y eut pas de suite. Comme le fait remarquer Laura Gran de Trieste (Gran et Dodds 1989:11), ce fut le début d'une longue période, quelque dix ans, marquée par une absence presque totale de dialogue entre les praticiens et la communauté scientifique. Il semble en effet qu'à l'exception des chercheurs soviétiques, qui, si l'on en juge d'après les comptes rendus qu'en font H . Salevsky (1987a) et G. Chernov (1992), semblent s'être intéressés depuis toujours à la psychologie, à la linguistique et à la recherche empirique, les praticiens auteurs d'études sur l'interprétation semblent dans l'ensemble avoir, délibérément ou non, ignoré les connaissances et les méthodes de la communauté scientifique.
3.2 Caractéristiques générales de la période
Avant d'analyser de manière plus détaillée l'activité de théorie et de recherche menée pendant cette période, i l semble intéressant d'en indiquer en synthèse les principales caractéristiques :
3.2.1 Une activité de recherche menée par des praticiens-ensei-• ' gnants
Entre le milieu des amiées 70 et le milieu des années 80, la quasi-totalité des travaux de recherche et de théorisation sur l'interprétation ont été menés par des praticiens ou des enseignants de l'interprétation. Les derniers travaux de H. Barik et de E Goldman-Eisler datent du début de la décennie, et la dernière publication de D. Gerver est le volume d'actes de la conférence de Venise citée ci-dessus. A partir de ce moment là et jusque vers le milieu des années 80, la grande majorité des écrits réflexifs, théoriques et empiriques sur l'interprétation — plusieurs centaines d'entrées dans notre bibliographie personnelle— sont signés de praticiens qui enseignaient l'interpréta-
50 DANIEL GILE
tion. On notera aussi une vingtaine de mémoires de fin d'études réalisés par des étudiants en Allemagne (à l'école de Heidelberg), en Italie (à l'école de Trieste) et au Japon (à la International Christian University de Tokyo).
Les principaux centres de réflexion sur l'interprétation durant cette période sont Paris (notamment l'ESIT), l'Allemagne, les Etats-Unis (notamment l'école de l'université de Georgetown, dans le troisième tiers de la période), Tokyo, Moscou et la Tchécoslovaquie. Les articles et livres de praticiens non-enseignants viennent surtout du Japon, avec des textes de type anecdotique.
Notons au passage que ces centres de réflexion ont une production très modeste, puisque d'après notre bibliographie personnelle, au total, à l'exception de la France en 1981, 1984 et 1985, aucun n'a produit plus de 10 publications par an durant cette période, la moyenne mondiale annuelle des textes produits, tous centres et toutes catégories confondues, étant de l'ordre de 10 entre 1970 et 1974, de 20 entre 1975 et 1979, et de 25 entre 1980 et 1984. En outre, ces centres tournaient autour d'un très petit nombre de théoriciens et chercheurs. Si l'on examine le nombre des auteurs de textes sur l'interprétation appartenant à chaque centre géographique, seules l'Allemagne, la France et l'Union Soviétique comptent plus de 10 auteurs. Au total, l'ensemble des textes durant cette période sont produits par quelque 80 auteurs. Il s'agit donc d'une petite communauté, très éparpillée à travers le monde.
3.2.2 L'essentiel des travaux est de type réflexif ou théorique
Par opposition aux années 60, au cours desquelles l'essentiel de la recherche a été mené par des chercheurs fortement orientés vers la démarche expérimentale, les années 70 se caractérisent par une augmentation relative de la masse des considérations fondées sur la seule expérience personnelle de chacun plutôt que sur une démarche d'observation systématique de phénomènes spontanés ou provoqués en laboratoire. Cette tendance personnelle se développe surtout en Occident, notamment en France. En même temps se cristallise dans les deux Allemagnes, à Heidelberg, puis à Germersheim en RFA et à Berlin et à Leipzig en RDA, un mouvement théorique axé sur la linguistique et couplé avec la recherche théorique sur la traduction écrite.
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 51
Cette caractéristique est fortement corrélée avec le fait que l'essentiel de la recherche est mené par des praticiens et des enseignants venant pour la plupart des disciplines littéraires, et plus particulièrement de l'étude des langues vivantes et des civilisations étrangères ; ni les uns ni les autres ne sont formés à la recherche empirique. Par ailleurs, celle-ci avance par petits pas : i l s'agit d'abord de recueillir des données ; puis des hypothèses sont élaborées, vérifiées à travers d'autres observations et expériences, corrigées le cas échéant, la progression étant très prudente. Ce type de démarche ne répondait manifestement pas à ce que cherchaient les praticiens et chercheurs, à savoir des réponses pratiques et quasiment immédiates pour leur permettre d'améliorer la qualité de leur travail ainsi que leurs méthodes de formation. Troisièmement, comme il est indiqué au Ch. 1, tant la motivation que la disponibilité manquaient pour ce type de travail au' long cours demandant, en plus de la partie créative, de longs efforts de traitement mécanique' des données (transcription, classement, comptage ou autres mesures, traitement statistique). On notera à cet égard que le faible volume de recherche empirique qui a tout de même été réalisé pendant cette période l'a surtout été dans les pays de l'Est, notamment en Union soviétique et en Tchécoslovaquie. Ce phénomène s'explique peut-être partiellement par le fait que les enseignants et praticiens y étaient fonctionnaires, avec des horaires relativement réguliers et des revenus plus ou moins indépendants du nombre de journées d'interprétation accomplies; dans les pays occidentaux, le statut libéral de la quasi-totalité des praticiens fait qu'ils donnent la priorité non pas à la recherche, mais à la pratique de l'interprétation, dont provient la quasi-totalité de leurs revenus même quand ils sont enseignants.
On mentionnera aussi les faiblesses méthodologiques des expérimentateurs, évoquées plus haut, qui ont jeté parmi les praticiens la suspicion non seulement à l'égard des psychologues et psycholinguistes, mais aussi à l'égard de la démarche expérimentale en tant que telle.
En revanche, la réflexion personnelle et la théorisation comportaient une grande part de création et très peu de travail de recueil et de traitement de données. Elles pouvaient se dérouler au domicile du chercheur, sans contrainte d'horaires, sans le passage obligé par l'apprentissage de méthodes d'élaboration de plans expérimentaux et de techniques statistiques, sans la rigueur d'une logique axée sur des domiées concrètes obtenues dans des situations précises. En outre, la réflexion personnelle
52 DANIEL GILE
et la théorisation permettaient aux chercheurs d'aborder d'emblée les questions qui fes intéressaient, à savoir les principes et théories directement applicables à la pratique de l'interprétation et de son enseignement. La tendance suivie dans la recherche par les praticiens et enseignants s'explique donc fort bien (voir aussi Moser-Mercer 1991).
3.2.3 Pes travaux fortement cloisonrjés
Durant les années 70 et jusque vers la fin des années 80, des travaux étaient réalisés dans plusieurs centres répartis dans le monde, en partie par des groupes de chercheurs constitués, comme à l'ESIT à Paris, en partie par des étudiants à l'occasion de leur mémoire de fin d'études, comme à Heidelberg et à Trieste, mais souvent aussi par des individus isolés. Qui plus est, si de nombreux chercheurs en interprétation dans différents pays étaient au courant des travaux menés à l'ESIT grâce à la puissante diffusion des écrits qui en émanaient, la grande majorité d'entre eux, y compris d'ailleurs les chercheurs de l'ESIT, ne savaient pas ce qui se faisait ailleurs. Au cours de nombreuses visites dans des universités et écoles d'interprétation dans différentes parties du monde depuis 1985, nous avons pu constater que les chercheurs que nous avons rencontrés ignoraient une proportion étonnante des travaux de leurs confrères dans d'autres pays, voire dans leur propre pays.
A cet état de fait, quatre explications possibles :
— Les obstacles linguistiques
Ceux-ci existent même au sein de la communauté des traducteurs et interprètes. On admettra sans difficulté que les Européens de l'Ouest et les nord-Américains n'aient pas pu lire les textes écrits en russe, en chinois ou en japonais. En revanche, l'explication linguistique ne tient pas pour les Japonais qui ne connaissaient pas les publications en anglais. L'obstacle linguistique explique aussi que de nombreux textes rédigés en allemand n'aient pas été lus en dehors des pays germanophones (voir Stenzl 1983, Snell-Hornby 1992). Ce dont on se rend moins compte, c'est que des textes rédigés en français sont restés inaccessibles à de nombreux chercheurs en interprétation, notamment en Asie et en Australie, mais aussi dans certains pays européens.
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 53
— Des barrières politiques
Elles expliquent surtout que l'information ait eu beaucoup de niai à circuler entre les pays de landen «bloc de l'Est» et les pays occidentaux, d'où la méconnaissance en Occident de ce qui se faisait en Union soviétique et en Tchécoslovaquie.
— La formation des praticiens à la recherche
Contrairement aux psychologues et psycholinguistes, les praticiens, qui n'ont pas été formés spécifiquement à la recherche, ne suivent pas la discipline de la recherche, et notamment ne cherchent pas systématiquement à prendre connaissance de tous les travaux réalisés sur un thème avant de l'aborder eux-mêmes. On est fondé à croire que s'ils étaient passés par cette étape dans leurs travaux plutôt que de ne se fonder que sur leurs propres observations et réflexions, la communication entre interprètes-chercheurs, au moins dans les pays occidentaux, aurait été sensiblement meilleure.
— Les attitudes
Il nous semble toutefois incontestable que dans certains cas au moins, le cloisonnement ait été le résultat non pas de facteurs extérieurs, mais de la volonté — en l'occurrence le manque de volonté — des chercheurs. Ce facteur est notamment manifeste chez les chercheurs japonais, qui ne semblent pas avoir cherché à connaître les écrits occidentaux sur l'interprétation. Lors d'un séjour de recherche d'un an au Japon entre août 1985 et septembre 1986, nous avons pu nous rendre compte que non seulement les Japonais ne lisaient pas ces textes, mais qu'ils s'en désintéressaient, probablement en raison de leur approche plus pragmatique que théorique et scientifique de l'interprétation. Plus frappant encore, le groupe de l'ESIT, dont les membres se citent constamment, mais ne se réfèrent quasiment jamais à des travaux sur l'interprétation extérieurs à leur école (voir Brisset 1993).
3.3 La « théorie du sens »
Pendant les années 70 intervient une véritable explosion des publications sur l'interprétation, qui se poursuit d'ailleurs dans les années 80. Dans cette masse de textes, le groupe de l'ESIT
54 DANIEL GILE
occupe une place très importante. Non seulement ses écrits en représentent près de 20 %, mais y figurent notamment un livre à grand succès, L'interprète dans les conférences internationales de D. Seleskovitch (1968), ainsi qu'une dizaine de thèses de doctorat, face à un total de cinq thèses soutenues ailleurs pendant la même période. C'est aussi dans les années 70 qu'a été créé à l'ESIT un programme d'études doctorales en traduction et en interprétation, le premier dans son genre (qui est d'ailleurs resté unique en France, alors que des chaires de traduction et interprétation ont été créées ailleurs, notamment en Autriche). Sous l'énergique impulsion de D. Seleskovitch, l'ESIT s'est fortement implantée au sein du groupe d'écoles dont proviennent la plupart des chercheurs et théoriciens de l'interprétation, et ses idées, notamment la 'théorie du sens', flatteuses pour l'interprétation et les interprètes, ont pris une position dominante au sein de la communauté des enseignants.
La 'théorie du sens', ou 'théorie interprétative de la traduction', postule que lors de la traduction, le traducteur (ou interprète) écoute le discours en langue de départ, en extrait le 'sens' ou 'message' en « oubliant volontairement » l'enveloppe linguistique en langue de départ (Seleskovitch 1968:35), puis reformule ce même 'sens' en langue d'arrivée sans référence à l'enveloppe linguistique initiale. Pour traduire, trois conditions doivent être réunies :
— La compétence traductionnelle, qui n'est pas définie explicitement.
— La maîtrise des langues de départ et d'arrivée, — Une bonne connaissance du sujet et de la situation de
communication.
A partir de là, le traducteur (ou interprète), qui est « l'égal intellectuel de l'auteur ou orateur » (Seleskovitch et Lederer 1984:165-166), est en mesure de traduire, et ce quelles que soient les langues de départ et d'arrivée, et sans difficultés particulières dues à la combinaison linguistique spécifique concernée (voir Ch. 8).
Ce schéma présente un attrait certain pour les enseignants-praticiens :
— D'une part, i l correspond à une stratégie réelle qui s'est cristallisée au fil des ans chez les interprètes, et qui a pour mérite de les délivrer de la lenteur et des dilemmes de la servitude comparatiste. L'interprète considère que son devoir de fidélité se rapporte au 'vouloir-dire' de l'orateur tel qu'il le perçoit, et ne s'attarde pas sur les éventuelles divergences entre
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 55
les paroles effectivement prononcées en langue de départ et les mots prononcés en langue d'arrivée. La 'théorie du sens' donne à cette stratégie une justification doctrinaire qui dispense sçs tenants d'une justification théorique ou expérimentale de ce concept de la fidélité :
«La pratique de l'interprétation a prouvé que cette latitude (à l'égard des mots du discours) critiquée dans le passé sur le plan traductologique théorique comme marque d'infidélité à l'égard de l'original, est le meilleur garant de la fidélité à son fond et à sa forme » (Seleskovitch et Lederer 1989 :251).
— La 'théorie du sens' est d'une grande simplicité, et son assimilation ne demande pas l'acquisition d'un bagage théorique. Les opérations de compréhension et de reformulation n'y sont pas analysées en détail. La théorie se contente d'indiquer que la compréhension s'appuie sur les connaissances linguistiques et extra-linguistiques existantes et sur les connaissances, linguistiques et extra-linguistiques, que fournissent la situation et le contexte.
— La 'théorie du sens' est valorisante pour l'interprète, en ce sens qu'elle met l'accent sur l'analyse qu'il effectue à tout moment, analyse qui le place haut sur le plan intellectuel, au-dessus du «linguiste» qui ne fait que « transcoder », c'est-à-dire chercher mécaniquement des équivalences linguistiques.
— Enfin, la 'théorie du sens' a des applications dans la formation des traducteurs et interprètes : elle asseoit la nécessité pour les étudiants de maîtriser parfaitement leurs futures langues de travail avant même d'entamer l'apprentissage du métier, et concentre fortement les efforts pédagogiques sur l'analyse plutôt que sur les équivalences linguistiques.
La solide implantation de la 'théorie du sens' dans la communauté des enseignants durant cette période peut également être attribuée à des facteurs sociologiques. En effe% son principal porte-parole, D. Seleskovitch, avait soutenu le premier doctorat français sur l'interprétation et créé le premier programme doctoral sur la traduction et l'interprétation en France. La série de thèses sur ^ l'interprétation soutenues à l'ESIT au cours des années 70 avait renforcé le prestige de l'école. Les idées qui y étaient défendues bénéficiaient naturellement de cette situation.
L'implantation de la 'théorie du sens' dans une position dominante a pendant de nombreuses années frappé d'un tabou les recherches linguistiques sur l'interprétation (voir Ch. 8). A cela s'ajoute un rejet catégorique de rexpérimentation qui, selon les tenants de la 'théorie du sens', ne saurait être une
56 DANIEL GILE
démarche de recherche valable, car elle ne peut reproduire l'ensemble des éléments de la communication sur le terrain, éléments qui jouent un rôle essentiel dans les processus de l'interprétation. Pour Seleskovitch et Lederer, seules les situations « authentiques » constituent Une bonne base pour l'observation de l'interprétation (Seleskovitch dans Seleskovitch et Lederer 1984:263).
Les faiblesses des travaux expérimentaux menés par les psychologues durant les années 60 et au début des années 70 y étaient pour quelque chose, mais peut-être y avait-il aussi une certaine attitude défensive de la part des praticiens-chercheurs : ayant trouvé leur terrain de chasse, ils marquaient leur territoire et le défendaient contre toute incursion étrangère en rejetant la démarche des scientifiques, et en allant jusqu'à poser que seuls les praticiens étaient qualifiés pour la recherche sur l'interprétation, les autres ne comprenant pas la nature de celle-ci. Cette attitude se manifeste d'ailleurs par un langage parfois assez violent. Ainsi, se référant aux erreurs commises dans les années 60, M . Lederer critique « certains psychologues, qu'il est plus charitable de ne pas nommer ici... » (Seleskovitch et Lederer 1984:146), et D. Seleskovitch affirme que « depuis près d'un siècle... [la psychologie] ...se contente d'étudier les réflexes conditionnés de petits rongeurs » (Seleskovitch et Lederer 1984:295).
3.4 Thèmes et réalisations
3.4.1 La formation
Pendant les années 70 et 80, les thèmes liés à la formation des interprètes ont sans aucun doute été ceux qui ont rassemblé le plus grand nombre d'écrits sur l'interprétation, que ce soit sous forme d'articles, de communications ou de livres. Même les textes ne traitant pas explicitement de ce thème comportent souvent des références aux applications en matière de formation.
Si l'on examine l'ensemble de ces publications, on s'aperçoit qu'il s'agit essentiellement de textes normatifs et réflexifs. On notera aussi la grande place qu'y prend la consécutive, et plus particulièrement la prise de notes. Les textes sont assez répétitifs, en ce sens qu'ils reprennent les mêmes idées, parfois contradictoires, et que les débats prennent la forme d'une succession • d'affirmations et contre-affirmations (notamment en
REGARDS SUR LA. RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 57
matière de 'shadowing', de travail vers la langue B, de chronologie dans la progression de la consécutive à la simultanée), sans tentatives d'approfondissement ou de vérification empirique.
Quelques tentatives de recherche ont néanmoins été faites (voir par exemple Moser 1978), mais elles ne semblent pas avoir été suivies d'applications au sein des écoles, qui ont préféré s'en tenir à des critères intuitifs. Actuellement, on peut considérer que les méthodes en cours dans les écoles les plus connues, teUes que décrites par exemple dans Delisle 1981 et dans Seleskovitch et Lederer 1989, relèvent toujours de l'intuition et non pas de la recherche. La recherche sur la formation est présentée plus amplement au Ch. 7.
3.4.2 Les modèles de l'interprétation
Si les chercheurs non interprètes, qui étaient pour la plupart psychologues cogniticiens et psycholinguistes, se sont penchés sur des questions précises relevant des processus linguistiques et psychologiques intervenant en interprétation, du côté des chercheurs-praticiens, en dehors de la formation, ce sont les modèles de l'interprétation qui semblent avoir fait l'objet des efforts de recherche les plus nombreux.
Le modèle le plus simple de l'interprétation est le concept « triangulaire » de la 'théorie du sens' expliqué plus haut.
Dans la même lignée, Mariano Garcia-Landa (1978) reprend le principe abstrait comprehension-reformulation et en explicite les paramètres théoriques à travers une formule à l'allure mathématique, en y ajoutant la différence qui peut intervenir entre le sens que l'orateur cherche à exprimer et celui que comprend l'interprète. M . Garcia-Landa reconnaît par là implicitement que la perception du discours de l'orateur par l'interprète n'aboutit pas à «La compréhension » dans l'absolu, comme semble l'impliquer le modèle triangulaire idéalisé défendu par D. Seleskovitch.
Marianne Lederer (1981) reprend l'idée d'une compréhension axée sur le « sens » plutôt que sur la « signification linguistique » des mots. Elle affine quelque peu l'analyse de la phase de compréhension en parlant d'une compréhension par « unités de sens » successives, qui sont l'élément de base opérationnel de l'interprétation, et précise que l'interprète de simultanée effectue huit actions qui se chevauchent dans le temps :
1. L'audition du discours
58 DANIEL GILE
2. La compréhension du discours 3. L'intégration des unités . de sens à des connaissances
antérieures 4. L'énonciation à partir de la mémoire cognitive 5. La restitution à partir de la langue originale (opération de
calque) 6. L'évocation de termes à partir de la mémoire vocale 7. Le contrôle auditif du discours d'arrivée 8. La prise de conscience de la situation ambiante
Marianne Lederer ne précise pas comment ces opérations s'intègrent les unes par rapport aux autres dans un processus cohérent, et ne fait pas intervenir dans son analyse les connaissances de l'époque en linguistique et en psycholinguistique.
Rappelons aussi le modèle de communication de H. Kirchhoff (1976), dit « modèle à trois participants et deux langues », où est montré le parcours d'un concept à partir de son codage linguistique, puis de son expression verbale par l'orateur, vers la compréhension' par l'interprète, qui se fait grâce à ses connaissances, puis, à travers le codage et l'expression verbale par l'interprète, vers sa compréhension par le destinataire. Ce modèle ne précise pas non plus les processus cognitifs.
Contrastant avec ces modèles très schématiques, les modèles de David Gerver (1976) et de Barbara Moser (1978) sont fondés sur la psychologie cognitive. Ils se décomposent eux aussi en une phase de compréhension et une phase de reformulation, et comportent différentes étapes de détection de caractéristiques phonétiques, d'analyses, de comparaisons entre des contenus de mémoires à court et à long terme, de décisions sur l'identité linguistique des segments de discours, puis une étape de production de discours qui est détaillée en termes de traitements linguistiques, d'opérations d'anticipation et de tests.
Enfin, i l convient d'évoquer deux modèles russes, celui de Chernov (1978) et celui de Shiryaev (1979). Pour ce dernier, la simultanée se compose de trois étapes : 1'« orientation », qui correspond à la compréhension, la « recherche », qui consiste en la prise de décisions de traduction, et 1'« exécution ». Les « niveaux de conscience » se déterminent par un « mécanisme de synchronisation », qui semble englober les opérations de gestion de la capacité de traitement (voir Ch. 4). D'après Chernov (1992), ce modèle n'a pas été soumis à une vérification empirique.
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 59
Le modèle de Chernov n'est pas une description du processus d'interprétation, mais une analyse des inferences, essentiellement de l'anticipation, qui se déroulent pendant l'interprétation. Chernov considère que le savoir pré-existant de l'interprète lui permet une certaine anticipation du contenu du discours de l'orateur, et que ce savoir s'enrichit au fil du discours et permet une anticipation de plus en plus fine à différents niveaux linguistiques et discursifs (le « pronostic probabi-liste »). Chernov postule aussi des déplacements de l'attention en fonction de la situation : quand le discours en langue de départ est suffisamment redondant, l'interprète déplace toute son attention vers la production de son propre discours ; inversement, quand des problèmes se posent dans la compréhension en raison de difficultés linguistiques ou autres, son attention est concentrée sur le discours en langue de départ, ce qui fait d'ailleurs que les erreurs commises éventuellement en langue d'arrivée ne sont plus corrigées. Chernov considère le pouvoir explicatif de son modèle comme supérieur à celui de Shi-ryaev (Chernov 1992).
Enfin, les modèles d'Efforts de Gile, présentés en détail au Ch. 4,. ne se focalisent pas sur le processus, mais tentent d'expliquer les problèmes récurrehts à travers l'examen des contraintes qu'implique l'interprétation en matière de capacité de traitement.
3.4.3 Autres études et thèmes
Parmi les autres thèmes qui ont mobilisé l'attention des praticiens pendant la période s'étendant des années 70 jusque vers le milieu des années 80, citons :
— La consécutive, et notamment la prise de notes en consécutive (voir par exemple Lampe-Gegenheimer 1972, Cerrens 1975, Henderson 1976, Xlg 1980 et 1982, Kirchhoff 1979, Capaldo 1980, Thiéry 1981, Gran 1981, Schweda-Nicholson 1985).
— Les questions linguistiques, et plus particulièrement les problèmes de connaissance des langues chez les interprètes, l'expression orale, le perfectionnement linguistique, le bilinguisme (voir Ch. 8).
— La comparaison entre la traduction et l'interprétation (Eberstark 1982, Gile 1986b et bien d'autres).
— La qualité du travail (voir le Ch. 6).
60 DANIEL GILE
— Les problèmes de santé et de stress chez les interprètes de conférence sont évoqués dans Kolmer 1981, Kurz 1981 et 1983c,d, Cooper, Davies et Tung 1982.
— Des questions psycho-sociologiques touchant essentiellement le statut des interprètes sont traitées dans Kurz 1983a, Zeller 1984, Rojas 1987, Kondo 1988.
— L'histoire de l'interprétation intéresse elle aussi quelques auteurs praticiens. Outre les comptes rendus sur les procès de Nuremberg et sur l'évolution de la profession sous sa forme moderne (Haensch 1956, Herbert 1978, Nishiyama 1988, Ramier 1988), i l existe quelques travaux sur l'interprétation dans l'antiquité et à d'autres moments de l'histoire (Glaesser 1956, une petite série d'articles d'I. Kurz enumeres dans la bibliographie en fin d'ouvrage, Bertone 1987, etc.).
Toutefois, la plupart des ces travaux (à l'exception des textes historiques) sont des essais de réflexion ou textes normatifs plutôt que des travaux de recherche proprement dits, et la grande majorité des centaines de textes qui ont été produits durant cette période sont assez éloignés de la recherche telle qu'elle se définit dans la plupart des disciplines universitaires.
Le tableau qui se dégage donc vers le milieu des années 80 est celui d'une recherche majoritairement axée sur la spéculation et la théorie, ne cherchant pas à renouer le contact avec la communauté scientifique, à vérifier les idées par les faits ou à découvrir des faits nouveaux.
Pourtant, i l existe un noyau d'interprètes-fortement motivés par la recherche qui ne se satisfont pas de cette situation, qui appellent à une recherche de type différent, et qui réalisent des projets plus conformes à la démarche scientifique. C'est sous leur impulsion, et notamment grâce à un environnement favorable créé à Trieste, que commence la période de renouveau dans laquelle nous nous trouvons actuellement.
Chapitre 3
Tendances récentes dans la recherche sur l'interprétation
1. Introduction
En novembre 1986, la Scuola Superiore per Interpret! e Tra-duttore (SSLM), école de traduction et d'interprétation de l'Université de Trieste, organisait une grande conférence sur les « aspects théoriques et pratiques de la formation à l'interprétation » (Gran et Dodds 1989). Au cours de cette réunion, quelques idées fortement ancrées dans le dogme dominant furent contestées ouvertement pour la première fois dans une telle enceinte, et des appels furent lancés pour une collaboration avec les chercheurs des autres disciplines potentiellement concernées. Cette conférence marque un tournant dans la recherche sur l'interprétation et le début d'une nouvelle période, qui se poursuit actuellement.
En réalité, si la conférence de Trieste apparaît comme un repère symbolique, le renouveau couvait depuis un certain temps déjà. Dès le début des années 80, voire quelque peu avant, des signes avant-coureurs de l'évolution apparaissaient timidement. Ainsi, en 1979, Linda Anderson, interprète de conférence, soutenait au Canada une étude de M.A. dans laquelle elle mesurait l'effet sur la prestation de l'interprète d'une connaissance préalable du contenu du discours, et de la présence ou de l'absence de l'image de l'orateur devant l'interprète (sur moniteur cathodique). En 1983, Jennifer Mackintosh, également interprète, soutenait à Londres un travail de M.A. expérimental sur l'interprétation avec relais. Toujours en 1983, Catherine Stenzl de Londres soutenait une 'thèse' de M.A. dans laquelle elle analysait la recherche passée et appelait vigoureu-
62 DANIEL GILE
sèment à la recherche empirique. Au cours des années 1980, Gile réalisait quelques études empiriques, notamment sur la constitution d'énoncés à partir de messages non verbaux (voir Ch. 6), sur la détérioration de la qualité du français des élèves interprètes au cours des exercices d'interprétation (Gile 1987), sur la sensibilité dès informateurs aux fautes et maladresses de langue (Gile 1985a), sur la perception de certains types d'homophones dans la compréhension du japonais à l'écoute (Gile 1986e).
Toutefois, à l'époque, les chercheurs désireux d'adopter une démarche plus proche de la recherche scientifique étaient isolés face au paradigme dominant. C'est à l'occasion de la conférence de Trieste que se sont manifestées pour la première fois de manière très nette des convergences autour d'un nouveau paradigme, ce qui a donné une forte impulsion au mouvement auquel nous assistons actuellement.
Ce chapitre décrit les tendances présentes à travers l'analyse des activités des différents centres, et de la forme et du contenu des recherches proprement dites.
2. Les centres nouveaux ou en renouvellement
Comme il est expliqué au chapitre 1, la recherche sur l'interprétation se fait à partir d'un petit nombre de centres, dont une dizaine représentent l'essentiel de la production de textes sur le plan mondial Sous cet angle, la situation reste inchangée depuis le début des années 80.
En outre, la composition des centres constitués au cours des années 70 et avant a peu évolué : dans la plupart des cas, les chercheurs et théoriciens sont enseignants et praticiens, et à quelques noms près, les principaux auteurs de publications restent les mêmes. Les types de textes provenant de ces auteurs restent eux aussi sensiblement les mêmes, avec une majorité de textes de réflexion ou théoriques, consacrés à des questions de formation, aux ressemblances et différences entre traduction et interprétation, à la consécutive, aux conditions de travail des interprètes, à leur qualification, à l'histoire de l'interprétation. Dans ces centres, la recherche empirique est quasiment inexistante (à l'exception toutefois des travaux soviétiques et quelques autres travaux dans les pays de l'Est), que ce soit à l'ESIT, à TETI de Genève, dans les différents centres allemands, ou aux Etats-Unis.
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 63
En revanche, on a vu apparaître depuis le milieu des années 80 quelques nouveaux centres, qui se sont avérés particulièrement productifs. Par commodité, nous les désignons ici par la région, le pays ou la ville où ils se trouvent, car si certains sont des écoles, d'autres correspondent à une concentration géographique de chercheurs et d'études sans identité institutionnelle :
2.1 L'Australie
Les textes australiens sur l'interprétation de conférence étaient quasiment inexistants jusqu'en 1989, date de la publication des actes de la conférence de Trieste (Gran et Dodds 1989). A cette occasion parut un article descriptif général du marché australien de l'interprétation par A. Gentile (1989) du Victoria College, Victoria. Depuis 1991, l'activité australienne s'est grandement développée dans la réflexion et la recherche sur l'interprétation, notamment grâce à l'impulsion donnée par le Key Center for Asian Languages and Studies de l'université du Queensland à Brisbane, spécialisé dans la traduction et l'interprétation anglais-japonais, qui a organisé les deux premières conférences nationales australiennes sur la traduction et l'interprétation. Parmi les articles publiés par des chercheurs australiens figurent notamment des travaux empiriques réalisés par Peter Davidson et Ng Bee Chin, qui avait été engagée par le Key Center pour entreprendre des travaux de recherche sur la traduction et l'interprétation (voir bibliographie en fin d'ouvrage). La création de ce poste de recherche en traductologie dans une école de traduction et d'interprétation reste à notre connaissance une initiative . rare. Notons en passant qu'il n'existe plus, ayant été remplacé par un poste de chercheur en enseignement des langues, mais que le centre de Brisbane reste actif dans la recherche traductologique. C'est notamment lui qui, avec la Japan Association of Translators de Tokyo, organise la série des conférences IJET — International Japanese/English Translation Conference, et qui a accueilli la quatrième de la série, en juillet 1993.
Quelques autres universités australiennes s'intéressent à la traduction et à l'interprétation. Notons en particulier la University of Western Sydney Macarthur, où un programme de M.A. en traductologie a été créé en 1992.
64 DANIEL GILE
2.2 Le Japon
Comme i l est expliqué au Ch. 2 (voir aussi Gile 1988c), les. publications japonaises sur l'interprétation étaient depuis 1961 assez nombreuses, avec une dizaine de livres et de nombreux articles anecdotiques et introductifs. Rappelons à ce propos que l'interprétation est, dans l'esprit du public japonais, une activité fortement associée à ce qui y est considéré comme une véritable discipline, à savoir la maîtrise de l'anglais, et la grande majorité des publications sur l'interprétation entrent dans la rubrique des textes sur l'apprentissage de l'anglais. C'est notamment le cas d'un assez ambitieux projet de recherche réalisé en 1991 à l'université Sainte Sophie de Tokyo (voir ci-dessous), qui, bien que portant sur l'interprétation de conférence, est présenté comme un projet sur l'enseignement des langues étrangères à travers l'enseignement de l'interprétation.
Cependant, la recherche proprement dite était totalement absente du Japon, et la communication avec le reste du monde était elle aussi inexistante. C'est à la fin des années 80 que, sensibilisé par la recherche à l'étranger, Masaomi Kondo, interprète de conférence et professeur d'économie, résolut de lancer une véritable activité de recherche au Japon. Il créa en novembre 1990 la Interpreting Research Association of Japan et lança une revue de recherche, Tsûyakurironkenkyû {Interpreting Research), dont le premier numéro parut en juillet 1991. La plupart des membres de l'association enseignent l'interprétation dans des écoles privées, et se préoccupent essentiellement des problèmes de formation. Les numéros de Interpreting Research parus jusqu'ici comportent surtout des essais, avec quelques études de cas, des réflexions sur la profession d'interprète, un questionnaire, des comptes rendus sur des cours de formation, et, dans les trois derniers numéros, des comptes rendus et bibliographies.
Par ailleurs, une assez importante opération de recherche comprenant notamment plusieurs études empiriques a été lancée à l'université Sainte Sophie de Tokyo (Watanabe 1991, voir Section 4 plus loin et notre compte rendu Gile 1992d). Il semblerait que ce projet n'ait pas abouti à la formation d'une équipe de recherche stable au sein de ladite université, et qu'il n'ait pas eu d'autre suite.
D'autres auteurs japonais publient des articles sur la traduction à titre individuel ou pour le compte d'une entreprise de traduction. La communication entre les chercheurs japonais
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 65
semble quasiment inexistante, à l'exception de la communication interne au sein de la Interpreting Research Association, qui est bien organisée, avec des réunions régulières programmées. Cet isolement des théoriciens et chercheurs japonais à l'intérieur de leur propre pays reflète aussi le morcellement du marché professionnel de l'interprétation au Japon.
Les initiatives entreprises ces dernières années, bien que peu nombreuses, montrent la capacité des Japonais de mobiliser des forces impressionnantes quand ils le souhaitent. On trouve notamment dans le projet de l'université Sainte Sophie une étude sur 129 sujets (Izumi 1991), taille d'échantillon inégalée jusqu'ici dans les travaux sur l'interprétation. Le Japon, totalement absent en matière de textes théoriques et de recherche jusqu'en 1991, est devenu le centre le plus productif au cours de la période 1990 à 1992, avec 32 textes rédigés par 27 auteurs. Au cours de la même période, l'Italie, deuxième en nombre de textes publiés, en a produit 29, et la France en a contribué 27 (d'après notre bibliographie personnelle). Cependant, pour le moment, en l'absence d'un programme complet de formation à l'interprétation dans un institut universitaire (à part quelques cours isolés, notamment à l'université Sainte Sophie), i l n'existe pas de motivation à la recherche proprement dite, si ce n'est une certaine stimulation de l'extérieur à travers des contacts avec le Key Center de l'université du Queensland et avec quelques chercheurs européens. L'avenir de la recherche au Japon dépend à notre avis de l'institutionnalisation de l'interprétation comme discipline universitaire à part entière, ce que réclame d'ailleurs avec insistance M. Kondo (voir par exemple 1991).
2.3 Trieste
Si les premiers textes triestins sur l'interprétation datent du début des années 80, au cours de la deuxième moitié de la même décennie, la recherche à la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori de l'université de Trieste a connu une intensification spectaculaire, triplant par rapport à la première moitié. Plus significatif, la plupart de ces textes sont des mémoires de diplôme (« Graduation thesis ») et des articles les résumant, ce qui assure un renouvellement permanent de la recherche. Sur le plan des effectifs des chercheurs, le centre triestin est d'ailleurs le plus grand au monde, avec
66 DANIEL GILE
une trentaine d'auteurs de publications sur l'interprétation (ce chiffre comprend les auteurs des mémoires de fin d'études).
Autres caractéristiques importantes du centre triestin : — La recherche empirique y a une place de choix, ce qui
tranche avec tous les autres centres (voir Gran et Taylor 1990) — La recherche interdisciplinaire y est fermement implantée,
essentiellement dans la coopération avec la neurophysiologie (voir Section 4.1)
— L'école de Trieste est à l'origine d'une intense activité de publication, et édite une revue de recherche, The Interpreters Newsletter.
A bien des égards, le centre triestin est donc exemplaire.
2.4 La région Scandinave
Les Scandinaves, très peu connus dans le domaine de la recherche traductologique jusqu'aux années 80, ont fortement intensifié leurs activités ces dernières années et se sont sensiblement ouverts sur la communauté traductologique internationale, notamment à travers la série des « Language International Conferences » ' sur l'enseignement de la traduction et l'interprétation (voir Dollerup et Loddegaard 1992 et Dollerup et Lindegaard 1994), et l'activité régulière de S. Tirkkonen-Condit en faveur de la recherche empirique en traductologie (Tirkkonen-Condit 1991 et Tirkkonen-Condit et Laffling 1993). Ces deux activités ont une audience internationale. Les pays nordiques tiennent également des colloques périodiques internes, les SSOTT ou « Scandinavian Symposium on Translation Studies », dont le quatrième, qui s'est tenu à Turku en Finlande (Gambier et Tommola 1993), a attiré lui aussi une participation internationale. Enfin, l'école de Turku a organisé en coopération avec l'école de Trieste et l'ISIT à Paris une conférence internationale sur l'interprétation en août 1994.
Un certain renouvellement de la recherche y est assuré par le système des mémoires, qui a produit plusieurs travaux intéressants en traductologie, et notamment des mémoires sur l'interprétation, qui proviennent de plusieurs universités finlandaises (mais qui sont peu accessibles pour les chercheurs étrangers, étant écrits en suédois ou en finnois sans traduction en anglais). Par ailleurs, plusieurs travaux sur l'interprétation sont en cours au Danemark.
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 67
2.5 L'Autriche
L'Autriche est un centre relativement ancien, d'où sont issus plusieurs chercheurs connus et actifs : I. Kurz, H. Bühler, M. Bowen (actuellement à Georgetown, aux Etats-Unis), B. Moser-Mercer (actuellement à Genève).
L'école de Vienne est d'ailleurs l'un des centres où les étudiants préparent des mémoires de fin d'études, dont certains consacrés à l'interprétation (voir par exemple Zeller 1984). Ces derniers sont toutefois peu nombreux, et le nombre d'auteurs autrichiens de publications sur l'interprétation est faible, une petite dizaine. A l'heure actuelle, la recherche à Vienne se démarque surtout par sa qualité, grâce notamment à une longue et dynamique activité de I. Kurz. Deux doctorats sur l'interprétation (Pöchhacker 1992 et Strolz 1992) ont également été soutenus récemment. De manière plus générale, la directrice actuelle de l'école de Vienne, M . Snell-Hornby, lui a imprimé un fort élan dans le sens de la recherche, qui s'est manifesté entre autres par la tenue en 1992 d'une grande conférence sur «La traductologie comme interdiscipline » et par la création, lors de cette conférence, d'une société savante européenne de traductologie, la « European Society for Translation Studies ». Une deuxième école de traduction et d'interprétation, rattachée à l'université de Graz, s'intéresse également à la recherche, avec quelques projets en cours.
2.6 L'Allemagne
En Allemagne, plusieurs centres universitaires ont été à l'origine de textes sur l'interprétation. Notons plus particulièrement l'école de Heidelberg, à laquelle appartiennent quelques 40% des auteurs allemands, et les centres de l'ex-Allemagne de l'Est, surtout Berlin (voir les références concernant les travaux de H. Salevsky dans la bibliographie en fin d'ouvrage) et Leipzig, où l'on connaît bien les travaux soviétiques.
Les récents événements politiques qui ont aboli le rideau de fer ont permis aux chercheurs de l'Est et de l'Ouest de mieux communiquer. Notons par ailleurs que les chercheurs allemands en interprétation se situent dans la mouvance de la Translationswissenschaft, la traductologie au sens large, et que leur optique est plus théorique qu'empirique et fortement rat-
68 D A N I E L G I L E
tachée à la linguistique, et plus spécialement à la linguistique textuelle (« Textlinguistik »).
2.7 La Suisse
Comme i l est expliqué au Ch. 2, avec les travaux des professeurs de l'Ecole de Traducteurs et d'Interprètes de l'université de Genève tels que J. Herbert (1952), J.-F. Rozan (1959) et G. Ilg (voir bibliographie en fin d'ouvrage), la Suisse a été le premier centre de réflexion sur l'interprétation dès les années 50. Les interprètes suisses ont continué à produire des essais sur l'enseignement de l'interprétation, notamment dans Parallèles, l'organe de l'ETI. Ils n'ont toutefois que peu abordé des questions plus théoriques et n'ont pas entrepris de recherches proprement dites, avec la notable exception de B. Moser-Mercer. Depuis le début des années 90, Parallèles suit de près l'évolution de la recherche sur l'interprétation à travers des comptes rendus réguliers, rédigés pour la plupart par G. Ilg. Dans sa philosophie comme dans la qualification de la plupart de ses enseignants, l'ETI reste toutefois une école à vocation professionnelle, et non pas à vocation de recherche.
2.8 Les républiques tchèque et slovaque
En ex-Tchécoslovaquie, des praticiens et universitaires réfléchissent depuis de nombreuses années à l'interprétation, et plusieurs dizaines de textes, dont quelques thèses de doctorat, y ont été publiées. Cependant, la quasi-totalité de ces publications étaient en langue tchèque, et la situation politique avait gardé la Tchécoslovaquie dans un isolement quasiment total par rapport à l'Occident. Depuis l'ouverture des pays de l'Est, la situation a considérablement changé. Le périodique Acta Universitatis Carolinae Translatologica Pragensia de l'université Charles de Prague en est à son cinquième volume, et l'on y trouve plusieurs articles sur l'interprétation. Par ailleurs, la même université a organisé en octobre 1992 une conférence internationale sur la traduction et l'interprétation, et plusieurs interprètes tchèques et slovaques effectuent des visites et des stages dans des écoles de traduction et d'interprétation d'Europe occidentale. L'activité de recherche proprement dite est actuellement faible dans les républiques tchèque et slovaque, notamment pour des raisons économiques. En effet, par rap-
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 69
port à l'interprétation, relativement bien rémunérée, les traitements des enseignants universitaires et chercheurs sont très faibles. La déficience motivationnelle qui en résulte et qui s'ajoute à l'absence de considération à l'égard des traductolo-gues de la part des autres universitaires pose un problème structurel fondamental. Les perspectives de développement en l'absence d'une solution à ce problème sont difficiles à estimer. A cet égard, la récente décision de créer un programme de doctorat en traductologie à l'université Charles de Prague est encourageante.
2.9 L'Asie hors-Japon
Hormis le Japon, centre fortement activé ces dernières années, seules les régions chinoises se sont manifestées à travers des textes de réflexion ou de recherche sur l'interprétation. D'après notre bibliographie, depuis 1987, une dizaine de publications chinoises y ont. été consacrées, dont la moitié environ viennent de Hong Kong et un tiers de la nouvelle école de traduction et d'interprétation de l'université Fu Jen à Taipei. Il est probable qu'il existe d'autres publications en chinois de Chine continentale auxquelles les chercheurs du reste du monde n'ont pas accès.
Ces publications sont à l'évidence très peu nombreuses, et ne justifient pas encore l'appelation « centre de recherches » pour la région chinoise. Cependant, depuis la fin des années 80, on voit quelques participants chinois aux conférences de traductologie. Le système des mémoires de fin d'études à l'école de l'université Fu Jen, qui a déjà produit une étude socioprofessionnelle sur l'interprétation (Tseng 1992), permet lui aussi d'espérer une certaine accélération de l'activité.
3. Autres centres et activités individuelles
3.1 La France
Comme i l est indiqué au Ch. 2, pendant la période dite « des praticiens », et surtout au cours de la première moitié des années 80, la France a eu un rôle important dans le milieu de la réflexion théorique sur l'interprétation, surtout par la voie de l'ESIT. La situation a sensiblement changé depuis la deuxième moitié de la décennie. En effet, alors que de nou-
70 D A N I E L G I L E
veaux centres apparaissaient et que la recherche s'orientait vers des idées et expériences nouvelles, l'équipe de l'ESIT n'a pas suivi. A l'exception d'un livre normato-refléxif de D. Seleskovitch et M . Lederer (1989) sur l'enseignement de l'interprétation, ainsi que d'une thèse théorico-normative sur la fidélité en traduction (Donovan 1990), l'ESIT a été peu active. Les travaux de D. Gile, relativement nombreux, sont ceux d'un invididu, et non pas d'un groupe.
3.2 Les Etats-Unis
Aux Etats-Unis, la plupart des textes sur l'interprétation ont pour auteurs D. et M . Bowen, de la division de traduction et d'interprétation de l'université de Georgetown. Son organe trimestriel, The Jerome Quarterly, se compose en général de brefs articles qui relèvent de la vulgarisation.
Quelques rares textes viennent aussi de l'école de traduction et d'interprétation du Monterey Institute of International Studies (MHS 1989, Weber 1984). D'autres ont été publiés par la American Translators Association, dans les actes de ses conférences annuelles et dans la Scholarly Monograph Series, qui comprend notamment un volume consacré à l'interprétation (D. et M . Bowen 1990). Là aussi, à l'exception de quelques textes de N. Schweda-Nicholson rapportant des études empiriques, i l s'agit d'essais réflexifs, de textes sur la formation et de textes historiques. Enfin, récemment apparu sur la scène, l'interprète de langue des signes Bill Isham (1993) apporte à travers une démarche expérimentale une contribution prometteuse à la recherche sur les aspects psycholinguistiques de l'interprétation.
3.3 Le Canada
Le Canada, pays bilingue, est particulièrement actif dans la recherche sur la traduction et la terminologie, avec de multiples centres universitaires, une recherche florissante et de nombreuses publications, dont des revues de haut niveau au Québec. Il présente aussi une certaine activité universitaire dans le domaine de l'interprétation de liaison et d'interprétation auprès des tribunaux. En comparaison, en matière d'interprétation de conférence, l'activité de recherche y est singulièrement faible, les apports étant essentiellement individuels.
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 71
Depuis le mémoire de M.A. de L. Anderson, en 1979, la seule activité de recherche suivie est celle de S. Lambert de l'université d'Ottawa, à laquelle s'ajoute occasionnellement un article ou projet de recherche isolé, tel que le doctorat de M . Dillinger i l 989).
3.4 L'Amérique latine
L'amérique latine est elle aussi un centre actif de formation et de réflexion sur la traduction, comme il apparaît à la lecture de Informaciones SUT, le bulletin du service latino-américain d'information sur la traduction de l'UNESCO. Cette activité se traduit notamment par de nombreuses conférences et échanges entre les pays de la région. Toutefois, en dépit de ses contacts avec l'Espagne, l'Amérique latine est peu connue pour ses activités traductologiques en Europe, probablement pour des raisons linguistiques d'une part, mais aussi et surtout pour des raisons financières, car l'argent manque aux chercheurs latino-américains pour se rendre en Europe et y participer aux colloques et conférences traductologiques. En matière de recherche sur l'interprétation, on évoquera surtout plusieurs mémoires de fin d'études faits à l'ISIT à Mexico. Il existe peut-être d'autres travaux, inconnus en Europe, comme le donne à penser une récente lettre personnelle que nous avons reçue de la part d'une enseignante cubaine, Lourdes Arencibia Rodriguez, à laquelle elle joignait des copies de quelques textes didactiques et réflexifs non publiés dont elle est l'auteur, en évoquant les difficultés matérielles auxquelles se heurtent les enseignants et chercheurs sur place, notamment le manque d'argent et de papier.
3.5 Autres pays
Les autres pays ont une activité quantitativement très restreinte, avec de rares articles écrits par un ou quelques praticiens ou enseignants. Ainsi, la seule recherche connue actuellement en Pologne est celle d'A. Kopczynski ; le seul auteur bulgare connu est B. Alexieva ; en Israël, on citera Ruth Morris, auteur de quelques publications sur l'interprétation lors du procès de • John Ivan Demjanjuk, et M . Shlesinger, dont la recherche est plus variée. Il existe d'autres auteurs européens, américains, africains et asiatiques, parfois réputés dans la com-
72 D A N I E L G I L E
munautë internationale de la recherche sur l'interprétation, mais dont la position est individuelle, et non pas représentative d'un centre géographique ou institutionnel.
La faible productivité collective de ces pays ne saurait toutefois être considérée comme un bon indicateur de leur contribution à la recherche sur l'interprétation. En effet, dans l'état embryonnaire de celle-ci, seule une fraction des textes publiés comporte une innovation factuelle, conceptuelle ou méthodologique, la plupart étant plutôt répétitifs. Dans ces conditions, la contribution de chaque chercheur individuel peut être bien plus grande que dans les disciplines mieux établies, où des normes scientifiques sont plus régulièrement respectées. C'est ainsi que deux auteurs canadiens (L. Anderson et S. Lambert), un auteur israélien (M. Shlesinger), un auteur bulgare (B. Alexieva), un auteur polonais (A. Kopczynski), ont peut-être contribué davantage par la nature de leur recherche, en partie empirique, qu'un plus grand nombre d'auteurs dans des centres plus productifs quantitativement.
4. Nature et thèmes de la recherche
Comme i l est indiqué au début de ce chapitre, dans sa structure fondamentale, l'environnement de la recherche en interprétation n'a pas beaucoup évolué depuis les années 70 et 80. En effet, la quasi-totalité des chercheurs sont aujourd'hui encore praticiens et/ou enseignants de l'interprétation, et les contraintes en matière de motivation, de formation et de disponibilité mentionnées au Ch. 1 restent les mêmes.
En conséquence, la nature même de la recherche, ainsi que les thèmes abordés, n'ont pas beaucoup évolué non plus. Une grande proportion des textes, qui sont pour la plupart réflexifs ou théoriques, portent sur la formation, sur la consécutive, sur des thèmes professionnels. Les différences observées par rapport à la « période des praticiens » sont principalement les suivantes :
a. L'essentiel du travail de recherche est toujours réalisé par des praticiens, mais ceux-ci s'évertuent de plus en plus à utiliser les idées et résultats des études faites sur la traduction écrite dans le domaine traductologique, ainsi que des résultats de la linguistique et la psychologie. On voit notamment apparaître, à Trieste (voir par exemple Gran et Fabbro 1987), à
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 73
Vienne (Kurz 1993) et en Finlande (Tommola et Niemi 1980), quelques projets interdisciplinaires.
b. Des appels de plus en plus nombreux se font entendre -en faveur de la recherche empirique, ce qui correspond d'ailleurs à une récente tendance observée également dans la recherche sur la traduction écrite. Le nombre d'études empiriques sur l'interprétation a augmenté de manière spectaculaire depuis le milieu des années 80 (voir par exemple Gran et Taylor 1990 et les numéros 2 à 4 de la revue triestine The Interpreters Newsletter. La Section 5 de ce chapitre en énumère une importante partie, et quelques autres études sont présentées dans les autres chapitres. Notons cependant que, en dépit de cette augmentation en chiffres absolus, d'après notre bibliographie personnelle, quelque 15 % seulement des textes publiés entre 1985 et 1992 correspondent à des travaux empiriques.
c. Plusieurs travaux se sont attachés à l'étude de la spécificité de l'interprétation selon les langues (voir plus loin), alors que le thème même était banni de plusieurs centres importants pendant la période des praticiens (voir Ch. 2).
d. La communication entre interprètes, très peu présente jusque vers le milieu des années 80, a fait un grand bond en avant, comme il est précisé dans la Section 5 de ce chapitre.
Parmi les projets intéressants par leur direction et leur démarche, signalons les travaux suivants :
4.1 Etudes neurophysiologiques
En 1984, F. Fabbro et L. Gran ont commencé à étudier trois groupes d'étudiantes à l'université de Trieste, dont un groupe d'étudiantes en fin d'études d'interprétation. Au cours de tests d'écoute dichotiques, i l s'est avéré que pour les tâches langagières, l'hémisphère gauche était supérieur à l'hémisphère droit pour tous les sujets à l'exception du groupe d'étudiantes en fin de cursus d'interprétation, chez qui l'anglais langue passive était également représenté dans les deux hémisphères, ce qui semblait être l'effet du fort niveau d'entraînement à l'interprétation que subissaient ces sujets (Gran et Fabbro 1988). En 1987, une deuxième expérience de latéralisation a été réalisée par paradigme verbal manuel sur un groupe de 14 étudiantes droitières en cursus d'interprétation. Au cours des tâches expérimentales, qui n'étaient pas toutefois des opérations d'interprétation, aucune différence significative entre les deux hémisphères n'est apparue chez les sujets.
74 D A N I E L G I L E
Dans une expérience plus proche des conditions de la simultanée, S. Lambert (1989b) a comparé les performances d'un groupe d'interprètes selon que le discours original était acheminé vers leur oreille droite, leur oreille gauche ou vers les deux à la fois. Il s'avère que les droitiers faisaient moins d'erreurs quand le message était présenté à leur oreille droite (donc à l'hémisphère gauche) que lorsqu'il était présenté à l'oreille gauche ou aux deux oreilles à la fois.
Dans une autre étude sur la latéralisation cérébrale, V. Daro (1989) a réalisé des expériences de shadowing, de traduction allemand-italien de séries de mots isolés, et en même temps d'exercices de mémorisation de 1 à 3 mots distincts envoyés dans l'oreille opposée à celle qui servait aux deux autres exercices. La comparaison des erreurs dans ces expériences a fait apparaître une nouvelle fois que dans les fonctions langagières, il semble y avoir moins de dissymétrie inter-hémisphérique chez les interprètes de simultanée que chez les sujets bilingues ne pratiquant pas l'interprétation.
Ivo Ilic (1990) a fait écouter à un groupe de 12 interprètes professionnels femmes et à des étudiantes des phrases anglaises et leur traduction en italien, ainsi que des phrases italiennes et leur traduction en anglais, en alternant langue source et langue cible ainsi que l'oreille dans laquelle chacune était acheminée. Les sujets devaient, après chaque phrase et sa traduction, dire si celle-ci était correcte. Un assez bon équilibre entre hémisphère droit et hémisphère gauche a été mis en évidence pour ce qui est des fonctions linguistiques chez les interprètes professionnels. Dans l'ensemble, les professionnels ont mieux reconnu les erreurs sémantiques dans la traduction, et les étudiants ont mieux reconnu les erreurs syntaxiques. Par ailleurs, les interprètes professionnels ont obtenu des scores bien plus élevés que les étudiantes dans l'identification des erreurs sémantiques dans les phrases en langue non maternelle envoyées dans l'oreille gauche (hémisphère droit).
Enfin, Green, Schweda-Nicholson et coll. (1990) ont comparé la latéralisation cérébrale durant le shadowing et l'interprétation simultanée. Il est apparu une fois de plus que si l'hémisphère gauche était plus actif pendant le shadowing, i l n'en était pas de même pendant la simultanée. Ces résultats donnent à croire, eux aussi, que la pratique de la simultanée permet aux interprètes de développer les fonctions linguistiques de l'hémisphère droit.
Au-delà de cette symëtrisation des hémisphères cérébraux pour les fonctions du langage, V. Daro (1990) a réalisé une
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 75
expérience dite de paradigme d'interférence verbale-manuelle, durant laquelle i l s'est avéré que la latéralisation hémisphérique gauche des fonctions linguistiques n'était pas la même selon la vitesse de la production du discours. Elle en conclut que l'asymétrie inter-hémisphérique tend à baisser à mesure que la production du discours devient plus rapide.
La publication la plus récente sur l'interprétation dans l'optique de la neurophysiologie porte sur un projet réalisé par l'institut de neurophysiologie et l'institut de traduction et d'interprétation de l'université de Vienne (Kurz 1993). Il s'agissait d'examiner l'activité cérébrale des interprètes au cours de différentes conditions expérimentales, et notamment de voir s'il existait des différences entre la simultanée et le repos, et entre la simultanée et d'autres . tâches cognitives, d'identifier les zones cérébrales les plus impliquées dans la simultanée, et de comparer la latéralisation cérébrale en fonction de la langue employée (maternelle ou non).
I. Kurz (1993) présente un cas d'espèce, dans lequel une interprète professionnelle germanophone a alterné entre périodes de repos et 6 activités cognitives : « simultanée mentale » (sans énonciation et production de son) de l'allemand vers l'anglais, « simultanée mentale » de l'anglais vers l'allemand, shadowing en allemand, shadowing en anglais, écoute dune musique de Mozart et calcul arithmétique. Les résultats suggèrent que :
1. L'électrœncéphalogramme contient des informations sur l'activité de réflexion verbale.
2. L'activité intervenant durant la simultanée se distingue nettement de celle accompagnant les autres tâches cognitives.
3. La simultanée implique les deux hémisphères, surtout dans les régions temporales, davantage à gauche qu'à droite.
4. L'hémisphère droit semble être plus important pour la langue non maternelle que pour la langue maternelle, ce qui corrobore les résultats italiens cités plus haut.
4.2 Etudes sur la spécificité linguistique de l'interprétation
Au cours des dernières années, plusieurs études empiriques ont porté sur les problèmes spécifiques de l'interprétation entre une langue source donnée et une langue d'arrivée donnée. Rappelons que si dans les pays de l'Est, le sujet avait été
76 D A N I E L G I L E
abordé par le passé, riotamment par des chercheurs soviétiques (voir Ch. 1) et par H. Salevsky (1983) dans la combinaison russe-allemand, il avait été pour ainsi dire proscrit en Occident.
A Trieste, L. Avirovic a étudié les caractéristiques du serbo-croate et leurs incidences sur la formation des interprètes (1990). M. Fusco (1990) et M. Russo (1990) se penchent sur le problème des langues fortement apparentées à travers l'exemple de l'espagnol et de l'italien. A. Giambagli (1990) a comparé les transformations grammaticales intervenant en consécutive dans l'interprétation vers l'italien à partir de l'anglais d'une part, et du français de l'autre. Le numéro spécial de la revue The Interpreters Newsletter sur l'interprétation du japonais (1992) comporte également plusieurs articles consacrés aux spécificités de celui-ci (par P. Davidson, D. Gile, M. Kondo, H. Uchiyama). Enfin, à Taiwan, R. Setton examine le cas du chinois (1993).
Pour l'instant, ces travaux se cantonnent pour la plupart au niveau des constatations linguistiques et des hypothèses, sans que puissent y être présentés des faits indiquant l'incidence de ces spécificités sur la charge mentale ou sur les performances des interprètes. Le mouvement est toutefois lancé, et l'on peut probablement s'attendre à des résultats plus tangibles à terme. Voir aussi le Ch. 8.
4.3 Autres sujets
Parmi les autres domaines étudiés figurent en bonne place la formation, qui continue de susciter des textes essentiellement réflexifs, et la qualité du travail, dont l'exploration commence à s'orienter vers des études empiriques (voir les chapitres 6 et 7).
Par ailleurs, on relève une assez grande variété de sujets traités par des études empiriques, le plus souvent à Trieste, avec peu ou pas de replications pour l'instant. Outre les travaux mentionnés dans les autres chapitres, on citera à titre illustratif :
— Les pauses en simultanée : I. Cenkova (1989), P. Ovaska (1987).
— Une comparaison des résultats d'un exercice de paraphra-sage simultané italien-italien d'étudiants se destinant à l'interprétation d'une part, et d'étudiants en fin de cursus de l'autre : Chiara Russo (1990).
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 77
— Une comparaison de la traduction à vue et de la simultanée au regard de la rétention d'information : Maurizio Viezzi (1989, 1990). Dans cette étude, i l est apparu, comme dans les travaux antérieurs de D. Gerver et de S. Lambert (1989), que l'information était mieux retenue après l'écoute qu'après l'interprétation simultanée. Par ailleurs, l'information était mieux retenue après la lecture simple qu'après la traduction à vue. Enfin, l'information était d'autant mieux retenue que les transformations morpho-syntaxiques appelées par la traduction étaient plus faibles. Ces résultats intéressants semblent indiquer que la rétention d'information est fonction inverse du coût de l'opération de traduction en capacité de traitement.
— Les erreurs et omissions dans l'interprétation de discours médicaux : Cristina Galli (1990). Un résultat intéressant qui ressort de cette étude est l'absence d'une différence significative dans la performance des interprètes selon qu'ils travaillaient vers leur langue A ou leur langue B (voir Ch. 4).
— La restitution des chiffres en consécutive : Maria Selena Alessandrini (1990)
— La fréquence vocale lors de la lecture de textes dans différentes langues : Valeria Daro (1990)
— L'effet d'un retour casque avec retard sur la performance des interprètes : Edith Spiller-Bosatra et Valeria Daro (1992).
— Une étude par questionnaire sur les principaux facteurs perçus par les interprètes comme importants pour l'accomplissement de leur mission : Janet Altman, de l'université Heriot-Watt à Edimbourg (1990).
— Une étude par questionnaire, auprès d'étudiants et d'interprètes professionnels, sur ce qui rend l'interprétation facile ou difficile :Izumi 1991.
— La compréhension chez les interprètes : Mike Dillinger de l'université McGill à Montréal (1989, 1990). Dans cette étude, l'auteur, qui n'est pas interprète, a cherché à vérifier les différences entre les modalités de compréhension intervenant chez les interprètes et chez les bilingues, et a abouti à la conclusion qu'il n'y avait pas de différences significatives entre les deux groupes. Ce travail intelligent et fouillé pose toutefois des problèmes méthodologiques sérieux du fait que les discours n'étaient peut-être pas représentatifs de discours réalisés en conférence (voir Ch. 9).
— Le travail terminologique chez les interprètes de conférence : B. Moser-Mercer (1992), dans une étude par questionnaire.
78 DANIEL GILE
5. La communication .
Les chercheurs en interprétation communiquent entre eux de plus en plus. Cette tendance apparaît dans la variété des références bibliographiques qui clôturent les articles publiés au cours des dernières années, par opposition au cloisonnement qui les caractérisait par le passé, mais aussi dans la plus grande participation des interprètes aux grandes conférences de traductologie. L'école de traduction et d'interprétation de l'université de Trieste a largement contribué à cette amélioration de la communication à travers la revue The Interpreters Newsletter, la première du genre. Elle a été suivie par la revue japonaise Tsûyakurironkenkyû {Interpreting Research). L'AIIC a constitué une Commission de la recherche qui suit elle aussi les activités de recherche en interprétation de par le monde et qui a préparé une bibliographie, périodiquement mise à jour. Par ailleurs, un réseau international d'information sur la recherche et la théorie en interprétation (IRTIN) a été constitué à Paris et publie deux fois par an un bulletin d'information, dont la philosophie, qui vise une diffusion aussi large que possible de données brutes, est assez proche de celle du bulletin de traductologie TRANSST L'IRTIN a vu sa taille augmenter très rapidement, et i l s'étend maintenant sur cinq continents. Enfin, avec l'ouverture politique de ces dernières années, l'Est et l'Ouest commencent à communiquer, et le Japon, qui s'était enclavé depuis toujours en matière de recherche en interprétation (voir Gile 1988c), s'est également mis à s'intéresser aux travaux occidentaux : on trouve notamment dans Tsûyakurironkenkyû des articles qui passent en revue des publications occidentales. Toutefois, les résultats occidentaux ne sont que très peu utilisés dans la recherche japonaise.
Ce mouvement de communication se démarque aussi par une plus grande ouverture d'esprit de la part des praticiens chercheurs, et la hiérarchie rigide qui était imposée jusque vers le milieu des années 80 par les personnes en place dans le monde de l'enseignement, et accessoirement de la recherche, s'est effondrée. Ainsi, l'on a vu non seulement lors de la conférence de Trieste, mais aussi à d'autres réunions, et notamment lors d'un atelier de formation de professeurs d'interprétation organisé à Bruxelles sous l'égide de la Commission de la formation de l'AIIC en février 1991, des échanges sur un pied d'égalité entre les représentants des écoles traditionnellement
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 79
considérées comme les meilleures, et des interprètes parfois plus jeunes enseignant dans des écoles moins réputées.
6. Conclusion
Il nous semble indubitable que depuis la deuxième moitié des années 80, l'esprit de la recherche en interprétation a changé. L'évolution n'est pas due à une modification des conditions fondamentales dans lesquelles s'effectue la recherche, car les contraintes de temps et de motivation et la pauvreté des moyens financiers sont restés les mêmes. Le mouvement vient d une dynamique de personnes. Les idées de l'ancienne génération ne s'étant pas renouvelées, des chercheurs isolés essayaient depuis plus de dix ans de tracer leur propre voie. Dans une évolution naturelle fortement accélérée par les initiatives de l'école de Trieste et de quelques chercheurs individuels, la communication entre ces efforts personnels a fini par s'établir, et un effet d'entraînement a pu s'instaurer. Il se trouve que ce nouveau paradigme privilégie l'ouverture, la communication et la progression par des moyens plus scientifiques que dans les précédentes décennies. La dynamique pourra-t-elle échapper durablement aux contraintes environnementales qui ont pesé sur la communauté des interprètes chercheurs par le passé ? Les perspectives sont analysées en fin d'ouvrage.
Chapitre 4
Les modèles d'Efforts de l'interprétation
1. Introduction
Une partie non négligeable des textes publiés sur l'interprétation tente d'expliquer la manière dont celle-ci fonctionne, et vise notamment l'élaboration de modèles descriptifs exhaustifs (voir Ch. 2). Plutôt que de tenter de modéliser dans leur totalité des processus encore peu connus, i l est également possible, dans une démarche moins ambitieuse, de partir des difficultés manifestes de l'interprétation, pour tenter d'en modéliser les aspects susceptibles d'expliquer les problèmes récurrents. C'est dans cette optique qu'ont été élaborés les modèles d'Efforts présentés dans ce chapitre. /
2. De la difficulté d'interpréter
Dans les textes sur l'interprétation, les limites, voire les défaillances de l'interprète ne sont que rarement mentionnées. Quand elles le sont, les auteurs ont tendance à les attribuer à de mauvaises conditions de travail. Cette discrétion des chercheurs s'explique au moins partiellement par leur appartenance à la profession et par les problèmes psychologiques et sociologiques qu'impliquerait une étude trop détaillée et trop explicite des insuffisances de l'interprétation (voir Shlesinger 1989).
Pourtant, en simultanée comme en consécutive, l'interprétation comporte des difficultés même pour les interprètes les plus chevronnés, comme elle se manifeste notamment par la
82 D A N I E L G I L E
fatigue de l'interprète, mais elle se voit surtout à travers des erreurs, omissions et autres baisses ou insuffisances de la qualité de l'interprétation. Concrètement, ces défaillances de l'interprète donnent lieu à deux catégories de symptômes :
a. Symptômes se révélant dans la forme
— Dégradation de la qualité de la voix (voix plus aiguë, laissant apparaître un effort ou une tension — voir Daro 1990).
— Dégradation de la clarté de renonciation et de l'accent (notamment par interférence avec l'autre langue en présence).
— Dégradation de la qualité prosodique de l'interprétation: pauses, intonation, rythme.
— Dégradation de la qualité linguistique de l'interprétation : fautes et maladresses de langue sur les plans lexicologique, terminologique, grammatical, stylistique, pragmatique.
b. Symptômes se révélant dans le fond
Il s'agit essentiellement d'omissions non justifiées d'éléments d'information présents dans le discours en langue d'arrivée (certaines omissions sont stratégiques et peuvent être considérées comme légitimes' — voir Ch. 5), d'ajouts d'information non justifiés, de déformations de l'information.
2.1 Exemple
A titre d'illustration des types de manifestations de la difficulté d'interpréter que l'on peut rencontrer sur le terrain, nous présentons ci-dessous la transcription d'un segment de discours et de son interprétation par un professionnel en situation authentique. Il s'agit d'un discours en anglais, fait par un orateur américain lors d'une conférence sur la pêche • en août 1982. Le segment présenté ici correspond à quelque 70 secondes de discours. Dans le discours de l'interprète (en français), des majuscules indiquent des fautes et-maladresses.
Discours original
1 Before I dissertate on some of my ideas, first of 2 all Bob Kearney says to me he says « I would much 3 rather you have said your piece before lunch so 4 we could have a good laugh and enjoy our lunch ».
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 83
5 And I took that as a compliment and then I wanted to 6 answer Cliff's request about now that we found this 7 tremendous resource what are we going to do with it 8 and how we gonna utilize it ? I purposely did not 9 go back to my room and outline what I was going to
10 talk about, because if I did I would probably say a lot 11 of things that really weren't on my mind and I would 12 try to tailor it after the context of this meeting. 13 But I would like to say that the work of the 14 Commission and the purpose of this particular 15 meeting is intriguing to me because I have been 16 following the work of Bob and his group for the 17 last three or four years...
Discours interprété
1 Avant de commenter certaines de mes idées, surtout 2 E N C E Q U E / M O N A M I a dit « J ' E S P E R E que tu A U R A S F I N I
3 ton discours avant le déjeuner afin que nous A Y O N S un 4 bon déjeuner par la suite ». J'ai pris cela comme un 5 compliment et et j'ai voulu répondre à la question de 6 Cliff sur la façon de T R O U V E R ces ressources comment 7 nous allons les utiliser. A dessein, je ne suis pas 8 retourné / J E N E S U I S P A S R E V E N U S U R C E Q U E J ' A I D I T
9 A U P A R A V A N T . . . . Le travail de la Commission et 10 le T H È M E de cette réunion E S T U N P E T I T / M E S U R P R E N D
11 un peu j'ai suivi le travail de Bob D A N S son groupe 12 D E P U I S / A U C O U R S des trois dernières années...
Les aspects sonores de la dégradation de la forme (voix, énonciation, accent et prosodie) ne peuvent être vus à travers cette transcription écrite, à défaut d'un codage spécifique. On entrevoit toutefois des ' perturbations dans le rythme du discours d'arrivée à travers quatre incidents où l'interprète se reprend : à la ligne 2 ( « E N C E Q U E / M O N A M I a dit »), aux lignes 7 et 8 («je ne suis pas retourné / J E N E SUIS PAS R E V E N U »), aux lignes 10 et 11 (« EST U N PETIT / M E S U R P R E N D un peu ») et 12 (« DEPUIS / A U C O U R S »). Il est d'ailleurs intéressant de noter que ces incidents s'enchaînent en cascade, ce qui s'explique peut-être par un enchaînement de déséquilibres dans la gestion de la capacité de traitement par l'interprète à la suite d'un premier 'déclencheur' (voir Section 8).
Sur le plan linguistique, on relève une maladresse stylistique à la troisième ligne du discours de l'interprète (« afin que nous AYONS . un bon déjeuner »).
En ce qui concerne le fond, on relève les fautes suivantes :
84 D A N I E L G I L E
1. L'omission de « first of all » (lignes 1 et 2 de l'original). 2. L'omission du nom Bob Kearney, remplacé par « M O N
A M I » (ligne 2). 3. Une déformation de l'information véhiculée aux lignes 1 et
2 de l'original : « I would much rather you have said your piece before lunch » signifie «j'aurais préféré que vous disiez ce que vous aviez à dire avant le déjeuner ».
4. L'omission de « so we could have a good laugh » (« afin que nous puissions bien en rire »), aux lignes 3 et 4 de l'original.
5. Une déformation de « now that we found this ... resource » (« maintenant que nous avons trouvé cette ressource »), aux lignes 6 et 7.
6. L'omission de « tremendous » (« importante », « superbe », etc.), à la ligne 7 de l'original.
7. Une déformation de «I ... did not go back to my room » («je ne suis pas retourné dans ma chambre »), aux lignes 8 et 9 de l'original
8. Une longue omission de « ...and outline what I was going to talk about, because if I did I would probably say a lot of things that really weren't on my mind and I would try to tailor it after the context of this meeting. But I would like to say that... », aux lignes 9 à 13 de l'original. Ce passage, dont la logique n'est pas très claire, signifie apparemment « ...et faire un plan de ce que j'allais dire, car si je le faisais je dirais probablement beaucoup de choses que je ne pense pas vraiment et j'essaierais d'adapter mon propos à cette réunion précise. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que... ».
9. Une déformation de « intriguing » (ligne 15 de l'original). 10. Une déformation de «Bob and his group » (ligne 16 de
l'original). 11. Une déformation de « three or four years » (ligne 17 de
l'original).
2.2 Les fautes et maladresses en interprétation : fréquence et importance
Dans les 70 secondes de discours reproduites ci-dessus, on relève donc 11 fautes sur le fond et plusieurs maladresses dans la forme. Or, le discours est lent (moins de 150 mots/minute) et non technique, i l est fait par un locuteur natif dans un accent compréhensible et avec des caractéristiques prosodiques qui ne semblent pas anormales, et les conditions de tra-
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 85
vail de l'interprète, notamment sur le plan acoustique, étaient bonnes.
On peut donc se demander si l'interprète enregistré était incompétent, s'il traversait au moment de l'enregistrement une période difficile qui réduisait son aptitude à interpréter, ou s'il s'agit là d'une image représentative des limites de l'interprétation dans l'ensemble. La réponse à la première question est négative : l'interprète enregistré avait une bonne réputation auprès de ses collègues et dé ses clients. Par ailleurs, le même segment de discours a été utilisé par la suite pour une expérience sur les noms propres (Gile 1984), dans laquelle le nombre des fautes et maladresses commises par une dizaine d'interprètes professionnels travaillant dans des conditions analogues a été similaire, ce qui semble confirmer qu'il ne s'agit nullement, dans ce cas précis, d'une contre-performance individuelle.
Peut-on donc considérer que cette fréquence des fautes et maladresses, de l'ordre d'une dizaine par minute d'interprétation, est représentative du niveau de prestation moyen' sur le terrain ?
Si l'on se reporte à d'autres extraits de discours originaux et d'interprétations publiés, notamment dans des thèses de doctorat (Seleskovitch 1975, Lederer 1978, Pöchhacker 1992, Strolz 1992), l'on y trouvera de nombreux segments de plusieurs minutes d'interprétation sans une seule faute. Le tableau qui se dégage de ces extraits diffère très sensiblement de celui que donne l'extrait présenté ci-dessus.
A l'observation, la fréquence des fautes et maladresses observées en interprétation présente une forte variabilité, qui ne peut pas toujours s'expliquer par des raisons précises au-delà de certains déclencheurs de difficultés que les interprètes connaissent bien (voir Section 8). Dans l'extrait reproduit plus haut, c'est, au dire d'une partie des interprètes qui ont participé à l'expérience sur les noms propres, la logique un peu 'tortueuse' de l'orateur qui est en cause. Il arrive aussi que l'on ne puisse faire de diagnostic, fût-il impressionniste.
La détermination des caractéristiques statistiques de la fréquence des fautes et maladresses est intéressante dans des études corrélationnelles et causales où sont également étudiés des facteurs de difficulté précis. En l'absence d'un tel cadre, la variabilité de cette fréquence est telle qu'elle rend vide de sens la notion de moyenne. Il n'en reste pas moins intéressant de noter que les fautes et maladresses peuvent être très fré-
86 D A N I E L G I L E
quentes, même chez des interprètes compétents et dans de bonnes conditions de travail.
Au-delà de la fréquence des fautes et maladresses, i l importe de savoir quelle est leur importance qualitative. A cet égard, on notera également une grande variabilité. A titre d'exemple, dans le segment de discours reproduit plus haut, l'omission de « first of all », première 'faute' sur la liste, n'a probablement pas grande importance. A l'autre extrême, on peut évoquer une conférence de préparation à une course transatlantique en avion, pendant laquelle les interprètes ont été incapables de reproduire les noms, les chiffres et les codes nécessaires au déroulement des vols. Dans ce cas précis, les fautes étaient très graves, en ce sens qu'elles réduisaient à près de zéro l'impact du discours. Dans la plupart des cas, l'importance qualitative des fautes et maladresses se situe entre les deux. Là aussi, la notion de moyenne n'a pas beaucoup de sens ; il convient de noter simplement que ces fautes et maladresses ne sont pas dans l'ensemble inoffensives, et qu'il importe donc de les limiter autant que possible.
3. Fautes et maladresses non liées aux processus mentaux de l yin terpréta tion
3.1 Problèmes environnementaux
Certaines fautes et maladresses survenant dans l'interprétation peuvent être imputées, partiellement ou entièrement, à des phénomènes extérieurs au discours de l'orateur et aux mécanismes de l'interprétation. Il arrive par exemple que le son parvenant aux oreilles de l'interprète soit d'un volume ou d'une qualité insuffisante du fait que les appareils électroniques sont défaillants ou ont été mal installés, que l'orateur est trop éloigné de son microphone, qu'il s'en détourne tout en parlant, qu'il a oublié de le mettre en marche. Ces facteurs de difficulté sont très fréquents mais ne sont pas traités ici. En effet, leur solution passe par des mesures techniques et par une information et une action d'éducation et de discipline, qui sont marginales dans l'optique cognitiviste et linguistique adoptée dans cet ouvrage.
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 87
3.2 Connaissances et compréhension de l'interprète
D'autres problèmes d'interprétation sont attribuables à une compréhension insuffisante du discours original par l'interprète indépendamment des contraintes cognitives de l'interprétation. Ils peuvent être liés à des termes techniques ou à des noms propres peu connus ou non connus de l'interprète, à un discours ayant un contenu particulièrement dense, un raisonnement . difficile à suivre, etc. Dans le segment de discours reproduit plus haut, même en écoutant à plusieurs reprises le passage représenté par écrit aux lignes 10 à 12 de la transcription de l'original, on ne voit pas très bien ce qu'entend l'orateur quand il dit :
« ... I purposely did not go back to my room and outline what I was going to talle about, because if I did I would probably say a lot of things that really weren't on my mind and I would try to tailor it after the context of this meeting. »
Cette opacité du message pourrait expliquer son omission par l'interprète.
Notons que chez les professionnels compétents, notamment ceux qui ont suivi une formation et ont été sélectionnés dans l'une des grandes' écoles d'interprétation, i l est relativement rare que les connaissances linguistiques générales soient en cause. Il peut arriver qu'un mot ou une expression ne soient pas connus de l'interprète, surtout dans les registres littéraires et dans des variantes nationales ou sociolectes particuliers, quand les orateurs ne parlent pas la langue standard', mais la fréquence de ces incidents de parcours est probablement de l'ordre de quelques unités à quelques dizaines d'unités par an, soit un ordre de grandeur négligeable par rapport à la masse des centaines d'incidents qui peuvent se produire par journée de travail.
De même, s'agissant de professionnels compétents, i l est rare que la capacité d'expression des interprètes et leur connaissance générale de la langue active vers laquelle ils travaillent soient insuffisantes. La chose peut se produire plus souvent dans des registres spécifiques (langage juridique, langage militaire, langage religieux, etc.), qui peuvent être considérés comme des registres de spécialité.
88 D A N I E L G I L E
4. Les contraintes de l'interprétation
Les facteurs environnementaux et l'insuffisance des connaissances linguistiques et extra-linguistiques de l'interprète ne suffisent pas à expliquer tous les incidents de parcours, comme le montre le cas du segment de discours reproduit plus haut, et comme nous l'avons constaté régulièrement sur des discours enregistrés et leur interprétation. Les erreurs surviennent souvent sur des segments de discours qui ne présentent aucune difficulté apparente, que ce soit dans les facteurs environnementaux, dans le raisonnement, dans la technicité du lexique ou dans la complexité de la syntaxe. Il convient donc de chercher ailleurs les raisons des problèmes.
Nous avons suivi pendant un an (Gile 1987) cinq étudiants francophones en deuxième (et dernière) année du cursus d'interprétation à l'ESIT au cours de leurs entraînements en classe et en groupes de travail. Les exercices étaient de trois types :
— Exposés : présentation par un étudiant d'un exposé oral, préparé ou improvisé, mais jamais lu. Les exposés servaient de 'discours' qui devaient être interprétés par les autres étudiants.
— Exercices d'interprétation consécutive, faits sur la base d'exposés oraux, préparés, improvisés ou lus.
— Exercices d'interprétation simultanée, faits sur la base d'exposés oraux, préparés, improvisés ou lus.
Des exposés faits en français et des discours interprétés vers le français à partir de l'anglais et de l'allemand ont été enregistrés et étudiés au regard des fautes et maladresses de français qu'ils comportaient. En l'absence d'un jeu de normes généralement admises pour l'oral, les fautes et maladresses (désignées sous le nom d'écarts ' par rapport aux normes d'acceptabilité) ont été déterminées à l'aide de v dix informateurs locuteurs natifs (Gile 1985a). Les fréquences des écarts dans les trois types d'exercices ont la physionomie suivante (tableau 1) :
Etudiant A B C D E Simultanée 42 30 37 38 31 Consécutive 35 24 31 11 16 Exposé 11 10 5 8 *
* Pas d'exposés enregistrés
Tableau 1 : Nombre moyen d'écarts par 100 mots de discours en français
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 89
On constate pour tous les sujets l'existence de trois paliers, avec, dans un ordre croissant des fréquences des défaulances, les exposés, la consécutive et la simultanée, phénomène qui peut s'expliquer par la comparaison suivante :.
L exposé -—Dans l'exposé, l'orateur exprime ses propres idées ou
énonce des connaissances acquises avant le début de son discours.
— Il choisit ses propres mots et ses propres tournures avant et pendant son exposé, et ce à son propre rythme.
— Il n'a pas besoin de commencer à énoncer une idée tant que celle-ci n'est pas claire dans son esprit.
— Il est libre de modifier le déroulement de son discours à tout moment.
— Il peut concentrer toute son attention sur la formulation du discours.
La consécutive — En consécutive, l'interprète énonce des idées qui ne sont
pas les siennes, et i l doit souvent reformuler des informations dont il vient seulement de prendre connaissance.
— Pour préparer son discours, i l n'a que le temps de l'intervention de l'orateur, pendant laquelle son attention est également prise par l'écoute et l'analyse du discours et par la prise de notes.
— En revanche, au moment de la reformulation, i l peut parler à son propre rythme.
— L'interprète connaît l'ensemble du segment de discours qu'il va interpréter avant d'en commencer la reformulation. Sur ce plan, i l est parfois en meilleure situation que l'orateur, à qui il arrive de devoir improviser.
— L'interprète est dans son intervention astreint à la fidélité au discours de l'orateur, et ne peut y changer que des éléments mineurs (voir Ch. 5).
— Au cours de la phase de reformulation, une partie de son attention est consacrée à la lecture des notes et à un effort de mémoire.
La simultanée — En simultanée comme en consécutive, l'interprète exprime
des idées qui ne sont pas les siennes et reformule des informations dont i l vient seulement de prendre connaissance.
90 D A N I E L G I L E
— Pour préparer son discours, i l ne dispose que de quelques fractions de secondes à une ou deux secondes, et son rythme suit de très près celui de l'orateur : i l ne peut le devancer, sinon pour terminer une phrase dont i l prévoit la fin, et ne peut se permettre de prendre trop de retard, sous peine de perdre de l'information (voir plus loin).
— Son horizon ne dépasse guère la phrase, voire un segment de phrase dans le discours de l'orateur. Par opposition à la consécutive, en simultanée, non seulement l'interprète n'a pas un champ de vision correspondant à un enchaînement de plusieurs idées, mais i l doit souvent commencer à interpréter une idée avant même de l'avoir saisie dans sa totalité.
— Pendant que l'interprète fait son discours, son attention est fortement partagée, puisqu'il doit en même temps écouter la suite du discours de l'orateur.
Au regard de la production linguistique du discours, on relève donc deux différences importantes entre l'exposé et l'interprétation, qu'elle soit consécutive ou simultanée :
— L'obligation de fidélité : Alors que l'intervenant parlant en son nom propre peut laisser son discours dévier par rapport à sa pensée sans même que ses auditeurs s'en rendent compte, l'interprète n'a pas cette latitude. Comme le montrent et l'expliquent les psychologues cogniticiens et psycholinguistes (voir par exemple Aitchison 1987, Clark et Clark 1977, Matthei et Roeper 1983), la production du discours est une tâche complexe et difficile. Souvent, quand la production d'un énoncé reflétant ' une idée précise pose des difficultés au locuteur, l'idée est sacrifiée au bénéfice de la facilité linguistique, surtout dans l'oral. Comme l'explique Colin Cherry (1978 :79),
« We pay a price with the possession of a language, for we become prone to verbal habits. It is only too easy to use clichés, proverbs and slogans as a substitute for reasoned statements »
Par manque de motivation, d'énergie' ou de souplesse, l'homme tend à se laisser dériver, suit les courants de la loi du moindre effort et se laisse infléchir dans la production du discours par des 'tics' et habitudes linguistiques, ce qui débouche sur un énoncé peu ou prou infidèle à sa pensée. D'après Frieda Goldman-Eisler (1958 : 67-68) :
« ...Fluent speech was shown to consist of habitual combinations of words such as were shared by the language community and such
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 91
as had become more or less automatic... Thus speakers are keeping up with pressure of time, and the need for being intelligible and maintaining rapport will be tempted and constrained to having recourse to ready-made verbal sequences, phrases and clichés, and subjective meaning itself will be guided through these channels and modified as a result. »
L'interprétation ne permet pas un tel laisser-aller et agit donc en révélateur de cette difficulté d'énoncer.
— La deuxième différence essentielle, qui est la plus apparente mais pas nécessairement la plus importante, est le contraste entre le caractère unilingue de l'exposé et le caractère bilingue de l'interprétation. On ne sait pas exactement comment s'opère mentalement le passage de la réception dans une langue vers la production dans une autre, et la théorie selon laquelle les deux sont dissociées à travers une étape de 'déverbalisation' durant laquelle ne subsiste plus aucune trace linguistique est contestable (voir notamment Kolers 1978). Cependant, i l est raisonnable de supposer que la coordination bilingue, et surtout la lutte contre les interférences linguistiques que risque d'engendrer la présence simultanée de deux systèmes linguistiques 'actifs', demandent un effort elles aussi.
Il semble toutefois que le principal facteur de difficulté en interprétation est la pression du temps, qui comprime des activités d'analyse et de production dans de très courts délais et qui impose notamment une simultanéité des activités et un partage important de l'attention. C'est dans cette optique qu'ont été mis au point les 'modèles d'Efforts'.
5. Opérations automatiques et non automatiques
Initialement, nous avons élaboré le modèle d'Efforts de la simultanée sur une base intuitive pour expliquer la grande fréquence des fautes et maladresses d'interprétation qui ne pouvaient être attribuées ni à des facteurs environnementaux, ni à une difficulté particulière de la compréhension ou de la production en tant que telles. Par la suite, des textes de psychologie cognitive et de psycholinguistique ont permis d'asseoir ce modèle sur le concept de 'capacité de traitement' et sur une masse considérable de travaux de recherche réalisés autour de ce même concept.
L'une des bases de l'idée est la notion de 'capacité de transmission' d'un canal, formulée par D. Shannon à la fin des
92 D A N I E L G I L E
années 40 : tout canal de transmission d'information a un débit informationnel maximum qui ne peut être dépassé. Cette idée a été reprise, adaptée à leurs besoins et intégrée dans leurs modèles par les psychologues cogniticiens (Moray 1967, Kah-nemann 1973, Richard 1980), sous une forme plus générale de 'Système de traitement général à capacité limitée' ou S ACAL. Les opérations mentales chez l'homme se classeraient en deux catégories : les opération 'automatiques' et les opérations qui ne le sont pas. Ces dernières passent par définition par le SACAL, dont elles consomment une partie de la capacité de traitement disponible. Si deux opérations non automatiques passent par le SACAL en même temps, la consommation de l'une s'ajoute à la consommation de l'autre. Par définition, les opérations automatiques ne passent pas par le SACAL et ne consomment pas de capacité de traitement.
En réalité, cette dichotomie est quelque peu simpliste. Les opérations répétitives 's'automatisent' progressivement, et i l est difficile de définir un seuil très précis où une opération passe de la catégorie 'automatique' à la catégorie 'non automatique'. Cependant, certaines opérations appartiennent clairement à l'une ou à l'autre. D'après Richard (1980:149-150), les opérations non automatiques, qui passent par le SACAL, sont celles qui ne peuvent être automatisées : détection d'un stimulus bref, identification d'un stimulus non familier présenté dans des conditions défavorables, stockage en mémoire d'une information devant être réutilisée par la suite, élaboration d'une réponse non automatisée, contrôle de la précision d'un geste, opérations cognitives relevant du système symbolique. Les opérations automatiques, qui ne relèvent pas du SACAL, sont l'encodage d'un stimulus familier présenté dans des conditions favorables, le déclenchement d'une réponse automatisée, et le déroulement d'un programme moteur sans contrôle.
Les modèles d'Efforts de l'interprétation se fondent sur l'idée que les opérations mentales qui interviennent dans celle-ci sont consommatrices de capacité de traitement.
6. Les Efforts en interprétation simultanée
6.1 Les trois Efforts
La simultanée comporte un grand nombre d'opérations cognitives. Dans l'analyse fonctionnelle réalisée pour l'élabora-
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 9 3
tion du modèle d'Efforts de la simultanée, trois groupes d'opérations ont été définis :
L'Effort d'écoute et d'analyse Il englobe l'ensemble des opérations mentales qui intervien
nent entre la perception du son du discours par les organes auditifs et le moment où l'interprète a attribué un sens (ou plusieurs potentialités de sens) au segment de discours qu'il a entendu, ou le moment où il renonce à le faire.
L'Effort de production du discours Celui-ci englobe l'ensemble des opérations mentales qui
interviennent entre le moment où l'interprète décide de transmettre une information ou une idée et le moment où i l produit vocalement l'énoncé qu'il a élaboré pour le faire.
L'Effort de mémoire à court terme • L'Effort de mémoire à court terme correspond à l'ensemble
des opérations liées au stockage en mémoire de segments de discours entendus jusqu'à leur restitution en langue d'arrivée, à leur perte si elles disparaissent de la mémoire, ou à la décision de l'interprète de ne pas les restituer.
Cet Effort intervient essentiellement pour quatre raisons : — Une raison physique, dans la mesure où un certain temps
s'écoule dans la plupart des cas entre le moment où un son est entendu et celui où il est restitué (mais s'il est anticipé par l'interprète, i l peut être restitué avant même d'avoir été entendu). A fortiori, s'agissant de syllabes, de mots ou de tournures, leur identification et leur compréhension prennent un certain temps, puisque les sons sont perçus physiquement de manière quasiment linéaire et que l'analyse porte sur des segments sonores, et non pas sur des points. D'après Graesser (1981:53), les mots à l'intérieur d'une proposition sont stockés en mémoire à court-terme jusqu'à ce que le récepteur arrive à la fin de la proposition.
— Des raisons " tactiques : l'interprète attend plus ou moins longtemps avant de restituer un segment de discours pour se donner le temps de mieux le comprendre grâce au contexte. Il peut également souhaiter attendre pour se donner davantage de recul et donc une plus grande marge de manœuvre dans renonciation en langue d'arrivée.
94 DANIEL GILE
— Il peut aussi être obligé d'attendre en raison des différences syntaxiques, entre langue de départ et langue d'arrivée (voir plus loin).
— H peut également arriver que l'interprète prenne du retard par rapport à un segment dense, rapide ou difficile à formuler du discours original, et ce retard entraîne automatiquement le stockage d'informations en mémoire.
Il existe d'autres opérations mentales qui interviennent dans l'interprétation, notamment la construction progressive d'une base de connaissances sur le sujet et sur la conférence concernée et son stockage en mémoire à long terme. Une grande par-
. tie de cette opération peut être considérée comme faisant partie de l'Effort d'écoute et d'analyse. Les autres opérations auxquelles on peut penser ne relèvent pas directement du processus central de l'interprétation. C'est pourquoi nos modèles d'Efforts s'articulent autour des trois groupes d'opérations définis plus haut.
6.2 Les Efforts sont-ils automatiques ?
6.2.1 L'Effort d'écoute
Dans la vie quotidienne, la compréhension des textes et des discours donne l'impression d'être un acte spontané qui ne requiert aucun effort. En réalité, cet acte comporte des opérations multiples dans un enchaînement complexe (voir par exemple Noizet 1980, Eysenck et Keane 1990:296). Plutôt que de reprendre l'ensemble des résultats obtenus dans ce domaine, dont on trouvera des explications dans les livres de psycholinguistique, nous nous contenterons d'en souligner quelques éléments saillants pour expliquer le caractère non automatique de la compréhension du discours par l'interprète.
Les travaux réalisés dès les années 50 et 60, notamment par Miller, Liberman et Pollack, montrent que la compréhension du discours ne consiste pas en la réception intégrale et passive d'un signal acoustique correspondant de manière univoque à un enchaînement de phonèmes, de syllabes ou de mots. En effet, des phénomènes physiques et physiologiques font que les sons émis pour vocaliser un segment de discours sont variables non seulement d'un locuteur à un autre, mais aussi d'un moment à l'autre chez le même locuteur (voir par exemple Haton et Liénard 1979).
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 95
. Par ailleurs, les informations véhiculées par chaque segment de signal portent non seulement sur le segment de discours visé, mais aussi sur des segments de discours voisins (Liber-man et coll., 1967). En effet, chaque segment est susceptible d'influencer phonétiquement le segment voisin : une consonne, une voyelle, une syllabe n'aura pas nécessairement le même son selon les consonnes, voyelles ou syllabes qui la précèdent et qui la suivent. En fait, l'auditeur interprète les sons captés à partir de certaines de leurs caractéristiques physiques, les 'traits discriminants', qui correspondent essentiellement à des variations dans la fréquence et l'intensité du signal sonore, en suivant les règles phonologiques, lexicales, syntaxiques et sémantiques de la langue concernée (Studdert-Kennedy 1974:2350).
Ces règles sont probabilistes : les traits discriminants perçus sont interprétés en fonction d'un ensemble de possibilités dont certaines sont plus probables que d'autres, le profil des probabilités étant déterminé par : ~
— L'apport linguistique du contexte : l'apprentissage d'une langue implique l'acquisition d'un système affectant des probabilités d'occurrence absolues et transitionnelles aux mots, phonèmes, lettres, syllabes et autres éléments linguistiques dans l'enchaînement du discours (Hörmann 1972).
— Le bagage extra-linguistique de l'auditeur, composé de ses connaissances extra-linguistiques préalables à l'échange, et des connaissances apportées par le contexte ; ce bagage superpose au système probabiliste linguistique un système probabiliste extra-linguistique très puissant (voir Slama-Cazacu 1961).
Ces systèmes probabilistes ont un rôle décisif dans la compréhension de la parole, puisqu'ils déterminent dans une grande mesure ce que l'auditeur entend' (Hörmann 1972:79), parfois en dépit des caractéristiques physiques perçues du son émis : dans un montage expérimental, un segment acoustique composé d'un toussotement suivi de la syllabe anglaise « ite » a été incorporé dans une phrase parlant de chiens féroces, et les sujets ont cru entendre clairement les mots « bite » ou « fight » (Warren 1970). Des 'illusions acoustiques' analogues ont également été notées par Miller et Skinner. En effet, explique Hörmann (1972:78), « ...la compréhension d'un message implique toujours plus que ce qui est contenu dans le signal lui-même... si le récepteur du message sait que les chiffres y sont plus probables que les mots, i l pensera que /ka.../ a plus de chances d'être quatre' que catastrophes' ».
96 DANIEL GILE
Trois éléments intéressent particulièrement l'interprète dans ces aspects de la compréhension du discours oral :
— Le facteur temps : l'analyse des sons captés prend un certain temps, d'autant plus long que la quantité d'information qu'ils véhiculent est plus grande (Le Ñy 19fJ8).
— L'attention ou capacité de traitement : l'analyse des signaux demande une • capacité de traitement d'autant plus importante, elle aussi, que la quantité d'information à traiter est plus grande (Miller 1973).
— La capacité de la mémoire à court terme : on sait que la mémoire à court terme a une capacité limitée, qui est de l'ordre de 7 morceaux' d'information (chunks' en anglais - Miller 1956). Cette limite oblige l'interprète à stocker les informations véhiculées par les enchaînements de sons sous forme de morceaux' plus grands que les phonèmes ou même les mots (Mas-saro 1975).
De toute évidence, le processus d'analyse aboutissant à la compréhension du discours n'est pas automatique, ne serait-ce qu'en raison du fait qu'il fait intervenir le stockage d'informations en mémoire à court terme à des fins de comparaison avec des éléments stockés en mémoire à long terme, puis la prise de décisions interprétatives. Le fait que ce processus soit rapide et le plus souvent inconscient explique qu'il puisse être perçu comme spontané' et sans efforts', maisr i l ne l'est pas au sens strict du terme, comme le montrent diverses expériences réalisées en psychologie cognitive (voir Richard 1980).
En interprétation interviennent des facteurs qui rendent la compréhension du discours encore plus consommatrice de capacité de traitement. Ils sont essentiellement liés à l'infériorité des connaissances pertinentes des interprètes par rapport à celles des délégués. En effet, de manière générale, l'orateur parle aux délégués, et non pas aux interprètes. En conséquence, sur le plan informationnel comme sur le plan linguistique, son discours est adapté aux connaissances des délégués, et non à celles des interprètes. Pour ces derniers, le discours original comporte davantage d'informations nouvelles, davantage d'informations imparfaitement connues, moins d'éléments connus, donc redondants, qui permettent l'anticipation ou la reconstruction de segments de son mal entendus. Il en résulte des besoins plus grands en capacité de traitement.
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 97
6.2.2 L ;Effort de production
La Section 4 ci-dessus explique et illustre les raisons pour lesquelles la production du discours ne saurait être classée dans la catégorie des opérations automatiques. .Signalons à ce propos que les pauses d'hésitation, considérées comme le principal indicateur des difficultés de la production, ont fait l'objet de nombreux travaux de recherche chez les psycholinguistes.
En interprétation, plusieurs facteurs augmentent les besoins de l'Effort de production en capacité de traitement :
— En premier lieu interviennent à nouveau les connaissances des interprètes, inférieures à celles de l'orateur. Ce déficit leur rend plus difficile la réorganisation du message en langue d'arrivée quand i l s'agit de contourner des difficultés d'expression par des paraphrases. En outre, sur le plan linguistique, dès que le vocabulaire ou le registre est un tant soit peu spécialisé, i l est moins disponible chez l'interprète que chez l'orateur-spécialiste (voir Ch. 8).
— En outre, en simultanée, la nécessité de parler au rythme de l'orateur plutôt qu'au rythme naturel de l'interprète constitue une lourde contrainte. La seule compréhension du discours original au rythme de l'orateur ne semble pas peser aussi lourd, si l'on en juge par le fait que les auditeurs ne s'en plaignent que lorsque l'orateur est particulièrement rapide ou que son discours est particulièrement dense.
— Troisièmement, l'interprète se trouve souvent dans la nécessité de commencer la reformulation d'une idée en langue d'arrivée avant d'avoir une idée très claire de l'ensemble de l'idée ou des enchaînements dans le discours initial ; cela l'oblige à choisir des débuts de phrase neutres' qui lui laissent une certaine marge de manœuvre dans la suite, ou à se débattre avec des fins de phrases parfois rendues difficiles par la direction inattendue que prend la phrase de l'orateur.
— Enfin, la nécessité de lutter consciemment contre les interférences linguistiques provenant de la langue de départ accroît encore les besoins en capacité de traitement.
En revanche, certains aspects de la production du discours sont probablement facilités par la situation particulière de l'interprète de simultanée :
— D'une part, i l est souvent en mesure de suivre la syntaxe de la phrase en langue de départ et a donc moins de décisions syntaxiques à prendre que l'orateur. Rappelons, comme le soulignent beaucoup d'enseignants de l'interprétation, qu'une telle tactique présente le très réel danger d'un calque syntaxique
98 DANIEL GILE
aboutissant à u¿& énoncé.peu naturel et peu compréhensible en langue d'arrivée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le calque est déconseillé, voire formellement interdit pendant le cursus de. formation à l'interprétation. Cependant, dans la pratique, on constate qu'il intervient assez souvent.
— D'autre part, sur le plan lexical, l'accès aux mots et termes techniques en langue d'arrivée peut être facilité par les choix déjà réalisés par l'orateur, surtout quand les termes employés en langue d'arrivée sont phonologiquement proches de ceux employés en langue de départ. Il y a là aussi risque d'interférence linguistique, mais l'effet faciHtateur est certainement très important, voir capital dans la terminologie scientifique et technique.
En résumé, la situation de l'interprète en tant que producteur du discours diffère sensiblement de celle du locuteur ordinaire. Les opérations lui sont facilitées d'un côté, mais comportent en tout état de cause des composantes non automatiques. Les erreurs et maladresses constatées sur le terrain et en laboratoire en sont la plus éloquente manifestation.
6.2.3 L'Effort de mémoire
L'Effort de mémoire en simultanée répond parfaitement à la définition des opérations non automatiques donnée plus haut par J.-F. Richard, puisqu'il s'agit bien de stocker des informations en mémoire pour les réutiliser ensuite. Qui plus est, en interprétation simultanée, le rythme de stockage et de recherche de l'information dépend de l'orateur, et non pas de l'interprète. Il en est de même de la quantité d'information à manier.
En fait, i l semble que l'Effort de mémoire à court terme soit particulièrement critique dans l'interprétation et qu'il explique de nombreuses difficultés, comme i l est exposé plus loin.
7. Le modèle d'Efforts de la simultanée
7.1 Présentation du modèle
Les interprètes sont apparemment conscients de la concurrence entre différents Efforts depuis longtemps. Ils mentionnent notamment depuis les années 60 les limites de la capacité de la mémoire à court terme et ses incidences sur les tactiques
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 99
de production (voir par exemple Fukuii et Asano 1961, Kade et Cartellieri 1971, Lederer 1978, Moser 1978, Wilss 1978). Cependant, les modèles d'Efforts semblent être la première tentative d'intégrer le concept dans un modèle explicatif.
Le modèle d'Efforts de la simultanée se présente sous la forme suivante :
(1) E + M + P + C - T
où
E désigne les besoins en capacité de traitement de l'Effort d'écoute et d'analyse
M désigne les besoins en capacité de traitement de l'Effort de mémoire à court terme • P désigne les besoins en capacité de traitement de l'Effort
de production du discours en langue d'arrivée C désigne la capacité de traitejnent nécessaire à la coordi
nation des trois Efforts. Il semble en effet exister des éléments expérimentaux démontrant qu'en la présence de plus de deux activités simultanées non automatiques, les besoins en capacité de traitement comprennent non seulement la somme des besoins individuels, mais aussi une certaine capacité de traitement pour la coordination entre les activités (Eysenck et Keane 1990:114).
T est le total des besoins.
Ce modèle appelle trois observations : — A tout moment, chacun des Efforts traite en principe un
segment différent du discours original. Dans le schéma le plus simple, si celui-ci se compose d'une succession de segments 1, 2, 3, 4, 5 etc., au même moment, P traitera le segment 1, M le segment 2, E le segment 3, puis P le segment 2, M le segment 3, E le segment 4 et ainsi de suite. En réalité, les opérations peuvent être bien plus complexes, avec des segmentations, des fusions et des permutations de segments.
— La capacité de traitement totale nécessaire à l'interprétation est éminemment variable, puisqu'elle dépend des besoins pour chaque segment de discours.
— A fortiori, la capacité de traitement nécessaire à chaque Effort est variable.
La formule (1) représente donc une somme instantanée et variable des besoins en capacité de traitement.
100 D A N I E L G I L E
Toutefois, le modèle ne prend véritablement un sens que sous la forme de l'inéquation (2) :
(2) E + M + P + C = T ^ D
où D désigne la capacité de traitement totale disponible
Qette capacité de traitement totale disponible D peut varier d'un moment à l'autre. On sait qu'elle est finie, mais rien ne prouve qu'elle est constante dans le temps.
L'inéquation (2) indique une condition nécessaire à une bonne interprétation : pour que l'interprète puisse accomplir correctement sa tâche, i l faut qué la capacité totale nécessaire T soit inférieure (ou égale) à la capacité totale disponible D.
En réalité, cette condition ne suffit pas, car i l peut arriver que la capacité totale disponible soit suffisante mais que la part affectée par l'interprète (consciemment ou non) à l'un des Efforts soit insuffisante au regard de la tâche qu'il doit accomplir au moment concerné. Il convient donc d'ajouter d'autres conditions de fonctionnement, représentées par les inéquations (3), (4) et (5), qui indiquent l'absence d'une insuffisance localisée de capacité de traitement pour un Effort donné.
(3) E < D (E) (4) M < D (M) (5) P < D (P)
où D(E) indique la capacité disponible pour l'Effort d'écoute et d'analyse pour la tâche qu'il doit accomplir au moment concerné, et où D(M) et D(P) indiquent respectivement la capacité disponible pour l'Effort de mémoire et pour l'Effort de* production en égard aux tâches qu'ils doivent accomplir au même moment.
7.2 Les défaillances
7.2.1 Sources de défaillances
Au regard du modèle d'Efforts, des défaillances peuvent survenir dans deux cas :
La saturation La saturation correspond au cas où le total des besoins
dépasse le total disponible (inéquation (2) non réalisée). Dans
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 101
une telle condition, Fun des Efforts au moins ne disposera pas de la capacité nécessaire au traitement du segment qui le concerne au moment voulu. La saturation est déclenchée par une augmentation des besoins en capacité de traitement dans un ou plusieurs Efforts (voir plus loin).
Le déficit individuel Le 'déficit individuel' correspond au cas où l'un des Efforts
ne dispose pas de la capacité de traitement nécessaire à l'exécution de sa tâche, alors que la capacité totale disponible est supérieure au total des besoins : l'inéquation (2) est réalisée, mais les inéquation(s) (3) et/ou (4) et/ou (5) ne le sont pas. Les déficits individuels surviennent notamment chez les étudiants et débutants, qui n'ont pas encore acquis la maîtrise de la gestion de leur capacité de traitement, mais aussi chez des professionnels chevronnés, en cas de défaillance passagère, par exemple à un moment de fatigue, et au moment où survient de manière inopinée un segment de discours plus complexe que prévu.
7.2.2 Les manifestations des défaillances
Il convient de souligner qu'une saturation ou un déficit individuel ponctuels n'engendrent pas nécessairement une défaillance ou une détérioration de la qualité de la prestation. Il est possible en effet que la charge de traitement soit telle qu'un transfert de capacité de traitement puisse se faire d'un Effort à un autre sans effets négatifs. Par exemple, si les segments de discours arrivant en Ecoute ne requièrent pas un important effort et si la mémoire à court terme n'est pas surchargée, un segment difficile à reformuler en Production peut être stocké un moment supplémentaire en mémoire, le temps de transférer une certaine capacité de traitement de l'Effort d'écoute à la Production. Autre exemple, un élément d'information non saisi à un moment donné peut être retrouvé par l'interprète grâce à une redondance dans le discours original quelques segments de discours plus loin. L'interprète peut aussi changer de tactique dans le traitement d'un segment de discours pour consommer moins de capacité de traitement, en optant par exemple pour un synonyme ou une paraphrase plutôt que pour la formulation visée initialement (voir Ch. 5).
Dans d'autres cas, la saturation ou le déficit individuel dans l'un des Efforts engendrent bien une détérioration de la qualité
102 DANIEL GILE
de l'interprétation. Celle-ci peut se traduire par une perte d'information, par une déformation de l'information, par une détérioration de la qualité linguistique du discours en langue d'arrivée, par une prestation moins claire, moins convaincante, moins agréable à écouter. Comme i l est expliqué au Ch. 6, ces pertes, déformations et autres baisses de qualité ne sont pas toujours perceptibles ou perçues par les observateurs lors de la prestation, mais elles peuvent aussi être très apparentes : fautes dans les noms propres, terminologie maladroite, fautes de grammaire, problèmes de prononciation, discours en langue d'arrivée au contenu illogique ou peu plausible.
7.2.3 Les enchaînements déficitaires
Dans l'étude des défaillances en interprétation, le concept d'enchaînements déficitaires' est particulièrement important, car i l permet d'expliquer certaines défaillances portant sur des segments de discours qui ne semblent pas poser de problèmes en eux-mêmes.
Les défaillances liées à l'insuffisance en capacité de traitement se produisent souvent à la suite d'un enchaînement, que l'événement déclencheur ait été une saturation ou un déficit individuel. En effet, la saturation est une insuffisance qui se répercute nécessairement sur au moins l'un des Efforts et crée au moins un déficit individuel.
Les déficits peuvent engendrer la perte d'une information au moment même où ils se produisent. Ainsi, un déficit suffisamment important dans l'Effort d'écoute peut empêcher l'interprète de capter un segment de discours au moment où il est énoncé, et provoquer son omission. Cependant, i l est très fréquent qu'un déficit provoque un problème à distance.
A titre d'illustrations, on peut considérer les cas suivants : Exemple 1
L'interprète ne trouve pas immédiatement un terme qu'il recherche en langue d'arrivée. Il affecte à l'Effort de production davantage de capacité de traitement pour le trouver - au détriment de l'Effort d'écoute, et perd ainsi une information dans un segment ultérieur du discours original. Exemple 2,
Le fort accent étranger d'un orateur oblige l'interprète à consacrer une grande quantité de capacité de traitement à l'Effort d'écoute. Il en résulte un déficit dans l'Effort de production, qui se traduit par une énonciation plus lente en langue
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 103
d'arrivée. Le retard s'accumule, et les informations à stocker en mémoire à court terme finissent par dépasser la capacité de celle-ci, d'où perte d'information. Exemple 3
Comme dans l'exemple 2, le fort accent étranger d'un orateur " oblige l'interprète à consacrer une grande quantité de capacité de traitement à l'Effort d'écoute. Il en résulte un déficit dans l'Effort de production, qui se ralentit. Pour rétablir l'équilibre, l'interprète reprend une partie de la capacité de traitement affectée à l'Effort d'écoute pour l'attribuer à l'Effort de production. Il en résulte un déficit dans l'Effort d'écoute, et la perte d'une information à l'écoute.
Dans ces trois cas, la perte se produit non pas sur le segment de discours déclencheur du déficit, mais sur un élément ultérieur.
Les mécanismes en jeu deviennent plus complexes encore si l'on tient compte non seulement des besoins et des disponibilités, mais aussi de la latence des réactions de l'interprète. En effet, celui-ci peut par exemple augmenter la part de capacité de traitement affectée à l'Effort d'écoute quand il reconnaît un segment difficile, ce qui peut se produire avant le début dudit segment si celui-ci est anticipable, mais aussi après le début de son énonciation par l'orateur, s'il ne l'est pas.
A titre d'exemple, une phrase peu dense comportant un segment informationnellement dense :
« Mister Chairman, Ladies and Gentleman, the Pacific Islands Development Fund and has committed large funds to the project. »
Globalement, cette phrase se décompose comme suit : t0-t2 : « Mister Chairman, Ladies and Gentlement, the » (faible densité informationnelle) t2-t4 : « Pacific Islands Development Fund » (forte densité informationnelle) t4~fin : « has committed large funds to the project » (faible densité informationnelle)
De manière très grossière, on peut suivre la dynamique théorique de la répartition de la capacité de traitement selon le schéma de la Fig.l :
104 DANIEL GILE
Figure 1 : Représentation schématique de la capacité de traitement dépensée lors de l'interprétation simultanée d'une phrase simple comportant un segment dense
I : débit informationnel du discours E : capacité de traitement dépensée par l'Effort d 'écoute et d'analyse P : capacité de traitement dépensée par l'Effort de production M : capacité de traitement dépensée par l'Effort de mémoi re T : capacité de traitement totale dépensée
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 105
a. L'Effort d'écoute
— De t0 à t2, l'orateur prononce la formule standard de début d'intervention, et l'Effort d'écoute de l'interprète est à un niveau de capacité de traitement très bas.
— En t2, l'orateur commence à prononcer le nom propre, segment informationnellement dense si l'interprète ne le connaît pas. L'interprète s'en rend compte en t3 et consacre davantage d'attention à l'écoute de ce nom.
— En t4, l'orateur finit de prononcer le nom propre et passe à un segment de discours moins dense que le nom propre, mais plus dense que la formule standard par laquelle i l a commencé son intervention. L'interprète s'en rend compte en t 5 et libère vers d'autres Efforts une partie de la capacité qui était engagée dans l'Effort d'écoute. .
— Le restant de ce segment se maintient dans l'ensemble au même niveau de densité informationnelle, et le niveau de capacité • de traitement consacré à l'écoute reste plus ou moins constant.
b. L'Effort de production
L'Effort de production commence en t 1 ; une fois que l'interprète a reconnu la formule. En l'occurrence, i l parle aussi vite que l'orateur et termine sa restitution en même temps que lui. Puis, reconnaissant une difficulté dans le nom propre, i l ne dit rien pendant un moment pour consacrer l'essentiel de sa capacité à l'écoute. Ce n'est qu'en t6, après s'être assuré que le nom propre est terminé, qu'il recommence à produire, à un niveau de consommation de capacité de traitement plus élevé que pour la formule.
c. L'Effort de mémoire
Pendant la formule d'appel standard qui marque le début de l'intervention, l'Effort de mémoire est quasiment nul, puisque l'interprète évoque en langue d'arrivée la même formule d'appel, qu'il connaît bien, et qu'il termine son énonciation en même temps que l'orateur. Lorsque ce dernier commence à prononcer le nom propre, comme l'interprète attend avant de reprendre son propre discours, l'information s'accumule en mémoire à court terme de t 4 jusqu'en t6, moment où l'interprète commence à restituer le discours. A partir de t6, elle
106 DANIEL GILE
commence à baisser progressivement, à mesure que l'interprète la restitue en langue d'arrivée et peut la laisser disparaître de sa mémoire à court terme.
d. La capacité totale utilisée
Rappelons que ce schéma est une construction théorique, simplifiée à l'extrême, qui ne vise pas à permettre le calcul de valeurs précises, mais à montrer comment les décalages entre les événements du discours original et les opérations de gestion de la capacité de traitement chez l'interprète peuvent engendrer des défaillances à distance.
Si l'on considère la somme des éléments de'capacité de traitement utilisés dans chaque Effort, on voit qu'alors que le segment le plus dense du discours se situe entre t2 et t4, c'est entre t 6 et t 7 que la somme est la plus élevée. Pendant qu'est prononcé ledit segment, i l existe bien un intervalle court, de t3
à t4, où le total est élevé, mais le reste du temps, i l est moyen. Dans ce schéma, une perturbation momentanée des condi
tions d'écoute, par exemple, a bien plus de chance d'aboutir à une défaillance entre t6 et t7, où le discours ne présente pas de difficulté particulière, qu'entre t 2 et t4.
Il va sans dire qu'une vérification des hypothèses sur lesquelles est bâti ce modèle à l'aide d'indicateurs physiologiques dans des mesures en ligne présenterait un intérêt capital, mais pose encore des problèmes (voir Section 12).
8. Les 'déclencheurs'
Dans l'ensemble, les 'déclencheurs' de problèmes, c'est-à-dire les éléments et caractéristiques du discours original qui engendrent des problèmes de saturation et de déficit individuel tels qu'ils sont connus et répertoriés par les interprètes, sont de deux types : ceux qui augmentent les besoins en capacité de traitement, et ceux dont le traitement, en l'occurrence à l'écoute, est particulièrement vulnérable à une baisse de l'attention.
8.1 Déclencheurs par augmentation des besoins en capacité de traitement
Dans l'optique des modèles d'Efforts, ces déclencheurs sont
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 107
essentiellement ceux qui imposent à l'interprète le traitement dune grande quantité d'information par unité de temps, et ceux dont le traitement pose des problèmes qualitatifs.
Dans la première catégorie, on notera en premier lieu les discours informationnellement denses. Ces discours augmentent en effet les besoins en capacité de traitement dans deux Efforts : L'Effort d'écoute et d'analyse, puisque l'interprète doit comprendre une plus grande quantité d'information par unité de temps, et l'Effort de production, car l'interprète doit reformuler une plus grande quantité d'information par unité de temps. Sont concernés les discours rapides, les textes lus (en raison de leur plus grande densité informationnelle), les enumerations, qui sont plus denses dans la mesure où elles comportent peu d'éléments de transition et de liaison à faible contenu informationnel.
Parmi les déclencheurs qui posent des problèmes qualitatifs, notons les accents dont l'interprète n'a pas l'habitude, et les structures linguistiques inhabituelles ou grammaticalement incorrectes, par exemple chez des orateurs ne parlant pas leur langue maternelle. Dans tous ces cas, l'augmentation des besoins en capacité de traitement porte essentiellement sur l'Effort d'écoute et d'analyse.
Un cas particulier est celui des noms propres composés', c'est-à-dire formés de deux ou plusieurs mots nominaux et adjectifs, éventuellement reliés entre eux par des mots grammaticaux (« Organisation internationale des producteurs de... », « Association pour la recherche sur... »). Ces noms propres présentent deux éléments de difficulté. D'une part, ils sont denses, car les mots pleins qui les composent ne sont séparés que par un petit nombre d'éléments de liaison à faible densité informationnelle (le plus souvent des conjonctions). D'autre part, dans la plupart des cas, pour des raisons syntaxiques, leur restitution en langue d'arrivée demande un réagencement de ces éléments : par exemple, d'anglais en français :
1 2 3 4 « International Association of Conference Interpreters »
« Association internationale des interprètes de conférence » 2 1 4 '3
Il en résulte une activité de mémoire à court terme fort intense. On peut en effet supposer que l'interprète balaie une première fois le nom en langue de départ pour décider lequel de ses éléments doit être restitué en premier. Puis i l restitue
108 D A N I E L GILE
cet élément en langue de départ et le stocke pour référence. Il balaie une nouvelle fois le nom en langue de départ pour déterminer le deuxième élément, puis l'ajoute au nom en langue d'arrivée. Le processus se poursuit ainsi, avec des références continuelles au nom en langue de départ et aux éléments de nom déjà restitués en langue d'arrivée, ce qui accroit très sensiblement l'effort à fournir.
L'augmentation des besoins en capacité de traitement associée à des différences syntaxiques entre la langue de départ et la langue d'arrivée, important problème potentiel qui a donné lieu à de nombreuses controverses, est traitée plus en détail au Ch. 8 à propos des problèmes linguistiques de l'interprétation.
8.2 Segments de discours vulnérables à l'écoute
A côté des déclencheurs par augmentation des besoins en capacité de traitement, i l existe des déclencheurs dont le risque est lié à leur vulnérabilité à l'écoute. Il s'agit de segments de discours courts et peu redondants, tels que les chiffres et les noms propres dits simples' (non structurés en groupes de mots, par opposition aux noms propres 'composés'), dont le taux de restitution dans la pratique est très bas (voir Gile 1984). En raison de leur faible redondance, i l suffit d'une baisse d'attention momentanée ou d'une interférence sonore ou autre pour qu'ils ne soient pas reconnus.
Il est également possible que certains mots ordinaires en langue de départ soient plus vulnérables que d'autres pour la même raison, mais la dépendance de la redondance à l'égard du contexte est telle que l'on ne saurait les qualifier de 'déclencheurs' au même titre que les chiffres et les noms propres simples. La question est toutefois évoquée dans un contexte plus large, celui de la langue, au Ch. 8.
9. Le modèle d'Efforts de la consécutive
Contrairement à la simultanée, la consécutive peut être décomposée en deux phases bien distinctes, l'une pendant laquelle l'interprète assimile le discours de l'orateur et prend des notes, et l'autre pendant laquelle i l le restitue en langue d'arrivée.
Dans l'optique de la capacité de traitement, la phase d'écoute peut se décomposer en trois Efforts :
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 109
Ecoute en consécutive = E + M + PN + C
où
E désigne le même Effort d'écoute et d'analyse qu'en simultanée
PN désigne la production non pas du discours en langue d'arrivée, mais de notes écrites
M correspond à un Effort de mémoire à court terme, similaire à celui qui intervient en simultanée.
En effet, pöpr les raisons déjà évoquées pour la simultanée, une certaine attente est indispensable entre l'arrivée de l'information dans le cerveau de l'interprète et sa consignation par écrit, sous une forme ou une autre.
C désigne l'Effort de coordination des autres Efforts, comme en simultanée.
J es notes font l'objet d'une importante masse de publications, essentiellement didactiques. Rappelons à ce stade, avant d'y revenir plus loin, qu'elles ne constituent pas une représentation écrite du discours dans sa totalité, mais un ensemble de repères destinés à faciliter la recomposition du discours par l'interprète lors de la deuxième phase. Néanmoins, en raison du temps requis pour le mécanisme manuel de l'écriture, la prise de notes est une activité qui intervient sinon sans discontinuer, du moins pendant une très importante partie du temps d'écoute.
La phase de reformulation, quant à elle, peut être modélisée de la manière suivante :
Reformulation en consécutive — MLT + Lect + P
où
MLT correspond à un Effort de. mémoire à long terme', à savoir l'évocation du segment de discours à interpréter
Lect est l'effort de lecture et de décodage des notes prises pendant la première phase.
P est la production du discours en langue d'arrivée, comme en simultanée
Durant cette seconde phase, l'interprète peut partager son attention à son rythme ; û ne dépend pas du rythme d'arrivée des informations dans le discours de l'orateur. Qui plus est, i l
110 DANIEL GILE
peut déplacer toute son attention d un Effort à l'autre en cas de nécessité sans risquer de se trouver en déficit de capacité pour le traitement d'un nouveau segment. Enfin, loin de concurrencer l'Effort de mémoire à long terme, l'Effort de lecture des notes peut faciliter celui-ci. C'est pourquoi nous n'indiquons pas d'Effort C dans cette deuxième phase de la consécutive.
De toutes ces considérations, i l ressort que du point de vue de la capacité de traitement, pour un interprète compétent, seule la phase d'écoute est critique en consécutive. Si elle a été solide, la phase de reformulation devrait se dérouler sans difficultés. ' Les problèmes liés à la capacité de traitement se présentent
pendant la phase d'écoute de la consécutive de la même manière qu'en simultanée, avec des phénomènes de saturation et de déficit individuel. La principale différence entre la simultanée et la consécutive à cet égard se situe dans l'Effort de production. En effet, l'Effort de production du discours est subordonné à l'obligation de fidélité : l'interprète doit restituer la totalité du message de l'orateur en langue d'arrivée. En revanche, la production des notes n'est pas une obligation, car les notes ne sont qu'une aide à la reproduction, et i l n'est pas nécessaire de noter un élément de discours pour pouvoir le reconstituer. Dans le cas d'interventions courtes, i l arrive d'ailleurs souvent que l'interprète ne prenne pas de notes du tout. Dans le cas plus général, l'interprète note des éléments plus ou moins nombreux, mais en tout état de cause, i l ne note jamais toute l'information qu'il entend et qu'il reconstituera. En cas d'augmentation des besoins en capacité de traitement, i l a en consécutive, au moins théoriquement, la possibilité d'éliminer complètement l'Effort de production des notes et l'Effort de mémoire à court terme qui lui est associé. L'option n'est pas toujours viable, car selon les cas, l'absence de notes risque de peser plus ou moins lourd sur la capacité de l'interprète de reconstituer l'intervention par la suite, mais elle est bien réelle.
En tout état de cause, la prise de notes semble peser lourdement dans la consommation de capacité de traitement, au moins pendant la phase d'apprentissage de la consécutive. Sur le terrain, on observe régulièrement une baisse de la qualité de l'écoute chez des étudiants dès qu'ils commencent à aborder la prise de notes, et ils disent eux-même que lorsqu'ils prennent des notes, ils comprennent' moins bien. Une petite expérience que nous réalisons régulièrement à titre pédagogique au moment du premier contact des étudiants avec la prise de
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 111
notes (Gile 1991b) montre d'ailleurs assez clairement l'impact que celle-ci a en matière de capacité de traitement. L'expérimentateur explique qu'il va faire un discours que les étudiants devront interpréter en consécutive. Les étudiants sont divisés en deux groupes, dont l'un seulement a le droit de prendre des notes. L'expérimentateur fait une intervention contenant de nombreux noms propres, qui sont un indicateur sensible de la qualité de l'écoute (Gile 1984), et compare ensuite le nombre de noms propres reçus' par chaque groupe. Il s'avère régulièrement que les résultats sont meilleurs chez le groupe d'étudiants qui n'ont pas pris de notes.
10. Les Efforts en traduction à vue et en simultanée avec texte
La traduction à vue est une variante de l'interprétation qui est parfois demandée aux interprètes comme aux traducteurs. Il s'agit de traduire oralement un texte au rythme de la lecture.
Dans cet exercice, l'Effort d'écoute est remplacé par un 'Effort de lecture', qui n'est pas rythmé par l'orateur. De même, l'Effort de production se fait au rythme de l'interprète. Par ailleurs, le texte en langue de départ étant écrit (et quasiment toujours imprimé), les problèmes de reconnaissance des mots à l'écoute disparaissent. Pour la même raison, i l n'y a pas de risque de perte d'informations stockées en mémoire à court-terme comme c'est le cas en simultanée et lors de la phase d'écoute de la consécutive. En apparence, la traduction à vue devrait donc être facile. On s'aperçoit toutefois qu'il n'en est rien. En fait, même des étudiants qui ont une assez bonne maîtrise de la consécutive peuvent éprouver des difficultés en traduction à vue. Il semblerait que ces difficultés puissent être attribuées principalement à trois facteurs :
— Le travail porte sur un texte écrit, donc dense et structuré syntaxiquement d'une manière qui n'en facilite pas le traitement en petits segments consécutifs distincts.
—- Quand l'interprète découvre un texte lu, i l n'est pas aidé, comme en interprétation, par le rythme et la prosodie de la lecture. Il en résulte probablement un accroissement relatif des besoins en capacité de traitement de l'Effort de lecture par rapport à l'Effort d'écoute et d'analyse en interprétation.
— La présence permanente sous les yeux de l'interprète du texte en langue de départ allège sans doute l'Effort de mémoire, mais impose probablement une consommation sup-
112 DANIEL GILE
plémentaire de capacité de traitement pour lutter contre les interférences linguistiques.
A ces facteurs s'ajoute peut-être une surcharge de la capacité de traitement due au fait que la réception se fait par voie visuelle, alors que la reformulation est toujours vocale. Y aurait-il des interférences, ou l'absence d'un partage des ressources, possible dans la simultanée, dans ce passage de la réception visuelle à la production vocale ? Dans la traduction à vue, i l ne devrait toutefois pas y avoir de défaillances liées à un 'déficit individuel' ou à une saturation de la capacité de traitement disponible.
La simultanée avec texte est une variante de la simultanée ordinaire' : i l s'agit de l'interprétation simultanée d'un discours que lit l'orateur et dont l'interprète dispose en cabine. Dans ce mode intermédiaire entre la simultanée et la traduction à vue, l'on retrouve l'aide vocale et prosodique que donne l'orateur-lecteur à l'interprète, l'élimination des problèmes de reconnaissance au son, et la réduction de l'Effort de mémoire à court terme grâce à la présence visuelle du texte sous les yeux de l'interprète. En revanche, le texte, qui présente les caractéristiques de densité de l'écrit, est rythmé par l'orateur, qui a souvent tendance à le lire très vite. En outre, une certaine surcharge de l'Effort de coordination est probable du fait de la nécessité pour l'interprète de comparer en permanence le message perçu auditivement, par la voix de l'orateur, et celui que présente le texte. Une autre difficulté spécifique de ce mode d'interprétation est liée à la tendance de l'interprète, qui, en simultanée avec texte, ne craint pas les pertes afférentes à une surcharge de la mémoire, à chercher à restituer les informations dans leur totalité à partir du texte écrit même quand il a pris beaucoup de retard par rapport à l'orateur. L'écart peut se creuser au-delà de ce qui est rattrapable. Par ailleurs, tenté de se reposer sur l'écrit plutôt que sur le discours prononcé par l'orateur, l'interprète risque, précisément en raison de ce retard et de sa concentration sur l'écrit, de ne pas capter et de ne pas pouvoir suivre l'orateur dans d'éventuelles modifications du discours par rapport au texte écrit (sauts' et autres omissions, ajouts).
11. L'anticipation
Etant donné l'importance de l'élément probabiliste dans la compréhension du discours oral, les phénomènes anticipatoires
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 113
y ont un rôle capital, comme c'est d'ailleurs le cas dans la lecture. Les psychologues et psycholinguistes qui se sont penchés sur l'interprétation soulignent son importance dans la simultanée (Flores d'Arcais 1978, Le Ny 1978). Les interprètes en parlent eux aussi : elle apparaît dans la phase d'écoute du modèle de la simultanée de B. Moser (1978), elle est au cœur d'un article de W. Wilss sur l'interprétation à partir de l'allemand (1978), et C. Cartellieri (1983) la décrit comme l'une des principales composantes de la simultanée. D'après Kade et Cartellieri (1971), qui reprennent les idées de Chernov (voir Ch. 2), l'interprétation simultanée comporte un processus stochastique de compréhension et de reformulation du discours au cours duquel l'interprète anticipe de manière de plus en plus précise à mesure que le discours se déroule. L'importance de l'anticipation en simultanée est illustrée par l'expérience de G. Chernov 1973 évoquée au Ch. 2.
C'est le cas de l'interprétation allemand-français qui a Je plus souvent attiré l'attention des interprètes sur l'anticipation. M . Lederer (1981) explique que la possibilité d'interpréter une phrase allemande sans attendre le verbe conclusif et sans surcharger la mémoire résulte de la capacité de l'interprète d'anticiper le sens avant la fin de la phrase sur la base des premiers éléments entendus. D'autres auteurs, tels que G. Ilg (1978) et W. Wilss (1978), pensent que l'anticipation est moins aisée dans l'interprétation à partir de l'allemand. Gérard Ilg (1978) notamment décrit une stratégie destinée à aider l'interprète de simultanée à surmonter les problèmes posés par les différences syntaxiques entre l'allemand et le français langue d'arrivée, qui est fondée essentiellement sur les possibilités et les difficultés de l'anticipation dans la compréhension du discours oral en allemand (voir aussi Ch. 8). L'anticipation est également perçue comme un moyen de restructurer le discours pour réduire les risques d'interférences linguistiques (Seleskovitch 1981).
11.1 Les effets potentiels de Vanticipation
En l'absence de toute capacité anticipatoire, tout signal (en l'occurrence tout phonème, mot ou groupe de mots) est équi-probable, et l'interprète ne peut optimiser la répartition de sa capacité de traitement disponible entre les Efforts. Il en résulte, en ce qui concerne l'Effort d'écoute, un risque de déficit individuel susceptible de provoquer une défaillance, ou au contraire une attribution de capacité de traitement au-delà des
114 DANIEL GILE
besoins, qui retentit sur la capacité disponible pour les autres Efforts et risque elle aussi de provoquer une défaillance. La capacité anticipatoire permet donc en principe une optimisation de la répartition de la capacité de traitement.
L'anticipation permet aussi de réduire la capacité de traitement nécessaire au traitement du signal, puisqu'elle abaisse la quantité d'information (nouvelle) qu'il introduit. Par là, elle diminue aussi le temps nécessaire à son traitement (Peterfalvi 1970, Richaudeau 1981:43).
D'un autre côté, une anticipation erronée est susceptible de 'coûter' cher à l'interprète, quand elle l'entraîne dans une voie sans issue et l'oblige à rebrousser chemin par la suite. D'où la prudence conseillée par les professeurs d'interprétation dans la tactique de restitution anticipée du début de phrase (voir Ch. 5).
11.2 L'anticipation linguistique
L'anticipation linguistique porte sur les probabilités transi-tionnelles afférentes aux règles phonologiques, grammaticales, stylistiques et autres propres à la langue, ainsi qu'à la longueur des unités lexicales mêmes. L'anticipation extra-linguistique est fonction de la rhétorique du discours et des connaissances extra-linguistiques de l'interprète, et varie donc essentiellement en fonction de facteurs situationnels et personnels, peu explorés jusqu'ici. Sur le plan pratique, i l est souvent difficile de séparer l'anticipation extra-linguistique de l'anticipation linguistique, mais l'existence d'éléments linguistiques susceptibles de permettre l'anticipation avec un apport extra-linguistique faible ou nul ne fait pas de doute : • Au niveau lexical, les expressions idiomatiques, proverbes et dictons constituent des segments de discours assez longs qui, une fois identifiés, permettent de réduire sensiblement la capacité de traitement affectée à l'Effort d'écoute. C'est à ce type d'anticipation que pense probablement M. Lederer (1981.76) quand elle affirme que :
« ...la prévision rend l'audition pratiquement inutile, car il suffit d'entendre « vous vous êtes dépensé... » pour prévoir « sans compter » et « vous n'avez pas ménagé... » pour anticiper « vos efforts » »
Au niveau grammatical,
« ...la présence d'un mot de liaison permet de mettre en œuvre un
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 115
certain nombre de stratégies' (Clark et Clark 1977) : on peut y voir le début d'un constituant plus large (Fodor et Garrett 1967), et chercher alprs des mots pleins appropriés à ce type de constituant (par exemple, après un déterminant, chercher un nom) ; de même, en ce qui concerne les propositions, on peut utiliser le premier mot d'une proposition pour tenter de déterminer la fonction de cette proposition dans la phrase, ce qui est particulièrement intéressant quand ce premier mot est une conjonction annonçant une subordonnée adverbiale (parce que, si, avant que, puisque...) ou une subordonnée relative (qui, que, dont...). Pour ce qui est des mots pleins, les suffixes aideront à déterminer la catégorie grammaticale, et, une fois identifié l'un ou l'autre mot plein, on pourra chercher d'autres mots pleins qui s'y rapportent : un verbe transitif demande un nom, un adverbe demande un verbe, etc., et on les cherchera de préférence dans le voisinage le plus proche. » (Costermans 1980:121)
En tout état de cause, les mots outils tels que les interroga-tifs (que, où, comment, etc.), les articles et les mots de coordination, dont la charge informative au sens sémantique est plutôt faible, sont des prédicteurs (Richaudeau 1981:48) et ont donc une grande utilité potentielle en simultanée. 11 en est de même des désinences, surtout dans les langues où les substantifs ont une déclinaison plutôt riche (notamment dans les langues slaves et en grec), car elles peuvent faciliter l'anticipation en indiquant le rôle grammatical ou fonctionnel des éléments apparaissant en début de phrase et donnent donc des indices sur la suite à venir.
Les considérations ci-dessus mettent en relief les problèmes susceptibles d'être posés par un orateur faisant son intervention dans une langue mal maîtrisée, problèmes évoqués plus haut à propos de l'Effort d'écoute. Au-delà des éventuels problèmes d'accent, en ne respectant pas les probabilités transi-tionnelles propres à la langue, i l rend l'anticipation plus difficile et plus risquée.
Par ailleurs, i l ne semble pas déraisonnable de penser que dans les langues où les indications grammaticales sont peu nombreuses, par exemple en japonais, l'anticipation linguistique est moins facile. De même, étant donné l'importance syntaxique et la charge informationnelle du verbe dans le discours (Noizet 1980), i l est plausible que sa présence vers le début de la phrase dans certaines langues favorise l'anticipation, et que son emplacement en fin de phrase dans d'autres langues, telles que l'allemand ou le japonais, ait un effet contraire.
116 D A N I E L G I L E
On peut également évoquer la progression de la marge de liberté syntaxique dans la construction de la phrase comme facteur susceptible d'influencer les possibilités d'anticipation. Dans certaines langues plus que dans d'autres, les choix faits successivement déterminent la suite de la phrase. En japonais, notamment, les particules et la nominalisation tardive de groupes verbaux permettent des échappatoires et des revirements jusqu'à la toute dernière partie de la phrase, ce qui rendrait l'anticipation difficile (Fukuii et Âsano 1961). En revanche, toujours en japonais, les phrases se terminent souvent par des fins de phrase de plusieurs syllabes ayant un contenu informationnel quasiment nul qui peuvent être anticipées grâce à l'intonation de l'orateur, mais aussi grâce à des prédicteurs particuliers. La possibilité qui en résulte d'anticiper sur plusieurs syllabes peut théoriquement avoir une importante incidence sous l'angle des modèles d'Efforts (Gile 1992b).
On peut également énumérer les obstacles linguistiques à l'anticipation. Certains tiennent aux caractéristiques grammaticales des langues concernées. D'autres sont d'ordre stylistique. F. Richaudeau (1981:41) cite deux types de structures qui font obstacle à l'anticipation linguistique :
— L'énumération, qui « s'oppose particulièrement au processus d'anticipation, le sujet récepteur ne pouvant prévoir quand la chaîne de concepts égrenés cessera pour faire place à un prédicat. »
— L'enchâssement, qui interrompt le flux logique d'une proposition en y intercalant une autre.
On notera qu'une partie des caractéristiques de renoncé qui en facilitent l'anticipation ou au contraire le rendent difficile relèvent de la langue (grammaire, longueur des unités lexicales), alors que d'autres relèvent du style personnel de l'orateur. La part relative de chacune de ces catégories dans l'anticipation n'est pas connue. Il serait techniquement envisageable de l'étudier à travers un très grand échantillon statistique de discours, de langues et d'orateurs, mais au stade actuel de l'exploration de l'interprétation, l'effort paraît inaccessible.
12. Réalité et perspectives dans les modèles d'Efforts sous l'angle de la recherche
Les modèles d'Effort constituent un cadre conceptuel cohérent, susceptible d'expliquer de nombreuses fautes et maladresses commises par les interprètes et de servir de grille pour
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 117
évaluer l'efficacité de différentes stratégies et tactiques professionnelles (Ch. 5).
Sur le plan de la recherche, leur principale faiblesse réside dans le fait qu'ils restent théoriques et intuitifs : ils ont beau s'appuyer sur des concepts et résultats de la recherche linguistique et psycholinguistique, leur vérification expérimentale est problématique.
En effet, i l est très difficile de mesurer la consommation et les besoins en capacité de traitement avec une fiabilité et une précision suffisantes, surtout compte tenu des variations très rapides que postulent ces modèles : à la vitesse du discours spontané, qui est de l'ordre de 100 à 250 mots/minute, i l faudrait mesurer des indicateurs ayant une latence d'une fraction de seconde. La plupart des indicateurs physiologiques connus (rythme cardiaque, tension artérielle, mouvements musculaires, résistance électrique de la peau) n'ont pas cette vitesse de réaction. Il semblerait que le diamètre de la pupille varie en fonction de la « charge mentale » avec une latence de quelque 0,5 secondes. J. Tommola de Turku, en Finlande, a comparé la dilatation moyenne de la pupille de 9 étudiants de simultanée dans trois conditions expérimentales : l'écoute d'un discours, sa répétition avec décalage (shadowing') et son interprétation simultanée. En moyenne, la dilatation était plus grande en simultanée qu'en répétition avec décalage, et plus grande en répétition que dans l'écoute (Tommola et Hyönä 1990). Selon la même méthode, Tommola et Niemi (1985) ont pu faire apparaître des variations dans la dilatation de la pupille selon la complexité de la structure syntaxique du discours de départ. Ces études nous semblent présenter un intérêt considérable : pour la première fois, l'on a pu mesurer les variations de la capacité de traitement totale utilisée à travers un indicateur physiologique, et ce en ligne'. Notons que pour des raisons techniques, i l a fallu demander aux sujets de poser leur menton sur un appui et de fixer un point précis pendant l'expérience. Ces conditions artificielles limitent le champ d'application de la méthode.
Une autre direction prometteuse est celle des mesures directes de l'activité cérébrale par électro-encéphalographie ou par imagerie médicale non invasive. Comme i l est indiqué au Ch. 3, une première exploration de l'activité cérébrale lors de l'interprétation par EEG a été réalisée à Vienne (Kurz 1992a et Petsche 1993), où a été a étudiée la latéralisation cérébrale dans différentes conditions expérimentales, notamment l'interprétation vers la langue A et vers la langue B. Là aussi, des
118 D A N I E L G I L E
problèmes techniques se posent, dans la mesure où l'interprétation était « mentale », sans articulation vocale, car celle-ci aurait provoqué des interférences dans les mesures.
Par ailleurs, s'il est possible de mesurer les variations des besoins totaux en capacité de traitement, i l est difficile de distinguer les besoins individuels à moins de modifier sensiblement ou de supprimer l'un des Efforts, au risque de fausser toute la structure et la dynamique du système, et ce en raison de l'interdépendance de ces Efforts dans le temps.
Enfin, les défaillances elles-mêmes ne sont pas nécessairement perceptibles, comme i l est indiqué au Ch. 6, et quand elles ne se manifestent que par un ralentissement du débit ou par une élégance moindre du discours en langue d'arrivée, il nous semble très difficile de mettre la chose en évidence.
En résumé, i l est envisageable de valider ou de réfuter en partie les modèles d'Efforts par des mesures en ligne de la capacité de traitement, ce qui permettra d'en affiner progressivement les éléments, mais i l semble difficile pour le moment de viser une validation totale de l'explication de la dynamique des défaillances qu'ils postulent.
Chapitre 5
—_— ( —- —-
Stratégies et tactiques de l'interprète
Comme il est montré au Ch. 4, Les contraintes qui pèsent sur l'interprétation rendent son exercice difficile, et tant les risques de défaillances que les occurrences de défaillances sont nombreux. Il apparaît donc intéressant d'étudier les stratégies et tactiques dont usent les interprètes pour y faire face.
1. Stratégies fondamentales de fidélité
1.1 Qualité et fidélité
Il est difficile de donner une définition absolue' de la qualité en interprétation, car, comme il est expliqué au Ch. 6, les attentes semblent varier non seulement selon la position de chacun dans l'acte de communication (orateur, auditeur comprenant la langue de. départ, auditeur ne comprenant pas la langue de départ, président de séance, interprète actif, interprète recruteur, client), mais aussi selon le type de conférence (culturelle, politique, technique, de loisir ou d'études, de négociation, etc.), sans parler d'une variabilité individuelle tenant à la personnalité de chacun.
Le présent chapitre étudie les stratégies et tactiques utilisées en interprétation. Il le fait du point de vue de l'interprète, qui concorde généralement avec celui des autres acteurs dans les directions générales suivies, sinon dans le poids relatif accordé à chaque composante.
Les idées exprimées ici résultent de l'observation de la pratique, et notamment de l'auto-observation, ainsi que des infor-
120 D A N I E L G I L E
mations recueillies lors de conversations avec des praticiens, y compris des professeurs d'interprétation. L'ensemble de ces sources donne l'impression d'une grande convergence sur les principes. Pour ces praticiens et enseignants, la qualité consiste essentiellement en :
— La transmission aux destinataires de la totalité du message' de l'orateur, c'est-à-dire de ce qu'il veut transmettre (par opposition aux autres informations que peut véhiculer son discours pour différentes raisons, comme il est expliqué plus loin).
— La transmission de ce message d'une manière claire pour les auditeurs.
— La transmission du message de manière convaincante, ce qui implique la justesse du registre et de la terminologie.
— La transmission du message d'une manière agréable pour l'auditeur : voix, prosodie, comportement hors cabine des interprètes.
Parmi ces trois objectifs, c'est le concept de fidélité qui a toujours intrigué les chercheurs, que ce soit en interprétation ou en traduction. La question est traitée plus loin sur la base d'une expérience empirique (voir aussi Gile 1985b).
1.2 Liberté et fidélité
Pour quiconque connaît le temps nécessaire à la production d'un texte d'arrivée fidèle et linguistiquement acceptable en traduction, la question de savoir comment il est possible de produire un discours fidèle en interprétation à la vitesse de renonciation spontanée apparaît fondamentale. Deux opinions semblent prédominer : selon l'une, étant donné la vitesse des opérations, l'interprète ne saurait aller au-delà d'une approximation du discours de départ ; selon l'autre, la fidélité se paie au prix d'une qualité linguistique inférieure mais néanmoins acceptable à l'oral, car les normes grammaticales et stylistiques de l'oral sont moins strictes que celles de l'écrit.
Dans les écoles d'interprétation, l'optique est différente. Non seulement les professeurs combattent fortement le littéralisme, comme le font aussi leurs collègues professeurs de traduction (voir Harris .1981), mais ils préconisent souvent une liberté par rapport au discours de départ qui semble aller au-delà de ce qu'acceptent la plupart des professeurs de traduction, du moins dans le domaine de la traduction scientifique et technique (dans la traduction littéraire, il semble y avoir une souplesse bien plus grande). Ils approuvent notamment la para-
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 121
phrase et les changements volontaires de structures de phrase, y compris de petits changements dans l'agencement de l'information, et acceptent à l'occasion des synthèses, voire des commentaires sur des passages du discours original. '
Ce point de vue peut s'expliquer sous l'angle tactique, si l'on considère qu'il s'agit de mesures destinées à limiter les incidences d'un problème ponctuel, tel que des perturbations dans les conditions d'écoute ou un discours trop rapide ou trop complexe. Il s'agit alors d'essayer de sauver' le maximum de ce qui peut l'être dans une optique de gestion de crise'. Notons toutefois que certains enseignants estiment que l'interprétation doit être complète ou ne pas être, et qu'ils préconisent l'arrêt de l'interprétation quand les conditions de travail sont mauvaises. Cette attitude, encore relativement fréquente dans certains milieux il y a une vingtaine d'années, est en voie de disparition (voir Section 3.1).
En revanche, on peut se demander si la grande liberté préconisée dans l'interprétation se justifie en tant que stratégie usuelle. Sous cet angle, on peut rappeler que des observateurs ont souvent l'impression d'une fidélité « parfaite » même quand l'interprète s'est éloigné peu ou prou du discours de départ (voir Ch. 6). En fait, contrairement aux lecteurs de textes, qui peuvent théoriquement passer autant de temps qu'ils le souhaitent à lire et relire un passage qui les intéresse et l'examiner minutieusement, les auditeurs entendent le discours une seule fois et n'en ont pas un souvenir textuel complet —les traces linguistiques d'un énoncé capté semblent en effet disparaître de la mémoire à court terme bien plus vite que ses traces sémantiques (Sachs 1967). Autrement dit, les déviations par rapport à une fidélité « littérale » peuvent perdre toute signification pratique dans la mesure où elles ne sont pas perçues.
Toutefois, ces considérations d'ordre pratique ne justifient pas à elles seules la liberté que prennent les interprètes même quand ils n'y sont pas contraints, en ce sens qu'une erreur non perçue n'en demeure pas moins une erreur. Les stratégies de fidélité des interprètes ont trois autres justifications, qui prennent tout leur sens en se fondant sur la première :
— La tendance actuelle des interprètes (et traducteurs), telle qu'elle se manifeste notamment dans la philosophie officielle des principales écoles professionnelles, est de considérer qu'ils traduisent essentiellement un message' ou des informations énoncés au service d'une intention de communication. Celle-ci consiste, dans les discours non-littéraires, à informer, à expliquer, à convaincre. La fidélité due au discours n'est donc pas
122 D A N I E L G I L E
une fidélité linguistique, mais essentiellement une fidélité à l'orateur, que l'on représente, et à ses intérêts, donc à son intention de communication. Comme l'écrit D. Seleskovitch (1968:172), « L'interprète vise constamment à faire réagir ses auditeurs à l'intervention de l'orateur dans le sens désiré par celui-ci ». La 'fidélité linguistique' est donc reléguée à une deuxième place ; elle est quasiment assimilée à une contrainte superposée à la tâche principale.
— D'autre part, le discours produit spontanément est 'bruité' par des facteurs extérieurs au message, à l'intention et à la physionomie linguistique voulue par l'orateur (problèmes de maîtrise linguistique chez l'orateur, stress, facteurs perturbateurs environnementaux). Il apparaît donc légitime de ne pas tenir compte qk ce 'bruit' au même titre que du 'message' proprement dit.
— Enfin, certains changements sont rendus indispensables par les différences inter-linguistiques.
1.3 Une expérience dénonciation
Ces deux derniers éléments apparaissent dans une expérience d'énonciation que nous réalisons régulièrement avec des étudiants, des traducteurs et interprètes professionnels et des chercheurs (voir par exemple Gile 1985b). Une idée simple est présentée au tableau graphiquement. L'expérimentateur explique aux participants la situation de communication ; dans l'exemple de la Fig. 1, ils sont assis à côté du conducteur, aperçoivent le panneau routier et souhaitent informer le conducteur de ce que dit le panneau. Puis l'expérimentateur leur demande d'écrire sur papier l'énoncé qu'ils produiraient en situation, chacun dans sa langue maternelle.
Dans cette expérience, les énoncés produits diffèrent quasiment tous les uns des autres, les différences pouvant être minimes, mais aussi très importantes. A titre d'exemple, voici quelques énoncés en français recueillis pour la Fig. 1 :
1. « Encore 50 kilomètres jusqu'à Paris » 2. « Plus que 50 kilomètres » 3. « 50 kilomètres » 4. « Nous sommes à 50 kilomètres de Paris » 5. « On est à 50 kilomètres de Paris » 6. « Il y a un panneau qui dit que nous sommes à 50 kilomètres de Paris » 7. « Le panneau dit que nous sommes à 50 kilomètres de Paris »
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 123
8. « D'après le panneau, on est à 50 kilomètres de Paris » 9. « Paris est à 50 kilomètres d'ici »
10. « Paris : 50 kilomètres »
Figure 1 : Dessin utilisé pour une expérience sur renonciation
Une partie de la variabilité s'explique par des différences dans la perception de la situation de communication par les participants. D'autres différences semblent relever d'une variabilité personnelle dans le processus d'énonciation chez le locuteur. Ainsi, les sujets choisissent d'encadrer le message, qui porte en substance sur la distance, de différentes manières : en mentionnant spécifiquement le panneau, en rappelant Paris, etc. En outre, pour des raisons liées à des règles linguistiques, leurs énoncés apportent d'autres informations, qui sont étrangères au message : par exemple, le fait que Paris est une entité singulière et que la distance de 50 kilomètres s'applique au moment de renonciation (informations véhiculées par le présent et le singulier dans « est »), ou que les relations entre le locuteur et son interlocuteur sont de nature telle que le premier pense pouvoir se permettre la tournure familière « on est ». Dans ces énoncés, on peut donc distinguer, en plus du message' du locuteur, des 'informations secondaires', à savoir les informations d'encadrement', les 'informations induites par les contraintes linguistiques', et des informations dites 'person-
124 DANIEL GILE
nelles' (voir Gile 1985b), dont une partie n'y figurent pas par la volonté du locuteur.
Autre fait intéressant, quand, dans une variante de l'expérience, on retire aux participants la feuille portant le premier énoncé et qu'on leur demande d'énoncer une nouvelle fois la même idée, une partie d'entre eux forment m\ énoncé différent du premier. Interrogés sur les raisons pour laquelle les deux énoncés ne sont pas identiques, ils répondent soit ne pas savoir, soit avoir changé d'optique', soit avoir pensé que le deuxième énoncé était meilleur que le premier sur le plan linguistique ou communicationnel.
De ces variations, il apparaît que lors de renonciation spontanée, le locuteur n'obéit pas à des lois déterministes qui aboutissent à un énoncé particulier, mais qu'il produit des énoncés dont i l peut penser qu'ils ne sont pas nécessairement optimaux au regard de l'acte de communication qu'ils servent, et qu'il peut souhaiter modifier par la suite. Ces observations concordent avec le fait que même dans l'écrit, où les auteurs disposent de plus de temps que les locuteurs produisant spontanément un énoncé oral, les modifications et corrections sont monnaie courante.
L'ensemble de ces facteurs semblent justifier une certaine liberté dans renonciation spontanée qu'est l'interprétation, à condition que cette liberté soit au service de l'efficacité de la communication, dans la recherche d'un énoncé plus clair, plus convaincant, plus acceptable sur le plan linguistique, mais qui respecte néanmoins le message, l'esprit et le style de l'orateur. Ils expliquent aussi que cette liberté soit moindre en traduction. D'une part, l'énoncé écrit à traduire a pu faire l'objet d'un contrôle et d'éventuelles améliorations qui ont abouti à sa forme actuelle, ce qui peut réduire la variabilité involontaire chez l'auteur par rapport à renonciation orale spontanée. D'autre part, le style' perçu par le lecteur dépend uniquement de l'énoncé qu'il lit en langue d'arrivée, alors que le style' de l'orateur en interprétation apparaît aussi à travers sa présence physique sur les lieux, donc son image et éventuellement sa voix. En interprétation, la partie vocale et la partie non-verbale de la traduction jouent donc un rôle non négligeable dans la reconstitution du style' de l'orateur.
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 125
1.4 Priorités dans la fidélité
Concrètement, les interprètes semblent suivre les priorités stratégiques suivantes :
a. Le message de l'orateur doit être intégralement transmis
b. Les informations secondaires présentes dans l'énoncé en langue de départ sont transmises en langue d'arrivée (dans le cas où elles sont reconnues en tant que telles), mais seulement si leur présence ne nuit pas excessivement (de l'avis subjectif de l'interprète) à l'obtention de l'effet recherché. Dans la hiérarchie qui en résulte, les informations d'encadrement et les informations personnelles semblent être prioritaires.
c. Le message' s'analyse et se restitue au niveau moléculaire' du mot, du groupe de mots, de la proposition ou de la phrase. Sauf cas particulier, l'interprète ne cherche pas à fusionner les messages moléculaires en un macro-message' dans son propre discours. De même, les autres types d'informations s'analysent et se restituent au niveau de la proposition ou de la phrase.
2. Stratégies de préparation ad hoc des conférences
Contrairement à la traduction écrite, qui permet l'acquisition des informations nécessaires en cours de traduction, l'interprétation demande une préparation avant le travail sur le discours, car une fois engagé dans le processus, l'interprète a très peu de temps et ne peut se déplacer pour aller rechercher des informations qui lui manquent.
La préparation des conférences par les interprètes vise essentiellement l'acquisition des connaissances nouvelles nécessaires à l'interprétation, ainsi que l'activation des connaissances pertinentes existantes. En effet, les connaissances sont plus ou moins 'disponibles', en ce sens que leur évocation en compréhension ou en production lors de l'interprétation demande plus ou moins de temps et de capacité de traitement. L'importance de cette 'disponibilité' apparaît sous l'éclairage des modèles d'Efforts du Ch. 4 : plus les connaissances sont disponibles, moins les besoins en capacité de traitement sont élevés dans l'Effort d'écoute, et éventuellement dans l'Effort de production et l'Effort de mémoire à court terme. Là aussi, l'interprétation contraste fortement avec la traduction, où une forte disponibilité des connaissances est utile, mais non critique.
126 D A N I E L G I L E
2.1 La preparation ad hoc
On peut distinguer la préparation continue et la préparation ad hoc pour une conférence particulière. La première vise à approfondir et à entretenir les connaissances générales de l'interprète, car au-delà du domaine spécifique dans lequel se situe une conférence, i l y est souvent fait allusion à des faits culturels anciens ou modernes, et notamment à l'actualité sociale, économique, politique, technologique ou scientifique, qui ne touchent pas directement le thème de la conférence. Les interprètes sont donc supposés avoir une culture générale assez large, qu'ils entretiennent en se tenant au courant de l'actualité. Les moyens de communication de masse sont le véhicule privilégié de ces efforts.
La préparation ad hoc, quant à elle, est principalement documentaire (mais pas exclusivement, comme il est expliqué plus loin). Elle se fonde sur les textes de la conférence concernée (programmes, abstracts, textes des communications, informations sur les participants, etc.), ainsi que sur des textes extérieurs à la conférence, choisis ' parce qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être pertinentes et utiles lors de la conférence. Elle porte sur des éléments linguistiques, principalement des termes spécialisés, et sur des éléments extralinguistiques (informations sur le sujet, les idées, les participants, leurs positions respectives, etc).
Essentiellement, la préparation documentaire consiste en trois opérations : la lecture de textes, le repérage et éventuellement le marquage physique des éléments d'information pertinents, et, le plus souvent, la préparation de listes de termes ou de glossaires pour la conférence. Les méthodes pratiques sont assez peu variées, si ce n'est dans les détails, comme dans la manière de marquer un terme (souligner, entourer, marquer au feutre, etc.), ou dans l'organisation du lexique (tri alphabétique, classement chronologique ou par sujet, glossaire manuscrit, dactylographié ou préparé sur ordinateur).
2.2 Préparation thématique et préparation terminologique
La préparation ad hoc peut se diviser chronologiquement en trois étapes : Ja préparation avant la conférence, la préparation de dernière minute, et la préparation en cours de conférence.
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 127
La préparation avant la conférence est celle où l'interprète a la plus grande liberté de manœuvre, puisqu'il dispose d'un certain temps et peut se déplacer. La préparation de dernière minute intervient quand l'interprète se trouve sur les lieux de la conférence, reçoit des documents supplémentaires et peut interroger des spécialistes sur place. Enfin, la préparation en cours de conférence consiste en l'utilisation des interventions déjà entendues et des textes remis aux interprètes une fois la réunion commencée pour la préparation des interventions qui doivent suivre.
La principale question stratégique qui se pose en matière de préparation ad hoc porte sur la préparation avant la conférence, et plus précisément sur l'équilibre idoine entre une préparation terminologique et une préparation 'thématique'. Etant donné les contraintes de temps, surtout en période chargée, les interprètes, qui peuvent ne disposer que de quelques jours, voire de quelques heures pour la préparation, n'ont souvent pas le temps de travailler à fond sur les deux.
La préparation terminologique consiste principalement à rechercher les termes spécifiques susceptibles d'apparaître lors des interventions, ainsi que leurs équivalents dans les différentes langues de travail concernées. La préparation 'thématique' vise l'acquisition de connaissances sur les concepts, les idées et les mécanismes plutôt que sur les termes. Il va de soi que la préparation thématique apporte sa moisson de termes, car les concepts s'expriment en termes, et que la préparation terminologique apporte des connaissances thématiques, car le travail n'est pas uniquement terminographique. Toutefois, les termes acquis lors d'une préparation essentiellement thématique ne sont pas tous pertinents et ne répondent souvent qu'à une petite partie des besoins. De même, les connaissances thématiques acquises lors d'une préparation terminologique sont essentiellement taxinomiques et ne couvrent pas tous les besoins.
En faveur de la préparation thématique, on peut faire valoir l'aide que peut apporter la connaissance de la structure conceptuelle du domaine pour l'analyse du discours de départ. En revanche, la macrostructure des discours spécialisés qui sont faits en conférence ne semble pas différer dans ses composantes principales en fonction du degré de spécialisation. Il s'agit toujours de la présentation d'une action et de ses conséquences, de la comparaison entre deux concepts, méthodes, procédés ou objets, de l'accumulation d'arguments en faveur ou contre une idée, de la description, selon une progression
128 D A N I E L G I L E
plus ou moins standard, dune expérience scientifique, etc. L'articulation macrostructurelle du discours ne pose donc pas à l'interprète beaucoup de problèmes liés à la spécialité concernée, même si la fréquence de différents types de macrostructures varie selon les domaines.
En revanche, les problèmes de compréhension et de restitution se posent souvent dans les parties moléculaires' du discours (Lederer 1981:53), au niveau de la phrase, et sont le plus souvent situés dans le vocabulaire technique, en interprétation comme en traduction. C'est pourquoi, dans une optique utilitaire, i l semble raisonnable de privilégier la préparation terminologique quand l'interprète dispose de peu de temps. D'après nos observations sur le terrain, c'est également la tendance générale de la quasi-totalité des professionnels.
Il est intéressant de noter que dans les écoles, les professeurs d'interprétation préconisent souvent une démarche thématique partant de l'assimilation du contenu des ouvrages de vulgarisation (D. Seleskovitch 1968 :113). Etant donné les considérations énoncées plus haut, on peut s'interroger sur l'efficacité de la démarche, en tout cas à court terme, face aux difficultés qu'apporte chaque conférence, où tant les concepts que les termes peuvent aller bien au-delà de ceux qu'on trouve dans le texte de vulgarisation. En revanche, à long terme, l'acquisition de connaissances de base bien structurées est susceptible de favoriser une implantation plus solide en mémoire et une meilleure compréhension d'éléments de connaissance spécialisés.
2.3 Un cas d'espèce
A notre connaissance, aucune étude empirique n'a été réalisée pour comparer les mérites de la composante thématique et de la composante terminologique de la préparation en interprétation. Sur cette dernière, i l n'existe qu'une étude de cas, faite par Gile (1989a), dans laquelle était examiné le taux de couverture terminologique des lexiques réalisés lors d'une préparation thématique.
La conférence préparée était un atelier de rythmologie dans une réunion de cardiologie, avec interprétation anglais-français. Aucun document de conférence n'avait été fourni à l'interprète, qui avait donc dû chercher des sources par lui-même. .Un cardiologue avait • conseillé la lecture des chapitres de rythmologie dans un livre de cardiologie précis, rédigé en anglais. Le même cardiologue avait ensuite indiqué les équiva-
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 129
lents en français. En tout, 110 termes techniques ont été relevés dans le livre, retenus et rassemblés dans un lexique.
Plusieurs constatations ont été faites lors de cette étude de cas :
— Le dictionnaire médical considéré par les interprètes de conférence et traducteurs comme le plus complet dans les langues concernées (WJ. Gladstone, Dictionnaire anglais-français des sciences médicales et paramédicales, St-Hyacinthe, Québec, et Paris, Edisem et Maloine) couvrait moins de 50 % des entrées du lexique.
— Les entrées du lexique ne couvraient qu'une fraction du vocabulaire spécialisé effectivement employé lors de la conférence. Pour des raisons pratiques, i l n'a pas été possible de faire une liste exhaustive des termes nouveaux' apparus en conférence et n'ayant pas été vus lors de la préparation, mais lors d'un échantillonnage quasi-aléatoire de 11 segments de 10 minutes répartis sur les 4 jours de la conférence, une moyenne de quelque 12 termes nouveaux' par segment a été relevée.
—- La plupart des termes utilisés en conférence et n'apparaissant pas dans le lexique n'ont pas posé de problèmes de compréhension ou de traduction en raison de leur similitude morphologique avec d'autres termes connus, en langue d'arrivée ou en langue de départ. Si les deux langues avaient été plus éloignées (français et allemand, français et russe, français et japonais), les problèmes auraient probablement été bien plus nombreux.
3. Stratégies et tactiques en ligne
3.1 Les tactiques en simultanée
En dépit de sa préparation, l'interprète se heurte très régulièrement à des problèmes en cours d'interprétation. Un terme technique, un nom propre ou un chiffre peuvent être mal compris, que ce soit par manque de connaissances, par déficit individuel dans l'Effort d'écoute au moment où il est énoncé, ou en raison d'une difficulté technique, par exemple de mauvaises conditions acoustiques. Même compris, le même élément peut poser des problèmes à la restitution, notamment :
— Si l'interprète ignore le terme ou le nom correspondant en langue d'arrivée
—-En raison d'un 'trou de mémoire'
130 D A N I E L G I L E
— L'élément en question peut avoir été oublié par l'interprète entre l'écoute et le moment de la restitution
— En raison d'une insuffisance de la capacité de traitement disponible pour la production au moment voulu
— En raison d'une interférence linguistique venant de la langue de départ.
Face à de telles difficultés, l'interprète peut avoir recours à une vingtaine de tactiques, qui s'appliquent chacune à une ou à plusieurs catégories de déclencheurs ou de difficultés :
1. La reconstitution par le contexte Un effort conscient permet souvent de reconstituer, par ana
lyse logique du contexte et de la situation et à l'aide des traits pertinents entendus, un élément de discours qui n'a pas été compris clairement.
Cette tactique, qui répond à des problèmes à l'écoute, n'est que l'extension consciente et volontaire d'une activité mentale qui fait partie de la perception du discours en conditions ordinaires.
2. L'attente Face à un problème de compréhension, l'interprète choisit
parfois d'attendre que le contexte lui donne davantage d'éclaircissements et tergiverse, par exemple en ralentissant renonciation de son discours ou en recourant au remplissage', à savoir la production d'un segment d'énoncé n'apportant aucune information nouvelle mais permettant d'éviter le 'blanc' (par exemple à travers des formules telles que « comme je vous le disais, Monsieur le Président, mes chers collègues », « c'est donc un problème important », etc.).
Le coût de cette tactique se mesure essentiellement en retard pris par rapport à l'orateur.
3. La mobilisation du collègue passif En simultanée, les interprètes travaillent par équipes d'au
moins deux personnes en cabine. En cas de difficulté, l'interprète passif (qui ne parle pas), dont la capacité de traitement est disponible, peut être mobilisé pour aider son collègue actif. Il peut avoir mieux entendu ou mieux compris le segment en question ou avoir une bonne solution pour sa restitution, et peut l'écrire sur une feuille pour son collègue. En outre, sa disponibilité lui permet de consulter un document ou un dictionnaire, ce que ne peut faire l'interprète actif sous peine de perdre trop de temps et de capacité de traitement.
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 131
Cette tactique peut être très efficace. En théorie, elle fait partie de la procédure de travail standard en cabine de simultanée. Dans la pratique, elle n'est pas toujours mise en œuvre, car les interprètes peuvent se retrouver seuls en cabine au moment où se produit une difficulté, et même quand ils ne le sont pas, l'interprète passif préfère souvent se reposer plutôt que de se concentrer sur le discours original et son interprétation.
4. La consultation de documents en cabine Dans la mesure où une information se trouve dans des
documents présents en cabine, l'interprète peut les consulter tout en travaillant. Cette tactique est consommatrice de temps et de capacité de traitement, et peut par là générer des saturations et des déficits individuels. Toutefois, elle est difficilement contournable. En effet, les interprètes ne peuvent stocker en mémoire toutes les informations dont ils sont susceptibles d'avoir besoin en conférence, et tenter d'en assimiler systématiquement un maximum est une stratégie économiquement peu raisonnable, surtout quand i l s'agit d'éléments d'information qui risquent fort de ne pas être mentionnés en conférence ou qui le sont une ou deux fois en tout. La consultation de documents en cabine est également nécessaire quand les intervenants se réfèrent spécifiquement à des passages figurant dans des textes écrits, notamment en comité de rédaction.
Le coût de la tactique en temps et en capacité de traitement peut être réduit dans une certaine mesure grâce à une bonne préparation, et notamment à travers une disposition intelligente des documents en cabine, qui permet de les retrouver facilement, et un bon marquage de l'information, qui en facilite le repérage en cours d'interprétation.
5. La restitution à un niveau d'abstraction plus élevé Il s'agit de remplacer un terme par un hyperonyme
(« streptokinase » par « enzyme », « répéteur » par « machine »), un nom de personne par une fonction, par une nationalité ou par un autre attribut de la personne (« Monsieur Katzantzakis a déclaré » peut ainsi être rendu par « l'auteur a dit », par «le délégué grec a dit », par « une personne a dit »), une idée par une autre idée plus abstraite.
Cette tactique s'applique tant à un segment de discours mal compris qu'à un segment que l'interprète a du mal à rendre avec précision dans la langue d'arrivée.
132 DANIEL GILE
6. La reproduction phonétique approximative Un nom mal entendu peut être rendu par une approxima
tion phonétique, l'interprète essayant de reproduire le son tel qu'il l'a entendu. Cette tactique peut également être utilisée pour un terme technique non compris, s'il est raisonnable de supposer que ce terme en langue de départ est connu des auditeurs de l'interprète ou peut être compris par eux.
7. L'omission tactique Il s'agit d'une omission consciente de l'information véhiculée
par un segment donné si l'interprète ne l'a pas comprise, s'il l'a oubliée ou s'il a du mal à la restituer en langue d'arrivée. L'omission tactique' se distingue de l'omission inconsciente, qui intervient par exemple quand l'interprète n'a pas assez de capacité de traitement dans l'Effort d'écoute et d'analyse et qu'il n'enregistre' pas un segment de discours donné.
8. L'interpellation des auditeurs En cas de difficulté de compréhension ou de restitution, l'in
terprète peut choisir d'en informer les auditeurs en sortant de son rôle d'alter ego de l'orateur, à travers une interpellation telle que « ...et un autre produit dont l'interprète n'a pas saisi le nom » (variante 'information') . Il peut aussi leur demander de demander à l'orateur de ralentir, de brancher son microphone si celui-ci est hors-tension, de se rapprocher du microphone s'il en est trop loin (variante 'demande d'intervention').
Si cette tactique peut avoir une certaine efficacité là où les autres sont impuissantes, notamment dans sa variante 'demande d'intervention', elle a peut-être un effet perturbateur. En effet, elle change brusquement les règles du jeu, l'interprète n'étant plus 'transparent' mais intervenant actif. Elle peut aussi gêner ou embarrasser les auditeurs en leur demandant d'intervenir alors qu'ils ne le souhaitent pas. Aucune des études sur la qualité du travail n'a abordé cette question jusqu'à présent.
9. L'explication ou la paraphrase Face à la difficulté de restituer un terme technique ou un
concept par un terme précis ou une expression consacrée en langue d'arrivée, l'interprète peut choisir d'expliquer ou de paraphraser l'expression. Par' exemple, en électronique, ne connaissant pas le terme français consacré pour le terme anglais 'action impulse', i l peut parler de «la recherche d'une ligne par sélecteur actionné par impulsions » ; 5 en médecine
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 133
dentaire, ne retrouvant pas le terme français 'tronculaire' pour 'mandibular block', i l peut parler d'« anesthésie régionale ».
10. La simplification Face à un segment de discours que l'interprète a du mal à
comprendre ou à restituer, i l choisit parfois de le restituer sous une forme simplifiée, en n'en rendant pas tous les éléments. La simplification implique donc des omissions, mais à un niveau plus 'régional' que ponctuel. La restitution de l'information à un niveau d'abstraction plus élevé (tactique 5) est un cas particulier de la tactique de simplification.
11. Le discours parallèle Dans des cas extrêmes où les conditions de travail sont parti
culièrement mauvaises et où l'interprète pense qu'il est impératif de parler, par exemple dans une situation où les composantes diplomatiques sont essentielles et le côté inforpiatif du discours est négligeable, i l peut être amené à formuler un discours parallèle sur un segment donné, en s'efforçant de le rendre compatible avec l'identité et la position de l'orateur et avec la situation.
Cette tactique pose évidemment des problèmes déontologiques, dans lesquels nous n'entrerons pas ici.
12. La 'naturalisation sauvage' Il s'agit de l'adaptation phonétique ou morphologique d'un
terme dont l'équivalent en langue d'arrivée est inconnu de l'interprète.
Par exemple, le terme anglais 'transputer' a été rendu en français par 'transputer' prononcé « transput ère », le verbe anglais 'to drive' par la création spontanée 'driver' (dans ce deuxième cas, i l s'est avéré par la suite que certains Français utilisaient spontanément ce verbe « français » qu'ils avaient peut-être créé eux-mêmes). -
13. Le 'transcodage' Il s'agit de traduire littéralement l'expression ou le terme
dont l'équivalent consacré en langue d'arrivée est inconnu de l'interprète. Ainsi, dans une conférence, le terme français 'télédétection' a été rendu en anglais par « télédétection » (le terme idoine dans le contexte eut été 'remote sensing').
14. Le repvoi des auditeurs à une autre source d'information
134 DANIEL GILE
Dans les conférences spécialisées, les interventions sont souvent accompagnées de diapositives ou transparents montrant des chiffres et noms de personnes, de lieux, de produits, de procédés. L'interprète qui n'a pas bien saisi un nom ou un chiffre à l'écoute peut renvoyer les auditeurs à l'écran, par exemple en parlant des « produits que vous voyez énumérés à l'écran » ou des « chiffres que montre le transparent ». Il peut aussi renvoyer les auditeurs à des informations figurant au programme de la conférence ou dans un autre document dont ils disposent (textes d'interventions, résumés, textes publicitaires, etc.).
15. La permutation des informations dans la restitution Cette tactique, signalée par M . Lederer (1978), répond à un
besoin de sécurité face à un risque de saturation de la mémoire à court terme. Lors d'une enumeration de noms, on constate souvent que l'interprète restitue les derniers noms d'abord. Dans la mesure où i l le fait très rapidement, sur la base de la trace phonique, i l fait peut-être l'économie de la capacité de traitement nécessaire à leur traitement sémantique et réduit ainsi la charge totale de l'Effort de mémoire à court terme. On sait que la trace phonique d'un message verbal disparaît rapidement, alors qu'il subsiste plus longtemps une trace sémantique, qui correspond à un niveau d'analyse plus profond (Sachs 1967). Si l'interprète devait restituer l'énumération dans l'ordre où elle est énoncée en langue de départ, le temps passé l'obligerait à un traitement sémantique sur l'ensemble de ses éléments.
16. La prise de notes S'agissant des chiffres et de certains noms, l'interprète pré
fère parfois les noter par écrit pour ne pas les oublier. La perte des chiffres, notamment, est un phénomène bien connu en interprétation, et c'est face aux chiffres que la tactique de la notation est le plus souvent utilisée. Cette tactique est toutefois coûteuse en temps et en capacité de traitement.
17. La modification du décalage chronologique orateur-interprète
En modifiant l'écart chronologique entre son discours et celui de l'orateur (EVS), l'interprète peut agir dans une certaine mesure sur les besoins en capacité de traitement pour chacun des Efforts. En. se rapprochant de l'orateur, i l réduit les besoins de l'Effort de mémoire. En revanche* il prend le risque
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 13 5
de se tromper dans la compréhension du discours et d'avoir à déployer un intense effort de production par la suite pour redresser une phrase partie dans la mauvaise direction' (voir Ch. 4). En s'éloignant de l'orateur, l'interprète réduit l'incertitude et donc les risques de surcharge dans l'Effort de production, mais augmente les besoins de l'Effort de mémoire.
L'un des principaux apprentissages de la simultanée lors de la formation initiale des interprètes est probablement celui de la gestion de cette tactique en fonction des difficultés. Nous pensons que cet apprentissage est essentiellement inconscient, bien que des conseils ponctuels puissent également être donnés par des enseignants.
18. La restitution anticipée des premiers segments de la phrase En cas de grosse différence syntaxique entre la langue de
départ et la langue d'arrivée et en cas de structure enchâssée en langue de départ, pour éviter de surcharger la mémoire, l'interprète peut faire de petites phrases ou des débuts de phrases neutres', c'est-à-dire ne l'engageant pas dans une voie précise (voir Ilg 1978). Cette tactique présente toutefois le risque d'obliger l'interprète à consacrer un important effort au rattrapage' si la phrase ou le début de phrase qu'il a énoncé s'avère incompatible avec l'expression du reste du message.
19. La 'fermeture' du microphone Citons enfin cette autre mesure extrême, prise parfois quand
les conditions de travail sont si mauvaises que l'interprète s'estime incapable de faire un discours cohérent, et préfère, par « dignité » (Seleskovitch 1968 :221) ou par « probité professionnelle » (Constantin Andronikoff, dans sa préface à Seleskovitch 1968), mettre son microphone hors tension.
Cette tactique était encore préconisée dans certaines écoles à la fin des années 70. Il semble toutefois qu'elle soit en voie de disparition. Si dans les années 50, période où les interprètes jouissaient d'un grand prestige, cette protestation pouvait avoir pour effet un ralentissement de l'orateur ou une autre amélioration sensible des conditions de travail, avec la banalisation progressive intervenue dans la profession, elle ne paraît plus acceptable pour le client et les délégués. L'interprète préfère actuellement interpeller les auditeurs pour leur faire observer le problème, puis faire de son mieux en usant des autres tactiques énumérées plus haut.
136 D A N I E L G I L E
3.2 Critères de choix des tactiques
Chacune de ces tactiques est adaptée aux circonstances en fonction dun petit nombre de lois générales, expliquées ci-dessous. Notons aussi que pour un même segment de discours posant problème, l'interprète peut avoir recours à plusieurs tactiques successivement. Par exemple, face à une phrase mal comprise, i l peut tergiverser, puis simplifier, puis, le contexte lui ayant donné des indications, reconstituer la phrase.
Les tactiques peuvent être appréciées en fonction de leur coût, qui peut se mesurer selon trois variables principales :
— Le coût en temps et en capacité de traitement La corrélation entre les deux peut être directe ou indirecte.
Ainsi, l'explication peut demander du temps et une capacité de traitement liée à un effort d'analyse et d'expression. En revanche, la mobilisation du collègue passif et l'interpellation des auditeurs sont coûteuses en temps, mais leur coût en capacité de traitement provient essentiellement du retard qu'elles engendrent et qui appelle un effort accru pour le rattrapage.
— La perte d'information Chaque tactique a un coût potentiel en information perdue'
dans le discours en langue d'arrivée. Notons qu'une perte dans le discours n'implique pas nécessairement une perte d'information pour les auditeurs. En effet, une information précisée dans un segment de discours peut être répétée ailleurs, ou être déjà connue des auditeurs. C'est pourquoi même des tactiques impliquant un véritable abandon d'information dans le discours (omission, passage à un plus grand niveau d'abstraction, etc.) peuvent n'affecter en rien la transmission du Message aux auditeurs. Par ailleurs, même une information non restituée qui est inconnue des auditeurs peut avoir pour ceux-ci une valeur négligeable, voire négative (informations superflues, parfois agaçantes pour les délégués). Sur le plan déontologique, l'omission d'une telle information s'oppose à l'obligation de fidélité. Sur le plan tactique, elle permet parfois de sauvegarder une information plus importante. Aucune recherche n'a tenté d'étudier les déterminantes de l'importance des informations primaires' (faisant partie du Message) pour les délégués, ni la capacité des interprètes d'évaluer cette importance.
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 137
— Les effets psychologiques ' de la tactique Outre l'aspect purement informationnel de chaque tactique,
les interprètes tiennent compte de ses incidences psychologiques' éventuelles. Ainsi, l'omission, si elle n'est pas détectée par les délégués, peut donner une (fausse) impression d'aisance chez l'interprète. En revanche, l'interpellation des auditeurs met en relief les difficultés qu'il éprouve et peut le discréditer.
On semble donc fondé à considérer que le choix des tactiques par l'interprète obéit à cinq lois générales :
1. La loi de maximisation du rendement informationnel Déontologiquement parlant, la loi prioritaire que suit l'inter
prète dans le choix de ses tactiques est celle de la maximisation du rendement informationnel de son discours. Notons que dans la sélection de la tactique à suivre, l'interprète tient probablement compte non seulement du segment problématique pour lequel la tactique est nécessaire, mais également des segments voisins, qui risquent d'être affectés par la tactique. Ainsi, il ne choisira pas la consultation de documents pour restituer un segment difficile si celle-ci, en prenant un temps et une capacité de traitement considérables, est susceptible de l'empêcher de restituer un segment voisin important.
Signalons un cas spécial, où l'importance relative du coût en temps est très grande par rapport au coût en capacité de traitement. Il s'agit de la simultanée pour la radio et la télévision, où il est particulièrement important de ne pas faire attendre l'auditeur/le téléspectateur. Dans ce cas particulier, où les échanges sont en outre plus interactifs que dans la réunion multilingue courante et où l'aspect informationnel a souvent moins d'importance, la restitution de l'information dans sa totalité a une importance moindre dans la qualité du travail.
2. La loi de l'impact maximum Compte tenu de la philosophie de loyauté professionnelle de
l'interprète vis-à-vis de l'orateur et des ses intérêts, les tactiques choisies visent, indépendamment de la loi de maximisation du rendement informationnel et parfois à son encontre, l'impact maximum du discours sur les auditeurs. Cette loi prend notamment sa signification dans le traitement des erreurs de l'orateur (voir Section 3.5 plus loin), mais elle permet aussi d'établir des priorités entre les informations à transmettre et oriente la manière dont elles sont restituées.
138 D A N I E L G I L E
Dans la plupart des situations d'interprétation, la loi de l'impact maximum ne pose pas de problèmes particuliers, en ce sens que les intérêts communicationnels de l'orateur convergent avec ceux des auditeurs ou sont au moins acceptables pour eux. Il existe toutefois des situations particulières où cela n'est pas le cas, notamment lors des interrogatoires de témoins par les avocats au cours de procédures judiciaires (voir Morris 1989).
3. La loi du moindre effort Cette loi est étrangère à toute considération technique, mais
sa présence est postulée dans une grande partie des activités humaines (Zipf 1949), et notamment dans le langage (Miller 1962). I. Pinchuk l'érigé en principe fondamental de la traduction technique (1977: 206) :
«In any event an adequate translation will always be one that has been produced with just enough expenditure of time and energy to meet the needs of the consumer. It should not be of a higher quality than he requires if this will introduce a higher cost... »
Nous n'avons entendu aucun professionnel ou enseignant prendre une telle position économique' sur l'interprétation. Le discours dans les écoles vise le meilleur résultat, et non pas un équilibre entre la dépense et le résultat. Néanmoins, l'observation sur le terrain du choix des tactiques par des interprètes en cabine s'explique souvent mieux par la loi du moindre effort que par d'autres raisonnements.
4. La loi d'auto-protection Parfois, les interprètes perdent un élément important dans le
discours et choisissent de ne pas en informer les auditeurs, les privant ainsi de la possibilité de demander à l'orateur de répéter ou de préciser. Un tel choix s'oppose à la loi du rendement maximum et ne peut pas toujours s'expliquer par la loi du moindre effort. Il s'agit plutôt pour l'interprète de se protéger en ne laissant pas apparaître ses difficultés et faiblesses.
Il convient toutefois de souligner que de telles tactiques ne relèvent pas toujours de la loi d'auto-protection. En effet, des interpellations répétées sont susceptibles de nuire non seulement à l'interprète, mais aussi à l'orateur, en ce sens qu'elles interrompent le fil du discours pour l'auditeur et abaissent le taux de réception. Notons aussi que parfois le discours est si visiblement ininterprétable, y compris aux yeux de l'auditeur,
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 139
que l'interprète ne perdrait rien en crédibilité à interpeller les auditeurs en leur précisant qu'il n'est pas en mesure de leur transmettre la totalité de l'information. C'est notamment le cas quand des orateurs s'expriment dans une langue qu'ils maîtrisent manifestement très mal et qu'ils parlent avec un accent très fort, et quand ils sont particulièrement rapides ou confus. Dans de telles circonstances, l'interprète peut expliquer une fois ces difficultés, puis interpréter de son mieux. En interpellant les auditeurs de manière répétée, i l ne se protège pas davantage, mais réduit sensiblement l'impact de la partie du discours qu'il est en mesure de restituer, et risque d'irriter les délégués.
5. La loi de recherche de la sécurité Face à des problèmes prévisibles (enumeration, discours
denses, etc.), les interprètes peuvent chercher à assurer une certaine sécurité dans la transmission informationnelle. C'est le principe même de la prise de notes en consécutive, mais il semble que cette loi agisse aussi dans la prise de notes en simultanée et dans le raccourcissement du décalage entre orateur et interprète.
La première, la seconde et la cinquième de ces lois répondent à des principes déontologiques ; la troisième et la quatrième relèvent plutôt de la faiblesse humaine. L'équilibre entre elles dépend essentiellement de l'équilibre entre l'honnêteté ou la conscience professionnelle de l'interprète, qui privilégient la loi du rendement maximum, et différents facteurs qui agissent pour la plupart dans le sens contraire, à savoir :
— L'état de santé et la fatigue de l'interprète. — Les mauvaises conditions de travail, qui d'ailleurs engen
drent une plus grande fatigue, et qui peuvent démotiver l'interprète.
— L'attitude des participants à l'égard des interprètes. Celle-ci peut agir dans les deux sens et a peut-être une inci
dence bien plus grande qu'il n'est généralement admis. En effet, de nombreux interprètes comparent leur travail à une activité sportive dans laquelle un minimum est dû et où il est possible de faire mieux au prix d'un gros effort supplémentaire. Selon que les délégués et orateurs semblent intéressés par ce que fait l'interprète et s'efforcent éventuellement de lui faciliter la tâche, ou au contraire sont indifférents à ses efforts et ont une attitude désagréable, l'interprète est plus ou moins motivé pour faire l'effort supplémentaire.
— L'importance que l'interprète attribue à son image
140 DANIEL GILE
La motivation de l'interprète dépend aussi de l'importance qu'il attribue à la qualité de son travail telle qu'il la perçoit ou telle qu'elle est perçue sur le terrain. Ainsi, quand i l est écouté en ligne' par un autre interprète ou par un client dont la réaction à son travail lui importe, i l peut avoir tendance à suivre davantage la loi de l'auto-protection. Quand i l sait que son travail va être écouté attentivement avec possibilité de détecter toutes ses erreurs, par exemple quand son discours est enregistré et doit être étudié de près et éventuellement comparé avec celui de l'orateur, les tactiques choisies sont susceptibles de correspondre davantage aux exigences de la loi du rendement maximum. Quand i l sait que personne ne l'écoute vraiment, il peut avoir davantage tendance à se laisser porter par la loi du moindre effort.
— La tension nerveuse dans laquelle se trouve l'interprète Un interprète très tendu et angoissé est susceptible de suivre
davantage la loi de la recherche de la sécurité qu'un interprète plus décontracté.
3.3 Les stratégies et tactiques en consécutive
Les stratégies et tactiques énumérées ci-dessus à propos de la simultanée s'appliquent également pour la plupart à la consécutive. Soulignons cependant que sur le plan tactique, en consécutive, les interprètes travaillent souvent seuls et ne peuvent donc mobiliser leur collègue passif. En outre, étant donné leur présence à côté de l'orateur et le fait que celui-ci ne parle pas pendant qu'ils interprètent, ils peuvent également lui demander des précisions sur un segment qu'ils n'ont pas compris ou pas retenu, ce qu'ils ne peuvent pas faire en simultanée. Cette vingtième tactique n'a aucun coût en capacité de traitement, car elle intervient entre la phase d'écoute et. la phase de reformulation (voir Ch. 4) et ne compromet pas la suite du traitement de l'information. En revanche, elle est susceptible de porter atteinte à la crédibilité de l'interprète, au même titre que la tactique d'interpellation des auditeurs.
Cependant, la plus grande différence entre simultanée et consécutive en cours d'interprétation est liée à la prise de notes. Sur le plan stratégique, certains enseignants de l'interprétation, notamment les Allemands de l'école de Heidelberg (Matyssek 1989), proposent l'apprentissage d'un système de symboles relativement complet. De même, S. Allioni de Trieste (1989) propose un système grammatical' particulier, où la
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 141
structure des notes reflète différentes caractéristiques grammaticales' du discours. La maîtrise d'un système complet de symboles présente l'avantage d'une économie de temps considérable. Or, le temps d'écriture est un facteur déclencheur de problèmes très important (voir Ch. 4). Cependant, tant que les symboles ne sont pas parfaitement maîtrisés, leur recherche en mémoire est susceptible de demander beaucoup de temps et de capacité de traitement, et l'apprentissage est long. C'est pourquoi la plupart des enseignants pensent qu'il est préférable que les étudiants n'apprennent pas séparément un système de symboles, mais qu'ils créent ceux dont ils ont besoin au fil de leur expérience. Aucune étude empirique n'a apporté jusqu'à présent des indications sur l'efficacité relative de chacune de ces options.
Sur le plan tactique, le moyen le plus efficace de faire face à une difficulté due à un déficit en capacité de traitement durant la phase d'écoute consiste à interrompre la prise de notes pour consacrer la totalité de l'attention disponible à l'écoute. Cette tactique n'a aucun coût en capacité de traitement ou en temps, mais elle implique un risque d'oubli lors de la reformulation. Elle va donc à l'encontre de la recherche de la sécurité.
3.4 Les stratégies et tactiques en traduction à vue et simultanée avec texte
Tant dans la traduction à vue que dans la simultanée avec texte, une stratégie universellement utilisée est la préparation du texte. Il s'agit essentiellement du marquage des éléments difficiles à la compréhension ou à la restitution et de l'éventuelle indication manuscrite d'équivalents contextuels.
Parmi les techniques de marquage, rappelons la segmentation du texte par des traits obliques, qui permet à l'interprète de délimiter visuellement des unités de traitement, ainsi que la numérotation des éléments d'une structure linguistique devant être restituée dans un ordre différent.
Sur le plan tactique, le résumé, c'est-à-dire la simplification par omission sélective, est une méthode à laquelle les interprètes ont souvent recours quand ils prennent du retard par rapport à l'orateur.
142 DANIEL GILE
3.5 Tactiques face aux erreurs de l'orateur
Face à une erreur manifeste de l'orateur, l'interprète peut user de trois tactiques :
— La restituer telle quelle en langue d'arrivée. Cette tactique obéit à la recherche de la sécurité, mais va à l'encontre des lois du rendement informationnel et de l'effet maximum.
— La corriger en suivant les lois du rendement et de l'effet maximum, et en prenant le risque de se tromper.
— S'en référer aux auditeurs, en leur signalant ce que l'orateur a dit et en exprimant ses doutes. Cette tactique donne elle aussi une certaine sécurité à l'interprète, mais va à l'encontre de la recherche de l'impact maximum, puisqu'elle dessert l'orateur.
4. Commentaires méthodologiques
Comme i l est précisé dans la Section 1, le présent chapitre décrit des faits dégagés au cours d'une observation personnelle sur le terrain ; i l les explique à travers les modèles d'Efforts et une réflexion personnelle, plutôt que sur la base de l'expérimentation ou d'une autre démarche scientifique systématique. On peut donc légitimement s'interroger sur le bien-fondé des indications présentées dans les pages qui précèdent.
En tant qu'interprète de conférence et enseignant de l'interprétation, nous considérons que les faits mêmes sont généralisés et très clairs dans l'esprit des interprètes. La question qui se pose est de savoir comment en démontrer l'existence sur une base scientifiquement verifiable. La chose serait probablement possible à travers des questionnaires et interviews, ainsi qu'une expérimentation finement réglée pour provoquer des tactiques particulières chez les sujets. Trois séries de problèmes se posent à propos d'une telle démarche :
— Les efforts à déployer pour mettre en évidence l'existence de ces tactiques et stratégies paraissent disproportionnés si l'on ne cherche que la confirmation explicite d'une réalité qui, au sein de la profession, ne semble pas vraiment contestable. Ces efforts prendront en revanche tout leur sens si l'on vise une quantification des tactiques et de leurs effets.
— Compte tenu des 'bruits' et incertitudes inhérents aux procédures observationnelles et expérimentales (biais dans l'échantillonnage, erreurs d'observation, erreurs dans l'enregistrement des données, erreurs et incertitudes cjans les montages
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 143
expérimentaux, interférences induites par les questions dans les questionnaires et interviews, variabilité statistique), l'expérimentation risque d'aboutir à des incertitudes égales ou supérieures à celles que comporte la simple observation.
— Enfin, les obstacles psychologiques qui se dressent dans l'étude des tactiques auprès des praticiens sont redoutables, puisque certaines sont contraires à la déontologie de l'interprétation, et toutes mettent en évidence les faiblesses de l'interprète.
Comme i l est indiqué aux chapitres 2 et 3, la recherche sur l'interprétation n'en est qu'à ses débuts. Si les textes spéculatifs abondent, les études descriptives manquent (Stenzl 1983). La présente enumeration fait partie d'un effort descriptif et pourrait servir de base à une réflexion sur les phénomènes qualitatifs intervenant dans la communication à travers l'interprétation, ainsi qu'à à des recherches futures plus précises. Mais compte tenu des difficultés énumérées plus haut et du prix à payer pour les surmonter, à ce stade descriptif de l'étude des stratégies et tactiques des interprètes, une démarche scientifique rigoureuse et précise ne semble pas idoine. Si dans quelques uns de ses aspects, l'interprétation se prête à des méthodes expérimentales et quantitatives, dans d'autres, elle rejoint d'autres disciplines des sciences humaines avec une forte composante spéculative. Il ne nous semble pas acceptable de s'en tenir à des spéculations là où une vérification empirique semble réalisable, mais i l faudra probablement accepter, pendant longtemps encore, des méthodes plus subjectives et moins rigoureuses dans l'étude de certains aspects de l'interprétation touchant à des facteurs psycho-sociologiques et déontologiques.
Chapitre 6
La qualité en interprétation de conférence
1. introduction
Dans tous les écrits fondamentaux, dans toutes les écoles spécialisées, ainsi que dans les associations professionnelles telles que l'AIIC, on souligne que l'interprétation de conférence est non pas une opération linguistique, mais un service de communication ayant pour finalité de faire passer des « messages ». Une telle prise de position devrait conduire naturellement à une interrogation sur les modalités et la qualité de cette transmission de messages en communication multilingue. Et pourtant, J. Carroll notait en 1978 que les travaux de recherche sur la qualité en interprétation étaient très rares. Non seulement i l y avait peu d'études empiriques cherchant à cerner des réalités sur le terrain, mais même sur le plan théorique, l'attitude assez consensuelle des chercheurs était interpréto-centrique : la qualité était définie par eux, selon leur vue du service en question, et non pas par les commanditaires et les bénéficiaires, et jusqu'à une date fort récente, les chercheurs n'éprouvaient pas le besoin de préciser ses contours, ni de réexaminer leur point de vue de manière critique. Dans un article sur la qualité publié dans le Bulletin de l'AIIC (1979:113), ce point de vue apparait clairement :
« Senior members of AUG, with a sigh and a smile, refer to the subject of quality as « the monster of Loch Ness ». They don't mean to say that quality doesn't exist. They feel that it gets talked about a lot, but that nobody has ever managed to catch (define) it for all the world to see and believe and that nothing can be done about it.
D A N I E L G I L E
The quality of an interpreter's performance and the monster of Loch Ness have another feature in common : those who see; it recognize it immediately. And interpreters instinctively, without having an official A U G definition, agree on what is good quality and what isn't. »
Le présent chapitre présente quelques réflexions personnelles sur cette notion centrale de qualité, évoque les travaux réalisés sur ce thème, et analyse les questions méthodologiques qui se sont posées lors de ces travaux.
2. Le cadre de la communication en interprétation de conférence
La 'qualité de l'interprétation' mesure une prestation de service ; i l apparaît donc intéressant de l'analyser d'abord en tant que telle, dans son cadre naturel.
2.1 L'interprète est-il le « double« de l'orateur ?
Généralement, l'axe de communication central en interprétation est conçu (Fig. 1) comme reliant linéairement l'orateur, l'interprète et le délégué (ce singulier désigne ici collectivement les délégués qui écoutent l'interprète).
Orateur . >- Interprète • - — ^ Délégué
Figure 1 : L'axe de communication central en interprétation
Dans cet axe, l'interprète de conférence est un médiateur «transparent», qui se confond avec l'orateur en produisant à l'intention du délégué un discours en langue d'arrivée « équivalent » au discours en langue de départ. C'est ainsi que se définit la mission de l'interprète de conférence (par opposition notamment aux interprètes de liaison) de manière apparemment consensuelle dans l'ensemble des milieux professionnels.
Or, comme i l est expliqué au Ch. 4, pour des raisons techniques liées à la capacité cognitive de l'interprète, cet objectif n'est pas toujours réalisable. Concrètement, le contenu du discours d'arrivée s'écarte souvent du contenu de l'original en
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 147
dépit des efforts de l'interprète. Il y a donc un décalage entre la réalité et l'image projetée, dû entre autres au fait que le délégué reçoit l'interprétation à la place de l'original et non pas en tant que résumé ou commentaire.
Ce décalage pose un problème déontologique et moral : l'interprète a-t-il le droit de se présenter comme le « double » de l'orateur quand il ne peut l'être ? A-t-il le droit de parler « à la première personne du singulier » quand i l sait qu'il perd des informations ? Doit-il au contraire présenter son discours comme une reproduction plus ou moins bonne de l'original ? Quelles seraient les conséquences professionnelles et commerciales' de ce changement ? Cette question n'a pas été abordée jusqu'ici dans la recherche sur l'interprétation.
Sans entrer dans une analyse approfondie de ces choix professionnels, i l est également intéressant d'évoquer, au regard de la recherche, le problème psychologique qu'ils peuvent poser. En effet, l'interprète, qui se fixe pour objectif la production d'un discours « équivalent » à l'original et qui n'est pas en mesure de le faire, subit une frustration qu'il exprime régulièrement sur le terrain. Il serait intéressant d'étudier ces réactions à court et à long terme, leur influence sur l'image qu'a l'interprète de sa profession et de lui-même, et leurs éventuelles incidences comportementales : désintérêt à l'égard de l'interprétation, baisse du professionalisme, notamment en ce qui concerne la préparation des conférences, recherche d'activités plus satisfaisantes en dehors de l'interprétation, etc.
2.2 Les forces en présence
Le schéma de la Fig. 1 pose le principe de la loyauté de l'interprète à l'égard de l'orateur, mais ne tient pas compte de l'existence de différentes forces qui le poussent dans d'autres directions.
• On citera premièrement le problème des éventuelles contradictions entre les convictions personnelles de l'interprète et celles de l'orateur. Ces contradictions peuvent généralement être prévues au moment du recrutement, quand sont données des indications sur le thème de la réunion et sur l'identité des participants. L'interprète a alors la possibilité de refuser le contrat, ou de décider qu'il l'accepte en s'obîigeant en conséquence à servir loyalement les orateurs qu'il interprétera, même si leurs opinions sont contraires aux siennes. Il est rare • que ces contradictions posent un véritable problème moral aux
148 DANIEL GILE
interprètes. Reste à savoir si en interprétant un orateur dont ils n'acceptent pas les opinions, ils sont aussi efficaces en tant que communicateurs à son service que dans le cas contraire. La même question se pose quand ils interprètent des orateurs à l'égard desquels ils éprouvent des sentiments négatifs : désapprobation morale, préjugés ethniques ou sociaux. La question est méthodologiquement difficile à étudier étant donné l'absence de critères et d'instruments suffisamment fiables et précis pour mesurer la qualité du travail. Elle ne semble pas avoir été souvent abordée dans les textes sur l'interprétation, même les textes de réflexion, anecdotiques ou prescriptifs, et l'on peut penser qu'elle n'est pas ressentie comme un problème réel dans la profession. Elle doit se poser avec davantage d'acuité dans l'interprétation communautaire' (« community interpreting », destinée aux immigrés).
Il existe toutefois d'autres forces en présence, auxquelles on pense moins spontanément et qui sont peut-être plus importantes. En effet, la configuration des acteurs de la communication en interprétation ne se limite pas à l'orateur, à l'interprète et aux délégués qui l'écoutent. En deuxième et en troisième ligne, l'on trouve d'autres personnages dont l'influence à l'égard de l'interprétation varie selon la situation (Fig. 2) :
Figure 2 : Le cadre de communication en interprétation de conférence
a. Les délégués Les délégués qui écoutent l'orateur en langue de départ
n'ont pas besoin de l'interprétation et ont tendance à considérer l'interprète comme un élément étranger et souvent gênant dans la communication, car l'interprétation implique des contraintes : préparation de documents, nécessité de parler dans un microphone, débit limité dans les interventions, réu-
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 149
nions plus longues, notamment dans le cas de la consécutive. Il s'ensuit qu'une présence non minoritaire de délégués de cette catégorie peut engendrer une pression supplémentaire sur l'interprète :
Quand la plupart des participants n'écoutent pas l'interprétation, ils tendent à ne pas tenir compte dans leurs interventions de la participation des étrangers, d'où le non-respect des contraintes susmentionnées et une dérive vers des échanges ne concernant que les participants locaux, tant dans le fond que dans l'expression. Il en résulte des discours plus difficiles à interpréter pour les étrangers, à qui manquent des repères culturels pour comprendre les échanges. . En consécutive, notamment, quand seule une petite minorité de délégués passe par l'interprétation, l'interprète est soumis à une pression le poussant à abréger son discours en parlant plus vite, voire en résumant les interventions au lieu de les reproduire intégralement. Cette pression peut se traduire par des manifestations d'impatience de la part des délégués, voire par des instructions explicites du président de séance. Il arrive aussi qu'un délégué ayant compris la langue de départ intervienne sans attendre l'interprétation, obligeant ainsi l'interprète à insister pour interpréter, ou à traduire par la suite les deux interventions bout à bout, ce qui peut nuire à la qualité de la transmission des échanges aux délégués qui suivent à travers l'interprétation.
Il existe aussi des environnements particuliers où les exigences de certains délégués vont à l'encontre de l'aspiration de l'interprète à réaliser une restitution de qualité du discours de l'orateur telle que décrite plus haut. Le cas le plus frappant est celui des procès en justice, où un avocat peut chercher à déstabiliser un témoin, notamment en lui coupant la parole et en exploitant ses mots précis pour le piéger (voir à ce sujet Morris 1989).
b. Le client Le client, défini ici comme le donneur d'ouvrage qui paie
rinterprète, peut avoir des intérêts différents de ceux de l'orateur, et peut donc faire pression dans un sens qui ne favorise pas la fidélité de l'interprète à l'égard de l'orateur. S'il est lui-même organisateur de réunions avec interprétation ou chef-interprète, i l peut souhaiter éviter d'attirer l'attention des organisateurs de la réunion sur les problèmes liés à l'interprétation (voir Section 4.1). Dans un tel cas, i l est susceptible de ne pas
150 D A N I E L G I L E
insister sur la qualité des conditions de travail : préparation d une documentation, respect du programme, choix d'un emplacement adéquat pour la cabine, etc. Par ailleurs, i l considère parfois que l'interprète a une obligation de loyauté professionnelle à son égard en tant que donneur d'ouvrage, plutôt qu'à l'égard de l'orateur, ce qui va à l'encontre de la neutralité' ou loyauté tournante' (loyauté à chaque orateur tour à tour) qui est à la base de la déontologie de la profession.
c. Le recruteur
Le recruteur est parfois le client (qui paie), et souvent un autre interprète. Même si la rémunération vient d'ailleurs, pour s'assurer une quantité suffisante de travail, l'interprète dépend davantage du recruteur que des délégués, qui en général réagissent peu à la bonne ou mauvaise qualité de la prestation (voir à ce sujet le livre satirique, mais souvent fort juste, de J. Coleman-Holmes 1971). La présence du recruteur sur le terrain peut donc avoir des incidences importantes sur le comportement des interprètes. Quand i l s'agit d'un collègue, sa présence en cabine peut avoir un effet très stimulant sur la qualité du travail de l'interprète 'actif, car i l peut mieux évaluer la qualité du travail que les délégués en salle (voir plus loin).
d. Les autres interprètes Leur influence est comparable à celle du collègue recruteur,
et peut aider l'interprète actif à maintenir son effort.
e. Le président de séance En tant que gestionnaire du déroulement de la réunion, qui
a autorité pour donner et reprendre la parole aux intervenants et pour intervenir lui-même à tout moment, le président de séance a un rôle important, notamment au regard du maintien de conditions de travail acceptables : horaires, débit de l'orateur, documents, discipline de microphone, etc.
f. Les techniciens Responsables du matériel électronique dans la salle d'inter
prétation, ils ont à ce titre un rôle essentiel, tant pour le son que pour l'aménagement de l'espace dans la salle, notamment en ce qui concerne le positionnement de la cabine jl 'interpréta-tion et de l'écran sur lequel seront projetés transparents et diapositives. Parfois, ils aident aussi à faire respecter la discipline
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 151
du microphone. Dans certaines réunions, notamment avec équipement mobile et dans des environnements bruyants ou présentant des problèmes techniques, la compétence et la vigilance des techniciens sont indispensables à un déroulement correct de la réunion.
Les conflits d'intérêt ayant une incidence sur la loyauté professionnelle n'interviennent en général qu'entre orateurs, destinataires, clients et présidents de séance. On ne dispose pas d'études sur les éventuels effets de ces conflits sur la prestation des interprètes.
2.3 La fidélité
La loyauté' de l'interprète à l'égard de l'orateur s'articule principalement à travers sa fidélité au discours original. Les écrits sur la fidélité abondent dans les revues sur la traduction. Ils sont essentiellement réflexifs et normatifs (voir notamment Donovan 1990 pour une étude reflexive sérieuse du sujet), mais nous n'avons connaissance d'aucune tentative de justifier les positions de principe par des éléments empiriques.
Les stratégies de fidélité des interprètes (voir Ch. 5) ont des conséquences importantes sur l'évaluation de leurs performances dans des études empiriques. En effet, une restitution complète des informations de l'original reflète peut-être une perte de contrôle de la part de l'interprète face à un discours trop rapide, trop dense ou trop difficile à comprendre pour d'autres raisons, alors que l'ajout ou l'omission de certaines informations reflète peut-être non pas une baisse des performances, mais plutôt l'aboutissement d'un processus de prise de décisions visant à optimiser l'impact du discours. Les chercheurs non familiarisés avec les stratégies et tactiques des interprètes risquent de tirer de l'observation d'un corpus des conclusions erronées. C'est notamment ce que l'on reproche à Henri Barik (voir Bros-Brann 1976 et Stenzl 1983).
3. La perception de la qualité
La qualité du travail en interprétation est donc fonction non seulement de contraintes affectant sa faisabilité, mais aussi des normes de l'observateur. Au regard de la recherche empirique se posent aussi des problèmes méthodologiques liés à la capa-
152 D A N I E L G I L E
cité de chacun des acteurs concernés (Fig. 2) d'évaluer ladite qualité. Face à la certitude de l'AIIC citée plus haut, face aux affirmations de D. Seleskovitch, pour qui les interprètes, « Witnessing the results of their own performance they are always able to see whether their listeners have clearly understood their translation » (1977:84), affirmations reprises par C. Donovan (1990:19), on trouve des opinions discordantes. Ainsi, C. Cartellieri (1983) considère qu'il n'existe pas de paramètres de qualité fiables, et d'autres collègues évoquent différents problèmes d'évaluation. Pour G. Ilg (1988), un interprète n'évalue pas un collègue comme le ferait un délégué. C. Stenzl (1983 :30) ajoute qu'il est difficile d'évaluer une prestation sans tenir compte de l'identité des délégués qui l'écoutent. W.E. Lambert (1978) et C. Namy (1978) soulignent la difficulté d'écouter l'original et l'interprétation en même temps, difficulté expliquée ci-dessous. A l'Ecole de Genève, explique Namy, il faut souvent recourir aux enregistrements pour parvenir à un accord entre les membres d'un jury d'interprétation. Si Carroll (1978) considère qu'il y a corrélation entre intelligibilité et fidélité d'une interprétation, Stenzl (1983) n'est pas d'accord, et fait observer que l'une n'implique pas l'autre. Dans le même esprit, selon K. Varantola (1980), on dit souvent qu'un interprète parlant d'un ton agréable et assuré peut tromper son monde. En revanche, W. Weber (1984:2) affirme qu'une interprétation défectueuse se repère immédiatement. Les pages suivantes analysent ces appréciations.
3.1 La fidélité informationnelle du discours de l'interprète
Le déterminant le plus évident de la qualité de l'interprétation est sa fidélité informationnelle. Il se trouve que cette fidélité est difficile à évaluer en situation de conférence pour l'ensemble des personnes qui y participent.
a. L'orateur : En simultanée, i l parle en même temps que l'interprète et ne
peut donc l'écouter et juger sa prestation. Il arrive que les orateurs portent un casque et contrôlent l'interprétation tout en parlant. Toutefois, écouter l'interprétation d'un segment de discours en le comparant à l'original, tout en prononçant un deuxième segment et en préparant mentalement le segment suivant, représente une charge cognitive probablement inabor-
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 153
dable pour la plupart des orateurs. Parfois les orateurs n'écoutent l'interprétation que pour s'assurer que les interprètes « suivent ». Dans ce cas, leur contrôle ne se fait que par rapport à quelques repères tels que les mots de la fin d'une phrase ou d'une proposition. En tout état de cause, i l n'y a pas de contrôle de l'intégralité du discours d'arrivée.
En consécutive, la situation est différente, dans la mesure où l'orateur a le loisir d'écouter la restitution de son discours par l'interprète. En principe, s'il comprend la langue d'arrivée, i l peut contrôler le discours cible. Sa capacité d'évaluer la qualité de celui-ci est toutefois limitée par le fait qu'en général, i l ne se rappelle pas avec précision l'ensemble de son propre discours. Il peut reconnaître une erreur ou un ajout dans le discours de l'interprète, mais est susceptible de ne pas y détecter une omission, surtout s'il s'agit d'un passage d'importance secondaire.
L'existence de ce phénomène se confirme quotidiennement dans les écoles d'interprétation, lors des exercices de consécutive en classe : lorsqu'il est demandé à un étudiant de relever les inexactitudes et omissions dans l'interprétation que fait un autre étudiant d'un exposé fait par lui-même auparavant, i l est le plus souvent incapable de pointer le doigt sur de telles défaillances informationnelles (voir Gile a.p. b).
b. Les délégués écoutant en langue de départ En simultanée, les délégués qui écoutent l'orateur en langue
de départ ne se préoccupent pas de l'interprétation, qu'ils n'entendent pas. En consécutive, i l entendent l'interprète, et ceux d'entre eux qui connaissent suffisamment bien la langue d'arrivée se retrouvent dans la même situation que l'orateur qui la comprend, dont le cas est évoqué ci-dessus.
c. Les délégués écoutant en langue d'arrivée Ces délégués, les véritables destinataires de l'interprétation,
n'ont pas en principe une compréhension suffisante de la langue de départ pour écouter le discours original. En principe, ils ne peuvent donc pas juger de l'intégrité informationnelle du discours de l'interprète. En revanche, ils peuvent y déceler certaines erreurs manifestes, quand le discours en langue d'arrivée leur semble incompatible avec ce qu'ils savent du sujet et de l'orateur.
d. Les interprètes passifs présents
154 D A N I E L G I L E
Les interprètes passifs' ont la compétence linguistique nécessaire, mais sont limités dans leur capacité d'évaluation par les mêmes difficultés que les délégués. En simultanée, s'ils sont assis dans la même cabine que l'interprète actif, ils ont la possibilité technique et la disponibilité pour l'écouter en même temps qu'ils écoutent l'original, ce qui n'est pas le cas du délégué, dont la principale préoccupation est en principe l'écoute du discours de l'orateur. Toutefois, pour l'interprète passif, le contrôle implique deux opérations simultanées : l'écoute d'un segment de discours original, et la comparaison de la restitution d'un segment précédent en langue d'arrivée avec un segment antérieur du discours original. Il charge donc son Effort de mémoire davantage que lors de la pratique de la simultanée. En consécutive, l'interprète passif lui aussi ne se rappelle la totalité du discours original que s'il prend des notes comme son collègue actif, auquel cas i l peut réaliser un contrôle intégral de la fidélité de l'interprétation.
e. Autres acteurs S'agissant du client éventuellement présent, d'un recruteur
non interprète, du président de séance ou animateur de table ronde et des techniciens, tous se retrouvent essentiellement dans la même situation que les délégués écoutant en langue de-départ ou en langue d'arrivée, avec les mêmes contraintes et limites.
Il apparaît donc clairement que si une évaluation grossière de la fidélité informationnelle de l'interprétation peut être faite par les participants sur la base d'erreurs captées au vol, en simultanée, personne n'est en mesure de l'évaluer de manière fine et fiable, et en consécutive, seul un interprète passif qui se donne la peine d'écouter le discours et de prendre des notes comme s'il allait l'interpréter lui-même est capable de le faire.
Ces considérations expliquent, partiellement au moins, pourquoi i l existe parfois une grande disparité entre les opinions qu'ont différents interprètes du travail d'un même collègue (Bertone 1989). C'est aussi la raison pour laquelle les affirmations de D. Seleskovitch et de W. Weber semblent peu fondées. En réalité, comme il est expliqué plus haut, non seulement les délégués ne peuvent évaluer correctement la fidélité d'une interprétation, mais même quand ils le peuvent, ils ne réagissent pas nécessairement. Le conseil de M . Lederer (1978), qui
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N I N T E R P R É T A T I O N D E C O N F É R E N C E 155
préconise l'écoute des sessions de questions et réponses, au cours desquelles l'interprétation est « vraiment » _ mise à l'épreuve pour en évaluer la qualité, n'est pas non plus suffisant, car des personnes interpellées peuvent répondre a côté' de la question sans que l'on sache si l'acte est volontaire, s'il est le résultat d'un manque de discipline dans l'expression, ou si elles n'ont simplement pas compris la question ; elles peuvent au contraire répondre de manière pertinente en ayant saisi une partie seulement de la question, ou répondre de manière non pertinente sans que la chose soit apparente. Il est d'ailleurs permis de penser que les participants à une conférence ne réagissent que sur certains points qui les intéressent particulièrement. Citons à titre anecdotique, mais révélateur, une expérience vécue lors d'une conférence où l'interprète recruteur était bien introduit auprès des délégués, ce qui lui permettait de leur poser des questions très directes. Au cours de cette conférence, l'un des orateurs a fait une intervention peu claire sur un appareil opto-électronique. Conscient de la difficulté d'interpréter un aussi mauvais exposé, l'interprète recruteur s'est renseigné auprès des délégués sur leur réaction à l'interprétation du discours. Il s'est avéré que tous étaient très satisfaits, à l'exception de deux personnes, les représentants d'une société concurrente de la première qui fabriquait un appareil similaire. Il semblerait que seuls ces deux délégués aient eu besoin de comprendre l'exposé de manière précise et qu'ils aient jugé l'interprétation en fonction de ces besoins. Ce sont aussi les seuls qui se soient rendus compte des faiblesses du discours en langue d'arrivée.
Techniquement, i l est possible de contourner la difficulté en enregistrant le discours original et le discours de l'interprète et en comparant les enregistrements. Toutefois, cette procédure, très consommatrice de temps, n'est envisageable que pour les chercheurs, par opposition aux délégués, qui sont sur les lieux de la réunion pour y participer et non pas pour évaluer les interprètes (sauf dans les cas où des enregistrements sont faits pour les besoins de la conférence). En outre, pour les chercheurs se pose un problème d'accès au corpus, qui est traité plus avant dans la Section 4.1.
3.2 Qualité de l'enveloppe' du discours de l'interprète
L"enveloppe' du discours de l'interprète peut se décrire en termes de langue, d'usage terminologique, de clarté, de proso-
156 DANIEL GILE
die, de qualité de la voix (voir à ce propos les propositions de F. Pôchhacker 1992 pour une analyse très fine de ces paramètres, ainsi que l'expérience de M. Shlesinger (1992) décrite dans la Section 4.2), et le cas échéant en termes d'expression faciale et gestuelle.
Contrairement à la fidélité informationnelle, la qualité de la voix, de la prosodie et de l'expression faciale et gestuelle de l'interprète se laissent généralement évaluer assez facilement par tous les acteurs qui ont la possibilité technique d'écouter et de voir l'interprète, qu'ils comprennent ou non les langues de départ et d'arrivée.
En revanche, la qualité de la langue et la clarté de l'expression ne peuvent être évaluées correctement que par les personnes qui ont une maîtrise suffisante du sujet et de la langue d'arrivée. Dans la pratique, si l'on exclut les contrôles occasionnels réalisés par le client, par le président de séance ou par des délégués écoutant normalement en langue de départ et curieux de savoir comment se déroule l'interprétation, cette évaluation est faite essentiellement par les interprètes passifs et par les délégués écoutant en langue d'arrivée. Quant à la précision de l'usage terminologique, elle ne peut être évaluée que par les spécialistes, donc par les délégués écoutant en langue d'arrivée ou par les interprètes passifs s'ils sont spécialisés.
Il apparaît dès ce stade de l'analyse que : — Le contrôle de la fidélité informationnelle ne peut être
réalisé que par un petit nombre d'acteurs; en tout état de cause, ce contrôle demande un effort considérable.
— L'évaluation de la présentation se fait beaucoup plus facilement, et souvent spontanément et inconsciemment. Il est donc fort possible que pour de nombreux délégués, l'impression d'une prestation plus ou moins bonne soit déterminée par la qualité de la présentation plutôt que par la fidélité réelle de l'interprète à l'orateur, surtout si les éventuelles erreurs et omissions n'affectent pas la cohérence et la plausibilité du discours par rapport aux attentes et connaissances de l'évalua-teur. C'est ce qui expliquerait l'évaluation parfois étonnamment généreuse des délégués pour une prestation que l'interprète estime lui-même médiocre ou mauvaise.
3.3 Autres aspects de la qualité du travail
Considérer que la qualité du travail de l'interprète est uniquement fonction de l'efficacité de la communication d'orateur
R E G A R D S SUR L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 157
à destinataire et que la fidélité et la qualité de l'enveloppe sont ses seuls déterminants, c'est ne pas tenir compte de l'univers social, psychologique et économique dans lequel s'inscrit l'interprétation, où d'autres critères de qualité ont un poids bien réel.
A titre d'exemple, si lors de réunions face à face, il apparaît peu important que les hommes soient interprétés par des hommes et les femmes par des femmes, dans les interprétations radio et télédiffusées, cet appariement compte pour les réalisateurs. Pour d'autres conférences, la tenue vestimentaire et la qualité du comportement des interprètes en cabine et hors cabine sont importantes. Ainsi, nous avons vu de nombreux cas où certains interprètes ont été préférés à d'autres en raison de leur capacité de «s'intégrer» aux délégués —pour reprendre l'expression du client. Inversement, des interprètes jugés «insuffisamment aimables» ont été exclus du recrutement, quelle que fût la qualité de leurs discours en langue d'arrivée. Par ailleurs, certaines composantes comportementales de la qualité de la prestation peuvent être qualifiées de «techniques». Ainsi, l'interprète travaillant lors de visites de chef d'Etat à chef d'Etat doit savoir comment se placer par rapport aux interlocuteurs à tout moment, quand passer de la chuchotée à la consécutive et inversement, quand traduire et quand se taire, quand se tenir à distance et quand se rapprocher des interlocuteurs à travers les différentes étapes du parcours officiel et officieux. Des erreurs à cet égard peuvent avoir un effet très préjudiciable à la qualité de sa prestation. La recherche sur ces composantes comportementales de la qualité pose de considérables problèmes d'accès aux informateurs potentiels.
Parmi les qualités comportementales, certaines appellent des réactions et évaluations contradictoires. Ainsi, chez un interprète, la rigueur peut être appréciée des collègues, notamment quand elle conduit à des exigences en matière d'information, car elle augmente les chances de l'équipe d'obtenir des documents en vue de la préparation de la conférence ; en revanche, elle peut être mal vue par le client, qui préfère souvent une plus grande souplesse, fût elle délétère au regard de la fidélité aux discours.
Autre qualité périphérique par rapport à la prestation de communication proprement dite, la capacité de l'interprète de s'intégrer dans l'équipe d'interprètes dans laquelle il travaille. Cet aspect de la qualité du travail est particulièrement important pour les missions en déplacement, où les interprètes, et
158 DANIEL GILE
parfois les délégués et interprètes, se retrouvent pendant une période de plusieurs jours en groupe feirmé et plus au moins isolé. A qualité de prestation communicationnelle plus ou moins égale, le choix du recruteur se porte souvent sur l'interprète dont le comportement hors-cabine lui convient mieux, plutôt que sur l'interprète dont la prestation est un peu meilleure. On observe également sur le marché des cas où cet aspect comportemental est un déterminant bien plus important que la performance de l'interprète en cabine.
Il est intéressant de noter que dans la plupart des écoles professionnelles, l'enseignement formel porte exclusivement sur la composante verbale de la qualité, et que les aspects comportementaux ne sont que rarement abordés, même quand ils touchent directement l'efficacité communicationnelle: comportement de l'interprète en cabine face au micro (maintien d'une distance toujours égale entre l'interprète et son micro, manipulation non bruyante des documents, emploi du bouton toussoir plutôt que du bouton de mise hors-tension du microphone, réactions face à un orateur qui parle sans un micro dans la salle, face à un orateur trop rapide, etc.), et de manière plus générale, comportement de l'interprète avec les orateurs, les délégués, les techniciens.
4. Aspects méthodologiques de la recherche sur la qualité
4.1 Problèmes d'accès
De l'analyse qui précède, il ressort que la qualité en interprétation est composée de plusieurs éléments de nature différente, que l'importance relative de ces composantes varie selon les types de conférence et les types de publics, et que la fidélité n'est évaluée que de manière approximative et peu fiable sur le terrain. Il s'ensuit que pour cerner de plus près sa réalité, il serait nécessaire de procéder à des recherches empiriques sur des échantillons nombreux, englobant des types de conférences, de délégués, de situations linguistiques et d'interprètes suffisamment variés pour pouvoir donner un tableau représentatif de la réalité sur le terrain.
Or, c'est précisément dans ces recherches empiriques que se pose de manière aiguë l'un des problèmes les plus difficiles dans la recherche sur l'interprétation, à savoir le problème d'accès au corpus.
R E G A R D S SUR L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 159
L'accès à des conférences pour des études empiriques est rendu difficile par les facteurs suivants :
a. La variété des conférences physiquement accessibles aux chercheurs De pays en pays, voire de ville en ville, la situation est très
différente au regard des variables déterminant la qualité et sa perception: types de réunions, langues de travail, nombre et niveau de qualification des interprètes, conditions de travail. Les différences sont particulièrement importantes entre pays d'Europe occidentale et pays d'Asie et d'Afrique, mais elles prennent également de l'ampleur à mesure que l'on évolue de l'Europe occidentale vers l'Europe de l'Est, le Canada, les Etats-Unis, les pays d'Amérique latine, l'Océanie.
Un chercheur ou une équipe de chercheurs travaillant dans un pays donné auront du mal à couvrir' les conditions régnant dans d'autres parties du monde, ne serait-ce que pour des raisons financières, mais également pour des raisons linguistiques.
b. La confidentialité des réunions Certaines réunions, notamment les assemblées générales de
sociétés, les visites politiques, certaines réunions dans les organisations internationales, ont une participation très restreinte et ne sont donc pas accessibles aux chercheurs.
c. Les recruteurs Si les organisateurs des réunions et les délégués ont tout
intérêt à ce que la qualité du travail des interprètes soit évaluée de manière fiable et précise, le point de vue du recruteur est parfois différent. Dans l'ensemble, il fait partie de l'une des trois catégories suivantes :
— Il peut avoir une fonction adrninistrative chez le client (société, association, organisation internationale, organisme public) en tant que Directeur, responsable de la communication, assistant d'un responsable, etc.
— Il peut être chef-interprète (dans une organisation internationale) et donc avoir la responsabilité du recrutement des interprètes, voire de l'ensemble des questions touchant à l'interprétation.
— Il est souvent interprète-conseil, et agit comme consultant indépendant pour le compte du client.
160 DANIEL GILE
Dans les trois cas, le recruteur porte une partie de la responsabilité des résultats de l'interprétation, partie qui est très grande dans le deuxième et le troisième cas. Si, dans l'absolu, il est de son intérêt d'avoir une idée aussi précise que possible de la qualité du travail à attendre d'une situation d'interprétation donnée, i l peut redouter d'un autre côté de voir apparaître au grand jour des faiblesses dans le travail de l'équipe qu'il a constituée, que la faute lui en incombe ou non. Les responsables administratifs chez un client ont par ailleurs pour priorité le bon fonctionnement de la réunion à laquelle ils travaillent, et craignent la gêne qu'est susceptible d'occasionner une démarche de recherche sous forme de questionnaires ou d'interviews. Les chef-interprètes, qui doivent souvent lutter avec l'administration de leur organisation pour assurer de meilleures rémunérations, un meilleur statut et de meilleures conditions de travail pour les interprètes, peuvent craindre la mise en évidence de défaillances dans le travail de ces derniers, qui peut avoir des effets néfastes. Quant aux interprètes-conseils indépendants, ils sont en concurrence commerciale' avec d'autres collègues remplissant les mêmes fonctions, et craignent toute intervention qui risque de leur nuire sur ce plan. C'est pourquoi quand des chercheurs s'adressent à ces recruteurs pour leur demander la permission de réaliser une étude sur la qualité de l'interprétation, ils essuient souvent des refus.
d. Les interprètes Les interprètes de conférence sont peu accessibles pour
deux raisons. La première est leur petit nombre : quelques milliers en tout dans le monde, quelques centaines au maximum sur les plus gros marchés (Paris, Bruxelles, Genève, Tokyo). Selon les pays et les combinaisons linguistiques, leur formation, leur situation économique, leur statut professionnel et leur compétence sont très variables. Comme il a été indiqué plus haut, il n'est pas possible à une équipe de recherche localisée en un endroit du monde de couvrir toute cette variété d'environnements et de situations.
La deuxième raison de la difficulté d'accès du fait des interprètes est leur vulnérabilité. Vulnérabilité psychologique tout d'abord : les interprètes ont par formation et par idéal professionnel l'ambition de parvenir à une fidélité informationnelle complète', et ressentent douloureusement le fait que souvent,
ils n'arrivent pas à réaliser cet objectif (voir Ch. 4). La vulnéra-
R E G A R D S SUR L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 161
bilité des interprètes est également professionnelle : d'une part, la mise en évidence de défaillances dans leur prestation risque de leur nuire face au client, et d'autre part, elle les affaiblit face aux collègues recruteurs. Même si les chercheurs promettent la confidentialité des résultats de leur recherche, il persiste une certaine méfiance. En outre, du fait même de la recherche, une sensibilisation des délégués ou du client, nuisible au statu quo, peut se produire. Enfin, les chercheurs sont souvent interprètes eux-mêmes. Dans ce cas, les interprètes qu'ils observent s'exposent avec toutes leurs faiblesses aux yeux de collègues qui sont par ailleurs recruteurs potentiels, d'où une réticence compréhensible.
4.2 Recherches empiriques publiées et en cours
Face à ces problèmes, si de très nombreuses publications portent sur la qualité du travail en ce sens qu'elles analysent différents aspects des performances des interprètes, les études empiriques ciblées sur l'évaluation de la qualité du travail en interprétation restent pour l'instant très peu nombreuses.
Et pourtant, sur le plan méthodologique, la démarche qui s'impose en première intention' est assez simple, puisqu'il s'agit de l'interrogation par questionnaires et interviews (voir Gile 1983b). C'est d'ailleurs de cette manière qu'ont procédé les rares chercheurs qui ont réalisé des travaux empiriques sur le sujet. En 1986, Hildegund Bûhler a interrogé par questionnaire des interprètes membres de la commission des admissions et du classement linguistique de l'ALTC sur l'importance relative de 15 variables sémantiques et pragmatiques du discours de l'interprète au regard de la qualité du travail.
Pour vérifier le degré de convergence entre les critères de ces interprètes et. ceux des délégués, Ingrid Kurz (1989b) a construit son propre questionnaire, reprenant les huit premiers critères de Bùhler, et l'a distribué à des délégués participant à une conférence médicale. Des 47 questionnaires rendus se dégage le tableau suivant :
La concordance du sens du discours en langue d'arrivée avec celui de la langue de départ a été jugée comme le facteur le plus important, comme c'était d'ailleurs le cas dans le questionnaire de Bùhler.
De même, la cohérence logique du discours en langue d'arri-vçe a été jugée très importante dans les deux questionnaires.
162 DANIEL GILE
On notera toutefois que les interprètes ont accordé à ce critère un poids plus important que les délégués.
L'emploi des termes appropriés a lui aussi été jugé important par les deux groupes.
En ce qui concerne l'intégrité de l'information rendue en langue d'arrivée par rapport à l'information dans le discours original, les délégués ont accordé à ce critère un poids sensiblement inférieur à celui qui leur avait été attribué par les interprètes dans le questionnaire de Bùhler. Ingrid Kurz explique toutefois ce décalage par une interprétation différente de l'idée d'mtégrité', les interprètes considérant que celle-ci désigne le seul message, et les délégués englobant dans leur réponse toutes les redites et les redondances du discours.
Un important décalage apparaît en ce qui concerne la fluidité du discours («fluency of delivery»), que les interprètes considèrent comme plus importante que les délégués. De même, la correction grammaticale est considérée comme relativement peu importante par les délégués dans le questionnaire de Kurz, ce qui contraste avec le poids qui lui est accordé par les interprètes interrogés par Bûhler. Enfin, toujours dans le domaine linguistique, l'accent natif' et la qualité de la voix sont considérés comme importants par les interprètes et moins importants par les délégués.
En conclusion, Ingrid Kurz note qu'une forte corrélation entre les deux groupes n'a été trouvée qu'en ce qui concerne les critères « essentiellement nécessaires à la communication » ; en revanche, les critères linguistiques et phonétiques ont été jugés bien plus importants par les interprètes que par les délégués.
De son côté, Lydia Meak de Trieste (1990) a rédigé un questionnaire qu'elle a présenté à dix médecins italiens ayant chacun une spécialité différente. Les neuf questions, auxquelles les répondants devaient ajouter des observations et suggestions, portaient respectivement sur :
— l'efficacité générale de la simultanée pour la compréhension de discours dans une langue non connue
— les éléments les plus dérangeants de l'interprétation — l'importance de la connaissance par l'interprète des fonc
tions de l'orateur et d'autres renseignements sur sa personne — les éléments d'un tableau qu'il est indispensable de
restituer — les éléments à traduire lors du commentaire sur un film
ou sur des diapositives
R E G A R D S SUR LA R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 163
— les branches de la médecine qui nécessitent une précision particulière
— l'effet de la rapidité du discours de l'interprète — l'importance des conclusions — la nécessité de traduire les abréviations.
Des réponses, il apparaît entre autres que les médecins italiens font preuve d'une certaine indulgence à l'égard des interprètes en matière terminologique, mais qu'ils sont plus exigeants quant à la connaissance générale du sujet traité.
Dans une étude de cas publiée en 1990, Gile a interrogé par questionnaire des délégués médecins sur la qualité d'une prestation d'interprétation au cours d'une conférence médicale. Les questions portaient sur :
— La qualité générale de l'interprétation — La qualité linguistique de l'interprétation — La qualité de l'usage terminologique dans l'interprétation — La fidélité — La qualité de la voix et de la prosodie des interprètes — Les principales faiblesses de l'interprétation
Cette étude visait elle aussi non pas une évaluation «objective » de la qualité du travail, mais une exploration de l'importance relative qu'accordaient les délégués à chacun des critères. Malheureusement pour cette tentative (mais heureusement pour les délégués et interprètes concernés), les évaluations ont toutes été très positives, ce qui n'a pas permis de mesurer le poids relatif de chacun des éléments de qualité par rapport à l'évaluation globale. On notera toutefois que chez les deux répondants qui ont donné une évaluation négative de la qualité vocale et prosodique de l'interprétation, l'évaluation de la qualité globale n'a pas souffert.
Reprenant le travail par questionnaire pour constituer des échantillons plus grands et pour avancer vers une plus grande discrimination par groupes d'utilisateurs, Ingrid Kurz (1992) a élargi son étude de 1988 à deux groupes supplémentaires: les délégués à une conférence sur le contrôle de qualité, et à une conférence du Conseil de l'Europe sur les équivalences des « périodes d'études », toutes les deux tenues en 1989.
Des résultats, il apparaît une fois de plus que le critère de concordance du sens de l'original avec celui de la traduction est le plus important pour tous les groupes, à l'exception des délégués du Conseil de l'Europe, qui ont considéré le bon usage terminologique comme plus important. La cohérence
164 DANIEL GILE
logique du discours a été considérée comme le deuxième critère le plus important par l'ensemble des groupes à l'exception des médecins, qui lui ont attribué le même poids qu'à la concordance du sens, et des délégués du Conseil de l'Europe, qui lui ont attribué la quatrième place, après la terminologie, la concordance du sens et l'intégrité de l'information transmise.
Dans l'ensemble, la correction terminologique arrivait en troisième place, mais elle était première pour les délégués du Conseil de l'Europe et deuxième pour les ingénieurs. L'intégrité de l'information arrive en quatrième place, et la fluidité de la prestation en cinquième place.
La correction grammaticale de l'interprétation, considérée comme importante par les interprètes interrogés par Bùhler, a été créditée d'un poids très inférieur par les délégués, notamment les ingénieurs. La qualité de la voix et la qualité de l'accent des interprètes ont eux aussi été évalués comme peu importants.
En Pologne, A. Kopczynski (1992) a réalisé une étude pilote sur la qualité en interrogeant par questionnaire 20 spécialistes des «humanités» (philologues, historiens, juristes, économistes), 23 scientifiques, techniciens et médecins, et 14 diplomates, en faisant la distinction entre orateurs et délégués. Dans la première question, il était demandé aux répondants quelle était la plus importante fonction de l'interprétation. La seconde question reprenait la première, mais en proposant des réponses et en demandant leur classement. La troisième question demandait quels étaient les éléments « irritants » en interprétation, et la quatrième proposait différentes réponses et demandait leur classement. Suivaient cinq questions sur le degré de participation de l'interprète à la communication outre le rôle de traduction proprement dit : L'interprète doit-il s'identifier à l'orateur? Imiter la prosodie du discours de l'orateur? Etre visible ou rester dans l'ombre ? Corriger d'éventuelles erreurs de l'orateur ? Résumer le discours ? Ajouter ses propres explications ?
Les résultats sont assez uniformes. Il apparaît pour l'ensemble de ces groupes que le critère de qualité le plus important est la restitution détaillée du contenu du discours. En deuxième place arrive la précision terminologique. L'importance de celle-ci est confirmée par la convergence des orateurs et délégués sur le premier « irritant », à savoir un usage terminologique incorrect. Au deuxième rang des « irritants », les orateurs placent l'inexactitude dans la restitution du contenu de leur discours, et les délégués dans les phrases non terminées et
R E G A R D S SUR LA R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 165
rincorrection grammaticale de l'interprétation. Quant au «degré de participation» de l'interprète, tous considèrent que ce dernier doit s'identifier à l'orateur et qu'il doit rester invisible. Il est intéressant de noter que les orateurs tendent à accepter que les interprètes les corrigent, alors que les délégués présentent une tendance opposée.
Signalons enfin une intéressante étude expérimentale de M. Shlesinger (1992), dans laquelle elle a cherché à comparer l'effet de certaines variables de présentation sur la compréhension et le rappel de l'interprétation. A ces fins, elle s'est servie d'enregistrements de passages d'interprétation qu'elle a transcrits. Plus de trois ans après, elle a demandé aux interprètes auteurs des interprétations initiales de lire les transcriptions, et a enregistré la lecture. Le résultat était un jeu d'enregistrements d'interprétations spontanées d'une part, et d'interprétations lues d'autre part. Puis elle a fait écouter les enregistrements à des sujets, et a comparé la compréhension et le rappel du contenu des enregistrements dans les deux types d'enregistrements. Dans l'ensemble, les résultats étaient meilleurs dans le cas de l'interprétation lue, ce qui va à l'encontre des idées généralement admises dans la profession, qui favorisent les discours spontanés (voir notamment Déjean Le Féal 1978).
La Commission de la recherche de l'ALIC a lancé une importante étude par questionnaire sur la qualité. A titre de préparation, au cours de l'année 1992, plusieurs membres ont réalisé des interviews en demandant essentiellement aux délégués ce qu'ils attendaient de l'interprétation et ce qui les gênait dans l'interprétation. Dans la seule série relativement importante (22 personnes), réalisée par une étudiante lors d'une conférence sur la ville de Berlin dans un centre culturel à Paris, le principal « irritant » apparu portait sur la qualité prosodique de l'interprétation, alors que la correction terminologique et la correction linguistique du discours en langue d'arrivée n'ont pas été mentionnées.
L'opinion exprimée dans le Bulletin de l'AIIC sur la qualité en tant que «monstre du Loch Ness», impossible à cerner mais identifiable dès qu'elle est visible, semble sérieusement ébranlée au vu de ces résultats. Les grandes divergences observées dans les études citées plus haut peuvent être attribuées à différents facteurs, notamment aux différences entre les groupes d'utilisateurs, qui permettraient d'expliquer des résultats apparemment surprenants. C'est ce que fait Ingrid Kurz en se servant d'une typologie des conférences mise au point par Gile (1989b). La variabilité des situations, voire des pays et des
166 DANIEL GILE
comportements culturels y afférant, ainsi que la variabilité de l'expérience passée des délégués en matière d'interprétation, peut se refléter dans les attentes. De toute évidence, l'image est complexe, et justifie des études à grande échelle si l'on veut parvenir à des conclusions solides.
io8 DANIEL GILE
— Comme il est indiqué au Ch. 1, la grande majorité des auteurs de textes sur l'interprétation sont enseignants, et sont donc particulièrement intéressés par le sujet.
— La formation est un thème sur lequel il est possible d'écrire des textes substantiels sans introduire d'éléments de théorie ou de recherche, d'où une plus grande facilité de production. Par ailleurs, de tels textes sont acceptés même par des interprètes généralement hostiles à la théorie et à la recherche.
Le présent chapitre ne cherche pas à rendre compte de manière détaillée de l'ensemble des textes sur la formation à l'interprétation. La majorité d'entre eux sont réflexifs et normatifs et ne répondent pas aux critères de la recherche. Qui plus est, ils sont très répétitifs. Il existe par ailleurs de nombreux textes de recherche qui touchent la formation indirectement, notamment en ce qui concerne les langues, la gestion de la capacité de traitement, la compréhension. Ces textes et travaux sont évoqués dans les autres chapitres de ce livre (voir aussi un intéressant tour d'horizon dans Mackintosh 1989). Le présent chapitre est consacré à une synthèse de la situation sur le terrain en matière de formation, à une présentation des idées qui ont cours dans ce domaine, et à des observations et interrogations méthodologiques.
D'après Ch. Thiéry, qui a dirigé pendant de nombreuses années la section d'interprétation de l'ESIT à Paris, « beaucoup d'interprètes, et non des moindres, ont acquis une grande compétence professionnelle sans suivre un enseignement quelconque » ; il ajoute qu'en théorie, « il n'y a rien dans cet apprentissage qui ne puisse être fait sur le tas, en l'absence de tout enseignement» (Thiéry 1981:105-106). D'autres enseignants, tels que W. Weber, ancien directeur de l'école de traduction et d'interprétation du Monterey Institute of International Studies, considèrent qu'il est de la plus grande importance de passer par la filière de formation institutionnelle, car à quelques exceptions près, lors de leurs débuts, les autodidactes acquerraient tous de mauvaises habitudes et feraient des erreurs qui pèseraient sur le restant de leur carrière (Weber 1984:2).
Quoi qu'il en soit, sur tous les marchés d'interprétation un tant soit peu importants, européens, canadiens et japonais, la plupart des interprètes passent actuellement par la filière de la formation à l'école, qui remplit, outre l'enseignement des principes et techniques de la profession, deux fonctions :
— Une fonction de filtre : les écoles font un important travail de sélection en n'octroyant le diplôme qu'aux étudiants ayant atteint un niveau de compétence opérationnel' de l'avis des
R E G A R D S SUR L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 169
membres des jurys d'examen, qui sont en principe tous interprètes confirmés et reconnus. Notons que le taux de réussite est faible, de 30 à 50 96 des candidats à l'ESIT selon les années d'après D. Seleskovitch 1981:41, et souvent moins. A travers cette fonction de filtre, les écoles contribuent à préserver un niveau élevé de qualification dans une professipn qui n'est réglementée que dans un très petit nombre de pays.
— Une fonction de passerelle pour l'accès au marché du travail: les écoles étant en étroites relations avec la profession, elles facilitent grandement les débuts professionnels de leurs diplômés.
2. Idées consensuelles
Depuis l'institutionnalisation du métier d'interprète de conférence, après la deuxième guerre mondiale, la formation à l'interprétation s'est cristallisée dans des écoles universitaires prises en charge par des professionnels. Les premières se situaient à Genève, Heidelberg, Paris, Vienne. Par la suite, de nouvelles écoles ont été créées dans d'autres villes, en Europe, puis ailleurs dans le monde.
Or, pendant les années cinquante et soixante, les praticiens, qui étaient peu nombreux, voyageaient beaucoup et se voyaient souvent. Contrairement aux chercheurs, les praticiens enseignants ont toujours beaucoup communiqué entre eux. Leur désir commun de donner un fondement solide à la profession d'interprète de conférence s'est notamment concrétisé à travers la fondation de l'AHC, qui joue elle aussi un rôle important dans la détermination de la politique de la formation au sein de la profession. Rappelons que dans les grandes' écoles d'interprétation, la plupart des enseignants sont eux-mêmes membres de l'AIIC, qu'ils sont souvent connus et influents dans la profession, et que la Commission de la formation se compose en majorité de représentants des écoles. Cette situation explique que les principes fondamentaux de la formation se soient développés de manière remarquablement homogène, bien qu'il existe certaines divergences sur des questions techniques. Aujourd'hui encore, le consensus règne sur une partie importante du champ de la formation.
Ce consensus se voit dans la réitération, dans des textes de différents auteurs, des mêmes règles de base. Citons à titre d'exemple une récente brochure de l'AIIC intitulée Conseils
170 DANIEL GILE
aux étudiants souhaitant devenir interprètes de conférence (1991), qui précise entre autres les principes suivants :
— Les études d'interprétation de conférence sont réservées aux titulaires d'un diplôme universitaire ou d'une expérience ou qualification équivalente.
Plusieurs écoles ont d'ailleurs fait le choix d'un niveau d'entrée plus élevé encore, en exigeant la licence, voire la maîtrise, à l'admission (voir Keiser 1979:12 et Skuncke 1979:2 dans ALIC 1979). Cette exigence universitaire est expliquée officiellement par la nécessité d'une certaine maturité intellectuelle chez l'interprète. Peut-être relève-t-elle aussi d'un désir de poser d'emblée le statut social de l'interprétation de conférence à un niveau élevé.
— L'admission à la formation en interprétation de conférence est conditionnée par les résultats à un test d'admission au cours duquel sont contrôlées les connaissances linguistiques du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse et sa culture générale.
Le préalable sur lequel insistent le plus les enseignants est la compétence linguistique, qui doit en principe se situer dès l'admission au niveau requis pour le travail en cabine. Autrement dit, dans les écoles d'interprétation, on forme à une certaine discipline intellectuelle et à des techniques plutôt qu'aux langues. Cette distinction, elle aussi, nous semble motivée en réalité non seulement par des considérations techniques, mais aussi par une aspiration à un statut social plus élevé pour les écoles d'interprétation que pour les écoles de langues. Dans les faits, la condition de maîtrise opérationnelle des langues de travail à l'admission n'est pas toujours remplie, et des cours de perfectionnement linguistique s'avèrent souvent indispensables (voir Ch. 8).
— Le responsable du programme de formation doit lui-même être un interprète de conférence en exercice « ayant une réputation internationale ». Les autres enseignants doivent eux aussi être des praticiens en exercice.
Dans un compte rendu succinct d'une table ronde sur la formation d'interprètes de conférence dans les pays du Bénélux tenue ên 1969, le ton est encore plus ferme : « Si l'on veut avoir la certitude que l'enseignement répond à la réalité professionnelle, il est absolument indispensable que ce soient des interprètes professionnels qui assurent l'enseignement de l'interprétation» (AUC 1979). En effet, comme l'explique D. Seleskovitch (1981:25), les interprètes, «...connaissant les modalités d'exercice de la profession, sachant quel est le niveau requis,
R E G A R D S SUR LA R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 171
conscients des aptitudes nécessaires, [sont] les plus aptes à définir le contenu de l'enseignement ». Cette exigence très forte affirme et stabilise le statut professionnel, et non pas universitaire, des écoles d'interprétation. Sur le plan de la formation, elle pose des problèmes pratiques et méthodologiques : les bons praticiens ne sont pas nécessairement de bons enseignants, et leur disponibilité limitée ne leur permet pas toujours d'assurer leurs cours avec la régularité voulue (voir Hofer 1986). Sur le plan de la recherche, cette exigence est associée aux problèmes évoqués dès le Ch. 1.
— La formation doit porter tant sur la consécutive que sur la simultanée.
Cette règle peut sembler anachronique à une époque où sur de nombreux marchés, la consécutive a quasiment disparu (Seleskovitch 1981:38). Pourtant, sur le plan de la formation, la consécutive continue à être considérée comme très importante (voir Section 4.1.2).
— L'entraînement doit se dérouler dans des conditions aussi proches que possible de la réalité professionnelle.
— Il s'agit donc de simuler d'aussi près que possible la situation de l'interprète professionnel sur le terrain. A l'évidence,, dans les écoles d'interprétation (par opposition aux stages de formation dans les organisations internationales telles que les Nations Unies et la Commission des communautés européennes), cette simulation a des limites (durée des exercices, environnement physique, absence de Vrais' délégués, situation de communication où les seuls enjeux sont éducatifs, etc.). Il est intéressant de noter qu'au-delà des déclarations de principe, aucun projet de recherche n'a été réalisé pour vérifier l'effet de ces limites sur l'efficacité de l'apprentissage.
3. Aptitudes à l'interprétation et sélection
3.1 Les aptitudes fondamentales
Les aptitudes fondamentales nécessaires à l'interprétation font l'objet de nombreux textes de réflexion. A titre d'illustration, qui reprend les idées généralement admises, W. Keiser (1978) en énumère treize (la quatorzième dans la liste ci-dessous, qui est très fréquemment mentionnée par d'autres auteurs et enseignants, découle de la huitième, à savoir la curiosité intellectuelle) :
172 DANIEL GILE
1. Une bonne connaissance des langues de travail 2. Une bonne capacité d'analyse 3. Une bonne capacité de synthèse 4. Une capacité intuitive d'extraction du sens du discours 5. Une bonne capacité de concentration 6. Une bonne mémoire à court-terme et à long terme 7. Une voix et une présentation acceptables 8. La curiosité intellectuelle 9. L'honnêteté intellectuelle
10. Le tact et un certain sens diplomatique 1 i . Une bonne endurance physique 12. Une bonne endurance nerveuse 13. Une bonne santé 14. Une bonne culture générale
Certaines sont évidentes (la connaissance des langues, ainsi qu'une voix et une présentation acceptables). D'autres s'expliquent par des contraintes professionnelles (honnêteté, tact, curiosité intellectuelle). D'autres encore ne sont pas expliquées ou documentées. Ainsi, on peut se demander ce qu'est réellement la capacité intuitive d'extraction du sens du discours', et pourquoi l'endurance physique et la bonne santé sont nécessaires dans un métier qui ne nécessite aucun effort physique particulier et qui se déroule généralement dans des conditions de confort qui, tant sur le plan de l'environnement physique du travail que sur celui des horaires, ne semblent pas plus pénibles que dans de nombreuses autres professions où l'on ne souligne pas ces conditions de santé et d'endurance physique.
D. Gerver, psychologue qui enseigna à l'université de Stirling en Ecosse, a réalisé à l'école d'interprétation de la Polytechnic of Central London des tests de personnalité sur les étudiants de ladite école ainsi que sur des interprètes professionnels. Ces tests n'ont pas permis de dégager un profil psychologique caractéristique (Longley 1989). D'autres travaux sociologiques, réalisés à partir de questionnaires et consacrés aux différences entre les profils des interprètes et ceux des traducteurs (Hen-derson 1987, Suzuki 1988), n'apportent guère d'éléments complémentaires sur le plan psychologique. La plupart des écoles visent en réalité dans leurs contrôles des aptitudes fonctionnelles plutôt que des profils de personnalité.
R E G A R D S SUR L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 173
3.2 Les tests d'admission
Les tests d'admission sont un sujet qui revient régulièrement dans les publications sur l'interprétation. Leur importance est grande en raison du très fort taux d'échec constaté dans les écoles.
Dans leur forme la plus simple, qui est adoptée par de nombreuses écoles, les tests d'admission se composent des éléments suivants, avec quelques variantes (voir Keiser 1978) :
— Des interviews dans les langues de travail du candidat: ces interviews aident à contrôler sa connaissance desdites langues et permettent aux membres du jury de se faire une idée de sa personnalité, et notamment de sa capacité d'expression.
— Un exposé improvisé sur un sujet d'actualité. Il est destiné à vérifier la capacité d'expression orale du candidat, sa curiosité intellectuelle, sa culture générale, ainsi que sa maîtrise de la langue concernée.
— Un contrôle de la compréhension d'un exposé non technique fait par l'un des membres du jury ou d'un texte écrit non technique : il est demandé au candidat de résumer le texte ou exposé et/ou de répondre à des questions le concernant.
— Parfois, un exercice de traduction à vue, qui permet de vérifier la compréhension d'un texte en langue de départ, ainsi que la capacité de séparation des deux langues en contact chez le candidat.
Dans certaines écoles, des épreuves de traduction écrite font également partie de la sélection des élèves-interprètes. A l'ISIT, elles permettent d'éliminer un grand nombre de candidats dont les connaissances linguistiques sont à l'évidence trop faibles, avant de présenter les autres à l'oral. A la Polytechnic of Central London, un exercice de shadowing avait également été incorporé dans la batterie de tests (Longley 1978). D'autres auteurs, tels que S. Lambert (1992a), proposent d'utiliser des tests de Cloze pour évaluer la connaissance des langues, la compréhension et la capacité d'anticipation des candidats.
Une idée intéressante est proposée par B. Moser (1978), qui part d'une base double: d'une part, l'idée selon laquelle une certaine période d'adaptation serait susceptible de révéler des aptitudes qui n'apparaissent peut-être pas pleinement lors-d'un examen unique et très court; d'autre part, l'analyse cognitive des opérations de la simultanée conduit B. Moser à se concentrer sur des aptitudes spécifiques. D'où l'idée de proposer aux candidats un cours préparatoire d'une quinzaine de séances
174 DANIEL GILE
d'entraînement à des tâches particulières, le tout étant suivi d'un examen. Les exercices proposés sont les suivants :
— En guise d'entraînement au partage d'attention, des exercices de shadowing et d'écoute avec comptage ou comptage à rebours, suivis de la présentation par l'étudiant d'un résumé du discours entendu.
— Des exercices d'analyse et de réexpression sous forme de paraphrasage.
— Des exercices de détection et de notation de chiffres dans des discours qui en contiennent beaucoup.
A la fin du stage, chaque candidat fait l'objet d'une recommandation : « favorable », « favorable avec réserves », ou « défavorable» à la poursuite des études en interprétation. Selon Moser (1985), un suivi de 4 ans fait apparaître une forte corrélation entre les résultats de ce stage et ceux des études subséquentes au Monterey Institute of International Studies.
Dans l'ensemble, les écoles considèrent que leurs méthodes de sélection ont fait leurs preuves, en ce sens que peu de candidats inaptes à l'interprétation sont admis, même s'il arrive que des candidats possédant les aptitudes de base soient refusés (Keiser 1978). Cette appréciation nous semble discutable, dans la mesure où l'efficacité d'un test s'évalue aussi bien sur les faux positifs que sur les faux négatifs. En outre, il existe d'autres filtres au cours des études, et surtout celui des examens du diplôme, où le taux d'échec reste très élevé, puisqu'il est supérieur, voire très supérieur à 50 % dans la majorité des écoles. Peut-on dans ces conditions parler de tests d'admission efficaces? Pour répondre à la question, il faudrait en savoir davantage sur les raisons des échecs en cours et en fin de formation. Précisons en passant que dans une étude observation-nelle récente réalisée à Trieste par A. Gringiani (1990), la fiabilité des tests dans son école s'est avérée médiocre. Il ne s'agit là toutefois que d'une étude de cas, et ce dans un système universitaire où il n'existe pas de sélection à l'entrée (c'est le cas en Italie et en Allemagne) : de ce fait, les candidats se présentant à l'admission diffèrent peut-être de ceux qui se présentent dans des écoles plus sélectives, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'efficacité des examens d'admission.
R E G A R D S SUR L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 175
3.3 Sélection en cours et en fin de parcours
Si la sélection à l'admission est souvent débattue dans les textes sur la formation, il n'en est pas de même de la sélection en cours et en fin de parcours. Et pourtant, la proportion des abandons spontanés chez les étudiants admis aux programmes est assez élevée, probablement supérieure à 50 % dans la plupart des écoles (observations personnelles). En outre, dans les cursus de deux ans, le passage de la première à la deuxième année est également marqué par un filtre : sur la base du travail de l'année ou d'un examen de fin d'année, les enseignants peuvent recommander le passage au niveau supérieur, le redoublement de la première année, un séjour linguistique à l'étranger ou l'abandon de la filière. Dans les stages de six mois de la Commission des communautés européennes, des filtres du même type sont disposés à intervalles réguliers, à la fin du deuxième mois, puis à la fin du quatrième mois.
S'agissant de l'examen final dit « du diplôme », les tâches et critères de réussite ou d'échec sont très clairement définis. En effet, les épreuves consistent en une succession d'exercices simulant les principales formes d'interprétation que le candidat aura à accomplir dans sa vie professionnelle dans ses langues de travail : simultanée, consécutive et traduction à vue. Quant au niveau de performance requis, il est celui d'un interprète professionnel prêt à travailler en cabine. Dans les principales écoles d'interprétation, les jurys d'examen se composent d'interprètes professionnels, dont une partie au moins ne font pas partie du corps enseignant de l'école concernée, ainsi que de représentants d'organisations recrutant des interprètes. La formule est remarquablement homogène et semble être considérée consensuellement comme adéquate par l'ALTC et les écoles. C'est pourquoi la profession et les enseignants semblent ne pas s'interroger sur les examens du diplôme comme ils s'interrogent sur les examens d'admission, bien qu'en réalité l'enjeu des examens de sortie soit plus important.
On notera l'absence d'études empiriques sur la validité de ces tests. Là aussi, si l'on en juge d'après l'intégration professionnelle des diplômés, rares sont les réussites non méritées. En revanche, on ne sait pas quel est le taux des échecs non justifiés. Signalons toutefois qu'il n'est pas rare que des candidats malheureux à l'école se lancent tout de même dans la profession, s'y intègrent et soient considérés par leurs pairs comme des interprètes compétents. Il est donc fort possible, comme l'affirment certains collègues, que les tests du diplôme
176 DANIEL GILE
soient plus sélectifs que ne l'exigerait le maintien d'une qualité acceptable aux yeux des praticiens sur le marché.
Sur le plan professionnel, il s'agit là d'un moyen de régulation permettant théoriquement d'élever le niveau moyen des interprètes de conférence. Toutefois, on ne dispose pas d'études empiriques permettant de voir si une telle évolution a effectivement eu lieu. Sur le plan humain, cette forte sélectivité des examens pose un problème dans le système européen et américain: les études d'interprétation demandent un fort investissement psychologique, et souvent un investissement de temps considérable: la plupart des programmes durent deux ans, et la durée effective de la formation est souvent prolongée par le redoublement d'au moins l'une des années, ou par une année d'interruption pour perfectionnement linguistique dans un pays étranger. Un échec au diplôme aboutit à la perte de tout cet investissement, du moins sur le plan formel des diplômes. Deux autres formules existent pourtant :
— Le programme de traduction et d'interprétation de l'université du Queensland, en Australie, conduit au M.A., diplôme universitaire que les étudiants acquièrent au terme de leurs deux années d'études quel que soit le verdict quant à leurs aptitudes à l'interprétation professionnelle. Parallèlement, il existe un système national d'accréditation géré par la NAATI (National Accréditation Authority for Translation and Interprétation), qui propose des examens d'interprétation de différents niveaux (les étudiants peuvent se présenter à un examen d'interprétation «communautaire», de niveau moins élevé que celui de l'interprétation de conférence), et qui sanctionne l'aptitude professionnelle. Ainsi, l'investissement des étudiants aboutit à un titre universitaire monnayable sur le marché du travail, même s'il n'aboutit pas à un diplôme professionnel.
— Dans certaines écoles d'interprétation japonaises, un « diplôme de fin d'études » est remis à tous les participants à la fin de leur scolarité. Toutefois, ce diplôme seul n'a pas de valeur professionnelle. La véritable qualification intervient lorsque les agences de traduction, qui réalisent également les programmes de formation (les écoles sont privées et leur appartiennent), recrutent les diplômés et leurs décernent un label' d'interprète « C » (débutant), puis « B » (confirmé), puis « A » (de « première classe »), selon leur évaluation de la qualité du travail effectué sur le terrain. Dans cette formule, contrairement au système normalisé des écoles européennes et de quelques écoles américaines, la sélection est informelle et personnelle.
R E G A R D S SUR L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 1.77
4. Les méthodes de formation
Dans toutes les écoles d'interprétation, l'enseignement se fait essentiellement à travers des exercices d'interprétation simulant la réalité : exercices de consécutive, de simultanée avec et sans texte, de traduction à vue. Les différences entre les écoles se manifestent dans l'abord de ces exercices et dans les cours et exercices périphériques :
4.1 La formation à la consécutive
4.1.1 Premiers contacts
Il est rare que les étudiants arrivant dans une école soient soumis d'emblée à des exercices d'interprétation proprement dits. En général, une préparation, même courte, est de rigueur. La forme la plus généralisée de ces premiers contacts est la « consécutive sans notes » ou « mémorisation », où les étudiants doivent résumer de courts exposés sans avoir le droit de prendre des notes. L'exercice peut être fait dans une seule langue, puis avec une langue de départ et une langue d'arrivée. Les exposés deviennent progressivement plus longs, plus difficiles, et il est demandé aux étudiants de les restituer d'une manière de plus en plus complète (voir les différents articles à ce sujet dans Delisle 1981, Gerver & Sinaiko 1978, Gran et Dodds 1989, ainsi que dans Seleskovitch et Lederer 1989).
Ces exercices sensibilisent les étudiants à la nature de l'écoute requise, à la nécessité d'analyser le discours original, aux exigences de rigueur dans la restitution, et les préparent à la « vraie » consécutive avec prise de notes.
4.1.2 La consécutive
Comme il est indiqué plus haut, la consécutive n'a plus la même valeur que par le passé en tant qu'outil professionnel, mais reste très importante sur le plan pédagogique. En fait, dans plusieurs écoles, dont l'ESIT et l'ISIT à Paris, une année entière, soit la moitié du cursus, est consacrée à la consécutive à l'exclusion de la simultanée; la consécutive continue d'ailleurs à être pratiquée jusqu'à la fin de la deuxième année, et
178 DANIEL GILE
les épreuves de consécutive à l'examen du diplôme sont éliminatoires au même titre que les épreuves de simultanée. En revanche, dans d'autres écoles, notamment à la Polytechnic of Central London et à l'ETI à Genève, la consécutive et la simultanée peuvent être enseignées indépendamment l'une de l'autre (AIIC 1979:25-26).
Certains enseignants critiquent la doctrine du passage obligatoire par la consécutive (voir Francis 1989), en faisant valoir qu'il n'a jamais été démontré que les aptitudes nécessaires à la consécutive et à la simultanée sont les mêmes, et qu'enseigner la consécutive à des étudiants qui ne s'en serviront peut-être jamais n'est pas une bonne politique, surtout dans le cadre d'un programme de formation court.
Il n'existe à ce jour aucune étude systématique sur l'apport de la consécutive à la progression de l'apprentissage et à l'amélioration du résultat final en matière de simultanée. En revanche, il semble y avoir accord parmi les enseignants sur le fait que la consécutive est un excellent outil de formation à l'analyse et un excellent outil d'observation des étudiants. En effet, la séparation chronologique entre l'étape d'écoute et l'étape de reformulation est un frein au psittacisme (AÏÏC 1979:38) et une incitation à l'analyse, et la performance en consécutive permet de détecter un manque d'analyse là où la même erreur ou maladresse en simultanée pourrait être interprétée comme ayant pour origine une interférence linguistique ou un problème de production en langue d'arrivée.
Comme il a déjà été mentionné au Ch. 2 et au Ch. 4, les écrits sur la consécutive, et notamment sur la prise de notes, sont très nombreux, et peuvent préconiser des systèmes très élaborés, voire fondés sur une grammaire des notes' (Allioni 1989). Cependant, là aussi, aucune recherche n'est venue appuyer les affirmations des uns et des autres. Rappelons seulement un modeste résultat de recherche empirique, à savoir une confirmation expérimentale de l'influence néfaste de la prise de notes sur la qualité de l'écoute chez les étudiants débutants à travers l'indicateur des noms propres (Gile 1991b, voir Ch. 4).
4.2 La formation à la simultanée
De même que la consécutive est précédée d'une période d'exercices préparatoires, l'entraînement à la simultanée est lui aussi précédé d'une certaine préparation.
R E G A R D S SUR LA R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 179
Celle-ci prend en général la forme d'exercices de partage de l'attention. L'exercice d'écoute et de comptage à rebours (ou autres modes de comptage non automatiques) semble unanimement accepté. La répétition avec décalage ou shadowing, quant à elle, a donné lieu à de très nombreuses controverses (voir notamment Lambert 1992a). On lui reproche surtout de ne pas « ressembler » à l'interprétation, en ce sens qu'elle implique la répétition mot pour mot du discours original sans effort de réexpression, ce qui ne serait d'aucune utilité et favoriserait le psittacisme. Pour la psychologue cogniticienne S. Lambert, l'exercice présente apparemment (elle ne le précise pas, mais sa logique semble claire) l'avantage de demander une certaine analyse, puisque les éléments linguistiques sont reconnus, mais l'Effort de production requis est moins contraignant que dans la vraie simultanée, ce qui le rend utile comme préparation à la simultanée. B. Strolz (1992), quant à elle, pense que le partage de l'attention nécessaire au shadowing est très vite appris ; il n'a donc qu'une utilité très limitée dans le temps. On notera là aussi l'absence de toute tentative de vérification systématique par les faits des affirmations en faveur ou contre cet exercice d'entraînement.
De manière plus générale, non seulement la répétition avec décalage, mais aussi d'autres exercices sont condamnés par de nombreux enseignants orthodoxes' au nom du principe de la similitude maximum entre les exercices faits en classe et le travail sur le terrain, formulé par les premiers enseignants et réaffirmé depuis de manière répétée (AIIC 1979). Ce principe relevait certainement du bon sens initialement, quand des systèmes d'enseignement furent mis en place par des praticiens de l'interprétation qui n'avaient aucune connaissance en psychologie cognitive et en psycholinguistique. Toutefois, il nous semble que son maintien face aux contre-arguments scientifiques, sans aucune tentative d'analyse, relève du conservatisme idéologique, d'autant plus que dans divers domaines, et notamment dans les disciplines sportives, l'entraînement par des exercices sensiblement différents de l'activité-cible est chose courante et parfaitement admise.
Une autre controverse porte sur la formation à la simultanée vers la langue B. Comme il est expliqué au Ch. 4, les interprètes sont partagés sur le travail en simultanée vers la langue B (tout en admettant le travail vers le B en consécutive, où les contraintes de temps et les risques d'interférence linguistique sont moins importants). Si ses adversaires les plus farouches reconnaissent sa nécessité dans certaines circonstances,
ISO DANIEL GILE
notamment pour les langues rares (Seleskovitch et Lederer 1989), ils n'acceptent pas le principe de la formation à l'interprétation vers la langue B. En effet, ils estiment que la méthode doit être acquise dans les sens B fers A et C vers A, et qu'une fois maîtrisée, elle sera aisément transférée dans le sens A vers B sans formation supplémentaire. Pour eux, entraîner les étudiants dans le travail vers le B équivaut à ouvrir la porte à la facilité, au manque de rigueur et au psittacisme (AUC 1979:31).
On notera qu'aucune recherche sur l'éventuel effet délétère du travail vers le B en cours de formation n'a été effectuée à ce jour, de même qu'aucune étude n'a cherché à vérifier la transférabilité de la maîtrise acquise dans l'interprétation dans un sens langue X - langue Y vers l'interprétation dans une autre combinaison linguistique. Ce principe de la transférabilité de la maîtrise acquise dans une combinaison linguistique et dans une modalité d'interprétation vers d'autres combinaisons linguistiques et d'autres modalités est très fondamental dans certaines écoles, notamment à l'ESIT, et conduit à une démarche pédagogique axée sur la méthodologie au détriment de l'acquisition de connaissances et de mécanismes spécifiques.
On soulignera par ailleurs que certains marchés, et non des moindres, sont presque exclusivement bilingues. C'est notamment le cas du marché japonais, très actif. Dans ces environnements professionnels, tout interprète étant destiné à travailler vers sa langue B autant que vers sa langue A (les interprètes disposant de deux langues A sont très rares), on peut s'interroger sur ropportunité de ne former les étudiants qu'à l'interprétation dans un sens linguistique. Ne serait-il pas plus raisonnable de cerner de plus près les risques réels qu'implique un entraînement à l'interprétation vers une langue B et de mettre au point des stratégies visant à les réduire ? Il est intéressant d'observer que dans les pays occidentaux (on connaît très peu la situation dans les ex-pays de l'Est), aucune méthodologie n'a été mise au point (ou tout au moins publiée) pour répondre à cette situation. Peut-être la chose est-elle partiellement attri-buable au tabou qui a frappé pendant longtemps le travail vers le B dans les centres les plus actifs en matière d'enseignement, de théorie et de recherche.
R E G A R D S SUR L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 181
4.3 Les cours périphériques
4.3.1 Les cours d'acquisition de connaissances thématiques
En marge de l'apprentissage des principes et techniques de l'interprétation proprement dite, la plupart des écoles offrent, dans une mesure très variable, des cours permettant aux étudiants d'acquérir des connaissances thématiques pertinentes. Il s'agit en général de cours sur l'économie, les relations internationales, les institutions politiques. Rares sont les cours portant sur des sujets scientifiques et technologiques, qui fournissent pourtant une très importante partie du travail de la majorité des interprètes.
Une autre modalité d'acquisition de connaissances pertinentes est celle des exercices d'interprétation qui sont consacrés, pendant une période de plusieurs jours à plusieurs semaines, à des domaines particuliers (microélectronique, SIDA, sidérurgie, construction navale, etc.). A travers la préparation et les exercices, les étudiants entrent en contact avec les idées et les termes propres au domaine étudié.
Aucune étude ne semble avoir été réalisée sur l'utilité de l'acquisition de connaissances préalables en cours de formation initiale, ni sur l'effet sur la qualité de l'interprétation de l'absence d'une telle formation. On notera que dans la vie professionnelle, une expérience ou une connaissance préalable du domaine est très appréciée des collègues recruteurs et des clients et constitue, à tort ou à raison, un « argument de recrutement» important. Des études sur la qualité en fonction des connaissances thématiques préexistantes chez l'interprète présenteraient donc un intérêt pratique non négligeable, en ce sens qu'elles permettraient éventuellement de mieux orienter les cours d'acquisition de connaissances thématiques.
4.3.2 Les cours de perfectionnement linguistique
En dépit du principe qui veut que tout candidat admis à l'école d'interprétation possède déjà ses langues de travail au niveau requis pour l'interprétation professionnelle sur le terrain, de nombreux étudiants en interprétation présentent des faiblesses linguistiques, qui sont d'ailleurs souvent à l'origine de leur échec aux différents examens.
Or, dans le domaine de l'enseignement des langues étrangères, il ne semble pas exister de programmes de perfectionne-
182 DANIEL GILE
ment linguistique au niveau de maîtrise nécessaire à l'interprétation de conférence, axé sur l'oral, sur la disponibilité et sur des registres particuliers, notamment techniques et oratoires (voir Ch. 8). C'est pourquoi les cours de perfectionnement linguistique mis en place par plusieurs écoles restent pour l'instant artisanaux, et n'ont donné lieu qu'à un petit nombre de publications (Lafrance 1976, Déjean Le Féal 1978, Ilg 1978, Association des amis de l'ESIT 1987).
4.3.3 Les cours « théoriques »
Dans la plupart des écoles, la formation à l'interprétation se compose essentiellement d'exercices préparatoires tels que décrits plus haut et d'exercices d'interprétation proprement dits. Dans un petit nombre d'entre elles, des explications 'théoriques' sont données aux étudiants pour leur permettre de comprendre les problèmes auxquels ils se heurtent et la raispn-d'être des méthodes que leur proposent les enseignants pour y faire face. A l'ESIT, il s'agit d'un cours annuel en première année où les explications sont données au niveau de la vulgarisation. A l'ISIT, il existe un cours semestriel de première année où sont présentés des concepts et modèles de base. Il s'agit notamment d'un modèle de communication, de modèles d'Efforts pour la consécutive et la simultanée (voir Ch. 4) et d'un modèle gravitationnel' de la disponibilité linguistique (Ch. 8), qui ont d'ailleurs été mis au point à des fins pédagogiques (voir Gile a.p. a).
Dans tous ces cas, l'effet de ces cours sur les étudiants, que ce soit en termes de résultats pratiques au cours des exercices d'interprétation ou en termes de motivation, n'a pas été mesuré.
5. Conclusion
Rappelons que la quasi-totalité des chercheurs en interprétation sont des enseignants, que la formation est l'application par excellence de la recherche dans ce domaine, et qu'une grande partie des textes sur l'interprétation porte sur la formation. Rappelons aussi que c'est dans les écoles que l'on trouve les conditions les plus favorables à la recherche, notamment des étudiants intéressés et un environnement universitaire.
Dans ces conditions, il est frappant de voir à quel point les méthodes restent intuitives et artisanales et à quel point la
R E G A R D S SUR LA R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 183
véritable recherche sur la formation reste absente. La situation dans ce domaine nous semble refléter clairement la position d'ensemble de la recherche dans les milieux de l'interprétation, position qui reste d'une grande faiblesse en dépit de la masse de textes universitaires publiés depuis les années 50.
Sur le plan pratique, force est de constater que la recherche n'a pas encore fourni aux enseignants d'indications solides sur l'efficacité relative des programmes qt méthodes de formation employés dans les différentes écoles. Si dans la thèse d'I. Pinter (1969), il s'est avéré que la capacité d'écouter et de parler en même temps était bien fonction de la durée de la formation antérieure, dans une étude de M. Viezzi (1990), les taux de rétention d'information après des tâches d'écoute simple, de lecture, de simultanée et de traduction à vue n'ont pas fait apparaître de différences entre étudiants et professionnels. Par ailleurs, dans l'étude de D. Gile sur les fautes et maladresses de langue survenant en interprétation (1987) évoquée au Ch. 4, aucune progression n'a été relevée entre le début et la fin de l'année universitaire. Les écoles seraient-elles plus efficaces comme filtres que dans leur fonction de formation ?
En tout état de cause, le champ d'investigation reste largement ouvert, avec de nombreuses possibilités de recherche, et, dans ce domaine précis, un accès facile aux sujets.
!
Chapitre 8
Aspects linguistiques de l'interprétation
1. Introduction
Une caractéristique singulière de la recherche sur l'interprétation, activité de communication centrée autour de la langue, est la très faible place qu'y a occupé pendant longtemps la recherche sur les questions linguistiques.
Le phénomène semble essentiellement attribuable à un rejet catégorique de ce thème de la part des chercheurs praticiens pendant toutes les années 70 et jusque vers le milieu des années 80, période pendant laquelle le monde de la recherche en interprétation était fortement dominé par la 'théorie du sens' (voir Ch. 2). Pour les tenants de cette théorie, les langues ont dans l'interprétation un rôle d'outil à vocation de transparence, et les préoccupations linguistiques relèvent de l'apprentissage des langues et non pas de l'interprétation proprement dite (voir Ch. 2 et Section 2.3 du présent chapitre) ; celle-ci se résumerait essentiellement à une analyse intellectuelle, suivie de la production 'spontanée' d'un discours.
Cette position a fortement influé sur le statut des disciplines linguistiques dans la recherche sur l'interprétation au sein de la communauté des praticiens-chercheurs. En effet, les tenants de la 'théorie du sens' refusent d'étudier au plan linguistique les modalités de décodage et de codage. Ils postulent notamment qu'à partir du moment où les langues sont maîtrisées et le sujet et la situation connus, la compréhension ne pose « aucun problème » en interprétation, où les ambiguïtés n'existent pas (Seleskovitch dans Seleskovitch et Lederer 1984:120, 274). La production du discours elle non plus ne pose pas de
136 DANIEL GILE
problème : « Sachant ce que nous voulons dire, nous énonçons les pensées les plus complexes, et les mots viennent nous servir avec une spontanéité presque totale» (Seleskovitch 1968:43) ...«Si le sens a été parfaitement saisi, l'original parfaitement déverbalisé, les mots pour le dire arriveront aisément, du moins en langue maternelle » (Seleskovitch et Lederer 1989:97).
Cette position théorique est, rappelons le, en contradiction avec les connaissances linguistiques et psycholinguistiques actuelles en matière de compréhension et de production du discours. Elle a pu exercer un certain attrait sur des praticiens enseignants (voir Ch. 4), mais à mesure que l'on reconnaissait le niveau souvent insuffisant de la maîtrise linguistique chez les étudiants admis en école d'interprétation (voir de Clarens 1973, Carroll 1978, Keiser 1978), il a bien fallu traiter le problème. Quant aux chercheurs et praticiens non enseignants, en dehors du groupe de l'ESIT, ils ne semblent pas avoir vraiment adhéré à l'idée de l'indépendance de l'interprétation vis-à-vis des paramètres linguistiques si l'on en juge d'après la masse des articles parus dans différents pays depuis les années 60.
Il n'est pas étonnant que l'étude des aspects linguistiques de l'interprétation ait pris un certain essor depuis le milieu des années 80, période charnière de changement de paradigme et de montée en force d'une tendance plus pragmatique dans la réflexion sur l'interprétation. Le présent chapitre formule quelques questions et problèmes fondamentaux qui se posent à propos des aptitudes linguistiques de l'interprète, et présente des idées et travaux réalisés sur ce thème.
2. Les besoins linguistiques
2.1 Etendue des connaissances
L'AHC définit les langues de travail en prenant pour référence la connaissance de la langue maternelle (AÏÏC 1982:10) :
— Les langues 'A' sont des langues maternelles ou rigoureusement équivalentes à des langues maternelles.
— Les langues 'B', sans être des langues maternelles, permettent aux interprètes de se faire comprendre parfaitement.
— Les langues 'C doivent être «totalement comprises» par l'interprète.
Ces critères sont de toute évidence insuffisants, car, selon son niveau culturel et sa catégorie socio-professionnelle, un locuteur natif peut avoir des connaissances linguistiques varia-
R E G A R D S SUR L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 187
bles, éventuellement inférieures par certains aspects à celles d'un locuteur non-natif cultivé qui parle la langue concernée avec un accent étranger et avec des fautes.
Pour préciser, D. Seleskovitch parle d'une connaissance de la langue de travail de l'interprète comprenant entre autres une «base de vocabulaire équivalant au minimum à celle d'un homme cultivé dont cette langue est la langue maternelle» (1968:136). Cette définition constitue une meilleure approximation, mais reste insuffisante. D'une part, la notion d'«homme cultivé» est quelque peu imprécise. Elle peut par exemple désigner une personne qui a beaucoup lu, notamment dans les domaines littéraires et artistiques, mais qui n'a pas nécessairement une grande connaissance des questions techniques et industrielles. Or, sur le plan pratique, le lot de la majorité des interprètes de conférence est de travailler pour l'essentiel à des conférences industrielles, scientifiques ou techniques où le langage littéraire et artistique n'a pas cours, mais où une très large part du vocabulaire important est technique. D'autre part, le vocabulaire du locuteur natif est également composé d'éléments de vocabulaire enfantin, scolaire, familier, voire
. argotique qui n'interviennent quasiment jamais en conférence. L'idée d'une équivalence par rapport à la langue maternelle ne semble donc pas justifiée.
En participant à des conférences et en lisant des transcriptions d'interventions, on est amené à classer le langage des conférences en trois composantes :
a. Le langage non spécialisé Ce langage correspond probablement à ce que D. Selesko
vitch appelle la « base » dans la citation ci-dessus. Il englobe le vocabulaire et les structures grammaticales non techniques employés dans les échanges en cours de séance, par opposition aux échanges à bâtons rompus qui interviennent pendant les pauses et en dehors des séances de travail. A notre connaissance, aucune étude descriptive de ce langage n'a été réalisée jusqu'ici. Une telle recherche, qui nécessiterait un vaste corpus en raison de la grande diversité des conférences, demanderait un très important travail de transcription de discours qui ne paraît pas envisageable sans des moyens humains et financiers considérables. D'où l'approximation de D. Seleskovitch, qui est reprise en général par d'autres enseignants. Elle conduit à considérer que le vocabulaire et les structures grammaticales de base du langage non spécialisé sont celles du vocabulaire
10;j DANIEL GILE
non technique et deç structures grammaticales que l'individu peut utiliser au cours de ses études supérieures et de sa vie personnelle et professionnelle d'adulte dans des circonstances plus ou moins formelles.
Compte teiiu du nombre d'entrées figurant dans les dictionnaires courants et de la proportion de termes techniques, argotiques et littéraires parmi elles, le vocabulaire de ce langage non spécialisé se situe probablement à quelques dizaines de milliers de mots, les noms propres et les variantes désinen-tielles n'étant pas comptés. On peut considérer aussi que ce vocabulaire est relativement stable, en ce sens que seule une faible proportion de ses éléments change au cours d'une carrière professionnelle.
b. Les langages de spécialité Les langages de spécialité dans les conférences internatio
nales se distinguent principalement du langage non spécialisé par leurs termes techniques, qui se chiffrent par milliers ou par dizaines de milliers selon le domaine, comme l'attestent les glossaires et dictionnaires spécialisés. Certains langages de spécialité comportent également des tournures et expressions particulières, mais celles-ci sont en général relativement peu nombreuses dans les échanges oraux par rapport à l'ordre de grandeur du nombre des termes spécialisés.
Parmi les langages de spécialité, il en est un qui intéresse particulièrement les interprètes de conférence travaillant pour les organisations internationales et pour des organes législatifs et judiciaires. Il s'agit du langage de la procédure, qui est relativement restreint dans son étendue, mais qui compte une proportion élevée d'expressions et tournures particulières (par opposition à des termes isolés).
Une caractéristique importante des langages de spécialité est la forte évolutivité de leur vocabulaire. D'après la revue Media et Langage (N.16, oct-nov 1982), la langue française s'enrichit annuellement d'environ 10 000 termes dans les seuls domaines scientifiques et techniques. L'innovation lexicale est particulièrement importante dans les domaines dont traitent les conférences internationales, qui sont souvent par définition à l'avant-garde du progrès : informatique, médecine, techniques spatiales, sciences de l'environnement, etc. L'interprète se trouve donc aux prises avec un vocabulaire technique en constant renouvellement.
R E G A R D S SUR L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 189
c. Le langage oratoire Enfin, dans certains types de réunions, notamment les réu
nions diplomatiques et politiques, mais aussi dans certaines réunions culturelles, intervient un langage où abondent des mots et structures linguistiques oratoires, voire littéraires.
La répartition de ces trois catégories de langage dans les conférences est variable. Si toutes englobent une large part de langage général non spécialisé, certaines comportent une forte part de langage de spécialité et peu de langage oratoire, et d'autres un langage plutôt oratoire et non spécialisé. Qui plus est, dans les langages de spécialité, qui, cumulativement, sont bien plus riches que le langage non spécialisé, seul un petit sous-ensemble de spécialités est concerné à chaque conférence. Il en résulte que selon leur 'marché', les interprètes peuvent avoir besoin de connaissances linguistiques sensiblement différentes.
2.2 La disponibilité linguistique et le Modèle gravitationnel
Comme il est expliqué au Ch. 4, la compréhension et la production du discours sont des opérations non automatiques; elles nécessitent du temps et une certaine capacité de traitement, qui revêtent une importance critique dans la capacité de l'interprète d'accomplir sa tâche. En dépit des fortes intuitions des pionniers, et notamment de J. Herbert (voir Ch. 2), la disponibilité lexicale et grammaticale n'a jamais été étudiée au regard des besoins de l'interprétation. Les leaders du mouvement de la 'théorie du sens' considéraient que :
...«après la période d'apprentissage de la langue, la langue maternelle bascule dans le réflexe et devient un outil aussi immédiatement et aussi naturellement disponible pour exprimer un vouloir dire que le sont les mains pour faire des gestes, allumer une cigarette ou écrire une lettre ; on réussit ces gestes sans qu'il soit nécessaire de les guider consciemment. De même on dit ce que l'on veut sans avoir à choisir aucun des phonèmes qui les construisent, et l'on écrit sans avoir à guider consciemment la main dans chacun des pleins et des déliés de l'écriture» (Seleskovitch, dans Seleskovitch et Lederer 1984:111).
D'autres chercheurs, tout en étant conscients de certaines difficultés linguistiques de l'interprétation (voir Déjean Le Féal
190 DANIEL GILE
1981, Lederer 1981, Thiéry 1981), ne les ont pas associées à la notion de disponibilité. La seule théorie existante en la matière semble être notre Modèle gravitationnel, expliqué ci-dessous, qui cadre bien avec le principe des modèles d'Efforts de l'interprétation (Ch. 4).
La disponibilité linguistique est une mesure du temps et de la capacité de traitement nécessaires à la compréhension d'une structure linguistique donnée à l'écoute, et du temps et de la capacité de traitement nécessaires à la production d'une structure linguistique donnée à partir d'une idée. En tant que telle, elle est un important élément des besoins en temps et en capacité de traitement de l'Effort d'écoute et de l'Effort de production.
Le Modèle gravitationnel de la disponibilité linguistique est essentiellement une représentation visuelle de la distribution des éléments linguistiques connus d'un locuteur selon leur degré de disponibilité dans une situation donnée et à un moment donné. Il s'agit donc en principe d'un 'instantané'. Notons toutefois que de même qu'un cliché photographique instantané permet de mettre en évidence les caractéristiques permanentes d'un visage, l'instantané gravitationnel permet potentiellement de faire des inférences sur les caractéristiques permanentes de l'individu qu'il représente en situation, voire d'une population d'individus partageant des caractéristiques similaires.
La morphologie du Modèle est celle d'un système gravitationnel composé d'un Noyau central et d'Orbites sur lesquelles 'gravitent' des Eléments linguistiques, à savoir les unités lexicales et les règles de 'grammaire' au sens large (Fig. 1). Le Noyau représente les Eléments linguistiques très centraux, dont la fréquence d'occurrence dans la vie courante du locuteur est si élevée qu'ils sont maintenus en permanence à un très haut niveau de disponibilité (voir plus loin). En revanche, les Eléments gravitant sur des Orbites ont une disponibilité variable, représentée par la distance entre leur Orbite et le Noyau. Plus un Elément est disponible, plus il gravite sur une Orbite proche du Noyau. Les Orbites éloignées correspondent à une disponibilité moindre.
R E G A R D S SUR LA R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 191
Figure 1 : Le modèle gravitationnel de la disponibilité linguistique
Le système gravitationnel couvre deux Zones, la Zone dite active', où gravitent les Eléments dont le locuteur dispose pour l'expression écrite ou orale, et la Zone dite passive', où gravitent les Eléments que le locuteur peut comprendre, mais qu'il n'est pas capable d'évoquer pour l'expression active. Par commodité, la Zone passive est représentée comme limitrophe extérieure de la Zone active. Intuitivement, cela correspond à la tendance des Eléments passifs à devenir actifs dès qu'ils dépassent un seuil de disponibilité, et inversement.
La dynamique du Modèle gravitationnel s'exprime en quelques lois simples, mais dont les incidences pratiques sont importantes. Les principales d'entre elles sont les suivantes
192 DANIEL GILE
(voir aussi Gile 1987). Précisons d'emblée qu'il s'agit de lois dérivées de l'observation personnelle, qui n'ont pas encore pu faire l'objet de vérifications systématiques :
1. La tendance centrifuge Un Elément non stimulé tend à dériver vers l'extérieur du
système: s'il est initialement dans la Zone active, il tend à migrer vers des Orbites de plus en plus décentrées, puis vers la Zone passive, où il continue le cas échéant à dériver vers l'extérieur jusqu'à sa disparition hors du Système.
2. L'effet centripète de la stimulation Un Elément stimulé par son utilisation, active ou passive,
tend à devenir plus disponible, c'est-à-dire à migrer vers des Orbites plus centrales. Il peut notamment passer de la Zone passive à la Zone active.
3. L'effet de la fréquence de stimulation La 'force' de l'effet centripète de la stimulation est fonction
de la fréquence de stimulation. Plus un Elément est stimulé souvent, plus il a tendance à migrer vers le centre. Cet effet peut d'ailleurs être considéré comme un corollaire des deux premières lois : chaque stimulation a un effet centripète et chaque intervalle entre deux stimulations entraîne une migration centrifuge ; l'augmentation de la fréquence de stimulation correspond à une multiplication des poussées centripètes et à un raccourcissement des intervalles centrifuges.
4. La force de la stimulation active Dans l'ensemble, une stimulation active (utilisation de l'Elé
ment par le locuteur dans l'expression active) a un effet centripète plus fort qu'une stimulation passive (qui intervient quand le locuteur lit ou entend l'Elément dans un texte ou discours d'autrui).
5. L'effet d'accompagnement Quand un Elément subit une poussée centripète du fait
d'une stimulation, il est accompagné, dans une mesure variable, par d'autres Eléments qui lui sont associés. Cette association peut être morphologique, phonétique, grammaticale, graphique, psychologique. Elle s'exerce aussi d'une langue à
R E G A R D S SUR LA R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 193
l'autre. Elle a d'ailleurs deux effets interlinguistiques intéressants. L'un, positif, rend un Elément en langue étrangère plus disponible à la suite de la stimulation d'un Elément dans une autre langue, qui lui est associé. L'autre, le revers de la médaille, est l'interférence linguistique qui entrave l'expression ou la compréhension dans une langue en raison de l'intrusion dans le système d'un Elément associé en langue étrangère (c'est notamment le cas des Taux amis').
Le Modèle gravitationnel peut être utilisé pour l'analyse de l'apprentissage des langues étrangères, mais son intérêt dans le présent contexte, qui est aussi sa véritable raison d'être, réside dans ses applications à l'interprétation de conférence. Citons à titre d'exemples les éléments suivants :
1. Le phénomène de la dérive centrifuge met en relief la nécessité d'une stimulation fréquente et régulière des langues de travail. Une langue de travail, fût-elle maternelle, se perd si elle n'est pas stimulée. Dans ce domaine, l'improvisation est dangereuse. Les interprètes parlent parfois de « réflexes » qu'ils n'ont pas quand ils n'ont pas l'habitude de travailler à partir d'une langue donnée ou vers une langue donnée. En toute probabilité, cette absence de «réflexes» correspond, partiellement au moins, à une disponibihté insuffisante des Eléments pertinents. 2. Etant donné les contraintes que subit l'interprète en matière de capacité de traitement, il apparaît que seules les parties les plus disponibles des Zones active et passive sont utilisables chez lui, par opposition à la totalité du système chez le traducteur. Il s'agit donc pour l'interprète de disposer dans ses langues actives d'une partie très disponible suffisamment riche dans sa Zone active pour couvrir les besoins. En revanche, il devra éviter d'aller chercher pour s'exprimer des Eléments peu disponibles, surtout dans une langue non maternelle, car le coût de leur emploi en temps et en capacité de traitement risque de le conduire à une saturation ou à un déficit individuel des Efforts, et donc à une défaillance.
Dans la durée, avec la stimulation répétée d'une partie limitée de son vocabulaire, l'interprète finit peut-être par présenter un aspect typique et bipolarisé de la Zone active, où certains éléments sont aussi disponibles que chez un locuteur natif, et d'autres le sont nettement moins que chez un tel locuteur, avec une pauvreté relative des Orbites intermédiaires.
194 DANIEL GILE
3. Avec le Modèle gravitationnel, la distinction entre langues actives et langues passives prend également un sens fonctionnel. La langue active doit être stimulée en permanence pour rester suffisamment disponible dans ses composantes pertinentes. Quant à la langue passive, elle doit être comprise rapidement et facilement, mais ne nécessite pas une grande disponibilité active. Sa stimulation peut donc être passive. Certains interprètes pensent d'ailleurs (Déjean Le Féal 1978) que les interférences sont plus importantes entre deux langues actives qu'entre langues actives et langues passives. 11 apparaîtrait donc préférable, pour l'entretien des langues passives, de se contenter d'une stimulation passive, en évitant la stimulation active.
Au-delà de l'aspect qualitatif de la disponibilité des langues de travail, le Modèle gravitationnel fait apparaître l'intérêt potentiel d'une analyse quantitative de la disponibilité. En effet, si l'on observe par exemple que la migration centripète peut être relativement rapide, parfois quasiment immédiate en situation de conférence pour certains termes techniques, et que la dérive centrifuge ne devient généralement manifeste qu'après plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années d'absence de stimulation, une évaluation quantitative précise et concrète de la disponibilité et de la dynamique gravitationnelle serait intéressante. Quels sont concrètement les seuils de disponibilité utiles ? À partir de quel moment les dérives centrifuges ont-elles une incidence sensible sur l'interprétation ? Quelles sont les formes et les fréquences de stimulation qui produisent les meilleurs effets ? Quelle est la véritable différence d'efficacité entre la stimulation active et la stimulation passive? Il apparaît malheureusement difficile de répondre à ces questions. En effet, si la rapidité de la compréhension ou de l'évocation d'un mot, ou encore de la construction d'une phrase hors contexte peuvent être mesurées en laboratoire, en situation d'interprétation, la situation, le contexte et les interrelations entre la langue passive et la langue active se conjuguent pour rendre des mesures véritablement révélatrices des mécanismes réels extrêmement difficiles à réaliser.
R E G A R D S SUR L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 195
2.3 La robustesse de la maîtrise linguistique
Outre l'existence même des Eléments linguistiques dans le Système gravitationnel de l'interprète et une disponibilité suffisante pour ses besoins, se pose le problème de la robustesse de sa maîtrise des langues de travail, et surtout de la langue active, face aux contraintes de l'interprétation. Ces contraintes sont essentiellement :
— le manque de capacité de traitement résultant de la simultanéité des trois efforts
— le stress accompagnant la fatigue, le 'trac' et la difficulté d'aborder des domaines de connaissance peu connus de l'interprète, parfois avec très peu de préparation
— en interprétation simultanée, le traitement simultané de la langue de départ et de la langue d'arrivée.
Par robustesse, nous entendons ici le maintien de la disponibilité des Eléments linguistiques, ainsi que la résistance aux interférences linguistiques face à ces contraintes. On constate en effet chez les étudiants, et même chez certains professionnels, un affaiblissement de la capacité d'expression dans les langues actives en cours d'interprétation, et notamment en simultanée, par rapport à l'expression libre.
Une seule étude empirique a été réalisée sur cette question (Gile 1987). Il s'agit de la comparaison des fautes et maladresses survenues lors de trois types d'exercices réalisés par des étudiants en première année d'interprétation à l'ESIT (voir Ch. 4). Les erreurs et maladresses relevées étaient les moins nombreuses dans les exposés et les plus nombreuses en simultanée, la consécutive prenant une place intermédiaire.
Notons que cette étude n'a mesuré que les erreurs et maladresses, c'est-à-dire des manifestations claires de l'effet des contraintes de l'interprétation sur la performance. D'autres effets peuvent se traduire par une régression de la disponibilité ou par un rétrécissement du champ des Eléments disponibles à différents niveaux de disponibilité; ces phénomènes ne sont pas faciles à détecter. Ils peuvent aboutir à une richesse ou à une élégance moindre de la prestation, ou à des dépenses accrues en temps de recherche et en capacité de traitement, qui peuvent se manifester par des défaillances plus nombreuses dont l'origine linguistique est difficile à déterminer.
Etant donné l'importance de la question, une quantification serait là aussi souhaitable afin que l'on puisse sélectionner des candidats plus résistants' s'il en existe et éviter des échecs prévisibles, et éventuellement afin que l'on puisse mettre au point
196 DANIEL GILE
des stratégies, tactiques et méthodes de formation pour améliorer la robustesse de l'outil linguistique chez les interprètes.
2.4 Le perfectionnement linguistique
Sur le plan pratique, les exigences linguistiques sont donc particulièrement sévères. Or, on ne dispose pas de tests permettant de mesurer les différents aspects du niveau linguistique des candidats à l'école d'interprétation avec une précision suffisante. Cette imprécision est probablement l'une des principales causes d'échec chez de nombreux candidats admis dans les écoles. H importe donc de mettre au point des tests suffisamment performants. Il serait également intéressant de mettre au point des méthodes de perfectionnement linguistique susceptibles de conduire les candidats rapidement et efficacement à un niveau adéquat. En effet, du fait de la baisse très rapide de la fréquence des mots dans la masse naturelle' du discours en fonction inverse de leur rang de fréquence, l'immersion linguistique simple paraît peu efficace pour le perfectionnement linguistique à un niveau élevé (voir Gile 1994), et des méthodes plus structurées s'imposent.
A ces fins, U convient aussi d'affiner l'étude lexicométrique des langues (le problème est moins critique sur le plan grammatical), et d'étudier la progression des locuteurs étrangers dans l'apprentissage selon différentes méthodes. A l'heure actuelle, au-delà des conseils intuitifs et personnels (voir par exemple Déjean Le Féal 1976), il semble n'y avoir qu'une seule étude de cas sur ce sujet, réalisée avec le japonais au cours d'une période d'auto-perfectionnement d'un an (Gile 1988a).
3. La spécificité de l'interprétation par langues
3.1 Introduction
Comme il est expliqué au début de ce chapitre, certains théoriciens de l'interprétation considèrent celle-ci comme une activité mentale qui, si les langues de travail sont bien connues, transcende la langue et s'en affranchit à travers la «déverbalisation» (Seleskovitch 1975). Reprenant à leur compte l'affirmation de Jakobson (1959) selon laquelle «ail cognitive expérience and its classification is conveyable in any existing language», ils en déduisent que «tout ce qui est dit
R E G A R D S SUR L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 197
dans une langue est exprimable dans une autre » (à condition que les deux langues appartiennent à des civilisations ayant atteint un degré de développement comparable, ajoute D. Seleskovitch, 1968:144), et en tirent la conclusion que «tout est traduisible ».
En se fondant sur leur expérience personnelle de l'interprétation, ces praticiens-chercheurs nient la spécificité de la traduction par langues :
«Les praticiens ne remarquent que très rarement les différences inter-linguistiques quand ils interprètent, car quelles que soient les différences entre langue de départ et langue d'arrivée, ils n'éprouvent aucun mal à formuler les idées de l'orateur dans leur langue maternelle, à condition que ces idées soient claires et qu'ils connaissent bien la langue de départ » (Seleskovitch 1977).
Les porte-parole de la thèse de la non spécificité affirment que la compréhension du discours est la même en interprétation que dans les conditions habituelles d'échanges oraux, et qu'elle est la même dans toutes les langues (Lederer 1981a). Ils rejettent notamment l'impression d'une difficulté accrue de l'interprétation à partir de l'allemand vers le français comme une illusion attribuable à une insuffisante maîtrise de cette langue de départ (Seleskovitch dans Seleskovitch et Lederer 1984:193; voir aussi Lederer, pp. 148-149, dans le même ouvrage) :
' « Vu sous l'angle du processus, il serait absurde d'affirmer que l'allemand ne peut être compris aussi vite que le français parce qu'il a des emboîtements syntaxiques ou parce qu'il place le verbe ou la négation en fin de phrase; c'est une connaissance de l'allemand et non de syntaxe ».
D. Seleskovitch affirme aussi (dans Seleskovitch et Lederer 1989:137) que:
«L'interprète français qui comprend l'allemand aussi bien qu'un Allemand n'aura pas plus de problèmes à interpréter à partir de cette langue qu'à partir d'une langue plus proche »
Cette argumentation apparaît défendable face à des interprètes débutants ou non compétents, mais est difficile à soutenir devant les déclarations contraires d'interprètes chevronnés germanophones. On notera par ailleurs que si M. Lederer
m DANIEL GILE
(1981a: 257-259) et d'autres montrent de manière assez convaincante que la difficulté posée par la position finale du verbe dans la phrase allemande peut être illusoire du fait des capacités d'anticipation de l'interprète, D. Seleskovitch reconnaît implicitement une certaine spécificité linguistique à l'interprétation en préconisant dans la consécutive un apprentissage de la structuration des notes en fonction de la langue d'arrivée (1981:40),
En tout état de cause, la thèse de la non spécificité est loin d'être partagée par tous les praticiens. Les tenants européens de la thèse contraire opposent eux aussi dans leurs publications l'exemple de l'allemand (Ilg 1978, Wilss 1978, Le Ny 1978, Kurz 1983, Strolz 1992). Pour les auteurs japonais, la spécificité linguistique de l'interprétation semble évidente, et ils en présentent les conséquences présumées sans même engager le débat sur la question (Fukuii et Asano 1961, Kunihiro, Nis-hiyama et Kanayama 1969).
La question n'est pas sans importance, et a des corollaires immédiats en matière d'enseignement. Si l'interprétation est spécifique par langues, les spécificités doivent être explorées, pour mieux armer à terme les étudiants de stratégies et de tactiques précises face aux difficultés qui se poseront dans la pratique (voir par exemple Pinhas 1976). Dans le cas contraire, l'enseignement unilingue de l'interprétation (voir Feldweg 1980 et Gile 1983a) pourrait être développé, et le transfert interlinguistique des compétences présenterait des possibilités intéressantes dans la formation pour les langues rares ou les langues non connues des enseignants.
La présente section passe en revue les spécificités théoriques de l'interprétation par langues. Elle évoque les différences potentielles dans la compréhension du discours, puis dans la production du discours, et enfin dans les conditions de la simultanée, en prenant notamment comme illustration l'exemple du japonais. Cette dernière langue, peu exploitée jusqu'à présent dans les analyses, présente des caractéristiques marquées et intéressantes que partagent peut-être d'autres langues de manière moins visible. L'étude de son cas peut conduire à reconsidérer les idées nées de la seule étude des langues occidentales et à formuler de nouvelles hypothèses.
3.2 Différences potentielles dans la compréhension du discours
La compréhension du discours en condition d'interprétation
R E G A R D S SUR LA R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 199
correspond-elle vraiment à celle qui intervient dans la vie quotidienne comme l'affirment M. Lederer et d'autres ? On rappellera en premier lieu qu'en conférence, les connaissances extralinguistiques, qui interviennent dans la compréhension des énoncés verbaux, ne sont pas les mêmes chez l'interprète et chez les destinataires du discours. Par ailleurs, les contraintes d'écoute auxquelles est soumis l'interprète sont bien plus lourdes puisque, ne pouvant se concentrer sur les seuls points du discours qui l'intéressent, il est obligé de tout comprendre dans une mesure suffisante pour pouvoir restituer le message en langue d'arrivée. Enfin, son écoute se déroule dans des conditions de partage de l'attention particulièrement ardues qui ne se rencontrent pas usuellement dans la vie quotidienne (Ch. 4). Il nous semble plausible que ces différences appellent des stratégies et tactiques d'écoute et de compréhension qui diffèrent quantitativement, voire qualitativement, de celles de l'auditeur ordinaire, et qui dépendent peut-être en partie de la langue concernée. Par ailleurs, il n'est pas exclu non plus que même dans l'écoute ordinaire, le poids relatif des stratégies et tactiques diffère selon la langue.
3.2.1 Les mots
Parmi les éléments linguistiques susceptibles d'affecter la compréhension du discours figurent les caractéristiques morphologiques et phonétiques des unités lexicales, mots grammaticaux ou mots pleins'. Comme il est signalé au Ch. 4, les mots courts sont, du fait de leur faible redondance interne, plus vulnérables que d'autres au bruit et aux baisses d'attention. Si la redondance externe', découlant du contexte et de la situation, rétablit peut-être une certaine robustesse en situation de communication ordinaire, il est fort possible que les différences entre les langues là-dessus aient davantage d'impact dans la situation d'interprétation du fait des conditions particulières dans lesquelles elle se déroule, notamment en simultanée.
Citons à titre d'exemple les mots du chinois, ou encore les kango en japonais : il s'agit de mots composés de la juxtaposition de plusieurs caractères chinois et prononcés a la chinoise'. Etant donné l'absence presque totale des tons en japonais et le faible nombre de phonèmes distincts dans cette langue, les homophones et quasi-homophones japonais sont très nombreux. Dans un petit dictionnaire umlingue japonais de quelque 60 000 entrées, 36,4 96 des entrées ont des homophones,
200 DANIEL GILE
contre 11,6 96 des entrées en chinois dans un dictionnaire du même type (Hayashi 1982:132). Dans les langues occidentales, la proportion des homophonies est pour ainsi dire négligeable, comme on peut le constater en feuilletant les dictionnaires de langue. Les homophonies sont souvent mentionnées par les Japonais eux-mêmes comme des obstacles à la compréhension à 1 écoute (Ikeda 1982:654, Iwabuchi 1977:84, Kanno 1978:71, Kindaichi 1957:113, Oide 1965:81-82). Les interprètes citent souvent eux aussi de tels problèmes dans leurs écrits (voir par exemple Kuiiihiro, Nishiyama et Kanayama 1969, Kurita 1975, Muramatsu 1978, 1979). Dans certains livres de japonais, on trouve même des listes d'homophones courants posant des problèmes d'ambiguité en contexte; Ikeda (1982:698-708) en énumère quelque quatre cents.
Dans une étude sur la question, D. Gile (1986e) a interrogé des Japonais et des Occidentaux, interprètes et non-interprètes, sur la fréquence des problèmes posés à l'écoute par des homophones. Les réponses ont fait apparaître une fréquence plus élevée en japonais que dans les langues occidentales. Au cours de la même étude, Gile a fait lire à un locuteur natif devant des étudiants japonais plusieurs séries de kango ayant des homophones. Dans cette expérience, le plus souvent, les kango entendus hors contexte n'étaient pas reconnus de manière uni-voque comme des binômes mot-sens: soit ils n'ont évoqué aucun sens dans l'esprit de l'auditeur, soit ils en ont évoqué plusieurs, sans qu'il fût possible de les départager sans recours au contexte. Du fait que les homophones et les problèmes qui y sont associés sont nettement moins nombreux dans les langues occidentales, ces résultats sont compatibles avec l'idée d'une spécificité de l'interprétation par langues dans la composante lexicale.
3.2.2 Les redondances grammaticales
Dans la théorie de l'information, le concept de redondance joue un rôle important. Il s'applique à une 'information' qui n'en est pas une car son contenu figure déjà ailleurs dans le signal. La redondance est néanmoins utile, car elle renforce la probabilité de réception de l'information. En effet, elle donne au récepteur une 'deuxième chance' de capter une information perdue en raison d'une défaillance momentanée du système ou d'un 'bruit' (autre perturbation du signal ou des conditions de sa réception).
R E G A R D S SUR L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 201
En interprétation, étant donné la fréquence élevée des 'déclencheurs' et des saturations et déficits individuels qu'ils peuvent engendrer (voir Ch. 4), la redondance prend une importance particulière. D'une part, elle donne à l'interprète cette 'deuxième chance'; d'autre part, elle réduit la densité informationnelle du discours, et par là les besoins en capacité de traitement.
Une partie de la redondance intervenant dans le discours dépend du 'style' personnel du locuteur et du contexte qu'il y introduit. Toutefois, les redondances grammaticales, qui relèvent des 'informations induites par les contraintes linguistiques' (voir Ch. 5), peuvent elles aussi avoir une importance. considérable.
Les redondances grammaticales se manifestent essentiellement par les désinences (conjugaisons, déclinaisons et accords) et par les mots outils (articles, conjonctions, prépositions, pronoms, particules etc.), qui peuvent réitérer une information également donnée par d'autres élément du discours («NOUS commençONS, LA nouvELLE méthode, LES animAUX, etc.).
Dans cette optique, on est fondé à se demander s'il n'existe pas davantage de redondances phonétiquement détectables dans certaines langues que dans d'autres. Si une différence régulière et importante n'apparaît pas immédiatement entre les langues occidentales les plus utilisées en interprétation (anglais, français, allemand, espagnol), elle est très nette quand on compare ces langues avec le chinois ou le japonais. En japonais, il n'existe pas de déclinaisons, pas d'accords, les désinences verbales y sont peu nombreuses, les articles et pronoms relatifs y sont inconnus, sans que d'autres éléments grammaticaux viennent donner les mêmes renseignements. La redondance proprement grammaticale du japonais semble bien être inférieure à celle des langues occidentales.
3.2.3 Les structures de phrases
Par ailleurs, il semblerait que certaines structures de phrases facilitent la compréhension en augmentant la puissance d'anticipation du récepteur (lecteur ou auditeur), et que d'autres, telles l'enchâssement, y fassent obstacle, notamment en raison des besoins accrus en capacité de mémoire à court terme qu'elles impliquent (Richaudeau 1973, 1981). Or, les enchâssements sont plus ou moins fréquents selon les langues. Ils le
202 DANIEL GILE
sont plus particulièrement dans celles où le déterminant précède le déterrniné, comme le japonais.
En revanche, toujours en japonais, les fins de phrase sont souvent linguistiquement prévisibles, en ce sens qu'elles correspondent à des formules d'atténuation, de politesse ou de clôture grammaticale de la phrase annoncées par des 'prédicteurs' linguistiques. Au-delà de ces prédicteurs, les fins de phrase qui ne comportent aucune information nouvelle peuvent s'étaler sur de nombreuses syllabes : dans une étude de Gile (1992b), 46 % des phrases dans un corpus de 23 discours japonais authentiques se sont avéré avoir des fins de phrase prévisibles d'au moins 5 syllabes, et 9 % avaient des fins de phrase prévisibles d'au moins 8 syllabes. Dans un échantillon de 12 discours français et 10 discours anglais, ces fins de phrase étaient inexistantes. Dans un échantillon de 6 discours allemands, des fins de phrase prévisibles pour raison grammaticale ont été observées sur 12 96 des phrases. Toutes avaient une longueur inférieure ou égale à 5 syllabes et se composaient de verbes et de combinaisons de verbes. Compte tenu du débit moyen d elocution, qui est généralement considéré comme étant de l'ordre de 5 ou 6 syllabes par seconde (100 à 250 mots par minute), le répit ainsi donné à l'interprète travaillant à partir du japonais, qui s'étend souvent de une à trois secondes en comptant les pauses d'hésitation, constitue potentiellement un moment privilégié pour rattraper un retard dans la prise de notes en consécutive ou dans la production en simultanée. En outre, il est fort possible que sur un plan plus 'mécanique', l'anticipation permette de réduire sensiblement les risques de saturation en capacité de traitement et de déficit individuel (voir Ch. 4).
Sur ce plan précis, les différences de structures permettent peut-être des stratégies et tactiques différentes. Il est vrai que l'anticipation du discours est en partie indépendante de la langue. Ainsi, on peut anticiper la réaction affective d'un orateur à une remarque qui lui a été faite, sa position de principe sur différents points, sa stratégie discursive et jusqu'à l'articulation logique de son discours. Cependant, l'anticipation à dominante linguistique est elle aussi très importante, comme il est montré dans l'étude de Gile précitée. Dans le corpus étudié, seules des formules du type «Merci Monsieur le Président» ont pu permettre l'anticipation de la fin de phrase en français et en anglais. C'est là que prennent toute leur signification les fins de phrase prévisibles en japonais.
R E G A R D S SUR L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 203
3.2.4 Eléments culturels
La langue reflète aussi des comportements culturels qui sont susceptibles de faciliter, ou au contraire de rendre plus difficile la compréhension du discours pour l'interprète. Dans ce contexte, on évoquera une fois de plus le japonais, qui contraste dans son usage en communication avec les langues occidentales. Selon de nombreux auteurs japonais, les Nippons répugnent à prendre des responsabilités individuellement, ou à exprimer des opinions de manière trop claire ou tranchée. Parmi les nombreux ouvrages analysant les comportements culturels japonais, signalons deux textes intéressant plus particulièrement la traduction et l'interprétation, Condon et Saito 1974, et le numéro spécial de Meta 33/1(1988) sur la traduction et l'interprétation au Japon. Dans le discours des Japonais, on trouve de fréquentes formes atténuatives, qui peuvent exprimer aussi bien une atténuation de forme ou de politesse qu'un doute réel, sans que l'on puisse distinguer les deux, ainsi que des articulations logiques peu explicites, et plus généralement des phrases linguistiquement ou informationnellement elliptiques. En effet, dans la tradition japonaise, la communication interpersonnelle doit pouvoir se réaliser sans qu'interviennent les mots (voir Hara 1988, Kondo 1988, Mizutani 1985). En outre, les Japonais font preuve d'une très grande liberté dans l'emploi de leur langue, que ce soit sur le plan lexical ou sur le plan grammatical (voir Gile 1988d).
Ces manifestations linguistiques très connues des caractéristiques culturelles des Japonais sont abondamment commentées par les Japonais eux-mêmes, et notamment par des interprètes. Si, aux dires des Japonais, elles rendent parfois difficile la compréhension pour des auditeurs en situation ordinaire, il est probable qu'elles ont des effets plus importants encore sur la compréhension chez les interprètes en conférence, et ce en raison de l'infériorité de leurs connaissances extra-linguistiques pertinentes par rapport à celles des délégués.
3.3 Différences potentielles dans la production du discours
Ces différences concernent essentiellement la souplesse de construction de l'énoncé en langue d'arrivée, ainsi que la lar-
204 DANIEL GILE
geur de la gamme des choix possibles à chaque articulation .de la production.
Au niveau lexical, on peut parler d'un usage plus ou moins souple selon les langues. Si cet usage est relativement précis en français, i l lest très peu en japonais (voir Gile 1988d), et appelle peut-être un niveau d'effort différent dans révocation lexicale.
La richesse lexicale de la langue peut avoir elle aussi une certaine importance dans la production du discours, car elle détermine en partie les efforts requis pour le choix lexical. Quand les champs sémantiques ne concordent pas dans la langue de départ et dans la langue d'arrivée, on peut supposer un effort de prise de décisions accru, et éventuellement un effort supplémentaire d'explication ou de paraphrase.
La souplesse grammaticale dune langue peut elle aussi influer éventuellement sur la difficulté de production des énoncés. La question est de savoir dans quelle mesure chaque choix grammatical ou lexical dans une phrase restreint les choix suivants. L'allemand et le français, par exemple, présentent dans l'ensemble une succession de choix de plus en plus limités. En japonais, en revanche, i l peut y avoir des échappatoires' par rapport à la direction prise initialement, et ce jusqu'en fin de phrase.
La possibilité plus ou moins grande de construire la phrase en langue d'arrivée à partir d'éléments d'information recueillis dans le discours en langue de départ sans s'engager dans une direction précise facilite potentiellement l'Effort de production, ainsi d'ailleurs que l'Effort de mémoire, puisque l'interprète peut garder en mémoire à court terme une quantité d'information plus faible en moyenne que celle qu'il doit engranger quand il travaille vers une langue à constructions plus rigides.
Un autre élément pertinent est la longueur relative des énoncés pour une information donnée. Que ce soit en raison de la longueur des mots ou des structures linguistiques conditionnées par la grammaire, à contenu informationnel et communi-cationnel équivalent, les phrases dans une langue peuvent avoir une longueur habituellement supérieure ou inférieure aux phrases dans une autre langue. A titre d'exemple, les Japonais considèrent que le japonais est plus long' que l'anglais (Fukuii et Asano 1961), et le chinois est probablement plus court' que la plupart des autres langues. Cette différence peut rendre la production plus difficile dans la langue longue', ne serait-ce que par le simple effort articulatoire et sa durée supérieure dans les langues les plus longues', car elle peut avoir
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 205
des incidences sur la charge de la mémoire à court-terme de l'interprète (Ch. 4).
3.4 Les différences entre langue de départ et langue d'arrivée
Ce dernier élément appelle l'évocation d'un autre aspect des spécificités linguistiques potentielles de l'interprétation, à savoir les différences entre la langue de départ et la langue d'arrivée. Outre les différences dans la longueur moyenne des énoncés dans les langues concernées, on peut mentionner les éléments suivants :
— L'écart lexical entre langue de départ et langue d'arrivée : Cet écart peut être morphologique. Il tient alors principale
ment à l'existence ou l'absence de racines lexicales communes. Ainsi, les langues latines, les langues germaniques, et de manière générale, une grande partie des langues occidentales partagent de nombreuses racines gréco-latines qui diffèrent des racines des langues asiatiques. Quand les deux langues concernées dans une opération d'interprétation sont morphologiquement proches, les interprètes ont probablement davantage de facilité à comprendre le vocabulaire en langue de départ, même s'il est technique et relativement rare, et à évoquer les termes correspondants en langue d'arrivée.
La topographie sémantique des deux langues en présence peut également être plus ou moins proche, en ce sens que les champs sémantiques s'assemblent et se décomposent de manière plus ou moins similaire. Dans certains cas, le 'découpage' de la réalité par les deux langues est proche et permet l'évocation du sens d'un mot ou d'une expression par un mot ou une expression correspondants ; dans d'autres, les différences dans les 'découpages' oblige l'interprète à prendre des décisions d'approximation, qui lui coûtent peut-être davantage de temps et de capacité de traitement.
— Les différences grammaticales entre les deux langues : Sur le plan grammatical, les similitudes permettent de pro
duire des phrases présentant les informations dans un ordre similaire, alors que d'éventuelles différences obligent l'interprète à une gymnastique mentale qui modifie l'ordre des informations dans la langue d'arrivée et qui suppose un plus grand Effort de mémoire à court terme. Un cas particulier de ce problème est celui des noms propres dits composés' (voir Ch. 4).
206 DANIEL GILE
Il convient toutefois de préciser que si les similitudes entre langue de départ et langue d'arrivée sont susceptibles de faciliter la production ou de réduire l'Effort de mémoire à court terme, elles peuvent aussi favoriser le psittacisme et aggraver le risque d'interférences linguistiques (voir Fusco 1990).
Soulignons enfin que pour le moment, ces considérations restent théoriques. Si de nombreux auteurs les mentionnent sur une base intuitive ou anecdotique, rares sont les études qui ont mesuré les effets des différences interlinguistiques sur l'interprétation.
Le travail le plus vaste réalisé dans ce contexte est probablement celui de Heidemarie Salevsky (1983), de Berlin, qui a fait interpréter en allemand 35 textes lus représentant quelque 200 pages et une dizaine d'heures de transcriptions d'interventions russes faites à l'ONU, pour y étudier différentes structures russes ainsi que les structures utilisables pour leur restitution en allemand. Notons que l'étude est restée théorique, et que l'effet réel des différences entre les deux langues sur l'interprétation sur le terrain n'a pas été examiné.
A Trieste, Chiara Russo (1990) a étudié expérimentalement l'effet des différences syntaxiques hispano-italiennes sur l'interprétation simultanée de l'espagnol vers l'italien chez 6 interprètes professionnels, et a trouvé que certaines structures posaient des problèmes qui se traduisaient par des faiblesses dans la version italienne du discours.
Toujours à Trieste, Anna Giambagli (1990) a montré que les transformations syntaxiques opérées en consécutive pour le passage en italien sont plus nombreuses et plus complexes quand l'interprétation se fait à partir de l'anglais que lorsque la langue de départ est le français.
En Australie, H . Uchiyama (1992) a étudié quelques transformations syntaxiques nécessaires dans l'interprétation japonais-anglais, et P. Davidson (1992) a examiné la segmentation d'un discours japonais lors de son interprétation vers l'anglais par des étudiants.
Ces travaux restent anecdotiques, mais à terme, leur multiplication devrait permettre de parvenir à une image plus claire de l'effet réel des différences syntaxiques entre langue de départ et langue d'arrivée sur les performances de l'interprète.
Chapitre 9
La recherche en interprétation : données et stratégies
1. De la réflexion spéculative à la recherche empirique
1.1 Introduction
Les chapitres précédents font apparaître le caractère intuitif, réflexif ou théorique de l'essentiel de la recherche réalisée jusqu'ici en interprétation. En 1969, Ingrid Pinter soulignait dans sa thèse que les affirmations de, ses collègues praticiens sur l'aptitude à l'interprétation se fondaient exclusivement sur des descriptions et observations générales, qui reposaient sur l'expérience personnelle de leurs auteurs et qui n'avaient aucun poids scientifique. Dix ans plus tard, dans son mémoire de M A , la Canadienne Linda Anderson (1979) se référait à une affirmation de Hannah (1966) selon laquelle les interprètes pouvaient fonctionner de manière effective avec 60% de la teneur du discours de l'orateur, et observait que les publications sur l'interprétation abondaient en affirmations du même type sur la manière dont l'interprète arrive à faire son travail et sur les conditions favorisant ou constituant obstacle à la réalisation de sa tâche ; d'après Anderson, ces affirmations semblaient fondées intuitivement, mais restaient en grande partie non vérifiées' expérimentalement (1979:3). Dans un autre mémoire de M A , Catherine Stenzl de Londres (1983) met en exergue l'absence d'observations et de descriptions systématiques de l'interprétation telle qu'elle se pratique, par opposition à des réflexions « spéculatives ». Elle note qu'il est passionnant de se livrer à des spéculations sur les processus mentaux qu'implique l'interprétation, mais souligne que ces
208 DANIEL GILE
spéculations ne peuvent que soulever des questions. Pour y répondre, i l faudrait une base de faits plutôt que des hypothèses. Avant de pouvoir mettre au point des modèles un tant soit peu solides du processus d'interprétation dans son ensemble, i l faudrait disposer de modèles validés empiriquement de la compréhension et de la production du discours, ainsi que de la mémoire des discours (p. 47).
1.2 La réflexion spéculative dans la recherche sur l'interprétation
En fait, si la « littérature » sur l'interprétation comporte un grand nombre de textes de réflexion, à l'exception des études expérimentales des années 60 et du début des années 70, ainsi que d'un petit effort depuis la fin des années 80, elle ne rend compte que de très peu d'efforts d'investigation répondant à la « démarche scientifique ». Il suffit pour s'en convaincre de l'examiner au regard des deux critères suivants, qui se retrouvent dans la plupart sinon dans tous les ouvrages consacrés aux méthodes de recherche dans les disciplines scientifiques :
1. La recherche scientifique se fonde essentiellement sur des faits : « le progrès scientifique vient d'abord de l'accroissement du nombre des faits donnés, de l'accroissement du stock d'observations sur lequel l'hypothèse peut prendre appui » (Fouras-tié 1966:115).
On ne niera pas que les réflexions des interprètes ont à leur source des faits, mais, comme le soulignent Ingrid Pinter, Linda Anderson, Catherine Stenzl et bien d'autres, ces faits n'ont pas été recueillis dans le cadre d'une démarche systématique, puis vérifiés et évalués. Il s'agit plutôt d'observations faites au hasard des conférences, non notées, puis filtrées et interprétées en fonction des souvenirs et opinions de chacun, sans procédure de vérification. Une partie non négligeable des idées qui se sont cristallisées à travers ces processus pourraient relever du « terrorisme trompeur des faits et phénomènes fournis par l'expérience immédiate... l'empirisme naïf que le nouvel esprit scientifique a finalement reconnu comme l'un des obstacles les plus redoutables qu'il ait dû surmonter dans le champ des sciences du vingtième siècle » (Peraldi 1982 : 10).
2. Dans la recherche scientifique, les méthodes et raisonnements doivent être explicités pour le lecteur ou auditeur (selon
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 209
que le rapport est écrit ou oral), afin que celui-ci puisse les évaluer, notamment au regard de leur validité et de leur fiabilité, et procéder éventuellement à des replications d expériences pour en vérifier les résultats. Pour certains scientifiques, «le critère de la valeur scientifique d'une méthode restera nécessairement le caractère contrôlable des résultats qu'elle fournit » (Reuchlin 1969 :35).
Or, dans la plupart des textes sur l'interprétation, les méthodes et données sur lesquelles se fondent les idées exprimées ne sont pas explicitées. Ainsi, Catherine Stenzl (1983 :47) explique que dans son livre, M. Lederer (1981) ne reproduit pas l'ensemble des discours en langue d'arrivée de son corpus et ne donne que peu d'informations fondées sur le corpus dans son ensemble ; i l en résulte l'impossibilité d'évaluer la représentativité des passages dont elle parle.
Quelques exemples ' récents de cette caractéristique des textes sur l'interprétation peuvent être trouvés dans un ouvrage collectif de D. Seleskovitch et M . Lederer (1989), où les deux auteurs affirment notamment que « scientifiquement le cas est clair : dans tous les secteurs du langage on comprend plus qu'on ne peut exprimer... Dans une langue étrangère aussi, on peut comprendre beaucoup plus qu'on ne peut exprimer» (p. 135). On se demandera pourquoi «le cas » est si clair. On peut aussi contester l'affirmation sur la base de l'observation des apprenants de langues étrangères qui arrivent à exprimer un message en choisissant les mots et les structures qu'ils connaissent, alors qu'ils ne comprennent pas le même message formulé par un locuteur natif avec des mots et des structures choisis par lui et qu'ils connaissent mal ou ne connaissent pas. D. Seleskovitch et M. Lederer n'expliquent d'ailleurs pas d'où vient leur certitude « scientifique », et ne citent aucune étude et aucun auteur à l'appui de leur affirmation.
Autre exemple, à la fin du même livre, elles écrivent :
« Nous avons présenté dans cet ouvrage les principes et les méthodes qui constituent les fondements raisonnes de l'enseignement de l ' interprétation ; ... ces principes et ces méthodes ont subi le test irréfutable de la vérification empirique ; leur validité est at testée par la réussite des nombreux interprètes qui ont été formés à les appliquer et qui sont aujourd'hui au tout premier rang de leur profession » (p. 265).
Là aussi, aucun détail n'est donné sur le « test irréfutable de la vérification empirique », et i l est impossible à un • lecteur de
210 DANIEL GILE
réaliser une replication de la démarche qui a conduit D. Seleskovitch et M . Lederer à leur conclusion.
Enfin, dans la version publiée de la thèse de doctorat d'Etat de D. Seleskovitch (1975), différentes affirmations sont faites, dont l'idée selon laquelle
«... les orateurs qui formulent très rapidement ne gênent pas les interprètes, car un orateur rapide répète sa pensée ou l'explicite là où d'autres font des pauses, de sorte que l'on peut affirmer que la mat ière que traite l ' interprète, à savoir le sens, n'est pas proportionnelle à la quanti té de paroles prononcées par unité de temps, mais que la densité de l'information reste toujours à peu près la même... » (p. 116).
Des conversations avec de nombreux collègues interprètes nous donnent à penser que l'idée selon laquelle la rapidité du débit ne gêne pas les interprètes est loin d'être partagée par tous les professionnels. On notera aussi et surtout, sur le plan méthodologique, que l'affirmation sur la constance de la densité informationnelle du discours n'est pas appuyée par la présentation de faits ou de références.
Ces travaux ne sont pas dénués de valeur pour autant, comme il est expliqué plus loin, mais ils posent quelques problèmes à ceux qui souhaitent les utiliser comme fondement pour approfondir leur compréhension des processus de l'interprétation.
Comme il est expliqué au Ch. 3, la présence des affirmations spéculatives, notamment celles qui ne correspondent pas à l'expérience vécue de tous les interprètes, a des conséquences sur le statut de la recherche au sein de la communauté scientifique et au sein de la communauté des interprètes. Dans cette section, i l sera fait abstraction de cet aspect de la question en faveur d'une comparaison de fond entre les avantages et inconvénients respectifs de la démarche intuitive et spéculative et de la démarche scientifique dans leur application à l'étude de l'interprétation.
Plus concrètement, on est amené à se poser la question de savoir si une démarche exclusivement intuitive est utile dans l'exploration de l'interprétation même si elle ne répond pas aux critères de la recherche scientifique, ou si les règles de celle-ci sont indispensables à tout progrès véritable.
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 211
1.3 Réflexion spéculative contre recherche scientifique
La théorisation intuitive est fondée sur l'expérience. et les impressions personnelles, et n'est pas soumise aux règles de systématisation, de contrôle et d'objectivation qui font partie de la démarche scientifique. Contrairement à celle-ci, la spécu-. lation ne comporte donc pas de barrières institutionnalisées contre les dérives et les erreurs, et en cas d'erreur i l est difficile de remonter le raisonnement ou la procédure pour en trouver la source précise. Peut-on pour autant en déduire que les conclusions auxquelles conduit la théorisation intuitive sont moins Vraies' ou moins utiles que celles auxquelles amène la démarche scientifique ?
La réponse à cette question n'est pas simple. La recherche scientifique parvient, souvent à des conclusions analogues à celles de la théorisation intuitive, mais au prix d'un effort bien plus coûteux et d'un temps de cheminement bien plus long en raison des méthodes mises en œuvre : observation systématique consommatrice de temps et d'efforts, expérimentation, replication des expériences et tentatives de recoupement, vérifications multiples, prudence systématique dans les inferences et dans les conséquences tirées. Par ailleurs, en dépit des points et méthodes de contrôle intégrés dans la démarche scientifique, celle-ci n'est pas exempte d'erreurs, qu'elles soient dues à des méthodes ou équipements défectueux ou à l'effet du hasard, par exemple dans le tirage au sort intervenant dans les procédures d'échantillonnage et dans les inferences statistiques. Les erreurs humaines, de raisonnement, de manipulation, ou simplement de recueil de données, n'en sont pas absentes non plus.
La réflexion sur l'interprétation s'est d'abord imposée en raison des besoins liés à la formation : i l s'agissait de mieux comprendre ce qu'on allait enseigner pour pouvoir mieux l'enseigner. Les erreurs éventuelles n'avaient pas des conséquences aussi graves que des erreurs dans la conception d'un équipement médical ou d'une centrale électrique. En outre, le résultat pouvait toujours être contrôlé à travers les examens de diplôme des étudiants. En revanche, à l'époque, la progression dans la réflexion sur l'interprétation devait être très rapide, car les besoins en matière de formation étaient immédiats. La théorisation intuitive de Jean Herbert et d'autres pionniers a conduit les premiers enseignants à une conception de l'interprétation comme une activité intellectuelle fondée sur la compréhension à travers l'analyse, et sur la reformulation d'un
212 DANIEL GILE
message plutôt que d'un « texte ». Cette philosophie reste dominante dans l'ensemble des « grandes » écoles d'interprétation, où elle est à la base d'une orientation de la formation axée sur l'analyse du discours et sur la recherche du 'Message' plutôt que sur une démarche comparatiste. On objectera que la validité de cette orientation n'est pas démontrée. Il est possible que les méthodes pratiques qui en sont l'émanation ne soient pas les meilleures ; i l est possible que la domination de la 'théorie du sens' ait freiné le développement de méthodes plus efficaces. Néanmoins, cela n'empêche pas les écoles de former de bons interprètes. Les méthodes intuitives semblent favoriser une certaine discipline intellectuelle chez les étudiants, puisqu'elles insistent sur l'analyse et la prise de décisions, et réduire les interférences linguistiques dans le discours en langue d'arrivée, puisqu'elles bannissent le mot-à-mot et sensibilisent les étudiants à l'effet gênant pour l'auditeur d'un discours qui ne respecte pas le génie de la langue concernée. Il convient de tenir compte aussi du facteur historique. Quelles que soient les critiques que l'on peut formuler à l'égard des méthodes de la première génération des chercheurs interprètes, la cristallisation de la 'théorie du sens' est indissolublement associée au développement d'un mouvement universitaire puissant qui a renforcé le statut universitaire de l'interprétation de conférence ; dans les deux principales écoles en France, celle-ci est maintenant enseignée en tant que cursus de 3 e cycle. De même, l'impulsion qui a lancé le mouvement a également inspiré une grande masse de textes universitaires, dont plusieurs doctorats, et mis en ' marche un véritable mouvement de réflexion et de recherche sur l'interprétation, dont sont issus des chercheurs qui ont opté pour une démarche de recherche plus proche des principes admis plus généralement par la communauté scientifique. Le premier élan spéculatif de la réflexion sur l'interprétation a donc également eu cette fonction positive.
Néanmoins, i l semblerait qu'au delà des applications à la formation et de l'incitation à la recherche, la démarche intuitive n'ait pas beaucoup fait avancer la compréhension et la connaissance de l'interprétation et de ses mécanismes depuis vingt ans. Il apparaît dans les différents chapitres de ce livre que sur des questions accessoires comme sur des questions fondamentales, les avis divergent, et les débats n'avancent pas faute d'arguments nouveaux et de données empiriques à l'appui des affirmations et contre-affirmations des uns et des autres ; depuis les années 70, peu d'idées nouvelles sont apparues, même dans la démarche intuitive. Par ailleurs, les
REGARDS SUR LA RECHERCHE E N INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 213
modèles qui ont été constitués, notamment par B. Moser (1978) et par î). Gile, ne peuvent être testés et éventuellement rejetés ou améliorés sans l'apport de faits pertinents soigneusement recueillis et analysés.
C'est dans ce contexte qu'apparaît l'intérêt de la recherche scientifique de type empirique, avec ses avantages liés à sa progression contrôlable et fondée sur des faits systématiquement recueillis et analysés.
1.4 L interprétation comme objet de recherche
Par commodité, i l peut être intéressant de représenter l'interprétation comme un processus P avec une entrée E et une sortie S se déroulant dans un environnement donné (Fig.l). L'entrant' ('input' en anglais) est ce qui arrive vers lp processus pour être transformé par celui-ci, en l'occurrence le discours en langue de départ et tous les autres éléments d'information pertinents que l'interprète recueille pendant son travail. Le sortant' (output' en anglais) est ce que produit le processus, en l'occurrence le discours en langue d'arrivée.
Figure 1 : L'interprétation comme processus
A travers ce modèle, deux constatations s'imposent :
a. Dans le processus d'interprétation, l'entrant et le sortant peuvent être observés dans de bonnes conditions L'interprétation v est une action publique', qui peut être
observée par tout participant à la conférence concernée. Si certaines réunions ont un caractère confidentiel ou à participation restreinte, beaucoup d'entre elles sont accessibles à tout observateur au prix d'une inscription et d'un éventuel droit de participation. Par ailleurs, le processus d'interprétation est bien délimité dans le temps, se tient sur une période courte, en un
214 DANIEL GILE
lieu physiquement circonscrit : la salle de conférence en consécutive, et la cabine d'interprétation en simultanée. En outre, il est entièrement contenu dans le travail d'une personne. Quand un discours est interprété en plusieurs langues, i l y 3 autant de processus que d'interprètes actifs et que de langues d'arrivée. L'entrant se compose essentiellement du discours en langue de départ, des éventuels graphiques montrés sur écran (diapositives ou transparents), des éventuels supports écrits dont dispose l'interprète, de l'image de l'orateur et de l'image et des sons provenant de la salle tels que perçus par l'interprète. En mode simultané, le sortant se compose du son du discours en langue d'arrivée tel qu'il parvient dans le casque des délégués qui l'écoutent (théoriquement, s'y ajoute l'image de l'interprète en cabine, mais en général les délégués ne s'y réfèrent pas) ; en mode consécutif, i l se compose du discours verbal et des gestes et expressions faciales de l'interprète. Souvent, l'essentiel de l'entrant est circonscrit dans le son de la voix de l'orateur qui fait son intervention en langue de départ. C'est notamment le cas quand l'interprète ne le voit pas ou le voit mal, quand il ne dispose pas de documents écrits, quand i l n'y a pas de support graphique sur écran, quand la salle ne réagit pas de manière perceptible pour l'interprète, quand celui-ci ferme les yeux pour se concentrer.
En outre, si de nombreux interprètes considèrent que la vision directe de l'orateur et de la salle est importante, en ce sens qu'elle apporte des éléments non-verbaux qui servent à l'interprétation, et si ce point de vue a été officialisé par l'AIIC qui a incorporé dans ses contrats-type une clause dans ce sens, d'après deux études empiriques, cet apport visuel n'aurait pas nécessairement une importance significative, du moins dans certains types de discours et de circonstances (Anderson 1979, Balzani 1990).
Quoi qu'il en soit, la partie sonore de l'entrant et du sortant peut être observée (au sens large du terme) en totalité, et la partie visuelle peut elle aussi être observée dans de bonnes conditions. Qui plus est, la partie sonore de l'entrant et du sortant peut être enregistrée en totalité, et la partie visuelle peut elle aussi être, enregistrée dans de bonnes conditions par des caméras.
Au regard du processus étudié, ces conditions d'observation sont assez exceptionnelles dans les sciences comportementales, car la plupart des aspects du comportement humain sont difficiles à décrire et à enregistrer de manière un tant soit peu
REGARDS SUR LA RECHERCHE E N INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 215
complète en raison de leur caractère long, complexe, distribué dans l'espace et dans le temps, et difficile à circonscrire.
b. Le processus d'interprétation n'est pas facile à observer En traduction, une partie du processus mental se manifeste
concrètement par des actes de recherche documentaire et terminologique, de rédaction et de correction théoriquement observables (concrètement, la recherche documentaire et terminologique est difficile à observer en raison de sa distribution dans le temps et dans l'espace). Les TAP (Think Aloud Protocols), dans lesquels les sujets traduisent tout en commentant leur travail à mesure qu'il se déroule, donnent peut-être aussi un aperçu sur le processus, mais on ne sait pas dans quelle mesure ils sont représentatifs du processus et dans quelle mesure ils le modifient (voir notamment Toury 1991).
En interprétation,, la recherche documentaire et terminologique se déroule surtout en amont du processus central En consécutive, on peut observer la prise de notes. Mais les opérations de mémoire à court terme ne sont pas directement observables, et les opérations d'énonciation ne laissent apparaître que le résultat, une fois les décisions prises. Les incidents de parcours tels que les faux départs, les hésitations, les fautes et les maladresses donnent des indices pour l'analyse du processus, mais là aussi, celui-ci ne peut pas être directement observé.
Un certain nombre de règles normatives sur la qualité souhaitable du produit du processus, à savoir le discours en langue d'arrivée, ont été formulées par les praticiens : ce discours doit être « fidèle » au discours original, fidèle au génie de la langue d'arrivée, clair, logique, agréable à écouter. Des règles ont également été formulées pour la partie contrôlable et maîtrisable du processus : i l faut acquérir des connaissances utiles à travers une préparation ad hoc, prendre des notes de telle manière en consécutive, rester à telle 'distance' de l'orateur en simultanée, faire appel à telles tactiques en cas de difficulté (Ch. 5). Cependant, une grande partie du processus, notamment l'ensemble des opérations de décodage du discours en langue de départ, de stockage et de recherche d'informations dans la mémoire à court terme, de production du discours en langue d'arrivée, reste inconnue, précisément en raison de l'impossibilité de l'observer directement.
En réalité, même dans les conditions les plus banales de la vie courante, les opérations usuelles de compréhension et de
216 DANIEL GILE
production du discours sont loin d'être comprises. En interprétation, la situation se complique du fait de la simultanéité des trois Efforts, avec les phénomènes de coordination et de concurrence (interférences) qu'elle implique, outre la présence simultanée de deux systèmes linguistiques distincts dans le processus (Ch. 4).
2. Les problèmes de la recherche empirique en interprétation
Outre les problèmes liés à la nature du processus et le fait qu'il ne peut être observé directement, se posent des problèmes plus concrets d'ordre 'environnemental' :
2.1 La variabilité des situations
Parmi les variables affectant les rapports entre l'entrant et le sortant du processus, on peut citer à titre illustratif :
— La nature du couple langue de départ-langue d'arrivée : l'annuaire de l'AXIC fait apparaître comme langues de travail de ses membres plus de dix langues, dont le français, l'anglais, l'allemand, mais aussi le russe, le chinois, le japonais, l'arabe et l'hébreu, qui appartiennent à des familles linguistiques différentes. Si certains théoriciens pensent que le processus est identique quelles que soient les langues, d'autres sont convaincus du contraire (voir Ch. 8). Dans le doute, les échantillons devraient couvrir de nombreux couples de langues différents.
— Le sens du travail de l'interprète (vers une langue maternelle, vers une langue active non maternelle, à partir d'une langue maternelle, à partir d'une autre langue), ainsi que le degré de maîtrise qu'a l'interprète de chacune de ces langues.
— Le rapport entre l'information véhiculée par le discours et les connaissances pré-existantes de l'interprète, qu'elles soient spécialisées ou non, linguistiques ou extra-linguistiques. Ce rapport détermine en grande partie la capacité de traitement et le temps nécessaires au traitement de l'information, éventuellement les stratégies et tactiques qui seront employées, ainsi que la capacité de l'interprète de comprendre et d'anticiper.
— La personnalité, l'expérience et les facultés mentales et morales de l'interprète, et notamment sa motivation, sa conscience professionnelle, son endurance, son intelligence analytique, la capacité de sa mémoire à court terme.
— L'état de fatigue physique et nerveuse de l'interprète.
REGARDS SUR LA RECHERCHE E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 217
— Le type d'intervention, en fonction des intentions sous-jacentes de l'orateur, dû type de raisonnement, de la densité informationnelle du discours.
— Les conditions d'énonciation du discours : traits prosodiques, voix de l'orateur, son comportement face au microphone.
— L'environnement de travaû de l'interprète : aménagement de l'espace, aération, température (voir Kurz 19§3c,d), éclairage, position de la cabine par rapport à l'orateur, par rapport à l'écran, par rapport aux délégués.
— La composition de l'équipe d'interprètes, et notamment les relations entre ses membres.
En l'absence de données empiriques suffisantes, on ne sait pas dans quelle mesure la variabilité dans chacun de ces aspects affecte les mécanismes intervenant dans l'interprétation qualitativement et quantitativement. Toutefois, de' l'avis de nombreux interprètes, ces variables comptent, et i l semble prudent d'en envisager l'hypothèse dans toute recherche empirique (voir Gile 1991a). En conséquence, les projets de recherche doivent être - quantitativement importants par la taille des échantillons et par le nombre de replications nécessaires dans des environnements divers.
2.2 L'accessibilité des sujets
Or, comme il est expliqué au Ch. 6, si une base de faits quantitativement importante est nécessaire pour assurer la représentativité des résultats empiriques, on trouve d'importants obstacles psychologiques et pratiques qui rendent difficile la constitution d'échantillons nombreux ou de grande taille.
Ces difficultés sont l'une des raisons pour lesquelles les études empiriques sont peu nombreuses. Les rares travaux de ce genre réalisés dans le domaine de l'interprétation le sont généralement avec de petits échantillons (avec une exception, une étude faisant appel à un échantillon de très grande taille au Japon, dans Watanabe 1991), et quasiment sans replications.
Par ailleurs, la variabilité dans les différents aspects de l'interprétation, expliquée plus haut, est en grande partie une fonction géographique. Par exemple, à Bruxelles, la grande majorité des journées de travail sont effectuées sur place pour la Commission des communautés européennes, ce qui implique un certain type d'environnement, qui se caractérise notamment par l'interprétation pour des groupes multilingues
218 DANIEL GILE
dont les membres travaillent ensemble depuis longtemps et se connaissent bien. Aux Etats-Unis, l'essentiel du travail en dehors de l'ONU est bilingue ; i l est souvent réalisé pour le Département d'Etat, avec une grande part de consécutive. Au Canada, la combinaison est essentiellement bilingue français-anglais, avec de nombreuses conférences traitant de questions canadiennes plutôt qu'internationales, et de fréquents voyages. A Tokyo, i l existe un mélange de marché privé et de marché public, les principales langue de travail étant le japonais et l'anglais. En Israël, une très importante partie des conférences a une composante culturelle judaïque. Autant dire qu'il est très difficile, dans une démarche observationnelle ou naturaliste', d'assurer la représentativité des phénomènes relevés dans le cadre d'une étude par rapport à la population totale des interprètes et des conférences (voir aussi Ch. 6).
2.3 Un environnement professionnel peu incitatif à la recherche
Comme il est indiqué au Ch. 1, contrairement à la plupart des autres disciplines de recherche, pour lesquelles i l existe des infrastructures universitaires ou des structures spécifiques de recherche publiques ou privées, l'interprétation de conférence ne dispose quasiment d'aucune base de ce type.
On ajoutera que l'environnement professionnel n'est pas très incitatif lui non plus. En effet, de même que les traducteurs, la plupart des interprètes professionnels ont vis-à-vis de la recherche une attitude d'indifférence au mieux, et d'hostilité au pire (voir par exemple Gémar 1983, Komissarov 1985, Viag-gio 1988, Seleskovitch 1989, Sager 1992). Cette attitude peut s'expliquer en partie au moins par la nature des travaux réalisés jusqu'à présent. On trouve d'une part les recherches psychologiques et linguistiques qui portent sur des points précis dont les applications à la pratique ne sont pas directement visibles ou immédiates (voir Ch. 2). Par ailleurs, la précision même de la recherche et de la terminologie scientifique rendent la compréhension des travaux et de leurs résultats difficile aux non initiés (voir Moser-Mercer 1991). Quant à la recherche réalisée par les praticiens, elle est soit de type théorique, soit de type méditatif. Pour la partie théorique se posent une fois de plus des problèmes de compréhension de la part des collègues praticiens, auxquels s'ajoute l'absence d'applications à la pratique. Dans la partie reflexive, les idées des chercheurs ne se distinguent guère dans leur nature et dans leur pouvoir explicatif
REGARDS SUR LA RECHERCHE E N INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 219
de celles des praticiens, et l'auréole universitaire dont se sont parés les théoriciens sur la base de ces idées a pu irriter leurs collègues. En outre, comme i l est montré plus haut, certaines idées exprimées par les chercheurs-praticiens sont en contradiction avec celles de nombreux professionnels, et ne sont pas présentées avec l'appui de faits et de raisonnements suffisamment persuasifs pour convaincre les sceptiques.
2.4 L interdisciplinarité
Une autre difficulté de la recherche empirique sur l'interprétation a sa source dans la multiplicité des disciplines que concerne à l'évidence la transformation d'un discours en langue de départ en un discours en langue d'arrivée dans les conditions de la consécutive et de la simultanée. Comme i l apparaît tout au long de cet ouvrage, même dans une optique très interpréto-centrique, la psycholinguistique doit intervenir quand i l s'agit d'étudier la compréhension et la production du discours ainsi que les interférences entre langue de départ et langue d'arrivée, et la psychologie cognitive est la discipline la plus à même d'analyser les problèmes de capacité de traitement, et notamment de partage de l'attention. Pour rechercher des indices plus précis sur la charge mentale' qu'impliquent les contraintes de l'interprétation, i l paraît intéressant de se tourner du côté de la physiologie, qu'il s'agisse de la neurophysiologie, des phénomènes vocaux (Spiller-Bosatra et Daro 1992), oculaires (Tommola et Niemi 1986) ou autres. A un niveau comportemental plus général, i l est intéressant de cerner de plus près le profil psychologique que requiert l'interprétation, et d'étudier les mécanismes sociologiques de la communication interlinguistique en situation de conférence, compte tenu des différences culturelles entre les interlocuteurs, qui relèvent de l'ethnologie —sans oublier la linguistique, ne serait-ce que pour ses outils descriptifs et analytiques.
Certes, chaque chercheur a pour vocation de se spécialiser dans l'un des aspects de l'interprétation sans avoir nécessairement à en connaître les autres en profondeur. Néanmoins, s'agissant de l'étude du processus d'interprétation, qui se retrouve dans une grande majorité des travaux entrepris sur l'interprétation, une certaine familiarité avec la linguistique, la psycholinguistique et la psychologie cognitive s'impose.
Dès lors se pose la question de l'acquisition de ce savoir. Celle-ci peut s'envisager de trois manières :.
220 DANIEL GILE
— Par 1 autoformation du chercheur interprète. Possible dans le cadre d'une collaboration interdisciplinaire, elle est dans l'ensemble assez difficile d'abord pour le chercheur-interprète individuel s'il n'est pas guidé par un spécialiste.
— Par une formation complémentaire des interprètes chercheurs. Celle-ci n'existe pas encore, même dans les rares programmes de recherche en traductologie. Des propositions en ce sens sont faites plus loin.
— Par une démarche inverse, consistant à orienter en matière d'interprétation le chercheur 'extérieur', linguiste, psycholinguiste ou neurophysiologue. Comme il est expliqué dans les chapitres précédents, depuis le milieu des années 70, on ne trouve quasiment pas de membres de ces communautés scientifiques dans la recherche sur l'interprétation, bien que l'on recommence à voir depuis peu, notamment à Trieste, une collaboration entre interprètes et neurophysiologues.
2.5 La complexité du phénomène
Une autre difficulté qui se pose dans l'étude empirique de l'interprétation, et en particulier dans la recherche sur les processus, tient à la complexité de cette activité, dans laquelle i l est très difficile d'isoler des phénomènes. Par exemple, dans la production de son discours d'aboutissement, l'interprète peut s'aider, dans la recherche d'un mot ou d'une structure syntaxique, des mots et des structures du discours en langue de départ, de même qu'il risque d'en subir les interférences. Il est donc possible que les mécanismes entrant en jeu dans la production du discours en interprétation soient sensiblement différents de ceux qui se produisent en situation de communication unilingue (voir aussi les chapitres 4 et 8).
Il apparaît difficile d'appliquer directement à l'interprétation les résultats d'expériences réalisées en laboratoire dans un environnement où les contraintes sont très différentes de celles de l'environnement professionnel. De même, dans la réalisation d'études expérimentales, i l est assez difficile de s'assurer que la tâche confiée aux sujets, et en particulier les discours de départ manipulés dans lesquels sont contrôlées plusieurs variables, représentent effectivement une situation analogue à l'interprétation en situation professionnelle. Les interprètes ont été prompts à souligner, à propos des expériences des psychologues et linguistes au cours des années 60 et 70, que 1'« interprétation » de phrases isolées et de mots isolés ne met-
REGARDS SUR LA RECHERCHE E N INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 221
tait peut-être pas en jeu les mêmes mécanismes de compréhension et de production et les mêmes stratégies et tactiques que l'interprétation sur le terrain (voir Ch. 2). De même, un discours construit ad hoc par l'expérimentateur pour présenter certaines caractéristiques linguistiques et logiques, qui est lu en laboratoire, ne représente peut-être pas de manière adéquate un discours de conférence, notamment dans son vocabulaire et sa rhétorique, et ne déclenche peut-être pas les mêmes mécanismes de vérification, d'anticipation et de raisonnement par analogie. C'est la principale réserve que l'on opposera au travail expérimental de M . Dillinger (1989), très fouillé par ailleurs, mais construit exclusivement sur deux discours de ce type.
A mesure que la base de données disponible s'élargira, la pertinence ou non pertinence de chacun des éléments de l'environnement d'interprétation devrait apparaître plus clairement, mais i l semble risqué pour le moment de tirer des conclusions sur l'interprétation de conférence à partir d'expériences de laboratoires trop contrôlées'.
3. Perspectives et stratégies
Face aux difficultés énumérées plus haut, i l apparaît important de viser des stratégies spécifiques. En effet, aucun de ces problèmes n'a vocation à disparaître spontanément :
— La variabilité des situations et la complexité du phénomène sont intrinsèques.
' — L'accessibilité physique des interprètes pourra s'améliorer si le marché s'élargit, mais il n'y pas de raison pour que les facteurs limitant leur accessibilité psychologique et professionnelle disparaissent.
— La complexité de l'interprétation et la nécessité d'une démarche interdisciplinaire sont des données immuables ; les difficultés qu'elles impliquent ne s'atténueront qu'à la mesure des progrès réalisés dans la recherche.
— Enfin, i l apparaît que pour modifier la physionomie de l'environnement professionnel et universitaire qui entoure la recherche en interprétation, i l faudrait que celle-ci produise des résultats différents, ou qu'elle soit mieux expliquée aux communautés professionnelle et universitaire.
C'est pourquoi i l nous apparaît opportun de viser trois axes de progression stratégiques pour améliorer la situation :
222 DANIEL GILE
3.1 L'incitation à la recherche
Comme i l est expliqué dans les premiers chapitres de ce livre, la quasi-totalité des travaux théoriques et de recherche sur l'interprétation sont réalisés par des enseignants ; ce sont les plus motivés par la recherche du fait de l'environnement universitaire dans lequel ils se trouvent et de leur activité pédagogique, qui appelle des interrogations sur la nature des processus en jeu, sur les raisons des échecs et des succès, et sur les éventuelles méthodes permettant d'améliorer la prestation des étudiants et des professionnels.
Les étudiants eux aussi sont attirés par l'exploration de cette discipline qu'ils essaient de maîtriser, pour des raisons qui essentiellement ne sont pas très différentes de celles de leurs enseignants. Au cours de nos visites dans différentes écoles de traduction et d'interprétation d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Australie, nous avons presque toujours rencontré un très grand intérêt de la part des étudiants à l'égard des questions théoriques.
Il semble donc naturel de concentrer les efforts d'incitation à la recherche dans ce milieu relativement accueillant des écoles d'interprétation, d'autant plus qu'il se prête assez bien à d'éventuelles mesures de réorganisation favorisant la recherche, ce qui n'est pas le cas du milieu professionnel. Deux axes d'efforts nous semblent envisageables dans les écoles :
1. La sensibilisation à la théorie et à la recherche lors de la formation professionnelle initiale :
Actuellement, les écoles d'interprétation sont en grande majorité dirigées en étroite coopération avec des praticiens, et sont perçues comme ayant une vocation essentiellement professionnelle, et non pas universitaire. Dans cet esprit, elles forment à la maîtrise d'un savoir-faire, et non pas à l'acquisition de connaissances. Il s'ensuit que l'on ne saurait y consacrer trop de temps et d'efforts à la théorie et la recherche sans modifier sensiblement l'équilibre des programmes d'une manière incompatible avec leur fonction fondamentale. Un cours unique de sensibilisation à la réflexion sur l'interprétation nous semble toutefois acceptable, potentiellement utile et susceptible d'être bien accueilli par les étudiants s'il est bien conçu. Un tel cours existe d'ailleurs dans de nombreuses écoles (voir Ch. 7). Toutefois, n'y sont présentés que des concepts et des modèles théoriques, et non pas des considérations liées aux méthodes de recherche.
REGARDS SUR LA RECHERCHE EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE 223
En revanche, i l existe certaines écoles où l'obtention du diplôme de fin d'études requiert statutairement un projet donnant lieu à un mémoire. Ce projet de fin d'études est une bonne occasion de sensibiliser les étudiants à la recherche. Comme i l est indiqué au Ch. 3, à l'occasion de ces projets ont été réalisés un certain nombre de travaux qui ne sont pas sans valeur, et qui ont donné le goût de la recherche aux étudiants et valorisé les écoles concernées sur le plan universitaire. Il nous semble que cette direction est prometteuse.
2. L'introduction de normes de qualification universitaire. et d'exigences de recherche dans les écoles d'interprétation :
A l'heure actuelle, l'accès à des postes dans une grande partie des écoles d'interprétation n'est pas subordonné à une qualification universitaire de haut niveau telle qu'un doctorat. Rien n'indique que la qualité de la formation des étudiants à l'interprétation en souffre, mais la situation n'est pas favorable à la recherche. Nous n'envisageons pas le doctorat obligatoire pour l'ensemble des enseignants ; une telle condition serait fort démotivante pour les praticiens ayant vocation d'enseigner, et priverait les écoles de leurs forces vives. Toutefois, l'institutionnalisation d'une qualification universitaire pour quelques postes, comme c'est notamment le cas à l'ESIT, nous semble souhaitable. Elle aurait l'avantage supplémentaire et non négligeable de stabiliser' les interprètes à vocation pédagogique et de recherche dans une véritable carrière universitaire, leur permettant ainsi de consacrer davantage de temps et d'efforts à l'enseignement et réduisant d'autant les problèmes d'organisation plus ou moins graves qui se posent dans les écoles à effectifs exclusivement 'free lance'. Encore faudrait-il que ce soient des interprètes-chercheurs qui soient nommés à ces postes. Si, faute de candidats interprètes, ce sont des universitaires étrangers à l'interprétation qui les occupent, le résultat aura été contraire à l'effet souhaité. D'où l'importance d'une stratégie générale d'incitation à la recherche auprès des praticiens. •, • .
Par ailleurs, on notera que les écoles d'interprétation universitaires sont institutionnellement et physiquement proches des centres de recherche universitaires, et qu'elles sont bien placées pour entretenir des contacts avec les chercheurs dans les disciplines intéressant l'interprétation. Elles partagent parfois les mêmes bibliothèques, et peuvent négocier l'accès pour leurs étudiants et enseignants aux bibliothèques spécialisées. De même, elles peuvent inviter des chercheurs linguistes, psy-
224 DANIEL GILE
chologues ou autres à présenter des conférences, et organiser éventuellement des journées d'information interdisciplinaires. Nous avons pris part à quelques réunions de ce type, et avons constaté des réactions positives de la part des participants. Ces actions de sensibilisation pourraient avoir un effet à long terme.
Deux autres stratégies d'incitation à la recherche nous semblent importantes. L'une est un effort d'information, destiné aux praticiens, et visant à leur expliquer l'intérêt de la recherche en dépit de l'absence de résultats applicables à court terme. Il s'agit de créer un environnement moins hostile et de susciter d'éventuelles vocations. A cet égard, le rôle de la Commission de la recherche, voire de la Commission de la formation de l'AnC, qui, appartenant à un important organisme professionnel, s'occupent de recherche et de formation, semble particulièrement intéressant. Par ailleurs, dans l'orientation des futurs chercheurs, i l convient de veiller à la qualité des projets réalisés, et, dans la mesure du possible, de suggérer aux étudiants des sujets plus concrets que théoriques. De toute évidence, cette incitation ne saurait être restrictive, et des étudiants ou chercheurs motivés par un thème relevant de la recherche fondamentale devraient également être encouragés à l'aborder. Cependant, s'agissant de personnes n'ayant pas encore porté leur choix sur un sujet, des suggestions concernant des recherches ayant une application pratique présentent un double avantage : elles sont motivantes, et pourraient aider à modifier l'image de la recherche que se sont fait de nombreux interprètes. Des exemples de projets ayant une application pratique sont donnés à la Section 3.3.4.
3.2 La formation
C'est dans le domaine de la formation que se situe probablement le plus grand potentiel de développement de la recherche.
Rappelons que parmi les principaux problèmes dont souffre la communauté des praticiens-chercheurs en matière d'interprétation figurent leur faible compétence en matière de méthodes de recherche et leur manque de connaissances dans les disciplines pertinentes. Là aussi, c'est dans le cadre des écoles que l'on peut rechercher prioritairement des solutions. L'action requise est double : i l s'agit d'une part d'une formation à la recherche en tant que telle, et d'autre part de l'acquisition des éléments de connaissance thématiques les plus utiles à la recherche sur l'interprétation.
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 225
Dans la recherche intervient au niveau le plus fondamental la « démarche scientifique », à laquelle sont superposées les techniques appropriées. Dans la plupart des disciplines scientifiques, les deux sont enseignées dans un même cursus. Le caractère interdisciplinaire de l'interprétation fait que la chose y est plus difficile : les techniques. utilisées en linguistique, en psychologie cognitive et en neurophysiologie sont variées et assez nombreuses. C'est pourquoi nous préconiserons une formation de base, axée sur les méthodes de recherche dans les sciences sociales (psychologie, sociologie, sciences de l'éducation), suivie éventuellement d'un perfectionnement spécialisé selon les besoins des projets des chercheurs.
Cette formation pourrait être recherchée initialement dans un département universitaire spécialisé dans les sciences sociales. Une fois une certaine compétence acquise par les interprètes issus de ces premières promotions, ceux-ci pourraient assurer une formation adaptée aux besoins spécifiques de la recherche sur l'interprétation dans le cadre de l'école où ils enseigneraient.
Etant donné la vocation essentiellement professionnelle des écoles d'interprétation, i l nous semble peu souhaitable de proposer la formation à la recherche aux étudiants en interprétation préparant leur diplôme professionnel. Elle interviendrait plutôt en option, pour les candidats à un diplôme universitaire de haut niveau. Le principe du programme doctoral parallèle à la formation professionnelle, adopté par l'ESIT à Paris, nous semble intéressant en ce sens qu'il est accessible aux étudiants inscrits en interprétation ainsi qu'à des candidats extérieurs au programme professionnel.
Sur le plan formel, le programme proposé dans les écoles d'interprétation pourrait se composer d'une formation de base d'un an, sanctionnée ou non par un diplôme (le D.E.A. en France), et d'un perfectionnement d'un an accompagnant la préparation du projet de recherche individuel, mémoire ou thèse. Le programme s'articulerait par exemple comme suit :
Première année — Un cours de méthodes de recherche, où seraient ensei
gnées la « démarche scientifique » et des techniques de base. Il existe de nombreux livres sur les méthodes de recherche dans les sciences sociales que l'on pourrait utiliser à ces fins au prix d'une légère adaptation (voir par exemple Babbie 1992, Frankfort-Nachmias et Frankfort 1992, Robert 1988).
226 DANIEL GILE
— Un cours parallèle présentant de manière critique la recherche réalisée dans le domaine de l'interprétation.
— Une série d'exercices d'application, essentiellement des replications d'études observationnelles et expérimentales.
— Le cas échéant, l'acquisition, dans un département universitaire ou un centre de recherche approprié, de connaissances thématiques spécialisées.
Deuxième année — Un séminaire dans lequel seraient discutés en classe lors
de réunions périodiques l'ensemble des projets des étudiants, selon leur état d'avancement.
— Le perfectionnement thématique et le perfectionnement technique dans les méthodes de recherche appropriées auprès d'un département universitaire ou d'un centre de recherche approprié.
3.3 Les stratégies de recherche
Etant donné l'ensemble des problèmes présentés dans les chapitres précédents, en attendant que la recherche sur l'interprétation arrive à maturité et prenne véritablement son essor, un certain nombre de stratégies nous semblent propres à faciliter la progression, surtout s'agissant des praticiens chercheurs :
3.3.1 De petits projets
En raison des problèmes évoqués plus haut, notamment les problèmes de formation à la recherche, de disponibilité des chercheurs praticiens et d'accès à des sujets, une proportion non négligeable des projets de mémoire et de thèse choisis par les étudiants n'aboutissent jamais. L'un des moyens susceptibles de réduire la proportion de ces échecs consisterait à orienter les jeunes chercheurs sur de petits projets, qui nécessitent de petits échantillons et un travail de durée limitée.
En limitant l'ambition des projets de recherche, on réduit certes la portée potentielle de chaque projet individuel, mais en augmentant probablement ses chances d'aboutissement. L'effet escompté est double : d'une part, augmenter la masse des travaux achevés dans le domaine de l'interprétation, et d'autre part, motiver davantage chaque chercheur à travers un premier succès. Une telle stratégie ne se justifiera peut-être plus
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 227
quand la recherche sur l'interprétation aura beaucoup progressé, car i l ne sera peut-être plus possible d'apporter une véritable contribution sans un projet d'envergure, mais dans la situation actuelle, même de petits projets peuvent apporter des faits nouveaux et intéressants.
3.3.2 Des projets méthodologiquement simples
En raison de l'absence d'une formation spécifique à la recherche de la plupart des praticiens-chercheurs, leurs travaux présentent souvent des faiblesses méthodologiques (voir notamment Gile 1991a). Une partie de ces faiblesses sont attri-buables à un manque de discipline et de rigueur dans le raisonnement, et peuvent être prévenues par une formation appropriée telle que présentée dans la Section 3.2. Il existe par ailleurs des problèmes plus techniques, relevant notamment des méthodes d'analyse statistique et des plans expérimentaux complexes destinés à démêler des enchevêtrements d'influences entre variables. Pour résoudre correctement de tels problèmes, i l est indispensable d'avoir une solide expérience des méthodes de recherche ou de faire appel à un spécialiste. Or, de tels spécialistes n'existent pas encore parmi les chercheurs en interprétation. Il nous semble donc préférable d'éviter des projets ambitieux comportant de tels obstacles, qui présentent en outre l'inconvénient d'être longs, donc en contradiction avec le premier principe présenté ci-dessus.
Plus précisément, dans la recherche par les praticiens chercheurs, nous pensons que l'expérimentation classique avec tests d'hypothèses par statistiques inférentielles ne doit être entreprise que sous la direction d'un spécialiste chevronné ayant une grande expérience de la recherche expérimentale et une bonne compréhension des méthodes statistiques. Quand un tel guide n'est pas disponible, i l nous semble préférable de s'en tenir à des techniques de statistique descriptive élémentaires.
3.3.3 La replication
Etant donné la faiblesse de la base factuelle existante dans la recherche sur l'interprétation, i l nous semble particulièrement important d'encourager la replication de projets empiriques, tant observationnels qu'expérimentaux.
228 DANIEL GILE
Or, la replication, ne comportant pas d'innovation, est peu attrayante pour le chercheur. Compte tenu des problèmes de motivation se posant dans la recherche sur l'interprétation, il importe de rechercher des mesures incitatives particulièrement fortes. C'est là qu'interviennent une nouvelle fois les écoles et les programmes de formation à la recherche, qui devraient à notre avis comporter obligatoirement des exercices de replication.
Notons à ce propos que la replication, outre son caractère indispensable dans la recherche empirique, a également une grande importance pédagogique. En effet, elle permet aux étudiants de se familiariser avec la pratique des méthodes de recherche sans les faire passer par de longues étapes de conceptualisation. Par ailleurs, à travers la réalisation de la replication et la comparaison avec le projet initial et d'autres replications éventuelles, les étudiants peuvent noter les faiblesses du travail initial et des textes qui en rendent compte, et développer ainsi leur sens critique.
3.3.4 Exemples de projets pour étudiants et praticiens débutant dans la recherche
A titre illustratif, nous présentons ci-dessous trois types de projets empiriques qui nous semblent réalisables par des débutants et qui correspondent aux critères énoncés plus haut.
a. Etudes terminométriques et lexicométriques :
On ne sait pas quels sont les termes et les unités lexicales non techniques (il s'agit du langage non spécialisé tel que défini au Ch. 8) les plus fréquemment employés en conférence dans différents domaines. S'il existe de nombreux lexiques et dictionnaires, aucun ne donne la fréquence relative des termes qui y figurent. Or, de telles informations peuvent permettre de cerner un vocabulaire minimum à enseigner aux étudiants ou à acquérir pour une conférence dans un domaine donné. L'enregistrement de conférences entières et leur dépouillement permettent de recueillir des informations potentiellement utiles là-dessus. Accessoirement, en procédant à ce genre d'exercice, méthodologiquement très simple bien que • très prenant en temps, les étudiants et praticiens peuvent se familiariser eux-mêmes avec les lexiques spécialisés des domaines concernés.
R E G A R D S S U R LA R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 229
b. Etudes sur les glossaires dans le cadre de la préparation de conférences : Les études sur les glossaires sont un bon exemple de projets
simples, de petite taille et utiles, en ce sens qu'elles améliorent les connaissances terminologiques du chercheur dans le domaine concerné au cours de son travail sur le corpus, et qu'elles sont susceptibles d'aider à dégager des stratégies et tactiques utiles pour leur préparation.
Citons, parmi les questions auxquelles on peut tenter de répondre à travers de telles études, les interrogations suivantes : Quelle est la taille moyenne d'un glossaire et quelles en sont les variations ? Quelle en est la taille utile (problèmes de complétude, de vitesse de consultation, de proportion de termes notés et non utilisés, de termes utilisés en conférence et non trouvés lors de la préparation) ? Quelle est la durée de sa préparation ? Quelle en est la fiabilité ? Dans quelle mesure les glossaires sont-ils transférables d'interprète à interprète et de conférence à conférence ? Comment améliorer cette transférabilité ? Quelle est la présentation optimale d'un glossaire (tri alphabétique, classement sémantique, noms propres et sigles séparés, etc.) ? Comment l'améliorer ?
Ces études sont essentiellement fondées sur l'observation de la pratique professionnelle. Elles peuvent également faire l'objet d'exercices pédagogiques en classe, où seraient comparées différentes stratégies et différentes sources au regard d'un exercice d'interprétation réalisé par la suite. Le Ch. 14 de Gile 1989a présente un exemple de projet de ce type sous sa forme la plus simple d'étude de cas.
c. Fautes de langue : Si l'existence de fautes de langue en interprétation est
connue, personne n'a recherché systématiquement des régularités qui permettraient de concevoir des stratégies correctrices.
Un travail de redherche relativement simple et potentiellement très utile pour les étudiants en interprétation consisterait à repérer, à classer et à compter les fautes de langue commises lors d'exercices d'interprétation, en recherchant notamment des régularités dans les types de problèmes survenant dans la langue active non maternelle des étudiants en fonction de leur langue maternelle (fautes de langue typiques des étudiants anglophones en français, des étudiants francophones en allemand, etc.).
230 DANIEL GILE
Signalons que si la démarche fondamentale dans une telle exploration est simple, sa réalisation pose des problèmes méthodologiques qui le sont moins, notamment en matière de définition opérationnelle des fautes de langue, car les normes d'acceptabilité linguistique sont. plus difficiles à cerner dans l'oral que dans l'écrit (voir Gile 1985a).
3.3.5 Une recherche interdisciplinaire
Depuis la conférence de Venise de 1977 (Gerver et Sinaiko 1978), de nombreux appels à la collaboration interdisciplinaire ont été lancés, notamment par les organisateurs de la conférence de Trieste (Gran et Dodds 1989) et par E. Arjona-Tseng (1989), qui souligne, comme nous le faisons dans ce livre, que les interprètes n'ont pas les connaissances et le savoir-faire scientifiques nécessaires à l'exploration des mécanismes en jeu. Comme le montre l'examen des problèmes survenant dans la formation et dans la pratique de l'interprétation, la recherche sur les processus impliqués ne saurait se passer de l'apport de la psychologie cognitive et de la psycholinguistique, et les perspectives sont également très intéressantes du côté de la neurolinguistique. On peut aussi espérer un important apport de la sociologie, voire de l'ethnologie, à l'étude de la communication à travers l'interprétation, qui a une grande importance pour la compréhension de la qualité du travail.
Un autre élément qui nous semble capital est celui du recul du chercheur par rapport à l'objet de sa recherche. Si, dans toute recherche scientifique, un tel recul ne peut être que relatif pour des raisons psychologiques tenant à la motivation même du chercheur, i l nous semble que dans le cas de l'interprétation, l'engagement affectif des praticiens est particulièrement fort. D'une part, comme i l est expliqué dans les chapitres précédents, les interprètes-chercheurs ne sont pas des chercheurs professionnels. L'activité de recherche chez eux correspond à une motivation particulièrement forte. La plupart d'entre eux enseignent également dans des écoles dont le statut universitaire est plutôt faible. Dans ces conditions, on peut raisonnablement s'attendre à un biais important dans leur recherche dans le sens d'une surévaluation des performances. G. 11g (1980) et C. Stenzl (1983) parlent d'une attitude défensive des interprètes. Selon Stenzl (1983 :42),
« We are quite pleased when psychologists confirm that ours is a
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 231
complex job which requires a number of highly developed skills, but we are perhaps less inclined to document the limits of our skills and to face the occasions when we did not properly understand a speaker or were unable to adequately render a message even if we had understood it ».
M . Shlesinger va plus loin (1989 : 8) :
« Those describing interpretation from the practitioner's standpoint are sometimes prone to a certain lack of detachment which surfaces in these writings in the form of a sense of awe at an impossible job incredibly done ».
Par ailleurs, étant donné leur activité de praticiens, ces chercheurs ne sont pas libres de rendre compte de toutes leurs pensées et de tous les résultats de leurs recherches, sous peine de se brouiller avec une partie de leurs collègues et de perdre une partie de leur travail.
C'est pourquoi l'intervention de spécialistes non interprètes semble fortement indiquée. L'expérience montre toutefois que le travail avec ces spécialistes ne va pas sans difficultés. D'une part, les spécialistes ne connaissent en général pas l'interprétation et la voient uniquement sous l'angle de leur discipline, d'où des divergences de vue de deux types :
— Différences méthodologiques, les spécialistes ne comprenant pas les contraintes qui limitent l'efficacité, voire la validité de leurs méthodes et procédures dans l'étude de l'interprétation.
— Différences dans les centres d'intérêt :. certains phénomènes qui paraissent intéressants, voir très importants pour les interprètes, notamment ceux qui ont trait à l'amélioration de leurs performances dans la pratique, peuvent paraître dénués de tout intérêt aux yeux des psychologues ou linguistes.
Du côté des interprètes, outre la faible disponibilité pour la recherche, évoquée au Ch. 1, se pose le problème du niveau nécessairement faible des connaissances dans le domaine des spécialistes avec lesquels on cherche à coopérer. Cette difficulté est d'ailleurs classique dans tout travail interdisciplinaire, le spécialiste étranger' ayant nécessairement une connaissance du domaine voisin inférieure à celle de ceux qui y travaillent régulièrement. Dans le cas de l'interprétation s'ajoute une difficulté supplémentaire du fait que le chercheur interprète n'a pas de spécialité scientifique propre qui le mette en position d'égalité, ou même en position de respectabilité scientifique vis-à-vis des spécialistes à qui i l s'adresse. Il en résulte une dif-
232 DANIEL GILE
ficulté dans le dialogue, dans la mesure où à moms d'avoir l'esprit particulièrement ouvert, les spécialistes en question auront tendance à accorder peu de crédit aux idées du praticien.
L'amélioration de la situation passe à notre avis par des activités de formation telles qu'évoquées dans la Section 3.2, ainsi que par un travail interdisciplinaire à deux vitesses :
— Des projets conçus et pilotés par les spécialistes, où les interprètes servent de consultants pour les aspects professionnels. On voit de tels exemples dans Tommola et Niemi (1986), ainsi que dans Kurz 1993.
— De véritables projets interdisciplinaires, quand le niveau de connaissances et de savoir-faire de l'interprète rend la chose possible.
En tout état de cause, actuellement, i l nous semble important que tout chercheur non-interprète entreprenant un travail sur l'interprétation consulte des interprètes, et ce non seulement sur les aspects de la pratique professionnelle, mais également sur des questions méthodologiques, afin d'éviter les erreurs qui ont été commises systématiquement par le passé.
3.4 Stratégies de communication
3.4.1 La communication avec la profession
Etant donné la forte dépendance des chercheurs à l'égard des praticiens, i l semble important de modifier quelque peu le climat d'indifférence, voire d'hostilité qui règne actuellement au sein de la profession à l'égard de la recherche. Un effort de communication paraît utile dans ce sens. Or, les praticiens chercheurs sont par définition fortement intégrés dans le corps professionnel des interprètes ; en outre, i l existe depuis plusieurs années une Commission de la recherche au sein de l'AIIC, et le Bulletin de l'AIIC publie des articles*et comptes rendus sur la recherche, sans que cela semble avoir changé les choses. On notera d'ailleurs une situation analogue dans le domaine de la traduction, où i l existe également des praticiens chercheurs et des revues professionnelles qui publient des articles de recherche.
Il nous semble qu'un véritable changement n'interviendra peut-être que lorsque la recherche comportera davantage de projets pratiques' et qu'elle produira plus de résultats applicables, ou au moins reconnus par la communauté scientifique,
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 233
ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Peut-être un contact avec la recherche lors de la formation initiale à l'école (voir Section 3.2 plus haut) est-il également susceptible d'apporter une contribution dans ce sens. L'effort de communication avec la profession devra toutefois être poursuivi par ailleurs.
3.4.2 La communication avec la communauté scientifique
Une telle communication est une partie intégrante de l'effort d'ouverture interdisciplinaire qui doit être entrepris par les praticiens chercheurs pour dépasser les limites de compétence qui les freinent encore. A l'heure actuelle, les praticiens chercheurs ne sont pas en mesure d'apporter à ces spécialistes des éléments factuels ou théoriques suffisamment solides. Au regard de la collaboration scientifique, ils se trouvent donc essentiellement dans une position de demandeurs. En revanche, ils peuvent proposer aux scientifiques :
— Un champ d'investigation peu exploré — Un appui logistique sous la forme d'informations pratiques
et de mise à disposition de volontaires pour des travaux, ainsi que de matériel et matériaux (cabines, discours enregistrés ou transcrits, etc.)
— Un savoir-faire professionnel et des intuitions souvent très fortes concernant le fonctionnement de l'interprétation.
La forme de coopération la plus naturelle à l'heure actuelle nous semble être celle où le spécialiste conçoit et réalise. L'interprète, quant à lui, a un rôle parfois très important dans la préparation matérielle et intellectuelle du projet, et peut notamment exercer un droit de regard sur certains choix méthodologiques ; néanmoins, i l reste un peu en retrait (voir Section 3.3.5 çi-dessus). C'est également cette modalité de progression, où les résultats sont publiés par les spécialistes, dans leur langage et dans leurs revues, qui permet probablement la meilleure diffusion de l'information sur la recherche en interprétation au sein de la communauté scientifique. Quand un nombre suffisant d'interprètes auront acquis les connaissances et le savoir-faire nécessaires, des rôles plus équilibrés, voire des projets indépendants entièrement conçus et réalisés par des praticiens chercheurs, pourront assurer une communication suffisante.
234 DANIEL GILE
3.4.3 La communication au sein de la communauté des praticiens chercheurs
Cependant, laxe de communication le plus"important au stade actuel est très probablement celui de la communication interne. On se rappellera l'isolement des chercheurs qui a caractérisé la période dite « des praticiens » (Ch. 2) pendant les années 70 et jusque vers le milieu, voire la fin des années 80, ainsi que la stagnation à laquelle i l a été associé. On évoquera aussi l'évolution depuis le début de la période de renouvellement, au cours de la deuxième moitié des années 80, avec la Commission de la recherche de l'AIIC, la revue The Interpreters Newsletter de l'école de Trieste, et l'IRTIN. Etant donné la petite taille et la dispersion géographique de la communauté des praticiens chercheurs, i l nous semble que la communication entre eux a une importance vitale pour une progression de la recherche de type scientifique, tant au regard de l'information, qui est une partie essentielle de cette progression, que de la motivation. C'est pourquoi nous attachons une grande importance aux véhicules de communication que sont les bulletins et revues spécialisés, ainsi qu'à la participation de chercheurs interprètes à des colloques de recherche.
Conclusion
Comme i l était annoncé dans l'Introduction à cet ouvrage, i l apparaît qu'après une quarantaine d'années de progression, la recherche en interprétation en est encore à ses premiers pas', avec de nombreuses ouvertures théoriques, mais bien peu d'exploitées, ne serait-ce que partiellement.
Face à • la mosaïque existante, certains, comme F. Pöch-hacker (1992), C. Stenzl (1983) et H. Salevsky (1987) déplorent l'absence de cohérence dans la recherche, craignent la dispersion des efforts et proposent des cadres théoriques intégrateurs, essentiellement dans le cadre d'une théorie globale de la traduction (Allgemeine Translationstheorie). A la lecture de leurs textes, qui ne contiennent que des considérations générales bien que fort pertinentes, sans propositions concrètes et précises, on peut craindre que ces structures soient trop vastes, trop éloignées de la vérification empirique, qu'elles restent insuffisamment dynamisantes et productives.
Nous pensons plutôt que la progression gagnera à s'appuyer sur des travaux empiriques, qui permettront de constituer une base factuelle, de vérifier des hypothèses, d'en élaborer de nouvelles. A terme, la mosaïque devrait se transformer en un ensemble plus ' cohérent, car le nombre de questions fondamentales qui se posent est relativement limité, et les faits recueillis dans des études spécifiques auront probablement des incidences qui déborderont de leur cadre d'origine. Cependant, la recherche empirique pose les problèmes de disponibilité et de motivation que l'on sait. Nous proposons d'y répondre, au moins partiellement, par les stratégies évoquées au Ch. 9..
236 DANIEL GILE
Quelles sont les perspectives de progression dans la recherche en interprétation telles qu'elles apparaissent actuellement ?
A travers l'analyse faite dans ce livre, on voit apparaître deux types de centres actifs:
— Ceux qui opèrent véritablement en tant que groupes, avec une interaction productive entre les membres. C'est notamment le cas des centres où la recherche est intégrée dans la formation (tels l'école de Trieste). Dans ce premier cas de figure, c'est le système qui assure la continuité. L'interaction prend aussi d'autres formes, notamment autour d'une personnalité, même quand l'infrastructure institutionnelle est absente ou faible ; tel est le cas à la Interpreting Research Association of Japan, animée par M . Kondo.
— Les 'centres' qui peuvent se définir tels quels sur le plan géographique, mais où l'interaction entre les chercheurs est faible, sinon inexistante. C'est le cas en Australie, au Canada, en Espagne, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse.
Seul le premier de ces modèles, celui où la recherche est intégrée dans la formation, nous semble porter en lui les éléments d'une continuité structurelle. Dans le deuxième cas, la productivité du centre dépend très fortement des activités individuelles d'une ou plusieurs personnalités centrales, et risque de se désintégrer s'ils cessent leur activité de recherche, la continuité ne pouvant être assurée que par d'éventuels successeurs, à travers un fragile système de filiation. Le devenir des centres diffus du troisième type est encore plus aléatoire.
De manière plus générale, i l semble raisonnable de postuler un certain nombre de conditions à une activité de recherche suivie en matière d'interprétation dans un centre donné :
a. L'existence d'un marché local de l'interprétation: Ce marché est important dans la mesure où i l assure des
possibilités d'observation sur le terrain. Un marché inexistant ou trop petit limite celle-ci, d'où une aggravation des problèmes d'échantillonnage, voire d'accès aux interprètes susceptibles de se prêter à l'observation ou l'expérimentation. Le marché local de l'interprétation est aussi un réservoir de praticiens-chercheurs.
b. L'existence d'une structure universitaire d'accueil: A l'évidence, celle-ci est nécessaire tant pour former que
pour motiver et accueillir les chercheurs. Jusqu'à présent, les
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 237
centres les plus productifs avaient comme structures d'accueil des écoles d'interprétation, mais i l est concevable que des départements de linguistique í et de psychologie, voire de sociologie ou de communication, jouent le même rôle dans une optique de recherche à dominante plus scientifique.
c. Les possibilités de communication avec d'autres chercheurs: La condition de communication peut paraître évidente, tant
elle fait intrinsèquement partie de la recherche scientifique en tant que facteur de progrès par la confrontation des idées, raisonnements, méthodes et résultats. Rappelons cependant. que dans le domaine de l'interprétation, tous les centres n'ont pas toujours cherché la communication. Nous pensons d'ailleurs que cela a été un important facteur de déclin pour certains d'entre eux. Notons aussi que la communication semble avoir un important effet motivant sur les auteurs de textes publiés et les participants à des colloques, avec un effet d'entraînement sensible.
d. Un nombre suffisant de chercheurs sur place: Une masse critique assurant la motivation et la communica
tion interne, de même que la visibilité pour les chercheurs extérieurs, paraît importante pour la viabilité de l'activité d'un centre. Il est difficile de déterminer le nombre minimum de chercheurs qui assurerait cette masse critique, car celle-ci dépend aussi des autres conditions. Ainsi, un groupe de 3 personnes dont la productivité est assez régulière, qui communiquent entre elles et avec l'extérieur et qui bénéficient d'une même structure d'accueil peut former à lui seul un 'centre' actif. En revanche, trois personnes, appartenant chacune à un autre centre d'accueil universitaire ou de recherche, et ne communicant pas entre elles, ne représentent pas une masse significative.
Les conditions ci-dessus ne sont pas indispensables à - la recherche au sens strict ; certaines activités de recherche ont été conduites dans des centres où elles ne sont pas réunies. Par exemple, l'Australie et la Finlande, qui ont produit plusieurs travaux ces dernières années, ne disposent que d'un tout petit marché local. Inversement, les structures d'accueil universitaires au Japon sont très peu favorables à la recherche, alors que les collègues japonais ont été très productifs depuis le début des années 1990. Cependant, i l semble raisonnable de supposer qu'au-delà de phénomènes isolés et de courte durée,
238 DANIEL GILE
les activités de recherche dans ces centres resteront limitées dans le temps et dans l'envergure par un environnement non favorable.
A ces conditions fondamentales s'ajoutent d'importants facteurs institutionnels, motivationnels et financiers, qui sont expliqués dans les premiers et dans le dernier chapitre de ce livre —sans compter les politiques personnelles des responsables d'écoles de traduction et d'interprétation.
A l'évidence, au regard de ces considérations, le plus grand potentiel se situe en Europe, du moins en ce qui concerne l'interprétation de conférence. L'Amérique du Nord, elle, a un important marché d'interprétation communautaire et auprès des tribunaux, de même que l'Australie, qui d'ailleurs est insti-tutionnellement très organisée en la matière. Dans ces deux régions, les conditions institutionnelles et financières sont favorables, mais le marché de l'interprétation de conférence est très modeste. Au Japon, i l n'y a pas encore de véritable structure d'accueil universitaire pour la recherche, en dépit du projet unique mené à l'université Sainte-Sophie (Watanabe 1991). Quant à l'activité dans les autres régions du monde, elle ne porte pas pour l'instant de promesse particulière.
A l'heure actuelle, la recherche dans la région européenne semble être en plein essor, dans le cadre d'un paradigme scientifique et avec une volonté de communication de la part de nombreux centres. En particulier, un colloque de recherche sur l'interprétation, co-organisé par l'université de Turku, par l'école de Trieste et par l'ISIT de Paris s'est tenu en Finlande en août 1993. On ne manquera pas non plus de noter la généreuse ouverture vers les interprètes faite par les traducteurs. Ainsi, la Chaire CERA de l'université catholique de Louvain, programme de recherche traductologique, qui a été tenue jusqu'à présent par des traductologues, d'horizons plutôt littéraires d'ailleurs, a été confiée en 1993 à D. Gile, un interprète n'ayant aucune compétence littéraire. Par ailleurs, la revue traductologique Target, dont les préoccupations ont jusqu'à présent porté essentiellement sur la traduction écrite, prépare actuellement un numéro spécial, le premier, -qui porte sur l'interprétation de conférence.
Tous ces signes sont encourageants, et une certaine dynamique favorable semble bien s'être installée. Toutefois, tant que la recherche en interprétation ne sera pas davantage institutionnalisée, avec un statut et des structures universitaires, le mouvement restera fragile. Le pronostic est donc plutôt optimiste, mais prudent.
Références bibliographiques
AnC (1966), Practical Guide for Users of Conference Interpreting Services, AUG, Genève. (1977), Historique des réflexions sur la qualité, AIIC Bulletin 5/3:90-92. (1979), Enseignement de l'interprétation : Dix ans de colloques, AIIC, Genève. (1982), Practical Guide for Professional Interpreters, AIIC, Genève. (1991), Conseils aux Etudiants souhaitant devenir interprètes de conférence, Genève.
A I T C H I S O N Jean (1987), Words in the Mind, An Introduction to the Mental Lexicon, Cambridge, Massachussets, Basil Blackwell.
A L E S S A N D R I N I Maria Serena (1990), Translating Numbers in Consecutive Interpretation : A n Experimental Study, The Interpreter's Newsletter 3:77-80.
A L E X I E V A Bistra (1983), Compression as a means of realisation of the communicative act in simultaneous interpreting, Fremdsprachen 27/4:233-238.
A L L I O N I Sergio (1989), Towards a Grammar of Consecutive Interpretation, in Gran, Laura & John Dodds (eds) 1990:191-197.
A L T M A N Janet (1990), What Helps Effective Communication ? Some Interpreters' Views, The Interpreter's Newsletter 3 :23-32.
A N D E R S O N Linda (1979), Simultaneous Interpretation : Contextual and Translation Aspects, M . A . thesis, Concordia University, Montreal, non publié. '
A N D R O N I K O F F Constantin (1968), Introduction à Seleskovitch, D. (1968), L'interprète dans les conferences internationales, Paris, Minard Lettres modernes, pp. 3-20.
A R J O N A - T S E N G Etilvia (1989), Preparing for the xxis t century, in MÜS 1989, pages non numérotées .
Association des amis de l'ESIT (1987), Comment perfectionner ses connaissances linguistiques, polycopié, novembre, 110 pages.
240 DANIEL GILE
A V I R O V I C Ljiljana (1990), Persistance and Change : Current Features of Serbo-Croatian and How They Affect the Training of Interpreters, The Interpreter's Newsletter 3 : 81-87.
B A B B I E Earl (1992), The Practice of Social Research, Belmont, California, Wadsworth Publishing Company.
B A L Z A N I Maurizio (1990), Le contact visuel en interprétation simultanée : résultats d'une expérience (Français-Italien), in Gran, Laura & Christopher Taylor (eds) 1990:93-100.
B A R I K Henry C. (1969), A Study of Simultaneous Interpretation, thèse de doctorat non publiée, University of North Carolina. (1970) , Some Findings on Simultaneous Interpretation, in Proceedings of the 78th Annual Convention of the American Psychological Association, V , Part 1. (1971) , A Description of Various Types of Omissions, Additions and Errors Encountered in Simultaneous Interpretation, Meta 16/4:199-210. (1972) , Interpreters talk a lot among other things, Babel 3/10. (1973) , Simultaneous Interpretation : temporal and quantitative data, Language and Speech 6:237'-21r0. (1975), Simultaneous Interpretation : Qualitative and Linguistic Data, Language and Speech 18 :272-297.
B E R T O N E Laura (1987), Un regard sur le passé, Meta 32/4:496-498. (1989), Teaching and Learning as global experiences, in MHS 1989, pages non numérotées .
B o s c H i A N - S c H i A V O N V. (1983), Lïnterpretazione simultanea di discorso letto, Graduation thesis, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, Universita degli Studi di Trieste.
B O W E N David & Margareta B o W E N (eds) (1990), Interpreting — Yesterday, Today and Tomorrow, American Translators Association, Scholarly Monograph Series, vol. IV, State University of New York at Binghamton.
B R I S S E T Annie (1993), Compte rendu de Lederer Marianne (red.) 1990, Etudes traductologiques, Target 5¡2 : 255-258.
B R O S - B R A N N Eliane (1976), Critical comments on H.C. Barik's article : Interpreters talk a lot, among other things, Bulletin de l'AIIC I V / 1 , Mars.
B Ü H L E R Hildegund (1986), Linguistic (semantic) and extra-linguistic (pragmatic) criteria for the evaluation of conference interpretation and interpreters, Multilingua, 5 /4: 231-236.
C A P A L D O Stephen (1980), A n Apology for Consecutive Interpretation, Meto 25/2.
C A R R O L L John B. (1978), Linguistic Abilities in Translators and Interpreters, in Gerver David & H . Wallace Sinaiko (eds) 1978:119-130.
C A R T E L L I E R I Claus (1983), The inescapable dilemma : quality and/or quantity, Babel 29/4: 209-213. (1989), Zur Beurteilung der Qualität beim Simultandolmetschen, Fremdpsrachen 2/1989 : 75-70.
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 241
C E N K O V A Ivana (1985), Teoretické aspekty procesu simultanniho tlumo-ceni (Les aspects théoriques du processus de l'interprétation simultanée), thèse de 3 e cycle, Facul té des Lettres, Université Charles de
* Prague. (1989) , L'importance des pauses en interprétat ion simultanée, Mélanges de phonétique générale et expérimentale, Publications de l'Institut de Phonét ique de Strasbourg, 1989:249-260.
C E R R E N S L . (1975), Enseigner la consécutive : la fin justifie-t-elle les moyens ? L'interprète 2/3, Genève.
C H E R N O V Ghelly V . (1969), Sinchronnyj perevod : recevaja kompressa — ligvisticeskaja problema (Linguistic Problems in the Compression
of Speech in Simultaneous Interpretation), Tetradi Perevodchika 6:52-65. (1973), K postroeniju psicholingvisticeskoj modeli sinchronnogo perevoda (Towards a psycholinguistic model of simultaneous interpretation), Linguistische Arbeitsberichte, N.7:225-260, Leipzig. (1978) , Teorija i praktika sinchronnogo perevoda, Moscou, Mezdu-narodnije Otnoshenija. (1979) , Semantic Aspects of Psycholinguistic Research in Simultaneous Interpretation, Language and Speech 22/3 : 277-295. (1992), Conference Interpretation in the USSR : History, Theory, New Frontiers, Meta 37/1:149-162.
C H E R R Y Colin (1978), On Human Communication, Cambridge, Masschu-( setts and London, England, The MIT Press.
C L A R E N S Jeannie de (1973), L'expression, Etudes de linguistique appliquée 12 : 124-126, Paris, Didier Erudition.
C L A R K Herbert H . & Eve V . C L A R K (1977), Psychology and language, San Diego, New York, Chicago, Atlanta, Washington D.C., London, Sydney, Toronto, Harcourt Brace Jovanovitch, Publishers.
C O L E M A N - H O L M E S John (1971), Mâcher du coton, Genève, Librairie Martingay.
C O N D O N John and M I T S U K O Saito (1974), Inter cultural Encounters with Japan, Tokyo, The Simul Press.
C O O P E R C L , D A V I E S R. & T U N G R.L. (1982), Interpreting stress : sources of job stress among conference interpreters, Multilingua 1/2.
C O S T E R M A N S Jean (1980), Psychologie du langage, Bruxelles, Pierre Mardaga.
C R E V A T I N Alessandra (1991), La traduzione dei numeri in interpretazione simultanea : un contributo sperimentale, Graduation thesis, Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, Universita degli Studi di Trieste.
D A R O Valeria (1989), The role of memory and attention in simultaneous interpretation : a neurolinguistic approach, The Interpreter's Newsletter 2:50-56. (1990) , Voice Frequency and Simultaneous Interpretation, The Interpreter's Newsletter 3 : 88-92.
242 DANIEL GILE
D A V I D S O N Peter (1992a), Segmentation of Japanese Source Language Discourse in Simultaneous Interpretation, The Interpreter's Newsletter, Special Issue 1: 2-11. (1992b), Simultaneous Interpreting Research : Past, Present and Future, Tsûyakuriron Kenkyû (Interpreting Research), Tokyo, 2/2:23-44.
D É J E A N L E F É A L Karla (1976), Le perfectionnement linguistique, Etudes de linguistique appliquée 24:42-51, Didier Erudition, Paris. (1978), Lectures et improvisations, thèse de doctorat, 3 e cycle, Université de Paris I U , non publiée. (1981), L'enseignement des méthodes d'interprétation et de la traduction, in Delisle, Jean (réd.) 1981: 79-90. (1990), Some Thoughts on thê Evaluation of Simultaneous Interpretation, in Bowen, David & Margareta Bowen (eds) 1990:154-160.
D E L I S L E Jean (red.) (1981), L'enseignement de la traduction et de l'interprétation. De la théorie à la pédagogie, Ottawa, Editions de l'université d'Ottawa, Cahiers de traductologie 4.
D I L L I N G E R Mike (1989), Component Processes of Simultaneous Interpreting, Unpublished PhD thesis, Department of Educational Psychology, McGi l l University, Montreal.
D O D D S John (1990), On the Aptitude of Aptitude Testing, The Interpreter's Newsletter 3:17-22.
D O L L E R U P Cay & Anne L O D D E G A A R D (eds) (1992), Teaching Translation and Interpreting. Training, Talent and Experience, Amsterdam/Philadelphia, John Benj aminas Publishing Company.
D O L L E R U P Cay & Annette L I N D E G A A R D (eds) (1994), Teaching Translation and Interpreting. Insights, Aims, Visions, Amsterdam /Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.
D O N O V A N Clare (1990), La fidélité en interprétation, thèse de doctorat, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris HI, non publiée.
E B E R S T A R K H . (1982), Dolmetschen und Übersetzungen : Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Parallèles 5 : 83-90.
E Y S E N C K Michael W . & Mark T. K E A N E (1990), Cognitive Psychology A Student's Handbook, Hove and London (UK), Hillsdale (USA) : Lawrence Earlbaum Associates.
F E L D W E G Erich (1980), Dolmetschen einsprachig lehren ? Bericht über ein gelungenes Experiment, Lebende Sprachen 25/4. (1989), The Significance of Understanding in the Process of Interpreting, in Gran, Laura & John Dodds (eds) 1989:139-140.
F L O R E S D ' A R C A I S G.B. (1978), The Contribution of Cognitive Psychology to the Study of Interpretation, in Gerver, David & H . Wallace Sinaiko (eds) 1978:385-402.
F O D O R J.A. & G A R R E T T M.F. (1967), Some syntactic determinants of sentential complexity, Perception and psychophysics 2 :289-296.
F O U R A S T I É Jean (1966), Les conditions de l'esprit scientifique, Paris, Gallimard.
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 243
F R A N C I S Michael (1989), The Teaching of Conference Interpreting : a Pragmatist's view, in Gran, Laura & John Dodds (eds) 1989:249-252.
F R A N K F O R T - N A C H M I A S Chava & David N A C H M I A S (1992), Research Methods in the Social Sciences, London, Melbourne, Auckland, Edward Arnold.
F U C H S - V I D O T T O Laetizia (1961), Notizen bei konsekutivem Dolmetschen, Kölner Dolmetscher-Arbeitstagung 37, mars.
F u K u n Haruhiro & Tasuke A S A N O (1961), Eigotsüyaku no jissai (An English Interpreters Manual), Tokyo, Kenkyusha.
F u s c o Maria Antonetta (1990), Quality in Conference Interpreting between Cognate Languages : A Preliminary Approach to the Spanish-Italian Case, The Interpreter's Newsletter 3 :93-97.
G A L E R Raul (1974), A vindication of shorthand, AIIC Bulletin 2/1. G A L L I Cristina (1990), Simultaneous Interpretation in Medical Confe
rences, in Gran, Laura & Christopher Taylor (eds) 1990:61-82. G A M B I E R Yves & Tommola J O R M A (1993), Translation and Knowledge,
SSOTT IV, University of Turku, Centre for Translation and Interpreting.
G A R C I A - L A N D A Mariano (1978), Les déviations délibérées de la littéralité en interprétation de conférence, thèse de doctorat de 3 e cycle, Université de Paris HI, non publiée.
G É M A R Jean-Claude (1983), De la pratique à la théorie, l'apport des praticiens à la théorie générale de la traduction, Meta 28/4:323-333.
G E N T I L E Adolfo (1989), The Genesis and Development of Interpreting in Australia : Salient Features and Implications for Teaching, in Gran, Laura & John Dodds (eds) 1989 :257-260.
G E R V E R David (1969), The Effects of Source Language Presentation Rate on the Performance of Simultaneous Conference Interpreters, in Foulke, E. (ed.) (1969) : Proceedings of the 2nd Louisville Conference on Rate and/or Frequency Controlled Speech, University of Louisville: 162-184. (1971) , Simultaneous Interpretation and Human Information Processing, thèse de doctorat non publiée, université d'Oxford. (1972) , Simultaneous and Consecutive Interpretation and Human Information Processing, London, Social Science Research Science Council Research Report H R 566 /L (1974a), The Effects of Noise on the Performance of Simultaneous Interpreters : Accuracy of Performance, Acta Psychologica 38 :159-167. (1974b), Simultaneous Listening and Speaking and Retention of Prose, Quarterly Journal of Experimental Psychology 26:337-342. (1976), Empirical Studies of Simultaneous Interpretation : a Review and a Model, in Brislin, R. (ed) 1976 : Translation, New York, Gardner Press : 165-207.
G E R V E R David & H . Wallace S I N A I K O (eds) (1978), Language Interpretation and Communication, New York and London, Plenum Press.
244 DANIEL GILE
G I A M B A G L I Anna (1990), Transformations grammaticales syntaxiques et structurales dans l ' interprétation consécutive vers l'italien d'une langue latine et d'une langue germanique, The Interpreter's Newslettern : 98-111.
G i L E D. (1983a), L'enseignement de l ' interprétation : utilisation des exercices unilingues en début d'apprentissage, Traduire 113 :7-12. (1983b), Aspects méthodologiques de l 'évaluation de la qualité du travail en interprétation simultanée, Meta 28/3 :236-243. (1983c), Des difficultés de langue en interprétat ion simultanée, Traduire 111 \ 2-%. (1984), Les noms propres en interprétation simultanée, Multilingua 3-2:79-85. (1985a), L a sensibilité aux écarts de langue et la sélection d'informateurs dans l'analyse d'erreurs : une expérience, The Incorporated Linguist 24/1:29-32. (1985b), De l'idée à l 'énoncé : une expérience et son exploitation pédagogique dans la formation des traducteurs, Meta 30/2:139-147. (1985c), Les termes techniques en interprétation simultanée, Meta 30/3:199-210. (1985d), L'interprétation de conférence et la connaissance des langues : quelques réflexions, Meta 30/4:320-331. (1986a), L'exercice d'interprétation — démonstra t ion de sensibilisation unilingue dans l'enseignement de l 'interprétation consécutive, Lebende Sprachen 31/1:16-18. (1986b), Traduction et interprétat ion : deux facettes d'une m ê m e fonction, The Linguist 3. (1986c), L a compréhension des énoncés spécialisés chez le traducteur, Meta 31 /4:363-369. (1986d), JAT Language Questionnaire Status Report, JAT Bulletin N° 17, août 1986. (1986e), L a reconnaissance des Kango dans la compréhension du discours japonais, Lingua 70:171-189. (1987), Les exercices d' interprétation et la dégradation du français : une é tude de cas, Meta 32/4:420-428. (1988a), Observations sur l'enrichissement lexical dans la progression vers un japonais langue passive pour l ' interprétation de conférence, Meta 33/1:79-89. (1988b), Compte rendu sur Masao Kunihiro, Sen Nishiyama et Nobuo Kanayama (1969), Tsûyaku, Eikaiwa kara dôjitsûyaku made, The Interpreter's Newsletter 1:49-53. (1988c), Les publications japonaises sur la traduction : un aperçu, Meia 33/1:115-126. (1988d), L'enseignement de la traduction japonais-français : une formation à l'analyse, Meta 33/1:13-21. (1989a), La communication linguistique en réunion multilingue -Les difficultés de la transmission informationnelie en interprétation
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 245
simultanée, thèse de doctorat, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris m , non publiée. (1989b), Les flux d'information dans les réunions interlinguistiques et l ' interprétation de conférence : premières observations, Meta 34/4:649-660. (1990a), Basic Concepts and Models for Conference Interpretation Training, First version, unpublished monograph, Paris. (1990b), Interpretation Research Projects for Interpreters, in Gran, Laura & Christopher Taylor (eds) 1990 : 226-236. (1990c), Issues in the training of Japanese-French conference interpreters, Forum 6: 5-7, December, Brisbane. (1990d), L'évaluation de la qualité du travail par les délégués : une é tude de cas, The Interpreter's Newsletter 3 : 66-71. (1990e), L a traduction et l ' interprétation comme révélateurs des mécanismes de production et de compréhension du discours, Meta 35/1:20-30. (1990f), Scientific Research vs. Personal Theories in the Investigation of Interpretation, in Gran, Laura & Christopher Taylor (eds) 1990:28-41. (1990g), Observational Studies and Experimental Studies in the Investigation of Interpretation, communication faite à la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, Universita degli Studi di Trieste, le 19 mars 1990. (1991a), Methodological Aspects of Interpretation (and Translation) Research, Target! 12: 153-174, 1991. (1991b), Prise de notes et attention en débu t d'apprentissage de l'interprétat ion consécutive — une expérience-démonstrat ion de sensibilisation, Meta 36/2-3:432-441. (1991c), Guide de l'interprétation à l'usage des organisateurs de conférences internationales, Paris, Premier ministre — Délégation générale à la langue française & Ministère des affaires étrangères, Ministère de la francophonie, 24 pages. (1992a), Basic theoretical components for interpreter and translator training, in Dollerup Cay & Anne Loddegaard (eds) 1992:185-194. (1992b), Predictable Sentence Endings in Japanese and Conference Interpretation, The Interpreter's Newsletter, Special Issue 1:12-23. (1992c), Compte rendu : Haruhiro Fukui i & Tasuka Asano, Eigot-suyaku no jissai (An English Interpreter's Manual) et The Quarterly Journal of the Interpreting Association of Japan, The Interpreters Newsletter, Special Issue 1: 69-72. (1992d), Compte rendu : Watanabe, Shoichi (ed) (1991), Gaikokugo-kyôiku no ikkan to shite no tsûyakuyôsei no tame no kyôikunaiyô-hôhô no kaihatsu sôgôkenkyû (Research on interpretation training methodology as a part of foreign language training), Parallèles 14:117-120.
246 DANIEL GILE
(1994), L a disponibilité lexicale et l'enseignement du japonais, Cipango, Mélanges offerts à René Sieffert, N u m é r o hors-série, Paris, INALCO, Centre d'études japonaises, pp. 315-331.
G l L E Daniel (a.p. a), Basic Concepts and Models for Translator and Interpreter Training, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company. (a.p. b), Fidelity assessment in consecutive interpretation : an experiment, doit paraî t re dans Target
G L A E S S E R E. (1956), Dolmetschen im Mittelalter. Ein Beitrag zur Entwicklung des VöIkergedankens. Beiträge zur Geschichte des Dolmetschens, Schriften des Auslands— und Dolmetscherinstitutes der lohannes-Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim, München, Isaar Verlag.
G L É M E T Ruth (1949), Les interprètes vus par un interprète, L'interprète 3, Genève. (1958), Conference interpreting, in Aspects of Translation (Studies in Communication 2), University College, London.
G O L D D. (1976), On Quality in Interpretation, Babel22/3. G O L D M A N - E I S L E R Frieda (1958), Speech analysis and mental processes,
Language and Speech, Jan.-March 1958, Robert Draper, U K . (1967) , Sequential temporal patterns and cognitive processes in speech, Language and Speech 10:122-132. (1968) , Psycholinguistics : Experiments in spontaneous speech, London, Academic Press. (1972), Segmentation of input in simultaneous interpretation, Psy-cholinguistic Research 1: 127-140. (1980), Psychological Mechanisms of Speech Production as studied through the analysis of Simultaneous Translation, in Language Production, V o l 1, Speech and Talk, London, Academic Press.
G R A E S S E R Arthur X . C . (1981), Prose comprehension beyond the word, New York, Heidelberg, Berlin, Springer-Verlag.
G R A N Laura (1981), L'annotazione grafiche nell 'in ter pre tazione consecutive, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Tradut-tori, Universita degli Studi di Trieste. (1990), A Brief Review of Research Work on Interpretation Conducted at the S S L M of the University of Trieste and of Recent Similar Studies conducted in Canada and The USA, in Gran, Laura & Christopher Taylor (eds) 1990: 4-20.
G R A N Laura & John D O D D S (eds) (1989), The Theoretical and Practical Aspects of Teaching Conference Interpretation, Udine, Campanotto
. Editore. G R A N Laura & Franco F A B B R O (1987), Cerebral Lateralization in Simulta
neous Interpreting, in Across the Language Gap, Proceedings of the 28th Annual Conference of the American Translators' Association, Medford, New Jersey, Learned Information, pp. 323-331 (1988), The Role of Neuroscience in the Teaching of Interpretation, The Interpreter's Newsletter 1:23-41.
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 247
(1990), A dichotic-listening study on error recognition among professional Conference interpreters, in Jovanovic, Mladen (ed) 1990:564-572.
G R A N Laura & Christopher T A Y L O R (eds) (1990), Aspects of Applied and Experimental Research on Conference Interpretation, Udine, Campanotto Editore.
G R E E N A, S C H W E D A - N I C H O L S O N , Jyotsna V A I D , Nancy W H I T E & Robert S T E I N E R (1990), Hemispheric involvement in Shadowing vs. Interpretation : A Time sharing Study of Simultaneous Interpreters with Matched Bilingual and Monolingual Controls, Brain and Language 39:107-133.
G R I N G I A N I Angela (1990), Reliability of Aptitude Testing, in Gran, Laura & Christopher Taylor (eds) 1990:42-53.
G U S T I N Darinka (1982), Word order in relation to simultaneous interpretation performance, Graduation thesis, Scuola Superiore per Inter-preti e Traddutori, Universita degli Studi di Trieste.
H A E N S C H G. (1956a), Der internationale Konferenzdolmetscher, Entstehung des Berufes, Lebende Sprachen 1/1. (1956b), Der internationale Konferenzdolmetscher II, Die Technik des Dolmetschens, Lebende Sprachen 1/2.
' (1956c), Der internationale Konferenzdolmetscher Hi . Die Dolmetschanlagen, Lebende Sprachen 1/3.
H A L L I D A Y M . A . K (1985), Spoken and Written Language, Victoria, Deakin University Press.
H A M M O N D Deanna L. (ed) (1988), Languages at Crossroads. Proceedings of the 29th Annual Conference, ATA, Medford, New Jersey, Learned Information Inc.
H A N N A H T.B. (1966), Oral comprehension, Meta 11/2. H A N S T O C K J. (1985), Translation and Interpretation in West Africa, ASLIB
Technical Translation Bulletin 31/1. H A R A Fujiko (1988), Understanding the silent culture of the Japanese,
Meta 33/1:22-24. H A R R I S Brian (1981), Prolegomenon to a study of the differences bet
ween teaching translation and teaching interpretating, in Delisle, Jean (red.) 1981:153-162.
H A T O N Jean-Paul et Jean-Sylvain L I É N A R D (1979), L a reconnaissance de la parole, La Recherche 99:327-335.
H A Y A S H I Okii (1982), Zusetsu Nihongo, Tokyo, Kadokawa. H E N D E R S O N J.A. (1976), Note-taking for consecutive interpretation, Babel
22/3. (1987), Personality and the Linguist : A Comparison of the Personality Profiles of Professional Translators and Conference Interpreters, University of Bradford Press.
H E N R Y Ronald and Diane (1977), Bibliographie internationale de l'interprétation, Laurentian University, Sudbury, Ontario.
H E R B E R T Jean (1952), Manuel de l'interprète, Georg, Genève.
248 DANIEL GILE
(1978), How conference interpretation grew, in Gerver, David & H . Wallace Sinaiko (eds) 1978 :5-10.
H E R M A N A. (1956), Dolmetschen im Altertum, Ein Beitrag zur antiken Kulturgeschichte Schriften des Auslands- und Dolmetscherinstitutes der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim.
H O F M A N N E (1963), A Contribution to the History of Simultaneous Interpretation, Tetradi Perevodchika 1:20-26, Moscow.
H O F M A N N Hedy Lorraine (1990), Conference Interpreting : Practice and Teaching in South Brazil, Meta 35/3 :652-655.
H Ö R M A N N Hans (1972), Introduction à la psycholinguistique, Paris, Larousse, 316 pages (traduction de la version allemande, Berlin-Heidelberg, Springer-Verlag, 1971).
I I N O K U C H I Sanae & Makiko T A N A K A (1991), Puro no t sûyakusha oyobi t sûyakukunrensei no t sûyaku no yakushutsujô no tokucho, in Watanabe (ed) 1991:143-238.
I K E D A Yasaburo (1982), Nihongo no jôshikidaihyakka, Tokyo, Kodansha. I L G Gérard (1959), L'Enseignement de l ' interprétation à l'Ecöle d'inter
prètes de Genève, L'interprète 14, Université de Genève. (1978), De l'allemand vers le français : l'apprentissage de l'interprétation simultanée, Parallèles 1: 69-99, Cahiers de l'ETI, Université de Genève. (1980) , L' interprétation consécutive : les fondements, Parallèles 3: 109-136, Cahiers de l'ETI, Université de Genève. (1981) , L'usage des conférences internationales : un projet de recherche à l ' E T I , Parallèles 4 : 55-66, Cahiers de l'ETI, Université de Genève. (1982) , L'interprétation consécutive : la pratique, Parallèles 5:91-109, Cahiers de l'ETI, Université de Genève. (1988), L a prise de notes en interprétat ion consécutive. Une orientation générale, Parallèles 9:9-13, Cahiers de l'ETI, Université de Genève. (1992) , Actualités, Parallèles 14: 115-117, 120-122, Cahiers de l'ETI, Université de Genève.
I L I C IVO (1990), Cerebral Lateralization for Linguistic Functions in Professional Interpreters, in Gran, Laura & Christopher Taylor (eds) 1990:101-110.
I S H A M William (1991), Evidence for Conceptual Mediation in Simultaneous Interpretation, Ph.D. dissertation, Northeastern University. (1993) , Simultaneous interpretation and the recall of source-language sentences, Language and Cognitive Processes 8 :241-264.
I W A B U C H I Etsutaro (1977), Akubun, Tokyo, Nihonhyôronsha. I Z U M I Koryu (1991), Tsûyaku ni kansuru ankêtochôsa (Interpreter sur
vey), in Watanabe, Shoichi (ed) 1991:239-372. J A K O B S O N Roman (1959), On Linguistic Aspects of Translation, in R.A.
Brower (ed) 1959 : On translation, Cambridge, Massachussets, Harvard University Press : 232-239.
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 249
J O V A N O V I C Mladen (ed) (1990) , Translation, a creative profession, Proceedings of the xnth World Congress of FIT, Belgrade.
K A D E Otto (1963) , Der Dolmetschvorgang und die Notation, Fremdsprachen 8 / ' 1 : 1 2 - 2 0 .
K A D E Otto & Claus C A R T E L L I E R I (1971) , Some methodological aspects of simultaneous interpreting, Babel 1 7 / 2 : 1 2 - 1 6 .
K A H N E M A N D. (1973) , Attention and Effort, Englewoods Cliffs, N.J., Prentice Hall .
K A N N O Ken (1978) , Hôsô to wago kango, Tokyo, Bunkacho. K E I S E R Walter (1970) , Les écoles d' interprétation et de traduction
répondent-elles à ce que la profession et les employeurs en attendent ? L'interprète 4 , Genève. (1978) , Selection and training of conference interpreters, in Gerver, David & H . Wallace Sinaiko (eds) 1 9 7 8 : 11-24.
K I N D A I C H I Ichiharu (1957) , Nihongo, Tokyo, Iwanamishinsho. K I R C H H O F F Hella (1976) , Das dreigliedrige zweisprachige Kommunika
tionssystem Dolmetschen, Le langage et l'homme 3 1 : 2 1 - 2 7 . (1979) , Die Notationssprache als Hilfsmittel des Konferenzdolmetschers im Konsekutivvorgang, in Sprachtheorie und Sprachpraxis, Tübingen, Gunter Narr.
K O L E R S Paul A . (1978) , On the representation of experience, in Gerver, David & H . Wallace Sinaiko (eds) 1 9 7 8 : 2 4 5 - 2 5 8 .
K O L M E R H . (1981) , What price an interpreter's ears ?, AIIC Bulletin I X / 4 , , Geneva. K O M I S S A R O V Vilen (1985) , The practical value of translation theory,
Babem/A: 2 0 8 - 2 1 2 . K O N D O Masaomi (1988) , Japanese interpreters in their socio-cultural
context, Meta 3 3 / 1 : 7 0 - 7 8 . ( 1991 ) , Interpreting Research and Post-Graduate Training Needed in Japan (en japonais), Tsûyakurironkenkyû (Interpreting Research) 1 / 1 : 3 8 - 4 9 , in 6 parts, 1991 . (1992) , The effectiveness of shadowing — a European debate (en japonais), Tsuyakurironkenkyu (Interpreting Research) 2 / 1 : 4 3 - 5 1 , Tokyo.
K O P C Z Y N S K I Andrzej (1976) , Conference Interpreting in Poland : an overview of the problems, Babel22/3 : 123-124 . (1980) , Conference Interpreting. Some Linguistic and Communicative Problems, Nauk, Wydawn, Poznan. (1992) , Quality in conference interpreting : Some pragmatic problems, in Snell-Hornby, Mary, Franz Pöchhacker & Klaus Kaindl (eds) 1 9 9 4 : 1 8 9 - 1 9 8 .
K R U S I N A A. (1971) , Main Factors Determining the Process and Quality of Simultaneous Interpretation, Acta Universitatis, 17 Novembris, Prague : Studies on language and theory of translation 11 /1971 .
K U N I H I R O Masao, Sen N I S H I Y A M A & Nobuo K A N A Y A M A (1969) , Tsûyaku. Eikaiwa ¡cara dôjitsûyaku made (Interpreting: From English Conversation to Simultaneous Interpreting), Nihonhôsôshuppankyokai.
250 DANIEL GILE
K U R Z Ingrid (1981), Temperatures in interpreters' booth - a hot iron ? Bulletin de VAIIC9/4:39-43.
(1983a), Konferenzdolmetscher: Berufszufriedenheit und soziales Prestige, Nouvelles de la FIT, Nouvelle Série, 2/4.
(1983b), Der von uns ... : Schwierigkeiten des Simultandolmetschens Deutsch-Englisch, in Festschrift zum 40 Jährigen Bestehen des Instituts für Übersetzer — und Dolmetscherausbildung der Universität Wien, Ulm, Dr. Ott Verlag.
(1983c), Temperatures inside and outside booths — a comparative study, Bulletin de l'AIIC 11/2: 67-72.
(1983d), C 0 2 and 0 2 levels in booths at the end of a conference day — a pilot study, Bulletin de l'AIIC U/3 :86-93.
(1985), The rock tombs of the princes of Elephantine, earliest references to interpretation in Pharaonic Egypt, Babel 31/4:213-218.
(1986a), Dolmetschen im Alten Rom, Babel 32/4:215-220. (1986b), A Survey Among A U G Interpreters on their Professional Back
ground, Bulletin de l'AIIC 14/1, Edition Spéciale : Strasbourg Symposium : Access to the Profession.
(1988), Conference Interpreters - Can They Afford not to be Generalists ? in Hammond, Deanna (ed) 1988 :423-428.
(1989a), The Use of Videotapes in Consecutive and Simultaneous Interpretation Training, in Gran, Laura & John Dodds (eds) 1989: 213-215.
(1989b), Conference Interpreting - User Expectations, in Hammond, Deanna (ed) 1989: 143-148.
(1990a), Conference Interpreting : Job Satisfaction, Occupational Prestige and Desirability, in Jo vano vie, Mladen (ed) 1990: 363-376.
(1990b), Christopher Columbus and his Interpreters, The Jerome Quarterly 5/3.
(1990c), Jesuit Missionaries as Translators in 17th Century China, Bulletin de l'AIIC 18/2: 17-18.
(1990d), The Interpreter Felipillo and his Role in the Trial of the Inca Ruler Atahualpa, Bulletin de l'AIIC 18/4: 10-12.
(1992a), Simultandolmetschen als Gegenstand der interdisziplinären Forschung, Habilitationsschrift non publiée, Université de Vienne.
(1992b), Shadowing exercises in interpreter training, in Dollerup, Cay & Anne Loddegaard (eds) 1992 : 245-250.
(1993) , E E G Probability mapping : detecting cerebral processes during mental simultaneous interpreting, The Jerome Quarterly 8/2: 3-5.
(1994) , A look into the black box: E E G probability mapping during mental simultaneous interpreting, in Snell-Hornby, Mary, Franz Pöch-hacker & Klaus Kaindl (eds) 1994: 199-207.
K U S A Y A N A G I M . (1991), Interpreting Market. Interpreter Aptitude Seen by Agency (en japonais), Interpreting Research 1/1:30-31.
K U T Z Wladimir (1990), Zum Kompressionszwang beim Simultandolmetschen, Fremdsprachen 4.
R E G A R D S S U R LA R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 251
L A F R A N C E G. (1976), Description du cours d'expression orale et de procédure parlementaire, Documents ETI, Université de Genève.
L A M B E R T Sylvie (1983), Recognition and Recall in Conference Interpreters, PhD thesis, University of Stirling, unpublished. (1988) , Information Processing among Conference Interpreters : A Test of the Depth-of-Processing Hypothesis; Meto 33/3. (1989a), L a formation d'interprètes : mé thode cognitive, Meta 34/4:736-744. (1989b), Simultaneous Interpreters : One Ear May Be Better Than Two, The Interpreters Newsletter2 : 11-16. (1991), Aptitude Testing for Simultaneous Interpretation at the University of Ottawa, Meta 36 /4 : 586-594. (1992a), Shadowing, Meta 37 /2 : 263-273. (1992b), The Cloze Technique as a Pedagogical Tool for the Training of Translators and Interpreters, Target 4/2: 223-236.
L A M B E R T W.E. (1978), Psychological Approaches to Bilingualism, Translation and Interpretation, in Gerver, David & H . Wallace Sinaiko (eds) 1978:131-144.
L A M P E - G E G E N H E I M E R V . (1972), Fragen zur Praxis des Notiznehmens beim Konsekutivdolmetschens, Diplomarbeit, Dolmetscherinstitut der Universität Heidelberg, non publiée.
L A N G Margaret (1992), Common ground in teaching translation and interpreting : discourse analysis techniques, in Dollerup, Cay & Anne Loddegaard (eds) 1992 : 205-210.
L A W S O N E.A. (1967), Attention and Simultaneous Translation, Language and Speech 10:29-35.
L E N Y Jean-François (1978), Pyschosemantics and simultaneous interpretation, in Gerver, David & H . Wallace Sinaiko (eds) 1978 :289-298.
Le petit journal (1957), Difficultés de la traduction simultanée des débats à Ottawa, Ottawa, 6 octobre.
L E B H A R P O L I T I Monique (1989), A propos du signal non verbal en interprétat ion simultanée, The Interpreter's Newsletter 2 : 6-10.
L E D E R E R Marianne (1978), Les fondements théoriques de la traduction simultanée, thèse de doctorat, Université Paris HI. (1981a), La traduction simultanée, Paris, Lettres Modernes. (1981b), L a pédagogie de la traduction simultanée, in Delisle, Jean (réd) 1981:47-74.
L I B E R M A N N A .M. , C O O P E R F.S., S H A N K W E I L E R D.P., S T U D D E R T - K E N N E D Y M . (1967), Perception of the speech code, Psychological Review 74 : 431-461.
L O N G L E Y Patricia (1968), Conference Interpreting, London, Pitman. (1978), An integrated programme for training interpreters, in Gerver, David & H . Wallace Sinaiko (eds) 1978 : 45-56. (1989) , Aptitude Testing of Applicants for a Conference Interpretation Course, in Gran, Laura & John Dodds (eds) 1989: 105-108.
M A C K I N T O S H Jennifer (1983), Relay Interpretation : An Exploratory Study, M . A . thesis, Birkbeck College, University of London, unpublished.
252 DANIEL GILE
(1989), AIIC Training Committee Review Paper on Training Interpreter Trainers, in MÜS 1989, pages non numérotées .
M A R T I N Anne & P R E S E N T A C I Ó N Padilla (1992), Semejanzas y diferencias entre t raducción e interpretación : implicaciones metodológicas, Sendebar, Boletín de la escuela universitaria de traductores e interpretes de Granada 3 :175-184.
M A S S A R O Dominic (1975), Experimental Psychology and Information Processing, Chicago, Rand McNally.
M A T S U M O T O K.& K . M U K A I (1976), Eigotsûyaku he no michi (The Road to English Interpreting), Tokyo, Nihontsûyakukyokai.
M A T T H E I Edward & T H O M A S Roeper (1985), Understanding and producing speech, New York, Universe Books.
M A T Y S S E K H . (1989), Handbuch der Notizentechnik: ein Weg zur sprachunabhängigen Notation, Heidelberg, J. Groos, 2 Vol .
M E A K Lydia (1990), Interprétat ion simultanée et congrès médical : attentes et commentaires, The Interpreters Newsletter 3 :8-13.
Media et Langages NI6, octobre-novembre 1982. M I L L E R George (1962), Decision units in the perception of speech, IRE
transactions on information theory IT-8/2 : 81-83, repris dans Automatic speech recognition, Vol.11, Ha-79-81, University of Michigan, Ann Harbor, 1963. (1956), Langage et communication, Paris, P U E
M I Z U T A N I Nobuko (1985), Nichieihikaku hanashikotoba no bumpô (Grammaire comparée du japonais et de Yanglais parlés), Tokyo, Kuroshioshuppan.
M H S - M O N T E R E Y I N S T I T U T E O F I N T E R N A T I O N A L S T U D I E S 1989, Division of
Translation and Interpretation, Proceedings of Ahe Twentieth Anniversary Symposium on the Training of Teachers of Translation and Interpretation, Monterey.
M O R A Y N . (1967), Where is capacity limited ? A survey and a model, Acta Psychologica 27: 84-92.
M O R R I S Ruth (1989), The impact of court interpretation on the role performance of participants in legal proceedings, M.A. thesis, Communications Institute, Hebrew University of Jerusalem.
M O S E R Barbara (1976), Simultaneous Translation : Linguistic, Psycholin-guistic and Human Information Processing Aspects, PhD. thesis, University of Innsbruck, unpublished. (1978), Simultaneous Interpretation : a Hypothetical Model and its Practical Application, in Gerver, David & H . Wallace Sinaiko (eds) 1978:353-368.
M O S E R - M E R C E R B. (1985), Screening potential interpreters, Meta 30/1 : 97-100. (1991) , Research Committee - Paradigms gained or the art of productive disagreement, Bulletin de l'AIIC 19/2 : 11-15. (1992) , Banking on Terminology. Conference Interpreters in the Electronics Age, Meta 37/3 : 507-522.
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 253
M U R A M A T S U Masumi (1978), Watakushi mo eigo ga hanasenakatta (I couldn 't speak English either), Tokyo, The Simul Press. (1979), Zoku — Watakushi mo eiga ga hanasenakatta (I couldn 't speak English either : A sequel), Tokyo, The Simul Press.
N A M Y Claude (1988), Quinze ans d 'entra înement dirigé à l ' interprétation d'anglais et d'espagnol en français, Parallèles 9: 43-47. (1978) , Reflections on the training of simultaneous interpreters : a meta-linguistic approach, in Gerver, David & H . Wallace Sinaiko (eds) 1978:25-34. (1979) , D u mot au message : Réflexions sur l ' interprétation simultanée, Parallèles 2:48-60.
N G Bee Chin (1992), End-Users' Subjective Reaction to the Performance of Student Interpreters, The Interpreter's Newsletter, Special Issue 1:35-41.
N G Bee Chin & Yasuko O B A N A (1991), The Use of Introspection in the Study of Problems Relating to Interpretation from Japanese to English, Meta 36 /2 : 367-382. (1992), The Significance of Speech Levels in English-Japanese Interpretation, The Interpreter's Newsletter, Special Issue 1: 42-51.
N I A N G Anna (1990), History and Role of Interpreting in Africa, in Bowen, Margareta & David Bowen (eds) 1990: 34-36.
N I L S K I T. (1969), Conference Interpretation in Canada, Documents of the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism, 2, Queen's Printer for Canada.
N I S H T Y A M A Sen (1970), Tsûyakujutsu (The Art of Interpreting), Jistunichis-hinsho, Tokyo. (1979), Tsûyakujustu to watakushi (The Art of Interpreting: A personal experience), Purezidentosha, Tokyo. (1983), Speaking someone else's mind, Winds, JAL Inflight magazine, 5/7. (1988), Simultaneous Interpreting in Japan and the role of Television : a personal narration, Meta 33 /1 : 64-69.
N O I Z E T Georges (1980), De la perception à la compréhension du langage, Paris, PUF.
N O W A K - L E H M A N N Elke (1990), Bewusste und unbewusste Operationen beim Simultandolmetschen, in Arntz A. & G. Thome (eds) 1990, Übersetzungswissenschaft - Ergebnisse und Perspektiven, Festschrift für W. Wilss : 555-562 Tübingen, Gunter Narr Verlag.
O I D E Akira (1965), Nihongo to ronri (Le japonais et la logique), Tokyo, Kodanshagendaishinsho.
O L É R O N P. et N A N P O N H . (1964), Recherches sur la traduction simultanée, Journal de Psychologie Normale et Pathologique 62: 73-94.
O V A S K A Paula (1987), Unfilled pauses and hesitations in impromptu speech and simultaneous interpretation, unpublished M.A. Thesis, University of Turku.
P A N E T H Eva (1956), Training for interpreting, Modern Languages, 39/1.
254 DANIEL GILE
(1957), An Investigation into conference interpreting, thèse de M.A. non publiée, université de Londres.
P E R A L D I François (1982), Psychanalyse et traduction, Meta 27 /1 : 9-25. P E T E R F A L V I Jean-Michel (1970), Introduction à la psycholinguistique,
Paris, PUF. P E T S C H E H . (1993), Hirnelektrische Vorgänge bei verbalem Denken, Neu
ropsychiatrie 7 / 1 : 13-17. P F L O E S C H N E R F. (1961), L a bataille de la qualité est-elle perdue ?, L'inter
prète 3, Genève. P I N C H U K Isadore (1977), Scientific and Technical Translation, Boulder,
Colorado, Westview Press. P I N H A S René (1976), Petites ficelles syntaxiques et professionnelles à
l'usage des cabines françaises paresseuses ou rebelles à l'empirisme, Bulletin de l'AIIC A120.
P I N T E R ( K U R Z ) Ingrid (1969), Der Einfluss der Übung und Konzentration auf simultanes Sprechen und Hören, thèse de doctorat non publiée, université de Vienne.
P Ö C H H A C K E R Franz (1992a), Simultandolmetschen als komplexes Handeln, thèse de doctorat, Geisteswissenschaftliche Fakultät der Uni-versitt Wien, septembre. (1992b), The role of theory in simultaneous interpreting, in Dollerup, Cay & Anne Loddegaard (eds) 1992 : 211-220.
P R I A C E L Stéphane (1957), L a prise de notes en interprétation consécutive, Babel3/l.
Q U I C H E R O N Jean-Baptiste (1985), L'interprète et les obstacles inhérents au multilinguisme, Multilingua 5 /1 : 15-20.
R E I S S Katharina (1983), Quality in Translation oder wann ist eine Übersetzung gut ? Babel 29/4.
R E U C H L I N Maurice (1969), Les méthodes en psychologie, Paris, PUF. R I C H A R D Jean-François (1980), L'attention, Paris, PUF. R I C H A U D E A U François (1973), Le langage efficace, Paris, Denoël.
(1981), Linguistique pragmatique, Paris, Retz. R O B E R T Michèle (1988), Recherche scientifique en psychologie, St-
Hyacinthe, Québec, Edisem et Paris, Maloine. R O J A S J. (1987), A Survey on job satisfaction of free-lance (and perma
nent) conference interpreters domiciled in the Geneva area, Term paper (Integrated Studies in Human Resources), Webster University.
R O M E R Thérèse (1985), Le métier d ' interprète - d'hier à demain, Meta 30/1:101-105.
R O O T H A E R R. (1978), Ein Modell für das Simultandolmetschen, Mitteilungsblatt für Dolmetscher und Übersetzer, N ° 2,3,4.
R O Z A N Jean-François (1953), Remarques sur l'automatisme de l'interprétation, L'interprète, Genève, 1. (1959), La prise de notes en interprétation consécutive, Genève, Georg.
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 255
Russo Macchiara (1990), Disimetrías y Actualización : Un experimento de interpretación simultanea (español-italiano), in Gran, Laura & Christopher Taylor (eds) 1990: 158-225.
S A C H S J.S. (1967), Recognition memory for syntactic and semantic aspects of connected discourse, Perception and Psychophysics 2 : 437-442.
S A G E R Juan (1992), The translator as terminologist, in Dollerup, Cay & Anne Loddegaard (eds) 1992 : 107-122.
S A L E V S K Y Heidemarie (1982), Z u einigen grammatischen Problemen der probabilistischen Prognostizierung beim Simultandolmetschen aus dem Russischen ins Deutsche, Fremdsprachen 26/3. (1983), Allgemeine und spezielle Probleme des Simultandolmetschens als einer spezifischen Art der Redetätigkeit, Dissertation, Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät , Humboldt Universität, Berlin. (1987a), Probleme des Simultandolmetschens. Eine Studie zur Handlungsspezifik, Berlin, Linguistische Studien, 154. (1987b), Probleme einer allgemeinen Translationstheorie (Zu einer Grundfrage der Übersetzungswissenschaft) , Berichte, Berliner Beiträge zur Übersetzungswissenschaft. 7 Jg., Heft 17 : 6-18.
S C H J O L D A G E R Anne (1993), Investigating SI Skills : Methodological and didactic reflections, Hermes 10-1993 : 41-52, Aarhus.
S C H W E D A - N I C H O L S O N Nancy (1985), Consecutive interpretation training : videotapes in the classroom, Meta 30 /2 : 148-154. (1986), A United Nations Interpreter Survey : The specialist/gener-alist controversy I, Multilingua 5/2 : 67-80. (1989) , An Interpreter Survey. The specialist/generalist controversy II, The Interpreter's Newsletter 2:38-45. (1990) , The Role of Shadowing in Interpreter Training, The Interpreter's Newsletter 3:33-37.
S E L E S K O V I T C H Dánica (1968), L'interprète dans les conférences internationales : problèmes de langage et de communication, Paris, Minard Lettres Modernes. (1975), Langage, langues et mémoire, Paris, Minard Lettres modernes. (1977), Take Care of the Sense and the Words Wil l Take Care of Themselves or Why Interpreting is not Tantamount to Translating Languages, Bulletin de l'AIIC 5/3 : 76-86. (1981), L'enseignement de l ' interprétation, in Delisle, Jean (red.) 1981:23-46. (1989), The State of the Art, in M Ü S 1989 : pages non numérotées .
S E L E S K O V I T C H Dánica & Marianne L E D E R E R (1984), Interpréter pour traduire, Paris, Didier Erudition. (1989), Pédagogie raisonnée de l'interprétation, Traductologie, N° 4, Paris, Didier Erudition.
S E T T O N Robin (1991a), Training Chinese-English Conference Interpreters, Cultural Factors, paper given at the Third International Conference
256 DANIEL GILE
on Cross-Cultural Comunication, East-West Chengkung University, Taiwan, April 1-6, 1991. (1991b), Training Conference Interpreters with Chinese Problems and Prospects, Paper given at the Asia-Pacific Conference on Translation and Interpreting : Bridging East and West, Hong Kong University, 28-30 October 1991. (1993), Is Non-Intra-IE Interpretation Different ? European Models and Chinese-English Realities, Meta 38 /2 : 238-256.
S H I N O D A Eiko & Ryuko S H I N Z A K I (1992), Eigo wa onna wo kawaru (Interpreting Women: Personal Perspectives on Communication), Tokyo, Hama no shuppan.
S H I R Y A E V A.F. (1979a), Sinchronnyi Perevod, Moscou. (1979b), Simultaneous Interpretation, The Activity of a Simultaneous Interpreter and Methods of Teaching Simultaneous Interpretation, Moscow (en russe, éditeur inconnu).
S H L E S I N G E R Mir iam (1989), Simultaneous Interpretation as a factor in effecting shifts in the position of texts on the oral-literate continuum, M.A. thesis, Faculty of Humanities, Tel Aviv University. (1992), Intonation in the Production and Perception of Simultaneous Interpretation, Paper presented at the Conference « Translation Studies — An Interdiscipline », Vienna, 9-12 septembre 1992.
S L A M A - C A Z A C U Tatiana (1961), Langage et contexte, L a Haye, Mouton & Co.
S N E L L - H O R N B Y Mary (1992), The professional translator of tomorrow : language specialist or all-round expert ?, In Dollerup, Cay and Anne Loddegaard (eds) 1992 : 9-22.
S N E L L - H O R N B Y Mary, Franz P Ö C H H A C K E R & Klaus K A I N D L (eds) (1993), Translation Studies : An interdiscipline, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.
S P I L L E R - B O S A T R A Edith & Valeria D A R O (1992), Delayed Auditory Feedback Effects on Simultaneous Interpretation, The Interpreters Newsletter 4: 8-14.
S T E N Z L Catherine (1983), Simultaneous Interpretation — Groundwork Towards a Comprehensive Model, M.A. thesis, Birkbeck College, University of London, unpublished. (1989), From Theory to Practice and from Practice to Theory, in Gran, Laura & John Dodds (eds) 1989: 23-26.
S T R O L Z Birgit (1992), Theorie und Praxis des Simultandolmetschen, thèse de doctorat, Geisteswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien.
S T U D D E R T - K E N N E D Y Michael (1974), The perception of speech, in Sebeok, Thomas A. (ed) 1974, Current Trends in Linguistics, L a Haye et Paris, Mouton, Vol . X I I : 2349-2385.
S U Z U K I Atsuko (1988), Aptitudes of translators and interpreters, Meta 33/1:108-114.
T H I É R Y Christopher (1974), Can Simultaneous Interpreting Work ? Bulletin de l'AIIC 2 : 3-5.
REGARDS SUR LA RECHERCHE E N INTERPRETATION DE CONFÉRENCE 257
(1975), Le bilinguisme chez les interprètes de conférence professionnels, thèse de doctorat de 3 e cycle, Université Paris EX, non publiée. (1981), L'enseignement de la prise de notes en interprétat ion consécutive : un faux problème ? in Delisle, Jean (réd.) 1981: 99-112. (1985), L a responsabilité de l ' interprète de conférence professionnel ou pourquoi nous ne pouvons pas écrire nos mémoires , Meta 30/1 : 78-81.
T I R K K O N E N - C O N D I T Sonja (ed) (1991), Empirical Research in Translation and Intercultural Studies, Tübingen, Gunter Narr Verlag.
T I R K K O N E N - C O N D I T Sonja and John L A F F L I N G (eds) (1993), Recent trends in empirical translation research, Studies in Languages 28, University of Joensuu.
T O M M O L A Jorma & Jukka H Y Ö N Ä (1990), Mental load in listening, speech shadowing and simultaneous interpreting : a pupillometric study, in Tommola, Jorma (ed.), Foreign Language Comprehension and Production, AF inLA Yearbook 1990, Turku.
T O M M O L A Jorma & Pekka N I E M I (1986), Mental load in simultaneous interpreting : an on-line pilot study, in Evensen, I. (ed.) 1986 : Nordic Research in Text Linguistics and Discourse Analysis.
T O U R Y Gideon (1980), In Search of a Theory of Translation, Tel-Aviv, The Porter Institute for Poetics and Semiotics. (1991) , Experimentation in Translation Studies : Achievements, Prospects and some Pitfalls, in Tirkkonen-Condit, Sonja (ed) 1991 : 45-66.
T R E I S M A N A. (1965), The effects of redundancy and familiarity on translating and repeating back a foreign and a native language, British Journal of Psychology 56 : 369-379.
T S E N G Joseph (1992), Interpreting as an emerging profession in Taiwan -A sociological model, M.A. thesis, Graduate Institute of Translation
. and Interpretation Studies, F u Jen Catholic University, Taipei. U C H T Y A M A Hiromichi (1991), Problems Caused by Word Order when
Interpreting/Translating from English to Japanese : The Effect of the Use of Inanimate Subjects in English, Meta 36/2-3 : 405-414. (1992) , The Effect of Syntactic Differences in English-Japanese Interpreting : Premodifying Adjectives in English, The Interpreter's Newsletter, Special Issue 1: 52-59.
" V A N H O O F Henri (1962), Théorie et pratique de l'interprétation, München, Max Hueber Verlag.
V A R A N T O L A Krista (1980), On Simidtaneous Interpretation, Turku, Publications of the Turku Language Institute, N . l .
V I A G G I O Sergio (1988), Teaching Interpretation to Beginners : Or How Not to Scare Them to Death, in Hammond, Deanna (ed) 1988: 399-406. (1992), Translators and interpreters : professionals or shoemakers ?, in Dollerup, Cay & Anne Loddegaard (eds) 1992: 307-314.
258 DANIEL GILE
V I E Z Z I Maurízio (1990) , Sight Translation, Simultaneous Interpretation and Information Retention, in Gran, Laura & Christopher Taylor (eds) 1 9 9 0 : 5 4 - 6 0 .
W A R R E N R . M . (1970) , Perceptual restoration of missing speech sounds, Science 1 6 7 : 392-393.
W A T A N A B E Shoichi (ed) (1991) , Gaikokugokyôiku no ikkan to shite no tsûyakuyôsei no tame no kyôikunaiyôhôhô no kaihatsu sôgôkenkyû (Research on interpretation training methodology as a part of foreign language training), Tokyo, University of Sophia, rapport non publié.
W E B E R Wilhelm (1984) , Training Translators and Conference Interpreters, Orlando, San Diego, New York, Toronto, London, Sydney, Tokyo, Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
W E S E N F E L D E R Ralph (1982) , 50 'trucs' pour réussir une réunion, Paris, Les Editions d'Organisation.
W I L S S Wolfram (1978) , Syntactic anticipation in German-English simultaneous interpretation, in Gerver, David & H . Wallace Sinaiko (eds) 1 9 7 8 : 3 3 5 - 4 3 .
Z E L L E R C M . (1984) , Ursachen und Auswirkungen der Feminisierung im Dolmetsch/Übersetzerstudium und Beruf, Diplomarbeit, Universität Wien.
Z I P F G.K. (1949) , Human Behavior and the Principle of Least Effort, Cambridge, Massachussets, Addison-Wesley.
Index des noms
A
Acta Universitatis Carolinae Trans-latologica Pragensia, 68
AIIC, 13, 21, 26, 28, 78, 145, 152, 161, 165, 169, 170, 175, 178, 179, 180, 186, 314, 216, 224, 232, 234
Aitchison, 90 Alessandrini, 77 Alexieva, 71, 72 Allioni, 141, 178 Altman, 77 American Translators Association,
70 Anderson, 61, 71, 72, 207, 208, 214 Andronikoff, 135 Arencibia Rodriguez, 71 Arjona-Tseng, 230 Asano, 34, 99, 116, 198, 204 Association des amis de l'ESIT, 182 Avirovic, 76
B
Babbie, 225 Balzani, 214 Barik, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 47,
49, 151 Bertone, 60, 154 Bowen, 67, 70
Brisset, 53 Bros-Brann, 151 Bühler, 67, 161, 162, 164 Bulletin de l'AIIC, 28, 48, 145, 146,
165,232
C
Capaldo, 27, 59 Carroll, 145, 152, 186 Cartellieri, 27, 42, 99, 113, 152 Cenkova, 41, 76 Cerrens, 59 Chaire C E R A , 238 Chernov, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 49,
58, 59, 113 Cherry, 90 Clark, 90,115 Coleman-Holmes, 24, 27, 150 Commission des Communau té s
européennes , 217 Condon, 203 Cooper, 60 Costermans, 115
D
Daro, 74, 77, 82,219 Davidson, 63, 76, 206 Davies, 60
260 DANIEL GILE
De Clarens, 186 Déjean Le Féal, 45, 165, 182, 189,
194, 196 Delisle, 57, 177 Dillinger, 19, 32,71,77, 221 Dodds, 49,61,63, 167, 177, 230 Dollerup, 66, 167 Donovan, 70, 151, 152
E
Eberstark, 27, 59 Ecole de Genève ETI - Genève, 28,
35, 62, 67, 68,152, 178 Ecole de l'université de George
town, 26, 50, 67, 70 Ecole de l'université de Heidel
berg, 50, 52, 67, 140 Ecole de l'université de Vienne,
67, 75 Ecole de Trieste (SSLM de l'uni
versité de Trieste), 49, 50, 52, 60,61,65,66,78,234, 236, 238
ESIT, 21, 22, 29, 33, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 62, 69, 70, 88, 168, 169, 177, 180, 182, 186, 195, 223,225
EST-European Society for Translation Studies, 67
ETI voir école de Genève Eysenck, 94, 99
F
Fabbro, 72, 73 Feldweg, 198 Flores d'Arcáis, 113 Fodor, 115 Fourastié, 208 Francis, 178 Frankfort, 225 Frankfort-Nachmias, 225 Fuchs-Vidotto, 35 fukui i , 34, 99, 116, 198, 204 Fusco, 76, 206
G
Galer, 27 Galli, 77 Gambier, 66 Garcia Landa, 57 Garrett, 115 Gémar, 218 Gentile, 63 Germersheim, 50 Gerver, 7, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 45, 46, 48, 49, 58, 77, 172, 177, 230
Giambagli, 76, 206 Gile, 12, 18, 19, 32, 33, 34, 35, 43,
46, 59, 62, 64, 70, 76, 78, 85, 88, 108, 111, 116, 120, 122, 124, 128, 153, 161, 163, 165, 167, 178, 182, 183, 187, 192, 195, 196, 198, 200, 202, 203, 213, 217, 227, 229, 230, 238
Gladstone, 129 Glaesser, 60 Goldman-Eisler, 19, 37, 38, 39, 40,
46, 49, 90 Graesser, 93 Gran, 22, 49, 59, 61, 63, 66, 72, 73,
167, 177, 230 Green, 74 Gringiani, 174
m
Haensch, 60 Halliday, 45 Hannah, 207 Hara, 203 Harris, 120 Haton, 94 Hayashi, 199 Hedinger, 35 Henderson, 59, 172 Herbert, 11, 32, 33, 34, 60, 68,
189,211
R E G A R D S S U R LA R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 261
Hof er, 171 Hörmann , 95 Hyönä, 117
I
LTET, 63 Ikeda, 200 Hg, 28, 35, 59, 68, 113, 135, 152,
167, 182, 198, 230 Ilic, 74 Informaciones SUT, 71 International Christian University,
50 Interpreting Research Association
of Japan, 64, 65, 236 IRTIN, 78, 234 IRTINBulletin, 9, 28 Isham, 70 ISIT (Mexico), 71 ISIT (Paris), 66, 173, 177, 182, 238 Iwabuchi, 200 Izumi, 65, 77
J
Jakobson, 196 Japan Association of Translators,
63
K
Kade, 42,99, 113 Kahnemann, 92 Kanayama, 34, 198, 200 Kanno, 200 Keane, 94, 99 Keiser, 170, 171, 173, 174, 186 Key Center for Asian Languages
and Studies, 63, 65 Kindaichi, 200 Kirchhoff, 58, 59 Kolers, 91 Kolmer, 60
Komissarov, 218 Kondo, 60, 64, 65, 76, 203, 236 Kopczynski, 71,72, 164 Krusina, 38 Kunihiro, 34, 198, 200 Kurita, 200 Kurz , 27, 41, 60, 67, 73, 75, 117,
135, 161, 162, 163, 198,217, 232
L
L'interprète, 31 Laffling, 66 Lafrance, 182 Lambert, 71, 72, 74, 77, 173, 179 Lambert W.E., 152 Lampe-Gegenheimer, 59 Lawson, 37 L e N y , 96, 113, 198 Le petit journal, 35 Lederer, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 70,
85, 99, 113, 114, 128, 134, 154, 167, 177, 180, 185, 186, 189, 190, 197, 198,209,210
Liberman, 94, 95 Liénard, 94 Lindegaard, 66, 167 Loddegaard, 66, 167 Longley, 24, 25, 172, 173
M
Mackintosh, 61, 168 Massaro, 96 Matthei, 90 Matyssek, 141 Meak, 162 Média et langages, 188 Meta, 203 MŒS-Monterey Institute for Inter
national Studies, 70, 167, 168, 174
Miller, 94, 95, 96, 138 Mizutani, 203 Moray, 92
262 DANIEL GILE
Morris, 71,138,149 Moser, 57, 58, 99, 113, 173, 174,
213 Moser-Mercer, 52, 67, 68, 77,218 0 Muramatsu, 26, 200
Quicheron, 27
N
NAATI, 176 Namy, 27, 33, 152 Nanpon, 36, 37,46 Ng, 63 N H K , 35 Niemi, 73, 117,219, 232 Nishiyama, 25, 26, 34, 60, 198, 200 Noizet, 94, 115 Nowak-Leeman, 33, 46 Nuremberg, 26, 60
R
Ramler, 60 Reuchlin, 209 Richard, 92, 96, 98 Richaudeau, 114, 115, 116, 201 Robert, 225 Roeper, 90 Rojas, 60 Romer, 27 Rozan, 32, 33, 68, 167 Russo, 76, 206
O
Oide, 200 Oléron, 36, 37, 46 Ovaska, 19, 76
P
Paneth, 35, 36, 167 Parallèles, 28, 68 Peraldi, 208 Peterfalvi, 114 Petsche, 117 Pinchuk, 138 Pinhas, 198 Pinter, 41, 45, 183,207, 208 Pöchhacker, 67, 85, 155, 235 Pollack, 94 Polytechnic of Central London,
172, 173, 178 Priacel, 35
Sachs, 121, 134 Sager, 218 Saito, 203 Salevsky, 49, 67, 76, 206, 235 Schjoldager, 32 Schweda-Nicholson, 59, 70, 74 Seleskovitch, 21, 22, 25, 33, 37, 54,
55, 56, 57, 70, 85, 113, 122, 128, 135, 152, 154, 167, 169, 170, 171, 177, 180, 185, 186, 187, 189, 196, 197, 198, 209,210,218
Setton, 76 Shannon, 91 Shinoda, 26 Shinzaki, 26 Shiryaev, 40, 58, 59 Shlesinger, 71, 72, 81, 156, 165, 231 Sinaiko, 49, 177, 230 Skinner, 95 Skuncke, 170 Slama-Cazacu, 95 Snell-Hornby, 52, 67 Spiller-Bosatra, 77,219
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE
SSOTT-Scandinavian Symposium on Translation Theory, 66
Stenzl, 46, 47, 52, 61, 143, 151, 152, 207, 208, 209/ 230, 235
Strolz, 67, 85, 179, 198 Studdert-Kennedy, 95 Suzuki, 172
V
Van Hoof, 31, 32, 33,35 Varantola, 152 Viaggio, 218 Viezzi ,41,77, 183
T
Target, 238 Taylor, 22, 66, 73 The Interpreters Newsletter, 9, 22,
28, 66, 73, 76, 78, 234 The Jerome Quarterly, 26, 70 Thiéry, 27, 59, 168, 190 Tirkonnen-Condit, 66 Tommola, 66, 73, 117, 219, 232 Toury, 28,215 TRANSST, 78 Treisman, 36, 37, 46 Tseng, 69 Tsûyakurironkenkyû (Interpreting
Research), 64, 78 Tung, 60
W
Warren, 95 Watanabe, 64,217, 238 Weber, 24, 70, 152, 154, 168 Wesenfelder, 24 Wüss, 99, 113, 198
Zeller, 60, 67 Zimnyaya, 40 Zipf, 138
U
Uchiyama, 76, 206 Union Soviétique, 51, 53 Université catholique de Lou vain,
238 Université Charles de Prague, 68,
69 Université d'Ottawa, 71 Université de Graz, 67 Université de Turku, 66, 238 Université du Queensland, 176 Université Fu-Jen, 69 Université Heriot-Watt, 77 Université MacGil l , 77 Université Sainte Sophie, 64, 65,
238 University of Sydney MacArthur,
63
Index des termes e í concepts
L a structure du livre et sa table des matières détaillée ont été conçues pour permettre de trouver facilement les sections où sont traités les différents concepts. Cet ' index est composé à titre complémentaire, notamment pour permettre de trouver des définitions et pour attirer l'attention sur quelques passages où sont ment ionnés les concepts ci-dessus et auxquels le lecteur pourrait ne pas penser spontanément .
A
accents, 107, 139 air (qualité de l'air), 44 aisance (apparente de l 'interprète),
137 Allgemeine Translationswissen
schaft, 235 anticipation, 42, 59, 201, 202 aptitudes, 13, 45 attitudes, 139-140, 230 automatismes, 33
B
bruit, 38, 122
C
calque, 97, 98 charge mentale', 117 chiffres, 108
chuchotée, 12 chunks, 96 client, 15, 149 compression de texte, 37, 38 conditions de travail, 139, 160 consécutive sans notes, 177 constituants, 39 contraintes liées à l ' interprétation,
148-149 convictions personnelles, 147, 148 correction grammaticale, 162, 164 créativité, 17
D
débit du discours, 37 décalage entre réception et refor
mulation, 12 décisions, 33 déficit individuel, 101 déficit informationnel, 18, 96, 97 délégués, 15
266 DANIEL GILE
densité informationnelle des discours, 210
déontologie, 13, 133, 136, 139, 143 désinences, 115 'déverbalisation', 91, 196 dialogue interpreting, 12 disponibilité des connaissances,
125 disponibilité linguistique, 32, 190
E
écarts, 88 Effort de lecture, 111 E V S — Ear-Voice Span, 36, 38,
39,41,47, 48, 134 expérimentation ouverte, 30
F
fatigue, 139, 195 faux amis, 193 fins de phrase, 116, 201 fission, 39 fluidité du discours, 162 flux d'informations, 12 formation à l ' interprétation vers le
B , 179, 180 fusion, 39
G
grammaire des notes, 141
H
homophones, 35, 62, 199, 200
I
image de l 'interprète, 17, 140 indicateurs physiologiques, 117
informations primaires, 136-137 informations secondaires, 123 intérêts communicationnels, 138 interférence verbale-manuelle, 75 interférences linguistiques, 91, 97,
98, 112, 113, 130, 194 interprétat ion communautaire, 12,
148, 176 interprétation d'affaires, 12 interprétat ion de conférence, 12 inteprétation de liaison, 12, 146 'interprétation mentale', 75, 118 interprète passif, 130, 140 'irritants', 164, 165
J
'jugement', 33
K
kango, 199, 200
L
langage de la procédure , 188 langue A, 186 langue B, 186 langue C, 186 langue des signes, 70 latence, 103, 117 lexicométrie, 196 liberté syntaxique, 116 longueur des énoncés, 204 loyauté professionnelle, 137 loyauté tournante, 150
M
'mémorisation' , 177 message, 120, 121 modèle flottant, 33 mots outils, 115
R E G A R D S S U R LA R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 267
N
naturaliste (démarche-), 8, 29 noms propres composés, 107 noms propres simples, 108 normes, 14, 88, 151,230
O
observationnelle (démarche-), 29 ouvrages de vulgarisation, 128
P
pauses, 37, 39, 40, 76, 97 pertes, 35, 136 précision de la consécutive, 32 prédicteurs, 115, 202 préparation continue, 126 préparat ion terminologique, 127 préparat ion thémat ique, 127 probabilités transitionnelles, 95,
114 procédures judiciaires, 138 pronostic probabiliste', 59 prosodie, 13,45, 111, 120 pseudo-compréhension, 18-19 pupille, 117
R
radio, 137, 157 recherche appliquée, 23 recherche empirique, 51 réglementation, 12 remplissage, 130 rendement du discours, 16 respectabilité scientifique, 231 richesse lexicale, 204 rythme, 37, 90, 97, 109
S
S A C A L - Système de traitement général à capacité limitée, 92
santé, 60, 139 saturation, 100 segmentation du discours, 38 seuil de confort, 19 shadowing, 32, 38, 57, 74, 75, 117,
174, 179 signification linguistique', 57 simultanée, 12 simultanéité, 41 situations authentiques, 56 souplesse grammaticale, 204 statut des interprètes, 60, 160, 170 stress, 60, 195 syllabes, 37, 38 symboles, 141
T
TAP - Think Aloud Protocols, 215 télévision, 137, 157 tension nerveuse, 140 tests de Cloze, 173 textes écrits, 45 textes lus, 107 Textlinguistik, 68 'théorie du sens', 33, 54, 55, 57,
185, 189,212 trac, 195 trace phonique, 134 trace sémant ique, 134 traduction, 14 traits discriminants, 95 'transcodage', 55 transformations grammaticales,
76, 77 Translationswissenschaft, 67
268 DANIEL GILE
U
unités de sens', 38, 57, 58
V
vision directe, 214 vulnérabilité des interprètes, 160
Table des tableaux et illustrations
• Schéma de la communication avec interprétat ion en réunion multilingue 15
• Nombre moyen d'écarts par 100 mots de discours en français . . . . . . 88
• Représentat ion schémat ique de la capacité de traitement dépensée lors de l ' interprétation simultanée d'une phrase simple comportant un segment dense 104
9 Dessin utilisé pour une expérience sur renonciation . . . . . . . . . . . . . . . . 123
• L'axe de communication central en interprétat ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
• Le cadre de communication en interprétat ion de conférence . . . . . . . 148
• Le modèle gravitationnel de la disponibilité linguistique . . . . . . . . . . . . 191
9 L'interprétation comme processus . . 213
Table des matières
I N T R O D U C T I O N 7
C H A P I T R E 1
La recherche sur l'interprétation : un cadre général
1. L'interprétation de conférence : r a p p e l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. L'interprétation de conférence comme objet de recherche . . 14
2.1 La recherche sur l'interprétation dans son cadre propre . . . . . . . . . . . — 14 2.1.1 Traduction et interprétat ion : quelques diffé
rences 14 2.1.2 Champs d'investigation . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . 15
2.2 La recherche sur l'interprétation comme cas particulier de communication verbale — . . 18
2.3 Les effets sociologiques et culturels de l'interprétation . 19 3. Auteurs et chercheurs dans les publications sur l'in
terprétat ion — . — . . . 20 3.1 Les interprètes-chercheurs 20
3.1.1 L a disponibilité — 21 3.1.2 L a motivation 21 3.1.3 L a formation à la recherche 23
3.2 Les étudiants en interprétation . . . . . . . . . . . . . — . . . . — 24 3.3 Les interprètes non chercheurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.4 Les chercheurs extérieurs'............................. 24
4. Types de textes et démarches de r e c h e r c h e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4.1 Les textes introductifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4.2 Les textes factuels professionnels....... — . . . . . . . . . . . . 26 4.3 Les textes anecdotiques 26 4.4 Les textes historiques................................... 26 4.5 Les textes 'réflexifs'ou de réflexion'. — . . . . . . — . . . . . 27 4.6 Les textes normatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.7 Comptes rendus et bibliographies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
272 DANIEL GILE
4.8 Les textes théoriques . . . . . . . . . 29 4.9 Les textes relevant de la recherche empirique . . . . . . . . . . 2 9
4.9.1 Les textes observationnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 4.9.2 Les textes expér imentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9
C H A P I T R E 2 Historique de la recherche sur l'interprétation
1. Les premiers écrits .., 31 2. L a période expérimentale des années 6 0 — 3 6
2.1 Présentation des travaux 3 6 2.2 Un examen critique des travaux expérimentaux.. 4 2
2.2.1 Les sujets — 43 2.2.2 Les matér iaux — . — . 4 5 2.2.3 Les conditions expérimentales 4 6 2.2.4 Les définitions, inferences et évaluations 4 6
3. L a période des praticiens : les années 7 0 et 8 0 4 8 3.1 Introduction 4 8 3.2 Caractéristiques générales de la période 4 9
3.2.1 Une activité de recherche m e n é e par des praticiens - ens eignants — . 4 9
3.2.2 L'essentiel des travaux est de type réflexif ou théorique • 5 0
3.2.3 Des travaux fortement cloisonnés 5 2 3.3 La « théorie du sens » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 3.4 Thèmes et réalisations 5 6
3.4.1 L a formation . . . . . . . . . . . . . . — 5 6 3.4.2 Les modèles de l ' interprétation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 3.4.3 Autres études et thèmes 5 9
C H A P I T R E 3 Tendances récentes dans la recherche sur l'interprétation
1. Introduction • 61 2. Les centres nouveaux ou en renouvellement 6 2
2.1 VAustralie. 63 2.2 Le Japon 6 4 2.3 Trieste 6 5 2.4 La région Scandinave...— . . . . . — 6 6 2.5 L'Autriche 6 7 2.6 L'Allemagne — . . . 6 7 2.7 La Suisse — 6 8 2.8 Les républiques tchèque et slovaque 68 2.9 L'Asie hors-Japon 6 9
3. Autres centres et activités individuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 3.1 La France. — 6 9 3.2 Les Etats-Unis 7 0 3.3 Le Canada 7 0 3.4 L'amérique latine.... — 71
R E G A R D S S U R L A R E C H E R C H E E N INTERPRETATION D E CONFÉRENCE . 273
3.5 Autres pays — . . . — . — . . . . . . . . . . . . 71 4. Nature et thèmes de la r e c h e r c h e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.1 Etudes neurophysiologiques — 73 4.2 Etudes sur la spécificité linguistique de l'interprétation 75 4.3 Autres sujets... — . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5. L a c o m m u n i c a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . — 78 6. Conclusion.. — 79
C H A P I T R E 4 Les modèles d'Efforts de l'interprétation
I. Introduction . . . . . . . . — . . . . . . . . 81 2. De la difficulté d ' interpréter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
2.1 Exemple................................................ 82 2.2 Les fautes et maladresses en interprétation : fréquence
et importance........................................... 84 3. Fautes et maladresses non liées aux processus mentaux de
l ' interprétation 86 3.1 Problèmes environnementaux.......................... 86 3.2 Connaissances et compréhension de l'interprète . . . . . . . 87
4. Les contraintes de l ' interprétation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 5. Opérations automatiques et non automatiques 91 6. Les Efforts en interprétat ion s i m u l t a n é e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.1 Les trois Efforts.. — 92 6.2 Les Efforts sont-ils automatiques ? . . . . . — . . . . . . . . . . . . 94
6.2.1 L'Effort d 'écoute 94 6.2.2 L'Effort de production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 6.2.3 L'Effort de mémoi re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
7. Le modèle d'Efforts de la s imultanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 7.1 Présentation du modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 7.2 Les défaillances. 100
7.2.1 Sources de défaillances 100 7.2.2 Les manifestations des défaillances . . . . . . . . . . . . . . 101 7.2.3 Les enchaînements déficitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
8. Les d é c l e n c h e u r s . . . . — .. • 106 8.1 Déclencheurs par augmentation des besoins en capa
cité de traitement — 106 8.2 Segments de discours vulnérables à l'écoute . — . . . . . . . 108
9. Le modèle d'Efforts de la consécutive . . — 108 10. Les Efforts en traduction à vue et en simultanée avec texte . 111 II . L'anticipation 112
11.1 Les effets potentiels de l'anticipation 113 11.2 L'anticipation linguistique......... — . . . . . . . . — . . . . . 114
12. Réalité et perspectives dans les modèles d'Efforts sous l'angle de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . 116
274 DANIEL GILE
C H A P I T R E 5 Stratégies et tactiques de l'interprète
1. Stratégies fondamentales de fidélité — . — • 1 1 9 1.1 Qualité et fidélité 1 1 9 1.2 Liberté et fidélité 1 2 0 1.3 Une expérience dénonciation 122 1.4 Priorités dans la fidélité 125
2. Stratégies de préparat ion ad hoc des conférences . . . . . . . . . . . 125 2.1 La préparation ad hoc 126 2.2 Préparation thématique et préparation terminologique. 126 2.3 Un cas d'espèce . . , 128
3. Stratégies et tactiques en ligne — 129 3.1 Les tactiques en simultanée — 129 3.2 Critères de choix des tactiques — 136 3.3 Les stratégies et tactiques en consécutive — 140 3.4 Les stratégies et tactiques en traduction à vue et en simul
tanée avec texte 141 3.5 Tactiques face aux erreurs de l'orateur 142 4. Commentaires m é t h o d o l o g i q u e s . . . . . . — . — . — . . — . . . 142
C H A P I T R E 6 La qualité en interprétation de conférence
1. Introduction — 145 2. Le cadre de la communication en interprétation de con
férence — . — 146 2.1 L'interprète est-il le « double » de l'orateur ? . . . . . . . . . . . . 146 2.2 Les forces en p r é s e n c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |47 2.3 La fidélité. 151
3. L a perception de la qualité . . . . — 151 3.1 La fidélité informationnelle du discours de l'interprète. 152 3.2 Qualité de l'enveloppe'du discours de l'interprète*..... 155 3.3 Autres aspects de la qualité du travail 156
4. Aspects méthodologiques de la recherche sur la qualité . . . . . 158 4.1 Problèmes d'accès 158 4.2 Recherches empiriques publiées et en cours — . . . — 161
C H A P I T R E 7 La recherche sur la formation à l'interprétation de conférence
1. Introduction 167 2. Idées consensuelles 169 3. Aptitudes à l ' interprétation et sélection 171
3.1 Les aptitudes fondamentales 171 3.2 Les tests d'admission 173 3.3 Sélection en cours et en fin de parcours........... . 175
4. Les méthodes de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 4.1 La formation à la consécutive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
R E G A R D S S U R LA R E C H E R C H E E N INTERPRÉTATION D E CONFÉRENCE 275
4.1.1 Premiers contacts — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 4.1.2 L a consécutive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
4.2 La formation à la simultanee . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . 178 4.3 Les cours périphériques..................................... 181
4.3.1 Les cours d'acquisition de connaissances thématiques — 181
4.3.2 Les cours de perfectionnement linguistique 181 4.3.3 Les cours « théoriques » 182
5. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
C H A P I T R E 8 Aspects linguistiques de l'interprétalion
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 2. Les besoins linguistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
2.1 Etendue des connaissances............................. 186 2.2 La disponibilité linguistique et le Modèle gravitationnel 189 2.3 La robustesse de la maîtrise linguistique . . . . . . . . . . . . . . . 194 2.4 Le perfectionnement linguistique 196
3. L a spécificité de l ' interprétation par langues . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 3.1 Introduction 196 3.2 Différences potentielles dans la compréhension du
discours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 3.2.1 Les mots 199 3.2.2 Les redondances grammaticales . . . . . . . . — . . . . . 200 3.2.3 Les structures de phrases 201 3.2.4 Eléments culturels 202
3.3 Différences potentielles dans la production du discours 203 3.4 Les différences entre langue de départ et langue d'ar
rivée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
C H A P I T R E 9 La recherche en interprétation : données et stratégies
1. De la réflexion spéculative à la recherche empirique . . . . . . . . 207 1.1 Introduction 207 1.2 La réflexion spéculative dans lu recherche sur l'in
terprétation 208 1.3 Réflexion spéculative contre recherche scientifique..... 211 1.4 L'interprétation comme objet de recherche. 213
2. Les problèmes de la recherche empirique en interprétation . 216 2.1 La variabilité des situations — 216
• 2.2 L'accessibilité des sujets — 217 2.3 Un environnement professionnel peu incitatif à la
recherche — 218 2.4 L'in. ter disciplinante 219 2.5 La complexité du phénomène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
3. Perspectives et stratégies 221 3.1 L'incitation à la recherche.............................. 222
.276 DANIEL GILE
3.2 La formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 3.3 Les strategies de recherche , 226
3.3.1 De petits projets 226 3.3.2 Des projets méthodologiquement s imples . . . . . . . . 227 3.3.3 L a replication .. — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 3.3.4 Exemples de projets pour étudiants et prati
ciens débutan t dans la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . 228 3.3.5 Une recherche interdisciplinaire . . . . — . . . . . . . . . 230
3.4 Stratégies de communication — 232 3.4.1 L a communication avec la profession . . . . . . . . . . . 232 3.4.2 L a communication avec la c o m m u n a u t é scien
tifique . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 3.4.3 L a communication au sein de la c o m m u n a u t é
des praticiens chercheurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
C O N C L U S I O N . - 235 R É F É R E N C E S B I B L I O G R A P H I Q U E S 239 I N D E X D E S N O M S 259 I N D E X D E S T E R M E S E T C O N C E P T S 000 T A B L E D E S T A B L E A U X E T I L L U S T R A T I O N S 000























































































































































































































































































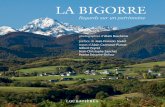





![Saillance visuelle des maillages 3D par patches locaux adaptatifs [Anass Nouri - Christophe Charrier - Olivier Lézoray] (Conférence Reims-Image, 2014, France)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632364ad48d448ffa006a732/saillance-visuelle-des-maillages-3d-par-patches-locaux-adaptatifs-anass-nouri-.jpg)

