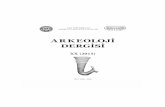Mémoire de fin d'études : "L'architecte et l'économie du construit
Cahiers d'études africaines, 193-194 - OpenEdition Journals
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Cahiers d'études africaines, 193-194 - OpenEdition Journals
Cahiers d’études africaines
193-194 | 2009TourismesLa quête de soi par la pratique des autres
Nadège Chabloz et Julien Raout (dir.)
Édition électroniqueURL : http://journals.openedition.org/etudesafricaines/14023DOI : 10.4000/etudesafricaines.14023ISSN : 1777-5353
ÉditeurÉditions de l’EHESS
Édition impriméeDate de publication : 20 juin 2009ISBN : 978-2-7132-2207-8ISSN : 0008-0055
Référence électroniqueNadège Chabloz et Julien Raout (dir.), Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009, « Tourismes » [Enligne], mis en ligne le 25 juin 2009, consulté le 03 février 2021. URL : http://journals.openedition.org/etudesafricaines/14023 ; DOI : https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.14023
Ce document a été généré automatiquement le 3 février 2021.
© Cahiers d’Études africaines
Depuis les Indépendances, le tourisme en Afrique a été appréhendé par les chercheurs
tour à tour comme une forme de néo-colonialisme, un facteur de développement,
comme destructeur des sociétés traditionnelles locales, puis comme facteur de paix et
de rencontre entre les peuples.
La figure néo-coloniale du touriste blanc, riche et puissant, tant décriée par les
chercheurs des années 1970, laisse de plus en plus la place à celle du touriste culturel,
solidaire ou équitable, en quête de rencontre avec l’autre.
La vingtaine de contributions réunies dans ce numéro visent à déplacer la réflexion
d'une problématique trop souvent basée sur l'impact du tourisme en Afrique à un
questionnement sur les imaginaires touristiques portés sur ce continent, sur la manière
dont les acteurs locaux et les autorités publiques participent à leur création, se les
approprient ou les contestent. Ce volume met l'accent sur les circulations
transnationales, les réseaux, le politique, les enjeux identitaires. Il montre surtout que
le touriste n'est plus un simple spectateur. Du Maghreb à l'Afrique du Sud, les auteurs
révèlent la dimension participative des pratiques touristiques contemporaines sur le
continent.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
1
SOMMAIRE
Corps et âmes. Conversions touristiques à l’africanitéNadège Chabloz et Julien Raout
« Découvrir l’âme africaine ». Les temps obscurs du tourisme culturel en Afrique colonialefrançaise (années 1920-années 1950)Sophie Dulucq
Imaged or Imagined? Cultural Representations and the “Tourismification” of Peoples andPlacesNoel B. Salazar
« Guides, guidons et guitares ». Authenticité et guides touristiques au MaliAnne Doquet
Culture nomade versus culture savante. Naissance et vicissitudes d’un tourisme de déserten Adrar mauritanienSébastien Boulay
Du tourisme culturel au tourisme sexuel. Les logiques du désir d’enchantementCorinne Cauvin Verner
Antiquaires et businessmen de la Petite Côte du Sénégal. Le commerce des illusionsamoureusesChristine Salomon
Au rythme du tourisme. Le monde transnational de la percussion guinéenneJulien Raout
Danser l’Orient. Touristes et pratiquantes transnationales de la danse orientale au CaireJulie Boukobza
Inspiration triangulaire. Musique, tourisme et développement à MadagascarMarie-Pierre Gibert et Ulrike Hanna Meinhof
« La tarentule est vivante, elle n’est pas morte ». Musique, tradition, anthropologie ettourisme dans le Salento (Pouilles, Italie)Elina Caroli
“We Offer the Whole of Africa Here!”. African Curio Traders and the Marketing of a GlobalAfrican Image in Post-apartheid South African Cities1
Aurelia Wa Kabwe-Segatti
Les scènes de la danse. Entre espace touristique et politique chez les Peuls woDaaBe du NigerMahalia Lassibille
Le festival, le bois sacré et l’Unesco. Logiques politiques du tourisme culturel à Osogbo(Nigeria)Saskia Cousin et Jean-Luc Martineau
Imaginaire national et imaginaire touristique. L’artisanat au Musée national du NigerJulien Bondaz
Tourisme et primitivisme. Initiations au bwiti et à l’iboga (Gabon)Nadège Chabloz
Marketing Vodun. Cultural Tourism and Dreams of Success in Contemporary BeninJung Ran Forte
Back to the Land of Roots. African American Tourism and the Cultural Heritage of the RiverGambiaAlice Bellagamba
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
2
“Find their Level”. African American Roots Tourism in Sierra Leone and GhanaAdia Benton et Kwame Zulu Shabazz
Les déçus de TombouctouMarco Aime
Désillusions et stigmates de l’exotisme. Quotidiens d’immersion culturelle et touristique auSénégalHélène Quashie
Tourisme d’oasis Les mirages naturels et culturels d’une rencontre ?Vincent Battesti
Chronique filmographique
Le tourisme et les images exotiquesJean-Paul Colleyn et Frédérique Devillez
Chronique bibliographique
De quelques dynamiques contemporaines en anthropologie du tourisme francophoneSébastien Roux
Analyse de textes
L’anthropologie du tourisme et l’authenticité. Catégorie analytique ou catégorie indigène ?Céline Cravatte
Analyses et comptes rendus
Aime, Marco. – TimbuctuElina Caroli
Barthélemy, Tiphaine & Couroucli, Maria (dir.). – Ethnographes et voyageursJean Copans
Campbell, James T. – Middle PassagesCristina D’Alessandro-Scarpari
Cauvin Verner, Corinne. – Au désertJulien Bondaz
Guyot, Sylvain. – Rivages zoulousCristina D’Alessandro-Scarpari
Jennings, Eric T. – Curing the ColonizersKatherine Luongo
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
3
Kane, Momar Désiré. – Io l’AfricaineAnthony Mangeon
Kibicho, Wanjohi. – Tourisme en pays maasaï (Kenya)Julien Bondaz
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
4
Corps et âmes. Conversionstouristiques à l’africanitéNadège Chabloz et Julien Raout
1 L’Afrique, souvent considérée comme le berceau de l’humanité, tient aujourd’hui une
place de choix dans l’imaginaire des touristes en quête de racines, d’authenticité et de
chaleur humaine. Selon l’Organisation mondiale du tourisme, le continent africain a
enregistré ces dernières années la plus forte augmentation de fréquentation touristique
au monde, même si l’Afrique ne représente que 4 %1 du volume touristique mondial.
Depuis les Indépendances, le tourisme en Afrique a été appréhendé par les chercheurs
tour à tour comme une forme de néo-colonialisme, un facteur de développement,
comme destructeur des sociétés traditionnelles locales, puis comme facteur de paix et
de rencontre entre les peuples. La figure néo-coloniale du touriste blanc, riche et
puissant, tant décriée par les chercheurs des années 1970, laisse de plus en plus la place
à celle du touriste culturel, solidaire, respectueux et en quête de rencontre avec l’autre.
Le « tourisme culturel » représenterait une forme de panacée : il permettrait la
rencontre, une meilleure compréhension mutuelle et un développement économique
tout en sauvegardant les coutumes et les expressions artistiques locales.
2 Ce numéro spécial des Cahiers d’Études africaines, en accordant une attention particulière
au sens que les touristes accordent à leur expérience du voyage, rompt avec les études
antérieures considérant le tourisme en Afrique principalement en termes d’impact2, de
domination, et le touriste comme un être mystifié, pris en charge par les agences de
voyages de telle façon qu’aucun événement ne mine ses certitudes ni le confronte à une
altérité autre que mise en scène à son attention (Boutillier et al. 1978). Sans occulter les
aspects inégalitaire et ambigu de la relation touristique entre Occidentaux et Africains,
les contributions présentées montrent qu’elle ne peut toutefois être réduite à des
questions d’opposition, de confrontation et de domination, trop exclusivement
mobilisées dans l’analyse du phénomène touristique sur le continent. Plusieurs articles
mettent par exemple en relief la manière dont les relations entre touristes et guides
s’insèrent également dans des relations sociales locales et des enjeux politiques
nationaux. Ce numéro s’inscrit ainsi dans la dynamique actuelle redessinant l’analyse
du tourisme francophone, présentée dans la chronique bibliographique de Sébastien
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
5
Roux. Il réunit un nombre important de contributions, tant il nous a semblé important
de refléter la diversité des pratiques touristiques, des réseaux par lesquels elles
circulent, ainsi que la complexité des représentations et des enjeux identitaires à
l’œuvre, du Maghreb à l’Afrique du Sud. Ces Cahiers d’Études africaines présentent des
contributions analysant le phénomène touristique en Afrique ; cette lecture
régionaliste n’empêche toutefois pas les articles de soulever des thèmes universels se
retrouvant dans d’autres aires géographiques, comme en témoigne par exemple
l’article d’Elina Caroli sur le tarentisme en Italie du Sud, qui aborde notamment les
questions — que l’on retrouve en Afrique — de la patrimonialisation des cultures locales
et du rapport entre tourisme et savoirs ethnographiques. Les spécificités du tourisme
en Afrique ont peut- être davantage trait aux représentations sur lesquelles il se fonde,
en rapport avec l’histoire, notamment la traite atlantique des esclaves et la
colonisation, qu’aux processus de « touristification » et aux pratiques touristiques.
3 Si, à l’instar d’autres revues scientifiques ayant récemment consacré un numéro spécial
sur le tourisme3, ce volume met l’accent sur les circulations transnationales, les
réseaux, et, dans une moindre mesure, sur les enjeux politiques, il montre surtout
l’évolution et les diverses formes que revêt la dimension participative des pratiques
touristiques sur le continent. L’appel à contributions, portant sur le tourisme culturel
en Afrique d’une manière assez générale, a retenu l’attention de chercheurs dont les
articles évoquent majoritairement le thème de la conversion. Les « convertisseurs »
d’abord, occupent ici une place importante, que ce soient les « médiateurs culturels »
(guides, passeurs artistiques, artisans, prestataires sexuels) ou les médias (films
documentaires, de fiction, presse écrite, musique, danse, Internet). Les candidats à la
conversion ou les « convertis », ensuite, sont les touristes : plusieurs articles
s’intéressent à leurs représentations, leurs motivations et à leurs pratiques. Enfin, les
dynamiques et les processus de la conversion — ou du désir de conversion — sont
multiples et leur analyse montre qu’ils touchent parfois au plus intime des individus :
corps, sentiments, recherche d’identité et de sacré. La grande majorité des
contributions, à travers différentes approches méthodologiques, évoque un désir de
transformation par le tourisme, que ce soit par la rencontre avec un paysage (oasis,
désert, ville mythique), l’échange (verbal, sentimental, sexuel) avec des locaux, la
pratique artistique (danse, musique), rituelle et religieuse (vaudou, bwiti). Pour les
touristes, il s’agit en quelque sorte de s’« autoformer »4 par le voyage, de se trouver soi-
même en expérimentant les pratiques des autres ou en « pratiquant » directement les
autres (tourisme sexuel et/ou sentimental). Ces formes de conversions à l’africanité se
retrouvent de façon paroxystique dans le « tourisme de racines ». Basées
majoritairement sur des représentations issues de l’époque coloniale, ces quêtes
touristiques se confrontent souvent à une réalité locale bien différente de celle qui
avait été imaginée, rencontrent les propres stéréotypes, désirs et stratégies des
autochtones souvent liés à une volonté d’émigration et se soldent fréquemment par des
désillusions de part et d’autre. Mais ces quêtes trouvent parfois matière à satisfaction
en débouchant sur des relations amicales et amoureuses durables avec les autochtones
et donnent à certains touristes un sentiment de réalisation personnelle, voire une
nouvelle direction à leur vie. Il arrive que cette « conversion à l’africanité » soit
également opérante chez certains guides locaux qui, par le biais du tourisme,
redécouvrent parfois des traditions, une manière différente de voir ou de vivre leur
environnement et négocient avec leur « identité africaine ».
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
6
4 Ces pratiques consistant à voyager pour découvrir la culture des populations
autochtones s’inscrivent dans ce qu’il est convenu de nommer le « tourisme culturel ».
Difficile à définir et à quantifier, cette catégorie est souvent employée en opposition au
« tourisme de masse ». Le tourisme culturel apparaît minoritaire si on le considère du
point de vue des chiffres de fréquentation mais il reste un idéal à atteindre, comme le
montre Vincent Battesti à propos du tourisme d’oasis en Afrique du Nord. Pour cet
auteur, il n’y a pas des « touristes culturels » et d’autres qui ne le seraient point, mais
une propension chez les uns et les autres à plus ou moins pratiquer certains aspects de
ce nouvel éthos. D’autres auteurs soulignent le caractère non opératoire de cette
dénomination, qui s’inscrit dans une tradition de nomenclature des pratiques
touristiques (tourisme de masse, individuel, sédentaire, itinérant, à forfait, à la carte,
etc.) mais qui informe peu des modalités concrètes des séjours.
Imaginaires d'hier et d'aujourd'hui
5 En amont de la zone d’interaction touristique, il est nécessaire de prendre en
considération les flux d’images, d’idées, de sons, de bribes de récits qui conditionnent la
rencontre. Le roman, la presse populaire, les brochures touristiques participent
aujourd’hui moins à la construction de l’imaginaire collectif occidental que d’autres
productions culturelles comme les films documentaires, le cinéma hollywoodien, les
récits d’expériences publiés et en ligne, les expositions d’art et d’artisanat, ou les
musiques du monde. La consommation de ces produits culturels prépare les individus à
découvrir de nouveaux lieux, elle préforme le jugement et forge les attentes des
visiteurs. La visite du pays représente alors bien souvent la volonté de vérifier la
conformité de la copie à l’original, « la fidélité de l’image mentale ou physique avec la
réalité de l’objet, là sous les yeux » (Amirou 2000 : 30). Ces imaginaires touristiques, qui
constituent le moteur du déplacement, prennent parfois la forme de stéréotypes
standardisés circulant à l’échelle planétaire et encouragent la naissance de pratiques
touristiques visant à exhiber les signes de l’authenticité des cultures africaines.
Plusieurs articles attestent des diverses sélections opérées par ces « fabricants
d’imaginaire » orientant le regard touristique.
6 Par une approche historique, Sophie Dulucq montre comment les premiers guides
touristiques publiés sous l’égide de l’administration coloniale française à partir des
années 1920 contribuent à définir ce qui est « touristique- ment pertinent » sur le
continent africain. À côté du tourisme de nature, ces guides encourageaient les
touristes à découvrir « l’âme africaine » à travers les manifestations de danse et de
musique, les « scènes de marché », ou les productions artisanales traditionnelles. Si la
connaissance du colonisé à travers le déplacement touristique contribua à construire
l’identité coloniale et impériale de la France, la mise en tourisme des cultures locales
participa également aux prémisses de leur folklorisation et standardisation.
7 Plus que les écrits académiques ou les récits de voyage, ce sont les films documentaires
et les films semi-biographiques ou de fiction qui conditionnent les attentes des
visiteurs désirant retrouver en Tanzanie l’image romantique du viril guerrier massaï.
Avec Noël B. Salazar nous comprenons comment les Massaï, à travers le prisme de la
médiatisation, sont devenus les icônes de l’Afrique traditionnelle et les symboles
« involontaires » de la résistance aux valeurs de la modernité. En l’absence
d’alternatives économiques à l’industrie touristique, les Massaï se résignent à « être
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
7
eux-mêmes pour les autres » en escamotant toutes traces de modernité du paysage
humain offert aux touristes. Dans leur chronique filmographique sur le tourisme, Jean-
Paul Colleyn et Frédérique Devillez montrent comment le cinéma construit plutôt qu’il
ne reflète une histoire de la vision et du regard, et accompagne le processus touristique
s’inscrivant dans un contexte de rencontres inégales car participant de la conquête du
monde par les peuples nantis.
8 Ce mécanisme d’imposition d’imaginaires globaux sur les sociétés visitées dont les
membres n’auraient d’autres choix que de se plier intégralement aux représentations
stéréotypées des visiteurs doit sans doute être nuancé. Ces imaginaires que E. Bruner
(2005 : 26) appelle des « récits maîtres » peuvent être personnalisés par l’expérience
touristique et se transformer au cours du voyage : « Master narratives provide a
preexisting structure, but they are not determinative, nor they possibly encompass the
many possible tourist responses. The tourist story is emergent in the enactment. » Sans
nier le fait que la demande d’authenticité des touristes, touchant à l’identité des
autochtones, comporte le risque pour les populations locales d’avoir toujours plus de
mal à former leur propre subjectivité en dehors de leur subjectivation par et pour le
tourisme, la majorité des contributions présentées dans ce numéro est représentative
d’une nouvelle manière d’envisager l’étude du tourisme, en considérant que « les
populations locales ne sont pas les objets passifs du regard touristique, mais des sujets
actifs qui construisent des représentations de leur culture à l’usage des touristes, des
représentations fondées à la fois sur leur propre système de références et sur leur
interprétation du désir des touristes » (Picard 2001 : 120).
Authenticités froide, chaude et existentielle
9 Depuis la « théorie du touriste » de Dean MacCannell (1976), la notion d’authenticité est
au cœur des débats qui animent la sociologie et l’anthropologie du tourisme, comme le
montre l’analyse de textes de Céline Cravatte qui questionne l’ambiguïté du concept
d’authenticité en tant que catégorie analytique ou indigène. Toutefois, le double usage
que MacCannell (ibid. : 3) a fait de cette notion a rendu son utilisation délicate. Dans sa
première acception, l’authenticité est considérée comme la quête principale des
touristes : « Pour les modernes, la réalité et l’authenticité sont considérées comme
étant ailleurs : dans d’autres périodes historiques, dans d’autres cultures, dans des
styles de vie plus purs et plus simples. » En se déplaçant, les touristes cherchent à
reconstruire une identité éclatée par la fragmentation de la vie moderne et
postmoderne. Le second usage de la notion d’authenticité intervient lorsque
MacCannell parle de mise en scène de l’authenticité (staged authenticity). Il montre
comment les touristes, dans leur quête d’authenticité, peuvent finalement être dupés :
là où ils pensent accéder aux coulisses de la culture visitée, l’endroit où les secrets sont
supposés être gardés, ils n’ont à faire qu’à d’autres pseudo-événements (Boorstin 1961),
d’autres mises en scène destinées à satisfaire leurs attentes. Tom Selwyn (1996), qui a
sans doute repéré le premier ce double usage de la notion d’authenticité chez
MacCannell propose de qualifier d’authenticité chaude (hot authenticity) la motivation
principale des touristes : la recherche de solidarité sociale, de fraternité avec les autres
(touristes ou populations locales) mais aussi la recherche de soi. Il qualifie
d’authenticité froide (cool authenticity) la qualité des connaissances acquises par les
touristes à propos de la destination choisie. Si le degré d’authenticité froide peut être
expertisé et se résume généralement à un ensemble de choses, d’hommes ou d’activités
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
8
à observer, l’authenticité chaude est du domaine du ressenti (feeling of authenticity). Elle
est par conséquent beaucoup moins objectivable et mesurable. En effet, si le chercheur
peut constater le fossé qui sépare, par exemple, une cérémonie initiatique de sa mise en
scène touristique, comment évaluer l’authenticité d’une rencontre ou la sincérité d’une
amitié nouée entre visiteur et visité ?
10 Un certain nombre d’articles présentés dans ce numéro, comme ceux d’Anne Doquet
sur les guides touristiques au Mali, de Julien Raout sur le tourisme musical en Guinée, et
de Vincent Battesti sur le tourisme d’oasis en Tunisie et en Égypte, tenteront de
montrer comment l’authenticité, autant comme catégorie recherchée par les touristes
que comme notion utilisée par les chercheurs, tend à se « réchauffer ». L’observation
d’objets, d’hommes ou de paysages n’est plus l’activité favorite des touristes
contemporains. De même, l’analyse de l’impact de ce « regard touristique » (Urry 1990)
sur les populations visitées ne constitue plus la principale préoccupation des
chercheurs. Loin d’être les spectateurs passifs de spectacles organisés à leur intention,
les touristes désirent aujourd’hui s’impliquer en prenant part aux activités locales. Les
articles sur le tourisme sexuel (C. Cauvin Verner, C. Salomon), le tourisme musical (J.
Raout, J. Boukobza) ou le tourisme mystico-spirituel (N. Chabloz) montrent que le
tourisme n’est pas uniquement une activité visuelle mais implique également des
expériences corporelles et participatives. Ces articles s’efforcent de saisir les contours
de cette « authenticité chaude » recherchée par des touristes désirant se découvrir eux-
mêmes à travers le prisme des relations qu’ils entretiennent avec leurs hôtes.
L’« authenticité existentielle » (Wang 1999) recherchée pendant le voyage, qui
conduirait le touriste à découvrir son véritable moi intérieur, peut aussi, comme le
souligne Nadège Chabloz, se passer de rencontre avec l’autochtone. Les touristes
venant s’initier au bwiti gabonais désirent avant tout consommer la plante iboga et
avoir accès au savoir initiatique. Par conséquent l’initiateur peut être indistinctement
français ou gabonais, l’essentiel étant la découverte de soi grâce aux visions que
procure la plante.
Les guides : passeurs culturels et prestataires sexuels
11 La pratique du tourisme dans sa version culturelle se caractérise généralement par la
recherche du contact avec l’indigène. Les touristes s’y prêtant ne rencontreront que
ceux disposés à les rencontrer ou désignés implicitement pour jouer le rôle de
médiateur. C’est lorsque le tourisme se définit comme culturel qu’interviennent de
façon quasi systématique les médiateurs que sont les guides. On peut penser, comme le
montrent les articles d’Anne
12 Doquet et de Sébastien Boulay, que la présence des guides est nécessaire sans quoi la
rencontre touristique ne serait pas. Le guide est tenu de transmettre à son groupe des
informations sur sa culture, son histoire, la faune et la flore des zones traversées. Il
endosse le rôle de médiateur culturel, et a un rôle de représentation. Finalement,
l’échange possible avec le guide résout en partie le problème de l’échange quasi
impossible avec les autochtones rencontrés durant le circuit. Ce dernier permet, plus
que le passage, la conversion momentanée d’une identité culturelle à une autre.
Sébastien Boulay montre que le guide apparaît ainsi comme un équilibriste se
maintenant entre une occultation de certains éléments de sa culture et une
(sur)valorisation d’autres, tentant d’inscrire son discours dans le cadre des
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
9
représentations qu’ont les touristes tout en tâchant de faire évoluer leur conception.
Pourtant, malgré leur rôle prédominant, voire indispensable dans la rencontre
touristique, les guides ont jusque-là peu intéressé les chercheurs en sciences sociales, si
ce ne sont E. Cohen (1985, 2001), Wang (1999), Reisinger & Steiner (2006), dont le point
commun, comme ici l’article d’Anne Doquet, est d’atténuer le caractère mystificateur
du guide. Si les guides sont souvent perçus comme instigateurs du mensonge pour leurs
clients naïfs et dupés, ils ne peuvent être réduits, selon Anne Doquet, à des personnages
singeant la tradition. Cette auteure montre que ce qui se joue n’est pas de l’ordre du
dédoublement de l’authenticité décrit par MacCannell et ses successeurs et que tout
l’art du guide consiste à instaurer entre lui et ses clients une relation transférable aux
villageois.
13 La relation touristique entre guides et touristes est souvent empreinte d’ambivalence.
Selon Anne Doquet, cette ambivalence reflète celle des relations franco-africaines dans
lesquelles la solidarité et la fraternité flirtent avec les asymétries et le racisme. Ainsi, les
guides maliens induisent les visiteurs vers d’autres versions où l’authenticité ne répond
plus à la conception passéiste d’un idéal socioculturel de pureté et de solidarité, mais à
des réalités sociales et culturelles du Mali d’aujourd’hui. Cette ambivalence se retrouve
dans les relations sexuelles et/ou amoureuses qu’entretiennent les touristes avec les
guides.
14 Le « tourisme sexuel » serait une forme exacerbée de marchandisation où l’individu,
exploité, réduit à sa seule consommation, se voit refuser toute part d’humanité (Michel
2006). Cette vision tragique d’une exploitation sexuelle mondialisée est assez répandue,
notamment dans la littérature sur la prostitution dans le tourisme : le tourisme sexuel
apparaît comme une forme spécifique de prostitution qui, en jouant sur l’accumulation
des rapports de domination, exploiterait les individus les plus fragiles des destinations
touristiques. Cette perspective victimisante est discutée par quelques chercheurs
comme Sébastien Roux (2009 : 28-42) qui, en menant un travail ethnographique en
Thaïlande, a pu accéder à une réalité quotidienne différant de ces analyses indignées et
montrer la complexité des liens unissant touristes et populations locales. Cet auteur
montre notamment que la prostitution dans le tourisme ne se limite pas au différentiel
qui sépare les touristes des populations locales, en termes de pouvoir, de richesses ou
de mobilité. Les contributions de Corinne Cauvin Verner et de Christine Salomon
s’inscrivent dans ce mouvement de renouvellement théorique de l’anthropologie du
tourisme sexuel (Cohen 1971, 2001 ; Graburn 1983) en interrogeant la nature du
caractère prostitutionnel à l’œuvre dans le tourisme sexuel féminin au Maroc et au
Sénégal, ses formes culturelles et historiques spécifiques, ainsi que la nature de la
rencontre et de la confrontation d’individus inégalement dotés. Ces enquêtes de terrain
questionnent en des termes originaux les transformations sociales engendrées par la
mondialisation, et pensent le tourisme sexuel comme un terrain fécond pour réfléchir
aux articulations genre-classe-race.
15 Selon Corinne Cauvin Verner, l’échange sexuel permet aux touristes de dénier tout à la
fois la réalité économique de la relation et l’aspect ludique de l’expérience, en
détournant le rapport marchand en rapport interculturel. Cette relation entre touriste
et guide, sans être dépourvue de sentiments, est aussi le lieu très calculé d’une
circulation de biens et de services. L’analyse de Christine Salomon sur les échanges
économico-sexuels sur la Petite Côte du Sénégal entre des touristes européennes
quinqua ou sexagénaire et de jeunes hommes sénégalais, donne à voir une imbrication
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
10
particulière des inégalités économiques, de genre et d’âge avec les stéréotypes racistes.
Elle montre également qu’il existe tout un continuum possible d’échanges économico-
sexuels entre le mariage et la prostitution, et bat en brèche la vision réductrice qui
ferait de ces jeunes hommes des personnages marginaux, présentés tantôt comme de
simples intermédiaires culturels, tantôt comme des prostitués, tantôt comme des
exploiteurs.
La rencontre touristique
16 La rencontre avec l’autochtone fait partie des motivations principales de ceux qui
partent dans le cadre d’un « tourisme culturel », et elle s’insère également dans la
doctrine du tourisme culturel diffusée notamment par l’Unesco (Cousin 2008 ; Picard
1992) et l’Organisation mondiale du tourisme. Vincent Battesti montre que le tourisme
culturel correspond à une exigence de la part des touristes d’attractions
socioculturelles et de pittoresque qui se porte aujourd’hui sur la dimension humaine :
rencontrer des « locaux », ce qui suggère finalement plus une variation des pratiques
qu’une nouvelle ère du tourisme. Ce n’est pas le contact avec les indigènes qui intéresse
les voyageurs du XIXe siècle, la rencontre touristique s’inscrivant alors dans les
dualismes observateur/observé, dominant/dominé. Selon cet auteur, ce n’est pas
vraiment l’intérêt porté au « culturel » qui fait la spécificité du tourisme culturel, mais
le passage du « pittoresque » à « l’authentique » ou de l’ethnocentrisme au relativisme
culturel. Aujourd’hui ce sont les « backpackers » qui partent à la découverte des oasis et
qui définissent le tourisme culturel comme la recherche d’une rencontre authentique
avec la population et la culture locales.
17 Les anthropologues étudiant le tourisme se sont emparé de cette rencontre (Amirou
1995 ; MacCannell 1992 ; Urbain 1991), sans toujours d’ailleurs s’essayer à en donner
une définition précise, mais en analysant sa nature et ses ressorts, en concluant parfois
que ne s’opère pas de « véritable rencontre » (C. Cauvin Verner). Si l’on part du
principe qu’il y a rencontre lorsque deux personnes entrent en contact et échangent,
on peut s’interroger sur le sens de cette « non rencontre » souvent observée par les
anthropologues sur leur terrain touristique. Est-ce que la rencontre ayant lieu n’est pas
conforme à celle qui a été promise et vendue par les voyagistes ? Estelle une « non
rencontre » du point de vue des touristes, des autochtones ou bien de l’anthropologue ?
L’effacement du caractère fortuit traditionnellement associé à la rencontre, fortement
réduit ou effacé par les voyages organisés serait-il responsable de la déqualification de
la rencontre ? Ou encore cette déqualification proviendrait-elle du fait que le terme
évoque dans la philosophie contemporaine5 un accord extrême se dévoilant entre deux
personnes désormais unies par la reconnaissance et la réciprocité ? Si la rencontre peut
également être considérée comme étant le résultat d’une conjonction (par exemple de
deux personnes se rencontrant au cours d’un séjour touristique), comme nouvel
élément, un fruit, est-ce à dire que ce fruit est obligatoirement lié aux registres de
l’entente, de l’amour, de la compréhension mutuelle ? Si ce fruit appartient aux
registres du malentendu, de l’ambivalence, de la méfiance ou de la haine, cela signifie-
t-il pour autant que la rencontre n’a pas eu lieu ou qu’elle n’est pas « véritable » ?
Sébastien Boulay montre comment les dispositifs sur lesquels repose la mise en
tourisme de la culture en Adrar mauritanien mobilisent et produisent des relations
entre individus, qui, sans la naissance de cette activité, ne seraient probablement
jamais entrés en contact les uns avec les autres. Ce type de tourisme instaure un
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
11
contact, entre les habitants de ces zones et les touristes, beaucoup plus direct que celui
qui existait avec les coopérants et les militaires français présents à Atar, voire avec les
administrateurs coloniaux avant 1960. Mahalia Lassibille, analysant le phénomène
touristique comme une interaction, souligne que la relation créée ne se limite pas
toujours à un contact ponctuel avec un étranger de passage et qu’elle peut déboucher
sur un rapport durable qui a des répercussions considérables pour les
18 WoDaaBe et les touristes occidentaux. En mettant en regard un réseau et des histoires
individuelles, il devient possible de dépasser l’appréhension du tourisme culturel
comme une catégorie homogène pour l’envisager comme un ensemble de processus
interactionnels à décliner dans le temps.
Circulations transnationales
19 Longtemps cantonnées à l’analyse des interactions se produisant dans un cadre local,
les études touristiques ont souvent considéré les visités comme des « ré-acteurs » en
face du visiteur (Michaud 2001). Plusieurs articles présentés dans ce numéro proposent
de prendre en considération les flux, les circulations d’images et d’idées qui façonnent
les imaginaires touristiques, mais aussi les réseaux transnationaux mobilisés par les
acteurs organisant le déplacement touristique. Sur ce point, M. Lassibile montre que les
WoDaabe du Niger, encore peu connus du grand public, doivent mobiliser tout un
réseau international de relations tissé au gré de leur voyage ou user d’Internet et de
mailing-listes pour inviter des Occidentaux à leur assemblée annuelle. De la même
manière, les musiciens malgaches, étudiés par M.-P. Gibert et U. H. Meinhof, mettent à
profit leurs tournées internationales pour sensibiliser le public à s’investir dans les
actions humanitaires qu’ils coordonnent. La dichotomie tranchée entre hôtes et
visiteurs, qui réduit souvent un ensemble complexe de mouvements à un schéma
binaire, est remise en question par ces enquêtes multi-situées (Appaduraï 2001). Elles
soulignent le rôle des « intermédiaires culturels » (« cultural brokers ») maîtrisant à la
fois les codes culturels des pays émetteurs et ceux de la destination touristique et
montrent que les visités peuvent être très actifs dans leur propre « mise en tourisme ».
Plusieurs articles signalent également que le réseau relationnel transnational tissé au
cours de l’interaction touristique peut être mis à profit pour soutenir des projets de
migration à l’étranger (A. Bellagamba, J. Raout, C. Cauvin Verner). Adia Benton et
Kwame Zulu Shabazz montrent que le tourisme de racines au Ghana et en Sierra Leone
est le produit d’un complexe arrangement entre les intérêts personnels des acteurs, les
réseaux transnationaux de solidarité, les technologies et les contraintes des différents
acteurs à des niveaux aussi bien locaux, régionaux, continentaux que mondiaux.
Analysant le classement du bois sacré d’Osogbo au patrimoine mondial, Saskia Cousin et
Jean-Luc Martineau révèlent l’importance des réseaux internationaux dans la sélection
finale du site et sa détermination en tant que patrimoine culturel, en raison de la
présence des statues de l’artiste autrichienne Suzanne Wenger.
Enjeux identitaires autour de la musique, de la danse et de
l'artisanat
20 Comme le rappelle Sophie Dulucq à propos de l’Afrique coloniale française, le tourisme
en Afrique s’est très vite tourné vers les pratiques culturelles et artistiques. Compte
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
12
tenu de la rareté des monuments et des sites archéologiques à visiter, on invitait les
touristes à acheter de l’artisanat, à assister à des « tam-tam » ou à des danses
cérémonielles. Même si l’on a reconnu au tourisme un rôle important dans le maintien
d’activités culturelles « traditionnelles » qui sans lui auraient disparues, la
marchandisation, les mises en scène touristiques ainsi que le développement d’un « art
d’aéroport » ont souvent été analysés en termes de dégradation et de
« dégénérescence » du patrimoine culturel (de Kadt 1979). Plusieurs articles de ce
numéro prennent position sur la question de l’authenticité et de la mise en scène des
pratiques artistiques et artisanales en montrant que le ménage de la culture et de
l’économie en situation touristique n’est finalement pas si houleux qu’on le pensait.
Alors que Mahalia Lassibille remet en question la distinction entre « danses
commerciales » et « danses cérémonielles » chez les Peuls woDaabe du Niger, Julien
Bondaz dépasse la dichotomie entre objets authentiques et objets touristiques en
montrant que les objets artisanaux présentés au Musée National du Niger représentent
des « points de contacts » entre l’imaginaire national nigérien et les imaginaires
touristiques.
21 Certaines études contemporaines, articulant plus particulièrement la musique ou la
danse et le tourisme, interrogent non pas la manière dont les musiques et les danses
reflètent une identité locale mais plutôt comment elles peuvent contribuer à la
« production » des identités et des lieux (Cohen 1997). L’intérêt pour les musiques et les
danses constituent la motivation principale de nombreux déplacements touristiques.
Celles-ci se trouvent ainsi projetées au centre de nouveaux enjeux économiques et
identitaires: « [...] arts and culture are promoted as major factors in individual’s choice
of destinations not only to visit, but to move to and live in, so that music is now
explicitly bound up with the politics of place and with the struggle for identity and
belonging, power and prestige » (Abram et al. 1997: 8). Plusieurs contributions
montrent que les danses, les musiques et l’artisanat jouent aujourd’hui un rôle
significatif dans le développement touristique en fonctionnant comme de puissantes
attractions. Elles montrent également que l’inscription de ces pratiques dans des
réseaux transnationaux peut contribuer aussi bien à des enrichissements qu’à des
réductions esthétiques et impulser localement de nouvelles dynamiques sociales et
identitaires.
22 Julien Raout, à travers la percussion guinéenne, et Julie Boukobza, avec la danse
orientale, s’intéressent à des pratiques touristiques éminemment participatives. Dans
les deux cas, l’objectif du voyage n’est pas d’assister à des spectacles de musique et de
danse mais de se former à une pratique artistique ou de la perfectionner dans le pays
« source ». Pour le tourisme musical en Guinée et le tourisme de la danse en Égypte
(mais aussi le tourisme mystico-spirituel au Gabon étudié par N. Chabloz), le
déplacement touristique constitue la prolongation d’une expérience démarrée dans le
pays d’origine des touristes. Le voyage est alors souvent conçu comme un pèlerinage
pour des apprenants en quête de légitimité artistique. Encouragés par des pratiques
communes, des réseaux se constituent entre les pays émetteurs de touristes et les pays
considérés comme étant à l’origine de la pratique étudiée. Julien Raout s’intéresse ainsi
aux relations développées entre les percussionnistes guinéens et les touristes venus des
quatre coins du globe pour pratiquer le jembé. Les réseaux transnationaux se
structurant à travers les solidarités et partenariats noués entre les apprentis et leur
maître contribuent non seulement à l’internationalisation des percussions guinéennes
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
13
mais également, en retour, à des flux touristiques échappant aux tour-opérateurs
conventionnels. Julie Boukobza analyse les rapports qu’entretiennent les danseuses
orientales d’Égypte avec leurs concurrentes étrangères. Les enjeux identitaires
spécifiques à cette pratique, devenue transnationale, se cristallisent pendant le festival
international de danse orientale organisé au Caire. Alors que les danseuses étrangères
manifestent une volonté de conversion à l’« égyptiannité », les folkloristes locaux
enclenchent un mécanisme de récupération du savoir-danser sous une bannière locale.
23 En plus du tourisme et de la musique, l’article de Marie-Pierre Gibert et Ulrike Meinhof
introduit l’entité du développement. Il montre comment les passionnés de musique
malgache peuvent être amenés à développer des actions humanitaires à Madagascar.
Mais contrairement aux deux articles précédents, il montre une autre facette du
rapport entre musique et découverte d’un pays : le fait de séjourner à Madagascar pour
un séjour humanitaire peut également conduire à aimer la musique de ce pays. L’article
souligne alors l’importance que prennent les musiciens dans le monde du
développement. En procurant des images exotisantes et rassurantes, ces musiciens
contribuent à la construction et à l’expansion des réseaux d’aides, à la pérennité des
actions de développement ainsi qu’à l’atténuation des incompréhensions entre les
membres d’ONG venus du Nord et les paysans malgaches. Moins explicite sur la
question des réseaux, l’article d’Elina Caroli place néanmoins la circulation au centre de
son analyse des transformations de la musique et des rites liés à la Tarentelle. L’article
montre, en comparaison avec le phénomène d’« ethnologisation » de la culture dogon,
comment la relecture positive mais réductrice du tarentisme par le regard
anthropologique a conduit à un véritable revival de la musique pizzica. Façonnée par la
circulation de sa musique ainsi que par les écrits d’ethnologues, la région du Salento, au
Sud de l’Italie, est devenue une « région musicale » connue bien au-delà des frontières
nationales. Enfin, l’article d’Aurelia Wa Kabwe-Segatti, traitant des marchés d’objets
artisanaux africains en Afrique du Sud, met l’accent sur le rôle des migrants d’Afrique
de l’Ouest et du Congo dans cette économie. À travers la figure de l’« entrepreneur
ethnique » qu’incarnent ces migrants, l’auteure questionne l’imagerie de l’Afrique
développée sur ces marchés ainsi que la possibilité d’une insertion économique et
sociale des migrants africains dans un contexte sud- africain très tendu.
Détournements politiques
24 Les enjeux politiques du tourisme ont majoritairement été analysés par les biais des
États (Franklin 2003), des politiques touristiques (Wood 1997) et du nationalisme (David
2007 ; Hainagiu 2008). Les « détournements politiques » du tourisme dont il est question
dans ce numéro sont effectués par des autorités locales, des institutions culturelles et
des groupes sociaux. L’article de Saskia Cousin et Jean-Luc Martineau s’intéresse à la
manière dont les autorités politiques et traditionnelles du Nigeria s’approprient le
classement au patrimoine mondial du bois sacré et des œuvres de Suzanne Wenger qu’il
comprend pour augmenter la notoriété touristique du festival d’Osogbo, alors même
que ce dernier n’est pas classé et est présenté par l’Unesco comme une menace pour le
bois. Le classement sert le tourisme, lui-même utilisé pour légitimer le statut de
capitale régionale d’Osogbo et l’inscrire dans une histoire largement fantasmée. Ainsi,
le tourisme n’est pas une fin mais un outil au cœur des enjeux de pouvoir et de
représentation de soi, à l’échelle de la ville, de l’État nigérian et de sa représentation à
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
14
l’Unesco. Julien Bondaz décrit le double enjeu du Musée National du Niger, lequel, en
tant que musée national vise la construction et le renforcement d’une unité nationale,
et en tant qu’institution culturelle, intègre des représentations plus larges de l’Afrique.
L’article de M. Lassibille démontre que les interactions touristiques ne prennent tout
leur sens que placées en relation avec celles établies localement, dans le cas de
l’Assemblée avec les Touaregs, les autorités nigériennes et l’ensemble des WoDaabe. Ce
n’est que dans un ensemble interactionnel que le tourisme culturel devient un levier.
S’il s’agit pour les WoDaaBe de faire venir les touristes à eux, c’est également par ce
biais touristique qu’ils cherchent à « porter leur voix » auprès des autorités
nigériennes. Il s’opère ainsi une forte relocalisation au cœur du phénomène de
mondialisation où le tourisme culturel s’insère et auquel il participe.
Retours aux sources
25 Des milliers d’Afro-américains sont allés en Afrique depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à
nos jours. Si certains s’y sont installés de façon permanente — notamment au Liberia au
XIXe siècle —, d’autres y sont allés simplement pour découvrir ce monde d’où étaient
partis leurs ancêtres. Comme le montre J. T Campbell (2006)6, les premières expériences
de « retour en Afrique », liées à l’épopée donnant lieu à la colonie de Sierra Leone en
1787, suivie par celle du Liberia, témoignent notamment des difficultés pratiques et
intellectuelles de toutes sortes que ces colons rencontraient. Ces Afro- américains
n’avaient en effet que peu de choses en commun avec les Africains qu’ils rencontraient.
La déception et la désillusion des Afro-américains face au continent noir que l’on
trouve dans les articles (A. Bellagamba) ne sont pas nouvelles et se retrouvent déjà dans
les écrits de ceux qui ont tenté l’expérience dans les années 19307. À la fin du XXe siècle,
on perçoit une renaissance de l’intérêt des Afro-américains pour le continent, un
sentiment renouvelé d’identification, dû en partie au succès avec lequel a été accueillie
la publication du roman Roots d’Alex Aley, et de la série télévisuelle qui en a été tirée,
mais également à la diffusion des théories et des idées afro- centristes. C’est ce
sentiment qui, selon J. T Campbell, explique le développement rapide d’une industrie
touristique vouée à ramener en Afrique les Afro-américains, à leur faire ressentir le
pathos du retour aux sources. Les États européens, anciennes puissances coloniales en
Afrique, ne seraient ainsi pas les seuls à avoir fait de ce continent à la fois leur alter ego,
leur terre exotique et primitive où l’on vient se ressourcer pour tenter d’échapper à la
société occidentale, car le Liberia, la Sierra Leone ou le Ghana seraient d’une certaine
manière des « colonies » des États-Unis. Trois contributions décrivent et analysent
l’élaboration et la mise en œuvre du tourisme de racines d’Afro-américains en Afrique,
ainsi que la nature de leur rencontre avec les autochtones. L’article d’Adia Benton et de
Kwame Zulu Shabazz compare un pays en développement, le Ghana, avec un pays
sortant d’un conflit armé (Sierra Leone) pour comprendre les possibilités, les limites et
les ambiguïtés de ce phénomène panafricain de « tourisme de racines africaines »
émergent.
26 Alice Bellagamba montre comment a été initiée une tradition de rencontres entre
Gambiens et touristes afro-américains depuis la publication du roman Roots d’Alex Aley
en 1976. La commémoration de la traite atlantique des esclaves, utilisée comme
ressource touristique en Gambie, est analysée notamment à travers la création d’un
musée de l’esclavage à Albreda et d’une cérémonie initiatique organisée par la petite
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
15
communautée jola, destinée à « convertir » des adolescents afro-américains en « vrais »
fils et filles de l’Afrique. Alice Bellagamba choisit d’étudier leur rencontre du point de
vue des villageois plutôt que des touristes, contrairement à la plupart des études sur le
tourisme de racines en Afrique de l’Ouest.
27 Jung Ran Forte analyse l’appréhension de la production de l’« africa- nité » et de la
« tradition », ainsi que l’objectivation de la culture en biens marchands en examinant
les dynamiques qui ont transformé les cultes vaudou au Bénin en héritage culturel
national, mémoire de l’esclavage, et par la suite en attraction touristique. En
juxtaposant les politiques étatiques aux récits de vie de deux femmes béninoises (une
guide touristique et une prêtresse vaudou) engagées dans le tourisme, cet article traite
du tourisme de racines du point de vue des agents locaux et notamment des manières
par lesquelles ils performent et perçoivent leur culture dans la rencontre avec des
touristes africains-américains venus découvrir leurs origines africaines.
28 Au-delà d’une recherche de racines africaines, les touristes français « mystico-
spirituels », étudiés par Nadège Chabloz, s’initient au bwiti gabonais pour se soigner et
pour découvrir leur « moi intérieur » à travers les visions procurées par l’iboga, la
plante utilisée dans ce rite, considéré également comme une religion. Les articles
portant sur le vaudou au Bénin et le bwiti au Gabon interrogent les liens existant entre
tourisme et religion (Vukonic 1996 ; Dallen & Olsen 2006). Contrairement à ce que
montre la plupart des études réalisées sur le sujet, ce ne sont pas les lieux saints qui
sont recherchés et visités par ces touristes. En quête de « sacré sauvage » (Bastide
1975), ils expérimentent une religion en « dansant avec les dieux » ou en absorbant une
plante locale. Ce tourisme mystico-spirituel procède d’une combinaison entre la
spiritualité new age et des rites adaptés par des intermédiaires (autochtones et français)
et se fonde au Gabon sur une vision primitiviste de la nature, des populations et de la
« tradition » africaines.
Désillusions exotiques
29 La promotion de voyages à destination du continent africain s’appuie sur des images
spécifiques, inspirées et soutenues par l’ethnologisation de certaines régions, villes,
groupes sociaux et « rites traditionnels » africains, comme le montre ce numéro à
travers le pays dogon (A. Doquet) et la ville de Tombouctou au Mali (M. Aime, S.
Dulucq), les Pygmées et le rite initiatique du bwiti au Gabon (N. Chabloz). La
contribution d’Elina Caroli, comparant la « situation ethnologique » du Salento et du
tarentisme en Italie du Sud avec celle du pays dogon montre que l’Italie du Sud est
victime des mêmes fantasmes que l’Afrique, entre esthétisation et exaltation de son
primitivisme d’une part, et lieu de tout genre de corruption, voire enfer mafieux
d’autre part. Le succès du tourisme culturel et de l’ethnotourisme reposerait en partie
sur l’urgence d’aller voir (et d’expérimenter) des traditions en voie de disparition du
fait de la mondialisation, censée engendrer l’homogénéisation des cultures. L’identité
locale est mobilisée comme ressource dans les discours des autochtones, des
promoteurs touristiques et culturels, des agences de voyages, pour s’insérer dans le
« forum international » ou « le marché mondial des identités » (Amselle 2001 : 24-25).
Les destinations africaines peu connues pour leurs « trésors ethnologiques », comme le
Sénégal, se vendent davantage grâce à la promotion de leur environnement littoral que
par le biais d’attributs « typiques » évoquant généralement la « culture africaine ». Ce
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
16
qui n’empêche pas les stéréotypes et les stigmates tirés du passé colonial de perdurer.
L’article d’Hélène Quashie analysant les interactions quotidiennes entre des
ressortissants européens semi-résidents et expatriés et des autochtones sénégalais
montre que leurs relations sont en grande majorité d’ordre conflictuel. Ces conflits, dus
en partie à l’important différentiel socio-économique caractérisant leurs niveaux de vie
et rendant inévitables certains types d’antagonismes, proviendraient également des
représentations sociales de part et d’autre mettant en péril l’établissement d’un lien
social et d’une confiance réciproque. L’idéal de la quête de l’autre n’entre pas en
adéquation avec la conception de la rencontre selon cet autre, ni avec le contexte social
dans lequel elle s’établit. On pourrait penser que le fait de vivre de manière prolongée
dans le pays permet aux touristes semi-résidents d’entretenir une relation de qualité
avec les autochtones, mais cela ne semble pas être le cas pour les touristes étudiés par
Hélène Quashie. Il leur manque la connaissance de leur statut au sein de leur
environnement social et l’établissement d’une distinction entre le sentiment de
compassion que leur inspire les Sénégalais et la volonté de faire leur connaissance. Les
auteurs sont nombreux à souligner la désillusion des touristes comme des autochtones
à propos de la rencontre. En Gambie (A. Bellagamba), les étudiants africains-américains
partent du village de Medina en ayant la conviction qu’ils n’ont pas eu un réel accès à la
culture locale, alors que les villageois se plaignent du peu de gains matériels apportés
par ces touristes et se sentent humiliés par les « vieux vêtements » qu’ils leur ont
laissés. Mais la désillusion des touristes peut aussi concerner leur rencontre avec un
lieu qu’ils avaient imaginé autre. Marco Aime nous invite à prendre la mesure du
décalage entre la réalité de « la Tombouctou d’aujourd’hui » et la vision romantique de
cette ville développée dans les récits des explorateurs et voyageurs européens des XIXe
et XXe siècles. Ces récits qui ont façonné l’imaginaire collectif occidental en décrivant
un lieu chargé d’histoire ne correspondent pas à ce que les touristes ont effectivement
sous les yeux lorsqu’ils visitent la ville. Les touristes occidentaux déterminés par leur
perspective préconçue du patrimoine culturel seraient ainsi incapables d’apprécier la
riche histoire de Tombouctou en l’absence de monuments prestigieux. Le décalage
entre les visions fantasmées de l’Afrique de la part des touristes — qu’ils soient
européens ou afro-américains — et les réalités locales, ne doit cependant pas occulter la
complexité et la richesse de la rencontre entre touristes et populations locales de plus
en plus étudiée par les chercheurs en sciences sociales. Un point aveugle demeure
cependant dans l’étude du tourisme sur le continent. En effet, si l’image de l’Occidental,
« touriste-roi en Afrique » (Dieng & Bugnicourt 1982) tend à être remplacée par celle du
« touriste-converti à l’africanité », nous savons encore peu de choses sur les
motivations, les représentations et les mobilités de loisirs des touristes africains en
Afrique.
BIBLIOGRAPHIE
ABRAM, S., WALDREN, J. & MACLEOD, D. (eds.)
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
17
1997 Tourists and Tourism : Identifying with Peoples and Places, Oxford, Berg.
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES
2007 « Les Nouvelles ( ?) frontières du tourisme », 170 (5), Paris, Éditions du Seuil.
AMIROU, R.
1995 Imaginaire touristique et sociabilités du voyage, Paris, PUF.
2000 Imaginaire du tourisme culturel, Paris, PUF.
AMSELLE, J.-L.
2001 Branchements. Anthropologie de l’universalité des cultures, Paris, Flammarion.
APPADURAÏ, A.
2001 Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Payot.
AUTREPART
2006 « Tourisme culturel, réseaux et recompositions sociales », 40 (4), Paris, Armand Colin.
BASTIDE, R.
1975 Le sacré sauvage, Paris, Éditions Payot.
BERTHO-LAVENIR, C.
1999 La roue et le stylo. Comment nous sommes devenus touristes, Paris, Odile Jacob.
BOORSTIN, D. J.
1961 The Image: A Guide to Pseudo-events in America, New York, Harper and Row.
BOUTILLIER, J.-L., COPANS, J. & FIELOUX, M. (dir.)
1978 Le tourisme en Afrique de l’Ouest, panacée ou nouvelle traite ?, Paris, Maspero.
BOYER, M.
1996 L’invention du tourisme, Paris, Gallimard.
BRUNER, E.
2005 Culture on Tour. Ethnographies of Travel, Chicago, The University of Chicago Press.
CAMPBELL, J. T.
2006 Middle Passages. African American Journeys to Africa 1787-2005, New York, Penguin.
CAZES, G.
1989a Les nouvelles colonies de vacances ? t. I : Le Tourisme international à la conquête du Tiers Monde,
Paris, L’Harmattan.
1989b « Le mirage touristique dans les pays pauvres : réflexions à partir de quelques exemples de
l’Afrique Noire », in Pauvreté et Développement dans les pays tropicaux. Hommage à Guy Lasserre,
Pessac, Institut de Géographie, CEGET : 319-338.
1992 Les nouvelles colonies de vacances ? t. II : Tourisme et Tiers Monde, un bilan controversé, Paris,
L’Harmattan.
CIVILISATIONS
2008 « Tourisme, mobilités et altérités contemporaines », 57 (1-2).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
18
COHEN, E.
1971 « Arab Boys and Tourist Girls in a Mixed Jewish-Arab Community », International Journal of
Comparative Sociology, 12: 217-233.
1985 « The Tourist Guide: The Origin, Structure and Dynamics of a Role », Annals of Tourism
Research, 12: 5-29.
2001 Thaï Tourism. Hill Tribes, Islands and Open-ended Prostitution, Bangkok, White Lotus.
COHEN, S.
1997 « More than the Beatles: Popular Music, Tourism and Urban Regeneration », in S. ABRAM, J.
WALDREN & D. MACLEOD (eds.), op. cit.: 71-90.
COUSIN, S.
2008 « L’Unesco et la doctrine du tourisme culturel », Civilisations, 57 (1-2) : 41-56.
DALLEN, J. T. & OLSEN, D. H.
2006 Tourism, Religion and Spiritual Journeys, Londres, Routledge.
DAVID, B.
2007 « Tourisme et politique : la sacralisation touristique de la nation en Chine », Hérodote, 125,
numéro spécial, Chine, nouveaux enjeux géopolitiques : 143156.
DIENG, I. M. & BUGNICOURT, J.
1982 Touristes-rois en Afrique, Paris, Karthala (« Les Afriques »).
DUMAZEDIER, J.
1972 [1962] Vers une civilisation du loisir ?, Paris, Éditions du Seuil.
FRANKLIN, A.
2003 Tourism. An introduction, London, Thousand Oaks ; New Delhi, Sage publications.
GRABURN, N.
1983 « Tourism and Prostitution », Annals of Tourism Research, 10 (3): 437-443.
HAINAGIU, M.
2008 « Une légende à des fins touristiques dans la Roumanie communiste. Les circuits à thème
“Dracula, Vérité et Légende” », Civilisations, LVII, 1-2 : 109-125.
DE KADT, E.
1979 Tourisme : passeport pour le développement ? Regards sur les effets culturels et sociaux du tourisme
dans les pays en développement, Paris, Banque Mondiale-UNESCO-Economica.
MACCANNELL, D.
1976 The Tourist : A New Theory of The Leisure Class, New York, Schoken Books.
1992 Empty Meeting Grounds. The Tourist Papers, Londres, Routledge.
MICHAUD, J.
2001 « Anthropologie, tourisme et sociétés locales au fil des textes », Anthropologie et Sociétés, 25
(2) : 15-33.
MICHEL, F.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
19
2006 « Vers un tourisme sexuel de masse ? », Le Monde Diplomatique, août.
PICARD, M.
1992 Bali. Tourisme culturel et culture touristique, Paris, L’Harmattan.
2001 « Bali : Vingt ans de recherches », Anthropologie et sociétés, Tourisme et sociétés locales en Asie
orientale, 25 (2) : 109-127.
REISINGER, Y. & STEINER, C.
2006 « Reconceptualising Interpretation : the Role of Tour Guides in Authentic Tourism », Current
Issues in Tourism, 6: 481-498.
ROUX, S.
2009 « Le savant, le politique et le moraliste. Historiographie du “tourisme sexuel” en
Thaïlande », a contrario, 11 : 28-42.
SELWYN, T.
1996 The Tourist Image. Myths and Myth Making in Tourism, Chichester, Wiley.
URBAIN, J.-D.
1991 L’idiot du voyage, Paris, Plon.
URRY, J.
1990 The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Society, London, Sage.
VUKONIC, B.
1996 Tourism and Religion, Oxford, Pergamon.
WANG, N.
1999 « Rethinking Authenticity in Tourism Experience », Annals of Tourism Research, 26: 349-370.
WOOD, R. E.
1997 « Tourism and the State: Ethnic Options and Constructions of Otherness », in M. PICARD & R.
E. WOOD (eds.), Tourism, Ethnicity and the State in Asian and Pacific Societies, Honolulu, University of
Hawai’i Press: 1-34.
NOTES
1. Le Maghreb et l’Afrique du Sud captant la moitié de ce pourcentage, la part mondiale des
touristes se rendant dans le reste de l’Afrique est infime.
2. À partir de la fin des années 1970, les chercheurs se sont en effet principalement intéressés à
l’impact socioculturel du tourisme sur les populations locales (DE KADT 1979) ou à son impact
économique, en soulignant notamment le problème de la fuite des devises dans les pays du Tiers-
Monde (coût des investissements dans les équipements touristiques et rapatriements à l’étranger
des bénéfices effectués par les entreprises étrangères participant à l’industrie touristique)
(BOUTILLIER ET AL. 1978 : 23-46). Plus de dix ans après, le géographe G. CAZES (1989a, 1989b, 1992)
réaffirmait le bilan plus que mitigé du tourisme dans certains pays d’Afrique noire francophone.
3. Voir notamment les revues AUTREPART (2006), ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES (2007),
CIVILISATIONS (2008).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
20
4. À propos de l’acte touristique comme perspective d’autoformation par le voyage, voir
notamment BOYER (1996), BERTHO-LAVENIR (1999). Au sujet du rapport entre augmentation du
temps libre et autoformation par le loisir, voir les ouvrages de Joffre DUMAZEDIER (1972
notamment), fondateur de la sociologie des loisirs et cofondateur du mouvement d’éducation
populaire Peuple et Culture.
5. D’une façon générale, la rencontre évoque le surgissement contingent d’un événement, lui-
même constitué par le croisement de deux individus. Le terme insiste traditionnellement sur le
hasard et la contingence qui président à ces croisements. Plus précisément, dans la philosophie
contemporaine, le terme évoque à la fois la contingence du croisement des vies et l’extrême
adéquation, l’accord extrême qui se dévoilent entre les deux consciences. Celles-ci sont alors
unies par la reconnaissance et la réciprocité (glossaire non exhaustif des termes employés par le
professeur Robert Misrahi dans le cadre de ses œuvres et de son séminaire, <//diplomarc.org/
files/Glossaire %20Robert %20Misrahi.doc>).
6. Voir également sur cet ouvrage, le compte rendu de Cristina D’ALLESSANDRO SCARPARI (dans ce
numéro).
7. Comme ceux de l’écrivain Langston Hugues qui quitte les États-Unis pour l’Afrique de l’Ouest
en 1923.
AUTEURS
NADÈGE CHABLOZ
Centre d’études africaines, EHESS, Paris.
JULIEN RAOUT
Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques, Université des sciences et
technologies de Lille I, Lille.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
21
« Découvrir l’âme africaine ». Lestemps obscurs du tourisme culturelen Afrique coloniale française(années 1920-années 1950)"Discovering the African Soul". The Dark Ages of Cultural Tourism in French
Colonial Africa (1920s-1950s)
Sophie Dulucq
NOTE DE L'AUTEUR
« Découvrir l’âme africaine »: Cette expression éminemment datée est tirée d’une
brochure touristique du début des années 1950 : Services d’information de l’AEF, Afrique
équatoriale française (brochure éditée à l’occasion de la participation de l’AEF à la foire
exposition de Brazzaville), 1951, p. 40.
1 C’est dans les termes suivants que la Revue des voyages vante, en 1958, les charmes de
nouveaux circuits touristiques organisés en Afrique occidentale française :
« Ces croisières [...] sont conçues de telle façon qu’en peu de jours, le touriste puissevoir le maximum de choses. Non seulement, au cours du voyage, les beautésnaturelles des pays traversés sont mises à la portée du voyageur, mais aussi lefolklore indigène, les tribus les moins accessibles, les curiosités de la vie locale avec,entre autres, les marchés si pittoresques de l’Afrique noire et une faune d’unevariété sans égale qui fera le bonheur des chasseurs d’images »1.
2 Depuis plusieurs décennies, en effet, les territoires français d’Afrique subsaharienne
sont devenus des destinations sinon courantes du moins prisées par une élite de
voyageurs à la recherche de dépaysement et d’exotisme. Certaines activités touristiques
y sont repérables dès la fin du XIXe siècle — liées à l’attrait de la chasse dans les savanes
sahéliennes ou en forêt —, mais en dépit d’un intérêt sans cesse réaffirmé par les
pouvoirs coloniaux, les infrastructures indispensables au développement du tourisme
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
22
ont été lentes à se mettre en place (Marcin 2006). On discerne néanmoins les prémisses
d’un développement touristique en Afrique « noire » française à mesure que les
conditions de transport s’améliorent — routes, trains, puis avions (Haumonté 2005) —
et que divers organismes publics ou privés commencent à encadrer les touristes. Certes
le nombre des visiteurs est encore réduit au moment des indépendances, même avec les
progrès du transport aérien dans l’après- guerre qui met Dakar ou Brazzaville à
quelques heures de Paris. Mais l’activité touristique, difficile à quantifier en l’état
actuel des recherches et compte- tenu de l’imprécision structurelle des sources, ne
cesse de progresser tout au long de la période coloniale, passant de quelques centaines
de voyageurs dans les années 1920 à quelques milliers dans la décennie 1950.
3 Parallèlement à cet engouement relatif pour les voyages en Afrique, une impulsion est
donnée par l’administration coloniale avec la publication des premiers guides, comme
ceux réalisés sous l’égide du gouvernement général de I’AOF à partir des années 1920,
régulièrement réédités au cours des années 1930-1940 puis relayés par les Guides Bleus
Hachette à partir des années 19502. En mobilisant administrateurs, militaires, mais
aussi savants et érudits, les autorités n’hésitent pas à inventorier des sites, à proposer
des circuits, à dispenser des conseils pratiques aux voyageurs, à définir ce qui est
« touristiquement pertinent » (Furlough 2002), tout en vantant les mérites de l’« œuvre
coloniale ». Il faut cependant bien garder en tête que le tourisme est demeuré une
activité très marginale avant les indépendances, mobilisant souvent davantage les
talents rhétoriques des administrateurs coloniaux que le financement effectif
d’infrastructures sur le terrain.
4 Plusieurs recherches en histoire ont commencé à explorer les aspects politiques,
administratifs et économiques de l’émergence du tourisme en Afrique (Marcin 2006 ;
Dulucq 2009), ainsi que ses liens avec l’entreprise coloniale (Zytnicki & Boumeggoutti et
al. 2006 ; Zytnicki & Kazdaghli 2009), travaux auxquels le lecteur pourra se reporter, s’il
le souhaite, pour saisir les contours et les objectifs de ces pratiques soutenues par les
autorités françaises. Celles-ci voient en effet dans le développement touristique un
moyen de prodiguer aux voyageurs une « leçon de choses » impériale dans les années
1920-1930 (Furlough 2002) puis, dans les années 1950, une voie possible de
développement (Dulucq 2009).
5 En remontant à cette genèse, on découvre que des expériences précoces ont contribué à
l’« invention » d’une Afrique touristique qui s’est appuyée sur la mise en scène
d’éléments relevant de la sphère culturelle. En l’absence de sites monumentaux à
visiter, le primo-tourisme s’est bien sûr essentiellement structuré autour de la
promotion de la chasse et de la nature, sur le modèle du safari développé dans les
colonies britanniques. Mais tous les touristes de l’époque ne sont pas exclusivement
chasseurs ou amateurs de faune et de flore. Beaucoup d’entre eux sont également mus
par l’idée d’une rencontre avec l’Afrique mystérieuse et éternelle, poussés au voyage
par leur curiosité pour des mœurs et des coutumes étranges, par le pittoresque d’un
folklore indigène aux contours exotiques et par l’attirance pour un artisanat local de
plus en plus valorisé. L’offre touristique s’est adaptée à cette demande — qu’il faut
resituer dans un contexte colonial profondément marqué par des logiques
économiques, politiques et idéologiques spécifiques3 (Zytnicki & Boumeggouti 2006 :
9-10) —, tout en la renforçant selon des mécanismes déjà bien rodés en Europe
occidentale (Boyer 1996 ; Bertho-Lavenir 1999).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
23
6 Cet article se propose d’examiner les premières formes de mise en tourisme des
cultures locales en se concentrant particulièrement sur les activités « culturelles »
proposées aux voyageurs de l’époque. Ce sera l’occasion d’inscrire le fait touristique
dans une histoire plus globale des représentations et des savoirs coloniaux et de
souligner, en s’appuyant notamment sur les travaux d’Anne Doquet (1999, 2002) et de
Gaetano Ciarcia (1998, 2003) sur le pays dogon contemporain, les relations étroites qu’a
très tôt entretenues le tourisme en Afrique avec l’ethnographie. Il s’agira également de
saisir les premiers mécanismes de folklorisation et de patrimonialisation (peut-être
même de « marchandisation » ?) des cultures locales, prodromes d’un processus qui a
atteint aujourd’hui des dimensions particulièrement spectaculaires dans certaines
zones, comme justement chez les Dogons4.
7 Des sources variées — récits de voyage individuels, guides, rapports, documents
officiels ou privés — fournissent à l’historien un matériau précieux pour étudier la
manière dont les acteurs d’une activité touristique balbutiante se sont saisis des
cultures africaines à l’époque coloniale. Mais cette documentation présente des lacunes
de taille et ne permet pas, loin s’en faut, de répondre en détail à des interrogations
parfois simples. Ainsi, la documentation officielle consultée à ce jour n’a-t-elle fourni
que des chiffres fragmentaires et généralement très approximatifs du nombre de
touristes visitant I’AOF ou I’AEF5. Identifier les promoteurs du tourisme africain n’est pas
toujours facile avant la Seconde Guerre mondiale, dans la mesure où, par exemple, les
brochures de propagande touristique émanant des services d’information fédéraux ou
territoriaux sont rarement signées — voix anonymes de l’administration. Quant aux
traces documentaires laissées par/ou à propos des acteurs africains du tourisme
(guides, danseurs, artisans, employés de l’hôtellerie, etc.), elles sont sporadiques et, là
encore, ne donnent souvent lieu qu’à des allusions rapides et factuelles, difficilement
mobilisables pour une interprétation approfondie.
8 Tout en ayant pleinement conscience des limites auxquelles se heurte l’enquête
historique, nous avons l’ambition d’explorer dans cet article une facette d’un sujet qui
n’a guère retenu jusqu’ici l’attention des historiens du fait colonial, alors même que le
tourisme constitue un point d’entrée original dans l’histoire de l’Afrique sous
domination européenne. Nombreuses sont les pistes (documentaires, interprétatives)
qui mériteront à coup sûr d’être complétées, approfondies et enrichies. Dans l’état
actuel de nos recherches, il apparaît d’ores et déjà que les adeptes du tourisme culturel
contemporain ont eu des devanciers à l’époque coloniale, avides tout autant qu’eux de
découvrir l’Afrique « authentique » et « éternelle », ce qui ne fut pas sans conséquence
sur les populations visitées.
S'intéresser « aux hommes et à la terre d'Afrique » :quand le touriste se pique d'ethnologie et d'histoire
9 C’est sous l’égide du Gouverneur général Jules Carde qu’est publié, en 1924, le Bréviaire
du tourisme en Afrique occidentale française, édité par les services du gouvernement
général et imprimé par les services centraux de I’AOF. Dans la logique des directives
données par le ministre des Colonies Albert Sarraut, au début des années 1920, Carde
s’attache à encourager l’essor des territoires de la fédération dans un contexte de
relative croissance de l’économie coloniale6, ce que fera également son successeur Jules
Brévié. Cet intérêt pour les possibilités de développement touristique dans les colonies
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
24
africaines est le fait d’un nombre relativement restreint d’individus avant la Seconde
Guerre mondiale, les initiatives relevant souvent de personnalités isolées de
l’administration coloniale, de militaires aventureux, d’amateurs de voyages sportifs,
tous promoteurs d’un tourisme d’élite. On peut évoquer quelques figures remarquables,
comme l’administrateur Jules Leprince qui repère des itinéraires et des sites potentiels
au Fouta Jallon (Guinée) dès 19107. On rencontre aussi des aristocrates et des grands
bourgeois amoureux de la chasse et du voyage d’exception — l’incontournable Émile-
Louis Bruneau de Laborie (1929, 1931)8 ou le baron Jacques de Fouchaucourt (1928,
1938) — et divers polygraphes du Parti colonial, tel Maurice Rondet-Saint (1933), un
temps directeur de la Ligue maritime et coloniale et auteur de plusieurs récits de
voyage dans l’empire français.
10 Le tourisme, s’il n’a pas de poids économique réel, est toutefois un secteur susceptible
d’attirer en Afrique des hommes d’affaires, des décideurs, des colons ou des
investisseurs potentiels. La connaissance des colonies est aussi un vecteur de l’idée
coloniale et de construction d’une identité impériale, même auprès de ceux qui ne
voyageront jamais (Furlough 2002). Il n’est donc guère étonnant de voir fleurir la
propagande touristique à partir des années 1920 — vraisemblablement
disproportionnée par rapport au nombre réel de voyageurs —, relayée en métropole
par l’Office colonial puis par l’Agence générale des Colonies9. Après 1945, la tendance se
confirme, avec un infléchissement dans les objectifs de la promotion touristique : pour
les services centraux des colonies et des fédérations comme pour le ministère de la
France d’Outre-Mer ou les directeurs d’agences spécialisées dans le tourisme outre-
mer10, c’est avant tout l’argument du développement économique qui est mis en avant
pour soutenir les efforts touristiques, dans le cadre des plans d’investissement du FIDES
(Dulucq 2009).
11 Quelles que soient les motivations finales, les guides et les brochures de propagande
touristique qui organisent et amplifient le discours officiel s’accordent sur un constat
tout au long de la période coloniale : aux chasseurs de gibier ou d’images qui se rendent
pour leurs loisirs dans les colonies s’ajoutent les vacanciers qu’attirent « les excitants
plaisirs des découvertes de terres et d’hommes primitifs »11 et, plus généralement, tous
ceux qui « s’intéressent aux hommes et à la terre d’Afrique »12. De fait, « l’étude des
races et des mœurs indigènes » est aussi l’un des « motifs qui peuvent attirer des
visiteurs dans la Colonie »13. Tout un programme s’offre au visiteur que la découverte
culturelle intéresse, promu d’office au rang d’ethnographe amateur :
« Le touriste que retient particulièrement l’homme, ses mœurs, ses travaux, sesœuvres d’art n’a, lui aussi, que l’embarras du choix dans l’immense variété dupeuplement du centre africain français. À travers les tam-tam et les cérémoniesfétichistes du Sud, les fantasia et les rituels musulmans du Nord, il pourra chercherà découvrir l’âme africaine si mystérieuse et si attachante. Il s’attachera auxdifférents arts locaux : sculptures, poteries, peintures murales ; il s’intéressera à lamusique centrafricaine dont l’étude vient juste de commencer, mais laisse déjàentrevoir tout un monde de rythmes, de tons et de cadences, pleins d’attraits pourle chercheur soucieux de remonter aux sources de l’expression musicaleprimitive »14.
12 Il est remarquable de voir comment l’ensemble des promoteurs du tourisme place le
voyage en Afrique sous les auspices de la jeune science ethnographique ; ces savoirs
récents viennent pimenter le simple plaisir du dépaysement et légitimer la démarche
des voyageurs. Le touriste, du haut de sa supériorité d’Européen, est convié non pas à
simplement rencontrer des populations, mais à les étudier avec toute la distance
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
25
requise. Comme le précise une brochure de 1931 : « Pour avoir, au point de vue du
pittoresque, une réputation moins brillante que [la Guinée], la Côte-d’Ivoire offre
cependant aux amateurs de pittoresque et d’études ethnographiques de nombreuses
attractions et d’intéressants objets d’étude »15. Le touriste est ainsi invité à s’inscrire
dans la démarche de connaissance des populations colonisées, ce qui était au cœur de
l’émergence des savoirs coloniaux depuis le XIXe siècle (Cahiers Jussieu 1976 ; Nordman
& Raison 1980) et plus spécifiquement de l’africanisme (Sibeud 2002). On conseille
parfois aux voyageurs, en plus des cartes, du matériel de chasse, de camping et de
photographie, de se munir de « quelques-uns des ouvrages qui ont été publiés sur
l’histoire, l’ethnographie, les coutumes du pays, la faune, la flore, la documentation
économique, etc. »16.
13 Les guides touristiques puisent directement dans les travaux ethnohistoriques de
Maurice Delafosse ou de Georges Hardy, compilant et vulgarisant un certain nombre de
connaissances sur le passé africain, évoquant pêle-mêle les anciens empires soudanais
et les guerres de conquête du XIXe siècle. Les travaux des savants coloniaux —
historiens, ethnologues, archéologues, linguistes — sont une source importante où
s’alimentent les auteurs souvent anonymes des ouvrages touristiques des années
1920-1930.
14 La constitution d’un patrimoine touristique a en effet besoin de connaissances validées
et d’un discours d’autorité : il a déjà été fait allusion à l’utilisation massive de Maurice
Delafosse dont le classique, Haut-Sénégal-Niger (1912), sert de référence à toutes les
mises au point historiques destinées aux voyageurs curieux dès les premières
brochures de l’Entre-deux-guerres.
15 Des contacts fructueux sont même noués dans les années 1930 par les services des
gouvernements généraux des colonies avec des institutions savantes métropolitaines,
comme l’attestent les courriers échangés par Henri-Georges Rivière, alors directeur du
Musée de l’Homme (Byrne 2001) : « En retour de l’aide offerte par l’administration
coloniale [aux missions ethnographiques en AOF], le musée exposa et diffusa des
prospectus touristiques pour les colonies. Les missions de Griaule, en particulier,
suscitèrent beaucoup d’intérêt public, ce qui créa de la publicité pour les colonies »17.
Au Soudan français, on a d’ailleurs largement recours aux recherches assez largement
médiatisées de Marcel Griaule et de ses élèves, au détour d’exposés ethno-touristiques
sur la cosmogonie dogon18.
16 La vulgarisation scientifique à la sauce touristique s’amplifie après 1945, d’autant plus
que des institutions pérennes de recherche scientifique se sont installées en AOF sous
l’égide de l’Institut français d’Afrique noire de Dakar. Ainsi, les multiples co-auteurs du
premier Guide Bleu de I’AOF en 1958 sont, pour la plupart, des scientifiques reconnus,
chercheurs à I’IFAN. On trouve parmi les contributeurs Théodore Monod, zoologue,
botaniste et directeur de I’IFAN ; Bohumil Holas, chef de la section ethnographie-
sociologie ; Raymond Mauny, chef de la section archéologie-préhistoire ; Gérard
Brasseur, géographe et directeur du Centre IFAN de Bamako, etc. (Houlet 1958).
17 Cette mobilisation des spécialistes de sciences humaines et sociales est d’ailleurs un
classique, que ce soit en métropole — les recherches des érudits locaux y interviennent
également dans la construction des discours touristiques — ou dans les territoires
colonisés où ce discours appartient aux seuls savants européens (Zytnicki &
Boumeggouti et al. 2006 : 12-13). Dès lors, il n’est pas difficile d’imaginer qu’hier comme
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
26
aujourd’hui, les touristes sont « guidés par le besoin de confirmer leurs connaissances
livresques », qu’ils aient lu Griaule, Delafosse ou quelque roman colonial teinté
d’ethnographie. C’est là que réside l’essence même de la pratique touristique : aller
reconnaître plutôt que découvrir (Doquet 1999 : 250), contrairement au discours que
tiennent sur eux-mêmes les acteurs du secteur, qui se voient plutôt comme des
explorateurs des temps modernes. Cette vulgarisation ethnico- historique constitue
moins un outil de découverte ou de connaissance approfondie qu’un instrument de
légitimation de l’entreprise touristique qui s’installe résolument au carrefour du
divertissant et de l’instructif.
18 On a mis en évidence les mêmes processus dans les guides de voyages en Europe — des
guides Baedeker aux Guides Joanne, en passant par les Guides Bleus Hachette — qui, dès le
XIXe siècle, situent l’acte touristique dans une perspective d’autoformation par le
voyage (Boyer 1996 ; Bertho- Lavenir 1999). En cela, les bréviaires touristiques publiés
en AOF et en AEF sont le prolongement direct des guides métropolitains, comme l’étaient
déjà les premiers ouvrages touristiques sur le Maghreb à la fin du XIXe siècle (Zytnicki
2006 : 90-92). L’entrée de l’Afrique de l’Ouest dans la célèbre collection des Guides Bleus
(Houlet 1958) à la fin de la période coloniale confirme une forme de « normalisation »
du tourisme subsaharien, qui fait largement appel aux connaissances savantes de
l’époque, vulgarisées au profit d’un lectorat familier de la structure des guides de
voyage. C’est aussi une reconnaissance des frontières élargies de la Plus grande France.
19 Les guides ne se contentent pas de vulgariser les savoirs ethnographiques de l’époque.
Ils égrènent aussi les clichés habituels sur la « mentalité » des indigènes (bonhomie,
nonchalance, fatalisme, paresse, etc.). On y classifie les peuples selon la terminologie
psychologisante de l’époque, comme cela est d’ailleurs pratiqué dans les classifications
des populations européennes, proposée par la littérature touristique :
« Au nord-est de la colonie (de Côte-d’Ivoire), le voyageur visitera, non sans plaisir,Bondoukou, une des plus vieilles villes de l’AOF, habitée par des Mandésmusulmans, aux cases en pisé, qui forment un îlot au milieu des Abrous animistes.Ces Mandés venus du pays ashanti à la fin du seizième siècle, ont asservi lesautochtones, les Koulangos, peuple le plus doux et le plus paisible qu’il soit possiblede rencontrer »19.
20 Certaines considérations amènent aussi à évoquer, çà ou là, le corps des Africains,
agrément pour l’œil du touriste en mal d’émotions qui, de Paul Morand à Jean-Richard
Bloch (1929)20 en passant par Gide, évoque les silhouettes sculpturales des « indigènes ».
Pour attirer le voyageur à Odienné, on précise volontiers que la ville est « célèbre pour
la beauté des femmes, croisements de nègres et de peulhs, aux traits fins et réguliers,
aux corps sveltes et élégants [...] »21.
21 Dans un registre différent, le voyage en Afrique est parfois présenté comme une forme
de voyage dans le temps, qu’il s’agisse de remonter aux sources antiques22 ou vers
l’aube de l’humanité. Comme le proclame une brochure en trois langues (français,
anglais, allemand) de 1958 vantant les charmes de I’AEF : « Le voyageur y découvrira des
types physiques remarquables, des coutumes et des modes de vie inchangés depuis des
millénaires côtoyant les aspects de la vie la plus moderne »23.
22 Certes « les hommes plus que les sites constituent l’attrait principal du tourisme
africain »24. Mais la visite de monuments fait si intrinsèquement partie des pratiques
occidentales, en métropole (Boyer 1996 ; Bertho-Lavenir 1999) comme dans les colonies
nord-africaines (Zytnicki & Boumeggouti et al. 2006), que les promoteurs du tourisme
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
27
aofien et aefien partent eux aussi à la recherche de lieux valorisables. Bien souvent,
d’ailleurs, en l’absence de grands vestiges du passé, c’est vers les réalisations coloniales
que sont aiguillés les touristes, incités à visiter le quartier européen d’une ville ou, sur
telle ou telle rivière de l’Oubangui-Chari, à aller admirer un « pont splendide ». Quoi
qu’il en soit, plusieurs monuments sont mis en avant selon des modèles discursifs
éprouvés par nos rédacteurs anonymes. À Djenné, c’est bien sûr la grande mosquée qui
constitue un site touristique majeur, avec la vieille ville. À Gao, la visite s’impose au
tombeau de l’Askia Mohammed, « grande pyramide de briques sèches, hérissée de
poutres, témoignage du puissant État Sonrhaï disparu, qui subsista du VIIe au XVI e
siècle et dont les fondateurs auraient été des chrétiens convertis vers l’an mil à
l’Islam »25. À Tombouctou, il faut absolument aller voir la maison de Caillié et la
mosquée Sankoré. Près de Bandiagara, il ne faut pas manquer l’excursion aux grottes de
Deguembéré où périt El Hadj Omar Tall.
23 Les premiers guides des années 1920 —jusqu’au Guide Bleu de 1958 — exaltent avec
lyrisme les gloires d’antan, et ce d’autant plus volontiers que les vestiges du passé ne
sont pas toujours très spectaculaires :
« Que de souvenirs évoquent, chez le voyageur, le seul nom de Soudan ! C’est, auMoyen-Âge, le tumulte des empires de Gao et de Mali ; Songhrais et Mandés,affaiblis par leurs conquêtes, détruits par les guerres ; c’est la venue à Tombouctoude la petite armée marocaine dont les mousquetaires eurent raison des royaumesaffaiblis. [...] Dans la région de Gao et de Tombouctou, le touriste visitera avecémotion les villes autrefois si puissantes, tombées avant notre occupation sous lejoug des peuples voilés du Sahara, autrefois pillards du désert et qui sont devenus,sans l’organisation de la défense saharienne, nos utiles auxiliaires ; [...] encontinuant vers le sud [...] il séjournera à Sikasso qui résista à Samory et futinutilement assiégée par ce conquérant »26.
24 La mise en tourisme, qui passe immanquablement par l’« invention » de sites (Bertho-
Lavenir 1999 ; Zytnicki 2006 : 87-88), se fait parfois au risque de la déconvenue. C’est le
cas à Tombouctou, dont les touristes ont peut- être trop rêvé. On l’a dit, les touristes
vont souvent vérifier sur place ce qu’ils ont lu, et ressentir l’impression à laquelle ils se
sont préparés (Doquet 1999 : 251). Le désappointement est palpable chez Paul Morand
(1928 : 52) qui parle de Tombouctou comme d’un « gros village nègre », frustrant sur le
plan touristique — beaucoup ont d’ailleurs cherché à le dissuader d’y faire étape — et
où tout tombe en ruine. Même déception chez le baron de Foucaucourt qui s’exprime
dans un récit publié la même année que celui de Morand : « La déchéance de la grande
métropole africaine s’est depuis [l’époque de Caillié] poursuivie, et le touriste en
revient généralement déçu », n’ayant à visiter que des « cases médiocres » et les
modestes hébergements de Réné Caillié lui-même, de Heinrich Barth et de Gordon
Laing. En dehors de « quelques magasins assez riches en objets indigènes »,
Tombouctou « ne mérite guère qu’une visite d’une journée [...] » (de Foucaucourt 1928 :
107-108)27.
25 Il faut dire que la ville des portes du désert était devenue, dans le contexte des
explorations systématiques au début du XIXe siècle, un véritable « mythe
géographique », un « lieu de condensation » de l’imaginaire européen, la « synecdoque
d’une Afrique à explorer » (Surun 2002 : 131-132). Au moment de son « dévoilement »,
Tombouctou ne peut que désappointer les voyageurs européens, à l’instar de ses
premiers visiteurs du siècle précédent : « Tout se passe comme si le voyageur, qui
arrive porteur d’une certaine représentation de Tombouctou, se trouvait dépourvu
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
28
d’image parce que l’objet qu’il a soudain sous les yeux ne peut être saisi à travers cette
représentation » (ibid. : 143).
26 Le mythe a la vie dure28, de même que la déception sans cesse réitérée. Il semblerait que
« personne n’[a] rien appris sur Tombouctou entre-temps », qu’« aucun voyageur ne
prend en compte la déception de ses prédécesseurs » : la représentation mythique est
« décidément indétrônable » (ibid. : 143). Des premiers explorateurs du XIXe siècle aux
premiers touristes du XXe, le mécanisme est rigoureusement similaire : il convient
d’aller éprouver soi- même la force du mythe, et d’expérimenter en personne le
désappointement...
Une mise en scène folklorisée des cultures locales
27 Les guides et les brochures ne se contentent pas de produire des discours. Ils invitent
aussi les lecteurs à se lancer dans des activités concrètes, à développer des pratiques
touristiques. On engage le touriste à assister à des fêtes — les fameux « tam-tam »
systématiquement évoqués —, à acheter des souvenirs artisanaux, parfois à rencontrer
des notables « indigènes ». Il s’agit partout d’accéder à une Afrique à la fois authentique
et, par-dessus tout, la plus traditionnelle possible.
28 Dès les années 1920, les récits des voyageurs ne sont pas en reste, et vantent le charme
bigarré de la vie locale. Paul Morand (1928 : 74), traversant l’AOF en 1928, considère la
visite du marché de Danané, en Côte-d’Ivoire, comme « l’un des plus émouvants
spectacles de [s]on séjour ». En 1955 encore, sous la plume du directeur général de
l’Agence nationale pour le Développement du Tourisme Outre-Mer, le pittoresque des
marchés demeure la première curiosité proposée aux potentiels voyageurs :
« Comme dans tout centre africain, on ne saurait quitter Dakar sans aller faire untour au marché, le marché de Sandaga qui offre le spectacle haut en couleurs d’unefoule grouillante, faite de races multiples, vêtue de teintes très vives. Pourl’Européen arrivant en Afrique, les scènes de marché sont parmi les plus appréciéesdes amateurs d’exotisme. Sans doute parce qu’elles permettent de prendreimmédiatement contact avec la vie locale et de saisir sur le vif des manifestationsspontanées de populations pas toujours faciles à pénétrer »29.
29 Un autre spectacle prisé est celui du « tam-tam », terme générique qui désigne des
réalités variées : cérémonies impliquant chants et danses, spectacles organisés par les
autorités locales dans les années 1920-1930, spectacles en cours de folklorisation
comme les danses masquées dogon (Doquet 1999 : 259) ou spectacles intégralement
commerciaux, assurés par des professionnels à partir des années 1950. Dans la partie de
son récit intitulé « Conseils pratiques », Paul Morand donne un certain nombre
d’indications aux aspirants au voyage dans la boucle du Niger : s’ils veulent voir des
danses, des cérémonies et des festivités en tout genre, il leur faut télégraphier à
l’avance chez les administrateurs de cercle, « au premier interprète ou à l’écrivain ».
C’est justement parce qu’il n’a pas prévenu suffisamment tôt les autorités qu’il n’a pas
pu assister, à Banfora, au « fameux tam-tam coït » (sic) (Morand 1928 : 55). En pays
dogon, dans les années 1950, on conseille d’assister, à Sangha comme à Bandiagara, à la
danse des masques, dans une région qui « par ses sites comme par son folklore, peut
être rangée parmi les plus touristiques de l’Afrique occidentale »30.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
29
30 La danse est parfois une activité pratiquée par des professionnels, comme en atteste cet
exemple des années 1930, sans que l’on sache très bien si la professionnalisation est
directement liée à la présence de touristes :
« [...] Touba (en Côte-d’Ivoire), au milieu d’un paysage gracieux, est renommé pourses “tam-tam” variés, ses danseurs géants costumés montés sur des échassescachées sous d’amples pantalons ; [...] au nord d’Odienné, existe un corps dedanseurs et FN31 FN 32 de danseuses professionnels, composé de jeunes indigènesentraînés dès l’enfance, dont les danses mimées, les ballets, aux sons de nombreuxinstruments, sont des plus gracieux »33.
31 Vers 1955, on repère au hasard des sources consultées la mention de quelques
spectacles visiblement organisés en marge de certains équipements touristiques, sans
que l’on puisse clairement identifier les acteurs de ces attractions. Tout au plus, dans la
bourgade de Man (Côte-d’Ivoire) où a été installé un « campement-restaurant », note-t-
on la tenue de « danses pratiquées par des danseurs fétichistes masqués »34, sans qu’il
soit possible de savoir si ces danses sont déjà le fait d’individus salariés. Ailleurs, le
touriste est invité à faire coïncider sa visite avec les fêtes locales plus spontanées,
comme chez les Bororos de Bouar, sur l’itinéraire conseillé entre Bangui et Brazzaville :
« Le touriste aimera assister à une de leurs fêtes coutumières, telle la fameuse fêtedu Mouton, qui rassemble fréquemment plus de 2 000 personnes ; les dansesmartiales suivent les prières ; ce ne sont que bruits de tam-tam et de trompettes ;au milieu de tout cela, on admire les chefs en grand costume, montés sur leurschevaux richement caparaçonnés ; enfin, après le sacrifice de quelques moutons etbœufs, un immense festin groupe les participants, qui, au son des musiquesguerrières, s’égaient longuement près des cases »35.
32 Selon Anne Doquet (1999 : 259), il est difficile « de reconstruire l’évolution de ces
danses qui n’ont pratiquement jamais intéressé les ethnologues », compte tenu de la
rareté des écrits consacrés à leurs formes folkloriques. Cette ethnologue signale
cependant que « durant les années de la colonisation, des sorties occasionnelles étaient
imposées par l’administration coloniale pour honorer la visite d’un personnage
important » ; mais, « c’est dans les années cinquante qu’elles ont pris une tournure plus
régulière et qu’un salaire a été fixé pour chaque participant », avant une complète
professionnalisation de certains jeunes danseurs dogon, intégrés dans la troupe de
folklore national malien après l’indépendance. Les chercheurs ont par ailleurs mis en
évidence pour la période plus récente des années 1980-2000 des processus de
transformation et de standardisation des danses masquées dogon (ibid. : 260), au cours
desquelles les protagonistes doivent exhiber l’« authenticité » de la manifestation36.
C’est ce que déplore déjà l’ethnologue Bohumil Holas (cité dans Houlet 1958 : CXLIX),
lorsqu’il déclare que les danses masquées, à l’origine de caractère hiératique, sont
devenues « grâce à leur popularité bibliographique, une attraction touristique banale ».
33 Les « chefs indigènes » constituent eux aussi une quasi-attraction touristique pour les
premiers voyageurs des années 1920-1930 (Marcin 2006 : 21). Plusieurs globe-trotters
rendent ainsi visite à des dignitaires, comme en attestent les témoignages de Émile-
Louis Bruneau de Laborie (1931), de André Gide (1927) (qui, lors de son fameux voyage
d’investigation au Congo, a aussi des activités de nature pleinement touristique) ou de
Marcel Sauvage (1937). Ce dernier rencontre plusieurs chefs au Cameroun, notamment
Hamaloukou, sultan de Tibati, et Hayatou, sultan de Garoua. Il a droit à une parade de
guerriers en cotte de maille, organisée à son seul bénéfice (Marcin 2006 : 21). Certains
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
30
chefs se plient d’assez mauvaise grâce à des visites visiblement imposées par
l’Administration (ibid. : 209).
34 Mais, de façon générale, soit sous la contrainte des autorités soit en vertu d’un intérêt
bien compris, on peut imaginer que certains individus parmi les populations visitées,
ont directement contribué à mettre en scène, selon les desiderata des étrangers, telle ou
telle cérémonie, se faisant « les garants de l’image à présenter » (Doquet 1999 : 255) et
participant à une invention touristique de la tradition. À l’exemple des informateurs et
des premiers guides de la région de Sangha, certains membres des communautés
villageoises attractives ont su précocement identifier, capter et canaliser les attentes
des Occidentaux — tant auprès des ethnographes que des touristes attirés par les écrits
ethnographiques. Ainsi, « le succès durable de la société dogon [en tant qu’attraction
touristique] suppose la coïncidence entre l’objet de la quête des visiteurs et ce qu’ils
croient constater au cours de leur pérégrination : les Dogon se montrent bien dogon »
(Doquet 2002 : 2), ce qui suppose la participation active de quelques-uns à la mise en
scène touristique. Les sources de l’époque coloniale sont malheureusement muettes sur
cette co-création de l’espace et des pratiques touristiques par les Africains, telle que
peut l’étudier aujourd’hui l’ethnologue — co-création qui implique à la fois des formes
de duplicité (pour « berner » le tourisme crédule et lui donner à voir ce qu’il attend),
mais aussi des formes complexes de réappropriation d’une vision occidentale de la
« tradition » (ibid. : 9-10).
Artisanat, patrimonialisation, muséification
35 Le développement du tourisme en Afrique subsaharienne a eu, on s’en doute, de
multiples retombées sur les économies locales. Certes, la fréquentation des circuits
touristiques de I’AOF et de I’AEF n’atteint pas, loin s’en faut, celle de régions plus
précocement et plus massivement fréquentées comme les territoires britanniques ; son
impact est bien moindre qu’en Rhodésie (McGregor 2003), en Union sud-africaine ou au
Kenya, territoires où se développe notamment un tourisme pratiqué par la minorité
blanche locale. Mais, dans les colonies françaises comme ailleurs, il faut nourrir les
voyageurs, les loger, les guider, les transporter, les distraire. Le touriste du XXe siècle
n’est plus un voyageur au sens ancien du terme, mais un consommateur de sites, de
monuments, de spectacles — au bénéfice de qui une partie de ces activités est produite,
programmée, encadrée par des acteurs en voie de professionnalisation.
36 C’est aussi un grand consommateur d’objets, ces fétiches indispensables à l’étranger de
passage. Cet article ne se propose pas d’explorer la variété des retombées économiques
de l’activité touristique en Afrique française, mais de se concentrer sur quelques
domaines en rapport direct avec la thématique de la mise en tourisme des cultures. Le
secteur de l’artisanat en fait partie au premier chef. L’intérêt pour les « industries
indigènes » est en effet un leitmotiv des guides de voyages et l’on sait bien que, dès le
XIXe siècle, les touristes n’ont de cesse de ramener un souvenir de leurs vacances,
preuve matérielle autant que symbolique du statut que confère le voyage d’agrément
dans une société où le commun des mortels se déplace encore rarement pour son
simple plaisir (Bertho-Lavenir 1999).
37 Les guides consacrent de longs passages à répertorier la variété de ce que le voyageur
peut rapporter dans son bagage, preuve s’il en était besoin de la nécessité pour le
touriste d’acheter des objets d’artisanat. Ainsi, « les bijoutiers indigènes du Sénégal
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
31
sont habiles à fabriquer des bijoux en filigrane d’or, des bagues, colliers, bracelets
habilement travaillés. Les Maures du fleuve ont des poignards au manche d’ébène et au
fourreau d’argent, gravés et incrustés, ainsi que des colliers du même travail », tandis
que « les touristes pourront se procurer, en Côte-d’Ivoire, des spécimens intéressants
de l’art nègre : statuettes aux formes les plus diverses, sièges d’apparat finement
sculptés, masques aux formes humaines ou bestiales, cannes curieusement travaillées,
poteries portant en relief des images d’animaux, etc. »37. Au Dahomey, « les amateurs de
souvenirs historiques trouveront à Abomey de nombreux vestiges et souvenirs des
anciens rois de ce pays ; partout, les touristes rencontreront de nombreux articles de
l’art local : masques, sièges, armes et, notamment, de curieuses reproductions en cuivre
d’hommes et d’animaux ». Sur les marchés de Haute-Volta, « on pourra se procurer ces
étranges masques indigènes, ornés de longues fibres végétales qui cachent entièrement
le danseur, ainsi que des instruments de musique les plus divers (balafons, guitares,
etc.) » ; quant à la Mission des Pères Blancs de Ouagadougou, elle « fabrique des tapis de
haute laine qui peuvent rivaliser avec ceux du Maroc »38. À Djenné, on trouve dans les
années 1950 « des bijoux d’or, d’argent, de cuivre, des armes, des coussins de cuir, de
beaux tapis aux coloris éclatants et aux dessins originaux, des broderies et des poteries
intéressantes »39. Mais l’artisanat est parfois moins élaboré, ce que ne manquent pas de
déplorer les rédacteurs de brochures : « Les articles en vannerie et les cuirs travaillés
sont à peu près les seuls objets qu’un touriste puisse emporter comme souvenirs de la
Guinée »40.
38 Les artisans locaux commencent visiblement à sculpter des objets spécialement
destinés aux voyageurs. Certaines productions semblent déjà se standardiser et
s’orienter vers le goût des touristes. C’est ce que déplore Bohumil Holas, chef de la
section d’ethnologie-sociologie de I’IFAN, à propos des statuettes en fonte à cire perdue
des Fon du Dahomey :
« C’est de là que nous proviennent, après avoir parcouru tous les ports et tous lesmarchés de l’AOF dans les sacs des Haoussas et des Dioulas (commerçantsambulants) et dans les valises des touristes blancs, des milliers de ces statuetteseffilées, en bronze jaune, qui semblent douées de mouvement. [...] ces figurines —fabriquées toujours en séries suivant les mêmes modèles — perdent beaucoup deleur charme ; ravalées au rang d’objets banals d’exportation, de simples bibelotssouvenirs de voyage, elles satisfont davantage le touriste que le vrai connaisseurd’art africain » (Holas cité dans Houlet 1958 : CLXIII).
39 Le masque en bois — dont on sait qu’il a joué un rôle important dans l’émergence de
l’art d’avant-garde du début du XXe siècle — est également un objet prisé par le
voyageur étranger, auréolé tout à la fois de sa dimension artistique, ethnographique et
touristique, facile à transporter, mais aussi facile à fabriquer en série. Le Guide Bleu de
1958 atteste d’ailleurs une forme d’adaptation cocasse à la loi du marché : en plein pays
lobi, s’est développé depuis plusieurs années un artisanat d’inspiration baoulé, sous
l’impulsion d’un commandant de cercle, car les masques baoulé se vendent mieux aux
touristes de passage que les productions artisanales locales41. L’initiative semble isolée
et suffisamment exceptionnelle pour être mise en avant par le guide ; pour autant,
cette anecdote suggère des formes précoces d’homogénéisation culturelle, de
désacralisation des objets et de folklorisation de la culture sous l’impact de la demande
européenne.
40 Certaines formes de la modernité africaine peuvent néanmoins être données à voir aux
touristes, dans la mesure où elles attestent le succès généralisé de la « mission
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
32
civilisatrice ». Au Congo, l’émergence de nouvelles activités artistiques développées
dans le cadre du Centre d’art africain dirigé par M. Lods, est signalée et les visiteurs les
plus curieux sont invités à y découvrir les productions : « [que le touriste] n’oublie pas
de visiter [...] l’atelier de peinture d’où sont sortis des artistes africains d’un réel
talent »42. Les ateliers artisanaux soutenus par les missionnaires sont également
indiqués de façon systématique. Ailleurs, ce sont les écoles d’artisanat qui sont créées
et soutenues par les autorités coloniales.
41 Bien sûr, leur vocation première n’est pas de fournir en objets « typiques » le marché
étroit des touristes, mais de développer ou de sauvegarder des savoir-faire locaux, tout
en contribuant à la formation professionnelle des jeunes. Mais, dans le domaine de
l’artisanat d’art, les liens avec l’activité touristique ne sont pas inexistants dans la
mesure où les guides et les brochures incitent systématiquement leurs lecteurs à aller
acheter des objets auprès des créateurs formés dans ces centres, de l’ouvroir des Sœurs
blanches de Ouagadougou ouvert en 1917, à la Maison des Artisans fondée à Bamako en
1932. Dans la première moitié du XXe siècle, « l’ouvroir des tapis [...] était alors la
grande attraction de la capitale de la Haute-Volta, et faisait obligatoirement partie de la
visite de la ville » pour les personnalités de passage comme pour les visiteurs étrangers
(Bobin 2003 : 263). Quant au centre de Bamako — qui forme pendant trois ans des élèves
bijoutiers, cordonniers, maroquiniers, forgerons, tisserands, relieurs, sculpteurs —, il
garantit une formation artistique « conforme à la tradition, avec l’emploi des
techniques du pays et de la décoration locale » (Holas cité dans Houlet 1958 : 187).
42 Des travaux plus approfondis devraient permettre de mieux connaître ce volet de la
politique coloniale de formation professionnelle en Afrique subsaharienne et de voir
dans quelle mesure elle peut être rapprochée de la politique volontariste menée par
Lyautey43 au Maroc (Dulucq & Zytnicki 2007 : 14).
43 L’essor de l’artisanat d’art dans les territoires dominés va de pair avec un phénomène
croissant de patrimonialisation des cultures indigènes, soutenues d’abord par les
autorités coloniales (Oulebsir 2004 ; Dulucq & Zytnicki 2007 : 9-19) puis réappropriées
par les Africains eux-mêmes. C’est ce que montre Gaetano Ciarcia (2003 : 138-139) à
propos de la culture dogon : les Dogons, et les Maliens en général, ont transformé le
mythe ethnographique griaulien en « ressource naturelle » et en « patrimoine », au gré
d’une gestion « anthropologico-touristique de la région ». D’où la continuité probable,
des temps coloniaux au tourisme contemporain, d’une valorisation, d’un inventaire et
d’une promotion de la « tradition » africaine qui n’excluent pas le phénomène
d’invention de cette même « tradition » (Ciarcia 2001b). Dans un tel processus, les
populations sont parfois amenées à « cohabiter avec [leur] propre fiction » (Ciarcia
2003 : 195), dans une économie générale de l’exotisme.
44 L’émergence d’un patrimoine africain inventorié, collectionné, étudié, éventuellement
sauvegardé et mis en musées, est l’un des aspects culturels que les guides de l’époque
coloniale promeuvent dès qu’ils en ont la possibilité. Ils conseillent par exemple
d’inclure la visite des quelques musées existant dans les capitales où collections
ethnographiques, historiques et artistiques, constituent des vitrines valorisantes des
colonisés comme des colonisateurs (Adedze 1997). Ainsi, « lorsqu’on passe à Dakar, une
visite à Gorée s’impose. [...] À Gorée a été inauguré le 4 juin dernier (1955) un Musée
Historique de I’AOF. Les salles sont installées pour évoquer [sa] longue histoire, souvent
obscure [...] »42. Le musée a été installé « après une patiente restauration de l’ancienne
demeure “bourgeoise” de Gorée qui l’abrite »43 — indice supplémentaire du souci de
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
33
préservation du patrimoine bâti. Les institutions muséales ont en effet un rôle non
négligeable dans les politiques culturelles coloniales, en métropole comme dans les
territoires dominés, proclamant le rôle bénéfique des colonisateurs, seuls gardiens
légitimes des patrimoines autochtones (Oulebsir 2004 ; Dulucq & Zytnicki 2007). Si les
musées sont moins nombreux et bien moins dotés en AOF et en AEF qu’en Indochine ou
qu’au Maghreb, leur développement dans les années 1950 s’inscrit dans une mise en
scène de l’Afrique qui est aussi celle de la France comme puissance tutélaire et
protectrice des cultures locales : les touristes sont incités à venir y admirer à la fois les
objets et ceux qui les conservent.
45 On le voit, dès le début du XXe siècle, les promoteurs du tourisme en Afrique coloniale
française se sont appuyé sur une gamme d’arguments variés pour tenter d’attirer des
visiteurs encore peu nombreux. Si les touristes européens ou américains qui se rendent
en Afrique rêvent d’abord de chasse et de pêche sportive, de grands espaces
dépaysants, la valorisation d’éléments d’ordre culturel a fait partie dès l’origine de la
mise en tourisme.
46 Or, reconnaître plutôt que découvrir, prendre la mise en scène de la culture pour la
culture elle-même, telle a souvent été la seule attente des touristes. Cet état d’esprit
« émousse forcément la curiosité et limite l’intérêt des étrangers pour la réalité »
(Doquet 1999 : 250). On ne s’étonne guère de voir les voyageurs des années 1920-1950
venir chercher en Afrique coloniale la confirmation de ce qu’ils croient déjà savoir sur
la culture et sur l’« âme africaine » : ésotérisme des croyances animistes, hiératisme des
danses ancestrales, pittoresque des marchés, beauté des productions artisanales
« traditionnelles ».
47 Ces attentes encouragent la naissance de pratiques touristiques relativement bien
circonscrites qui visent à exhiber les signes tangibles de la « tradition » et de
l’« authenticité » des cultures africaines. Cérémonies rituelles calibrées et art nègre
convenu sont donc au rendez-vous, dans un processus de folklorisation et de
standardisation où les autorités coloniales comme les acteurs africains sont partie
prenante, mais échappent sans doute en partie aux visiteurs. L’expérience coloniale
n’est certes pas l’unique matrice de la mise en tourisme stéréotypée des cultures
africaines contemporaines, mais certains mécanismes y sont déjà repérables. Ils
renvoient tout autant à la nature de l’activité touristique en général (mise en scène des
identités, invention de sites, création d’objets et d’images « souvenirs », etc.) qu’à des
processus plus insidieux, liés à la domination impériale elle-même et au sentiment de
supériorité qui en découlait. Découvrir l’« âme africaine », c’est aussi aller constater de
visu le fossé séparant l’Européen de l’Africain, le colonisateur du colonisé, dans la mise
en spectacle de ce dernier.
48 Le primo-tourisme culturel de l’époque coloniale a indubitablement concouru, comme
l’ont montré Anne Doquet et Gaetano Ciarcia pour une période plus récente, à
enclencher des phénomènes d’« ethnologisation » d’un groupe particulièrement visité.
Les savoirs coloniaux ont en effet participé au devenir touristique de certains lieux, —
de Tombouctou à Sangha —, de certains groupes — des Touaregs aux Dogons. Dans le
cas de ces derniers, on peut même parler de « cadeaux mythologiques » fort bienvenus
légués par les colonisateurs. L’État malien aurait ainsi hérité d’« une matrice
scientifico-coloniale instrumentalisée pour valoriser la culture locale » (Ciarcia 2003 :
139), au gré d’un développement rapide du tourisme à partir des années 1970-1980.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
34
49 Tout cela n’a pas été sans conséquences sur les cultures des populations ainsi « mises
en tourisme ». On peut inférer du cas dogon l’existence de réappropriations, au moins
partielles, par certains acteurs « indigènes », de la vision projetée sur eux, dans la
mesure où il allait de l’intérêt économique de ces populations de séduire les touristes.
Cette évolution sous l’œil fasciné des étrangers a ainsi pu contribuer à encourager des
mutations culturelles importantes : fixation de styles à succès (artistiques,
cérémoniels), repli éventuel sur un éventail restreint de manifestations
« spectaculaires », patrimo- nialisation de la « tradition », etc.
50 Pour autant, l’historien a, bien moins que l’ethnologue — qui bénéficie d’un accès direct
à ses informateurs —, la possibilité de valider ces intuitions. Les sources coloniales ne
lui donnent guère accès à cette dimension passionnante du phénomène touristique
vécu par les populations concernées, le cantonnant dans une position d’extériorité
comparable peut-être à celle d’un touriste en pays étranger...
BIBLIOGRAPHIE
ADEDZE, A.
1997 Collectors, Collections and Exhibitions. The History of Museums in Francophone West Africa, Los
Angeles, University of California, Thèse non publiée.
BERTHO-LAVENIR, C.
1999 La roue et le stylo. Comment nous sommes devenus touristes, Paris, Odile Jacob.
BLOCH, J.-R.
1929 Cacahouettes (sic) et bananes. À la découverte du monde connu, Paris, NRF (« Les documents
bleus »).
BOBIN, F.
2003 « Sœurs blanches et femmes voltaïques : regards croisés sur l’ouvroir de Ouagadougou
(1917-1954) », in H. d’ALMEIDA-TOPOR, M. LAKROUM & G. SIITTLER (dir.), Le travail en Afrique noire.
Représentations et pratiques à l’époque contemporaine, Paris, Karthala : 261-282.
BOYER, M.
1996 L’invention du tourisme, Paris, Gallimard.
BRUNEAU DE LABORIE, É.-L.
1929 Les chasses en Afrique française. Carnets de route, Paris, Société d’éditions géographiques,
maritimes et coloniales.
1931 Guide de la chasse, et du tourisme en Afrique centrale et spécialement au Cameroun, Paris, Éditions
géographiques, maritimes et coloniales.
BYRNE, A.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
35
2001 La quête d’une femme ethnologue au cœur de l’Afrique coloniale. Denise Paulme 1909-1998, Maîtrise,
Université de Provence-Centre d’Aix. <http://sites.univ-provence.fr/~wclio-af/numero/6/
Sommaire.html>.
CAHIERS JUSSIEU
1976 Le mal de voir. Ethnologie et orientalisme, politique et épistémologie, critique et autocritique, numéro
spécial, Cahiers Jussieu, 2, Paris, Université Paris-Diderot-Paris 7.
CIARCIA, G.
1998 « Ethnologues et dogon. La fabrication d’un patrimoine ethnographique », Gradhiva, 24 :
108-115.
2001a « Dogons et dogon. Retours au “pays réel” », L’Homme, 157 : 217-230.
2001b « Exotiquement vôtres. Les inventaires de la tradition en pays dogon », Terrain. Revue
d’ethnologie de l’Europe, 37 : 105-122.
2003 De la mémoire ethnographique. L’exotisme en pays dogon, Paris, Éditions de l’EHESS (« Cahiers de
l’Homme »).
DELAFOSSE, M.
1912 Haut-Sénégal-Niger, Paris, E. Larose.
DOQUET, A.
1999 Les masques dogon. Ethnologie savante et ethnologie autochtone, Paris, Karthala.
2002 « Se montrer dogon. Les mises en scène de l’identité ethnique », Ethnologies comparées. Revue
électronique du CERCE, 5 : non paginé.
DULUCQ, S.
2009 « Tourisme et fait colonial. La naissance du tourisme dans les territoires de l’Afrique
française (années 1920-1950) », in C. ZYTNICKI & H. KAZDHAGLI (dir.), Le tourisme dans les colonies
françaises (XIXe-XXe siècles), Actes du colloque Tourisme et fait colonial au Maghreb, Toulouse, 7-9
décembre 2006, Paris, Publications de la SFHOM : 39-54.
DULUCQ, S. & ZYTNICKI, C. (dir.)
2007 « La colonisation culturelle outre-mer », dossier spécial, Outre-Mers. Revue d’Histoire,
356-357 : 9-172.
DE FOUCAUCOURT, J.
1928 De l’Algérie au Soudan par le Sahara. 5 000 km en automobile dans le désert et la brousse. Guide
transsaharien : les deux rives du Tanezrout N’Ahenet, Paris, F. Lanore.
1938 Vingt mille lieues dans les airs. Tour d’Europe, tour d’Afrique, dans un petit avion de tourisme, Paris,
Payot.
FURLOUGH, E.
2002 « Une leçon de choses. Tourism, Empire and the Nation in Interwar France », French
Historical Studies, 25 (3) : 441-473.
GIDE, A.
1927 Voyage au Congo, Paris, Gallimard (« Carnets de route »).
HAUMONTÉ, J.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
36
2005 Des ailes pour l’Afrique. Le développement de l’aéronautique en Afrique française coloniale
(1945-1960), Maîtrise, Toulouse, Université de Toulouse-II.
HOULET, G.
1958 Afrique occidentale française, Togo, Paris, Hachette (« Les Guides Bleus illustrés »).
HOUSEFIELD, J.
2004 « Cultural Governance. Artisans and Museums in French Colonial Morocco », Colloque de la
Western Society for French History (atelier: Interrogating French Colonial Governance: Algeria,
Vietnam, Morocco), communication orale.
LEPRINCE, J.
1910 « Le tourisme colonial. À travers le Labé (Fouta-Djalon) », Revue Coloniale : 385-390.
LLANES, C.
2006 Le tourisme au Maroc de 1912 à 1956. Développement et spécificités en période coloniale, Master 2
d’histoire, Toulouse, Université de Toulouse- Le Mirail.
MARCIN, Y.
2006 La naissance du tourisme dans l’Afrique coloniale française, Master, Toulouse, Université de
Toulouse-Le Mirail.
MCGREGOR, J. A.
2003 « The Victoria Falls 1900-1940. Landscape, Tourism and the Geographical Imagination »,
Journal of Southern African Studies, 29 (3): 717-737.
MORAND, P.
1928 AOF. De Paris à Tombouctou, Paris, Flammarion.
MURRAY, A.
2000 « Le tourisme Citroën au Sahara (1924-1925) », Vingtième Siècle. Revue d’Histoire, 68 : 95-107.
NORDMAN, D. & RAISON, J.-P. (dir.)
1980 Sciences de l’homme et conquête coloniale. Construction et usages des sciences humaines en Afrique
(XIXe-XXe s.), Paris, Presses de l’ENS.
OULEBSIR, N.
2004 Les usages politiques du patrimoine. Monuments, musées et histoire en Algérie (1830-1930), Paris,
Éditions de la Maison des sciences de l’Homme.
RONDET-SAINT, M.
1933 Sur les routes du Cameroun et de l’AEF, Paris, Société d’éditions géographiques, maritimes &
coloniales.
SAUVAGE, M.
1937 Sous le feu de l’équateur. Les Secrets de l’Afrique noire, Paris, Denoël.
SIBEUD, E.
2002 Une science impériale pour l’Afrique ? La construction des savoirs africanistes en France (1878-1930),
Paris, Éditions de l’EHESS.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
37
SURUN, I.
2002 « La découverte de Tombouctou : déconstruction et reconstruction d’un mythe
géographique », L’Espace géographique, 2 : 131-144.
ZYTNICKI, C.
2006 « L’invention des sites touristiques dans la Tunisie pré-coloniale et coloniale », in C.
ZYTNICKI, D. BOUMEGGOUTI, ET. AL. (dir.), Pour une histoire du tourisme au Maghreb (XIXe-XXe siècles) :
87-98.
ZYTNICKI, C. & KAZDAGHLI, H. (dir.)
2009 Le tourisme dans les colonies françaises (XIXe-XXe siècles), Actes du colloque Tourisme et fait
colonial au Maghreb, Toulouse, 7-9 décembre 2006, Paris, Publications de la SFHOM : 39-54.
ZYTNICKI, C., BOUMEGGOUTI, D. ET AL. (dir.)
2006 « Pour une histoire du tourisme au Maghreb (XIXe-XXe siècles) », Tourisme, 15.
NOTES
1. Revue des voyages, no 3 (dossier spécial AOF), 1958, p. 14.
2. Gouvernement général de l’AOF, Guide du tourisme en Afrique occidentale française, Paris, Émile
Larose, 1926. Ce guide fut régulièrement réédité et augmenté. Le premier Guide Bleu date de la fin
des années 1950 et s’inspire partiellement de ces guides antérieurs publiés par les autorités
aofiennes.
3. Il ne s’agit pas de considérer, de façon simpliste, que les pratiques touristiques actuelles sont
directement héritées des expériences de l’époque coloniale. Ce serait tomber dans le cliché
réducteur assimilant tourisme et (néo-)colonialisme. Pour autant, il paraît légitime et éclairant
de réinscrire les usages du tourisme contemporain en Afrique dans la longue durée.
4. Il convient d’avoir pleinement conscience des biais qu’induit l’utilisation, dans une recherche
historique, d’enquêtes ethnologiques récentes. Le risque principal est évidemment de plaquer les
analyses contemporaines sur le passé, sans possibilité d’étayer et de documenter solidement le
propos. Alors que l’ethnologue peut solliciter directement les acteurs du tourisme en pays dogon
et construire son objet scientifique en interaction avec eux, l’historien se trouve démuni : les
sources coloniales des années 1930-1950 n’envisagent pratiquement pas le rôle des Dogons dans
la mise en tourisme de leur patrimoine, pas plus que leur éventuelle perception de l’activité
touristique. Pour autant, les avantages heuristiques d’un tel rapprochement sont tangibles : il
permet de poser l’importante question historiograhique de l’agency des populations africaines en
situation coloniale (leur marge de manœuvre et leur « quant à soi ») et de décentrer le regard des
colonisateurs vers les colonisés. La référence aux recherches ethnologiques actuelles rend
possible l’hypothèse de formes de continuité historique depuis l'époque coloniale. Le rôle
complexe joué par les populations locales lors de la mise en tourisme de leur espace et de leur
patrimoine peut, dès lors, être repensé dans la longue durée, sans qu'il faille perdre de vue l'idée
qu'il s'agit d'une piste d'interprétation non corroborée par la documentation directe.
5. Renseignements de toutes les façons difficiles à obtenir, dans la mesure où les voyageurs
semblent assez souvent combiner le voyage d’affaires et le voyage d’agrément. Sans doute cette
question importante de la quantification trouvera-t- elle des éléments de réponse dans une
collecte systématique de la documentation adaptée : rapports de services divers (Police et Sûreté,
Douanes...), registres des ports et des aéroports, rapports politiques et économiques...
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
38
6. Jules Carde, gouverneur de 1923 à 1930, est le promoteur de la politique de « mise en valeur »
des colonies et le propagateur du mot d’ordre selon lequel il fallait « faire du Noir ».
7. Jules LEPRINCE (1910) a été tour à tour administrateur du Moyen-Congo, commandant du cercle
de Labé (Guinée) et maire de Conakry en 1918.
8. Issu de l’aristocratie parisienne, militaire, pilote, cet apologue du duel (Les lois du duel, Paris,
Éditions de la revue Les Armes, 1912) est aussi l’auteur de multiples récits de ses exploits
cynégétiques en Afrique (où il meurt d’ailleurs d’un accident de chasse en 1930).
9. Transmuée ultérieurement en Agence économique de la France d’outre-mer.
10. Voir par exemple, dans les années 1950, le rôle d’un zélateur infatigable du tourisme
subsaharien, Charles Duvelle, directeur général de l’ANTOM (Association nationale pour le
Développement du Tourisme dans les Territoires d’OutreMer) ou l’implication personnelle du
gouverneur de l’AEF.
11. Services d’information de l’AEF, Afrique équatoriale française, op. cit. (Académie des Sciences
d’Outre-mer, Af carton 15, no 167).
12. Chroniques d’Outre-mer, no 29, octobre 1956, p. 35.
13. Gouvernement général de l’AOF, Bréviaire du tourisme en Afrique occidentale française, Paris,
Larose, 1924, p. 5.
14. Services d’information de l’AEF, Afrique équatoriale française, op. cit., p. 39-40.
15. Exposition coloniale internationale de Paris, Commissariat de l’AOF, Le tourisme en Afrique
occidentale française, 1931, p. 17.
16. Gouvernement général de l’AOF, Bréviaire du tourisme en Afrique occidentale française, op. cit.,
p. 6.
17. Bibliothèque du Musée de l’Homme, MS 134 : prospectus de propagande touristique, Lettres
de G.-H. Rivière aux Gouverneurs des colonies, cité par Alice BYRNE (2001).
18. Encyclopédie mensuelle d’Outre-Mer, numéro spécial : Le tourisme en Afrique française, 1955,
pp. 140-141.
19. Exposition coloniale internationale de Paris, op. cit., p. 19.
20. Pour lui, le Noir est « comme l’accomplissement de l’obscur idéal physique ».
21. Exposition coloniale internationale de Paris, Commissariat de l’AOF, op. cit., p. 19.
22. « Partout le voyageur aura sous les yeux une vie indigène extrêmement pittoresque, une vie
rappelant par sa rusticité, mais aussi par son mouvement ordonné, et, disons-le, par sa grandeur,
les plus beaux tableaux de l’Antiquité », in Gouvernement général de l’AOF, Guide du tourisme en
Afrique occidentale française, Paris, Agence économique des Colonies, Larose, 3e édition, 1935, p. 7.
23. Service de l’Information du Haut-commissariat de la République française à Brazzaville,
L’Afrique équatoriale française, Casablanca, Édition Fontana, 1958,
p. 88.
24. Chroniques d’Outre-mer, no 18, août-septembre 1955, pp. 61-62.
25. Encyclopédie mensuelle d’outre-mer, op. cit., p. 138.
26. Exposition coloniale internationale de Paris, op. cit., p. 20.
27. Voir également dans ce numéro, l’article de Marco AIME, « Les déçus de Tombouctou ».
28. Félix Dubois, à la fin des années 1890, contribue à retourner la réalité (le déclin effectif de la
ville) en un nouvel attrait : Tombouctou « la mystérieuse » cache sa splendeur sous des dehors
misérables et ne livre son secret qu’aux voyageurs initiés (cité dans Isabelle SURUN 2002).
29. Encyclopédie mensuelle d’outre-mer, op. cit., p. 136 (numéro spécial dirigé par Charles Duvelle,
directeur général de l’ANTOM).
30. Encyclopédie mensuelle d’outre-mer, op. cit., p. 141.
31. Exposition coloniale internationale de Paris, op. cit., p. 19.
32. Encyclopédie mensuelle d’outre-mer, op. cit., p. 152.
33. Encyclopédie mensuelle d’outre-mer, op. cit., p. 206.
34. Pas de chaussures de sport, pas de lunettes de soleil, pas de montres, etc.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
39
35. Exposition coloniale internationale de Paris, op. cit., pp. 16 sq.
36. Exposition coloniale internationale de Paris, op. cit., pp. 16 sq.
37. Encyclopédie mensuelle d’outre-mer, op. cit.
38. Exposition coloniale internationale de Paris, op. cit.
39. Exposition coloniale internationale de Paris, op. cit.
40. Encyclopédie mensuelle d’outre-mer, op. cit., p. 210.
41. Lyautey fut non seulement un promoteur zélé des arts et traditions populaires (HOUSEFIELD
2004), mais aussi un ardent partisan du développement touristique dans le protectorat (LLANES
2006 : 149 sq).
42. Encyclopédie mensuelle d’outre-mer, op. cit., p. 137.
43. IFAN, Guide du musée historique de Gorée, Dakar, IFAN, 1955, p. 7.
RÉSUMÉS
Des années 1920 aux années 1950, des formes précoces de tourisme ont émergé en Afrique
tropicale sous domination française. Ce tourisme s'est essentiellement structuré autour
d'activités de nature (safari, pêche), mais il s'est également concentré sur la découverte des
cultures locales, contribuant dès l'Entre-deux-guerres à leur « mise en forme » et à leur « mise en
scène ». Administrateurs coloniaux, opérateurs privés et voyageurs eux-mêmes ont ainsi amorcé
un processus d'« invention » du patrimoine touristique africain, autour de sites repérés
(Tombouctou, falaise dogon, etc.) et d'activités codifiées (achats d'objets artisanaux sur les
marchés, assistance à des « tam-tam » et des danses cérémonielles, etc.). Si peu développé qu'ait
alors été ce tourisme, il a néanmoins eu des effets de retour sur les sociétés et les cultures locales
et a construit des représentations pérennes de ce qui était « touristiquement pertinent » en
Afrique.
Early forms of tourism developed in French tropical Africa from the 1920s to the 1950s. Tourism
was essentially focussed on nature- related activities (safari, fishing) but touristic interest was
also aroused by the discovery of local cultures, thus shaping or reshaping them. Colonial officers,
private investors and travellers themselves initiated the "invention" of an African patrimony,
shedding light on special spots of interest (Timbuktu, Dogon cliffs, etc.) and on codified activities
(shopping for artefacts in market places, watching "tam-tam" and other ceremonial dances, etc.).
Even if tourists were rare back then, feedback effects on local societies and cultures were induced
by tourist activities, which also promoted perennial representations of what is "touristically
consistent" in Africa.
INDEX
Keywords : French colonial Africa, invention of an heritage, representations, tourism
Mots-clés : Afrique coloniale française, invention des sites, patrimonialisation, représentations,
tourisme
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
40
AUTEUR
SOPHIE DULUCQ
Laboratoire FRAMESPA (France méridionale & Espagne), Université de Toulouse- Le Mirail,
Toulouse.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
41
Imaged or Imagined? CulturalRepresentations and the“Tourismification” of Peoples andPlacesImagé ou imaginé ? Les représentations culturelles et la « tourismification » des
peuples et des lieux
Noel B. Salazar
AUTHOR'S NOTE
This article is based on research supported by the National Science Foundation under
Grant No. BCS-0514129, and additional funding from the School of Arts and Sciences,
University of Pennsylvania (USA). The ethnographic fieldwork in Tanzania was
conducted under the auspices of the Tanzanian Commission for Science and
Technology (Research Permit No. 2007-16-NA-2006-171) and kindly sponsored by the
University of Dar es Salaam. An earlier version was presented at the 10th Zanzibar
International Film Festival Conference in 2007. I am most grateful to Joseph Ole
Sanguyan and Monica C. Espinoza for their thoughtful comments and support.
1 Peoples and places around the globe are continuously (re)invented, (reproduced, and
(re)created as tourism marketers create powerful representations of them. This
happens in a competitive bid by potential destinations to obtain a piece of the lucrative
tourism pie, in a world marked by rapidly changing travel trends and mobile markets.
If anything, tourism is part of what David Harvey (1989: 290-293) calls the “image
production industry”, in which the representation of peoples and places has become as
open to production and ephemeral use as any other. Because image-making has
emerged as a crucial marketing tool, it variously influences peoples’ attitudes and
behaviours, confirming and reinforcing them as well as changing them. Images travel,
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
42
together with tourists, from predominantly tourismgenerating regions to tourism
destinations and back, leading to a “tourismification” of everyday life—“a socio-
economic and socio-cultural process by which society and its environment have been
turned into spectacles, attractions, playgrounds, and consumption sites” (Wang 2000:
197). Paradoxically, tourismification proceeds not from the outside but from within a
society, by changing the way its members see themselves (Picard 1996)1.
2 As Adrian Franklin and Mike Crang (2001: 10) point out, tourism “is not simply a
function of changing local cultures caught in the stream of globalizing flows or the
touristification of localities [...]. Touristic culture is more than physical travel, it is the
preparation of people to see other places as objects of tourism, and the preparation of
those places to be seen”. Rather than asking whether a given culture has become
polluted or enhanced by tourism (and other global processes), a more salient question
to ask is how tourism and its imaginaries are contributing to the (re)shaping of culture
and society (Salazar 2005).
3 Tourismification is a universal phenomenon and an integral element of globalization.
Global tourismification rapidly interlinks and intensifies the circulation of people,
capital, images, and commodities. However, this is often a highly ambivalent
development, not the least in zones of poverty. Tourismification can result in loss of
cultural pride and complete reliance on tourism for subsistence. In many cases, tourism
development has been largely responsible for forcing irreversible changes, either
directly, by destroying or prohibiting traditional means of livelihood, or more subtly,
by providing a potentially easy way to earn badly needed resources (Mowforth & Munt
2003). People in the margins often have little (economic) choice but to accept and to
adapt to the tourismified identities and cultural views that are created for them. While
cultural alienation is one possible outcome, tourism and tradition do not necessarily
stand in polar opposition to each other (as the latter attracts the former), and tourism
can lead to a resurgence and affirmation of local (ethnic) identities and competing
discourses of heritage—be these real or imagined, authentic or invented (van der Duim
et al. 2005). In other words, peoples and places are not simply re-presented, displayed,
or enacted; the tourismification process involves performative relations of
contestation, reification, and negotiation (Coleman & Crang 2002; Hall & Tucker 2004).
4 Tourismified communities borrow from traditional anthropology an ontological and
essentialist vision of cultures, conceived as static entities with clearly defined
characteristics, to represent themselves to visitors. Ideas of old-style ethnology—
objectifying, reifying, homogenizing, and naturalizing peoples—are widely used by all
kinds of groups, staking their claims of identity and cultural belonging on strong
notions of place and locality. Ironically, this is happening at a time when scholars
prefer more constructivist approaches to culture, taking it for granted that cultures
and societies are not passive, bounded, and homogeneous entities (Gupta & Ferguson
1997). Of course, academic writings are only one among many sources of inspiration
that shape tourism imaginaries of peoples and places2. The influence of popular culture
media forms—the visual and textual content of documentaries and movies; art and
museum exhibitions; trade cards, video games, and animation; photographs, slides,
video, and postcards; travelogues, blogs, and other websites; guidebooks and tourism
brochures; coffee-table books and magazines; literature; advertising; and quasi-
scientific media like National Geographic—is much bigger (Morgan & Pritchard 1998).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
43
Throughout this article, the term “cultural representations” will be used to refer to
such content.
5 In the case of sub-Saharan Africa, western imagery of the region has often been
presented in the most literal sense of the word, in visual forms. These visual
representations, which flourished especially during the colonial era, lay at the basis of
stereotypical “us” versus “them” categorizations (Salazar 2007a). During colonial rule,
for example, the British in East Africa highlighted Maasai life because, as colonizers,
they wanted to promote an image of Africans as different and nobly primitive. Some
authors have interpreted contemporary tourism as a continuation and silent
perpetuation of these old processes of stereotyping and “measuring” African cultures
in a hierarchical relation to western civilization (Mowforth & Munt 2003). According to
Harry Wels (2002: 64), “we have replaced the stage for the African Other from Europe’s
World Exhibitions, journals, scientific ethnographies, National Geographic, television-
documentaries and so on, to Africa itself”. Tourism imaginaries often depict Africa in
the same way as the continent was portrayed during the colonial period. Consequently,
tourists long for
“pristine African landscapes with the picturesque thatched roofs dotted andblending into it and expect to hear the drums the minute they arrive in Africa, withAfricans rhythmically dancing to its ongoing cadenza. That is Africa. That is theOtherness [...] for which they are prepared to pay money. This is the imagery towhich the tour-operators have to relate in their brochures in order to persuadeclients/tourists to book a holiday with them” (ibid.: 64).
6 In this paper, I use the example of the visual cultural representations surrounding the
Maasai of East Africa to analyze how the (re)construction of Maasai society in Tanzania
and its socio-cultural tourismification are framed within well-established notions of
western dominance and superiority (for similar analyses in the Kenyan context Akama
2002; Berger 1996; Norton 1996; Wels 2002)3. I show how the romanticized imagery of
the virile Maasai warrior—reinforced by different types of popular visual media such as
nature documentaries, mainstream Hollywood entertainment, and semi-biographic
films—has led to a true Maasai-mania that is profoundly affecting the daily life and
culture of Maasai as well as other ethnic groups in the country. The ethnographic data
for this study were collected during two periods in which I conducted fieldwork in
Tanzania: three months in 2004 and eight months in 2007. They consist of participant
observation notes of cultural tourism activities in southern Maasailand, transcripts of
indepth interviews with locals (Maasai and others) and short semi-structured
interviews with international tourists, and collected secondary sources related to
tourism and visual cultural representations of the Maasai (Salazar 2008). The
interviews with locals were conducted either by me or by my Maasai research assistant.
I did background literature research at the University of Dar es Salaam, the Economic
and Social Research Foundation, Research on Poverty Alleviation, and the Professional
Tour Guide School in Tanzania; the University of Pennsylvania in the USA; and the
University of Leuven in Belgium.
Maasai imaginarles
“The word was passed round that the Masai had come [...]. Passing through theforest, we soon set our eyes upon the dreaded warriors that had been so long thesubject of my waking dreams, and I could not but involuntarily exclaim, ‘What
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
44
splendid fellows!’ as I surveyed a band of the most peculiar race of men to be foundin all Africa” (Thomson 1885).
7 The Maasai, speakers of the Eastern Nilotic Maa tonal language, are a widely dispersed
ethnic group of semi-nomadic pastoralists and small-scale subsistence agriculturists
who occupy arid and semi-arid rangelands in southern Kenya and northern Tanzania—
collectively known as Maasailand. In Tanzania, they are said to have lived in the whole
of the Serengeti plains and Ngorongoro highlands for some two centuries. Through
their powerful (and stereotyped) media image, the Maasai have become “icons” of
African traditionalism and unwitting symbols of resistance to modernist values (Galaty
2002).
8 For decades, the Maasai have been a source of fascination among tourists and cultural
advocates who have been struck by their adamant refusal to abandon their culture.
Overseas professional photographers have immortalized them in pictures carried in
publications and on postcards. Multiple tales about their audacity are told and
environmentalists laud their ability to sustain balance with nature, which allows them
to co-exist with their cattle and wild game. However, this “pictorial fame” (Galaty 2002:
347) bears considerable political costs. The tacitly pejorative images that proliferate in
film, tourism brochures, and advertising convey unspoken cultural presuppositions
that shape public (mis)understandings of Maasai communities. These images speak
confidently about who the Maasai are, what they represent, and what their fates will
be.
9 Ideas of Maasai traditionalism and conservatism are closely bound together with
images of the Maasai male, alternately as a fierce warrior or obstinate pastoralist (Coast
2001). For early European explorers who encountered this nomad warrior “race”,
Maasai ilmurran (warriors) represented the epitome of a wild and free lifestyle 4. By
publishing embellished accounts of their encounters with Maasai, these explorers
reinforced the mythic images of Maasai as noble savages and icons of wildest Africa,
and enhanced their own reputation for bravery and boldness (Hodgson 2001). Joan
Knowles and David Collett (1989) sketch how the warrior archetype, one of several
possibilities found in early explorers’ texts, was elaborated in ways that justified
colonial policies, and later became the basis for postcolonial development initiatives5.
In part due to these historical (mis)representations, Maasai are now considered an
integral part of the African wilderness, an image that corresponds with a stereotyped
western idea of the primitive, sexual, violent African, or the romanticized image of the
noble savage (Hughes 2006). Edward Bruner (2002: 387) nicely summarizes the
representational narrowing of Maasai culture as follows: “The basic story about the
Maasai [...] is a gendered Western fantasy of the male warrior- proud, courageous,
brave, aristocratic, and independent, the natural man, and the freedom-loving
pastoralist. Associated with this warrior narrative are artifacts and adornments—shield
and spear, beads, earrings, red ochre, sandals.”
Silver Screen "Maasai"
“He, who has travelled far, sees far”, Maasai proverb.
10 According to Neal Sobania (2002), the Maasai were amongst the earliest African peoples
specified and named in mass-produced European images.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
45
11 As far as the commercial film industry is concerned, the Maasai have been over-
exposed probably to a greater extent than any other ethnic group in Africa. This
fascination with a “tribe”, whose traditional pastoral lifestyle and tall dignified bearing
have come to symbolize “Africa” to many in the West, has increased dramatically over
the past decades. The intensifying commercialization of the Maasai and their culture in
movies, for instance, is a consequence of the high profile they have developed over the
years, through their reputation for courage and unspoilt culture and the promotion of
this image by international photographers, producers of documentary and
ethnographic films, writers, and the tourism industry.
12 Among the first Maasai to acquire international celebrity status was Tanzania’s Tepilit
Ole Saitoti, who appeared in a National Geographic documentary, titled Man of the
Serengeti (1972), about his work as a game warden in the Serengeti National Park during
the early 1970s. Due to the success of the documentary, Saitoti was awarded
scholarships that enabled him to study in the USA as well as in Germany, writing a thesis
on the cohabitation of people and animals. His ethnographic books (Saitoti 1987, 1988)
are considered accurate and sensitive in portraying Maasai traditions and culture. After
completing his studies, Saitoti returned to Tanzania, where the National Geographic
traced him again to document the changes in his life, from a game warden to an
accomplished scholar, in Serengeti Diary (1989). To some, Saitoti’s efforts at representing
Maasai are highly commendable, while others see it as heralding a new genre of Maasai
disparagingly labelled the “professional Maasai”—denoting those who have amassed
wealth for simply trading in the group’s culture. Interesting is the fact that Saitoti has
become a tourism icon in his own right, with regular cultural tours being organized to
his Olbalbal house in the Ngorongoro District. Ethnographic filmmakers have played an
important role in disseminating nostalgic Maasai imagery too. Take the example of
Melissa Llewelyn-Davis, who made five movies about the Maasai (and never completed
her PhD in anthropology because she decided to stay in East Africa). Her first films
(directed by Chris Curling), Masai Women (1974) and Masai Manhood (1975), were
traditional authoritative documentaries. Both visual ethnographies were part of
Granada Television’s Disappearing World Series. They are successful as colourful and
dramatic pictures of an exotic society that has long appealed to Westerners as just what
romantic savages should be like. As anthropological accounts, they are rather
disappointing, although at the time they were among the best accounts available
describing Maasai life.
13 Given the representational history of the Maasai briefly sketched above, it is not
surprising that a number of feature films fit the Maasai within a postcolonial
glorification and visual representation of colonial life, a recuperation of the era of
those who conquered Africa. One of the clearest examples of this is the classic
autobiographic movie Out of Africa (1985) in which Maasai—as African male “Others”—
are seen as a sexual danger towards white women. While presenting a nostalgic picture
of colonial times, the film also focuses on the relentless decline of Maasai culture and
tradition in the face of inevitable modernization. Likewise, the romantic German
production, Nowhere in Africa (2001), tells the true story of a German Jewish refugee
family moving to and adjusting to farm life in East Africa in the 1930s. When the father
is suffering from malaria, he is being nursed back to health by his Maasai cook and
bodyguard—a prime example of noble savage ethos. The young daughter falls in love
with Africa and black culture, easily absorbing Maasai culture.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
46
14 The casting of Maasai actors has broken new terrain in terms of the culture’s exposure
to the mainstream entertainment audience. Unfortunately, most films play on the line
of exoticism and innocence, without bothering to tell the Maasai’s own story or create
parts that bring out their culture and intrinsic values. Rather than celebrating the
Maasai, the movie industry is treating this people as it once treated Native Americans
(Red Indians)—as a foil of adventure films, a convenient community of nameless,
faceless “barbarians” who can be counted on to foolishly ride into a hail of bullets and
lose every battle to the good guys. Some lobby groups, including Richard Gere’s
Survival International, have emerged to speak against the ridiculing of minority
cultures, dealing with the issue at global level and listing protection of the Maasai
among its priorities. Even without forcing Maasai to play degrading roles, commonly
their parts do not require any acting skills. Typical poses display warriors resting on
one leg while leaning on a huge spear as the African sun sets or rises on the
background, herding cattle, or doing their trademark cultural jig, jumping high in the
air. They are largely faceless, pliable, and with no speaking roles other than occasional
chanting, mainly appearing as symbols to satisfy the filmmakers’ ideal of exotic Africa.
Newly emerging Tanzanian film directors understand the monetary value of Maasai
warrior representations as well. Half the space of the promotional poster for the movie
Bongoland (2003), for example, was taken in by a group of Maasai standing in front of a
typical hut topped by a grass-thatched roof. During the Philadelphia premiere of the
movie, filmmaker Josiah Kibira confessed that this was “purely done for marketing
purposes”, because the entire storyline of the film is situated in the USA.
15 In the 1990s, Hollywood caught the Maasai bug and some major movies carried
representations of the ethnic group, purely for visual effect. The Ghost and the Darkness
(1996), which was shot in South Africa and based on a story about the man-eaters of
Tsavo (Kenya), had a Maasai scene despite the fact that this does not appear in the
original colonial story written by Colonel John Patterson. The band of brave warriors
accompanies a maverick white hunter, brought in to dispatch the man-eating lions that
no one else has been able to kill. This film heightened the already selective nature of
popular images of Maasai pastoralists, presenting only male characters and offering
lurid caricatures of their warrior nature. Sydney Kasfir (2002) was able to research how
the Samburu actors experienced the filming as well as how they portrayed the Maasai6.
The actors were kept at a distance, unaware of the film’s storyline and not always
involved either in setting the terms of their employment. By the end of the shooting,
however, they had become increasingly sophisticated about the sale and display of
their own image. In the 1996 box office hit, Independence Day (1996), another group of
Maasai was seen at the end of the movie, crawling out of a bush in Africa to join the rest
of the world in the celebration when the United States saves the world from an
invading alien force. In Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003), some cheaply
paid Maasai extras clad in bright red colours featured as mere exotic background image
for star actress Angelina Jolie. It is telling that the casting agent tapped Benin movie
star Djimon Hounsou to play the main Maasai character.
16 Although, or maybe because, Maasai are almost always represented as fierce warriors
and excellent hunters of wild animals, they are remarkably absent in wildlife movies.
Take the example of John Wayne’s Oscar-winning wildlife adventure film Hatari! (1962),
about a group of men trapping wild animals and selling them to zoos. This movie is
widely believed to have put Tanzania on the Hollywood map of the world and greatly
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
47
assisted in opening up the country’s major tourism attractions. Although the movie was
shot inside Arusha National Park with the help of Maasai to locate places and supplies,
no Maasai figure prominently in the film. One notable exception to the rule is the
spectacular IMAX production Africa: The Serengeti (1994), in which the migration of
wildebeests and zebras is compared to the nomadic existence of “the proud Maasai
people, ever seeking good grazing for their cattle herds”. The documentary focuses on
the exotic warrior diet—a mixture of milk and blood—and puts the Maasai in a time-
frozen past by stressing how, “once the most formidable warriors in East Africa, the
Maasai still defend their cattle and families with spears”. However, not all wildlife
lovers seem to appreciate that Maasai live close to their preferred animals (Árhem
1985). On the Image Database website, one of the largest Internet movie databases, a
reviewer of this documentary left the following comment:
“This is a great documentary with some amazing footage of wild animals. My onlycomplaint is that they showed humans; that ruined it for me. They showed about 5minutes of Africans [Maasai] in the Serengeti and how they live [...]. We see humansevery day and it’s too bad that they included some here7.”
17 The French-made Masai: The Rain Warriors (2004) is the first production to be solely
populated by real-life Maasai and spoken entirely in their native Maa tongue. The cast
had no previous acting experience and everything was shot in the highlands of Kenya,
presented as a timeless place untouched by modernity. The storyline, seemingly based
on a Maasai legend, follows a group of courageous teenagers who are sent out to secure
the mane of the fiercest of all lions, as an offering to the rain gods—a traditional Maasai
rite of passage. While this is a much more realistic cultural representation, it still
capitalizes heavily on the warrior stereotype. However, as Bruner (2001: 894) argues,
“the colonial image of the Maasai has been transformed in a post-modern era so that
the Maasai become the pleasant primitives, the human equivalent of the Lion King, the
benign animal king who behaves in human ways. It is a Disney construction, to make
the world safe for Mickey Mouse”. His assessment is nicely illustrated in The White
Massai (2005), a German autobiographical movie evocating the fantasy of what it is like
to step outside western culture and into Maasai culture (actually Samburu). It is a
hopelessly romantic love story about a young Swiss lady who falls for a Samburu while
on holiday with her boyfriend in Kenya. After overcoming many obstacles, she moves
into a tiny mud hut with him and spends four years in Kenya, until the dream starts to
crumble and she finally flees back to Europe with her baby daughter.
18 In animations, Maasai frequently appear as tourism attractions for Westerners. In the
Wild Thornberrys episode Critical Masai (2000), the explorer family is camping near a
Maasai village. When the natives visit the Thornberry camp, the children of the family
run into their Maasai friend who is trying to prove himself as a warrior. This inspires
the kids to compete to see which one of them is more of a warrior themselves. Simpson
Safari (2001) tells the hilarious story of The Simpsons family safari to Tanzania. Of
course, their holiday includes a visit to a Maasai village as well. The Simpsons are
portrayed sitting by the campfire with the chieftain, drinking a traditional Maasai
beverage from calabashes. The family does a spit-take when their local guide tells them
it is cows’ blood and the villagers find their behaviour uproarious. The Simpsons
children show off some of the “tribal” body adornments the Maasai gave them—neck
rings (of the style most commonly found among the Ndebele people in South Africa and
Zimbabwe) and a clay lip plate (as worn by the Mursi people of the Omo Valley in
south-western Ethiopia). Later, the family goes more or less completely native and
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
48
dances around the fire with the Maasai. Through exaggeration and irony, the makers
succeeded in presenting a highly self-critical analysis of western representations of
wildest Africa. Finally, it is worth mentioning that The Lion King (1994), undoubtedly the
most influential animation made about (East) Africa, does not feature any Maasai, even
if the landscapes unmistakably refer to the wide Serengeti plains and the Ngorongoro
area—the latter still the home of many Maasai in Tanzania.
Tourismified Maasai
“Visual tropes of traditionalism and martial virtue, contemporary images ofpastoralists are seemingly dependent on the tourist gaze. In industrially designedencounters, tourists at once absorb, reflect, and mentally recreate the pictorialpastoralists they view while on safari through some of the world’s most spectacularlandscapes and its most unusual herds of wild animals” (Galaty 2002: 351).
19 Apart from the amazing wildlife, it is an undisputed fact that the Maasai are the flag-
bearer of Tanzanian tourism. The relationship between tourism and Maasai culture in
the country has been largely determined by safari imaginaries. This can be partly
explained by the fact that the most popular “northern circuit” game areas are situated
in regions where Maasai reside. The well-established representational attraction of the
Maasai in (western) tourist-generating countries is another explanation for their
relationship with safari tourism. In fact, until recently Maasai were virtually the only
ethnic group extensively used to represent the Tanzanian people on the one hand (e.g.
the global Tanzania, Authentic Africa campaign of the Tanzania Tourist Board), and to
fulfil the tourists’ expectations to see typical authentic Africans on the other hand8.
Although the country is populated by over 120 different ethnic groups, most foreign
visitors only think of the Maasai as “local people” (Bachmann 1988; Spear & Waller
1993). Unsurprisingly, ilmurran with their distinctive long ochre dyed plaited hair,
colourful blankets, and jewellery, are one of the main features associated with Maasai
by the large numbers of international tourists who visit Maasailand. As participant
observation and short semi-structured interviews during safari tours confirmed,
international tourists want to catch a glimpse of warriors with their lion hunting
equipment (spears, clubs, and knives) and women decorated with beads and a child on
their back in their most traditional habitat9. They not only want to set eyes on the
Maasai—“as seen on television”— but also want to immortalize the experience by
taking their pictures or filming them and buying tangible souvenirs to be reminded of
the “historical” encounter.
20 In conventional tourism circles, the Maasai have traditionally been represented as a
unique and esoteric community that represents the essence of real Africa, namely as a
people who have managed to resist western influence and to retain their “exotic”
culture. As a consequence, overseas tour operators and travel agents often market the
Maasai as one of those extraordinary, mysterious indigenous African communities that
have remained untouched by western influence and the global forces of modernization.
These forms of tourism imaginaries are usually represented as ideal for tourists,
particularly Euro-American tourists, who are keen on exoticism and adventure in the
manner of the early European explorers (although fieldwork showed that Asian visitors
touring Maasailand also liked this). In most instances, foreign tourists, and particularly
those from North America and Europe, want to see Africans and the African landscape
in the same way as they saw it during their formative years of image-moulding, when
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
49
images of the black continent were usually based on information dating back to the
colonial period (Wels 2002: 64). Therefore, many Westerners long for pristine African
landscapes dotted with picturesque huts topped by grass-thatched roofs. They also
expect to hear the sound of drums the minute they arrive in Africa, and to see African
natives rhythmically dancing to the ongoing cadence, representing real and
quintessential Africa (Norton 1996). As the visual cultural representations discussed
above, tourism projects the Maasai as primitive people who “walk tall” amidst the
deadly Africa wildlife.
21 John Akama (2002), who did a historical analysis of the development of the Maasai
image and the representation of their culture in the tourism industry, argues the latter
has taken over colonial images to use Maasai culture as “additional anecdotes” in the
safari experience. Many stories and elements of Maasai culture therefore have been
torn from their sociocultural context to function as entertainment around the safari
campfire. Examples of this are the jumping warriors and their heroic stories about the
killing of lions and their sexual potency, as expressed by the number of wives. This
Maasai image is being used to contribute to the adventurous and authentic atmosphere
of the wildlife safari. These Maasai representations fit perfectly within the fantasy of
authentic indigenous Africa: living in mud huts, herding cattle, seemingly untouched
and unaware of the globalized world. The romance of the safari pairs the viewing of
game with the scenes of nomadic Maasai. Because of their presence near the most
popular game parks and their worldwide image, the Maasai are both being pushed and
pulled into the front region of tourism, resulting in the apparent freezing or standstill
of their culture. Their lasting place in tourists’ imagination is partly due to the common
belief that they still live in harmony with nature. While true to a degree, this idea leads
to the attitude, reinforced by tourism promotions, that the Maasai are part of the
landscape, not so unlike wildebeest and zebras. In reality, the same protected areas that
draw tourists were often created by removing the Maasai people from their lands
(Neumann 1998)10. However, Tanzanian tour guides now jokingly say that foreign
visitors do not come to see the “big five”—a hunting term historically used to denote
the five most dangerous African animals: lion, leopard, rhinoceros, elephant, and
buffalo—but the “big six”: the big five plus the Maasai11.
Maasai (Images) on the Move
“It was also in Zanzibar that we started seeing the famous Maasai people, abeautiful tribe mostly living in Kenya and Tanzania now but I believe originallyfrom Ethiopia (don’t quote me on that). I had read about them some and had heardmany interesting things about them, particularly how eccentric and colourful theirappearance is. There is a small number of Maasai in Zanzibar. They sell jewellery,the traditional beaded jewellery that they themselves wear and we of course allmanaged to have half our bodies adorned with it by the end of our island stay”12.
22 Due to popular cultural representations such as the ones discussed earlier, every
tourist seems to “know” the Maasai—a fact some business-minded Maasai themselves
exploit (Bruner 2001; Bruner & Kirshenblatt-Gimblett 1994). Indeed, many Maasai now
portray “traditional” versions of themselves for tourists, maintaining a well-developed
sense of selfobjectification and self-commoditisation. Those not wanting to take part in
the tourism game, often motivated by a strong wish to protect traditional Maasai
culture, are forced to retreat to remote locations. However, Maasai culture, like any
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
50
other culture, is dynamic and evolves to adapt to new circumstances. Group members
are now intermarrying, adopting the languages and livelihoods of neighbouring
communities, and participating in various national and international development
activities. Martha Honey (1999: 220) nicely illustrates these changes:
“It was a classic African scene: A Maasai elder, caught in a time warp, entering hiskraal, as his ancestors had done for hundreds of years. But there was a twist to thisphoto-perfect panorama. The Maasai was Moringe Parkipuny, former Member ofParliament, former college professor, and social activist, and his compound was anewly built Maasai secondary boarding school.”
23 The forces of modernization and globalization have visibly penetrated into traditional
gear as well. The customary animal skins have been replaced by polyester tartan
blankets produced in Pakistan. The beads used in ornaments that undergo frequent
revisions to keep up with the latest fashions come from the Czech Republic. The
traditional knives are cheaply imported from China, the blades sharpened and made
smaller so that they fit locally made protective sheaths. The ilmurran are increasingly
seen using cell phones, smoking cigarettes with filters, wearing socks and shoes or
putting on watches (which are often taken off the moment foreign visitors shows up).
Finally, many Maasai children are now attending primary and secondary school and
there is a rapidly growing group of well-educated urban(ized) Maasai, although there is
still a very clear gender bias (Coast 2002).
24 Tourism generally has been a nuisance because photographic safaris have
commoditized much of Maasai culture (van der Cammen 1997). Of course, the degree of
influence of tourism on Maasai settlements varies according to their location relative
to main access roads. However, virtually no communities are left completely untouched
by visiting foreigners. Whereas tourism alone should not be held responsible for all
changes Maasai communities are currently undergoing, the tourismification process
has quickly turned their traditions into a cultural tourism commodity, part of an all-
inclusive package13. One of the major predicaments is that so many of the traditional
activities of the Maasai are now against the law; and precisely those illegal activities are
most appealing to tourists14. The conversion of culture into an object of tourism means
that traditional values are transformed into commercial ones, in a bid to meet
(projected) tourist expectations and desires. This transformation comes with several
semantic changes, both positive and negative to vernacular traditions. Many Maasai
themselves, like other indigenous groups, seem to be selling their own marginality.
Were they not marginal to and different from the tourists, they would not have
attracted the latter’s attention. In order to sustain such commodity and to continue
attracting customers, they have to maintain their difference. They may try to put on a
show, for example (Bruner & Kirshenblatt-Gimblett 1994). Blue jeans, watches, and cell
phones are concealed behind spears, feathers, and other ornaments or may be taken off
for the duration of the show. However, in order to sustain itself over time, such a show
has to be well disguised. It would be self-defeating if it were too blatant (Bruner 2001).
Spears, clubs, jewellery and artwork were initially just part of the culture of the Maasai.
Normally they only produced them for their own subsistence, but eventually they
discovered that it is worthwhile selling these artifacts to tourists. Nowadays, an
extensive manufacturing system is set up to produce tourist art. Even used machetes
and leaking calabashes used to transport milk are sold to eagerly paying visitors.
25 The fact that Maasai are seen as an auxiliary to wildlife tourism strengthens the
marginality argument regarding the Maasai as an object of tourism attraction. Maasai
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
51
are seen as an extension of wildlife; hence, they are regarded as most marginal (almost
as marginal as wild animals) from the centrality of the so-called “civilized” human
existence and society. Many have become voiceless warrior performers. When learning
to be themselves they are asked to participate in a predetermined representation of
themselves, for others. Maasai artistry is today being harnessed to meet the growing
tourist souvenir market, and age-old ceremonies are being turned into visitor shows.
Culture has become a flexible capital to be used profitably and has to yield a return.
Interlocking Maasai communities with tourism maintains, defends, or contests some
key societal institutions. A new development within boma (settlements) along touristic
circuits, for instance, is the permanent presence of warriors. These ilmurran play an
important role in performing dances and seem to be extending their interests into the
market place, whereas traditional customary practice stipulated that they should live
together in their own temporary manyatta in surrounding bush areas (Ritsma & Ongaro
2002: 132). My fieldwork observations and findings from short interviews confirmed
that tourists usually do not realize that most of the Maasai settlements they visit were
specifically built for tourism purposes.
26 Some Maasai themselves have been accused of peddling falsehoods as a means of
enticing foreign visitors. It is partly because of poverty, but more and more Maasai are
exploiting the situation and, as some confessed to my Maasai research assistant, they
do not mind fabricating untruths about their culture to make money. People in some
areas have resorted to begging or seeking to be photographed for cash (Turton 2004).
They have become so aware of how to extract money from tourism that foreign visitors
on occasion have been horrified at their boisterous and frantic attempts to be
photographed and videoed, in exchange for hard cash. According to Akama (2002),
“various forms of unwanted behaviour and vices of mass tourism have been notedin Maasailand. They include incidents of prostitution, alcoholism, smoking, anddrug taking. The Maasai youth are especially influenced by tourist behaviour andare enticed to indulge in such deviant activities.”
27 Not only Maasai culture in general is changing; some Maasai themselves are exploring
new horizons. In the coastal towns of Kenya and on the beaches of Zanzibar, the places
where most of the package tourists stay, there are many Maasai. Attracted by potential
employment opportunities and the seeming wealth of touristic regions, up-country
Maasai have migrated to these coastal areas. Benefiting from their image, they take up
jobs as security guards, sell artefacts and adornments along the beach or in towns, and
perform traditional dances in hotels. In Zanzibar’s Stone Town, for example, there are
plenty of Maasai tourist art traders. They all migrated from the northern districts of
Arusha and Kilimanjaro, basically following the tourist movements. Many of them were
first employed as walinzi (guardians) in hotels, but then—being extremely popular with
tourists who tour the national parks in the north of Tanzania—became an attraction
themselves and now perform for tourists. Most have been in the tourism souvenir trade
for a while and travel regularly between the mainland and Zanzibar. Quite a number of
them got into tourism after the severe droughts of the 1990s, when most of their cattle
died. They are well aware of their aesthetic appeal to a foreign tourism gaze.
Interestingly, most of Stone Town’s Maasai or Maasai-style tourist art is actually made
by Zanzibari people. The Maasai men who make beaded jewellery are a cultural oddity,
because, in their own culture, beading is a woman’s task. Recently, also Tanzanian
Maasai women started migrating from Maasailand to Dar es Salaam and other cities,
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
52
even as far as Zanzibar, Kampala, and Nairobi. They produce and sell beads and
traditional medicines for cash to support their families.
28 This phenomenon of migration is indicative of an overall intensifying impoverishment
of the Maasai (Coast 2002). Only very few migrated for frivolous reasons, and those few
are seen by others as deviants, likely to stay in town and become “lost” to the more
traditional Maasai community (May 2003: 17). Many Maasai blame the recent decline in
economic circumstances on their lack of schooling. Formal education was historically
shunned, partly due to the mobile life style, and also because the relevance of it for
pastoralism was not evident. Young Maasai men who travel to the coast to become
“beach boys” may expand the sense of roaming adventure long associated with their
age grade, but elders are concerned about their moral decline from encounters with
western tourists (Hodgson 2001). The new migrants usually profess a profound dislike
for life in the city, and an expressed goal to earn enough to replenish their shrunken
livestock herds and return home; a wish to remain pastoralists (albeit not in a
traditional way, but making use of modern commodities and new information and
communication technologies) and politically as well as socio-culturally independent.
Unfortunately, few Maasai seem to be reaping substantial financial benefits from
tourism.
Tourism Trap?
“Pastoral peoples find themselves in a kind of trap. To the extent that they want ashare of the tourist dollar, or want the income derived from selling their images tothe Western media, then they are required to enact the Western fantasy. But to theextent that they enact the Western fantasy, they then reproduce and henceperpetuate that fantasy. To enact is to construct” (Bruner 2002: 389).
29 Through the tourismification process, many Maasai have discovered their culture’s
capacity to make its own impact upon the global economic scene. This has quickly
resulted in a loss of some of its characteristics, mainly because tourism development is
embedded in Maasai cultural factors. Cultural narratives are ambivalent and cannot
exist any longer without reference to tourism. Instead of providing an accurate
representation of Maasai history and culture, tourism has continued to present the
colonial images and stereotypes concerning the Maasai as a backward community that
provide additional anecdotes to western tourism lurking for exoticism and adventure
in the African wilderness. The incorporation of ilmurran into an “economy of
performance” for tourists evidences how the selfexploitation of one’s own culture
—“being-themselves-for others”—predominates where few economic alternatives
prevail (Bruner & Kirshenblatt-Gimblett 1994).
30 When human agents occupy a contested space that they are striving to legitimize, they
reproduce their identity through the confirmation of cultural representations that
speak to their conceptions of themselves and their interpretation of what they perceive
to be tourists’ perceptions of them. Therefore, un-coordinated tourism development
presents an immense power to destroy territorial and local identities. According to
Akama (2002: 43), “it can be argued that instead of tourism assisting to ameliorate
social and economic problems that are confronting the Maasai, it has become part of
the process of marginalization of the Maasai and the distortion of their historical and
cultural values”. At the same time, tourism has proved to be an integral part of the
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
53
Maasai cultural process and it provides institutionalized and prestigious forms through
which these cultural and ideological processes can be mediated.
31 In tourism, culture is always re-worked, re-packaged, and re-produced for new
audiences (Bruner 2001). This mediation of culture need not necessarily lead to
homogenization (the “end of history” approach) but can also create hybridization
(whereby cultures learn and adapt from each other). Dean MacCannell (1976: 14) argues
that “what remains of the primitive world are ex-primitives, recently acculturated
peoples lost in the industrial world, and another kind of ex-primitive, still going under
the label primitive’, a kind of performative primitive’”. While it brings in
modernization of local traditions, often making destinations unattractive to the eyes of
cultural tourists, the process of tourismification also leads to a movement of identity
affirmation, variously called “traditionalization”, “indigenization”, or, in this case,
“maasaiization”. This case study of the tourismified Maasai culture has tried to move
beyond chronicling the “invention of tradition” for tourists to a more nuanced
examination of the ways in which history, politics, and touristic performances are
intertwined. There may be a monolithic romanticized, distorted, and exoticized image
of the Maasai in international tourism discourse, but what is crucial for an
understanding of tourism imaginaries is to ethnographically examine particular sites to
determine how global imageries are locally enacted. One of the points I have tried to
make in this article is that popular visual media play a huge factor in influencing
tourist expectations, and, ultimately, the attitudes and behaviours of those that are
visited as well. In the case of Africa, Amy Staples (2006: 394) recently reminded us that
“largely as a result of independent and commercially sponsored safari films, as well as
the Hollywood safari films that followed in their wake, African cultures with
spectacular dances, colourful costumes, and exotic practices became emblematic of the
continent”. These kind of images-as-imaginaries are so powerful because “they not
only enact but also construct peoples, places, and stories” (Bruner 2002: 387). It is
important to acknowledge that images are never politically neutral; they have real
world consequences, sometimes unintended ones, and sometimes consequences that
contradict precisely what the images were designed to convey. No matter how, cultural
representation of ethnic groups is a political act. As far as Maasai are concerned,
“a diffuse train of associations is triggered by distinctive cloth-wrapped bodies,selfconsciously designed hair-pieces, patterns of lobe extension and scarification,arrays of jewellery, and weapons seemingly joined to bodies, which transcendsparticularities of time, place, and cultural affinity. Those associations includetenacious traditionalism, localism, difference” (Galaty 2002: 348).
32 Everybody seems to “know” the Maasai—with spears and shields dancing or charging
across the open plains—at a time these pastoral communities are faced with political
marginalization and are often being dispossessed of their land. The silent assertions
that are partners of the explicit images through which they are conveyed suggest,
wrongly, that pastoralists are unready to grasp the opportunities of modernization, are
unproductive in their use of the rangelands, and represent unworthy trustees of the
environmental resources of the great East African savannah (ibid.). The cinematic
exploitation of Native Americans only began to break down when big-name Hollywood
luminaries such as Marlon Brando spoke out against their negative portrayals15. Who is
willing to do the same for the Maasai?
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
54
BIBLIOGRAPHY
AKAMA, J. S.
2002 “The Creation of the Maasai Image and Tourism Development in Kenya”, in J. S. AKAMA & P.
STERRY (eds.), Cultural Tourism in Africa: Strategies for the New Millennium (Arnhem: Association for
Tourism and Leisure Education): 43-53.
ARHEM, K.
1985 Pastoral Man in the Garden of Eden: The Maasai of the Ngorongoro Conservation Area, Tanzania
(Uppsala: University of Uppsala).
BACHMANN, P.
1988 “The Maasai — Choice of East African Tourists — Admired and Ridiculed”, in P. ROSSEL (ed.),
Tourism: Manufacturing the Exotic (Copenhagen: IWGIA): 47-64.
BERGER, D. J.
1996 “The Challenge of Integrating Maasai Tradition with Tourism”, in M. F. PRICE (ed.), People and
Tourism in Fragile Environments (Chichester: John Wiley & Sons): 175-197.
BRUNER, E. M.
2001 “The Maasai and the Lion King: Authenticity, Nationalism, and Globalization in African
Tourism”, American Ethnologist 28 (4): 881-908.
2002 “The Representation of African Pastoralists: A Commentary”, Visual Anthropology 15 (3):
387-392.
BRUNER, E. M. & KIRSHENBLATT-GIMBLETT, B.
1994 “Maasai on the Lawn: Tourist Realism in East Africa”, Cultural Anthropology 9 (4): 435-470.
VAN DER CAMMEN, S.
1997 “Involving Maasai Women”, in L. FRANCE (ed.), The Earthscan Reader in Sustainable Tourism
(London: Earthscan).
COAST, E.
2001 Colonial Preconceptions and Contemporary Demographic Reality: Maasai of Kenya and Tanzania
(London: University College, Human Ecology Research Group).
2002 “Maasai Socioeconomic Conditions: A Cross-Border Comparison”, Human Ecology 30 (1):
79-105.
COLEMAN, S. & CRANG, M. (eds.)
2002 Tourism: Between Place and Performance (New York: Berghahn).
VAN DER DUIM, R., PETERS, K. & WEARING, S.
2005 “Planning Host and Guest Interactions: Moving Beyond the Empty Meeting Ground in
African Encounters”, Current Issues in Tourism 8 (4): 286-305.
FRANKLIN, A. & CRANG, M.
2001 “The Trouble with Tourism and Travel Theory?”, Tourist Studies 1 (1): 5-22.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
55
GALATY, J. G.
2002 “How Visual Figures Speak: Narrative Inventions of ‘The Pastoralist’ In East Africa”, Visual
Anthropology 15 (3): 347-367.
GAONKAR, D. P. & LEE, B. (eds.)
2002 “New Imaginaries”, Public Culture 14 (1).
GUPTA, A. & FERGUSON, J. (eds.)
1997 Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology (Durham: Duke university Press).
HALL, C. M. & TUCKER, H. (eds.)
2004 Tourism and Postcolonialism: Contested Discourses, Identities and Representations (London:
Routledge).
HARVEY, D.
1989 The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change (Oxford: Blackwell).
HODGSON, D. L.
2001 Once Intrepid Warriors: Gender, Ethnicity, and the Cultural Politics of Maasai Development
(Bloomington: Indiana university Press).
HONEY, M.
1999 Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? (Washington: Island Press).
HUGHES, L.
2006 “Beautiful Beasts’ and Brave Warriors: The Longevity of a Maasai Stereotype”, in L.
ROMANUCCI-ROSS, G. A. DE VOS & T. TSUDA (eds.), Ethnic Identity: Problems and Prospects for the Twenty-
First Century (Lanham: Altamira Press): 246-294.
KASFIR, S. L.
2002 “Slam-Dunking and the Last Noble Savage”, Visual Anthropology 15 (3): 369-385.
KNOWLES, J. & COLLETT, D.
1989 “Nature as Myth, Symbol and Action: Notes Towards a Historical Understanding of
Development and Conservation in Kenyan Maasailand”, Africa 59 (4): 433-460.
MACCANNELL, D.
1976 The Tourist: A New Theory of the Leisure Class (New York: Schocken Books).
MAY, A.
2003 Maasai Migrations: Implications for Hiv/Aids and Social Change in Tanzania (Boulder: University
of Colorado, Institute of Behavioral Science).
MORGAN, N. & PRITCHARD, A.
1998 Tourism Promotion and Power: Creating Images, Creating Identities (Chichester: John Wiley).
MOWFORTH, M. & MUNT, I.
2003 Tourism and Sustainability: Development and New Tourism in the Third World (London:
Routledge).
NEUMANN, R. P.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
56
1998 Imposing Wilderness: Struggles over Livelihood and Nature Preservation in Africa (Berkeley:
University of California Press).
NORTON, A.
1996 “Experiencing Nature: The Reproduction of Environmental Discourse through Safari
Tourism in East Africa”, Geoforum 27 (3): 355-373.
PICARD, M.
1996 Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture (Singapore: Archipelago Press).
PRATT, M. L.
1992 Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation (London: Routledge).
RITSMA, N. & ONGARO, S.
2002 “The Commodification and Commercialisation of the Maasai Culture: Will Cultural
Manyattas Withstand the 21st Century?”, in J. S. AKAMA & P. STERRY (eds.), op. cit.: 127-136.
SAID, E. W.
1994 Orientalism (New York: Vintage Books).
SAITOTI, O. T.
1987 Maasai (New York: Harry N. Abrams).
1988 The Worlds of a Maasai Warrior: An Autobiography of Tepilit Ole Saitoti (Berkeley: University of
California Press).
SALAZAR, N. B.
2005 “Tourism and Glocalization: ‘Local’ Tour Guiding”, Annals of Tourism Research 32 (3): 628-646.
2006 “Touristifying Tanzania: Global Discourse, Local Guides”, Annals of Tourism Research 33 (3):
833-852.
2007a “Representation in Postcolonial Analysis”, in W. A. DARITY (ed.), International Encyclopedia of
the Social Sciences (Farmington Hills: Thomson/Gale).
2007b “Towards a Global Culture of Heritage Interpretation? Evidence from Indonesia and
Tanzania”, Tourism Recreation Research 32 (3): 23-30.
2008 Envisioning Eden: A Glocal Ethnography of Tour Guiding, PhD dissertation, Department of
Anthropology, University of Pennsylvania.
SOBANIA, N.
2002 “But Where Are the Cattle? Popular Images of Maasai and Zulu Across the Twentieth
Century”, Visual Anthropology 15 (3): 313-346.
SPEAR, T. T. & WALLER, R. (eds.)
1993 Being Maasai: Ethnicity and Identity in East Africa (London: James Currey).
STAPLES, A. J.
2006 “Safari Adventure: Forgotten Cinematic Journeys in Africa”, Film History 18 (4): 392-411.
THOMSON, J.
1885 Through Masailand (London: Sampson Low, Marston, Searle and Rivington).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
57
TORGOVNICK, M.
1990 Gone Primitive: Savage Intellects, Modern Lives (Chicago: The University of Chicago Press).
TURTON, D.
2004 “Lip Plates and the People Who Take Photographs’: Uneasy Encounters between Mursi and
Tourists in Southern Ethiopia”, Anthropology Today 20 (3): 3-8.
WANG, N.
2000 Tourism and Modernity: A Sociological Analysis (Oxford: Pergamon Press).
WELS, H.
2002 “A Critical Reflection on Cultural Tourism in Africa: The Power of European Imagery”, in J.
S. AKAMA & P. STERRY (eds.), Cultural Tourism in Africa: Strategies for the New Millennium (Arnhem:
Association for Tourism and Leisure Education): 55-66.
Filmography
ALLERS, R. & MINKOFF, R.
1994 The Lion King (Burbank: Walt Disney Pictures): 88 mins.
DE BONT, J.
2003 Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (Los Angeles: Paramount Pictures): 117 mins.
CASEY, G.
1994 Africa: The Serengeti (Hollywood: Graphic Films): 39 mins.
CURLING, C. & LLEWELYN-DAVIS, M.
1974 Masai Women (London: Granada Television): 55 mins.
1975 Masai Manhood (London : Granada Television) : 55 mins.
EMMERICH, R.
1996 Independence Day (Culver City: Centropolis Entertainment): 145 mins.
HAWKS, H.
1962 Hatari! (Edinburgh: Malabar Productions): 157 mins.
HOPKINS, S.
1996 The Ghost and the Darkness (Beverly Hills: Constellation Entertainment): 109 mins.
HUNTGEBURTH, H.
2005 The White Massai [Die Weisse Massai] (Munich: Constantin Film Produktion) : 131 mins.
KIBIRA, J.
2003 Bongoland (Minneapolis: Kibirafilms): 105 mins.
KIRKLAND, M.
2001 The Simpsons: Simpson Safari [Season 12, Episode 17] (Los Angeles: Twentieth Century Fox): 22
mins.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
58
LINK, C.
2001 Nowhere in Africa [Nirgendwo in Afrika] (Geiselgasteig: Bavaria Film): 141 mins.
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
1972 Man of the Serengeti (Washington: National Geographic Society): 50 mins.
1989 Serengeti Diary (Washington: National Geographic Society): 54 mins.
NOBLE, R.
2000 Wild Thornberrys: Critical Masai [Season 3, Episode 5] (New York: Nickelodeon): 30 mins.
PLISSON, P.
2004 Masai : The Rain Warriors [Masai : Les guerriers de la pluie] (Issy-les-Moulineaux : Mars
Distribution) : 94 mins.
POLLACK, S.
1985 Out of Africa (Los Angeles: Mirage Entertainment): 150 mins.
NOTES
1. Other scholars, including PICARD (1996) and WANG (2000), call this “touristification”. I prefer
tourismification as a term because it is not the mere presence of tourists that is shaping this
phenomenon but, rather, the ensemble of actors and processes that constitute tourism as a
whole.
2. Imaginaries are representational systems that mediate reality and form identities. As
institutionally grounded representations implying power, hierarchy, and hegemony, they
represent possible worlds that are different from the actual world, and are tied in to projects to
change it in particular directions (GAONKAR & LEE 2002). Tourism imaginaries are heavily
influenced by mythologized (often western) visions of “Otherness” from popular culture, (travel)
literature, and academic writings in disciplines like anthropology, archaeology, art, and history
(PRATT 1992; SAID 1994; TORGOVNICK 1990).
3. This article is part of a larger project in which I examine how local tourism actors and
intermediaries in Tanzania and Indonesia represent their cultural and natural heritage to a
global audience of tourists (SALAZAR 2005, 2006, 2007b, 2008).
4. An ilmurran describes a stage in a Maasai youth’s life when he has been circumcised and
incorporated into the newest age set. Circumcised young men are junior warriors, a traditional
period of life associated with the establishment of a manyatta, a camp to protect their
neighbourhood.
5. Major colonial accounts that contributed to creating lasting stereotypes of Maasai culture
include Richard Burton’s The Lake Regions of Central Africa (1860), Joseph Thomson’s Through
Masailand (1885), Karl Peters’ New light on dark Africa (1891), Sidney and Hildegarde Hinde’s The
last of the Masai (1901), and Marguerite Mallett’s A white woman among the Masai (1923).
Representative traditional ethnological writings on the Maasai comprise Alfred C. Hollis’s The
Masai: Their language and folklore (1905), Meritz Merker’s The Masai: Ethnographic monograph of an
East African Semite people (1910), Louis S. B. Leakey’s Some notes on the Masai of Kenya Colony (1930),
Henry A. Fosbrooke’s An administrative survey of the Masai social system (1948) and George W. B.
Huntingford’s The southern Nilo-Hamites (1953).
6. The Samburu are the northernmost of several Maa-speaking groups of cattle pastoralists. The
merging of Maasai and Samburu identities in this film reflects both historical reality and current
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
59
cultural politics. One of the casting reasons for using Samburu instead of Maasai is that they were
considered more “traditional”, referring to their relative lack of experience with the cash
economy, hence financially more attractive to the filmmakers (KASFIR 2002).
7. <http://www.imdb.com/title/tt0109049/>.
8. The much smaller ethnic group of Hadzabe bushmen of Karatu District (Eastern Rift Valley) are
now being promoted aggressively by Tanzania’s tourism industry as the last “authentic” hunter-
gatherers of East Africa.
9. Visitors to Maasai-inhabited areas in Tanzania do not come to see only, or primarily, the
Maasai. Their attraction is mainly to the wildlife and a visit to a Maasai settlement is combined
with a wildlife-viewing safari through the African savannah. This was not different in the past.
Although the Maasai and their cattle have been crucial elements in the Serengeti ecosystem, they
were merely a footnote to Theodore Roosevelt’s hunting safari of 1909, the event that turned
America’s attention to East Africa.
10. In 1959, with the establishment of Serengeti National Park, the Maasai who lived there were
evicted and moved to the Ngorongoro Conservation Area. In 1974, they were forced to evacuate
some parts of Ngorongoro as well, because their presence was believed to be detrimental to
wildlife and landscape. In the 1980s, they faced further restrictions as the conservationist
attitude of the government stiffened. In 2006, the Tanzanian government even gave an
ultimatum to Maasai communities living inside Ngorongoro—around 60.000 people—to vacate
the area by end of the year.
11. While observing a classroom interaction in a tour guide school in Arusha, I heard a teacher
tell the apprentice driver-guides (only a minority of whom were Maasai) that many western
female tourists travel all the way to Tanzania for only two things: to see a lion and [...] a Maasai
penis (confirming the widely spread imaginary that Maasai men are well endowed).
12. <http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/gracielastanley/preparations/1142082900/
tpod.htm>.
13. Other factors that have greatly contributed to transforming the Maasai way of life are (global)
trade, missionary activities (including schooling), and, increasingly, new information and
communication technologies (e.g. the use of mobile phones and the Internet).
14. The British banned, unsuccessfully, the practices of the ilmurran in 1921, and the postcolonial
East African governments all have laws against lion hunting, cattle raiding, and female
circumcision.
ABSTRACTS
The various ways in which peoples and places around the globe are represented and documented
in popular media have an immense impact on how tourists imagine and anticipate future
destinations. Even though tourism discourses take a variety of forms, visual imagery seems to
have the biggest influence on shaping tourists' pretrip fantasies. Based on ethnographic
fieldwork, this paper illustrates the dynamic processes of cultural tourismification in Tanzania's
so-called "northern circuit". In many parts of the world, famous nature documentaries,
mainstream Hollywood entertainment, and semi-biographic films about this region have become
fashionable icons for sub-Saharan Africa as a whole, often reinforcing a perfect nostalgic vision
of the black continent as an unexplored and time-frozen wild Eden. While tourism
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
60
representations have overwhelmingly focused on wildlife, an increasing demand for "meet-the-
people" cultural tourism is increasingly bringing local people into the picture. Interestingly,
locals are commonly portrayed while engaging in vibrant rituals or in inauthentic, staged poses
wearing celebrative costumes. As an example, the paper discusses how the romanticized image of
the virile Maasai warrior, dressed in colourful red blankets and beaded jewellery, has led to a
true Maasai-mania that is profoundly affecting the daily life and culture of Maasai and other
ethnic groups.
Les différentes façons dont les peuples et les lieux sont représentés dans les médias populaires
ont un impact immense sur la manière qu'ont les touristes d'imaginer et de prévoir leurs futures
destinations. Bien que les discours sur le tourisme prennent des formes diverses et variées, les
images semblent avoir la plus grande influence sur la façon dont les touristes rêvent leurs
voyages. Basé sur un travail de terrain ethnographique, ce texte illustre les processus
dynamiques de tourismification culturelle dans ce qu'on appelle « le circuit du nord » de
Tanzanie. Dans beaucoup d'endroits du monde, les documentaires célèbres sur la nature, les
divertissements grand-public de Hollywood et les films plus ou moins biographiques de cette
région sont devenus des icônes à la mode pour l'Afrique subsaharienne, renforçant souvent une
vision nostalgique du continent noir comme un Eden sauvage inexploré et figé dans le temps.
Alors que les représentations du tourisme se sont principalement centrées sur la faune et la flore,
une large demande « de rencontrer des gens » se fait sentir. De plus en plus, le tourisme culturel
fait entrer la population dans le paysage. On montre fréquemment les habitants pratiquant des
rituels vibrants ou habillés de costumes de cérémonie dans des mises en scène sans authenticité.
En exemple, ce texte traite de l'image idéalisée du guerrier massaï, viril, paré dans des
couvertures rouges et orné de bijoux, qui mène à une vraie « massaïmania » qui affecte
profondément la vie quotidienne et la culture des Massaï et d'autres groupes ethniques.
INDEX
Mots-clés: Tanzanie, Massaï, représentation culturelle, imaginaire touristique, tourismification
Keywords: Tanzania, Maasai, cultural representation, tourism imaginary, tourismification
AUTHOR
NOEL B. SALAZAR
The Research Foundation - Flanders (FWO) and Marie Curie Fellow (7th European Community
Framework Programme) at the Interculturalism, Migration and Minority Research Centre,
University of Leuven, Belgium, and Visiting Research Associate at the Centre for Tourism and
Cultural Change, Leeds Metropolitan University, UK.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
61
« Guides, guidons et guitares ».Authenticité et guides touristiquesau Mali« Guides, Handlebars and Guitars ». Authenticity and Touristic Guides in Mali
Anne Doquet
1 Sur la page d’ouverture du site du ministère du Tourisme malien, le mot saute aux
yeux : « Mali, un pays authentique. » Notion-clé depuis un quart de siècle de la
promotion touristique depuis le pays comme des agences extérieures, l’authenticité est
devenue la première caractéristique du Mali et préside toujours dans ce pays à un
tourisme qui, malgré de récentes tentatives de diversification, a toujours été et reste
culturel. Cette forme de voyage au succès croissant suppose de la part de ses adeptes un
esprit de partage et de rencontre. Les interactions qu’elle promet et promeut se veulent
les plus sincères, donc les plus immédiates. Celles-ci devraient donc logiquement être
dénuées de toute médiation susceptible de les dénaturer. Or, — et le constat n’est pas
propre au Mali —, c’est précisément là où le tourisme se définit comme culturel
qu’interviennent de façon quasi systématique les médiateurs que sont les guides. Est-ce
à dire que la rencontre touristique est impossible ? Sans aller si loin, on peut penser
que la présence des guides est nécessaire, sans quoi elle ne serait pas. Dans un pays où
le français est langue d’État, il est difficile de la justifier par le seul obstacle
linguistique. Le manque d’indications et les aléas des moyens de transport constituent
eux aussi un élément explicatif, mais insuffisant encore. Enfin, le harcèlement peut
aussi user la patience des touristes rétifs, préférant finalement supporter un guide pour
en éloigner cent. Mais ces éléments n’épuisent pas les raisons de l’appel à ces
médiateurs, dont le rôle ne se limite sûrement pas à conduire les touristes vers tel ou
tel lieu réputé. Alors que le gouvernement malien tentait il y a une dizaine d’années
d’organiser les métiers du tourisme, Moussa, un jeune guide, adressa au ministre, qui
considérait que tout restait à faire, cette sentence : « Y’a des guides, des guidons, et des
guitares »*. Les guidons sont ceux dont le rôle se limite à conduire les visiteurs, les
guitares sont les beaux parleurs qui connaissent la chanson, mais pas le terrain. Et puis
il y a les guides qui, bien avant que le gouvernement1 ne se préoccupe de leur sort (et de
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
62
celui de leurs clients), ont construit leur profession, mais en même temps les bases du
tourisme malien d’aujourd’hui. Derrière l’humour, Moussa rappelait aux autorités que
le travail des guides avait un sens qu’on essaiera d’éclairer ici. Dans ce pays où
l’authenticité constitue l’idée phare des visiteurs et de la promotion touristique, à quoi
servent réellement ces médiateurs ? Leur présence nécessaire traduirait-elle le fait que
l’objectif premier du voyage n’est qu’une illusion nécessitant une mise en scène pour
les yeux des visiteurs ? Si tel était le cas, ils seraient instigateurs de mensonge et de
tromperie pour leurs clients naïfs et dupés. C’est ainsi que les guides, personnages
souvent mal aimés et par les Maliens, et par les étrangers, sont souvent perçus. Cette
schématisation de leur rôle ne va pas sans préjugés. Elle découle d’une part d’une
appréhension positiviste qui rend la présence des étrangers incompatible avec
l’authenticité culturelle. Cette dernière serait alors vouée au dédoublement : d’un côté
réelle et protégée du regard inquisiteur, de l’autre factice et fabriquée pour ce même
regard. Ce même point de vue prête au tourisme un caractère autodestructeur, les
visiteurs poursuivant une authenticité que leur seule présence détruit par la facticité
des mises en scène. Mais n’y a-t-il rien de vrai dans cette facticité apparente ?
L’authenticité est-elle seulement une extrapolation occidentale mise en forme par les
populations visitées ? En d’autres termes, ne fait-elle aucun sens chez ces populations ?
La question reste posée dans un pays où les frontières entre les politiques culturelles et
touristiques n’ont jamais été nettes et où des manifestations destinées aux touristes
remportent un succès local certain. En parallèle, cette conception de l’authenticité
comme caractéristique intrinsèque des objets, objective et mesurable, réduit la quête
touristique à un ensemble d’objets et d’hommes à voir. Personnage insensible, dénué
d’émotion, le touriste ne viendrait que reconnaître et se satisferait de scènes et de
relations taillées à son image. C’est oublier que sa quête est aussi et peut-être avant
tout une recherche de soi dans le vécu de relations sociales avec l’Autre, qui ne peut
être nourrie par une simple présentation d’objets à regarder. C’est aussi tomber dans
les clichés dont souffre le touriste, résumés par l’expression de J.-D. Urbain (1991)
« idiot du voyage ». Natifs rusés contre étrangers naïfs, telle est la conception que peut
mettre en question une ethnographie des relations guides- touristes. Car si les guides
peuvent apparaître comme trompeurs et créateurs de facticité, ils savent répondre à
des désirs que les mises en scène ne peuvent assouvir. Leur engagement dans diverses
actions en fait en même temps des acteurs culturels plus que des personnages. Enfin, ils
entretiennent avec leurs clients des relations profondément ambivalentes. Leur activité
semble finalement répondre à la quête d’authenticité tout autant que la contrarier.
Mais en creusant ces ambivalences, on retrouve une authenticité dont le propre est
peut-être d’émerger là où elle n’est pas attendue.
Tu n'es pas un touriste, tu es un frère...
2 Utilisée un peu à tort et à travers en anthropologie et en sociologie du tourisme, la
notion d’authenticité a fait l’objet de diverses analyses théoriques dévoilant ses
acceptions multiples. En 1976 MacCannell introduisait le concept dans la sociologie du
tourisme, en en faisant la motivation centrale des visiteurs : « Pour les modernes, la
réalité et l’authenticité sont considérées comme étant ailleurs : dans d’autres périodes
historiques, dans d’autres cultures, dans des styles de vie plus purs et plus simples »
(MacCannell 1976 : 3). Mû par cette unique perspective, le touriste de MacCannell se
verrait du coup servir une simulation montée par les visités en réponse à son
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
63
aspiration. En ce sens, et pour de nombreux auteurs en sociologie ou anthropologie du
tourisme, les populations visitées s’évertueraient à protéger leur culture en en offrant
une représentation aux touristes, tandis que les traditions significatives se
poursuivraient en coulisse. Disqualifiée par certains, la théorie de MacCannell a été
nuancée par d’autres. Selwyn (1996), le premier, a insisté sur le double sens contenu
dans son usage. Il parle d’authenticité chaude (hot authenticity) lorsque MacCannell se
réfère à la principale motivation des touristes, la recherche de relations sociales
harmonieuses et solidaires que la vie moderne et postmoderne aurait anéanties.
Parallèlement, il qualifie de froide (cool authenticity) l’authenticité mise en scène (stage
authenticity), en lien cette fois avec la qualité de la connaissance associée à l’expérience
touristique, et alimentée par les musées, les guides (écrits) ou même les anthropologues
(Selwyn 1996 : 7). Pour nourrir les désirs de leurs clients, les guides devront faire avec
cette double nature de l’authenticité.
3 Répondre à la recherche d’authenticité « froide », située du côté de la connaissance,
implique de leur part de mesurer tant les connaissances réelles que le désir de
connaissance de leurs clients. À des degrés très variables, ces derniers ont acquis des
savoirs sur la culture visitée, savoirs théoriques dont ils recherchent des illustrations
vivantes. S’il est admis dans la littérature consacrée aux touristes que ces derniers
cherchent moins à connaître qu’à reconnaître ce que leurs lectures ou visionnages leur
ont appris, les guides doivent cerner cette pré-connaissance du terrain et doublement
la conforter par leurs explications et par des scènes de vie. Or la plupart des guides du
Mali, hormis les quelques diplômés de ces dernières années, ont eu une scolarisation
très limitée, quand ils ne sont pas analphabètes. Beaucoup ont eu des enfances
douloureuses, voire ont grandi dans la rue. Les nouveaux diplômés des quelques
formations aux métiers du tourisme récemment mises en place au Mali seraient
certainement mieux placés que les guides auxquels on se réfère ici pour répondre aux
interrogations des visiteurs, notamment en matière d’histoire. Aussi ces derniers
doivent-ils pallier leur manque de culture générale et écrite en multipliant les
stratégies pour déjouer le rôle de donneurs d’explications qui leur est dévolu. Mais le
désir des visiteurs est-il vraiment d’apprendre ? Sans maîtriser les connaissances pré-
acquises par leurs clients, les guides ont une nette intuition du contenu de
l’authenticité froide : les Blancs cherchent une Afrique intacte, préservée, qui n’aurait
pas été confrontée aux valeurs de la modernité. Il leur suffit alors d’attirer l’attention
des touristes sur toutes les scènes de vie respirant l’ancestralité. Que des vieillards se
reposent à l’ombre d’un baobab et aussitôt l’idée de l’arbre à palabres s’illustre
magnifiquement. Ainsi, bien souvent, le décor colle au texte sans les besoins d’une mise
en scène contraignante. Le meilleur guide ne sera finalement pas celui qui donnera le
plus d’explications, mais celui qui saura pointer les objets, les personnages et les scènes
de vie les plus à même d’évoquer la tradition, quelques personnages du village
seulement (tel le forgeron qui vendra son travail) jouant cette dernière contre une
compensation lucrative. Ce qui importe est donc moins l’étendue du savoir théorique
du guide sur la zone qu’il fait visiter que la connaissance de la quête de son client. Les
« guidons et guitares » de Moussa sont ceux qui conduisent les visiteurs sur les sites et
leur livrent des explications théoriques. Mais si ces deux catégories, visant
explicitement d’une part les jeunes guides inexpérimentés qui restent muets une fois
rendus sur le site et, d’autre part les nouveaux diplômés qui récitent leur savoir sans le
rendre vivant, sont clairement distinguées de celle de « guide », c’est que c’est ailleurs
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
64
que se jouent les connaissances et la maîtrise du métier de guide, du côté de
l’« authenticité chaude ».
4 En effet, les tactiques permettant de pallier les lacunes théoriques des guides
s’apparentent à des stratégies de mise en contexte du voyageur en quête de ressenti
social authentique.
5 Les guides esquivent les questions de ceux qui cherchent des traces de leurs lectures en
revendiquant une autre connaissance : « Ça, c’est les Africains des livres, ça c’est pour
les Toubab. Moi, je vous parle des Africains vrais, vrais, vrais » (A., guide de Mopti). Plus
subtilement encore, ils s’emparent des techniques de transmission du savoir
traditionnel pour placer le touriste en position d’initié ne devant pas dépasser son
maître : « Vous les Blancs, vous êtes trop curieux. Il ne faut pas connaître d’un coup.
Tout s’apprend un peu un peu » (C., guide de Sangha). Et d’ajouter un proverbe en
langue locale replaçant cette conception de la connaissance dans la tradition (tels que
« Petit à petit, l’oiseau fait son nid » ; « Ne fabrique pas une outre plus grande que celle
de l’homme qui t’a appris à connaître la brousse »).
6 Ces formules qui sont bien des esquives préparent en même temps les visiteurs au
ressenti de l’authenticité dans le partage. Or le guide, bien plus qu’un simple
traducteur, est le pivot de la relation visiteurs-visités. C’est lui que les touristes voient
et fréquentent le plus, et leur lien concret avec ce personnage déterminera l’empathie,
ainsi que le sentiment de rencontre profonde avec les autres. Aussi les guides insistent-
ils en permanence sur leur propre expérience, et en particulier sur les rituels, réels ou
fictifs, qu’ils ont vécus. Ils se démarquent volontairement de la littérature pour se faire
les témoins vivants des êtres imaginaires que les touristes rêvent de rencontrer.
Souvent vêtus de costumes traditionnels, bardés d’amulettes ostentatoires qu’on
pourrait penser destinées à leurrer leurs clients, accentuant les gestes et attitudes
traditionnelles les plus typiques, ils peuvent être regardés comme des personnages
folkloriques décalés de la réalité. La part de théâtralité est belle dans ces récits et ces
présentations de soi. Mais ne sont-ils que dans la représentation lorsqu’ils racontent
une trajectoire vécue ou désirée, et qu’ils se parent des attributs de la coutume ? Leurs
références constantes à la sorcellerie, dont l’effet sur les touristes est garanti,
comportent souvent une part d’exagération mais ne sont pas toujours mensongères.
Les amulettes qu’ils portent ne sont ainsi pas décoratives : personnages extrêmement
jalousés du fait de leurs biens (nombre d’entre eux parviennent par exemple à
construire des maisons en dur très jeunes), les guides se surprotègent des attaques de
sorcellerie sous la menace desquelles ils vivent. Aussi, même si une part de leur
personnage est surjouée, leurs attitudes et accoutrements ne sont en réalité pas
réservés à leurs clients. En saison « morte », lorsqu’une occasion de fête leur est
donnée, ils portent ces mêmes costumes, et les musiques de leurs idoles (Bob Marley
tout particulièrement) alternent avec des morceaux locaux traditionnels qu’ils
chantent et dansent entre eux et pour eux. Dès lors, en dépit du fait que certains
amateurs jouent faux et deviennent de véritables caricatures dont l’artifice est
difficilement supportable pour leurs clients, les guides les plus expérimentés ne
peuvent être réduits à des personnages singeant la tradition. Leur regard sur cette
dernière est certainement plus distant que celui des villageois, leur métier leur
imposant ce recul. Mais distance n’est pas forcément synonyme de détachement : leur
rapport à la tradition peut être étroit, et reste déterminant pour la sensation qu’auront
les touristes d’effleurer ou d’atteindre l’authentique, non seulement dans leur relation
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
65
à ce personnage qui accompagnera leur séjour, mais au-delà, dans leur relation au
monde étranger qu’ils viennent découvrir.
7 En effet, si le guide parvient à inspirer au touriste le sentiment de pénétrer à travers lui
dans la tradition, ce lien se prolongera dans la relation aux personnes rencontrées par
son intermédiaire. Quelques petites clés détermineront ces rencontres. Sachant très
bien que sa relation à ses clients déterminera toutes les autres, le guide prendra des
précautions pour que rien ne vienne la noircir. L’épineuse question de l’argent,
considéré comme l’un des éléments de corruption les plus redoutables, sera en
particulier traitée au préalable, afin qu’elle intervienne le moins possible durant le
tour. Conscients de l’image négative que les visiteurs, venant chercher un monde
autarcique où seul le don et le troc définissent les échanges, ont des transactions
financières, les guides les confortent dans cette conception, leur conseillant par
exemple de ne jamais donner de monnaie aux villageois pour ne pas les « gâter », mais
de préférer offrir fournitures scolaires ou médicaments au chef du village, censé se
charger d’une répartition équitable. De même, ils proposent des tours « tout compris
sauf boissons » incluant l’hébergement, la nourriture et leur salaire, mais aussi tous les
frais liés à la visite des villages qui échappent totalement aux visiteurs. Ces tours
atteignent parfois des sommes exorbitantes qui peuvent générer quelques tensions en
début de séjour. Mais au fil de la visite, la question s’évanouit doucement non
seulement entre les touristes et leur guide, mais aussi entre eux et les villageois. Un
guide de Sangha m’explique ainsi : « Tu sais, les touristes n’aiment pas voir qu’on paie
l’argent partout. Si ils veulent prendre des vieux en photos, les vieux veulent l’argent.
Si je leur dis ça, ils disent que c’est pas bon, ils ont la déception. Donc ils prennent la
photo, et après je vais donner 1 000 francs aux vieux. » Nullement conscients des
sommes laissées au village pendant leur passage, pas plus que des pourcentages
récupérés par le guide une fois leurs achats effectués, les clients peuvent vivre quelques
journées en dehors de la transaction monnayée, mis à part l’achat de souvenirs. Pas de
question d’argent entre le guide et ses clients, pas non plus entre eux et les villageois.
Ce transfert de la relation touriste-guide à la relation touriste-population ne se limite
pas à la question financière. Pressentant la quête de fraternité de ses clients, le guide
met en place avec eux des relations sociales quasi familiales facilement prolongeables
dans les rencontres ponctuelles avec les villageois. La distribution de noms et prénoms
locaux ainsi que l’apprentissage des salutations en langue locale en constituent un
élément. Lorsque les touristes viennent à croiser des villageois, le guide les présente
par leur nouveau patronyme qui aussitôt déclenche le jeu local des relations à
plaisanterie. Toujours amusée lorsque des Blancs balbutient maladroitement quelques
mots en langue locale, la population se prête facilement au jeu, se permettant à
l’occasion de glisser à l’égard des visiteurs quelques moqueries incompréhensibles. Le
guide aura également pris soin d’apprendre à ses clients un ou deux proverbes
classiques que ceux-ci tenteront de placer au bon moment. Les logiques de
l’enchantement décrites par Winkin (2001) fonctionnent alors à merveille au profit
d’une sensation de rencontre éphémère mais authentique, faite de sourire et de
convivialité, dénuée de services monnayés. Ainsi, en préparant des moments de
rencontre furtifs mais efficaces, le guide assouvit le désir de solidarité et de fraternité
de ses clients. Ceci sans trop de difficultés. En effet, on est loin d’une mise en scène
généralisée, nécessaire sans doute dans les villages ethniques construits spécialement
pour le tourisme. L’idée souvent évoquée dans la littérature, qu’à la vue des touristes
les Massaï se mettent à jouer aux Massaï et les Papous aux Papous, est largement
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
66
abusive. Ici, si le guide perçoit finement les intentions de ses clients et prépare
correctement la découverte de scènes de vie et la rencontre avec les habitants, la mise
en scène reste minime. Ce qui se joue n’est pas de l’ordre du dédoublement de
l’authenticité décrit par MacCannell et ses successeurs. Et c’est tout l’art du guide
d’instaurer entre lui et ses clients une relation transférable aux villageois. C’est ainsi
qu’il doit les convaincre d’une fraternité sincère. Quel touriste ne s’est pas entendu dire
que lui, précisément, n’était pas un touriste mais un frère, et que pour cette raison, il
assistait à des scènes et partageait des moments que les autres n’avaient pas la chance
de vivre ? Les guides récemment entrés dans le métier s’étonnent souvent de l’aversion
des touristes pour leurs homologues : « Vraiment, je ne sais pas pourquoi les Blancs ne
s’aiment pas. Moi si je vais en Europe et si je vois un Malien, je vais être content et je
vais bien causer. Mais les Blancs s’ils voient un autre Blanc, ils se fâchent tout de suite »
(E., guide de Siby). En revanche, les plus expérimentés connaissent bien le « complexe
du faux » (Urbain 1991) dont sont atteints les touristes et s’évertuent à les soustraire
symboliquement à cette catégorie en créant une illusion de fraternité. Il faut, pour y
parvenir, une conscience très juste de leurs désirs et aspirations, qui fait certainement
défaut aux « guidons » et aux « guitares » de Moussa.
8 Dans la sociologie du tourisme, E. Cohen est un des rares chercheurs à s’être intéressé
aux guides. Si D. Nash (1981) pressentait leur importance dans un des articles
fondateurs de la discipline, l’idée n’a eu que peu de relais. Ap et Wong (2001) ont
pourtant estimé le rôle du guide déterminant dans la réussite du voyage car il
transformerait la visite de tour en expérience. Auparavant, le travail de Cohen (1985,
2001 : 89) sur le tourisme thaïlandais a défini l’évolution du rôle des guides par quatre
fonctions : instrumentale (essentiellement, montrer le chemin), sociale (entretenir la
convivialité et la sociabilité du groupe), interactionnelle (servir de médiateur entre les
touristes et les locaux), et enfin communicative (faire remarquer les points d’intérêts et
expliquer les sites mais surtout les interpréter en fonction des expériences et des
attentes touristiques). Quatre types de guides sont alors identifiés selon les fonctions
qu’ils remplissent : Originals, Animators, Tour leaders et Professionals. La dernière
catégorie suppose quatre composantes : sélectionner l’itinéraire, fournir des
informations correctes et détaillées, interpréter ce que les touristes voient et ce dont ils
font l’expérience, présenter de fausses informations comme si elles étaient vraies
(« fabrication »). L’interprétation des sites en fonction des expériences et des attentes
touristiques constitue donc selon Cohen l’apanage des guides professionnels. Il ne s’agit
pas juste de décrire, mais de parvenir à faire ressentir. Les clés de mise en contexte
décrites plus haut sont un des outils de ce processus. Depuis le travail de Cohen,
quelques articles se sont attachés à redéfinir la question de l’authenticité puis à
reformuler le travail des guides en conséquence. En 1999 Wang invitait à « repenser
l’authenticité » et, se rapprochant de l’authenticité chaude de Selwyn, crée le concept
d’authenticité « existentielle ». L’authenticité, explique-t-il, n’est pas seulement celle
des hommes et des objets visités, mais une « expérience existentielle impliquant des
sentiments personnels ou intersubjectifs activés par le processus liminal de l’activité
touristique » (Wang 1999 : 351). Libérées des contraintes de leur quotidien, les
personnes engagées dans ce processus se retrouvent. En ce sens, l’authenticité
existentielle n’a rien à voir avec le vrai ou le faux des lieux visités ou des personnes
rencontrées. Se sentir soi-même vrai, en harmonie avec le monde, ne dépend pas de la
fiabilité de ce qui nous entoure. Le concept de « faux authentique » de D. Brown (1999)
résume bien cette position. À propos du hall d’exposition du parc de la paix à
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
67
Hiroshima, il écrit : « Bien que le site ait pour centre un faux, il suscite des émotions
profondes et authentiques. » Ici, l’authenticité de l’objet n’est plus en jeu, car « le faux
authentique n’est pas simplement l’objet en lui-même mais la relation entre les
visiteurs et les guides, relation dont l’objet n’est que le médiateur ». Le rôle des guides,
plus que de fournir des explications, consisterait à pousser le touriste vers cette mise
en phase avec le monde. C’est à cette conclusion que parviennent Reisinger et Steiner
(2006 : 495), dont l’article définit les guides comme « éclaireurs de chemin ». Pour ces
auteures en effet, ces derniers ne doivent pas expliquer aux touristes ce que signifie
leur expérience, pas plus que les conseiller sur les réactions qu’ils doivent avoir, mais
encourager l’engagement personnel de ces derniers.
9 Ces différents articles tentant d’éclairer le rôle du guide ont pour point commun
d’atténuer son caractère mystificateur. L’un des premiers et principaux détracteurs de
MacCannell, Urry (1990 : 51), a depuis longtemps considéré que réduire la recherche
des touristes à une quête d’authenticité ressortait d’une théorie simpliste et inadéquate
aux réalités du tourisme contemporain, et a entre autres insisté sur sa part ludique. En
effet, les visiteurs dénommés « post-touristes » se complairaient dans l’inauthenticité
de l’expérience touristique et leur plaisir dépendrait de leur faculté à pénétrer le jeu
(ibid. 1990). Plus nuancée, la même comparaison élaborée par Cohen (1988), dessine le
tourisme comme un jeu qui « s’enracine profondément dans la réalité, mais pour le
succès duquel une grande dose d’imagination, de la part des acteurs comme des
spectateurs, est nécessaire. De leur plein gré, même si c’est souvent de manière
inconsciente, ils participent avec espièglerie à un jeu de “comme si”, prétendant qu’un
produit arrangé est authentique même si tout au fond d’eux-mêmes ils ne sont pas
convaincus de cette authenticité » (ibid. : 383)2. Experts dans ce « faire-semblant », les
guides seraient peut-être les maîtres, voire les créateurs des règles de ce jeu, auquel ils
ont su adapter les logiques occidentales. Là réside sans doute le cœur de leur talent. Dès
lors, si la sociologie et l’anthropologie du tourisme, restées longtemps sous l’emprise de
l’optique muséale et de la théorie du touriste de MacCannell, ont largement privilégié
la question de l’authenticité des objets visités, les guides qui ont une fréquentation de
longue haleine des Blancs ont certainement compris avant les chercheurs que leur
quête était souvent moins tournée vers les objets que vers eux- mêmes. Percevant
l’aversion des touristes pour leur société et pour eux- mêmes, jouant de leur
culpabilité, ils ont créé progressivement une relation entre eux et leur client qui
permettrait à ce dernier d’atteindre son objet sans que le monde qu’il traverse ne soit
celui d’une authenticité artificielle et construite à sa mesure. Pour ce faire il leur a fallu
apprendre de manière progressive et de plus en plus affinée les désirs du monde blanc,
tout comme ils ont dû présenter et expliquer ce monde étranger aux populations
visitées. Ainsi, si une des composantes de la catégorie de guides professionnels
construite par Cohen est la « fabrication », à savoir la présentation d’objets « faux »
comme s’ils étaient vrais, les guides ne sont des fabricants d’inauthenticité que dans
une moindre mesure. Variant les doses d’authenticité « froide » ou « chaude » selon les
clients à qui ils ont affaire, ils en sont les véritables baromètres, tout comme les
metteurs en scène et les créateurs. Dans ce dosage précis en lequel seuls les bons guides
sont experts, il y a bien une part d’authenticité mise en scène au sens où l’entend
MacCannell, c’est-à-dire destinée à satisfaire la soif d’exotisme des touristes. Mais celle-
ci est-elle pour autant factice ? Ce caractère lui est logiquement prêté dans une
perspective positiviste, propre d’une conception occidentale découlant notamment des
activités muséales. Mais si l’authenticité n’est plus considérée comme une propriété
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
68
objective et mesurable des objets, mais comme une construction sociale à laquelle
contribuent des acteurs de tous les niveaux (locaux, nationaux et internationaux),
autrement dit, si on adopte une perspective constructiviste, les frontières entre la
création d’inauthenticité et la création culturelle s’estompent, et le rôle des guides peut
prendre un autre éclairage.
Les guides dans la fabrique de l'authenticité
10 Depuis une quinzaine d’années et encore aujourd’hui, l’idée d’authenticité inonde le
marché touristique malien. Le mot revient dans toutes les brochures des agences, les
guides édités, mais aussi toute forme promotionnelle locale émanant tant du ministère
que d’organismes privés. En même temps, les guides usent et abusent du terme pour
répondre aux attentes de leurs clients dont sont également averties les personnes
croisées par les touristes sur les sentiers aménagés pour eux. Cette même authenticité
semble avoir été dès le départ décisive dans le choix des zones touristiques officielles,
et ce en dehors de tout choix gouvernemental. Ainsi, le directeur général de la SMERT3
expliquait en 1979 (Soundjata, 12 : 29) : « Qu’il s’agisse de Tombouctou ou du pays dogon,
l’origine des courants touristiques vers ces sites est partie non pas d’une volonté
interne d’y promouvoir le tourisme, mais d’une conséquence des écrits des
explorateurs et chercheurs qui ont été très tôt frappés par l’originalité de la culture
malienne à travers ces sites. » L’idée d’authenticité avait effectivement germé dans les
écrits de différents explorateurs, administrateurs ou chercheurs occidentaux. Aux
travaux précurseurs de Delafosse, qualifié par Amselle (2001 : 173) de « père de
l’authenticité malienne », succédaient ceux de Griaule dont le best-seller, Dieu d’eau
(1948), fournissait le socle de l’idée d’une Afrique authentique, formulée par la suite par
les esprits les plus imaginatifs. L’authenticité froide gagnait donc du terrain dans les
publications auxquelles répondaient les circuits mis en place par la SMERT3
(Tombouctou, Pays dogon-Djenne-Mopti, combinaison des deux). Mais si une quête
d’authenticité déterminait ces destinations, on peut s’étonner que dans le dossier de
trente pages que la revue culturelle Soundjata éditait en 1979 afin de faire le point sur
l’activité touristique au Mali, on ne trouve qu’une seule fois le terme (Soundjata, 12 : 27).
Tout au long du dossier, le tourisme est qualifié de culturel, d’humain, et le touriste en
quête d’« empathie humaine ». Ne peut-on penser que si les activités touristiques ne
constituaient qu’une réponse à la soif d’authenticité des visiteurs, le terme apparaîtrait
dans les propos des nombreux fonctionnaires interrogés (directeur de la SMERT,
commissaire du tourisme, cadres de Douentza, Mopti, Gao, etc.) ? Est-ce à dire qu’au
Mali l’idée d’authenticité n’émanerait pas de la sphère touristique ?
11 En réalité, les archives de la politique culturelle du Mali sous les régimes du premier
président Modibo Keita et de son successeur Moussa Traore laissent transparaître
l’évolution de la notion, de plus en plus prégnante dans les discours officiels. Ces
derniers concernent particulièrement les ouvertures des biennales culturelles,
manifestations nées après l’indépendance du pays et poursuivies pendant trente ans,
qui mettaient en compétitions sportives et artistiques les régions administratives du
pays. De 1962 à 1988, la biennale occupait une place de choix dans les programmes de
politique culturelle des deux gouvernements. Nées d’un besoin d’unité et de
stabilisation du pays en voie d’adoption de valeurs socialistes peu compatibles avec
l’organisation sociopolitique traditionnelle, ces manifestations jetaient les fondations
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
69
de la culture nationale. Pour ce faire elles mettaient en avant la fraternité, la solidarité
et l’égalité des cultures maliennes : la reconnaissance et le respect des spécificités
culturelles, qui ne devaient en aucun cas être hiérarchisées, constituaient un principe
mis en œuvre dans l’organisation pendant la biennale du jatiguiya, où chaque quartier
devait accueillir dans des conditions optimales les membres d’une des délégations
régionales.
12 La biennale, annonçait le discours d’ouverture, devait faire connaître l’« humanisme »
malien. L’humanité et l’hospitalité des cultures maliennes, présentées comme égales,
solidaires et formant une unité faisant la richesse du pays ne sont pas sans rappeler
l’« authenticité chaude » recherchée par les touristes : on prête aux cultures harmonie
et fraternité, sans évincer leur richesse historique. En même temps, si l’idée
d’authenticité n’est pendant longtemps pas explicitée dans les discours d’ouverture de
la biennale, elle y apparaît dans les années 1980, à travers la voix d’Alpha Oumar
Konare, futur président du pays démocratisé et de N’T. I. Mariko, alors ministre de la
Jeunesse4. Mais ce qui est intéressant est de voir comment cette explicitation
s’accompagne d’un glissement de sens. La thèse que Y. Toure (1996) consacra à la
biennale explicite ainsi la « folklorisation » des cultures maliennes à laquelle ont
largement contribué les biennales. « Une composition pour le jury bamakois est réussie
lorsqu’elle est tirée du patrimoine local et qu’elle est représentée de façon
authentique », écrit-il (ibid. : 285). Et il montre comment des titres anciens dénomment
les œuvres contemporaines, comment des danses traditionnelles sont imaginées, ou
encore rapporte l’anecdote de la « supercherie » d’un directeur régional présentant des
costumes et des armes tachées de sang attribuées à un roi bambara du XVIIIe siècle. On
passe donc, au sein de cette grandiose manifestation nationale, de la conception
implicite d’une authenticité « chaude » à l’explicitation d’une idée d’authenticité
« froide » et à sa concrétisation par la mise en scène. Or dans ces mêmes années, la
promotion touristique ne s’est pas encore emparée du terme, et les mêmes notions
d’humanité, de solidarité ou d’hospitalité y prédominent. C’est dire que la notion fut
d’abord lancée comme ciment d’une culture construite par et pour l’État avant d’être
utilisée, voire reconvertie, dans le monde touristique en suivant un cheminement
similaire. Légèrement décalés, ces parcours dans les sphères politiques et touristiques
devaient se rejoindre quelques années plus tard dans la fusion des ministères de la
Culture et du Tourisme, présidée par Aminata Traore. Sous son mandat, la promotion
gouvernementale du tourisme a clairement pris appui sur le maaya (l’humanisme) et le
jatiguiya (l’hospitalité). Elle a entre autres organisé trois consultations nationales,
dénommées « Toguna » », au cours desquelles devait être définie la stratégie
d’intervention de l’administration dans le domaine de la culture et du tourisme. Il
s’agissait, pour la ministre, de promouvoir une approche du tourisme culturel qui
participerait au développement humain durable. « Le développement humain et social
durable du Mali » se ferait « à travers une réinterprétation de la gestion économique et
de la démocratie à la lumière de valeurs traditionnelles de société qui restent à
découvrir et à partager » (Ministère de la Culture 1997 : 50), « le retour à l’humain »
constituant la valeur ultime. Cette valeur préexistait en fait au mandat d’Aminata
Traore, comme l’illustre cet extrait du dossier « tourisme » de la revue Soundjata (1979,
10 : 37) : « Si nous voulions caractériser le tourisme au Mali, nous dirions qu’il est
essentiellement humain. Ici, pas de grandes plages au bord de la mer, pas de safaris aux
grands fauves. Mais le dépaysement, la richesse culturelle, les styles architecturaux et
le pittoresque des rassemblements humains. Enfin, tout y gravite autour de l’humain. »
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
70
La présentation de la clientèle va également dans ce sens : « Ceux-là pour qui des
vacances ne veut pas dire passivité physique et intellectuelle, mais participation et
empathie avec le peuple et la civilisation visitée. » Cette insistance sur l’humain devait
plus tard rejoindre les préoccupations d’A. O. Konare qui dirigea le pays durant une
décennie (19922002), et su insuffler dans divers programmes son penchant pour les
sciences humaines et encourager les actions visant à promouvoir les valeurs culturelles.
Le maaya et le jatigya fondèrent donc l’assise des politiques non seulement touristiques,
mais culturelles, et lorsque le Mali fut chargé en 2002 d’organiser la Coupe africaine des
Nations (CAN), elles furent largement mises en avant, le jatigya des biennales étant
reproduit à Bamako où chaque quartier se devait d’accueillir dans les conditions
optimales l’équipe et les supporters d’un des pays en compétition. Même si les
commerçants déplorèrent quelque peu cette hospitalité contrainte, les deux valeurs
promues lors de la CAN gagnèrent du terrain et les caractères humaniste et hospitalier
des Maliens font aujourd’hui partie du sens commun. Cette adhésion procède
certainement d’un nationalisme prégnant depuis les années 1960. Pourtant, si les
biennales artistiques et culturelles en ont accompagné la formation entre 1962 et 1988,
leur reprise en 2003 s’est traduite par un échec cuisant. Reflet et moteur d’une culture
nationale aujourd’hui désuète, elles sont boudées par les Maliens, qui leur préfèrent les
festivals culturels dont la prolifération a accompagné les processus de démocratisation
et de décentralisation du pays. Alliant des visions locales, nationales et internationales,
ces nouvelles manifestations « prennent » grâce à cette plurivocalité constitutive des
identités maliennes contemporaines (Doquet 2008). Les festivals ont en effet la
particularité de gagner l’enthousiasme du public malien, tandis que leurs subventions
visent l’essor du tourisme culturel. Cette destinée ne les empêche cependant pas de
figurer sur la carte culturelle du Mali établie par la Direction nationale des Arts et de la
Culture — dont la tâche est de « promouvoir une culture vivante et authentique ».
Entre politiques touristique et culturelle (qui aujourd’hui dépendent de ministères
distincts), les frontières sont ténues, tout comme dans les activités qu’elles mettent en
œuvre. Et l’on y retrouve aujourd’hui le même processus de glissement d’une
« authenticité chaude » non explicitée, mais contenue dans la mise en exergue du
couple maaya-jatigya à une « authenticité froide » exprimée, le terme couvrant la
promotion de tous ces événements. Les festivals relèvent en effet d’entreprises
dialogiques où l’authenticité culturelle d’aujourd’hui se construit dans le croisement de
visions endogènes et exogènes de la tradition. Les partenaires internationaux
contribuent à leur mise en scène, tout autant que les ministères et les « entrepreneurs
culturels » locaux, et l’authenticité des cultures maliennes est clairement affichée dans
leur promotion. Or, dans cette construction plurielle, les guides peuvent jouer un rôle
de premier plan.
13 Leur double connaissance des logiques organisationnelles occidentales et des réalités
de terrain en font les partenaires les plus efficaces des bailleurs occidentaux. Par leurs
va-et-vient permanents entre les deux mondes et les traductions qu’ils induisent, ils
constituent les personnes privilégiées pour faciliter les interactions et les actions
entreprises. Ce rôle n’est pas sans rappeler celui des « courtiers en développement »
étudiés par ailleurs. La décentralisation a entraîné une « prolifération d’acteurs et
d’organisations intermédiaires » (Bierschenk et al. 2000 : 11), et les guides se sont
logiquement intégrés dans la fabrication et l’organisation des nouvelles manifestations
culturelles. Si certains d’entre eux ont intégré les conseils municipaux de leur
commune, la majorité se sont investis dans des ONG aux objectifs variés. Les
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
71
recompositions et les reformulations engendrées à tous les niveaux par la réforme de la
décentralisation ont fait émerger de nouveaux besoins. En parallèle, les clients des
guides, aux fonctions et compétences variées, éprouvent souvent durant leur voyage le
désir d’aider ou de construire. Souvent déjà intégrés dans divers réseaux locaux ou
internationaux, ils ont trouvé l’occasion de contribuer activement à la prise en charge
inédite des traditions induites par les réformes politico-administratives. Le rôle du
guide peut ici s’apparenter à celui du courtier de développement dont il partage les
compétences « rhétoriques, organisationnelles, scénographiques et relationnelles »
(ibid. : 23, 26, 27). La similitude ne s’arrête pas là. Le courtier, médiateur actif entre deux
unités sociales, en tire un bénéfice (ibid. : 16) et les guides agissent aussi dans ce sens :
même les plus généreux d’entre eux n’ont aucune vocation altruiste. Mais le caractère
profiteur ne suffit pas à définir un courtier : « On peut même penser que la sincérité,
d’autres diraient la foi développementaliste [...] est une qualité importante du courtier,
qui doit croire en la cause qu’il plaide : ce rôle s’accommoderait sans doute mal d’une
perversité désabusée » (ibid. : 24-25). Or les guides sont animés d’une même sincérité et
l’attachement à leur culture est souvent bien plus profond qu’il ne paraît. C’est dans cet
esprit qu’ils s’investissent dans le renouveau culturel et pas seulement dans de simples
mises en scènes folkloriques. Si elle leur profite, leur implication dans divers réseaux
(mairie, associations, ONG...) amène certains d’entre eux à intégrer les nouvelles élites
qui côtoient les tenants du pouvoir traditionnel dans les reconstructions politiques et
sociales en cours. Et il est à noter que si l’illettrisme frappe une grande partie des
guides, ils sont de plus en plus nombreux à entreprendre des descriptions de leur
culture par des essais d’ethnographie autodidactes, dont quelques-uns parviennent à la
publication. Ainsi, si l’authenticité est devenue le maître mot de la promotion du Mali
et si on la considère dans son aspect « froid » comme une construction intellectuelle
dont le parcours s’étend de nos musées aux mises en scènes in situ et impliquant bon
nombre d’agents locaux, nationaux et internationaux, on peut incontestablement
compter les guides au nombre de ces agents.
14 Par ailleurs, si les frontières entre politiques culturelle et touristique présentent une
convergence elle-même poursuivie dans des manifestations comme les festivals
culturels, faut-il vraiment considérer les mises en scènes de l’authenticité comme
artificielles et les dissocier du processus permanent de reconstruction culturelle ?
Hobsbawn et Ranger (2006) ont depuis longtemps montré comment les sociétés
traditionnelles ont toujours réinterprété ou « inventé » des traditions pour légitimer
leur identité ou leur autorité politique. Les manipulations de traditions évolutives
affichées comme immuables constituent un des ressorts de toute culture. N’en va-t-il
pas de même pour l’authenticité ? Dès lors qu’on adopte une perspective
constructiviste et qu’on ne la considère plus comme une qualité intrinsèque de ces
objets, mais comme un outil de légitimation, son invention ne diffère pas vraiment de
celle des traditions. Pour cette raison, les frontières entre tourisme et culture sont
délicates à établir et les guides, agents essentiels de l’activité touristique, sont aussi des
acteurs de la reconstruction culturelle.
15 Parce que l’idée d’authenticité émane avant tout des politiques culturelles du pays, elle
ne peut être envisagée comme un simple produit élaboré pour nourrir les espoirs des
visiteurs. Sa réactivation depuis un quart de siècle traduit les recompositions d’un pays
engagé dans un double processus de démocratisation et de décentralisation, mais aussi
dans des logiques mondialisées au sein desquelles les cultures maliennes se livrent à
des branchements internationaux (Amselle 2001) et dont le tourisme n’est qu’un
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
72
élément. Les remaniements consécutifs à cette modernité malienne sont nombreux et
divers. Dans ce vaste mouvement, l’authenticité resurgit pour se loger autant dans les
dynamiques identitaires et culturelles que dans la promotion touristique du pays.
Jonglant avec les spécificités locales et l’internationalité de leurs clients, les guides
s’inscrivent dans ce processus avec une aisance que leur vaut leur longue fréquentation
de touristes aux origines diverses. N. Salazar (2005) a ainsi montré comment cette
position en fait des acteurs privilégiés pour l’étude de ce qu’il est convenu d’appeler la
« glocalisa- tion ». Naviguant dans le local comme dans l’international, les guides
contribuent à la construction et à la reconstruction d’une authenticité reflétant les
réalités contemporaines du pays. Cet investissement minimise ce qui est souvent vu
comme une tromperie, à savoir le talent des guides pour falsifier les réalités en les
transformant au goût des touristes. Et à regarder de plus près les relations entre les
guides et leurs clients, la même relativité s’impose dans l’analyse de l’authenticité
« chaude ».
Frères et sujets
16 La reprise du titre de l’ouvrage de J.-P. Dozon (2003), lui-même emprunté à
l’impérialisme d’Hannah Arendt (2006), vient pour finir démythifier le tableau quelque
peu idyllique des relations décrites plus haut et que beaucoup de touristes aux
expériences malheureuses pourraient considérer comme de la pure spéculation
anthropologique. En effet, le rôle du guide comme éclaireur de chemin gagnant la
sympathie et la confiance de ses clients pour les aider à atteindre l’esprit fraternel et
solidaire dont ils sont en quête, ne recouvre en rien la complexité des rapports qui se
jouent entre eux et leurs clients. Oscillantes et ambivalentes, ces relations ne sont pas
sans rappeler leur réciproque. En mettant en perspective les relations franco-
africaines du XVIIe siècle à aujourd’hui, J.-P. Dozon a éclairé les contradictions du
traitement des colonisés par la France, et en particulier le paradoxe consistant à les
traiter à la fois comme frères et comme sujets. Les « doses de fraternité » instillées dans
l’assujettissement des colonisés (ibid. : 341) s’inscrivent dans un grandissant « besoin
d’Afrique » ne pouvant être réduit à des motivations d’ordre matériel. Inversement à
leur périodisation officielle, les relations franco-africaines sont passées « d’une période
de relative dissociation à des phases de rapprochement de plus en plus organique »
(ibid.). Cette proximité croissante explique que se soit en parallèle graduellement
installé un « désir de France ». Aussi, si l’ambivalence a toujours guidé les rapports de
la France à ses colonies, elle a en même temps nourri le rapport des colonisés à la
France et la décolonisation n’a en rien empêché l’imprégnation durable des liens ainsi
créés. Par un effet de miroir, le traitement paradoxal des colonisés par les colons se
reproduit dans celui des excolons par les ex-colonisés.
17 La relation des Maliens à l’ancienne puissance coloniale oscille toujours entre
admiration et haine, entre rejet et assimilation, et sur place, les relations franco-
maliennes en pâtissent. Loin de se détecter au premier coup d’œil, cette fluctuation
d’attitudes et de sentiments devient souvent perceptible lorsque les situations
relationnelles se font délicates. Parce qu’ils aspirent peut-être plus que d’autres à
entrer en contact avec les populations, les touristes y sont particulièrement exposés. Et
parce que la position d’intermédiaire du guide lui confère un rôle décisif dans toutes les
rencontres touristiques, la dégradation de la relation touriste-guide fait rapidement
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
73
tourner le voyage au cauchemar. Car si « l’enfer, c’est les autres », l’enfer du touriste, ce
peut être simplement l’Autre, incarné dans l’unique personne du guide.
18 D’une certaine façon, la rencontre touristique est bien héritière de situations de
violence et de domination coloniales, dont les attitudes condescendantes ou agressives
de certains visiteurs portent parfois les marques. Au cœur de ces interactions, les
guides n’entendent nullement laisser ces situations se reproduire et la moindre
arrogance envers eux peut déclencher une violence, qui, pour symbolique qu’elle soit,
n’en est pas moins inattendue. Le client réfractaire à leurs initiatives et à leurs
injonctions risque alors d’être rapidement mis en difficulté, l’entourage local faisant
cause commune avec ses compatriotes. Comme ils jouent par ailleurs souvent avec la
culpabilité supposée des visiteurs, les guides mettent le doigt sur une corde sensible qui
peut susciter une violente irritation. Tapie sous la convivialité, l’agressivité est prête à
surgir et les altercations ne sont pas rares. Cette ambivalence relationnelle est sous-
tendue par une ambivalence globale vis- à-vis du monde blanc. Les guides adhèrent
dans une certaine mesure au mode de vie occidental dont ils adoptent des éléments, pas
sur le plan matériel uniquement. L’éducation qu’ils offrent à leurs propres enfants et ce
à différents niveaux (scolarité, santé...) illustre par exemple cette adaptation.
L’Occident, et plus particulièrement la France, constitue un important repère de leur
identité. Mais ils peuvent en même temps éprouver de la répugnance pour ce pays dont
ils sont si proches et pourtant si lointains, surtout pour ceux qui n’ont jamais trouvé le
moyen de s’y rendre. Jalousés par les populations envieuses de leurs biens et
désapprouvant leur conduite déviante, infériorisés par une administration qui n’a
jamais reconnu leurs talents, méprisés par la population blanche résidente qui les fuit,
ils vivent une marginalité parfois difficile à assumer. Aussi n’est-il pas rare d’entendre
de leur bouche que tout ceci est la faute des Blancs qui les ont « contaminés ». La
métaphore récurrente de la contamination est révélatrice du mépris parfois éprouvé.
Mais en même temps les guides, généralement partis de rien et ayant pour la plupart
vécu une enfance difficile, se sont construits dans des interactions avec les étrangers
qui donnent lieu à des amitiés sincères et durables. Propices à cette sincérité, les
rapports qu’ils entretiennent avec leurs clients sont aussi faits de curiosité, de partage
et cette complicité est rendue possible par les valeurs communes qui les animent. Alors,
aux imputations de contamination font place des sentiments de proximité et
d’adhésion à des valeurs opposées à celles des sociétés maliennes. Alors ils se mettent à
part des maux dont tous les Maliens s’accusent, et cela n’est rendu possible que par leur
assimilation aux Occidentaux : les Maliens sont hypocrites, menteurs ou malveillants,
les Blancs (et donc eux-mêmes) sont sincères, francs et généreux. Ces oscillations
récurrentes sont particulièrement criantes lorsque la relation du guide à ses clients, et
en l’occurrence à ses clientes, se fait plus intime. Énoncée par Fanon, la thèse de la
revanche par voie sexuelle peut s’appliquer à eux. Ainsi C. Cauvin Verner (2007 : 248)5
écrit-elle à leur propos au Sud du Maroc : « Les anciens nomades ne sont plus dissidents
et ne dressent plus armes ou chapelets devant les Français mais, en séduisant, en
s’enivrant, d’une manière générale en provoquant, les jeunes générations continuent la
guerre par d’autres moyens. » La métaphore guerrière de l’entreprise de séduction des
guides n’est pas forcément abusive, comme le prouvent nombre de couples au destin
très sombre. Néanmoins, des conversations privées avec certains guides ne mettant pas
en jeu l’étalage de leurs exploits sexuels, laissent transparaître leur heureux
étonnement à s’être laissés prendre dans des complicités de couple auxquels les
rapports de genre habituels ne les avaient pas préparés.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
74
19 Si l’ambivalence donc, traverse globalement le rapport des guides au monde blanc, elle
imprègne plus précisément leur relation aux touristes. Et au double traitement comme
frères et comme sujets autrefois infligé aux colonisés fait écho celui qui est aujourd’hui
réservé à leurs clients. Les premières décennies du tourisme malien éclairent la part de
fraternité contenue dans la relation. Le bilan établi en 1979 dans la revue Soundjata
évoque les « ratés insignes » de la politique malienne en matière de tourisme entre
1968 et 1979 (Sounjdata, 10 : 35) et donne en exemple « le déferlement de “touristes-
hyppies” sur le Mali avec toutes les multiples conséquences que cela pouvait sous-
entendre “trafic divers, drogue, comportements sociaux de marginaux, etc.” ». Un
cadre de Douentza renchérit : « Et puis, le comble est que ce peu d’argent qu’ils
dépensent chez nous, c’est au Mali qu’ils le prennent. Une grande partie de ces
touristes sont des trafiquants. Ils font du trafic de voitures, de motos à grosses
cylindrées, de whisky, etc. entre le Mali, l’Europe et nos pays Africains voisins » (ibid. :
36). Ce profil du touriste est précieux car la prise en charge des activités touristiques
par l’État, instituant des « tours » balisés et impersonnels, dans lesquels l’esprit
convivial devait avoir du mal à percer (séjours chronométrés, arrêt obligatoire aux
postes administratifs pour la délivrance de diverses autorisations...), n’engageait en
réalité qu’une faible part de la clientèle : « Certains spécialistes pensent que sur les
25 000 touristes visitant annuellement le Mali, seuls 5 000 environ passent par la SMERT.
Tout le reste fait du tourisme individuel plus ou moins sauvage » (ibid., 11 : 38). Cette
distinction est éclairante pour comprendre quels types de liens ont pu se nouer entre
les guides et leurs clients. En effet, une large part des accompagnateurs autodidactes de
ces années relevait d’un monde social difficile, et nombre d’entre eux étaient
quasiment livrés à eux-mêmes. Cette autonomie juvénile induisait des pratiques
illicites, comme des petits trafics, et des activités transgressives. Or, la fréquentation
des Blancs deux décennies seulement après la décolonisation n’était pas forcément
regardée d’un bon œil. D’autres, issus de « bonne famille », attirés par le monde
occidental, expliquent quelles réprimandes leur ont values cette curiosité : battus,
attachés pour certains d’entre eux, ils ne se livraient à leur activité que dans la
clandestinité. Il y a un quart de siècle, leur métier contenait donc une part de
transgression que présentait en même temps la pratique du tourisme sauvage,
officiellement interdite par l’État. Des pratiques déviantes communes liaient donc les
guides et les touristes, instaurant sans doute entre eux une certaine connivence. Aussi
leur échange revêtait-il une dimension égalitaire, dans laquelle les clients étaient
quasiment des pairs. C’est dans ce partage que s’est construite la relation guide-
touriste, et elle perdure même si le profil des visiteurs a changé.
20 Néanmoins, le partage et la complicité alternent avec des attitudes injonctives dans
lesquelles le Blanc se réduit à un sujet devant suivre sans résistance le parcours qui lui
est imposé. Les guides s’expliquent de ce comportement délibéré par le fait qu’ils sont
responsables aux yeux des populations et du gouvernement des actes de leurs clients,
qui doivent en conséquence se plier à leur autorité. La dénomination des visiteurs qu’ils
adoptent entre eux et dans la langue locale traduit par ailleurs cet assujettissement : ce
sont les Blancs de X ou les Blancs de Y. Si comme l’écrit Mbembe (2000 : 217), les
colonisés ont été réduits à néant et placés dans un « hors-monde », un même rejet de la
réalité frappe parfois les touristes, avec bien entendu un degré de violence
incomparablement moindre. Les visiteurs sont alors baladés — comme, pour poursuivre
les métaphores de Mbembe, on promènerait un animal — dans des circuits sur lesquels
il n’ont pas mot à dire et dans des relations qu’ils ne choisissent pas. Plus aucune
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
75
attention n’est alors portée à leurs désirs, leurs questionnements, leurs sensations, bref
à leur singularité.
21 Et ce déni de la qualité de sujet se retrouve, de façon plus discrète, dans les relations
furtives et médiatisées des touristes à la population. Le touriste est tout d’abord
naturellement positionné dans un hors-monde linguistique, et des commentaires
moqueurs et provocateurs entourent souvent celui qui ne peut les entendre. Les rires et
les regards complices qui les accompagnent ne font qu’écarter le visiteur avide de
proximité. Mais l’indice le plus probant de ce rejet reste l’indifférence marquée à son
égard. Là où l’étranger cherche à nouer le contact, il se heurte souvent à un mur
constitué non d’insultes ou de protestations, mais d’une simple ignorance de son être.
Là encore, il serait abusif de réduire l’ensemble des relations à ce rejet. Nourrie de
sentiments envieux envers des êtres dont les moyens et la mobilité ne semblent pas
connaître de limites, la rencontre touristique suscite aussi admiration et curiosité
bienveillante. Malgré son caractère furtif, elle autorise des moments partagés où
quelques gestes ou sourires suffisent à esquisser un lien, aussi éphémère soit-il. Les
visités déplorent ainsi la difficulté de rencontrer les visiteurs accaparés par leurs
guides. Et dans les rares moments de rencontre offerts aux deux parties,
l’enchantement peut fonctionner à merveille et dans les deux sens.
22 Peut-être révélatrice des relations franco-maliennes dans leur ensemble, l’ambivalence
se fait criante dans le comportement qu’adoptent les guides à l’égard de leurs clients.
Présente à différents niveaux relationnels, elle paraît fort éloignée du désir de partage
fraternel qui compose l’authenticité « chaude », où tout est harmonie et solidarité. Mais
si les guides insupportent autant bon nombre d’étrangers, et particulièrement les
résidents, n’est-ce pas parce que dans un sens, ils expriment directement et
franchement toute l’ambivalence des relations franco-africaines dans lesquelles la
solidarité et la fraternité flirtent avec les asymétries et le racisme ? En ce sens, si l’on
sort de l’utopie de relations sociales solidaires et harmonieuses, le caractère ambivalent
de la relation guide-touriste, parce qu’il reflète en l’inversant le traitement des
colonisés et comme frères et comme sujets, n’est-il pas le plus authentique qui soit ?
*
23 « Authenticité » est devenu un mot-clé de l’anthropologie et de la sociologie du
tourisme depuis MacCannell. Cependant la notion se décline dans diverses pratiques et
acceptions qui obscurcissent ses contours. Sa version touristique présente elle-même
une double nature, « chaude » ou « froide », qui nécessite chez les guides la
connaissance des lieux et des hommes vers lesquels ils mènent leurs clients, mais aussi,
et peut-être surtout, celle des désirs et aspirations de ces derniers. Quelle que soit sa
température, l’authenticité recherchée relève d’un fantasme qui ne peut être nourri
sans une déformation, une falsification et une mythification de la réalité. Ce décalage
entre la quête touristique et le monde réel peut faire du guide un marchand d’illusions.
Pourtant, si on creuse les différentes acceptions de la notion, on s’aperçoit que tout en
abreuvant celle de l’imaginaire occidental, les guides induisent les visiteurs vers
d’autres versions où l’authenticité ne répond plus à la conception passéiste d’un idéal
socioculturel de pureté et de solidarité, mais à des réalités sociales et culturelles du
Mali d’aujourd’hui. Cette contemporanéité est en premier lieu due à ses usages
politiques locaux. Mobilisée dès l’indépendance par les programmes et les
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
76
manifestations culturelles du gouvernement, elle intégra par la suite le domaine
touristique pour se traduire dans des pratiques fusionnelles, à l’instar des festivals dont
on ne sait plus trop s’ils sont destinés aux touristes ou aux populations locales. Cette
construction dans le politique explique sa résurgence au moment où le pays
entreprenait d’importantes réformes et où cette revitalisation occasionnait de
nouvelles mises en scène des traditions dont les guides, maîtrisant les réalités locales,
traversant de multiples réseaux, rejoignant parfois les élites, sont souvent devenus
d’importants agents. Par leur implication dans le renouveau culturel, ils permettent
aux étrangers d’aborder l’authenticité dans une optique plus réaliste. Enfin, la relation
complexe qu’ils entretiennent avec eux porte les traces d’un passé colonial dont la
lente digestion reproduit certaines attitudes en les inversant. La rencontre touristique
porte en elle une ambivalence convoquant ces douloureux moments de l’histoire. Si
elles déçoivent certainement leurs espoirs, ces relations oscillantes ramènent les
visiteurs à des réalités historiques, sociales, politiques et culturelles en leur offrant
l’occasion de s’extraire de leur condition d’« idiots du voyage ». Pour ce faire, les
mouvements d’un guidon ou les sons d’une guitare ne suffisent pas. Seuls les guides
nourriront leur quête sans les enfermer dans un monde fictif construit à leur image,
mais en éclairant d’autres voies d’accès vers les réalités d’un Mali certes
« authentique », mais contemporain.
BIBLIOGRAPHIE
AMSELLE, J.-L.
2001 Branchements. Anthropologie de l’universalité des cultures, Paris, Flammarion (« Champs »).
AP, J. & WONG, K.
2001 « Case Study on Tour Guilding: Professionalism, Issues and Problems », Tourism Management,
22: 551-563.
ARENDT, H.
2006 L’Impérialisme, Paris, Éditions du Seuil.
BIERSCHENK, T., CHAUVEAU, J.-P. & OLIVIER DE SARDAN, J.-P.
2000 Courtiers en développement. Les villages africains en quête de projets, Paris, Karthala.
BROWN, D.
1999 « Des faux authentiques », Terrain, 33 : 41-56.
CAUVIN VERNER, C.
2007 Au désert. Une anthropologie du tourisme dans le Sud marocain, Paris, L’Harmattan.
COHEN, E.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
77
1985 « The Tourist Guide: The Origin, Structure and Dynamics of a Role », Annals of Tourism
Research, 12: 5-29.
1988 « Authenticity and Commoditization in Tourism », Annals of Tourism Research, 15: 371-386.
2001 Thaï Tourism. Hill Tribes, Islands and Open-ended Prostitution, Bangkok, white Lotus.
DOQUET, A.
2008 « Festivals touristiques et expressions identitaires au Mali », Africultures, 73 : 60-67.
DOZON, J.-P.
2003 Frères et sujets. La France et l’Afrique en perspective, Paris, Flammarion.
GRIAULE, M.
1948 Dieu d’eau, Paris, Fayard.
HOBSBAWN, J. & RANGER, T.
2006 L’invention de la tradition, Paris, Éditions Amsterdam.
MACCANNELL, D.
1976 The Tourist. A New Theory of the Leisure Class, New York, Schocken Books.
MBEMBE, A.
2000 De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, Paris, Karthala.
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME AU MALI
1997 Maaya. La culture et le tourisme au service du développement social et humain durable, Bamako.
NASH, D.
1981 « Tourism as an Anthropological Subject », Current Anthropology, 22: 461-481.
REISINGER, Y. & STEINER, C.
2006 « Reconceptualising Interpretation: the Role of Tour Guides in Authentic Tourism », Current
Issues in Tourism, 6: 481-498.
SALAZAR, N. B.
2005 « Tourism and Glocalisation. “Local” Tour Guiding », Annals of Tourism Research, 32: 628-646.
SELWYN, T.
1996 The Tourist Image. Myths and Myth Making in Tourism, Chichester, John Wiley & Sons Ltd.
Soundjata
1979 nos 10, 11 et 12, Dossier : « Le tourisme malien en question ».
TOURE, Y.
1996 La Biennale artistique et culturelle du Mali (1962-1988). Socio-anthropologie d’une action de politique
africaine, Thèse de doctorat, Marseille, EHESS.
URBAIN, J.-D.
1991 L’idiot du voyage. Histoires de touristes, Paris, Plon.
URRY, J.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
78
1990 The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies, Londres, Sage Publications.
WANG, N.
1999 « Rethinking Authenticity in Tourism Experience », Annals of Tourism Research, 26: 349-370.
WINKIN, Y.
2001 « Le touriste et son double », in Y. WINKIN, Anthropologie de la communication. De la théorie au
terrain, Paris, Éditions du Seuil (« Points essais ») : 205-224.
NOTES
1. Moussa était un des guides les plus fins et les plus créatifs que j’ai eu la chance de rencontrer.
Ce texte veut lui rendre hommage.
2. Traduit in BROWN (1999 : 49).
3. Société malienne d’Exploitation des Ressources touristiques, société anonyme d’économie
mixte créée en 1975 dont les actionnaires principaux étaient les sociétés d’État.
4. Les discours d’ouverture des biennales sont reproduits en annexes dans la thèse de Y. TOURE
(1996).
5. Voir également CAUVIN VERNER (dans ce numéro).
RÉSUMÉS
Au Mali, pays toujours perçu et vendu comme une terre d'authenticité où prévaut le tourisme
culturel, l'esprit de rencontre et de partage avec les populations, le touriste de MacCannell prend
tout son sens. Mais la rencontre escomptée est-elle possible ? Pour différentes raisons (pas
uniquement linguistiques), elle est médiatisée par des acteurs très peu analysés dans la
littérature sur le tourisme. Cet article tente d'éclairer les liens entre les guides touristiques et la
quête d'authenticité de leurs clients. La question de l'authenticité est d'abord questionnée dans
sa double nature, que Selwyn qualifie de « froide » et « chaude ». Les stratégies des guides pour
nourrir cette double quête sont analysées, en même temps qu'est relativisé le caractère trompeur
de leur activité. Si les guides parviennent à instaurer avec leurs clients une relation fraternelle
transférable à l'ensemble des villageois, leur talent réside plus dans la connaissance et
l'adéquation des réponses aux désirs touristiques que dans des mises en scène factices et
artificielles. La question de l'authenticité est alors reconsidérée sur le terrain malien.
Préexistante au tourisme, l'émergence de la notion dans les politiques culturelles du pays
inaugurait la convergence des politiques culturelles et touristiques, et celle de leurs
manifestations. Cette fusion met en question l'idée de simples mises en scène nourrissant les
désirs étrangers au profit du dynamisme culturel. Tels des courtiers en développement, les
guides peuvent devenir des acteurs sociaux et culturels du Mali contemporain, rejoignant une
élite politico- intellectuelle active dans la reconstruction contemporaine des identités. Enfin,
l'article se penche sur la nature des relations entre les guides et leurs clients, fortement
marquées par l'ambivalence. Le traitement paradoxal des colonisés par les colons semble
aujourd'hui se reproduire dans celui des ex-colons par les ex-colonisés. Héritière de situations
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
79
antérieures de violence et de domination coloniales, la rencontre touristique porte en elle ce
paradoxe et s'avère pour cette raison plus authentique qu'elle ne paraît.
In Mali, a country almost perceived and praised by its promoters as an authentic land where
tourism is predominantly cultural and travelers are willing to meet local people and interact
with them, what MacCannell wrote about the tourist gets its whole significance. But can the
travelers really live such an experience? For several reasons (not always linked to language), it
needs intermediaries scarcely studied by tourism specialists. In this paper I aim to throw light
upon how the touristic guides deal with their customers' search of authenticity. Firstly I shall call
to mind the dual nature of authenticity, which Selwyn calls "cool" or "hot". While examining
how the guides manage to respond to that double search, I shall seek to show their behavior is
not as insincere as it seems. If they succeed in setting in with their customers a brotherhood than
can be extended to all the villagers, it is rather by their knowledge and their cleverness to adapt
to the tourists' purpose than by presenting arranged scenarios. Then I intend to regard
authenticity from a Malian point of view. Previous to tourism, the emergency of that concept
incited the cultural and touristic ministries to join into the same designs and the same events.
Such a merger calls into question the idea of a counterfeit authenticity merely staged to feed the
foreigners' desires while increasing cultural dynamism. Just as development brokers, the guides
may become social and cultural agents of modern Mali, contributing with a politico-intellectual
active elite to the current attempts to reconstruct identities. I shall examine the relationships
existing between the guides and their customers, which are deeply ambiguous. The
discriminatory treatment of colonized people by colonists seems nowadays to be reproduced in
the one of the ex-colonists by the ex-colonized. As the heir of violent and oppressive colonial
circumstances, that paradox interferes in the touristic contacts, thus revealed more authentic
that they seem to be.
INDEX
Mots-clés : Mali, authenticité, dynamisme culturel, guides, politiques culturelles, tourisme
Keywords : Mali, authenticity, cultural dynamism, guides, cultural policies, tourism
AUTEUR
ANNE DOQUET
IRD, Bondy ; Centre d’études africaines, EHESS, Paris.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
80
Culture nomade versus culturesavante. Naissance et vicissitudesd’un tourisme de désert en AdrarmauritanienNomad culture versus Erudite Culture. Birth and Vicissitudes of the Desert
Tourism in the Adrar Region of Mauritania
Sébastien Boulay
1 Profitant des difficultés d’autres destinations sahariennes comme l’Algérie, le Mali ou le
Niger, le tourisme organisé prend son essor en Mauritanie à partir de 1996, grâce à
l’ouverture d’une ligne aérienne entre Paris, Marseille et la ville d’Atar, chef-lieu de la
région de l’Adrar1. Les voyages proposés sont présentés comme relevant à la fois de la
catégorie du « tourisme d’aventure », proposant des séjours d’une semaine de
« randonnée chamelière » ou de 4x4 dans le désert, et de celle du « tourisme culturel »,
ciblant la découverte de la culture locale et la visite de sites historiques. Jusqu’en 2007,
le volume des touristes français se rendant en Adrar par ligne aérienne directe reste
limité à environ 10 000 personnes par an. Le « marché » est disputé par une quinzaine
de voyagistes, français pour la plupart, représentés sur place par des agences
mauritaniennes qui assurent la réalisation des circuits. La grande majorité de ces
derniers passe par la petite cité de Chinguetti, faisant d’elle le site touristique le plus
visité de la région.
2 La naissance du fait touristique en Adrar suppose des processus de représentation et de
mise en visite de la « culture locale », concept absent de l’univers lexical des Adrarois
jusque récemment et résultat d’une construction à plusieurs voix : voyagistes
étrangers, institutions internationales, État et professionnels mauritaniens, touristes
enfin. Le projet de ce texte sera précisément d’interroger, à l’appui de matériaux
d’enquête recueillis en 2005 et 20062, ces processus et dispositifs d’invention3 et de
transmission suscités par l’implantation de cette nouvelle activité économique. Comme
le note M. Picard (2001 : 120), « les populations locales ne sont pas les objets passifs du
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
81
regard touristique, mais des sujets actifs qui construisent des représentations de leur
culture à l’usage des touristes, des représentations fondées à la fois sur leur propre
système de références et sur leur interprétation du désir des touristes ». Quels éléments
de la culture locale sont qualifiés pour représenter celle-ci ? Comment ces éléments
sont représentés et transmis, pour quelle « efficacité » aux yeux des touristes ? Quelles
nouvelles relations sociales suscitent ces processus ?
3 La première partie du texte sera consacrée à une description du produit touristique le
plus vendu par les voyagistes français intervenant en Adrar, la « randonnée
chamelière » dans le désert, en tant que cadre de rencontre des protagonistes et
d’échanges interculturels. Nous procéderons ensuite à une analyse des modalités de
reconstitution et de transmission d’une culture « nomade » dans le cadre de cette
équipée singulière. Puis nous verrons comment, à travers l’exemple de la ville de
Chinguetti, une autre version de la culture locale, savante et citadine, est fabriquée et
présentée aux visiteurs. La dernière partie du texte s’intéressera aux nouvelles
relations sociales générées ainsi qu’aux modalités d’instrumentalisation du patrimoine
dans la défense d’intérêts économiques et politiques locaux.
Le circuit de « randonnée chamelière » : une équipéeinterculturelle singulière
L'aérogare d'Atar : lieu du basculement
4 Entre fin octobre et fin avril, deux voire trois avions charters desservent chaque
dimanche l’aérogare d’Atar, chef-lieu de la région de l’Adrar, en provenance de Paris et
de Marseille. Ils sont affrétés par la société Point- Afrique voyages, suivie, depuis 2002,
par l’affréteur GO Voyages. L’embarquement des touristes se fait en France, au petit
matin, et l’arrivée des avions à Atar a lieu vers 12 h 00, heure locale, soit au moment le
plus chaud de la journée. Les touristes quittent généralement un climat froid et humide
pour trouver à leur arrivée en Mauritanie un climat très sec et des températures
diurnes assez élevées (souvent supérieures à 35o à l’ombre en début et en fin de saison).
Le dépaysement4 est avant tout une affaire de perception sensorielle et la première
impression de changement que ressentent les touristes en sortant de l’avion tient dans
la chaleur écrasante de la mi-journée.
5 Ce tourisme séduit avant tout des individus relevant des classes moyennes et
supérieures et travaillant dans les domaines de l’Enseignement, de la Santé, des
grandes et moyennes entreprises. Les groupes comprennent davantage de femmes que
d’hommes5. La moyenne d’âge est de 41 ans. Un tiers des participants sont des
célibataires et beaucoup de personnes menant une vie de couple en France choisissent
de faire ce voyage seules, soit parce que le conjoint n’est pas intéressé par le trekking6,
soit pour des contraintes de congés ou professionnelles. Le trek dans le désert est
souvent un projet individuel au cours duquel on fera le point sur sa vie : les enquêtes
ont en effet montré que la randonnée dans le désert mauritanien était souvent
effectuée à un moment important de la biographie individuelle (reconversion
professionnelle, rupture affective, etc.). Inversement, lorsque ce voyage est fait en
couple, il peut être choisi pour sceller un moment important de la vie conjugale
(voyage de noces, anniversaire de mariage). Le désert permet de « faire le vide » pour
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
82
mieux repartir dans la vie. L’épreuve physique dans cet environnement a également
valeur d’initiation (Urbain 2002 : 230).
6 Une fois les formalités de douane accomplies et les bagages récupérés, les touristes
sortent du bâtiment et se dirigent vers le parking de l’aéroport, où les attendent des
hommes en boubous bleus ou blancs qui brandissent des affichettes portant les noms
des différents voyagistes qui commercialisent des séjours en Mauritanie7. Chaque
guide-accompagnateur accueille et regroupe ses clients. Il se présente et demande au
visiteur de décliner son identité afin de vérifier que celui-ci figure bien sur la liste que
lui a confiée sa société8. Les arrivants restent ensuite auprès de « leur » guide le temps
que celui-ci rassemble les autres membres du groupe. Les vendeurs de chèches
profitent de ce temps d’attente pour venir proposer aux uns et aux autres des turbans,
dont ils vantent les vertus contre le vent et le soleil tout en les enroulant autour de la
tête de Français médusés et en proie à la fatigue.
7 Ces turbans sont volontairement appelés « chèches » par ces vendeurs lorsqu’ils
s’adressent aux touristes, car ils savent que c’est le nom9 couramment employé en
français pour évoquer le turban de « l’Homme du désert », tandis que les Maures
appellent le turban hawli dans leur dialecte arabe, le hassâniyya. Il est vendu aussi bien
aux femmes qu’aux hommes alors qu’en Mauritanie, il n’est porté que par les hommes,
les femmes s’enveloppant le corps dans une melhafa, voile léger et coloré de cinq mètres
de long. Ce rituel d’« enchèchement » des touristes revêt une grande force symbolique,
pour l’Occidental d’une part, qui voit dans le chèche l’attribut caractéristique du
nomade saharien et dont l’adoption participe grandement au dépaysement du voyage10,
pour les Maures, d’autre part, pour qui l’intégration de l’étranger passe avant tout par
la transmission de la langue et des habitudes vestimentaires, deux éléments essentiels
et immédiatement repérables de leur identité.
8 L’espace de l’aérogare n’est pas un espace anodin : il inaugure et clôt le voyage. Le
visiteur en gardera un souvenir marquant. Cet espace apparaît à la fois, pour le
touriste, comme une rupture avec son environnement socioculturel habituel, et une
mise en contact avec l’inconnu, le différent11, l’ailleurs.
Le personnel mauritanien du circuit : origines et rôles
9 Le guide est le premier interlocuteur du groupe de touristes (dont le nombre varie
entre huit et quinze) et le restera durant toute la durée de leur séjour. Les guides
mauritaniens que nous avons côtoyés lors des quatre circuits auxquels nous avons
participé, étaient francophones et avaient, pour un bon nombre d’entre eux, fait des
études supérieures. Âgés en moyenne de 35 ans, ils ont passé leur enfance et leur
jeunesse en milieu urbain et ont avoué avoir découvert dans leur métier, non
seulement la culture française des touristes mais aussi celle des habitants du désert.
Durant les trois premières années, les guides ont appris, dans l’urgence, le métier sur le
terrain, parfois avec des formateurs français. Les générations suivantes ont été
recrutées sur la base de leur niveau d’étude et ont reçu une double formation,
théorique (en français et en histoire notamment) et pratique (connaissance des
itinéraires, logistique, cuisine, premiers soins, etc.).
10 Le cuisinier qui accompagne le guide dans les circuits est formé « sur le terrain ». Il doit
rester discret — ce qui ne l’empêche pas de sympathiser avec des trekkeurs — et
efficace, car la réussite du circuit dépendra beaucoup de sa ponctualité et de la qualité
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
83
des repas qu’il préparera. La fonction de cuisinier précède bien souvent celle de guide
et la plupart des cuisiniers n’aspirent qu’à accéder à ce statut, comme leur frère aîné ou
leur cousin12. La réussite du circuit repose grandement sur la bonne entente entre ces
deux personnages-clés.
11 Les chameliers, au nombre de trois en général, n’apparaissent dans l’histoire du circuit
que le matin du deuxième jour (lundi), au commencement de la « randonnée
chamelière », au moment du chargement des bagages du « groupe » sur la dizaine de
dromadaires mobilisés pour la randonnée. Durant le circuit, ils sont spécifiquement
chargés du soin dispensé aux animaux, mais aussi du chargement et du transport des
bagages, des personnes qui souhaitent monter, de l’approvisionnement en eau, de la
collecte du bois mort, du feu, et enfin de la préparation du thé. Même si leur statut
professionnel dans le secteur du tourisme est des moins valorisés, leur présence est
absolument centrale dans la logistique du voyage. De fait, les chameliers sont bien
souvent des éleveurs qui vivent encore avec leur famille dans le désert, même s’ils ne
nomadisent plus guère — contrairement à d’autres régions du pays où le pastoralisme
nomade est encore bien vivace.
12 Le circuit de « randonnée chamelière » suit un programme standard, fruit d’une
collaboration entre le voyagiste et son agence réceptive mauritanienne. Sur un séjour
de huit jours, cinq sont consacrés à la marche dans le désert, soit entre 80 et 100 km à
pied13, avec passage éventuel dans des villages ou près de campements. Le trek est très
souvent inauguré et/ou achevé par la visite guidée d’une ville ancienne, Ouadane ou
plus fréquemment Chinguetti, incluant la visite d’une bibliothèque familiale et de ses
manuscrits anciens. Cette équipée, aux étapes programmées, rythmée par les nuits en
bivouac et les repas partagés après des heures de marche, laisse paradoxalement une
place importante à la surprise et à l’imprévu, qui participent grandement de
l’« authenticité » de l’expérience aux yeux des participants.
La méharée : reconstitution d'une « culture nomade »vivante
Le circuit dans le désert : un espace-temps hybride
13 La logistique du voyage a tout d’une expédition au long cours, telles que celles relatées
par les explorateurs occidentaux du Sahara des XIXe et XX e siècles, dont les récits
bercent l’imaginaire de certains touristes. Mais c’est une logistique hybride, composée
à la fois d’objets habituels du déplacement chez les Maures, d’équipements et de vivres
pensés par l’encadrement mauritanien comme nécessaires aux touristes et enfin des
bagages de ces derniers. Le décor est planté et le rêve des touristes, nourri également
par les images des catalogues des voyagistes, commence à se réaliser : « chameaux » et
« nomades », dans leurs vêtements traditionnels d’éleveurs, sont devant eux et le
désert est aux portes de l’auberge.
14 La marche du groupe dans le désert est ensuite une succession de prises de distances et
de contacts entre individus. Les touristes marchent généralement en tête avec le guide,
tandis que les chameliers se trouvent à l’arrière du convoi. Durant le premier jour de
marche, les touristes maintiennent une certaine distance entre eux, puis ils
sympathisent assez facilement durant les jours suivants, l’expérience physique vécue
collectivement jouant un rôle évident de rapprochement des personnes. Au cours du
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
84
voyage, les deux composantes du groupe — touristes d’une part et personnel
mauritanien d’autre part — sont bien différenciées. Elles prennent deux repas distincts,
dans deux espaces distincts, la priorité étant toujours donnée au groupe- touristes qui
doit manger vers midi, « comme en France ». Seul le guide, responsable du circuit, fait
des va-et-vient entre les deux emplacements.
15 Au cours des cinq ou six jours de trek, la vie du circuit s’organise ainsi autour des
étapes de marche à pied ponctuées par la pause du midi et le bivouac, traversant des
paysages de dunes, de plateaux rocailleux et de palmeraies. Pour les touristes, les temps
forts du circuit sont les heures de marche dans le désert, conçues comme propices au
recueillement et au bilan personnel. Pour les chameliers, au contraire, les moments les
plus prisés sont ceux où ils se retrouvent autour du repas et du cérémonial du thé. Dans
la société maure, le voyage est conçu comme dangereux car consistant en la traversée
d’une étendue « vide », domaine privilégié des djinns (appelés « gens du vide »). On est
par conséquent en présence de deux conceptions culturelles du voyage dans le désert,
presque diamétralement opposées. Finalement, la « randonnée chamelière » concrétise
assez fidèlement la représentation qu’avaient les trekkeurs de la « méharée » tout en
comportant une grande découverte : le fait que le désert soit habité.
Le guide-accompagnateur : passeur culturel ou équilibriste de
l'entre-deux ?
16 Échanger verbalement avec le guide est a priori plus aisé qu’avec les chameliers,
puisqu’il est « là pour ça » et qu’il parle la langue de ses clients. Le guide est tenu,
durant le circuit, de transmettre à son groupe des informations sur sa culture, son
histoire, sur la faune et la flore des zones traversées. Lors du passage dans une ville
ancienne, il doit procurer un minimum d’informations sur celle-ci, sa vie sociale passée
et présente. Non seulement il endosse le rôle de médiateur culturel, mais il a aussi un
rôle de représentation : pour le groupe, il est le peuple mauritanien à lui tout seul.
Finalement, l’échange possible avec le guide résout en partie le problème de l’échange
quasi-impossible avec les « autochtones » rencontrés durant le circuit.
17 Ce dernier permet en outre, plus que le passage, la conversion momentanée d’une
identité culturelle à une autre, même si cette conversion reste éphémère et s’effectue
bien souvent sur un mode ludique. Par exemple, certains guides profitent du premier
repas du dimanche midi, où chacun doit se présenter succinctement, pour débaptiser
les touristes et pour leur donner un nom local : un tel se voit ainsi appeler Mokhtar, un
autre Mohammed, une telle Aminatou, une autre cAysha. Cette conversion a pour
contrepartie celle du cuisinier et des trois chameliers qui se voient affublés de prénoms
français ! Cette pratique consistant à donner un nom local à l’étranger est courante
dans la société maure et vise à favoriser son assimilation dans la culture locale14.
18 L’effort de conversion15 de la part du guide est perceptible également dans le discours
qu’il tient aux touristes. Convertir signifie en quelque sorte pour le guide présenter aux
touristes sa culture (dont il a lui-même une certaine représentation) en des termes et
surtout des concepts compréhensibles par eux, tel un interprète qui doit choisir, dans
la langue de l’auditeur, le bon mot pour exprimer une idée. Cet effort de conversion
exige de connaître la psychologie et la culture des touristes, ce qui est souvent le cas
des guides qui, pour beaucoup, ont déjà effectué plusieurs séjours en France à
l’invitation de touristes (Boulay 2006) et qui, surtout, côtoient environ 150 clients
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
85
français pendant six mois chaque année. Finalement, dans l’acte de conversion, le guide
élude ce qui peut, à son sens, poser des problèmes de « réception » (culturelle) par le
touriste et au contraire met en avant ce qui sera compréhensible, voire plaira au
touriste.
19 Durant les premières années, les guides et le personnel des agences réceptives ont dû
procéder à des ajustements de leurs représentations et pratiques du désert et du
voyage avec celles des visiteurs, comme l’illustrent les propos du responsable d’une des
agences réceptives les plus importantes :
« [...] dans les premières années, les chameliers et les guides ne comprenaient pasles goûts des touristes. Par exemple, ils installaient les bivouacs dans les oueds, prèsdes arbres, plutôt que dans les zones de dunes prisées et demandées par lestouristes. J’ai eu beaucoup de mal à les convaincre qu’il fallait répondre auxattentes des touristes qui recherchent avant tout le désert. Et puis, petit à petit, cesquelques familles se sont adaptées, comprenant que cette activité pouvait êtresource de revenus »16.
20 Le guide apparaît ainsi comme un équilibriste se maintenant, non sans une certaine
adresse, entre une occultation de certains éléments de sa culture et une
(sur)valorisation d’autres, tentant d’inscrire son discours dans le cadre des
représentations qu’ont les touristes des « nomades » et du désert, tout en tâchant de
faire évoluer leur conception. Les touristes, outre leur intérêt pour le désert, sont en
effet fascinés par l’image du nomade chamelier, fier et résistant, que la littérature et
l’iconographie occidentales sur le Sahara véhiculent. Pour cette raison, communiquer
et échanger avec des « nomades » sera pour eux un objectif important de leur voyage.
Les chameliers incarneront leur représentation du nomade et de sa culture. Cette
incarnation agira avec d’autant plus de force que, lors du circuit, la vie nomade dans le
désert sera en quelque sorte reconstituée sous leurs yeux.
21 La pratique assidue de l’islam par le personnel accompagnant mauritanien est
également un canal important de représentation et de transmission de la « culture
locale » aux touristes, d’autant que beaucoup d’entre eux viennent au désert dans une
sorte de démarche mystique (Urbain 2002). Le guide, les chameliers et le cuisinier
profitent des pauses du groupe pour faire leurs cinq prières quotidiennes. La simplicité
de l’acte surprend toujours les étrangers ainsi que le fait que la prière puisse se faire
presque n’importe où, y compris au milieu d’un groupe de personnes occupées à tout
autre chose.
« Quand ils voient que nous prions, ils nous respectent énormément, se tiennent àl’écart, tout le monde se tait, s’il y a des enfants, ils leur disent d’attendre la fin dela prière pour venir nous voir ! Alors que chez nous, pendant la prière la viecontinue et les enfants peuvent jouer à côté de nous s’ils le souhaitent. Il arrivemême que certains touristes nous rappellent à l’ordre sur l’heure de la prière : alorsque nous n’avons pas vraiment d’heure fixe pour prier. Les touristes sont toujourssurpris de notre ferveur »17.
22 Ces prières viennent rythmer la vie du circuit et, pour ces touristes qui n’ont pour la
plupart jamais vécu au contact de musulmans pratiquants, participent pleinement du
dépaysement du voyage. Aux yeux des visiteurs, la pratique religieuse des
accompagnateurs mauritaniens apparaît comme un pan d’une culture contemporaine
vivante, une pratique qui participe à l’authenticité du voyage et à son esthétique. Par
ailleurs, alors que les guides s’efforcent durant le circuit de ne pas aborder les
questions religieuses de peur qu’elles ne suscitent des débats houleux entre les
trekkeurs, ils évoquent souvent la curiosité des touristes vis-à-vis de l’islam et surtout
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
86
de ses implications dans la vie sociale et matérielle : l’alcool, la polygamie et les
rapports hommes-femmes, le jeûne.
La rencontre avec les « nomades » a-t-elle finalement lieu ?
23 Les chameliers étant tenus de garder une certaine distance avec le groupe, les échanges
avec eux seront d’abord de l’ordre de l’observation discrète : les touristes observent la
façon dont les chameliers harnachent les bêtes, préparent le thé ou guident le convoi ;
les chameliers commencent à disséquer la composition du groupe et essaient de
comprendre les relations existant entre ses membres. Voir des femmes arpenter le
désert sans objectif autre que la distraction, en pantalon, avec un turban, « comme des
hommes », est toujours pour eux une curiosité. Dans leur société, les femmes ne
s’aventurent pas hors du monde quotidien de l’habitation (jadis la tente, aujourd’hui le
plus souvent, la maison) sans raison.
24 Rapidement, de premiers contacts s’opèrent. Ce sont toujours les touristes qui font le
premier pas. Certains d’entre eux souhaitent monter sur le dos d’une des montures du
convoi prévues à cet effet. Des mots sont échangés, les chameliers connaissant quelques
mots de français, les touristes leur demandant le nom de certaines choses en arabe.
Bien sûr le guide peut faciliter la communication, notamment lorsque le touriste
souhaite poser une question précise (sur l’âge d’une bête, sur la quantité d’eau qu’elle
peut ingurgiter, le nombre de jours qu’elle peut passer sans être abreuvée, etc.). Mais
l’essentiel de la communication interculturelle passe par des mots, des signes, des
attitudes.
25 Souvent, quelques touristes souhaitent participer aux tâches dont les chameliers sont
chargés : certains les aident à harnacher les bêtes, d’autres à allumer et attiser le feu du
bivouac, d’autres enfin à préparer, avec le cuisinier cette fois, la pâte à base de farine et
d’eau servant à préparer la galette, que l’on fera rôtir dans le sable sous la braise.
Derrière ces initiatives, il y a une réelle volonté de se départir de l’image du touriste
consommateur passif, pour aller vers celle d’un touriste « frère », « solidaire », qui se
met au même niveau que ses hôtes. Ces contacts se traduisent souvent par une
« fraternisation » qui contribuera grandement, aux yeux des touristes, à la réussite de
leur voyage. Celle-ci sera souvent attestée par le don, à la fin du circuit, d’un objet de la
part du chamelier avec qui cette fraternisation aura opéré : son bâton d’orientation, sa
pince à échardes... Cet objet « authentique » scellera, pour le touriste, le lien
effectivement noué avec la figure tant convoitée du « nomade », et donc la réussite de
son voyage. Ce don provoquera quasi-systématiquement le contre-don d’un objet de la
part du touriste : couteau suisse, lampe frontale, tee-shirt, dans le meilleur des cas
chaussures de randonnée ou sac de couchage. Pour le chamelier, cet objet revêtira une
valeur utilitaire et marchande réelle, sans pour autant annuler la trace de la relation
d’amitié établie18.
26 Cette découverte de la culture locale durant le circuit s’opère également à l’occasion
des soirées en bivouac. Celles-ci sont animées et préparées par le guide. Lors de ces
veillées, c’est une culture orale populaire et vivante qui est présentée au « groupe » :
ces veillées sont consacrées au jeu des devinettes, à la poésie ou au conte, au chant et à
la danse. Lors d’un circuit auquel nous avions participé, les touristes avaient pris part à
des jeux d’adresse traditionnels avec les chameliers. Bien évidemment,
l’environnement de ces veillées, sous un ciel étoilé, près du feu de camp, au milieu des
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
87
dunes, donnait aux yeux des touristes une efficacité supplémentaire à la transmission
de ces « échantillons » de la culture locale. Les touristes ne restaient pas des acteurs
passifs ; certains proposaient à leur tour des jeux collectifs ou des contes.
27 Au moment de la pause du midi ou du bivouac, des femmes, habitant un campement
voisin, viennent s’installer autour des nattes du groupe pour vendre de l’artisanat
qu’elles présentent comme « traditionnel » et de fabrication « locale » (bijoux,
calebasses, pinces à échardes, tabatières, vanneries, pieds de palanquin, pointes de
flèches néolithiques, etc.). Ces femmes ont parfaitement assimilé les itinéraires des
groupes, connaissent très bien le nom des différents guides, leurs région et tribu
d’origine, ainsi que le nom de l’agence réceptive et du voyagiste pour lesquels ils
travaillent. Elles savent très bien faire la différence entre des touristes « Allibert » et
des touristes « Terre d’Aventure », qui n’auront pas le même comportement ni le même
pouvoir d’achat, et dont les guides n’agiront pas avec elles de la même manière. Elles
connaissent leurs goûts, quelques mots de leur langue, leurs faiblesses aussi. Elles
savent que leurs habitudes de négoce ne sont pas les mêmes que les leurs. Elles ont
forgé, au fil des années, leur propre représentation du « touriste », se résumant à celle
d’un naçrâni19, venu découvrir leur pays et leur culture, et prêt à dépenser quelques
milliers d’ouguiyas pour de menus objets d’artisanat local.
28 Généralement, ces vendeuses ambulantes s’approvisionnent auprès de grossistes du
marché d’Atar, voire de Nouakchott. Bien souvent, elles doivent délaisser
momentanément le domicile familial pour leur commerce et sont les seules personnes
locales, outre les chameliers, avec lesquelles les Nçâra (pl. de naçrâni) peuvent échanger.
À travers leur rencontre, les touristes découvrent un statut local de la femme
musulmane très éloigné de ce qu’ils avaient pu imaginer. Ces commerçantes venues des
campements ou villages alentours féminisent leur représentation des « nomades » et du
« désert ».
29 Les objets d’artisanat acquis auront la valeur d’échantillons de culture locale prélevés
et constitueront des traces gardées20 d’une culture nomade « vivante » et
« authentique ». Les carnets de bord, la photographie (plus courante que la vidéo
numérique), sont également des moyens privilégiés par les trekkeurs pour s’approprier
et mettre en mémoire les découvertes glanées lors du voyage, ainsi que les
« événements » qui ponctuent son déroulement.
Mise en scène d'une « culture savante » : l'exemple deChinguetti
Construction d'un patrimoine culturel bon à visiter
30 Parallèlement à cet effort de reconstitution de la « culture nomade » pour des touristes
il est vrai avant tout attirés par le désert et ses habitants, certains sites sont aménagés
spécifiquement pour la visite. Pour comprendre comment cette conversion s’est
opérée, nous prendrons l’exemple de la petite cité de Chinguetti, modelée par les
promoteurs de la culture et du tourisme en « patrimoine culturel » d’intérêt
touristique. Il semble en effet que les démarches des instances de qualification du
patrimoine culturel rejoignent celles des promoteurs du tourisme en Mauritanie : elles
visent à fabriquer un « patrimoine »21 prioritairement utile pour le développement
économique de la région par le tourisme.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
88
31 Le classement de Chinguetti au Patrimoine mondial de l’Unesco a été obtenu en 1996,
l’année même du lancement du tourisme en Adrar. Certes, cette démarche avait été
initiée quelques années auparavant22, mais le fait que cet événement coïncide avec
l’arrivée des premiers charters sur l’Adrar semble refléter la collusion entre les
logiques des opérateurs de la patrimo- nialisation et celles des agents de la mise en
tourisme de la région. Cette liste est le label par excellence d’une culture globale
consensuelle, émis par une institution des Nations Unies spécialement mandatée pour
qualifier « les plus dignes traces du passé » (Fabre 2000b : 205) pouvant entrer dans cet
héritage mondial. L’Unesco a joué un rôle moteur dans la mise en patrimoine de la cité
de Chinguetti, même si cette intervention était souvent très mal adaptée au contexte
local :
« Il y a eu deux projets Unesco relatifs à la sauvegarde des manuscrits deChinguetti. Le premier a été financé par le Japon. Il s’agissait de restaurer unemaison de la vieille ville achetée par l’Unesco pour abriter les livres de l’ensembledes bibliothèques. Ce projet a été mené sans aucune concertation avec lespropriétaires de bibliothèques et les habitants. La maison achetée était bien troppetite pour recueillir des collections d’ouvrages anciens et surtout elle étaitinondable en cas de forte pluie. Le jour de l’inauguration officielle de cette maison,en présence du Président de la Fondation nationale de Sauvegarde des villesanciennes, il a plu et tout le monde s’est aperçu qu’il y avait un problème avec cettemaison. Le projet a ensuite été abandonné.Le second projet a consisté à construire une maison sur un autre terrain de la vieilleville. Celle-ci est aujourd’hui achevée. Mais comment voulez-vous faire entrerplusieurs milliers d’ouvrages dans des pièces aussi exiguës. C’est bien trop petit. Etpuis les livres bénéficient dans nos bibliothèques familiales d’une climatisationnaturelle alors que la climatisation artificielle de la maison Unesco posera desproblèmes en cas de panne de courant ou autre. Finalement il a été décidé que cettemaison servirait plus de bureau d’accueil des visiteurs, avec l’exposition dequelques ouvrages de valeur. L’autre problème est que ce projet a été monté enpriorité avec une famille, et ne reçoit pas l’accord de tous les détenteurs debibliothèques familiales. Le chef de cette famille avait également passé un accord de“gérance éternelle” de cette maison avec la Fondation et l’Unesco, alors que nousdemandions une gérance collégiale et tournante. Finalement, quelquespropriétaires de bibliothèques se sont retirés du projet. Cette famille avait, qui plusest, déjà bénéficié de nombreuses aides [...] »23.
32 Aujourd’hui, de nombreuses institutions et ONG de développement intervenant au sein
de la commune de Chinguetti, séduites par la rapidité apparente de la greffe de ce
secteur touristique sur l’économie locale (Boulay 22 23 2006), reprennent à leur compte
ce discours patrimonial dans la formulation de leurs projets et dans leur lecture de la
ville, alimentant ainsi le processus en cours. Les projets de développement
d’institutions internationales (Union européenne à Chinguetti de 2003 à 2006,
Coopération espagnole à Ouadane de 2006 à 2008), sont également des « arènes »
(Olivier de Sardan 2005) ou se confrontent et s’ajustent des représentations
divergentes, émanant d’acteurs différents (agents de développement, fonctionnaires
internationaux, décideurs mauritaniens, ONG locales), quant au choix des éléments de la
culture locale qui doivent donner corps à cette notion exogène de « patrimoine
culturel ». Ces projets constituent d’importants vecteurs de production d’un
« patrimoine culturel » prêt à être consommé par les touristes. Depuis quelques années
en effet, le tourisme dit « équitable », « durable » ou « culturel », est présenté comme
un levier privilégié de développement et un outil de lutte contre la pauvreté par les
institutions internationales (Unesco en tête)24.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
89
33 Ce discours promotionnel reprend en fait assez fidèlement celui des guides touristiques
et des catalogues des voyagistes qui sont également des acteurs très importants de ce
processus de mise en monument de la ville, passant largement par sa sanctuarisation25.
Chinguetti est en effet très souvent présentée comme la « Septième ville sainte de
l’islam »26. Cette forge- rie récente, est non seulement méconnue des Mauritaniens et
des habitants de Chinguetti eux-mêmes, mais également démentie par les intellectuels.
Celle-ci participe du dispositif performatif exogène de patrimonialisation de la ville.
34 Parallèlement à l’engouement médiatique étranger dont la ville fait l’objet depuis les
années 1980 et 1990 surtout, Chinguetti, fondée vers le VIIe siècle de l’hégire (le XIIIe ap.
J.-C.), occupe localement une place de tout premier plan dans la construction politique
de la mémoire de la nation mauritanienne. La cité de Chinguetti est toujours
représentée par le minaret de sa mosquée, surmonté de cinq œufs d’autruche
distinctifs. Ce bâtiment est devenu, par métonymie, le « monument » mis pour la ville
de Chinguetti, mais aussi et surtout, par un processus de « logoïsation » (Anderson
1991) largement encouragé par les militaires nationalistes arabes, l’emblème de
l’héritage historique et culturel de la nation tout entière, dont le seul ciment incontesté
entre ses différentes composantes sociolinguistiques demeure l’islam. Néanmoins, le
classement de l’Unesco reste inconnu de la grande majorité des Mauritaniens27.
35 Du côté mauritanien, on a une forme de patrimonialisation par sélection et
emblématisation d’un édifice religieux, le petit minaret de la Mosquée de Chinguetti :
dans ce cas, c’est le patrimoine religieux qui nourrit et signifie le patrimoine culturel de
la nation tout entière. Alors que, du côté des acteurs étrangers, la patrimonialisation
opère par la production d’un discours performatif sur la ville au prestigieux passé : le
patrimoine religieux semble alors servir de simple support d’un patrimoine culturel
prêt à être consommé par les touristes. Il s’agit donc là de deux constructions
patrimoniales autonomes, mais qui peuvent s’alimenter : l’une, « locale », représente la
religion de toute une nation, ciment de la société, l’autre, « globale », met plutôt en
avant l’aspect civilisationnel de l’islam, à travers ses bibliothèques notamment, et est
destinée à un public étranger et non musulman.
Un patrimoine culturel contre-nature ?
36 La visite de la ville de Chinguetti est de courte durée : une heure environ28. Le guide-
accompagnateur commence toujours par une promenade de quelques minutes dans les
rues de la vieille ville avec son groupe. Puis il s’arrête à proximité de l’enceinte de la
mosquée historique, si possible sur une hauteur qui permet de découvrir le minaret et
l’intérieur de cet espace, interdit aux non-musulmans. Une fois cette introduction faite,
il mène son groupe dans l’une des bibliothèques29 familiales de la ville, généralement
sise à proximité de la mosquée.
37 Le conservateur des lieux, qui se présente comme un membre de la famille propriétaire,
prononce d’abord un discours introductif sur Chinguetti et sur l’histoire de la
collection. Puis il propose au groupe de pénétrer dans la pièce renfermant les précieux
manuscrits. Les visiteurs s’installent en cercle autour de lui. Le conservateur parle à
voix basse, dans ce minuscule espace, frais et sombre. L’ambiance est presque au
recueillement. Il montre délicatement à l’assistance quelques exemplaires de différents
types d’ouvrages (Coran, Vie du Prophète, ouvrages de droit, de grammaire, etc.),
certains anciens de plus de cinq siècles, leur explique le système de pagination
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
90
employé, présente les techniques utilisées à l’époque pour la fabrication de ces
ouvrages (type de papier utilisé, matières à encres et instruments d’écriture) et pour
leur conservation. Pour mieux convaincre, le conservateur de la bibliothèque choisit
des ouvrages représentatifs (les plus beaux, les plus vieux, ceux recélant une astuce
technique...). Les photos sans flash sont autorisées. Se révèle alors aux touristes toute
une culture religieuse savante, en relations avec le reste du monde arabo-musulman
depuis des siècles. La bibliothèque devient bien le sanctuaire gardant les « trésors
inestimables »30 de la ville, à savoir ses manuscrits, et compense la visite interdite de la
mosquée.
38 Ces bibliothèques sont fréquentées par presque tous les groupes de passage à
Chinguetti, et ceci pour deux raisons essentielles. D’une part, les bibliothèques sont
actuellement les seuls espaces « culturels » de la ville destinés à la visite31. D’autre part,
ces lieux présentent une forte capacité à capter la curiosité de touristes issus de
catégories sociales dans lesquelles l’écrit est valorisé et le livre conçu comme un objet
prestigieux. En sortant de la bibliothèque, les visiteurs ne peuvent guère faire
autrement que de tomber sur des vendeuses d’artisanat installées sous des tentes qui
ceignent la mosquée historique. Le site ressemble, de fait, à un petit campement
commercial en pleine ville. L’émotion ressentie par les visiteurs devant ces manuscrits
peut donc rapidement laisser la place à un sentiment de tourisme commercial et de
saturation.
39 Lors de la visite de la ville, un certain nombre de sujets et de lieux ne sont pas abordés.
On circule autour du site religieux sans que jamais on ne puisse y pénétrer. Par ailleurs,
les principales bibliothèques familiales se trouvent autour de la mosquée — ainsi que
les tentes-boutiques des vendeuses d’artisanat — soulignant sa présence interdite. On
regarde les manuscrits sans pouvoir les toucher. On est bien là dans l’une des
définitions du sanctuaire : espace exclusif entourant quelque chose de sacré, de
précieux. Les conservateurs de bibliothèques mauritaniens jouent un rôle ambigu dans
la transmission de leur culture, sélectionnant des éléments au détriment d’autres : la
religion n’est évoquée que de façon allusive et historique, on parle d’un islam savant, de
savoirs « traditionnels », de cité historique, d’architecture, de bibliothèques, de
manuscrits anciens, etc. Bref, lors des visites, les expressions matérielles, intellectuelles
et historiques de l’islam à Chinguetti sont mises en avant, mais pas la pratique de la
religion aujourd’hui. Comme si la production patrimoniale destinée à des étrangers
devait nécessairement procéder d’une mise au passé de la culture et comme si l’islam
au présent n’était pas bon à montrer au regard de l’actualité internationale qui fait, il
est vrai, en Occident, une large place au « terrorisme islamiste ».
40 La transmission de la culture, dans le cas d’un site comme Chinguetti, semble passer
obligatoirement par la fabrication d’un « patrimoine » bien défini et balisé, labellisé par
les instances internationales et prêt à l’usage de visiteurs étrangers. Elle contraint
d’une part les Mauritaniens à mettre quelque chose derrière le concept emprunté de
« culture » 32, qui reste un concept très englobant. On assiste ainsi à une
« essentialisation » de la culture (Maffi 2004), autour du manuscrit et de la bibliothèque
par exemple, processus qui laisse souvent également le sentiment, chez le destinataire
de cette mise en scène, d’un manque (la mosquée historique interdite mais visible) ou
d’un phénomène tronqué (le présent d’une pratique de l’islam). Ce manque ressenti lors
de la visite de Chinguetti est largement accentué par l’aspect commercial de cette mise
en scène et surtout par l’expérience inverse que vivent les touristes lors de la marche
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
91
dans le désert33. Cet effort de transmission conduit par ailleurs les Mauritaniens à
matérialiser une culture essentiellement immatérielle (poésie, histoire orale, chants
des griots, chants de louange, etc.), pour des étrangers habitués à une version très
matérielle du patrimoine culturel34. Il exige enfin une professionnalisation d’un des
membres de la famille dans ce nouveau « métier » :
« Dans le passé, celui qui s’occupait des manuscrits familiaux était souvent le plusâgé et/ou le plus érudit de la famille. Il était choisi par l’ensemble de la familleélargie. Aujourd’hui, de nouveaux critères se sont ajoutés, voire ont remplacé lesanciens : il faut que cet homme connaisse au moins une ou deux langues de plus quel’arabe, dont le français parfaitement puisque l’essentiel des touristes sontfrancophones, et qu’il ait de bonnes dispositions à communiquer avec les visiteurset à donner des explications claires. Hier, c’était le commerce caravanier qui nousfaisait connaître dans tout le monde arabe, aujourd’hui c’est le tourisme qui faitparler de Chinguetti partout dans le monde. Mon frère est un jour tombé sur uneinterview de moi dans une émission d’une chaîne de télévision allemande. Il a étésurpris d’une part de me voir à la télévision, d’autre part de m’entendre parlerallemand ! En fait, j’étais doublé. J’ai vu aussi un jour ma photo dans un guidetouristique » 35.
41 Ce dispositif fait passer ces bibliothèques et ces ouvrages religieux, normalement et
encore parfois destinés à l’étude, aux statuts respectifs de musée et d’objets de
mémoire voire de « beaux objets ». Normalement fréquentés par les membres des
familles propriétaires, ces lieux deviennent soudain accessibles à des étrangers non
musulmans, qui ne sont pas en situation d’étude, ni en demande d’instruction
religieuse ou juridique, mais de visite, de découverte et de loisir.
Nouvelles relations sociales générées et ajustementssociaux
42 La mise en tourisme de la culture en Adrar mauritanien repose donc sur des dispositifs
de transmission, que ce soit dans le cadre de la « randonnée chamelière » dans le désert
ou dans celui de la visite d’une « ville ancienne » classée. Ces dispositifs mobilisent et
produisent des relations entre individus qui, sans la naissance de cette activité, ne
seraient probablement jamais entrés en contacts les uns avec les autres. L’implantation
d’une économie touristique dans une région comme l’Adrar se traduit également par le
développement de stratégies d’instrumentalisation du patrimoine culturel à des fins
économiques et/ou politiques, qui donnent lieu à un certain nombre d’ajustements
sociaux.
Partenariats « translocaux »
43 Ces dispositifs de visite ont été mis en place dans le cadre de collaborations étroites
entre voyagistes français et agences de voyage mauritaniennes dans la seconde moitié
des années 1990. Il s’agissait alors de concevoir dans l’urgence36 des « produits » à
même de répondre à la fois aux exigences de l’État, qui, dans sa déclaration de politique
générale de 1994, prônait notamment la mise en place d’un « tourisme saharien,
culturel, [...], écologique et méditatif », non aliénant et respectueux des valeurs
islamiques37, et à l’engouement occidental pour de nouvelles formes de tourisme,
« d’aventure » ou « solidaire ». Dans ce cadre, la société française Point-Afrique, qui
affréta les premiers avions charters sur l’Adrar en 1996, et son partenaire mauritanien,
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
92
la SOMARSET (filiale de la société nationale d’industrie minière- SNIM qui exploite le
minerai de fer dans la région de Zouérate)38, jouèrent un rôle moteur non seulement
dans l'identification des sites d’intérêt touristique et des premiers itinéraires de
trekking, mais surtout dans la formation des premiers guides-accompagnateurs. Malgré
l’effondrement des activités trekking de la SOMARSET depuis 2005, les guides qu’elle a
formés jouent aujourd’hui un rôle-clé à l’interface entre attentes et stratégies des
voyagistes français et agences réceptives locales.
44 Leur expérience (du terrain, des touristes, des populations fréquentées sur les circuits)
en fait des personnages absolument indispensables aux voyagistes. Ces derniers, basés
en France, savent en effet que la réussite de ce type de tourisme, axé sur la découverte
d’une culture locale « vraie » et sur la « chaleur de l’hospitalité nomade », repose en
grande partie sur les épaules du guide. Raison pour laquelle certaines sociétés
représentées39 en Mauritanie font presque chaque année venir « leurs » guides en
France pour renforcer leur formation, concevoir avec eux de nouveaux produits et faire
la promotion de leur pays auprès de clients potentiels, à l’occasion par exemple d’une
manifestation comme « Eldorando », premier festival international de « randonnée »
organisé par La Balaguère dans les Pyrénées françaises en 2005, puis dans l’Aude en
200740.
45 Parallèlement à ces échanges professionnels naissent des partenariats sur la base de
relations nées durant le circuit entre les guides et certains touristes, désireux d’aller
plus loin que la simple relation guide-client, et de se départir ainsi de leur image de
« touristes ». En effet, durant le circuit, des amitiés se nouent, se prolongeant ensuite
par des échanges d’adresses, de courriers électroniques ou d’appels téléphoniques
réguliers entre le guide et certains de ses anciens clients. Des associations sont mises
sur pied et donnent lieu à des micro-projets de solidarité entre des localités de l’Adrar
et des communes ou écoles françaises : construction de salles de classe, fourniture de
motopompes, envoi de matériel médical pour un dispensaire ou de matériel
pédagogique pour une école, résultat direct de cette idéologie du « tourisme solidaire »
portée par bon nombre des touristes visitant l’Adrar. Chaque année, les guides partent
en France rendre visite à leurs amis disséminés dans tout l’hexagone. Quelques-uns ont
monté une petite troupe de conteurs et se produisent dans des écoles ou dans des
centres culturels, à l’occasion de réunions dédiées à la découverte de la Mauritanie ou
du sahara. Cette circulation des guides répond en quelque sorte aux séjours effectués
par les touristes français en Adrar, entretient le réseau de contacts, constitue un mode
de diffusion privilégié de la « culture » mauritanienne, et est mis à profit pour le
montage de projets « culturels » ou « humanitaires ».
46 Chaque guide constitue ainsi, au fil de sa carrière, un carnet d’adresses qu’il peut ainsi
activer à tout moment, selon le projet qu’il souhaite mettre en œuvre (Boulay 2006).
47 Une fois ce réseau constitué, il arrive souvent que le guide crée sa propre agence
réceptive et organise des circuits « à la carte » pour ses anciens clients, présentés
comme des « amis », et pour les amis de ses amis. Ainsi, assiste-t-on depuis quelques
années à une multiplication d’agences, bien souvent matérialisées par une simple carte
de visite et une adresse Internet ! Néanmoins, seules quelques-unes d’entre elles
parviennent à survivre dans un secteur extrêmement concurrentiel. Celui-ci est
contrôlé par moins d’une dizaine d’agences réceptives de poids, qui sont parfois
contraintes de vendre des prestations à perte pour conserver leurs partenaires du
Nord.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
93
« Ce que je n’acceptais pas c’était le diktat de certains tour-opérateurs avec nous.J’étais toujours très ferme avec eux, contrairement à [mon directeur]. À la fin, jen’étais plus sur la même longueur d’ondes avec [lui], qui acceptait souventl’inacceptable, notamment de travailler à perte et d’accepter des petitsarrangements informels. Le colonialisme c’est fini depuis longtemps, et il n’y avaitaucune raison d’accepter les décisions des tour-opérateurs, jusqu’au choix desguides avec lesquels ils souhaitaient faire partir leurs groupes de touristes. Alorsqu’en principe nous devions être les seuls à décider du choix des guides à fairetravailler. Les TO ont facilement tendance à diviser les prestataires locaux entreeux, pour mieux contrôler la situation du tourisme en Adrar, “diviser pour mieuxrégner” en quelque sorte. D’une saison à l’autre ils n’ont aucun scrupule à mettre enconcurrence leur réceptif avec un autre pour faire pression sur les prix parexemple. Ce rapport des sociétés françaises à l’“indigène” me déplaisaitprofondément »41.
48 Derrière les discours de tourisme « solidaire » ou « durable » des voyagistes français, on
assiste donc, depuis quelques années, à une forte détérioration de cette économie, à la
fois sous la pression et les décisions des voyagistes qui cassent sans cesse les prix d’une
destination commençant à s’essouffler, après avoir bénéficié de l’effet de nouveauté des
premières années, et face à la démission de l’État42 dans son rôle de régulation et
d’organisation du secteur.
49 Plus que de partenariats transnationaux, il nous semble pertinent ici de parler de
partenariats « translocaux », puisqu’on est en présence de liens entre le local « ici » et
le local « ailleurs » (Appadurai 2005). La majorité des voyagistes de randonnée
proposant l’Adrar comme destination revendiquent en effet un ancrage dans un terroir
particulier : les Alpes pour Allibert, les Pyrénées pour La Balaguère, l’Ardèche pour
plusieurs autres. Cette stratégie, à laquelle s’ajoute souvent la volonté affichée de
promouvoir un tourisme « équitable », leur permet de se distinguer des agences
« parisiennes » qui apparaissent d’emblée comme de grosses organisations à visées
exclusivement commerciales. Par ailleurs, nous avons vu que les liens noués entre
guides et touristes sont entretenus entre les lieux de vie respectifs du guide et du
trekkeur.
50 Nous avons enfin observé des expériences de partenariats économiques locaux entre
Français, qui investissent dans le secteur et que l’on retrouve à la tête d’agences
réceptives ou de structures d’hébergement locales, et Mauritaniens. Ces stratégies
d’alliance, parfois constituées sur la base de mariages mixtes entre une Française et un
Mauritanien, sont souvent considérées comme la clé de la réussite dans le secteur. Elles
répondent au besoin qu’ont les Mauritaniens de mieux connaître la culture et les
attentes des touristes français. Sans cette connaissance en effet, les produits proposés
n’ont que peu de chances de satisfaire la demande des touristes. De même, les
investisseurs étrangers peuvent difficilement, au moins durant les premières années, se
passer d’un collaborateur mauritanien pour réussir à se faire une place dans l’économie
locale.
Réseaux locaux, solidarités, compétitions
51 Le réseau professionnel du tourisme en Adrar semble a priori plaqué hermétiquement
sur la société adraroise. N’y entre pas n’importe qui, n’importe quand. Faire partie du
réseau, c’est travailler pour l’une des agences réceptives de la place, comme guide,
comme cuisinier, secondairement comme chauffeur ou chamelier. Un grand nombre de
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
94
personnes travaillant dans ces agences ne sont pas originaires de l’Adrar.
Généralement, on entre dans une agence par recommandation et on commence par le
bas de l’échelle. Par exemple, chez le réceptif du voyagiste Allibert, le personnel est
d’abord recruté comme aide-cuisinier, puis, devient cuisinier après quelques mois ou
années, et plus tard guide si une place se libère. À la SOMARSET, les cas de promotion
d’un cuisinier au poste de guide sont plus rares. Il existe une hiérarchie des métiers qui
est difficile à gravir et l’accès au statut de guide, conçu comme lucratif et stratégique
car pourvoyeur de relations avec l’Europe, est délicat. Intégrer le réseau du tourisme en
Adrar c’est y jouer un rôle, ne serait-ce que modique, acquérir une place et un statut
connus et reconnus par les autres membres du réseau.
52 Autour du réseau de personnels d’agences, on trouve une sorte de réseau périphérique
constitué par les gérants d’auberges, les vendeurs de cartes postales, les vendeurs
d’artisanat, les conservateurs de bibliothèques et de petits musées locaux. Ce réseau se
situe aux franges du réseau principal et est complètement dépendant de lui. Il apparaît
en effet que ceux qui sont au cœur du réseau touristique sont les personnels travaillant
au contact direct des touristes, à savoir les guides, les cuisiniers et les chameliers. Cette
proximité avec la « ressource » leur confère une certaine importance dans le système
touristique. Ces éléments du réseau, les guides en particulier, sont caractérisés par une
grande mobilité d’une agence à une autre, qui s’opère au gré des opportunités et de la
santé des agences. Beaucoup de guides formés jadis par la SOMARSET travaillent par
exemple aujourd’hui pour d’autres réceptifs, se connaissent et bien souvent
entretiennent des liens d’amitié. Chaque dimanche, jour d’arrivée et de départ des
touristes, ils se retrouvent sur l’esplanade d’accueil de l’aéroport, qui devient un espace
de rencontre et d’échanges très important, parfois de disputes générées par les rivalités
et la compétition qui existent entre les différentes agences réceptives de la place.
Chacun sait parfaitement qui travaille pour qui, depuis combien de temps, qui est
originaire de l’Adrar ou ne l’est pas, etc.
53 Les responsables des agences réceptives les plus importantes sont connus de tous mais
restent en arrière-plan, aux commandes de l’organisation des circuits. Ils sont moins
d’une dizaine et sont devenus des personnalités locales influentes. Leurs noms circulent
beaucoup dans la petite ville d’Atar. Autour d’eux gravitent guides, cuisiniers et petites
mains du tourisme. Ces figures deviennent les principaux points nodaux du réseau :
entrer dans le réseau consiste à se placer sous la protection de l’une d’elles. Se
dessinent ainsi des groupes éponymes qui s’appuient bien souvent sur les liens de
parenté existant entre les différents membres du personnel. Les guides ont parfois pour
cuisinier un frère plus jeune, un neveu ou un cousin. Ils peuvent également avoir la
même origine géographique et tribale.
54 Une compétition naît entre ces groupes constitués. Chacun représente et est appuyé
par le(s) partenaire(s) étranger(s) pour le(s)quel(s) il travaille. Mais, en même temps,
chacun est susceptible de perdre ce(s) partenaire(s) au profit d’une autre agence, ou
inversement de gagner la faveur d’un voyagiste au détriment d’une autre agence de la
place. Certains voyagistes n’ont en effet aucune difficulté à se libérer d’un prestataire
local pour recruter son concurrent direct, pour une simple question de réduction des
coûts de prestation ou suite à une mésentente. Ce sont eux qui, de toutes façons, sont
souverains sur la constitution ou la dissolution de ces partenariats. Les réceptifs n’ont
pas de marge de négociation.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
95
Le patrimoine culturel comme ressource et comme instrument
55 Depuis 1996, les Adrarois ont appris à connaître les dispositifs de visite mis en place, les
professionnels du secteur, les itinéraires des groupes, les comportements des
Européens lors des visites et des marches dans le désert. Cette connaissance acquise au
fil des années leur a permis de s’impliquer dans un secteur qui, dès le départ, était
promis à un certain succès mais qui était complètement nouveau. Travailler au contact
des touristes, dans une région entretenant pourtant depuis le début du XXe siècle des
relations très fortes avec la France, était très mal vu par la population lors des
premières années de développement de ce secteur. Encore aujourd’hui, l’afflux
saisonnier de ces visiteurs est perçu de manière très ambivalente par les populations
fréquentées : d’un côté, le tourisme est apprécié pour la nouvelle ressource économique
qu’il constitue, de l’autre, le fait que ces visiteurs ne soient pas musulmans suscite
souvent, notamment chez les habitants des espaces ruraux traversés, des commentaires
d’incompréhension face à « ces gens qui ne prient pas comme nous ». Ce type de
tourisme instaure un contact entre les habitants de ces zones et les touristes beaucoup
plus direct que celui qui existait avec les coopérants et militaires français présents à
Atar, voire avec les administrateurs coloniaux avant 1960.
56 Progressivement, quelques individus ont essayé de s’impliquer dans la « valorisation »
de leur « patrimoine culturel », avec généralement pour objectif essentiel de glaner
quelques ressources économiques. L’Adrar étant une région extrêmement riche en
vestiges archéologiques, on assiste par exemple depuis plusieurs années à une
multiplication de petits musées locaux, sis dans les villes anciennes (on en compte
plusieurs à Ouadane) ou près de villages nés récemment dans le désert. Ce fait révèle un
réajustement d’attitude des familles bédouines vis-à-vis des objets archéologiques qu’ils
vendaient ou donnaient aux touristes il y a encore quelques années, et qu’ils présentent
aujourd’hui aux étrangers moyennant un droit d’entrée modique, dans de petites
huttes situées près des itinéraires des circuits. Les éleveurs maures, qui collectent les
objets archéologiques le long de leurs parcours pastoraux, accordaient jadis peu
d’importance aux objets « anciens » qu’ils attribuent volontiers à une population
disparue (les Bafour, en Adrar et au Tagant). Ce changement d’attitude a révélé
l’intégration par les nomades de la valeur mémorielle de ces objets, et surtout la prise
de conscience du fait que l’histoire locale est un motif d’attraction des étrangers,
synonyme de fréquentation et donc de génération de revenus économiques. Ces objets
historiques sont ainsi passé, aux yeux des habitants du désert, du statut de vestiges
inutiles et sans valeur (avant le tourisme) à celui de biens marchands (dans les premiers
temps du tourisme) et deviennent maintenant des attractions capables de générer une
économie de la visite. Cette dernière a d’ailleurs eu un effet direct sur le repeuplement
des localités les plus fréquentées :
« De nombreuses familles originaires de cette cité, mais qui étaient parties depuisplusieurs années voire plusieurs décennies à Nouakchott ou Nouadhibou, sont entrain de revenir y habiter ou restaurent la maison familiale pour la louer à unaubergiste ou à un projet financé par des Occidentaux (Union européenne,Coopération espagnole ou autre), ou encore placent leurs économies dans desterrains dont les prix ne cessent, actuellement, d’augmenter »43.
57 Néanmoins, depuis 2004, le produit « désert mauritanien » montre des signes
d’essoufflement, que les professionnels locaux imputent généralement à une absence
de renouvellement du produit, d’organisation du secteur, de professionnalisation des
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
96
métiers. Ainsi un ancien guide insiste sur l’effort que doivent fournir les Mauritaniens,
les communes fréquentées par les touristes, les investisseurs privés, l’État, afin d’être
plus dynamiques et de se renouveler en permanence, dans un secteur qui évolue très
vite :
« Concernant la stagnation actuelle du volume de touristes, il y a diverses causes àmon avis. Tout d’abord, il faut que les opérateurs réinjectent une partie de leursgains dans des infrastructures et des investissements, sinon nous n’évolueronsjamais et ne proposerons jamais rien de nouveau aux touristes. Il faut aussi qu’uneville comme Atar améliore son apparence : propreté des rues, plantations d’arbresou de palmiers dans les rues, etc. Il n’y a pas assez de publicité faite pour le pays :on ne peut plus se satisfaire du simple bouche à oreille. Il faut que l’Office nationaldu Tourisme et la direction du tourisme ainsi que la Fédération soient plusdynamiques dans ce sens [...]. À Chinguetti, depuis le commencement du tourisme,rien n’a vraiment changé. Certaines rues ont été désensablées par un programme[de l’Union européenne], les vendeuses ambulantes d’artisanat sont toujours lesmêmes et courent toujours après les touristes, malgré les consignes que nous leurdonnons. La ville n’est pas mieux apprêtée pour le tourisme qu’il y a dix ans. Onvisite toujours les mêmes lieux, on y voit toujours les mêmes choses. Il faut évoluerun peu, sinon les touristes ne reviennent pas »44.
58 Le « patrimoine culturel » n’est pas seulement vu comme une source potentielle de
revenus. Il peut être aussi, surtout lorsqu’il détient le précieux label d’une institution
comme l’Unesco, un nouveau « lieu » d’expression de compétitions politiques et
l’instrument de contestation de pouvoirs locaux. L’installation en 2005 d’un pylône de
télécommunications en plein cœur de la ville ancienne de Ouadane, classée sur la liste
du Patrimoine mondial en 1996, a ainsi été l’occasion saisie par les habitants
« historiques » de cette ville pour dénoncer l’« ignorance » du maire en place à l’époque
et de son clan. Elle a été l’occasion choisie par les Idaw el-Hâj de Ouadane — tribu
religieuse revendiquant la fondation de la ville, un statut d’élite cultivée et de
gardienne de la mémoire de Ouadane —, pour dénoncer également l’emprise politique
sur leur ville de bédouins récemment sédentarisés, les Amgarîj, qualifiés d’illettrés, de
statut social inférieur, n’accordant aucune place au « patrimoine culturel » et à
l’histoire45. L’érection du pylône de télécommunications était ainsi présentée par les
Idaw el-Hâj comme la preuve de cette ignorance et comme un acte qui allait faire fuir
les touristes et pénaliser lourdement la jeune et encore fragile économie touristique de
Ouadane. Aujourd’hui, les discours des touristes visitant la ville de Ouadane ont
confirmé cette crainte, mais les facilités apportées par le téléphone sans fil semblent
avoir rapidement fait oublier cet « événement ». Néanmoins, le « patrimoine culturel »
reste une arme privilégiée par l’opposition municipale pour reprendre la ville des
mains des Amgarîj, considérés comme des usurpateurs.
59 Même si ces contestations n’ont pas permis aux Idaw el-Hâj, alliés à d’autres tribus
moins nombreuses, de reconquérir la ville lors des dernières élections municipales de
2006 et de destituer le maire sortant, elles constituent pour notre propos un exemple
parfait de l’assimilation puis de l’instrumentalisation de ces discours patrimoniaux
exogènes, par un groupe d’individus porteur de revendications politiques et
économiques. Le projet de création d’une aire protégée dans la région de Ouadane,
projet conçu et porté depuis plusieurs années par un ressortissant des Idaw el-Hâj de
Ouadane, qui est également représentant en Mauritanie d’une puissante ONG
internationale de conservation de la nature, semble également s’inscrire dans le même
type de démarche.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
97
*
60 On assiste en Adrar à la construction d’une « culture locale » autour de deux catégories
bien distinctes voire opposées : une culture « nomade » populaire et authentique d’un
côté, version proposée aux touristes durant leur voyage dans le désert et au cours de
leurs rencontres avec les Adrarois, une culture « savante » de l’autre, mise en scène lors
de la visite de villes anciennes comme Chinguetti et Ouadane. Cette construction
s’opère au sein de cette nouvelle arène que constitue le fait touristique et est le fruit de
rencontres et d’ajustements entre les représentations occidentales du Sahara, d’une
part, et des conceptions locales de la culture, d’autre part, que le tourisme pousse à
essentialiser autour de quelques éléments emblématiques.
61 Ces représentations et pratiques sont la résultante d’échanges et de partenariats qui
restent fragiles et reposent sur des réseaux d’acteurs nécessitant des conditions
favorables pour se déployer. L’attentat contre des voyageurs français dans le sud du
pays, perpétré le 24 décembre 2007 par des Mauritaniens revendiquant une
appartenance à des mouvances fondamentalistes, suivi de l’annulation très médiatisée
du rallye automobile Paris-Dakar, ont porté un coup sévère à ce tourisme prônant la
rencontre directe avec la population locale et le dialogue des cultures. Le pays, jusque-
là épargné par ce type d’événement, est en train de connaître un sort comparable à
celui connu par ses voisins malien et algérien. Et le nouveau coup d’État militaire
survenu le 6 août 2008 ne va sans doute qu’accentuer cette tendance.
62 Dans ce contexte, on est en droit de s’interroger sur l’avenir de la position attribuée à la
« Septième ville sainte de l’islam » par les voyagistes français et les professionnels
mauritaniens du tourisme dans les stratégies de promotion de la destination en France
et dans le dispositif de visite de l’Adrar. De même, il sera intéressant de suivre
l’évolution des discours des guides locaux sur leur culture, des représentations
produites par les trekkeurs européens sur la destination et des comportements des
populations visitées vis-à-vis de ces petits groupes de touristes « solidaires ».
BIBLIOGRAPHIE
ANDERSON, B.
1991 Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London-New York,
Verso.
APPADURAI, A.
2005 Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Payot (« Petite
bibliothèque Payot, 560 »).
BONTE, P.
1998 L’émirat de l’Adrar. Histoire et anthropologie d’une société tribale saharienne, Thèse de doctorat,
Paris, EHESS.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
98
2001 La montagne de fer. La SNIM (Mauritanie) : une entreprise minière saharienne à l’heure de la
mondialisation, Paris, Karthala.
2008 L’émirat de l’Adrar mauritanien. Harîm, compétition et protection dans une société tribale
saharienne, Paris, Karthala.
BOULAY, S.
2006 « Le tourisme de désert en Adrar mauritanien : réseaux “translocaux”, économie solidaire et
changements sociaux », in A. DOQUET & S. LE MENESTREL dir.), Tourisme culturel, réseaux et
recompositions sociales, Autrepart, Revue des Sciences Sociales au Sud, 40 : 67-83.
CAUVIN VERNER, C.
2007 Au désert. Une anthropologie du tourisme dans le Sud marocain, Paris, L’Harmattan.
CHEIKH, A. W. O.
2006 « Nouakchott, capitale nomade ? », in MUSÉE NATIONAL DE NOUAKCHOTT & CCF ANTOINE DE SAINT-
EXUPÉRY DE NOUAKCHOTT (dir.), Nouakchott, capitale de la Mauritanie, 50 ans de défi : exposition
« Nouakchott 1958-2006 » du 13 février au 5 mars 2006, Saint-Maur-des-Fossés, Sépia : 139-148.
À paraître « Patrimonio, memoria, Estado : nota sobre o patrimonio mauritano e os seus usos », in
M. CARDEIRA DA SILVA (dir.), Castelos a Bombordo, Lisboa, Livros Horizonte.
DEY, S. A. O.
1999 « Bilan critique des efforts entrepris pour la sauvegarde de la ville de Chin- guetti », in Actes
du 1er Colloque international sur le patrimoine culturel mauritanien, « Projet de sauvegarde et de
valorisation du patrimoine culturel mauritanien » : 60-67.
FABRE, D.
2000a « L’ethnologie devant le monument historique », in D. FABRE (dir.), Domestiquer l’histoire.
Ethnologie des monuments historiques, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’Homme : 1-29.
2000b « Ancienneté, altérité, autochtonie », in D. FABRE (dir.), op. cit. : 195-208.
MAFFI, I.
2004 Pratiques du patrimoine et politiques de la mémoire en Jordanie. Entre histoire dynastique et récits
communautaires, Lausanne, Éditions Payot (« Anthropologie-Terrains »).
OLIVIER DE SARDAN, J.-P.
2005 [1995] Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement social, Paris,
Karthala ; Marseille, APAD.
PANAROTTO, S.
2003 Projet d’appui à la Commune de Chinguetti, Étude tourisme et communication, Rapport
intermédiaire, Mission du 25 juillet au 23 août 2003, Nouakchott, Agriconsulting pour le
ministère des Affaires économiques et du développement.
PICARD, M.
2001 « Bali : Vingt ans de recherches », Anthropologie et sociétés, Tourisme et sociétés locales en Asie
orientale, 25 (2) : 109-127.
REY, A. & REY-DEBOVE, J. (dir.)
1991 Le petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
99
ROUX, M.
1996 Le désert de sable. Le Sahara dans l’imaginaire des Français (1900-1994), Paris, L’Harmattan.
UNESCO
2003 Le Sahara des Cultures et des Peuples. Vers une stratégie pour un développement durable du tourisme
au Sahara dans une perspective de lutte contre la pauvreté, Paris.
URBAIN, J.-D.
2002 L’idiot du voyage, Histoires de touristes, Paris, Payot (« Petite bibliothèque Payot »).
WARNIER, J.-P.
1999 Construire la culture matérielle. L’homme qui pensait avec ses doigts, Paris, PUF.
ZISMAN, A.
2004 « Rapporter le désert à la maison. Quand le sable devient objet », in V. NAHOUM-GRAPPE & O.
VINCENT (dir.), Le goût des belles choses, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’Homme :
165-173.
NOTES
1. Le rôle joué par l’ancien président de la République Maaouiya Ould Sid Ahmed Taya
(1984-2005), originaire de l’Adrar, dans le choix de cette région pour donner une impulsion au
secteur touristique, a sans doute été décisif, même s’il est vrai que l’Adrar présentait d’emblée un
« potentiel touristique » important en termes de renommée à l’étranger, de variété des paysages
et des sites, ainsi que des relations anciennes avec la France. L’Adrar reste aujourd’hui l’une des
régions les moins peuplées du pays : 69 542 habitants au Recensement général de la population et
de l’habitat de 2000 (dpt d’Aoujeft : 20 181 ; dpt d’Atar : 38 962 ; dpt de Chinguetti : 6 704 ; dpt de
Ouadane : 3 695). Sur l’Adrar, voir notamment les travaux de P. BONTE (1998, 2008).
2. Recherche post-doctorale encadrée par l’USM 105 « Objets, cultures et sociétés » du Muséum
national d’Histoire naturelle, et soutenue par la SOMASERT (Société mauritanienne de services et
de tourisme).
3. A. APPADURAI (2005 : 22) a montré que le « local » n’existe pas de lui-même, qu’il est invention
permanente et que ce sont les conditions et modalités d’invention de ce « local » qui doivent être
analysées.
4. Selon J.-D. URBAIN (2002 : 146), l’inadaptation du code de perception à un nouvel
environnement fonde précisément l’expérience du dépaysement et de la révélation.
5. Un public comparable à celui décrit par C. CAUVIN VERNER (2007) dans le Sud marocain.
6. Nous employons à dessein dans ce texte les termes « trekking », « trek » et « trek- keur » qui
sont couramment employés par les touristes et les professionnels de ce type de tourisme. Ces
termes renvoient à une expérience physique éprouvante, vécue collectivement, dans un
environnement extrême.
7. Les plus connus et les plus importants du point de vue du nombre de voyageurs pris en charge
sont : Nomade Aventures, Explorator, Zig-Zag, Club Aventure, Point-Afrique voyages, La
Balaguère, Désert, Terre d’aventure, Atalante, Traces, Chemins de Sable, Allibert, Visage, La
Burle.
8. Ces sociétés, qui prennent en charge les touristes à destination, sont appelées, dans le jargon
du tourisme, « agences réceptives », ou plus communément « réceptifs ». Elles sont dirigées et
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
100
gérées soit par des Mauritaniens, soit par des étrangers installés dans le pays, ici bien souvent des
Français.
9. Mot de l’arabe algérien qui est passé en français durant la période coloniale.
10. Rituel qui n’est pas sans rappeler celui du collier de fleurs par lequel on accueille les visiteurs
dans le Pacifique, mais qui revêt néanmoins, nous semble-t-il, une force symbolique bien plus
importante.
11. Même si certains touristes n’en sont pas à leur premier voyage en Mauritanie, on sait que le
passage d’un milieu à un autre, même peu différent, suscite toujours un sentiment de décalage,
d’étrangeté, de dépaysement.
12. Car bien souvent le guide recrute une personne de confiance pour travailler avec lui, issue de
son cercle de parents ou d’amis.
13. L’expérience physique est vivement recherchée par les touristes, pour la plupart d’entre eux
marqués par la représentation initiatique voire biblique du désert (ROUX 1996).
14. Cette pratique peut également s’inscrire dans une stratégie de séduction de la part des guides
vers les touristes (CAUVIN VERNER dans ce numéro) et se retrouve fréquemment lors
d’observations des interactions entre guides et touristes, notamment en Afrique de l’Ouest.
15. Même si le terme « conversion » renvoie d’abord au fait de « passer d’une croyance
considérée comme fausse à la vérité présumée », il renvoie aussi et surtout au fait de « changer
une chose en une autre » (REY & REY-DEBOVE 1991).
16. Entretien fait à Nouakchott, 21 septembre 2005.
17. Entretien avec un guide de la SOMASERT, le 29 avril 2006, Atar.
18. Comme l’a montré J.-P. WARNIER (1999 : 125), les objets sont plus et surtout autre chose que
des mots, ils sont un « espace autonome de production de sens ».
19. Terme apparaissant dans le Coran pour désigner les Chrétiens, et que les Maures emploient
plus généralement pour désigner les Occidentaux. Il a le sens implicite de non musulman, mais
marque également l'appartenance à l'une des trois religions révélées, synonyme d'une certaine
proximité religieuse et culturelle avec l'islam, qui confère donc à l'étranger un statut bien plus
valorisé que celui d'athée ou de polythéiste.
20. Voir à ce sujet l’article de A. ZISMAN (2004) sur le statut conféré par les ex- trekkeurs aux
objets rapportés du Sahara mauritanien.
21. Une notion qui a fait son apparition en Mauritanie dans le courant des années 1980 et 1990
surtout, notamment avec la création en 1993 de la Fondation nationale des villes anciennes
(FNSVA), puis le classement des quatre cités historiques sur la liste du Patrimoine mondial de
l’Unesco (1996) et le colloque inaugural du Projet de sauvegarde et de valorisation du patrimoine
culturel mauritanien (PSVPCM) en 1999, financé par la Banque Mondiale. Ce soudain
« engouement » patrimonial s’inscrivait dans une démarche très claire de valorisation d’une
culture « arabe » conçue comme la seule légitime par le pouvoir militaire en place en Mauritanie
de 1985 à 2005. Voir, au sujet de la construction politique du patrimoine culturel et de la
mémoire nationale en Mauritanie, A. W. O. CHEIKH (à paraître).
22. Un appel à la sauvegarde des quatre villes anciennes de Mauritanie (Chinguetti, Ouadane,
Tichit et Oualata) avait été lancé du haut du minaret de Chinguetti en 1981 par Moctar M’Bow,
alors directeur de l’Unesco, suivi d’un second lancé en 1988 par son successeur Fedérico Mayor,
également depuis Chinguetti. En 1993, le ministère de la Culture et de l’Orientation islamique
publiait un arrêté portant classification des quatre villes historiques, patrimoine national
protégé (DEY 1999 : 61-62).
23. Entretien avec le gérant d’une bibliothèque de Chinguetti, 2 octobre 2005.
24. Le Sahara des Cultures et des Peuples. Vers une stratégie pour un développement durable du tourisme
au Sahara dans une perspective de lutte contre la pauvreté, 2003.
25. La notion de sanctuaire, qui renvoie à « un lieu protégé, fermé, secret, sacré » (R EY & REY-
DEBOVE 1991), me semble pertinente ici car très proche de celle de « monument » que D. FABRE
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
101
(2000a : 27) a définie comme « la partie la plus précieuse d’un tout ». Elle sous-tend des idées
d’exception, d’exclusion, de démarcation spatiale.
26. Entre autres qualificatifs : « ville mythique du désert », « ancienne cité caravanière »,
« capitale spirituelle de la Mauritanie », « oasis aux prises avec l’ensablement », « ville de départ
des pèlerins ouest-africains pour La Mecque », etc.
27. Il faut dire que le patrimoine bâti en Mauritanie, et dans la culture maure en particulier, et le
patrimoine tangible en général, ne sont pas valorisés, contrairement au patrimoine intangible et
à la tradition orale, qui font l’objet de démarches spontanées et populaires de conservation
(poésie, musique, conte) au sein de la société.
28. Ce laps de temps varie néanmoins selon que la visite de Chinguetti est placée en début ou en
fin de circuit, selon également la période de fréquentation (hors ou pendant les vacances
scolaires françaises), selon enfin le profil et les attentes des touristes évalués par le guide.
29. La ville en compte une quinzaine, mais seules trois ou quatre sont régulièrement visitées et
organisées pour recevoir des groupes de visiteurs. La bibliothèque la plus visitée, celle des Ahl
Habott, se trouve néanmoins dans un autre quartier mais est très bien située puisque donnant
sur la place centrale de la vieille ville, près de la Maison du Livre et du Château d’eau, édifices
remarquables de la cité.
30. Catalogue 2004/2005 du voyagiste La Balaguère, p. 77.
31. Une Maison Théodore Monod (financement Union européenne) est en projet ainsi qu’une
Maison des Manuscrits (financement Unesco).
32. Ils ont recours au terme thaqâfa, emprunté à l’arabe littéraire, pour trouver un équivalent au
terme français culture.
33. Quand la visite de Chinguetti est placée en début de trek, on visite rapidement la ville car les
touristes sont impatients de découvrir le désert, objet véritable de leur séjour. Quand la visite de
Chinguetti est placée en fin de trek, la ville est l’objectif symbolique et géographique de la
marche mais l’empreinte physique et mentale de cette dernière amoindrira largement l’intérêt et
l’enthousiasme pour la visite de la ville.
34. Voir également dans ce numéro l’article de Marco AIME sur Tombouctou.
35. Entretien avec un gérant d’une bibliothèque de Chinguetti, 2 octobre 2005.
36. Contrairement au tourisme de trekking dans le désert marocain, qui s’implante dans le cadre
d’une économie touristique nationale développée depuis plusieurs décennies et de dispositifs de
visite déjà très élaborés et variés (CAUVIN VERNER 2007 : 88), le trekking dans le désert
mauritanien est la première véritable offre touristique organisée d’un pays pour ainsi dire
dépourvu de tradition touristique.
37. Engagement qui sera confirmé dans la loi 96.023 du 7 juillet 1996 organisant l’activité
touristique (PANAROTTO 2003).
38. Ce partenariat s’inscrivait dans la continuité des liens historiques unissant la société
française MIFERMA, qui devint SNIM en 1974 suite à sa nationalisation, et la région de l’Adrar,
qui fournit, rappelons-le, dans les années 1960 et 1970, une grande partie du personnel de cette
société (BONTE 2001).
39. Les voyagistes français n’accordent pas la même importance et les mêmes moyens à la
fidélisation de leurs guides. Cette fidélisation passe par l’organisation de séjours de formation en
France ou par l’octroi de primes ou de petites aides familiales aux guides.
40. Il était question, avant l’assassinat de quatre touristes français en Mauritanie le 24 décembre
2007, de « délocaliser » l’édition 2009 d’« Eldorando » en Mauritanie. Au sujet du festival de 2005,
voir BOULAY (2006).
41. Entretien avec un ancien cadre d’une importante agence réceptive locale, Nouakchott, 15 juin
2006.
42. L’État s’est longtemps appuyé sur la SOMASERT, filiale touristique de la société publique
SNIM, qui contrôlait dans les premières années plus de 50 % du marché de l’organisation des
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
102
circuits, pour organiser le secteur, homogénéiser les prestations et les prix des professionnels, au
point que cette société était souvent accusée de concurrence déloyale par les agences réceptives
privées.
43. Un instituteur de Chinguetti, natif de cette ville, 30 septembre 2005.
44. Entretien fait à Nouakchott, le 15 juin 2006.
45. Cette conception de la culture, structurée autour d’une opposition entre le monde bédouin,
considéré comme fruste et sauvage, et le monde citadin, vu comme civilisé et raffiné, est
omniprésente dans la société maure et dans le monde arabo- berbère en général. On retrouve
cette opposition entre cumrân al-badawî et cumrân al-hadarî dans la vision khaldunienne de
l’histoire et de la société (CHEIKH 2006 : 139).
RÉSUMÉS
Le tourisme organisé a pris son essor dans la région de l'Adrar (Mauritanie) à partir de 1996. Les
circuits commercialisés par leurs promoteurs français articulent « tourisme d'aventure »,
proposant des randonnées chamelières dans le désert, et « tourisme culturel », ciblant la
découverte du patrimoine culturel local. La naissance du fait touristique en Adrar suppose des
processus de fabrication et de mise en visite d'une « culture locale », mobilisant différents types
d'acteurs et suscitant des ajustements de représentations et de pratiques. Ce sont ces processus à
l'interface que ce texte se propose de décrire et d'analyser.
Starting in 1996, organised tourism has developed rapidly in the Adrar region of Mauritania. The
package tours sold by French travel agents focus on "adventure tourism", with camel trips in the
desert, or "cultural tourism" for discovering the local cultural heritage. The advent of tourism in
Adrar implies the fabrication of a "local culture" for tourists to visit. This involves a variety of
players and has required certain adjustments to be made to both representations and practices.
This paper attempts to describe and analyse these interface processes.
INDEX
Mots-clés : Mauritanie, région de l'Adrar, Sahara, Chinguetti, désert, méharée, patrimoine,
réseaux, tourisme, trekking
Keywords : Mauritania, Adrar, Sahara, Chinguetti, desert, safari, patrimony, network, tourism,
trekking
AUTEUR
SÉBASTIEN BOULAY
UR 200 « Patrimoines locaux et stratégies », IRD/Muséum national d’Histoire naturelle.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
103
Du tourisme culturel au tourismesexuel. Les logiques du désird’enchantementFrom Cultural Tourism to Sexual Tourism: the Logics of Desire for Enchantment
Corinne Cauvin Verner
1 Depuis les années 1990, la guerre civile ayant tari le flux des randonneurs dans le Sud
algérien, les franges sahariennes du sud-est marocain voient la progression constante
d’un tourisme international d’excursion dans le désert. Profitant de cette manne, de
nombreux habitants de la province du Drâa se font commerçants, rabatteurs de
clientèle, entrepreneurs de circuits, de campings, de bivouacs ou de maisons d’hôtes,
chauffeurs de 4x4, guides ou chameliers, selon leurs compétences et leur niveau
d’instruction. Mon attention s’est portée sur quelques-uns de ces prestataires issus
d’une tribu sahraouie qui, en partenariat avec un voyagiste français adhérant aux
principes du tourisme équitable, ont créé à Zagora une petite agence d’excursion
saharienne proposant des circuits de randonnées allant de sept à quinze jours. Au
terme d’une enquête conduite auprès de ce groupe de 1994 à 2004, au cours de laquelle
je me suis jointe, au même titre que d’autres touristes, à huit circuits de randonnées, il
est apparu que malgré le souhait commun au voyagiste, aux touristes et aux guides de
voir mis en pratique un tourisme de découverte, il ne s’opérait pas de véritable
rencontre. Pendant les circuits, touristes et accompagnateurs forment deux groupes
distincts entre lesquels les interactions restent limitées. L’authenticité appelant des
processus de vérification et les randonneurs n’étant pas des experts (Warnier 1996),
ceux-ci doutent constamment de la conformité des lieux traversés, des rôles sociaux et
des pratiques culturelles de leurs hôtes, ainsi que de la singularité de leur séjour auquel
ils prêtaient le caractère d’une aventure. Pour les touristes de sexe féminin, un type
d’interaction transcende toutefois cette mécanique de la déception lorsqu’une « idylle »
se noue avec l’un des accompagnateurs — le plus souvent le guide. Vécu comme un rite
de passage où se trouveraient réactualisées les représentations romantiques du Sahara
et des « Hommes bleus », l’échange sexuel dissipe les frustrations liées à la perception
d’une véritable rencontre avec les populations locales. Mais, presque tous les circuits
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
104
voyant naître une relation entre une touriste et un guide qui, sans être dépourvue de
sentiments, est aussi le lieu très calculé d’une circulation de biens et de services, la
question se pose de savoir s’ils n’instituent pas un tourisme sexuel au Sahara
marocain1.
2 Lorsque j’effectuais mes premiers séjours à Zagora, en 1994, le tourisme n’était pas
l’objet de mon enquête : je m’appliquais à étudier l’imaginaire du désert des oasiens.
Mais dans cette zone frontalière du Maroc et de l’Algérie, agitée par des attaques du
Polisario jusqu’en 1980, mes informateurs me soupçonnaient d’activisme politique en
faveur de la dissidence sahraouie. Le titre d’ethnologue ne me donnait aucun statut et
ne me permettait pas de m’inscrire dans un rapport social. En conséquence, je dus
réfléchir à la place que je pouvais occuper légitimement sur ce terrain. Le tourisme
était une activité économique importante de la région, qui mobilisait de nombreux
acteurs, oasiens ou nomades sédentarisés qui, tout en faisant mine de se rendre
disponibles à mes recherches, cherchaient surtout à me vendre une excursion dans le
désert. Au bout d’un an, je décidais de modifier mon projet initial : puisque mes
informateurs voulaient que je sois touriste, je ferais du tourisme mon objet d’étude.
Assumant ce statut, je n’étais plus l’objet de soupçons sur les dimensions politiques de
mon enquête et, assez paradoxalement, des procédures d’adoption se mettaient en
place avec un groupe de Nwâjî, nomades arabophones de dialecte hassaniya,
sédentarisés à Mhamîd puis à Zagora après les dernières grandes vagues de sécheresse
des années 1970, dont les cadets avaient monté une petite agence de randonnées en
partenariat avec le voyagiste français Croq’Nature. Auprès de ce groupe, plusieurs
types d’investigations ont été combinés.
3 J’ai participé à huit circuits de randonnées. Le premier fut réglé au voyagiste au tarif
habituel, les suivants directement à l’agence de Zagora et à moindre coût. L’entreprise
était familiale. Le patriarche, qui en était le garant moral, voulut dès le deuxième
circuit que la location des dromadaires ne me soit pas facturée. J’ai également séjourné,
plusieurs fois par an pendant dix ans, au sein de l’unité domestique de ce groupe de
Nwâjî — une ferme en pisé à la périphérie de Zagora transformée progressivement en
gîte d’étape pour les touristes. Cette petite ruche avait sa démographie : le patriarche,
né dans les années 1930, avait été successivement berger, méhariste dans l’armée
française, mineur au Tafilalt, commerçant, puis soldat de l’armée marocaine, jusqu’à sa
retraite en 1975. De sa dernière épouse, il avait huit enfants, cinq garçons et trois filles,
nés entre 1965 et 1990, qui tous vivaient sous le toit familial. Auxquels s’ajoutaient
encore la mère et les sœurs de son épouse, des orphelins du lignage, ainsi que plusieurs
tributaires issus des anciens esclaves. Les cinq garçons, qui n’avaient fréquenté que
l’école coranique et n’avaient suivi aucune formation professionnelle, exerçaient tous
le métier de guide et ne recrutaient de guides et de chameliers qu’en fonction du
critère tribal. Le principe, c’était de rester entre Nwâjî. À leurs côtés, j’ai rendu visite à
leurs alliés et collatéraux, je me suis déplacée en pèlerinage au sanctuaire de Sidi Nâjî,
le saint fondateur de leur tribu. J’ai également reçu des guides nwâjî en séjour à Paris et
divers membres de la tribu lorsque, à partir de 2000, je me suis installée à Marrakech.
4 Tous mes interlocuteurs étaient informés de ma recherche. Le voyagiste y était
indifférent. Le patriarche et les femmes du groupe préféraient me croire appliquée à
étudier la généalogie du groupe, réputé chorfa, (descendant du prophète). De fait, j’eus
avec eux de longs entretiens sur la parenté et devais ces dernières années publier des
articles sur l’historique de la tribu dans des magazines marocains. Parmi les cadets,
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
105
j’eus pour informateur privilégié l’aîné des fils, délibérément provocateur et tenu à
l’écart des circuits par le voyagiste, qui lui reprochait son agressivité à l’égard des
touristes lorsqu’il avait consommé alcool ou haschich. Pas plus que le voyagiste, les
touristes ne se sentaient concernés par ma recherche. Ils ne concevaient pas d’être un
objet d’étude. Il allait de soi qu’étant ethnologue, je devais m’intéresser aux
populations sahariennes. Pourtant, jamais ils ne m’interrogeaient sur ma connaissance
du terrain. Ils réservaient leurs questions à leur guide, instructeur légitime supposé
objectiver sa culture au plus près d’une vérité sociale. Ils ne se tournaient vers moi que
pour être renseignés sur le déroulement d’un circuit dont le guide était excédé de
répéter les détails et dont il était manifeste que j’étais familière. Ces touristes étaient
majoritairement français, provinciaux, d’âge mûr, issus des classes moyennes, et
comptaient une plus forte proportion de femmes qui, célibataires ou non, voyageaient
le plus souvent sans leur conjoint.
5 Sur ce terrain et cet objet d’étude, j’ai réalisé quatre films documentaires (Cauvin
Verner 2001a, 2001b, 2002a, 2002b) et j’ai soutenu une thèse (ibid. 2005). Les touristes
avec lesquels je suis restée en relation ont vu mes documentaires, ainsi que chaque
membre du groupe de Nwâjî enquêté. Les guides possèdent des copies de ces films, ainsi
qu’un exemplaire de la version publiée de ma thèse (ibid. 2007) mais, étant
analphabètes, la plupart ne l’ont pas lue. Des touristes ou des résidents français leur ont
fait le compte rendu, principalement sur les questions relatives à la sexualité avec les
étrangères qui occupent l’un des deux derniers chapitres. Des rumeurs selon lesquelles
les guides me reprocheraient d’avoir écrit sur un sujet, qui ne ferait pas « une bonne
publicité » à la vallée du Drâa me sont rapportées. Toutefois, lorsque je séjourne au sein
du groupe ou qu’il me visite à Marrakech, personne ne me cherche querelle sur ce
point, manifestement écarté des conversations.
Le tourisme culturel comme ressource promotionnelle
6 Peu ou prou, le tourisme n’a-t-il pas toujours été motivé par un désir de découverte
culturelle, celui-là même qui fonde le « Grand tour », voyage entre les grandes
universités de l’Europe initié dès le XVIIe siècle ? Institutionnalisé depuis 1976, grâce à
une charte2 révisée tous les six ans par l’Icomos, principal conseiller de l’Unesco en
matière de protection des monuments et des sites, ce tourisme qualifié de culturel n’est
pourtant ni un secteur d’activité économique, ni même vraiment un marché
puisqu’aucun critère ne permet d’évaluer sa rentabilité (Cousin 2006). La charte qui y
réfère énonce des principes, des recommandations et des objectifs dont les différents
acteurs du tourisme peuvent tenir compte mais qu’ils sont aussi en droit d’ignorer. S’y
trouvent évoquées des questions d’éducation, de citoyenneté, de libéralisme, de
développement ou d’inégalités sociales qui ne sont pas nécessairement des
compétences des producteurs et des consommateurs d’activités de tourisme. En l’état
actuel du marché, l’application des dispositions est difficilement repérable. Aucun
indicateur ne permet d’en mesurer la portée et l’efficacité. Il n’en est pas fait mention
dans les bilans statistiques de la fréquentation touristique au Maroc qui est, avec les
transferts financiers des résidents à l’étranger, la principale source de devises du pays
et une option prioritaire du développement : le roi Mohammed VI s’est engagé à
recevoir dix millions de touristes à l’horizon 2010. Ces bilans ne reconnaissent le
tourisme culturel qu’en termes de destinations. Par exemple, la ville impériale de
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
106
Marrakech, riche en monuments (palais, médersas), folklore (place Jemaa el Fna) et
traditions artisanales (souks), motiverait un tourisme culturel, tandis que la ville
côtière d’Agadir ne justifierait qu’un tourisme balnéaire. Mais aucune donnée ne nous
renseigne sur la pratique effective des touristes séjournant dans un riad de Marrakech
ou dans un complexe hôtelier d’Agadir. À la faveur de ma propre enquête, jamais je n’ai
été tentée de qualifier de « tourisme culturel » le type de pratique touristique que
j’étudiais, tout autant susceptible de relever d’un tourisme sportif, pèlerin, de
découverte ou d’aventure, voire d’affaires, certains touristes commerçant de l’artisanat
local pour financer des voyages ultérieurs. Outre que la dénomination « tourisme
culturel » s’inscrit dans une tradition de nomenclature des pratiques touristiques
(tourisme de masse, individuel, sédentaire, itinérant, à forfait, à la carte, etc.),
paradoxalement elle informe peu les modalités concrètes des séjours. Elle est si peu
opératoire qu’on la trouve fréquemment mentionnée entre guillemets.
7 On ne saurait toutefois la considérer comme une fiction marketing. Les clients du
voyagiste Croq’Nature, sans jamais se définir comme des « touristes culturels »
prévoient en effet de pratiquer un tourisme alternatif, marginal, leur permettant
d’entrer en contact avec des nomades et de se familiariser avec leur culture. En ce sens,
on peut dire que la plupart se reconnaissent dans l’idéal-type du « touriste lettré »3 : ils
souhaitent parcourir le désert à pied ou à dos de dromadaire plutôt qu’en véhicule tout
terrain. Ils préfèrent des nuitées à la belle étoile dans les conditions d’un déplacement
caravanier à des étapes confortables dans des bivouacs. Ils occupent leurs soirées par
différents travaux de plume : correspondance, journal de bord, croquis ou aquarelles.
Ils s’essayent à mémoriser un peu d’arabe, s’appliquent à vérifier leur itinéraire sur les
cartes IGN qu’ils ont emportées avec eux et sur lesquelles ils inscrivent les toponymes
indiqués par leur guide. Ils procèdent de la sorte à une intellectualisation du voyage.
8 Assez significativement, le discours promotionnel du voyagiste Croq’Nature adjoint à
cette perspective d’un tourisme culturel celui d’un « tourisme- développement » plus
apte à être objectivé et que la brochure s’applique d’ailleurs à rendre transparente.
Titrée « Voyages équitables et solidaires. À la rencontre des cultures et des peuples de
l’Atlas et du Sahara »4, cette volumineuse brochure insère en effet de longs
développements sur l’historique du coude du Drâa, l’économie du village d’Oulad Driss
à partir duquel s’effectue le départ des circuits, mais aussi un rapport d’activités où des
historiques et des graphiques détaillent les modalités des partenariats avec les
populations locales, la gestion des recettes et la division du travail5. Les touristes y
voient garantie une triple authenticité, de la société locale (des accompagnateurs issus
des tribus bédouines), des prestations du voyagiste (fondées sur des liens personnalisés
avec des groupes locaux), de l’expérience touristique (le temps d’un circuit, vivre « avec
des nomades, comme des nomades »6). En contribuant à redynamiser le pastoralisme, à
créer des dispensaires, des puits et des écoles, à endiguer l’exode rural, ou encore à
sensibiliser à l’écologie moderne, les touristes se sentent ainsi investis d’une mission de
« bienfaiteurs » donnant un sens à leur voyage, autre que l’hédonisme. Ils trouvent le
moyen de se distinguer du touriste de masse (Urbain 1991).
9 Guides et chameliers ne distinguent pourtant pas le touriste de masse du touriste
culturel, pas plus qu’ils ne conçoivent de différence entre un touriste et un voyageur.
Cela étant, ils ne considèrent pas que tous les touristes sont équivalents. Ils se moquent
par exemple volontiers du touriste « FRAM » dont ils détournent le sigle en devise :
« Faut Rien Acheter au Maroc. » Ils préfèrent les touristes individuels voyageant à la
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
107
carte, sans programme défini, dont ils estiment pouvoir tirer toutes sortes d’avantages.
Selon leurs témoignages, le « meilleur » des touristes est âgé de moins de quarante ans,
il voyage seul ou avec un groupe d’amis, il exerce une profession libérale, idéalement
dans la presse car s’en trouveront garanties des conversations animées et une bonne
publicité en Europe, il aime faire la fête, c’est-à-dire qu’il voyage avec des bouteilles
d’alcool et du haschich, et il est enfin une femme, disposée aux aventures amoureuses.
Mécanismes de la déception et rhétoriques del'authenticité
10 Sociologues et anthropologues établissent fréquemment une homologie de structures
entre le tourisme et le pèlerinage, entre le tourisme et les rites de passage. Dean
MacCannell (1976) parle des sites touristiques en termes de lieux sacrés. « Sous le
conformisme grégaire, le rite collectif. Sous le circuit, la cérémonie », écrit Jean-Didier
Urbain (1991 : 231). La brochure du voyagiste Croq’Nature vulgarise le thème de la
quête mystique en évoquant la « magie » de paysages inondés de lumière, et ne manque
pas de citer le proverbe dit touareg : « Dieu a créé des pays pleins d’eau pour y vivre et
des déserts pour que l’homme y trouve son âme. » Elle ménage les effets de rupture ou
de démarcation propres aux scénarii initiatiques : les lieux sont décrits comme « hors du
commun », « paradisiaques », éloignés des grands pôles d’agitation touristique. Elle
annonce épreuves et rites cérémoniels : endurer le manque de confort, faire l’ascension
de la grande dune de Chigaga, boire successivement trois thés dont le premier serait
âcre comme la vie, le deuxième doux comme l’amour, le troisième suave comme la
mort. Le déroulement même des randonnées est susceptible d’être décrit comme un
rite de passage : la « séparation » se ferait au départ du circuit lorsque les touristes se
délestent d’une partie de leurs encombrants bagages et qu’ils se travestissent en
revêtant chèche et sarouel. L’« initiation » se réaliserait tout au long du parcours, avec
un point d’acmé dans les grandes dunes où la caravane fait halte une demi-journée et
une nuit. La « réintégration » aurait lieu au retour en France, accompagnée
d’hypothétiques prises de conscience et d’effets de nostalgie. Pourtant, malgré la petite
efficacité rituelle de ce programme7, un nombre significatif de touristes expriment une
insatisfaction au cours de leur séjour. Ils sont déçus, pour des raisons qui tiennent à
une série de paradoxes : comment authentifier des Bédouins devenus des « nomades de
profession » ? Comment se singulariser dans le cadre d’une expérience collective ?
Comment vivre une aventure tout en respectant un programme ?
11 J’ai en mémoire la protestation d’une touriste lorsqu’un campement fut établi à
proximité d’une maison en terre où, à la fin du jour, une pompe à eau se mit à
fonctionner à grand bruit. Le guide eut beau expliquer que le désert était peuplé
d’habitants vivant de l’irrigation de minuscules parcelles de terre et de l’élevage de
petit bétail, les randonneurs doutaient de se trouver géographiquement au Sahara8. Ils
imaginaient traverser un espace monotone et désolé, sans eau, sans végétation,
impropre à toute autre chose qu’au parcours, où toute vie brusquement se serait
arrêtée pour ne laisser place qu’au vide, au néant. Ils rêvaient d’un au-delà des
frontières, désert des déserts absolu hanté de métaphores maritimes d’où ils auraient
perdu la grève. Au lieu de cela, leur périple s’effectue à l’est de Mhamîd dans des
steppes semi-arides où résistent armoises, alfas, tamaris, acacias, euphorbes et
coloquintes. Ils ne sont jamais bien loin d’une oasis ou d’un puits. Ils suivent des
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
108
sentiers, des pistes, le long desquels ils croisent des troupeaux de chèvres et de
dromadaires, des bergers, parfois même d’autres groupes de touristes, la concurrence
entre les agences locales entraînant une surexploitation des sites. Hors l’erg Chigaga,
atteint à mi-parcours à raison d’environ trente kilomètres par jour, les paysages ne leur
offrent que très peu de ces hauts reliefs dunaires qui illustrent les brochures des
voyagistes et servent de décor à la promotion des destinations sahariennes.
12 Ils doutent également de se trouver en présence de « vrais nomades » et d’être les
témoins de traditions culturelles ancestrales. Méconnaissant la société qui les accueille,
ils cherchent à distinguer le vrai du faux, l’hérité de l’inventé, le spontané du folklorisé,
comme en témoigne ce dialogue enregistré avec ma caméra en 2000 auprès de touristes
allemands, étudiants en art et en architecture :
« — Je n’ai pas ressenti ça comme typiquement nomade.— Moi j’ai trouvé qu’ils faisaient beaucoup de choses pour eux-mêmes [...]. Quand ilsont chanté, dansé, ça leur faisait vraiment plaisir. Ils ne l’ont pas fait par obligation,pour nous divertir. J’ai trouvé ça très authentique.— S’ils étaient seulement entre eux, s’ils n’avaient pas besoin de l’argent destouristes, leur vie serait différente, ils conserveraient davantage leurs racinesculturelles [...]. Je ne dirais pas que j’ai trouvé ça très authentique, comme la vraievie des nomades. »
13 En effet, leurs guides nwâjî s’adaptent à ce qu’ils perçoivent de leurs attentes. Par
exemple, il leur arrive de se dénommer Touareg, alors qu’ils ne le sont pas (Cauvin
Verner 2009). Lorsqu’ils n’accompagnent pas des groupes dans le désert, ils s’habillent
quelquefois à la mode occidentale. Dès qu’un client se présente, ils revêtent la tenue
traditionnelle de « l’Homme bleu ». Mais ces folklorisations restent mesurées, sinon
maîtrisées. Toute gandoura bleue n’identifie pas un professionnel du tourisme ou un
« faux guide »9 et ses usages ne se limitent pas au seul champ de l’activité touristique.
Plusieurs des guides nwâjî auprès desquels j’ai enquêté s’habillent occasionnellement
de cotonnades bleues lorsqu’ils séjournent à Marrakech ou même à Paris. Il s’agit alors
d’afficher comme une distinction leur identité culturelle de nomades sahariens.
14 Le nombre des accompagnateurs varie selon le volume des groupes. Il faut compter un
dromadaire par touriste et un chamelier pour deux à trois dromadaires. Seul le guide
parle une langue européenne. Les touristes ne parlant pas l’arabe, les interactions avec
les chameliers sont donc très limitées. Pendant les temps d’arrêt des circuits, ceux-ci
sont très actifs à prendre soin des dromadaires, installer le campement, préparer le feu,
les repas, puiser l’eau et ramasser du bois mort. Bien qu’ils aient souhaité s’initier à la
vie nomade, les touristes restent oisifs. Au fil des péripéties du circuit (inconfort,
fatigue, mélancolie), leurs intentions initiales se délitent. Lorsque le guide leur propose
d’aller chercher du bois, les uns déclarent être trop fatigués, les autres qu’il ne s’en
trouve plus à des kilomètres à la ronde. Ils n’aident pas à éplucher les légumes et se
lassent assez vite de décharger les dromadaires ou d’aider à la mise en place des
campements. Un peu comme s’ils séjournaient à l’hôtel, ils attendent d’être servis et
leur guide ne manque pas de finir par leur adresser la remarque grinçante « alors, ça va
l’Hôtel mille étoiles ? ».
15 De la sorte, touristes et chameliers forment deux groupes distincts qui se maintiennent
à distance l’un de l’autre pour manger, dormir, causer et s’amuser. Entre ces deux
groupes, le guide assure une fonction de médiateur : il est le seul à comprendre la
langue et les attentes des clients. Plusieurs séjours en Europe pendant la saison estivale
lui ont généralement permis de parfaire cet apprentissage. Il est éclaireur, leader, et
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
109
également mentor : il dirige la troupe, indique les choses à voir, montre la marche à
suivre, programme les rencontres avec les populations locales. Il est le responsable de
toute l’organisation, de l’approvisionnement en nourriture, en eau, de la sécurité du
groupe, tout autant que de sa cohésion : il lui faut éviter que survienne un conflit,
veiller à ce que s’instaurent des sociabilités et à ce que se maintienne une « bonne
ambiance ». Il veille à ce que les randonneurs ne manquent de rien mais il ne leur
délivre pas spontanément de discours interprétatif de sa culture et paraît souvent las
de répondre à leurs questions. Il ne se mêle à eux ni pour manger, ni pour dormir, et ne
se rend disponible qu’au moment où l’on sert le thé, peu après l’établissement des
campements. Aussi les touristes essaient-ils de capter son attention, afin de bénéficier
de ses commentaires ou simplement d’entrer en interaction avec lui, car de la qualité et
l’intensité de cette interaction dépend pour une grande part leur perception d’un
voyage réussi.
La sexualité avec un guide comme performancerituelle
16 La recherche de plaisir et d’émotions est une des motivations importantes des
randonneurs. Ayant conscience que le temps des vacances est en quelque sorte
« chronométré », ils souhaitent profiter de chaque instant, auquel ils cherchent à
donner une intensité particulière. Ainsi les voit-on trouver une incomparable saveur à
une simple salade de crudités, un moment de repos ou de complicité avec leur guide,
qu’ils ne confondent pas avec les immigrés maghrébins qu’ils ont l’occasion de
fréquenter dans leur pays. Ils prêtent en effet aux nomades du Sahara toutes sortes de
valeurs d’exception : courage, fierté, liberté, sens de l’honneur, hospitalité. À cette
altérité codifiée du Bédouin romantique (Pouillon 1996), s’ajoutent des attributs
physiques et comportementaux perçus comme séduisants : drapés élégants de
cotonnades bleues, virilité tempérée de féminité, visage voilé, regard souligné de khôl,
aptitude au jeu, à la musique et à la danse, langue inconnue à laquelle suppléerait un
langage du corps « instinctif et animal, doux et délicat » (Bowles 1952 : 250). Le désert
lui-même est surinvesti de sensualité : les randonneurs ne manquent pas de comparer
les courbes des dunes à un corps de femme. Leurs perceptions sont aiguisées en maints
« frémissements » de la peau au contact du sable, « caresses » du vent, « morsures » du
soleil, « vertiges » face à l’immensité... Combinée à la force des éléments naturels, à
l’inconfort, à la fatigue et à la perte des repères habituels, cette érotisation de l’espace
désertique prédispose à un échange sexuel vécu au même titre que le rythme soutenu
de la marche comme une performance.
17 La brochure du voyagiste Croq’Nature recommande de « s’abandonner », « de vivre le
désert de l’intérieur, de façon à se perdre et se reconquérir pour trouver l’essentiel ».
Les randonneurs ont conscience de cette parodie de rite de passage. Au terme de leur
séjour, ils savent bien qu’ils n’ont fait que « jouer » à suspendre leur vie ordinaire. Un
randonneur, philosophe de formation, qui encadrait un séminaire de ressourcement
pour des éducateurs de l’institution Les Orphelins Apprentis d’Auteuil, le formulait en
ces termes :
« Pouvoir courir dans les dunes, c’est une histoire d’enfance [...]. Dormir à la belleétoile, c’est une histoire d’enfance [...]. C’est une très belle autorisation au jeu, on
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
110
peut faire comme si tout était possible, comme si les règles habituelles n’étaientplus en vigueur [...]. On peut se salir, ne pas se laver pendant dix jours [...]. »
18 Le guide n’a pas à déployer toutes sortes de ruses pour séduire une touriste de son
groupe. Il lui suffit de marquer son intérêt par quelques flatteries et attentions
particulières. Dès le premier jour, il met en place une stratégie de séduction auprès
d’une touriste déterminée dont il ne modifiera pas le choix, quand bien même celle-ci
repousserait ses avances. Lors du premier campement nocturne, comme c’est
l’habitude à chaque circuit, il questionne chaque randonneur sur son activité
professionnelle, son nom, son âge, son lieu de résidence, etc. En fonction des
indications recueillies, avec la complicité des chameliers, il attribue un surnom à
chacun10. La femme convoitée hérite de prénoms flatteurs : Zahra, « la fleur », Dâwiya,
« celle qui illumine », Adju, « celle qui revient », tandis que celles qui l’indiffèrent,
parce qu’il les trouve vieilles, laides ou peu sympathiques, se voient affubler de
prénoms dont il est évident qu’ils ne leur plairont pas — par exemple Fatima, que les
touristes exècrent pour les connotations vulgaires qu’il reçut à l’époque coloniale, ou
même « la chiante ». Une fois le repas terminé, le guide vient s’asseoir auprès de la
touriste convoitée, il converse avec elle, se montre tendre et affectueux. Ses qualités de
séducteur ne reposent pas seulement sur son apparence physique, sa gestuelle, son
charme ou sa capacité à établir une relation de confiance mais aussi sur l’acquisition
des codes sociaux européens liés à l’égalité des sexes, la sophistication vestimentaire,
les manières de table ou d’hygiène, l’expression orale et l’humour. Au bout d’un certain
temps, il cherche généralement à entraîner la touriste à l’écart du groupe pour
contempler le ciel étoilé : un échange sexuel se produit alors parfois dès ce premier
soir, auquel les touristes déclarent ne pas avoir la tentation de résister, comme si elles
ne s’appartenaient plus. Le cours des choses semblant relever d’une nécessité
intérieure, l’issue est dédaignée. Ce qui se joue, c’est le sens de la vie11.
19 Les touristes ne cherchent pas à dissimuler que le guide est leur amant. Tout au
contraire, elles semblent en éprouver une certaine fierté : une intimité se construit, qui
crée un état de « permanence euphorique » et transcende la situation touristique par
un équivalent de rite d’agrégation faisant défaut aux interactions habituelles.
L’idéalisation romantique du Sahara et des « Hommes bleus » trouve là un point
d’ancrage : l’échange sexuel permet de dénier tout à la fois la réalité économique de la
relation et l’aspect ludique de l’expérience. Il détourne le rapport marchand en rapport
interculturel (Winkin 1999). À une touriste devenue l’amie d’un guide, l’équipe des
accompagnateurs réserve en effet des attentions particulières. À la fin du circuit, ou à
l’occasion d’un prochain voyage, l’étrangère est invitée à séjourner au domicile familial
de son amant, où les sœurs et les tantes s’amuseront à la vêtir à la mode sahraouie, à
dessiner au henné sur ses mains, à l’emmener en visite au sanctuaire. Selon les cas, les
partenaires se reverront, à Zagora où la touriste s’efforcera de venir plusieurs fois par
an, ou en Europe où le guide voyagera s’il réussit à obtenir un visa. Dans ces conditions,
l’échange sexuel avec un guide tient-il de l’accident ou de la norme ? Il satisfait tout à la
fois un désir d’exotisme, d’aventure, de romantisme, et de revalorisation du statut.
Mais s’y profile également une métaphore de conquête qui, en raison de l’aspect
économique de la situation, se trouve nourrie d’hostilité et d’agressivité. Les touristes
ont dépensé de l’argent pour accéder à l’authenticité d’un monde. En couchant avec un
guide, ne produisent-elles pas l’équivalence d’une relation de prostitution ?
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
111
Logiques transactionnelles
20 Lorsque je commençais mon enquête sur le tourisme au Sahara marocain, je
n’imaginais pas être prise à témoin d’échanges sexuels. Pourtant, dès ma première
randonnée, il apparut que trois femmes eurent une liaison avec chacun des trois guides
qui encadraient le groupe12. Plusieurs des circuits auxquels je devais participer par la
suite virent ces échanges se répéter. À chacun de mes séjours, une « copine »13
étrangère était accueillie au sein de l’unité domestique de ces Nwâjî auprès desquels
j’enquêtais. Avec certaines d’entre elles, je devais maintenir des liens d’amitié et me
trouver malgré moi en position de confidente comme si, compte tenue de ma
familiarité avec les guides, j’avais été en mesure de leur prodiguer des conseils. Je fus
de la sorte prise à témoin, assez intimement, de plusieurs aventures. Depuis la
publication de ma thèse, plusieurs touristes auprès desquelles je n’ai jamais séjourné à
Zagora ont pris contact avec moi pour me confier leur témoignage. D’autres, que je
rencontre fréquemment et dont j’aimerais recueillir l’histoire, au contraire refusent de
me la communiquer. S’il arriva que je fus moi-même courtisée, ce n’était pas des plus
fréquents : j’étais mariée et mère de deux enfants qui souvent m’accompagnaient
lorsque je ne devais pas randonner. J’étais sous la protection des femmes et du
patriarche, perçue comme une sorte de cousine lointaine qui engrangeait de la
mémoire nwâjî. Appliquée à maintenir ces liens d’adoption, je percevais ce qu’il y aurait
eu d’inconfortable à entretenir une liaison avec l’un des cadets. Enfin, à être le témoin
des conflits et des chagrins qu’occasionnaient ces échanges, je n’avais plus aucune
illusion romantique. J’étais affranchie.
21 Peu d’ethnographies ont été consacrées à des cas analogues d’échanges sexuels entre
des touristes féminins et des indigènes masculins. Je ne peux mentionner que celles
conduites à Jérusalem par Cohen (1971) et Bowman (1990), à la Barbade par Karch &
Dann (1981), en Jamaïque par Pruitt & Lafont (1995), et en Équateur par Meisch (2005).
En France, le film Vers le Sud (2005)14, leur a donné une visibilité auprès du public. Elles
posent une double difficulté : celle de leur problématisation en termes de tourisme
sexuel, et celle de leur spécificité en termes de genre : les dynamiques de ces échanges
sont-elles différentes selon que les touristes et leurs partenaires sexuels sont masculins
ou féminins ? En l’absence d’enquête comparative, je peux difficilement répondre à ces
questions. N’ayant jamais réfléchi aux types de pratiques susceptibles de caractériser
un « tourisme sexuel », aucun de mes travaux n’avait, jusqu’à ce jour, formulé en ces
termes la sexualité avec les étrangères. Je m’y risque pour la première fois, sans
prétendre pouvoir développer la question de sa pertinence.
22 Étudiant les échanges sexuels entre des touristes masculins et des indigènes féminins
en République dominicaine, Brennan introduit la notion de sexscape, en référence aux
travaux d’Appadurai (2001) classant les flux culturels globaux en cinq paysages
construits par l’imagination. Sa définition du sexscape — consommation de sexe tarifée ;
inégalités de race, de genre, de classe, de nationalité et de mobilité entre les acheteurs
et les vendeurs ; érotisation de l’altérité, présente dans les imaginations et promue par
l’industrie touristique (Brennan 2004 : 16) — ne s’applique que partiellement à la
situation que j’ai étudiée au Sahara marocain. En effet les différences culturelles y sont
érotisées sur la base de stéréotypes racialisés : d’un côté la femme occidentale riche,
indépendante, éduquée, moderne et désinhi- bée qui, en opposition à la sexualité
normée caractérisant la relation matrimoniale dans les sociétés musulmanes, « accepte
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
112
de faire l’amour dévêtue dans les dunes et même en plein jour », commentent les
guides ; de l’autre le nomade saharien exotisé en « Homme bleu », démuni et
analphabète mais orgueilleux, romantique, inaliénable (incarnant une sorte de contre-
culture), sensuel et si ardent qu’« une boîte de préservatifs n’aurait pas suffi pour
passer la nuit », expliquent les randonneuses pour justifier de n’en avoir pas utilisés.
23 Toutefois, l’échange sexuel n’est pas tarifé et il motive rarement le premier voyage. La
plupart des touristes auprès desquelles j’ai enquêté, si elles y étaient disposées, ne
l’avaient en aucune façon programmé ni même imaginé15. Aucune expertise ne fait
mention du Sahara comme une destination de tourisme sexuel bien que, dès les années
1920, des films de fiction aient commencé de mettre en scène les amours interdites du
Bédouin et de l’Occidentale16 et que des échanges analogues puissent être observés au
Mali, au Niger ou encore en Jordanie. Ces échanges présentent un caractère de
permanence et d’affection. Les partenaires restent en relation téléphonique et
épistolaire. De nombreux guides ne sachant pas lire le français, requièrent l’aide des
étrangers de passage. J’ai de la sorte été chargée de la lecture et de la rédaction de ce
courrier du cœur. Les lettres des touristes sont très sentimentales, fréquemment
accompagnées de poèmes sur « la simplicité de la vie des nomades et la sagesse de leur
philosophie ». Leurs amants souhaitent y répondre par le souvenir de moments
d’intimité sexuelle et la perspective de retrouvailles. S’ils tendent à nier qu’ils sont
« amoureux », certains m’ont dit s’être senti « écrasés » par la femme étrangère, au
point de consulter un fqîh17 avec une mèche de cheveux lui appartenant pour se
délivrer de ses sortilèges. Il m’est arrivé d’être prise à témoin du chagrin de l’un d’eux
après que « sa copine » lui ait signifié qu’elle rompait et ne reviendrait jamais plus. Il
était recroquevillé à son domicile, il avait prit froid, il toussait et me déclara que sa
peine était aussi grande que celle ressentie le jour où il avait perdu un bébé chameau. Je
vis un autre sangloter un jour, de ne pouvoir se lier durablement ni à une Marocaine,
dont il jugeait qu’elles avaient le cœur endurci, ni à une Française, qu’il percevait au
contraire comme trop sentimentales et au sujet desquelles j’ai entendu maintes fois :
« Elles sont chiantes ! » Le plus souvent, les touristes reviennent au moins une fois
visiter leur amant. Selon les cas, les liaisons peuvent conduire à une émigration
définitive ou temporaire, du guide en Europe, ou plus rarement de la touriste au Maroc.
Certaines ont vu naître des enfants. Faut-il pour autant les qualifier de « tourisme
d’idylle » (Pruitt & Lafont 1995) ?
24 Sans être l’objet d’un commerce de type strictement monétaire, ces liaisons procurent
aux guides de randonnées toutes sortes de gratifications. Conformément aux
prescriptions islamiques de ségrégation sexuelle, chez les Nwâjî la mixité est prohibée :
les possibilités de rencontre entre hommes et femmes sont donc limitées, codifiées,
voire ritualisées par le cadre strict des mariages, hors lequel tout échange hétérosexuel
est proscrit. Dès lors, les célibataires trouvent dans la fréquentation des touristes une
compensation. Sur le caractère transgressif de ces échanges au regard des normes et
des valeurs de la société bédouine, il est prévu de conduire une enquête
complémentaire. En effet, ils sont loin d’être généralisés : les touristes masculins ne
peuvent y prétendre, ni les « déclassés » (anciens esclaves ou métayers). Ils sont
transgressifs, puisque l’islam reconnaît dans le mariage la seule forme légale et admise
de sexualité, mais ils sont explicitement reconnus par l’ensemble des acteurs sociaux et
restent solidement normés18.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
113
25 Paradoxalement, ils peuvent même garantir une revalorisation du statut. Les Nwâjî
sont marginalisés dans la masse berbérophone des Aït Atta établis au nord du coude du
Drâa. Les citadins les qualifient avec dédain de ‘arû- biya, Bédouins, dans le sens
péjoratif de « péquenauds ». Identifiés au plan national comme des Sahraouis, ils sont
très surveillés par les autorités. La plupart n’ont fréquenté que l’école coranique et ne
savent ni lire ni écrire19. La fréquentation intime des étrangères atténue les effets de
cette marginalisation : à leur bras, ils sont admis dans les bars des hôtels quatre étoiles
de la ville. La relation est également gratifiante du point de vue intellectuel : les guides
entretiennent avec les touristes de longues conversations qui les renseignent sur le
vaste monde où ils ont les plus grandes difficultés à voyager. Confrontés à la monotonie
d’un travail répétitif et dévalorisant, ils y trouvent un élargissement du champ
d’expérience et du réseau social, et même une certaine ivresse, confortant la thèse du
sociologue libanais Sélim Abou (1981 : 75) selon laquelle il y a multiplication des
aventures sexuelles lorsque, d’une part, les cadres de référence de la société d’origine
et les normes de comportement y attenant n’ont plus de prise sur la conscience, et
lorsque, d’autre part, les individus n’ont pas encore intériorisé les cadres et les normes
de la culture de l’autre. « Ils traversent alors une sorte de chaos culturel, dans lequel
une activité sexuelle débordante compense un vide psychologique et moral angoissant,
et tient pour ainsi dire le rôle d’une drogue. » La fréquentation d’une étrangère
améliore également leur niveau de vie. Elle est en quelque sorte rétribuée par des
cadeaux divers : achat de kif, de cigarettes, d’alcool, d’un logement et parfois même
obtention d’un visa20 ; prêt, non remboursé, pour l’achat de terres ou de dromadaires,
etc. Le secteur touristique étant très compétitif et l’activité saisonnière aléatoire, les
prestataires en viennent à produire une équivalence entre leurs compétences de guide
et de séducteur. Plus que de séduire, il s’agit alors de conquérir, et ces conquêtes sont
véritablement capitalisées, comme autant de chances de promotion sociale et de
revanche. On observe par exemple que les lettres écrites par les touristes sont l’objet
d’une compétition. Les adresses ne se donnent pas, ne s’échangent pas, ne se vendent
pas. Chance d’émigration, c’est à qui en détiendra le plus. Les frères se querellent pour
une visite en Europe chez une touriste qui ne figurait pas dans le carnet du visiteur. Ils
se comportent en rivaux. Ils ne sympathisent pas avec la copine de l’autre. Plutôt, ils la
dénigrent, jugeant qu’elle est laide, maigre, vieille ou peu généreuse. À moins qu’ils ne
tentent de la séduire, pour prouver qu’elle est prête à coucher avec n’importe qui. La
conquête des étrangères est alors susceptible de réactiver un ressentiment de race, de
genre et de classe illustrant la thèse de Roger Bastide (1970 : 78) selon laquelle « c’est
dans l’étreinte même de deux partenaires sexuels de couleur différente ou dans la
courtisa- tion qui la précède, dans ces moments privilégiés qui semblent être un défi au
racisme et la redécouverte de l’unicité de l’espèce humaine, que nous allons voir se
glisser le racisme, paradoxalement, sous ses formes les plus haineuses, les plus
méprisantes ».
Des rapports de pouvoir discontinus
26 « Qui baise l’autre ? », pourrait-on questionner à la suite de l’article de Bowman (1990)
intitulé « Fucking Tourists ». Captant le guide, sorte de cultural broker attitré (Cohen
1985), dans une intimité faisant défaut aux interactions avec les autres touristes, les
touristes voient satisfaites leurs prétentions à un tourisme de découverte culturelle.
Bien qu’elles évaluent que la relation se soit établie sur la base d’une attraction
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
114
réciproque, elles ont rarement choisi leur amant : un circuit n’emploie qu’un seul guide
et les échanges avec les chameliers sont, comme on l’a vu, très limités, voire proscrits.
Elles sont donc plus courtisées qu’elles ne courtisent elles-mêmes. Les séducteurs de
touristes ne formulent pas de jugements de valeur sur les étrangères qu’ils savent
indépendantes économiquement et donc libres de voyager seules. Mais ils pensent
qu’elles sont toutes potentiellement à la recherche d’une aventure et ils les imaginent
souvent plus riches qu’elles ne le sont. Certains séduisent une touriste à chaque
randonnée, quelquefois sur le mode du harcèlement (des plaintes sont alors déposées
auprès du voyagiste), quand d’autres sont plus réservés. Ils sont curieux
d’expérimenter une sexualité différente, de nouveaux modes de relation entre hommes
et femmes, mais ces mêmes raisons qui ont justifié leur attirance sont aussi susceptibles
d’éveiller un sentiment de honte, voire de répulsion. En effet, les séducteurs restent
dépendants des touristes, économiquement et même affectivement puisqu’il leur
appartient rarement de décider de la poursuite d’une relation : ils ne sont pas en
mesure, ni d’obtenir un visa, ni de s’offrir un séjour en Europe. Ce sont les touristes qui
décident, ou non, de revenir, de faire des démarches administratives ou de pourvoir
aux frais d’un voyage.
27 Certaines d’entre elles, parmi les plus âgées, qui se sont installées à Zagora, peuvent
être amenées à changer de partenaire pour quelqu’un qu’elles jugent plus désirable,
plus fidèle ou plus éduqué. Elles gardent le contrôle de la situation, formulent des
exigences — quand, en regard des normes locales, il est impensable qu’une femme dicte
ses volontés affectives. Si accepter leur aide financière n’entache pas leur
respectabilité, il ne sied pas qu’elles évaluent trop précisément l’importance de leurs
dons. Lorsqu’elles ont créé en partenariat avec leur amant une petite affaire d’artisanat
ou d’hôtellerie locale, elles ont fourni les capitaux et restent aux commandes de
l’entreprise. L’amant se trouve alors en opposition avec ses normes culturelles : un
homme n’est pas supposé être entretenu par une femme que tout le monde raille en
l’appelant « la grand-mère ». Au lieu d’être gratifié, il se sent humilié, doublement
exploité à des fins sexuelles et économiques : l’étrangère « profiterait » de lui pour
séjourner gratuitement dans le pays, acquérir au meilleur tarif de l’artisanat, etc.
28 Mais il existe une marge de fabrication d’une autonomie, voire d’une résistance au sein
de cette situation postcoloniale. Les dernières années de l’enquête ont vu certains
guides mettre brutalement un terme à leur liaison pour épouser la fille de leur oncle
paternel — conformément aux règles de l’endogamie pratiquée chez les Nwâji — alors
même qu’ils élaboraient un projet d’émigration, et étaient le père d’enfants mâles avec
des étrangères. Nous avons également observé que certains autres, généralement les
plus démunis économiquement, s’absentaient à l’occasion d’une visite qu’ils avaient
pourtant appelée de leurs vœux, ou se livraient en présence de leur « copine » à la
conquête ostensible d’autres touristes. Par là, ils tentent de stabiliser les rapports
sociaux en réintroduisant leurs propres normes relatives à la séduction et à la
sexualité.
29 Dans certains cas assez rares mais qui marquent durablement les rapports sociaux, les
touristes s’offrent si facilement qu’il n’est plus besoin de les séduire. Les guides se
sentent alors dépossédés de leur virilité. Les pôles masculin/féminin, actif/passif, se
renversent : au lieu de conquérir, ils se sentent chassés, c’est-à-dire dire traités comme
des femmes et des prostitués : « Elles viennent toutes pour profiter de l’amour ! »
Lorsqu’ils se sentent harcelés, ils expriment une forme de dégoût : « Mais pour qui elles
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
115
se prennent, tu as vu comme elles sont belles les Marocaines ! » Leur estime d’eux-
mêmes se trouvant bousculée, ils jugent alors que les touristes sont trop émancipées
(ils insistent notamment sur leurs exigences sexuelles), et ils se mettent à valoriser, par
contraste, les normes locales d’inégalité des sexes. Ils songent avec nostalgie aux filles
des tribus et se promettent de ne plus toucher une étrangère. Le soir, dans les bars, ils
ne parlent que de l’argent qu’ils ont réussi à soutirer aux touristes de passage et du
nombre de femmes qu’ils sont arrivés à séduire — vente et séduction sont toujours
entrelacées. Se crée ainsi une sorte d’arène de compétition où ils paradent, au sens
quasi rituel du terme (Goffman 2004), pour rendre publique leur compétence à vaincre
l’intégrité économique et corporelle d’une touriste construite comme une adversaire.
Ils exagèrent le nombre des occasions qui se sont offertes à eux — le refus de certaines
propositions redouble le prestige d’un séducteur. Ils se vantent d’avoir possédé les
femmes en des endroits qu’ils jugent peu convenables (un coin de dune), et parfois
même en cachette de leur mari — preuve qu’ils seraient irrésistibles. Les touristes
masculins ont conscience de cette compétition à la virilité. Un jour, j’ai entendu l’un
d’eux s’exclamer : « Non mais ils font quoi avec les femmes françaises ? ! [...]. Ils nous
prennent nos femmes mais nous, les leurs, on ne peut pas les approcher ! »
30 Dans leurs conversations, les séducteurs de touristes opposent souvent les chrétiennes
aux musulmans et, plus curieusement, les Blanches aux Noirs. Les Nwâjî ne sont pas
noirs de peau. En s’attribuant de la couleur, ils créent de l’adversité : s’ils parviennent à
transgresser l’interdit de « la femme blanche », n’est-ce pas qu’ils sont plus forts, plus
virils que les touristes, ou bien que leurs femmes sont « des filles à nègres » ? De
nombreux récits exposent des situations où une touriste aurait couché successivement
avec plusieurs guides, ou bien se serait munie de préservatifs. Il y va du rétablissement
de la masculinité locale.
31 De leur côté, les touristes délaissées par un amant infidèle peuvent être amenées à faire
des commentaires peu élogieux sur sa sexualité, jugée bestiale et inexpérimentée.
Lorsqu’elles sont accueillies au sein des unités domestiques, elles sont invitées à
partager le repas avec les aînées — et il faut voir dans ce partage du pain et du sel un
geste d’adoption qui fait défaut à l’accueil des autres touristes. Selon leur statut, il leur
est permis, en l’absence de leur amant, de partager la chambre des femmes ou des
jeunes filles21. Elles participent aux travaux collectifs : cueillette des légumes,
préparation des repas, corvées de vaisselle, de lessive ou de ménage. Toutefois, la
cohabitation n’est pas exempte de tensions au regard des normes sociales et religieuses
du groupe. Elles restent des étrangères, dénommées nasrâniyât, chrétiennes. L’échange
sexuel ne scelle aucune alliance. Les guides ont toujours en tête de courtiser d’autres
touristes ou d’épouser leur cousine, et l’hospitalité comporte autant de droits que de
devoirs : l’étrangère qui ne tient pas la place qui lui est assignée, qui perturbe
l’équilibre de la vie familiale, tente de modifier les règles de ségrégation sexuelle et
reçoit des touristes comme s’ils étaient ses propres invités provoque l’indignation
générale. Les aînées ne manquent pas, entre elles, de protester et de dénigrer ces
femmes qui leur prennent leurs enfants, favorisent leur adoption de valeurs
occidentales et les incitent à émigrer. Certaines formulent la prière suivante à
l’occasion des visites aux sanctuaires : « Faites que nos garçons n’aillent plus avec les
femmes blondes, elles sont comme des vipères. »
32 Pour ceux qui occupent à Zagora le bas de la hiérarchie (militaires, nomades
sédentarisés, métayers agricoles), l’échange sexuel avec une touriste est un moyen
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
116
d’ascension sociale : seuls les nantis et les puissants possèdent beaucoup de femmes.
Mais ils pensent que ces touristes libres de voyager sans la protection d’un mari ou d’un
parent masculin témoignent de la décadence des sociétés occidentales. Ceux qui
bénéficient à Zagora d’une reconnaissance sociale (fonctionnaires, lettrés, notables)
associent ce commerce sexuel à une activité frauduleuse qui porterait atteinte à la
dignité des hommes du pays. Ils dénoncent la corruption des mœurs que provoquerait
le dévergondage des touristes, assimilées à des prostituées. Les autorités répriment
sévèrement tout manquement à la loi : un Marocain et une étrangère ne sont pas
acceptés dans une chambre commune à l’hôtel et ne sont pas autorisés à habiter
ensemble à moins d’être mariés ou de justifier d’un certificat de concubinage établi en
France.
33 Dès lors, des scandales éclatent régulièrement. À titre d’exemple, en voici deux d’entre
eux. Le premier impliquait une Française, âgée d’une quarantaine d’années, venue
créer une maison d’hôtes à Zagora. Elle hébergeait un employé marocain avec lequel
elle entretenait une liaison. Le couple fut dénoncé et comparut devant le tribunal. Lors
de son entretien avec le procureur, la femme fut accusée de prostitution, qualification
impropre au vu des données économiques de la relation, mais il n’existait aucun cadre
législatif à l’expérimentation de cette nouvelle division du travail. Le second impliquait
une femme hollandaise d’une soixante d’années, éprise d’un chamelier nwâjî marié et
père de famille. Les femmes de la tribu s’opposèrent à cette union qui signifiait
l’abandon de l’épouse et des enfants. Alors la Hollandaise négocia : le chamelier aurait
un visa pour la Hollande ; il recevrait un salaire dont il verserait une partie à son
épouse, auprès de laquelle il reviendrait périodiquement. Quelques semaines plus tard,
le couple était marié devant le cadi et la Hollandaise convertie à l’islam, pour prévenir
toute attaque juridique ou morale. De Hollande, elle envoyait l’argent nécessaire à
l’édification d’une maison. Mais lorsqu’elle revint à Zagora, elle dut constater que celle-
ci était occupée par la première épouse. Elle négocia alors que, le temps de son séjour,
le chamelier lui accorde toutes ses nuits et, afin d’être obéie, menaça de suspendre
toute aide matérielle. L’amour, disait-elle, « ne devait pas faire oublier que la relation
reposait sur un contrat ». Elle ignorait alors que le chamelier, en possession de ses
nouvelles richesses, avait profité de son absence pour se marier à une troisième femme.
De la sorte, il trouvait le moyen de s’affirmer affranchi de toute domination. Aussi, bien
que les touristes expérimentent une certaine revanche sociale à voyager
indépendamment des hommes, suspendre leur morale sociale, s’affirmer comme
« sujets » de leur sexualité (Tabet 1987) en prenant un amant indigène qu’elles
dominent économiquement, on les voit échouer à renverser le rapport d’inégalité entre
les sexes : leur autonomie crée un être socialement dangereux, proche de la
délinquance morale. Quels que soient les sentiments qui les fondent, les échanges
restent déterminés par un ordre stratégique à l’allure agonistique très marquée. Les
guides en saisissent l’occasion pour renverser les positions de domination instituées
par la situation touristique et rétablir une hiérarchie où prévalent leur masculinité et
leurs valeurs sociales.
34 Ce ne sont donc pas tant les discours promotionnels des séjours qui définissent la
pratique touristique, que le type de relations susceptibles de se construire entre les
touristes et les indigènes. Les interactions étudiées au Sahara marocain montrent que
la prétention à un tourisme culturel crée les conditions d’un tourisme sexuel qui, sans
être tarifé, est gouverné par une logique transactionnelle de biens matériels et
immatériels qui l’institue comme une composante de l’économie locale : la séduction
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
117
des étrangères est capitalisée et elle est l’objet d’une compétition, notamment parce
qu’elle permet de s’enrichir, de renégocier sa marginalité et même d’émigrer.
BIBLIOGRAPHIE
ABOU, S.
1981 L’identité culturelle. Relations interethniques et problèmes d’acculturation, Paris, Anthropos.
APPADURAI, A.
2001 Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Payot.
BASTIDE, R.
1970 Le proche et le lointain, Paris, Cujas.
BERTOLUCCI, B.
1990 Un thé au Sahara, fiction, 138 min., adaptée du roman de Paul Bowles, Royaume-Uni-Italie,
The Sahara Compagny Limited & Tao Films.
BOWLES, P.
1952 Un thé au Sahara, Paris, Gallimard.
BOWMAN, G.
1990 « Fucking Tourists. Sexual Relations and Tourism in Jerusalem’s Old City », Critique of
Anthropology, 9 (2): 77-93.
BRENNAN, D.
2004 What’s Love Got to Do with It: Transnational Desires and Sex Tourism in the Dominican Republic,
Durham-London, Duke University Press.
CANTET, L.
2005 Vers le Sud, fiction, 115 min., adaptée d’une nouvelle de Dany Lafferière, France, Haut et
Court productions.
CAUVIN VERNER, C.
2001a L’appel du désert, documentaire, 52 min., Paris, Lili Productions, Diffusion Épinal.
2001b Nomades de profession, documentaire, 52 min., Paris, Lili Productions, Diffusion Épinal.
2002a Les Nouaji, documentaire, 52 min., Paris, Lili Productions, Diffusion Épinal.
2002b Les noces de Nazha, documentaire, 52 min., Paris, Lili Productions, Diffusion Épinal et France
5.
2005 Au désert. Jeux de miroirs et acculturation. Anthropologie d’une situation touristique dans le Sud
marocain, Thèse de doctorat, Paris, EHESS.
2007 Au désert. Une anthropologie du tourisme dans le Sud marocain, Paris, L’Harmattan.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
118
2009 « Les Hommes bleus du Sahara, ou l’autochtonie globalisée », Civilisations, LVII (1-2) : 57-73.
CHABLOZ, N.
2007 « Le malentendu. Les rencontres paradoxales du “tourisme solidaire” », Actes de la recherche
en sciences sociales, 170 (5) : 32-47.
CHARBONNEAU, J.
1951 À la découverte de l’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc). Ce qu’il faut voir, savoir et lire, Paris,
Éditions touristiques et littéraires.
COHEN, E.
1971 « Arab Boys and Tourist Girls in a Mixed Jewish-Arab Community », International Journal of
Comparative Sociology, 12 (4): 217-233.
1985 « The Tourist Guide: The Origins, Structure and Dynamics of a Role », Annals of Tourism
Research, 22: 5-29.
COUSIN, S.
2006 « De l’Unesco aux villages de Touraine : les enjeux politiques, institutionnels et identitaires
du tourisme culturel », Autrepart, 40 : 15-30.
DOQUET, A. & LE MENESTREL, S.
2006 « Introduction : Tourisme culturel, réseaux et recompositions sociales », Autrepart, 40 : 3-14.
FORMOSO, B.
2001 « Corps étrangers : Tourisme et prostitution en Thaïlande », Anthropologie et Sociétés, 25 (2) :
55-70.
FRITZMAURICE, G.
1926 The Son of the Sheik, fiction, 68 min. adaptée d’une nouvelle de Edith Maude Hull, USA,
Feature Productions.
GOFFMAN, E.
2004 « Le déploiement du genre », Terrain, 42 : 109-128.
HENRY, J. R.
1983 « Le désert nécessaire », in E. LAMBERT & A. LAURENT (dir.), Désert. Nomades, guerriers,
chercheurs d’absolu, Paris, Autrement : 17-34.
HUGON, A.
1931 La croix du Sud, fiction, 90 min., France, Pathé Natan.
JEFFREY, D., LE BRETON, D. & LÉVY, J.
2005 Jeunesse à risques : rites et passages, Laval, Presses de l’Université de Laval.
KARCH, D. & DANN, G.
1981 « Close Encounters of the Third World », Human Relations, 34: 249-268.
KRUHSE-MOUNT BURTON, S.
1995 « Sex Tourism and Traditional Australian Male Identity », in M.-F. LANFANT, J. B. ALLCOCK & E.
M. BRUNER (eds.), International Tourism. Identity and Change, Londres, Sage.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
119
LAFERRIÈRE, D.
1997 « Vers le Sud », in D. LAFERRIÈRE, La chair du maître, Outremont, Lanctôt éditeur.
LÉVY, J., LAPORTE, S. & FEKI, M.
2001 « Tourisme et sexualité en Tunisie. Note de recherche », Anthropologie et Sociétés, 25 (2) :
143-150.
MACCANNELL, D.
1976 The Tourist. A New Theory of the Leisure Class, New York, Schocken.
MEISCH, L. A.
2005 « Gringas and Otavalenos. Changing Tourist Relations », Annals of Tourism Research, 22 (2):
441-462.
POUILLON, F.
1996 « Bédouins des Lumières, Bédouins romantiques : mouvement littéraire et enquête
sociologique dans le voyage en Orient (XVIIIe-XIXe siècles) », in U. FABIETTI & P. C. SALZMAN (eds.),
Antropologia delle società pastorali tribali e contadine, Pavia, Ibis.
PRUITT, D. & LAFONT, S.
1995 « For Love and Money. Romance Tourism in Jamaica », Annals of Tourism Research, 22 (2):
422-440.
TABET, P.
1987 « Du don au tarif. Les relations sexuelles impliquant une compensation », Les Temps
Modernes, 490 : 1-53.
URBAIN, J.-D.
1991 L’idiot du voyage. Histoires de touristes, Paris, Plon.
WARNIER, J.-P.
1996 « Les processus et procédures d’authentification de la culture matérielle », in J.-P. WARNIER &
C. ROSSELIN (dir.), Authentifier la marchandise. Anthropologie critique de la quête d’authenticité, Paris,
L’Harmattan : 9-38.
WINKIN, Y.
1999 « Le touriste et son double. Éléments pour une anthropologie de l’enchantement », in S.
OSSMAN (dir.), Miroirs maghrébins. Itinéraires de soi et paysages de rencontre, Paris, CNRS éditions :
133-143.
NOTES
1. Je remercie Sébastien Roux pour sa lecture attentive de plusieurs versions de cet article. Ses
commentaires m’ont conduite à mieux préciser les conditions de mon enquête et engagée à
davantage de prudence et de rigueur dans la mobilisation de notions dont il convenait de
discuter la pertinence. Je remercie également Nadège Chabloz pour ses encouragements
bienveillants à chacune des étapes de l’écriture, qui m’ont permis de mener cet article à son
terme.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
120
2. « Charte révisée du tourisme culturel », <http://www.icomos.org/tourism/patintrans.html>,
1999. Un des objectifs du Millénaire de l’ONU pour le développement durable et la lutte contre la
pauvreté est actuellement de mettre en œuvre un projet « Le Sahara des cultures et des
peuples ». Les dispositions visent au renforcement des coopérations aux niveaux local, national
et international, à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine au bénéfice des populations en
situation de pauvreté, à la promotion des cultures et des civilisations du Sahara, à l’amélioration
des conditions de préservation des écosystèmes sahariens, à l’encouragement de politiques
touristiques responsables, et à la promotion de la gouvernance participative locale.
3. Un guide d’Afrique du Nord d’époque coloniale, dirigé par le général Charbonneau en
collaboration avec un collectif de militaires, d’ecclésiastiques et d’administrateurs, vante les
qualités du touriste lettré en ces termes : « Le touriste lettré c’est par exemple ce scout, ce jeune
étudiant, ce prêtre, cet instituteur de campagne, cet industriel cultivé, ce professeur, ce retraité
demeuré alerte qui, à pied ou à bicyclette, s’en va à travers son canton notant dans son esprit ou
sur son calepin tel ou tel détail amusant ou caractéristique, telle vieille chanson du folklore local.
Ce n’est donc point une question de mode de locomotion, de distance à parcourir, de situation
sociale ou même de haute culture. Définissons le touriste lettré celui qui cherche à profiter de ses
déplacements pour enrichir son intelligence et son cœur » (CHARBONNEAU 1951 : 15).
4. <www.croqnature.com>.
5. Pendant les huit mois de la saison touristique (d’octobre à mai), l’activité du voyagiste permet
à l’agence de Zagora d’employer une trentaine de personnes, la plupart rémunérées à la journée :
25 euros pour les guides, 15 pour les cuisiniers, 10 pour les chameliers. Aux salaires, s’ajoutent
pourboires et commissions, et les employés sont affiliés à la CNSS (Caisse de sécurité sociale
marocaine). Six pour cent du chiffre d’affaires financent une aide au développement au Maroc, au
Mali, au Niger, en Mauritanie et en Algérie où, selon la conjoncture politique du moment, sont
organisés des circuits de randonnées équivalents.
6. Les guides nwâjî de Zagora, avant même de s’associer au voyagiste Croq’Nature en 1994,
avaient élaboré avec l’aide d’un touriste français un petit prospectus énonçant : « Aimeriez-vous
mener la vie d’un nomade touareg durant une journée, voire une semaine ? Allal Touareg, de
naissance, vous propose cette promenade à dos de chameau et une vie dans la liberté du désert
tout comme ses parents. »
7. En testant les oppositions symboliques désert/ville, nomade/sédentaire, sauvage/ civilisé,
tradition/modernité, Orient/Occident, les randonneurs réactualisent le mythe du désert comme
« envers de la civilisation » (HENRY 1983).
8. Les géographes dessinent pourtant la frontière nord du Sahara sur la ligne du djebel Bani, au
sud duquel s’effectuent les circuits de randonnées.
9. Une édition du Guide du Routard identifiait comme étant des « faux-guides » les indigènes
coiffés d’un chèche bleu, tandis que ceux coiffés d’un chèche noir étaient distingués comme de
« vrais nomades ». Cette appellation de « faux- guide » est problématique : on les dit « faux »
parce qu’ils ne détiennent pas de plaque minéralogique délivrée par le ministère du Tourisme
mais, comme il n’existe pas au Maroc de licence officielle de guide dans le désert, tout individu
accompagnant des touristes et ne justifiant pas d’un emploi dans une agence ou d’une
autorisation à exercer comme chamelier, est donc susceptible d’être qualifié de « faux-guide » et
d’être inquiété par les autorités locales. Dans l’acception commune, un « faux-guide » désigne
aussi un rabatteur qui, sous prétexte de guider les touristes, s’efforce de les entraîner dans une
boutique où il perçoit une commission de trente pour cent sur leurs achats. L’activité est
clandestine. Une brigade de police spécialisée est chargée de la réprimer, surtout dans les grands
centres urbains de Fès et de Marrakech. Il en va de l’amende à la peine de prison. Dans la vallée
du Drâa, cette activité de « faux-guide » est pourtant une alternative au chômage et à
l’émigration vers les grandes métropoles du pays.
10. On observe ce même jeu d’attribution d’un nom indigène au Burkina Faso (CHABLOZ 2007).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
121
11. La plupart des touristes n’utilisent ni préservatifs, ni parfois même contraception. À ce jour,
aucun cas grave de maladie sexuellement transmissible n’a été signalé. En revanche, quelques
femmes ont été enceintes. Des grossesses ont du être interrompues, quand d’autres ont été
poursuivies à leur terme. Il n’existe pas de dépistage HIV à Zagora. Aucune campagne de
prévention n’y est mise en œuvre. Les guides connaissent l’existence du Sida mais ils sont dans le
déni de la possibilité d’une contamination. Plus curieusement, les touristes dénient aussi, voire
défient cette éventualité. Sur ces « conduites à risques », rites intimes de fabrication du sens, voir
JEFFREY, LE BRETON & LÉVY (2005).
12. Ce premier circuit auquel je participai, en 1994, testait le début du partenariat avec le
voyagiste Croq’Nature. Trois accompagnateurs nwâjî susceptibles d’exercer la fonction de guide
encadraient le groupe quand, les années suivantes, chaque circuit ne mobiliserait plus qu’un seul
guide.
13. Pour désigner les touristes avec lesquelles ils ont des échanges sexuels, les guides emploient
le terme français de « copine », auquel ils ne cherchent pas à trouver d’équivalent en arabe.
14. Vers le Sud, le film réalisé par Laurent Cantet, est adapté d’une nouvelle de Dany Laferrière
parue dans La chair du maître (1997).
15. Certains guides soutiennent toutefois qu’ils ont repéré des préservatifs dans leurs bagages.
C’est une information que je n’ai pas vérifiée mais dont j’estime devoir tenir compte. Alors qu’en
Tunisie, les séducteurs de touristes sont dénommés « bezness » », terme francarabe vulgarisé par
un film de Nouri Bouzid pour désigner ceux qui font de la « baise » un « business », aucun terme
ne désigne, au Maroc, les séducteurs de touristes que l’on voit pourtant dans chaque grande ville
du pays courtiser activement touristes ou résidents. Selon les cas, ils sont assimilés à des
prostitués.
16. The Son of the Sheik, George FITZMAURICE (1926). La croix du Sud, André HUGON (1931). Et, plus
récent, Un thé au Sahara, Bernardo B ERTOLUCCI (1990), adapté du roman de Paul BOWLES, The
Sheltering Sky (1949).
17. Fqîh : interprète de la loi religieuse, jurisconsulte, petit lettré de campagne.
18. Les échanges sexuels avec les chameliers sont rares et provoquent du scandale. J’ai en
mémoire le cas d’une touriste russe immigrée en France, âgée d’une vingtaine d’années, et d’un
jeune chamelier de dix-sept ans, qui s’étaient épris l’un de l’autre sans avoir eu d’échanges
sexuels. Ce chamelier n’était pas un descendant d’esclave. Il était issu des Nwâji mais, orphelin de
père, avait été adopté par le groupe responsable de l’agence. Les guides sous les ordres desquels il
travaillait lui ordonnèrent de ne plus poursuivre de relation téléphonique ou épistolaire avec
l’étrangère et de renoncer à la courtiser. Le couple brava l’interdit. Il se retrouva sous la tente de
la mère du jeune chamelier. Mais au bout de quelques temps, la touriste fut convaincue qu’on
cherchait à l’empoisonner. Elle renonça à voyager au Maroc et, ses demandes de visas restant
vaines, elle finit par perdre contact. Le chamelier abandonna l’activité touristique et partit faire
du commerce de bétail à Smara, au Sahara occidental. Depuis, il a fait la rencontre d’une autre
touriste et, à ce jour, il a émigré en Hollande.
19. Certains ont étudié jusqu’à la licence à Marrakech ou à Agadir mais, parce qu’ils n’ont pas
trouvé d’emploi, finissent par revenir à Zagora pour y exercer le métier de guide et ainsi ne plus
être à la charge de leurs parents.
20. Un grand nombre de jeunes de la vallée du Drâa rêvent de partir vivre en Europe, aux États-
Unis ou au Canada. Ce rêve n’est pas motivé que par l’argent. Il traduit une aspiration à un
« mieux-vivre » : trouver le partenaire idéal, disposer de ses revenus à titre individuel, vivre
indépendamment de la famille ou du groupe tribal. Quotidiennement, il est entretenu par les
touristes, qui diffusent l’image d’individus riches et libres de voyager, ainsi que par les rumeurs
de réussites que ne dément pas, chaque été, le retour ostentatoire des « Résidents marocains à
l’étranger » (RME). L’idée même de migrer est un facteur d’équilibre. Elle nourrit des journées
entières de bavardages qui permettent de se soustraire aux aléas du quotidien sans pour autant
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
122
s’engager dans un vrai processus de rupture. À ce jour, cinq guides auprès desquels j’ai enquêté
ont émigré, en France, en Allemagne, en Espagne, en Hollande et aux États-Unis.
21. L’intégration est mise en œuvre selon les critères locaux qui distinguent les jeunes filles (bnât)
des épouses (sing. mrâ. pl. ‘ayâlât). Une touriste qui n’a jamais été mariée est traitée comme une
jeune fille, tandis qu’une touriste déjà mariée peut prendre place dans le cercle des épouses.
RÉSUMÉS
Une enquête monographique conduite au Maroc sur des circuits de randonnées « à la rencontre
des peuples du Sahara » montre que les touristes sont fréquemment déçus. Ils ne parviennent ni
à authentifier des Bédouins devenus des professionnels du tourisme, ni à se singulariser en
voyageant en groupe, ni à vivre une aventure tout en respectant un programme. Un type
d'interactions semble toutefois réaliser les prophéties d'enchantement délivrées par les
brochures, lorsque les randonneuses ont un échange sexuel avec leur guide : une intimité se
construit qui transcende alors la situation touristique par un équivalent de rite d'agrégation.
Mais ces romances, en ce qu'elles permettent de renégocier les statuts et les rapports de pouvoir,
présentent aussi un caractère agonistique très marqué.
A monographic study conducted in Morocco on camel treks for tourists, "seeking to encounter
peoples from the Sahara", demonstrates that the tourists are often disappointed. They are unable
to authenticate the Bedouins who have become tourism professionals. Furthermore, the tourists
can neither affirm themselves as individuals when travelling in a group, nor can they experience
adventure while sticking closely to the itinerary. One sort of interaction does seem nonetheless
to accomplish the enchanting prophecies delivered by the brochures, when female tourists have
a sexual encounter with their local guide. An intimacy is established which transcends the tourist
situation through the equivalent of a rite of re-incorporation. However, renegotiating the status
and power relationships, these romances are also characterized by significant tensions.
INDEX
Mots-clés : Maroc, Sahara, identités de genre et de race, postcolonialisme, rencontre des
cultures, tourisme sexuel féminin
Keywords : Morocco, Sahara, identities of gender and race, postcolonialism, cultural encounters,
female sexual tourism
AUTEUR
CORINNE CAUVIN VERNER
Centre d’Histoire sociale de l’islam méditerranéen, EHESS, Paris.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
123
Antiquaires et businessmen de laPetite Côte du Sénégal. Lecommerce des illusions amoureusesAntique Dealers and Businessmen from Petite Côte in Senegal: The Trade in
Amorous Illusions
Christine Salomon
NOTE DE L'AUTEUR
Cette étude a bénéficié d’un financement de l’Agence nationale de recherche sur le
Sida. Je remercie France Lert, directrice de l’Unité 687 de l’Inserm, qui m’a permis de la
mener à bien ainsi qu’Emmanuel Lagarde et d’Abdoulaye Sidibé Wade pour leur
implication dans le projet et la mise en place de l’étude. Mon travail doit énormément à
l’amitié et à l’aide de Falilou Ndiaye et d’Éric Kanago et à ma collaboration avec
Youssou Sarr et Nini Diouf. À la faculté des Lettres et Sciences humaines de l’UCAD, je
tiens particulièrement à remercier Bacary Sarr et Oumar Ndao pour les lectures qu’ils
m’ont conseillées ainsi qu’Ousseynou Faye pour son investissement scientifique dans ce
travail et pour ses commentaires sur une première version de ce texte. Merci enfin à
Papa Alioune Ndao et à Mamadou Dieng pour leur relecture attentive.
1 Au Sénégal, surtout sur la Petite Côte, la destination touristique la plus fréquentée du
pays, les échanges économico-sexuels entre jeunes hommes sénégalais et touristes
européennes — des Françaises dans leur grande majorité, généralement plus âgées
qu’eux — ont acquis une visibilité certaine. À la figure stéréotypée du vieux Blanc
escorté d’une jeune et jolie Sénégalaise, s’ajoute désormais celle de la touriste quinqua
ou sexagénaire, main dans la main avec un athlète en maillot de corps exhibant sa
musculation, un boy doolé ( doolé, force en wolof), ou un artiste portant dreads et
patchwork coloré, à la manière du musicien Cheikh Lô.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
124
2 Dans ces deux situations, souvent désignées comme prostitutionnelles, où la jeunesse
est l’attribut du service sexuel tandis que l’âge mûr est celui de la contrepartie
économique, il s’agit de commerce informel, sans tarification de la sexualité, ni réelle
professionnalisation de ses fournisseurs. La négociation économique n’est pas
forcément explicite avant l’acte sexuel si bien que les termes de la transaction sont loin
d’être clairs ainsi que le montrent les études qui se sont attachées aux jeunes femmes
fréquentant les bars ou les discothèques en quête de rencontres (Smette 2001 ; Fouquet
2007). L’enchevêtrement des significations entre sexualité commerciale et non
commerciale paraît d’autant plus complexe que les relations vont de l’éphémère, ou de
la durée des vacances, à des formes plus stables, des sortes d’amitiés ou d’abonnements
au service sexuel plus ou moins rétribué, parfois des cohabitations ou des mariages.
L’aspect économique revient toutefois sur le devant de la scène lors des différends qui
surgissent et alimentent la chronique des faits divers de la région de Mbour, des
Européens (hommes ou femmes) se plaignant régulièrement d’être volés ou spoliés par
leur partenaire ou encore victimes de « mariages d’intérêt » qu’ils souhaitent annuler
pour cette raison1.
3 Dans des revues françaises, des articles dénonçant les « ravages du tourisme sexuel » se
sont emparés de ces relations2, citant le Sénégal comme destination du « tourisme
sexuel de masse » avec la Gambie voisine. Des reportages photographiques et télévisés
ont complaisamment montré les couples contrastés que forment des femmes
européennes, d’un certain âge et suffisamment aisées pour voyager, avec des hommes
africains, apparemment plus jeunes et plus pauvres qu’elles3. Une telle fascination, qui
touche à la pornographie, s’enracine dans un processus dont Colette Guillaumin (1992),
dans un article sur le rapport entre pratique du pouvoir et idée de nature, a démontré
qu’il était à la base de l’idéologie raciste. En effet, à partir d’une naturalisation de
l’altérité, c’est bien la même logique qui « racise » des groupes sociaux en fonction de la
couleur de la peau mais aussi du genre, ou de l’âge, ces trois opérateurs de
catégorisation se cumulant dans le cas des « jeunes Black » et des « vieilles Blanches »
(Salomon 2007).
4 Le type de relations sociales étudié ici, lié aux renégociations contemporaines du genre
en Occident, semble être apparu au Sénégal avec l’essor du tourisme hôtelier (Dieng &
Bugnicourt 1982). Dès les années 1990, le phénomène était devenu suffisamment
perceptible pour que ses protagonistes masculins soient localement qualifiés de Sex
Machines (Biaya 2001 : 82). Mais il plonge à l’évidence également ses racines dans le
passé colonial et s’inscrit dans une histoire ancienne de « mariages à la mode du pays »4
dans les comptoirs portugais de la Petite Côte. Cependant, la reconfiguration mondiale
actuelle, où les migrations touristiques du Nord vers le Sud s’amplifient — notamment
vers les destinations d’Asie et d’Afrique5, alors même que les citoyens des pays de ces
régions sont partout empêchés d’aller au Nord par des politiques terriblement
restrictives —, paraît propice à son déploiement à grande échelle. Ses localisations
incluent de nombreux sites touristiques du bassin méditerranéen, d’Asie et de la région
caraïbe. Les destinations balnéaires d’Afrique subsaharienne où des recherches rendent
compte d’un tourisme sexuel féminin sont la Gambie (Brown 1992 ; Ebron 2002 ; Nyanzi
et al. 2005 ; Wagner 1977 ; Wagner & Yamba 1986), Zanzibar en Tanzanie (Sumich 2002),
la région de Malindi au Kenya (Kibicho 2004) et le lac Malawi (Prowse 2004). Les
chercheurs en sciences sociales qui se sont intéressés aux divers beach-boys ont
généralement souligné le côté professionnel des amitiés qu’ils nouent avec les touristes,
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
125
les assimilant à de petits entrepreneurs (entrepreneurs), des travailleurs indépendants
(freelancers), aventureux (risk-takers) et débrouillards (hustlers). Alors que certains
auteurs leur ont attribué en Afrique un rôle de médiateurs culturels (culture brokers),
entre les éléments les plus « traditionnels » de leur société et les touristes (Brown 1992 ;
Sumich 2002), d’autres ont souligné la créativité de leur style de vie et la spécificité des
relations sociales qu’ils nouent où l’ensemble des inégalités sont fortement racialisées
(Ebron 2002 ; Nyanzi et al. 2005 ; Prowse 2004).
5 Ma présentation des jeunes hommes sénégalais — travaillant souvent déjà dans le
tourisme ou dans le commerce — dont la cible privilégiée est constituée par des
vacancières seules auxquelles ils proposent diverses prestations, y compris sexuelles,
s’inscrit dans cette seconde perspective. Parfois nommés avec un certain mépris « topp
tubaab » ( « topp », « suivre » en wolof), ceux qui tournent autour des Blancs, sont
généralement appelés sur la Petite Côte « antiquaires », en référence aux marchands
d’objets, prétendument anciens, proposés aux touristes, ce qui identifie clairement leur
activité comme commerciale6. La plupart des concernés préfèrent néanmoins se définir
comme des boutiquiers, des guides ou mieux des « businessmen ».
6 J’examine ici leurs compétences et leurs stratégies pour réussir dans un univers
compétitif, dont certaines relèvent de mises en scène d’une identité africaine
correspondant largement aux clichés occidentaux. Je m’intéresse également aux
arbitrages entre conduites individuelles et normes sociales en fonction de la part de
stigmate et de clandestinité attachée aux transactions sexuelles avec les touristes. Ma
description donne à voir une imbrication particulière des inégalités économiques, de
genre et d’âge avec les stéréotypes racistes. Elle met également en lumière, au-delà
d’une forme persistante d’aliénation postcoloniale, l’extraversion de la jeunesse
sénégalaise urbaine et son inscription, pour échapper à la pauvreté et à son système
national, dans ce que Tshikala Biaya (2000 : 2) a appelé « la globalisation et la
mondialité, sa culture universelle d’aujourd’hui ».
7 L’enquête repose sur l’observation des lieux de drague et des interactions avec les
femmes touristes ainsi que sur une vingtaine de récits d’hommes âgés de 22 à 37 ans
régulièrement engagés dans des relations suivies avec elles. Une majorité de ceux
exerçant à Saly ou aux alentours avaient déjà été sollicités entre 1999 et 2001 pour
répondre à un court questionnaire dans le cadre du mémoire de maîtrise de Nini Diouf
sur les unions mixtes à Mbour ou celui du mémoire de DEA de Youssou Sarr sur le
tourisme sexuel7. C’est ainsi que j’ai pu les contacter en 2005 et qu’ils ont accepté un
entretien approfondi. Deux ans plus tard, en 2007, j’ai interrogé à nouveau une dizaine
d’entre eux, qui se trouvaient toujours dans la même activité8, afin de mieux cerner
leurs trajectoires. Les conditions de mon enquête ont été évidemment en partie
déterminées par ma situation de femme tubaab « libre » (non accompagnée d’un mari)
qui me plaçait dans une position ambiguë, que la déclinaison de ma qualité de
chercheure ne suffisait pas à lever9. La consultation des registres des mariages à la
mairie de Mbour est venue compléter mes données en permettant de prendre la mesure
de la partie légalisée du phénomène.
La Petite Côte : « une banlieue tropicale de l'Europe »10
8 L’on se souvient peut-être du tube (près d’un million de disques vendus en France), du
groupe Martin Circus, Je m’éclate au Sénégal11, sorte de manifeste du tourisme de masse
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
126
qui coïncidait avec le lancement de la politique de développement de ce secteur par
l’État sénégalais dans les années 1970. Aujourd’hui, l’on continue, semble-t-il, de
s’éclater au Sénégal puisque le nombre de visiteurs est estimé, en l’absence de chiffres
officiels, de 500 000 à 700 000, dont plus de la moitié est constituée de Français. Le
tourisme constitue un secteur-clé de l’économie, qui a devancé l’arachide et figure au
deuxième rang après la pêche. Bien que le produit balnéaire soit désormais saturé et
concurrencé, le gouvernement sénégalais affiche l’objectif ambitieux d’attirer un
million et demi de touristes à l’horizon 2010. La Petite Côte, à seulement 80 km de
Dakar, qui a profité de la désertion de la Casamance, draine 70 % des visiteurs.
9 Initié par l’implantation d’un club de vacances allemand et d’un hôtel grand standing
dans un parc forestier, le développement du tourisme a été confié dans cette région à la
Société d’aménagement et de promotion de la Petite Côte (SAPCO, créée en 1975), une
société d’économie mixte transformée en société anonyme à participation publique
majoritaire. Celle-ci construisit, en bord de mer, à 5 km de Mbour, la station de Saly
comprenant plusieurs hôtels bâtis autour d’un centre commercial, avec parking,
pharmacie, cafés, discothèques, boutiques destinées aux touristes, plus un « marché
artisanal » à proximité. Cet aménagement, conçu pour fixer sur place les vacanciers,
complété aujourd’hui par des banques avec distributeurs de billets, des cybercafés, des
locations de voitures, de scooters, de quads et un port de plaisance, continue de
s’étendre, employant plus de 3 000 personnes et proposant un hébergement d’une
capacité de 8 000 lits.
10 Les prestations et les prix proposés attirent désormais une clientèle assez populaire et
pour une bonne part âgée, essentiellement française, qui vient surtout en haute saison,
de décembre à avril. Le séjour type, très encadré, dure une semaine, l’hôtel ou le club
de vacances proposant aux clients dans la journée des animations ou quelques circuits
dans les environs, et le soir des spectacles au bord de la piscine. Tout est fait pour les
décourager de s’aventurer hors des sentiers balisés. Ils ne peuvent lier connaissance
qu’avec les employés des hôtels, les boutiquiers et les taximen, ou alors avec les guides
autorisés à se poster au sein de la station pour proposer des excursions. Tous les autres
« artistes des relations humaines », ainsi qu’ils se plaisent à se définir, sont réduits à
accrocher leur attention soit sur la partie de la plage qui reste en libre accès, sur
laquelle ils vendent des souvenirs et où vers le soir, des garçons viennent faire du sport
et exhiber leur plastique corporelle, soit dans les boîtes de nuit, si toutefois ils ont les
moyens d’y entrer. L’infrastructure de Saly est complétée par des résidences para-
hôtelières vendues en copropriété. Chaque résidence est composée de constructions
identiques enserrées dans un enclos gardé, avec piscine, bar-restaurant et espaces verts
soigneusement entretenus. Quelques-uns de ces logements sont achetés par des
Sénégalais fortunés, mais la grande majorité l’est par des Français, souvent des
retraités venus précédemment en vacances, qui ont décidé de s’établir sur place une
partie de l’année et louent leur logement le reste du temps. Ces résidents constituent
une population un peu moins captive que celle des clubs de vacances et génèrent des
restaurants et des petits commerces à proximité, formels ou non.
11 On trouve encore d’autres types d’hébergements touristiques en bord de mer dans les
localités adjacentes. Ils vont d’établissements chics et fermés surveillés par des gardes
en uniforme armés de chicote pour dissuader les jeunes d’approcher les clients, à des
hôtels familiaux et des « campements » plus modestes, souvent tenus par des couples
franco-sénégalais, ainsi qu’à des villas louées meublées. Des habitants des villages
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
127
voisins proposent même des chambres d’hôtes. Le littoral présente ainsi un continuum
d’habitations jusqu’à Mbour, ville qui connaît une explosion démographique et fournit
la majeure partie de la main-d’œuvre des hôtels et des bases de loisirs de la Petite Côte.
Alors que Saly comptait officiellement 7 556 habitants en 2002 (Diouf 2003), quatre ans
plus tard le chiffre de 20 000 personnes est avancé par le guide Lonely Planet Sénégal et
Gambie, du moins en haute saison. Au delà des employés du secteur touristique, tout un
monde de pauvreté et de débrouille côtoie celui des vacanciers et des retraités, s’efforce
de se mettre à son diapason et de calquer son emploi du temps sur le sien, ce qui donne
à ses acteurs une connaissance certaine des modes de vie occidentaux dans ce
qu’Achille Mbembé (2000 : 41) nomme « l’économie des désirs inassouvis », c’est-à-dire
l’économie des biens vus, à portée de main, convoités, mais dont il apparaît comme fort
improbable qu’on parvienne à les posséder. Ainsi peut-on observer dès le matin sur la
plage des jeunes désœuvrés, « les conjoncturés », emboîter le pas aux promeneurs en
leur parlant « réveil musculaire », puis jouer à la pétanque avec les retraités dans les
résidences, promener en laisse le chien d’une « copine » européenne, tandis que des
jeunes femmes sénégalaises déambulent en compagnie de Pa tubaab (vieux Blancs) et
lézardent en maillot de bains autour des piscines. Les mixités entre jeunes Sénégalais,
hommes ou femmes, et touristes ou résident(e)s européen(ne)s deviennent encore plus
visibles à partir du moment de l’apéritif, dans les bars, et le soir dans les restaurants et
les discothèques. Pour créer une ambiance « sénégauloise » rassurante pour les
vacanciers, les enseignes des boutiques, ou les cartes professionnelles des taxis
annoncent : « Ahmed Le Breton », « Omar Le Belge » ou « Aux Girondins » en référence
au club de football. Malick se fait appeler Mike, Maguette, Max, Mustapha, Taf et
Souleymane, Jules, ce qui est courant dans la jeunesse sénégalaise urbaine, mais
Mouhamad va aussi prendre un nom d’emprunt (Pascal) pour se « toubabiser ».
12 S’inscrivant dans une série d’efforts aussi répétés que vains des pouvoirs publics pour
faire disparaître les pauvres12 des lieux publics et protéger les touristes, une association
pour le développement du tourisme à Saly a été constituée et distribue des badges à ses
membres, seuls autorisés à aborder les vacanciers au sein de la zone hôtelière13.
Pareillement, le parking et le marché artisanal sont tenus par des associations dont les
adhérents (les « adras ») se différencient ainsi des taximen « clando » et des marchands à
la sauvette. Le droit d’entrée à ces associations, qui fonctionnent également comme
caisses de secours pour leurs membres, est élevé14. Par conséquent, ceux qui arrivent
sur le marché du travail et ne peuvent débourser cette somme se trouvent interdits
d’accès à la zone hôtelière, au marché artisanal et au parking, obligés d’y aller
furtivement ou nuitamment et sont alors exposés à la répression. Aussi la façon dont ils
abordent les touristes estelle généralement plus pressante et directe, souvent
maladroite, parfois désespérée, y compris dans la proposition de services sexuels15.
13 Ce sont les membres des associations, plus faciles à contacter car leur activité s’est
officialisée, qui constituent, avec quelques employés d’hôtels, la majorité des hommes
qui ont participé à mon enquête, laquelle s’est déroulée en français. Bien que leur
niveau scolaire ne dépasse généralement pas le CM216 et qu’ils aient commencé à
travailler tôt, à force de fréquenter les touristes et de partager leur intimité, leur
français parlé est devenu excellent, et certains se plaisent même à rémailler de jurons
ou de « verlan » pour démontrer à quel point ils maîtrisent des codes linguistiques
communs avec les vacanciers. Bien que tous racontent avoir « eu leur première
Française » alors qu’ils étaient simples vendeurs ambulants, rabatteurs ou laveurs de
voiture, ils qualifient sans état d’âme les débutants dans le métier de « gigolos qui sont
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
128
à la plage et cherchent les dames du troisième et quatrième âge » ou encore
d’« arnaqueurs qui embêtent les touristes ». On peut considérer, par analogie avec
l’aristocratie ouvrière, qu’ils représentent l’aristocratie du secteur informel17.
Beaucoup accusent même les « antiquaires », arnaqueurs de petite envergure, d’être
responsables de la baisse de l’activité touristique. Un guide badgé, 37 ans, qui sept ans
auparavant, démobilisé de l’armée et embauché comme gardien d’hôtel, a rencontré
une Française et s’est fait financer par elle son permis de conduire et son adhésion à
l’association (elle continue toujours de le « sponsoriser »), relaie le discours répressif :
« Chaque boutique a droit à deux personnes et comme ça si on voit une personnequi traîne, on voit que c’est un rabatteur, un antiquaire, on le fait arrêter. Dans levillage artisanal, ce sont des boutiquiers, pas des antiquaires, l’antiquaire, c’estcelui qui vous racole, il gère rien, il te propose un restaurant et le lendemain il s’esttaillé avec ton argent. Il y a des gardiens en uniforme que l’association a recrutés, lagendarmerie peut aussi te demander le badge. »
14 À l’omniprésence de gardiens d’allure martiale, recrutés préférentiellement parmi
d’anciens militaires, s’ajoute les rafles par les gendarmes, surtout le soir, qui infligent
des amendes à tous ceux identifiés comme des figures de la marginalité — jeunes
traînards désargentés ou femmes suspectées de se prostituer — dont la seule présence
dans l’espace public serait néfaste à l’image du Sénégal et de ses valeurs.
15 Dans une société plutôt prude, où il importe de savoir se tenir, avec une norme
homophobe affirmée18, l’organisation à Saly, dans une boîte de nuit à la mode, d’un
défilé de travestis en 1999, puis la diffusion d’un reportage de M619 sur la pédophilie
dans cette localité20 et des articles à sensation dans la presse locale21, amènent souvent
à considérer l’endroit comme la capitale de la débauche. Un ancien « antiquaire » de
Mbour (31 ans, vivant habituellement à Genève où il travaille comme cuisinier,
interrogé alors qu’il est revenu en vacances), lui-même séparé d’une professeure
d’université rencontrée quand il avait 17 ans, épousée quatre ans plus tard et rejointe
en Suisse, de s’indigner :
« Moi quand j’étais ici j’ai tout vu, mais à cette époque, le tourisme était deux foisplus propre. Moi je mets pas les pieds à Saly, c’est la prostitution. C’est la faute augouvernement, il ne devrait pas accepter les résidents. Les résidents, y a pas decontrôle. C’est la faute du PS, la SAPCO a vendu toute la plage. Ils ont tout ratissé, ilsont regardé que l’argent. Ça devient comme la Thaïlande. Un jour il y aura la mêmechose à Saly que le tsunami, le bon dieu va nettoyer tout ce qui est dégueulasse. »
16 La presse locale, extrêmement diserte sur les « fléaux sociaux » susceptibles de ternir
l’image du pays et sur la « dégradation des mœurs », n’épargne pas les relations
étudiées ici. Quand des litiges opposent les partenaires d’un couple mixte d’âge
discordant et que l’un d’eux recourt à la police, les affaires sont présentées comme un
effet de la prostitution si le plaignant est un homme qui s’est fait dépouiller par une
jeune Sénégalaise (ou par le copain de celle-ci, à qui elle a facilité l’entrée dans la villa
ou la résidence). Mais lorsque c’est une Européenne qui incrimine un homme sénégalais
plus jeune qu’elle22, les faits sont rapportés dans la rubrique pédophilie, au motif que la
différence d’âge est « astronomique »23. Que des femmes soient nettement plus âgées
que leurs amants semble donc constituer un objet de scandale dans une société qui en
revanche tolère que les hommes entretiennent, dans le mariage, surtout polygame, ou
la prostitution, des relations avec des femmes bien plus jeunes qu’eux24, la séniorité
venant dans ce cas renforcer l’autorité masculine. Autre inversion des normes, alors
que les obligations de prise en charge des besoins économiques du ménage sont en
principe masculines et que « le défaut d’entretien » reste la principale cause de divorce
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
129
des épouses25, les femmes ici occupent le rôle de pourvoyeur économique. Leur
supériorité en matière d’âge et de ressources serait-elle susceptible d’ébranler le cadre
normatif des relations hétérosexuelles ? C’est bien ce que semble redouter l’éditorial
cité de L’intelligent intitulé « À nous les petits Sénégalais » qui commente la plainte
déposée par une Européenne désireuse de récupérer la voiture et la maison « données »
à son partenaire (majeur puisqu’en âge de conduire), rapportant en caractères gras la
« découverte » du commandant de gendarmerie « horrifié » de Mbour : « Un contrat
secret imposait au garçon trois rapports par jour. Une cadence qu’il n’a pas pu tenir.
D’où le courroux de la vieille dame. » La femme incarne ici la dangerosité sociale et la
dépravation. En revanche l’infantilisation et la victimisation de l’homme impliqué le
déresponsabilisent et permettent de l’affranchir du stigmate de prostitué (Pheterson
2001).
Des businessmen
17 Les entretiens publiés dans « Touristes Rois en Afrique » (Dieng & Bugnicourt 1982)
indiquent que les échanges économico-sexuels de ce type sont apparus dès l’essor du
tourisme au Sénégal. Sur un total de 56 employés d’hôtel interrogés à Dakar, sept
d’entre eux mentionnent avoir obtenu une rémunération pour des services sexuels. Un
cuisinier explique que les touristes femmes « paient parfois les hommes comme les
hommes touristes paient les filles sénégalaises » (ibid. : 75) et un « boy de chambre » fait
le récit d’une transaction :
« Un jour une Italienne m’a demandé de lui tenir compagnie en ville pendant lanuit. Je lui ai montré tous les meilleurs night-clubs et les grands bars de la ville. Auretour elle m’a offert une jolie montre et m’a invité à manger dans sa chambre.Après le repas elle m’a proposé de lui faire la cour. J’étais très réticent, je n’avaisjamais fait la cour à une tubaab. Elle m’a offert 5 000 F pour me convaincre et j’aiaccepté. J’ai passé plusieurs nuits avec elle jusqu’à son départ. Je rencontre detemps en temps des femmes de la sorte, mais toujours moyennant quelque chose :un cadeau ou de l’argent » (ibid. : 46).
18 Le montant habituel de la compensation, 5 000 FCFA plus une montre, est corroboré par
un taximan : « J’ai dormi avec elle [une femme suisse] et elle m’a donné 5 000 F et une
belle montre comme souvenir car elle devait repartir pour la Côte-d’Ivoire le
lendemain » (ibid. : 80). Toutefois, une certaine discrétion semble avoir été de mise à
cette époque, les salariés redoutant d’être licenciés en cas de découverte par leur
patron.
19 Mon enquête, en 2005 et 2007, révèle que les employés d’hôtel, notamment les gardiens
et les animateurs, demeurent toujours bien placés pour nouer ce type de relations dont
l’acceptation sociale dans le milieu de l’hôtellerie est devenue telle que la part de
clandestinité paraît désormais réduite, voire inexistante. Les hôtels de la Petite Côte
tirent même ouvertement profit des rencontres sexuelles entre les touristes et les
locaux puisque tout(e) client(e) invitant quelqu’un pour la nuit paye pour son hôte une
nuitée supplémentaire, dont le prix oscille de 30 000 à 60 000 FCFA (46 à 92 euros) selon
les établissements. Cette barrière financière non négligeable n’existe pas dans les
résidences qui se contentent de demander — ce que font également les hôtels — que le
visiteur laisse sa pièce d’identité aux gardiens, lesquels peuvent d’ailleurs fermer les
yeux moyennant un pourboire. En outre, l’activité, considérée comme annexe au
salariat il y a vingt ans, est de nos jours envisagée comme « une porte de sortie », « une
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
130
source de survie pour sortir de la galère », une opportunité à ne pas laisser passer
d’autant que « en une journée tu peux gagner le salaire d’un mois à l’hôtel » et qui, au-
delà d’un gain ponctuel, ouvre, si la relation se pérennise, sur une vie supposée
meilleure, que ce soit au Sénégal ou en Europe. Il ne s’agit donc plus de prestations
rapides, réduites à un ou des actes physiques impliquant peu la personne et conçus
comme un travail ponctuel et rémunéré, mais de relations à plus long terme qui
requièrent un investissement psychologique et social où la sexualité ne peut être
facilement dissociée des autres aspects de la vie personnelle et, bien évidemment, de
certaines formes d’attachement.
20 Non seulement les salariés du tourisme ne craignent plus ni le licenciement ni
l’opprobre, mais ils se déclarent prêts à démissionner pour saisir les occasions qui se
présenteraient, comme l’affirme ce gardien d’hôtel célibataire de 30 ans employé
durant la haute saison pour un salaire mensuel de 50 000 FCFA (76 euros)26 : « Si tu fais
une rencontre, que la personne t’aide, que la femme t’emmène, c’est la chance. Ici tu
n’as pas de travail. Beaucoup sont partis comme ça. Ce sont des Françaises, des Belges
ou des Suisses. » Et un tailleur d’une boutique d’hôtel, 35 ans, marié avec trois enfants,
de renchérir : « Si tu as 60 ans et que tu es Sénégalaise, on dira : elle est folle cette
vieille. Mais si tu es tubaab, ce n’est pas pareil. Moi si je rencontre une femme qui
m’aide, je l’épouse, je suis partant : chacun y trouve son intérêt, même si ce n’est pas le
même. »
21 Cette idée qu’une liaison avec une Européenne, même d’une autre génération, peut
changer radicalement la vie, reflète la puissance de la monétarisation et
l’instrumentalisation de la sexualité qui se développent dans un contexte de crise
économique et dont l’un des effets est l’individualisation des conduites, quitte à ce que
ces manifestations soient réprouvées par la morale sociale dominante (Marie 1997).
22 La valeur des cadeaux et la compensation monétaire reçues par ceux dont les visées se
concrétisent demeurent difficiles à estimer, à cause de l’aspect non tarifé des
prestations masculines. Mes entretiens indiquent cependant que la voiture a
définitivement supplanté la montre comme cadeau-type valorisé. Un guide de 35 ans,
adhérent de l'association du parking de Saly, décrit le rôle de sa première voiture dans
son ascension sociale :
« Quand je suis arrivé à Mbour, je dormais dans la gare routière, je lavais lesvoitures. Pour avoir le permis, j’ai fait saisonnier dans le Saloum pendantl’hivernage pour l’arachide. J’ai commencé à travailler comme chauffeur, mais à cemoment- là, ce n’était pas ma voiture. C’est comme ça que j’ai rencontré le coupletubaab qui avait un hôtel dans le Sud de la France. Ils m’ont envoyé l’argent pourmon passeport et je suis allé travailler chez eux là-bas, j’ai fait la cuisine, j’ai faitaussi les vignes, tout. Quand je suis rentré ici, ils m’ont donné la 505 pour faire dutransport et aider mes parents. Maintenant qu’ils se sont séparés, elle, elle estrepartie à zéro, et on ne se cache plus. »
23 La femme en question, désormais à la retraite, a construit une maison sur la Petite Côte
où elle passe une partie de l’année. Elle a aidé son amant à acheter une voiture
supplémentaire — un minibus (il emploie désormais un jeune frère comme chauffeur de
la 505) —, et même une « maison tubaab avec une bonne », également sur la Petite Côte,
où, lorsqu’elle n’est pas là, il habite en semaine et invite ses copains « à manger du
bœuf bourguignon ». De plus, elle lui a donné la somme de 500 000 FCFA (760 euros)
nécessaire pour se marier au village : « Elle m’a dit elle-même : pour ton avenir, tu dois
avoir des enfants. C’est mes parents qui ont choisi une cousine et arrangé tout. C’est
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
131
une fille de mon village qui n’a pas fait les bancs. Tout le monde le sait, la tubaab, elle
était au mariage, c’est elle qui a donné l’argent pour la dot. » Deux ans plus tard, il vit
toujours entre sa famille au village (il a maintenant deux enfants) et la « copine
française » dont il dit qu’elle lui « a appris beaucoup de choses, à faire la cuisine, à
économiser, à investir surtout ». Il possède maintenant une carte bleue et a acquis
depuis peu une quincaillerie à Mbour que tiennent ses sœurs. Le minibus a été
remplacé par une luxueuse berline climatisée et il a — toujours grâce à l’aide de la
« copine » car lui-même n’est pas allé à l’école et ne lit pas — des cartes de visite et un
site Internet, ce qui lui fait dire qu’il est devenu « tour operator ». La « copine » était,
selon lui, prête à payer 1 500 000 FCFA (2 287 euros) pour des faux papiers afin qu’il
puisse voyager à nouveau avec elle en France mais finalement, jugeant l’opération trop
risquée, ils sont en train de faire le nécessaire pour se marier à la mairie27.
24 Un autre homme, loueur de quads rétribué à la commission, âgé de 27 ans en 2005,
confirme que, dans le milieu, l’achat d’une voiture mesure le succès. Après avoir quitté
l’école en CM2, travaillé comme ouvrier boulanger puis pêcheur, il était lui aussi laveur
de voitures lors de sa rencontre avec une touriste :
« J’étais un gamin, c’était il y a six ans, c’était une dame de 41 ans, on a passé unesemaine ensemble. Elle était très gentille [comprendre généreuse], mais elle étaitvieille. Elle est encore venue il y a 5 mois. En fait, j’ai pas qu’une seule copinefrançaise. Elles achètent des voitures. Moi j’ai deux voitures : une 405, plus uneRenault 21, elles font des cadeaux. J’ai un pote à moi il est taximan ici, maintenant ilest marié avec une Française qui a acheté une voiture à 9,5 millions [14 483 euros],une 4X4 Mitsubishi. Ils se sont connus une semaine, après elle est rentrée et aenvoyé les 9,5 millions. Y a pas que lui, y a tout le monde qui est dans le business. »
25 En 2007, il travaille toujours dans la location de quads, mais a aussi pris sa carte
d’« adra » comme chauffeur-guide au parking. Son apparence a changé, il a troqué ses
dreads contre une coupe de cheveux courte. Il s’est marié (à la mosquée) avec la jeune
femme sénégalaise dont il avait déjà un enfant — « quand tu as un gosse et que tu n’es
pas marié, c’est gênant » — et avec laquelle il a eu un second enfant. Mais, comme
l’interlocuteur précédent, il adapte librement à sa situation la version musulmane de la
polygamie, qui implique une régularité impartiale des tours de l'homme, même s'il n'y
a pas co-résidence des épouses. En effet, outre ses anciennes conquêtes qui reviennent
en vacances à Saly et qu'il revoit alors, il entretient depuis un an une liaison avec une
« copine » attitrée, avec qui il cohabite deux ou trois mois d'affilée lorsqu'elle vient :
« Dans le tourisme, tu as envie de rencontrer des femmes qui te donnent des coupsde main, qui t’aident, qui t’achètent des voitures. Ma copine maintenant elle a 58ans, mais elle est bien dans sa tête, elle fait des placements à la banque, elle a desactions, j’apprends à économiser. Elle est veuve, on s’est connu en 2006, et elle adéjà construit ici une maison à 50 millions [76 225 euros] avec piscine [...]. Quand tuas des projets, tu ne peux pas larguer, tu fais un an avec elle, elle te donne 10 000euros, deux ans ça fait 20 000, trois ans 30 000. »
26 La place de la voiture dans la réussite personnelle est encore évoquée par un détenteur
d'un badge de guide — que par coquetterie, il ne porte jamais sur lui —, âgé de 30 ans,
qui a démarré comme pâtissier dans un hôtel. Ce dernier ne renie ni la dénomination
d’« antiquaire », ni même celle d'« arnaqueur », mais préfère néanmoins lui aussi
désormais se définir comme businessman :
« Pour ce qui est de l’argent tu ne peux pas trouver mieux que Saly au Sénégal. J'aieu cinq voitures, j'en ai vendu deux, maintenant je me lance dans l'immobilier,j'achète des parcelles pour des amis, je construis des maisons pour eux, mais je
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
132
voudrais aussi importer des pièces détachées pour les 607, la 607 c'est la voiture desministres. Si tu trouves une dame qui est sympa, elle te file 100 000 F dans le mois,elle t'envoie une voiture, comme ça tu fais tout pour la satisfaire. Mais ce n’est pasl’argent qui compte, c’est le cœur, si elle envoie 20 000, 30 000 ou 50 000 par mois,c’est toujours ça. »
27 À partir des récits recueillis, se dessinent ainsi les qualités requises pour réussir dans
cet entreprenariat : croire suffisamment en soi pour oser et tenter sa chance, savoir
saisir l’aubaine qui vous met le pied à l’étrier, faire fructifier ses gains28 et être capable
d’acquérir de nouvelles connaissances en matière de développement commercial
(économiser et investir).
28 Les généreuses donatrices, qui envoient de l’argent entre leurs visites pour maintenir
les relations29, n’appartiennent cependant pas toujours aux catégories
socioprofessionnelles favorisées. Interrogés sur les professions de leurs « copines », les
hommes mentionnent effectivement des commerçantes, des femmes d’affaires, des
avocates, une notaire, une sociologue, mais aussi des postières, des infirmières, des
institutrices et des secrétaires. Si l’on examine la profession déclarée par les conjointes
européennes dans les registres des mariages à la mairie de Mbour, la catégorie des
petites employées apparaît la plus représentée. Néanmoins, comme ces femmes ont un
certain âge30, qu’elles sont divorcées ou veuves pour la plupart et n’ont pas (ou plus)
d’enfants à charge, elles semblent disposer de revenus ou d’économies susceptibles
d’alimenter l’envoi de mandats réguliers, à la différence des jeunes filles au sujet
desquelles un « antiquaire » du marché artisanal note : « Elles n’ont pas grand chose,
alors que les femmes âgées, elles te disent : je veux t’aider, qu’est ce que je peux faire
pour toi, j’ai envie de te donner un coup de main. » Et le loueur de quads déjà cité
insiste : « C’est les vieilles qui peuvent t’apporter tout de suite une jolie maison, une
jolie voiture, mettre beaucoup d’argent dans ton compte, pas une jeune fille. Tu sais, les
Sénégalais ils aiment l’argent, tu leur donnes 200 ou 300 euros ils n’hésitent pas quoi.
C’est l’argent qui roule ici. » Bien que les cadeaux pécuniaires puissent atteindre des
sommes conséquentes, c’est évidemment loin d’être toujours le cas. Un enquêté, 26 ans,
chauffeur pour le compte de son frère, évoque des situations moins favorables : « Les
vieilles tubaab, elles te font beaucoup de promesses mais c’est juste pour passer des
vacances. » Amertume exprimée également par un guide plus expérimenté de 34 ans :
« Il y en a qui te font des promesses, qui te disent : au retour je vais t’envoyer cela,et puis rien du tout, elles t’oublient, ça me fait mal au cœur. Quand j’accompagnedes clients à l’aéroport, je vois des femmes qui ouvrent leur sac devant lespoubelles, sortent des adresses, déchirent et mettent dans les poubelles. Et c’est passeulement une ou deux fois que j’ai vu ça ! Tu peux tomber sur quelqu’un à lalongue, ça aboutit à quelque chose, mais quelquefois c’est pour trois nuits ou unesemaine et c’est fini. »
29 Chaque rencontre fait en réalité courir le risque d’une mésaventure. En se conformant
d’une part à l’adage selon lequel « un homme ne dit jamais non », qui exprime
l’obligation sociale de virilité, et d’autre part à la règle implicite qui veut que le
montant de la compensation ne soit jamais négocié avant l’acte sexuel, mais donné
dans l’après-coup, comme dans un élan de générosité féminine, les hommes se
retrouvent parfois piégés par un simple repas offert, d’une valeur moyenne de 5 000
FCFA31. Ainsi le loueur de quads qui affirme recevoir de sa copine actuelle 10 000 euros
dans l’année, auquel je demande s’il s’est déjà trouvé dans une situation de contrainte
sexuelle : « Il y avait une Française qui était là-bas, elle m’avait invité à manger. J’ai
mangé, après je dis : OK, bonne soirée. Elle me dit : non, tu ne t’en vas pas, tu veux pas
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
133
rester avec moi ? Et après, ben, ça ne me plaisait pas, mais tu vois, je l’ai fait aussi pour
lui faire plaisir, elle m’a invité à manger, elle était très sympa, faut que je sois nice
aussi. » De fait, dans l’espoir d’un gain à venir, les hommes se placent dans un rapport
de type serviciel et subordonné. Et quand ce n’est pas la partenaire elle-même qui fait
« bien sentir que c’est elle le chef », ils doivent fréquemment affronter l’hostilité et les
vexations de la part des employés des restaurants et des hôtels qui n’hésitent pas, par
exemple, à demander d’un ton soupçonneux à la touriste accompagnée d’un jeune
(d’allure pauvre) : « Mais il est avec vous ? »
30 Se montrer capable d’accepter les rebuffades des touristes, les échecs, les humiliations
des mieux nantis (parfois des gendarmes lors des rafles) et se remettre rapidement des
difficultés sont donc également des qualités nécessaires à cet entreprenariat. Non
seulement il faut supporter les déboires et pouvoir en plaisanter 32, mais il convient
d’acquérir ce savoir-faire commercial particulier qui consiste à tourner à son avantage
les revers subis, en mettant les personnes qui les ont infligés en dette d’amitié, ce
qu’explique un guide de 30 ans, relatant un malentendu avec deux vacancières
recrutées pour une excursion au Lac Rose. Voulant s’arrêter pour déjeuner avec elles
chez sa sœur et donner quelque chose à cette dernière, il leur avait demandé une
avance. Il s’était alors aperçu qu’au lieu de 65 000 F, elles avaient compris 6 500 F. Le
conflit les avait conduits chez les gendarmes et le commandant avait expliqué aux
touristes que « quand même elles exagéraient, il fallait au moins donner 20 ou 30 000
F ». Sur ce, le guide avait rétorqué que l’important était qu’elles soient contentes, qu’il
n’y avait pas de problème et que, puisque la voiture lui appartenait, il allait carrément
leur offrir l’excursion. Au retour, il les avait même emmenées visiter le port de Mbour
ce qui n’était pas compris dans le contrat de départ. L’atmosphère s’étant détendue, les
touristes avaient proposé 20 euros de plus, ce qu’il avait refusé et elles l’avaient invité
alors à dîner. Au final, l’habile businessman conclut : « Maintenant j’ai leurs numéros de
portables, on se téléphone de temps en temps, elles m’ont déjà envoyé huit clients. »
31 Afin toutefois de limiter les incidents de ce genre, une catégorisation des touristes
s’opère en fonction d’un repérage d’ordre économique33 : les femmes d’âge mûr sont,
ainsi que développé plus haut, opposées aux jeunes filles incapables d’« épauler »
financièrement le partenaire et, les Françaises, avec lesquelles il est aussi plus facile de
faire connaissance grâce à la langue, sont de façon générale préférées aux Espagnoles
« radines », qui discuteraient trop les prix, et aux Allemandes jugées trop « fermées ».
Mais, au sein du groupe le plus intéressant potentiellement, les Françaises d’âge moyen,
sont encore différenciées : celles qui voyagent sur Air France et résident dans des hôtels
chics de celles qui viennent en charter et en club bon marché (comme FRAM dont on se
moque en disant que c’est l’acronyme de « Français Rien à Manger »).
Faire découvrir la vraie Afrique
32 La détermination, l’habileté et l’intelligence des situations de ces hommes se déploient,
comme nous venons de le voir, dans plusieurs activités commerciales connexes. Elles
leur permettent non seulement de vivre et de faire vivre leur famille mais aussi
subjectivement de sortir d’un statut social marginal et de se construire une identité
socialement valorisée, d’hommes d’affaires, ne serait-ce d’ailleurs qu’en partie sur un
mode fantasmatique, grâce aux bénéfices escomptés d’une rencontre avec une touriste
généreuse. La station de Saly apparaît ainsi comme un espace où se joue, pour attirer
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
134
l’attention et amorcer une relation censée améliorer radicalement la position sociale
des acteurs, une série de mises en scènes genrées de soi34 dans lesquelles le corps, au
travers du vêtement, de la coiffure et du maintien, joue un rôle important.
33 Parmi ces mises en scène, se remarquent d’emblée deux constructions masculines assez
stéréotypées : d’une part celle de l’artiste baay-fall métissé de rastaman35 et, d’autre part,
celle du boy doolé qui renvoie à la fois à l’adepte de la lutte sénégalaise et au rappeur
africain-américain. Ces figures hybrides ont en commun de capter et d’hypertrophier
des caractéristiques que les clichés occidentaux attribuent aux Africains : un goût
extraverti pour la parure, la musique et la danse, l’étalage non inhibé de la force
physique, traits qui sont en net décalage avec l’idéal social de pondération et de
retenue (kersa) dominant au Sénégal. Ainsi battre le jembe, porter des couleurs
chatoyantes, parler fort, gesticuler et danser de façon suggestive constituent des
habitus et des pratiques propres à une caste — les batteurs, les griots, les sculpteurs
lawbe experts en techniques de massage et en danses érotiques (Ly 1999). Ou encore le
fait de s’entourer d’objets et de rituels mystiques comme le font les adeptes de la lutte,
une pratique anciennement rurale, connaît un énorme succès dans la jeunesse urbaine
déshéritée (Havard 2001). La rupture avec les convenances sociales se trouve en outre
accentuée par la consommation ostentatoire de tabac et d’alcool — certains se targuant
d’être des musulmans « tantôt à droite tantôt à gauche » —, et l’affichage de codes
contestataires mondialisés, comme fumer de l’herbe à la manière rasta ou proférer,
comme dans le rap, des paroles de violente dénonciation sociale.
34 La désirabilité sociale s’exprime également au travers d’une troisième construction,
surtout chez les plus âgés des hommes rencontrés : celle du trentenaire « sérieux » qui
en attendant le « vrai amour » s’est consacré à sa famille. Il se présente par conséquent
comme un célibataire attardé, propre sur lui — coupe de cheveux courte comme il faut,
vêtements de marque, maintien impeccable et digne — défenseur des valeurs morales,
musulman convaincu et ennemi des aventures sans lendemain, pour qui la sexualité
hors mariage n’est pas concevable, sinon dans un transport amoureux passager
incontrôlable, mais qu’il faut officialiser rapidement à la mosquée, sinon à la mairie.
35 Quelles que soient cependant la construction de la masculinité choisie et l’activité
professionnelle déclarée, aux yeux de la plupart de ces hommes, leur atout essentiel,
voire leur fond de commerce, réside dans leur virilité, pensée comme indissociable de
leur africanité, dans une logique d’acceptation revendicative et de réappropriation d’un
stigmate tiré évidemment du passé colonial (Guillaumin 1992 ; Sayad 1999). La
dénomination Sex Machines qui les désignait dans les années 1990 perpétue d’ailleurs
sans fard les clichés de l’hyper-sexualité africaine et du « beau jeune Noir » construit
comme « jeune poulain, étalon » (Fanon 1952 : 135). Au stéréotype ancien de
« l’Africain-bête de sexe » répond un stéréotype féminin plus récent : celui de la Sugar
Mummy occidentale36 qui tente de s’approprier cette hyper sexualité masculine. Cette
construction ne fait qu’ajouter la séniorité au tableau des inégalités qui
défavoriseraient les hommes sénégalais dans leurs relations avec des Européennes. En
effet, et ceci illustre la façon dont hiérarchies coloniales et postcoloniales influent sur
les représentations du genre dans l’acception commune, le Sénégalais qui vit avec une
Française ne peut qu’abdiquer sa supériorité masculine pour devenir l’esclave (jaam) de
cette femme, son valet (dag) ou son subordonné (suq). L’image de prédatrice, aussi
décrépie physiquement que puissante économiquement, de la Sugar Mummy occidentale
paraît assez éloignée de la figure de la Diriyaanke, une Sénégalaise aisée et élégante, elle
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
135
aussi d’âge moyen, pouvant être une femme libre avec des amants plus jeunes et moins
fortunés qu’elle, mais qui reste néanmoins une « dame » dont le raffinement continue
de séduire. Ce qui est loin d’être le cas de nombreuses touristes européennes, habillées
avec le laisser-aller vestimentaire propre aux vacances, issues en outre, comme indiqué
plus haut, de milieux populaires et souvent marquées par l’âge et la vie.
36 Certes, une série de phrases toutes faites — « la beauté est éphémère, l’important c’est
le cœur », « l’âge, ça ne compte pas », « le bonheur se trouve sur tous les continents » et
des références fréquentes à Khadija la femme du Prophète, de 15 ans son aînée —, sont
destinées à apaiser les inquiétudes des femmes quant à leur âge et à leur apparence
physique. Le sont aussi les premières phrases échangées, entendues à de nombreuses
reprises et rejouées lors des entretiens non sans cynisme par plusieurs de mes
interlocuteurs :
Lui : « Alors la jeune [variantes : la miss, la gazelle] ça va ? »Elle : « Mais je ne suis plus toute jeune [variante : je pourrais être votre mère] ! »Lui : « On dirait pas, vous faites du sport [variante : quel est votre secret] ? »
37 Au-delà des dénégations et des énoncés lénifiants qui leur sont réservés, ces
Européennes vieillissantes sont généralement vues comme exploitant la puissance
sexuelle des hommes sénégalais, et ce dans l’espoir d’échapper à leur condition décatie.
Ainsi, le businessman dont les talents commerciaux ont été relatés plus haut, développe :
« La majorité des Françaises qui viennent ici, c’est pour les hommes, elles ont 50 ans, 55
ans, les Sénégalais, ils te rendent jeunes. Tu vois même un couple qui sont venus, et
l’année prochaine, y a la femme qui vient seule. J’ai discuté avec une femme de 50 ans,
elle me dit : “quand même, les Sénégalais sont durs à faire le goulou- goulou et après le
goulou-goulou, le matin je me sens bien”. » Les interactions avec les vacancières sont
interprétées au travers de ce prisme : « C’est pas des propositions mais c’est des trucs
ou des gestes qui te font savoir que... comme moi je suis barman, des fois tu vois des
femmes... elle te montre qu’elle veut faire l’amour avec des hommes, elle passe derrière
le bar avec un paquet de cigarettes par exemple. Les Blanches, elles disent que les
Sénégalais ils sont forts pour le sexe et les Sénégalais, c’est à cause de la pauvreté et du
miroitement du pouvoir et des richesses » explique un homme de 24 ans, qui est allé
jusqu’en classe de troisième et vient de se marier civilement avec une Française de 38
ans, aide-comptable, qu’il a connue au bar où il travaille37. Son ami, un « artiste
tatoueur » de 26 ans, auparavant tailleur, qui explique posséder « la créativité
africaine » et a également une « copine française », une notaire de 32 ans avec laquelle
il vient de passer une semaine dans le plus luxueux hôtel de la région, abonde dans le
même sens : « Il y a des Françaises qui te le disent carrément : vous avez une belle peau,
vous êtes comme ci, comme ça, qui te montrent que... qui te parlent de tout, du sexe et
de tout. C’est ce qui les motive dans ce sens parce qu’au Sénégal pour avoir des
relations sexuelles c’est facile, c’est même écrit sur le Guide du Routard que c’est gratuit
au Sénégal soit avec les filles soit avec les garçons. »
38 Un loueur de parasols de 35 ans assimile à du vampirisme l’insatiabilité sexuelle de ces
femmes (point de vue qui transparaît également dans l’article « À nous les petits
Sénégalais » du journal L’intelligent) : « On voit des petits avec des femmes qui ont deux
fois l’âge de leur maman. Ces femmes qui sont avec ces jeunes-là, elles ont besoin de
sang frais. Moi si je couche avec une vieille maman qui a l’âge de ma mère, c’est elle qui
gagne. Et pour quoi ? Pour 1 000 euros ? Pour 2 000 euros ? »
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
136
39 Les transactions sexuelles sont ainsi placées par les hommes impliqués dans un registre
d’inégalités si massives que serait renversé du même coup le sens de la domination
dans les rapports hétérosexuels. Par conséquent, afin d’éviter de se faire avoir et
vampiriser en ayant des relations « gratuites », et afin de conserver une image
d’homme viril, c’est-à-dire dominant, ils légitiment l’instrumentalisation des
partenaires, l’utilisation de stratagèmes qui parfois relèvent de l’extorsion de fonds, en
décalage avec les règles qui régissent, par ailleurs dans la société sénégalaise, les
rapports sociaux de sexe. Se justifiant de ce que « situation oblige », leurs pratiques
s’inscrivent dans cette « esthétique de la prédation et de l’accaparement » qu’évoque
Achille Mbembe (2000 : 41).
40 Dans ce contexte, leur proposition récurrente de « faire découvrir la vraie Afrique » aux
touristes ne se superpose ni à la découverte du mode de vie des membres de leur
propre famille38, ni aux excursions qu’ils organisent dans un ou deux villages aux
alentours. Dans un article sur les relations entre touristes et beach boys à Zanzibar,
Sumich (2002) observe que la visite d’un village constitue une étape obligée d’un voyage
touristique en Afrique. Mais alors que les acteurs du tourisme, qui ont un intérêt
commercial à organiser ces excursions pour lesquelles on les paye si cher, insistent
plutôt sur les points communs qu’ils ont avec les touristes car ils se voient eux-mêmes
comme des gens « modernes », la plupart des voyageurs en quête d’authenticité
construisent le village comme un zoo humain de la différence culturelle (a human zoo of
cultural difference) qui leur permet enfin de voir l’Autre et l’Afrique véritable (real
Africa). À leurs yeux, les beach boys et les guides zanzibari constituent, par leur
connaissance de la langue et de la culture locale, une porte d’entrée incontournable
vers cet Autre exotique, mais ils sont considérés comme déjà trop occidentalisés pour
être réellement intéressants.
41 Bien entendu, pour les touristes français(es) qui viennent la première fois au Sénégal, le
village représente également un passage obligé. Aussi chaque guide de Saly propose-t-il
un circuit comportant une halte dans un village sereer et un village pë’l. En prévision de
cet arrêt (une heure environ), il recommande à ses client(e)s « d’apporter des stylos,
des bonbons, et sur place d’acheter du riz et du sucre », bref de se conformer au
comportement stéréotypé du Blanc en Afrique. Ceci lui permet d’avoir à la fois un
statut de bienfaiteur et des obligés dans le village en question et de se présenter aux
touristes comme le seul interlocuteur et centre d’intérêt possible, par contraste avec le
dénuement d’un monde villageois qui sert de repoussoir. Comme le formule le loueur
de quads, guide à ses heures : « Elles vont au village une fois, ça leur suffit pour
découvrir l’Afrique typique. » En effet, de cette excursion, comme de la visite effectuée
dans la famille, l’on attend des touristes un apitoiement — les larmes versées sont
particulièrement appréciées car annonciatrices de gestes généreux par la suite —, mais
surtout que soit retenue la leçon résumée par une résidente à l’ethnographe : « À part
ici [Saly, plus quelques localités proches de la Petite Côte], il n’y a rien à voir, tout
autour il n’y a que de la misère. »
42 « L’Afrique véritable », incarnée par les dragueurs eux-mêmes, est distinguée de
« l’Afrique typique », qu’elle soit rurale ou urbaine (une partie des familles des guides
et des « antiquaires » résident en effet en ville, à Mbour ou Thiès). Cette dernière est
perçue comme miséreuse et sans intérêt, si ce n’est de servir de faire-valoir aux
diverses mises en scène masculines décrites, qui, à elles seules, incarnent la « vraie
Afrique » et méritent l’attention. Lorsqu’une « copine » européenne revient
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
137
régulièrement rendre visite à un amant, ou même s’installe toute ou une partie de
l’année avec lui, sa connaissance de la société sénégalaise ne semble guère s’étendre et
s’approfondir : tout concourt à ce que l’univers balnéaire qui lui est familier reste le
seul fréquentable. Même Dakar — perçue comme poussiéreuse et dangereuse — n’est
pratiquée que pour aller à l’aéroport. La langue utilisée dans le couple demeure le
français et l’énoncé d’une salutation basique en wolof — bonjour, ça va ?, bien merci —
est considéré par son compagnon comme une insertion largement suffisante. La
dynamique de la relation, quand cette dernière s’avère durable, est tournée vers la
poursuite d’une vie dans laquelle la Petite Côte serait une banlieue tropicale du Nord. Et
dans les cas où l’union s’officialise par un mariage à la mairie, elle s’inscrit dans la
perspective d’un départ pour l’Europe39.
43 Dans la mesure où le mariage, pour les générations précédentes, devait s’effectuer dans
son rang social (nawle), se marier avec un(e) Blanc(he) était considéré comme une
mésalliance extrême (génn xeet, sortir de sa race), sauf peut-être chez les personnes
castées40, où ce pouvait être un moyen de s’affranchir de l’étau social de la caste. Or,
depuis presque une décennie maintenant, les mariages mixtes célébrés à la mairie de
Mbour qui unissent des Sénégalais et des Européens, fluctuent, selon l’année
considérée, de 16 à 24 % du total des mariages enregistrés41, un phénomène dont
l’ampleur ne peut évidemment pas s’expliquer par la seule question des castes mais est
à rapporter au désir qui traverse toutes les couches sociales chez les jeunes d’« aller en
kaw » (kaw, le haut donc le Nord), et devient de plus en plus difficile à réaliser
autrement. Parmi ces mariages, ceux unissant des hommes sénégalais à des conjointes
européennes, des Françaises dans 73 % des cas, dépassent désormais largement les
mariages de femmes sénégalaises avec des conjoints européens (198 versus 127 sur la
période 2004-2007).
*
44 Les hommes dont les propos décomplexés sont retranscrits ici, propulsés en quelques
années de gagne-petit en hommes d’affaires, grâce à leur débrouillardise, à leur
mobilisation d’un savoir-faire genré particulièrement efficace et à leur connaissance
des langues et mode de vie occidentaux, ne sont pas sans rappeler Camara, le
personnage du roman de Williams Sassine, Le Zéhéros n’est pas n’importe qui (1985).
Comme lui, ils apparaissent tantôt comme « des zéros qui se prennent pour des héros »,
tantôt comme un « mélange de zéros et de héros » (ibid. : 217). Comme lui également, ils
ne sont pas n’importe qui. En effet, pour accéder à une situation meilleure, au style de
vie et aux biens tant convoités dans un contexte de pauvreté extrême, il leur faut
déployer une énergie et des aptitudes particulières, dont celle de prendre des risques et
de faire face aux échecs et aux humiliations sans se décourager. Il leur faut aussi
s’affranchir d’un certain nombre de limitations sociales afin de continuer à consolider
leur autonomie tout en évitant de se marginaliser totalement car, n’étant plus dans leur
prime jeunesse, ils sont pris dans des obligations sociales telles qu’aider leurs parents et
pour certains élever des enfants. Ils doivent de ce fait en permanence improviser pour
s’orienter avec adresse entre des exigences qui paraissent contradictoires. Et dans cette
mesure, ils sont représentatifs ainsi qu’ils le prétendent de « la vraie Afrique » urbaine
d’aujourd’hui.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
138
45 Les arrangements entre eux et les femmes qu’ils fréquentent, autant les touristes
européennes que les femmes sénégalaises d’ailleurs, montrent bien qu’il existe tout un
continuum possible d’échanges économico-sexuels entre le mariage et la prostitution
(Tabet 2004)42 et qu’à la différence de la fiction produite par l’imaginaire occidental
contemporain, amour et argent sont loin d’être des mondes antagonistes (Zelizer 2001).
Si mon enquête éclaire le contexte et les pratiques sexuelles transactionnelles de ces
acteurs masculins du tourisme en restituant le sens qu’ils donnent à celles-ci, elle ne
s’est en revanche qu’accessoirement attachée à leurs partenaires européennes et ne
permet pas de trancher, à leur sujet, entre tourisme sexuel et « tourisme sentimental »
(« romance tourism »), concept développé pour la Jamaïque par Pruitt et Lafont (1995) et
contesté par d’autres chercheurs travaillant également dans la Caraïbe qui récusent
toute différence entre ce tourisme féminin et le tourisme sexuel masculin et avancent
que ces femmes ont recours à une prostitution masculine. Dans Performing Africa, une
étude sur les griots de Gambie où, dans la partie sur la marchandisation de la culture,
un chapitre est consacré aux relations entre les femmes scandinaves et leurs « amis
professionnels », Paulla Ebron (2002 : 169) juge, quant à elle, que les histoires de ces
femmes ne constituent pas une simple inversion des récits masculins de vacances : elles
n’imaginent nullement les hommes gambiens comme des proies faciles, ce que
confirment par ailleurs les entretiens avec eux qui n’ont rien de récits de victimisation.
Les hommes que j’ai interrogés au Sénégal ne se présentent pas non plus comme des
victimes, loin s’en faut, ce dont témoigne entre autres leur attachement à une identité
de businessman. La drague professionnalisée s’inscrit parmi d’autres activités qui
relèvent d’une économie à la fois informelle et spéculative où les frontières du légal et
du moral sont aisément franchies. Il n’apparaît pas chez eux de dissociation complète
entre le service sexuel comme travail et la sexualité comme expression et vie
personnelle, et ils construisent leurs partenaires féminines européennes non comme
des clientes, mais comme des « copines », avec lesquelles cohabitation et mariage sont
envisagés comme une issue possible à la pauvreté, un accès au voyage et une meilleure
inscription dans un monde globalisé. Aussi, la complexité et la fluidité qui se dégagent
des productions de leurs identités, tant professionnelle que genrée, contredisent-elles
la vision réductrice qui ferait d’eux des personnages marginaux, présentés tantôt
comme de simples intermédiaires culturels, tantôt comme des prostitués, tantôt encore
comme des exploiteurs.
BIBLIOGRAPHIE
ADJAMAGBO, A. & ANTOINE, P.
2004 « Etre femme “autonome” dans les capitales africaines. Les cas de Dakar et Lomé », DIAL,
document de travail, DT/ 2004/03. <www.dial.prd.fr/dial_publications/PDF/Doc_travail/
2004-03.pdf>.
ADJAMAGBO, A., ANTOINE, P. & DIAL, F. B.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
139
2004 « Le dilemme des Dakaroises : entre travailler et bien travailler », in M. C. DIOP (dir.),
Gouverner le Sénégal : entre ajustement structurel et développement durable, Paris, Karthala : 247-272.
ANTOINE, P. & NANITELAMIO, J.
1995 « Peut-on échapper à la polygamie à Dakar ? », Chronique du CEPED, 32.
ANTOINE, P., DJIRÉ, M. & NANITELAMIO, J.
1998 « Au cœur des relations hommes-femmes : polygamie et divorce », in P. ANTOINE, D.
OUEDRAOGO & V. PICHE (dir.), Trois générations de citadins au Sahel. Trente ans d’histoire sociale à Dakar
et Bamako, Paris, L’Harmattan : 147-180.
AUDRAIN, X.
2004 « Devenir “baay-fall” pour être soi », Politique africaine, 94 : 82-104.
BIAYA, T. K.
2000 « La Culture Populaire : une auberge espagnole ou une nouvelle discipline ? », Africa Policy
Information Center. <http://www.africaaction.org/rtable/bia0005f.htm>.
2001 « Les plaisirs de la ville : Masculinité, sexualité et féminité à Dakar (19972000) », African
Studies Review, 44 (2) : 71-85.
BROWN, N.
1992 « Beachboys as Culture Brokers in Bakau Town, The Gambia », Community Development
Journal, 27 (4): 361-370.
DIAL, F. B.
2007 « Le divorce, une source d’émancipation pour les femmes ? Une enquête
à Dakar et Saint-Louis », in T. LOCOH (dir.), Genre et sociétés en Afrique. Implications pour le
développement, Paris, Ined : 357-370.
DIENG, I. M. & BUGNICOURT, J.
1982 Touristes-rois en Afrique, Paris, Karthala ; Dakar, Enda.
DIOP, A. B.
1985 La famille wolof : tradition et changement, Paris, Karthala.
DIOUF, N.
2003 Les mariages mixes à Mbour, Mémoire de maîtrise, Dakar, Faculté des lettres et sciences
humaines, UCAD, non publié.
EBRON, P.
2002 Performing Africa, Princeton (New-Jersey), Princeton University Press.
FANON, F.
1952 Peau noire, masques blancs, Paris, Éditions du Seuil.
FAYE, O. & THIOUB, I.
2003 « Les marginaux et l’État à Dakar », Le mouvement social, 204 (3) : 93-108.
FOUQUET, T.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
140
2007 « De la prostitution clandestine aux désirs de l’Ailleurs : une “ethnographie de
l’extraversion” à Dakar », Politique africaine, 107 : 102-124.
GUILLAUMIN, C.
1992 Sexe, Race et Pratique du pouvoir. L’idée de Nature, Paris, Côté-Femmes.
2002 [1972] L’idéologie raciste. Genèse et langage actuel, Paris, Gallimard.
HAVARD, J.-F.
2001 « Ethos “bul faale” et nouvelles figures de la réussite au Sénégal », Politique africaine, 82 :
63-77.
HERTRICH, V.
2002 « Nuptiality and Gender Relationships in Africa. An Overview of First Marriage Trends over
the Past 50 Years », Communication présentée à la conférence annuelle de la Population
Association of America, Atlanta, 9-11 mai.
KIBICHO, W.
2004 « Tourism and the Sex Trade : Roles Male Sex Workers Play in Malindi, Kenya », Tourism
International Review, 7: 129-141.
LY, A.
1999 « Notes brèves sur l’érotisme chez les Lawbes du Sénégal », Bulletin du Codestria, 3-4 : 46-47.
MALAM, L.
2003 « Performing Masculinity on the Thai Beach Scene », Department of Human Geography,
RSPAS, ANU, Working paper 8. <http://rspas.anu.edu.au/grc/publications/MalamL_2003.pdf>.
MARIE, A.
1997 « Du sujet communautaire au sujet individuel. Une lecture anthropologique de la réalité
africaine contemporaine », in A. MARIE ET AL. (dir.), L’Afrique des individus, Paris, Karthala : 53-110.
MBEMBE, A.
2000 « À propos des écritures africaines de soi », Politique africaine, 77 : 16-43.
MBOW, P.
2000 « Démocratie, droits humains et castes au Sénégal », Journal des Africanistes, 70 (1-2) : 71-91.
NYANZI, S., ROSENBERG-JALLOW, O. & BAH, O.
2005 « Bumsters, Big Black Organs and Old White Gold : Embodied Racial Myths in Sexual
Relationships of Gambian Beach Boys », Culture, Health & Sexuality, 7 (6): 557-569.
PHETERSON, G.
2001 Le prisme de la prostitution, Paris, L’Harmattan.
PROWSE, M.
2004 « It’s Really Just Like Fishing... What You Catch Depends on The Bait You Put on The Line:
The Construction of Friendships Between Beachboys and Tourists on The Shore of Lake Malawi »,
Draft paper presented at Livehoods at the Margins’ Conference, School of Oriental and African
Studies, 8-9 July, London.
PRUITT, D. & LAFONT, S.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
141
1995 « For Love and Money. Romance Tourism in Jamaica », Annals of Tourism Research, 22 (2):
422-440.
SALOMON, C.
2007 « Jungle Fever. Genre, âge, race et classe dans une discothèque parisienne », Genèses, 69 :
97-111.
SARR, Y.
2002 Approche sociologique de la pratique du tourisme sexuel à partir du cas des jeunes âgés de 18 à 24 ans
de la Petite Côte au Sénégal, Mémoire de DEA, Dakar, Faculté des lettres et sciences humaines,
UCAD, non publié.
SASSINE, W.
1985 Le Zéhéros n’est pas n’importe qui, Paris, Présence Africaine.
SAYAD, A.
1999 La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris, Éditions du Seuil.
SMETTE, I.
2001 Managing Hearts, Bodies and Beauty. Young Dakar Women’s Construction of Selves, Ph. Thesis,
Oslo, University of Oslo.
SUMICH, J.
2002 « Looking for the “Other”: Tourism, Power and Identity in Zanzibar », Anthropology of
Southern Africa, 25 (1-2): 39-45.
TABET, P.
2004 La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel, Paris, L’Harmattan.
WAGNER, U.
1977 « Out of Time and Space. Mass Tourism and Charter Trips », Ethnos, 42 (1-2): 39-49.
WAGNER, U. & YAMBA, B.
1986 « Going North and Getting Attached: The Case of the Gambians », Ethnos, 51 (3): 199-222.
ZELIZER, V.
2001 « Transactions intimes », Genèses, 42 : 121-44.
NOTES
1. Les employés consulaires utilisent d’ailleurs parfois cet argument pour décourager les
candidats au mariage et n’accordent le visa au conjoint sénégalais qu’après un parcours dissuasif.
2. Voir notamment Marianne (27 août 2000), L’Express (3 juillet 2003), Le Nouvel Observateur (18-24
août 2005), Le Monde Diplomatique (août 2006).
3. Voir notamment « African gigolos » dans Biba (avril 2000), « Sable brûlant » dans Strip-tease (6
mai 2003), et « Charters pour l’amour » dans Envoyé spécial (6 avril 2006).
4. Au XVIIe siècle, les premières unions de ce type entre femmes sereer et hommes portugais
installés à Saly-Portudal, Joal et Rufisco étaient plutôt durables. Leurs enfants, garçons et filles
(les Signares, dames en portugais), prospéraient dans le commerce. Par la suite, à Gorée et à Saint-
Louis, où ils émigrèrent avec l’arrivée des Français et des Anglais au XVIIIe siècle, le mariage à la
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
142
« mode du pays » devint temporaire, bien que reconnu par l’Église catholique et le Roi de France.
Il unissait le temps de leur séjour des hommes puissants, français et anglais, et des Signares dont
les familles espéraient constituer avec l’Europe des réseaux d’alliance et d’affaires protecteurs.
5. Voir le baromètre de l’Organisation mondiale du tourisme no 3 du 10 novembre 2008.
6. Le terme antiquaire renvoie aux différents artisans castés — bijoutiers, sculpteurs, cordonniers
et tisserands — qui vendaient chaque fin de semaine leurs produits sur la plage aux militaires
français du camp de repos de Mbour implanté lors de la Seconde Guerre mondiale.
7. Département de sociologie, Université Cheikh Anta Diop, Dakar.
8. En 2007, deux hommes interrogés en 2005 n’ont pas désiré continuer à participer. Trois se
trouvaient à l’étranger, deux ayant obtenu un visa pour rejoindre leur femme en Europe, un
autre voyageait pour « affaires » aux États-Unis. Un seul avait quitté l’activité de guide
touristique et de drague : il s’était installé comme mareyeur à Mbour.
9. L’anthropologue africaine-américaine Paulla E BRON (2002 : 178) souligne elle aussi cette
difficulté en Gambie : « Indeed it became essential to my research to separate myself from tourist
women. And yet I, too, as an anthropologist traveling without the guardianship of a male
protector, was implicated in many of the same ways as other women travelers. »
10. L’expression est empruntée à un article « Le tourisme en AOF », L’Illustration, 29 février 1936,
supplément, p. XIII.
11. Au refrain éloquent : « Je suis à poil [...] je m’éclate au Sénégal, avec une copine de ch’val. »
12. Mendiants, prostituées, « faux guides » et marchands ambulants (FAYE & THIOUB 2003).
13. En Gambie, en 1989, les autorités avaient tenté de contrôler le secteur informel du tourisme
en attribuant des badges et parfois des uniformes à certains « bom- sas » » ou « bumsters » »,
nom donné aux jeunes hommes qui traînent et, entre autres activités, draguent les femmes
touristes. Tous devaient s’enregistrer auprès du ministère et ceux qui étaient sélectionnés
recevaient l’autorisation de stationner près de tel ou tel hôtel, sans pour autant être payés
(BROWN 1992). Une nouvelle campagne, plus répressive, fut entreprise en 2002-2003 (NYANZI ET AL.
2005). Au Malawi, des séances de formation ont été également organisées en 2002-2003 par le
ministère du Tourisme pour les soi-disant guides. Ceux qui réussissaient l’examen final étaient
accrédités et recevaient un badge (PROWSE 2004). Dans ces deux cas cependant, comme au Sénégal,
le badge s’est révélé peu utilisé car il va à l’encontre de la mise en scène du caractère fortuit des
rencontres amicales ou amoureuses.
14. Il se monte à 100 000 FCFA, 152 euros, ce qui équivaut à deux mois de salaire d’un employé au
SMIG.
15. Un rastaman qui a observé à la plage plusieurs marchands ambulants proposer des colifichets
à l’ethnographe, vient vers elle à son tour et lui déclare en la regardant droit dans les yeux :
« Moi, c’est toi que je veux. » Citons encore cet homme parlant mal le français et apostrophant
une Européenne, la soixantaine bien sonnée, toujours sur la plage : « Tu sais, je suis un bon
étalon » et ce garçon, en ville, à une dame aux cheveux blancs : « Vous ne cherchez pas quelqu’un
qui baise bien ? » (C. Enel, communication personnelle, 2007).
16. Parmi les hommes qui ont accepté les entretiens formalisés, la plupart venaient de familles
urbaines et étaient allés jusqu’au CM2 avant de rentrer dans la vie active. L’un d’entre eux avait
atteint un niveau de 3e et deux autres n’avaient pas été scolarisés du tout et avaient appris le
français sur le tas.
17. En Gambie, des niveaux de compétence différents ont également été décrits chez les
« bumsters », allant du niveau amateur au niveau intermédiaire et confirmé (NYANZI ETAL. 2005).
18. En février 2008, le tollé suscité par l’organisation d’une fête homosexuelle, qualifiée de
célébration d’un mariage gay, est allé jusqu’à un appel à manifester publiquement contre
l’homosexualité au sortir de la prière du vendredi à Dakar.
19. Dans le magazine Ça me révolte (7 mai 2003).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
143
20. L’année d’avant, Avenir de l’Enfant (ADE), un Observatoire pour la protection des enfants
contre les abus et l’exploitation sexuels avait été mis en place à Mbour par une ONG sénégalaise
qui dénonçait non seulement les abus perpétrés par les touristes, mais également ceux commis
au sein des familles.
21. Du style « Confidences d’un homosexuel de Saly Portudal : Mon copain que je partage avec sa
femme », L’Observateur, 14 avril 2006.
22. Au Sénégal, la majorité sexuelle est de 18 ans et civique de 21 ans.
23. L’intelligent, no 2208, mai 2003.
24. Cet écart d’âge est associé à l’entrée en union précoce pour les femmes, tardive pour les
hommes, généralisée pour les deux sexes (avec remariage dans l’immense majorité des divorces)
et à l’organisation du marché matrimonial polygamique. L’analyse de questionnaires
biographiques recueillis à Dakar en 1990 montrait qu’au premier mariage féminin, l’écart avec le
conjoint était de 10 ans dans une union monogamique et de 20 dans une union polygamique
(ANTOINE & NANITELAMIO 1995). On observe cependant que l’âge au premier mariage des femmes
augmente et que l’écart entre conjoints de ce fait se réduit (ADJAMAGBO, ANTOINE & DIAL 2004 ;
HERTRICH 2002).
25. Même s’il y a une certaine évolution des rôles au sein des couples urbains où la femme est
salariée, l’adhésion à la norme d’entretien de l’épouse reste très forte chez les femmes
(ADJAMAGBO & ANTOINE 2004 ; ANTOINE, DJIRÉ & NANITELAMIO 1998 ; DIAL 2007 ; DIOP 1985).
26. Cette somme, qui correspond au salaire mensuel minimum garanti, équivaut au prix
journalier de pension payé par une touriste dans un hôtel de standing moyen.
27. Au Sénégal, les registres des mariages à la mairie mentionnent le régime choisi : monogamie
ou polygamie. Lorsque l’un des conjoints est Européen, pour que le mariage soit reconnu dans
son pays, l’option est obligatoirement la monogamie. Cela reste envisageable ici car le précédent
mariage de l’homme s’est effectué « au village » (mariage traditionnel et religieux) mais n’a pas
été officialisé par l’état-civil.
28. Soulignons de ce point de vue la différence avec les jeunes femmes décrites par Thomas
FOUQUET (2007) qui claquent en dépenses ostentatoires l’argent qu’elles obtiennent de leurs
clients.
29. Elles sont qualifiées de « ressource », de « grenier » voire de « Banque Mondiale » par les
parents des « antiquaires », quant à eux parfois nommés péjorativement « Western Union », en
référence au message publicitaire de la Radio télévision sénégalaise : « Pour transférer de l’argent
liquide rapidement je fais confiance à Western Union. »
30. Dans les mariages enregistrés pour l’année 2007 à Mbour entre des femmes européennes et
des hommes sénégalais, l’âge moyen des femmes est de 42 ans et l’écart d’âge moyen entre les
conjoints est de 10 ans de plus pour la femme. Remarquons cependant que dans 25 % des cas, les
femmes ont de 0 à 6 ans de moins que le conjoint, dans 25 % des cas de 1 à 14 ans de plus, dans
25 % des cas de 15 à 24 ans de plus, et au-delà de 25 ans dans 25 % des cas.
31. Ceci est corroboré par les propos tenus devant l’ethnographe sur la plage d’un hôtel de Saly
par une résidente, dans les 70 ans, s’adressant à deux autres vacancières françaises de sa
génération : « Les hommes sénégalais, tu donnes 5 000 F [8 euros] et tu couches avec. »
32. Il est courant d’entendre ainsi apostropher la touriste qui refuse de discuter et passe son
chemin : « Alors, tu es fâchée ou fauchée ? »
33. À Zanzibar, les riches touristes sont appelés kuku, ce qui en swahili signifie poulet, ceux qui
sont moins aisés sont désignés par le terme vigorodo qui désigne le matelat peu épais utilisé par
les gens du commun, et les routards (ainsi que les non Européens, à savoir les touristes
asiatiques) sont quant à eux nommés kishuka, merde d’oiseau (SUMICH 2002).
34. Ce qui corrobore l’analyse de Linda MALAM (2003: 7) à propos des hommes thai employés dans
les bars et les bungalows en Thaïlande du Sud: « By “ad- libbing” identity categories in spaces of
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
144
intense interaction with Western tourists, bar and bungalow workers have the opportunity to
contest their marginal status in some spaces/contexts and re-write new identity script. »
35. La profession d’artiste est l’une de celles les plus souvent déclarées aux registres des mariages
par les conjoints sénégalais de femmes européennes. Ces Baay-fall sont souvent qualifiés de Baay-
faux (AUDRAIN 2004).
36. Cette dénomination est utilisée dans une pièce de Tanika Gupta, Sex, Sand and Sugar Mummies
in a Carribean Beach Fantasy, jouée au Royal Court à Londres en 2006 et dont l’intrigue se situe sur
la plage de Négril à la Jamaïque.
37. Deux ans plus tard, j’apprends qu’il a obtenu son visa et l’a rejointe en France, mais qu’il s’en
est séparé rapidement et est parti travailler en Espagne.
38. Emmener la touriste dans la famille, lui faire mesurer l’écart entre les conditions de vie
locales et celles de l’Europe, apparaît non seulement être une façon de créer de l’intimité et de la
confiance, mais aussi de la mettre en face de ses responsabilités financières. Cette tactique a été
également relevée chez les beach boys de Bakau en Gambie (BROWN 1992) et de Cape Maclear au
Malawi (PROWSE 2004).
39. Une étude par questionnaire réalisée en 2002 dans la région de Malindi au Kenya auprès de 73
hommes impliqués dans des échanges économico-sexuels avec des touristes montre que 18 %
d’entre eux avaient déjà rendu visite à des client(e)s ou ami(e)s (KIBICHO 2004).
40. Dans la plupart des groupes ethniques du Sénégal, et notamment chez les Wolofs, une
stratification rigide oppose aux personnes libres les anciens esclaves et surtout les membres de
groupes endogames d’artisans (forgerons, boisseliers, peaussiers...) et de musiciens (griots),
appelés castes. À ces groupes, est associée une notion d’impureté qui vient soutenir l’interdiction
pour toute personne libre (ou même d’origine captive) de se marier avec un(e) casté(e) et un
certain nombre de représentations qui sont à la source de discriminations sociales et politiques
(MBOW 2000).
41. Nini D IOUF (2004) avait, dans son mémoire de maîtrise, relevé 16 % de mariages mixtes en
2000/2001 et 19 % en 2002/2003. L’étude des registres par année indique 17 % en 2004, 24 % en
2005, 18 % en 2006 et 17 % en 2007, arrêtée à la date du 5 décembre.
42. Son champ d’investigation concerne les relations hétérosexuelles impliquant une
compensation (les hommes paient les femmes), mais le concept peut être étendu aux relations
dans lesquelles la transaction économique se fait dans l’autre sens. L’auteure souligne d’ailleurs
l’intérêt des études sur les rapports dans lesquels des hommes sont rémunérés ou entretenus par
des femmes et la « formidable occultation sociale de ce phénomène » (TABET 2004 : 171).
RÉSUMÉS
Dans un contexte de précarité économique et d'obstacles à partir au Nord, l'arrivée massive de
touristes — dont des femmes seules — susceptibles de fournir des compensations pour des
services rendus, paraît avoir engendré au Sénégal une proposition de prestations sexuelles qui
n'existait pas, du moins à cette échelle et sous cette forme. Le phénomène a acquis sur la Petite
Côte, première destination touristique du pays, une visibilité incontestable. L'article s'appuie sur
les récits d'hommes, désignés sous le terme générique d'« antiquaires », qui ne vendent pas
forcément des objets, mais s'engagent dans des transactions sexuelles avec des vacancières
venues d'Europe, souvent plus âgées qu'eux. Il décrit les compétences mobilisées pour réussir
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
145
dans cette activité, interroge la réorganisation des rapports sociaux de sexe qu'elle implique et
souligne la complexité des significations possibles pour les acteurs eux- mêmes. L'étude discute
enfin le rôle de culture brokers parfois attribué aux beach boys ailleurs en Afrique.
Against a backdrop of economic precariousness combined with obstacles to going North in search
of work, the massive influx of tourists to Senegal, including women travelling alone and willing
to pay for services rendered, has given rise to an offer of sexual services that was previously
unknown—or at least not on that scale and in that form. The phenomenon is clearly visible in
Petite Côte, the country's leading tourist destination. The article is based on the stories of the
men generically known as "antique dealers", not because they necessarily sell objects, but rather
because they engage in sexual transactions with European female holiday makers, often far older
then they are. It describes the skills used to succeed in the business, questions the reorganisation
of social sexual relations that it implies, and underscores the complexity of meanings this may
have for the players themselves. The study also discusses the role of the culture brokers
sometimes attributed to beach boys elsewhere in Africa.
INDEX
Mots-clés : Sénégal, Petite Côte, commerce, tourisme féminin, transactions sexuelles, Sugar
Mummy, virilité
Keywords : Senegal, Petite Côte, trade, female tourism, sexual transactions, Sugar Mummy,
virility
AUTEUR
CHRISTINE SALOMON
Inserm, Centre d’épidémiologie et de santé des populations, U 687, Villejuif, France.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
146
Au rythme du tourisme. Le mondetransnational de la percussionguinéennePulse of Tourism. The Transnational World of Guinean Drum
Julien Raout
1 La République de Guinée n’est pas un pays touristique. L’Etat guinéen n’a pas construit
de discours sur l’hospitalité légendaire de sa population comme c’est le cas au Mali, au
Sénégal ou au Maroc. Malgré la beauté et la diversité de ses paysages, la Guinée n’a pas
su, pour l’instant, attirer les tour operator internationaux extrêmement frileux à
intégrer la destination dans leur catalogue en raison de l’instabilité politique chronique
du pays1. Mis à part le tourisme d’affaires et quelques circuits de trekking dans le Fouta-
Jalon, le tourisme en Guinée est porté par un engouement international grandissant
pour les percussions et les danses traditionnelles du pays. Le tambour jembé,
l’instrument emblématique de la culture guinéenne aujourd’hui pratiqué dans le
monde entier, attire chaque année, pendant la saison sèche (de novembre à février) des
centaines de touristes désirant perfectionner leur pratique musicale et découvrir le
pays d’origine de leur instrument d’élection. Nous proposons d'étudier ce tourisme du
rythme, émergent en Guinée depuis la fin des années 1980, en replaçant le phénomène
dans le cadre de l’accélération des transformations musicales et de la circulation des
artistes depuis la décolonisation.
2 Longtemps préoccupées par les dégradations du patrimoine musical occasionnées par
le tourisme, les problématiques contemporaines liant musique et tourisme insistent
aujourd’hui sur le rôle de la musique dans le combat pour le prestige d'un lieu à travers
l'organisation de festivals ou la création de musées dédiés à des artistes locaux (Abram
et al. 1997 ; Dewitt 1999 ; Gibson & Connell 2005 ; Doquet 2008). En 1999, les autorités
ont tenté de mettre en œuvre la construction d’un Centre international de percussion
(CIP) à Conakry. Ce projet, qui donnait suite à la première et unique biennale de
percussion, fut abandonné par la Commission européenne, le principal financeur. En
l’absence d’un investissement de la part des institutions culturelles guinéennes, le
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
147
phénomène touristique est essentiellement pris en charge par le monde associatif. Une
multitude d’associations de danse et de percussion africaines basées à l’étranger (en
Europe, en Amérique du Nord et du Sud, au Japon) organisent des séjours de formation
sur place. D’abord encadrés par une diaspora d’artistes des ballets nationaux de Guinée,
les touristes organisent également leur formation auprès de jeunes artistes guinéens
restés au pays. Le phénomène s’amplifie alors pour générer des réseaux transnationaux
d’artistes, de solidarités et de partenariats noués entre les visiteurs et leurs hôtes.
3 La mise en tourisme de la Guinée à travers ces réseaux nous amène à nous interroger.
Comment les imaginaires des touristes et ceux des artistes guinéens entrent-ils en
résonance (mais aussi en conflit) pour donner naissance à ces réseaux transnationaux
qui alimentent le phénomène touristique sans l’intervention ni des tour operator
conventionnels ni de politiques touristiques d’envergure ?
4 En replaçant la circulation des individus au centre de l’analyse nous espérons montrer,
en premier lieu, les opérations de formatage préalables à la mise en tourisme de la
musique guinéenne. Ensuite, notre article s’attachera à décrire les réseaux qui
permettent l’organisation du voyage et les différentes modalités d’apprentissage
musical proposées aux visiteurs. Ces données nous permettront de mieux saisir les
imaginaires de ces visiteurs activement engagés dans les pratiques musicales locales.
Enfin, nous montrerons comment cette nouvelle économie touristique suscite
localement des vocations artistiques, mais génère également des tensions autour d’un
patrimoine musical désormais partagé.
5 Cette enquête, effectuée entre 2003 et 2008, est basée sur une série d’entretiens avec
des artistes guinéens résidant dans leur pays ou à l’étranger, anciens maîtres musiciens
des ballets nationaux ou jeunes artistes en voie de professionnalisation, et des
apprentis percussionnistes internationaux en formation en Guinée. Une observation
participante multi-située, entre la France et la Guinée, m’a conduit à endosser
alternativement le rôle d’apprenti percussionniste dans le cadre de stages collectifs, de
musicien accompagnateur dans les ballets ou les cérémonies populaires de Guinée mais
aussi d’observateur plus distancié de manière à ne pas être soumis au point de vue
univoque d’un seul maître de musique.
La Guinée comme « pays de percussion » : réseau depratique et communauté d'interprétation de lapercussion guinéenne
6 Avant d’aborder la manière dont les musiques de percussion guinéenne se
reconstruisent aujourd’hui « avec et à travers le tourisme » (Doquet & Le Menestrel
2006), voyons d’abord comment la réinvention de ces musiques, dans le cadre des
politiques culturelles de la post-indépendance puis dans le contexte de la globalisation,
a permis leur appropriation par un public international et contribué à construire le
territoire guinéen comme une destination attractive, un « pays de percussion »2.
De la réinvention à la globalisation
7 La Première République de Guinée, de l’indépendance du pays en 1958 à la mort du
président Sékou Touré en 1984, ne fut pas favorable au développement du tourisme3. En
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
148
revanche, le régime d’obédience marxiste contribua de manière significative à la
promotion des arts populaires, en particulier de la musique. Les efforts de Sékou Touré
et de son Parti démocratique de Guinée (PDG), pour réhabiliter et revigorer la culture
locale dénigrée pendant la période coloniale, ont culminé dans le développement de
politiques culturelles destinées à construire « l’imaginaire national » (Anderson 1983).
Une des premières mesures du gouvernement guinéen fut de dissoudre les groupes
musicaux jouant des musiques d’inspiration française. Trop associés à l’oppression
coloniale, ces groupes, jouant de la valse, de la polka ou du tango, furent sommés
d’effectuer des séjours à l’intérieur du pays pour se ressourcer à la base de la culture
populaire guinéenne. Les groupes de « musique moderne » guinéenne, tels que le
Bembeya jazz ou les Amazones de Guinée, interprétant le folklore local avec guitares
électriques et saxophones, donnèrent ainsi naissance à une musique nouvelle qui
inspirera tous les musiciens d’Afrique de l’Ouest. L’autre versant de cette politique
culturelle fut la revalorisation et la réinvention des musiques traditionnelles locales. Le
découpage colonial des territoires africains avait laissé au nouveau gouvernement la
nécessité de gérer une multiplicité de groupes « ethniques », ou « ethnicisés » par le
pouvoir colonial : les Peuls dans les montagnes du Fouta- Jalon à l’Ouest du Pays, les
Baga, Landouma et Soussou sur la côte atlantique, les Malinké sur les plateaux de
Haute-Guinée, et une mosaïque de communautés en Guinée forestière au sud-est du
pays, Kissi, Toma, Guerzé, Manon, Konianké, regroupés sous l’appellation de Forestiers.
Dès les premiers jours de l’indépendance, le pays entier fut quadrillé par des agents du
gouvernement qui eurent pour mission de recruter les meilleurs danseurs et musiciens
dans toutes ces régions de Guinée. Ces artistes, souvent de jeunes paysans analphabètes
qui animaient les cérémonies populaires ou religieuses dans leurs communautés
d’origine, furent regroupés dans la capitale, Conakry, au sein de groupes musicaux
appelés ensembles instrumentaux nationaux ou ballets nationaux. Ces ensembles
musicaux pluri-ethniques, dont le plus fameux fut certainement le « Ballet africain de
la République de Guinée »4 qui donnera des représentations à travers le monde,
devaient révéler toute la diversité culturelle du pays et en proposer une synthèse
démontrant l’unité de la nouvelle nation. Parmi les instrumentistes engagés lors de ces
recrutements, les joueurs de jembé, les jembefolaw, (littéralement, ceux qui font parler le
jembé en malinké, sing. jembefola), sont particulièrement prisés. Ce tambour en forme de
calice que l’on frappe à mains nues, utilisé en Haute- Guinée pour encourager les
paysans lors des travaux agricoles, des cérémonies populaires (mariages, baptêmes) ou
religieuses (sortie des masques, circoncisions, fête du mouton), devient vite, grâce à sa
puissance, sa polyvalence et le côté spectaculaire de sa pratique, « l’instrument roi du
ballet » (Zanetti 1996 : 171).
8 Selon ses concepteurs, cette politique culturelle n’était pas un simple retour au passé
précolonial. Face aux supputations récurrentes de primitivité des peuples africains, il
fallait offrir aux yeux du monde une culture débarrassée des traditions considérées
comme archaïques. En portant les masques sacrés sur scène, en transformant les
mythes et les fétiches en spectacles populaires, les ballets et ensembles musicaux
furent mis au service d’une politique systématique de lutte contre les religions
traditionnelles5 (Rivière 1969). À partir de l’indépendance du pays, tous les Guinéens
seront encouragés à pratiquer des instruments de musique comme la kora ou le balafon
et à chanter en public alors que ces activités étaient auparavant exclusivement
réservées aux familles de griots. En tant que principal véhicule de l’idéologie du Parti,
la musique était considérée comme une obligation civique, et tous les citoyens se
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
149
devaient de pratiquer une activité musicale6. À travers cette grande entreprise
d’ingénierie culturelle, de modernisation et de rationalisation des traditions, le
gouvernement guinéen contribua à transformer singulièrement et durablement la
culture locale.
9 En 1984, suite à la mort brutale et inattendue de Sékou Touré, un groupe d’officiers,
dirigé par le général Lansana Conté, prit le pouvoir. Le nouveau régime opta pour le
libéralisme économique. Dès 1985, fut lancé le premier plan d’ajustement structurel
instauré par le Fonds monétaire international (FMI). Dans le cadre de ce plan
d’ajustement structurel, plus de 12 000 fonctionnaires furent licenciés (Devey 1997 :
153). Parmi ces fonctionnaires éconduits se trouvaient, en première ligne, les artistes
des ballets et orchestres nationaux. Seuls les directeurs artistiques et certains solistes,
musiciens ou danseurs des ballets nationaux eurent la possibilité de garder leur statut
de fonctionnaire. Avec la fin de la Première République, les préoccupations du
gouvernement s’écartèrent radicalement de la promotion des arts, renvoyant pour un
temps la plupart des artistes à la marginalité.
10 Mais, après vingt-six années d’isolement, l’ouverture des frontières permit aux
étrangers d’entrer librement en Guinée. Les pionniers du tourisme musical se rendant
en Guinée dès la fin du régime communiste pour voir sur place les fameux Ballets
africains furent d’abord accueillis avec étonnement par les artistes guinéens. Famoudou
Konaté, soliste virtuose des Ballets africains pendant plus de vingt ans, fut
certainement l’un des premiers batteurs de jembé guinéens à recevoir ces apprenants
d’un nouveau genre :
« Les Blancs sont entrés en Guinée en 1986. C’était une surprise car la Guinée n’étaitpas populaire. Des Allemands sont venus aux répétitions des ballets africains aupalais du peuple. On a commencé à faire connaissance. Après la répétition du ballet,ils demandaient de donner le cours de tam-tam [...]. Au début c’était dur detransmettre, ils m’ont dit “il faut donner le cours”. Je ne connaissais même pas lemot ! » (entretien, 25 avril 2005, Conakry).
11 L’avènement de la Seconde République permet désormais aux musiciens de faire
commerce de leur art. Mais le contexte de paupérisation engendré par l’abandon du
soutien étatique conduit la plupart d’entre eux, en particulier les jembefolaw et les
danseurs ayant acquis une réputation internationale grâce à leurs tournées avec les
ballets nationaux, à s’installer à l’étranger. La réouverture des frontières en 1984
marque le début d’une période de circulation accrue pour les artistes guinéens en quête
de nouveaux « patronages ». Grâce aux contacts noués en Guinée, Famoudou Konaté
sera invité en Allemagne pour animer des cours de jembé. Il vit aujourd’hui entre Berlin
et Conakry et mène une brillante carrière internationale. Mamady Keïta, certainement
le plus connu des jembefolaw, recruté à l’âge de huit ans dans le ballet national Djoliba
passera par Abidjan et le ballet Koteba de Souleyman Koly avant de s’installer en
Belgique. En 1991, il ouvre sa propre école de percussion à Bruxelles, Tam-tam
Mandingue. L’engouement mondial pour la percussion africaine à partir des années
1990 conduit le maître guinéen à développer son activité. En moins de cinq ans, l’école
de Mamady Keïta devient une véritable « multinationale de la percussion ». Il ouvre des
succursales à Paris, Munich, Conakry, aux États-Unis, au Japon et en Israël. Il a
également mis en place un diplôme de percussion délivré sur concours à ses apprenants
internationaux leur permettant d’ouvrir une école certifiée conforme par le maître. Il y
a aujourd’hui plus de vingt-cinq écoles TamTam Mandingue dans lesquelles Mamady
Keïta anime régulièrement des stages de jembé. Sur le même modèle, de nombreux
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
150
artistes guinéens formés dans les ballets nationaux ouvrent des écoles ou animent
ponctuellement des stages de percussion ou de danse à travers le monde. Aujourd’hui
ces anciens des ballets nationaux doivent partager le florissant marché de la percussion
avec une nouvelle génération de jeunes artistes formés en Guinée après 1984 dans les
petits ballets privés de la capitale.
L'authenticité reconstruite et le voyage virtuel en Afrique
12 Dès le début des années 1990, le jembé est certainement l’instrument de musique extra-
européen le plus populaire à travers le monde. L’instrument fait désormais partie de la
culture des jeunes urbains à travers des pratiques collectives et conviviales (au sein des
Maisons des jeunes et de la culture, des écoles, des parcs, des associations...), à travers
la danse ou les arts de rue. La robustesse de l’instrument, la facilité de se le procurer et
les images tribales qui lui sont associées en font un instrument de choix pour des
individus désireux, comme le promet la plupart des stages de percussions, de découvrir
la « culture africaine ». Si certains apprenants détournent l’instrument pour créer une
musique nouvelle, la plupart d’entre eux désirent s’approcher au plus près du jeu
« traditionnel ». Un artiste guinéen résidant en France depuis la fin des années 1980
remarque qu’il y a deux types de public pour les percussions africaines en France :
« Il y a ceux qui veulent le traditionnel et ceux qui veulent la World Music. C’est despublics différents. Ceux qui prennent des cours de percu veulent vraiment latradition, le roots, pas le moderne [...] donc il faut jouer le jeu » (entretien, 7décembre 2004, Paris).
13 Il n’est pas rare aujourd’hui d’entendre des groupes composés uniquement de jeunes
percussionnistes français, japonais ou mexicains reproduire, presque à la perfection, les
polyrythmies7 de Haute-Guinée. Dans le cadre des cours de jembé dispensés hors
d’Afrique, les artistes guinéens sont concurrencés par les Maliens, les Burkinabè, les
Ivoiriens et les Sénégalais ainsi que par leurs anciens élèves, les « jembefolaw blancs »8.
Mais les compétences des musiciens guinéens formés « à la dure » sous le régime de
Sékou Touré en apprenant une multitude de rythmes au sein des ballets confèrent à
leur enseignement un attrait particulier.
14 Il est toutefois frappant de remarquer que l’histoire des ballets est systématiquement
éludée des récits prodigués lors de cette transmission. Pendant le cours, le professeur
de percussion explique le contexte culturel « originel » dans lequel se pratiquent les
danses et les rythmes qu’il interprète. Tous les rythmes transmis sont ainsi associés à
une cérémonie particulière et à une ethnie spécifique (le rite de circoncision chez les
Malinké pour le rythme soli, la danse de séduction soussou pour le rythme yankadi, la
sortie du masque kakilembe chez les Baga pour le rythme du même nom...). Les cours de
percussion constituent ainsi de véritables voyages virtuels au cœur d’une Afrique
imaginée. Les enseignants guinéens se sont faits spécialistes de ce type d’informations
« ethnographiques ». L’évocation des fêtes traditionnelles et leurs cortèges de
représentations plus ou moins stéréotypées, que les maîtres guinéens appellent des
« histoires culturelles », vont de pair avec la transmission des musiques et danses
d’Afrique. Les ballets guinéens dans lesquels « même les sourires étaient mis en scène
par les cadres du parti »9 correspondent assez mal aux qualités de spontanéité souvent
attribuées aux musiciens africains. Les professeurs africains tirent ainsi parti des
stéréotypes occidentaux, largement hérités de la période coloniale, en se « branchant »
directement sur les cultures villageoises, au détriment des références aux ballets dans
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
151
lesquels ils ont été formés. En évitant de faire référence aux diverses opérations de
rationalisation (démystification, décas- tisation...), qui ont pourtant permis cette
transmission standardisée, ils donnent l’illusion d’une culture pure, authentique, vierge
de toute influence occidentale, ou de toute instrumentalisation politique. Cette
primitivisation de l’expression musicale, co-construite par les maîtres guinéens et leurs
apprentis internationaux, suggère que cette musique prend son sens dans un contexte
« traditionnel » indissociable de la vie sociale africaine10. Cet imaginaire d’une musique
enracinée dans un terroir, tel que véhiculé par les stéréotypes ethnomusicaux des cours
de percussion ou de danse africaine mais aussi par les industries culturelles (les films
documentaires ou les productions de World Music), constitue un puissant moteur du
déplacement touristique.
15 Des stages de percussion sont aujourd’hui proposés presque partout en Afrique de
l’Ouest11. La Guinée reste, en revanche, la destination la plus prisée. Bien que pendant la
période Sékou Touré les musiques guinéennes « traditionnelles » et « modernes »12
furent singulièrement réinventées, les visiteurs retiennent généralement que
l’isolement antérieur du pays confère à sa musique une authenticité particulière. La
faible fréquentation touristique actuelle renforce également ce sentiment
d’authenticité des styles musicaux locaux. Pour J. M., percussionniste amateur, le choix
de la destination s’effectua sur ce critère d’une authenticité procurée par l’isolement du
pays :
« On avait déjà une petite idée sur la musique guinéenne parce qu’on nous a dit quec’était un pays qui était resté longtemps fermé sur lui-même à cause de SékouTouré et tout. Donc il y avait une certaine authenticité qui était restée au niveau dela musique, et puis c’était pas perverti entre guillemets avec tout ce qui est afro-jazz, afro-rock et tous ces machins là » (entretien, 15 février 2004, Tayiré, Basse côteGuinée).
16 Pour les percussionnistes professionnels ou semi-professionnels, souvent plus au fait de
l’histoire musicale du pays, le voyage d’apprentissage en Guinée est également motivé
par une quête de prestige et de légitimité. Le curriculum vitae d’un percussionniste non
originaire du pays dont il pratique la musique fait aujourd’hui état de tous les séjours
de formation qu’il a effectués à l’étranger en Afrique de l’Ouest mais aussi
éventuellement à Cuba ou en Inde. Professionnels ou amateurs, ces touristes musicaux
pratiquent tous le jembé depuis plusieurs années dans leur pays d’origine, et leur
déplacement en Guinée repose sur l’activation de réseaux transnationaux au centre
desquels se trouvent les artistes guinéens migrants.
Le tourisme musical : de l'apprentissage instrumentalau désir de communauté
17 L’enquête fait apparaître deux types de voyages musicaux : des stages collectifs
organisés et des formes d’apprentissage plus solitaires et informelles.
Les stages collectifs
18 L’organisateur de stages collectifs est généralement un artiste guinéen réputé, installé
à l’étranger et recrutant des stagiaires au sein de l’école dans laquelle il enseigne son
art ou lors des stages ponctuels qu’il anime à travers le monde. Mamady Keïta et
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
152
Famoudou Konaté seront parmi les premiers à amener des groupes de touristes en
Guinée à la fin des années 1980. La nationalité des touristes varie en fonction du réseau
qu’a su tisser le maître au gré de ses voyages. Ainsi, Famoudou reçoit majoritairement
des Allemands, mais aussi des Russes, des Polonais, des Finlandais et des Australiens.
Mamady Keïta accueille des Belges, des Japonais, des Français, des Israéliens et des
Américains. Aujourd’hui, l’organisateur est également un jeune artiste guinéen ayant
émigré récemment ou un artiste étranger ayant effectué de nombreux séjours en
Guinée.
19 Les organisateurs accueillent généralement les touristes dans des villas à Conakry ou
sur les îles de Kassa ou de Room proches de la capitale.
20 Ces villas achetées grâce aux nouveaux revenus procurés par leurs activités
internationales peuvent accueillir jusqu’à soixante visiteurs. S’y dérouleront les cours
de danse, de percussion (quatre heures par jour). Les stagiaires pourront y déguster des
spécialités culinaires guinéennes et parfois acheter des souvenirs aux boutiquiers qui
s’installent dans la cour. L’organisateur aura ainsi la possibilité de faire bénéficier d’une
manne financière non négligeable à quelques individus de son choix. Il engagera
généralement des membres de sa famille ou des artistes du ballet dans lequel il jouait
avant sa migration pour encadrer les touristes, animer les cours, préparer les repas ou
assurer la sécurité des visiteurs. Dans les villas de la capitale comme sur les îles, ce sont
des stages « tout compris ». Les touristes payent un forfait d’environ neuf cents euros
pour trois semaines de stage13. Ils sont pris en charge depuis leur arrivée à l’aéroport
jusqu’à leur départ. Pendant leur séjour, des excursions sont organisées, à la plage ou
au marché. On propose également aux touristes d’assister à des fêtes populaires et aux
répétitions des ballets. L’apprentissage musical et le tourisme culturel sont assez bien
séparés. Le stage collectif de percussion en Guinée est similaire à celui prodigué lors des
cours à l’étranger. Les visiteurs apprennent des rythmes et des pas de danse lors des
cours formalisés dispensés par un maître. Les apprenants apprécient toutefois
l’immersion dans le contexte guinéen. La pratique artistique fait ici partie de la vie
quotidienne. Elle est répétitive et redondante. Comme l’explique un stagiaire français,
la coupure entre la vie artistique et la vie sociale y est atténuée :
« Apprendre en Guinée, c’est être au milieu des gens, être dans le match, on va dire.Forcément ton rythme de vie, ton alimentation, les odeurs, tout ce qui t’entoure teperturbe [...]. C’est pas comme à Paris où il faut sortir de chez soi, prendre savoiture, ça casse le charme. Ici on va à l’atelier pour partager, pour vivre auquotidien. On est toujours dans un truc musical » (entretien, 26 juillet 2003,Conakry).
21 Ces stages collectifs se terminent invariablement par un dundunba. Cette danse
originaire de la région du Hamanah, en Haute-Guinée14, a été réappropriée récemment
par les artistes de la capitale, principalement soussou. Elle se pratique par exemple
lorsque deux artistes se marient. À cette occasion, tous les ballets « amis » seront
invités à participer à la fête. À ce titre, le dundunba est devenu un marqueur
d’appartenance à la communauté des batteurs et danseurs de la capitale, régulièrement
amenés à travailler ensemble à l’animation de spectacles ou de cérémonies.
Aujourd’hui, le dundunba est également organisé pour fêter la fin d’un stage de danse
ou de percussion.
22 Cette cérémonie, à laquelle tous les stagiaires étrangers doivent participer en
effectuant quelques pas de danse devant l’assemblée (les autres stagiaires, les artistes
qui encadrent le stage mais aussi les habitants du quartier) ou en accompagnant ces
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
153
danses à la percussion, constitue un moment fort du voyage. À travers ce rite de
clôture, les organisateurs offrent aux visiteurs l’occasion d’une mise en situation qui
dépasse le cadre rigide des cours habituels, mais aussi le sentiment de faire partie de la
communauté d’artistes.
23 Le marché des stages de percussion en Guinée étant devenu de plus en plus
concurrentiel, certains organisateurs diversifient leur offre. À l’issue du stage organisé
à Conakry, Famoudou Konaté propose aux stagiaires de prolonger leur séjour en
effectuant une préparation à l’intérieur du pays, à Sangbarala, son village natal de
Haute-Guinée. Les touristes pourront assister à des fêtes organisées par les villageois et
continuer leur formation avec un membre de sa famille resté au village. Le danseur
Lamine Keïta, basé à Paris, propose un stage « découverte » à travers toutes les régions
de Guinée. Les touristes circulent de village en village en minibus accompagnés par des
artistes de Conakry. Un guide accompagnateur précède le convoi pour prévenir les
villageois de l’arrivée imminente du groupe de touristes. Les villageois également
informés de l’arrivée des visiteurs par la « radio rurale » les accueilleront avec des
chants et des danses comme ils le feraient pour une haute autorité politique guinéenne.
Comme l’affirme son organisateur, ce « stage découverte » permettrait aux touristes de
découvrir la « vraie Afrique » :
« Je me suis dit pourquoi ne pas emmener ces élèves-là dans les vrais villages,qu’elles partagent tout avec les villageois, qu’elles dansent avec eux, qu’elles voientles traditions des villages, qu’elles dorment dehors, qu’elles sentent que réellementelles sont en Afrique. Alors quand elles rentreront chez elles, elles se sentiront àl’aise et fortes parce qu’elles savent qu’elles sont venues vraiment en Afrique et pasà Conakry avec toutes les lumières, les voitures. C’est ça qui m’a donné l’idée defaire une différence avec les autres, de faire des stages découvertes » (entretien, 7avril 2004, Kindia).
24 Le tourisme musical itinérant, qui procure des images conformes à celles développées
pendant les cours de percussion où de danse à l’étranger, comble les stagiaires qui non
seulement peuvent regarder danser les villageois mais ont aussi la possibilité de danser
avec eux ou de soumettre, à leur approbation, les chorégraphies qu’ils ont répétées.
Cette entrée musicale et participative permet, d’après les visiteurs, d’éviter un rapport
marchand trop frontal avec les locaux. « Apprendre d’eux », pratiquer une activité
commune comme la musique et la danse permet d’attirer un regard bienveillant de la
part de la population et désamorce les possibles critiques de voyeurisme à leur
encontre. La pratique artistique sur place constitue pour eux un moyen de « rencontrer
les gens », une « porte d’entrée » sur la culture hôte. Elle est une médiation entre
visiteurs et visités. En outre, lors de ces stages collectifs itinérants encadrés par des
artistes de Conakry, des formes de sociabilités autarciques se développent. Pour les
visiteurs, le groupe d’appartenance n’est plus le groupe de stagiaires originaires d’un
même pays mais le groupe international d’artistes travaillant ou voyageant ensemble à
travers le pays. C’est à partir de ce nouveau groupe de référence, soudé par la pratique
artistique, que les visiteurs disent partir à la rencontre des autochtones villageois.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
154
Cours de jembé dispensé par un jeune mai ̂tre de Conakry
Photo de l’auteur, 2005.
Représentation publique à l'issue d'un stage collectif dans le quartier de Matam à Conakry
Photo de l'auteur, 2005.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
155
Cours de danse sur la place d’un village de Haute-Guinée lors d’un stage itinérant
Photo de l'auteur, 2005.
25 Si ce type de séjour dans les régions rurales de Guinée semble faire de plus en plus
d’adeptes, la plupart des maîtres tambours remarquent une certaine désaffection pour
les stages collectifs qu’ils organisent. Un nombre grandissant d’apprentis
percussionnistes organisent maintenant leur stage en Guinée quasiment sans
intermédiaire.
L'apprentissage informel
26 Ces apprenants ont parfois séjourné en Guinée une première fois dans le cadre d’un
stage collectif au cours duquel ils ont tissé localement un réseau de relations. Ils
reviendront ensuite seuls chez un jeune artiste qu’ils ont rencontré lors de leur
premier séjour. D’autres arrivent pour la première fois en Guinée avec une adresse, un
contact (souvent un membre de la famille de leur professeur installé en Europe, ou le
maître de leur maître) et organisent leur formation artistique sur place. Le « savoir
circuler » (Tarrius 2000) des touristes se développe grâce aux réseaux personnels qu’ils
ont su développer, mais également grâce aux différents forums Internet par lesquels ils
peuvent organiser leur départ (comment obtenir une fiche d’invitation, un visa, de
bonnes adresses pour apprendre le jembé ou la danse en Guinée, où loger...). Ces
apprenants, souvent solitaires, séjournent en Guinée pour une durée plus longue,
généralement entre un et six mois. Ils sont souvent plus aguerris et parfois
professionnels (intermittents du spectacle, professeurs de danse ou de percussion).
Dans le cadre de ces stages informels, tous les tarifs sont négociés séparément (cours
individuels de danse ou de jembé, hébergement, nourriture...) et le séjour est
généralement plus économique que lors des stages collectifs. L’apprenant sera souvent
exposé à la précarité en matière d’hébergement, de restauration et, en l’absence de
tarification claire, entretiendra parfois des rapports financiers conflictuels avec son ou
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
156
ses formateurs. En revanche, il vivra au quotidien avec son maître et accédera à des
modes d’apprentissage semblables aux apprentis percussionnistes guinéens. En plus des
cours individualisés (environ 25 000 francs guinéens de l’heure, soit 4 euros),
l’apprenant sera intégré au ballet de son maître et jouera les accompagnements au
jembé pendant les répétitions quotidiennes. Aucun ballet n’a, à ce jour, fixé de tarif pour
intégrer temporairement un apprenant étranger. La rétribution éventuelle dépend de
la relation d’amitié qu’entretiennent l’apprenant et le membre du ballet qui l’a invité et
du bon vouloir du directeur du ballet. Un deuxième mode d’apprentissage spécifique au
tourisme individuel consiste à accompagner des artistes locaux lors des cérémonies
populaires qu’ils animent. Lorsque les stagiaires entretiennent des rapports
particulièrement amicaux avec leur professeur, ils seront invités lors des cérémonies de
mariages (sabar), de baptême ou de circoncision. Avec d’autres apprenants guinéens, ils
joueront le jembé pour accompagner les solos du maître au sein d’un groupe musical
composé de tambours basse (dundun), d’une guitare électrique et d’une ou plusieurs
griottes (jeli- musso en maliké ou jeliguiné en soussou). Dans ce cas, l’apprenant ne paie
pas. Au contraire, il est systématiquement rémunéré par son maître grâce à l’argent
gagné auprès des organisateurs de la cérémonie. Un percussionniste français, déçu par
l’aspect trop « touristique » d’un stage collectif sur l’île de Room, prolonge ainsi son
séjour dans un quartier populaire de Conakry :
« Le contrat, bon [...] il était simple, c’était j’habite avec mon prof, sa copine et sespotes, on passe nos journées ensemble. S’ils allaient dans les ballets, j’allais dans lesballets. Si on avait un dundunba, un sabar ou un truc comme ça, eux, c’est pourgagner leur vie hein [...], on allait accompagner ces trucs-là, si y avait un mariage,un truc plus éloigné, ben on bougeait. Le but, c’était de travailler quoi. Et là, je mesentais pas en trop, j’accompagnais, et même on me payait des fois. Eux m’ontdonné de l’argent [...]. On m’a dit que j’avais un bon son, ils m’ont dit quej’accompagnais bien. Ça c’était bien, j’avais l’impression d’avoir ma place »(entretien, 4 décembre 2004, Paris).
27 Animer avec son maître les cérémonies locales de baptême ou de mariage est perçu par
les apprentis étrangers comme une preuve d’adoption par la communauté des artistes
locaux. Être payé par son maître au même titre que les autres, même si la somme est
dérisoire (souvent deux ou trois euros), contribue à inverser la relation marchande.
L’apprenant n’est plus un consommateur ou un client, mais devient un partenaire. De
plus, la reconnaissance par le public local, notamment par les femmes qui viendront
danser lors de la cérémonie, constitue une forme de validation de la virtuosité et de
l’endurance de l’apprenti jembefola.
28 Ce tourisme musical individuel et informel, que les autorités guinéennes qualifient de
« tourisme sauvage », est en plein essor dans la capitale guinéenne mais aussi à
l’intérieur du pays. À la différence des stages collectifs assez formalisés (quatre heures
de cours par jour), l’apprentissage se fait ici par imprégnation et par mimétisme. Au
sein des ballets, les apprenants travaillent l’endurance physique et l’énergie collective.
Dans les cérémonies populaires, ils travaillent la coordination entre la danse et le
marquage rythmique ainsi que l’improvisation. Ces situations d’interactions musicales
avec les artistes des ballets, et avec les habitants du quartier qu’ils font danser lors des
cérémonies, donnent aux apprentis étrangers le sentiment d’une meilleure inscription
dans le contexte sociomusical local. Ainsi, les stages collectifs organisés dans les villas,
qui sont pour les participants une façon d’accéder à une connaissance plus authentique
que lors de la transmission déterritorialisée, sont souvent qualifiés par les apprenants
solitaires de « stage bunker », de « stage à caractère industriel » (Zanetti 2005 : 104) ou
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
157
encore de « safari percu » pour les stages itinérants en zones rurales. Pour ces
apprenants voyageant seuls, les touristes « parqués dans des villas » ne pourraient ni
connaître les « réalités du pays », ni accéder à un savoir musical authentique.
29 Sans reprendre l’ancienne distinction entre voyageurs accédant à une connaissance
authentique, en coulisses, et touristes dupés par les mises en scène (Boorstin 1961), qui
recouperait partiellement une distinction entre musiciens professionnels et amateurs,
tentons plutôt de comprendre les imaginaires communs liés à la participation musicale.
Les imaginaires de la participation musicale
30 Au-delà de la simple acquisition de techniques musicales, la participation aux activités
de danse et de musique dans un village de Haute-Guinée ou dans un quartier populaire
de Conakry procure aux apprenants étrangers le sentiment d’expérimenter une
nouvelle relation avec leurs hôtes africains et de s’absoudre de la domination
symbolique associée à leurs statuts d’Occidentaux. Que le but soit d’effectuer un « beau
voyage » ou de réellement se perfectionner musicalement, les imaginaires du tourisme
musical semblent converger vers un même objectif : s’absoudre de sa différence aux
yeux des
31 Guinéens à travers une opération de « conversion » à l’africanité. Pour réaliser cette
inclusion au sein de la communauté des batteurs et danseurs locaux, les touristes
s’évertuent à vivre « à la guinéenne ». Emprunter les transports collectifs locaux, loger
chez l’habitant, ne pas dépenser plus d’argent que le « Guinéen moyen », parler de son
mieux le soussou ou le malinké ou manger le riz à la main dans le plat collectif (même si
on propose une cuillère), l’objectif est de se fondre dans la masse, de ne pas être trop
identifiable parmi la foule des locaux. L’immersion de ces « touristes clandestins »
(Urbain 1991) au sein des quartiers populaires de Conakry a parfois rendu l’enquête
difficile. Dans les cas les plus extrêmes, cette identification à leurs hôtes conduit les
apprentis percussionnistes à éviter les autres Blancs, surtout s’ils sont ethnologues et
posent des questions qui pourraient leurs rappeler leurs origines. Dans cette forme de
pérégrination touristique fusionnelle, l’ethnologue est lui-même perçu comme un
touriste par les apprenants solitaires intégrés aux quartiers populaires de la capitale. Il
s’agit pour ces apprenants en immersion de casser la « solidarité de Blancs » que
Benedict Anderson (1983 : 156) qualifie de caractéristique des relations entre colons.
32 Au cours de ce voyage en Afrique, qui fait aujourd’hui pleinement partie de la
construction identitaire d’un nombre grandissant de jeunes Occidentaux, la musique
est souvent au cœur d’une quête existentielle. Cette quête de sens pour des visiteurs
affirmant avoir « reçu une leçon de vie », « avoir retrouvé ce qui est essentiel mais que
nous avons perdu », « être devenu plus humain », passe par l’imprégnation de la vie
locale, le fait de vivre avec les Guinéens, de participer à leurs activités quotidiennes et à
leurs difficultés. Ces musiciens en mouvements sont bien semblables aux touristes
décrits par Dean MacCannell (1976) pour qui le déplacement touristique est caractérisé
par la recherche d’une authenticité supposée perdue dans les sociétés industrielles. Le
tourisme musical participatif manifeste à la fois la recherche d’une authenticité
musicale et la quête d’une « authenticité existentielle » (Wang 1999). Il reflète la
duplicité de l’authenticité recherchée dans le déplacement touristique telle que Tom
Selwyn (1996) l’a mise en lumière. Selon lui, les touristes recherchent des
« connaissances authentiques » à propos de la société de la destination choisie
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
158
(l’authenticité froide), mais aussi des « relations sociales authentiques » avec les
populations visitées (l’authenticité chaude) (ibid. : 8). Cette authenticité froide des
connaissances et des savoirs, prodiguée par les guides ou les musées, selon Selwyn, est
ici apportée par les maîtres musiciens guinéens. Les touristes, équipés en caméra et
enregistreurs numériques, « stockent de la connaissance ». Ils répertorient les rythmes,
décrivent souvent dans leur journal de bord les danses et rituels auxquels ils ont accès.
Leur séjour en Afrique s’apparente ainsi à une forme d’ethnomusicologie populaire15.
Bien qu’ils n’y trouvent pas toujours confirmation des images qu’ils s’étaient forgées
avant le voyage, la quête des formes musicales et chorégraphiques authentiques
poussera les touristes à s’enfoncer de plus en plus loin dans les villages mais aussi dans
certains quartiers populaires de la capitale guinéenne.
33 La recherche d’une « authenticité chaude », celle concernant les relations sociales
solidaires et harmonieuses entretenue avec les hôtes, semble également commune à
l’ensemble des visiteurs. Au-delà d’un simple apprentissage de techniques musicales,
l’enjeu du déplacement de ces apprenants en quête de légitimité artistique est aussi
d’être reconnu comme étant « un des leurs ». Pendant leur séjour en Guinée, les
voyageurs recherchent les signes de leur adoption par la communauté des batteurs et
danseurs guinéens. Cette reconnaissance peut passer par différents canaux. Le signe
d’adoption le plus évident et le plus courant est certainement l’attribution d’un
nouveau patronyme. Dès qu’il se présente chez son maître, l’apprenti étranger se voit
presque à chaque fois attribuer un prénom local, voire un nom de famille africain. Ce
changement de patronyme dure généralement le temps du voyage, mais certains le
gardent comme nom de scène16. Travailler avec son maître de jembé à l’animation des
cérémonies populaires est également considéré comme un signe d’adoption. L’idée
qu’une relation marchande entre le maître et l’apprenant puisse faire barrage à une
amitié sincère les conduit à développer diverses solidarités et partenariats. Pour rendre
justice à son maître, l’apprenti s’évertue à lui trouver des contrats en Europe pour
l’animation de stages ou de spectacles. Il effectuera souvent de longues démarches
administratives pour procurer un visa aux artistes et s’improvisera tour manager.
Certains entreprennent également un commerce d’instruments entre la Guinée et leur
pays d’origine procurant ainsi un revenu substantiel aux partenaires guinéens qui les
fabriquent.
34 Enfin, la dimension sensuelle et sexuelle de ce tourisme musical impliquant hommes et
femmes dans des activités communes est certainement la composante la plus
fondamentale de cette « authenticité chaude » recherchée par les visiteurs. Les
relations sexuelles et amoureuses fréquemment entretenues entre touristes et artistes
locaux aboutissent souvent à des mariages17. Ces relations manifestent une quête
d’adoption de part et d’autre, mais témoignent également d’un rapport libidinal à
l’Afrique et à sa musique. Toutefois, à la différence d’autres types d’échanges sexuels ou
de mariages mixtes en situation touristique impliquant généralement des touristes,
hommes ou femmes, d’âge mûr et de jeunes locaux (Cauvin Verner et Salomon dans ce
numéro), ces relations se contractent ici entre individus de même classe d’âge. Comme
nous allons le voir, ces relations, notamment lorsqu’elles aboutissent à un mariage,
tiennent une place prépondérante dans la constitution des réseaux transnationaux
d’artistes mais aussi dans la perpétuation du phénomène touristique en Guinée. Mais
observons à présent la manière dont les artistes guinéens mettent à profit cette double
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
159
exigence d’authenticité du tourisme musical dans le cadre de stratégies économiques et
migratoires.
De l'imaginaire national à l'imaginaire transnational
35 Inédits à la fin des années 1980, les cours de danse et de percussion prodigués aux
touristes constituent aujourd’hui une source de revenu de plus en plus importante. Si la
mise en tourisme de la musique guinéenne a d’abord profité aux grands artistes des
ballets formés sous Sékou Touré, qui furent les investigateurs des premiers stages
organisés, l’intensification du tourisme musical informel permet maintenant aux
artistes restés au pays de bénéficier de nouvelles ressources. La pratique de la danse et
de la percussion en Guinée procure des revenus à travers l’animation des fêtes et des
cérémonies populaires locales, mais l’occasion (même si c’est plus rare) d’avoir un élève
étranger est beaucoup plus lucratif. « Avoir son Blanc », comme disent souvent les
jeunes Guinéens, offre non seulement un soutien financier ponctuel, mais aussi la
possibilité de voyager à l’étranger en fonction des diverses solidarités nouées avec son
apprenti.
36 Nous tenterons de montrer comment l’imaginaire musical n’est plus encadré par des
institutions solides comme l’État ou le rite mais plutôt par les flux de populations en
mouvements, touristes et artistes migrants. Explorons deux quartiers de Conakry,
devenus à la fois des quartiers de musique et de tourisme, pour comprendre le
processus actuel de revitalisation des musiques traditionnelles dans le cadre de la
globalisation.
Revalorisation du statut du jembefola et réappropriation sociale des
ballets de la Révolution
37 Dans le quartier de Symbaya, on croise beaucoup d’artistes depuis que Famoudou
Konaté y a construit une villa pour accueillir des stagiaires étrangers au début des
années 1990. Des jeunes Français en boubou africain, coiffés de dread locks rasta,
répètent dans une cour avec des jeunes Guinéens de même allure ; un Japonais installé
à la terrasse d’un café bredouille quelques mots en soussou avec son maître de jembé ;
un groupe de Néerlandaises mange un plat de riz/sauce sur le bord de la route... Depuis
quelques années, quelques boutiques d’artisanat se sont également installées dans le
quartier. On y vend des housses de jembé, et divers souvenirs comme des bracelets en
cuir ou des mini jembé en pendentifs. Kapisco (35 ans) fait partie de ces artistes
gravitant autour de la villa de Famoudou Konaté. Recruté en 1984 à Kouroussa en
Haute-Guinée pour intégrer les Ballets africains à Conakry, il a vécu le changement
d’orientation de la politique culturelle de la Seconde République renvoyant la plupart
des artistes à la marginalité. En travaillant avec Famoudou à l’animation des stages de
percussion, il a connu l’essor du tourisme musical dans le quartier.
« Les jeunes, comme ils voient tous les Blancs derrière Famoudou Konaté pourconnaître le jembé, ils pensent que Famoudou il a des milliards. Tu as compris ?Parce qu’on sait que si tu rentres en Europe, bon, quand tu reviens, même si tu n’aspas gagné beaucoup, mais le peu que tu as gagné, quand tu rentres chez nous, tupeux devenir patron » (entretien, 1er avril 2005, Conakry).
38 Le prestige social que la mobilité confère à l’artiste migrant, ce « héros du retour » (de
Latour 2003), lorsqu’il revient au pays avec un groupe d’apprentis percussionnistes
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
160
étrangers, a contribué à transformer singulièrement le statut du joueur de jembé en
Guinée. Les grands artistes des ballets nationaux, comme Famoudou Konaté, de retour
d’Europe ou d’ailleurs, affichent, souvent de manière ostentatoire, les signes de leur
réussite. Ils construisent des « villas à étages », achètent des voitures au port de
Conakry, ont toujours une liasse de billets en poche et racontent leurs expériences à
l’étranger, au « pays des Blancs » (Foté ta en soussou). Même s’il est toujours recruté
dans les milieux populaires, le jembefola porte des vêtements à la mode (en bogolan ou
inspirés par les rappeurs américains), parle plusieurs langues, voyage à travers le
monde. À l’aéroport, on remarque toujours un nombre important d’artistes venus
chercher ou raccompagner des touristes ou voyageant eux-mêmes à l’étranger. Avec les
diplomates et les hommes d’affaires, les artistes sont certainement la catégorie
socioprofessionnelle la plus mobile à l’international. On dit d’ailleurs aujourd’hui en
Guinée : « Si tu veux que ton fils sauve sa famille, il vaut mieux lui apprendre à jouer le
jembé que de lui faire faire des études de médecine » (Kokelaere 2000).
39 Au sein des ballets urbains créés par Sékou Touré, les artistes avaient acquis un statut
social plus valorisant que celui des jembefolaw de village. Ils restaient néanmoins au bas
de l’échelle sociale. Les artistes de la Révolution ne pouvaient pas s’enrichir
personnellement et devaient reverser tous leurs gains au Parti. Avec l’avènement de la
Seconde République, en 1984, l’abandon du soutien étatique aux orchestres et ballets
avait conduit à la dissolution de la plupart d’entre eux. Le président Lansana Conté
avait d’ailleurs déclaré à l’époque sur les ondes de la RTG : « [...] pendant la première
République on ne faisait que danser. Maintenant si quiconque vient taper à la porte
pour demander à sa fille de venir faire du théâtre ou de la musique que l’on prenne un
bâton pour le frapper »18.
40 Après une période où il fut difficile de recruter des artistes au sein des ballets devenus
« privés », on assiste à une véritable revitalisation des ballets de danse et de percussion
de la capitale. En 2008, l’Alliance pour le développement de la percussion et de la danse
guinéenne (ADPG) a recensé 1 250 artistes percussionnistes et danseurs répartis dans les
48 ballets de Conakry. Alors que les ballets guinéens étaient, pendant la Première
République, un instrument privilégié de propagande pour le régime, ils sont
aujourd’hui des centres de formation dans lesquels les jeunes artistes rêvent d’une
carrière internationale.
41 Ainsi, le quartier de Matam est devenu un haut lieu du tourisme musical grâce aux
centaines d’artistes qui répètent au sein des nombreux groupes de musique et de danse.
Il est le passage obligé pour les groupes de touristes participant à un stage sur l’île de
Room ou de Kassa, pour les élèves de Famoudou Konaté qui désirent assister aux
répétitions des ballets et aussi pour les apprenants solitaires qui logeront dans le
quartier et organiseront leur formation sur place. Les jeunes batteurs et danseurs,
encadrés par d’anciens fonctionnaires des ballets nationaux touchant une maigre
pension de l’État, répètent quotidiennement dans les ballets et se livrent à une
concurrence acharnée pour se faire repérer par les quelques promoteurs de spectacles
de passage ou par les touristes.
42 Jigla Sylla, ancien danseur du ballet militaire de Guinée, a fondé son ballet privé à la fin
des années 1980. S’il a eu, dans un premier temps, beaucoup de difficultés à enrôler des
artistes, il obtient aujourd’hui un retour sur investissement :
« Au début du ballet, les familles des artistes n’étaient pas contentes. Elles disaientque j’avais dérangé leurs enfants avec le jembé et la danse. J’ai sensibilisé la famille
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
161
et maintenant ce sont ces enfants-là qui ont gagné la chance d’aller en Europe. Dansle ballet, présentement, il y a seize artistes à l’étranger : en France, aux États- Uniset au Canada. Maintenant ils gagnent leur pain et chacun a construit quelque chosepour leur famille ici en Guinée. Certains reviennent nous voir, ils apportent ducordage pour les jembé, ils nous donnent de l’argent pour acheter des instruments.Je remercie Dieu, je remercie le contact qui a aidé les enfants à aller en Europe »(entretien, 11 juillet 2005, Conakry).
La connexion au réseau touristique comme mode de circulation
43 Les jeunes se réinvestissent massivement dans la pratique des arts dits
« traditionnels », mais la difficulté à vivre de leur art en Guinée conduit la plupart
d’entre eux à tenter leur chance à l’étranger en intégrant des réseaux professionnels
internationaux. Le désir d’exil des jeunes artistes guinéens, nourri par les artistes
migrants, trouve une possibilité de concrétisation grâce à la présence des touristes. Le
réseau touristique est utilisé comme une véritable « porte de sortie » du pays et, à plus
long terme, comme une possibilité de « sortir de la misère ». Dans ce contexte,
l’Européen, l’Américain ou le Japonais venant dialoguer avec ces jeunes devient le
réceptacle de tous les fantasmes et constitue une opportunité de concrétiser une
nouvelle vie à l’étranger. Une pression s’exerce sur le visiteur pour développer des
solidarités ou des partenariats transnationaux. Ces solidarités ou partenariats, quand
ils aboutissent, peuvent prendre différentes formes : faire du business d’instruments
entre l’Europe et l’Afrique, se marier à un(e) touriste qui deviendra peut-être le ou la
manager de l’artiste, obtenir un contrat pour l’animation d’un spectacle. Ces demandes
insistantes d’obtenir « une aide », un « coup de pouce », virant souvent au harcèlement,
sont parfois mal vécues par certains apprenants étrangers. Elles entrent toutefois en
résonance avec l’imaginaire de nombreux touristes désirant nouer des solidarités avec
leur maître et valider ainsi leur appartenance à la communauté des artistes locaux.
Cette « authenticité chaude » (Selwyn 1996) recherchée par les visiteurs est largement
mise à profit dans les stratégies d’extraversion des jeunes artistes guinéens :
« Tous les batteurs du quartier ont commencé le jembé pour pouvoir partir enEurope. Donc ils apprennent le jembé pendant un an, deux ans et puis ils peuventapprocher les Blancs et dire “bon..., je t’aime..., je veux qu’on se marie... Tu vas, euh,m’inviter, je t’aime, euh, je veux qu’on se marie...”. S’ils gagnent une femme ou unbon ami ou un partenaire blanc, il va l’aider pour rentrer en Europe » (Kapisco,entretien, 1er avril 2005, Conakry).
44 L’engouement international pour le jembé suscite de nouvelles vocations et de
nombreux jeunes Guinéens démarrent ainsi une pratique artistique par opportunisme,
en haute saison touristique19. Ces jeunes artistes, lorsqu’ils parviennent à migrer en se
connectant au réseau touristique, vivent souvent des situations dramatiques à
l’étranger, dans la clandestinité après l’expiration de leur visa ou circulant au gré des
diverses invitations et expulsions. Ceux qui parviennent toutefois à régulariser leur
situation administrative dans le pays d’accueil, puis à ouvrir un cours de danse ou de
percussion grâce à une association locale, voire à se produire sur scène avec un groupe,
reviendront en Guinée en faisant bénéficier leur famille et leur ballet de nouveaux
revenus procurés par leur carrière internationale. Mais en organisant à leur tour des
stages de percussion en Guinée, ils amèneront également des touristes, sources de
revenus et de « contacts » pour leur maître de ballet :
« Un ancien membre de mon ballet, Amara Karabane, est parti à Clermont-Ferranden 1992. C’est lui le premier qui m’a envoyé des stagiaires ici en 1994. C’est lui qui
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
162
encadrait le stage mais on a travaillé ensemble au ballet pour former les étrangers.Donc les stagiaires sont venus chez moi pendant un mois, on a pris contact. L’annéesuivante, ils sont passés directement par moi pour revenir ici. Donc chaque annéeils viennent ici, ça fait dix ans. Et puis ces Français m’ont invité moi-même enFrance. Je suis parti à Clermont-Ferrand avec des batteurs et des danseurs deSaâmato. Ça a bien marché avec ce groupe. Maintenant quatre garçons et une fillese sont mariés avec ces stagiaires de Clermont-Ferrand. Ma fille même s’est mariéeavec un stagiaire d’Amara Karabane. Il s’appelle Tony, il vient à Conakry dans deuxsemaines. Maintenant il organise lui aussi des stages et il a dit “comme je suis mariéavec ta fille donc je viens chez toi”. Donc il est correct » (entretien, 11 juillet 2005,Conakry).
45 Le système d’allégeance qui lie un membre du ballet à son maître conduit l’organisateur
du stage à faire bénéficier à son maître des revenus du tourisme en amenant les
stagiaires chez lui. Les touristes dans leur volonté de couper les intermédiaires
(d’accéder aux coulisses) reviennent directement au ballet Saâmato. Une collaboration
de long terme, faite d’invitations en France et de stages annuels à Conakry, débouche
sur cinq mariages entre les membres du ballet Saâmato et le groupe d’artistes de
Clermont-Ferrand. L’un des stagiaires français marié à la fille du directeur du ballet
(qui anime maintenant des cours de danse en France) amène de nouveaux stagiaires
pour un voyage en Guinée qui débouchera peut-être sur d’autres mariages ou d’autres
invitations.
46 L’intensification de la fréquentation touristique produit donc plus de départs d’artistes
guinéens vers l’étranger (à travers les mariages ou les différents partenariats). Les
artistes qui « réussissent » à l’étranger reviendront en Guinée avec des groupes de
touristes. Grâce à ce réseau transnational d’artistes en circulation constitué par les
touristes et les artistes guinéens qui partent animer des stages ponctuels ou s’installent
durablement à l’étranger, le tourisme nourrit la diffusion de la pratique de la danse et
de la percussion à travers le monde. En retour, cette profusion de stages et d’écoles de
percussion dans presque toutes les métropoles des pays industrialisés accroît le nombre
de touristes musicaux potentiels qui visiteront la Guinée et noueront des solidarités
avec d’autres musiciens locaux.
Sentiment de désappropriation et transmission
47 La recherche d’une « authenticité chaude » lors du déplacement touristique entre en
résonance avec les aspirations des musiciens guinéens désirant mieux vivre de leur art
en circulant à travers le monde. En revanche, la recherche d’« authenticité froide »,
manifestée par les touristes désirant accéder à des connaissances musicales
authentiques, semble plus problématique.
48 D’une part, l’intérêt quasi exclusif des touristes pour les musiques et danses
traditionnelles conduit à une certaine dichotomie entre, d’un côté des musiques
consommées par les publics locaux ou des pays avoisinants — souvent basées sur le
répertoire griotique mais interprétées avec des guitares électriques et des
synthétiseurs — et, de l’autre, des musiques dites « traditionnelles » produites
essentiellement pour le public international et les touristes. Ainsi, les percussionnistes
Mamadi Keïta et Famoudou Konaté restent inconnus du grand public guinéen et leurs
disques sont introuvables sur les marchés de Conakry alors qu’ils se vendent par
milliers à l’étranger. Les élites guinéennes déplorent parfois cette focalisation de
l’intérêt international sur ce qu’elles considèrent comme les aspects les plus
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
163
stéréotypés de la culture guinéenne, affirmant à propos du jembé « pour nous c’est très
commun, c’est de la musique de village », ou « Le jembé ? Mais il n’y a pas que ça en
Guinée ! ». Toutefois, cette revitalisation des musiques traditionnelles en milieu urbain
semble faire la joie des milieux populaires. Les habitants font aujourd’hui largement
appel à ces musiciens pour l’animation des mariages ou des baptêmes, et ce, à moindre
coût vu le nombre impressionnant d’artistes en concurrence dans la capitale.
49 D’autre part, la situation de tourisme musical en Guinée complexifie le processus de
transmission du patrimoine musical. Dans les quartiers où il n’existe pas de ballet (le
quartier de Symbaya par exemple), le contexte de marchandisation de la percussion
conduit certains maîtres à faire payer leurs apprentis guinéens au même titre que les
étrangers pour leur enseigner les différents rythmes du pays et les « histoires
culturelles » qui les accompagnent. Dans ce contexte, les étrangers sont largement
favorisés. Ils ont les moyens de payer les maîtres qui leur transmettront leurs
connaissances, et ils ont également les moyens de se déplacer où bon leur semble à
l’intérieur du pays pour apprécier les différents rythmes joués dans leur contexte, alors
que de nombreux artistes guinéens ne sont jamais sortis de Conakry. Dans les quartiers
où ils ne sont pas encadrés par les anciens au sein de ballets, les jeunes artistes
guinéens éprouvent bien souvent un sentiment de désappropriation de leur propre
culture au profit des apprenants étrangers, et analysent parfois la situation de tourisme
musical comme une forme de pillage de la culture guinéenne20. Ce sentiment de
désappropriation, exprimé par une jeunesse peu sûre de ses connaissances musicales,
et face à une clientèle internationale devenant peu à peu une concurrence sérieuse, fait
même peser une certaine inquiétude sur le maintien à long terme de l’activité
touristique. Des stratégies de rétention du savoir peuvent éventuellement être mises en
place par certains artistes craignant, comme me le confiait l’un d’entre eux, que « si on
donne tout aux étrangers, ils ne viendront plus car ils connaîtront le jembé mieux que
nous ».
50 En revanche, dans les quartiers où le dispositif des ballets est revitalisé, la transmission
des doyens vers les jeunes apprentis guinéens est motivée, d’une part, par les enjeux
économiques et de mobilité et, d’autre part, dans l’optique d’une résistance face au
déplacement des savoirs. Constatant toute l’énergie déployée par les étrangers pour
apprendre, répertorier et enregistrer les rythmes guinéens, un maître de ballet
souligne la nécessité de transmettre le patrimoine musical aux jeunes du quartier :
« On s’est dit “non, ne laissons pas nos enfants comme ça”, pour ne pas que vous lesBlancs, un jour ce que vous faîtes comme cela, nos enfants ne le font pas. Qu’unjour, au moins, on ne me demande pas de payer un billet d’avion à mon petit-filspour aller apprendre sa culture. Alors voici notre lutte ici à Matam » (entretien,Morciré Camara, 17 juillet 2003, Conakry).
*
51 Les imaginaires portés sur les musiques africaines, construits lors des cours de
percussion ou de danse à l’étranger par les films documentaires ou l’industrie du
disque, tendent à concevoir celles-ci comme des musiques pures, authentiques,
inextricablement liées à la vie des Africains. Comme l’écrit É. Da Lage (2008 : 21) à
propos des représentations véhiculées par les productions discographiques du label
Occora : « Le monde musical authentique est un monde pré-colonial, dans lequel un
passé fantasmé pourrait servir de référence pour un monde a-historique et idyllique,
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
164
dans lequel les interprètes ne seraient que des instruments, de simples maillons quasi
mécaniques d’une chaîne continue et fragile. » Nous espérons avoir montré ici que les
traditions ou les cultures musicales qui passionnent les touristes sont en réalité le fruit
de diverses constructions (notamment politiques), emprunts, et revendications, mais
aussi le produit de réappropriations des stéréotypes internationaux par les musiciens
qui affirment en être les détenteurs. Les récits liés à l’instrumentalisation politique de
la musique guinéenne après l’indépendance sont systématiquement écartés de la
transmission. Les maîtres percussionnistes préfèrent délivrer à leurs apprentis
internationaux des versions plus conventionnelles du passé en insistant sur le contexte
traditionnel et ethnique de leur pratique musicale ou en manifestant leur volonté de
leur faire découvrir la « vraie Afrique sans voiture ni électricité ». Ces exemples
témoignent de la réappropriation d’une « Afrique rêvée » par les artistes guinéens eux-
mêmes. C’est au sein de ce monde éminemment transnational, dans lequel les
imaginaires sont façonnés par les flux d’images, de sons, et d’individus (Appadurai
2001) que se reconstruisent aujourd’hui les musiques dites traditionnelles. Les ballets
guinéens, autrefois instruments de propagande du régime de Sékou Touré, sont
aujourd’hui des tremplins pour des carrières internationales. Cette revitalisation des
ballets manifeste bien la globalisation des enjeux liés à la vie musicale. En même temps,
elle signale que le tourisme, plutôt que de détruire l’authenticité des musiques locales,
vient relayer les politiques culturelles dans la dynamique d’appropriation des musiques
traditionnelles par les jeunes urbains.
52 Dans le monde transnational de la percussion guinéenne, le rôle du tourisme nous a
semblé central. Les touristes, d’abord fascinés par l’objet musical qui motive leur
déplacement, développent également des solidarités et des partenariats avec les
artistes résidant en Guinée. Ces « relations sociales authentiques », également
recherchées dans le déplacement touristique (Selwyn 1996), cette volonté d’appartenir
à une communauté transnationale d’artistes, sont largement mises à profit par les
artistes guinéens, désirant vivre de leur art en internationalisant leur carrière. Dans un
contexte où les frontières de l’Europe deviennent des barricades, la difficulté pour les
artistes africains (en particulier les jeunes) d’obtenir un visa, même lorsqu’ils ont un
contrat de travail à l’étranger21, place, désormais, tous les espoirs de mobilité
internationale sur la connexion au réseau touristique. Les réseaux transnationaux se
constituant au fil des rencontres au sein de cette communauté de pratiques contribuent
à l’internationalisation de la musique guinéenne, mais aussi, en échange, au maintien
de l’activité touristique encouragée par les artistes migrants de retour au pays pour
organiser des stages. Grâce à ce réseau d’artistes en circulation, le tourisme musical en
Guinée se passe aussi bien de politiques touristiques que de tour operator
conventionnels. La fluidité de ces réseaux personnels et associatifs permet, en outre,
une suspension puis une reprise rapide des stages en cas d’instabilité politique.
53 Cependant, si le tourisme favorise la circulation des artistes, il encourage certainement
le conservatisme plutôt que la créativité musicale. La Guinée, réputée dans toute
l’Afrique de l’Ouest depuis les années 1960 pour ses orchestres modernes22 et
aujourd’hui pour sa foisonnante scène hip hop, reste, dans l’imaginaire des touristes, un
« pays de percussion ».
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
165
BIBLIOGRAPHIE
ABRAM, S., WALDREN, J. & MACLEOD, D. (eds.)
1997 Tourists and Tourism. Identifying People and Places, New York-Oxford, Berg.
ANDERSON, B.
1983 Imagined Communities. Reflexions on the Origin and Spread of Nationalism, Londres, Verso.
APPADURAI, A.
2001 Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Payot.
BOORSTIN, D. J.
1961 The Image. A Guide to Pseudo-Events in America, New York, Harper and Row.
BOUTILLIER, J.-L. (dir.)
1978 Le tourisme en Afrique de l’Ouest. Panacée ou nouvelle traite, Paris, Maspero.
CHARRY, E.
2000 Mande Music, Chicago, The University of Chicago Press.
CUSTERS, R.
2008 « L’Afrique révise les contrats miniers », Le Monde diplomatique, juillet, 652 : 12-13.
DA LAGE, É.
2008 « Politiques de l’authenticité », Copyright Volume !, 6 (1/2), Angers, Éditions Mélanie Seteun :
17-32.
DECORET-AHIHA, A.
2004 Les danses exotiques en France 1880-1940, Pantin, Centre national de la danse.
DEVEY, M.
1997 La Guinée, Paris, Karthala.
DEWITT, M. F. (ed.)
1999 Music, Travel, and Tourism, numéro spécial, The World of Music, 41 (3), Journal of the
Department of Ethnomusicology, Otto-Friedrich-University of Bamberg.
DOQUET, A.
2008 « Festivals touristiques et expressions identitaires au Mali », Africultures, 73 : 60-67.
DOQUET, A. & Le MENESTREL, S.
2006 « Tourisme culturel, réseaux et recompositions sociales », Autrepart. Revue de sciences sociales
au Sud, 40 : 3-13.
EBRON, P.
2002 Performing Africa, Princeton (New-Jersey), Princeton University Press.
GIBSON, C. & CONNELL, J.
2005 Music and Tourism. On the Road Again, Clevedon, Channel View Publications.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
166
KEÏTA, F.
1957 « La danse africaine et la scène », Présence Africaine, 14-15 : 202-209.
KOKELAERE, F.
2000 « Sur le marché de la percussion : le cas guinéen », Africultures, 29 : 53-56.
DE LATOUR, É.
2003 « Héros du retour », Critique internationale, 19 : 171-189.
MACCANNELL, D.
1976 The Tourist : A New Theory of the Leisure Class, New York, Schoken Books. MEILLASSOUX, C.
1968 Urbanization of an African Community: Volontary Associations in Bamako, Seattle, University of
Washington Press.
RIVIÈRE, C.
1969 « Fétichisme et démystification. L’exemple guinéen », Afrique-Documents, 102-103 : 131-168.
SCHAEFFNER, A.
1926 Le jazz, Paris, Édition J. M. Place.
SELWYN, T.
1996 The Tourist Image. Myths and Myth Making in Tourism, Chichester, Wiley. TARRIUS, A.
2000 Les nouveaux cosmopolitismes : mobilités identités, territoires, La Tour d’Aigues, Éditions de
l’Aube.
URBAIN, J. D.
1991 L’idiot du voyage. Histoires de touristes, Paris, Plon.
WANG, N.
1999 « Rethinking Authenticity in Tourism Experience », Annals of Tourism research, 26 (2):
349-370.
ZANETTI, V.
1996 « De la place du village aux scènes internationales : l’évolution du Djembé et de son
répertoire », Cahiers de musiques traditionnelles, 9, numéro spécial, Nouveaux enjeux : 167-188.
2005 « La nécessaire reconnaissance des milieux traditionnels dans l’apprentissage des
percussions ouest-africaines », in L. AUBERT (dir.), Musiques migrantes, Golion, Infolio Éditions ;
Genève, Musée d’ethnographie : 87-107.
NOTES
1. Début 2007 une grève générale contre l’incurie du président Lansana Conté a paralysé le pays
et fait plus de trois cents morts parmi la population. En décembre 2008, suite au décès de Lansana
Conté, le Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), emmené par le
général putschiste Moussa Dadis Camara, suspend la constitution, les activités politiques et
syndicales, dissout le gouvernement et toutes les institutions républicaines.
2. « Guinée : pays de percussion » est le nom d’un projet de festival organisé par une agence
culturelle de Conakry (Festikaloum) qui n’a finalement pas eu lieu.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
167
3. Pour appuyer l’idée que le tourisme peut être à l’origine de phénomènes de subversion dans
les pays socialistes (prise de conscience de la rareté de certains biens de consommation...), J.-L.
BOUTILLIER (1978 : 68) note que le seul pays d’Afrique de l’Ouest resté à l’écart du développement
touristique est celui qui a connu l’expérience politique la plus radicale : la Guinée.
4. Le « Ballet africain », créé à Paris à la fin des années 1940 par l’intellectuel militant
anticolonialiste Keïta Fodeba, fut la première troupe africaine à se produire dans les théâtres
français (KEÏTA 1957 ; CHARRY 2000 ; DECORET-AHIHA 2004). Il fut « nationalisé » par Sékou Touré en
1958.
5. Cette opération de démystification a permis d’enrichir le répertoire populaire de rythmes
sacrés jusqu’alors réservés à l’initiation. Ces rythmes sacrés comme kawa, soliwoulen ou kakilembe
sont aujourd’hui joués à travers le monde dans les spectacles ou les cours de percussion.
6. Certains maîtres actuels du jembé furent à l’époque contraints de pratiquer la musique. Ainsi
Lamine Lopez Soumah, qui « voulait être footballeur » fut menacé par les cadres du PDG de ne
pas être ravitaillé en riz s’il n’exploitait pas ses compétences de percussionniste dans le ballet
communal (entretien du 17 juillet 2003, Conakry).
7. La polyrythmie est constituée par la superposition de plusieurs patterns rythmiques différents.
8. Certains « jembefolaw blancs », comme l’Italien Bruno Généro, sont aujourd’hui considérés
comme des maîtres et leur enseignement est prisé tout autant que celui des maîtres africains.
9. Comme l’affirme Minkailou Bangoura, percussionniste de l’Ensemble instrumental national de
Guinée depuis 1971 (entretien, 15 mars 2004, Conakry).
10. Sur l’ancienneté de cette conception essentialiste des « musiques africaines » perçues comme
fondamentalement attachées à la vie quotidienne, notamment au travail et au fétichisme, voir A.
SCHAEFFNER (1926).
11. En Guinée, mais aussi au Mali, au Sénégal ou à Bobo Dioulasso au Burkina Faso.
12. Musiques « traditionnelle » et « moderne » sont les catégories autochtones forgées au cours
de la Première République. Elles sont toujours utilisées en Guinée. La musique « moderne »
intègre les instruments électriques et importés (guitares, saxophones, batteries). La musique
« traditionnelle » est celle des ballets et ensembles instrumentaux. Les musiques rurales sont
appelées « folklore ».
13. Ce forfait n’inclut pas le billet d’avion. Ces associations n’ont généralement pas de licence
d’agent de voyage et, par conséquent, ne peuvent pas « faire d’aérien ».
14. Selon C. M EILLASOUX (1968), le dundunba est traditionnellement dansé lors des grandes
occasions, une victoire militaire, ou pour accompagner le rite de circoncision.
15. La participation musicale est aussi une méthode d’investigation pour les ethnomusicologues
ou les anthropologues (CHARRY 2000 ; EBRON 2002).
16. Pour les plus célèbres : Thomas Lambert, jeune artiste français, devient Toma Sidibé en
empruntant le patronyme de son maître de jembé, le percussionniste suisse Vincent Zanetti est
assimilé au clan des Jara, le musicien français François Glowinski, qui se convertit également à
l’islam, est rebaptisé Ousman Danedjo.
17. En 2005, sur les vingt-deux touristes musicaux interrogés, huit étaient mariés à une ou un
artiste guinéen.
18. Propos rapportés par Célestin Camara, conseillé à l’Alliance pour les danses et percussions
guinéennes (ADPG) (entretien, Conakry, 30 juin 2005).
19. Ces jeunes, qui se revendiquent maîtres après seulement quelques mois de pratique,
contribuent, selon les autorités guinéennes, à dégrader l’image de la percussion en Guinée.
Plusieurs personnes interrogées se rejoignent sur ce constat : Tellivel Diallo (directeur national
de la culture de 1982 à 2001), Riad Chaloud (Bureau guinéen des droits d’auteurs), Célestin
Camara (ADPG), et aussi certains maîtres musiciens. Aujourd’hui, pour réguler l’activité,
certaines associations ou institutions concernées par le phénomène tentent de mettre en place
un système de diplômes destiné aux Guinéens (attestant du statut de « maître percussionniste »,
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
168
d’« accompagnateur » ou de « répétiteur »), et également aux apprenants étrangers attestant de
la participation à un stage avec tel ou tel maître. Mais ce système a peu de chance de se mettre en
place. D’une part, les jeunes musiciens guinéens sont extrêmement réticents à l’idée d’une
institutionnalisation du phénomène. Ils craignent la prédation de leur source de revenu la plus
conséquente. D’autre part, le système de diplômes correspond assez peu aux imaginaires des
touristes en quête d’oralité et de spontanéité.
20. D’autant plus que, lorsqu’ils estiment ne pas profiter suffisamment de la manne financière du
tourisme, les jeunes comparent l’appropriation de la culture guinéenne par les touristes à
l’exploitation de la bauxite par les compagnies étrangères. La Guinée est premier producteur
mondial de bauxite, mais la population profite peu de cette manne. Ce pays riche en matières
premières se retrouve en bas de l’échelle de développement humain établie par le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) (160e rang sur 177).
21. Sur les difficultés que connaissent actuellement les musiciens africains pour circuler en
Europe voir l’excellent dossier du réseau Zone Franche <http://www.zonefranche.com/pdf/
synthesedebat11mai.pdf>.
22. Les orchestres modernes guinéens des années 1960, restés longtemps méconnus du public
occidental, font néanmoins l’objet d’un récent engouement. De nombreux enregistrements
d’époque sont réédités par les labels Syllart et Oriki Music.
RÉSUMÉS
Mis à part le tourisme d'affaires et quelques circuits de trekking dans le Fouta-Jalon, le tourisme
en Guinée est porté par un engouement international grandissant pour les percussions et les
danses traditionnelles. Le tambour jembé, l'instrument emblématique de la culture guinéenne,
attire chaque année des centaines de touristes désirant perfectionner leur pratique musicale et
découvrir le pays d'origine de leur instrument d'élection. Nous proposons d'étudier ce tourisme
du rythme, émergent en Guinée depuis la fin des années 1980, en replaçant le phénomène dans le
cadre de l'accélération des transformations musicales et de la circulation des artistes depuis la
décolonisation. Comment cette nouvelle économie du tourisme musical génère des réseaux
transnationaux d'artistes, suscite localement des vocations artistiques mais provoque également
des tensions autour d'un patrimoine musical désormais partagé ?
Apart from business tourism and a few hiking journeys in the Fouta-Jalon, tourism in Guinea is
supported by a growing international craze for traditional music and dance. The jembe drum,
true emblematic instrument of Guinean culture, attracts every year hundreds of tourists who
wish to improve their musical practice and discover the country of origin of their chosen
instrument. We aim to study this rhythm tourism which has risen from the late 1980's, by
considering this phenomenon as a part of the quickening of musical transformations and
increasing movements of artists since decolonization. How does this new tourism based economy
generate artistic transnational networks and create artistic callings on a local level while causing
tensions around a musical heritage that is shared from now on?
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
169
INDEX
Mots-clés : Guinée, danse, jembé, percussion, réseaux transnationaux, tourisme musical
Keywords : Guinea, dance, jembé, percussion, transnational networks, musical tourism
AUTEUR
JULIEN RAOUT
Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques, Université des sciences et
technologies de Lille I, Lille.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
170
Danser l’Orient. Touristes etpratiquantes transnationales de ladanse orientale au CaireDancing the Orient. Tourists and Transnational Apprentices in Oriental Dance in
Cairo
Julie Boukobza
1 Les notions d’Orient, d’Occident, de Monde arabe, comme d’orientalité et
d’occidentalité sont largement mobilisées dans les discours des danseuses orientales
professionnelles qui exercent au Caire. Elles s’imbriquent dans des revendications
identitaires et sont jugées d’après des critères d’authenticités variablement définis. Car,
depuis la fin des années 1980, la danse orientale est l’objet d’un engouement mondial,
et des jeunes femmes originaires du monde entier viennent la pratiquer au Caire en
tant que professionnelles. Elles s’établissent aussi comme des personnes-relais dans les
réseaux internationaux de sa transmission et occupent une situation d’entre-deux
propice à leur conférer des fonctions de passeuses. Les spectacles de la danse orientale
au Caire sont destinés aux touristes occidentaux et à ceux venus du Golfe Persique. Ce
sont aussi des divertissements appréciés des publics cairotes et l’on voit des danseuses
orientales à la télévision, au cinéma et aux fêtes des mariages. Des publics égyptiens
fréquentent donc des lieux d’abord conçus pour les touristes1. À partir des années 1980,
les hôtels internationaux se multiplient au Caire et de luxueux cabarets éclosent sur
l’avenue des Pyramides. Ces endroits, aujourd’hui encore, sont dédiés aux spectacles de
la danse orientale professionnelle2.
2 Il fut noté, à propos de la danse féminine amateur dans les mariages tunisois, que la
danse en public s’adresse à un destinataire et qu’elle participe d’un échange : l’on tient
des « comptes de danse » (Nicolas 2002). Cette réciprocité présente la danse en public
comme un don qui postule un retour et l’inscrit dans une temporalité de l’échange qui
mobilise un « tabou de l’explicitation », selon l’expression de Pierre Bourdieu (1994),
c’est-à-dire l’affirmation d’une gratuité de l’action par les délais observés entre ces
dons et la dénégation volontaire du caractère automatique du retour du don. La danse
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
171
professionnelle porte des enjeux différents, mais qui se cristallisent eux aussi autour de
la question de l’échange et même, de manière prosaïque, du paiement. Ce sont les
variations dans les façons d’aborder ce paiement et les modalités des échanges entre
des danseuses professionnelles et leur public ainsi qu’entre des professeurs de danse et
leurs élèves qui structurent les enjeux conférés à la danse en contexte. Parce que ces
deux circonstances d’échange de la danse façonnent les dominances d’aspect de celle-ci
et la font accéder au statut de représentante d’identités plus vastes, illustrant certains
aspects des pratiques touristiques qui génèrent des rencontres mais aussi érigent
certains traits culturels comme les formes représentatives d’une société.
3 Les contacts des acteurs de la danse orientale en Égypte avec des étrangers sont décrits
depuis plusieurs siècles et le XIXe, particulièrement, a vu s’ériger des représentations
stéréotypées des danseuses qui influencent encore la façon de les envisager, tant dans
les mondes dits occidentaux et arabes qu’en Égypte. Les divers enjeux actuels de la
danse scénique sont déjà discernables dans les témoignages historiques qui nous sont
parvenus.
4 Parmi ces divers enjeux actuels, l’on trouve celui d’une cristallisation identitaire de la
danse s’exprimant dans un groupe de professionnels marqué par l’influence folklorique
et qui utilise un événement explicitement touristique pour recentrer autour de lui le
vaste réseau des pratiquantes hors d’Égypte. La création il y a quelques années d’un
festival de la danse orientale porte les nouveaux enjeux économiques et symboliques
conférés à cette danse.
Publics et acteurs de la danse orientale au Caire
Spectateurs du passé
5 L’histoire sociale des publics étrangers des danses féminines d’Égypte permet une mise
en perspective des pratiques scéniques actuelles. Les voyageurs des mondes arabes et
européens ont rapporté et commenté leurs expériences personnelles à ce propos. Les
productions littéraires témoignent d’approches plurielles de l’objet, mais aussi d’une
certaine importance du rôle des danseuses féminines dans diverses sphères sociales
égyptiennes. Elles sont massivement évoquées au XIXe siècle par les écrivains
voyageurs orientalistes et leur existence en Égypte est attestée dès le XVIe siècle durant
lequel elles étaient soumises à de lourdes taxes en tant que professionnelles du
divertissement (Raymond 1999). L’imam égyptien Ibn Hajar Al-Asqalani, au XVe siècle,
témoigne même d’une présence plus ancienne de ces femmes lors des célébrations des
saints locaux (mouled-s) en Égypte (Mayeur-Jaouen 2006). Certains récits savants
évoquant les danseuses d’Égypte se sont attachés à les condamner pour leur rôle dans
ces cérémonies et pour leurs pratiques corporelles tôt déclarées transgressives. C’est
l’opinion du chroniqueur égyptien
6 Jabarti qui relate les événements de l'expédition de Bonaparte en Égypte entre le XVIIIe
et le XIXe siècle et c’est également l’opinion des réformistes musulmans dès la fin du
XIXe siècle (ibid.). Leurs textes et leurs idées reflètent les positions des penseurs de la
réforme musulmane dans l’ensemble du Moyen-Orient durcissant l’opposition entre un
islam sacré et licite et une religiosité populaire et profane. À cet égard, l’Égypte occupe
un statut particulier dans cette aire géopolitique plus vaste. Elle y est représentante
d’autorités sunnites internationales : « Depuis le XIXe siècle, l’État égyptien se veut le
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
172
principal promoteur de l’islam réformiste, standard de modernité dont il dispute
aujourd’hui l’exclusivité aux islamistes. L’histoire des institutions d’enseignement de la
religion montre que leur rencontre avec le réformisme musulman a profondément
modernisé le système qui légitime les ulémas, sans pour autant modifier la base de leur
pouvoir » (Luizard 2000). Pour autant, le pays est également connu depuis plusieurs
siècles pour ces pèlerinages festifs auxquels se joignent prostituées et danseuses
(Mayeur-Jaouen 2006). Ces dimensions explicitement transgressives, condamnées par
divers pouvoirs politiques et religieux, rendent difficiles les recherches historiques.
Judith E. Tucker fait état des passerelles qui existaient entre les professions de
danseuse et de prostituée et d’une opposition entre des danseuses de rues destinées à
des publics populaires et d’autres qui se produisaient dans des cercles privilégiés. Elle
souligne néanmoins combien
« leurs professions particulières leur donnaient un statut à part et reléguaient la viefamiliale et ce qui lui était lié au niveau de considérations très secondaires. Cemonde demeure voilé dans l’obscurité, car les stigmates liés à de telles activitésplaidaient contre une reconnaissance officielle de ces femmes dans les comptesrendus du tribunal et ailleurs. Les informations sur l’organisation des métiersreconnus comme “honteux” sont donc rares, et nous devons nous rabattre sur lesobservations des voyageurs européens dont la fascination pour l’exotisme et lasensualité produisit des descriptions détaillées de cette catégorie de femmes »3
(Tucker 1986 : 150).
7 Le corpus littéraire des voyageurs orientalistes sur les danseuses d’Égypte se structure
autour de la recherche de sensations exotiques. Les danseuses s’y imposent
progressivement comme des passages obligés du voyage en Orient. Ce genre
autobiographique revendique et assume la subjectivité de son approche, comme en
témoigne l’intitulé de l’ouvrage d’Alphonse de Lamartine (1961) : Souvenirs, impressions,
pensées et paysages pendant un voyage en Orient, 1932-1933. De Lamartine condamne
durement les danseurs travestis qu’il a l’occasion d’observer au Liban. Pour certains
auteurs, comme Gustave Flaubert et Gérard de Nerval, expérimenter l’Orient revêt les
allures d’une quête d’émotions puissantes de type exotique. Comme l’exprime Tzvetan
Todorov (1989 : 346) à propos de Loti, le voyage est l’occasion d’un « renouvellement de
la sensation grâce à l’étrangeté ». L’objectif affiché est la recherche d’expériences
sensationnelles. Les danseuses et les prostituées d’Égypte répondent à ces attentes, car
elles rendent possibles des expériences érotiques et transgressent les règles du
comportement féminin. Les voyageurs romantiques ouvrent la voie du tourisme en
Égypte, entendu ensuite en tant qu’expérience massivement vécue et aux parcours
banalisés. Le processus est déjà préfiguré chez ces voyageurs écrivains par
l’intertextualité récurrente de leurs récits viatiques, qui ressassent les mêmes topoi et
ancrent les voies incontournables du voyage et les manières dont il doit être vécu. Le
premier guide touristique paraît en 1839, inaugurant l’édition de nombreux ouvrages
du même type. La systématisation des étapes du voyage semble s’accompagner d’une
baisse dans l’intensité affichée de l’expérience. Parallèlement, les conditions de voyage
par bateaux et par trains à vapeur deviennent plus sûres et plus rapides. Les
expériences vécues par le voyageur sont prévues et anticipées, comme le montre la
réaction d’Émile Guimet (1867) qui regrette de n’avoir pas vu les pittoresques
crocodiles du Nil et les danseuses de Haute-Égypte, lors du voyage qu’il relate dans ses
Croquis égyptiens. Journal d’un touriste. Ainsi que le pressent Maurice Barrès dans ses
récits de voyages au Moyen-Orient en 1923, « Le général Gouraud a créé de grandes
routes qui ouvrent ces régions aux curiosités les plus paresseuses. Des touristes iront
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
173
bailler, où le cœur me battait si fort [...]. J’aurais clos en juin 1914 la longue série des
pèlerins du mystère » (Barrès cité dans Berchet 1985 : 9).
8 En Europe, au cours du XIXe siècle, le traitement artistique de la femme orientale
devient un espace érotique investi pour sa permissivité relative par les écrivains, les
peintres et les photographes européens et américains. S’opère alors la typification d’un
modèle féminin, tendance explicite sous la plume de Flaubert (1910) dans son ironique
Dictionnaire des idées reçues : « Bayadère : Ce mot entraîne l’imagination. Toutes les
femmes de l’Orient sont des bayadères »4. Les figures de la danseuse et de la prostituée
sont utilisées comme les métaphores d’une population féminine générale. Les
représentations de ces femmes se répandent dans les sociétés européennes et sont
recyclées à l’époque coloniale dans le contexte des expositions universelles. Ces
manifestations festives à l’usage des peuples, en favorisant la circulation des images et
des personnes, ont fait émergé de nouvelles formes chorégraphiques. Celles-ci
influencèrent tant les pays coloniaux, où un engouement massif pour la pratique des
danses dites exotiques a perduré jusqu’à nos jours, que les pays colonisés où des
générations de danseurs ont imprégné leurs pratiques des expériences vécues à
l’étranger. Dès la première moitié du XXe siècle s’élabore au Caire la forme moderne de
la danse orientale et les célèbres productions cinématographiques égyptiennes qui la
donnent à voir sont diffusées du Maghreb jusqu’aux pays du Golfe. Les grands noms
égyptiens de la danse et de la chanson attirent les spectateurs, tandis que les scénarii
soulignent leur statut social ambigu. Le premier lieu public dédié aux spectacles de
cette nouvelle danse fut créé en 1926 par la syrienne Badea Masabni dans le centre-ville
du Caire et fut nommé al- kasinu5 (Dougherty 2005). Masabni a injecté dans cette danse
des éléments esthétiques et chorégraphiques propres au classicisme européen.
Pourtant, les comédies musicales égyptiennes présentent ces danseuses comme des
produits de la société égyptienne. Ces deux tendances complémentaires se nourrissent
l’une de l’autre et introduisent une rupture symbolique avec les manipulations
européennes d’une danse de l’Orient fantasmée par l’Occident, exhibée dans les
expositions universelles, les music-halls et les films d’Hollywood. Présentée comme une
pratique localement signifiante, la danse orientale n’apparaît donc ni comme un
produit purement colonial ni purement local. C’est cette évolution historique qui
justifie une conception de la danse orientale en tant que produit partiellement global et
localement réinvesti.
Des projets situés de démonstration de soi
9 Ce détour historique permet d’appréhender les forces qui s’exercent à double sens
entre les intentions des acteurs de la danse et les réceptions des publics étrangers. La
danse en public apparaît comme le fruit de cette interaction, comme un acte porteur
d’un sens immédiat, inscrit dans un contexte d’action et modelé par la position de ses
acteurs et de ses récepteurs. L’approche de l’activité dansée comme un bien symbolique
en circulation qui entraîne des contre-dons permet de porter l’analyse sur le plan de
ses contextes et des interactions entre les groupes en présence (Nicolas 2002). De la
même manière, la métaphore commune de la danse comme langage, si elle présente des
limites, permet d’appréhender celle-ci à travers le filtre romanesque et d’opérer une
distinction heuristique entre les instances d’auteur, de narrateur et de lecteur. La danse
n’est pas le miroir naïf de celui qui la produit ni de sa société. Elle porte au contraire le
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
174
projet plus ou moins explicite d’une « présentation de soi », selon la notion d’Erving
Goffman (1973). La réception envisagée d’un certain public influence les choix des
danseurs, comme l’écrit Anne Décoret-Ahiha (2004 : 201) à propos d’Uday Shankar,
danseur indien se produisant en France dans les années 1930 : « Toute la démarche de
Shankar consista ainsi à adapter la spécificité des langages chorégraphiques et
musicaux indiens en un langage spectaculaire compréhensible par le public occidental
mais aussi par les élites européanisées de l’Inde. » Le concept d’exotisation de soi6 fut
élaboré lors de recherches sur les danses actuelles de sociétés anciennement colonisées.
Stavros Stavrou Karayanni (2005 : 132) l’a employé à propos de la rencontre entre
Flaubert et une danseuse de Haute-Égypte. Il définit l’exotisation de soi comme « un
effort pour offrir au riche client en visite le produit qu’il s’attendait à recevoir ».
10 Visant des fins commerciales selon l’auteur, ce stratagème est construit à partir de la
vision présupposée qu’un autre porte sur soi. Il s’agit de se conformer aux critères
discernés dans des définitions exogènes de sa propre identité.
11 Les préoccupations des spectateurs du passé ainsi transmises à la danse par les
danseurs eux-mêmes, semblent se retrouver dans les lieux actuels de la danse orientale
scénique au Caire. Aujourd’hui, deux tendances majoritaires parcourent ces lieux et
leurs usages de l’espace, opposant les nightclubs aux cabarets. Ces types de lieux sont
destinés à des publics différents, bien qu’ils soient tous les deux également fréquentés
par des Égyptiens. Chacun de ces publics confère à la danse professionnelle des
fonctions distinctes. Cette opposition est précieuse pour l’analyse, bien que les
observations montrent parfois une réalité plus nuancée. Les night-clubs sont
principalement destinés aux touristes occidentaux et les cabarets sont à l’usage de ceux
venus des pays du Golfe Persique. Les spectacles de la danse orientale dans les night-
clubs des hôtels internationaux constituent un passage obligé des séjours touristiques
organisés au Caire et sur les bateaux de croisière en province. Ils sont aussi fréquentés
par une élite financière égyptienne assez large. Le spectacle de la danse orientale dans
ces night-clubs s’est progressivement figé autour d’un schéma récurrent qui a intégré
des passages de danses folkloriques. Ces spectacles s’inscrivent ainsi dans le modèle de
la danse figurée. Ils extirpent la danse du contexte d’une pratique collective et assurent
une distance physique constante entre la danseuse et son public : personne ne se
permet de monter sur scène à moins d’y être expressément invité. La participation du
public au spectacle se limite au fait que, parfois, des femmes du public se lèvent et
dansent près de leur tablée, à l’attention de leurs convives. Les codes de franchissement
de l’espace font de la danseuse professionnelle un être inaccessible. Une
décontextualisation de la danse y est élaborée, qui installe une relation entre danseuses
et publics fondée sur la distance et l’imaginaire. La distance permet paradoxalement
des « présentations de soi » fortement érotisées, qui s’expriment par des nudités, par
des mimiques faciales de séduction et par l’expression conventionnelle d’une émotivité
féminine. Selon cette même érotisation, les danseuses orientales font subir aux règles
chorégraphiques du folklore les entorses qui sont le propre de leur personnage
scénique et lui font porter des enjeux de séduction. Les danses folkloriques qui sont
désignées en dialecte égyptien par l’adjectif cha‘bī (du peuple), proposent des
représentations du groupe identitairement orientées. Un trait d’union entre folklore et
danse orientale est mis en scène à travers la danse qu’on appelle baladi, adjectif qui
signifie communément populaire, mais avec un ancrage étymologique dans le territoire
davantage que dans le groupe social (balad signifie ville). La danse baladī présente une
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
175
forme amateur de la danse orientale fondée sur l’improvisation, qui exploite un
contexte musical et des formes chorégraphiques spécifiques. L’expression « ār-raqṣ āl-
baladī », c’est-à-dire « la danse baladī » est couramment employée pour désigner « la
danse orientale », tandis que l’appellation stricte de « ār-raqṣ āš-šarqī », littéralement
« la danse orientale », est davantage usitée dans le cadre de ses prestations scéniques.
Danse féminine urbaine mise en folklore dans les années 1960, selon certains
observateurs, la danse baladī est conçue comme une pratique répandue et ancrée dans
le local (Buonaventura 1994). Elle construit un cadre au discours de la représentativité
sociale de la danse orientale. Elle reflète également l’implication des institutions
folkloriques dans les pratiques dansées égyptiennes, créations du pouvoir socialiste qui
visent à mettre en images l’identité nouvelle et indépendante du pays7. L’entreprise
nationaliste avait condamné les danseuses orientales et les films musicaux où elles
apparaissaient pour leurs liens avec le pouvoir khédival et avec l’Occident (Armbrust
2000). Aujourd’hui encore, les professionnels du folklore prennent soin de se distinguer
de celles-ci. Mais leur autorité grandissante dans l’activité de la danse orientale de
scène est particulièrement sensible depuis les années 1980, où ils ont négocié un statut
de professeurs et d’experts chorégraphiques. Sous leur influence, les scènes des hôtels
internationaux exhibent aujourd’hui une forme spectacularisée de la danse,
étroitement associée avec des formes dansées présentées comme endogènes.
12 Au contraire, les cabarets du Caire se différencient dans une large mesure des night-
clubs. Ils sont massivement fréquentés par les « Arabes », ainsi qu’on désigne au Caire
les touristes venus des pays du Golfe et majoritairement d’Arabie Saoudite. De
nombreux Cairotes évoquent en souriant l’existence d’une « saison des Arabes » qui
s’étend chaque année du mois d’août jusqu’à la fin du mois de septembre. Ces touristes
« arabes » représentent des enjeux financiers majeurs dans l’industrie égyptienne du
divertissement depuis les années 1980. Ils ont financé des films, des revues, des
cassettes vidéos et des chaînes transmises par satellite, ont contribué à donner au Caire
son rôle de capitale du divertissement et à l’entretenir malgré les crises économiques et
touristiques qui ont marqué la dernière décennie. Nombreuses sont les vedettes
égyptiennes de la musique, de la chanson et de la danse qui se sont enrichies grâce à
leurs soutiens financiers. À la différence des night-clubs, les cabarets possèdent une
réputation sulfureuse du fait d’un possible franchissement de leur frontière scénique
par le public. La danseuse de cabaret a pour fonction d’ouvrir l’espace de la scène aux
spectateurs. Il leur est possible d’y danser et d’interagir avec elle. Les danseuses font
preuve d’une expérience pratique des façons d’interagir dans la proximité des corps.
C’est ce parfum d’immoralité que les publics saoudiens ainsi que certains publics
égyptiens viennent chercher. Les directeurs de cabarets rémunèrent modestement les
danseuses qui doublent leur salaire grâce aux pourboires du public, s’assurant ainsi à
moindre coût que la danseuse s’impliquera dans une relation directe. C’est donc afin
d’obtenir un pourboire que la danseuse entretient une interaction constante avec le
public, allant de table en table et plaisantant. Le pourboire est consécutif à l’expérience
de la danse sur scène par une personne du public. Lorsqu’un membre du public monte
sur scène quelques instants, il donnera en général un pourboire avant de retourner
s’asseoir. Si c’est une femme, son père ou son mari remplira cette tâche pour remercier
la danseuse ou le chanteur de ce moment accordé à sa parente. Il jette alors une liasse
de billets au-dessus du destinataire. Il peut aussi les égrainer un à un sur sa tête et ses
épaules afin de faire durer l’instant et d’entretenir l’incertitude du moment où il
s’arrêtera. Un employé est là pour ramasser promptement les billets à terre juste après
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
176
le moment du pourboire. Le donateur peut aussi déléguer un membre du personnel, le
chanteur le plus souvent, pour accomplir ce geste. Ce dernier remercie alors plusieurs
fois au micro la générosité du client et souligne au besoin sa nationalité : « Mille mercis
à notre frère saoudien ! » est une rengaine souvent entendue. Lié à la porosité de la
frontière scénique, le pourboire est une pratique spécifique aux cabarets qui permet
aux Saoudiens d’exprimer un statut financier confortable et souvent envié (de
nombreux Égyptiens partent travailler en Arabie Saoudite). De fait, la sortie au cabaret
est l’occasion, pour certains, de fêter une réussite financière ponctuelle, ou encore de
divertir un hôte. Ces mises en scène font du pourboire un geste ostentatoire, situé dans
une sphère du paraître qui souligne la générosité et le statut de mécène du donateur.
Cette surexposition du paiement va à l’encontre du procédé d’enchantement décrit par
Pierre Bourdieu (1994) à propos de l’échange des biens symboliques : loin de dissimuler
la dimension marchande de l’événement, le procédé du pourboire ostensible la
souligne. Ceci semble orienter la compréhension de la situation vers le schéma du
donnant-donnant immédiat plutôt que vers celui d’un don et d’un contre- don, si l’on
en croit l’importance fondamentale que Bourdieu confère à l’intervalle temporel entre
chaque partie de l’échange, intervalle ici inexistant. Le rôle de l’argent exhibé est
probablement à mettre en relation avec une pratique valorisée de l’aumône, ici conçue
comme une forme d’évergé- tisme artistique, religieusement fondée dans une société
musulmane, où la prodigalité construit le prestige de celui qui la dispense.
13 Les danseuses qui ont suivi les enseignements du folklore, pour la plupart, ne
conçoivent l’exercice de leur profession que dans le cadre des nightclubs où la
présentation de soi est orientée vers la dimension identitaire. Les danseuses des
cabarets sont l’objet de dénigrements justifiés par la place conférée au pourboire et à la
danse collective. Les observations dans ces deux types de lieux révèlent donc une
adéquation relative entre les spectacles proposés et les attentes spécifiques des publics.
Des influences sont actives entre les groupes en présence. Les danses des night-clubs
sont orientées vers la présentation d’une identité de groupe dans la danse répondant à
une demande d’expérience « exotique » des publics occidentaux. Ces scènes portent
d’ailleurs des noms aux consonances orientales : Harun Al-Rachid, Balbek, Casablanca,
Aladin. Les publics saoudiens ont quant à eux accès à un espace dédié aux
comportements transgressifs qui en constituent l’intérêt, avec la possibilité de mettre
en scène leur statut de bienfaiteurs des arts. Les noms des cabarets reflètent une
attirance pour l’Ouest (Parisiana, du nom d’un music-hall parisien du début du XXe
siècle, Al-Andalus, Cave de Roi, Tivoli). Il existe un jeu de renvois référentiels croisés
autour d’un axe Est-Ouest qui rappelle l’importance que revêt la dimension « exotique »
de l’événement, renvoyé dans un ailleurs pour mieux expérimenter les sensations de
l’étrange et de la marge comportementale et sociale. Les ajustements sur les attentes
des publics montrent l’existence d’un dispositif d’adaptation anticipée des
professionnels de la danse orientale envers ces attentes exogènes. Il s’agit de rendre
accessible et lisible la danse, mais aussi de la rendre satisfaisante pour les différents
publics. Ces rencontres situées mettent des groupes en présence dont l’un, de part sa
position d’occupant de la scène, est porté à exhiber un profil particulier. Ce stratagème
d’exotisation de soi soulève la question des forces dominatrices à l’œuvre d’ordres à la
fois politique et économique. Les spectacles touristiques de la danse orientale offerts à
ces deux types de publics vérifient les définitions d’Edward Said (2003) sur un Orient
créé par l’Occident. Par un effet retour des représentations sur un Autre, celui-ci s’en
trouve modifié et, comme l’écrit Said, contenu dans un univers réducteur et conçu
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
177
comme essentiellement étranger. L’exotisation de soi révèle aussi l’incorporation de
symboliques féminines imposées par un système dominant. Elle montre combien la
relation de pouvoir est déséquilibrée. Des chercheurs ont interrogé les relations des
danses coloniales et postcoloniales aux dispositifs de pouvoir. Ils distinguent la
chorégraphie perçue comme la normalisation voire la domestication de la danse du
mouvement excessif. Ils intègrent donc la danse dans une dialectique opposant des
politiques de l’ordre à des politiques du désordre. Marta Savigliano (1995), par exemple,
tente de voir dans les mouvements excessifs du tango argentin une démarche
symbolique qui vise à s’affranchir de la domination coloniale. Mais la volonté de se
dégager du contrôle extérieur sur soi s’incarne principalement dans la revendication de
marqueurs identitaires. Retourner les définitions exogènes, souvent finalement
dépréciatives, et en faire les fiers supports d’une spécificité du groupe, voilà le
mécanisme qui, dans le cas de la danse orientale, a renversé la situation. Ce phénomène
apparaît dans le cas spécifique des danses exhibées dans les night-clubs, qui
revendiquent une assise identitaire à la danse. L’idéologie du folklore, en durcissant les
frontières identitaires, revendique un caractère strictement endogène de la danse et
une transmissibilité limitée aux individus issus d’une société égyptienne idéale. Ces
distanciations identitaires sont observables dans le cadre du festival annuel de danse
orientale Ahlān wa Sahlān et dans le rapport qu’entretiennent les danseuses égyptiennes
avec les danseuses étrangères venues au Caire pratiquer la danse en professionnelles.
L'identité comme enchantement. Danseusesétrangères et participantes au festival
Passer la ligne
14 Depuis la fin des années 1980, des danseuses étrangères sont apparues au Caire,
originaires d’Europe de l’Ouest, de Russie, des États-Unis et d’Amérique du Sud. D. est
française, elle habite au Caire depuis une dizaine d’années. Anciennement danseuse
orientale, elle exerce depuis plus de cinq années le métier de professeur de danse et
possède une clientèle d’élèves internationale et fidèle. D. évoque les changements
qu’elle perçoit dans les raisons qui ont motivé ses choix de danser au Caire, hier et
aujourd’hui :
« On danse au Caire parce qu’on a une vraie scène, parce qu’on a des éclairages,parce qu’on a un public qui est arabophone, d’accord, c’est ça les vraies raisons,mais les raisons qui nous poussent à venir danser au Caire, c’est tout à fait d’autresraisons, d’accord, c’est, je sais pas, La Mecque de la danse orientale, c’est laconsécration aussi j’imagine, enfin bon, toutes ces raisons-là elles sontintéressantes, donc j’ai moi aussi, j’avais ces raisons-là, je voulais aller au Cairecomme tout le monde, je suis allée au Caire, voilà. » (D., 46 ans, été 2003, discussionen français dans son appartement à Doqqi).
15 Aujourd’hui, comme la plupart des danseuses étrangères installées au Caire, D. voyage
pour enseigner. Elle se rend régulièrement en France et en Europe, mais aussi au Japon
ou en Afrique du Sud. Elle s’est lancée dans la recherche d’une méthode explicative et
descriptive pour enseigner la danse. Plus largement, elle a amorcé une démarche
intellectuelle qui remet en cause la manière dont elle a appris la danse et tente de la
déstructurer pour reconstruire sa conception même de la danse. Elle veut mettre en
parole et comprendre la nature des mouvements pour être plus à même de les
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
178
transmettre. Elle enseigne principalement à des étrangères en stages intensifs au Caire,
vend ses chorégraphies et dispense aussi des cours réguliers, collectifs et individuels.
Comme D., les danseuses étrangères connaissent les attentes des élèves internationales
en termes de méthodes d’enseignement et savent s’y adapter. Elles ont conscience de
cet atout qui est le leur et cherchent à le développer par une réflexion sur des
méthodes pédagogiques efficaces. C’est pour elles un moyen de revaloriser leur
enseignement qui souffre de la concurrence égyptienne. Car D., comme d’autres
étrangères, se sent mal à l’aise avec ses élèves égyptiennes. Elle ne se donne pas le droit
de sortir de son propre statut d’élève vis-à-vis de l’ensemble des femmes égyptiennes.
Elle compense parfois cette frustration en les dénigrant, en affirmant qu’elles sont de
mauvaises élèves, qu’elles ne sont ni régulières ni fiables. D’ailleurs, les danseuses
étrangères jouissent d’une réputation de fiabilité et de professionnalisme auprès de
certains responsables de salles, et savent exploiter cette image pour accuser les
danseuses égyptiennes d’être souvent en retard et même absentes au travail. Certaines
danseuses étrangères soulignent la vulgarité des danseuses égyptiennes pour les
déprécier, voire des défauts physiques conçus comme récurrents, tels qu’une mauvaise
qualité de peau. Ce sentiment de la différence, construit par l’attitude même de rejet
des danseuses égyptiennes, est retourné en faveur d’elles-mêmes et exploité contre
leurs professeurs et rivales. Les frontières identitaires s’enracinent donc dans une
répartition des qualités et des défauts pour la danse qui sont en partie conçues comme
des compétences naturelles. Les danseuses venues d’ailleurs oscillent entre la volonté
de devenir identiques à leurs modèles et l’expression de leur propre particularité.
Après s’être formées à la pratique de la danse orientale, ces danseuses étrangères font
leurs débuts, pour les plus jeunes, directement sur les scènes du Caire. Elles participent
au renouveau de l’engouement mondial pour les danses dites exotiques. Leurs discours
pour définir une belle danse récupèrent les critères égyptiens et pointent leurs efforts
pour s’y conformer. Lors de leur apprentissage, la première vague de ces danseuses
étrangères consacrèrent un temps conséquent à une expérience d’itinérance
professionnelle. Elles exercèrent d’abord dans leur pays d’origine, puis multiplièrent
les expériences d’une ou deux années à l’étranger, dans les pays du Moyen-Orient, du
Golfe et du Maghreb, mais aussi en Inde, au Sri Lanka ou en Afrique du Sud. Elles s’y
produisent sur les scènes des hôtels internationaux, pour des cérémonies familiales et
des réunions professionnelles. Au contraire, le parcours des plus jeunes danseuses
étrangères les a menées directement au Caire depuis leur pays d’origine. Les plus
anciennes revendiquent ces expériences itinérantes comme des valeurs ajoutées et les
chargent des notions d’une renaissance à un nouveau statut et d’un apprentissage
complet et accrédité lorsque débute la pratique au Caire. Leurs discours portent les
marques de la conscience d’une supériorité. Les danseuses étrangères tentent de
montrer, autant qu’elles le peuvent, qu’elles sont proches de leur modèle féminin
égyptien. La recherche de légitimité identitaire oriente les démarches des danseuses
étrangères vers le groupe des folkloristes en tant que source de savoirs et
d’apprentissages. En découle une hiérarchie des figures dans l’échelle de l’autorité en
matière de danse orientale.
16 Le passage de la ligne identitaire par les danseuses étrangères exige un changement de
nature. Pour certaines, un processus d’adoption symbolique a rendu possible ce
franchissement. Une jeune danseuse russe a repris le nom de scène d’une danseuse
égyptienne, vedette en son temps, qui l’a formée et soutenue dans sa démarche, et qui
lui a donné son nom. Le mariage avec un homme égyptien est encore une manière
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
179
d’intégrer la nouvelle communauté. L’intégration symbolique s’accompagne d’une
philosophie du quotidien et d’attitudes corporelles conçues comme orientales.
Certaines parmi ces étrangères disent s’être adaptées à leur nouvel environnement au
point d’être devenues elles-mêmes des femmes orientales. Cette orientalité recouvrirait
un art quotidien de la patience et du calme ainsi qu’une habileté à contourner les
désagréments du Caire. La valorisation d’un comportement calme conçu comme
oriental pourrait être mise en relation avec l’apprentissage au Caire par les danseuses
de la lenteur dans leur danse, spécificité exigée selon elles par le public égyptien. Car la
lenteur chorégraphique, en laissant un espace à l’exhibition d’un personnage émotif, au
mime sur les lèvres des paroles du chant, permet d’afficher sur scène ses connaissances
des codes en vigueur. Les étrangères vérifient cette remarque de Georges Devereux
(1985 : 192) à propos de la quête d’intégration au groupe : « L’identité ethnique est
parfois mise le plus fortement en œuvre précisément par ceux qui, selon les critères
habituels, ne seraient pas censés la posséder. » Une danseuse anglaise, installée au
Caire depuis plusieurs années, utilise ses origines familiales iraniennes pour légitimer
le fait qu’elle se considère comme une personne orientale. Née en Iran de parents
iraniens, sa famille a émigré à Londres au cours de ses premières années, mais elle ne se
considère pas comme une européenne. Ce statut identitaire privilégié est ensuite
mobilisé pour porter un jugement sur les tendances de la danse orientale en Europe.
Selon elle, les Européennes ne respectent pas les règles appliquées au Caire : elles ne
sauraient pas ce qu’est la véritable danse orientale. De même, le public européen ignore
ce qu’il devrait exiger d’une danseuse. Ces reproches normatifs sont la marque d’une
pratique qui, pour une personne, s’est façonnée selon des critères extérieurs conçus
comme incontournables. Le manquement aux règles est vivement ressenti, du fait de
ses coûteux efforts en leur faveur. Cette danseuse récupère donc à son profit une
logique instaurée pour légitimer un statut de référence vis- à-vis de ses comparses
d’Europe. Son discours impose des frontières identitaires peu flexibles : l’on naît d’un
côté ou de l’autre de la ligne sans possibilité de franchissement. L’instrumentalisation
des généalogies s’opère aussi dans des circonstances a priori moins favorables : large est
le prisme des origines familiales qui permettent le rattachement au groupe dominant.
Une jeune danseuse américaine évoque ses origines amérindiennes pour démontrer ses
affinités avec l’univers oriental du spectacle :
« C’était très étrange au début, parce que, tu vois, étant occidentale, on n’a pasvraiment l’habitude d’avoir des spectateurs qui participent, et on n’a pas l’habituded’avoir leurs enfants qui montent sur la scène avec soi, et qui restent là, tu vois ! Etj’ai beaucoup de chance parce que ma mère est Indienne [d’Amérique] et donc j’aides [...] les Indiens sont très [...]. Ils rient et plaisantent tout le temps et quand ilsvont à un spectacle, ils vont parler à l’artiste (performer) et des choses comme ça[...]. Je l’avais déjà, c’était à l’intérieur de moi, mais je voulais être très formelle et jevoulais être très professionnelle quand je suis venue, alors j’ai du changer çacomplètement. C’était dur au début. » (L., 26 ans, Le Caire, été 2003, ma traductiond’une discussion en anglais dans son appartement près de l’avenue des Pyramides).
17 On trouve ici l’idée d’une transmission par le sang de traits comportementaux qu’il faut
chercher en soi et (re)découvrir. Il s’agirait d’une forme d’héritage biologique et
inconscient. N’importe quelle origine qui n’est pas conçue comme occidentale semble
permettre de pénétrer dans la communauté orientale, définie ici comme la
communauté des Autres en général, de ceux qui ne font pas partie de cet Occident. La
fracture distribue d’une part l’idée d’un souci des règles formelles dans la danse, et de
l’autre une forme de convivialité et de relations humaines plus consistantes. Les
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
180
représentations de la ligne à franchir pour accéder à l’orientalité sont donc diverses,
mais toujours corrélées à la conception que chacune a de sa propre nature et de sa
position vis-à-vis de la référence égyptienne.
Le festival Ahlān wa Sahlān
18 La plupart des danseuses étrangères, lorsqu’elles arrivent au Caire, suivent un
enseignement dispensé par une ancienne danseuse folklorique qui a su s’établir en
passeuse vers la danse orientale. La plupart des danseuses égyptiennes des night-clubs
ont également d’abord exercé les danses folkloriques égyptiennes, d’une manière
professionnelle ou amateur. Elles sont elles aussi façonnées par cet apprentissage et par
ses idéologies. Aujourd’hui, les folkloristes détiennent une autorité incontestée, ils
vendent des chorégraphies et construisent une vitrine internationale de la danse en
voyageant à travers le monde pour organiser des ateliers à la demande des danseuses
hors d’Égypte. La hiérarchie du savoir structure donc aussi une répartition des tâches
dans l’enseignement. Cette hiérarchie s’illustre à l’intérieur du réseau des pratiquantes
internationales qui se regroupent chaque année au festival Ahlān wa Sahlān. Ce festival
restructure à grande échelle un système de marchandisation des compétences
chorégraphiques qui lui préexistait. En centralisant ce marché mondial, il s’impose
comme incontournable. C’est le premier festival de danse orientale au Caire à être
destiné aux pratiquantes du monde entier. Inauguré en juin 2000, il a su rapidement
s’établir comme un lieu d’apprentissage privilégié. Créé par des personnalités du milieu
des danses folkloriques, l’événement diffuse une danse orientale présentée comme un
support identitaire, tendance qui est spécifique à ce groupe. Les activités proposées
dans le festival mêlent le registre touristique et le registre artistique. Les spectacles et
les ateliers se tiennent dans de haut lieux du tourisme égyptien. Le premier festival
s’est tenu près de Sharm El-Sheikh, célèbre station balnéaire de la mer Rouge. Puis il a
investi des hôtels internationaux du centre-ville du Caire, avant de se déplacer vers
l’extrémité sud de la ville, au prestigieux hôtel Mena House, au pied des pyramides de
Guizeh. L’organisation du festival propose une formule qui inclut et prend en charge les
déplacements entre l’aéroport et l’hôtel, l’hébergement avec petit-déjeuner,
l’inscription au festival et l’entrée au gala d’ouverture. Des excursions touristiques sont
proposées par un partenaire exclusif. Les prix pratiqués par le festival s’alignent sur
ceux d’un tourisme de luxe au regard des critères égyptiens : les cours de danse
orientale coûtent 60 $ chacun, et ceux de danse folklorique 30 $. Les organisateurs
imputent le faible succès de l’édition de 2003 au déclenchement de la guerre en Irak et
aux craintes de la contamination par le SRAS8. Des réticences envahirent les deux
principaux pays dont sont originaires les participantes au festival : les États-Unis et le
Japon. En juin 2005 le succès fut au rendez-vous avec plus d’une trentaine de
nationalités représentées. Le festival dure sept jours et son déroulement est encadré
par les deux temps forts que sont les galas d’ouverture et de clôture. La tendance
explicite est de faire du gala d’ouverture un événement artistique, et les danseuses qui
s’y produisent sont sélectionnées pour leurs qualités professionnelles. Les danseuses
présentées en 2003 et 2005 étaient des célébrités du moment, majoritairement
égyptiennes. Une étrangère y figurait à chaque fois, qui avait été formée par les
danseurs folkloriques. Toutes se produisaient alors régulièrement dans les night-clubs
du Caire. Celles-ci montrent au festival les mêmes spectacles que ceux qu’elles
présentent d’habitude, mais plus courts9. En 2003, des professeurs du Maroc et de
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
181
Tunisie avaient été inclus au programme. En 2005, il y avait une danseuse indienne. S’y
tient également un défilé de mode d’une créatrice égyptienne de costumes de danse
orientale. Le gala de clôture, quant à lui, présente des célébrités d’hier et des danseuses
moins connues. Pendant le reste de la semaine, des ateliers de danse orientale et de
danses folkloriques ont lieu pendant la journée. Ils sont animés par quelques grands
noms égyptiens de la danse orientale au Caire et majoritairement par des danseuses et
danseurs folkloriques, mais également par quelques représentants du reste du monde
arabe. Chaque soir de la semaine se tient une scène ouverte où les pratiquantes venues
d’ailleurs peuvent faire la démonstration de leurs talents.
19 L’intitulé du festival, Ahlān wa Sahlān, est une formule d’accueil répandue qui signifie
bienvenue. Sur le site Internet officiel, un encadré des partenaires touristiques
annonce : « Venez en invité et repartez en ami. » Ces deux amorces font émerger le
registre de l’enchantement décrit par Pierre Bourdieu à propos de l’économie des biens
symboliques. Situant la relation sur le terrain du don (à l’« invité ») et de l’amitié, ces
formulations passent sous silence les aspects économiques de l’échange. Une salle de
l’hôtel est dédiée aux paiements qui n’interviennent pas dans la relation directe entre
l’élève et le professeur lors des cours. Les esprits se focalisent alors sur la transmission
qui a lieu et peuvent prétendre à une relation dépourvue d’enjeux financiers. Au
festival de 2005, D., la danseuse orientale égyptienne la plus en vue dans le Caire
d’aujourd’hui, n’a donné que deux heures d’atelier au lieu des trois heures prévues.
Face à ses élèves, elle a invoqué à sa décharge ses difficultés personnelles liées à des
indiscrétions médiatiques dont elle fut victime et qui faisaient d’elle l’objet
d’innombrables rumeurs. C’est ainsi que la sensation d’avoir côtoyé les états d’âmes de
D. a fait passé à beaucoup d’élèves l’amertume de l’argent déboursé. Cette complicité
affichée exploite l’image d’une convivialité amicale et durable entre le professeur et
l’élève. L’amitié promise par les slogans du festival fait miroiter une relation d’égalité
et de proximité. Le festival donne néanmoins lieu à d’innombrables mises en scène du
paraître qui structurent une hiérarchie implicite. Par les robes de soirée, les
maquillages et les brushings, ou encore par les costumes de scène portés lors des
ateliers, les pratiquantes montrent une volonté de s’identifier à un certain modèle de la
danseuse orientale égyptienne, apprêtée et habillée avec soin telle qu’on la voit sur
scène. Ces modalités de présentation de soi nous renseignent sur l’objectif de
l’apprentissage qu’offre le festival, qui semble être de s’assimiler à un modèle jusqu’à
tenter de lui devenir semblable. Ces manières de se rendre similaire au modèle
empruntent des voies diverses. Par exemple, lorsqu’un présentateur évoque au micro
les diverses nationalités présentes, un concert de youyous s’élèvent à la mention de la
France, connue pour rassembler des pratiquantes dont les origines familiales plongent
dans le monde arabe. Des élèves qui se produisent le soir en semaine dans le festival
demandent au présentateur d’évoquer leur identité arabe. Des termes égyptiens liés à
la danse ou au vocabulaire usuel sont abondamment employés par les participantes.
Pendant les galas, un important dispositif filme les personnes du public, qui se lèvent
pour danser et dont l’image est restituée en direct sur un écran géant. Les danses
présentées par les participantes à ces occasions ou lors des scènes ouvertes copient
celles de leurs idoles. L’originalité n’est pas de mise, au contraire, tout concourt à
souligner la conformité avec le modèle. La plupart de ces femmes n’exercent que
rarement la danse en public mais sont professeurs. Les exhibitions scéniques d’une telle
dimension leur sont donc peu habituelles. L’enjeu de l’enchantement à l’œuvre au
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
182
festival consisterait-il à glisser les pratiquantes dans la peau d’une danseuse orientale
égyptienne ? On semble vendre ici le rêve d’une similarité.
20 Mais l’idéologie folkloriste est parfois mise à mal par les participantes. N., ancien
danseur folklorique égyptien et conférencier, finit en 2003 sa communication dans un
brouhaha et un désintérêt général. L’attention des participantes s’échappe vers
d’autres horizons. En juin 2003, une danse masculine provoque une certaine dissipation
pendant un cours de danse folklorique. Lors d’un atelier, une femme de Louxor était
présentée comme étant la dernière représentante des ġawāzī10. Celle-ci ne parlant pas
l’anglais, une américaine parlait pour elle et s’attachait à souligner la valeur
d’authenticité particulière dont elle l’accréditait. Une chose imprévue arriva : un des
musiciens de l’orchestre, lassé par la situation, se leva et se mit à danser en imitant la
danse orientale féminine. J’assistais là à un spectacle que j’avais déjà vu dans d’autres
contextes, l’imitation exubérante de la danse des femmes par un homme, sur le ton du
jeu, du défi et de l’humour. Certaines participantes à l’atelier se sont laissées prendre
au jeu de danser avec lui ou de l’admirer. Mais sur son site Internet, une participante
américaine, originaire de l’Iowa, donne de cet épisode un récit accablant pour l’homme.
Son intrusion provoqua l’indignation de S., car il avait détourné l’attention des
personnages principaux à ses yeux qu’étaient les professeurs de danse :
« Ses mouvements n’avaient rien à voir avec aucune des danses saidi11 d’hommesque j’ai vues dans les documentaires vidéo, et j’ai commencé à soupçonné [sic] qu’ilétait en train d’inventer des trucs juste pour s’amuser à voir toutes ces femmesnaïves l’imiter. Ça me fait peur de penser que ces gens vont rentrer chez eux etenseigner ces saletés à leurs élèves en les faisant passer pour la danse desghawazi »12 (S., 45 ans environ, journal en ligne).
21 S. assiste à une imitation non pas d’une danse folklorique mais de la danse orientale
féminine, imitation qui est une pratique masculine assez répandue. Mais le musicien de
l’orchestre ne présente pas à ses yeux la garantie d’authenticité des professeurs
officiels du festival. Si S. condamne l’événement, de nombreuses participantes à
l’atelier en revanche se sont laissées entraînées par la danse de l’homme, ouvrant ainsi
une brèche dans l’effort de contrôle exercé par les dirigeants du festival. On voit
affleurer ici les influences que portent les pratiques de la danse en dehors des cadres
égyptiens. Les cours de danse orientale en France sont également souvent menés par
des professeurs issus du Maghreb et véhiculent les influences d’une pratique spécifique
à ces pays. Quelques hommes amateurs de danse orientale participaient en tant
qu’élèves aux festivals auxquels j’ai assisté. Ils exhibaient leurs danses lors des soirées,
sous les regards désapprobateurs et ironiques des professeurs : les danseurs masculins
de danse orientale sont une spécificité non égyptienne. Il existe au Caire des hommes
professeurs de danse orientale, mais ceux-ci s’attachent à ne pas la pratiquer
publiquement en dehors des cours. Ils ont des formations voire des carrières de
danseurs folkloriques. L’émergence de la danse orientale masculine en public au
festival impose donc une manifestation peu convenable en Égypte mais permise dans le
réseau international. Les usages des espaces au sein du festival révèlent que la
prestigieuse scène des galas n’est accessible qu’aux danseuses sélectionnées par les
dirigeants. Celles qui proposent leurs danses aux caméras pendant les pauses le font
autour de leurs tablées au milieu du public. L’espace central du public est occupé par le
groupe des organisateurs, professionnels du folklore et danseuses orientales
égyptiennes. Ils relèguent plus loin de la scène les participantes au festival. Cette
organisation des tables dans l’espace rappelle à tous la hiérarchie symbolique. La
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
183
notoriété des danseuses présentées est soulignée par le martèlement de leur nom au
micro. Il est formellement interdit de prendre des photos et de filmer les spectacles.
Ces mesures mettent en scène et construisent aussi une image du succès égyptien à la
destination du public présent.
L'émotion comme spécificité locale
22 Les enseignements techniques et chorégraphiques apportés dans le cadre des ateliers se
structurent principalement autour de la transmission de chorégraphies.
L’enseignement n’aborde pas les principes de la création chorégraphique, mais
présente un savoir déjà construit et formalisé. Pourtant, l’essentiel de la danse
orientale ne se situe pas, du point de vue même des folkloristes et des publics
égyptiens, dans la structure chorégraphique mais plutôt dans l’expression d’une
émotion qui se situe au niveau du mouvement. Comme l’exprime L., égyptienne et
ancienne danseuse folklorique, professeur de danse orientale au festival et
chorégraphe :
« [les étrangères] ont un ressenti différent, nous, nous sommes nés avec cetteémotion (feeling), en tant qu’Égyptiens, n’importe qui peut écouter la musique etdanser quelque chose, parce que nous sommes nés avec ce style de musique. Maisles autres, elles l’apprennent. Elles apprennent comment écouter la musique etcomment bouger avec la musique, c’est [...], elles sont différentes [...], c’est le styleoriental, les gens orientaux, oui. Elles se concentrent sur la technique, pas sur lesémotions. Pour nous, c’est les émotions en premier, en second et en troisième !L’émotion en premier, c’est sûr, et la technique vient après ça, c’est sûr [...] » (L., 45ans, Le Caire, été 2003, ma traduction d’une discussion en anglais dans sonappartement du côté de l’avenue des Pyramides).
23 Les conventions dansées liées à cette émotion ne font pas l’objet d’un apprentissage
dans le festival. Elles n’y sont pas non plus évoquées. Selon cette ancienne danseuse
folklorique, les ateliers sont orientés selon les attentes spécifiques des pratiquantes
étrangères qui possèdent déjà des bases techniques. Cette justification de l’orientation
pédagogique permet aussi de maintenir la différence identitaire. La danse est présentée
comme authentique et les manipulations subies à l’occasion de sa transmission sont
passées sous silence. La similarité exaltée dans le festival se dissout dans une relation
de maître à élève verrouillée par une transmission sélective. La frustration entretenue
par un savoir en partie confisqué incite les participantes à revenir puiser indéfiniment
à la source de la connaissance. R. est une exdanseuse égyptienne de la troupe
folklorique nationale Réda, chorégraphe, elle est la figure centrale de la formation des
danseuses orientales des nightclubs et du festival. Elle critique l’incompétence des
danseuses à l’étranger, surtout celle des femmes d’origine arabe « qui pensent tout
savoir »13. Elle accuse les étrangères de vouloir considérer la danse comme sacrée et
d’ainsi la figer dans un état à préserver de toute évolution. Cette position la révolte :
« Qu’est-ce que cela veut dire, qu’elle est sacrée ? Qu’elle est enfermée à double tour ?
C’est stupide ! » De nombreuses danseuses américaines aiment en effet évoquer la
danse orientale comme une forme de communion mystique et archaïque. Émerge ici
une incompréhension entre deux conceptions de ce que recouvre la notion de sacré.
C’est donc au niveau d’une définition idéologique de la danse que R. revendique son
expertise. La hiérarchisation des idées sur la danse est finalement reconnue par les
pratiquantes puisque celles-ci considèrent leur participation au festival comme une
expérience légitimante dans leur parcours. N., égyptien et ancien danseur folklorique, a
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
184
lui aussi travaillé pour l’État égyptien, il est aujourd’hui chorégraphe et formateur.
C’est lui qui tient pendant le festival une conférence sur les danses d’Égypte. Dans son
discours, il situe l’origine de la danse orientale à l’époque de l’Antiquité pharaonique :
« La danse orientale est reliée à la danse pharaonique, où une danseuse particulière
était choisie pour sa beauté, son adresse, son agilité et sa présence féminine. À l’époque
actuelle, beaucoup de professionnelles pratiquent cet art, il y a celles qui le font dans
l’intimité de leurs chambres, celles qui dansent pour le profit et celles qui dansent pour
l’art »14. Rattacher la danse actuelle à une époque lointaine permet d’ancrer cette
pratique dans une dimension historique. C’est l’ériger en patrimoine culturel national.
L’auteur condamne implicitement les danseuses des cabarets. L’idée du profit diabolise
la danseuse, rappelant l’enchantement de la relation économique au festival qui
apparaît comme un mécanisme conférant de la valeur à la danse. L’art est idéalisé
comme un projet désintéressé, sans prix exprimable et sans arrière-pensée. Lié à
l’entreprise chorégraphique nationale amorcée avec l’indépendance et le socialisme, ce
chorégraphe projette dans son discours leurs valeurs politiques : la liberté et
l’insoumission aux pouvoirs extérieurs sont corrélées à la démonstration sans fard de
son identité, grâce à la métaphore du lien marchand aboli. Mais, selon les enquêtes
menées auprès des danseuses des lieux plus modestes et des cabarets, elles aussi
considèrent pourtant la danse comme un art. Émerge ainsi, au sein du festival, la
volonté de restreindre les manifestations licites de la danse orientale à des formes
canonisées.
24 La construction d’une charge identitaire de la danse orientale par les danseurs
folkloriques les a érigés en détenteurs du savoir et des compétences. La présentation de
la danse orientale par le biais du folklore, qui exploite le registre identitaire du local, a
relancé les débats sur les qualités nécessaires à une belle danse et à sa transmission.
L’enjeu en est une définition de la femme égyptienne : on affirme aujourd’hui au Caire
que toutes les femmes égyptiennes savent bien danser et ce savoir-danser est présenté
comme fondateur d’une certaine fierté. On postule une transmission génétique de ce
savoir-faire, qui est parfois conçu comme une faculté innée. Vu sous cet angle, ce savoir
appartient à un patrimoine biologique transmis de façon exclusive à l’intérieur du
groupe. D’autres danseuses et publics égyptiens le formulent en termes de talent et des
gradations apparaissent alors au sein de la population nationale : les femmes
d’Alexandrie sont connues pour faire de bonnes danseuses. D’autres encore définissent
cette aptitude comme un savoir culturel. Une danseuse égyptienne a comparé
l’aptitude des femmes originaires de son pays dans la danse à celle des Italiennes dans
la préparation des pâtes. Il s’agit dans les deux cas d’une spécialité locale renommée,
l’accent étant mis sur une transmission du savoir de génération en génération. Les
étrangères, celles qui n’ont pas reçu la même éducation, peuvent être performantes
mais n’atteindront jamais le degré de perfection de celles qui bénéficient d’une
transmission familiale et sociale. Le savoir est ici perçu comme le résultat d’une
tradition locale qui s’enrichit au cours des générations et se développe par l’expérience
personnelle. L’individu égyptien est dans la plupart des cas considéré comme le maillon
d’une chaîne privilégiée de la transmission. L’héritage du savoir culturel, par sa
dimension strictement intergénérationnelle, s’ajoute à l’exclusivité exprimée par un
savoir inné donné avec la naissance et le lignage.
25 La notion d’émotion cristallise ces enjeux identitaires féminins. Elle m’a souvent été
présentée comme le principe créateur d’une belle danse orientale. Cette émotion est
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
185
propre aux femmes égyptiennes, parfois propre aux Égyptiens en général, et à l’Orient.
Comme l’explicite L., professeure égyptienne de danse citée plus haut, posséder cette
émotion constitue un marqueur donnant la preuve d’une appartenance à une identité
égyptienne et féminine, conçue comme orientale. L’expérience de cette émotion
explique l’aptitude à la danse : l’on sait bien danser parce que l’on ressent cette
émotion. Elle désigne une transcendance, révèle l’unité du groupe et structure
l’expérience de l’existence pour les individus selon les conventions désignées par l’idée
d’émotion. L’appréciation esthétique de la danse du côté du public masculin se fonde
également sur cette aptitude émotive. Comme l’évoque Y., égyptien et amateur de
spectacles de danse orientale :
« Toutes, ou la plupart des filles égyptiennes sont des danseuses du ventre parnature. Non, c’est quelque chose à l’intérieur, très profond, peut-être avec lesgènes, peut-être génétique, quelque chose de génétique, qui sait, mais c’est [...] laplupart d’entre elles, disons facilement 99,9 %, elles savent danser la danse duventre, et elles savent, en fait, te divertir. Ce mot est très précieux : divertissement[entertainment]. C’est quand tu regardes quelque chose et que tu y prends plaisir,c’est cela le divertissement. Venant d’un homme, ça ne peut pas me divertir. Jeparle de moi- même, parce que ça doit être exécuté [performed] par une danseuse.[...] Je parle des mouvements lents, [...] ça doit être fait d’une manière très lente, tuvois, comme si [...] un chanteur très célèbre chantait pour toi. Et parfois tu écoutesce chanteur et tu fais cela, tu pars avec lui, tu pars avec la musique, tu fermes mêmeles yeux. Parfois je ressens ça avec les danseuses du ventre. Parfois lorsque ça meplaît, alors je pars avec la musique exactement comme ça. Et je fais descommentaires, tu sais, “Allah ! Allah ! C’est beau ! C’est merveilleux !” » (Y., 40 ansenviron, Le Caire, été 2003, ma traduction d’une discussion en anglais au siège de lacompagnie de tourisme pour laquelle il travaille)15.
26 L’émotion permet d’évoquer une spécificité commune à toutes les femmes égyptiennes
car elle relègue les dimensions techniques de la danse au second plan. Un lien unit
l’émotion à l’audition de la musique. C’est en écoutant la musique égyptienne que se
déclenche le processus émotif source d’inspiration d’une belle danse. La connaissance
des musiques sur lesquelles on danse est donc avancée comme un facteur important
dans la construction du savoir-danser, au même titre que la compréhension des paroles
chantées. C’est donc sur un terrain intime qu’est située l’aptitude féminine à la danse.
Une distribution restreinte dans l’expérience d’une telle émotion refuse ainsi aux
étrangères, et surtout aux Occidentales, une aptitude complète à la danse.
*
27 Le détour par les contextes historiques dans lesquels s’est en partie développée la danse
orientale permet d’observer une adaptation aux attentes des publics, soit l’existence
d’influences exogènes considérables. Un effet retour des influences des divers publics
de la danse s’est opéré sur la manière de la mettre en scène en Égypte. Les échanges
marchands à l’œuvre ont façonné les contenus mêmes de la danse, afin de les
conformer aux attentes et aux intérêts des divers publics. Ces évolutions de la danse
sont observables aujourd’hui, à travers les deux cas distincts de la danse
spectacularisée, porteuse d’identité et d’enchantement des night-clubs et celle des
cabarets qui permet un autre type de transgression corporelle tout en mettant en scène
le geste du paiement. Mais cette dernière particularité de la danse scénique est
dénoncée comme une concession à des exigences exogènes par les porteurs de
l’idéologie folklorique. Ceux-ci tentent de rapatrier la danse à l’intérieur de frontières
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
186
identitaires et de contrôler les influences extérieures sur celle- ci, en sélectionnant le
contenu des transmissions aux danseuses étrangères.
28 Pour les touristes, les spectacles de danse orientale proposent un exotisme reconstruit,
et le festival offre aux danseuses venues d’ailleurs l’enchantement qui consiste à revêtir
momentanément les oripeaux de cet exotisme. Les spectacles en s’adressant aussi aux
cercles égyptiens aisés, contribuent à entretenir une réflexion collective et une
orientation des valeurs identitaires portées ainsi par la danse, ainsi exhibée dans des
lieux à vocations touristiques où siège, même virtuellement, un observateur étranger.
En Égypte, en théorisant dans certains contextes les limites de la transmission de cette
danse aux Autres, on lui revendique un caractère endogène irréductible. Or le tourisme
en Égypte, en dehors des lieux de la danse orientale, constitue aussi l’expérience d’une
relation à forte tension. Depuis les attentats new- yorkais de 2001, l’industrie
touristique est en berne du fait de la désertion partielle des publics occidentaux. À la
manière des définitions tranchées des groupes aptes à la danse orientale sur les sites
touristiques historiques, l’humanité semble se décliner en deux cercles distincts, les
locaux s’opposant aux touristes. À cette bipolarité s’ajoute une relation marchande
toujours ressassée qui provoque une mise à distance. L’un des enjeux symboliques de la
danse orientale actuelle au Caire se situe dans la récupération du pouvoir de se définir
soi-même. Les constructions idéologiques constituent ici des forces réductrices :
dresser des stéréotypes, ériger des frontières identitaires définies comme naturelles,
uniformiser les approches et les discours dans le festival. Mais l’engouement mondial
pour la danse orientale dépasse la simple mascarade festive et son importation dans de
nombreux pays construit aujourd’hui de nouvelles manières de l’envisager. L’évolution
transnationale des pratiques a déclenché des mécanismes dynamiques de redéfinitions
stratégiques. Des valeurs exogènes sont ainsi reformulées au sein de nouveaux projets.
Les vacillements du cadre posé d’autorité au festival semble refléter la confrontation
construite par Arjun Appadurai (2005) entre une nation fonctionnant comme entité
centralisée, ici représentée par les folkloristes, et des réseaux globaux, plus mobiles et
aux références multiples. Les redéfinitions actuelles de la danse orientale au sein des
nightclubs sous l’influence folklorique dépassent ainsi l’univers clos des salles de
spectacle pour se répercuter dans la société égyptienne et dans les réseaux mondiaux
de sa pratique actuelle.
BIBLIOGRAPHIE
APPADURAI, A.
2005 [1996] Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Payot &
Rivages.
ARMBRUST, W.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
187
2000 « The Golden Age before the Golden Age. Commercial Egyptian Cinema before the 1960s », in
W. ARMBRUST (ed.), Mass Mediations: New Approaches to Popular Culture in the Middle East and Beyond,
Berkeley, University of California Press: 292-327.
BERCHET, J.-C.
1985 Le Voyage en Orient : Anthologie des voyageurs français dans le Levant au XIXe siècle, Paris, Robert
Laffont.
BOURDIEU, P.
1994 Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Éditions du Seuil.
BUONAVENTURA, W.
1994 [1989] Serpent of the Nile: Women and Dance in the Arab World, Londres, Saqi Books.
DÉCORET-AHIHA, A.
2004 Les danses exotiques en France (1880-1940), Pantin, Centre national de la Danse.
DEVEREUX, G.
1985 Ethnopsychanalyse complémentariste, Paris, Flammarion.
DOUGHERTY, R. L.
2005 « Dance and Dancer in Egyptian Films », in A. SHAY & B. SELLERS-YOUNG (eds.), Belly Dance.
Orientalism, Transnationalism and Harem Fantasy, Costa Mesa, California, Mazda Publishers :
145-171.
FLAUBERT, G.
1910 Œuvres complètes de Gustave Flaubert, t. 1, Paris, L. Conard, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k208211x.notice>.
FRANKEN, M. A.
1996 « Egyptian Cinema and Television: Dancing and the Female Image », Visual anthropology, 8:
267-285.
GAMBLIN, S.
1996 « Tourisme international et changement social en Égypte : gérer la norme “globale” et les
identités locales », Égypte/Monde Arabe, 26 : 33-58.
GOFFMAN, E.
1973 La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Éditions de Minuit.
GUIMET, É.
1867 Croquis égyptiens : journal d’un touriste, Paris, J. Hetzel, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k104901f>.
KARAYANNI, S. S.
2005 [2004] « Dismissal Veiling Desire : Kuchuk Hanem and Imperial Masculinity », in A. SHAY & B.
SELLERS-YOUNG (eds.), op. cit.: 114-143.
DE LAMARTINE, A.
1961 Voyage en Orient. Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en Orient,
1832-1833, Paris, INALF, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k887532>.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
188
LUIZARD, P.-J.
2000 « Pouvoir religieux et pouvoir politique dans les pays arabes du Moyen-Irient. De la
tradition ottomane à la modernité réformiste », Confluences Méditerranée, 33, <http://
www.europe-solidaire.org/spip.php?article3454>.
MAYEUR-JAOUEN, C.
2006 « Le corps entre sacré et profane : la réforme des pratiques pèlerines en Égypte, XIXe-XXe
siècles », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 113-114 : 301-325.
NICOLAS, M.
2002 La danse en milieu urbain tunisien : technique du corps et socialisation, Thèse de doctorat, Aix-en-
Provence, Université de Provence-MMSH.
RAYMOND, A.
1999 [1973] Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle, Le Caire, Institut français d’Archéologie
orientale.
SAID, E. W.
2003 [1978] L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Éditions du Seuil.
SAVIGLIANO, M. E.
1995 Tango and the Political Economy of Passion, Boulder, Westview Press.
TODOROV, T.
1989 Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine, Paris, Éditions du Seuil.
TUCKER, J. E.
1986 [1985] Women in Nineteenth-Century Egypt, Le Caire, American University in Cairo Press.
NOTES
1. Les touristes étrangers commencent à affluer en masse vers l’Égypte lorsque Anouar el-Sadate
signe l’accord de paix de Camp David en 1978 avec Israël et alors que le Liban a sombré depuis
plus de trois années dans la guerre civile (GAMBLIN 1996).
2. Les observations et les entretiens retranscrits ici ont été menés pendant les années 2003 à
2005.
3. C’est ma traduction de l’anglais.
4. Le mot bayadère, d’origine portugaise, désigne une danseuse.
5. Le mot casino est d’origine italienne : il montre les influences européennes dans l’apparition
de ces types d’établissements au Caire.
6. C’est ma traduction du terme anglais auto-exoticization de Karayanni.
7. Pour des précisions sur les acteurs principaux et les productions cinématographiques des
danseurs folkloriques d’Égypte, se reporter à l’article de FRANKEN (1996).
8. L’épidémie du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) a débuté en Chine à la fin 2002. En
mars 2003, l’OMS déclenche une alerte mondiale.
9. Un spectacle de danse orientale au night-club ou au cabaret dure environ une heure.
10. Les ġawāzī étaient des danseuses de rues, selon les descriptions qu’en donnent les écrivains-
voyageurs au XIXe siècle.
11. Le said désigne le sud de l’Égypte.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
189
12. S. s’exprime en anglais. C’est ma traduction.
13. R., 56 ans, Le Caire, mai 2003, ma traduction d’une discussion en anglais dans son
appartement à Doqqi.
14. N., ancien danseur folklorique, professeur, extrait d’une conférence inédite donnée en anglais
au festival, Le Caire, hôtel Mena House, juin 2003. Ma traduction.
15. Y. possède aussi une formation de danseur folklorique. Il dispense parfois, par plaisir, des
cours de danse orientale aux touristes qu’il accompagne. Lorsqu’il était jeune adulte, sa famille l’a
convaincu de s’investir dans des études de tourisme et d’abandonner l’idée d’une carrière dans
les danses folkloriques.
RÉSUMÉS
La danse orientale professionnelle au Caire est une activité touristique. Les professionnels de ces
spectacles ont adapté leurs prestations aux attentes des publics. La relation de domination
imposée par la demande touristique est renversée par un mécanisme de récupération du savoir-
danser sous une bannière locale. Une large audience cairote est présente à ces spectacles,
montrant combien cette danse fonctionne comme une vitrine de soi, agréée par une partie de la
population. Les danseuses étrangères, présentes au Caire depuis un quart de siècle, oscillent
entre la conformité au modèle et des stratégies de défense de leurs différences. Un festival
annuel au Caire cristallise ces enjeux au niveau du réseau actuel des pratiquantes mondiales de la
danse orientale.
Professional oriental dance in Cairo is meant for tourists. Professional of entertainment adjusted
their performances to audiences' expectations. The relationship of domination the tourists'
demands imposed has reversed by a recovering of oriental dance under a local banner. A broad
Egyptian audience attend those performances. It presents the dance as a window of the identity
of the group, approved by a part of the population. Oriental dancers from abroad, present in
Cairo since a quarter of century, hesitate between the accordance with a model and strategies to
promote their own differences. Every year, a festival in Cairo crystallize those stakes at the level
of the current world-wide network of the apprentices of oriental dance.
INDEX
Mots-clés : Égypte, Caire, corps, danse orientale, féminité, tourisme
Keywords : Egypt, Cairo, body, oriental dance, femininity, tourism
AUTEUR
JULIE BOUKOBZA
Institut de recherches et d’études sur le Monde arabe et musulman/CNRS, Aix-en- Provence.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
190
Inspiration triangulaire. Musique,tourisme et développement àMadagascarInspirational Triangle. Music, Tourism and Development in Madagascar
Marie-Pierre Gibert et Ulrike Hanna Meinhof
1 Maintien ou réinvention d’une vision inégalitaire évolutionniste et postcolonialiste
entre Nord et Sud, incompréhensions réciproques, relations superficielles, non prise en
compte des populations « visitées », autant de critiques qui ont longtemps été adressées
tant aux projets de développement qu’aux activités touristiques1. Dans une tentative de
réponse, un tournant a été amorcé dans les années 1990 vers des pratiques
encourageant la « participation locale » 2, l’empowerment ou le « développement
durable » d’une part, l’émergence des concepts de « tourisme solidaire » ou « tourisme
responsable »3 imaginés et valorisés par les professionnels du tourisme et du
développement de l’autre. Ces solutions ne semblent pas pour autant être exemptes de
problèmes, et en premier lieu celui d’un décalage entre rhétorique et pratique. Certes,
la nécessité de « rendre la parole » aux premiers concernés est énoncée et encouragée
par tous, et les grands organismes d’aide au développement (Banque Mondiale, FMI,
etc.) ne sont pas en reste, mais cela ne semble pas toujours être le cas sur le terrain et
les relations de pouvoir demeurent souvent inégales (Chabloz 2007 ; Goedefroit 2007 ;
Pottier et al. 2003 ; Woost 1997). Dans le même temps, certains auteurs s’interrogent sur
le rôle que joue « la nébuleuse des ONG du Sud » (Atlani-Duault 2005) dans une période
où les grandes agences d’aide au développement encouragent l’action de la « société
civile » locale.
2 C’est dans ce contexte que nous a semblée intéressante la découverte, au fil d’une
recherche portant sur tout autre chose ou presque, de plusieurs situations où se
construisent des relations d’échange et de soutien mutuel entre musiciens et
organisations humanitaires et dans lesquelles le tourisme joue tantôt le rôle de
déclencheur, tantôt au contraire découle de cette rencontre entre membres d’une ONG
et artistes. Ces configurations nous sont apparues en explorant les réseaux de relations
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
191
construites par des musiciens malgaches avec lesquels nous travaillons actuellement
dans le cadre d’une recherche sur les réseaux transnationaux d’artistes à travers
l’Afrique et l’Europe4.
3 Si les trois domaines — tourisme, développement5 et musique — sont aujourd’hui de
plus en plus étudiés par les chercheurs en sciences humaines et sociales, soit pour eux-
mêmes, soit dans leur articulation deux à deux, la triple mise en relation l’est encore
rarement. C’est donc ce triangle d’interrelations où l’articulation entre ces trois entités
peut s’effectuer selon différentes modalités, que nous nous proposons d’explorer ici en
analysant les trajectoires et les motivations de différents acteurs. Les exemples sur
lesquels s’appuie cet article présentent trois parcours différents qui mettent tous en
relation un groupe de personnes associées à une ONG ou une association caritative6
allemande ou autrichienne, des populations malgaches vivant dans des régions souvent
très pauvres du pays, et plusieurs musiciens malgaches engagés socialement et/ou
politiquement dans leur propre pays. Dans les trois cas, ce qui nous intéresse
particulièrement n’est pas tant de questionner la relation entre touristes et musiciens,
touristes et habitants, ou encore touristes et « développeurs », que d’envisager
l’expérience touristique comme « un moment » dans un parcours qui articule membres
d’une ONG venus « du Nord », musiciens d’un pays dit « du Sud », et population locale.
4 Nous faisons l’hypothèse que l’arrivée dans le duo développement-tourisme d’une
troisième dimension, celle des pratiques culturelles (ici la musique), et plus
particulièrement de leurs acteurs, les musiciens, contribue à la fois à dépasser les
incompréhensions entre membres d’une ONG venus d’Europe et population malgache
qu’ils sont venus « aider », ainsi qu’à rééquilibrer — en partie au moins — les inégalités
inévitablement créées par ces pratiques d’aide à sens unique7.
Tourisme, musique et développement : des relationsduelles
5 Tourisme et musique partagent une longue histoire commune : des découvertes
musicales faites aux siècles précédents par les grands voyageurs aux répertoires dansés
et musicaux locaux revisités pour animer des soirées touristiques, en passant par les
festivals de musique d’abord inspirés par Wagner il y a plus d’un siècle (Boret et al.
2005) ou la mise en valeur d’une ville ou d’une région grâce à son importance dans
l’histoire de la musique. Ces différentes configurations, ainsi que leurs effets et raisons
d’être, font l’objet de nombreuses recherches en sciences sociales depuis quelques
décennies8. S’articulant en un débat sur les avantages et inconvénients de la mise en
valeur d’un territoire par la présentation de ses pratiques artistiques9, ces recherches
placent plus particulièrement les questions du « contact culturel » et de
l’« authenticité » au centre de la réflexion. De fait, ces deux positions opposées étaient
déjà soulignées par de Kadt (1979) à la fin des années 1970 dans son rapport rédigé pour
l’Unesco et la Banque Mondiale. D’un côté, le tourisme est envisagé comme conduisant
à la transformation (négative), voir à la « dégénérescence » des pratiques culturelles ou
de l’artisanat d’une région ou d’un pays. De l’autre, le tourisme est vu comme
permettant la conservation de produits ou de pratiques artistiques qui auraient sinon
disparu, et/ou stimulant la créativité et l’innovation des artistes et artisans (de Kadt
1979)10, à tel point que certains auteurs parlent même de « commercial value of art for
tourism » (Zeppell & Hall cités dans Smith 2003 : 137). Le présent article n’a cependant
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
192
pas l’intention de prendre directement position dans ce débat, mais de se pencher plus
particulièrement sur la relation de découverte réciproque qui lie musique et tourisme.
La découverte d’une musique peut en effet faire naître le désir d’aller dans le pays
d’origine des musiciens, et réciproquement, séjourner dans un pays mène souvent à en
aimer la (une, des) musique(s).
6 Cette question de mise en valeur d’un lieu par l’utilisation de pratiques artistiques nous
conduits vers le pôle du développement puisqu’elle est extrêmement présente tant
dans la littérature du développement que dans celle, critique, sur le développement.
D’autres liens existent entre ces deux domaines, mais ils ne font encore qu’assez
rarement l’objet de recherches empiriques. Il existe ainsi des ONG qui tendent à intégrer
dans leurs programmes le financement de projets dits « culturels » en soutenant les
artistes locaux11 et/ou qui utilisent les arts comme vecteurs de certaines de leurs
actions. Par ailleurs, un certain nombre de musiciens de renom participent de façon
ponctuelle à diverses campagnes de sensibilisation d’aide et de développement, ces
actions étant souvent connues grâce à leur large médiatisation12. Quoique cette
utilisation de la musique comme vecteur de sensibilisation soit présente dans certains
parcours analysés dans cet article, la relation entre musique/musiciens et ONG explorée
ici est un peu différente : les musiciens malgaches jouent ici le rôle d’interface entre
associations humanitaires européennes et paysans malgaches.
7 Enfin, et comme cela a déjà été mentionné en introduction, au croisement, d’une part,
de la réorientation des politiques de développement vers des méthodes de
« participation locale » et, d’autre part, des nombreuses recherches menées depuis
plusieurs décennies sur les impacts sociaux, culturels et environnementaux du
tourisme, a émergé le concept de « tourisme durable ». C’est particulièrement le cas à
Madagascar depuis la fin des années 1980 comme le montre B. Sarrasin (2005 : 171 sq.)
qui parle d’une « instrumentalisation du tourisme pour l’environnement ». Les travaux
récents montrent cependant que les relations construites dans ces nouveaux contextes
entre touristes « responsables » et habitants des régions dites « à développer »
demeurent problématiques13. L’une des formes extrêmes de ce type de tourisme à la
frontière des pratiques humanitaires est celle de volontariat ou de bénévolat14 dans
certaines ONG : des voyageurs curieux ou engagés socialement découvrent ces
programmes de volontariat et décident d’y participer comme alternative à un tourisme
« plus direct ». Ils deviennent alors travailleurs humanitaires temporaires et cela les
mène parfois à occuper ensuite un poste permanent dans une ONG. Toutefois, quoique
de tels liens entre expérience touristique et engagement dans les pratiques caritatives
et humanitaires apparaissent parfois furtivement ou implicitement au détour de
certains travaux de chercheurs en sciences sociales15, seuls quelques-uns de ces travaux
questionnent directement ce point de contact entre tourisme et développement. C’est
le cas notamment de X. Zunigo (2007) qui envisage le volontariat comme « figure
spécifique du tourisme »16 ou d’E. Grégoire (2006) qui montre comment séjours
touristiques et naissances de petites oNG sensibilisées aux conditions de vie des
populations touaregs du Niger sont intimement liés. C’est donc sous cet angle, tant
thématique que méthodologique, que nous nous proposons d’explorer la relation
développement-tourisme.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
193
Analyse des discours, représentations et perceptions
8 Logique d’exposition et logique de recherche sont souvent différentes. Notre point
d’entrée dans ce travail ne fut ni Madagascar, ni les ONG européennes, mais d’abord un
musicien malgache, Zafimahaleo Rasolofondraosolo — dit Dama —, membre du groupe
Mahaleo, puis l’ensemble des Mahaleo et finalement d’autres artistes malgaches. C’est
en suivant le parcours de chacun que sont apparus ces multiples liens avec des ONG
européennes, ainsi que les points de contacts qui existent entre ces ONG. C’est donc déjà
selon la perspective de ces deux groupes d’acteurs — musiciens et membres d’ONG —
que nous avons pénétré le « monde du développement ». Ce sera cette même
perspective que nous adopterons dans le présent article, cherchant à interroger leurs
discours, leurs perceptions, et leurs motivations, concernant des rencontres et une
expérience d’aide au développement qu’ils considèrent comme réussies.
9 Partant des récits que font les membres de trois associations européennes (l’une
allemande, les deux autres autrichiennes), nous chercherons à comprendre comment
ce qu’ils disent d’eux-mêmes et de leurs expériences guide et influence leurs pratiques
sur le terrain. Selon S. Goedefroit et J.-P. Revéret (2007 : 14), « Madagascar est peut-
être, plus que d’autres pays, le réceptacle d’un déversement de projets de
développement, sans doute à cause des fantasmes que fait naître la situation d’extrême
pauvreté dans laquelle se trouve la population, opposée à l’extrême richesse de la
biodiversité de celle qu’on appelle la Grande Île ». Or ce qui nous intéresse ici est
justement la manière dont les protagonistes de ces trois histoires de vie articulent cette
tension entre un imaginaire misérabiliste et/ou paternaliste souvent prégnant dans les
représentations de « la pauvreté dans le Tiers Monde » (Street 1994) et une perspective
plus égalitaire fondée sur une relation d’échange qu’ils mettent peu à peu en place avec
des artistes malgaches.
10 Une large partie de ce travail prendra donc appui sur les discours — d’où le parti pris de
publier de longs extraits d’entretiens —, que l’on mettra en regard des expériences de
vie quotidienne de ces acteurs, de leurs différents projets et de leurs réseaux de
connaissances17. L’approche sera résolument constructiviste puisqu’il s’agira de saisir
au plus près les relations qui se développent entre les différents acteurs, ainsi que les
réseaux qu’ils mobilisent et/ou mettent en place. Adoptant le point de vue des
« développeurs » et des artistes pour mieux le questionner, cet article n’a en revanche
pas pour but d’analyser la mise en pratique de ces discours dans les villages malgaches
concernés, ni d’en évaluer les conséquences en termes de développement. D’autre part,
dans la mesure où, au commencement de ce travail se trouve une recherche portant sur
les réseaux des artistes, et non sur des questions touchant au développement ou aux
organisations humanitaires, il ne s’agit ici que de résultats exploratoires, d’une
première étape de réflexion sur ces relations triangulaires qui lient tourisme,
développement et musique.
11 Dans un premier temps nous nous pencherons de manière très empirique et
volontairement très peu analytique sur trois cas de « développeurs » : quelle est leur
trajectoire, quel rôle joue le tourisme dans ce parcours, et comment la musique et les
musiciens entrent à leur tour dans l’histoire. Dans une seconde partie, nous nous
arrêterons sur les points qui, communs à tous ces récits, nous semblent concourir à ce
qui est perçu par les acteurs comme un rééquilibrage des relations entre
« développeurs » et « populations locales » par l’intermédiaire d’une troisième
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
194
catégorie d’acteurs que sont les musiciens, et la mise en place d’un système de réseaux
qui s’articulent à la fois au niveau du local, du régional, du national et du
transnational18.
Histoires d'une rencontre
Du tourisme à l'aide au développement, via la musique : l'histoire
d'Anne et Erich et l'association Freunde Madagaskars
12 L’activité touristique est au point de départ de tout le parcours d’A. et E., couple
d’Allemands vivant à Munich19. Au milieu des années 1980, ils découvrent Madagascar
« par hasard » lors d’un voyage touristique à l’île Maurice au cours duquel leur avion
survole la Grande île. Ils s’y rendent quelques années plus tard et, enchantés par ce
séjour, ils multiplient leurs voyages pendant les années qui suivent.
« C’était en 1987, notre premier voyage à Madagascar, et on s’est baladé dans tout lepays avec un sac à dos, sans plans précis. On est tombés amoureux du pays, on nepouvait plus partir de là, on a rencontré des gens, et l’année d’après on était deretour. Et ainsi de suite pendant ces 20 dernières années, on est retournés àMadagascar très régulièrement, une fois par an, des fois même deux [...] » (Erich)20.
13 Ces nombreuses et régulières demandes de visa pour Madagascar finissent par attirer
l’attention du conseiller honoraire de l’ambassade malgache en Allemagne qui leur
téléphone un jour pour leur proposer d’adhérer à l’association d’envergure nationale
Deutsch-Madagassischer Verein (Association germano-malgache), qui organise et
finance divers projets de développement à Madagascar21. Puis, lors de la première
réunion de cette association, ils découvrent l’existence d’une petite ONG, Freunde
Madagaskars22 (Les Amis de Madagascar), nouvellement créée par des Munichois à leur
retour d’un séjour touristique à Madagascar, et destinée à aider les enfants d’une école
de la petite ville de Belo-sur-Tsiribihina, à l’ouest de l’île. E. et A. en deviennent
également membres23. Leur entrée dans ces deux associations marque donc leur
passage vers le monde de l’humanitaire et du caritatif. S’impliquant toujours davantage
dans les projets de l’une et l’autre des associations, ils multiplient leurs voyages à
Madagascar, combinant désormais accompagnement de la mise en place de projets de
développement et tourisme. Mais, peu à peu, ils réalisent que ce type de projets ne va
pas sans problèmes, car ils sont construits sur des illusions d’Européens désireux de
faire le bien en allant aider les « pauvres Malgaches dans le besoin », mais ne
parviennent pas à saisir la réalité du terrain. E. et A. ressentent donc de plus en plus le
besoin d’une médiation locale. Ce faisant, ils prennent conscience, à l’échelle de leur
propre expérience, de ce que les anthropologues du développement montrent du doigt
depuis plusieurs décennies, à savoir les incompréhensions réciproques et la non-
viabilité de projets créés hors du contexte local de leur application. L’association
engage alors un enseignant malgache également formé à la mise en place de projets de
développement, et désireux d’aller travailler à Belo car il vient originellement de cette
région. Il met en place un large programme qui ne concerne plus seulement les
conditions de travail dans l’école et le bien-être des enfants, mais s’intéresse plus
largement aux familles de ces élèves.
14 Puis une autre rencontre va permettre à E. et A. de poursuivre dans cette direction de
médiation « locale ». Lors d’une célébration, à Berlin, du jour de l’Indépendance
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
195
malgache, ils font la connaissance d’un musicien malgache venu jouer pour l’occasion
et, par son intermédiaire, établissent le contact avec son frère Ricky, musicien
renommé vivant à Antananarivo. Ricky est également co-créateur, avec le musicien
Dama du groupe malgache Mahaleo24, du projet malgache Voajanahari dont le but est
de sensibiliser divers publics (malgaches et étrangers, ruraux et urbains) à la situation
de Madagascar par l’intermédiaire de concerts-débats donnant la parole au public25.
Ainsi, lorsque Ricky, Dama et Hajazz (autre musicien malgache) viennent présenter ce
projet près de Cologne quelques temps plus tard, E. et A. s’y rendent puis rejoignent les
artistes après le concert. Enthousiasmés et fascinés par Ricky et Dama, tant par leur
dimension d’artistes que d’êtres humains, et par les buts de l’association Voajanahari,
ils leur proposent de collaborer à l’un des projets mené par Freunde Madagaskars.
« Dama et Ricky ont accepté et ont donné un concert formidable à Belo [...]. Les gensnous ont dit que c’était l’événement culturel le plus important dans toute l’histoirede la ville. [...] Et tout le public a mis ses plus beaux habits, et tous les gensimportants de la ville étaient présents aussi, et au final il est venu près de 500personnes » (Erich).
15 Grâce au concert bénévole organisé en soutien à l’association Freunde Madagaskars, et
plus généralement à la venue de ces artistes à Belo-sur- Tsiribihina, les habitants de la
ville venus assister au concert commencent véritablement à s’ouvrir de leurs
préoccupations devant E. et A., par l’intermédiaire des musiciens.
« Lors de notre dernière visite liée au concert de Dama et Ricky à Belo, lesreprésentants des associations de paysans sont venus à l’hôtel où était Dama etpendant toute une matinée, Dama a dû discuter des problèmes des paysans aveceux. Et c’est à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte que noslimitations à l’école, le professeur et les enfants, n’étaient pas tenables à longterme, mais qu’au contraire nous devions nous attaquer à une perspective pluslarge. Et comme 90 à 95 % de la population est constituée de paysans, l’éducationdes enfants est directement liée aux problèmes d’agriculture, donc maintenant oncomprend que c’est absolument central, et maintenant on essaie de l’inclure, parexemple en incluant des livres pour adultes dans notre bibliothèque » (Erich).
16 Selon A. et E., cette médiation permet aux membres de Freunde Madagaskars d’être
davantage au fait de l’ensemble du contexte dans lequel ils travaillent, et d’ajuster leur
projet aux véritables besoins de la population.
17 La rencontre avec deux musiciens malgaches, eux-mêmes engagés dans les questions
d’aide dans leur propre pays, semble donc venir désamorcer le manque de
compréhension qui prévalait jusque-là, en mettant en place des relations plus
profondes entre les différents acteurs. En outre, l’événement que représente la venue
jusqu’à Belo de ces deux musiciens célèbres donne de l’importance à l’association
étrangère aux yeux des habitants de cette petite ville, puisque c’est grâce à elle que
Dama et Ricky sont venus.
18 Enfin, dernière étape dans la mise en place de ce circuit d’échange, E. et A. commencent
à trouver des dates de concerts pour Ricky et Dama à Munich, ces spectacles
permettant ensuite aux artistes d’établir à leur tour des contacts avec d’autres
organisateurs en Allemagne et en Europe. Ces concerts remplissent plusieurs rôles qui
semblent mettre en place un véritable échange. D’un côté, l’association allemande voit
son prestige rehaussé tant à Madagascar — où les activités de cette ONG et ses membres
jouissent désormais d’une visibilité allant jusqu’à Antananarivo26 — qu’en Allemagne —
pour sa capacité à pouvoir mettre en contact divers promoteurs culturels avec
d’excellents artistes malgaches. En outre, les membres de l’association allemande se
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
196
sentent honorés par la présence de ces musiciens célèbres et sont enchantés de pouvoir
ainsi les côtoyer à un niveau interpersonnel. Cela leur permet également de mettre en
place des liens étroits avec la diaspora malgache en Allemagne et en Europe. Par
ailleurs, en participant à ces tournées co-financées par l’association, les artistes
malgaches accèdent à des scènes musicales européennes à la fois plus nombreuses et
plus variées, sortant ainsi, en partie du moins, du réseau exclusivement
communautaire.
19 Et la boucle est finalement bouclée : en contribuant à faire connaître Madagascar à
l’étranger (« To put Madagascar on the map »)27, les musiciens participent à leur
manière à cette « mise en tourisme de la culture » dans une phase qui précède le
voyage lui-même puisque ces concerts européens se font également devant de
potentiels futurs touristes.
De la musique au tourisme via l'aide au développement : l'histoire
d'Hildegard et Sepp et l'association Baobab
20 H. et S. sont un couple d’Autrichiens catholiques très pratiquants, qui se décrivent
comme « touchés depuis toujours par les problèmes du TiersMonde ». Cherchant à faire
prendre conscience de ces problèmes au reste de la population autrichienne, ils entrent
régulièrement en contact avec d’autres groupes qui partagent les mêmes
préoccupations. C’est ainsi qu’ils rencontrent l’association Welthaus-Linz dont l’une des
activités est justement de coordonner les différentes actions de bénévoles de cette
région. En 1998, le directeur de la Welthaus-Linz leur propose de les aider à trouver des
lieux de concert pour un groupe de musiciens venus de Madagascar, les Mahaleo.
« Je pense qu’il y avait entre 100 et 150 personnes au concert, et ça a été un vraisuccès, et avant ça [...] ils avaient fait un atelier dans un collège [Gymnasium], etl’après-midi on les avait invités à la maison [...] et nous avions beaucoup discuté. [...]Dama était tellement dedans, de tout son cœur et de toute son âme [...]. Ça nousfascinait, que eux, des musiciens, soient si engagés pour leur propre pays. [...] Nousconnaissons plein de gens qui participent à des projets de ce genre, [...]principalement des gens d’Église, et c’était formidable pour nous de rencontrer,pour une fois, des gens non religieux. Et en plus de ça des gens qui sont trèscélèbres et qui sont tellement au courant de la pauvreté dans leur propre pays etqui essaient de s’en occuper, et de régler ces problèmes avec de nouvellesméthodes. Ils nous ont raconté [...] comment ils vont dans les villages avec leurcaméra et font parler les gens, ça nous a fascinés, nous n’avions jamais rencontréquelque chose comme ça [...]. Et c’est comme ça que l’idée est née, j’ai senti que,vraiment, ces gens-là avaient besoin de soutien, et donc on a créé un groupe de self-taxation pour récolter de l’argent » (Hildegard, Altmünster, septembre 2007).
21 Une seconde visite des musiciens malgaches en Autriche deux ans plus tard renforce les
liens précédemment créés, réactive la motivation nécessaire à la fondation d’une
structure, et contribue à créer un réseau de personnes désireuses de « faire quelque
chose pour aider les Malgaches ». S’appuyant alors sur ce réseau autrichien qui se
développe peu à peu, H. et S. créent en 2001 l’association Verein Baobab-Solidarität mit
Madagaskar28 afin de pouvoir solliciter des aides pour financer les divers projets des
Mahaleo à Madagascar.
22 Les débuts sont parfois compliqués par des problèmes de communication (grande
distance géographique, français hésitant des Autrichiens), mais la situation se simplifie
peu à peu, notamment grâce au fait que l’un des musiciens des Mahaleo, Charle, vient
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
197
régulièrement en Autriche rendre visite à son fils installé dans le pays. Des liens plus
étroits s’établissent alors entre le couple autrichien et ce musicien, et se doublent d’une
étroite collaboration entre l’association Baobab et la structure malgache CICAFE (Centre
d’information, communication, animation, formation, éducation) que Charle coordonne
depuis sa création en 199929. Celle-ci devient la structure médiatrice entre projets
malgaches locaux et association Baobab, se chargeant entre autres d’évaluer les besoins
locaux et de suggérer quels projets entreprendre et financer. L’instauration de cette
relation qui articule les niveaux du social et du professionnel marque une étape
suivante dans la structuration de cette association et dans la perception qu’ont H. et S.
de leur travail.
23 Finalement, H. et S. qui n’étaient jamais allés à Madagascar décident de s’y rendre en
2006 afin de visiter les projets auxquels ils ont contribué, et de découvrir le pays. En
effet, depuis le début de leurs activités d’aide (et pas seulement pour Madagascar), leur
rapport aux pays aidés est ambivalent : leur volonté de se distancier de l’expérience
touristique est telle qu’ils participent à divers projets de développement sans ressentir
le besoin d’aller voir ce qui se passe sur le terrain.
« C’était notre premier voyage dans l’hémisphère sud, même si depuis qu’on a 20ans on participe à des choses de ce genre, mais on avait toujours dit que l’on n’a pastoujours besoin d’être dans le pays en question pour savoir ce que l’on doit y faire.Je pense que l’on voit cela à la télévision, on entend ça à la radio, on le lit dans lesjournaux. [...] Nous avions toujours ressenti très fortement que c’était comme ça,mais maintenant je sais [...] que cela m’a complètement dévastée, je veux direressentir ce que cela veut dire pour quelqu’un de vivre comme un illettré, ce quec’est que vivre dans un village pareil, ce que l’on ressent en travaillant avecquelqu’un comme ça, et de l’aider à changer quelque chose dans sa vie, que c’estvraiment difficile à faire. Je pense qu’en tant qu’Européen ordinaire, c’est trèsdifficile de s’imaginer ça. Ce sont des choses que l’on ne voit pas à la télévision, devraiment ressentir les angoisses véritables des gens là-bas, c’était vraimentintéressant » (Hildegard et Sepp).
24 Ils reviennent ainsi de ce voyage avec des sentiments partagés. D’un côté, leur position
de départ, largement ancrée dans une vision d’un « Nord riche » se devant de partager
avec un « Sud pauvre » en vertu des préceptes de la charité chrétienne qui sont les
leurs, est confortée tant ils ont été choqués par la pauvreté. Mais cette vision est en
même temps remise en doute par ce séjour au cours duquel, expliquent-ils, ils ont été
très impressionnés par la manière dont les villageois auxquels ils ont rendu visite
surmontent ces situations difficiles et souhaitent traiter d’égal à égal avec leurs
visiteurs. Ce séjour achève alors de transformer leur manière d’envisager l’activité
d’aide : jusque-là action « que chacun doit faire » (Hildegard) mais qui reste
relativement abstraite, elle devient une relation avec des êtres humains spécifiques
avec lesquels ils ont échangé :
« Et quand tu vois leurs trois enfants et leurs minuscules possessions, c’est vraimenttrès bouleversant, et cependant, cela te donne le sentiment que maintenant tuconnais les gens [...]. Mais ces liens nous les avons maintenant dans nos cœurs, sibien que maintenant je peux me représenter ces gens, et quand nous allons àl’église le dimanche, ils vont aussi à l’église. Et chacun pense à l’autre, c’est devenuun magnifique et solide lien pour moi. Et maintenant je connais de manièrebeaucoup plus intense les raisons qui nous font faire ce que l’on fait, parce que [...]les années précédentes étaient très dures, et le contact avec Madagascar a souventété marqué par les difficultés, et pour moi, ce n’était pas toujours facile de motiverles autres, [...] j’ai aussi eu des périodes où je me sentais déprimée [...] [mais]maintenant je suis plutôt dans une période où je dis que je peux aussi être faible, je
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
198
sais qu’il y a quelqu’un qui porte le fardeau avec moi, et c’est bien que ce soitmaintenant devenu un réseau de personnes » (Hildegard).
25 Plus pragmatiquement, c’est également un moyen pour eux de découvrir les conditions
de vie sur place et ainsi de mieux saisir le travail de leurs partenaires et de « mieux
comprendre pourquoi certaines choses ne peuvent pas être atteintes si facilement »
(S.).
26 Ainsi l’expérience du voyage reproduit-elle, mais sous une autre forme et en la
renforçant, celle de la rencontre avec les musiciens : elle permet de personnaliser les
êtres et les lieux auxquels sont destinées leurs activités caritatives, donnant ainsi un
visage et un but plus palpable à leur implication, et consolidant de ce fait leur
engagement.
Du développement au tourisme via la musique, puis retour à l'aide au
développement : l'histoire de Heribert et l'association WelthausLinz
27 Depuis de longues années, H. travaille à plein temps dans la branche locale de
l’organisation catholique Welthaus de la ville autrichienne de Linz30. Les buts de cette
organisation sont à la fois d’aider des communautés en difficulté dans « le Tiers-Monde
et l’Europe de l’Est et du Sud »31 en privilégiant le développement de l’éducation, et
d’attirer l’attention des Autrichiens sur ces problèmes par différents moyens afin de
récolter des fonds pour les divers projets financés par la Welthaus. Le lobby est un de
ces moyens, l’organisation de représentations données par des personnes venant elles-
mêmes des régions « à aider » (manifestations intitulées Begegnungen mit Gasten,
Rencontres avec des invités32) et de concerts par des artistes de ces régions, en est un
autre :
« On a remarqué que les contacts directs laissent une impression bien plus profondeque si c’est l’un de nous qui parle de la situation dans le pays [...]. Via la musique etle théâtre on touche de nombreux sens [...] ça ouvre les cœurs. [...] Dans le sensd’une compréhension holistique, d’une compréhension globale, cela devientévident que là tu as un effet beaucoup plus grand que si c’était moi qui faisaisn’importe quelle présentation » (Heribert, Linz, Septembre 2007).
28 Lorsque H. rencontre les membres du groupe malgache Mahaleo en 1997, il est
immédiatement séduit par la dimension artistique de leur travail, mais aussi par leur
engagement social, environnemental et politique dans leur propre pays. Cette
rencontre se fait par l’intermédiaire d’une autre branche de la Welthaus, celle de la
ville autrichienne de Graz, avec laquelle les Mahaleo avaient déjà développé des projets.
H. entraîne alors les musiciens dans une succession de représentations dans les églises
et les écoles des environs. Puis c’est à nouveau le renforcement de la dimension sociale
de la relation qui semble agir comme pivot : se retrouvant un soir tard après l’un des
concerts, H. et les musiciens mettent au point une plus grande tournée en Autriche
pour l’année suivante33, et répètent l’expérience en 2000. La nature des activités
menées ensemble se transforme ensuite peu à peu :
« Pendant les premières années, nous collaborions uniquement à travers la musiqueet la culture, parce que les Mahaleo insistaient sur le fait que leur but premier étaitd’établir une globalisation de l’amitié et que l’amitié doit fonctionner sans argent etsans dépendance. Cependant après quelques temps nous avons suggéré que puisquenous sommes une organisation qui finance des projets, s’ils voulaient proposer desprojets nous serions très heureux de les évaluer. Et c’est comme ça que petit à petit
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
199
nous avons fini par faire du travail de développement dans des projets dedéveloppement avec eux » (H.).
29 Ainsi, alors qu’à cette époque, la Welthaus-Linz n’a pas de lien avec Madagascar, car
d’autres pays sont considérés comme « prioritaires » (selon la terminologie de la
Welthaus), cette rencontre avec les Mahaleo change le regard de H. Il suit alors les
suggestions de l’un des musiciens, Raoul, et finance divers projets dans un village de la
région de Tomasinoa (côte est de Madagascar) où celui-ci vit et exerce en tant que
médecin. Raoul articule ainsi la participation d’H. aux différentes étapes de son propre
engagement auprès de la population du village :
« À 5 ou 6 km de Tamatave [Tomasinoa] j’ai acheté un terrain [...] je commençais àdéfricher et puis il y a les paysans qui viennent petit à petit me voir [...] pour medemander beaucoup de choses. [...] ils ont une volonté de se développer. Et puis moije leur ai dit d’abord, il faut que vous vous organisiez entre vous. [...] Donc ils ontpensé de créer un centre pour se rencontrer. Et lorsqu’on était en Autriche on aproposé le projet à Heribert et tout de suite ils ont dit bon, il faut faire le projetchiffré [...], et l’aventure a commencé là-dessus. [...] On a construit un centre, unemaison communautaire où les gens peuvent se réunir, organiser une fête et tout ça.[...] Et on a construit aussi un petit centre médical, qui est tenu par une fille duvillage que j’ai formée pendant 4 ans à Tamatave à mon cabinet. [...] Elle est capablede faire des sutures, des accouchements et tout ça. [...] Et on a construit une écolemaintenant, pour les enfants, pour pouvoir libérer les femmes pour les travaux deschamps »34.
30 Finalement, ce n’est qu’au milieu des années 2000 que H. se rend à Madagascar. Il part
avec un autre membre de la Welthaus-Linz pour visiter l’un des projets exploratoires
financé par l’association et revoir les membres de Mahaleo. Il y visite également de
nombreux programmes locaux de développement, ainsi que les projets d’une autre
association autrichienne, l’association Baobab dont il a été question dans le récit
précédent. Ces multiples visites lui permettent ainsi de découvrir les solutions choisies
par les uns et les autres35, créant ainsi un réseau entre différentes ONG. Ce séjour
l’enchante. Son regard constitue donc une opposition très nette avec la perception de S.
et H. présentée ci-dessus. Pour autant, l’un des résultats de ce séjour est similaire en ce
sens qu’il contribue à renforcer l’implication de H., et de ce fait celle de la Welthaus-
Linz, dans son travail d’aide. En effet, de retour en Autriche, il décide de faire de
Madagascar l’un de leurs « pays prioritaires », et la principale destination des travaux
de développement menés par l’association.
Soutiens et bénéfices mutuels : vers un rééquilibragesymbolique et pratique des relations Sud/Nord ?
31 Les trois parcours qui précèdent, quoique distincts dans leur déroulement, aboutissent
tous à la mise en place d’une médiation entre les associations caritatives et les besoins
des populations malgaches que ces dernières souhaitent aider, le rôle de médiateur
étant pris en charge par des artistes rencontrés en Europe par certains membres de
l’association. Discussions informelles et entretiens avec artistes et « développeurs »
laissent apparaître le sentiment qu’une telle collaboration les satisfait et leur semble
efficace sur le terrain, même si certaines difficultés surviennent parfois, nous y
reviendrons. Parler ici d’« efficacité » ne renvoie donc pas, comme cela a été dit en
introduction, à une évaluation pratique, dans les villages, des activités de
développement menées par les différentes associations. Il s’agit en revanche de rendre
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
200
compte de deux autres types d’évaluation. D’une part, la perception de deux catégories
d’acteurs (les artistes et les membres des ONG) et, d’autre part, le fait que ces
associations non seulement se maintiennent à Madagascar au fil des années, ayant ainsi
acquis une certaine viabilité, contrairement à de nombreuses structures qui ne durent
que le temps d’un projet, mais en plus se développent, obtenant davantage de
ressources et s’impliquant toujours plus dans divers projets locaux. Il s’agira donc ici, à
travers les récits faits par les « développeurs » et certains entretiens menés avec les
artistes, d’analyser les différents mécanismes, symboliques ou pratiques, qui semblent
concourir à cette « efficacité ».
Plaisir artistique et engagement social
32 Si les rencontres entre musiciens et membres des associations étudiées surviennent à
des moments différents dans les trajectoires des individus, dans les trois cas la
combinaison « plaisir artistique ressenti » plus « mise en place de liens
interpersonnels » plus « intérêt pour l’engagement préalable des artistes dans des
questions sociales, environnementales et/ou politiques » est récurrente. Elle forme le
point de départ et le point d’ancrage de cette relation entre musicien(s) et membres des
associations caritatives.
33 Au fil des entretiens et des observations de terrain, il apparaît que le plaisir artistique
et émotionnel ressenti à l’audition de cette musique est l’un des premiers déclencheurs
d’un désir de renouveler les rencontres. Même si nous ne partageons pas l’idée selon
laquelle « la musique est un langage universel » (Campbell 1997) — celle-ci étant au
contraire en large partie culturellement et socialement construite — et encore moins
l’adage disant que « la musique adoucit les mœurs », il n’en demeure pas moins que l’on
puisse effectivement ressentir beaucoup de plaisir à la première écoute d’un style de
musique totalement inconnu. À cela s’ajoute le lien particulier qui se construit entre
émotion musicale et lieu auquel on associe certains répertoires musicaux, lien analysé
par S. Cohen (1997 : 77-78) : « Music’s peculiar ability to affect or articulate mood and
atmosphere, and consequently to trigger the imagination, contributes to people’s
experiences of places and attitudes toward them, and this occurs in a multitude of
different ways and contexts. [...] [Music is a] particularly precious resource in the
social, sensual and symbolic production of place and local subjectivity. »
34 Ainsi, c’est d’abord par l’intermédiaire de leur activité artistique que les musiciens
malgaches jouent un rôle important dans la (re)formulation de l’imaginaire
qu’entretiennent les « développeurs » européens vis-à-vis de Madagascar. En
introduisant cette dimension de plaisir, ils se dégagent, au moins temporairement, du
carcan que charrient les représentations de misère et de pauvreté le plus souvent
associées à « l’Afrique » en général et à Madagascar en particulier (Street 1994). En
contrepartie ils contribuent, en partie du moins et sans que cela soit le fruit d’une
volonté de leur part, à l’élaboration d’une image exotisante et rassurante de ce pays36.
En déclenchant de manière plus émotionnelle un intérêt pour Madagascar et sa
population, les musiciens participent donc activement à la relation subjective
qu’entretiennent les membres des associations caritatives vis-à-vis de « leur terrain ».
En ce sens, c’est bien le fait qu’ils soient musiciens, et non pas simplement malgaches,
qui est à l’œuvre ici.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
201
35 À cette dimension de plaisir artistique s’ajoute celle d’un plaisir social, plaisir « d’être
ensemble », formule trop vague mais à laquelle renvoie cette référence, récurrente
dans les trois récits, à un moment-clé où artistes et membres d’une association se
retrouvent dans une situation de socialisation qui leur permet de se rencontrer sur un
terrain plus personnel (boire un verre après le concert ; inviter les musiciens « à la
maison »). Dans les trois cas, ce moment est vécu comme déclencheur car il permet de
basculer dans la sphère du privé et d’envisager la relation sur un plan interpersonnel.
36 Finalement, l’implication de ces individus « tellement au courant de la pauvreté dans
leur propre pays et qui essaient de s’en occuper, et de régler ces problèmes avec de
nouvelles méthodes » (Hildegard) est également un facteur déclencheur. Cette
dimension d’engagement social des artistes touche d’autant plus la corde sensible des
« développeurs » qu’elle les renvoie à l’image positive qu’ils ont — ou souhaitent avoir
— d’eux-mêmes et à leur volonté de « faire le bien ». S. Goedefroit (2007 : 53) souligne
cette importance d’un engagement commun lorsqu’elle analyse les relations qui se
mettent en place entre villageois se proposant de représenter la communauté
villageoise et ONG ou médiateurs extérieurs : « C’est sans doute là que se produit “la”
véritable rencontre entre les “étrangers” (travaillant dans le cadre d’une ONG) et ceux
qui, perçus également comme “étrangers” au sein de leur village de résidence, voient
dans ce rendez-vous un moyen, d’une part, d’être reconnus comme représentants d’une
communauté qui tarde à les reconnaître et, d’autre part de faire “évoluer” les choses. »
37 Sur ce point, je pense que les expressions habituellement employées pour qualifier ce
comportement (« courtage », « comportements adaptatifs », « effets pervers ») ne
recouvrent qu’imparfaitement la complexité de la réalité. Ce n’est pas forcément par
intérêt personnel, mais aussi par engagement, que certains revêtent, de manière
opportune, des habits de courtiers. Qu’ils soient bénévoles d’ONG, « facilitateurs » ou
encore « médiateurs environnementaux », appointés par un projet de transfert de
gestion de la biodiversité, ou encore laissés-pour-compte dans le village où ils vivent,
tous sont mus par un engagement qui les fait se rejoindre.
38 La combinaison de ces trois facteurs (plaisir émotionnel, lien social et engagement
commun) contribue alors à développer un intérêt réciproque entre ces deux groupes
d’acteurs, et constitue un terreau fertile pour la construction d’une relation qui est
perçue comme égalitaire, car basée sur des échanges marqués par une curiosité, un
dialogue et un respect réciproques pour les activités et les engagements des uns et des
autres. De plus, cet intérêt pour des êtres humains désormais « personnalisés », avec
lesquels se sont tissés des liens affectifs, et non plus pour « des Malgaches » d’un côté et
« des Européens » ou « des développeurs » de l’autre, s’étend aux proches des uns et des
autres et permet finalement à chacun d’entrer dans l’intimité du pays de l’autre par un
canal complètement différent de celui qui avait été emprunté jusque-là — à savoir la
dimension bureaucratique des associations humanitaires et caritatives. Cette
personnalisation participe en outre de la construction d’un regard différent sur les
« richesses » de
39 Madagascar qu’ont à cœur de promouvoir certains des artistes37, souhaitant déplacer
l’accent mis en général sur la diversité biologique de l’île38 pour le placer sur celle de la
diversité humaine.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
202
Tourisme et pratiques culturelles : déclencher,alimenter et transformer le parcours des« développeurs »
40 Dans les trois situations analysées ici, la rencontre avec Madagascar a d’abord été
fortuite, le pays ne faisant pas partie des « priorités » des individus ou des différentes
associations. Mais une fois que cette rencontre a lieu, Madagascar devient le cœur de
leurs occupations qui se réarticulent alors en une activité mixte, « à facettes multiples »
(Larsen, Urry & Axhausen 2006), associant tourisme et visite de projets :
« Pour le moment, nous prévoyons un voyage à Madagascar — une partie pour dutravail sur les projets, et l’autre partie avec toute la famille pour leur montrer lesbeautés de Madagascar et pour rencontrer nos amis malgaches » (Heribert, e-mail àU. H. M., février 2008).
41 Le tourisme devient donc partie intégrante du travail des ONG en s’insérant dans un
cycle d’activités et de développement de réseaux. Le travail sur des projets entraîne de
nouvelles visites (où cohabitent tourisme et développement) à Madagascar ; ces visites
donnent à leur tour naissance à de nouveaux projets, permettent d’élargir le cercle de
connaissances des membres des ONG, et suscitent éventuellement la participation de
nouveaux individus ou groupes de soutien. En parallèle, les concerts donnés en Europe
éveillent de nouveaux désirs de tourisme vers Madagascar, ce qui, dans un certain
nombre de cas, mène à son tour à la participation de ces touristes aux activités des
associations, à de nouveaux projets de développement, et ainsi de suite.
42 Par ailleurs, dans certaines trajectoires étudiées ici, un phénomène intéressant survient
lors du séjour touristique effectué, phénomène qui correspond à ce que Bruner (2005 :
24) analyse comme la transformation d’un « preexisting tourist tale from an abstract
text into an embodied narrative, a somatic experience ». Bruner (ibid. : 23 et sq.)
s’intéresse en effet à ce qu’il nomme les récits et narrations touristiques (touristic tales,
touristic narratives) et analyse la manière dont ceux-ci évoluent d’une version
« prévoyage » fondée sur un certain nombre de présupposés, vers une version
transformée et personnalisée par l’expérience vécue du voyage. Ici, c’est la manière
d’envisager l’activité humanitaire qui constitue la narration et se trouve transformée :
après la rencontre avec des musiciens malgaches, c’est le séjour à Madagascar qui
achève souvent de transformer une activité d’aide envisagée de manière abstraite et
idéologique — « quelque chose que l’on doit faire » (Hildegard) — en une relation
personnalisée, établie avec des êtres humains spécifiques pendant le séjour. Cela
apparaît de façon particulièrement saisissante dans le récit de H. et S. : ce processus de
personnalisation, qui avait débuté avec le tissage d’une relation privilégiée avec Charle
et sa famille, se poursuit dans cette étape fondamentale qu’est le voyage à Madagascar.
Celui-ci leur permet désormais de se représenter vraiment les gens qu’ils aident. En
outre, cette expérience touristique les entraîne dans une première étape de remise en
question de leur vision de ce qu’est cette « aide » en percevant l’importance du contre-
don.
« Il y avait cette femme qui est venue à l’église [...]. Je lui ai donné une petite boîted’allumettes, et j’ai coupé un petit morceau de savon pour elle, et cette femme aalors beaucoup insisté pour qu’on l’accompagne à sa hutte, et là, de ses petitesprovisions de riz, et c’était vraiment sa dernière réserve, elle nous a donné un petitsac de riz. Oh, c’était tellement touchant pour nous [...] tu ne peux même pas
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
203
commencer à comparer ce que nous lui avions donné avec ce qu’elle nous donnait »(H.).
43 De fait, l’importance de ce processus de personnalisation de l’aide a été parfaitement
perçue par de nombreux organismes d’aide humanitaire de par le monde, qui en font le
moteur de leurs programmes de parrainage d’enfants : chaque donneur peut suivre les
« progrès »39 de son « filleul » et, ainsi, « voir réellement la différence qu’il [le donneur]
fait [...] dans les vies des enfants les plus pauvres du monde et de leurs
communautés »40.
Don et contre-don
44 Et justement, l’une des critiques les plus récurrentes faites depuis plusieurs décades
aux divers projets d’aide ou de développement porte sur l’inégalité du processus : les
populations locales ne sont pas envisagées comme des acteurs mais comme de simples
receveurs de ces projets, ce qui les confine dans un rôle passif. Or, comme cela a été
montré par M. Mauss ([19231924]) il y a déjà plus de quatre-vingts ans, sans contre-don,
toute pratique de don instaure un rapport de pouvoir inégal entre les acteurs, plaçant
le receveur qui ne peut rendre dans une position d’infériorité et de dépendance.
45 L’idée a déjà été esquissée dans un paragraphe précédent : si les projets sont perçus
comme « plus efficaces » après l’arrivée des musiciens dans le travail des associations,
ce serait parce que cette arrivée s’est traduite par la mise en place des relations de
dialogue et d’échange entre les différents acteurs. Cette nécessité de transformer les
relations d’aide en relations d’une autre nature est clairement exprimée par Dama
lorsqu’il explique que les Mahaleo « ne désirent pas être aidés » mais veulent
« travailler avec des amis », thème qu’il reprend régulièrement lorsqu’il s’adresse, en
concert, à un public non malgachophone. Il présente alors le concert comme
participant d’une « globalisation de l’amitié »41. Qu’en est-il donc exactement de ces
échanges ?
46 D’un côté, on l’a vu, les musiciens apportent aux ONG leurs compétences de médiateurs.
De part leurs propres expériences, ils sont davantage capables de faire le lien et
l’interface entre les ONG et les habitants des villages où œuvrent ces associations, et le
plus souvent d’établir eux-mêmes des projets en fonction de leur compréhension des
réalités locales. Pour ce faire, ils proposent aux villageois et aux paysans des espaces de
dialogues que ceux- ci — aux dires des artistes et des « développeurs » — investissent
volontiers, lorsqu'ils ne les ont pas eux-mêmes sollicités, comme c'est le cas lorsque des
paysans de Belo viennent trouver Dama avant le concert.
47 En parallèle, la venue des musiciens dans différents lieux (tant à Madagascar qu’en
Europe) ne recevant que rarement des événements culturels de cette envergure, est un
don important pour le public. Et l'apport est encore plus grand si musiciens et public
sont proches et se connaissent personnellement : ainsi les membres des différentes
associations européennes se sentent-ils particulièrement redevables aux musiciens du
moindre concert auquel ils ont la chance d'assister.
48 En outre, concerts et tournées permettent d'attirer l'attention — y compris celle des
médias — sur le travail des ONG, localement mais aussi à un niveau national et
international. Ainsi par exemple, tandis que les habitants de Belo commencent à
considérer avec plus d'intérêt et de respect l'association étrangère installée dans leur
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
204
village depuis plusieurs années parce que celle-ci a réussi le tour de force d’y organiser
un concert de Dama et Ricky, à l’autre bout de la chaîne, I’ONG devient beaucoup plus
séduisante pour les bailleurs de fonds grâce à son partenariat avec des artistes
s’engageant à la fois au Nord et au Sud et encourageant la « participation » de leur
public42. L’engagement des musiciens est donc un atout précieux pour les ONG dans un
contexte où, comme le souligne S. Goedefroit (2007 : 50), « en matière de
développement local, il existe une concurrence importante entre les ONG œuvrant dans
la même région et occupant le même créneau. Ces organisations partagent les mêmes
contraintes (l'urgence, le nombre d'actions à réaliser) et les mêmes ressources
(financements) ». Finalement, et de manière plus générale, le fait que ces ONG soient
ainsi en liens étroits avec des musiciens est ressenti comme un formidable laissez-
passer par les membres de ces associations. Il en va de même dans le cas de E. et de A.
dont les réseaux de connaissances s'élargissent de plus en plus, jusqu'à les mener dans
les salons diplomatiques d’Antananarivo ou de Munich43. Ils rencontrent également
l’ensemble de la communauté malgache installée en Allemagne, dont certains membres
participent désormais aux activités de l’association Freunde Madagaskars. Celle-ci est
de fait devenue peu à peu un point de convergence des activités musicales malgaches à
Munich.
« [...] à travers cette culture, et à travers les concerts ici aussi, ce n’est passeulement que nous sommes devenus beaucoup plus connus à Belo, parce que leconcert à été annoncé par la petite station de radio [locale] et qu’il y a eu uneinterview d’une heure avec Dama et Ricky, mais aussi ici, en Allemagne, on a réussià établir de bien meilleures relations avec la diaspora malgache, parce que des gensviennent de toute l’Allemagne pour les concerts que nous avons organisés. C’est pastous les jours que les Malgaches qui vivent ici ont la chance de rencontrer leurspropres artistes » (Erich).
49 De leur côté, les associations autrichiennes et allemandes offrent en échange leurs
infrastructures et leurs financements pour mener à bien les projets choisis localement.
Ce faisant, ils apportent de l’aide aux villageois, mais également aux musiciens puisque
ces derniers, on l’a vu, sont eux-mêmes engagés dans divers projets.
50 Mais c’est également sur le plan artistique que l’échange est vécu comme très bénéfique
par les musiciens, car ces infrastructures associatives leur fournissent de nouvelles
ouvertures professionnelles en Europe. Outre l’obtention d’un support financier pour
une partie au moins de leurs tournées, elles leur donnent également accès à des
audiences européennes plus larges et à des lieux de concerts différents44. Or, de
manière générale dans ce milieu professionnel, et de manière particulièrement aiguë
pour les artistes malgaches au vu des faibles débouchés professionnels à Madagascar et
de l’infrastructure très limitée de l’industrie musicale malgache, les musiciens doivent
s’intégrer dans des réseaux professionnels internationaux pour pouvoir vivre de leur
musique45. Ces nouveaux points d’entrée les conduisent également à dépasser les
réseaux communautaires malgaches dans lesquels la plupart de leurs spectacles étaient
inscrits jusque-là. Finalement, cette plus large exposition à un public varié les amène à
nouer des contacts avec divers organisateurs qui leur font à leur tour des propositions
de concerts.
51 Au niveau des communautés villageoises enfin, s’il est impossible d’établir ici ce
qu’elles-mêmes estiment retirer des situations étudiées, il est en revanche possible de
regarder ce que les associations considèrent recevoir en contrepartie de leur travail.
D’une part, et nous l’avons déjà évoqué, l’une des monnaies d’échange est la confiance
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
205
que donnent les villageois aux associations lorsqu’ils constatent qu’elles collaborent
avec des artistes malgaches célèbres. Leur seconde forme de contribution correspond à
ce que les différents acteurs du développement souhaitent tout particulièrement : la
connaissance intime qu’ont les villageois de la situation locale et leurs savoir-faire dans
de nombreux domaines. Ainsi, dans les trois cas étudiés ici, la quasi totalité des travaux
sont effectués par les artisans locaux. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres
actions de développement, rares sont les « experts » venus du dehors qui interviennent
dans ces projets. Les associations privilégient également des solutions « low-tech » que
les habitants pourront construire et entretenir eux-mêmes46.
52 Ainsi semblent donc s’être mis en place un certain nombre de rapports de bénéfice
mutuel qui impliquent don et contre-don entre différents types d’intermédiaires ou
groupes d’acteurs (population locale, artistes, membres des associations caritatives
européennes) mettant en jeu plusieurs dimensions (personnelle, artistique,
professionnelle, communicationnelle). Ce faisant, l’élaboration de tels échanges peut
être envisagée comme un moyen d’enrayer en partie au moins le déséquilibre entre
« développeurs » et « développés » en contrecarrant — ou du moins en allégeant — le
problème de l’altruisme, ou du don sans contre-don à ceux que l’on considère comme
« dans le besoin », au nom de certaines règles de morale (charité chrétienne,
humanisme, etc.) qui sous-tendent, au moins implicitement, les sentiments et les
activités des « développeurs ».
*
53 Selon les artistes et les développeurs rencontrés, dans les trois cas étudiés ici — et nous
sommes conscientes de leur degré de spécificité —, l’articulation entre tourisme et
pratique culturelle (musique) semble participer positivement d’une « action entreprise
par des sociétés se construisant ou se reconstruisant avec et à travers le tourisme »
(Doquet & Le Menestrel 2006). L’intérêt mutuel que se portent ces deux catégories
d’acteurs, ainsi que les relations de confiance qui se sont développées entre eux,
donnent aux acteurs le sentiment d’être parvenus à dépasser la plupart des
frustrations, décalages ou « malentendus » (Chabloz 2007) qui prévalaient auparavant
dans leur travail de « développeurs » grâce au dialogue ouvert établi entre les
partenaires. Tout ceci contribue à mettre en place de meilleures bases pour des projets
et des collaborations qui se renouvellent d’année en année. Ainsi l’action des
associations qui a souvent commencé à une très petite échelle grandit peu à peu, le
nombre de projets pris en charge se multiplie et leur durée de vie s’allonge.
54 Cette inscription des projets et des associations dans une perspective plus « durable »
s’ancre en outre dans un processus qui est apparu peu à peu au fil de l’analyse, celui du
développement exponentiel de réseaux qui s’articulent à la fois au niveau du local, du
national et du transnational.
55 Les ONG sont situées dans des réseaux d’inter-connaissance qui se construisent et se
diversifient peu à peu à la fois en Europe et à Madagascar. Les deux associations
autrichiennes sont d’abord directement liées par une histoire et des actions communes
au niveau local, tandis que de leur côté E. et A. participent conjointement aux activités
de plusieurs organisations allemandes. Puis, lorsque les membres de ces différentes
associations voyagent à Madagascar, elles entreprennent de se rendre mutuellement
visite. Rencontrant alors les artistes partenaires locaux de ces projets, des
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
206
« développeurs » qui ne se connaissaient pas en Europe découvrent l’existence d’autres
associations via leur passage à Madagascar.
« J’ai trouvé cela très excitant pendant ce voyage le fait que nous en tantqu’étrangers qui visitions Madagascar pour la première fois, nous étions malgrétout capables de mettre en place des réseaux » (Heribert).
56 Ce type de réseaux est envisagé très positivement par les membres de ces petites
associations car ils y voient un moyen de faire circuler des idées entre les différentes
ONG. Ils constituent une plate-forme d’échange de contacts, d’individus, mais aussi de
savoirs et de solutions techniques qui leur semblent fonctionner dans un contexte
culturel relativement similaire, et qui leur permettent ainsi de ne pas perdre de temps
(et d’argent) dans les mêmes tâtonnements, de ne pas refaire les mêmes erreurs à
chaque nouveau projet, mais au contraire de mutualiser les idées47. Ces réseaux
contribuent ainsi largement à une meilleure compréhension entre les différents
partenaires.
57 D’autre part, un réseau intense de relations entoure depuis plusieurs décades les sept
musiciens de Mahaleo puisque ceux-ci sont ensemble sur scène depuis trente-cinq ans
et avant cela étaient camarades de classe et/ou frères. Ainsi, tandis que chacun est
engagé dans des projets sociaux et/ou environnementaux différents, il leur arrive
fréquemment de travailler ensemble sur des projets ponctuels ou de partager leurs
carnets d’adresses. Ces réseaux combinent donc à la fois des raisons artistiques,
familiales, amicales, professionnelles et idéologiques. Ils ne se concentrent pas
uniquement au niveau local de Antananarivo et de sa région, mais ils s’étendent vers
Antsirabe (où travaille Bekoto), et plus loin encore, vont jusqu’à la côte est dans la
région de Toamasina (où vit Raoul) et à l’Ouest dans la région de Morondava (où se
trouve la ferme-école de Dama). Les réseaux de chacun dépassent également les
frontières de la grande île, à la fois vers l’Autriche et l’Allemagne comme nous l’avons
vu, mais également vers d’autres pays européens ou nord-américains, combinant là
aussi différents niveaux et catégories d’acteurs (monde du développement, milieux
artistiques, liens familiaux). Des réseaux professionnels dans le domaine artistique
prennent également forme en Europe où, après chaque concert ou presque, les
musiciens malgaches rencontrent des organisateurs susceptibles de leur offrir d’autres
dates, ou des membres de l’audience désireux de soutenir leurs projets (Meinhof 2005 :
125-126). La multiplication des réseaux dans lesquels s’inscrivent les différents acteurs
apparaît ainsi à la fois comme l’un des « effets secondaires » des projets de
développement, et comme l’un des moyens qui leur permettent de fonctionner et de se
maintenir. Cette vie sociale propre, qui n’est pas issue des pratiques de développement
stricto sensu mais en est l’un des produits dérivés, nourrit et favorise le déploiement des
projets. Le choix de pénétrer le monde de l’humanitaire et du caritatif à travers l’étude
des « développeurs », du rôle du tourisme et de la rencontre avec des artistes, permet
d’éclairer différemment la situation. Cette étude montre que l’arrivée des musiciens
comme interface entre les « donneurs » du Nord et la population malgache à un niveau
local entraîne la mise en place d’une relation d’échange où tous les individus concernés
deviennent acteurs de la situation. Basées sur des nécessités pratiques et symboliques
« des deux côtés », ces relations se développent de manière plus égalitaire par la
création de réseaux qui lient intrinsèquement « ceux qui aident » venus du Nord et les
musiciens « du Sud » engagés socialement. Ce sont ceux que l’on est « venu aider » et
« développer » qui deviennent ceux qui aident et apportent aux « développeurs », à la
fois par leur musique et leur connaissance fine du contexte culturel, battant ainsi en
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
207
brèche l’idée selon laquelle les richesses se trouvent au Nord et les besoins au Sud. Les
artistes ne jouent donc pas seulement un rôle de médiateurs sur le terrain, mais ils
interviennent aussi malgré eux dans la relation plus émotionnelle et imaginaire que les
« développeurs » entretiennent avec Madagascar. Ainsi, quoique les musiciens
malgaches soient aussi des « Autres », les « développeurs » se sentent proches d’eux sur
de nombreux plans, à la fois parce qu’ils partagent leur engagement et certains de leurs
points de vue, et parce que des liens plus privés se sont tissés entre leurs histoires de
vie, réduisant de ce fait l’altérité représentée par les villageois de Madagascar pour les
membres des associations européennes. Finalement, il semble que cette modification de
leur regard et la remise en question de leurs représentations initiales que traduisent les
discours valorisant l’égalité entre les différents acteurs, permettent ensuite, par
ricochet, de modifier leurs pratiques de développement48. Il serait donc intéressant, à
ce stade, de prolonger ce travail par une étude de terrain dans les villages malgaches où
travaillent ces associations49. Entendre la voix du troisième groupe d’acteurs
apporterait ainsi un nouvel éclairage et permettrait de confronter les discours analysés
ici.
BIBLIOGRAPHIE
ATLANI-DUAULT, L.
2005 « Les ONG à l’heure de la “bonne gouvernance” », Autrepart, 35 (3) : 3-18.
BENSIGNOR, F.
2006 « Desert Rebel : projet artistique et solidaire », Hommes et Migrations, 1264, novembre-
décembre : 135-140.
BERGER, L.
2007 « Les voix des ancêtres et les voies du développement. Les populations de l’Ankarana en
butte à la mondialisation », Études rurales, 178 : 129-160.
BERGERON, F.
2005 Ishumars, les rockers oubliés du désert, documentaire, 95 minutes, France, Original Dub Master.
BICCUM, A.
2007 « Marketing Development: Live 8 and the Production of the Global Citizen », Development and
Change, 38 (6): 111-126.
BLANC-PAMARD, C. & FAUROUX, E.
2004 « L’illusion participative. Exemples ouest-malgaches », Autrepart, 31 : 3-19.
BORET, A., ATTALI, J. & LEROY, J.-P.
2005 « Tourisme et musique, un paradoxe fructueux. La musique est un voyage. Le festival, outil
de développement touristique », Espaces, 222 : 22-28.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
208
BRUNER, E. M.
2005 Culture on Tour. Ethnographies of Travel, Chicago-London, The University Press of Chicago.
CAMPBELL, P. S.
1997 « Music, the Universal Language: Fact or Fallacy? », International Journal of Music Education:
32-39.
CAUVIN VERNER, C.
2007 Au désert. Une anthropologie du tourisme dans le Sud marocain, Paris, L’Harmattan.
CHABLOZ, N.
2007 « Le malentendu. Les rencontres paradoxales du “tourisme solidaire” », Actes de la recherche
en sciences sociales, 170 : 32-47.
CHABOUD, C., MÉRAL, P. & ANDRIANAMBININA, D.
2004 « Le modèle vertueux de l’écotourisme : mythe ou réalité ? L’exemple d’Anakao et Ifaty-
Mangily à Madagascar », Mondes en Développement, 32 (1), 125 : 11-32.
COHEN, E.
2002 « Authenticity, Equity and Sustainability in Tourism », Journal of Sustainable Tourism, 10 (4):
267-276.
COHEN, S.
1997 « More than the Beatles: Popular Music, Tourism and Urban Regeneration », in S. ABRAM, J.
WALDREN & D. V. L. MACLEOD (eds.), Tourists and Tourism. Identifying with People and Places, Oxford-
New York, Berg: 71-89.
DOQUET, A. & LE MENESTREL, S.
2006 « Tourisme culturel, réseaux et recompositions sociales », Autrepart. Revue de sciences sociales
au Sud, 40 : 3-13.
ESCOBAR, A.
1991 « Anthropology and the Development Encounter », American Ethnologist, 18 (4) : 658-82.
ETHNOLOGIE FRANÇAISE
2002 « Touristes, Autochtones : qui est l’étranger ? », 32 (3).
GARDNER, K. & LEWIS, D.
1996 Anthropology, Development and the Post-modern Challenge, London, Pluto Press.
GIBSON, C.
2002 « Rural Transformation and Cultural industries: Popular Music on the New South Wales Far
North Coast », Australian Geographical Studies, 40 (3): 337-356.
GIBSON, C. & CONNELL J.
2005 Music and Tourism: On the Road Again, Clevedon, Channel View Publications.
GILMAN, L. & FENN, J.
2006 « Dance, Gender, and Popular Music in Malawi: the Case of Rap and Raga », Popular Music, 25
(3): 369-381.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
209
GOEDEFROIT, S.
2007 « La restitution du droit à la parole », Études rurales, 178 : 39-63.
GOEDEFROIT, S. & REVÉRET, J.-P.
2007 « Quel développement à Madagascar ? Introduction », Études rurales, 178 : 9-21.
GRÉGOIRE, E.
2006 « Tourisme culturel, engagement politique et actions humanitaires dans la région d’Agadès
(Niger) », Autrepart, 40 : 95-111.
GRILLO, R. D. & STIRRAT, R. L. (eds.)
1997 Discourses of Development. Anthropological Perspectives, Oxford-New York, Berg.
HÉRODOTE. REVUE DE GÉOGRAPHIE ET DE GÉOPOLITIQUE
2007 « Géopolitique du tourisme », 127, 4e trimestre.
DE KADT, E.
1979 Tourism : Passport to Development? New York, Oxford University Press. (Version française :
Tourisme. Passeport pour le développement ? Paris, Banque Mondiale et Unesco, 1979).
KAEPPLER, A. & LEWIN, O.
1986 « Fourth International Colloqium “Traditional Music and Tourism”. Held at Kingston, and
Newcastle, Jamaica, July 10-14, 1986 », Yearbook for Traditional Music, 18: 211-212.
KAUFMANN, G.
1997 « Watching the Developers: A partial Ethnography », in R. D. GRILLO & R. L. STIRRAT (eds.),
op. cit.: 107-131.
LARSEN, J., URRY, J. & AXHAUSEN, K.
2006 Mobilities, Networks, Geographies, Aldershot, Ashgate.
MALLET, J.
2002a « Histoires de vie, histoire d’une vie : Damily, musicien de “tsapik”, troubadour des temps
modernes », Cahiers de musiques traditionnelles, 15 : 113-132.
2002b « “World Music”. Une question d’ethnomusicologie ? », Cahiers d’Études africaines, XLII (4),
168 : 831-852.
2004 « Liens sociaux et rapports ville/campagne. Analyse d’une pratique musicale du Sud de
Madagascar », Kabaro, Diversité et spécificités des musiques traditionnelles de l’Océan Indien, II (2-3) :
155-167.
2007 « Industrie du disque, musiques africaines et naissance du tsapiky, “jeune musique” de
Tulear (Sud-Ouest de Madagascar) », in D. NATIVEL & V. RAJAONAH (eds.), Madagascar et l’Afrique :
Entre identité insulaire et appartenances historiques, Paris, Karthala : 469-481.
MAUSS, M.
1997 [1923-1924] « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques », in
M. MAUSS (dir.), Sociologie et Anthropologie, Paris, PUF : 143-280.
MEINHOF, U. H.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
210
2005 « Initiating a Public: Malagasy Music and Live Audiences in Differentiated Cultural
Contexts », in S. LIVINGSTONE (ed.), Audiences and Publics: When Cultural Engagement Matters for the
Public Sphere, Bristol-Portland, OR, Intellect: 115-138.
MEINHOF, U. H. & RASOLOFONDRAOSOLO, Z.
2005 « Malagasy Song-Writer Musicians in Transnational Settings », Moving Worlds, 5 (1): 144-158.
MEINHOF, U. H. & TRIANDAFYLLIDOU, A.
2006 « Beyond the Diaspora: Transnational Practices as Transcultural Capital », in U. H. MEINHOF &
A. TRIANDAFYLLIDOU (eds.), Transcultural Europe. Cultural Policy in a Changing Europe, Basingstoke,
Palgrave: 200-222.
MICHAUD, J.
2001 « Anthropologie, tourisme et sociétés locales au fil des textes », Anthropologie et Sociétés, 25
(2) : 15-33.
MOWFORTH, M. & MUNT, I.
1998 Tourism and Sustainability. New Tourism in the Third World, London-New York, Routledge.
PAES, M.-C. & RAJAONARIVELO, R.
2005 Mahaleo, documentaire, 102 minutes, France, Laterit Productions.
PARDUE, D.
2004 « Putting Mano to Music : The Mediation of Race in Brazilian Rap », Ethnomusicology Forum,
13 (2): 253-286.
PICARD, M. & MICHAUD, J.
2001 « Tourisme et sociétés locales », Anthropologie et société, 25 (2) : 5-13.
POTTIER, J.
2003 « Negociating Local Knowledge: An Introduction », in J. POTTIER, A. BICKER & P. SILLITOE (eds.),
Negotiating Local Knowledge. Power and Identity in Development, London, Pluto Press : 1-29.
POTTIER, J., BICKER, A. & SILLITOE, P. (eds.)
2003 Negotiating Local Knowledge. Power and Identity in Development, London, Pluto Press.
RAOUT, J.
2006 « Mondialisation musicale et tourisme : le cas de la Guinée (Conakry) et du Maroc », in H.
MILIANI & L. OBADIA (dir.), Art et transculturalité au Maghreb, Paris, éditions des archives
contemporaines : 77-84.
RASOLOFONDRAOSOLO, Z. & MEINHOF, U. H.
2003 « Popular Malagasy Music and the Construction of Cultural Identities », AILA Review, 16:
127-148.
RÉAU, B. & POUPEAU, F.
2007 « L’enchantement du monde touristique », Actes de la recherche en sciences sociales, 170 : 4-13.
ROTH, S.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
211
2007 « Getting Involved in Humanitarian Aid. Biographies and Transnational Careers of
Humanitarian Aid Workers », Conference paper for the 102nd Annual Meetings of the American
Sociological Association, 11-14 August, New York.
SALDANHA, A.
2002 « Identity, Spatiality and Post-colonial Resistance: Geographies of the Tourism Critique in
Goa », Current Issues in Tourism, 5 (2): 94-111.
SARRASIN, B.
2005 « Environnement, développement et tourisme à Madagascar : Quelques enjeux politiques »,
Loisirs et Société/Society and Leisure, 28 (1) : 163-183.
2007 « Géopolitique du tourisme à Madagascar : de la protection de l’environnement au
développement économique », Hérodote. Revue de géographie et de géopolitique, 127, 4e trimestre :
124-150.
SIMÉANT, J.
2001 « Entrer, rester en humanitaire : des fondateurs de MSF aux membres actuels des ONG
médicales françaises », Revue Française de Science Politique, février-avril, 55 (1-2) : 47-72.
SMITH, M. K.
2003 Issues in Cultural Tourism Studies, London-New York, Routledge.
STREET, B.
1994 « The International Dimension », in U. H. MEINHOF & K. RICHARDSON (eds.), Text, Discourse and
Context: Representations of Poverty in Britain, London- New York, Longman: 47-66.
URRY, J.
1990 The Tourist Gaze, London-Thousand Oaks-New Delhi, Sage Publications.
WOOST, M. D.
1997 « Alternative Vocabularies of Development? “Community” and “Participation” in
Development Discourse in Sri Lanka », in R. D. GRILLO & R. L. STIRRAT (eds.), op. cit.: 229-253.
ZUNIGO, X.
2007 « “Visiter les pauvres”. Sur les ambiguïtés d’une pratique humanitaire et caritative à
Calcutta », Actes de la recherche en sciences sociales, 170 : 102-107.
ZYSBERG, C.
2004 « Le tourisme solidaire et responsable, c’est du tourisme », Espaces, 220 : 18-19.
NOTES
1. La littérature critique portant sur les actions de développement est immense. Pour trois étapes
de la réflexion, voir par exemple ESCOBAR (1991), GOEDEFROIT & REVÉRET (2007), GRILLO & STIRRAT
(1997).
2. Les Participatory Poverty Assessments (PPAS) sont ainsi mis en place par la Banque Mondiale
et le FMI au milieu des années 1990 (POTTIER 2003 : 24-25). Voir notamment POTTIER ET AL. (2003)
sur le rôle de(s) « savoir(s) local(aux) » dans les actions de développement.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
212
3. Ou encore « tourisme responsable », « solidaire », « équitable », « alternatif », etc. Certains
auteurs emploient chacun de ces termes dans une perspective différente (ZYSBERG 2004 : 19),
d’autres les envisagent au contraire comme pouvant être utilisés comme des synonymes (CHABLOZ
2007 : 33). C’est cette seconde position que nous adopterons dans le présent article. Voir
également E. COHEN (2002) pour un bilan sur ce rapport entre tourisme et « sustainability » ».
4. L’ensemble du projet TNMundi est effectué grâce au financement du Arts and Humanities
Research Council (Royaume-Uni) que nous tenons à remercier ici. Nos remerciements vont
également à Sébastien Lodeiro, Dama, Laurent Berger, Natacha Borrel et les évaluateurs
anonymes pour leurs remarques extrêmement constructives.
5. Nous adopterons ici la position de G ARDNER & LEWIS (1996 : 2) concernant le terme
« développement » : étant lui même porteur des connotations « évolutionnistes » que l’on
cherche à éviter, il nous est pourtant nécessaire de l’employer si l’on veut justement analyser ces
pratiques et relations puisqu’il est de fait « un ensemble de pratiques et de relations » où
agences, programmes de développement ou travailleurs sont des « entités objectives ».
6. Dans cet article, nous utiliserons les termes « ONG » et « association caritative et/ou
humanitaire » comme synonymes. L’expression « pratiques caritatives et humanitaires » sera
envisagée au sens large, englobant à la fois les grosses structures institutionnelles (de type ONU
ou Banque Mondiale) et les actions de coopérations organisées en petites structures
indépendantes. C’est toutefois de ces dernières qu’il sera plus particulièrement question dans les
cas présentés en détail ici.
7. Quoique pas toujours explicitement envisagée dans une perspective maussienne, et donc en
termes de rupture du cycle de don et contre-don (MAUSS 1997), cette construction d’une inégalité
entre donneurs et receveurs tient une grande place dans la littérature critique des pratiques de
développement. Nous y reviendrons.
8. Le thème du tourisme était ainsi au cœur du 4 e colloque de l’International Council of
Traditional Music (ICTM) il y a plus de vingt ans (KAEPPLER & LEWIN 1986), et il vient à nouveau
d’être choisi pour le 25th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology. Pour autant,
le tourisme lui-même a mis longtemps à s’imposer en anthropologie sociale et sociologie comme
sujet d’étude « sérieux », et peut-être davantage encore dans l’espace francophone comme le
rappellent souvent les éditeurs de divers numéros spéciaux parus récemment (PICARD & MICHAUD
2001 ; DOQUET & LE MENESTREL 2006 ; RÉAU & POUPEAU 2007).
9. Depuis les premières conclusions du rapport rendu par DE KADT (1979) jusqu’à aujourd’hui, et
concernant des lieux extrêmement divers : du Royaume-Uni (COHEN 1997) à Bali (BRUNER 2005) en
passant par Goa (SALDANHA 2002) ou certaines régions rurales de l’Australie (GIBSON 2002 ; GIBSON &
CONNELL 2005).
10. Sur cet intérêt des grands organismes de développement pour l’activité touristique dès les
années 1960, voir MICHAUD (2001 : 15).
11. C’est le cas notamment de l’une des ONG présente à Madagascar et étudiée dans le cadre de
notre recherche, Azafady, <http://www.azafady.org/>. Ce type de financement se lit également
en filigrane dans de nombreux articles sans pour autant être traité directement ; voir par
exemple GILMAN & FENN (2006) ou PARDUE (2004).
12. On pensera ainsi aux nombreux musiciens et chanteurs sollicités par les organismes d’aide au
développement tel que l’Unesco ou la Banque Mondiale. Un exemple parmi tant d’autres est celui
d’une dizaine d’artistes africains célèbres (et parmi eux le musicien malgache Jaojoby)
enregistrant We are the Drums (2004) dans le cadre d’un des projets destinés à atteindre les « UN
Millennium Development Goals ». Une autre forme de cette imbrication entre musique,
engagement politique et ONG est celle que l’on retrouve dans le travail de l’ONG britannique
Sandblast, <http://www.sandblast-arts.org> avec le groupe saharawi Tiris, ou encore du projet
Desert Rebel, <http://desertrebel.com> auquel F. BENSIGNOR (2006) a dernièrement consacré un
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
213
article et F. BERGERON (2005) un film documentaire. De manière différente, et souvent contestée,
citons les concerts multisites du Live 8, organisés par Bob Geldof en collaboration avec le
mouvement Global Call to Action Against Poverty. À ce sujet, voir l’article de BICCUM (2007 : 111)
qui envisage ce spectacle du Live 8 comme une « popularisation du développement » largement
prise en charge par l’État britannique.
13. Un certain nombre de travaux récents se penchent sur les relations entre touristes et
populations locales : CHABLOZ (2007) analyse les décalages ou « malentendus » qui persistent entre
chacun ; BRUNER (2005) développe la notion de « touristic borderzone » ; CAUVIN VERNER (2007)
s’intéresse aux imaginaires réciproques et aux stratégies — calculées ou non — de
repositionnement qui ont lieu dans ces interactions ; ou encore MOWFORTH & MUNT (1998).
14. Sur la différence entre volontariat et bénévolat, voir SIMÉANT (2001) et ZUNIGO (2007).
15. C’est le cas par exemple dans CHABLOZ (2007 : 47), ROTH (2007 : 8) et SIMÉANT (2001 : 49). Pour
des travaux analysant plus particulièrement les trajectoires de divers membres d’organismes
humanitaires, voir KAUFMANN (1997), ROTH (2007), SIMÉANT (2001), ainsi que le chapitre 5 de
MOWFORTH & MUNT (1998).
16. L’article de ZUNIGO (2007) montre bien cette possible superposition entre tourisme et pratique
humanitaire et caritative, non pas dans la perspective habituelle des travaux portant sur le
tourisme solidaire mais en étudiant les ambiguïtés qui entourent la pratique du volontariat.
17. Le « terrain » ethnographique n’est donc pas ici à envisager en termes de lieu, mais
d’individus que l’on suit au fil de leurs activités, de leurs déplacements et de leurs rencontres.
18. Dans leur introduction au récent numéro de la revue Autrepart intitulé « Tourisme culturel,
réseaux et recompositions sociales » DOQUET et LE MENESTREL (2006) déploraient le manque
d’études empiriques qui dépassent le cadre avant tout local des travaux portant sur le tourisme,
alors même qu’elles étaient convaincues de l’existence de réseaux beaucoup plus larges.
19. Retraités tous les deux depuis quelques années à peine. Erich est titulaire d’un master de
sociologie et a mené pendant trente ans des recherches sur la jeunesse au sein du German Youth
Institute de Munich. De son côté, Anne fut longtemps directrice d’un large centre comprenant
plusieurs jardins d’enfants et garderies.
20. Sauf indication contraire, les entretiens retranscrits ici ont été menés en allemand (ou
dialecte autrichien de la région de Altmünster dans le cas de H. et S.) par Ulrike H. Meinhof, puis
traduits en français par les auteurs pour les besoins de cette publication.
21. <http://www.dmve.de>.
22. <http://www.freunde-madagaskars.de>.
23. Leur participation à cette association est devenue de plus en plus centrale au fil des années, à
tel point qu’Erich en est aujourd’hui le président.
24. Dama est l’un des sept membres d’un des groupes les plus connus à Madagascar, Mahaleo,
créé en 1972 lors des mouvements de protestation populaire qui secouent Madagascar et mènent
finalement au renversement du gouvernement néo-colonial. De cet engagement politique dans
les années 1970 découle la direction prise jusqu’à aujourd’hui par chacun des musiciens dans
divers engagements sociaux, environnementaux et/ou politiques. Dama (chant, guitare et
harmonica) est socio-
25. logue et agriculteur de formation. Il a créé une ferme dans la région côtière de Morondava
dans laquelle il développe et transmet de nouvelles méthodes d’agriculture biologique ; il a
également été membre du Parlement malgache à deux reprises (candidat indépendant). Bekoto
(chant et guitare) est sociologue de formation, il travaille en particulier pour la défense des droits
des paysans au sein de l’association malgache IREDEC (Institut de recherche et d’application des
méthodes de développement communautaire). Fafah est chanteur à temps plein, mais il lutte
également pour la réhabilitation des quartiers les plus pauvres d’Antananarivo. Nono (chant et
guitare basse) est chirurgien. Dadah (chant et guitare) est également chirurgien. Nous
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
214
reviendrons plus loin dans cet article sur Charle (batterie) dirigeant de la CICAFFE, et Raoul
(chant et guitare), médecin et frère de Dama. Sur le groupe Mahaleo, voir <http://
www.mahaleo.com>, ainsi que MEINHOF (2005 : 121 et sq.).
Pour une présentation du projet, voir <http://www.myspace.com/voajanahari>.
26. À tel point qu’ils sont désormais reçus pour diverses cérémonies du corps diplomatique
allemand à Madagascar et malgache en Allemagne.
27. Expression régulièrement utilisée par les artistes malgaches désireux d’utiliser leur art pour
faire découvrir l’existence même de ce pays à un public non malgache.
28. <http://www.verein-baobab.at/>.
29. Pour un bref aperçu du travail mené par Charle et la CICAFE à Madagascar, ainsi que sur
l’engagement social et politique des autres membres du groupe Mahaleo en général, voir le film
Mahaleo de PAES & RAJAONARIVELO (2005).
30. La Welthaus regroupe sept organisations dont les buts sont communs, mais les différentes
branches disposent d’une large autonomie dans la définition de leurs priorités et de leurs
activités, <www.welthaus.at>. Pour la branche de Linz, voir <http://www.dioezese-linz.at/
pastoralamt/wekef/>.
31. Selon la terminologie de la Welthaus.
32. Pour une description de ces Begegnungen mit Gästen, voir <www.welthaus.at>.
33. Tournée à l’occasion de laquelle ils travaillent avec H. et S., ce qui mènera à la création de
l’association Baobab dont il a été question dans le récit précédent.
34. Entretien avec Raoul et Dama des Mahaleo, mené en français par Ulrike Meinhof et Marie-
Pierre Gibert.
35. En particulier en termes d’équipement faiblement technologique.
36. Sur ce lien entretenu par les publics occidentaux avec la dite « world music », à grand renfort
d’imaginaire et le plus souvent sans aucune contextualisation, voir MEINHOF (2005), RAOUT (2006)
et MALLET (2002 b).
37. Dama et Ricky, discussions informelles. Voir aussi le texte de présentation du projet
Voajanahari.
38. Concernant la prédominance des discours sur l’environnement et la biodiversité dans le
déploiement de politiques de développement à Madagascar, et leur exploitation pour promouvoir
le tourisme, voir SARRASIN (2005).
39. <https://www.worldvision.ca/Sponsor-a-Child/Pages/HowitWorks.aspx>.
40. <http://www.charitybasics.co.uk/ch_plan.php> (traduction des auteurs).
41. Cité par MEINHOF (2005 : 132).
42. Ce qui va dans le sens de BLANC-PAMARD & FAUROUX (2004) ou de ATLANI-DUAULT (2005) qui
montrent comment la dimension « participative » des projets est devenue l’un des critères
particulièrement prisés par les bailleurs de fonds.
43. Ils ont ainsi été invités lors de la visite du président malgache Marc Ravaloma- nana en
Allemagne.
44. Ainsi les contacts de Anne avec la municipalité de Munich ont permis l’organisation de
concerts au Seebuehne, à la Muffathalle et au Musée d’Ethnologie (Staatliches Museum fur
Volkerkunde).
45. Voir les travaux de J. MALLET (2002a, 2004, 2007) sur les musiciens de la région de Tuléar. C’est
également ce qui se dégage de nos nombreux entretiens avec des musiciens malgaches installés
en Europe, ainsi que des discussions entre artistes, promoteurs culturels et chercheurs ayant eu
lieu lors du colloque organisé par TNMundi à Antananarivo en Novembre 2007, <http://
www.tnmundi.soton.ac.uk/events.htm>.
46. Paradoxalement, ce parti pris d’adopter des solutions « low-tech » est parfois l’un des points
d’achoppement entre « développeurs » et villageois.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
215
47. Il s’agit bien entendu toujours de la perspective des « développeurs ». L’argument contraire
pouvant en effet être avancé, selon lequel cette circulation d’informations pourrait également
être la source non plus d’une transmission de « solutions » mais d’une transmission d’« erreurs »,
ou du moins de solutions qui satisfont les « développeurs » mais pas les villageois.
48. Ce que S. GOEDEFROIT (2007 : 53) note également : « Cette façon de penser “ce qui est bien pour
l’autre” recèle une capacité d’agir sur le réel. »
49. Ce prolongement serait d’autant plus fascinant que les travaux de S. GOEDEFROIT (2007) ou de
BLANC-PAMARD & FAUROUX (2004) montrent que, bien souvent à Madagascar, les expériences de
développement donnant en théorie la parole et le droit de décision à tous ne sont qu’une
« illusion participative ».
RÉSUMÉS
Cet article explore les relations complexes liant musique, tourisme et développement à
Madagascar et en Europe. Trois parcours de « développeurs » sont analysés, où se construisent
des relations d'échange et de soutien mutuel entre musiciens et organisations humanitaires et
dans lesquels le tourisme a tantôt joué le rôle de déclencheur, tantôt au contraire découle de
cette rencontre entre membres d'une ONG et artistes. Nous faisons l'hypothèse que l'arrivée dans
le duo développement-tourisme d'une troisième dimension, celle des pratiques culturelles (ici la
musique), et plus particulièrement de leurs acteurs, les musiciens, permet de dépasser les
incompréhensions entre membres d'une ONG venus d'Europe et population malgache qu'ils sont
venus aider. Ce triangle de support mutuel permet de rééquilibrer — en partie au moins — les
inégalités inévitablement créées par ces pratiques d'aide à sens unique.
This article explores intricate interconnections between music, tourism and development in
Madagascar and Europe. We analyze three trajectories of actors in humanitarian work whereby a
relationship of exchange, friendship and mutual support has developed between members of
humanitarian organizations and artists. In some instances, this relationship has been triggered by
a prior experience of tourist visits to Madagascar, and in others has led to it. Using data from our
fieldwork in Madagascar and Europe, our paper develops the hypothesis, that the cultural
practices (here music), and in particular their actors, the musicians, create a third dimension in
the duality development-tourism, which overcomes the frequent misunderstanding between
NGOs' members coming from Europe and local Malagasy people whom they have come to assist.
This triangle of mutual support rebalances some of the inevitable inequalities arising from one-
way practices.
INDEX
Keywords : Madagascar, artists, development, music, tourism, NGO
Mots-clés : Madagascar, artistes, développement, musique, tourisme, ONG
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
216
AUTEURS
MARIE-PIERRE GIBERT
Centre for Transnational Studies, University of Southampton, Grande-Bretagne.
ULRIKE HANNA MEINHOF
Centre for Transnational Studies, University of Southampton, Grande-Bretagne.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
217
« La tarentule est vivante, elle n’estpas morte ». Musique, tradition,anthropologie et tourisme dans leSalento (Pouilles, Italie)“The Tarantula is Alive, it is not Dead”. Music, Tradition, Anthropology and
Tourism in Salento (Apulia, Italy)
Elina Caroli
NOTE DE L'AUTEUR
« Ballati tutti quanti ballati forti / ca la taranta è viva e nun è morta » (« dansez tous
dansez vite / car la tarentule est vivante, elle n’est pas morte ») : couplet d’un morceau
traditionnel de pizzica, la musique qui — notamment dans sa forme de pizzica tarantata
— était le plus souvent jouée pendant les rituels du tarentisme.
Le Salento contemporain : une identité pour vivre etpour vendre
1 Depuis une dizaine d’années, on assiste dans le Salento, l’extrême bout des Pouilles où
se situent le finis terrae et le point le plus oriental de la péninsule italienne, à la mise en
œuvre de politiques culturelles visant à promouvoir une identité locale. Celle-ci,
comme le souhaitent ses artisans, devrait permettre à ce petit territoire de « faire
entendre sa voix » à l’échelle globale. Ce mouvement tout à fait contemporain prend
son essor à partir d’une relation nouvelle au territoire, à ses ressources patrimoniales
et à son passé. Ainsi, il s’agira ici d’analyser « la façon dont le passé et son récit sous
forme d’histoire sont mobilisés comme une ressource dans les processus de
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
218
construction des identités » : de ce point de vue, il s’agit d’une mobilisation du passé
qui a un sens pour le présent (de L’Estoile 2001 : 123).
2 La redécouverte des racines et la revitalisation des traditions locales serviraient à
entretenir une différence essentielle par rapport à un monde dont on appréhende et on
craint tout d’abord l’homogénéisation. Sont tout à fait actuelles les affirmations de
maints hommes politiques ou des opérateurs culturels salentins qui, très souvent,
lorsqu’ils parlent des traditions ancestrales qui seraient le propre de leur région,
finissent par se référer à la mondialisation. L’identité locale, dans ces discours, est une
ressource qu’il faut valoriser pour gagner sa place dans le combat mondial pour la
présence, pour le droit d’exister et pour ne pas être effacé par une culture, soupçonnée
comme dominante, uniformisant les autres. De ce point de vue, ce mouvement
contemporain salentin s’insère à juste titre dans ce que Jean-Loup Amselle (2001 :
24-25) a appelé « le forum international » ou « le marché mondial des identités ».
Le salento dans les Pouilles, Italie du Sud
3 De plus, cette crainte d’une homogénéisation culturelle que la mondialisation serait
censée pouvoir engendrer « suscite l’urgence d’aller voir et recueillir ce que le monde
globalisé de demain ne nous permettra plus de voir » et garantit le succès du tourisme
culturel ou de l’ethnotourisme en quête de cultures « authentiques » (Doquet 2002 :
115-116). D’où le fait que les artisans de cette identité locale — ce que l’on appelle
localement « salentinità » — misent sur cette dernière et affirment qu’elle devrait
également constituer le socle sur lequel bâtir un modèle alternatif et durable de
développement, nourri en large partie par l’essor touristique du territoire.
4 Une identité ainsi construite est en effet, comme le savent très bien les hommes
politiques et les opérateurs culturels salentins, l’attrait principal du tourisme
contemporain, notamment culturel. La renaissance culturelle du territoire et le succès
touristique qui l’accompagne ces derniers temps demeurent par conséquent les
éléments fondamentaux du modèle alternatif de développement imaginé par la classe
politique au pouvoir. Ainsi, les buts des politiques culturelles dépassent largement le
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
219
domaine culturel, l’enjeu étant d’ailleurs celui du développement économique de l’aire
via le succès touristique.
5 C’est pourquoi j’ai cité la formule forgée par Sergio Blasi d’une « identité pour vivre et
pour vendre » (Santoro & Torsello 2002 : 184) : si, du point de vue notamment des
institutions locales, il s’agit dans la plupart des cas d’opérations de marketing territorial
s’appuyant sur la revivification de certaines traditions locales, la communauté locale et
en particulier les jeunes sont également impliqués dans cette démarche, en y puisant
des chances nouvelles d’occupation professionnelle et également un sens
d’appartenance et un orgueil nouveaux-nés.
6 La comparaison est tout à fait possible, voire nécessaire1 — car la similitude est
frappante — avec ce qu’affirme Anne Doquet (2002 : 119-120) par rapport aux
commencements du tourisme culturel au Mali, en l’occurrence dans le Mande : « Il ne
fait aucun doute que les motivations de ces nouveaux montreurs de culture soient
avant tout d’ordre économique. Néanmoins, il est intéressant d’entendre dans leurs
discours que cette réinvention des traditions répond aussi à un désir de la jeunesse de
mieux comprendre son passé pour mieux savoir qui elle est. »
7 Dans cette contribution, je tâcherai de comparer les résultats de mes enquêtes de
terrain et l’analyse de la situation salentine2 avec des études qui se penchent sur la mise
en patrimoine et la touristification des traditions au Mali, notamment en Pays dogon.
Comme on le verra, cela est possible tout d’abord du fait de l’essor touristique de ces
deux régions très éloignées et différentes et du lien de cet essor avec une situation que,
toujours d’après Anne Doquet, on pourrait nommer « situation ethnologique ». S’il
existe en effet « un regard ethnologique continu porté sur les Dogon de Sangha » (ibid.
1999 : 15), il en va de même pour le Salento et le tarentisme. Le tarentisme, la
littérature et les récits produits sur lui ne sont point étrangers au récent succès du
Salento qui, pour certains, est devenu une véritable mode. La Grecïa (l’Union de onze
communes de la province de Lecce situées au cœur de la péninsule salentine) est
l’épicentre de cette véritable « révolution territoriale » (Di Mitri 2006-2007 : 28) qui a
engendré un succès touristique. C’est ainsi que sont nés le projet de promotion du
dialecte d’origine grecque, le griko (depuis 1999 langue minoritaire de l’État italien),
qui a joué un rôle majeur dans la construction identitaire locale et celui du renouveau
de la musique traditionnelle, central dans la promotion de la région tout entière. C’est
dans la Grecïa salentine que se déroule, depuis 1998, le festival le plus connu de
musique salentine et notamment de pizzica, à savoir La Notte della Taranta (La Nuit de la
Tarentule).
8 Il s’agit d’un festival ayant lieu en août, durant deux semaines avec des concerts dans
tous les villages de la Grecìa3, dont le point culminant est le grand concert (le
concertone) de Melpignano. C’est cette nuit — qui donne d’ailleurs son nom au festival —
la plus longue et la plus fréquentée du Salento, qui a changé la destinée de ces quelques
villages et finalement de toute la province.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
220
La Grecìa salentine
9 Ainsi, ce n’est pas un hasard si j’ai cité Sergio Blasi : le maire de Melpignano, président
de l’institut Diego Carpitella (créé en 1997 dans le but de promouvoir le patrimoine
immatériel salentin et étroitement lié au festival), affirme que, même si la « mère » de
La Notte della Taranta est la Grecïa, il peut en être considéré à juste titre comme le
« père »4. Durant ces dix dernières années, grâce à une promotion avisée, cette
manifestation a su se développer, en attirant un public toujours plus nombreux et en
élargissant considérablement son champ d’action, dans le temps et dans l’espace. Il ne
fait aucun doute que ce festival tire aussi son succès extraordinaire de sa référence à un
phénomène anthropologique majeur tel que celui du tarentisme5.
10 Dans le prochain paragraphe, je montrerai comment la patrimonialisation du
tarentisme s’est produite à partir d’une image particulière de ce dernier, à savoir celle
d’Ernesto de Martino et des chercheurs et anthropologues qui l’ont suivi dans « ce topos
de l’ethnologie italienne qui est le Salento » (Bevilacqua 2005 : 74). Si aujourd’hui on
peut parler de « l’empire de l’Araignée ressuscitée à Melpignano et dans ses
environs »6, toute opération de récupération prend sa valeur et pour ainsi dire son
« appellation d’origine contrôlée de la référence à l’œuvre scientifique la majeure qui a
fondé le mythe ethnographique salentin », à savoir La Terre du remords (ibid. : 73).
11 Le Salento peut être de la sorte considéré comme une région « ethnologisée », puisqu’il
a été sillonné par nombre d’anthropologues après la saison inaugurale demartinienne
et qu’il a été de plus en plus souvent l’objet d’une anthropologie autochtone. De plus,
c’est à partir du mythe ethnographique ainsi créé que l’on a procédé à la construction
des identités locales. Grâce notamment à une inversion des signifiés du phénomène
d’antan, les événements créés autour de la « tarentule » ou les discours sur le
tarentisme construisent aujourd’hui une nouvelle identité locale (Fumarola &
Lapassade 2006-2007 : 63) très à la mode, comme nous le verrons plus loin.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
221
12 Or, cette identité locale, surgie de l’interaction de chercheurs venant d’ailleurs, érudits,
opérateurs culturels, musiciens et hommes politiques locaux, pose problème. La
question foncière (abordée dans la dernière partie de cette contribution), est celle de la
promotion d’une image réductrice de la culture salentine qui se vend pourtant très bien
sur le marché touristique. La « renaissance » dont parlent les élites locales cacherait le
risque d’une vitrification de la culture et de la société salentines prises au piège d’un
regard — externe ou interne — exotisant. Des traits culturels sélectionnés et réifiés sont
mis en avant en tant qu’étendards identitaires et labels distinctifs à utiliser sur le
marché touristique.
Ab « La terra del rimorso » condita
13 Sur le site officiel du festival le plus connu du Salento, on peut lire que « La Notte delta
Taranta est une grande fête de sons et de gens qui n’a rien à voir avec le rite du
tarentisme »7. Ceci est sans doute vrai dans la mesure où les performances qui ont lieu
aujourd’hui sur la scène de Melpignano ou ailleurs, n’ont rien en commun avec le
tarentisme d’antan. Rien en commun sauf peut-être leur propre volonté de s’y
brancher. En réalité, localement on ne peut pas se passer du symbole de la tarentule
(cela est d’ailleurs évident déjà à partir du nom même de l’événement) car on sait que
la tradition du tarentisme attire, amplifie le charme du Salento et rend La Notte della
Taranta avec sa panoplie de produits (concerts en Italie et à l’étranger, CD, DVD, livres)
beaucoup plus appréciée sur le marché touristique et sur celui de la revitalisation
folklorique. Il est évident que la mise en spectacle, voire la folklorisation du rituel de
jadis et de la musique qui l’accompagnait ont pris appui, de façon très consciente, sur le
rituel lui-même et notamment sur une description et une analyse particulières de ce
dernier, à savoir celles de l’historien des religions et ethnologue Ernesto de Martino.
14 Avec la parution de sa monographie, en 1961, de Martino (1999 : 45) dévoilait la misère
matérielle et psychologique de la « terre du remords », strictu sensu le Salento où,
comme il l’affirmait, le tarentisme influençait à l’époque « l’idéologie et le
comportement de quelques milliers de personnes » alors que, en considérant les
renseignements occasionnellement recueillis durant les visites dans les villages
salentins, il lui est possible d’affirmer que, « durant la saison de 1959, les tarentulés
étaient, dans l’ensemble, un peu plus de cent ». De ces « mordus de la tarentule » de
Martino (ibid. : 29-30) décrit l’« exorcisme musical » effectué à domicile grâce à
l’intervention de musiciens, en l’occurrence le petit orchestre (orchestrina) du coiffeur-
violoniste Stifani, et la visite successive à Galatina, à la chapelle de Saint- Paul, censé
être le protecteur à la fois des araignées et des tarentulés. La taranta, autrement dit la
tarentule, est le « monstrum mythique » (ibid. : 70), « le symbole suprême, le mythe
unificateur de tout l’ordre symbolique du tarentisme » (ibid. : 235) : c’était sa morsure
qui était censée plonger le « piqué » dans un état d’extrême agitation ou, au contraire,
catalectique et dépressif. Le but de la musique était alors de faire sortir le tarentulé de
son état en le faisant danser (même pendant plusieurs journées) jusqu’à expulser le
venin et à recevoir la grâce de saint Paul.
15 La Notte della Taranta par antonomase, c’est-à-dire le concert final du festival ainsi
nommé, a lieu à l’entrée de Melpignano, près de l’ancien couvent des Augustiniens. Il
s’agit du même lieu que l’on voit encore à l’état d’abandon dans les premières scènes de
La Taranta (1961) de Gianfranco Mingozzi, le premier documentaire sur le tarentisme
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
222
(Mingozzi 2002 : 10, 20)8. Dans le documentaire, le couvent n’est que l’exemple visuel
qui accompagne les mots du poète Salvatore Quasimodo sur les églises qui « sèchent et
tombent dans le silence », dans un Salento qui n’est que Sud oublié et immobile (ibid. :
45).
16 Le couvent n’est qu’une des nombreuses images récurrentes qui parsèment l’histoire du
regard posé sur le tarentisme à partir de « Salento 1959 », c’est-à-dire à partir à la fois
de l’arrivée de l’équipe de de Martino dans le Salento et de sa description du terrain
dans la première partie de La terre du remords. En fait, comme on le verra par la suite, on
est ici aussi, comme l’affirme Sory Camara dans sa préface à l’ouvrage d’Anne Doquet
(1999 : 10) sur les masques dogon, « sous l’empire du regard » où, d’image en image,
dans un jeu de miroirs, la popularité de l’objet ethnographique en marque la fixation,
voire l’aliénation.
17 D’ailleurs, de Martino (1999 : 28) affirma lui-même avoir décidé d’entreprendre sa
recherche sur le tarentisme après avoir vu des clichés d’André Martin pris « du haut de
la tribune ad audiendum sacrum » et « représentants les scènes qui, chaque année, du 28
au 30 juin, se déroulent dans la chapelle de Saint-Paul en Galatina ». Le pouvoir de
l’image qui fige immédiatement l’objet du regard est tellement fort que de Martino
(ibid. : 29) se placera avec des membres de son équipe dans la même tribune d’où Martin
avait photographié les « mordus de la tarentule ». Après lui d’autres feront de même,
comme Mingozzi — dont chaque documentaire sur le tarentisme sera un hommage
explicite à de Martino — et comme Luigi Chiriatti (1995 : 26), un spécialiste et musicien
local.
18 On peut aisément affirmer l’existence d’un fil rouge entre ces différentes
« représentations » du tarentisme mais ici il est important de souligner que l’œuvre
demartinienne « jette les fondations » d’un nouveau regard qui pèsera lourd sur la
destinée du phénomène. C’est pourquoi l’anthropologue Giovanni Pizza (2006-2007 : 65)
parle de l’existence d’une véritable « trace demartinienne » qui a fait du Salento un
« site de la mémoire » de l’anthropologie italienne. Immédiatement après « Salento
1959 » commence « le pèlerinage salentin d’anthropologues post-demartiniens » (ibid. :
72), composé de certains membres de l’équipe qui accompagna de Martino lors du
premier terrain.
19 Cette tendance, évidente dans la publication de nombreux ouvrages post- demartiniens
qui souvent ne franchissent pas les limites de la province de Lecce, s’est accentuée
dernièrement. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que pendant longtemps de Martino fut
l’objet d’une sorte de « damnatio memoriae »9 10. La traduction française de son ouvrage
parut chez Gallimard en 1966 ; l’intellectuel local Sergio Torsello (2006 : 30) souligne
cependant qu’en 1961 la publication de La terra del rimorso passa presque inaperçue dans
le monde intellectuel salentin et qu’en réalité, dans le Salento, ce livre fut découvert
beaucoup plus tard11. Or, après la réédition de La terre du remords en 1994 — à laquelle
contribua, dit-on, un intellectuel salentin en contact avec la maison d’édition (ibid. : 47)
— la monographie sur le tarentisme, jadis considérée (toujours d’après Torsello) comme
une « œuvre mineure » dans la bibliographie demartinienne (ibid. : 25), a connu un
nouveau succès et, notamment dans le Salento, est devenue un véritable best-seller,
étalé dans les vitrines des librairies à côté d’ouvrages d’histoire locale ou de guides
touristiques.
20 L’an 1994 est considéré comme une date charnière concernant cette redécouverte car,
par la suite, les publications et les événements liés à La terre du remords ou au
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
223
tarentisme se multiplient. Alors que la bibliographie sur le tarentisme s’accroît11, les
intellectuels salentins ont l’impression qu’à nouveau, comme à l’époque des enquêtes
de de Martino et de ses collaborateurs, le Salento est devenu un terrain privilégié de
recherche pour les sciences sociales (ibid. : 39-40). Entre l’intérêt anthropologique et
l’attrait touristique il n’y a qu’un pas, surtout lorsqu’il s’agit d’impulser un tourisme en
quête de « derniers lieux authentiques ». C’est ainsi que ces dernières années, on
observe à la fois une revitalisation de la pensée demartinienne dans l’anthropologie en
Italie et à l’étranger12 mais également, parallèlement, une mise en patrimoine du
tarentisme impulsée par les politiques culturelles locales (Pizza 2006-2007 : 66).
21 Mise à part l’arrivée dans le Salento de nombreux chercheurs liés de façon plus ou
moins directe à de Martino et à sa recherche fondatrice, la référence continuelle et très
claire à de Martino se perpétue aujourd’hui et appartient également à tout regard
endogène, qu’il s’agisse des nombreux ouvrages d’ethnologie autochtone, de films ou de
réélaborations de morceaux traditionnels.
22 Dans le premier cas, on pourrait citer l’exemple du livre de Luigi Chiriatti13 Morso
d’amore (Morsure d’amour) dont le titre souligne clairement la dimension psychologique
liée à une désillusion amoureuse de la crise de tarentisme. Or, il s’agit justement de la
lecture faite par de Martino de la crise de la seule tarentulée dont il put observer à la
fois le cycle complet de l’exorcisme chorégrapho-musical à domicile et la visite à la
chapelle de Saint-Paul à Galatina. La tarentulée était « Maria di Nardo », d’après le nom
conventionnel que lui donne de Martino, nom sous lequel elle sera d’ailleurs toujours
connue ; Mingozzi (2002 : 19), qui la filma dans son documentaire La taranta, nous
révélera par la suite son vrai prénom, Assuntina.
23 À partir de ce même personnage, on peut donner un autre exemple concernant cette
fois les films réalisés au sujet du tarentisme, tel que Pizzicata (1996) dans lequel le
réalisateur Edoardo Winspeare14 reconstruit le milieu d’un Salento populaire encore
culturellement homogène par rapport à l’idéologie qui sous-tendait le phénomène du
tarentisme. D’après Chiriatti (1995 : 17), c’est la figure de Maria di Nardo, telle qu’elle a
été présentée par de Martino dans La terre du remords, qui « inspire » Winspeare.
24 Enfin, pour donner un dernier exemple de la présence d’un tarentisme de matrice
demartinienne dans les regards et récits successifs, je citerai le cas du morceau
traditionnel salentin Lu rusciu de lu mare (Le bruit de la mer) dans la version du groupe
Alla Bua. Il ne s’agit pas d’une pizzica tarantata, c’est-à-dire d’une pizzica liturgique,
originairement jouée et dansée lors des crises de tarentisme ; ce n’est pas non plus une
pizzica profane 15. Le texte de ce morceau révèle tout de suite qu’il s’agit d’un chant
d’amour, dont le rythme est très lent. Ceux qui prétendent que le chant « naît » à
Gallipoli, affirment également que sa fonction était d’accompagner les coups des rames
des pêcheurs (on expliquerait de la sorte le rôle majeur que joue la mer dans le texte
d’un chant de travail de pêcheurs). Néanmoins, suivant une tendance désormais
généralisée parmi la plupart des groupes du folk revival salentin, Alla Bua exacerbe le
rythme et structure le morceau comme s’il s’agissait d’une véritable pizzica. Qui plus
est, le vidéoclip16 du morceau est construit suivant la description de l’exorcisme de la
tarentule faite par de Martino, avec des références visuelles tout d’abord à la tarentulée
vêtue de blanc ; à la corde au bout de laquelle elle se balançait parfois dans les moments
d’identification avec l’araignée qui l’avait piquée ; aux chaises entre les barres
desquelles les tarentulés se contorsionnaient parfois durant les crises ; à la figure du
pont, faisant partie du moment identificatoire avec l’araignée du cycle chorégraphique
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
224
et dont de Martino (1999 : 84) affirma que « c’était l’arc hystérique classique ». Enfin,
certaines scènes du clip montrent les musiciens du groupe dans une voiture et elles
rappellent non seulement une fameuse photographie de de Martino dormant sur le
siège arrière d’une voiture lors de son terrain salentin, mais surtout les scènes
désormais classiques de Maria di Nardo amenée en voiture à Galatina et filmées par
Mingozzi dans La taranta.
25 Cette permanence de la description demartienne et son ubiquité ont fait parler, à
propos de La terre du remords, d’« œuvre ouverte »17 justement parce qu’il s’agirait d’une
œuvre très revisitée, et d’« image totale » (Tari 2004 : 14) ou, finalement, d’une
véritable « identification du passé salentin avec la mémoire demartinienne de Salento
1959 » (Pizza 2002 : 45). C’est pourquoi j’ai adapté la célèbre formule latine à l’héritage
de de Martino et de son œuvre dans le Salento en parlant d’une époque qui peut être
calculée « ab La terra del rimorso condita ».
26 Or c’est justement cette persistance qui pose problème. À présent, le lecteur qui connaît
la situation des Dogon au Mali aura déjà remarqué plusieurs points communs entre
cette démarche dans le Salento et celle par laquelle « les Dogon du Mali sont devenus
les Dogon de Griaule, puis les Dogon des ethnographes, et pour finir, les Dogon pour
touristes » (Camara 1999 : 11). Anne Doquet (1999 : 15) remarque en fait que, déjà, à la
suite de la mission Dakar-Djibouti, l’ethnologie n’a plus cessé de poser « sur la société
qu’elle a tant chérie un regard permanent », en l’érigeant en modèle. Mais c’est en
considérant à la fois Dieu d’eau (1948) de Marcel Griaule et La terre du remords d’Ernesto
de Martino que l’on décèle les analogies les plus surprenantes18. Non seulement par
rapport à leur réception et à leur usage contemporains dans les sociétés qui ont fait
l’objet de leurs enquêtes respectives, mais également pour ce qui concerne leurs
terrains réciproques.
27 Tout d’abord, concernant les Dogon et l’ethnologie, on peut distinguer deux phases :
l’avant et l’après Dieu d’eau (Doquet 1999 : 26,121). Gaetano Ciarcia (2001 : 106), lorsqu’il
parle de « la vulgarisation du discours érudit, véhiculée surtout par le livre Dieu d’eau,
de l’ethnologue Marcel Griaule » en Pays dogon, ne fait que constater l’importance
fondatrice de cet ouvrage. Un autre point en commun, qui n’est sans doute pas étranger
au grand succès de ces ouvrages même en dehors de leur milieu disciplinaire d’origine
et à leur utilisation actuelle à des fins de promotion touristique, c’est qu’il ne s’agit pas
de simples œuvres d’anthropologie, de froids comptes rendus de terrain. D’après
Ciarcia (ibid. : 106), Dieu d’eau est un texte « qui prétend être scientifique et littéraire à
la fois ». On peut dire la même chose de La terre du remords dont certaines pages
possèdent un lyrisme émouvant qui a sans doute contribué à la vulgarisation du texte
auprès d’un large public.
28 Concernant l’informateur de Griaule, Ciarcia continue en soulignant que « Griaule
manie les mots d’Ogotemmêli [...] en présentant ce personnage comme une figure
romanesque de maître à penser exotique ». Et d’en conclure qu’« une telle création
conditionnera la transformation du livre en emblème » (ibid.). Passons maintenant à La
terre du remords : au départ, la situation est différente mais on peut affirmer que le
résultat est semblable. De Martino a été accusé d’avoir, pour ainsi dire, « occulté » son
informateur privilégié, le barbier-violoniste Luigi Stifani. Quelqu’un a remarqué que de
Martino ne le nomme jamais (Torsello 2000 : 21). On a même parlé d’une « stratégie du
silence » mise en place par de Martino, en considérant cette omission comme une
limite majeure qui entame le rapport du chercheur avec son informateur privilégié (Di
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
225
Mitri 2005 : 43). Et pourtant, même si Stifani demeure anonyme, cela n’a pas empêché le
violoniste de jouer un rôle de premier plan dans La terre du remords, pour ensuite
devenir une figure emblématique du tarentisme tout court et l’informateur privilégié
de tous ceux qui sillonneront les mêmes lieux en suivant les traces demartiniennes.
29 De Martino se réfère à plusieurs reprises à Stifani en l’appelant « notre barbier
violoniste ». Et lorsqu’il s’attarde sur la description de l’exorcisme musical, Stifani est le
personnage central, au même titre que la tarentulée. En lisant ces pages, on se trouve
face à un « maître » du tarentisme, qui, justement grâce à ce rôle, a pu par la suite
devenir une figure « presque mythique du Salento » (Collu 2004 : 53) dont l’activité a
été définie comme étant « pseudo-chamanique » (Nocera 2000 : 30). Les anecdotes
citées par de Martino ont sans aucun doute contribué à donner cette impression. De
Martino raconte avoir demandé à Stifani, durant une pause de la cure domiciliaire de
Maria, de lui donner son pronostic sur la grâce que saint Paul aurait faite à la
tarentulée, lui permettant ainsi d’arrêter la danse. « Sur le ton assuré et bureaucratique
d’un employé de chemins de fer donnant au voyageur un renseignement d’horaire, il
nous déclara : “Le saint accorde sa grâce soit à midi, soit à treize heures ou alors à
quinze heures ou à dix- sept heures”. » Et de Martino (1999 : 84-85) de constater que
« la grâce s’était produite exactement à 14 h 55 ».
30 Qui plus est, lorsqu’il décrit l’exorcisme musical, de Martino s’attarde sur l’image du
violoniste se penchant sur la tarentulée de manière à ce que son archet aurait pu être
un prolongement du corps de la femme. De Martino nous renvoie à cette occasion
l’image d’un musicien thérapeute maîtrisant parfaitement le rituel. Georges Lapassade
(1976 : 134), en analysant la description demartinienne, affirmera par la suite que « le
rapport entre le violoniste, musicien principal, et la tarentulée [...] est décrit comme un
rapport entre hypnotiseur et hypnotisé ». Pourtant, dans son journal intime, Stifani
(2000 : 58) avoue avoir été parfois troublé par les tarentulés lorsqu’il jouait pour eux car
il craignait qu’ils puissent en quelque sorte faire de lui une nouvelle recrue.
31 Quoi qu’il en soit, Salento 1959 change à tout jamais la vie ordinaire de Stifani et aussi la
perception qu’il a de lui-même. Comme on l’a dit, Stifani deviendra par la suite
l’informateur privilégié de tous ceux qui voudront observer le phénomène : ce sera à lui
que s’adressera Mingozzi avec une lettre de recommandation de de Martino. Ainsi, ce
sera Stifani qui fixera par la suite les rendez-vous de Mingozzi avec les tarentulés et
leurs familles lors du tournage de La taranta. Stifani guidera également Mingozzi dans
tous les « hauts lieux » du tarentisme (Mingozzi 2002 : 18) et fixera les moments du
tournage. Parfois, il ira jusqu’à arrêter le rituel pour présenter l’équipe de Mingozzi aux
parents de quelque tarentulée (ibid. : 19) ; une autre fois, il résoudra une bagarre entre
le mari d’une tarentulée et un membre de l’équipe qui avait commencé à « travailler »
sans attendre l’arrivée du violoniste (ibid. : 25).
32 Mingozzi se présenta chez Stifani avec une lettre signée par de Martino lui-même et
put par la suite affirmer que Stifani se montra toujours « gentil et disponible » (ibid. :
17). Lorsque, quelques années plus tard, le chercheur local Chiriatti commence à son
tour son parcours de la mémoire du taren- tisme, la première étape ne peut qu’être
Nardo et la boutique de Stifani. Or, à la demande de renseignements faite par Chiriatti,
Luigi Stifani répondra en demandant très clairement à être payé. Ce qui poussera
Chiriatti (1995 : 57, 60) à affirmer, lorsqu’il rencontrera le frère de Stifani, Antonio, (lui
aussi musicien des tarentulés, n’ayant pas pour autant la renommée de Luigi),
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
226
qu’Antonio est beaucoup plus ouvert que le frère car il parle spontanément du
phénomène et ne veut pas être payé pour ses informations.
33 Conscient de son importance, Luigi Stifani se signera, dans son journal intime,
« informateur Stifani » et transformera sa boutique en « bureau sur le tarentisme ».
Rencontrer Stifani deviendra le passage et même « le départ obligé de toute étude,
recherche ou “approche” de la pizzica salentine » (Melissi 2005 : 19)19. À son tour, Stifani
tirera un certain orgueil de son rôle et de son « intégration dans le milieu international
des savants de la musique ethnique » (Bevilacqua 2005 : 76). Dans son journal intime, il
citera l’invitation qui lui fut adressée pour participer à un colloque à Lecce « avec
beaucoup de spécialistes d’ethnomusicologie de nombreux pays » (Stifani 2000 :
48-49)20.
34 La deuxième dramatis persona (Pizza 2002 : 43) de La terre du remords, Maria di Nardo,
réagira de façon tout à fait différente à cette montée d’intérêt, prouvant toutefois de
nouveau, l’importance de l’héritage demartinien. En effet, il existe dans le Salento une
sorte de « rituel de la mémoire » dès que l’on s’intéresse au tarentisme : interviewer
Maria di Nardo (Pizza 20062007 : 72). Dans son cas, il y a même eu de l’acharnement,
comme lors de l’interview d’Annabella Rossi présentée dans le documentaire de
Mingozzi, Sud e magia21 (1978) qui ressemble de façon troublante à un interrogatoire de
police, et qui s’achève sur le désespoir de Maria affirmant qu’« on ne fait pas ces
choses ».
35 Le passage du documentaire sur la deuxième chaîne de la télévision nationale provoqua
à l’époque de nombreuses réactions. En particulier, Edoardo Sanguineti souligna le
problème de la « spectacularisation de la recherche » et de l’exotisme implicite dans la
façon médiatisée de montrer ces « Autres » (Mingozzi 2002 : 70-71). Annabella Rossi se
justifia en ripostant qu’il s’agissait d’une opération nécessaire afin de « faire entrer
dans l’histoire une culture qui de l’histoire a toujours été exclue » (ibid. : 72-73).
36 Il ne s’agit que d’un autre cas de figure du regard ethnologique producteur d’« isolats
culturels » vendus par la suite sur le marché de l’ethnique. En 1995, en posant le même
problème, Germaine Dieterlen répondait ainsi à un journaliste de Libération : « Mais que
voulez-vous, les Dogon sont à la mode. Je suis effrayée par le regard qu’on porte sur
eux. Comme s’ils étaient des gens à part [...], comme s’ils étaient “isolés” sur notre
planète » (Doquet 1999 : 287).
37 Enfin, le problème général qui se pose par rapport à ces écrits, est celui de la
généralisation sans doute abusive des résultats des enquêtes ethnologiques. Dans le cas
de Dieu d’eau aussi bien que dans celui de La terre du remords, la situation est rendue plus
complexe du fait que ces textes ont façonné notre regard et qu’ils sont utilisés aussi
localement dans le processus de patrimonialisation. Autrement dit, étant donné qu’il
existe une « relation entre le mythe ethnologique et les pratiques de valorisation du
patrimoine » contemporaines (Ciarcia 2001 : 106), il faudrait à mon sens s’interroger
sur ces dernières et sur les conséquences de cette relation, et cela justement à cause du
moulage de la culture vécue, sans cesse mouvante, sur la culture décrite et par là figée.
38 En ce qui concerne le cas de de Martino, même si son enquête fut longuement préparée
et même si certains membres de son équipe se rendirent à plusieurs reprises dans le
Salento, le temps passé sur le terrain demeura assez limité, ce qui d’ailleurs est avoué
par de Martino lui-même (1999 : 8). Salento 1959 prend appui sur les observations faites
pendant une vingtaine de jours, du 20 juin au 10 juillet (Agamennone 2005 : 16). C’est
toujours de Martino qui révèle le rôle majeur joué par l’aléa dans sa démarche. Ce ne
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
227
fut que par hasard, en parlant avec le gérant de l’hôtel où il se trouvait avec son équipe
à Galatina, qu’il eut vent de l’exorcisme de Maria de Nardo et de l’activité des deux
frères Stifani. De plus, même s’il affirme qu’à l’époque il aurait dû y avoir une centaine
de tarentulés dans le Salento, des trente-cinq qui se rendirent à la chapelle de Galatina
du 28 au 30 juin 1959, son équipe choisit d’en suivre dix-neuf (de Martino 1999 : 44-45).
Parmi eux, le cas de Maria di Nardo fut le seul à être entièrement observé par l’équipe,
au domicile de la tarentulée et à la chapelle de Galatina.
39 Certes, on pourrait affirmer que l’aléa est une donnée commune à toute enquête de
terrain. La question n’est pourtant pas là. En revanche, mon but était de montrer que ce
sont les écrits de de Martino qui changent la destinée de leurs personnages principaux.
Alors qu’à l’époque de l’enquête demarti- nienne, différentes formations musicales
jouant pour les tarentulés existaient dans le Salento (Agamennone 2005 : 32-35),
l’orchestre de Stifani est déjà essentialisé avec le compte rendu de La terre du remords
paru dans la revue L’Homme en 1962. On peut y lire que la musique est jouée « par un
orchestre composé d’accordéon, tambourin, violon et guitare » (Cassin 1962 : 131). Un
violoniste rencontré par hasard devient le violoniste des tarentulés, de surcroît
convoité par tout chercheur jusqu’à sa mort ; une tarentulée, la tarentulée. Finalement,
le caractère fortuit et la partialité du regard n’a pas empêché que, par la suite, le
tarentisme décrit par de Martino devienne le tarentisme tout court.
Le néo-tarentisme et la mode du Salento
40 Analysons à présent les pratiques contemporaines de valorisation du patrimoine dans
leur relation au mythe ethnologique. Pour décrire la situation plus récente du Salento,
on parle souvent de « néo-tarentisme » en se référant à la fois à la parution continue
d’ouvrages « post-demartiniens » et en général à la reprise du débat sur le tarentisme,
mais en incluant également dans cette formule le succès touristique de la région,
notamment parmi les jeunes, qui accompagne un large mouvement de renouveau
musical. Il s’agit d’ailleurs de différentes facettes d’un même processus déclenché dans
une société « ethnologisée », autrement dit, comme l’explique Anne Doquet, une société
« vivant en permanence sous le regard des chercheurs et sous d’autres regards
complices ». Et Doquet (1999 : 290) de poursuivre : « Toutes les cultures de ce type
semblent avoir été éclairées par un texte ou un ensemble de textes inauguraux, signés
d’une personne ayant fait autorité dans la discipline. » De la sorte, ce personnage
influent crée un « moule théorique » qui sera toujours remployé par les autres
chercheurs. En revenant au cas du Salento, que l’on s’accorde avec de Martino ou pas,
on ne s’en éloigne jamais dès que l’on parle de tarentisme.
41 C’est pourquoi d’ailleurs ceux qui parlent de néo-tarentisme en marquant une
différence essentielle entre ce mouvement contemporain et le phénomène d’antan
finissent par oublier un aspect pourtant important du processus, à savoir le lien
existant entre le passé — et le récit ethnologique du passé — et les opérations
contemporaines. Certes, aujourd’hui on ne pourrait plus étudier le tarentisme dans le
cadre d’une histoire religieuse du Sud, mais ce qui compte c’est d’observer au niveau
local la gestion de la mémoire et de la tradition et la construction de l’identité qui en
découlent et d’analyser les enjeux spécifiques de ces opérations.
42 Comme on le dit souvent localement en se référant à la situation du « tout-pizzica » et en
général à l’engouement pour la musique salentine et le Salento, la « tarantule » est
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
228
encore bien vivante. Alors que de Martino observait un phénomène qui d’après lui se
serait vite épuisé et dont ne restaient que des bribes, à partir de son enquête et de
celles qui viendront dans son sillage, l’araignée recommencera à mordre, même d’une
façon différente. Non seulement l’œuvre demartinienne fonde le tarentisme et oriente
les images qui, depuis l’enquête de 1959, ont marqué l’appréhension de sa fin, mais elle
marque surtout le début de sa « renaissance ».
43 Les valeurs sont toutefois renversées : on passe du « remords » d’autrefois au
« rachat », et du tarentisme on trie les différents aspects en ne gardant que ce qui se
vend le mieux. Ce n’est pas une « invention de la tradition » mais il y a eu à un certain
moment un renversement des signifiés. La douleur des tarentulés est effacée pour faire
place à la fête et aux rituels libérateurs des néo-tarentulés. La référence au rite
demeure, mais elle est maintenant vécue en clé positive, d’abord comme élément
distinctif. Le phénomène honteux de jadis, que l’on cherchait même à cacher, est
affiché à toute occasion, alors même qu’il n’y a plus de tarentulés, et demeure à la base
de l’orgueil nouveau-né d’être salentins et de participer d’une culture au centre de
l’intérêt de plusieurs sujets : chercheurs et touristes, tout d’abord. Le changement est
évident : devant la chapelle de Galatina, par exemple, où il n’y a que des jeunes curieux
— sans doute les mêmes que le public de La Notte della Taranta — prêts à filmer l’arrivée
d’une dernière tarentulée qui ne se produira pas ou ayant simplement l’envie de jouer
du tambourin.
44 Ce changement des sujets impliqués n’est toutefois pas récent. Mingozzi l’affirmait déjà
en 1982, non sans une certaine nostalgie et une nuance de regret. Son documentaire
Sulla terra del rimorso s’achève sur cette remarque de la voix-off : « Galatina, 29 juin 1982.
Nous sommes retournés, pour la troisième fois après 1961 et 1977, à la chapelle de saint
Paul. [...] Aujourd’hui, photographes, opérateurs de cinéma et touristes sont de plus en
plus nombreux et leur présence dépasse largement celle des malades d’autrefois. Une
vide manie de folklore s’accroche à ce néant qui reste d’un phénomène ethnographique
une fois imposant, assujettissant et dur [...] » (cité dans Mingozzi 2002 : 75). Pourtant,
Mingozzi fait partie du groupe qu’il observe, s’il est vrai, comme l’affirme de Martino,
qu’en 1959 il n’existait déjà que des reliquats de l’ancien rite. Par le biais de discours
comme celui de Mingozzi, c’est une distinction que l’on veut imposer, fondée sur
l’image d’une sorte d’« âge d’or » qui n’a jamais existé. C’est encore Mingozzi (ibid. : 82)
qui, en revenant sur son expérience de 1982, parle du « sens de désolation de l’ancienne
fête réduite à une marchandise et à la consommation », sans d’ailleurs vouloir se
rendre compte de sa part de responsabilité dans ce processus. Ce même sentiment est à
la base des commentaires de ceux qui regrettent « le tarentisme qui malheureusement
n’existe plus » (cité dans Pizza 2006-2007 : 69).
45 C’est toujours dans une situation « ethnologisée » que les changements majeurs, ayant
informé l’histoire du tarentisme et le passage vers ce qui est appelé aujourd’hui « néo-
tarentisme », se sont produits. Force est de considérer, par exemple, l’importance de la
rencontre du chercheur local Luigi Chiriatti22 — qui possède à l’heure actuelle les
archives les plus riches concernant les traditions salentines et qui arrive même à parler
d’« ethnie salentine » (Miscuglio & Chiriatti 2004 : 13, 17) — avec des sociologues ou des
ethnologues, tels que Pietro Fumarola et Georges Lapassade. Ce dernier a joué d’ailleurs
un rôle de premier plan dans la démarche qui a conduit au néo-tarentisme
d’aujourd’hui, même s’il semble qu’il ait voulu s’en éloigner par la suite. Pourtant, ces
réflexions sur le tarentisme ne sont pas exemptes d’erreur. Pour ne citer qu’un exemple
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
229
toutefois parlant, dans son ouvrage consacré aux transes et aux possessions, lorsqu’il se
penche sur le tarentisme, il confond la pratique de thérapie musicale avec la musique
utilisée pendant son déroulement, en affirmant que « le nom populaire de ce rituel est
pizzica-pizzica » (Lapassade 1982 : 123).
46 C’est le début de la surestimation de la pizzica et de la confusion aujourd’hui généralisée
entre la « tarentelle liturgique », autrement dit la pizzica tarantata jouée lors du rite
domiciliaire et la « tarentelle profane » (Carpitella 1999 : 454), c’est-à-dire la pizzica-
pizzica ou la pizzica du core, celle des danses de couple et de cour pendant les fêtes. On en
est aujourd’hui à appeler indifféremment tout morceau taranta, même lorsqu’il s’agit de
pizzica profane, alors que Carpitella, dans son appendice à La terre du remords qui reste
encore à présent l’étude d’ethnomusicologie la plus importante sur le tarentisme
(Agamennone 2005 : 23), soulignait péremptoirement que « lorsqu’on parle de modules
chorégraphiques du tarentisme, il faut exclure les modes de la danse profane » et, sur
un ton encore plus tranchant, que « la tarentelle qui est dansée dans le tarentisme n’est
pas la tarentelle profane » (ibid.). Malgré ces avertissements, on assiste souvent
aujourd’hui, lors des concerts de pizzica, à la présence simultanée dans la danse
d’éléments cinétiques renvoyant à la fois aux deux modèles. Ainsi, lorsque quelques
spectateurs d’un des très nombreux concerts de musique traditionnelle salentine se
mettent à danser, d’une façon qui d’ailleurs est souvent critiquée par les (prétendus)
connaisseurs ou par les anciens pour être issue de quelque école de danse, le fait d’être
engagé dans un bal de cour n’empêche pas la danseuse de « mimer » les mouvements
« tarentulés » comme on les a appris des pages demartiniennes, des photos d’archives
qui font de temps en temps l’objet de quelque exposition, des documentaires de
Mingozzi ou, plus récemment, des films de Winspeare.
47 Cette confusion des modèles s’accompagne des discours sur l’importance du rythme et
sur la transe. Ici Lapassade a joué le rôle principal. Lorsqu’il revient dernièrement sur
ce passage du tarentisme au néo-tarentisme, il affirme que de la thérapie de jadis « on
valorise aujourd’hui la musique ainsi que, dans un discours très idéologisé, sa liaison
ancienne avec la transe des tarentulés — ceci à la faveur d’une nouvelle mode de la
transe véhiculée par certains courants de la techno »23. Il passe par la suite en revue les
étapes essentielles de ce processus en soulignant surtout l’importance de l’expérience
théâtrale et culturelle de II ragno del dio che danza (L’araignée du dieu qui danse) de Luigi
Santoro, de l’Université de Lecce, en 1981 qui marqua aussi le début de sa participation
— de façon inconsciente, dit-il — à la constitution et au développement du néo-
tarentisme. Autre étape, toujours en 1981 : la publication de la version italienne de son
Essai sur la transe, alors qu’en 1986 parut la traduction italienne de La musique et la transe
de Gilbert Rouget. À ce propos, Lapassade affirme que le chapitre de cet ouvrage
consacré au tarentisme et basé sur les analyses de de Martino et de Carpitella, a joué un
rôle décisif dans la constitution « idéologique » du néo-tarentisme. Enfin, il mentionne
aussi l’organisation, par le sociologue Fumarola, de concerts de techno-pizzica.
48 Or, me semble-t-il, à une époque — la nôtre — où les anciens tenants de la pizzica
éprouvent l’envie de s’éloigner de la mode du néo-tarentisme et de ses dérapages,
Lapassade semble ne pas vouloir assumer sa partie de responsabilité dans le processus.
Dans le chapitre « La danse de l’araignée » de son Essai sur la transe, il reprend la
description faite par de Martino de la thérapie domiciliaire de Maria di Nardo pour en
conclure que « c’est une transe provoquée — mais le narrateur n’emploie jamais cette
expression » (Lapassade 1976 : 132). C’est encore Lapassade qui conçoit les tambourins
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
230
de la pizzica en tant qu’« éclateurs rythmiques » en expliquant ainsi le concept
d’éclatement : « Le rythme fort, de plus en plus intense et signifiant des tambourins
défonce la conscience ordinaire, la caisse et la fait éclater. » Et de conclure que « le
tambour peut ainsi faciliter ou provoquer ce passage qui définit l’entrée dans la
transe » (ibid. : 137).
49 Depuis, les tambourins connaissent un grand succès dans le Salento. Alors que, au
milieu des années 1970, Chiriatti (1995 : 33) n’arrivait plus à s’en procurer pour ses
concerts, aujourd’hui les fabricants se multiplient à nouveau et on peut même en
acheter sur Internet. Le nombre des cours de tambourin augmente dans toute l’Italie
comme à l’étranger, et dans le Salento sont prévus aussi des cours pour les enfants à
l’école.
50 On ne peut comprendre comment l’ouvrage de Rouget aurait pu provoquer tout cet
engouement sinon à partir d’un malentendu de sa pensée, étant donné que le but de La
musique et la transe était, d’après son auteur, celui de relativiser l’importance que l’on
donne communément à la musique dans les phénomènes de transe. Rouget se situe de
la sorte sur une position diamétralement opposée à celle de Lapassade qui, comme on
vient de le voir, utilise même le verbe « provoquer ». Au contraire, pour Rouget, la
musique manipule la transe, l’organise et la socialise plutôt que de la provoquer ou de
la déclencher. Comme le dit d’une façon très claire Michel Leiris (1980 : 12) dans
l’introduction à l’ouvrage de Rouget, « la musique, en tant que combinaison sonore
agissant par son seul impact sur les nerfs, [...], n’est en mesure d’engendrer la transe.
Cette constatation paraît donc réduire à néant l’idée reçue suivant laquelle ce serait le
paroxysme musical (jeu virulent des tambours, par exemple, ou de quelque instrument
que ce soit) qui, par une sorte de contagion, déclencherait directement et à lui seul cet
autre paroxysme, la transe ».
51 En revanche, il est sans aucun doute vrai que Lapassade a contribué directement — en
opérant par sa recherche-action dans le Salento sur les intersections entre musique
traditionnelle d’une part et musique reggae, techno ou phénomènes liés à la transe de
l’autre (et cela à partir du début des années 1980) — à l’inversion des signifiés qui a
provoqué le passage du tarentisme au néo-tarentisme. Il faut rappeler d’ailleurs que
c’est Lapassade (1982 : 127) qui s’adonne au comparatisme entre les comportements des
tarentulés (la fascination pour les couleurs, par exemple) et les effets de drogues telles
que le LSD. Ses théories ont été de la sorte beaucoup moins déformées que celles de de
Martino (qui espérait ardemment que le phénomène disparaisse) ou de Rouget, dont les
textes ont été utilisés malgré eux par les « militants » de la transe libératoire à la mode
aujourd’hui.
52 C’est en fait la prétendue qualité de la pizzica et de son jeu de tambourins, c’est-à-dire le
pouvoir de déclencher la transe, de conduire le sujet dans un état modifié de conscience
et aussi d’expérience nouvelle libératrice par rapport à son corps, qui la rend tellement
appréciée chez le peuple du néo-tarentisme. Pour contrer cette essentialisation, je me
bornerai à rappeler ce qu’avouait Stifani, un des « dieux tutélaires » du mouvement.
Lorsqu’il n’arrivait pas à scazzicare le tarentulé, autrement dit à le faire danser afin qu’il
sorte de sa crise, il mettait de côté les morceaux de pizzica tarantata et espérait avoir
plus de chance avec tout autre genre de musique, y compris des airs d’opéra.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
231
La Notte della Taranta et le mouvement de la pizzica
53 Comme le dit Cici Cafaro, poète-paysan octogénaire de la Grecïa, « lorsque j’étais petit,
il y avait les tarentulées [...] maintenant le tarentisme est devenu un grand amusement
parce que les tarentules ont presque complètement disparu mais on dit qu’elles sont
devenues marchandise savoureuse, parce qu’on tire profit des tarentules mais moi, je
ne peux pas me taire parce que je jouais l’harmonica pour les tarentulées et je sais
combien elles souffraient »24. Cafaro se réfère sans aucun doute tout d’abord au festival
La Notte delta Taranta, la manifestation qui a rendu célèbres le Salento, la pizzica, et le
tarentisme parmi un public de plus en plus large et international.
54 Ce festival est aujourd’hui l’événement le plus important pour ce qui concerne le
renouveau de la musique traditionnelle salentine et contribue fortement à la
renommée touristique du Salento. À chaque édition, notamment lors du concert de la
soirée finale, il attire de plus en plus de passionnés (cent cinquante mille spectateurs,
d’après les chiffres officiels en 2008), ceux qui sont appelés « néo-tarentulés ».
L’orchestre de La Notte delta Taranta, créé en 2004 par le musicien et ethnomusicologue
Ambrogio Sparagna, se produit désormais dans différents contextes et à toute époque
de l’année : ainsi, on a exporté la musique salentine et par conséquent le Salento à
Rome, Bologne, Venise (où en 2005 l’orchestre a clos le Carnaval), Turin (en ouverture
du concert-événement des Polices en 2007) mais aussi à l’étranger. Sur le site du
festival, on parle avec fierté de « la taranta nel mondo ».
55 C’est sans aucun doute à cause de la renommée de ce festival que le terme taranta est
désormais utilisé non seulement pour se référer à la fameuse araignée du tarentisme ou
pour parler du festival lui-même, mais il a carrément aussi remplacé, dans le discours
courant, celui de pizzica. Cette taranta, omniprésente dans les discours sur le Salento
sans que l’on sache pour autant de quoi on parle exactement, est présentée de
différentes manières. Comme le dit Cafaro, elle est une « marchandise savoureuse » et
ce symbole est même utilisé à l’occasion d’un spectacle théâtral de dégustation de
produits typiques25, Il pasto della tarantola (Le festin de la tarentule), mis en scène par une
compagnie de Lecce. D’ailleurs, n’importe quel site sur la musique traditionnelle
salentine, y compris les pages web des musiciens eux-mêmes, prévoient toujours des
liens d’informations touristiques.
56 Quoi qu’il en soit, le succès du festival fait débat. Des critiques fusent de toutes parts à
l’encontre d’un événement qui est taxé de trahison de la tradition, de gaspillage de
l’argent public (pour payer notamment les vedettes internationales qui, à chaque
édition, sont invitées à unir leurs voix et leurs traditions musicales à celles des
chanteurs et musiciens locaux : il y a eu, entre autres, Joe Zawinul et Stewart Copeland)
ou, enfin, de n’être qu’une « grotesque roulotte de cirque pour les vacanciers »26. À côté
des critiques, il y a aussi les efforts, fournis généralement par les mêmes détracteurs,
pour détrôner le festival de son monopole du renouveau de la musique traditionnelle
salentine. D’autres festivals voient ainsi le jour ces derniers temps. De nouveau, on
pourrait comparer la situation du Salento à celle décrite par Anne Doquet à propos de
Sangha. Elle affirme que « la réputation de certains lieux pour leur tradition originale
peut, en effet, être controversée par d’autres lieux revendiquant la primauté de la
cérémonie ». Et, à ce propos, Anne Doquet (2002 : 121-123) cite le cas de la région de
Bandiagara qui cherche à contrer le monopole touristique de Sangha et a mis en place
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
232
dans ce but en 2000 une nouvelle forme de danses masquées intitulée « festival des
masques ».
57 Dans le cas de Melpignano et du Salento, même si, au moins localement, les opérateurs
culturels sont conscients de la différence par rapport au passé et au tarentisme, des
conflits parfois très exacerbés naissent entre puristes d’une part et tenants du
métissage de l’autre, surtout à propos de la musique traditionnelle et du folk revival. Les
« montreurs de culture » (ibid. : 119) à l’instar de Blasi sont souvent conscients du fait
que les opérations contemporaines de remaniement de la tradition n’ont rien en
commun avec le tarentisme décrit par de Martino. Cependant, ils profitent (en termes
du succès du Salento sur le marché touristique) de la confusion générée par leur
démarche chez les touristes. Ainsi, les touristes quittent le Salento en ayant le plus
souvent une idée tout à fait altérée du tarentisme d’antan et des manifestations de ces
dernières années.
Entre succès et vitrification
58 Quoi que l’on en dise, le tarentisme, épuré de tout aspect non vendable, est à la base du
succès de cette péninsule dansante qu’est le Salento contemporain. Le pouvoir
libérateur de la pizzica, le caractère festif de tout rassemblement à l’occasion des
concerts, se manifeste de façon plus générale dans le rapport au terroir. Du Salento on
exalte la magie, l’authenticité et le caractère intacte et sauvage. C’est cette image qui
est vendue aux touristes. De plus, nombre de résidents secondaires notamment
étrangers affirment avoir retrouvé là-bas un rapport plus sain et pour ainsi dire
ancestral avec la « terre » et avec eux-mêmes27. Cette dimension est également promue
par le biais du cinéma qui renvoie une image peut-être édulcorée du Salento mais sans
aucun doute parfaite du point de vue de la promotion de ce dernier. Si les films du
réalisateur Edoardo Winspeare sont parfois critiqués pour renvoyer aussi bien une
image de carte postale qu’au thème pernicieux du « sang », des « racines », des
traditions et de l’authenticité (voir par exemple son film Sangue vivo), il est pourtant
certain que par ce biais, le Salento a su également se valoriser.
59 Enthousiastes de cet essor, les administrateurs locaux et nombre d’opérateurs culturels
ont alors parlé de « renaissance ». Autour notamment de la taranta dans tous ses
avatars, ont prospéré l’industrie touristique, du loisir et du spectacle. La pizzica d’abord
et la taranta ensuite sont devenues les emblèmes de la « salentinità » », c’est-à-dire de la
prétendue identité locale dont on est très fier.
60 Or, comme dans le cas des « montreurs de culture » maliens aux buts économiques, il
s’agit tout d’abord d’une opération de marketing territorial très avisée. Ce ne sont pas
simplement les élites locales qui profitent de ces remaniements, la population locale en
tire également bénéfice. Alors que les anciens profitent d’un nouveau statut et d’un
gain d’autorité en tant que porteurs d’une culture perçue comme originaire et
authentique — et chaque fois que l’un d’entre eux meurt c’est, comme le disent les
« entrepreneurs » locaux « de la tradition », un morceau entier de civilisation qui
disparaît — les jeunes trouvent de nouvelles chances d’épanouissement dans le
tourisme ou dans le milieu très dynamique des groupes du renouveau de la musique
traditionnelle.
61 Pourtant, une fois dévoilées les motivations « matérielles » des sujets impliqués dans ce
processus, il ne faudrait pas par la suite les accuser d’inauthenticité. Au contraire. Dans
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
233
le cas du Salento, le tourisme est effectivement un atout majeur pour la communauté
locale et pour le territoire. De plus, par ce biais on découvre un nouveau rapport à des
traditions qui autrement auraient sans doute été oubliées. Le tourisme peut bien être
aujourd’hui, comme le soutient Anne Doquet à propos des dogon touristifiés, un lieu
d’expression des identités. Et on le voit très clairement dans le Salento. Car, s’il peut y
avoir des mises en scène de la tradition, « dans les coulisses se jouent des négociations
qui font sens pour les acteurs et peuvent générer des resocialisations et des
reformulations identitaires qui sont bien contemporaines » (Doquet 2002 : 125).
62 Dans ce processus, les élites locales salentines ont eu dans les mains non seulement La
terre du remords comme référent privilégié par rapport au passé et aux traditions sur
lesquelles il fallait à nouveau se brancher tout en les patrimonialisant, mais aussi La
pensée méridienne (1996) du sociologue de Bari, Franco Cassano. Grâce à ce livre, ils ont
appris l’importance d’une pensée du Sud par le Sud lui-même, autrement dit d’un Sud
autonome par rapport au Nord, et l’importance d’atteindre le développement en
partant des ressources locales, sans mimétisme d’aucune sorte.
63 Celui de Cassano pourrait être considéré comme un nouveau méridiona- lisme, ou, en
utilisant une expression forgée par Jean-Loup Amselle (2008 : 232-233)28, un autre cas de
figure de « sud-alternisme ». Il s’agit d’un sud- revivalisme dans lequel le Sud devrait
devenir, d’après le sociologue de Bari, le sujet de sa propre pensée et cesser d’être
pensé par les autres. Ce qui signifie échapper au regard exotisant que l’on a souvent
jeté sur lui. Comme le rappelait Ernesto de Martino (1999 : 16) dans La terre du remords,
« lorsque, à partir de 1561, les jésuites entreprirent leur action missionnaire dans le
Vice-Royaume de Naples et disséminèrent leurs collèges dans les Abruzzes, la Pouille,
Naples et la Sicile, l’expression d’“Inde italienne” leur venait souvent aux lèvres pour
désigner cette partie de l’Italie ». Et, pour ne considérer que le cas du tarentisme, il y a
toujours eu une forte dose d’exotisme dans la façon d’appréhender ces corps se
mouvant de façon obscène, presque à mimer l’acte sexuel. Pizza (2002 : 53) voit dans
cette insistance sur « l’érotisme des corps dansant possédés par le rythme », l’existence
d’une projection orientaliste interne du regard occidental.
64 Première remarque : même si à l’origine du succès du Salento demeure le souci
idéologique de se penser par soi-même, c’est-à-dire devenir autonome par rapport aux
images fabriquées par les autres, il n’est pas du tout certain que l’on ait réussi à sortir
du piège de l’exotisme. Au contraire. Justement parce qu’il s’agit de quelque chose
fonctionnant très bien du point de vue de la promotion touristique, les élites locales ont
donné à voir une image figée et exotique de leur culture et de leurs traditions.
Certaines voix, de plus en plus nombreuses, critiquant la gestion contemporaine de la
tradition, mettent ainsi en garde les « montreurs de culture » salentins contre les
risques d’une construction d’images édulcorées qui finirait par transformer le Salento
en « un dépôt d’altérités exotiques » (Portelli 2002 : 72).
65 La seconde remarque concerne la mode du Salento. Le succès touristique et musical de
ce dernier suffit-il vraiment à parler de « renaissance » ? Suffit-il de croire que l’on ait
atteint le tant convoité développement alternatif de la région ? De périphérie
marginale d’un Sud perçu comme étant perpétuellement en retard et en manque de
développement par rapport au reste du pays, le Salento est devenu, au cours des dix
dernières années, une « région musicale », connue bien au-delà des frontières
nationales. Lorsque la nouvelle de la parution de l’édition anglaise de La terre du remords
— presque un demi-siècle après la publication en Italie — circula dans le milieu
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
234
salentin, l’élite locale se demanda tout d’abord si plus d’intellectuels anglophones
iraient acheter des résidences secondaires dans le Salento (Pizza 2005).
66 Or, face à la mode du Salento, force est de s’interroger sur les raisons de son succès et
aussi sur sa rançon. Encore une fois, il est possible de faire un parallèle entre l’Afrique
d’une part et le Salento de l’autre. D’après Jean-Loup Amselle (2002 : 47), il y aurait
actuellement deux représentations majeures de l’Afrique : tout compte fait, cette
dernière reviendrait à être, de façon contradictoire, une entité dégénérée et/ou une
source de régénération. Le Salento, comme d’ailleurs le Sud de l’Italie en général, me
paraîtrait être victime des mêmes fantasmes, entre esthétisation et exaltation de son
primitivisme d’une part et lieu de tout genre de corruption, voire enfer mafieux de
l’autre. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Salento a du succès auprès des résidents
secondaires, dans certains cas étrangers, c’est-à-dire auprès de gens qui s’impliquent
peu ou pas du tout dans la vie locale (Urbain 2002 : 47) et peuvent ainsi rester fascinés
même par des éléments de la vie locale qui ne renvoient qu’une image de retard et de
dégradation.
67 Ainsi, les politiques culturelles locales qui, par le biais de la patrimonia- lisation des
traditions, voient aujourd’hui le tourisme comme la panacée contre tous les maux,
risquent surtout de déboucher sur une « vitrification » (Amselle 2005) d’un Salento
esthétisé et réifié, c’est-à-dire sur un processus qui fait foncièrement bon marché de la
dimension sociale et des problèmes d’ordres politique et économique qui perdurent.
BIBLIOGRAPHIE
AGAMENNONE, M.
2005 Musiche tradizionali del Salento. Le registrazioni di Diego Carpitella ed Ernesto de Martino (1959,
1960), Roma, Squilibri.
AIME, M.
2000 Diario dogon, Torino, Bollati Boringhieri.
AMSELLE, J.-L.
2001 Branchements. Anthropologie de l’universalité des cultures, Paris, Flammarion.
2002 « L’Afrique : un parc à thèmes », Les Temps Modernes, 620-621 : 46-60.
2005 L’art de la friche. Essai sur l’art africain contemporain, Paris, Flammarion.
2008 L’Occident décroché. Enquête sur les postcolonialismes, Paris, Stock.
BEVILACQUA, S.
2005 « Tarantismo e patrimonio : un culto della memoria », Melissi, 10-11 : 73-82.
BLASI, S.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
235
2007 « Dalla festa la sfida del nuovo Sud », in S. QUARTA (dir.), La Notte della Taranta 1998-2007. Breve
storia per testi e immagini dei dieci anni che hanno « rivoluzionato » la musica popolare salentina, Lecce,
Guitar Edi- zioni : 3-5, <http://www.lanottedellataranta.it/decennale.php>.
CAMARA, S.
1999 « Préface », in A. DOQUET, Les masques dogon. Ethnologie savante et ethnologie autochtone, Paris,
Karthala.
CAROLI, E.
2008a L’alternative méridienne. La construction du griko et de la pizzica comme éléments d’une culture du
Mezzogiorno, Thèse de doctorat, Paris, EHESS.
2008b « Entre renaissance culturelle et persistence de la question méridionale : le cas de l’essor
touristique du Salento contemporain (Italie) », Articulo, revue de sciences humaines, 4, <http://
revue-articulo.eu/index.php?art=160>.
CARPITELLA, D.
1999 « L’exorcisme chorégrapho-musical du tarentisme », in E. DE MARTINO (dir.), La terre du
remords, Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo : 453-466.
CASSANO, F.
1996 Il pensiero meridiano, Bari, Laterza [première édition française : 1998].
CASSIN, E.
1962 « Recension », La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud, Ernesto DE MARTINO,
L’Homme, II : 131-133.
CAVALLARO, R.
2008 « Les Pouilles. L’Italie secrète », Ulysse, 125 : 54-89.
CHATTERJEE, P.
1997 Our Modernity, Rotterdam, SEPHIS; Dakar, CODESRIA, <http://www.sephis.org/pdf/
partha1.pdf>.
CHIRIATTI, L.
1979 II tarantismo vent’anni dopo de Martino, Mémoire de maîtrise, Lecce, Mimeo, Université de
Lecce.
1995 Morso d’amore. Viaggio nel tarantismo salentino, Cavallino, Capone.
CIARCIA, G.
2001 « Exotiquement vôtres. Les inventaires de la tradition en pays dogon », Terrain, 37 : 105-122.
CIARDO, A. A.
2007 « Un posto nel cuore del Salento per la “regina” Helen », La Gazzetta del Mezzogiorno, 30
marzo : 25.
COLLU, R.
2004 Personaggi ordinariamente straordinari del Salento, Nardo, Besa.
DI MITRI, G. L.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
236
2005 « Il riscatto del musico ignoto. Luigi Stifani fra invisibilité e redenzione », Melissi, 10-11 :
43-47.
2006-2007 « Fieri, perduti e reinventati o della retorica identitaria », Melissi, 12-13 : 28-33.
DOQUET, A.
1999 Les masques dogon. Ethnologie savante et ethnologie autochtone, Paris, Karthala.
2002 « Dans les coulisses de l’authenticité africaine », Les Temps Modernes, 620621 : 115-127.
FUMAROLA, P. & LAPASSADE, G.
2006-2007 « Identité locali e pensiero meridiano », Melissi, 12-13 : 61-64.
GRADHIVA
2000 E. de Martino, 26.
GRIAULE, M.
1948 Dieu d’eau, Paris, Éditions du Chêne.
LAPASSADE, G.
1976 Essai sur la transe, Paris, Jean-Pierre Delarge.
1982 Gens de l’ombre. Transes et possessions, Paris, Méridiens-Anthropos.
Musiques traditionnelles et production d’identités culturelles locales, <http://
www.canzonieregrecanicosalentino.net/lapassade.htm>.
LEIRIS, M.
1980 « Préface », in G. ROUGET, La musique et la transe. Esquisse d’une théorie générale des relations de la
musique et de la possession, Paris, Gallimard : 7-14.
DE L’ESTOILE, B.
2001 « Le goût du passé. Erudition locale et appropriation du territoire », Terrain, 37 : 123-138.
DE MARTINO, E.
1959 Sud e magia, Milano, Feltrinelli. [première édition française : 1963].
1999 La terre du remords, Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo. [première édition italienne :
1961 ; première édition française : 1966].
2005 The Land of Remorse. A Study of Southern Italian Tarantism, London, Free Association Books.
MELISSI
2005 10-11.
MINA, G. & TORSELLO, S. (dir.)
2006 La tela infinita. Bibliografía degli studi sul tarantismo mediterraneo 19452006, Nardo, Besa.
MINGOZZI, G.
1978 Sud e magia, documentado, 4 puntate, 16mm, colore, consulenza e testo, Annabella Rossi e
Claudio Barbati.
1982 Sulla terra del rimorso, documentado, 16mm, colore, 60’, testo, Claudio Barbati, Annabella
Rossi.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
237
2002 La taranta. Il primo documento filmato sul tarantismo, Nardo, Besa. [allegata VHS La Taranta,
documentario 1962, 35mm, b/n, 20’, con testi di Salvatore Quasimodo e Ernesto de Martino].
MISCUGLIO, A. & CHIRIATTI, L.
2004 Osso, sottosso sopraosso. Storie di santi e coltelli. La danza scherma a Torrepaduli, Calimera,
Kurumuny.
NOCERA, M.
2000 « Diario di un musico delle tarantate : Luigi Stifani di Nardo », in L. STIFANI (dir.), Io al Santo ci
credo. Diario di un musico delle tarantate, Lequile, Aramirè : 30-35.
2005 Il morso del ragno. Alle origini del tarantismo, Lecce, Capone editore.
PISANELLI, P.
2006 « Il sibilo lungo della Taranta. Musiche e poesie sui percorsi del ragno del Salento, dagli anni
Sessanta fino a “La Notte della Taranta” », documentario, Big Sur, Italia, 88’.
PIZZA, G.
2002 « Lettera a Sergio Torsello e a Vincenzo Santoro sopra il tarantismo, l’antro- pologia e le
politiche della cultura », in V. SANTORO & S. TORSELLO (dir.), Il ritmo meridiano. La pizzica e le identité
danzanti del Salento, Lecce, Aramirè : 43-63.
2005 « Ancora nella terra del rimorso per smascherare la retorica sul Sud », Il Corriere del
Mezzogiorno, 2 décembre, <http://www.vincenzosantoro.it/salentopizzicamusiche.asp?ID=282>.
2006-2007 « La traccia demartiniana e la celebrazione della ricerca », Melissi, 12-13 : 65-72.
PORTELLI, S.
2002 « La memoria della pizzica », in V. SANTORO & S. TORSELLO (dir.), Il ritmo meridiano. La pizzica e
le identité danzanti del Salento, Lecce, Aramirè : 67-76.
QUARTA, D. (dir.)
2007 La Notte della Taranta 1998-2007. Breve storia per testi e immagini dei dieci anni che hanno
« rivoluzionato la musica popolare salentina », Lecce, Guitar Edizioni, <http://
www.lanottedellataranta.net/>.
ROUGET, G.
1980 La musique et la transe. Esquisse d’une théorie générale des relations de la musique et de la
possession, Paris, Gallimard.
SANTORO, V. & TORSELLO, S. (dir.)
2002 Il ritmo meridiano. La pizzica e le identité danzanti del Salento, Lecce, Aramirè.
STIFANI, L. (dir.)
2000 Io al santo ci credo. Diario di un musico delle tarantate, Lequile, Aramirè.
TARI, M.
2004 « Finis Terrae. Antropologia, immagine, multitudo », in L. CHIRIATTI & M. NOCERA (dir.), Le
immagini del tarantismo. Galatina : il luogo del culto, Cavallino, Capone : 3-28.
TORSELLO, S.
2000 « Luigi Stifani ne La terra del rimorso e altre opere », in L. STIFANI (dir.), op. cit., 21-29.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
238
2006 « Panorami e percorsi. La letteratura sul tarantismo dopo La terra del rimorso », in G. MINA
& S. TORSELLO (dir.), op. cit. : 25-48.
ULYSSE
2008 « L’Italie secrète », 125, juillet-août.
URBAIN, J.-D.
2002 Paradis verts. Désirs de campagne et passions résidentielles, Paris, Payot.
NOTES
1. De ce point de vue, je m’éloigne partiellement de ce qu’affirme Salvatore Bevilacqua dans son
article sur le tarentisme et le patrimoine. Quoiqu’il souligne en fin d’article les ressemblances
entre Salento et Pays dogon, BEVILACQUA (2005 : 80) affirme, sans en expliquer clairement les
raisons, qu’en ce qui concerne par exemple le mythe ethnographique griaulien, « la comparaison
avec le mythe de La terre du remords est sans doute un peu forcée ».
2. Pour une étude plus détaillée du Salento contemporain, je renvoie à ma thèse de doctorat
(CAROLI 2008a). Pour un aperçu plus synthétique, voir également CAROLI (2008b). Ici, je ne prendrai
en compte que les quelques éléments qui permettent, à mon avis, la comparaison.
3. Les dernières éditions ont vu également la participation de villes ne faisant pas partie de la
susdite Union.
4. Voir l’interview d’Antonella Gaeta à Sergio Blasi parue dans La Repubblica- Bari du 24 août 2004,
p. II.
5. fait dernièrement l’objet au niveau international. D’ailleurs, après avoir explicité la recette du
succès grandissant de ce festival, l’article consacré à Melpignano s’attarde sur la description du
tarentisme dont on fait remonter l’origine jusqu’aux rites dionysiaques de l’Antiquité. De la
même manière, Salvatore BEVILACQUA (2005 : 73, 82) fait mention d’une description
ethnographique du tarentisme dans le guide Gallimard consacré à l’Italie du Sud et affirme que ce
n’est que le Salento qui profite de ce genre de commentaire.
6. Nistri, cité dans TORSELLO (2006 : 44-45).
7. <http://www.lanottedellataranta.it/decennale.php>. Il s’agit d’un extrait de l’introduction de
Sergio BLASI (2007 : 5) au livre de Dario Quarta paru à l’occasion de la dixième édition du festival.
8. Voir A GAMENNONE (2005 : 20). En 1960, un an avant Mingozzi, Diego Carpitella filma une
thérapie domiciliaire à Nardo et une « reconstruction artificielle » à Muro Leccese. Le film, qui
représente « la première documentation cinématographique du tarentisme », est présenté au VIe
Congrès International des Sciences anthropologiques et ethnologiques, qui s’est tenu à Paris du
30 juillet au 6 août 1960.
9. Gallini citée dans TORSELLO (2006 : 25, 44).
10. Valli cité dans TORSELLO (ibid. : 45).
11. En ce sens l’ouvrage édité par MINA et TORSELLO (2006) apporte une preuve irréfutable.
12. Il suffira de citer le numéro spécial de GRADHIVA (2000) consacré à de Martino ou la récente
parution de la première édition anglaise de son ouvrage (DE MARTINO 2005).
13. D’ailleurs, le mémoire de maîtrise de CHIRIATTI (1979) — auquel se réfère de même qu’à La terre
du remords Georges L APASSADE (1982 : 125-134) pour son analyse du tarentisme — s’intitule Le
tarentisme vingt ans après de Martino.
14. Winspeare a joué un rôle majeur dans la patrimonialisation de la tradition du tarentisme, la
redécouverte de la pizzica et finalement la construction d’une identité salentine et d’un Salento
« dansant ». D’après lui, le Salento est devenu « la Woodstock italienne » (SANTORO & TORSELLO
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
239
2002 : 174) notamment grâce au choix « politique », fait par lui et d’autres au début des années
1990, d’organiser à peu près deux cents fêtes partout dans le Salento. Bien que la musique
salentine ne puisse se réduire à la pizzica, ils choisirent cette dernière et cherchèrent à en faire la
musique du Salento (ibid. : 172). Voir également l’entretien avec Winspeare paru dans le numéro
d’ULYSSE (2008 : 57-59). Il est également intéressant de citer ce qu'affirme le réalisateur à propos
de son cinéma, par le biais duquel il aurait « “décidé” une représentation du “monde paysan”, de
la pizzica et du tarentisme que beaucoup auraient par la suite considérée comme “authentique” »
(SANTORO & TORSELLO 2002 : 174). « Bien sûr j’ai été influencé par Mingozzi, par les enregistrements
audio-visuels de Brizio Montinaro, de Luigi Chiriatti, d’Oronzo Marmone [...] », aveu qui confirme
l’existence et l’importance du fil rouge présent dans les représentations du tarentisme, même au-
delà du champ strictement scientifique.
15. Pour la différence, voir CARPITELLA (1999).
16. On peut visionner le clip sur Youtube, <http://www.youtube.com/watch ?v = 0jryWN38HfQ>.
D’ailleurs, sur ce site le morceau est présenté comme étant « typique de la tradition salentine de
la Taranta ». Ce qui est tout à fait faux mais constitue une des nombreuses preuves de la tendance
actuelle — consciente ou inconsciente — à tout vouloir renvoyer à la tradition du tarentisme. De
ce point de vue, Internet est un réservoir d'exemples des superpositions et des confusions qui
dérivent de la survalorisation contemporaine de la pizzica et du taren- tisme. Voir par exemple
<http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=162907206>, page
d’un garçon milanais de vingt-huit ans qui se présente en tant que « Lega italiana tutela de : Lu
rusciu de lu mare » (« Ligue italienne pour la protection de Lu rusciu de lu mare »). Il est
intéressant de noter que parmi les buts de la prétendue ligue, il y aurait celui de « trouver le
premier Rusciu de lu mare jamais chanté dans l’histoire : le point de départ de notre parcours
ethnomusical ».
17. Pizza, cité dans TORSELLO (2006 : 26).
18. Voir également AIME (2000). Dans ce livre, l’anthropologue creuse « dans le complexe jeu de
miroirs instauré par la triangulation dogon-ethnologues- touristes » (p. 11). Il ajoute qu’« environ un
demi siècle s’est écoulé depuis l’apparition de Dieu d’eau et pourtant une certaine griaulisation des
Dogon reste encore aujourd’hui » (ibid. : 13). Aime souligne le rôle joué par les « ethnologues
dogonneux » et par les milliers de pages concernant la mythologie et la philosophie dogon, dans
la construction de l’image devenue célèbre de ce peuple. Il rappelle que, par la suite, les Dogon
ont proposé leurs traditions en s’appuyant sur la lecture des textes de Griaule (ibid. : 15).
19. Dans ce numéro de la revue, publiée par la maison d’éditions Besa de Nardo et consacrée aux
cultures populaires, sont publiés les actes du colloque Da Luigi Stifani allo show business — Salento,
lo sviluppo possibile (De Luigi Stifani au show business — Salento, le développement possible),
organisé par Melissi et la mairie de Nardo, en hommage à la figure du violoniste récemment
disparu.
20. Stifani demeurera toujours à l’intérieur du système de croyance partagé à la base du
tarentisme. Ainsi, d’après lui, une morsure tout à fait réelle déclenche la crise et saint Paul
accorde la grâce. Néanmoins, il finira par s’approprier partiellement les discours des spécialistes
avec lesquels il entrera en contact. À ce propos, l’interview de Giorgio Di Lecce et Maurizio
Nocera avec Stifani en 1992 est très intéressante, en ce sens que l’informateur cite de Martino et
Carpitella pour expliquer certains aspects du phénomène (NOCERA 2005 : 19-25).
21. Le titre est évidemment un autre clair hommage à de Martino. Sud e magia (Italie du Sud et
magie) était en fait le titre d’une autre monographie demarti- nienne (1959), précédente à La terra
del rimorso mais où de Martino introduisait déjà, en appendice, le cas du tarentisme.
22. Mis à part son rôle d’érudit local et son activité d’éditeur (avec la maison d’éditions
Kurumuny), Luigi Chiriatti est également un musicien avant la lettre du revival de la musique
traditionnelle salentine, mais aussi un opérateur culturel fortement impliqué dans la
patrimonialisation des traditions salentines. Il a par exemple œuvré ces dernières années à la
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
240
revivification de la fête du 1er mai dans la campagne de propriété de sa famille et organisé le
renouveau de la tradition des chants de la passion du Christ grâce notamment à une
manifestation qui a lieu désormais dans la Grecîa salentine chaque année avant Pâques.
23. Voir Georges L APASSADE, Musiques traditionnelles et production d’identités culturelles locales,
<http://www.canzonieregrecanicosalentino.net/lapassade.htm> (site visité le 24 avril 2004).
24. On peut visionner cette interview dans le film documentaire de Paolo PISANELLI (2006), Il sibilo
lungo della taranta. Ce documentaire reste à mon sens ambigu, en hésitant entre promotion du
festival La Notte della Taranta et présentation des différentes critiques dont ce festival fait l’objet.
25. Cette combinaison entre promotion de la musique traditionnelle et promotion des produits
typiques locaux semble bien fonctionner : le 3 avril 2007, par exemple, s’est tenue à Prague la
manifestation Tarantula Passionata de caractère promotionnel du territoire salentin, qui
comprenait une conférence sur les traditions salentines et notamment le tarentisme, un concert
et un tour œnogastronomique des produits typiques des Pouilles et du Salento. Voir Rivista della
Camera di Commercio e dell’Industria Italo Ceca, avril 2007, p. 31 (petit article sans signature de la
revue de la Chambre de commerce italo-tchèque trouvé à l’ambassade italienne à Prague).
26. D’après Luca Ferrari, le 17 octobre 2005, < http://www.vincenzosantoro.it/
salentopizzicamusiche.asp?ID=268>.
27. Voir l’article d’Antonio Andrea CIARDO (2007 : 25) concernant l’achat d’une ancienne masseria
salentine de la part de l’actrice Helen Mirren.
28. Les ressemblances sont frappantes entre La pensée méridienne de Cassano et la communication
Our Modernity que Partha Chatterjee présenta la même année (1997) dans le cadre de conférences
organisées par le SEPHIS et le CODESRIA en Afrique, <http://www.sephis.org/pdf/partha1.pdf>.
RÉSUMÉS
Cet article montre comment dans le Salento, une région fortement ethnologisée, a été impulsé un
tourisme culturel qui prend appui sur la patrimonialisation et la mise en scène de traditions qui
ont fait l'objet du regard anthropologique. Le catalyseur du succès du Salento durant les dix
dernières années est la taranta, le produit de la relecture d'une manière positive du tarentisme,
comme il avait été décrit notamment par de Martino. Dans cette contribution, le cas de figure du
Salento a été analysé, à partir de mes propres matériaux d'observation, et en comparaison avec le
processus analogue qui se produit au Mali et notamment en Pays dogon.
This article aims to show the ways in which cultural tourism has been encouraged in a deeply
ethnologised Italian region, the Salento. Promotional attempts have been led by means of politics
of cultural heritage and of mise en scène of ancestral traditions, once studied by anthropologists.
In the last decade, the taranta has catalysed this process. Analysing the taranta, we especially deal
with de Martino's tarantism as it is now experienced in a new, positive way. Finally, the case
study of the Salento is enriched here by making a comparison with the same kind of processes
observed in the Dogon region of Mali.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
241
INDEX
Mots-clés : Italie du Sud, Salento, Pays dogon, anthropologie, musique, pizzica, tarentisme,
tourisme
Keywords : South Italy, Salento, Dogon country, anthropology, music, pizzica, tarantism,
tourism
AUTEUR
ELINA CAROLI
Centre d’études africaines, EHESS, Paris.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
242
“We Offer the Whole of AfricaHere!”. African Curio Traders andthe Marketing of a Global AfricanImage in Post-apartheid SouthAfrican Cities1
« Ici, nous offrons toute l'Afrique ! ». Commerçants de bibelots africains et
commercialisation d'une image africaine globale dans les villes sud-africaines
après l'apartheid
Aurelia Wa Kabwe-Segatti
AUTHOR'S NOTE
The author would like to thank Sarah Davies Cordova, Assistant Professor of French,
Marquette University, Wisconsin, for her editing of the English version of this paper.
1 Where as South Africa has become an increasingly popular destination for migrants
from all over the world and more specifically the African continent since the late 1980s,
this has also been accompanied by widespread xenophobic reactions that recently
degenerated into massive violent attacks (Mattes et al. 1999; Landau 2006; Crush 2001)2.
At the same time, tourism has become more and more important to the country’s
economy but also central in transforming its image internationally in the post-
apartheid context. Interestingly, one of the few areas of seemingly successful and
peaceful encounter of South Africans with African migrants is that of African curio or
crafts markets which have opened in most South African large cities and along tourist
routes. This article only focuses on those markets for their specific connection with
current African migration. In that respect, they are different from other markets (such
as the famous muti markets3 or the fresh produce market at City Deep, Johannesburg,
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
243
for instance) that might have been, at some stage in South African history, connected
to migration networks but no longer play that role. If the African crafts markets are
comparable in many ways to other markets in South Africa, in terms of formalisation
processes, management models and marketing of “Afrocentricity”, they are the only
ones that both “stage Africa” to a mostly non-African public and constitute a real
encounter with the rest of the continent. What I try to do in this article, beyond
documenting what is also a fairly new phenomenon in South Africa and one which has
not been researched extensively so far, is to assess the type of imagery of Africa that is
produced in the exchanges of goods taking place in these markets and whether it is
bound to transform otherwise prevalent stereotyped and negative images of the
continent and its inhabitants in South African society4.
2 The paper contends that the emergence of “African markets” in the postapartheid
urban landscapes filled the niches created by the production of commodified images of
the country (Rasool & Witz 1996) and, by extension, the continent. The nature of urban
transformation deriving from these “uplifting experiments” in formalising street trade
is referred to here but remains beyond the scope of the present paper5. Rather, the
analysis focuses on the creative process at work around the identification and
multilayered reading of a “cosmopolitan” African identity as a strategic and tactical
tool by different groups of actors (South African municipal authorities, retail private
actors and migrant traders)6. Based on empirical material collected over a two-year
period, the paper tries to show how this process has fulfilled actors’ immediate and
contrasted needs but has not necessarily led to countering negative clichés on African
migration in the long run. It thus tries to make use of the theoretical framework of the
notion of ethnic entrepreneurship in its application to the South African context.
3 The paper explores how and why these groups of actors identified a renewed image of
Africa as the catalyst of their various expectations, in the 1990s and 2000s South
African contexts of migration and of political and urban change. It documents the
practices and activities of the African curio trade in South African cities, the products
sold, the trade networks and the imaginarles on which the perceptions of migrants,
market managers and municipal councillors rely and in turn continue to fuel. After
painting the specific cultural and political context of the South African tourism
industry and offering a brief overview of the circulation of products and people, that is
the dissemination of new trade and migration networks towards and within South
African cities, the paper tries to unpack the imagery of Africa that is conveyed to South
Africans and international publics as well as its genealogy.
Conceptual Framework and Methods
4 Although this work is drawn from research aimed at reexamining our understanding of
transnational trade migration, this specific paper only partly makes use of that
conceptual framework. Transnational trade migration has essentially been envisaged in
the literature from two main perspectives: one inscribing migrant traders’ activities
within broader structural and historical constraint systems and another insisting on
the agency of actors and their capacity to overcome these systems and develop survival
strategies. Following the example of MacGaffey and Bazenguissa’s approach to
Congolese traders (2000) or Riccio’s work on Murid transnational networks in Italy
(2006), the present paper rather envisages a middle-path. Both tendencies have
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
244
demonstrated their limitations in offering convincing analyses, either because they are
looking at transnational trade networks from above (institutions, structural economic
constraints) or from below (traders’ strategies and tactics).
5 Our object here is in fact much more the encounter, in its cultural and political
dimensions, and its aftermaths and how the circulation of people, goods and images
concur to transform prevalent perceptions of African migrants and Africa in post-
apartheid South Africa. Therefore, I have tried to locate the dynamics observed within
the growing literature on post-apartheid cultural transformation and more specifically,
the role played by tourism in that transformation (Hugues 2007; Jansen van Veuren
2003; Koch & Massyn 2001; Schutte 2003). I have also taken into account historical
evidence in order not to consider those transnational traders as “free electrons”, who
would not only be isolated from their country of origin but also without a past and
cultural assets. In doing so, I have used available literature on African migration to
South Africa (Bouillon 1999; Landau 2007; Landau et al. 2006; Morris 1999) as well as
literature on the cultural dimension of African diasporic trade (Coombe & Stoller 1994;
Stoller 2003) and on new forms of mobility, liminality and urbanisation in Africa
(Landau 2005, 2006; Malaquais 2006). An approach in terms of ethnic entrepreneurship
(see part 4 “We Offer [...]”) was favoured here.
Tourism, Urban Regeneration and African Migrants
6 Tourism in post-apartheid South Africa has benefited from the post-1994
unprecedented opening to global tourist itineraries of various forms (classical game
and nature tourism, cultural and heritage tourism, and increasingly business and global
events tourism such as the World Summit on Sustainable Development in 2003 or the
coming 2010 Soccer World Cup). Whereas tourism used to be mainly domestic and
reserved to the white elite, its demographics have changed drastically in the 1990s. As
the number of foreign tourists has more than doubled since 1994, tourism is now the
fastest growing sector of the South African economy. In 2006, tourism represented 8.6%
of South Africa’s Gross Domestic Product and allowed for much hope in terms of
development potential (Pisanti 2007). However, there is much controversy around the
figures of tourism in South Africa. If it is estimated that the number of tourist permits
granted has gone from below a million a year in 1990 to over 9 million in 2007, one
should bear in mind that international tourists only account for one quarter of this
figure, the rest being people from the region, mostly travelling for non touristic
purposes (Barnes 2008; Hugues 2007). Tourism research literature on South Africa has
focused on certain cultural and identity aspects, notably the exploration of new forms
of heritage tourism (Nuttall & Coetzee 1999), of community tourism and its boom in
townships and rural areas (Preston-White & Rogerson 1990, 2003), or the exploration of
media constructed images of South Africa and its past that tend to essentialise the
country around animal wildlife, primitive tribalism and modernity (Rasool & Witz
1996). Mathers and Landau (2007) have recently explored the paradoxes of “Proudly
South African” tourism and the ethical problems it raises in terms of racism and
xenophobia.
7 But tourism in post-apartheid South Africa has not just been about increasing the
number of overseas tourists. It has, since 1994 in particular, become part and parcel of
the nation-building enterprise undertaken by the South African government as well as
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
245
a grassroots trend to display the transformation of identities in the new political
dispensation and to exhibit it as a self-redefinition process and a new face to the rest of
the world (Hugues 2007: 273), with a specific emphasis on heritage sites, from struggle
“lieux de mémoire” such as Robben Island to cultural villages and township tours.
8 The literature on migrants’ trade activities in post-apartheid South Africa has paid
scant attention to the involvement of migrants in the tourism industry. It has
essentially focused on documenting trade as a self-generating income earning activity
or as an opportunity for job creation and capacitybuilding for local populations
(Rogerson 1997; Peberdy & Rogerson 1999). Other works try to understand the roots
behind xenophobic treatments of migrant traders by local authorities and populations
(Landau 2005, 2006).
9 The transformation of post-apartheid South Africa from a refugeegenerating nation
into a new “eldorado” for international migrants and refugees from all over the
continent and beyond has now been relatively well documented (Bouillon 1999; Crush
1998; Crush & Williams 1999; Wa Kabwe-Segatti 2006). One of the most visible loci of
this “new” African presence is the market. Historically, South African cities have been
characterised by racial and social segregation and a fluctuating sense of public and
private space. By African or European standards, South African markets are few and far
between, even in a city like Johannesburg considered as the economic hub of the
country and the continent. The large fresh produce market that used to be the
heartbeat of the city in Newtown before the arrival of the National Party to power, was
relocated outside the city, at City Deep, as part of the modernisation works that were
carried out in the 1960s and 1970s (Guillaume 2001; Chipkin 1993). Until the 1980s,
street trading and hawking in inner city Johannesburg and the suburbs was strictly
regulated. With the repeal of influx control and of the Group Areas Act in the
mid-1980s, this activity started to become a durable feature of the city (Morris 1999).
However, it is not before the early 1990s that markets of a new type appeared. With the
advent of democracy and the (re)opening of the country, African curio markets, first as
a transformation of already existing flea markets (the Rosebank Rooftop market or
Bruma Lake in Johannesburg), and then as specific ventures, became in their turn a
new feature of South African cities and tourist sites.
10 In this urban post-apartheid context, one spatially more marked by fragmentation than
by economic and social continuity (Tomlinson et al. 2003; Harrison et al. 2003), curio
markets seem to have fulfilled three types of expectations: those of African migrants in
search of “respectable” income generating activity and of market niches; those of
South African market management business entrepreneurs seeking to diversify their
activity and conquer new markets; and those of South African local/municipal
institutions in search of formal economic activities to counter “urban decay” problems.
The diversification of retail points was then a general trend in all South African cities, a
point confirmed by Landre (1999). In Rosebank, an upmarket shopping area of
Johannesburg, the African Craft Market has become a new identity marker while a
Community Improvement District, a public-private urban renewal partnership, was set
up. The initiatives allowed the suburb to compete with other upmarket shopping areas
like Sandton and Hyde Park while keeping that different, “laid-back” style. Purely
private ventures like the Bruma market in Johannesburg or the Chameleon Village
market near Hartbeespoort in the North West, have helped to formalise growing
informal retail nodes7. Increasingly, markets are conceived by these local stakeholders
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
246
as nodes, combining a potential for job and growth creation with a social function, that
of endowing a suburb with a certain identity, and therefore marketing it locally,
regionally, nationally and internationally. It is now worth turning to the actual setting
up of the trade networks that allowed for the creation of these markets over the past
two decades.
The Circulation of Products and People: the Story ofan Encounter
11 Under apartheid and in the years immediately afterwards, South African “ethnic” craft
retail was fairly limited. It mainly offered crafts from neighbouring countries (Lesotho,
Mozambique, Swaziland and Zimbabwe). It was characterised by little variety and
adaptation to customers’ tastes and finally, by a geographical distribution in South
Africa that was shaped by apartheid heritage tourism policy, a policy that mainly
valued colonial sights. This scarcity and poor creativity was also a direct legacy of
apartheid policies in terms of basic and vocational education, entrepreneurship,
residential segregation and artistic and cultural policy. African curio markets were
therefore mainly informal, concentrated in the rural areas in the vicinity of touristic
sights and offered what locals were able to make there. The first markets to benefit
from the “ethnic” trend that materialised in the early 1990s were the “flea markets” of
Bruma Lake for instance in Johannesburg and Green Market Square in Cape Town,
although they did not offer at the time the variety and volume that exist today. The
curio market industry peaked around 1998-1999 and has stood on the verge of
saturation since, according to Bruce Jones, Managing Director of the B&B Company, one
of the major market management companies in Gauteng. The current context reflects
growing competition and therefore tension resulting from three main factors: first, the
import of Chinese crafts whose quality has significantly improved since the early 2000s
and which have since had a direct negative impact on South African craft making and
retail; second, the increase in the number of shopping malls, markets and broadly
speaking craft retail points throughout the country with malls evolving towards more
lifestyle and more interactive retail spaces in direct competition with markets; and
third, the lack of interest for crafts markets from the emerging black middle class,
characteristically more attracted to malls and other types of goods8.
12 Unsurprisingly, none of the first generation (late 1980s-early 1990s) African migrants
interviewed indicated having come to South Africa with the clear idea of establishing
themselves as curio traders. Most of the Congolese interviewed mentioned for instance
the constraints of the South African labour market as the main incentive for
entrepreneurship, mainly because their qualifications are not recognized and their
legal status (refugees, asylum seekers or temporary visitors) represents a liability. This
is consistent with what Bouillon (1999) or MacGaffey and Bazenguissa had documented
in the 1990s for Central Africans in particular, showing that they were initially mainly
involved in qualified occupations and trade or smuggling activities of a different nature
(MacGaffey & Bazenguissa 2000: 48-49) and with the results of the Wits-Tufts-IFAS 2003
and 2006 quantitative surveys undertaken in Johannesburg among 600 migrants in
selected neighbourhoods9. Occasionally, some brought samples of curio items in their
luggage as assets they could easily exchange for cash on their way South. Things such
as malachite beads or Kuba cloths from Congo or some “wood”, that is wooden masks
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
247
and statues from Cameroon, were brought in people’s luggage during that period. Very
clearly, although the actual history of that trade remains to be written, some
diversification and stratification occurred. Over a few years, traders moved from
dealing in products originating from their home country only to a variety of sources,
from retail to wholesale and vice-versa and from informal to formal activities. Product
diversification seems to have been rather recent (since approximately the early 2000s)
whereas specialisation (or passage between) activities (retail, wholesale,
craftsmanship), supply strategies and retail techniques seem to have evolved rapidly
from the early 1990s onwards. The trajectory of BF is quite typical of these
diversification, segmentation and specialisation processes:
“Having arrived in South Africa in 1994 from the Democratic Republic of Congo(Zaïre at the time), BF started curio trade by asking his family back home to sendhim beads of malachite that he would transform into necklaces and bracelets andsell to retailers at the Bruma flea market on the road to the Johannesburg airport.This activity enabled him to save enough money to start his own business, on thestreet, outside the main Mall at Rosebank, one of Johannesburg’s affluent suburbs,in the late 1990s. From outside the market, he moved inside like others during theformalisation process of the Rosebank African Craft Market in 2000 and opened hisown shop. He prospered in this activity, passing from malachite to the selling ofKuba cloths and masks and statues from West and East Africa until January 2007when he decided to sell his shop to become a wholesaler in Kuba cloths only and useall his network of former colleagues from Rosebank, Bruma and beyond as his firstcustomers” (BF, former shop owner and currently independent wholesaler,Johannesburg, 19/05/2006, 18/08/2006 & 22/09/2007).
13 Whereas passage from retail to wholesale activities seem to depend more on traders’
good fortunes and sense of where they can make more profit than to follow some
economic model, supply strategies seem to have clearly evolved towards segmentation:
fewer and fewer traders still travel directly back home as most buy from wholesalers
who come to them, sometimes directly at the marketplace. Some orders are still placed
with relatives back home (that is particularly the case for Bamoum people,
Cameroonians originating from the Foumban region, South West of Cameroon,
neighbours of the Bamileke group, also traditionally involved in trade10) or some
Congolese specialising in Kuba cloths. In such instances, the family network is crucial in
organising the sending of a shipment by sea or air. Even for those using family
networks back home to replace stocks, some specialisation has occurred with those
back home increasingly becoming professional supplying agents (as well as craftsmen
sometimes, especially in Cameroon) and those in South Africa specialising in retail. BA,
from the Foumban region in Cameroon, who owns a shop in Rosebank, explains:
“In a way, I wouldn’t like my brothers and sister to come over here. I have threebrothers and one sister who are married. They make different products for me. Ifthey leave, it will be difficult to find replacement for that. We work like a clan, so ifthey travel, really, it will be difficult for me to replace them” (BA, shop owner,Rosebank African Craft Market, 05/09/2006).
14 The airfreight and money transfer agencies, operated by the Congolese in particular
(such as Full Service in Yeoville and Kin Express in Observatory, Johannesburg), are
pivotal in enabling those flows which have grown from informal and haphazard
suitcase arrangements in the 1990s to fairly professional transactions in the 2000s. As
BF, the Congolese trader quoted previously, explains, he now hardly ever travels back
home but has set up his own supply network, relying partly on personal ethnic/family
ties, partly on formal and semi-formal intermediaries:
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
248
“I have a young one (‘un petit’) from Kasai' in Mweka [Kasai]. I call him to place myorders [...] he knows every nook and cranny there. I send him the money throughthe agencies and he then sends a parcel with Hewa Bora11. With my SARS VATnumber12, I can then take these through customs. We have invoices for that. Ofcourse, the amount is slightly inferior to the actual amount of the goods so that wepay less. There is absolutely no need to bribe anyone at O.R. Tambo [JohannesburgInternational Airport]. The only thing that is sometimes expensive is storage fees”(Interview with BF, independent wholesaler, Johannesburg, 22/09/2007).
15 The money transfer agencies do not operate within the South African exchange
regulation system as they normally should. In that sense, they remain informal or
illegal even if the cellphone cash transactions and reference number system they rely
on are efficient and reliable enough to allow for their durability. Kin Express for
instance opened in the mid-1990s and has since expanded its activity to airfreight and
bed and breakfast.
16 Another important transformation that has taken place since 2000 is the spread of
those markets along the main touristic roads and around touristic sights. From the
main centres in Johannesburg (Bruma, Rosebank), curio markets of various sizes and
degrees of formalisation have appeared in Soweto, outside the Hector Pieterson
Museum, and at the Hartbeestpoort Dam (Cramerview) along the R512 that leads to Sun
City and the Pilanesberg Nature Reserve and beyond. In Cape Town, from Green Market
Square and Long Street, they have spread throughout the region, along the wine route,
and are found in Stellenbosch, Franshoek, and along the Coast and the Garden Route, in
Hout Bay, Hermanus and Knysna. They can now also be found in all South African
major secondary cities (Nelson Mandela City, ex-Port Elizabeth, Durban, Bloemfontein)
and in small touristic towns, such as for instance Graskop in Mpumalanga (along the
Northern Drakensberg Route). Wholesalers, a little like 18th and 19th centuries peddlars
in the remote regions of the colony, get on buses with sports or shopping bags full of
their products and thus regularly replenish the stocks of their customers (either
African migrants or local shops) in those remote localities. Given this territorial
dispersal, African migrant shopkeepers no longer commute between large urban
centres and those smaller touristic towns. They tend to settle close to their shops and
only travel back to the larger centres whenever they need something out of the
ordinary or want to reconnect with the “home community”. Some have set up shops in
several places, as business ventures where the partners manage different shops and
buy stocks jointly. Mr and Mrs K., a couple of Congolese traders, started at the
Johannesburg Bruma Lake market in the 1990s, and then set up two shops at the
Hartbeespoort Chameleon Village Crafts Market and then another one across the street
at the municipal market. After having commuted between Johannesburg (an hour and a
half drive from there) for two years, they decided to keep one flat in Johannesburg for
their children (attending high school and university there) and one for the two of them
in Brits, a small town nearby, where most of the Chameleon Village African traders of
Congolese, Cameroonian and Senegalese origin, now stay13.
17 Except in the case of some better established Senegalese and Cameroonian traders who
travel directly to supplying countries about once a year (Côte-d’Ivoire, Senegal,
Cameroon and Gabon) to organise stock replacement, most traders interviewed have
become specialised in retail and wait for wholesalers to come and contact them at
regular intervals. The entire sector has developed over the last ten to fifteen years and
brought to the heart of South African cities products and people from the rest of the
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
249
continent. The whole sector fulfilled a “need for Africa” that was not only aimed at
international tourists but at South Africans in a period of unprecedented
transformation of their political and cultural self-representations. Let us now turn to
the various functions filled by this specialised trade activity.
"We Offer the Whole of Africa here!": South AfricanCurio Markets as the Ultimate Simulation
18 After a more detailed depiction of these markets seen as performances, this last part
explores the somewhat classic paradox of the “ethnic entrepreneur” as theorised and
documented by C. Quiminal (1991) and M. Timera (1996) on Soninkes; or A. Tarrius
(1995), M. Peraldi (2001) and E. Ma Mung (2006) on North African traders in France and
Light (1972); A. Portes et al. (1989); R. Waldinger et al. (1990), R. Coombe and P. Stoller
(1994) in North America; or its application to the South African context and its specific
relation to Africa on the one hand, and to the notions of “global” and “modernity” on
the other.
19 The most formalised and specialised African crafts markets (Rosebank in Johannesburg,
Long Street in Cape Town and Chameleon Village near Hartbeespoort) offer different
variations around the theme of African crafts. One common feature is the profusion
which mobilises all senses and contributes to creating a specific atmosphere. The
multiplicity of colours, materials, products, sizes of shops, circulation patterns and
musical backgrounds (sometimes playing some distinctly Congolese rumba and
ndombolo or Senegalese yela), all compose striking scenes and produce a certain “vibe”
as South Africans like to put it. The main actors in this African “drama”, the traders,
have, over the years, learnt how to embody their roles skilfully. They may stand outside
their shops or at market entrances, especially at quiet times of the day, sometimes
adorned in the clothes or jewels they sell (large “boubous”, African “Madiba” shirts,
bead necklaces, large Zulu round hats for women). Some of them draw customers to
their stalls thanks to the typical reverberating sound of West African drums
(“djembes”) that easily fills the entire facility and seems to invite all to walk towards
the origin of the call. There is a subtle balance14 though between chaos and order,
between exuberant cascades of masks and colourful cloths hanging over from the
ceiling and clearly delimited paths and stalls, toilet signposting and credit card
payment tills. The traders’ more or less conscious and sophisticated performances are
also carefully framed in order for them to embody this “tamed” and apprehensible
Africa: typically, they will be wearing name tags and clearly identifiable security jackets
on top of their attire and where and how long they exactly stand and talk to customers
will be regulated by market managements.
20 Those three markets stand out as specialised in “African arts and crafts” and sharply
contrast with others such as the Sunday Rosebank Rooftop Market (or Flea Market), the
Bruma Flea Market in Johannesburg or the Green Point Arts and Crafts Flea Market in
Cape Town where African crafts stalls are interspersed with old European antiques,
Indian incense, German sausages and Italian fresh bread stalls. They are also different
because they are permanent, daily markets and not weekly events (except for Bruma).
Besides playing a different economic role (the permanent markets are the most regular
sources of income for market management companies), they bring in a more specific
type of customers drawn there either by the “African flavour” or a specific shopping
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
250
purpose. Traders-customers interactions are as varied as the possible range of
transactions that can take place given the variety of products and it is beyond the scope
of this paper to investigate in depth customers’ perceptions but some recurrent trends
can be mentioned. Customers are equally distributed between international tourists of
all origins and mainly White and Indian South Africans. Strikingly in the minority,
Black South Africans might venture into those markets as part of a collective corporate,
school children or pensioners tour. This limited attendance reflects more general
cultural and shopping habits, as for instance in cinema or museum attendance. Most
traders interviewed perceive customers along stereotypical lines: Americans and
Germans are the “best buyers”, French, Italians and Spaniards like to bargain and chat
a lot, Indians are considered “difficult and mean” and Chinese are “complicated”
because they come in large groups, buy a lot but at very low prices. Customers from
tour operators have very limited perceptions of who the traders are and spend on
average between twenty and forty minutes in the markets. Traders either dissimulate
their non South African identity if they have the feeling customers are looking for
South African souvenirs or highlight it, especially in the case of Francophone traders
with French, Swiss and Belgian tourists when they think it might increase their sales.
The type of very insistent selling style displayed by “souk” traders in North Africa has
no place in South Africa. Any too insistent approach to customers will be reported to
management and will not be tolerated either by other traders or customers. If from
time to time young shop assistants try to stop customers by barring the way through
alleys and by “kindly forcing” them to enter a shop, they might be disciplined if their
behaviour is noticed by market management. The markets’ by-laws almost always
contain some paragraph about “the appropriate behaviour” for traders to adopt. When
it comes to transactions, those will be performed in a low voice and promises of a “very
good price” will materialise into offers that usually start by quadrupling the price
actually expected. Secrecy and harsh competition among traders may sometimes lead
to violence in the form of verbal abuse and even physical fighting over accusations of
“stealing customers” or “breaking market prices” but these remain the exception
rather than the rule15. Finally, increasing shares of the sales now come from online
corporate orders directly placed with market managers (particularly at the Rosebank
Market16), a dematerialised transaction that transforms the traders into manufacturers.
21 As an “ethnic” niche market, African craft sale in South Africa relies on a specific type
of marketing in which the salesman or shopkeeper is perhaps as important as the
product itself. In a way, the salesman, who is, most of the time, his own boss and wears
the two caps of trader and salesman, personifies the authenticity of the products on
display. As in any other similar “ethnic” niche markets worldwide, well described by
Alain Tarrius (1995) or Emmanuel Ma Mung (2006) in the case of “Arab” greengrocers
in France, products are only one part of the exchange taking place in the transaction.
The cultural background of the trader, the story he tells about the product, the contact
he develops with his customers, the bargaining, the language he speaks (especially
Francophones with French-speaking tourists) are all part of the game and tend to
transform the purchase into an experience that goes beyond the mere acquisition of
goods. As some traders in our survey note, some customers do not only come to these
markets to purchase goods but to meet with “Africans” and find out about their
country of origins, the language they speak, etc. Paradoxically but unsurprisingly given
the legacy of segregation in South Africa, for some tourists but also for some South
Africans, these brief encounters may be the only ones they have with black people in
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
251
their everyday lives or during their visit to the country. In this respect, the curio
business in South Africa only constitutes one aspect of a wider process described by
Rasool and Witz (1996: 4):
“In this world where almost nothing is left to chance [the world of tourismmarketing], South Africa is being asked to negotiate its own images, to suggest thestyle of its wrapping. The possibilities are bounded by the dazzling promise of anordered modernity, with the United States as the yardstick, and a primordial tribalbackwardness, with images of Third World violence, chaos and poverty as itsmeasure [...]. Unable to escape these parameters, South Africa is having topropound its Africanness’ as the embodiment of the continent’s possibilities formodernity, the engine room’ of Africa’s economic development [...]. In the process,South Africa, in the peculiarities of its modernity, is being inscribed as a world inone country’, reflecting not merely human diversity, but the very image of theworld itself.”
22 African crafts markets in the post-apartheid period are one such expression of
purported “Africanness” inside a modernised “wrapping” in which the African
transnational trader is the willing, sometimes unconscious living embodiment (and
even raison d’être) of this primordial versus modern tension. It is specific to the type of
goods sold and the position of this retail sector in the South African tourism industry.
This in itself distinguishes it from the kind of cultural processes at work among the
Congolese traders described by MacGaffey and Bazenguissa (2000: 50) in Europe, which
corresponds more to a hybrid and syncretic cultural production geared towards a self-
definition in an alien context. The kind of cultural processes to be observed around
curio traders in South Africa is probably much closer to that of the Senegalese and
Malian traders described by Stoller (2003) in North America. Stoller documents how
West African traders have made use of African Americans’ taste for Afrocentric
products in order to develop their businesses. His argument is mainly that the mimetic
faculty is the main framework in which West African traders organise their trade in
North America: “By marketing Afrocentricity17 at outdoor markets, at trade
expositions, in mainstream retail stores, on catalogue pages or in the virtual markets
found on the Internet, a simulated Africa has emerged in North America. By
understanding the importance of the copy, West African merchants, who, like their
forebears, are known for their economic adaptability, have marked Afrocentricity and
profoundly enhanced the profitability of their enterprises in North America” (Stoller
2003: 91).
23 The South African situation bears many resemblances to that of West Africans in North
America in terms of an encounter between African traders and a local emerging
Afrocentric culture with its own economic, cultural and political dynamics. The main
difference is perhaps that the monolithic vision of Africa which is promoted in the
South African markets is not supported by the Afrocentric trend that can be observed
for instance in South African design (in black-owned brands such as Strange Love,
Stoned Cherrie or Sun Goddess) but by mainly white economic interests and their
concentration in the retail and tourism industries. This certainly explains both the
success of these markets and their limitations in terms of audiences reached in South
Africa. The opening of these markets has filled a gap in both tourist attractions and
crafts retail at an opportune time. For some, the “African” market has transformed the
image of the suburb and positioned it vis-à-vis tour operators and other business
districts in a more and more competitive environment (this is the case of Rosebank for
instance which offers an “outdoor, cosmopolitan relaxed vibe”, according to one
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
252
interviewee, compared to Sandton, Johannesburg’s most affluent but more formal and
enclosed neighbourhood). For others, the opening of the market has simply placed
them on the map of tourist attractions, a goal that could only be achieved thanks to
their “African” identification18. However, as Stoller notes, considering marketing
Afrocentricity only as “an economically astute response to ever changing local market
conditions” does not explain the multiple dimensions encapsulated in the
phenomenon. The retail of “African” curios certainly represents a boon for corporate
South Africa, from interior design chains to market management companies. The retail
business in African curios is estimated to have more than doubled in the last ten years
(according to Bruce Jones, B&B Company and Richard Crooks, Chameleon Village). But
it certainly does not stop there.
24 As the Rosebank Market floor manager puts it, entering the market is almost “a shock
to your system” that comes from the “intensity of these foreign faces”19. Interestingly,
it is this “shock” that people, tourists and South Africans alike, are encouraged to seek.
The architectures of these markets have been designed to meet this ambition of
copying and recreating. A case in point is the Rosebank African Craft Market which,
like many instances of South African shopping mall (and leisure) architecture20 in fact,
vaguely mimics or replicates an external reference, here the Dogon architecture with
high terra cotta towers and hints at urban township culture with the use of corrugated
iron. The architect’s description is indicative of the intention:
“The building was designed to house street vendors who were seen as a securitythreat to surrounding business. The structure is simple and is wrapped in a richcrafted African fabric. It screens the ugly façade of the Mall parking garage. Thebuilding promotes accessibility and creates usable public open space within andaround it to encourage interaction, retail activity and public participation. Theinternal pedestrian street allows movement through the building. The interior isreminiscent of markets in Dar Es Alaam [sic] or Nairobi. The building is a touristattraction as much for what is on sale inside as for the building itself”, <http//www.kateottenarchitect.com>.
25 It thus reflects a series of tensions between primitiveness and modernity, authenticity
and artificiality, mystery of the origins and a positivist legal sale context, apparent
chaos and profusion, orderly organisation of the stalls and shops, and enclosed space
which easily gives rise to a somewhat parochial mentality and an open space where
people (customers as migrant traders) merely stroll through, village/local setting and
cosmopolitan networks and atmosphere, truly South African and global. I will try to
unpack some of these here.
26 This notion of replica or perhaps even, as Stoller shows for African markets in North
America, of simulation, as he calls it after J. Baudrillard’s use of the word (1983), is very
much present in the sense of feigning the symptoms of something to the point that
symptoms become the only tangible expressions of the new reality. Conducted
systematically in several markets, interviews revealed an ambition common to both
mall managers and traders, which is to make “Africa” entirely available to all (“We
offer the whole of Africa here!”). This undefined and holistic notion of “Africa”, a
primitive, creative, and decorative one (the notion of “décor” is central), is paired with
modernity as conveyed through the reassuring space of modern facilities, credit card
payment, “first class toilets” and secure parking lots21.
27 This monolithic but reassuring vision of Africa is not just the South African Eurocentric
avatar of the genre, it also expresses itself along the lines of essentialised ethnic (and
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
253
sometimes gender) categories inherited from apartheid times. This imposed ethnicity is
not just expressed verbally as I could realise in many interviews, but it is also
translated in the markets’ by-laws that impose product exclusivity, to “prevent undue
competition”. For instance, South African women selling beadworks play the part of the
“Ndebele ladies” and cannot deal in other crafts, Kenyans are restricted to selling
giraffes and elongated Masaï figurines or colourful Masaï blankets, Senegalese deal in
either masks, djembés or Chinese imports (glasses and belts) and Congolese will
invariably offer Kuba cloths, malachite and colonial, Tintin-style figurines. However,
the availability of products described in the first part and increasing competition have
resulted in diversification. The markets’ by-laws tend to lapse over time and most
traders consider diversified and plethoric stocks as the best guarantees of better sales.
The result is that most stalls now offer a diversity of products, even if each shop
continues to specialise mostly in one type of items. KS, from the Chameleon Village
Market explains: “Before, as wholesalers, we would only sell things from our country of
origin, the DRC, but now as retailers, we get what sells most easily, ‘from Cape to Cairo’
(laughter)”22. What matters above all in the eyes of the traders is the abundance of
goods in the shop as BP, a Congolese trader from the Rosebank Market summarises: “If
you have stock, you’re fine. If you keep your cash, you’ll regret it. If you have stock, you
sell”23.
28 Not only have traders who were not familiar with curio trade acquired specialised
knowledge on the products’ origin, material, production processes, etc, but they have
also clearly developed those skills beyond the limits of their countries and communities
of origin. This type of knowledge transmission is empirical and relies on mutual
teaching as well as selfteaching through African arts and crafts books that most traders
possess and use regularly. Thus Senegalese or South Africans now sell Congolese Kuba
cloths and Congolese might sell Kenyan wooden animals. BP, the Congolese trader from
Rosebank quoted previously, explains:
“When I first came, a friend of mine, D., welcomed me. He was selling art stuff. But Ididn’t pay attention. To me, this was like a hobby [...]. My girlfriend of the timeencouraged me to do that and my friend D. too. My family back home didn’t knowabout it, even until today. They have no idea what it’s all about, selling wooden’things [...]. Back home, I wasn’t interested in that but as I’ve travelled throughoutthe country, I could remember the different styles and the sort of things that artistswould make in Kinshasa at the Academy of Fine Arts. And my friend D. had books Ilearnt from [...]. Now I sell things from the DRC, Angola, Congo-Brazzaville,Cameroon, Nigeria and Benin” (BP, 12/09/2006).
29 Economic interest certainly explains part of this diversification and readiness to learn
about other craft traditions. Yet, it also represents a deliberate tactic to circumvent and
resist what is neatly perceived as domination from management and categories
imposed from above. The circumventing is initially mainly economic as te market by-
laws are perceived by traders as limiting business but it is also a matter of resisting as a
group and offering a competing understanding of “African values” diverging from
those artificially imposed from the outside. It also contributes to show management
that, in this very constrained environment, where traders occupy inferior positions and
are subjected to the markets’ by-laws24, they still control the source of income and the
business culture around it. For instance, at the Rosebank African Craft market, despite
an absence of durable representation and organisation, traders managed to oppose
management’s vision of a payment system with the use of labelled prices and a single
till that would have transformed them into mere sales people. The market entrance
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
254
now displays a sign that reads “This is Africa. We bargain!” It stands as the one by-law
imposed by traders and not management.
30 Interestingly, this motto (that can be found at other markets in various forms) also
defines a boundary between the inside and the outside on the basis of identification to
a monolithic Africa, secluded from the immediate outside world (South Africa). One of
the traders sheds further light on this demarcation by explaining: “Often people say,
when you’re outside you’re in South Africa, but when you’re inside you’re in Africa”25.
As Stoller indicates in the case of West Africans trading Chinese goods displaying
Afrocentric mottos in New York’s African markets, African traders in South Africa (as
well as South African vendors of similar goods) find themselves caught in a number of
ironies. Although they are geographically located on the African soil, the type of
Afrocentric discourse these traders face is far less structured than in North America
where its philosophical and pseudo-historical bases have translated directly into public
holidays (Kwanzaa) and the creation of a growing folklore. The marketing of African
curios has so far been rather unsuccessful with South African black audiences who
display little interest for crafts markets in general and have a clear preference for
trademarked goods26. The audience for this specific type of Afrocentric goods is thus
mostly from outside Africa and non-black South Africans. The other complexity is the
relation to Africa both in terms of boundaries and in terms of racial identity. Unlike in
North America where it is remote, in South Africa, Africa is present but at the same
time needs mediation (the Rosebank motto raises other questions: where does Africa
start? Where does it stop? How does one reach it?). Again unlike West Africans in North
America, who stand as ontological strangers, African traders and black South African
traders alike (that is the very insiders) are caught in this simulation of Africa thanks to
or because of the colour of their skins. The simulation reaches a kind of mise en abime in
the South African context and confirms that no singular reading of these phenomena
can be offered, notwithstanding the transnational dimension of these African import-
export networks in their Asian connections. A Cameroonian national passing for a
Congolese refugee and trading fake Senegalese masks made in China to a South African
interior decorator seeking to give an “African flavour” to an international guest house
is one of the most stereotypical situations observed in any of these South African
markets.
31 Products’ commodification is another interesting expression of the kind of cultural
hybridisation simulation may lead to. Information gathered by traders and market
managers over the years on customers’ tastes have progressively shaped the
manufacturing of products. The classic rules of retail marketing (constant trend
renewal, adaptation to travel requirements, price diversity in line with customers’
socio-economic backgrounds) and the competition of the South African retail context
have imposed themselves on African crafts. Products are either conditioned differently
from the place of production or by traders once in South Africa. Wooden sculptures will
be polished and varnished, Congolese elongated figurines will be painted black and
wrapped in beads, Kuba cloths will be sowed over cushions and bags, Senegalese batiks
framed, and malachite pieces carved into Mandela heads. Increasingly, those products
find their way into the more mainstream interior decoration retail chains (Mr Price
Home, @Home, Woolworths Home) where they do reach Black South African
customers.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
255
32 Those economic and social exchanges lend themselves to multiple readings that
pinpoint the various dimensions and frameworks at play. What is perhaps most specific
to the South African post-apartheid context is the fact that the mimicked reality
(Africa) acquires a reality of its own (crafts and their conveyors are this reality to
many) in the midst of the actual environment of the transaction (South Africa and its
people are part of Africa), an “Africa” that is both omnipresent and distant enough to
require mediation. The African unmarked goods sold on South African markets are not
trendy commodities such as for instance Mandela T-shirts or Malcom X caps in America
for which the power of the sign itself replaces the meaning it is based on. They are the
material culture through which Africa becomes real to many, international tourists,
white and black South Africans alike, in an African country today.
*
Tourism, Entrepreneurship and Migration in aGlobalised Regional Context
33 This paper intended to examine how African curio markets participate in a broader
process of image negotiation at work within South Africa and more broadly speaking
between Africa and the rest of the world.
34 In this game of perceptions and representations, African traders have little leeway to
offer more creative images of Africa than those they are expected to by either mall
managements or customers. These images are often conditioned by an essentialised
understanding of African identity prevalent among those who invest and regulate this
sector. These images revolve around ethnic specialisation, notions of primitiveness and
creativity, wilderness and profusion. The architectures adopted as well as the markets’
by-laws are based on the premises of these stereotyped images. Unlike North America
where Afrocentricity has become a repertoire (that some may deem fake) shared by
West African traders and African-American customers (Stoller 2003), such an encounter
has not (yet) happened between African traders and black South Africans, except when
commodified African crafts are sold in a depersonalised, branded manner in
mainstream retail shops. African curio trade in South Africa is not the locus of renewed
images of either Africans or the continent but rather the continuation of the South
35 African specific combination of primitiveness and modernity that has represented, for
several decades now, the main communication imagery of the South African tourism
industry.
36 In their attempt at copying and simulating a monolithic Africa, these markets provide
the various actors involved with several possible readings and positioning. To mall
managers, they offer new market niches with much expanding potential both
domestically and internationally, through tourism and the Internet (online sale), as
well as a social good conscience as experiments in formalisation. To local councillors
and managers, they offer possibilities to transform the image of their suburbs and to
adapt it to the new cultural icons of the country, thus participating in the
nationbuilding enterprise. To migrants, they offer multiple and flexible opportunities
to negotiate their more or less durable insertion in the host society. As a respectable
income-earning activity, curio markets allow them to merge into an otherwise
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
256
unfriendly social fabric where their quality as African foreigner is more often than not
a stigma. Indeed, curio markets transform this into an asset: by showcasing their
“Africanness” and their global ties, they are acknowledged as legitimate participants
into the South African economy and society27. This seems to confirm the validity of
Waldinger et al. s interactive model of ethnic entrepreneurship (1990) which accords
equal importance to labour market constraints, the impact of State policies and the ties
of ethnic networks.
37 It is still difficult to assess whether the learning processes and mutual encounters at
work within these transcultural spaces outweigh the restrictive and reproductive
dimensions highlighted in this paper. They do foster new perceptions of Africans and
their historical background within the markets, between management and traders, and
among traders, and the products commodification at work is a form of cultural
hybridization. However, South African markets are going through difficult times and
have not generated the success they were expected to, which reduces the impact they
may have on society. This is perhaps the limitation of copying and simulating. The
primitiveness they promote returns many South Africans to an impression of historical
déjà-vu that falls short of aspirations for a different Afrocentric modernity 28, for
trademarks and symbols that complexify rather than simplify African identities.
BIBLIOGRAPHY
BARNES, C.
2008 “High Tourism Figures Simply Not True”, Cape Argus, 30 March, <//www.iol.co.za>.
BAUDRILLARD, J.
1983 Simulations (New York: Semiotext).
BOUILLON, A. (dir.)
1999 Immigration africaine en Afrique du Sud. Les migrants francophones des années 1990 (Paris :
Institut français d’Afrique du Sud-Karthala).
CHIPKIN, C.
1993 Johannesburg Style. Architecture and Society, 1880s-1960s (Cape Town: David Philip).
CONSORTIUM FOR REFUGEES AND MIGRANTS IN SOUTH AFRICA
2008 Protecting Refugees and Asylum Seekers in South Africa, 19 June, Johannesburg,
<www.cormsa.org.za>.
COOMBE, R. & STOLLER, P.
1994 “X Marks the Spot: The Ambiguities of African Trading in the Commerce of the Black Public
Sphere”, Public Culture 15: 249-275.
CRUSH, J. (ed.)
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
257
1998 Beyond Control: Immigration and Human Rights in a Democratic South Africa (Cape Town: IDASA/
SAMP).
2001 Immigration, Xenophobia and Human Rights in South Africa (Cape Town: IDASA/SAMP
“Migration Policy Series 22”).
CRUSH, J. & WILLIAMS, V.
1999 The New South Africans? Immigration Amnesties and their Aftermaths (Cape Town: IDASA/SAMP).
GUILLAUME, P.
2001 Johannesburg. Géographies de l’exclusion (Paris : IFAS-Karthala).
HARRISON, P., HUCHZERMEYER, M. & MAYEKISO, M.
2003 Confronting Fragmentation: Housing and Urban Development in a Democratising Society (Cape
Town: university of Cape Town Press).
HUGUES, H.
2007 “Rainbow, Renaissance, Tribes and Townships: Tourism and Heritage in South Africa Since
1994”, in S. BUHLUNGU et al. (eds.), The State of the Nation 2007 (Pretoria: HSRC Press): 266-288.
JANSEN VAN VEUREN, E.
2003 “Capitalising on Indigenous Culture: Cultural Village Tourism in South Africa”, in C.
ROGERSON (ed.), Africa Insight, Special Issue, Tourism and Development in Africa. Issues in Contemporary
South Africa 33 (1-2) (Africa Institute of South Africa): 69-77.
KOCH, E. & MASSYN, P.
2001 “South Africa’s Domestic Tourism Sector: Promises and Problems”, in K. GHIMIRE (ed.), The
Native Tourist. Mass Tourism Within Developing Countries (London: Earthscan).
LANDAU, L. B.
2005 “Urbanization, Nativism and the Rule of Law in South Africa’s forbidden’ Cities”, Third World
Quarterly 26: 1115-1134.
2006 “Transplants and Transients: Idioms of Belonging and Dislocation in InnerCity
Johannesburg”, African Studies Review 49: 125-145.
2007 “Discrimination and Development?: Immigration, Urbanization, and Sustainable Livelihoods
in Johannesburg”, Development Southern Africa 24 (1): 61-76.
LANDAU, L. B. & HAUPT, I.
2009 “Tactical Cosmopolitanism and Idioms of Belonging: Insertion and SelfExclusion in
Johannesburg”, Journal of Ethnic and Migration Studies, Forthcoming.
LANDAU, L. B., PRESTON-WHYTE, E., TOLLMAN, S. & FINDLEY, S.
2006 “Africa Migration in the Twenty First Century: Conclusion”, in M. TIENDA, S. FINDLEY, S.
TOLLMAN & E. PRESTON-WHYTE (eds.), Africa on the Move: African Migration and Urbanisation in
Comparative Perspective (Johannesburg: Wits University Press): 329-355.
LANDRÉ, M.
1999 “The Changing Retail Structure of Pretoria. A Desktop Mapping Adventure”, L’Espace
géographique 28 (4): 309-319.
LIGHT, I.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
258
1972 Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare among Chinese, Japanese and Blacks (Berkeley:
University of California Press).
MALAQUAIS, D.
2006 “Villes flux. Imaginaires de l’urbain en Afrique aujourd’hui”, Politique africaine 100 : 17-37.
MA MUNG, E.
2006 “Négociations identitaires marchandes”, Revue européenne des Migrations internationales 22
(2) : 83-94.
MACGAFFEY, J. & BAZENGUISSA-GANGA, R.
2000 Congo-Paris. Transnational Traders on the Margins of the Law (OxfordBloomington: James
Currey-Indiana university Press-African Issues).
MATHERS, K. & LANDAU, L. B.
2007 “Natives, Tourists and Makwerekwere: Ethical Concerns with ‘Proudly South African’
Tourism”, Development Southern Africa 24 (3): 523-536.
MATTES, R. ET AL.
1999 Still Waiting for the Barbarians: South African Attitudes to Immigrants and Immigration (Cape
Town: IDASA/SAMP “Migration policy Series” 37).
MORRIS, A.
1999 Bleakness and Light, Inner City Transition in Hillbrow (Johannesburg: University of the
Witwatersrand Press).
NUTTALL, S. & COETZEE, C. (eds.)
1999 Negotiating the Past. The Making of Memory in Post Apartheid South Africa (Cape Town: Oxford
University Press).
PEBERDY, S. & ROGERSON, C.
1999 “Enclave Entrepreneurs ? Non-South African Entrepreneurs in South Africa’s Informal
Sector and Small and Medium Enterprises”, Institute of Migration and Ethnic Studies, University
of Amsterdam, Netherlands, Southern African Migration Project, Potential Skills Base Survey, 2003, <//
www.queensu.ca/samp/mig_db/mig_db.php>.
PERALDI, M. (dir.)
2001 Cabas et containeurs. Activités marchandes informelles et réseaux migrants transfrontaliers (Paris :
Maisonneuve et Larose).
PISANTI, L.
2007 “SA Tourism Figures Looking Healthy”, The Mail & Guardian Online, <http://www.mg.co.za>.
PORTES, A., CASTELS, M. & DENTON, L.
1989 The Informal Economies, Studies in Advanced and Less Developed Countries (Baltimore: The John
Hopkins University Press).
PRESTON-WHITE, E. & ROGERSON, C. (eds.)
1990 South Africa’s Informal Economy (Cape Town: Oxford University Press).
QUIMINAL, C.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
259
1991 Gens d’ici, gens d’ailleurs (Paris : Christian Bourgois).
RASOOL, C. & WITZ, L.
1996 “South Africa: a World in one Country. Moments in International Tourist Encounters with
Wildlife, the Primitive and the Modern”, Cahiers d’Études africaines XXXVI (3), 143: 335-372.
RICCIO, B.
2006 “‘Transmigrants’ mais pas ‘nomades’. Transnationalisme mouride en Italie”, Cahiers d’Études
africaines XLVI (1), 181 : 95-114.
ROGERSON, C.
1997 “African Immigrant Entrepreneurs and Johannesburg’s Changing Inner City”, Africa Insight
(Africa Institute of South Africa) 27 (4): 265-273.
ROGERSON, C. (ed.)
2003 “Tourism and Development in Africa. Issues in Contemporary South Africa” Special Issue,
Africa Insight 33 (1-2) (Africa Institute of South Africa).
SCHUTTE, G.
2003 “Tourists and Tribes in the New South Africa”, Ethnohistory 50 (3): 473-487.
SELLIER, J.
2005 Atlas des Peuples d’Afrique (Paris : La Découverte).
SIMONE, A.
2000 “Going South: African Immigrants in Johannesburg”, in S. NUTTALL & C. A. MICHAEL (eds.),
Senses of Culture: South African Culture Studies (Oxford-New York: Oxford University Press): 426-442.
STOLLER, P.
2003 “Marketing Afrocentricity: West African Trade Networks in North America”, in K. KOSER
(ed.), New African Diasporas (London: Routledge): 71-94.
TARRIUS, A.
1995 Arabes de France dans l’économie mondiale souterraine (La Tour d’Aigues : Éditions de l’Aube).
TIMERA, M.
1996 Les Soninké en France : d’une histoire à l’autre (Paris : Karthala).
TOMLINSON, R., BEAUREGARD, R. A., BREMNER, L. & MANGCU, X.
2003 Emerging Johannesburg. Perspectives on the Postapartheid City (New York-London: Routlege).
WA KABWE-SEGATTI, A.
2006 “Migrations en Afrique australe : levier de la Renaissance ou facteur d’inégalités ?”,
Transcontinentales 2 (Paris : Armand Colin) : 77-99.
WALDINGER, R., ALDRICH, H. & WARD, R. (eds.)
1990 Ethnic Entrepreneurs: Immigrant Business in Industrial Societies (Newbury Park: Sage
Publications).
WITS (FORCED MIGRATION STUDIES PROGRAMME)-TUFTS UNIVERSITY-IFAS
2003 Johannesburg City Survey, unpublished.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
260
2006 Three Cities Survey (Johannesburg, Maputo, Lubumbashi) on Migrants’ Livelihoods, unpublished
data, <www.migration.org.za>.
NOTES
2. The most complete report on the xenophobic attacks to date is the CORMSA Report, 2008.
3. Muti is a Zulu word meaning medicine. Muti markets are markets offering traditional
medicines sold by traditional healers/diviners (sangomas) and herbalists. They can be found in
most South African urban centres. Two famous muti markets in Johannesburg are the Mai-Mai
and the Faraday markets which have received much attention and investment from the
Johannesburg Municipality recently in a (so far unsuccessful) attempt at turning them into
tourist attractions (except in Durban where the muti market is part of the City’s tour). These still
mainly attract Black South Africans.
4. The paper is based on extensive fieldwork carried out in 2006 and 2007 in and around
Johannesburg and the observation of other cities such as Durban and Cape Town as part of a
research project entitled “African Traders and the City” pertaining to two research initiatives
(FSP-CEPED and ANR MITRANS CNRS research programmes, see www.ifas.org.za). It relies on
original qualitative data from this fieldwork (over 50 in-depths interviews with migrant traders
from Congo, Cameroon, Senegal, Kenya, South Africa, Zimbabwe and Malawi, market managers
and local authorities). The author would like to thank reviewers for their comments and
suggestions on the ethnographic data in particular.
5. These are part of the FSP Ceped and Mitrans projects mentioned in note 3.
6. This reading in terms of a strategic and tactical use of a “cosmopolitan” African identity was
first identified by Loren B. LANDAU and Iriann HAUPT (2009) in relation with migrants’ self-
exclusion practices. My intention here is to expand it to other actors and rather analyse it as a
repertoire offering many actors (public, private and migrants) multiple opportunities to
(re)position themselves in the South African context.
7. Interviews with The Mall managers (Nicole Greenstone, Leila Daya and Alvine Macaskill),
Rosebank, 18/09/2007; Bruce Jones and Vanessa Naidoo, B&B Markets Company, Rosebank,
14/08/2007 & 15/08/2006; Ian Ollis, Democratic Alliance Ward Councillor for Rosebank,
13/08/2007; James and Richard Crooks, owners and managers, Chameleon Village Market,
Cramerview, 12/10/2007.
8. Interviews quoted in note 6.
9. For more information in these surveys, see <www.wits.ac.za/migration>.
10. The Bamoum, from the Nigero-Congolese linguistic group and Ntu sub-group, probably date
back to the 17th century. Their expansion goes back to King Mbwe-Mbwe’s reign and the
organization of a professional army around the capital Foumban. Trade was then developed
towards the coast and the interior with cola nuts. The use of slaves in agriculture enabled an elite
of traders and specialized craftsmen to emerge and rule from Foumban, a town located between
Douala and Bafoussam, the Bamileke capital in the North-West (SELLIER 2005: 137).
11. Hewa Bora is a Congolese airline based in Lubumbashi, Katanga, with several direct flights a
week to Johannesburg.
12. SARS stands for South African Revenue Service. Most traders in formal markets and
wholesalers are now registered with SARS and pay VAT on their imports and sales. All traders
interviewed in Johannesburg and Cape Town concurred to confirm BF’s perception of customs
services at the airport and the reliability of the SARS number.
13. Interview with Mr and Mrs K., Chameleon Village Market, Cramerview, 01/10/2007 &
15/04/2008.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
261
14. Itself the result of sometimes harsh negotiations between shopkeepers and management.
15. Those observations are drawn from the months of participant observation conducted at all
three sites and visits to other markets. Although instances of fights were reported by all traders
interviewed and market managers, only one fight and a few minor arguments were witnessed
directly.
16. <http://www.craft.co.za/African.aspx>.
17. The term, borrowed from Stoller here, is preferred to “Afrocentrism” which bears a
resolutely negative connotation. Afrocentricity and Afrocentric are used here mainly to describe
what, in representations, discourses or forms, places African references in the centre or
enhances them.
18. Interviews quoted in note 6.
19. Vanessa Naidoo, B&B company, 15/08/2006.
20. The simulation of exotic cultural or historical themes characterises South African leisure,
retail and housing architecture. Famous instances are the Moyo restaurant chain or the Sun City
complex for “ethnic Africa”, the Emperor’s Palace and Montecasino Casinos for “Ancient Rome”
and most Gauteng gated communities and clusters for “Provence” or “Tuscany”.
21. Countering disorder and filth, two notions that were systematically associated with street
hawkers and their activities, is consistently presented as the goal pursued in these various
projects to formalize trade, according to interviewed mall owners, managers and councillors.
22. Interview with KS, 01/10/2007.
23. Interview with BP, 12/09/2006.
24. By-laws are established by management in all markets without any durable form of
representation or organisation on the side of traders. By-laws regulate shop rental, products,
behaviour on the market, access to the market and hiring of shop assistants. In all markets,
management imposes sanctions on those who contravene the by-laws. Sanctions can take the
form of temporary shop closure (the shop is taped and the owner is denied access) or even
exclusion from the market for disciplinary problems (mainly stealing and drinking). Most traders
interviewed found by-laws fairly acceptable and even desirable for some. Instances of severe
disciplinary measures were by and large very few according to information gathered from
management and traders. Rent prices were far more resented than the by-laws.
25. Interview with KP, Rosebank market, 01/09/2006.
26. Interviews quoted in note 6.
27. Of note is the fact that crafts market traders were not victims of the May 2008 xenophobic
attacks unlike Somali shopkeepers in the townships who have for a long time been the targets of
violent xenophobic and economic crime.
28. The extremely vibrant Afrocentric South African artistic and cultural scene is a fertile area of
such expressions and experiments but encounters with the rest of Africa mostly rely on imported
artistic skills supported by State and foreign cultural agencies and not on local African migrant
artistic communities (interview with Laurent Clavel, Cultural attaché, French Embassy in South
Africa, August 2008). On African migrants ' cultural input to Johannesburg 's life, see Aboumaliq
SIMONE (2000) in Nuttal & Michael.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
262
ABSTRACTS
Based on a two-year fieldwork in and around Johannesburg, this paper contends that the
emergence of "African markets" in the post-apartheid urban landscapes filled the niches created
by the production of commodified images of the country and, by extension, the continent. The
analysis focuses on the creative process at work around the identification and multi-layered
reading of a "cosmopolitan" African identity by different groups of actors (South African
municipal authorities, retail private actors and migrant traders). It tries to show how this process
has fulfilled actors' immediate and contrasted needs but has not necessarily led to countering
negative clichés on African migration in the long run. It thus tries to make use of the theoretical
framework of the notion of ethnic entrepreneurship in its application to the South African
context. The paper documents the practices and activities of the African curio trade in South
African cities, the products sold, the trade networks and the imaginaries on which the
perceptions of migrants, market managers and municipal councillors rely and in turn continue to
fuel. After painting the specific cultural and political context of the South African tourism
industry and offering a brief overview of the dissemination of new trade and migration networks
towards and within South African cities, the paper finally unpacks the imagery of Africa that is
conveyed to South Africans and international publics as well as its genealogy.
À partir d'un travail de terrain de deux ans dans et aux alentours de Johannesburg, cet article
montre comment l'émergence de « marchés africains », dans les paysages urbains post-
apartheid, est venue combler une niche créée par la production d'images commercialisables du
pays, et par extension, du continent. L'analyse se concentre sur le processus créatif à l'œuvre
autour de l'identification et des lectures multiples d'une identité africaine « cosmopolite » par
différents groupes d'acteurs (les municipalités sud-africaines, le secteur privé et les commerçants
migrants). On tente de montrer comment ce processus a servi les attentes immédiates et
contrastées des acteurs mais n'a pas nécessairement conduit à renverser durablement les clichés
négatifs sur la migration africaine. Le cadre théorique de la notion d'entrepreneur ethnique est
ainsi appliqué au contexte sud-africain. Cet article documente les pratiques et les activités de la
vente d'objets artisanaux africains dans les villes sud-africaines, les produits vendus, les réseaux
commerçants et les imaginaires sur lesquels les perceptions des migrants, des gérants de marché
et des conseillers municipaux reposent et à leur tour contribuent à alimenter. Après avoir décrit
le contexte culturel et politique de l'industrie touristique sud-africaine et donné un aperçu de
l'étendue des nouveaux réseaux commerçants et migratoires inter et intra- urbains, cet article
étudie l'imagerie de l'Afrique qui est véhiculée par les publics sud-africains et internationaux et
par sa généalogie.
INDEX
Mots-clés: Afrique du Sud, Afrique (imaginaires), tourisme et migration, commerce
transnational, régénération urbaine
Keywords: South Africa, Africa (imaginaries), tourism and migration, transnational trade, urban
regeneration
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
263
AUTHOR
AURELIA WA KABWE-SEGATTI
IRD Fellow, Forced Migration Studies Programme, University of the Witwatersrand,
Johannesburg
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
264
Les scènes de la danse. Entre espacetouristique et politique chez lesPeuls woDaaBe du NigerDancing Stages. Between the Touristic and Political Spaces Among WoDaaBe
Fulani of Niger
Mahalia Lassibille
1 L’engouement des sociétés du Nord pour l’Afrique a trouvé dans le tourisme culturel un
de ses moyens d’expression privilégié que l’Unesco (2003) a remarqué et tend à
soutenir. Cette organisation a d’ailleurs lancé en Algérie, Égypte, Libye, Mauritanie,
Tunisie mais aussi au Mali, Maroc, Soudan, Tchad, et Niger le projet intitulé « Le
Sahara, des cultures et des peuples ». Elle envisage d’intégrer le tourisme comme
activité de développement économique de ces pays et comme moyen de sauvegarde et
de valorisation de leur patrimoine naturel et culturel.
2 Dans cette perspective, les danses africaines forment un ressort non négligeable. Objet
de fascination pour les Occidentaux, décrites par les voyageurs et les ethnologues, elles
apparaissent régulièrement dans nos médias où elles sont dépeintes comme autant de
gestes ancestraux. Les guides de voyage et les agences touristiques font ainsi la
promotion de certaines destinations en louant des danses réputées pour leur beauté et
leur « authenticité » : danses masquées des Dogons du Mali, danses guerrières des Zulus
d’Afrique du Sud ou des Massaïs de Kenya/Tanzanie, danses de séduction des WoDaaBe
du Niger... Elles donnent lieu à des circuits touristiques qui se sont quelquefois
superposés aux missions ethnologiques.
3 Or, si ce phénomène peut être exploré par macro-analyse, c’est plutôt une micro-
anthropologie qui sera menée ici. En plus de révéler la complexité des processus à
l’œuvre dans la mise en tourisme des danses, elle permet de considérer les points de
vue des différents acteurs qui y prennent part et de saisir les interactions qui s’opèrent
entre eux comme le dénotent les enquêtes menées chez les Peuls woDaaBe du Niger.
4 Le Niger a pendant longtemps connu un faible développement touristique de par une
forte insécurité liée à la rébellion touarègue et au banditisme armé, et à un manque
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
265
d’infrastructure. Je ne rencontrais, lors de mes premiers terrains chez les WoDaaBe au
début des années 1990, que quelques touristes de passage. Par la suite, de plus en plus
de touristes arrivèrent aux fêtes locales, notamment à la « Cure Salée » d’Ingall, grand
rassemblement des pasteurs qui fut intégré au circuit touristique par le gouvernement
en 1998. Or, en 2003, les WoDaaBe ont pris la décision de ne plus y participer. Ils
estiment en effet n’en retirer aucun bénéfice alors que les touristes viennent
principalement voir leurs danses. Ils organisent depuis « l’Assemblée générale des Peuls
wodaabe du Niger ». En 2006, je me suis rendue à ce nouveau rassemblement où les
danses semblent constituer, en tant que pôle d’attraction touristique, un enjeu
considérable pour le groupe. Mais tandis que mes questionnements de départ se
centraient sur les WoDaaBe, je me suis trouvée au cœur d’interrelations avec plusieurs
voyageurs. Ceux-ci venaient discuter et poser des questions à « l’anthropologue » ainsi
que j’étais identifiée. En plus de la triangulation qui s’opérait entre eux, les WoDaaBe et
moi, je constatais que, sous la figure unitaire du touriste, se profilait une grande variété
de situations qu’il me fallait analyser.
5 Pour cela, j’ai mené une enquête in situ, concentrée sur le lieu de l’Assemblée, mais
aussi hors de ce cadre auprès des WoDaaBe ainsi que des voyageurs qui m’avaient laissé
leurs coordonnées. Cette recherche s’étendit alors sur plusieurs pays, France, Belgique
et Niger essentiellement, et usa de tous les moyens de communication possible,
téléphone, messagerie instantanée, courriels. Ces différents modes d’entretiens, s’ils
impliquent des biais à prendre en compte, eurent finalement l’avantage d’aisément
glisser vers un mode conversationnel qui produisit des propos singuliers. De plus, ils
me permettaient de multiplier les interlocuteurs, et subséquemment de mettre en
lumière la diversité de leurs profils et de saisir le phénomène de réseaux qui se
dessinait et se trouvait être au cœur de mon travail. Cette enquête « multi-située »
(Appadurai 2005) reflète les caractéristiques d’un terrain globalisé et du phénomène
touristique étudié, et fut indispensable pour répondre aux questions qui se posaient :
par quels processus des acteurs si différents sont-ils arrivés en ce même lieu, dans la
brousse nigérienne ? À quels agencements entre touristes, WoDaaBe et autorités du
Niger le déroulement de l’Assemblée donne-t-il lieu ? En quoi la danse forme-t-elle le
nœud central du dispositif, entre espace touristique et politique ?
De la globalisation à la localisation : un tourisme enréseau
6 Après que les WoDaaBe m’aient plusieurs fois parlé de leur « Assemblée générale » qui
semblait revêtir une grande importance pour eux, je reçus en 2006 un courriel du
collectif Djingo qui regroupe les associations woDaaBe du Niger. Il m’annonçait la
réalisation de la troisième édition de l’Assemblée, à Azanghafa dans la région de
Tchintabaraden. Était joint un programme mentionnant les allocutions, réunions et
danses qui allaient s’y dérouler, et le bureau exécutif de l’événement avec pour
organisateur le président de l’association Kaourital.
7 Il y avait dans cette seule « entrée en terrain » toutes les caractéristiques et les
difficultés de l’enquête qui s’ouvrait : un contexte mondialisé qui conduit les WoDaaBe
à user d’Internet pour informer des Occidentaux dont je faisais partie et dont certains,
comme moi, allaient prendre le chemin de l’Assemblée ; un fonctionnement en réseau à
l’image d’un listing mail dont les connexions et les hors-ligne formaient un pan aussi
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
266
mobile qu’insaisissable ; un ancrage local, dans une contrée aux échos lointains, dont
les tenants et les aboutissants woDaaBe restaient à préciser. Il y avait autant de
questions que de points mentionnés, et les éléments de réponse se sont révélés parfois
ardus à démêler et à écrire de par leur composante fortement interactive et leur
caractère déconcertant.
Quand les WoDaaBe décident d'« un forum social et culturel » :
histoire d'une cofondation
« J’ai rencontré Doutchi dans les rues de Paris, il sortait d’une boutique. Jeconnaissais déjà les WoDaaBe, j’avais rencontré Doula. Du coup, on a discuté. Il m’aexpliqué l’idée qu’il avait, d’une assemblée des présidents d’associations au départ.J’ai trouvé que son idée était bonne. Après, je suis revenue au Niger et j’ai vu queDoula écrivait avec d’autres WoDaaBe une lettre aux présidents d’associations pourdire de ne plus aller à la cure salée. Je lui ai alors parlé de l’idée de Doutchi, quec’était bête qu’il le fasse tout seul. Je leur ai dit de rentrer en contact. Ils ontorganisé la première Assemblée » (Sandrine1, 2006, Assemblée générale des PeulswoDaaBe).
8 L’idée et la mise en place de l’Assemblée sont tout d’abord le fait de jeunes WoDaaBe,
présidents d’associations au Niger. Ce dispositif associatif, initié principalement par la
possibilité de danser dans des festivals et de vendre des bijoux en Europe, États-Unis et
Canada, est particulièrement stratégique. En tant que cadre juridique, il permet aux
WoDaaBe de mener des activités dans les pays du Nord. Face à des conditions de plus en
plus difficiles pour des pasteurs nomades, ils ont dû trouver de nouveaux équilibres
économiques et des ressources alternatives aux seuls troupeaux. Les débouchés
touristiques et les ventes de bijoux et de danses furent alors utiles. Ce cadre associatif
permet également aux WoDaaBe de monter et de présenter des dossiers afin d’obtenir
des aides (puits, écoles, dispensaires...). Ils ont enfin, expliquent-ils, un statut pour faire
connaître leur culture et porter leurs revendications auprès des autorités nigériennes
et à l’étranger.
9 Or, d’une association au départ, elles se sont multipliées pour atteindre le nombre de
dix-neuf en 2006. Chacune regroupe un lignage, plus exactement une partie de lignage
vivant dans une région du Niger. Outre la volonté de faire bénéficier son groupe des
projets réalisés sans oublier des luttes de pouvoir, cette division correspond à un
fonctionnement lignager structurant dans la société des WoDaaBe. Cette situation
explique l’éparpillement sous-jacent au récit de Sandrine entre Doutchi (du lignage des
Bii Korony’en du nord d’Ingall, président de l’association des Éleveurs du Ténéré) et
Doula (Bii Nga’en du nord d’Agadez, président de l’association Baraka). Elle explique
aussi l’idée du rassemblement qui fut, avec l’enjeu touristique, un des tremplins
initiaux de l’Assemblée, et éclaire un premier pan de sa cofondation, celui entre
WoDaaBe. Sous l’impulsion de Doutchi et Doula, les dirigeants des associations se sont
réunis, ce qui s’institutionnalisa avec le collectif Djingo. Ils ont décidé de l’Assemblée,
se sont répartis les rôles (un bureau exécutif avec une direction tournante entre
associations) et les financements (chaque association donne sa contribution).
10 La part active des WoDaaBe est sur ce plan centrale : non seulement ils sont auteurs des
stratégies qu’ils élaborent et dans lesquelles leurs associations forment un élément
moteur, mais ils ont eu l’initiative de l’Assemblée. Ils ont à son sujet des actions et des
discours précis. Le contexte international dans lequel ils évoluent fait l’objet d’une
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
267
réappropriation et de réaménagements locaux. Ainsi, les destinataires de l’Assemblée
ne sont pas seulement les touristes mais les WoDaaBe eux-mêmes.
11 Cependant, la dynamique est plus complexe et interactive. Ces responsables
d’associations viennent régulièrement dans les pays du Nord depuis les années 1990. Et
ce fut principalement via des relations nouées au Niger et les circulations
d’Occidentaux entre les continents que les WoDaaBe sont arrivés ici, à l’image de
Doutchi : invité par une Française rencontrée à la « Cure Salée », il a commencé en 2003
à vendre des objets artisanaux en France, Belgique, Italie, Allemagne... Ces relations se
déroulent dans des va-et-vient entre WoDaaBe et Européens qui les accueillent et
recherchent des débouchés pour leurs productions. Ces derniers se révèlent être des
interlocuteurs à part entière. La venue des WoDaaBe est également l’occasion de nouer
contact avec d’autres Européens comme ce fut le cas entre Doutchi et Sandrine, et de
développer un réseau de personnes qui les hébergent, les aident et peuvent intervenir
dans des projets locaux. S’opère au cours de ces déplacements une combinaison étroite
entre acteurs africains et occidentaux qui n’est pas sans lien avec la mise en place de
l’Assemblée.
12 En effet, les touristes qui sont allés au Niger et les personnes rencontrées dans les pays
du Nord ont été décisifs dans la prise de conscience des WoDaaBe, générée tant par les
références apportées que par la valorisation du regard posé. Doula Mokao mentionne
par exemple que ce sont des amis français qui ont attiré son attention sur la nécessité
pour les WoDaaBe de régulariser leurs droits de territoire et d’accès à l’eau. Leurs
interlocuteurs occidentaux ont de même contribué à l’acquisition d’outils de
revendication. Doula a ainsi participé à des conférences indigènes en Suède (1992, 1994)
et fut invité, en 1998 par une Brésilienne, à rencontrer des chefs de tribus indiens pour
aborder les problèmes des peuples autochtones. Les notions de « droits indigènes », de
« commerce équitable » et de « tourisme solidaire » ont été largement acquises lors de
ces interactions. Certaines se retrouvent dans le projet de l’Assemblée, dans son
positionnement et ses références.
13 De plus, ces interlocuteurs apportent une aide matérielle dans l’organisation du
rassemblement par leurs conseils, l’accompagnement dans le montage de dossiers, un
soutien logistique et la diffusion d’informations. Le courriel d’invitation des WoDaaBe
mentionne d’ailleurs que toute contribution est bienvenue, et ajoute « n’hésitez pas à
nous tenir informé si vous connaissez une structure ou une bonne volonté qui pourra
aider à sa réalisation. Nous demeurons attentifs à vos suggestions ». Les WoDaaBe
encouragent des actions participatives et sollicitent leurs relations.
14 Car les acteurs occidentaux occupent une place considérable par la mise en réseau
qu’ils permettent à un niveau international2 mais aussi entre WoDaaBe d’associations
différentes. Sandrine a été une actrice charnière par la relation qu’elle a suscitée entre
Doutchi et Doula. De par leur position internationale, les Occidentaux ont un rôle
d’intermédiaire local selon la logique non plus additive mais combinatoire du réseau
(Mercklé 2004 : 9) qui tend à se profiler. Le réseau, en tant que maillage
d’interconnaissances et d’interdépendances, commence lorsqu’« il y a une liaison entre
les liens eux-mêmes, ce qui a pour conséquence que ce qui arrive [...] entre une paire de
“nœuds” ne peut manquer d’affecter ce qui arrive entre une paire adjacente »3. C’est
dans ce cadre d’analyse que l’on peut donner toute leur dimension aux relations entre
WoDaaBe et Occidentaux.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
268
15 De rencontre en rencontre, la création de l’Assemblée se révèle foncièrement
interactive et imbriquée tout en étant profondément identitaire pour les WoDaaBe.
Dans cette initiative qui associe forum social et tourisme culturel, les Occidentaux ne
sont pas réduits à des spectateurs auxquels cette Assemblée serait destinée. Comme
interlocuteurs, ils en sont les co-acteurs en participant de façon directe ou non,
volontaire ou involontaire, à sa fondation. Ils participent des interconnexions opérées,
notamment au sein de la trame associative et lignagère qui constitue un des premiers
axes du réseau, mais aussi des disjonctions instaurées.
Une dynamique d'opposition : la critique de la « Cure Salée »
16 La « Cure Salée » est devenue un centre d’attraction touristique au Niger. Plusieurs
voyagistes spécialisés proposent des circuits incluant « les grandes fêtes des peuples du
désert » à des amateurs d’aventures et de vacances hors des sentiers battus. Ils jouent
avec un imaginaire saharien porteur (Cauvin Verner 2007) et promeuvent des critères
chers au tourisme culturel : la rencontre avec l’autre, la découverte de pratiques
différentes... Les agences insistent sur les relations directes nouées avec les « dernières
populations nomades » et sur l’éclat et l’authenticité de leurs fêtes. La « Cure Salée » fut
ainsi intégrée au circuit touristique et encadrée par le gouvernement nigérien qui en
fixe les dates et lieux afin de permettre un accès plus facile.
17 Les danses woDaaBe constituent également un intérêt majeur de la fête, ce que les Peuls
ont petit à petit mesuré. Les agences les vantent ; les touristes demandent à voir leurs
danses qui les fascinent pour leur beauté, la finesse des parures et l’élection du plus
beau danseur ; les WoDaaBe sont abondamment filmés et photographiés. Néanmoins,
alors que le gouvernement envoie des aides et que l’arrivée de touristes constitue un
apport financier, les WoDaaBe expliquent ne recevoir aucune compensation. Au
contraire, ils doivent payer leur transport, leur nourriture, trouver à se loger : « On ne
gagne que la fatigue » (Ibi). Ils critiquent les autorités de ne pas s’intéresser à leurs
difficultés et les Touaregs d’avoir la mainmise sur la fête selon une rivalité ancienne
entre les deux groupes. C’est donc une question financière, de reconnaissance et de
pouvoir qui se pose quand le tourisme culturel devient un enjeu économique croissant.
Ainsi, après l’édition 2003 qui connut un grand flux touristique, les WoDaaBe
décidèrent, sur proposition des associations, de boycotter la « Cure Salée ». « Celui qui
est venu en 2004 à In-Gall pour voir danser les Wodaabé est venu pour rien. Un petit
groupe veut bien faire entendre des chants traditionnels sur le podium officiel, mais ils
se produisent en habits de tous les jours [...] Touristes mécontents » (Thiry 2006 : 18).
18 Or non seulement les WoDaaBe ont décidé leur retrait de la « Cure Salée », mais ils
organisent leur Assemblée de façon parallèle telle une « réunion alternative » (Doula).
L’établissement de ses dates est révélateur de cet objectif : ils la programment
simultanément, ce qui entraîne les reproches de la part des Touaregs qui y voient une
rupture illégitime de « la tradition » et un lieu de concurrence. L’Assemblée forme à la
fois un mouvement d’opposition et d’affirmation économique, politique et identitaire, à
analyser en interaction avec les touristes, les autorités et les Touaregs. Le problème est
alors pour les organisateurs d’y drainer les acteurs espérés.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
269
Vers l'Assemblée générale via le canal touristique
« Marie : Bruxelloise, accueille Ali et fait des ventes de bijoux, tient le dispensaire àl’Assemblée. Pascal : dentiste à Niamey, dispensaire. Le groupe de Belges : cadresqui ont un projet de forage avec Ortoudo. Jean-Pierre : Français, a connu l’ONGAourinde au festival de Montignac. Sandrine : a rencontré Doula et Doutchi,documentaire sur l’Assemblée. Thomas : documentariste, m’a contactée pourapprocher les WoDaaBe. Carol (américaine), Bjorn (suédois) : photographe etanthropologue, ont divers projets. Iez : Anversoise, a écrit un article sur “la prise deconscience des WoDaaBe”, lien avec Doula. Gilles : photographe, a vu un reportage àla télé. Des touristes de passage français, italiens, espagnols, allemands, américains,hollandais, japonais » (journal de bord, Assemblée 2006).
19 Au fur et à mesure de mon terrain, je me demandais comment des personnes si
différentes avaient entrepris ce voyage jusqu’au fin fond du Niger pour se retrouver à
l’Assemblée des WoDaaBe.
20 C’est tout d’abord la venue des touristes de passage qui peut être retracée. Ils sont
arrivés par le biais d’agences de voyage et de guides accompagnateurs qui les ont
conduits à ce rassemblement où ils peuvent assister aux danses woDaaBe qu’ils
recherchent et apprécient. Car les organisateurs de l’Assemblée ont pris soin
d’informer agences et guides de la tenue de leur nouvelle réunion en indiquant le
programme et les tarifs appliqués (150 000 FCFA par agence en 2006). Les organisateurs
woDaaBe utilisent ainsi une première chaîne de transmission avec comme supports les
danses, et comme intermédiaires les agences et les guides avec leurs ressources
informationnelles et les sites Internet qu’ils alimentent. Ils peuvent par ce biais
atteindre et charrier jusqu’à eux un ensemble de touristes avec lesquels ils n’ont pas de
liens directs si ce n’est au moment de l’Assemblée. Ce mouvement fonctionne à partir
du moment où ce rassemblement se trouve à la croisée de plusieurs intérêts, lieu de
découverte pour les voyageurs, débouché pour les agences, atout touristique pour les
WoDaaBe.
21 Néanmoins, ce n’est pas la seule chaîne investie. Aux journalistes, photographes et
documentaristes qui se sont connectés à la fête pour des raisons professionnelles, et au
site Internet du collectif qui informe les voyageurs ne passant pas par une agence,
s’ajoutent des Occidentaux venus sur invitation des WoDaaBe et ce sont leurs
trajectoires qu’il s’agit également de définir.
« — Mon parcours, qui a fait que je me suis retrouvée là... C’était en 2001. J’ai fait unvoyage où j’ai rendu visite à un cousin en poste à Niamey. Ali était le gardien de lamaison. Cette année-là, il a émis l’envie de voyager en Europe pour vendre desbijoux et c’est comme ça que je lui ai offert de venir à la maison. Depuis, il vienttous les ans.— C’est le seul à venir ?— Il y a tout un réseau. Il y a Ortoudo (beau-frère d’Ali) qui vient régulièrement etqui a des accointances avec Bernard.— Il y a donc d’autres choses qui se sont greffées au fur et à mesure ?— Il y a beaucoup de choses. Il y a le projet de Bernard avec la famille d’Ortoudo... ily a Ali et ma famille. Comment dire... Là, il y a toute une histoire familiale. Macousine avait fait aussi un voyage au Niger. Elle y est allée avec ses deux enfants. Il ya eu un accident dramatique dans la famille, Jonathan est décédé... Et cet adolescentavait été très sensibilisé à la situation des WoDaaBe, il en avait parlé dans son école.Et à son décès, un peu en mémoire de lui, il y a eu une grande collecte de fonds pourcette école (au Niger). Depuis, ma cousine, ma famille soutient l’école de Tékinawa4.C’est une histoire familiale... C’est très affectif [...].
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
270
— C’est donc par le biais d’Ali que tu es arrivée à l’Assemblée ? À sa demande ?— On ne va pas dire “demande”. Ce sont les liens et l’attachement qu’il y amaintenant entre nous, le fait qu’il vienne ici, donc tu vois, c’est un attachementquasi familial, et puis le fait que mes enfants soient allés là-bas voir la famille...C’est une rencontre » (Marie, 2007, entretien téléphonique).
22 Loin d’un récit aux paysages exotiques, c’est une histoire très chargée
émotionnellement, un parcours de vie qui est relaté et qui s’est construit à partir d’une
rencontre avec un BoDaaDo (singulier de WoDaaBe) pendant un voyage au Niger. Ce
sont des liens puissants et à long terme qui sont exprimés dès lors que cette rencontre
s’insère dans un ensemble de processus interactifs. Elle donna tout d’abord lieu à une
multiplication de voyages entre le Niger et les pays du Nord, de visites et de
retrouvailles : les WoDaaBe viennent régulièrement chez leurs hôtes tandis que ceux-ci
retournent au Niger, accueillis dans les campements woDaaBe. Ces voyages
s’accompagnent de membres de la famille et d’amis. Un tissu relationnel plus large
s’établit au fur et à mesure des contacts, un cercle d’interconnaissances dont les
relations se combinent et se renforcent. Ces micro-histoires ont souvent donné lieu à
l’élaboration de projets d’aide aux WoDaaBe et d’associations montées autour d’une
association boDaaDo et même d’une famille5. Les liens sont ainsi décrits en termes
familiaux, ce qui en manifeste l’importance pour les acteurs et fait écho au
fonctionnement des WoDaaBe, famille d’Ali et famille d’Ortoudo. Ce système est intégré
par les Occidentaux.
23 Les histoires individuelles, qui découlent d’un contexte touristique mais aussi
professionnel, ont abouti à des invitations à l’Assemblée. Les WoDaaBe concernés
l’expliquent par l’importance de ce rassemblement pour eux et par la place de ces
personnes dans leurs projets. D’autant que le nombre de « Blancs » qui se joindra à
l’Assemblée donnera du poids et de la visibilité à l’événement. Enfin, les invitations se
font plus appuyées lorsque la famille est organisatrice en raison des liens tissés et parce
que cette venue participera à sa propre renommée, plusieurs enjeux se superposant.
Chaque branche de WoDaaBe, chaque association, chaque BoDaaDo sollicite alors un
réseau de connaissances occidentales nouées au Niger et lors de leurs voyages afin de
venir à l’Assemblée, réseau dont je faisais moi-même partie. Nous arrivions avec des
groupes différents et selon des parcours personnels divers. Et ce maillage ne s’arrêta
pas là puisque certains d’entre nous avaient à leur tour invité d’autres personnes.
24 Ainsi, ce qui amena les Occidentaux à traverser le Niger jusqu’à l’Assemblée, c’est la
force du réseau. Si l’imaginaire touristique forme un moteur considérable du voyage
(Amirou 2000), c’est la dynamique relationnelle qui peut être son paramètre ultime. Ce
deuxième axe d’analyse présente l’intérêt de renforcer l’étude du phénomène
touristique comme une interaction (Picard & Michaud 2001 : 8). D’autant que la relation
créée ne se limite pas toujours à un contact ponctuel avec un étranger de passage. Dans
certains cas, elle débouche sur un rapport durable qui a des répercussions
considérables pour les WoDaaBe et les Occidentaux. Car ces interactions sont à
considérer dans l’ensemble de celles qu’elles impliquent. En plus des effets retour sur
chaque groupe, elles doivent être réinsérées dans la multiplicité des liens entre
WoDaaBe et Occidentaux et dans la pluralité des situations.
25 Dès lors, la figure unique du touriste éclate. Mettre en regard un réseau et des histoires
individuelles permet de dépasser l’appréhension du tourisme culturel comme une
catégorie homogène pour l’envisager comme un ensemble de processus interactionnels
à décliner dans le temps. L’imaginaire devient un paramètre composite et interactif du
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
271
réseau, et mêle des images esthétiques, familiales, ethniques que les acteurs négocient
au fur et à mesure de leur parcours.
26 Néanmoins, ces interactions touristiques ne prennent tout leur sens que placées en
relation avec celles établies localement, dans le cas de l’Assemblée avec les Touaregs,
les autorités nigériennes et l’ensemble des WoDaaBe. Les organisateurs ont en effet
lancé des invitations auprès des autorités politiques nationales, régionales et locales,
woDaaBe et non woDaaBe, dont la participation au rassemblement est également
importante. Ce n’est qu’à cette condition que la présence occidentale prend toute sa
place ; ce n’est que dans cet ensemble interactionnel que le tourisme culturel devient
un levier. S’il s’agit pour les WoDaaBe de faire venir les touristes à eux, c’est également
par ce biais touristique qu’ils cherchent à « porter leur voix » (Doutchi) auprès des
autorités nigériennes.
27 Au cœur du phénomène de mondialisation où le tourisme culturel s’insère et auquel
lui-même participe, s’opère ainsi une forte relocalisation. Le canal touristique, par la
puissance du réseau qu’il comprend et l’importance des enjeux qu’il concentre, induit
ce mouvement qui se cristallise pour les WoDaaBe dans l’Assemblée générale. Deux
points le confortent : l’ancrage de l’événement au Niger, et son insertion dans des
questions économiques, politiques et identitaires locales. Le rôle des WoDaaBe s’y avère
capital. À l’initiative du projet, ils ont sollicité leurs connaissances, organisé le
rassemblement, engagé les réseaux par lesquels les différents protagonistes sont
arrivés au rassemblement. Cependant, une fois les WoDaaBe, les « touristes » et les
autorités nigériennes réunis à l’Assemblée, il faut cerner plus précisément la manière
dont ils interagissent au sein de l’événement et analyser les agencements auxquels ce
rassemblement donne effectivement lieu afin d’en saisir l’efficacité.
Dans les interstices de l'Assemblée : le tourismeculturel comme champ d'interférences
28 Jour après jour, les organisateurs de l’Assemblée ont programmé plusieurs temps
correspondant aux buts revendiqués, faire découvrir la culture des WoDaaBe, se
rassembler et échanger autour de leurs difficultés, alerter sur leurs besoins et obtenir
des aides, des objectifs qui s’enchevêtrent tout au long du rassemblement.
L'émergence d'une instance militante
29 L’Assemblée générale commence par les discours des LaamiBe (chefs de groupements),
de l’organisateur et des présidents d’associations : chacun souhaite la bienvenue aux
participants, remercie et exprime l’importance du moment pour les WoDaaBe, le tout
en fulfulde. Les présidents d’associations ont joint pour cet acte d’inauguration les
chefs traditionnels qui apportent une aide matérielle notable et soutiennent
l’Assemblée par leur présence et leur participation. Ils assurent de ce fait celles de leur
groupe et officialisent l’événement. Si le système associatif a donné pouvoir et prestige
à des jeunes hommes, les chefs restent pour les organisateurs un relais incontournable
en tant que caution sociale et politique, et que vecteur de rassemblement.
30 Un premier niveau d’imbrication se fait donc entre acteurs woDaaBe qui doivent
combiner une partie de leurs prérogatives afin d’atteindre leurs buts. Toute une partie
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
272
de l’Assemblée sera constituée de discours, de réunions et de débats où ils vont exposer
leurs difficultés, envisager ensemble des solutions et définir des revendications
communes. Si les uns et les autres n’insistent pas sur les mêmes points, tous évoquent
les mêmes problèmes : une crise de l’élevage nomade causée par la dégradation de
l’environnement, les contraintes d’accès à l’eau et une réduction des territoires
pastoraux. Les WoDaaBe mettent également en avant des conditions de vie précaires et
une situation sanitaire et sociale fragile liée au manque de centres de santé et d’écoles
accessibles. Non scolarisés, ils expliquent enfin ne pas pouvoir accéder aux voies de
participation au gouvernement, ne pas avoir de représentants pour défendre leurs
droits et ne pas connaître les textes de lois.
31 Les WoDaaBe proposent au fil des réunions différentes pistes pour lesquelles ils
souhaitent solliciter les associations, les ONG et l’État nigérien : une semi-
sédentarisation dans des « centres woDaaBe » avec des écoles, puits, dispensaires,
greniers pour « obtenir des terres que le nomadisme fait perdre » ; une valorisation de
l’élevage mobile comme argument touristique et écologique majeur ; le développement
de la scolarisation et de la formation citoyenne, etc. Le caractère revendicatif des
WoDaaBe est flagrant dans un « forum social et culturel » (dossier de présentation
envoyé par Djingo) où ils élaborent leurs arguments et unifient leurs demandes.
32 Dès lors, un événement qui pouvait être qualifié de touristique participe à la
dynamique interne de la société. L’Assemblée permet aux WoDaaBe de se réunir à
grande échelle et de solliciter le groupe à un niveau plus général que les autres fêtes :
des milliers de personnes, des chefs et des lignages venus du pays entier s’y retrouvent.
Tous soulignent l’importance de « l’unité ainsi créée qui doit être entretenue pour faire
de la communauté des éleveurs une communauté forte et soudée » (discours laamiBe).
L’enjeu est social mais surtout politique : l’Assemblée conduit les WoDaaBe à se
constituer en communauté, à construire des stratégies collectives et à porter
officiellement leurs revendications.
33 Certes, cela n’empêche pas des intérêts concurrentiels de réapparaître. L’attribution de
la direction de l’Assemblée révèle des concurrences associatives et lignagères, car elle
participe à la renommée du groupe responsable. Ce rassemblement constitue un outil
politique avec ses stratégies de légitimation et ses jeux de rivalité6 et donne lieu à des
luttes de prestige courantes chez les WoDaaBe. D’autant que s’y superposent des
ambitions personnelles. L’Assemblée mêle des phénomènes de concurrence et des
processus de coopération en répondant simultanément à des enjeux différents.
34 Dans ce premier pan de l’Assemblée, les WoDaaBe forment le centre de l’événement.
Nombre de moments sont réalisés pour eux et ne sont guère orientés vers les touristes
qui en constituent le rouage mais pas le destinataire. Les discours ne furent d’ailleurs
nullement traduits, d’où le désappointement de certains voyageurs qui, déroutés,
venaient questionner les Occidentaux repérés comme « connaisseurs ». Ces dissensions,
si elles pouvaient les conduire à emprunter des voies parallèles, ont donné lieu à un
nouvel enchâssement, entre Occidentaux, avec les WoDaaBe en arrière-fond.
35 Pour autant, les touristes ne furent pas totalement écartés. Ils ont pu assister aux
discours et discussions, expérience qui participait à l’impression d’authenticité qu’ils
ressentaient entre des hommes enturbannés, bercés par les sonorités d’une langue
étrangère. Le déroulement de l’Assemblée réintègre les touristes par des moments qui
justement ne leur sont pas destinés. Ces débats donnaient également l’opportunité aux
membres des associations d’entrer en contact avec des personnes qui pouvaient être
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
273
intéressées par leur situation. Ils engageaient la conversation, les invitaient à prendre
un thé et, par captation, leur présentaient leurs projets. L’Assemblée donne ainsi lieu à
un ensemble d’interactions parfois inattendues entre Occidentaux et WoDaaBe qu’il
s’agit de décliner au fur et à mesure des manifestations.
Dans l'objectif du touriste
36 En plus des réunions, des danses sont quotidiennement réalisées auxquelles les
touristes sont nombreux à se rendre. Ils contemplent les parures et les chorégraphies
des danseurs, prennent films et photographies comme ceux qu’ils ont appréciés dans
les livres et les documentaires. Le voyage est total puisqu’il rejoint les images qu’ils ont
déjà vues et qu’ils rapporteront.
37 La réalisation de danses et la prise de vue sont dès lors inséparables de ces interactions
touristiques ainsi que journalistiques. Les WoDaaBe doivent répondre aux attentes de
personnes venues à l’Assemblée pour admirer leurs danses et qui se sont dans ce but
acquittées de leur « cotisation »7. Il leur faut également créer de l’événementiel pour
des Occidentaux qui souhaitent découvrir leur culture. Les danses sont en ce sens
efficaces et significatives même si d’autres expressions les complètent. L’organisateur a
fait dresser des « sagas », étals sur lesquels les femmes disposent calebasses et objets
décoratifs. Ces vaisseliers, propriété de chaque femme, sont embellis lors des fêtes
woDaaBe. Néanmoins, ils ne sont plus rattachés pendant l’Assemblée à une habitation
mais disposés les uns à côté des autres comme dans une exposition. Les touristes
pourront déambuler le long de ces objets qu’ils photographieront après les visages des
WoDaaBe qu’ils ont croisés et les courses de chameaux qui ont animé le rassemblement.
38 Néanmoins, les danses ne peuvent être uniquement lues comme des spectacles
touristiques. Tout d’abord, elles sont présentes dans tous les rassemblements woDaaBe.
L’Assemblée devient une occasion supplémentaire de se réunir et de fêter. De plus, le
public n’est pas seulement composé de touristes. Les danses sont le centre d’attraction
des jeunes woDaaBe. Ils sont avides de voir les danseurs et se pressent autour de la
piste. De même, les hommes dansent avec exaltation à la fois pour séduire les femmes
et attirer les objectifs des touristes. Enfin, les modalités ne sont nullement
transformées : les parures, chants et chorégraphies sont identiques aux danses
observées ailleurs. Les danses de l’Assemblée ne constituent pas des mises en scène
conçues à la seule intention des touristes, qui ne seraient destinées qu’à eux et
laisseraient les acteurs locaux indifférents. Bien au contraire, elles suivent la
composition des danses woDaaBe et sont également investies par eux.
39 Ces points rompent avec l’inauthenticité attribuée aux danses touristiques comme des
anthropologues l’ont déjà développé (Cohen 1988 ; Daniel Payne 1996). Outre que leurs
paramètres ne correspondent pas toujours à la séparation établie entre touristes et
autochtones, ces danses peuvent revêtir des fonctions identitaires importantes. Mettre
en scène sa culture conduit à définir et affirmer ce qu’est son identité, et son reflet dans
l’objectif du touriste la renforce. Une exposition n’est plus une folklorisation mais une
exacerbation identitaire que l’on présentera aux regards étrangers. Comme le résument
J. M. Furt et F. Michel (2006 : 7) : « L’identité contribue au développement touristique
autant que le tourisme contribue, pour sa part, à la refondation des identités. »
40 Les danses woDaaBe permettent de poursuivre cette déconstruction de l’inauthenticité
en questionnant jusqu’à la dichotomie « danse touristique » et « cérémonielle ». En
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
274
premier lieu, les négociations recouvrent des situations variées, entre des danses
réalisées sur scène, celles effectuées à la demande en brousse et une présence
touristique lors des cérémonies et rassemblements (Lassibille 2006). Certaines danses
peuvent donc être à la fois commerciales et cérémonielles, touristiques et autochtones.
Au-delà des interférences entre plusieurs contextes qui supposent une distinction sous-
jacente, danses « commerciales » et « cérémonielles » ne forment pas pour les WoDaaBe
des catégories hermétiques8. Les catégories des ethnologues se révèlent en
comparaison sclérosantes et idéologiques dans les choix opérés et ne donnent pas toute
sa dimension à l’imbrication des contextes. La danse est chez les WoDaaBe multi-
contextuelle et peut prendre place dans un cadre marchand sans enfreindre d’interdits.
Elle ne revêt pas les tensions chorégraphiques de danses rituelles effectuées dans une
situation touristique (Picard 1992). Ainsi, tandis que certaines sociétés s’attachent à
différencier danses « religieuses » et « touristiques », les WoDaaBe affirment leurs
similitudes.
41 L’anthropologue doit en conséquence se saisir de la spécificité des pratiques dansées
sans laquelle il ne peut cerner toutes les incidences qu’une mise en tourisme implique.
Il s’agit de différencier les contextes, les pratiques et les acteurs à commencer par les
WoDaaBe qui n’ont pas les mêmes centres d’intérêts : les plus jeunes vont aux danses,
les autres aux réunions. « L’important pour nous, ce ne sont pas les danses mais régler
les problèmes woDaaBe » (Sanda)9. La série de divisions et d’emboîtements de
l’Assemblée ne se répartit pas selon la division touristes/WoDaaBe mais à l’intérieur de
chacune.
Étrangers, indigènes ou autochtones ?
42 Les centres d’intérêts des Occidentaux divergent de la même façon selon qu’ils soient
des touristes de passage qui viennent assister aux danses et prendre des photographies,
ou des interlocuteurs qui connaissent les WoDaaBe depuis des années et prennent part
à des projets les concernant.
43 Ces derniers critiquent alors des danses qu’ils jugent justement trop « touristiques » et
les mises en scène qui sont présentées. Ils leur préfèrent les danses de nuit qu’ils
estiment plus « informelles » et les festivités non prévues dans le programme. Ces
appréciations sous-tendent la différenciation qu’ils établissent entre les touristes et
eux, et l’image que les danses touristiques leur renvoient. Le positionnement des uns
s’établit en opposition avec les autres. Il s’agit de se distinguer du « mauvais touriste »
qui déambule « comme au milieu d’un parc d’attractions, considérant chaque Peul non
comme un être humain mais comme un cliché potentiel » (Thomas). Le touriste devient
leur « étranger », leur « idiot du voyage » (Urbain 2001). C’est avec ces discours
intransigeants qu’ils cherchent à se différencier selon un arrière-plan tout aussi
idéologisé que celui des touristes. Les WoDaaBe doivent alors répondre simultanément
à des attentes qui se construisent en termes antinomiques tandis que touristes de
passage et Occidentaux impliqués sont tous, pour des raisons différentes, aussi
importants à leurs yeux.
44 Or, même les Occidentaux investis arrivent avec divers projets à l’Assemblée : Bernard
et le groupe de Belges souhaitaient faire avancer leur projet de forage à Azanghafa ;
Marie avait prévu d’apporter des soins ; Sandrine devait activer le projet Lissal, etc.
« chacun y va avec ses initiatives privées, il n’y a pas des grosses organisations. Des
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
275
petites initiatives privées qui se font par des liens d’amitié » (Marie). Ces acteurs, tout
en répondant aux demandes des WoDaaBe, ont poursuivi leurs objectifs. Alors qu’un
pan de l’Assemblée se centre sur les WoDaaBe, un autre se porte sur des Occidentaux
qui y font leur propre place.
45 Néanmoins, ces initiatives, dont les acteurs ne se connaissaient souvent pas avant le
rassemblement, se sont parfois coordonnées. Ainsi le « château belge », comme il fut
surnommé, se constitua sur place. Le groupe de Bernard arrivé avec Ortoudo et Marie
avec Ali, « on s’est retrouvé forcément. Ali et Ortoudo, c’est le même groupe [lignage
Gojanko’en] [...] ce n’était pas organisé ensemble. On s’est retrouvé ensemble » (Marie).
Ce regroupement ne s’est pas tant opéré en fonction de leur pays d’origine, la Belgique,
que selon leur famille boDaaDo de rattachement. Le système familial des WoDaaBe,
quoique particulièrement opérant, ne fut cependant pas exclusif et d’autres
rapprochements se sont réalisés. En premier lieu, des compétences se sont agrégées
dans des actions ponctuelles : Marie a rencontré un dentiste à l’Assemblée et ils ont
collaboré pour faire les consultations. J’y ai été à mon tour associée comme aide à la
traduction. Les voies d’arrivée à l’Assemblée ont été différentes, mais les ressorts selon
lesquels les personnes s’y retrouvent font qu’elles s’y combinent.
46 Au-delà, l’Assemblée a permis à des acteurs éparpillés sur plusieurs pays et appartenant
à différents réseaux woDaaBe de connaître leur existence mutuelle. Les WoDaaBe
maintiennent une certaine opacité quant à la composition de leur réseau et n’en
présentent jamais la totalité afin sans doute d’en conserver le contrôle. La réunion de
l’Assemblée y a en partie contrevenu. Les Occidentaux s’y sont rencontrés et côtoyés, et
quelques-uns sont restés en contact. Il y a bien sûr ceux qui font partie de la « même
famille » et ont des projets associatifs qui se recoupent. Il s’agit alors d’un
renforcement du réseau. Mais d’autres sont passés d’un cercle à l’autre quand ils ont
mené des actions communes ou lorsqu’ils ont été cooptés. La rencontre avec des
Occidentaux de cercles différents les a amenés à entrer en relation avec d’autres
WoDaaBe et associations. Le lien n’est plus en ce cas créé par les WoDaaBe mais par les
Occidentaux qui tissent, durant l’Assemblée, leurs propres réseaux à l’intérieur de ceux
des WoDaaBe. Et cette recherche anthropologique doit elle-même être insérée dans
cette dynamique. J’arrivais aussi avec mon projet à l’Assemblée ; j’y ai rencontré des
personnes que j’ai recontactées et qui ont activé leur réseau. Outre que l’anthropologue
constitue une interface entre les acteurs, les effets de son enquête prennent part au
processus.
47 Si la programmation de l’Assemblée répond aux buts revendiqués par les WoDaaBe, son
déroulement ne tient pas uniquement à eux ; non seulement il découle de ce qu’ils
projettent sur les autres acteurs, mais leurs interlocuteurs y ont aussi leur part en
menant leurs propres actions. Projets et ONG viennent y mener des campagnes de
sensibilisation, etc. Ceci conduit à considérer le déroulement de l’événement en termes
de configuration où les protagonistes sont à différencier au-delà des catégories
« touriste » et « autochtone ». En effet, outre que d’autres acteurs sont à insérer dans
l’analyse (guides, ONG, etc.), leur redistribution n’est pas toujours définie selon leur
appartenance mais par des centres d’intérêt et des attentes qui diffèrent,
s’enchevêtrent et interfèrent. L’analyse se déplace alors vers des interactions qui
forment l’essentiel du rassemblement. En émerge le profond enchevêtrement entre les
divers acteurs. Ils sont pris dans un ensemble d’interrelations, de représentations et
d’utilisation réciproque à étudier dans toutes ses ramifications et sa part
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
276
d’incompréhensions, de paradoxes et de tensions : rivalités entre associations woDaaBe,
divergences entre touristes et Occidentaux impliqués, désaccords entre projets,
tensions avec les guides souvent touaregs, malentendus du tourisme culturel et
solidaire (Chabloz 2007). L’Assemblée produit des dissensions qui aboutissent à de
nouveaux emboîtements, des maillages, démaillages et remaillages10. C’est pourquoi la
portée d’un moment ne se joue pas forcément par rapport à l’objectif de sa
programmation : les événements non destinés aux touristes les y intègrent tandis que
les spectacles dits « touristiques » les dépassent et revêtent des résonances identitaires
pour les WoDaaBe. C’est tout le paradoxe du tourisme culturel et son caractère auto-
destructeur : il perd toute légitimité dès lors qu’il existe.
48 S’engage ainsi un jeu de miroirs complexe entre étrangers, indigènes et autochtones :
les touristes sont « les étrangers » d’autres Occidentaux selon une mise en abîme où le
touriste reste l’autre ; les WoDaaBe sont les indigènes des autorités autochtones qu’un
visiteur résume en ces termes : « Tout ça c’est très bien, mais c’est quand même des
organisations ethniques. » L’Assemblée est considérée comme un exemple de
« tourisme indigène » alors qu’il se fonde intrinsèquement dans ses interactions avec
les Occidentaux. Mais le « tourisme indigène » commence peut-être à partir de là,
quand il se reflète dans le regard de l’autre, au moment même où une pratique
touristique devient un outil politique.
Entre espace touristique et politique : la danse commepivot
49 Il s’agit dans un dernier temps d’introduire les autres acteurs qui forment la
configuration effective de l’Assemblée, les officiels nigériens. Les autorités nationales,
régionales et locales, ministres, gouverneurs, préfets, maires, se déplacent à
l’Assemblée. Elles ne peuvent faire fi d’un tel rassemblement et de la venue de touristes
qu’elle suscite. La simple présence des « Blancs » confère du prestige à l’événement
selon un imaginaire colonial parfaitement intégré par les acteurs africains. Celui-ci
mêle la connivence de « frères », particulièrement présente chez les élites, et la
hiérarchie implicite des « souverains » et des « sujets » (Dozon 2003) qui donne sa
valeur au moment et se décline entre touristes, autorités nigériennes et WoDaaBe.
50 Les officiels sont ainsi reçus avec déférence par les WoDaaBe et leur arrivée donne lieu
à des manifestations programmées et particulièrement organisées. Des danses sont
mises en scène, photographiées par les touristes, sous le regard des officiels et des
WoDaaBe réunis. Elles forment le nœud de ce dispositif tout en réseau et en
imbrications.
Danser ici et danser là-bas : du local à l'international, de
l'international au local
51 Les danses sont au cœur du réseau développé. C’est pour elles que nombre de touristes
et de journalistes viennent jusqu’aux WoDaaBe. Elles sont un attrait touristique majeur,
notamment dans un cadre de « tourisme culturel ». C’est aussi par les danses que les
WoDaaBe sont pour partie venus dans les pays du Nord. Ils se produisent régulièrement
dans des spectacles et des festivals où ils rencontrent un succès certain. D’une
manifestation locale, les danses se transforment en pratique internationale dans un
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
277
changement d’échelle qui découle de flux de population et de médias interconnectés
selon le dispositif conceptuel d’Arjun Appadurai (2005)11. Les danses ont amené à « la
mondialisation des WoDaaBe » dans laquelle ces derniers sont des plus actifs.
52 Mais ces danses internationalisées redeviennent un enjeu local, par ce détour même,
comme l’Assemblée des WoDaaBe en témoigne. Elles concentrent trois phénomènes. En
premier lieu, leur internationalisation et leur mise en tourisme forme un enjeu
économique qui peut s’avérer croissant au Niger et avoir des répercussions locales
importantes comme l’illustre la situation des Touaregs (Grégoire 2006). Implantés dans
les circuits touristiques, commerciaux et associatifs de longue date, certains ont acquis
un pouvoir économique non négligeable et sont en train de développer des
« ranchings » (« propriétés privées et clôturées ») qui peuvent transformer le monde
pastoral.
53 De plus, les danses sont un lieu d’affirmation identitaire essentiel pour les WoDaaBe.
Les danseurs offrent la représentation qu’ils se font d’eux-mêmes, une identité qui se
centre chez eux sur la beauté physique (Lassibille 2004) et attire particulièrement le
regard. Les danses sont le garant de la présence de l’autre tout en posant
fondamentalement la limite entre soi et autrui. Elles suscitent un regard nécessaire
pour définir et affirmer l’identité du groupe, et le regard touristique en fait partie.
Conçues à l’intersection entre des regards, celui des autres et celui du groupe sur lui-
même, mises en scène éphémères qui doivent être sans cesse renouvelées pour exister,
les danses « touristiques » s’avèrent être au cœur des enjeux identitaires se posant
actuellement aux WoDaaBe. « [...] si les regards extérieurs occasionnent des mises en
scène de la tradition, dans les coulisses se jouent des négociations qui font sens pour les
acteurs et peuvent générer des resocialisations et des reformulations identitaires qui
sont bien contemporaines » (Doquet 2002 : 125).
54 Enfin, alors que les WoDaaBe sont plutôt marginalisés et dépréciés par les populations
nigériennes 12, leurs danses, valorisées dans et par les regards occidentaux, sont
devenues une vitrine culturelle du pays. Les WoDaaBe dansent au Niger pour les
manifestations qui y sont organisées (Festival international de la mode africaine, Jeux
de la francophonie...) et dans les réceptions données par le gouvernement nigérien lors
des visites de chefs d’État. Ils représentent le pays dans les festivals étrangers et
acquièrent une renommée qui n’est pas sans effet au Niger. Ils ont pris conscience que
leurs danses, pour lesquelles ils sont complimentés et recherchés, peuvent constituer
un moyen de pression et leur donner un pouvoir de revendication au Niger. Elles
deviennent stratégiques vis-à-vis des autorités.
55 Ceci tend à expliquer la place centrale des danses à l’Assemblée et leur mise en scène
pour l’accueil des autorités nigériennes. Attrait touristique, lieu d’affirmation
identitaire et vitrine politique, elles ont l’intérêt de rassembler en un même lieu les
différents acteurs impliqués et de constituer un spectacle révélateur des interactions
en cours.
« Des danses touristiques » comme scènes politiques
56 En face de la tente touarègue où les officiels seront installés, des jeunes femmes et des
danseurs s’alignent, parés pour certains en tenue de danse yaake, pour d’autres de
geerewol13. On entend des chants de ruumi diffusés par des haut-parleurs ainsi que les
instructions des organisateurs woDaaBe qui parlent dans un mégaphone. Le public est
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
278
nombreux. De part et d’autre de la ligne de danseurs, les WoDaaBe, jeunes hommes et
jeunes femmes, s’amassent. Sous un arbre ou sous la tente, les touristes prennent des
photographies. Tout le monde attend l’arrivée des autorités annoncées.
Danses woDaaBe organisées pour la réception des officiels nigériens. Assemblée générale desPeuls woDaaBe du Niger à Azanghafa, région de Tchintabaraden.
Cliché de l’auteure (2006).
57 Le départ est donné, les haut-parleurs sont coupés et les danseurs commencent à
entonner les chants de yaake/geerewol. La voiture arrive et le ministre sort tandis que
des militaires assurent la sécurité. Il fait le tour de la scène, salue la foule, regarde les
danseurs et échange quelques mots avec les touristes. Il s’installe enfin avec les chefs
traditionnels et les présidents d’associations alors que les danseurs continuent leurs
démonstrations. De jeunes WoDaaBe arrivent sur leurs chameaux, brandissant des
drapeaux du Niger, et s’alignent face à la tente selon les directives des organisateurs.
Puis, les autorités et les représentants woDaaBe discutent sous les caméras et les micros
des médias nigériens.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
279
Alignement de jeunes WoDaaBe à dromadaires. Assemblée générale des Peuls woDaaBe du Niger àAzanghafa, région de Tchintabaraden
Cliché de l’auteure (2006).
58 La mise en scène est flagrante : si l’alignement est une figure centrale des
chorégraphies woDaaBe, non seulement hommes et femmes ne dansent habituellement
pas ensemble, mais yaake et geerewol sont effectuées séparément. De plus, la geerewol,
devenue emblématique des WoDaaBe, n’est réalisée normalement que dans un contexte
cérémoniel précis, la Ngaanyka.
59 Les organisateurs cherchent par ce biais à exposer « la culture des WoDaaBe » pour
laquelle ils sont appréciés tout en affirmant leur appartenance à la nation nigérienne
symbolisée par les drapeaux qui flottent dans l’air. Ils scénarisent des éléments qui leur
semblent constituer des arguments aux yeux des autorités du pays tout en les flattant.
60 Cette mise en scène peut tout d’abord être analysée comme une « chorégraphie
politique », ceci en prolongeant les travaux d’Anthony Shay (2002 : 2). Cet
anthropologue a montré à propos des troupes de danses folkloriques que ces spectacles,
dont le répertoire, la scénographie, la musique et la chorégraphie furent triés et
modifiés, sont des vitrines politiques qui servent les images des États-Nations qu’elles
représentent. L’acte de représenter implique une forme de pouvoir, celui de définir, de
décrire et d’agir au nom de quelqu’un d’autre. Le même phénomène se retrouve dans
l’Assemblée non plus au niveau des États-Nations mais de celui des communautés face à
eux. Ces mises en scène, qui associent des processus d’essentialisation, de
particularisation et de stéréotypification, constituent pour les WoDaaBe une tribune
qui leur permet de jouer à la fois sur l’ethnicité et sur le nationalisme, entre la geerewol
et les drapeaux nigériens.
61 Or, le pouvoir de ces performances ne tient pas uniquement à leur contenu spécifique
et à leur capacité de représenter des identités essentialisées mais aussi à la présence
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
280
des acteurs qu’elles impliquent. La mise en scène ne fonctionne que si les trois regards
sont réunis, touristes, autorités et WoDaaBe. Le dispositif nécessite leur co-présence et
c’est là toute la dimension politique de ces interactions. Au-delà d’un miroir, c’est un
phénomène de diffraction qui se met en place entre des autorités qui regardent les
WoDaaBe par le canal touristique, et des WoDaaBe qui regardent leurs danses à travers
le prisme des regards posés sur elles. L’autre fait partie de la représentation par le
regard qu’il porte mais aussi par les images qu’il engendre et qui sont tout autant
influentes et opérantes. On passe par cette triade d’une chorégraphie à une
dramaturgie politique. D’autant que si touristes et autorités ne sont pas là, les WoDaaBe
n’agiteront pas les drapeaux nigériens. Ce sont les interprétants qui créent les signes.
62 Les danses engagées dans un cadre touristique se transforment alors en scène politique
à différents niveaux. La mise en scène à laquelle elles donnent lieu en constitue un
premier angle d’attaque. De plus, les chefs woDaaBe et les présidents d’associations ont
concrètement l’occasion d’exposer leurs revendications préalablement définies auprès
des autorités que les danses ont indirectement drainées. Enfin, ces danses touristiques
sont politiques dès lors qu’elles revêtent une dimension internationale et une portée
locale qui s’enchevêtrent. « Le touriste semble convoqué là pour reconnaître, certifier
l’acte » (Lanfant dans Picard 1992 : 10), acte identitaire et acte politique tout à la fois.
Le tourisme culturel comme ressort local
63 Le tourisme culturel peut à ce moment là être considéré dans ses incidences. Il forme
un levier économique pour les WoDaaBe mais non par la voie attendue. En effet,
l’Assemblée n’engrange pas de réels bénéfices et couvrent pour l’essentiel les
importantes dépenses liées à un tel rassemblement : location de matériels, achat de
nourriture et de carburant pour les invités et les organisateurs, salaires des cuisiniers,
techniciens, secrétaire/rapporteurs, vigiles, etc. Les danseurs ne sont nullement payés
et seuls les membres du comité d’organisation reçoivent une indemnisation (2 000 FCFA
par jour pendant quinze jours). Les cotisations versées par les touristes et les apports
bénévoles équivalent seulement aux contributions des associations, des chefs
traditionnels et des groupes eux-mêmes auxquelles s’ajoutent la participation de l’État
nigérien, collectivités et partenaires au développement.
64 En définitive, l’Assemblée est davantage un moment stratégique pour obtenir des aides
à venir auprès du gouvernement nigérien, des ONG et des touristes. Les WoDaaBe y
présentent leurs projets et y font leurs revendications, bénéficient d’une écoute si ce
n’est d’accords, et obtiennent des aides. En intégrant les touristes dans leurs stratégies
commerciales et migratoires, ils commencent à mettre en place des programmes de
scolarisation et de santé desquels ils étaient largement absents. Des « centres
woDaaBe », principalement initiés par les responsables d’associations, se multiplient
avec école, greniers et puits (une quarantaine pour l’instant sur le territoire). « Nous les
WoDaaBe, nous avons des problèmes au pays. Et on cherche des contacts mais on n’en
trouve pas au Niger. On pose des dossiers, mais cela ne marche pas [...]. C’est ce qui
nous donne le courage de venir ici, pour avoir des contacts, pour avoir les gens qui nous
aide à écrire, lire [...]. Pour nous aider pour les puits » (Doutchi). Dès lors, le sens de
circulation habituellement attribué est inversé : ce ne sont pas des Occidentaux qui
partent à la recherche des WoDaaBe mais des WoDaaBe qui partent à la recherche
d’Occidentaux de part et d’autre des continents.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
281
65 Les effets locaux du tourisme culturel prennent une dimension économique et sociale
mais aussi politique et identitaire sans que ces plans soient dissociables. Les WoDaaBe
affirment progressivement, par le biais des danses et du tourisme, leur position
politique et leur identité au Niger. De cette expérience touristique, naît le sentiment
que leurs danses peuvent constituer un atout dans un contexte local. Elles deviennent
un élément de valorisation et une « forme de pouvoir » non seulement pour ce qu’elles
mettent en scène, mais aussi pour les enjeux touristiques qu’elles représentent. Avec la
présence de touristes à l’Assemblée, les WoDaaBe font venir les autorités nigériennes
auprès desquelles ils tentent de faire pression. L’accueil des officiels est une clé du
rassemblement pour les organisateurs qui cherchent à être considérés comme des
interlocuteurs à part entière par le gouvernement. « Les WoDaaBe tu sais, ils ne sont
pas au gouvernement.
66 Il n’y a pas de WoDaaBe dans la justice, il n’y a pas de WoDaaBe dans l’administration, il
n’y a pas de WoDaaBe dans les organismes qui ont de l’argent. Nous ne sommes pas
dans les affaires du pays. Avec les associations, nous sommes connus [Min anndaama].
Est-ce que tu comprends ? » (Doutchi). Les associations, l’Assemblée et le collectif
Djingo, « c’est pour l’unité, pour avoir une voix face aux autorités, pour avoir la force
au pays [semmbe Di leydi] » (Doutchi). Et les danses de l’Assemblée en sont le point
d’aboutissement.
67 L’Assemblée leur en donne l’occasion même si les résultats ne sont pas au niveau
escompté par les WoDaaBe car les autorités ont leurs propres intérêts : elles ont des
voix politiques à engranger et une opinion publique à séduire tout en poursuivant
d’autres projets à concrétiser que ceux des pasteurs nomades. Elles ont tendance à se
méfier de mouvements qu’elles désignent « d’ethniques » selon un discours tribaliste
déjà analysé dans ses stratégies disqualifiantes (Amselle 1999 : 40). Elles furent ainsi
l’objet de critiques de la part de certains WoDaaBe qui y voyaient « des boubous qui
viennent et repartent ». De plus, leur arrivée tardive désorganisa l’Assemblée et
conduisit les organisateurs à repenser sa configuration interactionnelle. C’est encore
par voie indirecte que les effets politiques du tourisme culturel tendent à apparaître.
68 Les conseils et la sensibilisation de leurs interlocuteurs occidentaux se révèlent être le
ressort le plus fort sur un plan local. Iez et Louis par exemple, qui se sont rencontrés à
l’Assemblée et n’appartiennent pas au même réseau, ont proposé au collectif Djingo
d’engager deux axes : inciter les WoDaaBe à participer à la vie politique nigérienne,
assister aux conseils municipaux, communaux et aux commissions foncières, voter et se
présenter aux élections selon une stratégie locale évidente ; s’appuyer également sur
les chartes signées par le Niger (déclaration des Nations-Unies sur les droits des
peuples autochtones) et sur les organisations internationales qui promeuvent la
reconnaissance des peuples autochtones, ou encore prendre part à des projets de
convention comme le Pastoralist Policy Framework pour défendre leurs droits par
l’angle opposé. Ces propositions, votées par Djingo, croisent des dynamiques locales et
internationales dont les champs d’actions interfèrent. Ainsi, Iez a obtenu une aide
financière d’un centre néerlandais pour les droits des peuples autochtones au profit de
Djingo afin de consolider le collectif et pour qu’il travaille à la participation des
WoDaaBe dans les prises de décision locales, nationales et internationales.
69 Dans ce contexte, les danses engendrent finalement un tissu de relations qui engagent
les acteurs dans des positionnements politiques et revendicatifs plus affirmés. Elles
conduisent à une recomposition locale dont les effets restent à considérer sur le long
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
282
terme. La situation des WoDaaBe n’est plus à appréhender dans une globalité
décontextualisée mais dans une multiplicité de situations transnationales particulières,
du local au local, ce qui donne à repenser les différenciations habituelles entre global et
local, intérieur et extérieur, étranger et autochtone.
*
Une anthropologie du tourisme à l'interface duchorégraphique et du politique
70 Si le tourisme culturel est fréquemment envisagé du point de vue imaginaire et
idéologique, y insérer les pratiques concrètes auxquelles il donne lieu et dans lesquelles
les acteurs, leurs représentations et leurs actes interagissent, s’avère utile. Défini
comme un « tourisme de rencontre et d’échange », il se transforme en champ
d’interférences où l’observation des relations effectivement nouées est
particulièrement fructueuse. Par cette nouvelle ethnographie, le tourisme apparaît
comme une mise en réseau dont la dimension cachée conduit à inverser bien des
perspectives.
71 Cette démarche permet tout d’abord de déconstruire le modèle qui distingue le
touriste, l’indigène et la relation entre les deux pour mettre en avant leur constant
emboîtement, ceci dès le départ de la situation touristique. Le projet de l’Assemblée est
déjà l’histoire d’interrelations où WoDaaBe et Européens sont inextricablement liés. Cet
angle est renforcé par l’insertion inévitable des autorités dans l’équation, sans oublier
les Touaregs et des intermédiaires comme l’anthropologue, les agences et guides
touristiques, les médias. L’analyse de ces interactions participe d’une perspective
dynamique qui restitue la complexité des situations et des actions dans le réseau où ils
prennent place, au sein du maillage entre WoDaaBe et Occidentaux.
72 De plus, dans ce cas de figure, l’indigène n’est plus seulement un « réacteur » face au
touriste (Michaud 2001 : 19) ; il devient un initiateur, ce qui permet de revisiter le sens
de circulation habituellement attribué entre touriste et indigène, la grille de l’échange
inégal et les effets retour sur les sociétés. Car si « les Dogons » ou « les Massais »
deviennent une destination touristique en soi, les WoDaaBe restent inconnus du grand
public. Ils sont ainsi très actifs dans leur « mise en tourisme ». Non seulement ils
viennent en Occident et invitent les touristes, mais ils sont auteurs de leurs espaces
dansés tout à la fois chorégraphiques et politiques. En plus de désamorcer le débat sur
l’authenticité du spectacle, considérer les danses touristiques comme scène politique
permet de désenclaver la question du tourisme de la dichotomie entre une solution
ultime de développement et une forme néocoloniale d’acculturation, pour envisager
l’interaction touristique comme un espace de confrontation, de reformulation et de
recomposition économique, sociale, politique et identitaire. Différents objectifs se
greffent à l’enjeu touristique de l’Assemblée, plus exactement s’y encastrent. Et la
danse forme le nœud du dispositif : au cœur de la dynamique de réseau, elle est au
centre des interrelations entre les acteurs et à l’articulation entre espace touristique et
politique (Glowczewski & Henry 2007).
73 En conséquence, le « tourisme culturel », qui recouvre une grande diversité des
situations à prendre en compte dans l’analyse, peut être considéré comme un pivot. Il
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
283
est tout d’abord un des phénomènes de globalisation qui prend part aux ethnoscapes
définis par A. Appadurai (2005 : 71). Il en est le produit tout autant qu’il l’alimente : les
touristes et les voyageurs ont permis le déplacement des WoDaaBe ; ils les ont
connectés avec des ressources matérielles et idéologiques internationales ; ils ont une
capacité importante de diffusion des informations et de mise en réseau avec le rôle
central d’Internet. Le tourisme culturel a été un outil de mondialisation pour les
WoDaaBe.
74 En même temps, les touristes ont à ce titre une place considérable dans les dynamiques
et les recompositions sociales, politiques et identitaires locales. Loin de se réduire à de
simples spectateurs, les « touristes », pris dans leur diversité, sont de véritables acteurs
au sein des sociétés qu’ils visitent et sont centraux dans la stratégie des WoDaaBe de
par plusieurs facteurs : l’importance économique et politique qu’ils représentent ; la
mise en place de réseaux et le fort pouvoir d’attraction qu’ils procurent aux danses ; les
orientations qu’ils proposent. Dans les coulisses de la scène touristique, se jouent des
remaniements et des dynamiques interactives qui conduisent à des réaffirmations voire
des durcissements identitaires ainsi que des luttes économiques et politiques souvent
décisives.
75 Le tourisme culturel forme à ce stade un ressort pour les acteurs africains et
occidentaux afin de localiser des processus globaux et de globaliser des enjeux locaux.
Il met en jeu des itinéraires transnationaux entrecroisés dont la complexité des
configurations est à mettre en perspective par l’anthropologue qui compose lui-même
un paramètre de l’ensemble. Tourisme et anthropologie ont des parcours liés dont les
fils n’ont pas fini d’être tissés.
BIBLIOGRAPHIE
ALLCOCK, J. B., BRUNER, E. M. & LANFANT, M.-F. (eds.)
1995 International Tourism. Identity and Change, London-Thousand Oaks (etc.), Sage publications.
AMIROU, R.
2000 Imaginaire du tourisme culturel, Paris, PUF.
AMSELLE, J.-L.
2001 Branchements. Anthropologie de l’universalité des cultures, Paris, Flammarion.
AMSELLE, J.-L. & M’BOKOLO, E.
1999 [1985] Au cœur de l’ethnie. Ethnie, tribalisme et État en Afrique, Paris, La Découverte.
APPADURAI, A.
2005 [1996] Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Payot.
BONFIGLIOLI, A.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
284
1988 Dudal. Histoire de famille et histoire du troupeau chez un groupe de WoDaaBe du Niger, Paris,
Éditions de la Maison des sciences de l’Homme.
CAUVIN VERNER, C.
2007 Au désert : une anthropologie du tourisme dans le Sud marocain, Paris, L’Harmattan.
CHABLOZ, N.
2007 « Le malentendu. Les rencontres paradoxales du “tourisme solidaire” », Actes de la recherche
en sciences sociales, 170 : 32-47.
COHEN, E.
1988 « Authenticity and Commodization in Tourism », Annals of Tourism Research, 15: 371-386.
DANIEL PAYNE, Y.
1996 « Tourism Dance Performances: Authenticity and Creativity », Annals of Tourism Research, 23
(4): 780-790.
DEGENNE, A. & FORSÉ, M.
1994 Les réseaux sociaux. Une approche structurale en sociologie, Paris, Armand Colin.
DOQUET, A.
1999 Les masques dogon. Ethnologie savante et ethnologie autochtone, Paris, Karthala.
2002 « Dans les coulisses de l’authenticité africaine », Les Temps Modernes, 620621 : 115-127.
2005 « Les festivals de masques en Pays Dogon : des remaniements contemporains de la
tradition », in R. BEDAUX & J. D. VAN DER WAALS (dir.), Regards sur les Dogon du Mali, Gand, Snoeck ;
Leyde, Rijksmuseum voor Volkenkunde.
DOZON, J.-P.
2003 Frères et sujets. La France et l’Afrique en perspective, Paris, Flammarion.
FRANCE, S.
2006 Kawritem koe moe, Rassemblons nos têtes, documentaire, 52’, produit et réalisé par Sandrine
France.
FURT, J.-M. & MICHEL, F. (dir.)
2006 Tourismes et identités, Paris-Budapest-Torino, L’Harmattan (« Tourismes et sociétés »).
GLOWCZEWSKI, B. & HENRY, R. (dir.)
2007 Le défi indigène. Entre spectacle et politique, Montreuil, Éditions Aux lieux d’être.
GRÉGOIRE, E.
2006 « Tourisme culturel, engagement politique et actions humanitaires dans la région d’Agadès
(Niger) », Autrepart, 40 : 95-111.
LASSIBILLE, M.
2004 Danses nomades. Mouvements et beauté chez les WoDaaBe du Niger, Paris, Thèse de doctorat,
Paris, EHESS.
2006 « Les danses woDaaBe entre spectacles touristiques et scènes internationales : les coulisses
d’une migration chorégraphique », Autrepart, 40 : 113-129.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
285
MERCKLÉ, P.
2004 Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte.
MICHAUD, J.
2001 « Anthropologie, tourisme et sociétés locales. Au fil des textes », Anthropologie et Sociétés, 25
(2) : 15-33.
NADEL, S. F.
1957 The Theory of Social Structure, London, Cohen & West.
PICARD, M.
1992 Bali. Tourisme culturel et culture touristique, Paris, L’Harmattan.
PICARD, M. & MICHAUD, J.
2001 « Présentation. Tourisme et sociétés locales », Anthropologie et Sociétés, 25 (2) : 5-13.
RAUCH, A. (dir.)
2002 « Touriste, autochtone : qui est l’étranger ? », Ethnologie française, 32 (3).
SHAY, A.
2002 Choreographic Politics. State Folk Dance Companies, Representation and Power, Middletown
(Connecticut), Wesleyan University Press.
THIRY, I.
2006 « Nouvelle réunion Wodaabé déjà incontournable. Peuple nomade nigérien cherche sécurité
d’existence dans contexte changeant », Bulletin du Cercle du Libre examen, 43 : 14-18.
UNESCO
2003 Le Sahara, des cultures et des peuples. Vers une stratégie pour un développement durable du tourisme
au Sahara dans une perspective de lutte contre la pauvreté, Paris, Éditions Unesco.
URBAIN, J.-D.
2001 [1991] L’idiot du voyage. Histoires de touristes, Paris, Payot & Rivages.
NOTES
1. Présente à toutes les Assemblées jusqu’en 2006, Sandrine (30 ans, journaliste) a notamment
réalisé un documentaire sur l’édition 2004 (FRANCE 2006). Elle participait au projet Lissal de
coopération féminine woDaaBe, <http://wodaabe.unblog.fr/>.
2. Issus de différents pays d’Europe et d’Amérique, ils informent et mobilisent diverses personnes
et institutions ressources qui pourront interagir avec les WoDaaBe, et diffuser à leur tour les
informations. De connexion en connexion, l’information se globalise.
3. Nadel (1957), cité par DEGENNE & FORSÉ (1994 : 72).
4. Il s’agit du projet scolaire « L’école de Jonathan », <http://www.jonathan-school.com/>.
5. De même, Bernard fit un voyage touristique au Niger en 2004 lors d’une sécheresse combinée à
une invasion de criquets. Guidé par Ortoudo, il trouva qu’il y avait « un devoir moral à essayer
d’aider ces gens ». Il a fondé l’association Azawagh qui œuvre sur les lieux de localisation de la
famille d’Ortoudo, <http://www.azawagh.be/>.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
286
6. Les groupes dominants à l’Assemblée ne sont pas les lignages aînés comme c’est généralement
le cas, mais ceux majoritaires dans le champ associatif et commercial.
7. La cotisation varie selon le statut, professionnel ou touristique, et selon le média, photographie
ou/et vidéo. Un touriste non accompagné devait globalement s’acquitter de la somme de 20 000
FCFA contre laquelle un ticket de règlement lui était remis.
8. Ils usent par exemple du même mot, tiggol, pour une danse, dont la chorégraphie, le chant et la
parure correspondent à ceux de la geerewol (danse cérémonielle des WoDaaBe), lorsqu’elle est
entreprise dans un cadre commercial mais aussi en brousse dans un contexte initiatique
(LASSIBILLE 2004 : 461).
9. Président de l’ONG Aourinde.
10. Pour illustration, la fonction de guide étant particulièrement stratégique à plusieurs niveaux,
des WoDaaBe souhaitent monter leurs agences et contrôler ce chaînon considérable pour le
succès touristique, donc politique, de l’Assemblée. Quelques ex-touristes et des associations les y
aident dans une sorte d’autoengendrement.
11. Tandis que des voyageurs ont démarché des festivals au nom de WoDaaBe, des spectateurs
sont venus au Niger pour les voir.
12. Ils sont critiqués pour leur conversion tardive et dit-on relative à l’islam, et leurs pratiques
(vols de femmes, nomadisme...). Ils sont peu intégrés aux structures économiques, politiques et
sociales (BONFIGLIOLI 1988).
13. Dans la yaake, les danseurs sont maquillés de jaune, portent une tunique brodée et des
chapeaux peuls ; dans la geerewol, ils sont maquillés de rouge, ont le torse nu, portent une plume
d’autruche et des pagnes.
RÉSUMÉS
Le tourisme culturel trouve dans les danses un ressort non négligeable. Les touristes viennent les
admirer en même temps que les autorités locales en font la promotion. Or, en 2004, les Peuls
woDaaBe décidèrent de ne plus participer à la « Cure Salée », fête intégrée au circuit touristique
par le gouvernement nigérien, alors que leurs danses en sont une attraction. Ils organisent à la
place leur « Assemblée » pour attirer les touristes à eux et officialiser ainsi leurs revendications
auprès des autorités politiques. Cet article développe une analyse micro-anthropologique de
cette assemblée en se centrant sur les interactions entre touristes, WoDaaBe et autorités. Il s'agit
de dégager les réseaux par lesquels les touristes arrivent à l'Assemblée, en pleine brousse
nigérienne, et dans lesquels les WoDaaBe s'avèrent très actifs. Le but est aussi de saisir les
imbrications entre les acteurs qui dépassent les catégories « touriste » et « autochtone », et de
considérer la danse comme pivot, entre espace touristique et politique.
Dancing represents a major asset for cultural tourism. Tourists want to admire such dances and
the local authorities promote them. In 2004, however, the Fula WoDaaBe decided not to take part
in the "Cure Salée" festival any more, although it was included in a tour by the Nigerien
government, and when their dances are a visitor attraction. They organized their "Assembly"
instead, to draw tourists up to them, thus officializing their demands to the political authorities.
This article develops a micro-anthropological analysis of this assembly and focuses on the
interactions between the tourists, the WoDaaBe and the authorities. It aims at highlighting the
networks allowing tourists to come to the assembly through the bush (WoDaaBe are very active
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
287
in such networks). It also aims at grasping the social nesting between actors, which goes beyond
the two categories "tourist" and "native", and at considering dancing as a pivot between the
touristic and political spaces.
INDEX
Keywords : Niger, Fula WoDaaBe, dances, network, political stage, cultural tourism
Mots-clés : Niger, Peuls woDaaBe, danses, réseau, scène politique, tourisme culturel
AUTEUR
MAHALIA LASSIBILLE
Centre de recherche sur l’analyse et l’interprétation des textes en musique et dans les arts du
spectacle (RTM), Université de Nice.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
288
Le festival, le bois sacré et l’Unesco.Logiques politiques du tourismeculturel à Osogbo (Nigeria)The Festival, the Sacred Grove and the Unesco. Political Logic behing Cultural
Tourism to Osogbo (Nigeria)
Saskia Cousin et Jean-Luc Martineau
1 Depuis les années 1960, le tourisme culturel est désigné par les institutions
internationales comme une manière de sauvegarder le patrimoine et d’apporter des
devises aux pays en développement (Krapf 1961 ; Le Courrier de ¡’Unesco 1966 ; Sessa
1967 ; de Kadt 1979 ; Robinson & Picard 2006). La « doctrine du tourisme culturel »
(Picard 1992 ; Cousin 2008) a suivi l’évolution des dogmes économiques, la
transformation de la notion institutionnelle de culture et l’élargissement du concept de
patrimoine, mais elle reste centrée sur l’idée que le tourisme serait un phénomène
apolitique, vecteur d’échanges culturels et de recettes économiques. Pourtant, les
bénéfices pour les populations locales sont aujourd’hui fortement discutés, notamment
par les économistes (Caire & Le Masne 2007)1. De plus, plusieurs enquêtes
ethnographiques réalisées en Asie (Picard 1992 ; Oakes 1998 ; Nyiri 2005 ; Évrard 2006),
en Afrique (Doquet 2006 ; Grégoire 2006) ou en Europe (Cousin 2006) révèlent que le
tourisme culturel est au centre d’enjeux politiques et de rapports de pouvoirs de toutes
sortes et de toutes échelles. Le cas d’Osogbo s’inscrit dans ce contexte et permet
d’éclairer le rôle du tourisme et du patrimoine mondial dans la construction d’une
identité ethno-citadine.
2 Le bois sacré d’Osogbo au Nigeria est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2005.
Le 21 février 2008, une « soirée spéciale Osun Osogbo » est organisée au Musée du quai
Branly (Paris) : le réalisateur Pierre Guicheney présente son film La dame d’Osogbo,
consacré à Suzanne Wenger, une artiste autrichienne installée au Nigeria depuis les
années 1950. Si la soirée est annoncée sur le site de l’Unesco, le film ne porte ni sur la
ville d’Osogbo, ni sur son festival annuel, ni sur l’inscription du site au patrimoine
mondial2. C’est un portrait de Suzanne Wenger et de deux de ses enfants adoptifs, dont
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
289
la prêtresse Doyin F. Deyin, qui pratique ce soir-là au Musée du quai Branly un rite de
conjonction des eaux de la Seine et de l’Osun River. Cet événement culturel et
artistique, dédié à la figure charismatique de Suzanne Wenger, va pourtant être utilisé
d’une tout autre manière par les autorités nigérianes.
3 Le 18 janvier 2008, la délégation nigériane à l’Unesco et les organisateurs du Musée du
quai Branly apprennent que le gouverneur de l’État d’Osun et l’Ataoja (titre spécifique
de loba ou roi d’Osogbo) ont décidé d’assister à la projection. Le 21 février, une
quinzaine de personnes, dont le gouverneur de l’État, sa femme et son secrétaire,
l’Ataoja et sa suite s’installent dans le théâtre Claude Levi-Strauss. Pourquoi se sont-
elles déplacées en nombre pour venir voir un documentaire sur Suzanne Wenger, alors
même que cette dernière peine à faire reconnaître son travail ? Les autorités locales
profitent de la soirée pour faire la promotion touristique d'Osogbo, non pas du bois
sacré, mais du festival annuel. L’Ataoja explique ainsi que « Osogbo doit sa quiétude et
sa modernité à l’association ancestrale du royaume et de la déesse de la rivière ». Ce
pacte serait aux origines du festival annuel, qualifié de « fête culturelle », qui « a
permis à Osogbo d’être reconnue comme l'une des plus grandes attractions touristiques
avec la participation de touristes locaux et internationaux ». Avant lui, l’ambassadeur
avait également insisté sur le nouveau rôle touristique de l’État d’Osun, « désormais un
lieu accueillant pour le tourisme », alors que la présence du gouverneur et de l’Ataoja
serait « un message à la communauté internationale, une invitation à venir savourer la
richesse patrimoniale du festival annuel ». Pas un mot sur le sujet unique du film,
Suzanne Wenger. Le gouverneur, le roi et sa suite viennent au Musée du quai Branly
pour voir un film sur eux, puisque Pierre Guicheney a filmé leur témoignage. Arrivés en
retard, ils n’ont pu être prévenus de ce « petit détail » et sont furieux de découvrir
qu'ils ont été « coupés » au montage. Les représentants de l'administration nigériane
profitent aussi de cette soirée pour « circuler », pour faire du tourisme : si, faute de
moyens, le réalisateur n’a pu faire venir l’écrivain Soyinka initialement annoncé, le
voyage et le séjour au Hilton parisien de la délégation nigériane sont payés par le
gouverneur de l’État d’Osun3.
4 Cette courte description d'une soirée et des attentes divergentes de ses acteurs permet
d'évoquer la manière dont les autorités nigérianes parviennent à s’approprier une
manifestation dont ils ne sont pas les initiateurs. Et ce, afin de servir leurs objectifs
touristiques et politiques. Cette évocation soulève également des questions sur les
enjeux et les fins de la patrimonialisation. Nous allons voir que, pour les autorités
locales, l’inscription du bois sacré au patrimoine mondial est un moyen de promouvoir
le festival d’Osogbo et d’avaliser une réécriture de l’histoire propice à la promotion
touristique. Ici comme ailleurs, cette histoire est le fruit d’un travail de sélection, voire
d’invention, d’éléments susceptibles de marquer le caractère unique et extraordinaire
des lieux. Mais derrière ce premier objectif touristique, explicite, se profilent d’autres
enjeux, plus anciens, liés à l’organisation du territoire nigérian et à l’ambition d’Osogbo
de peser dans la construction d’une identité yoruba régionale. Notre hypothèse est que
le tourisme et le patrimoine sont ici un outil au cœur des enjeux de pouvoir et de
représentation de soi4.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
290
Le bois sacré. D'un patrimoine naturel national à unsite culturel mondial (1965-2005)
5 Sur une liste proposée par le gouvernement nigérian, l’Unesco distingue en 2003 le
bosquet sacré d’Osun-Osogbo comme l’un des 17 « objets situés » de son programme
pluriannuel (1998-2003). Cela correspond à l’un des objectifs du programme AFRICA 2009
qui vise, selon la Convention du patrimoine mondial, à identifier de nouveaux sites à
mettre en valeur pour les générations futures. Le dossier de candidature du « Paysage
culturel d’Osun-Osogbo » est soumis au Centre du patrimoine mondial en janvier 2004 ;
il est inscrit sur la liste en 2005, lors de la 29e session du comité du patrimoine mondial
qui se tient à Durban. Puisque le site est classé au niveau nigérian depuis 1965, autant
pour ses caractéristiques botaniques et environnementales que pour les réalisations de
Suzanne Wenger qu’il abrite, le classement mondial pourrait être perçu comme
l’aboutissement d’une démarche locale et nationale. En fait, l’historique de la
procédure de classement, aux niveaux national puis international, fait apparaître des
logiques plus diverses et complexes, dont les acteurs nigérians sont parfois même
absents.
Le classement national : le rôle de S. Wenger et la protection d'un
site naturel (1950-1987)
6 Dès l’époque coloniale, certains universitaires s’intéressent à Osogbo, mais pas au
festival d’Osun aujourd’hui valorisé. Ce n’est pas non plus le bois sacré d’Osogbo qui fait
l’objet d’articles dans les revues Nigeria Field et Nigeria Magazine mais l’artisanat local et
le festival de Sango qui a lieu en février (MacRow 1953). De même, en 1968, une
journaliste très au fait de la vie locale choisit de décrire le festival qui se tient en mars
pour marquer la fin du Ramadan5 (Kennedy 1968) et non la célébration yoruba en
l’honneur d’Osun, devenue confidentielle dans les années 1960.
7 En revanche, dès cette décennie, le site attire l’attention de Suzanne Wenger. Arrivée
dans les années 1950 avec Ulli Beier, dont elle est la première épouse, cette artiste
autrichienne crée avec lui dans les années 1960 une école d’art et des ateliers d’artistes
au sein du Mbari-Club d’Osogbo, dans la lignée du premier club créé par W. Soyinka, C.
Achebe et d’autres écrivains (Hudson 2001)6 à Ibadan. Alors qu’elle se remet d’une grave
tuberculose,
8 Wenger rencontre le prêtre Ajagemo qui l'initie à la religion orisa. À mesure qu’elle
s’implique dans le culte, elle prend ses distances avec Beier qui quitte le Nigeria en
1967, même s’il y reviendra fréquemment. Les ouvrages de Beier, et notamment
Contemporary Art in Africa publié en 1968, contribueront à faire exister l’école d’Osogbo
dans les imaginaires occidentaux, même si l’approche et les théories de Beier sont
vivement critiquées par les historiens et certains spécialistes de l’art africain7. Pendant
ce temps, Suzanne Wenger vit à Osogbo et travaille avec des artisans qui deviennent les
interprètes de son « nouvel art sacré ». Associée à la divinité de la fertilité et de la
créativité, elle devient grande prêtresse d’Osun, s’implique dans la protection du bois
sacré alors en pleine déréliction8 et y érige progressivement les sculptures et les
sanctuaires qui justifieront plus tard le classement par l’Unesco.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
291
9 Dès son installation, Suzanne Wenger sait mobiliser des soutiens institutionnels en
faveur du bois. En 1965, le gouvernement nigérian classe un modeste périmètre du site.
La protection sera étendue à 75 ha en 1992. Entre 1979 et 1987, la National Commission
for Monuments and Museums (NCMM) rémunère Suzanne Wenger et certains artisans
pour entretenir le bois sacré. L’artiste installe une boutique dans sa maison et organise
des expositions à l’étranger. Jusqu’à son décès en janvier 2009, Suzanne Wenger était
soutenue par la fondation The Adunni Olorisa Trust, essentiellement composée
d’expatriés9. Une fondation autrichienne s’occupe également de faire connaître son
œuvre. Les sculptures de Suzanne Wenger sont devenues une attraction touristique de
la région, au centre de tous les guides et sites Internet qui mentionnent Osogbo. C’est le
cas par exemple du Lonely Planet, même si les auteurs semblent ignorer que Wenger est
l’auteure des sculptures.
Nouveaux concepts à l'Unesco : paysage culturel et patrimoine
immatériel
10 Dans le prolongement du classement national, le Nigeria dépose une première
candidature à l’inscription sur la liste des World Heritage Sites de l’Unesco en 1979.
Celle-ci échoue malgré la présence plutôt favorable au sein de la commission
d’évaluation UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) du
professeur Ade Obayemi, directeur général du NCMM (National Commission for
Monuments and Museums), et du professeur Duncan Poore, britannique et ancien
membre du département des Antiquités au Nigeria avant 1960. Aucun des onze sites
nigérians proposés et visités par les représentants de l’Unesco lors d’une tournée de
quarante-deux jours n’est sélectionné : les sites ne peuvent s’inscrire dans les critères
de classement très européocentriques. En outre, le site initial du bois sacré d’Osogbo est
jugé trop petit. Dès lors, et jusqu’en 1987, rien ne se passe au niveau international, faute
de volonté politique et parce que les critères de sélection du patrimoine mondial
restent hors de portée en Afrique.
11 Le contexte devient plus favorable au Nigeria lorsque la notion de « patrimoine
immatériel » est introduite en 1982 à la Conférence mondiale de l’Unesco (Mondiacult,
Mexico). La consécration de la notion de « patrimoine immatériel » en 1992 résulte de
la prise en considération nouvelle des folklores et des cultures vivantes, et du travail
d’influence mené par les responsables japonais de l’Unesco, avec le soutien de
nombreux pays, notamment africains, afin de légitimer une conception plus ouverte du
patrimoine (Bortolotto 2007a). Il s’agit de rompre avec la conception monumentale et
occidentale de la convention de 197210 et c’est la raison pour laquelle le Comité du
patrimoine mondial crée, également en 1992, la notion de « paysage culturel » qui
permet de désigner et classer les interactions majeures entre les hommes et le milieu
naturel. C’est à ce titre que sont distingués les paysages associatifs comme les bois
sacrés. En 1994, le comité du patrimoine mondial adopte une « stratégie globale » dont
l’objectif est de procéder à un rééquilibrage des implantations des sites du patrimoine
mondial, alors essentiellement situés en Europe.
12 Les experts de treize États africains réunis à Harare vont dans le même sens : dans le
cadre africain, la nature et la culture ne peuvent être dissociées, le patrimoine spirituel
et ses supports physiques ont une importance majeure et la notion de paysage culturel
y a des caractéristiques spécifiques. En 1998, l’ouvrage Africa Revisited (Unesco 1998)
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
292
explicite la stratégie globale en présentant des cas concrets : il s’agit de « contribuer à
améliorer la représentation du patrimoine africain sur la liste du patrimoine
mondial »n. Ainsi, la notion de patrimoine historique évolue-t-elle, même si les experts
se préoccupent toujours plutôt d’architecture. En 2001 est votée la Déclaration
universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle11 12. Ces transformations ouvrent la
voie de la relance du processus de classement du bois d’Osogbo.
Nouvelle impulsion pour le bois sacré (1987-2004)
13 Selon le professeur Babawale et le docteur Adediran Mayo, conservateur et ancien
directeur de la NCMM, l’annonce de l’ouverture des critères de classement en 1982
redonne déjà espoir aux acteurs nigérians découragés par leur premier échec13. En
1987, une nouvelle impulsion est donnée pour relancer le site afin d’entamer les
démarches de classement. Mais pour l’architecte Thierry Jouffroy14, impliqué dans
l’inscription du site au patrimoine mondial et cofondateur du programme Africa 2009,
c’est la notion de paysage culturel (1992), et non celle de patrimoine immatériel (1982)
qui donne, dans les années 1990, l’idée à Joseph Eboreime, alors directeur de la NCMM,
de travailler à l’inscription d’Osun-Osogbo15. Il ne s’agirait donc pas d’une initiative
locale. En 1987, Adediran Mayo16 est nommé directeur du Musée national d’Osogbo avec
mission de coordonner les nombreux acteurs qui doivent s’impliquer dans le processus.
Les élites de la ville se regroupent au sein de l’Osogbo Cultural Heritage Council. Ce
conseil est présidé par l’Ataoja, Oba Iyiola Oyewale Matanmi. Au côté de la Nigerian
Tourism Development Corporation et du personnel du musée — partenaires
institutionnels incontournables — quelques universitaires et botanistes liés à Adediran
14 Mayo créent également un groupe de soutien à la rénovation du bois17. Ces
universitaires et ces notables s’assurent de la collaboration de Suzanne Wenger et de
quelques artisans très impliqués dans les projets de l’artiste autrichienne18. Le groupe
réalise une brochure-inventaire consacrée aux arbres du bois, publiée en 1988 par
Adediran Mayo et les botanistes de l’Université d’Ibadan et de Lagos. La première étape
du travail de reconquête du bois sacré, lancée en 1987, consiste à remettre en état,
réglementer et faire respecter la réglementation des sites classés : délimitation stricte
du bois sacré et interdictions d’installation pour les fermiers, d’accès pour la chasse, et
de construction de routes ou de bâtiments. Cela implique de détruire des fermes déjà
installées et de s’opposer aux projets alors en cours, notamment l’extension d’une école
coranique située dans le bois19. L’école coranique devient une annexe pédagogique du
musée, les routes sont fermées à l’exception d’un axe automobile et d’un chemin pour
piétons comprenant un pont ; le bois est clôturé grâce au recyclage des clôtures d’un
chantier de BTP de la société britannique Costain. Dès cette époque, Adediran Mayo
cherche à compenser l’arrêt de l’agriculture en développant la cueillette de plantes
médicinales et d’aliments traditionnels contribuant à l’entretien du sous-bois.
15 Des interventions ont également lieu aux niveaux régional et national à partir de 1987 :
les administrateurs militaires de l’ancien Oyo State puis celui du nouvel Osun State à
partir de 1991, les gouverneurs civils (depuis 1999) financent la délimitation cadastrale
du site. Ils ne sont pas les seuls acteurs du processus aux niveaux gouvernemental et
politique. En effet, le président Olusegun Obasanjo appuie le projet pendant ses deux
mandats (1999-2003 et 2003-2007)20. En octobre 2003, l’ambassadeur et délégué
permanent du Nigeria à l’Unesco, l’historien Michael Abiola Omolewa21, est élu pour
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
293
deux ans à la tête de la Conférence générale de l’Unesco. Surtout, le Nigeria est désigné
deux fois, presque consécutives, membre du World Heritage Committee, un comité
restreint qui a la haute main sur les procédures de sélection des sites à classer
(1976-1980 puis de nouveau 2001-2005 et 2007-2011). Le Nigeria se trouve donc dans
une position privilégiée pour faire aboutir ses demandes de classement. Cela n’évite pas
un échec en 2001 quand un premier projet de nomination de la forêt sacrée est rejeté
immédiatement par le centre de tri de l’Icomos qui prépare les dossiers de classement
pour le Comité du patrimoine mondial. Selon Thierry Jouffroy, le dossier était mal
présenté22.
La stratégie du classement
16 En février 2004, la NCMM, dont le nouveau directeur depuis 2002 n’est autre que
Adediran Mayo, soumet un dossier reformulé pour le compte du gouvernement
nigérian. Le classement est initialement demandé dans la catégorie des « biens
immatériels », au nom de quatre critères culturels23, mais son orientation « biologie/
botanique/environnement »24 lui vaut d’être aussi expertisé par I’ UICN, chargée de
l’évaluation pour le patrimoine naturel, pour un critère naturel (« paysage culturel
ayant évolué biologiquement »).
17 La fiche évaluative rédigée par l’Icomos est ambiguë. Elle indique que, selon les
catégories de biens culturels définies par la convention de 1972, il s’agit d’un « site »,
mais que « il pourrait aussi s’agir d’un “paysage culturel” »25. Au regard du travail de
recensement et de publication accompli par les groupes de défense du bois, de
l’implication des institutions chargées de la gestion et de la protection de la nature, de
son classement national au titre de patrimoine naturel, il eût été logique que le bois
sacré soit reconnu comme bien mixte (à la fois culturel et naturel) par les instances de
l’Icomos, ou qu’il soit inscrit dans la catégorie des paysages culturels. De plus, l’ouvrage
de référence du Comité du patrimoine mondial prenait explicitement comme exemple
de paysage culturel le cas des bois sacrés. Mais I’UICN mandaté uniquement pour faire
une étude théorique du dossier refuse le classement26.
18 La réussite des critères culturels et l’échec des critères naturels peuvent s’expliquer de
plusieurs façons. L’assistant technique qui a monté le dossier de nomination n’est autre
que Thierry Joffroy. Architecte et conseiller scientifique du laboratoire CRATerre-
ENSAG27, il est responsable de l’axe « cultures constructives et patrimoine mondial » de
ce laboratoire entre 2002 et 2005. Il coordonne à ce titre divers programmes avec le
Centre du patrimoine mondial et la Division du patrimoine culturel de l’Unesco
(désormais réunis) : Chaire Unesco, programme Africa 200928, dans le cadre duquel il
organise à Osogbo en octobre 2004 un séminaire intitulé « Tourisme durable et
patrimoine culturel ». Lors de la soirée consacrée au film sur Suzanne Wenger en
février 2008, il intervient en tant qu’« expert auprès de l’Unesco ». Bref, Thierry Joffroy
est bien placé pour présenter un dossier conforme aux attentes de l’Icomos et du
Comité du patrimoine mondial. À l’Icomos, le dossier est bien défendu par Susan
Denyer, secrétaire de l’Icomos-UK, et par quelques autres membres. Ils parviennent à
convaincre de l’intérêt de protéger l’œuvre de Wenger jugée par leurs collègues peu
représentative de la production yoruba. Selon l’un des membres de l’Icomos, la
nécessité de rééquilibrer les inscriptions en faveur des sites africains permet
d’emporter la décision finale29.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
294
19 Une autre explication, plus politique, est possible : après le « paysage culturel du
Sukur » inscrit en 1999, le Nigeria se devait d’obtenir au moins un autre site inscrit au
patrimoine mondial30. Or, le classement comme « paysage culturel », créé pour dépasser
les critères europo-centrés de 1972, pouvait apparaître comme moins valorisant que la
notion de « bien culturel ».
20 Une dernière raison, plus locale, tient à la mise en relation du bois et du festival opérée
par les acteurs locaux. Elle sera évoquée plus loin.
21 La réussite du dossier de nomination tient donc aux réseaux qui ont permis de rédiger
et d’évaluer le dossier en un temps record : deux semaines pour la réalisation du
dossier (janvier 2004), dépôt en février pour une évaluation en septembre 2004 alors
même que le plan de management du site a été remis en retard en juin 2004 (ce qui
constitue une entorse aux procédures prescrites). Malgré la diversité des critères, un
seul expert est mandaté31. À cela s’ajoute la forte pression politique liée au rôle que joue
le Nigeria à l’époque à l’Unesco, en tant que membre de la commission restreinte du
comité du patrimoine mondial (quarante pays). Plus de vingt personnes, dont le
gouverneur de l’Osun State, son ministre du tourisme et l’Ataoja se rendent à Durban en
2005 pour la proclamation des résultats : c’est la plus forte délégation jamais vue à un
Comité du patrimoine mondial.
Les critères retenus : une construction ad hoc
22 Sur le site de l’Unesco, le bien est ainsi présenté : « La dense forêt sacrée d’Osun, à la
périphérie de la ville d’Osogbo, est l’une des dernières zones de la forêt primaire qui
subsiste au sud du Nigeria. Elle est considérée comme la demeure d'Osun, une des
divinités du panthéon yoruba. La forêt, sillonnée par la rivière Osun, abrite des
sanctuaires, des sculptures et des œuvres d’art érigées en l'honneur d'Osun et d'autres
divinités yorubas. La forêt, désormais considérée par tout le peuple yoruba comme un
symbole identitaire, est probablement la dernière forêt sacrée de la culture yoruba. Elle
témoigne de la coutume, jadis très répandue, qui consistait à établir des lieux sacrés
loin de toute habitation humaine. » Paradoxalement c’est sa dimension de site naturel
remarquable qui est rappelée dans la notice de classement. Sa dimension religieuse
n'est évoquée qu'en second lieu. Contrairement à la justification de l'inscription du
site32, il n'est pas fait mention de Suzanne Wenger et du nouvel art sacré.
23 L’étude comparée du rapport de l’Icomos et du dossier de nomination donne quelques
clés pour comprendre la manière dont les événements présentés comme historiques
par l’Icomos ont été construits : reprenant terme à terme des éléments du dossier de
nomination, l’évaluation de l’Icomos s’attache non pas à la véracité historique des
éléments présentés, mais au sens qu’ils prennent ou semblent prendre pour les acteurs
interrogés. La question de savoir si ce qui est raconté relève du mythe ou de l’histoire
n’est donc pas pertinente. Les actions des dieux ou les légendes des hommes (par
exemple l’idée qu’Osogbo serait une cité invaincue, berceau des Yoruba) sont relatées
comme des faits, au même titre que les destructions subies par le bois pendant et après
la colonisation. Le dossier de nomination justifie la sélection des divinités orisa
représentées par des statues par la volonté — ou non — des dieux d’accepter d’être ainsi
incarnés. A priori, il ne s’agit donc pas d’une analyse historique ou anthropologique de
la place du sacré dans l’organisation sociale, culturelle et politique, mais de la
transcription directe et non distanciée d’explications données sur le rôle du sacré. Le
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
295
chapitre « Authenticité et intégrité » du dossier de nomination attire particulièrement
l’attention en ce qu’il constitue une défense et une illustration des conceptions de
l’authenticité, de l’identité et de la culture telles qu’utilisées par l’Unesco (Eriksen
2001 ; Bortoletto 2007b). Issue de la recherche anthropologique qui montre le caractère
dynamique de l’identité, ses perpétuelles recompositions et négociations, cette
conception utilise les notions d’identité et de culture comme des synonymes et permet
d’envisager comme « authentique » tout discours perçu comme identitaire. Ce qui
permet de présenter les actions divines comme des faits.
24 La construction du dossier correspond à l’évolution des définitions et des attentes de
l’Unesco, évolution liée à l’invention du patrimoine immatériel notamment. Il convient
aux critères de la Stratégie globale du Centre du patrimoine mondial. L’inscription du
bois sacré est une victoire pour l’ambassadeur nigérian peu au fait des détails du
dossier, mais il répond aussi à des enjeux plus locaux. Le fil conducteur du dossier de
nomination est en effet le suivant : tous les éléments historiques, légendaires ou
mythologiques paraissent avoir pour objectif de montrer que la ville d’Osogbo et le bois
sacré se répondent en miroir. Les métaphores gémellaires ou matricielles se succèdent :
le bois est la matrice du développement de la communauté, le marché humain est le
miroir du marché des dieux, le bois est la résidence des dieux, la ville celle des hommes.
Ce qui se dégage du dossier est que la famille royale fait le lien entre le bois sacré et la
cité, lien réaffirmé chaque année à travers le festival. Or, c’est bien le festival et la
famille royale qui sont au centre du dispositif politique local, et le classement du bois
sacré va être utilisé par les autorités locales et nationales pour promouvoir le festival,
sa sécularisation et sa commercialisation touristique.
Le festival. Osogbo à l'heure touristique (1987-2008)
Séculariser : d'Osun à l'Osogbo Day
25 Le festival d’Osun-Osogbo est, au départ, une manifestation de célébration de la déesse
Osun, déesse de la fécondité et de la rivière. Le festival dure dix jours. Après les
journées de culte orisa auxquelles assistent un petit nombre de fidèles initiés ou en
passe de l’être, le festival culmine avec un pèlerinage dans le bois sacré et une
immersion dans la rivière. Les participants au défilé final sont très nombreux pour
accompagner l’Arugba, une jeune fille vierge qui porte sur sa tête la calebasse rituelle.
Pendant plus de trois heures, les associations de citoyens d’Osogbo viennent saluer et
présenter leur respect à l’Ataoja33 dans une clairière étroite où un dais abrite au besoin
les officiels des intempéries. Les participants sont essentiellement des habitants de la
ville et des environs, mais la venue de personnes originaires de la cité, qui vivent
ailleurs au Nigeria ou à l’étranger, donne sa dimension « touristique » à l’événement.
26 Le dernier jour du festival coïncide toujours avec l’Osogbo Day qui célèbre la ville. Le
défilé constitue donc à la fois un point d'orgue religieux, une allégeance aux autorités
traditionnelles et une célébration civique destinée à conforter l’identité ethno-citadine
de ses habitants. Les habitants, désormais chrétiens ou musulmans, sont invités à
communier autour de l'identité commune — incarnée par l’oba — et du lieu de mémoire
fondateur — le bois sacré. Jour férié localement, l’Osogbo Day peut être présenté
comme une preuve d’inscription de la cité dans la longue durée. Ainsi le Daily Sketch, du
23 août 1991, annonce-t-il le « 400e Osun Festival » organisé par l’Osogbo Progressive
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
296
Union dirigée par Chief Igbalaiye. Il peut aussi bien être rapporté à sa dimension
touristique contemporaine, comme le fait toujours le Daily Sketch (23 août 1991) qui
décrit le « succès international » du festival avec la venue de touristes et la « présence
de la presse internationale ».
Désacraliser
27 Les acteurs sont tous soucieux de désacraliser le festival, voire de le folkloriser, de le
« touristifier » (Picard 1992). La manière dont, en 1992, le festival est présenté dans une
brochure, illustre la nécessité — et sans doute la difficulté — de concilier musulmans et
chrétiens autour de cette dimension yoruba désacralisée du festival : « Ce n’est pas un
livre sur la religion. C’est plutôt une brochure sur le tourisme et la culture. » Sur le
thème de « Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre », la brochure
présente la religion traditionnelle comme quelque chose qui participerait de l’identité
yoruba. Elle permet ainsi de justifier (et d’inviter à) la participation des musulmans et
des chrétiens : « Nous reconnaissons la grande influence de l’islam et du christianisme
sur la communauté yoruba en particulier à propos des pratiques religieuses
traditionnelles. [...] Mais combien de chrétiens ou de musulmans en pays yoruba
peuvent honnêtement se vanter de ne pas retomber dans la vieille religion
traditionnelle de temps en temps quand une urgence apparaît ? [...]. Pour cette raison,
nous considérons que la religion traditionnelle [...] n’est pas tuée par les religions
modernes ; elle est trop profondément ancrée chez le Yoruba pour être détruite.
Cependant, nous disons catégoriquement qu’il y beaucoup de musulmans et de
chrétiens qui ont dit honnêtement adieu à la religion traditionnelle et à ses pratiques.
En dépit de cela, c’est fréquent durant les festivals de trouver un grand nombre de
chrétiens et de musulmans parmi les participants actifs ou les spectateurs. »
28 Le jour de la cérémonie, l’oba tient un rôle religieux. Toutefois, étant musulman, il lui
est difficile de présenter le festival comme un événement religieux. Il justifie donc sa
présence et l’existence du festival par le fait que « cela fait venir les touristes »34.
L’Ataoja lui-même déclarait au Sunday Concord du 25 août 1996, à propos des cérémonies
qu’il venait de présider : « Cela n’a pas de réelles implications religieuses en tant que
telles. Dans le passé, c'était la vraie religion du peuple ici mais depuis l'avènement de
l’islam et du christianisme, cela a été réduit à une sorte de rassemblement célébrant un
héritage culturel. C'est la valeur que cela a maintenant et ce que nous faisons, c'est
simplement de préserver notre culture indépendamment de la religion que vous
embrassez. » Pasteur chrétien, l'ambassadeur du Nigeria à l’Unesco tient également à se
démarquer de ce qu’il considère comme des croyances populaires, tout en relayant la
réputation de fécondité de la déesse35. Que l'organisation de l'événement ait été confiée
récemment à Otunba Gani Adams, « elder culture activist »36 (Salawu 2008), ancien
fondateur du mouvement nationaliste extrémiste yoruba, Odua People’s Congress,
reconverti dans l’événementiel, va dans ce sens. En effet, l’affirmation de la dimension
yoruba du festival est la condition sine qua non de son succès à l’époque contemporaine.
Il s’agit donc de pouvoir honorer en la déesse Osun le symbole d’une identité ethno-
citadine sécularisée dans lequel musulmans et chrétiens peuvent se retrouver37.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
297
Commercialiser
29 La sécularisation de l’événement passe enfin par la valorisation de son succès
commercial ; ainsi, dans son discours du 26 août 1988, en clôture du festival commencé
le 15 août, l’Ataoja Matanmi III oscille entre référence obligée à la religion du passé et
affirmation d’un présent désacralisé où le fait culturel serait découplé de son essence
spirituelle. L’oba évoque ainsi dans un premier temps « un festival en souvenir de nos
pères fondateurs [sic] afin de préserver et de promouvoir notre héritage culturel
révéré », avant d’expliquer que « la valeur culturelle devient maintenant de plus en
plus significative ». Pour preuve, selon lui, le caractère œcuménique de l'événement et
la description du vaste public qui a assisté aux différentes journées. Les remerciements
aux organisateurs locaux participent également de la fabrication de l’événement festif :
« l’Osun-Osogbo Festival Committee, les compagnies privées, les clubs sociaux et
philanthropiques, les personnalités et les médias pour leur soutien moral et financier
qui ont fait de ce festival un grand succès. » Suivent les « fils et filles d’Osogbo »
résidant dans la fédération, des « milliers d’autres gens de l’intérieur du Nigeria [...]
une grande foule qui vient en touriste ou pour prier [...] », des « centaines d’étrangers
d’outre-mer »38.
30 L’Ataoja célèbre enfin explicitement la vocation commerciale de la journée qui lui
apparaît comme une forme de promotion culturelle, puisqu’il salue « et plus
significativement encore, les vendeurs et les marchands de biens et de marchandises à
Osogbo [qui] ont eu une journée bien remplie et réussie. C'est la vraie valeur de notre
héritage culturel pour laquelle nous avons prié. C’est sous ce jour que je vois de
nouveau le festival de 1988 [...] j'espère que les célébrations vont continuer d'attirer un
grand nombre de touristes à Osogbo car de tels touristes continueront d’avoir un effet
bénéfique sur l’économie de la ville »39. Financées par la publicité payée par les
entreprises locales et le Local Government, les brochures publiées à l’occasion du
festival40 sont également un vecteur de la vulgate touristico-culturelle. En 1992, outre le
discours de l’Ataoja, trois articles de l’Osogbo Cultural Heritage Council sont consacrés
respectivement au projet de centre touristique international, à une description du
festival, des centres d’intérêt en ville, du public « international », et, enfin, à une
version courte de Sacred People & Sacred Places, une brochure publiée par un érudit local
(Kayode 2006). En 1996, sept « articles » constituent la brochure : le discours de l’Ataoja,
sa biographie pour les vingt ans de règne, un article sur le théâtre yoruba, trois articles
sur les cultes d’Osogbo et deux sur l’impact du tourisme.
Internationaliser ?
31 Ces publications relaient les combats de l’Ataoja. En 1992, ce dernier appelle le
gouvernement d'Osun à financer la réhabilitation du pont suspendu dans le bois sacré,
et le Nigerian Tourist Board à « développer les soixante-treize acres de terre qui lui ont
été allouées à côté du bois pour construire un centre touristique international » ; en
1996, il fait éloge du « potentiel touristique d’Osogbo » pour la clôture du « Osun-
Osogbo INTERNATIONAL Festival ». La référence à une dimension internationale est
nouvelle. Enfin, depuis 2004, le gouvernement de l’État d’Osun finance la
retransmission en direct du dernier jour du festival dans tout le Nigeria sur la
principale chaîne de la NTA (Nigerian television authority). Pendant trois heures, on
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
298
peut voir alternativement les personnalités qui prennent la parole et le défilé des
groupes de pèlerins habillés de costumes colorés communs. Les — rares — pèlerins
venus des Amériques se signalent à l'oba par leur anglais, et parce qu'ils sont parfois
« blancs ».
32 L’État d’Osun (où est située la ville d’Osogbo) consacre une page de son site Internet au
tourisme, en mentionnant les sites existants et quelques hôtels, sans plus
d’informations. Mais l’on apprend que le gouvernement local envisage la construction
d'un hôtel cinq étoiles et d'un golf à Osogbo « afin d’anticiper la croissance du secteur
du tourisme et de la culture ». S’il est peu probable que les touristes internationaux
viennent à Osogbo pour jouer au golf, ni même pour loger dans un hôtel cinq étoiles,
ces projets révèlent en revanche la volonté de développer un tourisme national ou
régional à destination des plus riches. Plus fonctionnel, ce qui apparaît comme le site
Internet de la ville d'Osogbo propose quelques informations pratiques et historiques,
quoique presque exclusivement centrées sur la personne de l’Ataoja. Mais ce site est en
réalité une création de l’antenne américaine de l’Osogbo Progressive Union (OPU)41 et le
contact indiqué est situé à Washington. Appelant à rejoindre I’OPUUSA, les créateurs du
site s’adressent explicitement aux Nigérians exilés, mais aussi aux Africains-Américains
en quête de racines41 42. Le site Internet qui apparaît comme le plus « local », le plus
précis dans ses informations et le plus fonctionnel est en réalité transnational, comme
le sont, sans doute, également les internautes à qui il s’adresse.
La ville. L'invention d'une capitale yoruba, XVIe-XXIe
siècles
Osogbo is not « an ancient town »
33 À l’appui de leur projet touristique, les gouverneurs de l’Osun State et l’Ataoja ont lancé
depuis plusieurs années une campagne de promotion d’Osogbo sur le thème « Osogbo,
ancient town ». Or, si l’on retient le sens classique de l’expression au Nigeria — les villes
historiques enracinées dans le Moyen-Âge local43 —, la ville d’Osogbo ne relève pas de
cette catégorie. Elle fait, au contraire, partie des villes moyennes yoruba qui ont connu
une expansion démographique et économique ainsi qu'une émergence politique au XXe
siècle. Petites cités soumises à des empires englobants jusqu’au XIXe, elles n’ont jamais
été à la tête d’un empire et ce ne sont pas des cités-royaumes comme il en existe
ailleurs dans l'espace yoruba. Elles sont devenues de petits centres administratifs
locaux à l'époque coloniale, et c'est au cours des trente dernières années qu'elles ont
accédé au rang de capitales d’États fédérés ou qu’elles ambitionnent de le devenir44.
34 La ville d’Osogbo a été fondée au XVIIe siècle par un groupe de migrants venus d’Ilesa,
une cité-royaume voisine indépendante. La rivière Osun et la déesse Osun auraient joué
un rôle important dans la détermination du lieu d’installation ; la fondation serait
l’œuvre de deux personnages, Laroye et Timehin, chasseurs, sans doute parents
(frères ? cousins ?), qui auraient pris l’engagement d’honorer chaque année Osun lors
d’un festival. Dans le seul ouvrage universitaire consacré à Osogbo, les professeurs
Bolanle Awe et Olawale Isaac Albert (1995) considèrent que l’unanimité de la
communauté concernée sur ces quelques faits est de nature à réconcilier les traditions
orales divergentes sur le rôle des uns et des autres. Au moment de l’écriture de leur
ouvrage, la controverse à laquelle il semble répondre était strictement limitée aux
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
299
acteurs et aux enjeux locaux. Plus de dix ans plus tard, la concurrence des mythes
fondateurs à l’échelle locale est dépassée. Il s’agit désormais pour la cité de se
positionner à l’échelle régionale voire fédérale, d’acquérir une stature historique et de
s’ancrer dans un passé le plus ancien possible pour légitimer le pouvoir récent de ses
notables. Or, rien dans l’histoire de sa fondation ne fait d’Osogbo une cité phare de
l’espace yoruba : elle a toujours été soumise à l’autorité de voisines plus puissantes ;
celle d’Ilesa du XVIIe au XIXe siècle, puis celle d’Ibadan au XIXe qui assure la relève de
l’empire d’Oyo ruiné45. Jusqu’à lui faire oublier ses liens avec Ilesa qui ne l’a pas
défendue contre l’invasion des Peuls d’Ilorin. La ville passe enfin sous la coupe
britannique en 1903 et la juridiction administrative de l’Alaafin d’Oyo. C’est seulement à
partir des années 1930, sous ce même joug britannique, que sont posés les jalons de sa
future ascension politique et que, dans le même temps, se mettent en place les
éléments qui constitueront les fondements de son identité ethno-citadine.
35 À partir de 1934-1936, en effet, dans le cadre d’une grande réforme de l’administration
locale, le baale46, est promu Native Authority avec un conseil restreint de chefs bientôt
rejoints par quelques membres « éduqués »47. Cependant, la ville n est pas l’objet d une
très grande attention de la part des Britanniques et cet effacement relatif perdure
jusqu’à la fin des années 1970. Pendant ce temps, Osogbo digère son développement
économique et démographique48 sans faire preuve d’ambitions politiques. Ibadan est
devenue la capitale du vaste État fédéré d’Oyo et, comme nombre de villes secondaires
de l’est de l’Oyo State, elle vit à l’ombre de l’historique cité-royaume d’Ife fondée au IXe
siècle.
Le patrimoine mondial, un outil touristique au service du politique
36 L’instrumentalisation du festival et du classement du bois sacré, la réinterprétation
contemporaine des événements qui s’y déroulent depuis plus de cinquante ans
n’auraient pas grand sens rapportés à la seule mise en tourisme du patrimoine. Bien
avant de les mobiliser pour l’aventure Unesco, les notables d’Osogbo ont en effet enrôlé
les racines culturelles supposées anciennes dans l’opération de lobbying, en faveur de la
création d’un nouvel État fédéré, acquise en 1991.
37 Ce combat commence en 1977 et la mobilisation s’est poursuivie ensuite au-delà du
succès de 1991. La période 1977-1991 est celle de l’invention d’un militantisme ethno-
citadin chez les Osogbo. C’est alors que se constitue et que s’impose un « corpus »
d’affirmations diverses, reprises partout, qui participent de la construction de l’identité
de la cité. Cette dernière est abondamment réinvestie ensuite dans le dossier Unesco.
Ce corpus de slogans incantatoires se constitue autour du thème de la création de l’État
ou du choix de la capitale du futur État. À défaut d’arguments, les déclarations
publiques sont émaillées de « no need to say » ou « it is obvious » qui doivent suffire à
convaincre.
38 Le principal acteur de cette propagande identitaire est l’Ataoja49 lui-même. Fort de la
notoriété et de l’expérience qu’il a acquises lors de son engagement pour la création de
l’Osun State, il se consacre ensuite au lobbying en faveur du classement Unesco avec des
méthodes voisines. Il s’agit pour lui de donner à la nouvelle capitale de l’État d’Osun un
ancrage historique qui lui fait défaut face à Ile-Ife à l’histoire bien établie50. Son
omniprésence dans la presse écrite51 est l’un des aspects de cette quête de visibilité et
de racines52, mais les notables de la ville participent tous à la campagne53.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
300
39 Dernier ajout en date à l’histoire de la ville : la mention du classement à Durban devient
un élément du récit historique légitimant la cité dans son rôle de leader dans l’État
d’Osun et au Nigeria. Il apparaît ainsi clairement que le discours sur la valorisation
touristique de la cité est bien antérieur à son classement, et qu’il s’inscrit dans le projet
plus large de promotion de la cité dans le champ géopolitique et économique régional.
L’inscription au patrimoine mondial marque donc l’aboutissement de près de quinze
ans de démarches de l’État d’Osun pour se construire une légitimité historique et
culturelle.
40 Produit du combat pour la création de l’Osun State (années 1980) puis de celui pour le
label Unesco (1990-2005), ce « corpus » incantatoire imprègne la littérature
« officielle » que relaient la presse, des brochures et des tribunes libres de The Nigerian
Tribune ou d’autres journaux (The Concord, The Guardian, The Nation), les entretiens
formels ou informels. C’est cette vulgate qui est en partie reprise, en connaissance de
cause, dans le dossier de nomination. L’image est soignée autant que le texte, et ce,
depuis l’époque du lobbying pour la création du nouvel État. Les photos de l Ataoja
(devenu oba) dans The Nigerian Tribune ou Iwe Iroyin, propriétés de l’Oyo State, sont des
éléments-clés du processus d'identification des habitants à leur cité et du fossé
croissant qui se creuse entre Osogbo et Oyo. La photo de l’Ataoja se diffuse dans les
foyers de la ville et supplante celle de l’Alaafin. Les acteurs locaux se mettent en scène
dans les réunions de l’Unesco ou au Musée du quai Branly aussi bien que dans les
rassemblements régionaux d’oba, les festivals et les manifestations officiels.
41 Le schéma de ce « plan média » n'est pas spécifique à Osogbo mais c’est là qu’il a été le
plus efficacement mis en œuvre, jusqu’à surprendre les personnalités officielles de
l’Unesco ou responsables culturels français. L'ascension géopolitique des villes
moyennes dans le cadre régional yoruba repose en effet sur un certain nombre de
caractéristiques partagées dont Osogbo est un exemple emblématique : rôle moteur de
l'oba ou roi de la ville dans le lobbying, mobilisation des notables dans des associations
ou Progressive Unions, instrumentalisation de l'histoire locale et des archives
coloniales pour promouvoir leur ville auprès des commissions d’enquête successives et
des militaires au pouvoir pendant l’essentiel de la période postérieure à 1966,
promotion régulière de l'oba de la ville dans la hiérarchie des souverains à l’échelle
régionale par les autorités coloniales puis nigérianes, ce qui ramène au poids croissant
de son lobbying. L'autopromotion de ces cités s'inscrivait d’abord dans la perspective de
la création d’un nouvel État et, ensuite seulement, dans la perspective d’emporter la
capitale54 ; or, à ce stade du lobbying, il fallait avoir quelque chose en plus à défendre
que les cités rivales qui aspiraient aussi à devenir capitale du nouvel État. Ce processus
de différentiation devait conduire à la mise en valeur d’une singularité, sans pour
autant faire craindre aux militaires l’ouverture d’une boîte de Pandore dans le nouvel
État en déclenchant des conflits ouverts entre villes.
42 La mobilisation d’Osogbo sur le dossier culturel, l’un des (derniers) volets de la
recherche de cette singularité, présente une originalité en ce sens que la ville pousse ce
processus de singularisation au-delà des objectifs initiaux : elle exploite, dans le cadre
du dossier Unesco, le capital symbolique qu’elle avait mobilisé pour devenir capitale.
C’est au cours de cette seconde phase d’autopromotion qu’a été élaboré un ensemble
d’« outils » qui ont constitué ensuite les arguments mis en avant par l’Ataoja d’Osogbo
pour apparaître comme un pôle fédérateur au cœur de l’espace culturel yoruba.
L'obtention du classement au « patrimoine mondial » par l'Unesco est à la fois un signe
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
301
d'affirmation et un outil de promotion ultérieure dans le face-à-face avec Ife qui ne fait
que commencer.
*
43 « C’est la revendication culturelle qui fonde le patrimoine, non l’inverse. [...] Pour
fonctionner en tant que tel, un élément culturel doit en effet être placé dans un
premier temps dans le passé, ce qui permet ensuite d’en faire l’objet d’une
réappropriation » (Amselle 2005 : 24).
44 Depuis la création de l’État fédéré d’Osun au Nigeria en 1990, sa nouvelle capitale
Osogbo n’a eu de cesse de créer l’ancrage historique qui lui manquait. Un certain
nombre d’institutions et d’acteurs extérieurs à Osogbo participent, pour des motifs
différents, à la constitution de cet ancrage, d’un point de vue mythologique, identitaire
et religieux. Ces acteurs interviennent à des moments différents, des années 1950 à nos
jours. Il s’agit essentiellement de Suzanne Wenger, Ulli et Georgina Beier, les peintres
de l’École d’Osogbo, les communautés américaines et caraïbéennes adeptes du
panthéon yoruba, le roi (oba) de la cité, le gouverneur de l’État, l’ambassadeur du
Nigeria à l'Unesco, l'ancien chef de l'État nigérian, O. Obasanjo, et différents
responsables culturels locaux et nationaux.
45 À travers l’inscription du site au patrimoine mondial, l’Unesco apparaît dans ce
contexte comme une instance de légitimation déterminante, une institution
instituante. Le classement permet en effet à Osogbo de jouer à la fois de la polyvalence
des idées de patrimoine culturel et intangible, de son capital écologique, de sa valeur
patrimoniale et de son potentiel touristique. Il permet d’avaliser un corpus de données
historiques, culturelles et mythologiques constitué dans l’objectif politique de
permettre à Osobgo de passer du rang de ville secondaire au rang de capitale d’État.
Cette appropriation n’était pas évidente car elle est triplement paradoxale : du point de
vue de la conservation des espaces naturels, de la préservation de la dimension
spirituelle et des motivations des touristes.
Une appropriation paradoxale
46 De la part des autorités locales, le festival d’Osun est l’objet d’une sécularisation, d’une
commercialisation et d’une médiatisation fortes. Tout est fait pour relativiser le
caractère sacré de la cérémonie et accentuer son rôle de marqueur de l’identité yoruba
de la ville. Dans ce contexte, le classement au patrimoine mondial du bois sacré n’est
qu’un élément qui vient renforcer le caractère culturel (et non religieux) du festival en
le présentant comme l’objet du classement au patrimoine mondial. En effet, si le
discours sur la valorisation touristique de la cité est bien antérieur à l’inscription au
patrimoine mondial et si les acteurs politiques locaux n’en sont pas les initiateurs, ils
vont savoir utiliser ce classement pour promouvoir le festival et le rayonnement de la
cité d’Osogbo. Ainsi, aussi bien les autorités locales que l’ambassadeur du Nigeria à
l’Unesco croient ou laissent entendre que c’est le festival qui a été classé, et non le bois.
47 Le festival d’Osun-Osogbo a lieu au début du mois d’août, à la saison des pluies, ce qui
pose des problèmes de circulation dans le sous-bois et de conservation des enclos en
terre sur site. Ces risques n’ont pas échappé au Comité du patrimoine mondial, puisque,
lors de l’inscription à Durban en 2005, celui-ci fait trois demandes à l’État nigérian :
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
302
intégrer « la gestion des caractères naturels » dans la « gestion des caractères
culturels » ; donner des informations sur la fermeture d’une route goudronnée ; et,
surtout, créer « un plan de gestion du tourisme culturel afin de préserver les
caractéristiques spirituelles, symboliques et rituelles de la forêt par rapport au grand
nombre de personnes qui visitent le site, notamment durant la période du festival ». Le
paradoxe est que le classement du bois est utilisé pour vanter le caractère touristique
du festival et attirer des visiteurs, alors même que, pour le Comité du patrimoine
mondial, il constitue explicitement une menace potentielle.
48 Si les autorités locales considèrent le classement comme une preuve de reconnaissance,
elles ne peuvent souscrire, du moins officiellement, à la logique relativiste mise en
œuvre dans le dossier de nomination, notamment en ce qui concerne le rôle des
divinités traditionnelles. Il y a une sorte d’inversion des rationalités et des finalités
relationnelles : le dossier de nomination et l’évaluation de l’Icomos mettent en avant le
caractère sacré des échanges qui peuvent avoir lieu dans le bois et dénoncent « les
menaces fondamentalistes » qui pèseraient sur sa survie55, tandis que les acteurs locaux
promeuvent la dimension culturelle et identitaire du festival qui a lieu dans le bois en
relativisant en permanence son caractère religieux.
49 Le même paradoxe est à l’œuvre lorsque l’on se penche sur les motivations des
quelques touristes qui viennent à Osogbo visiter le bois ou, pendant le festival, s’initier
au culte orisa. Le tourisme religieux yoruba est une déclinaison du tourisme culturel
qui se développe aujourd’hui au Nigeria autour de communautés de pratiques liées à la
danse ou à la musique, et surtout, aux cultes orisa et ifa. Initié aux États-Unis (Capone
2005), ce tourisme est fondé sur une « conversion » à l’africanité. Les Africains-
Américains viennent, en groupe, chercher leurs racines et s’initier au culte orisa auprès
de prêtres nigérians, tandis que les Européens viennent en famille ou entre amis pour
voir les œuvres de Suzanne Wenger. Ces circuits sont hermétiques les uns aux autres :
les Africains-Américains et les adeptes d’Ifa ne font allusion à Suzanne Wenger et à ses
statues que marginalement, tandis que les récits d’expatriés et les journaux des
voyageurs postés sur Internet ignorent la plupart du temps le volet religieux proposé
par les prêtres d’Osogbo, voire la signification réelle du festival désormais sécularisé.
Tous sont considérés comme des touristes par les autorités locales. Et ils le sont du
point de vue de leurs consommations. C’est ainsi que l’Ataoja d’Osogbo peut saluer le
record de consommation de bière nigériane Star en 2005, le considérant comme un
signe du succès touristique du festival.
50 Mais, alors que les autorités locales font tout pour séculariser le festival, les Américains
en quête de racines le vivent comme une quête initiatique susceptible de les aider à
retrouver l’esprit sacré de la religion des origines. À l’inverse, c’est la dimension sacrée
du bois qui justifie son classement, alors que pour les voyageurs et les expatriés qui le
parcourent, il s’agit plutôt d’une visite culturelle motivée notamment par la fascination
que Wenger semble exercer sur les Occidentaux qui parcourent l'Afrique : celle qui est
passée « de l'autre côté du miroir ». Observés dans différents contextes touristiques, ces
paradoxes sont liés aux représentations que les uns ont sur les autres, mais aussi aux
malentendus liés à la construction réciproque des attentes et des désirs de l’autre
(Chabloz 2007).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
303
Osun, déesse transnationale
51 Le caractère transnational de l’opération, de ses acteurs et des circulations font
d’Osogbo un objet de « global politique » (Abélès 2007). Expatriés en week-end dans le
bois, Africains-Américains en stage d’initiation pendant le festival, experts des
institutions internationales en visite ou notables nigérians « circulant » à Durban ou à
Paris, tous produisent et échangent des expériences, des images et des discours qui leur
confèrent prestige et reconnaissance. L’utilisation de l’Unesco n’est pas terminée : le
voyage de la délégation du Nigeria en France en février 2008 n’avait pas pour
motivation unique la projection d’un film au Musée du quai Branly. En effet, la veille, le
gouverneur avait assisté à une réunion à l’Unesco sur un projet de centre culturel-
bibliothèque à Osogbo (Institute for Black Culture and International Understanding)
dont l’initiateur est l’ancien président Obasanjo. Il s’agissait d’obtenir de la part de
l’Unesco la reconnaissance de cette bibliothèque comme « Institut de catégorie 3 ».
C’est cet événement qui était essentiellement relaté dans la presse nigériane56, alors
que le documentaire présenté au Musée du quai Branly était décrit comme un film
consacré au festival touristique. Le global politique ne fait que commencer et l'on peut
s'interroger sur les rapports individuels ou collectifs que les institutions
internationales génèrent ou confortent vis-à-vis de constructions identitaires et
politiques. Quoiqu’il en soit, malgré des enjeux différents et des motivations
divergentes, tous ces événements participent à renforcer la légitimité d'Osun-Osogbo.
C'est sans doute la force d'Osun, déesse transnationale des rivières — des flux — et de la
fécondité.
BIBLIOGRAPHIE
ABÉLÈS, M.
2007 Anthropologie de la globalisation, Paris, Payot.
AMSELLE, J.-L.
2001 Branchements. Anthropologie de l’universalité des cultures, Paris, Flammarion.
2005 L’art de la friche. Essai sur l’art africain contemporain, Paris, Flammarion.
ANDA, M. O.
1998 « Hometown Associations: Indigenous Knowledge and Development in Nigeria », Africa
Today, 47 (2): 193-196.
ANDERSON, B.
1996 [1983] L’imaginaire national, Réflexion sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La
Découverte.
APPADURAI, A.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
304
2001 [1996] Après le colonialisme, les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Payot.
AWE, B. & ALBERTS, O. I.
1995 « Historical Development of Oshogbo », in C. O. ADEPEGBA (ed.), Model of Growing African Town,
Institute of African Studies Ibadan, University of Ibadan.
BALANS, J.
1995 Le Zimbabwe contemporain, Paris, karthala,
BORTOLOTTO, C.
2007a « From the “Monumental” to the “Living” Heritage: a Shift in Perspective », in J. CARMAN &
R. WHITE (eds.), World Heritage: Global Challenges, Local Solutions. Proceedings of the Conference at
Ironbridge, 4th-7th May 2006, British Archaeological Reports International Series, Oxford, Archeopress:
39-45.
2007b « From Objects to Processes: Unesco “Intangible Cultural Heritage” », Journal of Museum
Ethnography, 19: 21-33.
CAIRE, G. & LE MASNE, P.
2007 « La mesure des effets économiques du tourisme international », in C. BATAILLOU & B. SHEOU
(dir.), Tourisme et développement, Regards croisés, Perpignan, PUP : 31-57.
CAPONE, S.
2005 Les Yoruba du nouveau Monde. Religion, ethnicité et nationalisme noir aux États-Unis, Paris,
Karthala.
CHABLOZ, N.
2007 « Le malentendu. Les rencontres paradoxales du “tourisme solidaire”, Actes de la recherche en
sciences sociales, 170 : 32-47.
COUSIN, S.
2006 « De l’Unesco aux villages de Touraine : les enjeux politiques, institutionnels et identitaires
du tourisme culturel », Autrepart, 40 : 17-32.
2008 « L’Unesco et la doctrine du tourisme culturel », Civilisations, 57 (1-2) : 41-56.
DOQUET, A.
2006 « Décentralisation et reformulation des traditions en Pays dogon : les manifestations
culturelles des communes de Dourou et Sangha », in C. FAY, F. KONE & C. QUIMINAL (dir.),
Décentralisation et pouvoirs en Afrique, Paris, IRD Éditions : 303-320.
ERIKSEN, T. H.
2001 « Between Universalism and Relativism: a Critique of the UNESCO Concept of Culture », in J.
K. COWAN, M.-B. DMEBOUR & R. A. WILSON, Culture and Rights. Anthropological Perspectives, Cambridge,
Cambrigde University Press : 127-148.
ÉVRARD, O.
2006 « L’exotique et le domestique. Tourisme national dans les pays du Sud : réflexions depuis la
Thaïlande », Autrepart, 40, numéro spécial, Tourisme culturel, réseaux et recompositions sociales :
151-167.
GRÉGOIRE, E.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
305
2006 « Tourisme culturel, engagement politique et actions humanitaires dans la région d’Agadès
(Niger) », Autrepart, 40: 95-111.
HONEY, R. & OKAFOR, S. (eds.)
1998 Hometown Associations Indigenous Knowledge and Development in Nigeria, Londres, Intermediate
Technology Publications.
HUDSON, M.
2001 « When the World Looked to Nigeria », <http://www.telegraph.co.uk/arts/ main.jhtml?
xml=/arts/2001/01/20/bahuds20.xml&page=4>.
DE KADT, E. (dir.)
1979 Le tourisme, passeport pour le développement. Regards sur les effets culturels et sociaux dans les pays
en développement, Paris, Economica-Banque Mondiale-Unesco.
KAYODE, A.
2006 Osun Osogbo: Sacred Places and Sacred People, Osogbo, Book Surge Publishing.
KENNEDY, J.
1968 « I Saw and I Was Happy: Festival at Oshogbo », African Arts, 1 (2): 8-16.
KRAPF, K.
1961 « Les pays en voie de développement face au tourisme. Introduction méthodologique »,
Revue de tourisme, 16 (3) : 82-89.
LE COURRIER DE L’UNESCO
1966 December 1966 (XIXe year).
MACROW, D.W.
1953 « Osogbo Celebrates Festival of Shango », Nigeria magazine, 40: 298-313.
MARTINEAU, J.-L.
2006 « Yorùbá Nationalism and the Reshaping of Obaship », in T. FALOLA & A. GENOVA (eds.),
Yorùbá Identity and Power Politics, Rochester, University of Rochester Press: 205-228.
MULLER, B.
2004 « L’année prochaine à Ile-Ife. La ville idéale dans la construction de l’identité yoruba »,
Journal des Africanistes, 74 (1/1) : 159-179.
NAIFEH, S. W.
1981 « The Myth of Oosogbo », African Arts, 14 (2): 25-88.
NYIRI, P.
2005 Scenic Spots: Chinese Tourism, the State, and Cultural Authority, London, University of
Washington Press.
OAKES, T.
1998 Tourism and Modernity in China, London, Routledge.
OMOLEWA, M.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
306
1978 « The Teaching of French and German in Nigerian Schools 1859-1959 », Cahiers d’Études
africaines, XVIII (3), 71: 379-396.
PEEL, J. D. Y.
2000 Religious Encounter and the Making of the Yoruba, Bloomington & Indianapolis, Indiana
University Press.
PERROT, C.-H. & FAUVELLE-AYMAR, F.-X.
2003 Le retour des rois. Les autorités traditionnelles et l’État en Afrique contemporaine, Paris, Karthala.
PICARD, M.
1992 Bali. Tourisme culturel et culture touristique, Paris, L’Harmattan.
ROBINSON, M. & PICARD, D.
2006 Tourisme, culture et développement durable, Paris, Unesco.
ROY, C.
2005 Traditional Festival, a Multicultural Encyclopedia, Santa Barbara (CA), ABC-Clio.
SALAWU, F.
2008 « Okota Fiesta: Celebrating the Goddess of Love and Unity », The Daily Sun, 6 août 2008.
SESSA, A.
1967 Le tourisme culturel et la mise en valeur du patrimoine culturel aux fins du tourisme et de la
croissance économique, New-York, Nations-Unies CNUCED.
SOYINKA, W.
2007 You Must Set Forth ar Dawn, New York, Random House Trade Paperback Edition.
UNESCO
1972 Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, Paris, Unesco.
1998 Africa Revisited. Nouveaux regards sur l’Afrique, Unesco, World Heritage Centre.
2003 « Déclaration universelle sur la diversité culturelle : une vision, une plateforme
conceptuelle, une boîte à idée, un nouveau paradigme », série Diversité culturelle, 1, Paris, Unesco
Éditions.
NOTES
1. Selon plusieurs rapports de la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement), près de 85 % des dépenses touristiques dans les PMA (pays les moins avancés)
d’Afrique reviendraient en réalité à des entreprises occidentales. Les économistes parlent de
« fuites » pour désigner ce phénomène. Ces données sont difficilement vérifiables.
2. À l’exception d’un banc-titre en préambule et de l’explication que donne Doyin F. Deyin du rôle
joué par sa mère dans l’inscription au patrimoine mondial.
3. Pierre Guicheney a réalisé un deuxième film, coproduit par RFO et consacré notamment aux
artistes nigérians du « nouvel art sacré » initié par Wenger. Il est projeté le mardi 14 février 2009
à Paris, alors que Suzanne Wenger vient de mourir. Les membres de l'Icomos (Conseil
international des monuments et des sites) et de l’Unesco y sont nombreux, mais aucun notable
nigérian ne s’est déplacé.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
307
4. Cet article est le résultat d’une collaboration entre un historien spécialiste du sud-ouest du
Nigeria et une anthropologue des politiques touristiques, plutôt « européaniste ». Cette
collaboration s’est mise en place à l’initiative de Nadège Chabloz. Qu’elle en soit ici vivement
remerciée. Notre travail s’appuie sur des observations et des entretiens menés en France et au
Nigeria auprès des différents acteurs du dossier de classement d’Osogbo, l’analyse d’un corpus de
sources historiques, de rapports, chartes et documents, sur le tourisme culturel, produits par
l’Unesco, l’Icomos et l’OMT, et enfin l’étude des sites et des blogs que des touristes ont consacrés à
leur voyage à Osogbo. Pour des questions de place, ce dernier volet n’est pas développé dans
l’article. Les difficultés que nous avons rencontrées ne sont pas liées à nos méthodes
d’investigation : il y a longtemps qu’anthropologues, sociologues et historiens pratiquent
l’entretien et la confrontation de sources écrites ou orales. Nous avons aussi rapidement partagé
les mêmes constats et les mêmes hypothèses analytiques sur l’importance des enjeux politiques
locaux et le caractère relativement secondaire du développement économique par le tourisme. Le
vrai problème a plutôt résidé dans la construction et la rédaction de l’article, l’importance et la
place relatives des descriptions, de la chronologie, de la théorisation, des références extérieures
au terrain ou au corpus. Ainsi, l’historien annonce son hypothèse puis l’étaye selon un plan
chronologique argumenté. L’ethnologue propose une lecture plus inductive : partant d’une
problématique et d’une description faisant figure d’énigme et/ou de métaphore, son plan est
analytique : la chronologie s’efface derrière une théorisation qui procède par transfert et par
comparaison. En relation avec le projet éditorial de la revue, nous avons opté pour un plan
problématique au sein duquel la chronologie reprend ses droits.
5. Depuis le XVIIIe siècle, la diffusion de l’islam puis du christianisme dans le sud-ouest du Nigeria
a modifié les pratiques religieuses historiques yoruba. En se convertissant à l’une des deux
religions mondiales, les oba (rois) ont renoncé à leur rôle de prêtre. Cependant, ils ont confié à
des prêtres la réalisation de rituels souvent associés à la pérennité de la famille royale ou du
royaume lui-même. Des oba trop « modernes » comme l’Ooni d’Ife se sont vu reprocher par les
habitants de leur cité leur manque d’empressement à l’égard des cultes yoruba. De fait, le poids
des fêtes yoruba a décliné tout au long du XXe siècle en regard de l’importance croissante dans le
calendrier de chaque cité des fêtes chrétiennes ou musulmanes. La redécouverte récente pour
des raisons identitaires de ces cérémonies folklorisées ne doit pas faire illusion. En termes
religieux, elles n’ont plus de sens que pour une infime partie de la population très âgée.
6. Des clubs mbari seront également créés à Enugu, puis Lagos, Ife et Benin City. À l’occasion de
l’exposition « City Century » de la Tate Moderne, dont une partie est consacrée à Lagos, le
journaliste Mark Hudson, du Telegraphe, retrace l’itinéraire des Européens installés au Nigeria au
début des années 1960. Selon Mark Hudson, qui cite Beier lui-même, le Mbari-Club était financé
— à leur insu selon SOYINKA (2007) —, par la Fairfield Foundation, une organisation de la CIA qui
cherchait ainsi à contrer l’influence marxiste en Afrique de l’Ouest.
7. Avec sa nouvelle épouse, Georgina, Ulli Beier cherche à construire une école afro-européenne
novatrice. Dans un article intitulé « The Myth of Osogbo », Steven W. NAIFEH (1981) fait une
analyse féroce des contradictions de cette école. Selon lui, Beier présentait les œuvres des
artistes locaux comme de l’art « authentiquement africain », quitte à nier toute influence
occidentale alors que sa femme Georgina et lui donnaient des cours de peinture et organisaient
des expositions d’artistes européens. Pour Naifeh, les artistes du « nouvel art sacré » des Beier
ont attiré l’attention parce que leur art ressemblait à ce que les Européens et les Américains
attendaient d’un art africain. Or, selon le critique, il s’agit d’une réinterprétation locale de
l’interprétation de l’art africain fait par les artistes européens de la première moitié du XXe
siècle.
8. Selon Jean B ALANS (1995 : 365), elle partage avec d’autres Européens, comme Mc Ewen au
Zimbabwe, « un mysticisme assez naïf ». Toutefois, dans le film La dame d’Osogbo, Suzanne Wenger
affirme qu’elle a été associée au culte dès son arrivée, sans l’avoir vraiment voulu, et ses
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
308
interlocuteurs soulignent qu’elle a toujours gardé ses distances vis-à-vis de certaines croyances,
tout en sachant les utiliser pour protéger le bois.
9. Mais aussi du fils d’un de ses plus anciens et fidèles soutiens, homme d’affaires nigérian, qui a
payé son loyer pendant des années.
10. La convention de 1972 était essentiellement liée à des considérations historiques et
esthétiques. Il s’agit désormais de pouvoir identifier des monuments qui font sens pour leurs
« valeurs symboliques, sociales, culturelles et économiques » et de prendre en compte les
patrimoines intangibles.
11. Campements nomades, habitats dogons, établissements humains au Cameroun, architecture
militaire au Sénégal et au Bénin, coloniale au Togo et au Cameroun, architecture urbaine swahili,
établissements de missions en Afrique du Sud... Alors que le sujet de Africa Revisited est de
prendre en compte le patrimoine africain au même titre que les autres patrimoines, notamment
européens, ce qui frappe est que l'architecture coloniale est presque aussi présente que
l'architecture vernaculaire (4 exemples sur 11).
12. Koïchiro Matsuura, le directeur général de l’Unesco, indique que la Déclaration « érige la
diversité culturelle au rang de “patrimoine commun de l’humanité”, aussi nécessaire pour le
genre humain que la biodiversité dans l'ordre du vivant et fait de sa défense un impératif
éthique, inséparable du respect de la dignité de la personne humaine. La Déclaration vise à la fois
à préserver comme un trésor vivant, et donc renouvelable, une diversité culturelle qui ne doit
pas être perçue comme un patrimoine figé, mais comme un processus garant de la survie de
l’humanité » (UNESCO 2003 : 3).
13. Entretiens, janvier 2008.
14. Entretien, juillet 2008.
15. Entretien, décembre 2008.
16. Dr Adediran Mayo, le conservateur du Musée national d’Osogbo a été nommé directeur de la
NCMM en 2002 (Entretien, janvier 2008).
17. Ce groupe se structure autour d’un botaniste natif d’Osogbo, Tunde Morakinyo, de son père,
John Morakinyo, du Dr Akinsoji (originaire d’Iwo, en poste au département de Botanique de
l’Université de Lagos (UNILAG) et qui a beaucoup publié sur le bois), du Dr Oni (en poste au
Department of Forestry de l’Université d’Ibadan), du Dr Deboareo, du Musée national de Benin
City, de Remi Adedayo qui devient conservateur du bois sacré en 2002. En novembre 1999, Tunde
Morakinyo crée l’Iroko Foundation, un fonds destiné à collecter des dons pour assister la
communauté d’Osogbo dans son travail de protection de la forêt et de la vie sauvage incluant
l’aide aux pasteurs afin de limiter la déforestation.
18. Adebisi Akanji, artisan fabriquant des briques traditionnelles, Kasali Akangbe, artisan
charpentier et trois autres artisans.
19. L’Icomos signale aussi les dégradations du site dans les années 1950, la création par l’État
d’une plantation de teks et d’expériences agricoles, les débuts d’activités de pêche et de chasse et
le pillage des statues.
20. Entretien Pr Babawale, janvier 2008.
21. Auteur notamment d’un article publié dans les Cahiers d’Études africaines (OMOLEWA 1978).
22. Entretien, août 2008.
23. Les critères culturels demandés sont les no 1, 2, 3, 5, 6 (le 1 et le 5 ne seront pas retenus) : « 1.
représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain ; 2. témoigner d’un échange d’influences
considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le
développement de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification
des villes ou de la création de paysages ; 3. apporter un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue ; 5. être un
exemple éminent d’établissement humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du
territoire ou de la mer, qui soit représentatif d’une culture (ou de cultures), ou de l’interaction
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
309
humaine avec l’environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l’impact
d’une mutation irréversible ; 6. être directement ou matériellement associé à des événements ou
des traditions vivants, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une
signification universelle exceptionnelle. Le comité considère que ce critère doit préférablement
être utilisé en conjonction avec d’autres critères ». Jusqu’à la réforme de la fin 2004, les sites du
patrimoine mondial étaient sélectionnés sur la base de six critères culturels (1, 2, 3, 4, 5, 6) et
quatre critères naturels (1, 2, 3, 4). Avec l’adoption de la version révisée des Orientations, il
n’existe plus qu’un ensemble unique de dix critères.
24. Le dossier se prévaut notamment d’un soutien du Duc d’Edimbourg du WWF (World Wide
Fund for Nature).
25. Selon l’article 39 des « orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du
patrimoine mondial ».
26. Pour motiver son refus, l’UICN argue qu’« aucune information précise n’est donnée sur le
statut juridique de protection de l’écosystème », que le projet de plan de gestion met en évidence
des activités parasites, et que la proposition de classement comme « paysage culturel ayant
évolué biologiquement prête à confusion ». L’UICN rejette la demande de classement en arguant
des contradictions du dossier, mais ne prend pas en compte le travail de répertoire de plantes,
joint au dossier, ne se prononce pas sur l’intérêt de cet écosystème et ne se déplace pas sur le site.
27. CRATerre-ENSAG est un laboratoire spécialisé dans l’étude et la réhabilitation des matériaux
et des habitats en terre.
28. Source : Bilan scientifique du programme pluriannuel 2002-2005, Laboratoire CRATerre-
ENSAG.
29. Entretien, janvier 2009.
30. M. Omolewa, entretien mai 2008. Douze autres sites ont été inscrits sur la liste indicative en
1995 et 2007.
31. Un très bon connaisseur du dossier, européen, nous a fait part de son étonnement de voir
nommer un expert malien sur ce dossier, pour un site dont les particularités étaient très
différentes de celles de l’Afrique de l’Ouest. En revanche, il semblait considérer que les Européens
pouvaient légitimement expertiser n'importe quel site dans le monde...
32. « Le Comité du patrimoine mondial, 1. Ayant examiné les documents WHC-05/29.COM/8B,
WHC-05/29. COM/8B. Add 2 et WHC-05/29. COM/INF. 8B.1, 2. Inscrit la Forêt sacrée d’Osun-Osogbo
(Nigeria) sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères (ii), (iii) et (vi) : Critère (ii) :
Le développement du mouvement des artistes traditionnels du nouvel art sacré et l'intégration
de Suzanne Wenger, artiste autrichienne, à la communauté yoruba, se sont révélés être le terrain
d'un échange fertile d'idées qui ont ressuscité la forêt sacrée d'Osun. Critère (iii) : La forêt sacrée
d'Osun est le plus grand exemple, et peut-être le seul restant, d'un phénomène jadis largement
répandu qui caractérisait tous les peuplements yoruba. Elle représente aujourd'hui les forêts
sacrées yoruba et leur illustration de la cosmogonie yoruba. Critère (vi) : La forêt d’Osun est
l’expression tangible du système divinatoire et cosmogonique yoruba ; son festival annuel est une
réponse vivante, florissante et en perpétuelle évolution aux croyances yoruba dans les liens qui
unissent le peuple, ses dirigeants et la déesse Osun. 3. Demande à l’État partie du Nigeria de
considérer comment la gestion des caractéristiques naturelles de la forêt pourrait être renforcée
par leur intégration à la gestion des caractéristiques culturelles de cette dernière ; 4. Demande
également à l’État partie de donner des informations, dès que possible, sur la fermeture de la
route goudronnée ; 5. Demande en outre à l’État partie de considérer la mise en place d’un plan
de gestion du tourisme culturel afin de préserver les caractéristiques spirituelles, symboliques et
rituelles de la forêt par rapport au grand nombre de personnes qui visitent le site, notamment
durant la période du festival. »
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
310
33. L’actuel Ataoja, Oba Iyiola Oyewale Matanmi III, a été couronné le 27 juillet 1976 ; il appartient
à une famille royale créée en 1957-1958 par la scission de la famille Laro en deux branches : les
Laro et les Oyipe Matomi.
34. Entretien, 2005.
35. Entretien, mai 2008.
36. Femi Salawu compare le festival d’Osogbo à celui qui a été organisé à Arigidi-Akoko, cité
natale de O. G. Adams dans l’Ondo State.
37. De plus, la mobilisation des acteurs religieux traditionnels peut s’avérer utile pour faciliter
l’accueil des visiteurs. Ainsi, un courrier qui annonce le programme des festivités de 1989 illustre
la fusion entre les préoccupations d’intendance relatives à l’accueil touristique et le rituel sacré :
la procession de l’Ataoja le premier jour « symbolise le traditionnel nettoyage de la rue principale
de la ville des mauvaises herbes et des arbustes envahissants qui pourraient gêner (hamper)
l’entrée aisée des fermiers et des visiteurs dans la ville ». Le nettoyage est de la responsabilité du
Chief Ogala d’Osogbo. Dossier « Osogbo 1988 [...] », Ministère du Tourisme, Abuja. Consulté en
janvier 2008.
38. Le bois sacré et le festival sont visités par quelques expatriés occidentaux et des Africains-
Américains en quête de racines, mais ils restent rares.
39. Date illisible, Dossier « Osogbo 1988... », Ministère du Tourisme, Abuja.
40. Numéros disponibles 1992, 1996 et 2007.
41. Une Progressive Union est une association des ressortissants émigrés originaires d’une cité
donnée ; toutes les communautés émigrées ont leur association ; la première PU a été créée à
Lagos et Ibadan par les gens d’Oyo dans les années 1920 pour promouvoir le développement
économique et culturel de leur cité jugée archaïque par ses élites « éduquées ».
42. « Here we believe as long as you care about the well-being of your kith and kin back home
and would stand up for something noble for your ancestral home, then you should be part of
this », <http://osogbocity.com/id27.htm>.
43. Les fondations médiévales à partir des migrations des XIe et XIIe siècles lors de la vague de
peuplement yoruba venue des confins tchadiques : Ife, Ede, Ilesa, Oyo ou Benin City.
44. Pour Osogbo (août 1991) et Ado-Ekiti (octobre 1996). Pour Ogbomoso : deux tentatives suivies
d’échecs en 1991 et 1996.
45. La cause de la victoire serait inavouable sans l’intervention de la déesse : les soldats
djihadistes d’Ilorin ont en effet été victimes de beignets de légumes aux propriétés laxatives qui
les ont affaiblis. Certaines chroniques créditent donc la déesse Osun déguisée en marchande de
les leur avoir vendus.
46. Chef local yoruba vassal d’une puissance souveraine. Il a le titre d’Ataoja à Osogbo.
47. Il est ainsi officiellement chargé des questions de police, de basse justice et de fiscalité locale,
de la gestion des routes et des bâtiments publics. Ce faisant, le colonisateur déconcentre un
certain nombre de compétences exercées depuis les années 1906-1910 par l’Alaafin d’Oyo.
48. La ville s’est considérablement étendue entre 1930 et 2005 mais surtout depuis 1960 en
passant de 580 ha à 1 000 ha en 1970. Malgré les incertitudes liées à la qualité des
dénombrements coloniaux puis des recensements, on peut écrire que sa population s est accrue
considérablement au cours du XXe siècle. Évaluée à environ 60 000 personnes en 1911, la ville
compte plus de 250 000 habitants en 1963 et 369 000 en 1986, soit une progression de 2,5 % depuis
1963 (AWE & ALBERTS 1995).
49. Il s’agit du titre du chef de la ville qui signifie une position de subordination à l’égard d’un
suzerain ; ici, Oyo jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, puis Ibadan au XIXe. La promotion de baale à oba
fut un des aspects de la politique coloniale britannique qui multiplie les Native Authorities dans
les années 1930-1940 afin d’améliorer le quadrillage administratif du pays et de mieux mobiliser
pendant la guerre.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
311
50. Dans la brochure du festival de 2007, l’oba, dans la préface, réinvente sans retenue l’histoire
en plaçant la fondation en 1570 ap. J.-C. « selon les sources historiques » et en datant la lampe à
16 bougies, qui est au cœur des célébrations de l’ouverture du festival, de 500 ans d’âge. Le chiffre
seize chez les Yoruba renvoie toujours à une dimension sacrée (seize cauri, seize noix de palme,
seize chapitres du corpus d’Ifa, seize fondations royales médiévales de ville yoruba, seize Orisa
initiaux qui sont descendus du ciel pour organiser la vie sur terre...) (ROY 2005).
51. Son nom est associé à une lettre de prince K. S. O. Adebayo, intitulée « Osun State est une
nécessité », où il souligne, en dépit des évidences historiques et géopolitiques, que « les peuples
d’Osun » réclament cette création depuis 1976 avec Osogbo comme capitale car « c’est une des
plus vieilles provinces du pays », The Daily Sketch, 10 août 1991.
52. The Daily Sketch, 10 août 1991.
53. Dans une tribune libre, un citoyen d’Osogbo affirme : « Il suffit de dire qu’Osogbo est un
centre culturel, son festival rituel annuel réunit les peuples de diverses races ethniques [sic],
couleurs et autres nationalités. » Olatunji Pat Adewale, The Nigerian Tribune, 2 août 1991.
54. Les élites d’Osogbo qui ont pris la tête du lobbying pour la création de l’État d'Osun (avec
l'Osun State Movement) avaient dû s'assurer, pour ce premier objectif, le soutien de la
prestigieuse et historiquement très ancienne royauté d’Ife. Or, les deux villes revendiquaient
dans le même temps la capitale alors que l’Ooni d’Ife et Ile-Ife avaient une légitimité historique
bien plus forte qu’Osogbo pour la récupérer. En 1991, l’arbitrage fut favorable à Osogbo. Loin de
se contenter de ce triomphe sur Ife, l’Osogbo P. U. et l’Ataoja, roi d’Osogbo, ont poursuivi leur
mobilisation pour le développement de la ville et ils ont choisi de situer ce combat sur les
terrains culturel et touristique, ce qui supposait de faire oublier qu’Osogbo n’avait jamais
représenté un pôle fédérateur pour l’ensemble de l’espace yoruba (six États en 2007).
55. En fait, il s’agit simplement de la protestation des musulmans d’Osogbo qui sont mécontents
du projet de destruction de l’école coranique construite dans le sousbois. Le présenter comme
une forme de fondamentalisme est exagéré, voire dangereux.
56. Ainsi, l’article du journaliste Kabir Alabi Garba, posté le 29 février 2008 sur le site du journal
nigérian The Guardian, est centré sur la venue en France du gouverneur, Prince Olagunsoye, et sur
la réunion du 20 février, précédant la soirée du 21 au musée. Selon le journaliste, la présentation
d’un film sur le festival d’Osun Osogbo (sic) aurait été, pour le gouverneur, l’occasion de défendre
l’établissement dans le cadre de l’Unesco de l’Institute for Black Culture and International
Understanding. L'auteur fait uniquement mention des discours du gouverneur et de l’Ataoja
portant sur les enjeux touristiques du festival, sans allusion aucune au contenu du film projeté.
RÉSUMÉS
Cet article propose d'étudier le processus de classement au patrimoine mondial (Unesco) du bois
sacré d'Osogbo (Nigeria) en 2005, ses objectifs touristiques et ses enjeux politiques. Il s'intéresse à
la manière dont les acteurs (ambassadeur, experts, élus, roi) peuvent s'approprier le classement
au patrimoine mondial et la valorisation touristique. L'inscription du bois sacré au patrimoine
mondial est utilisée par les autorités locales, à plusieurs titres. Elle permet de promouvoir le
festival d'Osogbo et d'avaliser une réécriture de l'histoire propice à la promotion touristique. Ici,
comme ailleurs, cette histoire est le fruit d'un travail de sélection, voire d'invention, d'éléments
susceptibles de marquer le caractère unique et extra-ordinaire des lieux. Mais derrière ce
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
312
premier objectif touristique, explicite, se profilent d'autres enjeux, plus anciens, liés à
l'organisation du territoire nigérian et à l'ambition d'Osogbo de peser dans la construction d'une
identité yoruba régionale. Le tourisme n'est pas ici une fin, mais un outil au cœur des enjeux de
pouvoirs et de représentation de soi.
This article studies the process used for classifying the Sacred Grove of Osogbo (Nigeria) as a
Unesco World Heritage site in 2005, and the related tourist objectives and policy issues. It
addresses the way in which the main players (the ambassador, experts, elected officials, and the
king) are able to leverage and appropriate the World Heritage Site classification and its touristic
value in order to further their own political and cultural ambitions. The local authorities exploit
the Sacred Grove's World Heritage Site classification for several purposes. It helps them promot
the festival of Osogbo and endorses a rewriting of local history that is favourable to tourism.
Here, as elsewhere, history is the fruit of a section process—or even invention—of elements likely
to mark the singular, extraordinary nature of the place. But behind the primary touristic goal
other, older issues are at stake, related to the organization of the Nigerian territory and the
Osogbo ambition to play a role in the construction of a regional Yoruba identity. Encouraging the
growth of tourism is therefore not an end in itself, but a tool for revived power issues and a
renewed processes of self-representation.
INDEX
Mots-clés : Nigeria, Osogbo, Yoruba, bois sacré, classement, festival, patrimoine mondial,
Unesco
Keywords : Nigeria, Osogbo, Yoruba, Sacred Grove, classification, festival, World Heritage Site,
Unesco
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
313
Imaginaire national et imaginairetouristique. L’artisanat au Muséenational du NigerThe Products of National and Tourist Imaginations: Crafts in the National
Museum of Niger
Julien Bondaz
1 Le Musée national du Niger, récemment renommé Musée national Boubou Hama, a
longtemps constitué un modèle pour les musées d’Afrique tropicale. Inauguré le 18
décembre 1959, le jour du premier anniversaire de la proclamation de la république du
Niger, il résulte de la rencontre, orchestrée par Jean Rouch, entre Pablo Toucet, ancien
réfugié espagnol et archéologue au musée du Bardo, à Tunis, et Boubou Hama,
intellectuel nigérien alors président de l’Assemblée nationale et directeur du centre
IFAN de Niamey. C’est d’ailleurs le hangar qui sert de parking au centre IFAN, transformé
en salle d’exposition, qui devient le premier pavillon du Musée national. Huit autres
pavillons d’exposition seront peu à peu construits, depuis le pavillon des costumes en
1963 jusqu’au pavillon d’expositions temporaires en 19981. Mais c’est à d’autres
aménagements que le musée doit d’être qualifié de « musée insolite » par son premier
directeur (Toucet 1972 : 204) ou même d’« anti-musée » dans les pages d’un guide
touristique du début des années 1980 (Klotchkoff 1984 : 137). L’espace muséal, qui
s’étend sur un terrain de vingt-quatre hectares, est en effet constitué en outre d’un
jardin zoologique (augmenté pendant longtemps d’un aquarium), d’un jardin
botanique, d’un jardin des nations, d’un ensemble d’habitats traditionnels appelé
« musée de plein air », d’un centre éducatif et de divers espaces réservés à l’artisanat.
Ces espaces, où différentes pratiques artisanales mises en scène comme patrimoine
immatériel ou comme patrimoine vivant, sont en même temps des espaces de vente.
L’exposition muséale est ici en même temps une exposition commerciale.
2 Dès lors, choisir le Musée national du Niger comme terrain de recherche
ethnographique oblige bien évidemment à interroger non seulement les relations entre
visiteurs et agents du musée (guichetiers, guides, gardiens...), mais aussi celles entre
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
314
visiteurs et artisans ou autres vendeurs. Pour un chercheur français, l’une des
premières difficultés est précisément de se distinguer de ses compatriotes touristes,
bien que, comme le notent Michel Picard et Jean Michaud (2001 : 7), cette distinction ne
soit jamais véritablement assurée, ni la frontière vraiment nette. D’ailleurs, au moment
de quitter le musée pour rentrer en France, le chercheur redevient pour ainsi dire le
touriste qu’il avait semblé être lors de son arrivée, ou du moins est-il de nouveau
susceptible de partir avec quelques souvenirs, d’acheter quelques objets aux artisans.
3 Selon un visiteur nigérien, les touristes ont en effet un triple intérêt à venir au musée,
« ils peuvent avoir l’histoire du pays, prendre des photos pour montrer à ceux qui ne
sont pas allés au Niger et se procurer des objets qu’il n’y a pas là-bas [chez eux] ».
Autrement dit, ils peuvent obtenir trois choses : des connaissances par le biais de
l’exposition, des images grâce aux photographies et des objets auprès des artisans. Et
pour ces trois modes de relation au patrimoine, les attentes des touristes divergent de
celles des visiteurs nigériens. En tant que lieu institutionnel essentiel de la mise en
tourisme de la culture nigérienne, le Musée national apparaît en effet comme une
« zone de contact » (Clifford 1997) entre deux types de représentations, les unes
nationales, les autres touristiques. Un « imaginaire national » (Anderson 1996) et un
« imaginaire touristique » (Amirou 1995, 2000) trouvent au musée un lieu commun, en
particulier à travers les différentes pratiques artisanales mises en scène comme
patrimoine national et ethnographique, et à ce titre travaillées par des critères
d’ethnicité et d’authenticité socialement construits.
4 Quand la mise en musée et la mise en tourisme de l’artisanat se rejoignent, ce ne sont
alors plus seulement les notions d’« objet authentique » et d’« objet de tourisme » qui
conduisent l’analyse à une impasse (Cauvin Verner 2006), mais ce sont aussi celles
d’« objet muséal » et d’« objet commercial » qui font problème. Les objets produits par
les artisans et proposés à la vente à l’intérieur du musée doivent-ils être pensés comme
des « substituts de contact », comme des « dérivatifs » à l’« exigence de liens nouveaux,
difficile à satisfaire » dans le cadre d’une visite touristique (Lallemand 1978 : 104), ou
doit-on au contraire voir en eux des « points de contact » qui redonneraient du corps
aux choses muséales (Feldman 2006) ? Constituent-ils des « nœuds de relations
sociales » entre les personnes (de L’Estoile 2007 : 424) ou sont-ils travaillés par les
« frictions » qui traversent les musées contemporains (Kratz & Karp 2006) ?
5 La mise en musée et la mise en tourisme sont en effet avant tout des mises en ordre et
des mises en relation, des fabriques de catégories et des révélateurs de tensions, des
constructions d’identités et des confrontations d’imaginaires. L’entremêlement
d’éléments endogènes et exogènes qui caractérisent les objets de tourisme (Benfoughal
2002 : 127) semble ainsi mettre en forme la rencontre de l’artisan et du touriste, la
conjonction du musée et du marché et l’entrecroisement de l’imaginaire national et de
l’imaginaire touristique. La transaction marchande dont la culture fait (littéralement)
l’objet suppose alors l’existence d’imaginaires négociés, et donc une redéfinition, voire
une réorganisation, du musée : le projet muséographique initial de mise en scène de la
Nation (Gaugue 1997) a été adapté, la présence d’artisans au sein du musée a conduit à
une renégociation de l’usage des espaces de production et de vente, les relations entre
artisans ou vendeurs et touristes ont modifié les relations entre agents du musée,
artisans et vendeurs, et, enfin, des traditions artisanales ont été inventées (les croix
régionales touarègues) ou importées (la sculpture sur bois et les batiks) pour faire
coller l’image de la Nation à celle, plus vaste, de l’Afrique2.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
315
La mise en tourisme de l'artisanat : usage des espacesde production et de vente
6 Le Musée national du Niger est situé au cœur de Niamey, entre le petit marché et le
fleuve Niger, sur un terrain pentu et clos par des murs d’enceinte. L’entrée peut se faire
par deux larges portes, l’une en haut, presque en face du Centre culturel franco-
nigérien (CCFN) Jean Rouch, l’autre en bas, séparée du fleuve par l’un des plus grands
hôtels de la capitale, l’hôtel Gaweye. Une troisième porte, le plus souvent cadenassée,
est percée dans le mur qui sépare le musée de l’Institut de recherche en sciences
humaines (IRSH). En fait, la présence des artisans n’est pas circonscrite en un seul lieu.
Une topographie des pratiques artisanales et des relations commerciales apparaît de
manière assez précise, mêlant zones de vie et zones de travail.
7 Dès les abords du musée, à l’une ou l’autre porte, des vendeurs présentent aux visiteurs
différents produits artisanaux, profitant des grilles et des murs avoisinants pour
exposer des pièces de batik ou organisant sur des tables en bois un alignement de
bijoux, quelques sabres touaregs, ou encore une dizaine de boîtes de cuir. L’un d’entre
eux explique les avantages d’une telle place pour le commerce : « Être devant la porte,
c’est mieux qu’être à l’intérieur, parce que les gens n’ont pas besoin de payer leur ticket
d’entrée pour faire leurs achats. » Ainsi, tout au long de la rue qui conduit du petit
marché à la porte du haut, des vendeurs de produits artisanaux sont présents, aux côtés
de quelques vendeurs de café et autres tabliers proposant cigarettes, bonbons ou
cahiers. Deux coopératives artisanales se trouvent par ailleurs d’un côté de la rue,
tandis que de l’autre, à gauche de l’entrée, se situe l’une des deux boutiques du musée.
En bas, à l’autre porte, seuls quelques vendeurs et artisans ont leur stand à l’ombre de
quelques arbres où, sur des fils, sont fixées des dizaines de pièces de batik. Rares sont
en effet les visiteurs, et surtout les touristes, qui pénètrent au musée par cette porte.
Pour la plupart, les acheteurs font partie de la clientèle de l’hôtel Gaweye,
essentiellement des « majors », comme on appelle les militaires américains qui
viennent en mission au Niger et qui sont logés là quelques semaines. L’un des jeunes
hommes qui attendent à cette place d’éventuels acheteurs signale cependant avec
regret devoir payer la taxe imposée aux artisans et vendeurs du musée : « [bien que l’on
soit hors du musée] il faut pourtant payer la taxe de 1 000 FCFA par vendeur. Comme
nous sommes sept, cela fait 7 000 FCFA. »
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
316
Plan synthétique du musée national du Niger
8 Cette taxe pose en effet problème dans de nombreux cas. Elle résulte en fait d’une
évolution souvent conflictuelle de l’organisation du travail artisanal au sein du Musée
national du Niger, et renvoie donc à l’histoire de la présence des artisans au musée, et à
la mise en place de trois types d’espaces spécifiques, possédant chacun une fonction
distincte à l’origine. Pablo Toucet avait en effet prévu à l’intérieur du musée une zone
réservée au logement du personnel, une autre à la fabrication, et enfin des lieux de
vente.
9 On trouve ainsi, pour commencer, dans un coin reculé du musée, un véritable village
dans lequel habitent plusieurs agents du musée et de nombreux artisans et vendeurs.
D’une petite dizaine d’habitants à ses débuts, la population s’élève ainsi à plus de deux
cents aujourd’hui. Le village motive alors deux types de distinction, d’une part entre les
agents du musée logeant sur place et les agents du musée habitant « en ville »3, et,
d’autre part, entre les habitants du village travaillant (officiellement) au musée et les
autres. C’est parmi cette dernière catégorie que l’on trouve un grand nombre de
vendeurs de batiks, et c’est précisément pour cette raison que le village devient un lieu
non seulement de fabrication de batiks, mais également de vente. Il arrive en effet que
les vendeurs de batiks du village conduisent des touristes, interpellés dès l’entrée, lors
de leur visite ou à la buvette du musée, jusqu’à leur domicile au village pour leur
proposer une pile de batiks qu’ils déplient les uns après les autres. Cette invitation au
village apparaît ainsi comme une technique de vente en quelque sorte hospitalière, la
transaction se faisant dans un lieu imaginairement privilégié, puisque censément
réservé à des intimes (famille ou amis). Le village initialement destiné à loger les
travailleurs du musée s’est ainsi peu à peu changé en un lieu occasionnel de vente, en
un espace ambigu de rencontre entre les fabricants ou les vendeurs de batiks (ils sont
souvent les deux) et les touristes.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
317
10 Le second espace conçu par Pablo Toucet comme une zone de fabrication artisanale a
lui aussi évolué, et fait l’objet aujourd’hui de différentes tensions. Appelé « centre
artisanal », et situé au cœur du musée, sur un léger relief, il apparaît aujourd’hui plus
éclaté qu’à l’origine, à cause du nombre croissant d’artisans qui y travaillent (de trois à
six artisans à sa mise en place en 1963, à deux ou trois centaines aujourd’hui). L’un des
bijoutiers touaregs les plus âgés se souvient ainsi : « Toucet a eu l’idée de les réunir [les
artisans]. Au début ils étaient quatre. Quand des présidents visitaient le musée, ils
demandaient qu’ils leur fassent des présents (bijoux, chameliers touaregs en argent...).
Il voulait montrer les différentes techniques aux étrangers. [...] Toucet a exigé qu’ils
apprennent leurs métiers à différents apprentis à partir de 1970. » C’est le nombre
croissant d’apprentis qui a ainsi obligé l’administration du musée à réserver une zone
toujours plus grande à l’artisanat. Elle se compose actuellement de trois parties : un
vaste hangar en tôle, deux habitats traditionnels reconstitués de part et d’autre, et
enfin, à une extrémité de cet ensemble, un atelier fait de parpaings et couvert d’un toit
de tôle. Le hangar était auparavant fabriqué en paille, et a été entièrement détruit par
un incendie en 1992. Reconstruit l’année suivante, il présente désormais un espace
rectangulaire et ouvert sur toute une longueur.
11 On trouve sous le hangar, en façade et tout à droite la « section poterie » (2 potiers, le
père et son fils), plus à gauche mais aussi par-derrière, l’immense « section bijouterie
forge » (84 artisans), puis encore sur la gauche et jusqu’au fond, la « section
maroquinerie professionnelle », presque aussi imposante (69 artisans), tout à gauche
enfin, une partie de la « section sculpture » (une dizaine de sculpteurs). En arrière de
cette section sculpture, se trouve le bureau de la coopérative des artisans du musée.
Lorsqu’on fait face à cette grande structure, on découvre sur la droite, alors que le
terrain fléchit déjà légèrement en direction du fleuve, la reconstitution de l’habitat
traditionnel hausa, dont certaines des cases sont utilisées par le potier et son fils. À
gauche du hangar, s’ouvre un arc de cercle formé de plusieurs habitats traditionnels
songhay reconstitués occupés par la section tisserands (8 tisserands). Enfin, à la gauche
de ces cases, on trouve l’atelier où travaille le reste de la « section sculpture » (une
demi-douzaine de sculpteurs).
12 Cette mise en espace fonctionne en fait comme une triple mise en ordre. La répartition
précise des artisans dans le hangar ou à proximité, ainsi que le récent recensement
effectué par le musée et dont j’ai repris ci-dessus les chiffres4, répondent en effet à trois
objectifs : un objectif strictement muséographique qui était celui de Pablo Toucet (1963,
1968) quand il a conçu le musée, un objectif d’organisation du travail, et surtout un
objectif de contrôle de l’activité économique. À l’origine, en effet, l’activité économique
était concentrée au niveau des deux boutiques du musée. Le directeur fixait lui-même
le prix des différents produits en fonction de la qualité, et c’était ensuite aux vendeurs
de la boutique de les vendre. Le musée prélevait une taxe de 10 % sur chaque vente, ce
qui permettait entre autres de fournir l’eau et l’électricité aux artisans. Mais, peu à peu,
leur nombre augmentant, ceux-ci se sont mis à vendre aux visiteurs directement au
niveau de leur atelier, sous le hangar, au détriment des deux boutiques et surtout du
musée, qui ne percevait plus la taxe de 10 %. Le directeur du musée a alors décidé de
mettre en place une taxe de 1 000 FCFA par artisan et par mois pour couvrir les frais
d’approvisionnement en eau et en électricité, et donc d’établir au préalable une liste
précise des artisans autorisés à travailler au musée. Ce qui a provoqué des tensions
entre une majorité des artisans et l’administration. En signe de mécontentement, les
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
318
artisans du musée ont ainsi décidé de ne pas participer au défilé du 1er mai 2007 avec les
agents du musée, ainsi qu’ils en avaient l’habitude.
13 En fait, là encore, certains agents du musée ou visiteurs nigériens établissent une
distinction complexe entre les différents artisans (fabricants ou vendeurs de produits
artisanaux). Alors même que les artisans listés par l’administration du musée ont peu à
peu pris eux-mêmes en charge la vente de leurs produits et que les vendeurs de batiks
sont pour la plupart les producteurs des pièces qu’ils vendent, les premiers sont
qualifiés d’« artisans » et les seconds de « vendeurs » par les agents du musée. L’emploi
de ces deux catégories génériques tend ainsi à essentialiser une distinction entre
« objets de la tradition » (« je trouve ça très bien que les artisans travaillent au musée
parce qu’on peut avoir facilement les objets de la tradition », explique ainsi un visiteur
nigérien) et « objets de tourisme ». Cette distinction fonctionne cependant à un autre
niveau, entre artisans ayant hérité de compétences techniques et rituelles
traditionnelles et artisans ayant appris le métier de manière à gagner de l’argent. C’est
le cas par exemple pour les forgerons dont le savoir-faire traditionnel est valorisé. Trois
parmi les plus âgés sont ainsi réputés, dans tout Niamey, pouvoir soigner les brûlures.
Selon un agent du musée, « les autres sont devenus forgerons pour gagner de l’argent ».
Une autre compétence technico-rituelle, celle de charmer les serpents, est attribuée à
l’un des cordonniers (« maroquiniers » selon le vocabulaire de l’administration).
14 Par ce jeu complexe de distinctions entre artisans et vendeurs puis entre artisans
« traditionnels », « authentiques » et artisans taxés de mercantilisme, ce sont donc en
fait des oppositions entre ancienne génération et nouvelle génération, entre tradition
et modernité, entre musée et marché qui sont mises en discours et permettent de
penser les transformations dont le Musée national du Niger est le théâtre. L’ancien
directeur-adjoint du musée, Aladou Maman, en résume ainsi les conséquences : « Le
musée maintenant, c’est un marché », et en rend les touristes directement
responsables : « Autrefois il y avait une rigueur ethnographique, mais maintenant les
touristes commandent ce qu’ils veulent : ce sont des modèles exotiques. »
15 Selon lui, cela se traduit par le remplacement de l’ancien catalogue du musée (1977) par
un plus récent5 : « Dans l’ancien catalogue, il y avait une rigueur ethnographique, mais
avec le nouveau, on trouve du n’importe quoi. Ils ont pris ce qu’il y avait dans la rue,
dans les marchés [...]. » Ces deux catalogues ont en effet une assez grande importance
dans les relations entre les artisans et les touristes : ils servent non seulement de
répertoire de modèles pour les artisans6, mais aussi de catalogues pour les éventuelles
commandes, y compris les commandes depuis l’étranger.
16 Dans le catalogue du Musée national du Niger, trois catégories d’objets sont définies en
fin d’ouvrage :
« Nos artisans réalisent trois séries d’objets :1) Objets ethnographiques authentiques (aucune modification de l’original n’esttolérée).2) Pour les objets non traditionnels une grande liberté de création est laissée à nosartisans.3) Nos clients peuvent nous confier la fabrication d’objets dont ils ont conçu lesformes et choisi les matériaux. »
17 Cependant, dans l’introduction, Pablo Toucet et Albert Ferral, son successeur, insistent
davantage sur la valeur ethnographique et authentique des objets (il s’agit d’« objets
d’une authentique valeur ethnographique ») et présentent chaque section du catalogue
« dans un contexte ethnographique ». Les huit sections sont ainsi introduites chacune
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
319
par un texte d’une ou deux pages. Elles correspondent soit à des catégories d’objets
(« bijoux », « sculpture nigérienne », « maroquinerie », « instruments de musique
nigériens », « armes blanches », « poterie du Niger »), soit à des corporations d’artisans
(« tisserands nigériens », « forgerons-bijoutiers du Niger »). Le caractère national est
par ailleurs largement mis en avant, puisque cinq sections comportent une référence à
la nation nigérienne, mais pour chaque objet, l’origine ethnique est précisée
(remplacée, le cas échéant, par la mention « divers »). Le catalogue est cependant
destiné à deux catégories de lecteurs différents, les artisans et les visiteurs. Il est en
effet censé permettre « aux uns d’apprécier et de fertiliser leur imagination créatrice et
aux autres d’être plus sensibles à la variété de notre riche et authentique artisanat ».
18 Le nouveau catalogue propose, quant à lui, deux catégories d’objets, « objets d’art » et
« objets de fantaisie », traversées par des catégories ethniques : « bijoux et
maroquinerie Touareg » et « tissage, broderie Touareg et Bororo, vannerie et divers ».
La distinction réservée aux objets « Touareg » et « Bororo » (dont témoigne l’emploi de
la majuscule pour la forme adjectivale) tend ainsi à objectiver les deux ethnies du Niger
qui nourrissent le plus l’imaginaire touristique, les figures du Touareg et du Peul
bororo étant largement mythifiées. En tant que « labels » (Amselle & M’Bokolo 1999 :
VII), les ethnonymes semblent censés fournir une double garantie de qualité et
d’authenticité. L’accent est par ailleurs mis sur la qualité des produits, sur le commerce
comme « moteur de développement de l’artisanat » et sur les « performances
économiques » des artisans.
19 On voit donc qu’entre les deux catalogues, un changement de regard sur les objets s’est
là aussi effectué. La distinction entre objets traditionnels et objets non traditionnels
s’est changée en une distinction entre art et fantaisie, en même temps que l’affichage
des origines ethniques des objets ne sert plus la construction d’une identité nationale
mais le renforcement d’une imagerie touristique.
20 Dans ce contexte de transformation du musée en marché, d’abandon de la « rigueur
ethnographique » au profit de « modèles exotiques », les deux boutiques du musée
revendiquent leur rôle de contrôle de la qualité et de l’authenticité des objets, même si
elles présentent également des nouveaux modèles. Selon Rabiou Salif, le responsable de
la boutique qui se trouve au centre du musée : « Pour le travail artisanal, il faut
toujours garder la culture nigérienne : ça s’achète plus. Maintenant, avec la
mondialisation, il y a des choses qui sont faites au Niger, mais ce ne sont pas nos
modèles. » C’est le cas par exemple des porte-monnaie touaregs qui s’inspirent en fait
d’un « modèle moderne », ou le passage du tissu ou du synthétique au cuir : les
touristes passent en effet commande de sacs en cuir à partir de modèles de sacs en tissu
et en synthétique. Il y a également de nouveaux modèles inventés par les artisans. Le
rôle du vendeur est d’ailleurs primordial pour trouver une nouvelle inspiration : « On
est là pour aider le client à choisir et donner une explication. Si tu ne discutes pas avec
le client, tu n’as pas la chance de trouver de nouveaux modèles. »
21 La boutique est alors comprise comme un lieu de présentation du musée : « La boutique
montre : voilà ce que nous fabriquons au musée. » Elle met en scène le travail des
artisans du musée qui mettent eux-mêmes en scène le travail des artisans de toutes les
ethnies du Niger. La mise en scène de la nation est ainsi redoublée dans la boutique, qui
fonctionne donc comme un autre espace d’exposition au sein du musée, le vendeur
apparaissant comme un double du guide.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
320
La mise en ordre du tourisme : catégories etprésupposés
22 Plusieurs possibilités d’achats s’offrent donc aux touristes. Depuis la porte d’entrée et
parfois jusqu’à la fin de leur visite, des vendeurs les suivent en brandissant des objets
sortis de leurs poches : colliers présentés comme typiques mais importés du Nigeria,
hypothétiques météorites trouvées dans le désert aux environs d’Agadez, croix
touarègues... Aux abords, voire à l’intérieur du village, comme aux entrées du musée et
autour de la reconstitution de l’habitat traditionnel songhay, d’autres vendeurs
proposent des pièces de batik aux motifs variés. À l’intérieur ou autour du hangar des
artisans, ce sont les producteurs eux-mêmes qui étalent leurs produits, comme au
marché, et travaillent sous les yeux des visiteurs en attendant l’éventuel client. Et, au
centre du musée, près du bassin de l’hippopotame, sous un grand arbre, des jeunes
hommes profitent de l’ombre pour converser avec les surveillants du musée, les
premiers guettant vers l’entrée du haut l’arrivée des touristes pour leur proposer des
excursions en pirogue sur le fleuve ou, en 4x4, plus au Sud, dans le parc national du W,
les seconds s’éloignant quelquefois pour réprimander un enfant qui jette une pierre à
un babouin, ou assurer quelque peu la tranquillité des touristes durant leur visite7.
23 Ici les visiteurs sont classés en différentes catégories. L’administration distingue les
visiteurs « nationaux » (« adultes », « paramilitaires et militaires », « enfants ») et les
visiteurs étrangers (« expatriés résidents » ou « étrangers résidents » et « touristes »).
Le prix du billet d’entrée varie selon la catégorie à laquelle correspond le visiteur, de 25
FCFA pour les enfants nationaux à 1 000 FCFA pour les touristes, ce qui permet au musée
de connaître de manière assez réaliste le nombre d’entrées par catégories de visiteurs
et par mois, depuis 2002.
2002 2003 2004 2005 2006
Enfants nationaux 74 700 77 300 95 200 112 600 87 067
Adultes nationaux 52 300 76 100 99 600 83 800 107 509
Étrangers résidents 16 000 15 700 16 100 18 100 16 400
Touristes 5 300 6 750 6 650 7 700 11 112
Total 148 300 175 850 217 550 222 100 222 088
Source : Service financier et du matériel du Musée national du Niger.
24 On constate ainsi que, sur la période récente, la fréquentation touristique est assez
importante, et a eu tendance à augmenter numériquement et proportionnellement,
sans pour autant dépasser 5 %. Cependant, les vendeurs sont unanimes pour dire que
les mois où ils vendent le plus sont les mois de novembre à février, à la fois parce que
c’est la saison touristique et parce que c’est la période des fêtes. Ils déplorent l’absence
de clients en avril et en mai, c’est-à-dire en pleine saison chaude. Par ailleurs, en 2007,
tous ont constaté une baisse de la fréquentation touristique (et par conséquent une
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
321
baisse des ventes) liée au problème de rébellion touarègue dans le nord et en
particulier dans la région d’Agadez, qui attire habituellement nombre de touristes.
25 Les catégories de visiteurs définies par l’administration de manière à organiser une
grille tarifaire ne correspondent cependant pas aux catégories du langage ordinaire. Il
n’y a pas de terme vernaculaire traduisant la notion de touriste. En hausa, la périphrase
yawon bude ido a été popularisée par la radio La Voix de l’Amérique 8 et désigne le
touriste, mais peut être traduite littéralement : « Celui qui voyage pour apprendre avec
[pour ouvrir] les yeux. » Le paradigme visuel est ainsi posé comme central dans la
définition du tourisme. Dans le cadre spécifique du musée, alors même que les
catégories d’« étrangers expatriés » et de « touristes » peuvent être appliquées aussi
bien à des visiteurs européens, asiatiques ou arabes qu’à des visiteurs africains, les
vendeurs et les agents du musée supposent, a priori, que les visiteurs blancs sont tous
des touristes et que tous les touristes sont blancs : les termes désignant la couleur
blanche (annassaara en songhay-zerma9, anissara en hausa) servent ainsi à désigner non
seulement les Européens, mais aussi les Asiatiques et les Arabes, et tendent à équivaloir
la notion de touriste. Le plus souvent, le « Blanc » renvoie avant tout au « Français » :
« Pour nous, les Blancs, c’est les Français. Les autres, ce ne sont pas des vrais Blancs »,
précise ainsi l’un des artisans les plus âgés du musée, introduisant l’idée d’un Blanc
authentique en regard des représentations idéalisées de telle ou telle ethnie nigérienne.
26 Une seconde catégorie vernaculaire déborde également les catégories mises en place
par le musée, celle de « l’étranger » (yew en songhay-zerma, bako en hausa). La figure
complexe de l’étranger ne peut pas, en effet, être comprise en référence à la distinction
administrative entre « visiteurs nationaux » et « visiteurs étrangers » : pour un
locuteur zerma-songhay ou hausa est « étranger » toute personne qui n’habite pas dans
la même ville ou dans le même village. L’étranger est alors plus exactement un visiteur,
un hôte. Un habitant de Niamey qui fait visiter le musée à un parent vivant dans une
autre ville du Niger, par exemple, peut tout à fait le présenter, en français, comme un
« étranger ». À la distinction administrative référant directement au cadre de la nation
(les étrangers étant ceux qui n’appartiennent pas à la nation nigérienne), l’emploi de
catégories ordinaires conduit à la mise en place de deux autres distinctions, l’une entre
les Blancs et les Noirs et l’autre entre habitants de Niamey et personnes vivant à
l’extérieur de la capitale.
27 Outre les distinctions administratives et les distinctions vernaculaires, un troisième
type de distinctions est appliqué aux différents visiteurs du musée, qui renvoie
directement à une stratégie commerciale. Trois catégories génériques sont ainsi mises
en place, chacune associée à une recherche de produit spécifique : les « Nigériens » sont
supposés acheter essentiellement des porte-documents pour offrir dans le cadre de
séminaires, les « Africains » rechercheraient quant à eux plutôt des sacs pour dame, des
chaussures, des porte-monnaie et des bijoux, et les « touristes » enfin sont réputés être
attirés par les chaussures, les sacs et les bijoux. On voit ainsi que les trois catégories
recoupent à la fois la distinction administrative entre « nationaux » et « étrangers »
(Nigériens/Africains et touristes) et la distinction vernaculaire entre Noirs et Blancs
(Nigériens et Africains/touristes).
28 Au niveau des touristes, d’autres distinctions sont introduites de manière à mettre en
place les critères du goût touristique, qui apparaissent comme des critères nationaux. Il
s’agit en effet de distinguer, selon les catégories nationales d’origine des touristes, les
objets qui sont a priori susceptibles de les intéresser, ce qui tend à entretenir certains
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
322
stéréotypes. Selon un vendeur, les Chinois recherchent ainsi les sacs, les chaussures et
les ceintures en peau de crocodile, ce qui leur pose quelques problèmes à la douane.
29 Selon un autre vendeur (qui ne vend pas de maroquinerie), les Chinois et les Japonais
n’achètent que des statues. Alors que les Américains recherchent les sabres touaregs,
les Arabes (il s’agit surtout de Libyens) « n’achètent que des couteaux ». Quant à Condé,
le plus âgé des sculpteurs sur bois du musée, il a remarqué que les Américains
détestaient les bustes féminins, alors que les Français, au contraire, les appréciaient
particulièrement, etc. Certains Blancs constituent cependant une catégorie à part, les
« coopérants », parce qu’ils aiment décorer leur maison, ont développé un goût
spécifique pour le batik et les statues, en même temps qu’une technique d’achats
différente, puisqu’ils peuvent prendre le temps de se renseigner sur les prix et de les
comparer, et même passer des commandes.
30 Un tel système de distinction selon les nationalités d’origine des touristes permet
également de hiérarchiser la qualité de la clientèle, selon le nombre d’achats ou les
habitudes de marchandage. Il est acquis pour tous que les meilleurs clients sont les
Blancs. Comme le précise un artisan : « Ce sont les Blancs qui achètent, les Asiatiques ou
les Européens. Un Nigérien qui achète, c’est le rêve, mais si ça arrive, c’est pour offrir à
un ami blanc. » Le problème est d’ailleurs plus général, et ne concerne pas seulement
les produits du musée. Un jeune Touareg explique ainsi : « Les Nigériens n’aiment pas
acheter nigérien. Le problème, c’est qu’ils ne sont pas fiers de leur culture. Ils préfèrent
acheter chinois, français ou américain. Ils n’aiment pas porter les boubous. Ici on
fabrique des chaussures en cuir, les Blancs aiment beaucoup ça. Mais les Nigériens, ça
ne les intéresse pas. » Paradoxalement, ce sont les Blancs qui achètent les produits
nigériens. Mais là encore, lorsqu’il s’agit d’établir des distinctions entre les « Blancs »,
chaque vendeur établit sa propre hiérarchie. Pour l’un : « Les meilleurs clients sont les
Français parce qu’ils achètent [beaucoup] et parce qu’ils connaissent la valeur de
l’artisanat. » Pour un autre, qui vend ses produits à la porte du bas : « Ce sont les
Français qui aiment discuter les prix. Les Américains achètent souvent sans discuter,
surtout les majors [les militaires] qui descendent à l’hôtel Gaweye. Il y a des magasins
dans l’hôtel, mais les prix sont plus élevés : 15 000 à 20 000 FCFA, au lieu de 5 000 FCFA. »
Pour un troisième enfin : « Après les Américains, les meilleurs clients sont les
Allemands »10.
31 Dès lors, le problème pour le vendeur est de réussir à trouver le plus rapidement
possible la nationalité du touriste qui entre au musée ou qui passe à proximité de
l’étalage, pour s’adresser à lui directement dans la bonne langue (français ou anglais),
lui proposer les objets susceptibles de l’intéresser en priorité et trouver les bons
arguments de vente. Certains vendeurs disent ainsi deviner systématiquement la
nationalité de tel ou tel touriste à son apparence et à sa démarche, détaillant quelques
signes distinctifs : les Italiens sont dotés d’une barbe et d’une queue de cheval, les
Anglais sont toujours bien habillés et portent chemises et pantalons... Pour autant, ces
images caricaturales ne sont pas partagées par tout le monde. Un bijoutier touareg
explique ainsi : « Il y a des signes qui permettent de reconnaître de quels pays sont les
touristes, mais on ne peut pas les expliquer. C’est comme les cicatrices [les
scarifications] qui permettent de savoir d’où l’on vient. Même si les gens aujourd’hui
n’ont plus tellement de cicatrices, on continue de savoir d’où ils sont. » Une
correspondance est ainsi établie entre les signes qui permettent de distinguer parmi les
touristes leurs différentes nationalités et ceux qui permettent d’identifier les divers
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
323
groupes et sous-groupes ethniques. La figure du Blanc et des multiples identités
nationales qui la composent est le reflet de l’identité nigérienne et de sa pluralité
ethnique. L’image du touriste fonctionne sur le même mode que l’image de la Nation,
elle est à la fois composite et unifiée. Tout se passe comme si la mise en place d’une
typologie commerciale des touristes était une réponse à la typologie muséale des
ethnies, comme si la mise en tourisme du musée conduisait à une mise en musée des
touristes. Dès lors, la production des objets artisanaux s’inscrit dans le cadre d’une
négociation des imaginaires, en particulier à travers le recours muséal à des traditions
inventées ou importées.
Les croix touarègues : imaginaire national etimaginaire touristique d'une tradition inventée
32 L’origine des croix touarègues est présentée comme un mystère dans tous les guides
touristiques et sur tous les sites Internet consacrés à l’artisanat touareg, et est
susceptible à ce titre de réactiver tel ou tel fantasme. Dans l’édition 2000 du Guide Bleu
Évasion consacré au Sahara, on lit ainsi : « D’où vient ce dessin ? Déformation d’un motif
phallique, disent certains. Mais [...] on en est réduit aux conjectures »n. Non seulement
les bijoux touaregs tendent à être résumés par ces fameuses croix, mais elles sont elles-
mêmes souvent réduites à la seule croix d’Agadez : les guides touristiques ou les sites
consacrés à l’artisanat touareg parlent ainsi indifféremment des « croix touarègues »,
des « croix du sud » ou des « croix d’Agadez ». Dans le nouveau catalogue, utilisé par les
artisans du musée, le texte consacré aux « bijoux d’argent » précise d’emblée : « Si la
bijouterie touarègue est connue au-delà des frontières, c’est grâce à la célèbre CROIX
D’AGADEZ (Teneghel), véritable énigme de la création artistique. » Suivent alors
différentes hypothèses sur « l’origine et la signification de ce bijou, symbole des
“choses du désert” » (représentation de la constellation de la croix du Sud ou « bijou
porte-bonheur ») avant que ne soit précisé : « Il existe d’autres pendentifs 11 de même
style que la croix d’Agadez. Les bijoutiers les présentent sous forme de collection de 21
croix considérées comme emblèmes de localité ou de région »12.
33 Or, contrairement à l’origine de la croix d’Agadez et de quelques autres, la mise en
place de cette collection de vingt et une croix n’a rien de mystérieux. Elle est
directement liée à l’histoire du Musée national, même si les versions de son invention
varient selon les interlocuteurs. L’un, un agent du musée, accorde un rôle essentiel au
premier directeur : « Au départ, il n’y avait que quatre croix. Pablo Toucet a fait les
dessins des autres et les a donnés aux artisans pour qu’ils les fassent. Avec la technique
de la cire perdue, c’est facile ! » Le président de la coopérative des artisans du Musée
national, El Hadj Agak Mohamed, un bijoutier touareg, relativise l’idée d’une invention
des dessins. Les croix auraient plutôt été dessinées à partir de modèles existant dans la
région d’Agadez et collectés sous l’initiative de Pablo Toucet : « C’est un ingénieur
français qui était dans la région d’Agadez qui cherchait les modèles et qui a envoyé
vingt et un modèles au musée. Le groupe de travail était composé de l’ingénieur, d’un
avocat et de Toucet. » Un autre bijoutier touareg, plus jeune, rend responsables de
l’invention des croix les artisans du Musée national eux-mêmes, encouragés par une
intervention étatique : « Les croix ont été créées au musée : avant, il n’y avait qu’une
croix (zakat : la croix de Zinder). Chaque ancien a fait une croix pour son village. L’État a
vu ça et a voulu que chaque village ait sa croix. » C’est en tout cas sous la direction de
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
324
Pablo Toucet que les vingt et une croix, rassemblées sous forme de tableau vitré et
couvert de cuir, sont devenues un symbole essentiel du Niger.
34 Un tel tableau composé de vingt et une croix souvent associées, en légende, à un
toponyme, figure en effet à la fois l’unité nationale du Niger, chaque croix étant censée
représenter une région ou une localité du pays, et une énigme originelle qui ne pouvait
que renforcer une certaine « authenticité » de l’artisanat touareg. Et même mieux, en
tant qu’objet pluriel, composé de vingt et un types de croix, et unique, puisque les croix
sont rassemblées en un seul tableau, une telle mise en image semblait objectiver l’idéal
synthétique proposé par le Musée national. On raconte ainsi que la vingt-deuxième
croix créée après la mort de Mano ag Dayak, en 1995, est inspirée du motif d’un dallage
situé devant la porte de la boutique du musée. Mano ag Dayak, figure médiatique du
développement touristique de la région d’Agadez et porte-parole controversé de la
cause touarègue lors de la rébellion du début des années 1990 (Casajus 1995 ; Grégoire
2006), personnifie parfaitement la rencontre d’un imaginaire national en crise et d’un
imaginaire touristique en plein développement. Le musée aurait ainsi joué, sur le plan
iconographique, un rôle dans le processus de paix, même si la croix de Mano ag Dayak
n’a pas intégré le tableau des croix touarègues13. Les différentes croix ont également
inspiré Pablo Toucet et ses successeurs pour l’architecture des pavillons du Musée
national. En effet, s’ils reprennent pour l’essentiel le style hausa, en particulier dans le
choix des couleurs (bleue et blanche) et les découpes des corniches, ils intègrent
également des ouvertures ou des bas-reliefs en forme de croix touarègues. Le bâtiment
qui abrite la section éducative du musée présente quant à lui un plan au sol en forme de
croix d’Agadez.
Tableau des croix touarègues
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
325
35 Si le tableau des croix touarègues connaît un grand succès, constituant selon un
vendeur de la boutique, un « cadeau nigérien »14, les différents modèles de croix sont
aussi déclinés en divers pendentifs, boucles d’oreille ou porte-clés qui sont les produits
les plus vendus au musée. Là encore, la nationalité des touristes présuppose des
comportements d’acheteurs divers. Selon un vendeur, « il y en a qui achètent les bijoux
parce qu’ils sont jolis et d’autres qui veulent savoir de quelle région sont les croix. Ce
sont les Français qui cherchent à connaître ». Un autre précise que « les Français sont
les meilleurs clients : ils connaissent vraiment les bijoux, comme les Italiens, parce que
ce sont eux-mêmes des grands bijoutiers ». Cependant la majorité des touristes
s’intéresse avant tout à la qualité du métal, nickel ou argent. Les bijoux ne sont en effet
plus fabriqués en « argent touareg », métal réputé assez proche du nickel selon les
bijoutiers du musée. L’un d’entre eux explique d’ailleurs que le nickel, qui sert
désormais à la fabrication des croix, est importé du Nigeria, du Ghana ou du Maroc,
tandis que l’argent provient du Nigeria ou, pour une meilleure qualité, de France,
d’Allemagne et de Suisse. Les techniques de fabrication ont également changé, avec
l’usage répandu du chalumeau plutôt que celui du moule qui implique la fabrique de
croix plates et découpées aux ciseaux. Le jugement des agents du musée est à ce sujet
encore sévère : selon l’un d’entre eux, « les artisans ont gâté le travail ». Par ailleurs, la
pratique de l’artisanat par des Touaregs n’est pas sans poser également des problèmes
plus larges de mutation, caractérisés en particulier par l’inversion des rapports
économiques et sociaux et la rupture des liens de dépendance qui caractérisaient la
société touarègue (Grégoire 2006 : 101). L’un des artisans touaregs du musée témoigne
ainsi de ces changements :
« Depuis la grande famine de 1973 au Mali et au Niger, les Touaregs sont venus dansles villes. Avant, il n’y avait que les chameaux et les bêtes qui comptaient. Maismaintenant ils sont entrés dans la civilisation, ils ont des voitures. Ils font del’artisanat. Mais encore maintenant, il y a des vieux et des vieilles qui ont honte.Pour eux, ceux qui font de l’artisanat ne font plus partie de la race touarègue. C’estla honte qui fait que les Touaregs sont en retard sur la civilisation. »
36 Paradoxalement, la pratique de l’artisanat apparaît ainsi en rupture avec un mode de
vie pensé comme traditionnel, ou du moins inhérent à une certaine identité (« la race »)
touarègue. Les artisans touaregs sont ainsi perçus à la fois comme des producteurs
d’objets traditionnels, authentiques, typiques (imaginaire touristique) et comme des
personnes ne correspondant plus à une certaine définition, elle-même traditionnelle,
authentique et typique, de l’identité touarègue (imaginaire national).
La sculpture sur bois : maîtres guinéens et apprentisnigériens
37 L’imaginaire national et l’imaginaire touristique sont également en jeu dans la présence
de sculpteurs sur bois au Musée national. La section du catalogue publié en 1977 par le
Musée national du Niger intitulée « La sculpture nigérienne » est en effet paradoxale, le
texte de présentation signalant que « l’ivoire et certains bois précieux (ébène et bois
rouge) sont achetés dans les pays voisins »15 et que « les quelques artistes sculpteurs
installés au Musée national depuis 1958 sont en majeure partie des étrangers ». C’est le
cas en particulier du premier sculpteur accueilli au musée par Pablo Toucet, Baba
Doumbia, aujourd’hui décédé, et de son successeur « maître » Condé, tous deux
sculpteurs malinkés originaires de la région de Kankan en Guinée Conakry. Condé,
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
326
arrivé au musée en 1978 après avoir suivi une formation à l’Institut national des Arts de
Bamako, au Mali, explique : « J’ai travaillé avec la force avant de travailler avec la
tête », tandis que Baba Doumbia « n’a travaillé que par la force : il ne faisait que les
figurines du musée ». Ainsi, c’est Baba Doumbia qui a sculpté la scène villageoise en
ivoire qui est exposée dans le pavillon des costumes et met en scène les figures
hiératiques de femmes en train de piler ou de porter fagots de bois et calebasses et
d’hommes travaillant au champ, aux côtés d’animaux sauvages disproportionnés tels
qu’éléphant, hippopotame, girafe ou gazelle, mais aussi d’un chien et d’une poule. C’est
également lui qui a mis en place les différents types ethniques du Niger représentés soit
en buste, soit en pied et que l’on retrouve exposés sous l’appellation de « série
ethnique » au musée régional de Dosso ou toujours proposés à la vente à la boutique du
Musée national. Condé précise :
« Mon frère [Baba Doumbia] faisait tout ce qui était traditionnel [“les visages qu’il ya dans la caisse à la boutique”]. C’est moi qui ai créé tous les nouveaux modèles,tout ce qui est stylisé [en particulier le modèle appelé “la danseuse”]. Tous lesmodèles qui sont là, j’ai voulu inventer ça. J’ai enseigné aux élèves, mais il faut lamain : personne n’arrive à faire certains modèles sauf moi. »
38 Condé distingue ainsi le travail de « force » et le travail de « tête », la tradition et
l’invention de nouveaux modèles, les représentations ethniques ou villageoises et les
sculptures stylisées. Son atelier jouit d’une grande réputation, et les commandes sont
fréquentes, depuis les chaises décorées de girafes pour des touristes américains jusqu’à
des centaines de pénis grandeur nature pour une ONG qui monte un projet de
sensibilisation sur le SIDA.
39 Mais le succès d’un sculpteur guinéen au Musée national du Niger n’est pas sans créer
des tensions. La sculpture est en effet souvent considérée comme idolâtre par une
population largement musulmane, ce qui explique selon Condé que seuls les touristes
en achètent : « Les Nigériens n’achètent pas les statues. Quand ils voient ça, ils disent :
ça c’est gunki [”idole” ou “fétiche” en hausa], ça c’est idole. Si un Nigérien achète, soit
c’est un chrétien, soit c’est pour offrir à un étranger. » Ce qui explique également que
c’est depuis peu, et pour des raisons économiques, que les gens commencent à le
saluer : « Avant, beaucoup de monde ne me saluait pas parce que ce que Dieu fait je le
fais. Mais maintenant, comme il faut gagner de l’argent, ils veulent apprendre. » Mais
c’est surtout pour des raisons plus nationalistes que religieuses que « maître » Condé a
dû faire face à une certaine animosité de la part de quelques jeunes qu’il a formés. Il
raconte :
« Comme j’avais le nom guinéen [togo en malinké désigne à la fois le nom et larenommée], ils ont fait une lettre au directeur du musée pour demander que jeparte. Ils voulaient le nom nigérien. Le directeur a transféré la lettre au ministère,mais là-bas ils ont dit que le musée c’était les archives, et que mon frère [BabaDoumbia] a été le premier artisan au musée. Il y a des apprentis qui me sont restésfidèles et qui m’ont dit ça. Moi j’ai dit qu’ils pouvaient faire autant de lettres qu’ilsvoulaient, que les Blancs allaient continuer à venir chez moi. C’est pour cela que jeme suis mis à l’écart, parce que là où il y a des problèmes, ça ne sert à rien de rester.Ici [l’atelier où il travaille] c’est le projet DANI, le projet du Danemark [en fait, duLuxembourg], mais ça n’a pas été fini. Je ne sais pas ce qu’ils ont fait de l’argent,mais c’est resté comme ça. »
40 On comprend mieux ainsi pourquoi la section sculpture est séparée entre le hangar et
l’atelier, comme je l’ai indiqué plus haut. Cette séparation territoriale apparaît en fait
comme une mise en espace d’une séparation identitaire et générationnelle, opposant
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
327
d’un côté des jeunes sculpteurs nigériens et de l’autre un sculpteur plus âgé et
originaire de Guinée, qui n’en continue pas moins de former de jeunes Nigériens à la
sculpture. Mais selon Condé, quelque chose d’autre se joue dans cette opposition : « Là-
bas [au hangar] ce sont des marchands, ce ne sont pas des sculpteurs. Ils restent assis et
ils regardent les objets qui sont à eux. Mais le nom reste ici. Les Blancs, c’est Condé
qu’ils veulent. » On retrouve ici la distinction entre artisans et vendeurs dont sont
victimes les fabricants de batiks. On ne s’étonnera donc pas que, comme la sculpture
sur bois, le batik pose également la question de son intégration dans un imaginaire
national censément mis en scène au musée.
Le batik : production touristique et motifs nationaux
41 L’omniprésence de vendeurs de batiks aux abords et à l’intérieur du musée est
directement liée à l’existence d’un centre éducatif à proximité des bâtiments de
l’administration, à gauche de la porte d’entrée du haut. Créé en 1970 au sein du musée,
il abrite en effet depuis 1982 une formation en batik. Ali Boubacar, le chef du service
« centre éducatif », explique ainsi que le batik était une « tradition malienne et
ivoirienne » et qu’à cette date, « des Américains formés en Côte-d’Ivoire, de passage au
musée, ont donné une formation à l’ensemble des enseignants ». Assaïd Omar, un jeune
Touareg, d’abord formé en électricité puis en batik, est, depuis octobre 2006, professeur
contractuel de batiks au centre éducatif. Il précise que le batik vient de l’île de Java, et
pense quant à lui que c’est un Allemand qui a formé le premier professeur de batik,
aujourd’hui retraité. Ali Boubacar et Assaïd Omar ont tous deux conscience qu’il ne
s’agit donc pas d’une tradition nigérienne, et le directeur du centre précise qu’il s’agit
d’une production « directement tournée vers le tourisme ». En effet, la production de
batiks est essentiellement orientée vers une clientèle touristique, contrairement à celle
du wax, qui est la version industrialisée du batik indonésien.
42 Inventé aux Pays-Bas et exporté, d’abord au Ghana par un marchand écossais, puis dans
toute l’Afrique de l’Ouest, le wax a suscité et continue de susciter un engouement
populaire, dont témoignent l’omniprésence des pagnes en wax et la diversité des motifs.
Cependant, si le wax « se révèle surtout comme un support d’expression identitaire »
(Grosfilley 2006 : 65), le batik produit artisanalement à destination des touristes
apparaît lui aussi comme une mise en image d’identités construites, affichées et
commercialisables.
43 Deux types de batik sont en fait proposés par les vendeurs du Musée national du Niger,
le « batik d’art » et le « batik décoratif ». Dans les deux cas, l’appellation de « batik »
désigne une technique de réserve à la cire permettant la mise en place des motifs, la
cire étant appliquée soit au pinceau avec ou sans pochoirs, soit à l’aide de tampons. Le
« batik d’art » désigne une technique de teinture végétale sans fixateur. On ne peut
donc pas laver les pièces ainsi fabriquées. Le « batik décoratif » indique au contraire
que les teintures utilisées sont chimiques et sont fixées, de telle sorte que les pièces
peuvent être lavées, ce qui permet en particulier de fabriquer des nappes et des
serviettes. Alors que les teintures végétales du « batik d’art » sont importées du Nigeria
(en teinture végétale, il n’y a que quatre couleurs : rose, vert, bleu et jaune), les
produits chimiques du « batik décoratif » proviennent du Mali, et, contrairement à ce
que leur désignation pourrait laisser croire, le second est plus cher que le premier16. Ce
qui explique que les pièces de « batik d’art » soient les plus vendues.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
328
44 Pour autant, les ventes ont plutôt tendance à chuter, proportionnellement au nombre
de vendeurs. Au fil des années, le marché est en effet devenu de plus en plus saturé,
comme l’explique le directeur du centre éducatif :
« Auparavant, pour le batik, les élèves étaient placés en fin de formation àSonitextile, mais l’entreprise a été privatisée par les Chinois (ENITEX). Même les
simples stages ne sont plus possibles. Les seuls débouchés sont au musée ou auxalentours. Le marché est saturé. Sur sept grands couturiers nigériens, un seul aaccepté de prendre des élèves (trois). »
45 Des anciens élèves du centre éducatif ont donc créé leur atelier à l’intérieur du musée, à
côté du village, mais ont également transmis leurs techniques à leurs jeunes frères. À la
porte du musée, certains vendeurs de batiks reprochent à la formation proposée par le
centre éducatif du musée de ne déboucher sur rien. L’un d’entre eux regrette : « On
nous forme, et après, on nous jette sans nous trouver de place. » Un autre accuse
implicitement ceux qui n’ont pas suivi cette formation de fausser le marché et de
dévaloriser la marchandise.
46 L’explosion de l’offre par rapport à la demande conduit ainsi là encore à l’apparition
d’un classement catégoriel des vendeurs de batiks (producteurs diplômés, producteurs
non diplômés, revendeurs) et à la définition de la relation avec le touriste comme un
enjeu spécifique. Ce qui explique le reproche qui est fait par certains agents du musée
aux vendeurs de batiks quels qu’ils soient, et la mise en place, comme on l’a vu, d’une
distinction entre vendeurs et artisans, les producteurs de batik étant définis comme
vendeurs et non pas comme artisans. L’un des agents du musée explique ainsi comment
il en est venu à se désintéresser du batik : « Le batik, nous étions les premiers à être
formés [le centre éducatif du musée a été le premier à proposer une formation en batik
au Niger]. Mais vu comment maintenant les gens en font du commerce, ça ne
m’intéresse plus. Ceux qui le font le font pour les touristes. » Pourtant, on retrouve
dans le discours des vendeurs de batiks les trois catégories de clientèles déjà définies
plus haut : les Nigériens, les Africains et les touristes. Mais les vendeurs précisent que le
batik qui est acheté par les Nigériens sert de décoration pour les salles d’attentes et
pour les bureaux de l’administration nigérienne, et que si les Africains en achètent,
c’est pour le revendre en Europe.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
329
Motifs de batiks
47 Quant aux goûts des touristes en matière de batiks, ils apparaissent là encore assez
clairement, même si les vendeurs ne semblent pas faire de distinction selon les
nationalités d’origine des touristes. Le professeur de batik du centre éducatif enseigne à
ses élèves que les touristes « n’aiment pas les couleurs vives, [qu’] ils veulent des
couleurs foncées ». Quant aux motifs, ils apparaissent soit comme des symboles de la
Nation (la sorcière Saraouniya, figure historique de la résistance à l’invasion coloniale ;
les motifs inspirés des gravures rupestres qui ont fait la réputation archéologique du
Niger ; ou encore les girafes qui sont une référence aux dernières girafes de l’Afrique de
l’Ouest, sauvegardées à Kouré, à 60 km à l’Ouest de Niamey17), soit comme des images
d’une Afrique authentique (bestiaire sauvage ou scènes de village) ou mythifiée (les
chameaux et les tentes comme attributs des Touaregs). Dans cette double motivation de
la Nation et de l’Afrique, le batik devient ainsi le support d’un imaginaire national et
d’un imaginaire touristique, la représentation idéalisée de soi (le Niger comme nation)
fonctionnant en même temps comme image mythifiée de l’Autre (le Niger comme
destination touristique).
*
48 La rencontre entre imaginaire national et imaginaire touristique, autour des concepts
de tradition, d’authenticité ou d’ethnicité, a ainsi conduit les personnes travaillant au
Musée national du Niger non seulement à dresser des typologies des différents touristes
qui fréquentent l’institution, mais également à introduire des distinctions entre elles-
mêmes, dont la plus structurante est celle qui oppose artisans et vendeurs. Alors même
que les objets échappent aux catégories en devenant les supports de la rencontre entre
touristes et Nigériens, tout se passe comme si les personnes qui les produisent, les
exposent ou les vendent tendaient au contraire à mettre en place ou à renforcer des
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
330
distinctions sociales, à labelliser des représentations idéalisées de soi ou des autres
(l’artisan, le touriste), à authentifier des communautés imaginées (la Nation). Les objets
ne sont plus alors seulement relationnels, mais peuvent apparaître comme des objets
frictionnels. Transmis d’une culture à une autre, entre imaginaire national et
imaginaire touristique, ils « subissent des recontextualisations sociales et culturelles :
ils prennent d’autres formes, ils acquièrent de nouveaux usages et changent de sens.
Les transformer est une manière de marquer une appropriation et, en même temps, les
objets transforment ceux qui les manipulent » (Turgeon 2007 : 25).
49 Pour ce qui concerne l’anthropologie du tourisme, il semble donc essentiel de poser la
question des transformations sociales et culturelles non pas tant en termes
d’acculturation ou de métissage (de changements identitaires)18, mais plutôt en termes
de transmission (de dynamique relationnelle). Dans cette mesure, et pour ce qui nous
concerne, la culture matérielle ne constitue qu’un point de départ : les objets sont
irréductibles à leur fabrique, à leur exposition ou à leur commerce. En même temps
qu’eux, on l’a vu, ce sont les imaginaires national et touristique qui sont produits,
manipulés ou négociés, et finalement transmis, entre mise en musée et mise en vente.
Et c’est précisément pour cette raison que le Musée national du Niger semble en
définitive proposer moins la mise en scène de la Nation ou la mise en tourisme de la
culture que la construction (artisanale ?) d’images de soi et des autres.
BIBLIOGRAPHIE
AMIROU, R.
1995 Imaginaire touristique et sociabilités du voyage, Paris, PUF.
2000 Imaginaire du tourisme culturel, Paris, PUF.
AMSELLE, J.-L. & M’BOKOLO, E.
1999 « Préface à la deuxième édition. Au cœur de l’ethnie revisitée », in J.-L. AMSELLE & E.
M’BOKOLO (dir.), Au cœur de l’ethnie. Ethnie, tribalisme et État en Afrique, Paris, La Découverte &
Syros : I-X.
ANDERSON, B.
1996 L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte.
BENFOUGHAL, T.
2002 « Ces objets qui viennent d’ailleurs », in H. CLAUDOT-HAWAD (dir.), Voyager d’un point de vue
nomade, Paris, Éditions Paris-Méditerranée : 113-135.
CASAJUS, D.
1995 « Les amis français de la cause touarègue », Cahiers d’Études africaines, XXXV (1), 137 :
237-250.
CAUVIN VERNER, C.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
331
2006 « Les objets du tourisme, entre tradition et folklore. L’impasse des catégories », Journal des
Africanistes, 76 (1) : 187-201.
CLIFFORD, J.
1997 « Museum as Contact Zones », in Routes Travel and Translation in the Late Twentieth Century,
Cambridge, Harvard University Press: 188-219.
COUSIN-DAVALLON, F. & DAVALLON, J.
1986 « Les parcs zoologiques : l’imaginaire du naturalisme », in J. DAVALLON (dir.), Claquemurer,
pour ainsi dire, tout l’univers. La mise en exposition, Paris, Éditions du Centre Georges Pompidou, CCI :
83-95.
FELDMAN, J. D.
2006 « Contacts Points: Museums and the Lost Body Problem », in E. EDWARDS, C. GOSDEN & R. B.
PHILLIPS (dir.), Sensible Objects. Colonialism, Museums and Material Culture, Oxford, Berg : 245-267.
GAUGUE, A.
1997 Les États africains et leurs musées. La mise en scène de la Nation, Paris, L’Harmattan.
GRÉGOIRE, E.
2006 « Tourisme culturel, engagement politique et actions humanitaires dans la région d’Agadès
(Niger) », Autrepart, 40 : 95-111.
GROSFILLEY, A.
2006 Textiles d’Afrique entre tradition et modernité, Bonsecours, Éditions Point de vues-Département
de seine-Maritime.
KLOTCHKOFF, J.-C.
1984 Le Niger aujourd’hui, Paris, Jeune Afrique.
KRATZ, C. A. & KARP, I.
2006 « Introduction : Museum Frictions : Public Cultures/Global Transformations », in I. KARP, C.
A. KRATZ, L. SZWAJA & T. YBARRA-FRAUSTO (eds.), Museum Frictions : Public Cultures/Global
Transformations, Durham-London, Duke University Press : 1-31.
LALLEMAND, S.
1978 « L’image de l’Afrique à travers la publicité touristique », in J.-L. BOUTILLIER, J. COPANS, M.
FIELOUX, S. LALLEMAND & J.-L. ORMIÈRES, Le tourisme en Afrique de l’Ouest. Panacée ou nouvelle traite ?,
Paris, Maspero : 84-107.
DE L’ESTOILE, B.
2007 Le Goût des Autres. De l’Exposition coloniale aux Arts premiers, Paris, Flammarion.
LUXEREAU, A.
2004 « Des animaux ni sauvages ni domestiques, les “girafes des Blancs” au Niger »,
Anthropozoologica, 39 (1) : 289-300.
OLIVIER DE SARDAN, J.-P.
1982 Concepts et conceptions songhay-zarma, Paris, Nubia.
PANDOLFI, P.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
332
2001 « Les Touaregs et nous, une relation triangulaire ? », Ethnologies comparées, 2, Miroirs
identitaires.
2004 « La construction du mythe touareg, quelques remarques et hypothèses », Ethnologies
comparées, 7.
PICARD, M. & MICHAUD, J.
2001 « Présentation », Anthropologie et sociétés, 25 (2) : 5-13.
TOUCET, P.
1963 « Le Musée national de la République du Niger, Niamey », Museum, 16 (3) : 192-196.
1968 Notes sur le Musée National du Niger, Niamey, Brochure du Musée National du Niger.
1972 « Le musée de Niamey et son environnement », Museum, 24 (4) : 204-207.
TURGEON, L.
2003 Patrimoines métissés. Contextes coloniaux et post-coloniaux, Québec, Presses de l’Université
Laval ; Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’Homme.
2007 « La mémoire de la culture matérielle et la culture matérielle de la mémoire », in O. DEBARY
& L. TURGEON (dir.), Objets & Mémoires, Québec, Presses de l’Université Laval ; Paris, Éditions de la
Maison des sciences de l’Homme : 13-36.
NOTES
1. Les collections exposées sont essentiellement archéologiques (« pavillon de la préhistoire »,
« pavillon archéologique » et « pavillon des gravures rupestres ») et ethnographiques (« pavillon
classique » présentant les différents thèmes de la vie quotidienne, « pavillon des costumes » et
vitrine des instruments de musique). Notons également la présence d’un « pavillon de
l’uranium ».
2. Les données présentées dans cet article résultent d’un travail de recherche doctorale en
anthropologie effectué au Musée national du Niger (mars-mai et octobre-novembre 2007), sous la
direction de Michèle Cros. Je tiens à remercier ici vivement le directeur du musée, M. Kélessi
Mahamadou, et son adjoint — désormais successeur —, M. Mamane Ibrahim, ainsi que l’ensemble
des agents, des artisans et des vendeurs du musée, pour avoir permis que mes recherches se
déroulent dans les meilleures conditions.
3. Paradoxalement, cette expression largement utilisée par les agents du musée renvoie à l’idée
que le village du musée, bien que situé en plein centre-ville, est l’équivalent d’un village de
brousse. La présence d’animaux sauvages au musée entretient d’ailleurs l’idée du musée comme
un morceau de brousse en plein cœur de la ville. La symbolique du parc zoologique et
« l’imaginaire du naturalisme » qu’il met en scène (COUSIN-DAVALLON & DAVALLON 1986) semblent
ainsi implicitement impliquer le musée dans son ensemble, et le village qu’il abrite en particulier.
Les habitants du village disent, quant à eux, habiter « au musée ».
4. Liste des artisans, document interne, avril 2006.
5. Nouveau catalogue, édité par Lux-Développement, non daté.
6. Les jeunes artisans vont également de plus en plus sur Internet pour trouver de nouveaux
modèles.
7. Si les surveillants du musée laissent les vendeurs suivre les touristes durant leur visite, ils
n’hésitent pas à écarter, en les menaçant d’une matraque, ou plus souvent d’un morceau de tuyau
d’arrosage, les talibés, ces jeunes élèves d’écoles coraniques que leur maître envoie mendier
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
333
durant la journée, et qui se retrouvent nombreux au musée, en particulier le vendredi matin
avant la grande prière.
8. La Voix de l’Amérique est le nom français du service de diffusion radiophonique et télévisuelle
du gouvernement des États-Unis, Voice of America (VOA). Les premières émissions en langue
hausa datent de 1979.
9. Sur ce terme songhay-zerma et ceux qui suivent, voir pour de plus amples développements
OLIVIER DE SARDAN (1982).
10. Il faut bien évidemment prendre en compte que ces hiérarchies de valeurs sont présentées à
un chercheur français susceptible de devenir un client. Le fait de tenir en bonne estime les clients
français repose donc en grande partie sur un jugement circonstanciel.
11. Guide Bleu Évasion, Hachette, 2000, p. 573.
12. Nouveau catalogue, p. 54.
13. Une vingt-troisième croix a été créée par l’artiste français Michel Batlle et présentée au
festival de l’Aïr en 2004. Elle célèbre l’Inzad, le plus célèbre des instruments de musique touaregs.
14. Ce vendeur parle également des figurines de « chameliers » en métal comme de « trucs
nigériens ». On voit ici que des objets emblématiques de la culture touarègue sont investis d’une
signification nationale.
15. Aujourd’hui, l’ivoire n’est bien sûr plus sculpté et les bois précieux (ébène, acajou doré et
acajou rouge) sont importés du Nigeria.
16. Je dois ces informations techniques au professeur de batiks du centre éducatif du Musée
national du Niger, Assaïd Omar. Qu’il soit ici remercié pour le cours qu’il m’a donné.
17. Sur ces girafes et les conséquences de leur patrimonialisation, voir LUXEREAU (2004).
18. Ici se situe peut-être la limite du concept de « patrimoine métissé » proposé par Laurier
TURGEON (2003).
RÉSUMÉS
Le Musée national du Niger à Niamey apparaît comme un lieu institutionnel essentiel de la mise
en tourisme de la culture, une « zone de contact » (James Clifford) entre deux types de
représentations, les unes nationales, les autres touristiques. Ces deux imaginaires entrecroisés
s'expriment en particulier dans les différentes pratiques artisanales mises en scène comme
patrimoine immatériel dans le centre artisanal du musée. En tant que Musée national, le musée
vise alors explicitement la construction et le renforcement d'une identité nationale et favorise
l'« artisanat national » (poterie, bijouterie, maroquinerie). En tant qu'institution culturelle,
visitée par de nombreux touristes (plus de 11 000 en 2006), il intègre des représentations plus
larges de l'Afrique, en important certaines pratiques artisanales (sculpture sur bois et batik).
Cette double vocation du musée apparaît en particulier dans l'invention d'une tradition nationale
et touristique, les croix touarègues régionales. C'est finalement moins en effet la mise en scène
de la Nation ou la mise en tourisme de la culture qui est proposée par le Musée national du Niger,
que la rencontre des imaginaires national et touristique.
The National Museum of Niger in Niamey is a vital institution for the promotion of culture for
tourism. It is a "contact zone" (James Clifford) between two different representations: the
national one and the one created for tourism. These two interwoven imaginary creations are
especially well expressed in the various crafts presented as the country's intangible heritage in
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
334
the museum's craft centre. As a national museum, the institution explicitly aims to construct and
reinforce national identity and promote "national crafts" such as pottery, jewellery and
leatherwork. As a cultural institution visited by numerous tourists (more than 11,000 in 2006), it
integrates broader representations of Africa by importing certain artisanal practices such as
wood carvings and batik. A good example of the museum's twofold vocation may be seen in the
Tuareg regional crosses, which are an invented national and touristic tradition. What the
museum is really promoting is not so much the staging of the nation or the "touristification" of
culture, but a meeting of the national and touristic imaginations.
INDEX
Keywords : Niger, crafts, museum, nation, tourism
Mots-clés : Niger, artisanat, musée, nation, tourisme
AUTEUR
JULIEN BONDAZ
Centre de recherches et d’études anthropologiques (CREA), Université Lumière-Lyon 2, Lyon.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
335
Tourisme et primitivisme.Initiations au bwiti et à l’iboga(Gabon)Tourism and Primitivism. Initiation to Bwiti and Iboga in Gabon
Nadège Chabloz
1 La figure du primitif et le primitivisme ont souvent été analysés à travers les liens qu’ils
entretiennent avec la pratique artistique, et notamment celle du mouvement
surréaliste. Malgré quelques recherches1, les représentations primitivistes à l’œuvre
dans les pratiques touristiques restent peu étudiées et mal connues.
2 Centré sur la description et l’analyse des ressorts d’une pratique touristique que nous
appellerons « mystico-spirituelle et thérapeutique », en partie basée sur la figure du
primitif, cet article s’intéresse aux parcours et aux discours de Français partis s’initier
au bwiti, un rite initiatique gabonais2 utilisant les racines d’une plante, l’iboga3. Quelle
est cette pratique touristique ? D’où vient-t-elle ? Qui sont ses promoteurs et
pratiquants ?4. On analysera ensuite le rôle du primitivisme et de l’image du primitif
dans les représentations des acteurs en présence. On verra notamment que ces
représentations sont multiformes, mais également qu’elles évoluent selon les
situations. On s’emploiera également à définir les différentes acceptions de la notion de
primitif et de primitivisme à travers les discours et les pratiques des acteurs. Enfin,
nous verrons de quelles manières ces représentations et ces pratiques primitivistes
viennent conforter ou contredire les idéologies et les lieux communs du tourisme dit
culturel — notamment celles portant sur la « rencontre avec l’autre », une meilleure
compréhension entre les peuples et la sauvegarde des traditions locales.
3 La description et l’analyse s’appuient sur un corpus diversifié : l’observation de
l’initiation de Philippe au Gabon en juillet 2007 (Chabloz 2009) ; des entretiens filmés
sur plus d’une année avec Yann, un autre Français initié, vivant aujourd’hui à
Libreville, promoteur du bwiti en France et au Gabon ; des entretiens menés avec des
initiateurs5 au Gabon ; la littérature scientifique et grand public consacrée au bwiti et à
l’iboga ; des films documentaires ; des témoignages publiés sur des sites Internet.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
336
L’hétérogénéité de ce corpus permet d’apporter un éclairage sur la nature des
différentes représentations liées au primitif rencontrées dans cette forme de tourisme,
que ce soit en amont, lors de l’initiation et plusieurs années après.
Les acteurs de ce tourisme
Essai de typologie des touristes et de leurs motivations
4 Ce qui nous intéresse ici est de tenter de comprendre les raisons qui poussent des
Français à effectuer un voyage au Gabon pour « s’initier » à un rite local. Qui sont ces
Français ? Quelles sont leurs motivations ? À la suite de quel parcours arrivent-ils au
Gabon ? Que font-ils une fois arrivés sur place ? Aucune statistique sur l’origine
socioprofessionnelle des touristes partant s’initier au Gabon n’est disponible : les
personnes voulant s’initier et qui demandent un visa pour ce pays ne donnent pas le
véritable but de leur voyage, car s’ils le font, le visa leur est généralement refusé6.
D’après les informations recueillies auprès des quatre initiateurs accueillant des
Français et auprès de Yann qui a été en contact avec un grand nombre d’entre eux, on
trouve des travailleurs sociaux, des personnels des secteurs de la santé et de
l’enseignement, des animateurs socioculturels, des étudiants, des cadres d’entreprise,
des employés, des professions libérales, des psychologues. Ces personnes ont accès à
des ressources financières non négligeables (soit en fonds propres, soit empruntées à
leurs proches comme c’est souvent le cas pour des étudiants) car le billet d’avion pour
Libreville est onéreux (autour de 1 400 euros) et l’initiation sur place a un coût élevé
(entre 1 500 et 3 000 euros7 selon les initiateurs, ce coût ayant tendance à augmenter du
fait du développement récent de ce tourisme au Gabon) pour une durée variable, en
général, une quinzaine de jours.
5 Les candidats à l’initiation ont de vingt à soixante ans, avec peut-être une
prépondérance de la tranche 25-35 ans. Ils sont dans un parcours de « recherche
spirituelle ». La plupart a déjà effectué un stage de « développement personnel » à
l’iboga en France lors d’un week-end, mais également souvent une expérience à
l’ayahuasca au Pérou ou en Europe. Ces touristes présentent des similitudes avec la
clientèle des nouvelles thérapies, telle que la psychologie humaniste8 (Lipianski 1982 :
85-86). L’exemple de Philippe et de Yann9 va nous permettre de mieux comprendre le
cheminement, les caractéristiques, les motivations et la réflexion des Français qui
s’initient au bwiti. Formateur agricole âgé de trente-sept ans en 2007, père d’une petite
fille, Philippe vit en couple à Bordeaux. Il déclare souffrir d’un « malêtre assez diffus »
depuis l’âge de quinze ans, une première initiation en France lui ayant permis de
« régler des problèmes » avec sa mère, de « couper le cordon », et de ne plus se sentir
« angoissé ». Lors de son initiation, il donne les raisons qui l’ont poussé à se rendre au
Gabon :
« Je suis venu ici pour me faire initier au bwiti, j’ai envie d’avancer sur le chemin del’éveil, donc je veux changer des choses en moi, je veux me sortir de mes addictions,je veux connaître ma lignée, mes ancêtres10, je veux aussi pouvoir savoir mieux quije suis, ce que je suis censé faire sur cette terre » (Philippe, juillet 2007, Libreville).
6 Au-delà d’un désir de guérison lié à ses dépendances (au tabac et au haschich), Philippe
souhaite une initiation plus « métaphysique ».
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
337
7 Yann, trente-trois ans, père de deux enfants, parisien avant de s’installer au Gabon, est
autodidacte et est parvenu à devenir cadre supérieur. Il a découvert le Gabon et ses
traditions lorsqu’il dirigeait une branche d’export Afrique pour une entreprise
française. Il s’est intéressé à la tradition bwitiste, a vu « un documentaire de Cheyssial à
la télévision ». Yann avoue un amour tout particulier pour l’Afrique et ses rites
initiatiques traditionnels, un intérêt qu’il perçoit comme « transgénérationnel », car sa
mère est originaire de l’Afrique du Sud, et de plus les mères de ses deux enfants sont
originaires de l’Afrique de l’Ouest. Yann a suivi, en 2006, avec son épouse, un stage d’un
week-end à l’iboga en Normandie pour tenter de « régler les problèmes » dans son
couple. Selon Yann, cette première initiation s’est très mal passée, même si elle lui a
permis de « se nettoyer » de son passé de toxicomane : il a vomi pendant deux jours et
deux nuits et a eu « des visions extrêmement dures, tristes » de son passé11. Après un
deuxième « stage de développement personnel » réalisé quelques mois plus tard, il
décide « d’explorer cette voie à fond » et part au Gabon début 2007 (suite au
licenciement de son entreprise) pour faire sa « première initiation véritable ». Il débute
une initiation avec Atome Ribenga — qui lui a été conseillé en France et dont il a lu le
livre (Ribenga 2004) —, pendant laquelle il vit « une NDE, near death experience », et
affronte ses « pires démons, la peur de la mort, de l’inconnu », ainsi que son « mental,
dont nous sommes relativement prisonniers ici en Occident ». Longue de trois
semaines, cette initiation est ressentie comme un tournant dans la vie de Yann : « J’ai
tout appris de moi, sur mon histoire, mon identité, ma raison d’être, même sur la
compréhension de mes parents, de ma femme, de l’univers, des vérités très puissantes
qui sont aujourd’hui des piliers de ma vie. Avant j’étais suicidaire, dépressif, horrifié
par les choses qui m’étaient arrivées, alors que là, tout s’est inversé, aujourd’hui je suis
fier de ce que je suis, alors que j’étais très honteux de ce que j’étais. Et puis enfin, j’ai
aujourd’hui une foi inébranlable, j’ai pu expérimenter le contact avec le divin, ou avec
le moi intérieur, donc avoir une foi pas intellectualisée » (entretien filmé, février 2008,
Paris).
8 Les parcours de vie sont différents, mais Yann et Philippe cherchent tous deux à sortir
de leurs dépendances, poursuivre un itinéraire spirituel, trouver leurs « racines ». La
quête des racines et des ancêtres est une motivation fréquente, surtout chez les
personnes ayant un parent d’origine africaine, comme c’est le cas pour Philippe et dans
une certaine mesure pour Yann ; elle participe du « tourisme de racines » qui se
développe sur tous les continents12. Guérison, quête spirituelle, recherche de ses
racines et de « sa place dans le monde » sont les motivations principales des
Occidentaux venant s’initier13. D’après les différents témoignages recueillis auprès des
initiateurs, de Yann, et sur des sites Internet, il est possible de distinguer de manière
« idéal-typique » quatre profils de candidats à l’initiation.
Les « souffrants » ont des problèmes d’ordre psychologique parfois lourds, de traumatismes
(viol, dépressions lourdes). Ceux qui viennent s’initier pour des raisons thérapeutiques
seraient les plus nombreux.
Les « pick and choose » ou les « néo-chamanes » (Yann) qui expérimentent toutes les
traditions du monde. C’est dans cette catégorie que peuvent entrer les personnes qui sont à
la recherche d’un « trip » comme un autre. Avertis par de nombreux témoignages livresques
et par Internet de l’aspect « non-récréatif » de l’iboga, ils ne font généralement pas le voyage
jusqu’au Gabon et se contentent de consommer de l’iboga chez eux.
•
•
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
338
Les « mystico-spirituels ». Ils viennent se faire initier pour des raisons de développement
personnel et de quête mystique (entrer en contact avec « le divin », avec l’au-delà, avec ses
ancêtres). Selon Yann, ils sont minoritaires.
Les toxicomanes : selon Yann, les toxicomanes qui connaissent bien l’iboga comme « plante
miracle » sont nombreux à se faire initier pour se guérir. Ce constat est nuancé par Tatayo
qui déclare qu’ils sont minoritaires à venir au Gabon, étant souvent marginalisés, sans
travail, sans argent.
9 Les frontières entre ces différentes « catégories » sont poreuses14 : ainsi un toxicomane
ou une personne dépendante de drogues (haschich, tabac, alcool, médicaments) peut
venir se faire initier pour se débarrasser de ses dépendances, tout en poursuivant une
quête spirituelle (c’est le cas pour Yann et Philippe) et avoir tenté préalablement ou
postérieurement d’autres techniques (c’est le cas de Philippe qui a fait un stage à
l’ayahuasca en Espagne un an après son initiation gabonaise au bwiti et qui suit
aujourd’hui une formation en sophrologie). Enfin, quelques personnes s’initient pour
des raisons « professionnelles » afin de tenter de comprendre et de restituer les
mécanismes de l’initiation (psychothérapeutes, anthropologues ou cinéastes).
Une pratique touristique marginale
10 Les déplacements d’Occidentaux à l’étranger en vue de se faire « initier » à un rite local
diffèrent des voyages classiques. Ils se rendent directement dans le village ou dans la
famille qui les initiera, ne fréquentent ni les hôtels, ni les restaurants, ne visitent
généralement pas le pays, et repartent une fois leur initiation terminée15. Marginales16,
ces pratiques reposent sur un petit réseau d’acteurs qui proposent sur Internet des
séjours « clés en main » comprenant la prise en charge de la personne à l’aéroport de
Libreville, une initiation, l’hébergement, la restauration, et éventuellement une
excursion en forêt « primaire » après l’initiation. Malgré les spécificités de ce tourisme,
soulignons qu’il se rapproche d’autres pratiques comme le tourisme de désert (Cauvin
Verner 2007) et d’aventure (Boutroy 2006). Les dimensions d’épreuve, de danger, de
mort17, de performance, de souffrance, d’ascétisme et de mysticisme qui se révèlent de
manière très prégnante dans les discours et le vécu de ces initiés, ne leur sont
cependant pas spécifiques. De même, l’aspect rituel et initiatique du tourisme,
largement analysé par les anthropologues (Ebron 2000 ; Graburn 1989), se retrouve
dans de multiples pratiques touristiques.
11 Mais une question demeure concernant l’aspect touristique de cette quête de guérison
et d’éveil spirituel : Pourquoi se déplacer alors que le but est un « voyage intérieur »,
donc immobile ? En d’autres termes, pourquoi des personnes ayant suivi à côté de chez
elles un stage de développement personnel à l’iboga — avant son interdiction en
France18 — se rendent-elles ensuite au Gabon en devenant ainsi touristes19 ? Les raisons
données par les initiés varient, mais il semble que réaliser une initiation « dans les
règles de l’art » (Yann), dans son contexte local, serait un gage d’authenticité :
« J’avais vraiment envie de découvrir la tradition bwitiste dans son essence, sonorigine [...] complètement libéré, et puis sur une terre chargée, en Afrique, auGabon, et puis avec des experts, des personnes dont c’est la fonction pleine »(Yann, entretien février 2008, Paris).
12 On assiste également à ce que l’on pourrait appeler « une mode du chamanisme » sans
que ce terme soit bien défini20 ni géographiquement identifié. Des ouvrages témoignent
d’expériences d’individus citadins européens « initiés » au fond d’une forêt « primaire »
•
•
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
339
d’Afrique ou d’Amazonie (Navarro 2007 ; Ravalec et al. 2004 ; Sombrun 2002) ou devenus
« chamanes » (Kharitidi 1998 ; Sombrun 2004). Ces ouvrages pouvent être considérés
comme les héritiers de ceux de Castaneda (2002), qui est d’ailleurs cité souvent comme
un inspirateur par ces nouveaux initiés. Par ailleurs, le chamanisme attire de plus en
plus ceux qui s’intéressent à la psychanalyse et les psychothérapeutes eux-mêmes
(Laval-Jeantet 2006, Séjournant 2001). Les ouvrages d’anthropologues décrivant et
analysant leur expérience initiatique sont également nombreux (Bonhomme 2005 ;
Harner21 1990 ; Narby 1995). Si les pratiques se développent, le tourisme chamanique
est aussi un sujet de reportages ou de documentaires, au Gabon (Cheyssial ; Laval-
Jeantet 2003 ; Chabloz 2009), au Mexique (Chartier 2005-2006), au Pérou (Cheyssial
2002), au Brésil22, en Mongolie (Merli 2009).
13 Le retour du « chamanisme », traditionnellement associé aux « peuples primitifs »
s’observe également de façon plus marginale en France (Pellarin 2006). Ainsi Patrick
Dacquay, ancien homme d’affaires d’origine bretonne désormais acquis à « la tradition
des druides solitaires », propose-t-il un « chamanisme occidental »23, des conférences et
des formations, ainsi que des « voyages initiatiques » au Maroc, en France et au
Québec24.
Entre France et Gabon, les initiateurs du tourisme mystique
14 Les initiateurs et les promoteurs de l’iboga et du bwiti en France depuis quelques
années proviennent de milieux différents. Certains d’entre eux peuvent être considérés
comme des « intermédiaires culturels » (cultural brokers). Ce sont quelques Gabonais
vivant en France, des Français installés au Gabon, des personnalités issues de l’univers
culturel tels que l’écrivain Vincent Ravalec ou le réalisateur de cinéma Jan Kounen25. À
travers notamment les stages qu’ils proposaient en France, des Français ont également
grandement contribué à la connaissance dans l’hexagone de l’iboga et du bwiti, mais,
aussi, d’une certaine manière à sa reconnaissance au Gabon. En participant à de
nombreuses émissions diffusées sur la télévision gabonaise, Yann aurait contribué,
selon lui, à une réappropriation de ce rite par les Gabonais. En France, la médiatisation
du bwiti et de l’iboga a été relativement importante : télévision26, radio27, cinéma28,
Internet, littérature grand public29 ou scientifique, conférences 30, manifestations
culturelles31.
15 Hermann Nzamba, dit Mallendi, a créé en 2003 l’association culturelle Eboka, dont
l’objectif est de promouvoir et d’assurer la sauvegarde des savoirs traditionnels
gabonais et plus particulièrement la médecine traditionnelle. Cette association permet
sa promotion en France (Moussadji 2004 : 20), relayée par VSD, L’Express, un film-
documentaire sur Arte, deux livres32 dont il est le co-auteur. Mallendi va ensuite créer
un village culturel au Gabon, à Panga (près de Gamba, dans le département de la Basse-
Banio), pour organiser des stages d’initiation au bwiti pour des Occidentaux. Ils font le
voyage en petits groupes, ils étaient une soixantaine à partir entre 2003 et 2004. En
septembre 2006, Mallendi affirme « avoir donné l’iboga » à plus de mille cinq cents
personnes en France, qui seraient venues à lui sur recommandation d’un proche33.
Selon Yann, beaucoup de candidats à l’initiation entreprennent une démarche après
avoir vu un film documentaire, lu un livre sur le sujet, mais surtout après avoir
consulté les sites Internet d’associations gabonaises ou franco-gabonaises qui vendent
« une initiation clé-en-main ». Ces associations, selon Yann, « montrent le beau côté des
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
340
choses mais pas l’envers du décor, on ne prévient pas non plus des risques34 ». Deux ou
trois associations ont pignon sur Internet, et ce sont principalement vers elles que se
dirigent les Français, rassurés par leur visibilité, et les témoignages de précédents
initiés qui ont souvent vu leur vie changer positivement grâce à cette initiation.
D’autres initiateurs n’ont pas de site mais bénéficient d’une médiatisation auprès du
public français par d’autres voies (bouche à oreille, films documentaires, livres).
Certains ont créé une sorte de « tourisme de groupe » (comme Mallendi à Panga).
Secrétaire général de la commission nationale du Gabon à l’Unesco, Jean-Marie Vianney
Bouyou se présente ainsi comme un « facilitateur », ayant pendant deux ans fait office
d’intermédiaire entre une « prêtresse » locale du bwiti et une quarantaine de Français
(quatre voyages par an regroupant six personnes). Pour lui, la venue de Français au
Gabon, est la preuve que « nous sommes dans la mondialisation, c’est une forme de
reconnaissance, les Occidentaux ignoraient, maintenant ils viennent, ce sont des
signaux que le monde s’ouvre »35. Son rôle de facilitateur s’inscrirait selon lui dans la
philosophie de l’Unesco qui « prône la diversité culturelle, l’échange interculturel »36.
Images du primitif
16 Les représentations liées au primitif de ces Français qui partent au Gabon s’initier au
bwiti, et dans une moindre mesure à l’ayahuasca au Pérou apparaissent déjà en
filigrane à travers leurs motivations. Nous allons tenter d’en dresser un panorama qui
n’a pas la prétention d’être exhaustif mais qui a l’ambition d’apporter un éclairage sur
ses différentes acceptions par les touristes et les « médiateurs », telles qu’elles
apparaissent dans leurs discours et, de façon plus marginale, dans leurs pratiques. Si les
notions de « primitif » et de « primitivisme » pour qualifier des hommes, un art ou des
sociétés posent problème et peuvent être considérées comme un « fourre-tout
épistémologique, une catégorie artificielle où l’on rangerait, par commodité les
réfractaires » (Blachère 1996 : 18), nous verrons dans quelle mesure ces différentes
acceptions sont liées et se contredisent en apparence.
La terre africaine, berceau de l'humanité
17 Aller au Gabon pour se faire initier est souvent considéré comme un retour aux origines
de l’humanité. C’est d’abord la forêt gabonaise « des origines, pas une forêt replantée »,
dont l’homme est issu et dans laquelle pousse l’iboga, qui « va avoir un rôle
prépondérant dans l’expérience du futur initié » (Ravalec et al. 2004 : 15). À partir de la
forêt « primaire » et « originaire » gabonaise, c’est le continent entier qui est considéré
comme la terre d’où proviennent nos ancêtres (ibid. : 95). Dans un autre ouvrage, le
même auteur considère que le caractère primitif37, « archaïque » de l’Afrique est le
facteur explicatif d’un ressenti plus « profond » qu’en Amazonie concernant ses
expériences initiatiques (Ravalec, dans Kounen et al. 2008 : 84). On retrouve cette vision
d’une « terre chargée » gabonaise et africaine dans les motivations qui ont poussé Yann
à aller se faire initier au Gabon après ses expériences à l’iboga en France (voir supra).
18 De la terre, s’opère ensuite un glissement vers la plante, l’iboga. Plante poussant et
absorbée sur la terre africaine, l’iboga « confronte vraiment à la naissance de
l’homme », « fait entrer dans la mémoire de l’espèce », et permet de faire un travail
« plus en profondeur » que l’ayahuasca, en « décortiquant » l’initié « cellule après
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
341
cellule ». La primitivité de la plante — apparaissant comme personnalisée, avec une
volonté propre — qualifiée de « sauvage » et de « barbare » expliquerait la nature
« terrifiante et archaïque » des visions qu’elle procure aux hommes (ibid. : 91, 155).
19 La perception primitiviste de la terre, de l’iboga, des visions, glisse vers celle des
hommes, les autochtones, désignés comme les « frères » mais également comme les
ancêtres38 des Occidentaux (ibid. : 155).
Le « chamane » ancêtre et gardien des traditions
20 Le chamane, le nganga (guérisseur) au Gabon, semble incarner l’ancêtre de l’humanité
grâce à sa connaissance des mystères de la nature qui guérit et des états modifiés de
conscience, connaissance que l’Occident possédait avant sa modernisation, mais qu’il a
perdu (Navarro 2007 : 147-148). Les expériences chamaniques auraient la particularité
de remonter aux origines de l’humanité, à « l’époque de Cro-Magnon [...] dans les
grottes en Dordogne »39 (Kounen et al. 2008 : 34) et de permettre tout à la fois un « bond
dans la conscience collective » et un voyage dans le passé (ibid. : 22, 155).
21 De la vision primitiviste de l’homme africain (et amérindien), le glissement se fait à ses
traditions, et notamment à ses rites initiatiques, le bwiti.
Le bwiti, « tradition primordiale »
22 La grande majorité des Occidentaux venant se faire initier au Gabon choisissent des
initiateurs pratiquant un bwiti fang syncrétique40, car, pour des raisons historiques,
c’est celui qui s’est implanté à Libreville et dans la région de l’Estuaire (Mary 1999 :
25-26). Rares sont ceux qui prennent le risque de parcourir les pistes défoncées et
souvent inondées menant chez les Pygmées (Navarro 2007), perçus comme les « vrais »
détenteurs du savoir lié à l’iboga. Il est intéressant d’observer de quelles manières les
touristes négocient entre des nécessités pragmatiques et leur recherche d’authenticité.
Les initiateurs qui attirent le plus souvent les touristes vivent à Libreville et pratiquent
un bwiti souvent revisité façon « New Age ». L’aspect syncrétique d’un rite, surtout
lorsqu’il est connoté « religieux » et « catholique » rebute les touristes :
« Au début j’étais un peu choqué, voire déçu par la surreprésentation de symbolesreligieux, plutôt orientés catholiques, beaucoup d’ailleurs le sont. J’ai discuté avecpas mal de Français qui ne veulent pas aller dans le Disumba parce qu’ils trouventque c’est du mimétisme de rites catholiques et ils cherchent quelque chose dansl’esprit du traditionnel, qui répond plus à nos clichés, de ce que l’on se fait commeimage des rites africains, entre guillemets sauvages, quoi » (Yann, entretien filmé,février 2008, Paris).
23 Ce rejet est également exprimé par Philippe, qui n’a pas choisi le même initiateur que
Yann (maître Atome Ribenga) — qui lui avait pourtant été conseillé — justement du fait
de son syncrétisme affiché ; les « images de Jésus partout, les croix et tout ça » l’ont fait
fuir. Philippe a par ailleurs exprimé le même rejet lors de la veillée qui clôturait son
initiation (Chabloz 2009), seul moment, chez ces initiateurs (Christophe et Marie-Claire)
où sont apparus des signes à connotation catholique. Pourtant, même ceux qui ont
choisi de se faire initier, comme Yann, dans un bwiti syncrétique, trouvent matière à
satisfaire leur envie de primitivisme historique. En effet, la tradition bwitiste est
souvent décrite, et notamment dans le livre d’Atome Ribenga, pratiquant un bwiti fang
syncrétique, comme plongeant « ses racines dans les civilisations anciennes. Elle
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
342
proviendrait de la civilisation égyptienne qui est d’essence noire » (Meyo-Me-Nkoghe
2004 : 7). Cette tradition, une « sousbranche de la tradition primordiale » aurait été
transmise par les Pygmées (Ribenga 2004 : 16). Si, dans le bwiti fang, l’apport chrétien
est systématiquement travesti en redécouverte d’une tradition originelle (Mary 2000 :
192) par les maîtres initiateurs, cette représentation — teintée d’afro-centrisme —
d’une tradition « primordiale » qui aurait échappé aux influences extérieures (Ribenga
2004 : 19-20) est intégrée et relayée par certains initiés, comme Yann. Il considère que
« le Disumba est universel, ceux qui disent que c’est syncrétique c’est plutôt en vue de
discréditer un rite qu’ils ne connaissent pas »41. Il trouve par ailleurs un intérêt non
négligeable à l’universalité des symboles rencontrés dans le bwiti fang : « Je suis baptisé
catholique, ça m’arrange bien quand même aussi, car en France je peux retrouver
certains symboles et repères qui me permettent de me reconnecter avec ce que j’ai vu
au Gabon. »
Le primitif du futur/le primitif archaïque, ou « les derniers seront les
premiers »
24 Cette tension entre pragmatisme et désir d’authenticité se retrouve bien dans le choix
de l’initiateur de la part des touristes. D’un côté ils désirent bénéficier d’une prise en
charge rapide à leur arrivée à Libreville, ils ont besoin d’être rassurés par des
témoignages d’anciens initiés (qui se trouvent sur les sites Internet), et ils veulent être
certains que leur initiation réussisse (avoir des visions qui permettent de guérir et de
voir l’au-delà) ; d’un autre côté, ils veulent avoir accès à un bwiti qui corresponde à
l’idée du « rite traditionnel africain » qu’ils s’en font. Entre l’initiation chez les Pygmées
(authentiques mais trop difficiles d’accès et connus pour donner peu d’iboga ce qui
peut entraîner une absence de visions) et le bwiti syncrétique fang (proche mais pas
assez authentique du fait du symbolisme jugé trop catholique), s’offre une troisième
voie, une sorte de consensus pour les touristes : un bwiti revu et corrigé qui semble être
relativement adapté aux attentes des Occidentaux. Christophe et Marie-Claire, couple
franco-gabonais vivant dans une grande concession à 12 km de Libreville, proposent
ainsi un « bwiti sans interdits ni obligations, qui ne suit ni la voie disumba, ni celle du
misoko, mais la route du bois sacré »42. Cela signifie notamment qu’ils proposent une
initiation permettant une guérison thérapeutique en même temps qu’une recherche
mystico-spirituelle. Dans ce bwiti, on ne s’embarrasse pas des « accessoires »
symboliques que l’on retrouve traditionnellement dans le bwiti43, ni des « histoires liées
à la sorcellerie ». Christophe et Marie-Claire ne souhaitent d’ailleurs plus initier des
Gabonais mais préfèrent les Européens — qu’ils considèrent plus « simples » — pour
leur « élargir la conscience ». Avant d’initier les Européens au bwiti, le couple franco-
gabonais a expérimenté d’autres techniques, notamment de « visualisation, comme le
reïki et le kofutu » dont il s’aide encore aujourd’hui44.
25 Sans développer plus en profondeur les liens qui existent entre chamanisme et New Age
(Vazeilles 2003), entre bwiti et New Age (Bonhomme 2008) et la pénétration de ce
mouvement en Afrique (Simon 2003), il semble que le discours développé autour de ce
bwiti du consensus parvienne à convaincre et à rassurer les candidats à l’initiation qui
se retrouvent en terrain connu, tant il s’avère proche de celui généralement adopté par
les nouvelles thérapies de la « nébuleuse mystico-ésotérique » (Champion 1990 : 17-69)
qui se sont largement répandues aux États-Unis puis en Europe depuis les années 1960.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
343
Ce qui nous intéresse ici est que l’une des caractéristiques de l’invention religieuse de la
nébuleuse mystique-ésotérique, selon Françoise Champion « relève d’un privilège
donné au sujet des affects contre le sujet de la raison qui, à travers la filiation de la
contre-culture des années 60-70, renoue avec les diverses protestations contre la
modernité, peu ou prou inspirées de la tradition romantique » (Champion & Hervieu-
Léger 1990 : 12). La figure du primitif apparaissant dans les discours des acteurs de ce
tourisme mystico-spirituel et thérapeutique semble également relever d’une forme
d’anti-intellectualisme et de contre-culture qui sont toutes deux des protestations
contre le monde occidental.
26 Le primitif, caractérisé par ses émotions plutôt que par sa raison (Jewsiewicki 1991 :
192), sert à dénoncer, à l’instar des philosophes postnéopositivistes (Atlan 1986 : 16), les
illusions d’une science toute puissante, illusions qui seraient à l’origine des résurgences
du mysticisme et de l’irrationnel. Le primitif moderne incarné par la figure du « non
civilisé » (en opposition à l’Occidental) représenterait une alternative aux normes
contraignantes occidentales et permettrait de s’en affranchir. Le primitif n’est plus en
retard sur le monde occidental, tel qu’il était perçu pendant la colonisation, il est
désormais — et ce depuis l’Entre-deux-guerres avec les surréalistes — « en avance » :
« Les indigènes sont en avance par rapport à nous sur certains territoires de la
cognition pure, des relations interespèces, sur les façons d’appréhender et de
comprendre les phénomènes liés à la mort et aux phénomènes sensibles » (Kounen,
dans Kounen et al. 2008 : 14). La terre, la forêt abritant ce primitif du futur n’est pas
uniquement considérée comme « le berceau de l’humanité » mais fait l’objet d’une
représentation ultra-moderne (Ravalec 2004 : 15). La « tradition primordiale » du bwiti
est également adaptable à la modernité. Selon l’initiateur Christophe, le nouveau bwiti,
le « bwiti du troisième millénaire est arrivé en l’an 2000, avec les portables, Internet,
etc., le contact avec la plante est beaucoup plus rapide ». L’initiation a été réduite à
deux semaines « parce que les Européens n’ont pas le temps ». Ce bwiti moderne se
caractérise notamment par l’absence de certains rites (comme le sacrifice d’animaux),
de certains accessoires (plus nécessaires « car le bois sait où il doit aller »), et par la
transparence45, en opposition à la tradition du secret qui entoure habituellement le
bwiti. La modernité de ce bwiti réside également selon Christophe dans le fait de
parvenir à « 100 % de réussite dans l’initiation » (pas question qu’un Européen qui a
payé cher son billet d’avion reparte sans avoir eu de visions). Les nouvelles techniques
d’initiation pour y parvenir lui ont été transmises « à travers des révélations », et
consistent à « toucher directement le centre des visions et de mieux faire entrer le
bois »46. La plante, l’iboga, est également couramment associée à un outil de haute
technologie. Les discours selon lesquels l’Occident aurait tout à apprendre de l’Afrique
en général et des traditions en particulier reviennent de façon récurrente : « La Terre a
pensé à tout. Et que ce soit les soit disant “peuples primitifs” qui aujourd’hui nous
offrent une solution, quelle ironie (ça me fait penser les derniers seront les
premiers...) »47.
27 Il y aurait donc urgence, étant donné l’état du monde, à se rapprocher des « peuples
primitifs » qui acceptent généreusement de partager leurs connaissances, d’autant plus
que les techniques de guérison et d’éveil dont ils sont les gardiens permettraient « en
une nuit », de se retrouver « là où certains peuvent mettre 70 ans à arriver. C’est un peu
comme une analyse de 20 ans résumée en 3 jours »48.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
344
Le primitif au secours de l'Occident/le primitif mortifère
28 Dans les témoignages de personnes initiées il est majoritairement question de
guérisons spectaculaires. Yann déclare avoir été sauvé d’une mort certaine par le bwiti
et l’iboga et avoir également réussi à soigner sa mère qui souffrait de problèmes
psychiatriques depuis trente-cinq ans grâce à cette plante. Il a souhaité à un moment
donné « faire partager cette connaissance », pour aider ceux qui souffrent en Occident
(les dépendants aux drogues, à l’alcool, les dépressifs). Mallendi déclare vouloir
apporter une aide humaine, voire humanitaire au monde occidental en mettant « au
service d’une humanité en proie à ses démons, sa connaissance du Bwiti et de l’iboga »
(Moussadji 2004 : 20). Pour l’initiateur français Tatayo (cité dans Laval-Jeantet 2005 :
150), « le Bwiti est une des portes de salut de l’humanité ».
29 Mais quelques années après le début de la médiatisation du bwiti en France et le début
du tourisme mystico-spirituel et thérapeutique au Gabon, cette représentation
enchantée des rites initiatiques africains qui viendraient désormais au secours de
l’Occident après avoir été attaqués par les missions et la colonisation (et qui continuent
à l’être notamment par les Églises évangélistes) est remise en cause, notamment après
l’interdiction de l’iboga en France suite au décès d’un Français49. Ce désenchantement
se perçoit dans le discours de Mallendi. Il considère que « si la France interdit l’iboga
ici, on le prendra comme si la France était en train de renier le Gabon », que « l’échange
culturel doit aujourd’hui être vu dans les deux sens »50. Après son premier livre
enthousiaste sur le bwiti et l’iboga paru en 2004, on perçoit une nette remise en
question chez l’écrivain Vincent Ravalec qui émet des « réserves » concernant
l’initiation à l’iboga (dans Kounen et al. 2008 : 154, 174). L’observation du parcours de
Yann et de Philippe montre également quelques années après leur initiation une prise
de distance critique, comme nous le verrons plus loin. Cette image de régénération par
le primitif fait place à (ou va de pair avec) l’image du primitif mortifère.
Le primitif mortifère
30 L’opinion publique française découvre en 2006 à travers des faits divers que des
Français s’initient à des rites gabonais en France et au Gabon51 et que certains en
meurent. Ces événements donnent lieu à des articles de presse52, suivis d’une
polémique et finalement de l’interdiction de l’iboga en France, classée comme
stupéfiant de catégorie IV. La plante iboga, celle qui doit sauver l’Occident, est
désormais perçue comme une « plante tueuse ». Le bwiti est quant à lui signalé dans le
rapport de 2007 de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les sectes
(Miviludes) comme pouvant relever de dérives sectaires. Ces faits divers ont ceci
d’intéressant qu’ils activent à eux seuls la représentation de l’Afrique comme étant à la
fois « le berceau et le tombeau de l’humanité » (Amselle 1991 : 7).
31 Le caractère mortifère associé au primitif et à ses traditions est double : ils peuvent
apporter la mort et ont également la capacité de donner accès au monde des morts.
Pouvoir communiquer avec les morts, « voir la mort » constitue l’une des motivations
essentielles des personnes qui viennent se faire initier. En mangeant l’iboga, les initiés
auraient la possibilité de « rencontrer des parents décédés afin de régler post mortem
ce que leur mort avait laissé en suspens » (Bonhomme 2005 : 41). Pour les initiés,
apprendre à mourir est bien le but de toute initiation (Kounen, dans Kounen et al. 2008 :
180). Le thème de la mort revient dans tous les discours des initiateurs : il s’agit de
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
345
mourir symboliquement pour mieux renaître sur le plan spirituel (Ribenga 2004 : 35).
Selon Marie-Claire, initiatrice, le sentiment de mourir que les initiés éprouvent dans le
bwiti permet de voir la mort et, conséquemment, d’en avoir moins peur.
Le primitif universel/ relativisé
32 Le primitif, le chamane, n’est pas seulement l’être lumineux qui fait le bien de
l’humanité et veut sauver l’Occident, il est également perçu comme un être trouble et
ambigu. L’ambivalence des représentations liées au chamane montre que les initiés
projettent tour à tour sur ce personnage des désirs d’« universalité »53 et des
sentiments que l’on pourrait qualifier de « relativistes ». D’un côté, le chamane incarne
une conception du monde et particulièrement de la santé unifiée, « holistique » : le lien
« corps-esprit », ignoré par la médecine occidentale est préservé par le chamane
(Yann), il permet d’abolir la distance entre l’homme et Dieu entretenue par les religions
traditionnelles, enfin il incarne la réconciliation de l’homme avec la nature, dont il a
été séparé par l’urbanisation et la modernité54. Le chamane, le nganga, permettrait
d’accéder à une « Unité Originelle » (Atlan 1986 : 16)55, de se sentir relié à ses
semblables au sein d’une « conscience collective planétaire » (Navarro 2007 : 19) grâce à
la tradition bwitiste présentée comme « une branche de la tradition spirituelle
originale » (Ribenga 2004 : 16).
33 De l’autre côté, les initiés évoquent le fossé culturel et « psychique » qui existerait entre
Occidentaux et autochtones : ils n’auraient pas le « même système conceptuel » ni la
même organisation de « la psyché » (Ravalec, dans Kounen et al. 2008 : 58-59), raisons
pour lesquelles l’initiation d’Occidentaux à des rites locaux peut être dangereuse. Sont
évoqués le caractère « perfide et assez terrible » du « monde chamanique ayahuasca »,
la sorcellerie omniprésente, les jalousies entre chamanes, ainsi que les « situations
d’attaques chamaniques négatives », qui peuvent entraîner déprime et déséquilibre
durables chez les initiés. Contrairement au « sage » indien, dont la compassion pour
son prochain proviendrait du fait qu’il soit un religieux, le chamane est perçu comme
un guérisseur traditionnel qui travaille « avec des forces plus sourdes et négatives »
(Kounen et al. 2008 : 75, 78).
Le primitif communautaire / individualiste
34 La figure du chamane est souvent associée à une dimension communautaire : c’est celui
qui préserve aussi bien la santé que l’harmonie au sein de la communauté villageoise en
incarnant notamment le lien entre les hommes et les entités invisibles. Il peut sembler
paradoxal que des Occidentaux, impliqués dans une recherche spirituelle individuelle56,
se tournent pour la réaliser vers des chamanes ou des nganga pour accéder à un rite
initiatique dont ils ont une représentation « communautaire ». Si l’on suit la réflexion
de certains chercheurs ayant travaillé sur le bwiti, ce paradoxe n’en est pas un car « En
réalité, le Bwiti est aussi bien adapté à l’individu qu’au groupe social au sein duquel il se
développe » (Binet 1974 : 40). L’expérimentation directe avec le divin séduit les
personnes en quête de spiritualité, qui rejettent tout à la fois le dogmatisme des
religions traditionnelles et la rationalité de la société occidentale (ibid. : 41-42).
35 L’aspiration des Européens à une forme réinventée et individualisée du sacré à travers
un rite initiatique étranger et perçu comme communautaire peut être interprétée
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
346
comme un rejet du « sacré domestique » au profit du « sacré sauvage » (Bastide 1975).
Pour Bastide, le sacré domestiqué est un sacré collectif, résultant d’une organisation et
d’une cohésion de groupe qui partage les mêmes croyances et valeurs, tandis que le
sacré sauvage se veut une expérience hors normes se vivant de manière isolée dans des
sociétés hétérogènes. Cette expérience permettrait aux « jeunes générations » de rester
« dans la ferveur de l’instituant sans aller jusqu’à la constitution de nouveaux
institués » (ibid. : 227). Ainsi, ce qui peut paraître paradoxal dans cette démarche de
tourisme mystico-spirituel, s’intégrerait dans une certaine logique car la recherche de
« sacré sauvage » ne pourrait « se préciser que par l’utilisation de formes archaïques
significatives » (ibid. : 234), dans la mesure où cette forme de sacré ne peut prendre
assise que sur une forme de sacré « institué ».
36 Ainsi, le bwiti, également nommé « la religion de l’Eboga » (Bureau 1972) permettrait
aux Occidentaux en quête de sacré sauvage, d’entrer directement en communion avec
le divin, d’être en harmonie avec soi-même, les autres et son environnement et, — ce
qui serait sa « valeur ajoutée » sur le marché des religions mondiales — de voir le passé,
et de prévoir l’avenir57 (Meyo-Me-Nkoghe 2004 : 8). Par ailleurs, si la perception
communautaire de cette religion et de cette plante réside dans le fait qu’elles
permettent de se sentir connecté au reste du monde (la conscience planétaire), elles
sont surtout connues et perçues comme permettant à l’individu de réaliser une plongée
au plus profond de lui-même. Tout se passe comme si la représentation primitiviste du
chamane, de sa tradition et de l’iboga était liée à celle selon laquelle ces derniers
permettraient d’avoir accès au primitif qui est en nous, l’inconscient profondément
enfoui, en quelque sorte « notre primitif intérieur ».
Le primitif intérieur
37 Les visions procurées par l’iboga permettraient même58 de réaliser un « voyage au sein
de son propre ADN » (Geerte Frenken, cité dans Bonhomme 2008 : 15). Les visions
seraient ainsi un moyen (comme les rêves) pour l’Homme moderne de retrouver ses
origines, refoulées, inscrites dans son inconscient. L’idée selon laquelle l’histoire de
l’humanité est inscrite dans notre complexion psychique et qu’il existe un inconscient
collectif, où les symboles attachés aux rêves (et aux visions) sont identiques pour tous
— l’Homme gardant dans son inconscient le souvenir émotif de ses ancêtres — se
retrouve souvent dans les discours des initiés comme des initiateurs. J.-C. Cheyssial
dans son documentaire La guérisseuse de la forêt (2003) montre un Italien se faisant
initier par Bernadette Rébienot, n’étant jamais venu en Afrique et ne parlant aucune de
ses langues avoir une vision « où un esprit de la forêt se présente à lui en langue
tsogho », que l’initié prononce parfaitement. Pour Bernadette Rébienot l’initiatrice, ce
fait n’est pas étonnant, car « les êtres humains sont identiques ». L’iboga, ingérée en
dose « sub-toxique » permet d’effectuer un « voyage à travers les zones inexplorées de
la conscience qu’elle soit individuelle ou collective » (Cheyssial 2003)59.
38 Il est intéressant de faire un parallèle entre les représentations liées au primitif des
acteurs de ce tourisme mystico-spirituel avec celles des surréalistes. Tous considèrent
que le « primitif » est le négatif de l’Homme moderne occidental, dans le sens où il
n’appartient pas à la même culture rationnelle et qu’il est mu par des forces
inconscientes. En s’inspirant de son exemple, l’Homme occidental pourrait s’affranchir
du rationalisme de sa société et avoir « accès à la voie royale » de l’inconscient, grâce
aux rites initiatiques primitifs pour les premiers, et aux œuvres de l’art primitif pour
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
347
les surréalistes. Initiés, initiateurs et surréalistes partagent la représentation de cette
figure du primitif « mythique et terminale à la fois, d’une humanité réconciliée avec
elle-même, restaurée dans ses pouvoirs psychiques originaires » (Sabot 2003 : 7).
39 Notons que si, dans le cas du surréalisme, c’étaient surtout les objets (masques, statues,
etc.) qui fascinaient et inspiraient les artistes primitivistes, dans le cas des Français
s’initiant au bwiti, le « media », « l’entité intermédiaire » (Tatayo, cité dans Laval-
Jeantet 2005 : 151) ou le « catalyseur » primitif change. Il n’appartient plus au domaine
matériel mais végétal. C’est désormais une plante locale, l’iboga, considérée comme
primitive car utilisée par les Pygmées depuis la nuit des temps, qui fascine et permet
aux initiés de plonger à l’intérieur d’eux-mêmes pour découvrir le « primitif » en eux.
Pour les touristes mystiques, comme pour les collectionneurs d’art primitif, l’objet/
l’iboga est « clairement un ailleurs : géographique, temporel, mental » (Derlon & Jeudy-
Ballini 2008 : 59).
Logiques de ces représentations
40 Nous avons vu, à travers les discours des acteurs de ce tourisme mystico-spirituel et
thérapeutique de quelle façon la notion de primitivité est appliquée à la terre africaine
et à la forêt gabonaise, à la plante iboga qui pousse sur cette terre, aux Hommes, et plus
spécifiquement au nganga qui incarne la figure mondialisée du chamane, et par
extension, à ses traditions millénaires, comme le rite initiatique du bwiti. Dans un
deuxième temps, nous avons montré comment ces représentations semblaient, à
première vue paradoxales, associant tour à tour une vision du primitif moderne et
archaïque, salvateur et mortifère, universel et relativiste, communautaire et
individualiste, intérieur et extérieur. Ces représentations sont pour certaines d’entre-
elles fidèles à la notion de primitivité appliquée aux sociétés non occidentales (en
premier lieu amérindiennes) datant du XVIIIe siècle et reposant sur l’idée
évolutionniste que les sauvages sont les ancêtres sociaux des « civilisés », dont ils
figurent un stade de développement révolu (Taylor 2000). On retrouve également dans
les discours une idée du primitivisme proche de l’anthropologie du XIXe siècle selon
laquelle l’écart entre sauvages et civilisés est d’ordre biologique, leur histoire est
commune mais leur « essence » et leur « destinée » diffèrent. Les « primitifs » sont
alors considérés comme étant plus proches des états originaires de l’humanité, tout
comme les sociétés archaïques auxquelles ils appartiennent sont perçues comme
primitives « non parce qu’elles sont “arriérées”, mais parce qu’elles incarneraient des
formes structurelles logiquement premières » (ibid.). Pour les acteurs de ce tourisme, le
primitif et sa société sont perçus à la fois comme « premiers »60, mais également comme
étant restés à l’écart de la civilisation industrielle occidentale, cette idée se traduisant
souvent dans les discours par l’appellation de « sociétés traditionnelles ». C’est cette
mise à l’écart de la société moderne, jugée comme rationnelle et aliénante, qui donne
aux sociétés traditionnelles l’image de gardiennes des traditions et des connaissances
des mystères de la nature et de l’Homme. La représentation liée au « sauvage »61 est très
fréquente, même si le terme n’est jamais employé par ces acteurs et désigne « moins
une catégorie ethnographique qu’une figure inversée de la civilisation occidentale
servant une fonction critique centrale dans la philosophie morale et politique »
(Descola 2000). Cette figure inversée de l’Occidental est mobilisée notamment par les
acteurs de ce tourisme, et avant eux par les surréalistes de l’Entre-deux-guerres, qui
ont grandement contribué à inscrire le primitivisme moderne « dans la lignée de
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
348
mouvements culturels et artistiques qui s’élaborent au tournant du siècle à partir d’une
commune réévaluation critique des schémas mentaux et esthétiques imposés par
l’Occident blanc et rationnel » (Sabot 2003 : 4). L’ambivalence des représentations liées
au primitivisme que révèlent les discours des acteurs de ce tourisme serait donc en
partie identique à celle qui a accompagné la construction et l’évolution de cette notion
depuis le XVIIIe siècle, de la part des philosophes, des anthropologues et des artistes
d’avant-garde. La diffusion massive, à partir des années 1960-1970 en Occident, de la
psychanalyse (et notamment celle de Carl Jung), du mouvement New Age et des
nouvelles techniques thérapeutiques liées à l’idéologie du potentiel humain a
également contribué à la réinterprétation du concept de « primitif » : tout en étant le
contemporain de l’Homme occidental, le primitif, contrairement à ce dernier, est perçu
comme l’incarnation du principe de l’humanité, ayant préservé sa spontanéité
première, ainsi que les liens avec la nature et avec son « moi intérieur »62. Ainsi le
primitif devient le modèle à imiter ; en s’inspirant de ses œuvres et de ses rites
traditionnels, l’Homme occidental pourrait trouver un remède à ses maux physiques
ainsi qu’au tarissement de sa spiritualité et de sa créativité.
41 Les représentations de l’Afrique et des Africains relevées dans les discours des acteurs
oscillent entre archaïsme et modernité. On a vu que ces représentations ne sont pas
propres à l’Afrique et peuvent s’appliquer à tous les continents où se pratiquent ces
formes de tourisme (Asie, Amérique, et même en Europe). Pourtant, l’Afrique est
souvent montrée63 et perçue comme le continent le plus « archaïque » et de ce point de
vue le plus à même de correspondre à l’idée de primitivisme moderne, notamment de
par l’imaginaire lié à son statut de « berceau de l’humanité » et de terre de
l’animisme64. Par ailleurs, le couple dichotomique archaïsme/modernité se retrouve
fréquemment dans les visions touristiques et ne sont pas exclusives du tourisme
mystico-spirituel et thérapeutique65. En revanche, ce qui semble caractéristique de
cette pratique, c’est que ces touristes ne s’inscrivent pas dans le registre du « voir » tel
qu’il est habituellement mis en œuvre dans le tourisme (visiter des lieux, prendre des
photos, assister à des spectacles), mais dans une démarche « participative » ; il s’agit en
quelque sorte d’expérimenter un rite traditionnel et d’absorber une plante pour
effectuer une « plongée en soi ». De ce point de vue, il est possible de dire que ces
touristes ont une pratique primitiviste (dans le sens où nous avons vu que leurs
motivations à l’expérimenter reposaient pour une grande part sur leur vision
primitiviste du chamane, du rite et de la plante). Nous avons observé que c’est lors de
cette pratique et après celle-ci, que les représentations liées au primitif des touristes
évoluent.
Représentations ambivalentes
42 L’analyse des discours tenus par les initiés et les initiateurs sur leur parcours initiatique
et l’observation directe dans le cas de Philippe montrent que le primitif, souvent « bon
sauvage » avant le départ et au début de l’initiation, devient archaïque, détestable ou
incompréhensible, à la fin de l’initiation (c’est le cas pour Philippe et Christophe), ou
plusieurs mois après (c’est le cas pour Yann et pour Vincent Ravalec, comme nous
l’avons vu plus haut). Christophe, l’initiateur, qui commente le « pétage de plomb » de
Philippe lors de la veillée (Chabloz 2009), avoue que lui non plus, lors de sa première
initiation, ne pouvait plus supporter les gens qui l’avaient initié : il les trouvait
« sales », et ne comprenait pas pourquoi « ils pensaient parfois plus à bouffer, alors
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
349
qu’il fallait penser au ciel ». Ces représentations négatives des autochtones seraient
dues, selon Christophe, à l’état « divin » dans lequel se trouve l’initié sous iboga, et fait
qu’il voit « tout le monde comme de la merde ». Christophe précise que cet état est
transitoire et qu’une fois que la « conscience s’est élargie », il devient possible de
comprendre que deux mondes peuvent cohabiter. Cet état transitoire de haine apparaît
également chez Philippe lors de la veillée de son initiation : il quitte la veillée au petit
matin, hors de lui et me confie ses impressions : il n’a pas supporté l’aspect syncrétique
de la veillée, ni les transes, ni la musique. Il n’a pas aimé non plus être « déguisé » en
guerrier misoko ni se sentir obligé de danser alors qu’il n’en avait pas envie. Il a eu
l’impression d’être « dans un asile de fous, chez les branques » et voulait « tout faire
sauter ».
« Ça a été une épreuve vraiment horrible, je te jure je vous aurais tous mis au feu,j’aurais eu une grenade, je vous aurais fait sauter, [...] je pensais des trucs méchants,j’ai jamais pensé ça, mais même par rapport à tout le peuple gabonais, je lesmaudissais [...]. Mais même à en être raciste, je me disais les Gabonais je vais lesdétester [...]. J’ai même écrit un mot à un moment donné, les Gabonais vous êtesstupides, bêtes, ignares, ça devrait être leur slogan national » (échange filmé entrePhilippe et son initiateur Christophe, le surlendemain de la veillée, juillet 2007,Libreville).
43 Après une nuit de sommeil (la première depuis quatre jours), Philippe considère que le
« racisme »66 qu’il a éprouvé la veille s’est complètement transformé en empathie
envers les Gabonais.
44 Philippe, quelques mois après son retour en France, décide de réaliser un stage à
l’ayahuasca en Espagne, expérience qu’il estime bénéfique et « beaucoup moins
violente qu’avec l’iboga ». Il décide également de se reconvertir professionnellement
dans la sophrologie et a commencé une formation dans ce sens. Deux ans après son
initiation au bwiti, il considère que la sophrologie lui convient mieux car cette
discipline est dépourvue de « discours ésotériques » et a une approche scientifique, et
qu’elle ne se réalise pas à travers des rites ni « des rapports de pouvoir entre initié et
initiateur » qui l’ont gênés pendant son initiation au bwiti67.
45 Nous n’avons pas suivi l’initiation de Yann, mais à travers le récit sur le long terme qu’il
fait de son parcours initiatique, il est possible de constater une évolution de ses
représentations concernant les autochtones. Il a, depuis le début de sa démarche
initiatique en 2006, une vision « salvatrice » des thérapies traditionnelles car le bwiti,
comme nous l’avons vu, lui a permis de régler aussi bien des problèmes physiques que
spirituels. Il s’est engagé dans une démarche qu’il est possible de qualifier de
« prosélyte » pour médiatiser le bwiti et ses vertus, en participant à des émissions de
télévision diffusées en prime time au Gabon, en réalisant un film diffusé sur son site
Internet, en effectuant des démarches pour tenter de structurer et de sécuriser les
soins apportés par les nganga gabonais. Yann, qui se sent mieux au Gabon qu’en France,
décide même de s’y expatrier en septembre 2008. C’est en vivant au Gabon depuis
plusieurs mois et en s’engageant dans un nouveau travail initiatique qu’il a le
sentiment de perdre pied. Il évoque un conflit avec son maître initiateur qui lui
demande de s’investir plus avant dans la démarche initiatique alors que Yann arrive en
fin de visa, a la responsabilité de ses enfants en France, et a besoin de retrouver un
travail d’urgence. Il ressent alors un fossé entre deux conceptions du monde, l’africaine
et l’occidentale, un problème « interculturel » entre lui et son initiateur. Pour Yann,
« l’Occidental matérialise », alors que « l’Africain spiritualise », et lorsque l’initié veut
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
350
retourner à sa « culture occidentale, et passer à la phase pratique de matérialisation
des connaissances », cela n’est pas compris par le maître initiateur et cette situation
peut provoquer des conflits. Yann évoque également les différences concernant
l’environnement social, la construction sociale du village, les rapports aux anciens, aux
parents, aux enfants. Selon Yann, les contraintes de vie des Africains ainsi que les
représentations qu’ils ont des Européens contribuent à la difficulté de compréhension
entre Français et Gabonais. Les problèmes des Occidentaux (séparation, perte d’emploi)
seraient par exemple vus comme des « caprices », comparés à leur combat quotidien
contre la mort et la maladie. Un Occidental est traditionnellement vu comme un « être
non spirituel donc presque animal »68, « capricieux », « matérialiste », « raciste ». Ce
« choc culturel » est aggravé par le rite initiatique qui va générer « des états modifiés
de conscience », « une perte de contrôle de soi ». Après quelques mois passés à
Libreville et après trois nouvelles initiations, il se sent perdre pied, il a maigri, il sent
qu’il vit un moment de « bascule » et qu’il doit reprendre « une vie occidentale »,
retrouver ses « priorités » (travail, enfants, famille), sous peine de « devenir comme les
Français demeurant au Gabon qui sont passés de l’autre côté et qui ne vivent qu’à
travers le bwiti ».
46 Neuf mois après notre premier entretien, Yann estime avoir terminé son « travail avec
la plante, l’iboga, le bwiti », être passé par des phases très difficiles (dépression,
impressions mortifères) et avoir pris « beaucoup de distance » avec « l’engouement »
qu’il avait « pour la tradition » : « J’étais un peu plus entre guillemets prosélyte, et
maintenant j’ai énormément tempéré mes ardeurs sur les bienfaits universels de cette
tradition et de cette connaissance. » Avec le recul, Yann estime que pour partir
s’initier, il est préférable d’avoir « un environnement stable ». Les personnes concevant
leur départ comme « une fuite », comme cela a été son cas (séparation d’avec sa femme,
perte de son travail), vont « se perdre encore plus ».
47 L’étude approfondie des parcours d’initiation et de vie de Philippe et de Yann montre
que leurs représentations du primitif évoluent en fonction des événements vécus et que
leur vision de l’Afrique, des Africains, de leur initiateur semble basculer au moment où
ils vivent une sorte de désenchantement lié à la pratique initiatique/touristique.
Comme nous l’avons vu plus haut, leurs visions du primitif sont ambivalentes : les
représentations qu’ils ont du primitif, tout d’abord « positives » (universel, salvateur,
intérieur, futuriste) se transforment au cours de leur parcours initiatique (à des
moments différents pour Yann et Philippe) pour être négativement connotées (le
primitif devient relativisé, mortifère, extérieur, archaïque). La nature ambiguë du
rapport au primitif de ces « touristes » à travers une « pratique primitiviste » peut en
quelque sorte être comparée avec celle des surréalistes. La primitivité « intérieure »,
dont le primitif « extérieur » fournit le modèle idéal aux surréalistes demeure
inaccessible en réalité, et en pratique. Cela conduit à penser qu’il est difficile, voire
impossible « de faire coïncider le lointain et l’originaire, le primitif-objet et le primitif-
sujet, le primitif tel qu’il est en réalité [...] et le primitif tel qu’il devrait être » (Sabot
2003 : 6).
48 Touristes comme surréalistes aspirent à mettre en œuvre une « pratique primitiviste »
pour « tenter d’entrer en “résonance intime” avec “soi”, c’est-à-dire de “redonner à
l’homme civilisé la force de ses instincts primitifs” » (ibid.). Tout comme les surréalistes,
ces touristes mystico-spirituels veulent être les nouveaux explorateurs de l’Homme,
grâce à la plongée en des territoires inconnus, ceux du subconscient, d’un monde de
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
351
l’invisible, à travers un discours qui mêle psychanalyse occidentale et rites initiatiques
primitifs à travers une plante.
49 On se rend compte ainsi de la profonde ambivalence des représentations concernant
l’Afrique des différents acteurs et médiateurs de ce tourisme mystique. D’un côté ils
sont fascinés par la richesse spirituelle de l’Afrique et pensent qu’elle peut venir sauver
l’Occident de ses maux, d’un autre côté, l’image du primitif, négativement connotée,
n’est jamais bien loin. Cette ambivalence peut se retrouver dans des écrits datant de
cinquante ans69 et nous rappelle à certains égards celle d’un ouvrage daté de 1960,
intitulé Les Noirs sauveront les Blancs, dans lequel le Docteur William Jacson, initiateur de
la « mission Lorraine-Congo » fait le compte rendu de son voyage entre Nancy et
Lambaréné. Au fil du récit, émaillé par la transcription de discussions avec des
Européens, surtout des missionnaires, sont évoquées tour à tour les considérations du
père Dhellemmes sur les Pygmées ou celles du père Moll sur les Fang du Cameroun. Les
premiers, considérés comme étant « une des races les plus anciennes » pouvant être
rattachée « à la civilisation la plus primitive »70 (ibid. : 331), sont vus comme de « bons
primitifs » (ibid. : 332). En revanche, les seconds, moins « sauvages », car déjà
corrompus par la civilisation, sont ceux qui ont « l’imperfection d’un primitif » (ibid. :
356). Et Jacson de conclure sur la seule phrase du livre qui pourrait justifier son titre :
« Les Occidentaux ont évolué si vite qu’il ne leur semble plus possible de revenir aux
sources de la vie et aux raisons de notre fin en soi. Nous savons comment réaliser ce
destin, mais nos forces morales sont épuisées. Il nous faut découvrir l’esprit neuf où
sera déposée la vérité, afin qu’elle puisse se développer et s’étendre. Le Noir, par son
existence retirée hors de nos civilisations, pourrait être cette dernière chance » (Jacson
1960 : 441).
*
50 Tantôt jugé comme destructeur des cultures et des traditions, tantôt considéré comme
étant sauveur de ces mêmes traditions, le tourisme peut être comparé de ce point de
vue au colonialisme dans leur rapport avec le primitivisme. En effet pour Jewsiewicki
(1991 : 193) — qui cite la théorie du « primitivisme déclinant » de Goldwater — la
colonisation, loin d’être la cause de la décadence artistique primitive, pourrait même
être à l’origine de sa régénérescence, dans le sens où, ce ne serait qu’après la
reconnaissance de la valeur esthétique des artefacts primitifs dans les années 1930 que
des projets de relance des arts nègres dans les colonies auraient été lancés, participant
ainsi à leur survie et à leur développement. L’ouverture aux Occidentaux de certains
rites traditionnels comme le bwiti, depuis toujours tenus secrets, serait la condition de
leur survie. En effet, les Gabonais seraient « occidentalisés à une vitesse record par
volonté politique » (Laval-Jeantet 2008 : 3), ce qui entraînerait la perte des savoirs
traditionnels dans la société urbaine gabonaise, et expliquerait la course à la
médiatisation qui anime certains nganga prêts à tout pour la survie du culte. Dans
d’autres parties du monde, comme en Mongolie, le tourisme aurait également permis le
renouveau du chamanisme, longtemps interdit par le système soviétique.
51 Les groupes culturels liés à ce chamanisme, dénigrés par la société dominante seraient
du coup revalorisés (Brunel 2006). Il n’est pas certain qu’au Gabon, le développement de
ce tourisme engendre une revalorisation des groupes sociaux et culturels liés aux rites
initiatiques comme le bwiti, souvent mal perçus par la société. Jean-Marie Vianney
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
352
Bouyou, secrétaire général de la commission nationale de l’Unesco estime que la société
continue de marginaliser ceux qui sont dans le bwiti pour des raisons politiques
(expression de la diversité nationale) et de concurrence religieuse (notamment avec
l’Église pentecôtiste), et que le bwiti a une chance de devenir universel s’il s’ouvre au
monde en sortant des villages, et en étant investi par les intellectuels. La revalorisation
par le tourisme des rites initiatiques des sociétés traditionnelles vient donc conforter
l’une des idéologies du tourisme culturel (qui préserve les cultures) véhiculées
notamment par l’Unesco et l’Organisation mondiale du tourisme (Cousin 2008).
52 Si l’idée selon laquelle l’intérêt des Occidentaux pour le chamanisme maintient
vivantes certaines traditions, est répandue parmi les acteurs de ce tourisme71, la
rencontre avec les autochtones est peu évoquée ou alors à travers un jeu en miroirs de
regards croisés. Les indigènes, fascinés par le mode de vie occidental, délaisseraient
leurs traditions alors que les Occidentaux, désabusés par le rationalisme et la
surconsommation de leur société, partiraient à la recherche de leurs valeurs archaïques
chez les peuples traditionnels. « Tout comme le chien qui court après sa propre queue,
le traditionnel veut expérimenter les progrès technologiques, et ceux qui vivent la
modernité dans son excès ont soif de simplicité et de retour aux sources » (Navarro
2007 : 66). D’autres évoquent la question du « quiproquo interculturel » entre un
Occidental et son nganga, comme nous l’avons vu plus haut pour Yann ; le guérisseur
comprend-t-il vraiment les motivations de ce nouveau patient ? se demande Marion
Laval-Jeantet (2008 : 4) qui explique que le « quiproquo stérile » qui peut naître serait
dû à la recherche de subsides par le nganga et sa volonté de « perpétuer une tradition
mise en danger par la progression d’une culture occidentalisée », et de l’autre « un
(im)patient qui ne perçoit pas nécessairement les logiques structurelles de cette
thérapie ui exige la croyance en un monde parallèle invisible ». Par ailleurs, la
rencontre entre le nganga et l’initié occidental tourne souvent au conflit car ce dernier,
contrairement à l’initié gabonais, ne se « soumet » pas à son nganga. Si quelque chose
lui déplaît dans l’initiation, s’il décide de l’interrompre, il le fait, comme Philippe, qui
est allé au bout de l’initiation mais qui a avancé son départ d’une semaine. Yann
explique qu’après son refus de continuer le travail initiatique, son maître initiateur
était tellement en colère qu’il a juré de ne plus jamais initier d’Européens, jugés comme
trop différents. Le « malentendu interculturel profond » sur lequel repose en partie les
rencontres résultant de cet « attrait ou de cette curiosité pour l’expérience
communautaire et extatique qu’offrent les cultes exotiques » (Mary 2000 : 196) serait
dû, selon plusieurs observateurs, au fait que les contraintes touristiques des Européens
ne leur permettent pas de vivre assez longtemps au Gabon pour « gagner la confiance »
des autochtones et pour comprendre la culture du pays. Le fait que les candidats
européens à l’initiation passent souvent par des initiateurs français pourrait ainsi
s’expliquer par la nécessité de compenser le manque de temps nécessaire pour gagner
la confiance d’un Gabonais. Les Blancs qui proposent une initiation à des Blancs
fourniraient ainsi « une technicité suffisante pour leur offrir quelque chose qui leur
convient, mais l’échange est moindre »72. La « compréhension culturelle » ne pourrait
se faire que sur le long terme car « elle repose sur une logique de confiance, qui
nécessite une imprégnation forte de culture et qui rend l’initiation plus accessible »73.
La plupart des Européens se faisant initier par Tatayo et Christophe, deux Français,
pour des raisons en partie pragmatiques, comme nous l’avons vu, amène certains à
considérer que la « rencontre avec l’Africain ne se fait pas »74. Mais cette rencontre est-
elle vraiment recherchée par les Européens ? La pratique consistant à s’initier tendrait
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
353
à ne plus avoir besoin de l’autre pour se connaître et se découvrir. Si l’idée souvent
avancée selon laquelle « l’identité a besoin de l’altérité pour se réaliser et s’affirmer
dans l’aperception de ce qu’elle n’est pas » (Debray cité dans Gonseth et al. 2002 : 270), il
est possible d’avancer qu’à travers cette forme de tourisme, la rencontre avec l’autre
n’est plus essentielle, c’est l’iboga qui est censée faire découvrir qui on est au plus
profond de soi et qui permet de « savoir qui on est, en sachant qui on est pas »75, même
si la présence du nganga est considérée comme indispensable à l’interprétation des
visions de l’initié. Si « le voyage initiatique constitue [...] une véritable quête
d’interlocuteurs et de partenaires » (Bonhomme 2005 : 41), ces interlocuteurs sont en
quelque sorte « virtuels » (pourtant considérés comme réels), ils appartiennent au
monde des visions, ce sont des partenaires déjà connus qui sont recherchés, comme les
morts et les disparus, ceux qui sont susceptibles d’apporter de l’au-delà des réponses à
la vie actuelle.
« Je est un Autre »
53 Cette conception de l’identité en rapport avec l’altérité ou plutôt avec la non-altérité
serait due, selon Gilles Lipovetsky (1983 : 67), à la généralisation du « procès
d’individualisation » et du « procès démocratique » dans la société occidentale, qui
permettrait le rapport à soi de supplanter le rapport à l’autre ainsi que le déploiement
du narcissisme : « N’est-ce pas précisément lorsque l’altérité sociale fait massivement
place à l’identité, la différence à l’égalité, que le problème de l’identité propre, intime
cette fois, peut surgir ? » (ibid.). L’authenticité l’emporterait désormais sur la
réciprocité, la connaissance de soi sur la reconnaissance. À cet égard, il est intéressant
de souligner que ces touristes s’inscrivent davantage dans une quête d’authenticité
« intérieure » (avoir accès à leur « vrai » moi intérieur à travers les visions)
qu’« extérieure » (authenticité de la rencontre, des cultures, des paysages, etc.)76. De ce
point de vue, ces touristes répondent d’avantage à l’injonction au Be yourself (Flahault
2006) d’une « culture de l’authenticité » (Taylor 1989) qui serait propre à l’Occident,
qu’à la doctrine prônée par les instances promouvant le tourisme culturel selon
laquelle ce dernier permettrait une rencontre « authentique » avec l’autre et sa culture.
Cette forme de tourisme culturel, qui apparaît comme la plus « participative »77 qui soit,
montre également, et contre toute attente, un visage plus « ethnocentrique » : la
rencontre avec l’autochtone n’est pas nécessaire, les touristes se contentent et/ou
recherchent des nganga français ; une sorte de primitivisme sans primitif : seule la
transmission de ses rites, de ses plantes et du savoir-faire initiatique semble
majoritairement recherchée78. L’analyse des représentations qui entourent cette forme
de tourisme et de ses pratiques montre que lorsque l’autochtone est en quelque sorte
assimilé au soi-même du touriste (primitif universel, primitif intérieur, primitif
salvateur), la figure de l’autre disparaît au profit d’une nouvelle division, celle du
conscient et de l’inconscient, « le clivage psychique, comme si la division se devait
d’être reproduite en permanence, fût-ce sous un mode psychologique, afin que l’œuvre
de socialisation puisse se poursuivre » (Lipovetsky 1983 : 67). Tout se passe comme si le
sentiment de similitude avec l’autre engendrerait un sentiment d’étrangeté avec soi-
même, que permettraient « d’effacer » l’iboga et le bwiti « dont le but est de permettre
à l’homme de se découvrir. D’où la reprise par l’auteur du “connais-toi toi même” de
Socrate » (Meyo-Me-Nkoghe 2004 : 7).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
354
54 Par ailleurs, nous avons également pu observer que c’est lorsque la figure de l’Autre
réapparaît sur la scène sociale au cours de l’initiation, lorsqu’il est de nouveau perçu
comme étranger à soi-même et négativement connoté (primitif extérieur, relativisé,
mortifère, archaïque) que se produisent des situations de rencontre qui sont
interprétées par les touristes comme des « malentendus interculturels » ou des
« décalages culturels ». Nous avons montré par ailleurs (Chabloz 2007) que les conflits,
découlant d’un malentendu dans une situation de rencontre touristique, étaient
« productifs », dans le sens où ce sont eux qui amènent selon nous une meilleure
compréhension mutuelle entre touristes et autochtones. Il est difficile de parvenir à la
même conclusion concernant cette forme de tourisme. En effet, l’analyse des
interactions entre l’initié et son nganga est rendue difficile par l’utilisation constante
d’un discours ésotérique de la part du nganga. Les référents ésotériques,
caractéristiques de cette pratique initiatique, brouillent tout autant les cartes de la
rencontre touristique qu’ils obligent l’ethnologue à négocier avec des registres
relationnel, discursif et analytique79 qui ne lui sont pas forcément familiers.
BIBLIOGRAPHIE
AMSELLE, J.-L.
1991 « Présentation », Cahiers d’Etudes africaines, « La malédiction », XXXI, 121-122 (1-2) : 7-8.
ATLAN, H.
1986 À tort et à raison. Intercritique de la science et du mythe, Paris, Éditions du Seuil.
BASTIDE, R.
1975 Le sacré sauvage, Paris, Éditions Payot.
BINET, J.
1972 Sociétés de danse chez les Fang du Gabon, Paris, Orstom.
1974 « Drogue et mystique : le Bwiti des Fangs », Diogène, 86, avril-mai : 36-57.
BLACHÈRE, J.-C.
1996 Les Totems d’André Breton. Surréalisme et primitivisme littéraire, Paris, L’Harmattan.
BONHOMME, J.
2005 Le miroir et le crâne. Parcours initiatique du Bwete Misoko (Gabon), Paris, CNRS-Éditions-Éditions
de la Maison des sciences de l’Homme.
2006 « L’anthropologie religieuse du Gabon. Une bibliographie commentée », Cahiers gabonais
d’Anthropologie, numéro spécial, Anthropologie religieuse, 17 : 2019-2036. <http://
julienbonhomme.ethno.free.fr/Texts/Biblio_Gabon.pdf>.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
355
2008 « Les ancêtres et le disque dur. Visions d’iboga en Noir et Blanc », in S. BAUD & G. GHASARIAN
(dir.), Ethnologie des usages contemporains des substances végétales psychotropes. <http://
julienbonhomme.ethno.free.fr/Texts/Iboga.pdf>.
BOUTROY, E.
2006 « Cultiver le danger dans l’alpinisme himalayen », Ethnologie française, 4 (36) : 591-601.
BRUNEL, S.
2006 « Vers une disneylandisation universelle ? », Actes du Festival international de géographie,
Saint-Dié-des-Vosges.
<http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2006/brunel/article.htm#sdfootnote1sym>.
BUREAU, R.
1972 La religion d’eboga. 1. Essai sur le Bwiti fang. 2. Lexique du Bwiti fang, Thèse de doctorat, Paris,
Université de Paris X.
1996 Bokayé ! Essai sur le Bwiti fang du Gabon, Paris, L’Harmattan.
CASTANEDA, C.
2002 L’Herbe du diable et la petite fumée. Une voie yaqui de la connaissance, Paris, Bourgois.
CAUVIN VERNER, C.
2007 Au désert. Une anthropologie du tourisme dans le Sud marocain, Paris, L’Harmattan.
CHABLOZ, N.
2007 « Le malentendu. Les rencontres paradoxales du tourisme solidaire », Actes de la Recherche en
Sciences sociales, 170 : 32-47.
CHAMPION, F.
1990 « La nébuleuse mystique-ésotérique. Orientations psychoreligieuses des courants mystiques
et ésotériques contemporains », in F. CHAMPION & D. HERVIEU-LÉGER (dir.), De l’émotion en religion.
Renouveaux et traditions, Paris, Éditions du Centurion : 17-69.
CHAMPION, F. & HERVIEU-LÉGER, D. (dir.)
1990 De l’émotion en religion. Renouveaux et traditions, Paris, Éditions du Centurion.
CLOTTES, J. & LEWIS-WILLIAMS, D.
2007 Les chamanes de la préhistoire. Transes et magie dans les grottes ornées. Suivi de Après les chamanes,
polémiques et réponses, Paris, Points.
COUSIN, S.
2008 « L’Unesco et la doctrine du tourisme culturel », Civilisations, 57 (1-2) : 41-56.
DERLON, B. & JEUDY-BALLINI, M.
2008 La passion de l’art primitif. Enquête sur les collectionneurs, Paris, Gallimard (« Bibliothèque des
sciences humaines »).
DESCOLA, P.
2000 « Sauvage », in P. BONTE & M. IZARD (dir.), Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris,
PUF (« Quadrige ») : 651-652.
DEUTSCHLANDER, S. & MILLER, L. J.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
356
2003 « Politicizing Aboriginal Cultural Tourism : The Discourse of Primitivism in the Tourist
Encounter », Canadian Review of Sociology and Anthropology, 40 (1): 27-44.
EBRON, P. A.
2000 « Tourists as Pilgrims: Commercial Fashioning of Transatlantic Politics », American
Ethnologist, 26: 910-932.
FERNANDEZ, J. W.
1982 Bwiti. An Ethnography of the Religious Imagination in Africa, Princeton, Princeton University
Press.
FLAHAULT, F.
2006 Be yourself. Au-delà de la conception occidentale de l’individu, Paris, Mille et une Nuits.
FRIEDBERG, C.
2000 « Hallucinogènes », in P. BONTE & M. IZARD (dir.), op. cit. : 320-321. GOLLNHOFER, O. & SILLANS, R.
1997 La mémoire d’un peuple. Ethno-histoire des Mitsogho, ethnie du Gabon central, Paris, Présence
Africaine.
GONSETH, M.-O., HAINART, J. & KAEHR, R. (dir.)
2002 Le musée cannibale, Neuchâtel, Musée d’ethnographie.
GRABURN, N. H. H.
1989 [1977] « Tourism: The Sacred Journey », in L. SMITH (ed.), Hosts and Guests: The Anthropology of
Tourism, Philadelphia, University of Pennsylvania Press: 21-36.
HARNER, M. J.
1990 The Way of the Shaman, San Francisco, Harper San Francisco.
JACSON, W.
1960 Les Noirs sauveront les Blancs, s.l., Éditions du Sagittaire.
JEWSIEWICKI, B.
1991 « Le primitivisme, le postcolonialisme, les antiquités “nègres” et la question nationale »,
Cahiers d’Études africaines, XXXl (1-2), 121-122 : 191-213.
KHARITIDI, O.
1998 Chamane blanche, Paris, Pocket.
KOUNEN, Y., NARBY, J. & RAVALEC, V.
2008 Plantes et chamanisme. Conversations autour de l’ayahuasca & de l’iboga, Paris, Mama Éditions.
LAVAL-JEANTET, M.
2005 Paroles d’un enfant du Bwiti, les enseignements d’iboga, Paris, L’Originel-Charles Antoni.
2006 Iboga : Invisible et guérison. Une approche ethnopsychiatrique, Paris, CQFD.
2008 « Approche thérapeutique de la prise d’iboga dans l’initiation au Bwiti vécue par les
Occidentaux », 30 octobre.
<http://www.chamanisme.fr/Marion-Laval-Jeantet-bwiti-iboga.html>.
LEGRAND, C.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
357
2006 « Tourisme des racines et confrontations identitaires dans l’irlande des migrations »,
Diasporas, histoire et sociétés, 8 : 162-171.
LIPIANSKI, M.
1982 « Radioscopie de la psychologie humaniste », in D. FRIEDMANN (dir.), Autrement, 43, À corps et à
cris, Paris, Éditions du Seuil : 78-92.
LIPOVETSKY, G.
1983 L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain, Paris, Gallimard.
MARY, A.
1999 Le défi du syncrétisme. Le travail symbolique de la religion d’Eboga (Gabon), Paris, Éditions de
l’École des hautes études en sciences sociales.
2000 Le bricolage africain des héros chrétiens, Paris, Éditions du Cerf (« Sciences humaines et
religions »).
2005 « Le Bwiti à l’heure du village global », Rupture (Nouvelle série, 6), numéro spécial, Le Gabon
malgré lui : 83-103.
MEYO-ME-NKOGHE, D.
2004 « Préface », A. RIBENGA, La tradition bwitiste au Gabon. Voie directe de communication avec le
Divin, Libreville, La Maison gabonaise du livre : 7-9.
MOUSSADJI, S. A.
2004 « Mallendi : “L’iboga sera notre aide, sur le plan humanitaire, aux pays occidentaux” »,
L’Union Plus, mardi 28 septembre : 20.
NARBY, J.
1995 Le Serpent cosmique, l’ADN et les origines du savoir, Genève, Georg Éditeur.
NAVARRO, M.
2007 Une Occidentale initiée à l’iboga chez les Pygmées. La racine doit rester secrète, Monaco, Éditions
Alphée, Jean-Paul Bertrand.
DE NEGRONI, F.
1992 Afrique fantasmes, Paris, Plon.
RASSOOL, C. & WITZ, L.
1996 « South Africa: A World in One Country. Moments in International Tourist Encounters with
Wildlife, the Primitive and the Modern », Cahiers d’Études africaines, XXXVI (3), 143: 335-371.
RAVALEC, V., MALLENDI & PAICHELER, A.
2004 Bois Sacré, Initiation à l’iboga, Vauvert, Au Diable Vauvert.
RAVALEC, V. & SAZY, L.
2004 Ngenza. Cérémonie de la Connaissance, Paris, Presses de la Renaissance.
RIBENGA, A.
2004 La tradition bwitiste au Gabon. Voie directe de communication avec le Divin, Libreville, La Maison
gabonaise du livre.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
358
SABOT, P.
2003 « Primitivisme et surréalisme : une “synthèse” impossible ? », Methodos, 3, Figures de
l’irrationnel. <http://methodos.revues.org/document109.html>.
SALLÉE, P.
1985 L’arc et la harpe. Contribution à l’histoire de la musique du Gabon, Thèse de doctorat, Paris,
Université Paris 10-Nanterre.
SÉJOURNANT, M.
2001 Le cercle de vie. Initiation chamanique d’une psychothérapeute, Paris, Albin Michel (« Espaces
libres »).
SIMON, E.
2003 « Une exportation du New Age en Afrique ? », Cahiers d’Études africaines, XLIII (4), 172 :
883-898.
SOMBRUN, C.
2002 Journal d’une apprentie chamane, Paris, Albin Michel (« Pocket Spiritualité »).
2004 Mon initiation chez les chamanes. Une parisienne en Mongolie, Paris, Albin Michel (« Pocket
Spiritualité »).
STONE, D.
1982 « Les oncles d’Amérique », in D. FRIEDMANN (dir.), op. cit.: 107-129.
SWIDERSKI, S.
1990 La religion Bouiti. vol. 1. Histoire, Toronto, Legas.
TAYLOR, A.-C.
2000 « Primitif », in P. BONTE & M. IZARD (dir.), op. cit. : 600-601.
TAYLOR, C.
1989 Sources of the Self, The Making of the Mordern Identity, Cambridge (Mass.), Harvard University
Press.
VAZEILLES, D.
2003 « Chamanisme, néo-chamanisme et New Age », in R. HAMAYON (dir.), Chamanismes, Paris,
PUF-Diogène (« Quadrige ») : 239-280.
Filmographie
BONHOMME, J.
2003 Voir l’invisible. Initiation au Bwete Misoko (Gabon), documentaire, 35 min.
CHABLOZ, N.
2009 Bwiti et iboga en VF. Une initiation à Libreville, documentaire, 48 min., France/Gabon,
autoproduction.
CHARTIER, A.
2005-2006 Un pèlerinage sans fin, documentaire, 35 min.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
359
CHEYSSIAL, J.-C.
1995 Le bois sacré, documentaire, 24 min., Paris, Ellipse.
1997 La Nuit du Bwiti, documentaire, 50 min., Paris, Latitude 16/35 et Maximum Vidéo.
1998a Le Souffle de la Forêt, documentaire, 50 min., Paris, K. Production et Maximum Vidéo.
1998b L’esprit de la Forêt, documentaire, 26 min., Paris, production Fonds européen.
1999 Secrets de femmes, documentaire, 49 min., Paris, Digivision et Yves Planche.
2000 Le Peuple de la Forêt, documentaire, 50 min., Paris, La Luna Productions.
2002 L’Esprit de l’Ayahuasca, documentaire, 50 min., Paris, La Luna Productions.
2003 La Guérisseuse de la Forêt, documentaire, 26 min., Grand Angle Productions-Latitude Film,
RFO.
KELNER, G.
2002 Les hommes du bois sacré, documentaire, 53 min., Paris, Art Line Films. KOUNEN, Y.
2003 D’autres mondes, 72 min., distribution Eurozoom.
2004 Blueberry, l’expérience secrète, 2 h 04, France.
LAVAL-JEANTET, M. & MANGIN, B.
2003 Voyage en Iboga, documentaire, 35 min., production Art Orienté objet, Université Paris VIII,
Libreville et Paris.
MERLI, L.
2009 Shaman Tour, documentaire, 60 min..
PELLARIN, R.
2006 Chacun cherche son chaman, documentaire, 66 min., France, Stratis.
NOTES
1. Voir notamment RASSOOL & WITZ (1996) sur le tourisme en Afrique du Sud et de DEUTSCHLANDER &
MILLER (2003) sur le tourisme culturel amérindien.
2. Considéré par certains comme un rite initiatique, le bwiti est également souvent qualifié de
religion. Il n’est pas question ici de procéder à une enquête ethnographique portant sur le bwiti.
Des études ont été surtout effectuées sur le bwiti « traditionnel » des Mitsogho du Gabon central,
voir notamment GOLLNHOFER & SILLANS (1997), SALLÉE (1985), et sur le bwiti « syncrétique » des Fang
de l’Estuaire, voir notamment BINET (1972), BUREAU (1972, 1996), FERNANDEZ (1982), MARY (1999),
SWIDERSKI (1990). Pour une bibliographie détaillée et commentée sur le bwiti et l’anthropologie
religieuse du Gabon, voir BONHOMME (2006).
3. L’iboga est souvent définie comme « plante hallucinogène » (GOLLNHOFFER & SILLANS 1997 : 95 ;
MARY 1999 : 26 ; FRIEDBERG 2000 : 320-321), alors que pour certains elle ne l’est pas (RIBENGA 2004 :
44). La plupart des chercheurs, initiateurs et initiés semblent s’accorder sur le fait que les visions
provoquées par l’iboga ne peuvent être considérées comme des hallucinations notamment de par
leur caractère « réel ». Je remercie vivement André Mary pour la relecture attentive de cet article
et ses précieux conseils.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
360
4. Les catégories d’acteurs sont poreuses. Les promoteurs et les organisateurs de séjours
initiatiques ont souvent été initiés au préalable. Leurs discours présentent donc un double
intérêt : le témoignage d’une expérience vécue, le « recul critique » se voulant scientifique ou
didactique sur cette expérience. De plus, les représentations véhiculées par les « médiateurs »
sont en partie réappropriées par les candidats à l’initiation.
5. Dans cet article, nous nous intéressons moins au parcours des initiateurs que des initiés.
Précisons simplement que nous avons mené des entretiens avec quatre initiateurs : deux
Gabonais (Bernadette Rébienot et Atome Ribenga) et deux Français : Tatayo (sur le parcours
initiatique de cet initiateur, voir LAVAL-JEANTET 2005) et Christophe, le plus cité, car c’est lui que
nous avons suivi au cours de l’initiation qu’il donne à Philippe (CHABLOZ 2009). Christophe a
découvert le Gabon en y effectuant son service militaire, et compte parmi les premiers Français à
s’être initiés au bwiti (après Tatayo) à l’âge de 22 ans. Il est marié à Marie-Claire, une Gabonaise
avec laquelle il a vécu en France avant d’initier depuis une dizaine d’années des Européens « en
famille » dans leur village situé à 12 km de Libreville. Ils proposent un bwiti que l’on pourrait
qualifier « d’adapté aux Européens », qui « ne suit ni la route du misoko ni celle du disumba, mais
la route du bois sacré » et qui ne comporte « ni interdits, ni obligations » (entretien filmé, juillet
2007, Libreville).
6. Le gouvernement gabonais n’encourage pas ce tourisme mystico-spirituel, car il refusait les
demandes de visas (Tatayo cité dans LAVAL-JEANTET 2005 : 147-148) qui indiquaient cette
motivation, même avant l’interdiction de l’iboga en France en 2007. Cette précaution du
gouvernement gabonais « qui tantôt paraît favoriser le Bwiti tantôt l’interdit » (BINET 1974 : 55)
s’expliquerait également par ses rapports historiquement ambivalents avec la tradition bwitiste.
7. Ce prix comprend l’hébergement, la nourriture, l’achat d’ustensiles nécessaires à l’initiation,
l’achat de l’iboga (son coût a également augmenté suite au développement des initiations
d’étrangers, mais aussi de la médiatisation de l’ibogaïne, un des composants de l’iboga, connue
pour ses propriétés « anti-addictives »), la rémunération des musiciens et des danseurs et du
« petit personnel » qui accompagnent le banzi (initié). Ce prix peut également comprendre l’achat
et la confection du pagne de l’initié, ainsi que divers « services touristiques » consistant à la
préparation d’un CD de photos pour l’initié qu’il emportera avec lui, la confection d’un mongongo
(arc en bouche), et d’éventuelles excursions dans la forêt ou sur la plage une fois l’initiation
terminée.
8. L’expression de « psychologie humaniste » regroupe une série d’approches psychologiques et
de pratiques thérapeutiques élaborées et diffusées aux États-Unis dans les années 1960 avant de
connaître un certain succès en Europe et en France. Cette expression tend aujourd’hui à
l’emporter sur celle de « mouvement du potentiel humain » utilisée antérieurement (LIPIANSKY
1982 : 78).
9. J’ai rencontré Philippe lors de son arrivée dans sa famille initiatrice en juillet 2007, ai suivi et
filmé son initiation qui a duré une dizaine de jours (CHABLOZ 2009). J’ai été mise en relation avec
Yann par Tatayo, et nous avons mené plusieurs entretiens filmés approfondis à Paris,
s’échelonnant sur une année. Qu’ils soient ici tous deux remerciés.
10. Philippe est de père martiniquais et a découvert que celui-ci, décédé, était descendant
d’esclaves provenant du Sénégal.
11. Le récit de Yann sur son enfance et son adolescence est basé sur une suite ininterrompue de
souffrances, de violences et d’abandon. Sans entrer dans les détails il évoque une « enfance
difficile » au sein d’une famille « très malade » ainsi que des « violences, torture mentale,
abandon, rue, délinquance, enfermements, isolement, dépressions, toxicomanie, flirt avec la folie
et la mort ».
12. Cette forme de tourisme n’est pas spécifique à l’Afrique, voir notamment LEGRAND (2006) sur le
« tourisme généalogique » en Irlande ; BELLAGAMBA, BENTON & SHABAZZ, FORTE (dans ce numéro) à
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
361
propos du « tourisme de racines » en Afrique. Au Gabon, cette quête de « racines » provient
majoritairement de Français ou d’Européens, mais pas d’Afro-américains : « On n’a pas vu un seul
Afro-américain venir manger l’iboga, ils vont à l’Intercontinental en costume-cravatte, mais ils
ne viennent pas s’initier. Alors le retour aux sources... ploutch ! [geste de bras d’honneur] »
(Tatayo, entretien filmé, juillet 2007, Libreville).
13. Les motivations des « touristes » français et des Français vivant au Gabon sont différentes. Les
expatriés s’inscriraient plutôt dans des logiques de « curiosité et d’analyse intellectuelles » et
d’« insertion dans la population locale » (entretien avec J.-C. Morlaës, conseiller de coopération
adjoint à l’ambassade de France en poste au Gabon en 2007, juillet 2007, Libreville). Même si ce
n’est pas l’objet de cet article, précisons que les Gabonais viennent chercher dans le bwiti et
l’iboga une explication à une maladie ou à un malheur, mais ne sont pas en recherche d’un sens à
donner à leur vie (MARY 2005 : 14). Plusieurs témoignages d’initiateurs précisent également que
certains Gabonais s’initient au bwiti dans une logique politico-culturelle ou pour acquérir des
pouvoirs.
14. Le format de cet article ne permet pas de comparer les motivations à l’initiation des
Occidentaux avec celles des Gabonais (MARY 2005 ; BONHOMME 2008), mais précisons simplement
que, pour les Gabonais, l’aspect thérapeutique peut encore moins être séparé de l’aspect
mystique puisque les problèmes physiques ou psychologiques (souvent nommés « maladies
mystiques ») sont majoritairement attribués à des « attaques mystiques » qu’il s’agit de résoudre
dans le bwiti, l’iboga permettant notamment, grâce aux visions qu’elle procure, de trouver et de
contrer le responsable de ces attaques sur le plan de l’invisible.
15. Le déroulement des initiations dépend notamment de l’initiateur et du type de bwiti qu’il
pratique. Cependant, pour donner une idée des pratiques sur place, voici le déroulé de l’initiation
que nous avons suivie en juillet 2007 (CHABLOZ 2009) : 1er jour : cueillette des herbes destinées aux
bains de purification. 2e jour : bains, « bastonnade » (eau brûlante projetée sur le corps avec un
balai), un seul repas, le soir Christophe tire les cartes de tarot à Philippe. 3e jour : absorption
d’une plante vomitive, jeûne, bains, réunion le soir dans la « cour de la vérité » (« Nzimba ») pour
dire devant les esprits ce qui est recherché dans l’initiation, danses. 4e jour : dernier bain,
aspersion d’eau, « enfumage » (qui rend invisible aux sorciers), l’initié enduit de kaolin absorbe
l’iboga, accompagné par le son de la harpe et des chants de l’assemblée, visions le soir et la nuit
dans la chambre d’initiation. 5e jour : l’initié est debout et prend un repas de fruits, discussions
avec l’initiateur sur la signification des visions de la nuit. 6e jour : préparation de la veillée du
soir, distribution d’une petite dose d’iboga par Christophe à tout le village, veillée avec
« plusieurs bwiti » (disumba et misoko), Philippe danse habillé en guerrier misoko, mais part au
milieu de la nuit, excédé. 7e jour : au petit matin, Philippe décide de partir du village qu’il ne
« supporte plus », il me demande de l’accompagner, retour au village le soir. 8e jour : Philippe se
sent mieux après une nuit de sommeil, bilan de l’initiation avec Christophe en voiture, visite
d’une amie et d’un autre initiateur français (Tatayo), détour chez un ami français qui a fait des
photos de l’initiation de Philippe et qui lui donne un CD, départ pour l’aéroport le soir.
16. Une trentaine d’Occidentaux (dont une grande majorité de Français, et quelques Américains,
Canadiens, Allemands, Japonais) viennent se faire initier chaque année au Gabon depuis une
dizaine d’années. Le consul de France à Libreville estimait le nombre de touristes français au
Gabon à 25 000 en 2007. La majorité des touristes viendraient visiter des proches vivant sur place
ou pour faire du « tourisme d’affaires ». En raison du coût élevé du billet d’avion et de la rareté
des infrastructures touristiques, le pays est considéré comme peu attractif pour les voyages
d’agrément.
17. Depuis 2007, le ministère français des Affaires étrangères met d’ailleurs en garde les touristes
sur la page Internet consacrée aux « conseils aux voyageurs » en partance pour le Gabon, <http://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_ 909/pays_12191/gabon_12246/index.html>.
18. Arrêté publié au Journal Officiel du 25 mars 2007.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
362
19. Cela étant, si ces personnes se déplacent, même en France et passent deux nuits à l’extérieur
de chez elles, elles sont également considérées comme touristes, d’après la définition qu’en
donne l’OMT.
20. Le terme de « chamanisme » ou de « chaman » correspond d’abord aux guérisseurs de Sibérie,
il a été ensuite progressivement élargi à tous les guérisseurs et tradi-praticiens de la planète qui
ne pratiquent pas la médecine dite occidentale, et le terme a même été approprié par de
nombreux guérisseurs, surtout en Amérique du Sud.
21. L’anthropologue Michael Harner est également le fondateur et le président de la « Fondation
for Shamanic Studies » qui propose des cours et des séminaires en France, en Suisse et en
Belgique et des voyages sur le thème du chamanisme dans le monde, <http://www.chamanisme-
fss.org/seminaires.html>.
22. Un documentaire, « Les nouveaux tourismes » diffusé sur Canal + le 20 mai 2009, suit
notamment un groupe de Français lors d’une initiation au Brésil.
23. <http://www.patrickdacquay.com/patrick/index.php>.
24. Patrick Dacquay est également le compagnon d’initiation de la Franco-québécoise Mélanie
NAVARRO (2007) qui relate dans un ouvrage leur rencontre et leur périple au Gabon, ainsi que leur
initiation au bwiti chez les Pygmées.
25. Jan KOUNEN n’est pas à proprement parler un initiateur du tourisme vers le Gabon car ses
films portent surtout sur l’ayahuasca, mais son influence est reconnue par ceux qui partent
s’initier au Gabon ou ailleurs, et en ce sens, il peut être considéré comme quelqu’un dont le
travail a influencé le tourisme « mystico-spirituel » et « thérapeutique ».
26. Comme le documentaire de KELNER (2002) diffusé sur Arte en 2003.
27. Par exemple sur France Culture « Bwiti, voyages initiatiques au Gabon », 21 octobre 2006
(rediffusée le 6 janvier 2007) ; sur « Ici et Maintenant ! » (95.2 FM), émission sur l’iboga du 28
mars 2004, et celle du 15 juillet 2005.
28. Notamment les films de Jan KOUNEN (2003, 2004).
29. Julien BONHOMME (2006 : 2020) recommande de consulter les ouvrages non scientifiques sur le
bwiti et l’iboga (notamment celui de RAVALEC ET AL. 2004) « avec la plus grande prudence car ils
relèvent bien davantage de l’ésotérisme occidental et du New-Age que du travail universitaire ».
30. Le 5 avril 2004 au Musée de l’Homme ; le 1er février 2007 au musée Dapper ; le 28 mars 2007 au
Musée de l’Homme ; le 25 septembre 2008 à la Société de Géographie, conférence organisée par
l’INREES (Institut de recherche sur les expériences extraordinaires).
31. Comme par exemple lors des opérations de préfiguration du musée du Quai Branly
(programmation « hors les murs », les « Nuits du Bwiti », été 2002, Montpellier) ou par des
acteurs associatifs tels Ethnoart et Savoirs d’Afrique qui ont organisé la « Nuit de la Meyaya »
autour de la cérémonie du bwiti (2 septembre 2005, Aubervilliers).
32. L’un avec Vincent RAVALEC et Agnès PAICHELER (2004) et il participe à celui de RAVALEC & SAZY
(2004).
33. Communiqué publié en septembre 2006 sur le site Internet de l’association Savoirs d’Afrique,
<http://www.savoirsdafrique.org>.
34. L’absorption d’iboga serait déconseillée aux personnes ayant notamment des problèmes
cardiaques, reinaux et d’ulcère à l’estomac et souffrant de pathologies psychiatriques telle que la
schizophrénie. Yann évoque le cas de personnes s’étant faites interner en hôpital psychiatrique à
leur retour du Gabon, ainsi que des suicides et des « disparitions » (entretien filmé, février 2008,
Paris). Pour le quotidien L’Union, « initier des personnes étrangères à notre environnement
culturel n’est pas sans danger. C’est ainsi qu’au courant du mois d’août, deux Français ont fui le
village [de Panga] à la 3e nuit de leur initiation pour aller dormir dans la forêt. Heureusement ils
ont été retrouvés rapidement, et surtout sains et saufs sur la côte de Mayumba » (MOUSSADJI 2004 :
20)
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
363
35. Entretien, juillet 2007, Libreville.
36. « La diversité culturelle élargit les possibilités de choix offertes à chacun ; elle est l’une des
sources du développement, entendu non seulement en termes de croissance économique, mais
aussi comme moyen d’accéder à une existence intellectuelle, affective, morale et spirituelle
satisfaisante » (Article 3 de la Déclaration universelle de l’Unesco sur la Diversité culturelle,
2002).
37. Au sens de « qui appartient au premier état d’une chose ; premier, initial, originel » (Le Grand
Larousse illustré, 2005).
38. La figure de l’ancêtre au Gabon est incarnée par le Pygmée, considéré comme la « population
première » par excellence (BONHOMME 2005 : 143).
39. À propos de l’hypothèse (et des polémiques qu’elle a engendrées) selon laquelle les hommes
auraient toujours cherché à entrer en contact avec les esprits par l’intermédiaire des chamanes
et de leurs voyages pendant la transe, et que l’illustration de ces pratiques se retrouve dans l’art
préhistorique des cavernes, voir CLOTTES & LEWIS-WILLIAMS (2007).
40. Le bwiti syncrétique fang « inventé par les prophètes fang dans les années 19301950 » (MARY
2005 : 85) est celui qui est perçu par les Occidentaux comme le seul qui soit syncrétique, du fait
notamment de l’abondance des symboles de religion chrétienne, alors que toutes les formes de
bwiti seraient en réalité les produits « d’un jeu d’échanges et d’emprunts multiples entre ethnies
qui a précédé l’arrivée des missionnaires » (ibid.), ou de « bricolages » plus contemporains.
41. Entretien filmé, février 2008, Paris.
42. Selon Marion L AVAL-JEANTET (2006 : 15-20), les candidats à l’initiation ont à choisir entre
« deux cultes majeurs dont les pratiques sont très distinctes » : le Misoko (interethnique,
important au centre du pays, voir BONHOMME 2005), souvent qualifié de « culte de la guérison »
vers lequel se tournent les Occidentaux en souffrance psychologique, et le Disumba pratiqué par
tous les groupes ethniques et choisi par les Fang (qui le tiennent des Mitsogho) pour en produire
de nouvelles versions syncrétiques (avec le christianisme) et considéré comme la voie mystique
du bwiti, souvent qualifié de « culte des ancêtres ». Les prises importantes d’iboga permettraient
en effet d’avoir des visions ayant trait à l’au-delà et au monde des morts. Des tentatives de fusion
des cultes ont été menées, et c’est dans cette démarche que s’inscrit le type de bwiti proposé par
Christophe et Marie-Claire.
43. Comme la plume de perroquet rouge (symbolisant le voyage et la parole), l’aiguille (symbole
de l’entrée et de la sortie), le miroir, etc.
44. Christophe, entretien filmé, juillet 2007, Libreville.
45. C’est d’ailleurs l’absence du secret dans le bwiti pratiqué par Christophe et Marie-Claire qui a
permis que je suive et filme l’initiation de Philippe. Je profite de cette occasion pour les en
remercier.
46. Christophe, entretien, juillet 2007, Libreville.
47. Message posté sur le forum « l’alcool et l’alcoolisme : aide et entraide pour arrêter l’alcool
(ATOUTE) » de la part de « Nemo VNI » déclarant s’être fait initié en France avec Mallendi en
trois jours.
48. Ibid. Le discours pragmatique qui se retrouve chez de nombreux initiés et initiateurs selon
lequel une initiation remplacerait dix ans de psychanalyse, se retrouve dans les techniques de
groupes de développement qui s’appuient sur le même type d’autorité pragmatique de
l’expérience personnelle directe : « Si ça marche, fais-le » (STONE 1982 : 112-113).
49. Un toxicomane est décédé le 18 juillet 2006 durant un stage de désintoxication organisé par
un couple français dirigeant l’association Meyaya à la Voulte, en Ardèche. Cette association
organisait des séminaires de développement personnel basés sur le rite du bwiti et l’ingestion
d’iboga. Mallendi, tradipatricien gabonais exerçant en France depuis 2001 animait ces stages en
tant que prestataire indépendant et a été mis en cause dans cette affaire (même s’il était au
Gabon au moment des faits), inculpé pour « homicide involontaire et mise en danger de la vie
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
364
d’autrui », incarcéré pendant un mois avant d’être libéré et d’être mis en examen pour « pratique
illégale de la médecine et de la pharmacie ». Il donne son point de vue sur cette affaire,
notamment dans un communiqué publié en septembre 2006 (<http://www.savoirsdafrique.org>),
et s’explique le 28 mars 2007 lors d’un débat organisé au Musée de l’Homme autour de la
projection de films documentaires sur le bwiti et l’iboga. Sur le parcours de Mallendi et sur sa
vision du bwiti, voir également RAVALEC, MALLENDI & PAICHELER (2004 : 107-119) et le film de KELNER
(2002).
50. Mallendi, intervention au Musée de l’Homme le 28 mars 2007.
51. Le 17 décembre 2006, un Français de trente sept ans est mort par noyade pendant une
initiation encadrée par Tatayo. Les circonstances de ce décès restent obscures : il se serait baigné
dans la mer, sans surveillance, et se serait noyé alors que la mer était calme (c’est cette donnée
qui rend la mort suspecte aux yeux notamment du consul de France en poste à Libreville au
moment des faits). L’autopsie aurait révélé une anomalie cardiaque. Suite à ce décès, un
questionnaire de santé et de motivation a été élaboré sur le modèle de celui de Jacques Mabit,
médecin français organisant des stages à l’ayahuasca au Pérou (entretien filmé avec Tatayo,
juillet 2007, Libreville).
52. Julien DUMOND, « Mort mystérieuse lors d’une cure de désintoxication », Le Parisien, 8 août
2006 ; Azzedine AHMED-CHAOUCH & Bruno MASI, « La poudre africaine bientôt classée comme
stupéfiant. L’iboga plante tueuse ? », Choc Hebdo, no 71, 8-14 mars 2007.
53. Les représentations liées à l’universalisme incarné par le chamane renvoient, selon nous en
partie à l’universalisme des Lumières mais surtout à l’unité de l’esprit et de la matière « dans un
spiritualisme cosmique où l’univers est décrit en termes de conscience, de volonté et de vie
intérieure rejoignant en cela les enseignements des traditions mystiques » (ATLAN 1986 : 35).
54. Cette approche, que F. CHAMPION et D. HERVIEU-LÉGER (1990 : 39-40) qualifient de « militance
culturelle » se retrouve au sein de la « nébuleuse mystico-ésotérique ». Cette aspiration du
« mystique ésotériste » à « réinventer de l’unité » serait selon ces auteures une réponse
protestataire à l’avancée de la modernité qui est pour une grande part un processus de
séparation.
55. Selon Henri A TLAN (1986 : 16), l’idée d’une « Réalité Ultime » chez les Occidentaux
proviendrait notamment de leur « découverte » de la réalité du monde des rêves et de
l’imaginaire, grâce à la chimie (psychotropes), aux techniques de méditation (importées
d’Orient), la psychanalyse et le surréalisme.
56. L’intégration à un groupe ou la recherche du sentiment d’appartenance à une communauté
ne semble pas faire partie des motivations des Français qui partent s’initier. Selon Jean-Claude
Morlaës, conseiller de coopération à l’ambassade de France à Libreville en 1997, l’initiation est
une démarche individuelle qui n’entre pas dans une logique de groupe, contrairement aux sectes,
ce qui viendrait contredire les « risques de dérives sectaires » imputés au bwiti par la Miviludes
(entretien, juillet 2007, Libreville).
57. L’absorption des racines de la plante iboga permettrait en effet, selon de très nombreux
témoignages d’initiés, d’avoir des visions montrant des épisodes du passé et de l’avenir, visions
considérées comme réelles. Yann par exemple déclare que toutes les visions qu’il a eues sous
iboga se sont réalisées.
58. Mais ce discours se retrouve également chez les initiés à l’ayahuasca, voir NARBY 1995.
59. L’idée d’une conscience universelle semble également être l’interprétation du fait que les
initiés (quelle que soit leur provenance) à l’ayahuasca ont des visions de serpents, considérés
comme représentant l’esprit de la plante ayahuasca (CHEYSSIAL 2002).
60. Dans le sens du latin primitivus : qui naît le premier. Qui appartient au premier état d’une
chose, premier, initial, originel.
61. Du latin selvaticus : sylvestre.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
365
62. On retrouve cette idée au sein du mouvement surréaliste (SABOT 2003 : 7).
63. Par exemple, les documentaires du réalisateur Jean-Claude Cheyssial sur le bwiti, l’iboga et
l’ayahuesca, en abordant les différentes pathologies des initiés et leurs motivations à l’initiation
tendent à donner une image à certains égards plus « primitive » des Gabonais que des Péruviens.
Par exemple il montre des médecins français gravitant autour de l’ayahuesca au Pérou, mais il ne
montre pas les initiateurs français au Gabon. S’il filme des patients indigènes et européens dans
les deux pays, au Pérou, les pathologies des patients européens et indigènes ne semblent pas trop
éloignées (problèmes de dépendance au haschich et à l’alcool et de dépression pour le Français,
problème de dépendance à l’alcool et de dépression pour le patient péruvien) (CHEYSSIAL 2002),
alors qu’au Gabon (CHEYSSIAL 2003) le film débute sur l’initiation d’un Gabonais souffrant d’une
maladie « mystique » (« que l’on ne s’attend plus à trouver au XXIe siècle »), et enchaîne sur
l’initiation d’un Italien qui souffre d’une maladie bien occidentale, le malêtre. Ainsi donc, au
Pérou, les motivations à l’initiation des Occidentaux et indigènes sont représentées comme
quasiment semblables, alors qu’au Gabon, on perçoit un « fossé culturel » entre les pathologies et
les motivations des indigènes et celles des Occidentaux. De même, dans un autre documentaire
sur les femmes guérisseuses au Gabon (CHEYSSIAL 1999), cet auteur montre deux Gabonais
« atteints par une maladie typiquement africaine, le vampirisme ».
64. L’animisme est perçu comme impliquant une relation étroite de l’Homme avec son univers
naturel, ce qui représente une forme de progrès ou de modernité (primitivisme moderne)
opposée à la culture occidentale dont le progrès est basé sur la séparation d’avec la nature et sur
la maîtrise physique et intellectuelle de cette nature. Cette séparation et cet intellectualisme,
comme nous l’avons vu, sont considérés comme responsables de l’aliénation de l’Occidental.
65. Cette vision se retrouve également dans des pratiques touristiques plus « classiques »
consistant à visiter des lieux. Par exemple RASSOOL et WITZ (1996) décrivent la composition
d’images liées à « l’Africanité » du tourisme sud-africain qui s’articule autour de la vie sauvage de
ses animaux, de son tribalisme « primitif » et de sa société moderne.
66. Le « racisme » que pourrait éprouver les initiés, plongés dans un environnement étrange et
sous influence de l’iboga, est également évoqué par Vincent RAVALEC (2004 : 102).
67. Entretien téléphonique, janvier 2009.
68. À ce propos, il serait également éclairant de procéder à l’analyse du « primitivisme » présent
dans les représentations que les Gabonais ont des Occidentaux.
69. Ce qui pose la question d’une véritable rupture entre les représentations des touristes
contemporains liées au primitif en Afrique et celles des touristes pendant la période coloniale,
voir à ce sujet l’article de Sophie DULUCQ (dans ce numéro).
70. L’auteur déclare au père Dhellemmes que les Pygmées seraient des descendants des Atlantes
(JACSON 1960 : 331).
71. L’idée selon laquelle l’initiation des Blancs et sa médiatisation incite les autochtones à se
réapproprier leurs traditions se retrouve aussi bien chez les initiés (Yann), chez les
« médiateurs » (Narby dans KOUNEN ET AL. 2008 : 67 ; Kounen dans K OUNEN ET AL. 2008 : 68 ;
CHEYSSIAL, <http://jean-claude-cheyssial.com/pages/secrets.html>), que chez les initiateurs
(RIBENGA 2004 : 66-67).
72. Entretien avec Jean-Claude Morlaës, conseiller de coopération adjoint à l’ambassade de
France, juillet 2007, Libreville.
73. L’idée très répandue selon laquelle la condition sine qua non d’une « vraie » rencontre qui
entraînerait une meilleure compréhension mutuelle serait une longue durée de vie sur place, est
nuancée par l’expérience de Yann qui constate une incompréhension mutuelle entre lui et son
nganga après avoir vécu près d’un an à Libreville. C’est en « passant de l’autre côté », en devenant
presque Gabonais et en n’appartenant plus à la catégorie de touriste (l’OMT considère que le
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
366
touriste est celui qui vit moins d’un an sur place) que Yann évoque pour la première fois un
« décalage culturel » responsable du conflit qu’il a eu avec son maître initiateur.
74. Entretien avec Jean-Claude Morlaës, juillet 2007, Libreville.
75. Christophe, échange avec Philippe (CHABLOZ 2009).
76. Contrairement à Yann qui recherchait une initiation « authentique » (malgré ses aspects
syncrétiques), et à Mélanie NAVARRO (2007) qui est allée se faire initier chez les Pygmées, on
s’aperçoit à travers les discours des initiés et des « médiateurs culturels » de ce type de tourisme
que l’aspect touristique, considéré comme « non authentique » des structures d’accueil leur
importe en fait assez peu. on le voit à Libreville lorsque des Européens choisissent des Français
comme initiateurs pratiquant un bwiti qui leur est adapté. Ce phénomène s’observe également au
Pérou (KOUNEN ET AL. 2008 : 163-164).
77. Les touristes ne se contentent pas du registre du voir, mais expérimentent véritablement une
pratique initiatique, considérée par certains comme fondamentale dans la culture gabonaise.
78. Cela semble par exemple être le cas de Philippe qui estime que son stage d’initiation à l’iboga
en France lui a été plus profitable que son initiation au bwiti au Gabon, perçu comme « trop
spirituel » et les rites sur place comme trop contraignants. En revanche, ce n’est pas le cas de
Yann qui recherchait au contraire l’aspect rituel et la découverte de « l’essence » du bwiti.
79. Le format de cet article n’a pas rendu possible la description ni l’analyse du rapport
qu’entretient le chercheur avec ses informateurs sur ce type de « terrain », mais elles restent à
faire. Je conclue en remerciant chaleureusement Saskia Cousin pour son aide qui m’a notamment
permis de réduire cet article, deux fois trop long à l’origine.
RÉSUMÉS
Cet article apporte un éclairage sur les ressorts d'une pratique touristique que nous appellerons
« mystico-spirituelle et thérapeutique », en partie basée sur la figure du primitif. L'étude des
parcours et des discours de Français partis s'initier au bwiti, un rite initiatique gabonais utilisant
les racines d'une plante, l'iboga, ainsi que de ceux qui ont médiatisé et souvent initié cette
pratique en France, permet de mieux comprendre les différents registres et les différentes
représentations concernant le primitif. Ces représentations, multiformes, souvent ambivalentes,
évoluent en fonction des situations vécues par les touristes. On tentera tout d'abord de décrire
cette pratique touristique, ainsi que les personnes qui la mettent en œuvre, la médiatisent et
l'expérimentent. On s'emploiera ensuite à définir les différentes acceptions de la notion de
primitif et de primitivisme à travers les discours et les pratiques des acteurs. Enfin, nous nous
attacherons à analyser de quelles manières ces représentations et ces pratiques primitivistes
viennent conforter ou contredire les idéologies et les lieux communs du tourisme dit culturel —
notamment celles portant sur la « rencontre avec l'autre », une meilleure compréhension entre
les peuples et la sauvegarde des traditions locales.
This paper sheds light on the implications of tourist practice that we shall call "mystic-spiritual
and therapeutic" partly based on representations of the primitive. A study of French nationals
who have gone to Gabon to experience the bwiti initiation rite using the root of the iboga plant,
and the people behind the media coverage, who have frequently brought this practice to France,
give us a better grasp of the various levels of primitivism and its representations. There are many
(often contradictory) types of representations, which evolve according to the tourists'
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
367
experiences. We first attempt to obtain a clearer idea of this tourist practice and its offshoots, as
well as the persons who implement, promote and experiment with it. We then attempt to define
the various meanings behind the notion of primitive and primitivism though the views and
practices of those involved. Lastly we attempt to analyse how these primitivist representations
and practices support or contradict the ideologies and areas that are common to so-called
"cultural" tourism, especially when it claims to "meet the other", provide a better understanding
between people, and preserve local traditions.
INDEX
Mots-clés : Gabon, bwiti, iboga, initiations, pratiques, primitivisme, rencontre, représentations,
tourisme culturel, tourisme mystico-spirituel, tourisme thérapeutique
Keywords : Gabon, bwiti, iboga, initiation, practices, primitivism, encounters, representations,
cultural tourism, mystic-spiritual tourism, therapeutic tourism
AUTEUR
NADÈGE CHABLOZ
Centre d’études africaines, EHESS, Paris.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
368
Marketing Vodun. Cultural Tourismand Dreams of Success inContemporary BeninCommercialisation du vaudou. Tourisme culturel et rêves de réussite dans le
Bénin contemporain
Jung Ran Forte
AUTHOR'S NOTE
I wish to thank all the members of the Programme for the Study of Humanities in Africa
(PSHA) hosted by the Centre for Humanities Research, University of the Western Cape,
South Africa, who nourished my work over two years, and the CODESRIA Advanced
Research Fellowship that allowed me to extend my research in Benin. I am particularly
grateful to Jonathan Friedman, Nina Sylvanus, Jill Weintroub and Paolo Israel.
1 There is a sandy road that links the town of Ouidah1 to the Atlantic Ocean’s shore,
passing through the small village of Zoungboji and the lagoon preceding the sea. In the
early 1990s, that path was named “The Slave Route” in the memory of slaves that
walked along it to be embarked there on vessels, bringing them to the New World.
Artworks2, located along the road, were commissioned to commemorate slaves’
journeys and to narrate their stories: the place where captives were detained, the
auction area, and the mass grave’s location (Law 2004; Rush 2001). UNESCO erected a
monument, “The Door of No Return”, at the very final point of departure, in front of
the sea. Since then, many tourists have re-enacted those fictional although
tremendously real passages, walking all along the four kilometres-distance.
2 By the turn of the new millennium, the traffic along the road has increased as two new
hotels, Le Jardin du Brésil and La Casa del Papa, have been constructed in proximity of
the shores. As well, at the circle heading to the beach, where in the late 1990s there was
a shelter selling a few items and warm soft drinks and beers, a new buvette and a small
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
369
boutique of local crafts have been opened. Despite such new developments, the sandy
road shows signs of decline: monuments are covered with dust, damaged and
neglected, while the vegetation is growing over, hiding them from sight.
3 Over a decade, from its very beginning in the early 1990s to present times, Beninese
tourism has experienced many transformations, moving from an initial stage in which
it was associated with governmental policies and international agencies’ programmes
involved in cultural projects and the preservation of the national heritage, to
contemporary ones where private ventures, whether luxury hotels or small, modest
and domestic commerce, dominate the landscape of the tourism economy. It is indeed
toward those pioneering “paths of entrepreneurship”, which have emerged in the
mid-1990s at the margin of institutional programmes—while deeply and ambiguously
embedded in those same national policies—and have today become prominent
templates for economic, “successful” actions in Beninese tourism, that I would like to
draw attention. My aim is twofold: on the one hand I wish to explore practices of
cultural tourism, especially looking at the ways in which tourist commodities are
created and sold. On the other hand, in so doing, my attempt is to illustrate how
tourism matters to local everyday existence not only in economic terms, by allocating
incomes and providing livelihoods, but especially in contouring cultural productions.
4 Drawing linkages between the historical developments of the Beninese tourism
industry and intimate, fictional and orchestrated (Bourdieu 1994) biographies of two
women, I explore how practices and discourses of cultural tourism are crafted and
negotiated in the contemporary Republic of Benin, choosing as a pivotal site of study
encounters between local people and foreign travellers. Life stories are multi-layered
and polyvocal, as composed by a plurality of narrations, equally objectivation and
reconstruction of the lived experience (Ricœur 1990) and emotional memories,
speaking both on the social order and the unconscious, encompassing the self and the
other, although bringing the subject into existence. By putting those narratives into
play, I wish to shed light on the interactive ways in which cultural commodities are
created and complicate further the relationship between “hosts” and “guests”, blurring
boundaries between touristic worlds and local everyday life.
5 As result of the early 1990s cultural policies, Vodun3 religion is today considered as one
of the major assets of the country’s “cultural richness”.
6 Vodun’s presence is particularly crucial in the town of Ouidah, which, while
economically marginal, is considered as one of the more important spiritual and
“traditional” locations. The inclusion of Vodun cults into Beninese tourism markets
constitutes an interesting example for understanding how an everyday religious
practice is transformed into a commodity (marketed and exported), and conversely,
how tourism crucially determines conditions of religious reproduction. As the two
women’s life stories demonstrate, situations in which Vodun practices are sold to
tourists are twofold, as they refer both to the ways in which commodities are created
and to processes through which rituals are invented and innovated. “Sacred
commodities”, even if intended for international tourist markets, transcend the
restricted circles of religious practice that produce them, entering wider religious
arenas, redefining constantly the meanings of “tradition” and “authenticity”.
7 Encounters between local people and tourists provide rich material for understanding
how representations of “Africaness” and commodities are crafted, performed and
negotiated in these dialogical processes. It is indeed in these spaces that governmental
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
370
policies, imperatives from global markets, institutions, international agencies, tourists
and local people come into “friction: the awkward, unequal, unstable, and creative
qualities of interconnection across difference” (Tsing 2005: 4), leading to “new
arrangements of culture and power” (ibid: 5)4.
Auspicious Economic Conjunctures and Glimpses ofthe Future
8 Tourist guides and operators are crucial figures located at the intersection between
global flows and local life. Tourist guides, as legitimate experts and cultural mediators,
stand as the point of entry into a given culture they are supposed to represent at its
best for a foreign audience. From the tourists’ point of view, they embody cultural
meanings and practices, the very essence of a place and a population (Salazar 2005).
The work of the tourist guide indeed discloses processes through which locations are
commodified5, cultures are “exoticised” and “aestheticised”, and histories are
remodelled and turn into coherent narrations (ibid.).
9 In April 2008, during my short-term fieldwork trip, more than six years after our first
encounter, I saw Martine de Souza again. Four years have passed since my last visit to
the country, but Martine’s warm and welcoming smile had not changed at all. She
seemed very proud of her carrier’s achievements, pleased of being able to combine her
personal interests and the earning of an honest living, and eager to work on her new
projects. And then we started talking again about her job, her successes and failures,
her uneasy choices, the past and the future, and being the most prominent (female)
Beninese tourist guide. On the 8th of March 2008, Martine was awarded the Throphée
Amazone (the Amazon Trophy) 6 as an acknowledgement of her commitment to the
development of the country demonstrated over more than ten years with her work in
tourism, cultural exchange and dialogue, and her involvement in information and
awareness campaigns on child trafficking7.
“I would say that I’ve been a tourist guide all my life. As far as I recall, I startedtouring people around Ouidah when I was a teenager and I was attending secondaryschool. It was 1983. My father was a history teacher and was used to tell me thestory of our town and family. Far before Ouidah 1992, my father had already told meabout the story of the Slave Route. Once, friends were visiting him, and he asked meto take the guests for a walk in town. We went together to the Python Temple, themuseum and I told them the history of our family8. I enjoyed that task. Sometimes, Ihad to tour Anglophone friends of my father, and this is how English languagearoused my interest.”
10 While Martine de Souza is today considered one of most known and proficient tourist
guides of the town of Ouidah and of Benin in general, her career had started
accidentally, as she had never attended specific job trainings and she does not hold
certifications in tourism management. The creation of her professionalism has been
nourished by encounters, curiosity, entrepreneurship, personal social skills and
creativity. Yet, today Martine is an expert and qualified tourist guide, largely
appreciated by the tourists she works with, and whose knowledge of Benin and West
Africa goes beyond touristic worlds. She is a public, intellectual figure that acquired
such fame by participating in cultural projects in partnership with the Beninese
cultural department and international TV productions 9. Gifted in languages, Martine
speaks fluent French and English, which is very rare in this Francophone area, but also
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
371
several local languages—Mina, Ewe, Fongbe—which makes her a perfect translator for
tourists, journalists, photographers and scholars. She holds a degree in history and
English literature from the University of Ghana, and she has also published a booklet
collecting Beninese short legends, historical anecdotes and popular proverbs which is
sold at the historical museum of Ouidah (de Souza 2000)10.
11 At the beginning of the 1990s, Martine accidentally met an African American woman,
Sharon11, who had come to Benin to find her roots and to start a spiritual journey.
Because at that time she was the only English-speaker in Ouidah, Martine was “hired”
as a translator. She followed Sharon during her first journey, managing with kindness
and generosity the foreigner’s everyday life and helping her to communicate with
people. At the beginning Martine was not officially paid for her services but rather she
received gifts, meals and occasional loans. Over time, Martine and Sharon became more
than friends. As Sharon was particularly attracted by Vodun and was willing to
undertake several initiations, she planned quite a few trips to Benin over several years,
and each time Martine followed and assisted her. At the time of Sharon’s first voyage,
Martine was Catholic and timorous about inner Vodun cults’ circles. But spending time
with a foreigner and particularly following her steps in Vodun worlds, she realised for
the first time the importance and value of these religious practices.
12 The Republic of Benin experienced the launching of the tourist industry in a period of
political change at the same time as the encounter between the two women. Indeed
Sharon was one of the few tourists that had chosen such an unusual destination. The
severe economic crisis of the late 1980s forced the Marxist-Leninist regime12 to adhere
to structural adjustment programmes (Vittin 1991; Igue & Soule 1992; Banegas 1995;
Mayrargue l995; Gazibo 2005) while the democratic transition was underway13. The
political stability of the country was indeed supposed to facilitate the restructuring of
the economy and the beginning of development and financial programmes (Gazibo
2005). The project of establishing a flourishing tourism industry was at stake, as it
would allow the growth of a stagnant national economy14. According to scholars
(Banegas 2003; Mayrargue 1997), this critical period from 1990 to 1995 can be analysed
as being traversed by a double intertwined movement: the “re-traditionalisation” of
the public sphere and the organisation of “traditional” agents according to modern
patterns. Customary jurisdictions—whether monarchic, traditional or religious—were
restored and refashioned as new crucial political agents and lobbying groups, while a
national cultural identity progressively emerged, anchored on local traditions. At the
same time, under the government’s influence, “traditional” agents reorganised
themselves following institutionalised forms, such as the Council of Kings or the
National Community of Beninese Vodun Cults (CNCVB), in order to achieve
acknowledgment, unity, funds and a growing influence over political affairs (ibid.).
13 Martine admits that meeting Sharon was a turning point in her life. Accompanying her
throughout her travels in Benin has been an informal, albeit professional
apprenticeship thanks to which Martine has learned to be a tourist guide in a time in
which the Beninese tourism industry was beginning to develop. Sharing everyday life
with a stranger changed her gaze on her own culture, habits, values and history, and
particularly on Vodun. As I mentioned before, she was raised in a Catholic family and
thus it is through Sharon that she re-discovered these local, traditional religious
practices. During one of our conversations, she explained to me:
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
372
“Vodun is my tradition, my culture. Vodun can truly help people, no matter wherethey come from. But I also respect different beliefs. This is why Vodun interests meand this is the Vodun I want to show to tourists.”
14 Martine’s statement on Vodun religion refers to a particular set of meanings defining
Vodun religion that emerged and consolidated in the early 1990s. The cultural policies
carried by the first democratic government in those years played a foundational role in
the re-appropriation of Vodun practice by local people as a refashioned folklore, a
national tradition and culture, a World Religion15. Several projects of
patrimonialisation were set up in partnership with international agencies, mainly in
the historical centres of Abomey, Ouidah and Porto Novo16. Likewise, Benin participated
in international programmes, such as UNESCO’s World Heritage and “The Slave Route.”
Aspiring to the valorisation of national, historical, and material and intangible cultural
heritage, these actions also served touristic proposals by creating what today are
considered major tourist sites17. Also because of flourishing cultural activities (Tall
1995a)18, this period could be analysed as a crucial step in crafting a national memory,
the “assembling” of a national heritage that revised history and shaped a particular
gaze on the reconstruction of a pre-colonial past and the transatlantic trade, the
forging of a specific cultural identity and the marketing of cultural meanings (Morales
& Mysyk 2004). These dynamics question how cultural identity and memory are
constructed in light of present political agendas (Friedman 1992; Sutherland 1999, 2002;
De Jorio 2006) and how tourism shapes cultural productions and the manufacturing of
national heritages (Hasty 2002; Day 2004).
15 Taking advantage of the governmental interest in cultural matters of those years,
Martine made contacts with Ouidah’s history museum that was refashioned at the
beginning of the 1990s, and she started to work there as a tourist guide. From those
moving years, she learned to tell to a foreigner audience the story of the town of
Ouidah, its involvement in the Atlantic slave trade during the eighteenth and the
nineteenth centuries, the ancestral tradition of Vodun cults. Her first steps in the
tourism industry demonstrate how at the beginning of the 1990s, the lack of
institutions regulating and organising the market allowed officially unskilled subjects
to enter the system. Cultural and social capitals are employed as job skills to spend in
the market and, in turn, be re-invested toward the creation of new lucrative
professions.
Informal Tourist Economy: The Crafting of VodunCommodities
16 Heritage projects which opened at the beginning of the 1990s have lasted for a decade,
and today a few of their objectives are taken over by the direction of the EPA (École du
patrimoine africain), an academic institution created in 1998 and involved in a regional
programme of action intended for the preservation and maintenance of historical
heritage. By the new millennium, the state’s priorities in tourism matters moved away
from cultural issues toward more pragmatic domains: the diversification of tourist
attractions19, the creation of new tourist sites, as well as the building of infrastructure,
an area which is still precarious and lacking. Likewise, in those years, the need to
organise and regulate this economic sector emerged as a priority. The creation of
regional agencies, the stipulation of new partnerships, the improvement of job training
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
373
and the promotion and organisation of conferences and meetings were ventured as
major requirements.
17 Nevertheless, projects take time to transform into reality and in the meanwhile the
country has experienced a significant influx of tourists. Yet, this economic sector has
continued to grow over the last ten years, depending mostly on personal
entrepreneurship and creativity. Because of the absence of a national institution
regulating the access to the market and the lack of professional training, tourism can
be defined today as a “wild market”, mostly characterised by configurations of informal
and semi-formal economy. The permeability of these spaces, in which different
economic trajectories intersect, allows direct access to individual actors without any
institutional mediation. Communities and individuals promote themselves
spontaneously as tourist guides and operators, designing their own jobs, disclosing a
space in which anyone can be a potential “cultural specialist” and “cultural translator”.
Small budgets enable people to reach cultural and tourist circuits, supposed to grant
them with transitory profits and, possibly, with long-term investments. This is why, in
a landscape deprived of possible lucrative scenarios, even minor tourist activities
become sources of livelihoods that open up new possibilities and promises.
18 As a result of the cultural policies of the early 1990s, today the distinctiveness of the
Beninese tourist industry resides in its supply of Vodun religious experiences. Benin is
widely known as the “cradle of Vodun”, and has established itself as a “root” within
diasporic geographies20. Following formal, as in the case of events such as Ouidah 9221 or
the annual Vodun Festivity22, and informal paths, such as the one of Martine de Souza,
Vodun commodities have entered touristic and cultural markets: it is indeed not only
possible to “see” Vodun (as embodied in folklore, art, history and performances) but
also to experience it directly. Convents23, temples and shrines open their gates and
welcome foreign travellers. Vodun people respond to tourists by providing a wide
variety of experiences that engage travellers directly, inviting them to enter their
everyday life. Ritual practices and ceremonies are adapted, shortened and invented in
order to fit to tourists’ needs. Today, a whole niche of the tourism industry relates to
the trade of religious services. Offering glimpses of “traditional” Africa, the
participation in Vodun rituals and ceremonies allows tourists to satisfy their cultural
curiosity, make contact with local people and share significant moments with them,
experiencing “authenticity” (Craik 1997).
19 Martine was one of the first tourist operators that ventured the inclusion of “religious,”
or rather “spiritual,” experiences into tour programmes. Taking inspiration from the
encounter with Sharon, Martine does not offer impersonal leisure activities, but rather
special and intimate journeys. Indeed, she engages in making the trip an emotionally
intense and life-changing adventure. When she works, she also becomes an empathetic
friend, a good listener and a dynamic and tireless “translator” of Beninese culture.
“A tourist guide must be humble and welcoming. I’m like a sort of psychologist.Because of my experience in tourism, after five minutes of chat, I’m instantly ableto grasp how tourists are and what they need. A tourist guide should be able tounderstand tourists, satisfy them, and follow their moods. With experience, Ilearned how to interact with them, to handle with patience their temper, toappease them and control their whims. I want to show them a beautiful image ofmy country; I’m a sort of ambassador of my country. The thing that I love most ofmy job is that I can meet people from all over the world: it’s like travellingeveryday, without moving!”
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
374
20 To make the trip a unique encounter she carefully organises meetings with local
priests, providing a full range of spiritual experiences, such as divination sessions,
collective basic rituals to propitiate the journey, initiations and personal spiritual
paths. And it is clear that today there is no tourist who goes to Benin and does not want
to “see” Vodun. Her professional accomplishments and popularity in international
tourist markets depends heavily on her human skills. As she told me, from Sharon’s
experiences she learned that the main focus of a trip is not the programme itself—what
makes the voyage successful is the ability of the guide to connect with tourists and
understand their needs. This is why the spiritual experiences she provides are tailored
to each person.
“When I work with a group I try to understand what kind of commitment towardVodun people wish, and therefore I plan only specific rituals in collaboration withpriestesses and priests, who of course profit from these situations, but as I haveknown them for a long time I can testify to their honesty. To meet Vodun can beshocking for foreigners. For instance, I know that not all the people can stand ananimal sacrifice, the sight of blood; they think it’s cruel. So, I try to avoid awkwardsituations. And then, there are people who do not believe and others who do. Thereare people who are ignorant about Vodun and Benin and others who are not. Youmight need years and years to understand what Vodun is. So I prefer to carefullyorganise and plan everything.”
21 For these reasons, while Martine’s Vodun networks are large and extend all over the
country, she prefers to work in partnership with two temples in order to provide
religious, or rather spiritual, services to travellers. In Cotonou she operates with
Hounnongan Joseph Agbegbe Guendehou, registered phytotherapist and healer, vice-
president of the National Beninese Congregation of vodun Thron Kpeto DekaAlafia
(co.NA.Vauth), vice-president of the Beninese National Community of Vodun Cults
(CNCVB), and founder of the Vodun Thron Church and the community Force Tranquille.
With him, she organises prayers to the vodun Thron24 and, if tourists demonstrate a
bigger interest towards religious issues, they also organise initiations or healing rituals
to solve personal problems. As well, Hounnongan Guendehou and his assistants are
available for Fa divination sessions. In ouidah she brings tourists to the well-known
Mami Wata25 priestess, Amegansi Adjobassi.
22 With the participation of the full religious community, they organise a prayer for the
Ocean goddess: a basket with Mami Wata’s favourite offerings is prepared and brought
to the beach at night, and successively delivered to the sea’s waters. Martine is also the
“inventor” of the Beninese version of the “Root Divination”26, which allows African
American travellers to discover their African origins by means of naming the divinity
to which they are dedicated and might address their devotion. With the help of a few
diviners, the bokono, she organises an evening ceremony at the sacred forest of Ouidah.
As she told me, all the participants stand in a circle, while one by one they go in front of
the priest that casting the divination sacred “tools”, delivers the answer.
23 Diverse informal tourist operators have explored similar paths, sometimes with more
or less successful outcomes. However, the extraordinariness and uniqueness of
Martine’s career resides in her ability to transform situations, such as the occasional
encounter with Sharon, into a valued profession capable of lasting. I met Mahinou27 for
the first time in 1999 in Ouidah while I was participating in the activities of an
organised trip to Benin with a small group of European tourists. While Mahinou never
thought about herself as a tourist guide or operator, accidentally she found herself
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
375
working for tourists. Her inexperience did not prevent her from starting, at least for a
while, a flourishing business. However, doing business with tourists is not easy and
conceals its “dangers”.
24 Mahinou became involved in cultural tourism projects in the mid 1990s, a few years
before I met her28. Her cousin, who emigrated to France in the early 1980s, embarked
on a project of cultural tourism despite his unfamiliarity with tourism businesses. He
told me that he was motivated by the desire to help people from his native town and by
the same token, to share his roots and the richness of his culture with Westerners. By
engaging local people in the organisation of the trip he wished to bring money to the
town, supporting friends in their own projects while providing travellers with
authentic experiences of Beninese life and promoting dialogue and understanding
between people from different countries and cultures29. For several years, from the
mid-1990s to the beginning of 2000s, each January, for the duration of three weeks, the
town of Ouidah hosted small groups of European tourists, providing frugal, but
charming, accommodation, spicy homemade meals in local maquis, French-speaking
tourist guides, chauffeurs of wrecked but still running cars offered for adventurous
drives on sandy roads, young music and dance performers to entertain guests all
through the warm evenings and, at last but not least, authentic Vodun ceremonies to
satisfy cultural curiosity, sense of mystery and exotic fascinations.
25 Because most of the travellers were indeed amateur dancers interested in discovering
“authentic” African traditional dances, the major focuses were ceremonies and ritual
practices. The trip offered a large variety of Vodun “activities” or “excursions”:
performances of Egungun masks from Nago-Yoruba tradition 30; annual public
celebrations in convents, private intimate prayers in family-owned temples; divination
session; set of individual-based rituals which were suggested to the participants
according to their needs and willingness to engage with Vodun; participation to the
Vodun Festivity; and visits to local dignitaries, kings and queens. The participation in
local ceremonies was conceived as a special and privileged way to discover Benin. To
see and take part in Vodun rituals was therefore a way to fully understand traditional
dances and music in their original contexts. Performances were also supposed to
engage with tourists directly and actively, not only as spectators but also as effective
members of the community. The closeness with local people, also facilitated by sharing
ritual experiences, and the possibility of establishing long-lasting friendships were at
the core of this project.
Tourists' Money, Social Mobility and the Dangers ofnot Sharing
26 Proficient tourist guides such as Martine de Souza have learned through practice that
Vodun spiritual attractions must be prepared carefully and in detail. To work with
priests and priestess, eager to deal with naïve and demanding tourists wanting to
experience authentic traditional “Africa”, is indeed tricky. This is why Martine has
chosen to provide her clients with only tourist-tailored rituals, created ad hoc, rather
than letting inexperienced visitors to fully enter Vodun community life. To bring
foreign people into inner circuits of religious practice, as well as to encourage their
participation in the community life of cult groups or of villages and towns is difficult
and requires management and relational skills. As Martine told me, it has been quite
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
376
difficult for her to be a tourist guide. Being a woman with a successful career it has not
always been easy.
“I have often been accused of being a prostitute because I was working andtravelling alone with foreigners. People think that if you are going around withmen in the same car, you might be unfaithful. Ouidah is indeed a small town andpeople spread gossip. But I resisted that blackmail and my husband, my sisters andmy mother, who helped me take care of the children while I was working, did thesame. But it’s difficult to work in places like Ouidah where people badmouth you.And this is why today I prefer to stay in Cotonou.”
27 At the same time, people from the temples she collaborates with deeply esteem her
work and her kindness. They know that when Martine can she will bring tourists and
thus financially help them. They trust Martine also because of her religious
commitment, the intimate bond she has with these communities. Working with them
has been an occasion of personal growth. Quite recently she has also started her
spiritual journey. In 2007, a British television arrived in Benin to produce a
documentary on Mami Wata. Martine was hired as local assistant but especially as the
main character of film. Thanks to the financial support of the filmmaker who was
willing to document a story of an initiation to the goddess of the Ocean, she finally had
the money to initiate herself under the guidance of Amegansi Adjobassi. Likewise,
accompanying tourists to visit Hounnongan Guendéhou has been a revelation. Soon she
will be crowned as Thron’s priestess and therefore, as she said, would be able to give
testimony to tourists of what Vodun is through her lived experience. Once again,
widespread rumours about Hounnoungan Guendehou being a deceitful trickster who
concocts rituals for money, do not trouble her.
28 Because tourists are generally equated with money, and considering the precarious
living of most cult groups, Vodun people are very interested in foreigners and
particularly in the profit they implicitly offer to local people. Nevertheless, in Vodun
worlds, doing business with tourists (i.e. providing religious services) is marked quite
ambiguously. For a religious community, to be involved in the tourism industry implies
access to financial resources. Increased availability of funds is associated with notions
of prestige and power, but at the same time, financial gain suggest the lack of
authenticity and the loss of tradition. Priests and Priestesses working with tourists are
often labelled as crooks and charlatans, attracted by easy money and disrespectful of
the teachings of forefathers. Money is at the centre of local conflicts and quarrels that
arise in response to tourist flows. Personal aspirations and everyday basic needs clash
with tourist demands for authentic Vodun, conflicting with local social dynamics and
thereby redistributing possibilities.
29 In 1996, the first trip Mahinou and her cousin organised was scheduled in correlation
with a big religious event of the town of Ouidah. During that year, the convent to which
Mahinou belonged was hosting a large ceremony that engaged the whole community.
This yearly occurrence marks the moment in which divinities visit human worlds,
possessing their initiates. It is a time for animal slaughtering and public rejoicing,
dances and blessings. During ten days, initiates are possessed by the gods and, while
secrecy conceals part of their activities, once a day they parade in public spaces in the
town, giving advice to family members and amusing crowds of people, entertaining
them with dances, music, jokes and spectacular and acrobatic performances. These
ceremonies are very expensive and each member of the religious community and their
families must participate with financial contributions in order to buy animals for
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
377
sacrifices, food for the possessed initiates, sacred items, new dresses for gods
inhabiting human bodies, and to pay musicians and the duties to the convent which
takes charge of the complex logistics of the event.
30 That year Mahinou’s cousin suggested a deal. He asked the hungan (the master of
secrets) for permission to allow tourists to dance with the possessed vodunsi, offering
money in exchange. To dance in public performances with possessed initiates was a
very unusual request as generally no one is supposed to do so. Dancing with gods is
considered dangerous, and the highly choreographed dances—which are learned by the
initiates during their initiatory reclusion in the convent and which are considered
sacred knowledge—are not immediately accessible to people, least of all to European
amateur dancers. Nevertheless, tourists had the occasion to dance publicly with the
gods. For them, it was a very special, unique and authentic experience of transcendence
and immanence, a glimpse of the spiritual and human nature of dance. Most of the
people of Ouidah criticised this experiment. To see tourists disguised as vodunsi—
wearing traditional pagnes and the marks of the gods—dancing the gods’ dances
barefoot in the town’s streets was understood as a betrayal of tradition. Priests,
priestess and initiates involved in this project evaluated the experience in positive
terms. They were proud to notice how people from far-away countries were genuinely
interested in their practices, willing to adapt and share their everyday life. According
to them, critiques and rumours expressed the jealousy of local people who could not
take advantage of the situation and therefore were expressing their resentfulness. Yet,
while the touristic project continued, the experiment of allowing Westerners to dance
with the gods was never repeated. Between Mahinou’s cousin and the convent’s
authorities, an agreement was made. For the time being, tourists would be allowed to
dance but only after the end of the public performance of the vodunsi.
31 In 1998, thanks to the financial help of her cousin, Mahinou decided to build a new
compound outside the town and leave the old family house that was almost in ruins.
But she also had made another plan. Confident of her financial power generously
granted by this family member and his cultural tourism project, she suggested
relocating the annual ceremony of the convent to which she belonged to her new
compound. This move was supposed to bring her gratitude and respect from the
religious community and to add value and power to her status. For several years,
Mahinou hosted the ceremony in her house. However, after a while discontent arose
within the convent’s community. Because Mahinou was thinking that her hospitality,
and especially her funds availability, meant more freedom in decision-making and she
was feeling everyday less willing to share her money with the demanding convent,
restlessness spread throughout the religious community and her mind. Priests and
priestesses described her behaviour as arrogant and disrespectful of hierarchies.
Evaluating the situation, Mahinou, with the practical spirit and impetuosity that
characterise her, opted for a temporary resolution of the problem. She created new ties
and affiliations with other convents in order to find vodunsi willing to participate and
perform at the ceremonies she was still organising for European tourists and in honour
of her own Vodun.
32 The loneliness and the exclusion from the convent’s affairs did not upset Mahinou, who
was determined to see her own project succeed. Realistically she understood she would
never have the moral and technical support of her community that had been like a
family to her. The kind of ceremonies that she was planning to organise for herself and
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
378
for European tourists are highly complex and require a great number of people. The
involvement of the whole community is not only motivated by the large amount of
practical work, but also by the group’s hierarchical structure, which is based on the
unequal distribution of esoteric knowledge. Thus, the organisation of such rituals
cannot be completed by a simple initiate without the help and guidance of priests and
priestesses. In 2001, lacking the help and support she needed, she realised that the only
solution was to become a priestess. In that way, she thought she would have the
authority to lead her own convent, initiate vodunsi and above all, to organise
ceremonies by herself. Once more, the availability of funds provided by her cousin
allowed her to obtain what she wanted. In autumn 2001, she was crowned as priestess
by a priest who, according to rumours, did not have the authority to initiate her to the
priesthood, because he was chief of another divinity. Most of Ouidah’s people decided
against participating in the celebrations and when the newly crowned priestess
paraded along the streets of the town in order to receive greetings form other cult
groups, her ancient convent closed the compound gate as a sign of disagreement.
33 The following year, in 2002, Mahinou, who had become a Nah31, a priestess, once again
organised the ceremonies for the yovo, the “whites”. After more than five years, once
again tourists were allowed to dance with possessed initiates. Rituals were criticised by
Ouidah’s people who condemned them as lacking, disordered, disrespectful and
deceiving. Mahinou was labelled as an illegitimate priestess, a charlatan, but at the
time of the trip, as she was doing plenty of activity with tourists, she did not care. After
the travellers left, Mahinou felt alone. Her cousin was not planning another trip for the
next year, as he was busy with his own work, and most of all, he felt that the project
was drawing to an end32. Mahinou collapsed and fell sick. The severe disease was
aggravating day by day and she could not find a way to treat it. She was sure that the
illness was a witchcraft attack coming from jealous people. However, rumours on the
street differed, suggesting that her disease was a message of Mahinou’s Vodun, Dan
Akpahesou, who was manifesting his discontent toward her behaviour and her deeds.
She had been attracted by the lure of easy money and she had disdained her own
spiritual family. Gods were not pleased by such conduct. Money is such an ephemeral
thing. Indeed, despite the fact that many people from the town had benefited from this
tourism venture, “eating” their part of wealth, at the end Mahinou, or rather Nah, was
left alone.
Conclusion or How to Establish Oneself in the WildMarket
34 To establish oneself in the market is not an easy task. It requires flexibility and
intuition. Martine de Souza has indeed well understood that being able to transform
one’s business is the best way to secure it. Today, she offers all-inclusive trips in West
Africa; she is involved in programmes of “humanitarian tourism” on child trafficking
with North American undergraduate students; US scholars still continue to solicit her
help as research assistant; Martine is also requested as a tourist guide for local and
regional tourism in Benin; and lately she has been involved in the creation of the
Association of Professional Guides of Ouidah (AGAPO) in partnership with the town
council. “It is important to look at things that are not yet in the tourism market, and
then develop your offer”, Martine said to me. Indeed, encouraged by the new presence
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
379
of tourists from Martinique, she is planning to open a Martiniquais restaurant. As she is
bored of touring people to the same places, she is conducting personal research to
discover new tourist sites: a new circuit in the Dassa’s region; the “true” slave route, i.e.
the road that goes from Abomey to Ouidah; the crucial locations between Abomey and
Porto-Novo, in which the struggle of King Behanzin against French colonial rule took
place. But as she vigorously attested, whatever might happen, one has to hold on to
her/his working ethic: “Popularity means to do things in the best way as possible, with
the conscience that we are working for people and not for money.”
35 In this article I have investigated the landscape of contemporary Beninese tourism,
capturing the ways in which cultures and identities are commodified and lived
experiences are turned into objects of trade. Following the paths through which Vodun
“sacred” commodities have entered tourist and cultural markets becoming objects of
economic transaction, I have suggested that in order to fully understand such processes
it is necessary to look at the social dynamics in which these cultural productions are
inscribed and at the linkages existing between tourist commodities and the politics and
strategies that surround and reproduce them.
36 Martine de Souza’s and Mahinou’s “careers” present exceptional and innovative
features as they both started working with travellers when the tourism industry was
taking its first steps. It was a moment in which major heritage projects were launched
and cultural events were organised throughout the country. In those years of cultural
effervescence, these women had the clairvoyance to anticipate a trend which would
become a large part of the tourist market: the one of “sacred commodities”. Their
imagination, creativity and resourcefulness have led them to the crafting of religious
services for tourists that previously did not exist. Facing foreigners and their needs,
they have challenged social institutions and religious hierarchies, opening new paths of
development for the Vodun community at large. Encounters between “hosts” and
“guests”—both as methodological and theoretical standpoints—allow tourism to
intersect with trajectories of cultural production, enabling us to look at the ways in
which representations are constructed at the crossroads of local life and tourist flows.
It is in these spaces of contact between locals and tourists that new practices and
meanings emerge, where personal interests and motivations, community life and
tourist aspiration, governmental policy and development strategies merge.
37 The question of “authenticity” and “tradition” must be addressed, as it comes into view
as a crucial issue, linking local life and tourist worlds. Vodun commodities are supposed
to be imbued with tradition, an essence and a specificity that make them authentic. In
this context, notions of tradition re-actualise the “metaphysic of difference”—the
imaginary of Africa and Africans as different from the West because they are anchored
in tradition and customs (Mbembe 2000, 2001). However, authenticity that derives from
tradition and that marks “natives” and commodities in such distinctive ways does not
appear to be secure and stable, but rather it is haunted by “modernity”, and negotiated
(validated) through dialogue. Thus, these “practices of authenticity” indicate ways
through which authenticity operates by actualising dynamics of inclusion/exclusion. If
tradition, as history, refers to the ways in which people construct meaningful worlds,
then its crafting stands as an act of self-definition, an appropriation of life and
empowerment (Friedman 1992). Legitimating degrees of “Africaness”, pointing at
impostors and traitors of tradition, and validating touristic experiences as well as the
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
380
“trueness” of rituals and celebrations, the negotiation of authenticity distributes
possibilities and opens up futures.
BIBLIOGRAPHY
APTER, A.
1992 Black Critics and Kings: The Hermeneutics of Power in Yoruba Society (Chicago: Chicago University
Press).
1993 “Attinga Revisited: Yoruba Witchcraft and the Cocoa Economy, 1950-1951”, in J. COMAROFF &
J. COMAROFF (eds.), Modernity and Its Malcontent. Ritual and Power in Postcolonial Africa (Chicago: The
University of Chicago Press): 111-128.
BAKO ARIFARI, N.
2001 “La corruption au port de Cotonou : douaniers et intermédiaires”, Politique africaine 83 :
38-58.
BANÉGAS, R.
1995 “Mobilisations sociales et opposition sous Kérékou”, Politique africaine 59 : 25-44.
2003 La démocratie à pas de caméléon. Transition et imaginaires politiques au Bénin (Paris : Karthala).
BASTIAN, M.
1997 “Married in the Water: Spirit Kin and Other Afflictions of Modernity in Southeaster
Nigeria”, Journal of Religion in Africa 27 (2): 116-134.
BOURDIEU, P.
1994 Raison pratique. Sur la théorie de l’action (Paris : Éditions du Seuil).
CLARKE, K.
2004 Mapping Yoruba Networks: Power and Agency in the Making of Transnational Communities
(Durham-London: Duke University Press).
2006 “Mapping Transnationality: Roots Tourism and the Institutionalization of Ethnic Heritage”,
in K. CLARKE & D. THOMAS (eds.), Globalization and Race. Transformation in the Cultural Production of
Blackness (Durham-London: Duke university Press): 133-153.
2007 “Transnational Yoruba Revivalism and the Diasporic Politics of Heritage”, American
Ethnologist 34 (4): 721-734.
CRAIK, J.
1997 “The Culture of Tourism”, in C. ROJEK & J. URRY (eds.), Touring Cultures. Transformations of
Travel and Theory (London-New York: Routledge): 113-136.
DAY, L.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
381
2004 “What’s Tourism Got to Do With It? The Yaa Asantewa Legacy and Development in
Asanteman”, Africa Today 51 (1): 99-113.
DE JORIO, R.
2006 “Introduction to Special Issue: Memory and the Formation of Political Identities in West
Africa”, Africa Today 52 (4): v-ix.
DREWAL, H. J.
1988 “Mermaids, Mirrors and Snake Charmers: Igbo Mami Wata Shriners”, African Arts 21 (2):
38-45.
1996 “Mami Wata Shrines: Exotica and the Construction of Self”, in C. GEARY, M. J. ARNOLDI & K.
HARDIN (eds.), African Material Culture (Bloomington: Indiana University Press): 308-333.
EBRON, P.
2002 Performing Africa (Princeton: Princeton University Press).
FRIEDMAN, J.
1992 “The Past in the Future: History and the Politics of Identity”, American Anthropologist 94 (4):
837-859.
1994 Cultural Identity and Global Process (London: Sage).
GAZIBO, M.
2005 “Foreign Aid and Democratization: Benin and Niger Compared”, African Studies Review 48 (3):
67-87.
HASTY, J.
2002 “Rites of Passage, Routes of Redemption: Emancipation Tourism and the Wealth of Culture”,
Africa Today 49 (3): 47-76.
IGUE, J. O. & SOULE, B. G.
1992 L’État entrepôt au Bénin : commerce informel ou solution à la crise ? (Paris : Karthala “Économie et
développement”).
JEWSIEWICKI, B.
2003 Mami Wata. La peinture urbaine au Congo (Paris : Gallimard).
JOURNAL FRATERNITÉ
2008 “De braves béninoises couronnées”, 10 mars 2008. <www.fraternite-info.com>.
JOURNAL LE MATINAL
2008 “L’Ong ‘Jpg-Bénin’ honore les femmes...”, 10 mars 2008.
LAW, R.
2004 Ouidah. The Social History of a West African Slaving “Port” 1727-1892 (Athens-Oxford: Ohio
University Press).
MATORY, L. J.
1993 “Government by Seduction: History and the Tropes of ‘Mounting’ in Oyo-Yoruba Religion”,
in J. COMAROFF & J. COMAROFF (eds.), op. cit.: 58-85.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
382
1994 Sex and the Empire that Is No More. Gender and the Politics of Metaphor in Oyo Yoruba Religion
(Minneapolis-London: University of Minnesota Press).
2005 Black Atlantic Religion. Tradition, Transnationalism, and Matriarchy in the Afro-Brazilian Candomblé
(Princeton-Oxford: Princeton University Press).
MAUPOIL, B.
1981 [1943] La Géomancie à l’ancienne Côte des Esclaves (Paris : Institut d’ethnologie, Musée de
l’homme).
MAYRARGUE, C.
1995 “Le religieux et les législatives de mars 1995 au Bénin”, Politique africaine 58 : 157-162.
1997 “Démocratisation politique et revitalisation religieuse. L’exemple du culte vodun au Bénin”,
in F. CONSTANTIN & C. COULON (dir.), Religion et transition démocratique en Afrique (Paris : Karthala) :
135-161.
MBEMBE, A.
2000 “À propos des écritures africaines de soi”, Politique africaine 77 : 16-43.
2001 On the Postcolony (Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press).
MORALES, C. & MYSYK, A.
2004 “Cultural Tourism, the State and Day of the Death”, Annals of Tourism Research 31(4): 879-898.
RICŒUR, P.
1990 Soi-même comme un autre (Paris : Éditions du Seuil).
ROSENTHAL, J.
1998 Possession, Ecstasy and Law in Ewe Voodoo (Charlottesville-London: University Press of
Virginia).
RUSH, D.
1999 “Eternal Potential Chromolithographs in Vodunland”, African Arts 32 (4): 60-96.
2001 “Contemporary Vodun Arts of Ouidah, Benin”, African Arts 34 (4): 32-95.
SALAZAR, N. B.
2005 “Tourism and Globalization. ‘Local’ Tour Guiding”, Annals of Tourism Research 32 (3): 628-646.
SALMONS, J.
1977 “Mami Wata”, African Arts 10 (3): 8-15.
DE SOUZA, M.
2000 Regard sur Ouidah (A Bit of History) (Cotonou: B.3.P).
SUTHERLAND, P.
1999 “In the Memory of the Slaves: An African View of the Diaspora in the Americas”, in R. J.
MUTEBA (ed.), Representations of Blackness and the Performance of Identities (Westport: Bergin &
Garvey): 195-211.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
383
2002 “Ancestral Slaves and Diasporic Tourists: Retelling History by Revisiting Movement in a
Counternationalist Vodun Festival from Benin”, in T. FALOLA & C. JENNINGS (eds.), Africanizing
Knowledge. African Studies Across the Disciplines (New Brunswick: Transaction Publishers): 65-85.
TALL, E. K.
1995a “De la démocratie et des cultes voduns au Bénin”, Cahiers d’Études africaines XXXV (1), 137 :
195-208.
1995b “Dynamique des cultes voduns et du Christianisme céleste au Sud-Bénin”, Cahiers des
sciences humaines 31(4) : 797-823.
TSING, A. L.
2005 Friction: An Ethnography of Global Connections (Princeton-Oxford: Princeton university Press).
VITTIN, T. E.
1991 “Bénin du ‘système Kérékou’ au renouveau démocratique”, in J.-F. MÉDARD (dir.), États
d’Afrique noire. Formations, mécanismes et crise (Paris : Karthala) : 93-115.
NOTES
1. “Ouidah is situated in the coastal area (in the Department of Atlantique) of the modern
Republic of Benin (formerly the French colony of Dahomey) in West Africa. In origin, it is an
indigenous African town, which had existed long before the French colonial occupation in 1892.
In the pre-colonial period, it had belonged successively to two African states, first the kingdom of
Hueda (whence the name ‘Ouidah’) and from 1727 that of Dahomey, from which the French
colony took its name [...]. Today, Ouidah has a population of around 25,000 [...]. In the pre-
colonial period, however, Ouidah was the principal commercial centre in the region and the
second town of the Dahomey kingdom [...]. In particular, it served as a major outlet for the
Atlantic slave trade. [...] Ouidah was a leading slaving port for almost two centuries, from the
1670s to the 1860s” (LAW 2004: 1-2).
2. The Beninese contemporary artists whose work was exhibited in the context of Ouidah 92,
when the artworks where commissioned, were Cyprien Tokoudagba, Calixte and Theodore
Dakpogan, Simonet Biokou, Dominique Kouas, Romuald Hazoumé, and Yves Apollinaire Pédé. The
contributions of African diaspora artists were commissioned to Édouard Duval-Carrié (Haïti), José
Claudio (Brazil), and Manuel Mendive (Cuba) (RUSH 2001).
3. The term Vodun is polysemic as it simultaneously indicates a set of cults dedicated to different
divinities belonging to the same pantheon and supernatural beings—gods, spirits, natural forces
and ancestors in both embodied, fetish and immaterial forms. The specificity of Vodun worship
resides in gods’ feeding sacrificial rites, in possessions and in its organisation based on esoteric
knowledge, priesthood hierarchies and initiation admission. The relevance of the Vodun religion
must be understood in light of the crucial and complex role it played in the history of the
country, particularly during the pre-colonial period in which the political kingdom’s structure
was deeply intertwined with the cults’ system, often defined as a sort of state-religion (MAUPOIL
1981). Through the Atlantic slave trade, these cults reached the New World, originating a wide
set of ritual practices often labelled as Afro-American religions (MATORY 2005; SUTHERLAND 1999,
2002). I will employ the spelling Vodun following the local use, which is generally associated to
French spelling. Vodun divinity names are both used to indicate a god and an initiated
worshipper (as the embodiment of the divine essence). Therefore, in this paper I will
differentiate applying capital letters to refer to the former and small capitals to refer the latter.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
384
Likewise, I employ Vodun to indicate this religious system as a whole and vodun as a synonym of
god. As well, there is no use of plurals, which must be deducted by the context. Vodun divinities
are gendered; while certain gods have a distinct gender, in most cases, each of them has both a
female and male manifestations and devotees.
4. The data presented in this article was collected during 12 months of fieldwork in Benin, which
I conducted for my doctoral dissertation from 2001 to 2004. More recent data has been collected
in March and April 2008. The reconstruction of Martine de Souza’s and Mahinou’s life stories
were made through several interviews with a different range of people from the town of Ouidah.
I visited many times the temple of Hunnongan Guendehou in Cotonou and I closely followed the
activities of the Mami Wata convent of Amegansi Adjobassi at each field trip, over four years. I
also participated in two three-week tourist trips organised by Mahinou and his cousin (who
asked to be anonymous), in 1999 and 2002 and I researched Mahinou religious activities during
the twelve-month period of my fieldwork.
5. By using the term “commodification”, I refer to processes through which culture, conceived as
a product and a thing, “is culture disembodied from experience. It is culture neutralized and
turned into objects of consumption” (FRIEDMAN 1994: vi). Such dynamics implies a particular
reflection upon a given culture, as well as the individuation of a certain set of elements supposed
to characterise it distinctively. It is in some way a move that describes both a de-familiarising
gaze from the everyday and the known and a formalising process of construction of meanings.
6. The Trophée Amazone—so called in reference to the famous female military army of the kings of
Dahomey, the Amazons—which celebrated its 5th edition on the 8 th of March 2008, is annually
organised by the NGO Jpg-Benin (Jeunesse-perspective-groupement) in order to acknowledge those
leading, Beninese women who exceptionally revealed themselves in their different domains of
action during the year. Along with Martine de Souza, the singers Edia Sophie and Sèna Joy have
equally been awarded during the celebration at the CNCB (Conseil national des chargeurs du
Bénin). (Le Matinal, 10 mars 2008 ; <http://www.fraternite-info.com/article.php3?
id_article=872>).
7. From 1998 to 2001 Martine has worked with the World Bank as a local assistant in a project on
poverty and the exploitation and trafficking of children in rural areas. A few years after that
experience, she enquired about films that were produced during that project and stored in the
World Bank’s offices in Cotonou. She decided to create a NGO and with the collaboration of
UNICEF and Terre des Hommes (TDHIF) she travelled from village to village to show the
documentaries in order to “awaken” the conscience of poor, rural people and explain how child
trafficking operated.
8. Martine is one of the numerous descendants of the Brazilian Francisco Félix Chacha de Souza,
well-known slave trader who settled in Benin in the 1820s. The de Souza compound hosts a
family museum dedicated to the memory of the ancestor. The Slave Route and the Python
Temple, Dangbé, are among the most important tourist attractions of the town of Ouidah.
9. Such as African Wonders directed by Professor Henry Luis Gates Jr. and produced in 1999 by
PBS, in which Martine tours Professor Gates around the town of Ouidah, but also National
Geographic, BC “Time Watch”, NBC, etc.
10. Personal website: <http://www.beninguide.com>.
11. Sharon Caulder wrote a published, autobiographical novel, “Mark of Voodoo: Awakening to
My African Spiritual Heritage”, that collects memories from her travels to Benin, with particular
regard to her spiritual journey. However, Martine disagreed with most of the contents of the
book, and it is that dissent between the two that led to the end of their relationship.
12. Independence (1960) was followed by a period of political instability. In 1972 with a military
coup d’Etat, Mathieu Kérékou obtained power and few years later, in 1975 the country became the
Popular Republic of Benin in order to emphasise the government adhesion to Marxism-Leninism
that would last until the end of the 1980s.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
385
13. The state legitimacy was undermined by the economic crisis, ultimately linked to the general
world economic crises of the mid 1980s and particularly to changes in the oil market, and the
consequent Nigerian recession (VITTIN 1991).
14. Since independence in 1960, the Beninese economy was built on a system of importations and
re-exportations on a regional basis. In such context, the role played by the state was decisive in
enforcing strategies facilitating the transfer of goods—État entrepôt (IGUE & SOULE 1992). Indirectly
taking advantage of its geographical location, Benin has built its economy on the transit and
provision of natural resources of neighbour states, carrying out a policy of liberal trade, fiscal tax
reductions, and a decrease in customs duties, allowing the weakening of national borders (ibid.).
As result of such policies, the Beninese economy was heavily dependent on neighbouring states
because it was based on trade revenues. Likewise, the permeability of national borders, and
dependency on foreign imports, especially from Nigeria, has eased the flourishing informal
economy, predominantly on the trade field (BAKO ARIFARI 2001). Even though this economic
system experienced a severe crisis in the 1980s, it still persists today. The intense activity of the
port of Cotonou, which is the most important in the region, and the Sémé-Kraké’s border
between Benin and Nigeria are certainly proof of such economic strategies. At the beginning of
the new millennium, approximately 75% of the whole national budget came from fiscal incomes,
of which 45% originated from customs duties (ibid.).
15. A priest elite rose under governmental influence, attempting to modify certain cult features
considered antiquated and to shape an official, but unique image capable of withstanding
comparisons with other World Religions (MAYRARGUE 1997). The path toward the “modernisation”
of Vodun cults was an answer to different requests: the governmental need of an institutionally
unique referent structure for the entire Vodun community (ibid.), the growing transnational
project of a World Religion constitution (CLARKE 2007), grouping all the different branches of
Afro-American religions, but also the local determination to reform Vodun in order to guarantee
its existence.
16. The objectives of such projects, mainly carried out by PREMA of ICROM, in collaboration with
different European Cooperation departments and agencies, universities and institutions were: to
arrange historical sites, to safeguard immaterial heritage, to retain colonial ethnographic
museums of Abomey and Porto-Novo, to set up a historical museum of Ouidah and to preserve
and maintain royal palaces in Abomey and Porto Novo.
17. Ouidah’s “Slave Route”, Abomey’s and Porto-Novo’s Royal Palaces and Historical museums,
alongside the lacustrine villages of Ganvie and Aguegue and the National Park of Penjari are
considered as the key tourist locations.
18. The International Festival of Vodun Cultures and Arts Ouidah 92; the Regional Gani Festival,
Nikki (North of Benin); the Biennale of Popular and Religious Dances, Abomey; The Guelede Masks’
Festival, Porto Novo; The Yeke Yeke Regional Festival, Mono (TALL 1995a).
19. The programme of the Beninese government (<www.gouv.bj>, “Programme de
développement économique”, Governmental report 2001-2006, December 2006) focuses on: the
promotion of ecotourism in the National Pendjari Park; the development of “business tourism”
(le tourisme de congrès et le tourisme d’affaires) in urban centres; the promotion of seaside and
resort locations; the arrangement of the Fishing Route (Route de Pêches)—connecting Ouidah to
Cotonou—for tourists (to improve economic and social, durable development); the safeguard of
intangible heritage linked to the Guèlèdè marks recently listed as World Heritage by the UNESCO
(creation of a research centre for the documentation, information, the training and performing
arts).
20. Benin, as well as Nigeria and South Togo, is indeed considered to be a “sacred centre and
origin place of diaspora culture” (SUTHERLAND 1999: 202). On diasporic geographies see also
CLARKE (2004, 2007), MATORY (2005).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
386
21. The international festival, Ouidah 92: retrouvailles Amérique-Afrique organised in 1993
celebrated Vodun “cultures” and arts in their national and transnational dimensions. Vodun was
presented to the world as a cultural heritage, a national treasure and a source of artistic
inspiration. Even if the festival engaged few Beninese towns, the choice for the official event’s
location was again the small town of Ouidah, through which, in pre-colonial times, the slaves
passed through before leaving their homeland. Following a developmentalist perspective, Ouidah
92 was supposed to crucially contribute to the promotion of tourism and cultural industries (TALL
1995a; RUSH 2001). Moreover, the Atlantic trade was officially celebrated one year later with the
UNESCO transnational project “The Slave Route”.
22. Being a national holiday, a local community spiritual appointment and an internationally
popular tourist attraction, the Vodun Festivity—celebrated every year on the 10th of January—
defines a particular space in which political, economic, religious and cultural interests are
performed, debated and negotiated in their local and global dimensions. Recently invented in
1996, and motivated by a political rationale, this celebration is supposed to enact an ancestral
religion and to be illustrative of the “authentic Beninese tradition”, while at the same time it
constitutes a political arena in which the Vodun community negotiates and renovates its political
role within civil society (SUTHERLAND 1999, 2002; MAYRARGUE 1997).
23. The term “Convent” is currently used as the French translation of the Fongbe word hunkpame
or vodunkpame, which indicate the Vodun enclosure in which temples are located. Initiations take
place in that sacred space, the access to which is restricted.
24. The vodun Thron Kpeto Deka Alafia, and its associate cult Thron II, dates from colonial times
and for that reason, and also for their syncretic character that mixes trances with elements from
Muslim and Christian traditions, they were labelled as “new cults” (TALL 1995b). Originally, their
diffusion along the Bight of Benin from Ghana to Nigeria is associated with witchcraft hunting
(APTER 1993; ROSENTHAL 1998). Today the anti-witchcraft feature is still crucial as these cults
offer protection and wealth to their worshipper.
25. The spread of Mami Wata cults in West and Central Africa dates from the colonial times at the
beginning of the 20th century (DREWAL 1988), however linkages are traced back to the 15th century
with the arrival of the first Portuguese ships. Mami Wata’s appearance as a mermaid is both
related to the diffusion of a German chromolithograph of an Indian snake charmer (ibid.) and to
indigenous traditions of aquatic spirit worshipping. However, in Benin, Mami Wata is often
referred as the Mina version of the vodun Dan Aido Wedo, and is fully integrated within the larger
Vodun pantheon. As metaphor of African modernity’s contradictions (BASTIAN 1997; JEWSIEWICKI
2003), the persona of Mami Wata has also inspired a flourishing popular art production
throughout the continent. The presence of Indian elements in Mami Wata’s iconography
(SALMONS 1977; RUSH 1999; DREWAL 1988, 1996) and religious practice reformulates the question of
the hybridity and provenance of this spirit, as well as the way in which people appropriate
foreigner elements in the construction of their worlds.
26. The Martine’s “Root Divination” provides consists of a shorter and basic version of a normal
Fa divination session that is particularly requested by African Americans willing to discover their
African roots. The name of the ritual is clearly imported by uS tourists, however the content is
grounded in Vodun local knowledge. This kind of ceremony refers also to naming ceremonies
that are performed for African American tourists in different West African locations (EBRON 2002;
CLARKE 2004, 2006). In the US American, Yoruba revivalist context, Root Divination refers to
“divinatory rites with which priests in their community consult the oracle to determine the
nature of their African roots [...], the generality of ancestry” (CLARKE 2004: xvii).
27. Mahinou is one of the sacred names that qualifies an initiate of the vodun Dan Aido Wedo, the
rainbow snake who bestows prosperity and wealth. It is attributed to a person dedicated to this
divinity during the initiation rituals, and thus it indicates a specific embodied manifestation of
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
387
this god, as well as a hierarchical positioning of the devotee in reference to the whole cult’s
group and the religious society at large. By denoting the ranking of an individual in the
community, this name is associated to a set of relationships (of dependency and alliance) that, in
the form of rules and duties, determines the individual and social identity of a person and
therefore his or her space of action within the community.
28. Mahinou is today in her late thirties. She lives with her elderly mother as she is not married
and does not have children. She was initiated when she was a teenager, because she was “chosen”
(or rather destined) to take on family religious duties. For several years, she was secluded in a
convent in order to accomplish her initiation rituals. Like most initiates—the vodunsi, literally the
“wife of the vodun”: term which is applied regardless of the gender of the worshipper (on
“wives” of the gods and the trope of “mounting” see MATORY 1993, 1994)—, especially form rural
areas, Mahinou did not attend secondary school and she speaks poor French. Her revenues come
from religious services and small commerce.
29. In 2002, excluding the plane fare, the cost of the trip of three weeks was about 500 €,
including accommodation, meals, daily dance classes, transports and the participation to
ceremonies.
30. Ancestor masks from the Yoruba tradition, the Egungun cult, related to a male secret
initiation-based society, are widespread in the area of Ouidah and Porto-Novo.
31. Nah is the title that is given to a priestess. It signifies the highest rank in the hierarchy that
composes a cult’s group. A priestess, as well as a priest, has the power and the knowledge to
initiate an individual, i.e. to transform a person into a vodunsi. A Nah, which represents the female
principle of the cosmological order, is the counterpart of a hounnon, the male cult chief (also
named Dah), and together they organise community religious life. In large convents—considering
the latter as a religious community unit—there are more than a Nah, as the title not only
indicates the priestess at the top of the hierarchy, which of course has more power than the
other ones, but also allocates a status that is achieved by elder female initiates as a sign of
recognition of the amount of sacred knowledge and ritual mastery that are acquired through
experience, over time.
32. For the next year, in January 2009, after seven years, a new trip has been scheduled and
advertised. The cost of the two week-stay of 995 € is comprehensive of transports (excluding air
fare), accommodation, meals, day-trips, and dance and music classes.
ABSTRACTS
Since the 1990s the Republic of Benin, following a path similar to other West African countries,
has established itself as a destination for cultural tourism, in which history, ethnic traditions,
ancestral values and indigenous knowledge figure as main attractions. The study of recent
developments of the Beninese tourism industry sheds light on the ways in which meanings and
commodities are produced in encounters between "hosts" and "guests". Reconstructing the
polyvocal biographical narratives of two women engaged in tourism activities—a tourist guide
and a Vodun priestess— I analyse local responses to tourists' flows while addressing questions of
cultural consumption and the harshness of global markets. In order to understand how
representations of "Africaness" and "tradition" are produced and negotiated and how cultures
are commodified and transformed into artefacts of economic transactions, this paper draws
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
388
attention to the dynamics through which Vodun cults have been refashioned as a national
cultural heritage and a sites of the Atlantic Slave Trade memory, becoming the main cultural
assets of the country for international audiences. By blurring boundaries between tourist worlds
and everyday life, combining national policies and intimate stories, I look at the ways in which
local agents perform and resignify their culture and experience encounters with "others", while
exploring paths of "entrepreneurship" and success.
Depuis les années 1990, tout en suivant un chemin similaire à ceux d'autres pays de l'Afrique de
l'Ouest, la République du Bénin s'est lancée dans le domaine du tourisme culturel dans lequel
l'histoire, les traditions ethniques, les valeurs ancestrales et les connaissances indigènes
apparaissent comme des attractions principales. L'étude des développements récents de
l'industrie touristique béninoise illustre les façons par lesquelles les significations et les biens
marchands sont produits dans les espaces de rencontre entre les touristes et les « hôtes ». Par la
reconstruction des récits biographiques polyvocaux de deux femmes engagées dans le tourisme
— un guide touristique et une prêtresse vodun —, j'analyse les réponses locales aux flux
touristiques, tout en questionnant l'enchevêtrement des marchés globaux et des circuits de
consommation culturelle. Dans cet article, l'appréhension de la production de l'« Africanité » et
de la « tradition », ainsi que l'objectification de la culture en biens marchands sont éclaircies par
l'examen des dynamiques qui ont transformé les cultes vaudou en héritage culturel national,
mémoire de l'esclavage et, par la suite, en attraction touristique. En brouillant la distinction
entre mondes touristiques et vie quotidienne, et en juxtaposant les politiques étatiques aux récits
de vie, cet article rend compte du point de vue des agents locaux, des façons par lesquelles ils
performent et perçoivent leur culture dans la rencontre avec les « autres », en devenant
« entrepreneurs » et en aspirant au succès.
INDEX
Keywords: Benin, biographical narratives, cultural artefacts, cultural tourism, encounters,
marketing vodun, sacred commodities, Vodun religion
Mots-clés: Bénin, récits biographiques, biens marchands sacrés, objet culturel, tourisme
culturel, rencontres, commercialisation du vaudou, religion vaudou
AUTHOR
JUNG RAN FORTE
Centre for Humanities Research, University of the Western Cape, Cape Town, South Africa.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
389
Back to the Land of Roots. AfricanAmerican Tourism and the CulturalHeritage of the River GambiaRetour au pays de Racines. Le tourisme africain-américain et l'héritage culturel
du fleuve Gambie
Alice Bellagamba
“There’s an expression called the peak
experience’.
It is that which emotionally nothing in your life
ever can transcend.
And I know I have had mine that first day in the
back country in black West Africa.
When we got up within sight of the village of
Juffure the children who had inevitably been
playing outside African villages, gave the word
and the people came flocking out of their huts.
It’s a rather small village, only about 70 people.
And villages in the back country are very much
today as they were two hundreds years ago,
circular mud huts with conical thatched roofs”
(Haley 1973: 13-14).
1 In the late 1960s, the African American journalist and novelist Alex Haley discovered
the small rural village of Juffureh at the mouth of the River Gambia. By relying on oral
sources and other methods that were criticised by academic historians, Haley identified
the settlement as the place where slave traders kidnapped his ancestor Kunta Kinte so
as to sell him as a slave on the other side of the Atlantic (Vansina 1994: 149-150; Dorsch
2004: 104)1. Within a few years, the publication of the novel, Roots, in 1976 and the
production of a TV series with the same title brought the Republic of The Gambia to the
attention of the international community. A tradition of meetings and interactions
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
390
between Gambians and African American tourists was thus inaugurated and was to
expand in the decades to come.
2 Juffureh rapidly became a preferred destination for the daily excursions, organized by
tourist resorts, which during the 1970s developed close to the capital city of Banjul
(Harrell-Bond 1979; Dieke 1994)2. The small community got electricity, water pipes and
other facilities largely unknown in many rural areas of The Gambia.
3 Today, tourist guides bring visitors to the compound of the Kinte family, where till
some years ago they met Binta Kinte, an old lady who was introduced as one of the
living descendants of Kunta Kinte. After her death relatives from the family have begun
to perform the same task. The history of Juffureh is narrated and integrated with
details on Haley’s relationship with the Kinte family. Guides explain how the new
mosque of the village, which was completed in 1999, was dedicated to his memory. A
photograph of Haley surrounded by the villagers is shown together with pictures from
the TV series. In other terms, Roots has been locally appropriated carving out a niche for
The Gambia in the popular image of the homeland constructed by and circulated within
the African diaspora (Howe 1998: 108).
4 In the following pages, I have taken two cultural initiatives in the late 1990s as the
starting point for an examination of how in recent times government and private
agencies have exploited the heritage of the Atlantic slave trade as an attraction for
African American tourists3. The first was the establishment of a museum of slavery in
the old Albreda trading post, which is close to Juffureh4. The second was an initiation
ceremony organised by an American travel agency for a group of African American
College students, which I had the chance to attend in 20005. The event took place in
Medina, a Jola village not far from the capital city of The Gambia6. For more than a
week twenty-two teenagers, three teachers and the travel agent that promoted the
tour, took part in a busy program of cultural events designed to convert them into the
“true” sons and daughters of Africa. They were adopted by local families, and were
considered by Medina villagers as though they were members of the community who
had migrated abroad and had returned home to be initiated into the local cultural
tradition. New clothes in an African style were sown for them. Girls attended courses
on cooking and domestic tasks. Boys were taught about the virtues of manhood and the
importance of respecting their elders. At the end of the week, the village notables
officially proclaimed the African American students’ coming of age as adult men and
women. I will examine the significance of this experience for the participants in the
process and comment upon their different (and conflicting) agendas and aspirations.
Focus will be more on the perspective of the villagers than on that of their African
American guests, so as to balance the latitude accorded to the latter in the literature on
Roots tourism in West Africa (Ebron 1999; Hasty 2002; Holsey 2004). Medina community
welcomed the tour of African American College students as an opportunity of
development from below. This perception was based on both strictly economic
considerations (the injection of foreign currency caused by the visitors’ presence in
their community) and a broader policy aimed at establishing lasting personal
relationships with citizens from the other side of the Atlantic, which would prove
useful either to sponsor local projects of development or to sustain the emigration
projects of some of the local youth to the United States. Whether the expectations of
the villagers were even partially fulfilled is what I attempt to assess in this essay. As
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
391
Buzinde and Almeida Santos (2008: 485) recently maintained, tourism can either help
resolve or perpetuate socio-economic problems.
Gambian Cultural Policies and the Public Memory ofthe Atlantic Slave Trade
5 During the 1970s, the government of The Gambia actively tried to preserve the national
cultural heritage. First, it established the Cultural Archives to collect historical
traditions of the pre-colonial period as well as material artefacts, which in 1985 would
be used to create the National Museum of The Gambia. Then, in 1979 the Oral History
and Antiquities Division (OHAD) inherited the legacy of the Cultural Archives.
Immediately after the publication of Roots, the new institution took up the task of
promoting Juf- fureh. The OHAD sponsored the creation of an Arts and Crafts Market so
that the young artisans from the village and from other areas of The Gambia could
benefit from the increasing numbers of visitors. It advised the villagers to improve
facilities and sanitation and carried out research into the major historical sites
associated with the history of Atlantic slave trade. One of these was Fort St. James,
which is located on a small island just in front of Juffureh. During the seventeenth and
eighteenth centuries this site was home to the representatives of the Royal African
Company. Another was Fort Bullen, which was built by the British at the mouth of the
river after the formal banning of the Atlantic slave trade by the British Parliament in
1807. Fort Bullen and the British flag which stands in Albreda today, as well as the
treaties stipulated with local rulers in order to stop the illicit shipping of slaves
towards the Americas, symbolize British abolitionist trend during the nineteenth
century7.
6 The OHAD officials interviewed elders who lived in proximity of the two forts in order
to collect as much historical documentation as possible. The recorded narratives were
stored in the archive, which the OHAD had established in the capital city (Galloway
1976a, 1976b, 1981). Currently, such archive of tapes, transcriptions and translations is
one of the major sources of information to reconstruct the pre-colonial history of this
area of West Africa.
7 In spite of such efforts, the issues of slavery and slave trade never really captured the
attention of the larger public. The research priorities of OHAD focused on highlighting
the connections of indigenous pre-colonial polities to the larger historical space of the
Senegambia region rather than emphasising their links with the Atlantic world (Wright
1991; Bellagamba 2006). Slavery belonged to a past that would rapidly fade away under
the waves of modernisation. Why should the OHAD raise such a controversial issue in
the public realm? In the early 1990s, this agenda changed when the launching of the
UNESCO Slave Routes Project (1993) created opportunities for discussion on and a
historical re-evaluation of the history of the River Gambia in light of the centuries of
trade and cultural relations with Europe and the Americas. Experience had shown in
Ghana, where during the last years of the Rawlings’s regime the government
introduced measures to capture the attention of African American tourists and
communities by restoring historical sites associated with the Atlantic slave trade (Hasty
2002; McCaskie 2007), the cultural and economic potential of this legacy (Bruner 1996,
2005; MacGonagle 2006; Schramm 2007). The Gambia tried to follow the same path.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
392
8 Public reforms resulting from the structural adjustment plan launched in 1985 involved
the government in the establishment of the National Council for Arts and Culture
(NCAC), which incorporated the OHAD, the Monuments and Antiquities Division and the
National Museum. After having been attached for a short period to the Ministry of
Education and Youth, the NCAC was put under the responsibility of the Ministry of
Tourism. This amounted to official recognition of the outward-looking and market-
oriented direction the country’s cultural policy was taking in contrast with the
nationalist agenda of the 1970s and early 1980s8. Tourism had become a crucial source
of income for the weak national economy, which since colonial times had been almost
exclusively based on the commercial cultivation of groundnuts for export to world
markets.
9 Finally, historical events played their part. As a consequence of the military coup of
22nd July 1994, which ended the Fist Republic of The Gambia, the 1994-1995 tourist
seasons showed a dramatic decline which seriously affected the already weak labour
market of the Atlantic coastline. Statistics show that over one thousand hotel jobs
disappeared. The crisis affected transports, trade and horticultural business, which had
spread up to meet the needs of the tourists (Sharpley, Sharpley & Adams 1996: 3). As a
result, the NCAC turned to Haley’s experience and to the 1970s and early 1980s
researches of the OHAD on the historical sites associated with slavery in order to
promote a number of initiatives that could reinvigorate the tourist sector and capture
the emerging tourist market of the African diaspora.
10 The first was the Roots Homecoming Festival, which aimed at showing African American
tourists the investment opportunities in the country, besides of course displaying its
rich and complex cultural heritage to the world at large. In 1996, the festival was
inaugurated and was to become a permanent fixture in the years to come, one which
the government itself has rapidly transformed into an international stage to draw
attention on the achievements of the new regime9. Significantly, the festival always
takes place at the end of the tourist season, either in May or in June, so as to extend the
flux of visitors of the previous months.
11 The second initiative was the attempt to have Fort St. James and a number of other
historical sites restored and included in the UNESCO World Heritage List, as would
eventually happen in 2003. The third was the production of a guide to The Gambia’s
historical sites (Meagher & Samuel 1998). The fourth was the establishment of the
Albreda exhibition on slavery, which the NCAC organised rather hurriedly to meet the
celebration of the 1998 Roots Festival. The nearby village of Juffureh welcomed the new
museum as a further economic opportunity and took it as a sign that the government
born out of the military coup was more aware of their community’s real needs than the
previous one had been. on the same day, tourists can now visit the Albreda exhibit, and
then cross the river to reach the ruins of Fort St. James. On their way back, they can
tour Juffureh and buy souvenirs at the local Arts and crafts market.
Inside the Albreda Museum
12 Albreda Museum was set up in an old commercial building, whose history goes back to
the expansion of the groundnut trade along the River Gambia in the second half of the
nineteenth century. European companies left the country after independence and their
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
393
abandoned buildings rapidly turned into decaying remnants of a recent past in which
the country’s economy had prospered. Tourists and visitors are not aware of such
historical details, however.
13 The guide to the historical sites of The Gambia clearly states that the history of the
building hosting the slavery exhibition is quite obscure (Meagher & Samuel 1998: 62).
There is no other explanation to help visitors to disassociate this nineteenth-century
commercial building, which was involved in a wholly legitimate trade, from those used
for holding slaves awaiting shipment to the Americas during the previous centuries. At
the time, trading posts along the river consisted of huts and stockades, as described in
the account of Francis Moore (1738), who for a number of years ran a commercial
factory for the Royal African company close to the current settlement of Janjanbureh in
the Central River Region10.
14 At the exhibition entrance, a large sign declares: “In West Africa slavery is an old
phenomenon, though slaves were integrated into kinship groups and could manumit
themselves. The arrival of the Portuguese, and then of other European nations changed
the nature of the slave trade. Local elite and traders got involved in it at the expense of
the commoners.” This representation of indigenous slavery as a benign institution can
be found in both the museum leaflet and the guide to the historical sites of The Gambia
(Meagher & Samuel 1998: 45-46).
15 Both the guidebook and the exhibition therefore made a clear distinction between
indigenous and exogenous slavery, between the fate of slaves who were to be
assimilated into the structure of local societies and those who were deported across the
Atlantic. Brutality and exploitation characterised the treatment of the latter, whereas
the former were in a situation more similar to servitude than enslavement. The rest of
the exhibition tells how ancestors of Africans from the diaspora were forced into exile.
The first room explains the Triangular Trade in a simplified form. Old weapons, coffers,
Venetian beads and a variety of objects used as currency in transactions are shown
together with other pre-colonial archaeological findings.
16 The implicit message is that slavery was a form of violence exerted on harmless human
beings. This message is strengthened by a number of wooden shapes, which decorate
the walls and represent a caravan of chained men, women and children.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
394
Woodenshapes representing the traffic in slaves inside the Albreda Museum
(photograph of the autor, Albreda 2000)
17 Some other shapes, again painted in black, depict slave traders, thus exposing African
involvement in the trade. A third set shows the procedure by which slaves were
branded before being embarked on the ship.
18 The second room explains the passage across the Atlantic and life in plantations, while
the third describes the emancipation process in Northern and Central America and the
effects of the Atlantic slave trade on the Sene- gambia. This is depicted as a region
ravaged by a pagan ruling elite that oppressed the rest of the population. Such view
stems from the religious wars of the second half of the 19th century, which saw Islamic
reformers successfully achieve the political control of this area of West Africa (Gray
1966; Klein 1972, 1998). A map, which comes from Francis Moore’s account of his travels
(1738), illustrates the main settlements along the river in the early decades of the
eighteenth century. A model of Fort St. James shows what the building looked like
before it became a ruin.
19 The final part deals with the present day. There is a small section of the exhibition on
“Liberated Africans”, i.e. the slaves that British naval patrols along the coast freed from
the hand of slave dealers after the abolition of the Atlantic slave trade in 1807 (Gray
1966; Webb 1994). There is a list of names taken from the colonial archives and an
explanation of the crucial role they played in the social, economic and political
development of the colonial settlement of Bathurst, which is today Banjul, the capital
of The Gambia. The last section of the exhibition deals with Kunta Kinte and Alex Haley,
as they both epitomise the experience of return. During the 1970s, African Americans
chose to cross the Atlantic to establish a new relationship with The Gambia. The
awareness of a common origin mitigates the brutality of the ancient enslavement, and
an invitation to embrace a future, in which this old relationship becomes a
commitment to each other, is made quite explicitly in the closing panels of the
exhibition.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
395
20 Two statements are at the core of the museum’s narrative. First, the slave trade
involved both Europeans and Africans. Second, Europeans made the greater profit from
it. For a visitor who is familiar with the history of the region, such assertions sound
more incomplete than superficial. Details, which easily could have been drawn from the
available historical literature on slavery and the slave trade in Senegambia (Curtin
1975; Klein 1977, 1998; Barry 1998) are not part of the exhibition. This is mainly due to a
lack of access to such information rather than to an explicit intention to ignore facts.
Historian Donald Wright (2000: 24), who visited the Albreda Museum in 1998, has
credited it to be “much better than one would expect, given the government’s poverty
and the lack of resources for constructing such things”. Nonetheless, the exhibition has
been organised around a number of omissions.
21 From a historical point of view, one of the most significant is surely the complete lack
of references to whatever importance the memory of slavery and the slave trade might
still have in contemporary Gambian society. Both are represented as pure international
phenomena, which connected the river to the world at large. Apart from the initial
remarks on the benign nature of domestic slavery, all other references to the place of
this institution in local society have been erased. The exhibition attempts to separate
Atlantic and local history, the first of which is centre stage and the second is
downplayed or even completely expunged.
22 The curators of the Albreda Museum could not do otherwise and for a number of
reasons. After independence, slavery and the slave trade were not among the OHAD’S
research priorities. As in other West African countries, such matters from the past were
put aside in order to concentrate on nation building (Gaugue 1997; Austen 2001).
Consequently, the archive of oral sources that the OHAD established and on which the
NCAC relied to create the slavery museum did not provide sufficient information to
include the topic of local slavery into the exhibit. Objects were also few, as the
institution had neither time nor resources to engage into systematic campaigns of
collection. Beads, coins and other small items, which were already at the National
Museum, were moved to Albreda.
23 In addition, the link between the slave trade and the Islamic wars of the second half of
the 19th century, and the fact that the internal slave trade continued until the first
decade of the 20th century, are not issues that Gambians are eager to discuss in public
and still less to air on the global stage of cultural tourism. The descendants of late 19th
century slaves and slave masters still confront each other with their reciprocal
memories. In order to avoid complaints and conflicts, during the 20th century and in
particular after the achievement of independence such distasteful past has often been
silenced (Klein 1998; Bellagamba 2009).
24 By creating a narrative on slavery tailored exclusively to meet the expectations of
African American tourists, the Albreda Museum has unintentionally contributed to
push the controversial legacy of internal enslavement to the margins of public debate,
which reinforces the already existing tradition of silence. Similar processes were also
implicit in the initiative organised for African American students, which took place in
the village of Medina in 2000.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
396
Private Initiatives in the Field of the "Roots" Tourism
25 Since the inauguration in 1996 of the Roots Homecoming Festival, the Gambian
government has used the NCAC to cultivate relations with African American tourists.
Along with the Independence Day or the 22nd July anniversary of the military take-over,
the Roots Festival has become an opportunity to impress visitors with extravagant
ceremonies, new hotels and monuments, good roads and anything else that creates a
sense of progress and advancing modernity and bolster the legitimacy of a regime
founded on a coup. over the years, each of the principal localities that could be of
interest to the foreign visitors, such as Juffureh, the president’s hometown of Kanilai
and the settlement of Janjanbureh, has been endeavouring to raise its own profile
within the festival11.
26 Besides the government, a number of private initiatives have flourished as well,
although they are less renowned than the official ones. In Janjan- bureh, local youths
trying to earn a little money have created their own interpretation of a “Slave House”
using the basement of an old colonial commercial building, which actually traded in
groundnuts and not slaves.
The “Slave House” of Janjanbureh
(photograph of the autor, Janjanbureh 2006)
27 The owner, who lacked the resources to restore the building, kindly tolerated their
presence for a while. Then, other members of the family, who lived in town, came into
possession of the building and the related exhibition, and are currently attempting to
transform it into a more solid business. The recently elected Member of Parliament has
put the cultural marketing of the old colonial settlement of Janjanbureh at the top of
his political agenda.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
397
28 During the late 1990s Medina villagers in partnership with an African American travel
agency made similar efforts to promote African American tourism. The owner of the
travel agency, who promoted the idea of the 2000 ceremony, had visited The Gambia
several times. Eventually, he decided to establish his own network of private
relationships alongside the economic opportunities the government offered to the
African diaspora. With the assistance of some Gambian friends, he visited Medina and
negotiated the assistance of the villagers for the tour he meant to organise.
29 Medina is a community of around 2000 inhabitants. It is located in a region largely
populated by Jola who either belong to Jola groups historically settled in The Gambia or
who moved into the country as a consequence of the enduring political instability of
Lower Casamance in the past decades (Galloway 1980; Foucher 2005; Nugent 2007). A
good tarmac road, which had not been completed when I witnessed the initiation
ceremony in 2000, connects the village to the capital city. At that time, the community
had a primary school, a skills center, a Mosque and a number of small shops. The
villagers lived of agriculture and small businesses, as well as participation in the labor
market of the Gambian coast as resort workers, civil servants and private-sector
employees. As in other Gambian villages, Medina’s local economy largely benefited
from emigrants’ remittances.
30 The African American travel agent liked the village. Relatively accessible, it offered the
kind of rural environment that could attract tourists, who wished to use western-style
hotels on the coast as a base, while also obtaining some first-hand experiences of
African life. The community was ready to stage an initiation ceremony for the African
American guests and in that providing a unique opportunity of entertainment. It is
worth remembering that Roots (Haley 1976) begins by mentioning Kunta Kinte’s
initiation, as well as the daily ryhthm of life in rural Africa. Kunta was fetching wood
when slave-dealers captured him. Kunta Kinte, however, is described by Haley (1976) as
a Mandinka and ceremonies initiating children into manhood and womanhood are not
typical of the Jola. Mandinka communities, for instance, perform it and in certain areas
like Janjanbureh, they are quite conservative and traditionalist in the way in which the
boys’ circumcision ceremony is organised. For instance, they continue the custom of
segregating the children in the bush for more than three months. So, apart from the
friendly attitude of Medina villagers, why did the travel agent choose a Jola
community?
31 In the global imagination, the Jola—along with other groups of the Sene- gambia like
the Balanta at the border with Guinea Bissau or the Bassari of Eastern Senegal (much
more difficult to reach for the tourists than the coastal Jola communities like Medina)—
have gained a widespread and unrivaled fame for their attachment to custom and
traditional religious practices, which date back to colonial times or an even earlier
period (Mark 1992; Lambert 1998; De Jong 2002). This stigma of backwardness, which
for a long time deprived the Jola of prestige in the Gambian and Senegalese society, has
become an advantage in relation to the wider world. The Jola can now use it as a
distinctive marker of their identity so as to meet the traditionalist desires of foreign
tourists.
32 African American visitors who come to The Gambia are in search of objects, images and
behaviours that may evoke life as it was in this region at the time in which their
ancestors dispersed across the Atlantic. They would prefer not to see the Coca-Cola
factory (which is located on the main road to the capital city) or the ubiquitous Nestle
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
398
milk advertisements, because they long for a mythical and unchanging past of
thatched-roof houses, calabashes, charms and old-fashioned artefacts. They deplore the
intrusiveness of beach-boys and their westernized appearance and manner, but look
favourably on any behaviour that could be considered traditionally authentic and more
representative of local than global history.
33 Medina met such expectations. Moreover, and meaningfully, the Jola communities and
other decentralized societies of precolonial Senegambia, are widely supposed to have
been only marginally involved in the slave trade (Galloway 1980; Mahoney 1995)12. This
is an important detail for African American tourists. Mandinka, Wolof, Fula and
Serrahuli groups (which all together represent around 90% of the Gambian population)
recognised slavery within their social structure and actively engaged either in slave
raiding or in slave trading. Today, they have to deal with this controversial legacy in
their relations with the African diaspora and Gambian society as well. On the other
hand, the Jola see themselves as passive victims of the slave trade. This view is shared
by other sections of Gambian society and in recent years it has been reinforced by the
public declarations of the President of the country, who is a Jola and who has been very
active in promoting the culture of his ethnic group on a national stage. The historical
engagement of Jola communities with slave-dealing remains confined to academic
debates and is ignored by the wider public. They are therefore in a good position to
enter into a dialogue with African Americans, as both groups can perceive themselves
as having suffered of the same historical processes of enslavement, subjugation and
social humiliation.
34 “As I look at them, I cannot believe they sold their own brothers. Slavery was the result
of war and not of reciprocal betrayal”13. Such was the spontaneous comment of the
travel agent who organised the tour in the village of Medina, when after the end of the
ceremony I approached him to explain the research I was carrying out on the historical
and social memory of slavery and the slave trade. He continued by describing the
efforts he was making in the USA to collect enough funds to build a monument for Alex
Haley in Juffureh. In his perspective, the history of The Gambia and the vicissitudes of
Haley almost coincided.
35 Significantly neither slavery nor the traffic in slaves were ever overtly mentioned
during the week that the African American College students spent in the village. Their
historical knowledge of the Atlantic slave trade was built up by visiting Juffureh and
the Albreda Museum. On their way back to Dakar, where they would join their flight for
the USA, they were supposed to visit the Island of Goree as well. Haley’s Roots and
government narratives—as embodied by the official historical sites of The Gambia and
of Senegal—filled up their historical imaginary without leaving room for alternative
readings, which critically complicated the picture. Comparatively, also Medina villagers
largely ignored this remote past apart from what they learnt at school or by following
the Roots festival on the national television 14. Thus, not only tourists’ perception but
also Gambian popular memory of the Atlantic slave trade is fed by official narratives, as
Katharina Schramm (2007) observed in Ghana. However, I found no trace of what she
describes as the opposite contamination of officialdom with living memories of the
traffic in slaves that continue to shine in the interstices of public discourse (ibid.: 72).
36 As in the case of the Albreda Museum, official memories displace local ones. Medina,
like other communities, has its own history of sufferance which departs from the
Atlantic narrative and points to the painful and intimate realities of greed and betrayal.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
399
Two weeks after the departure of the African American tourists, Landing Jammeh, an
elderly Jola man from Medina provided me with the following details during an
interview. Landing referred to the religious wars, which afflicted this area of The
Gambia on the eve of British colonisation, and during which Jola communities were
raided and destroyed by Muslim warriors. His recollection included a touching
description of how slave traders used to seek the complicity of members of the
community and come at night “to wake them up so that they would open the fence for
them [...]. They would enter and capture the children. They would take the women as
well”. Cotton cloth was an important commodity during the nineteenth century and
highly prized in the Lower Gambia, where cotton was not grown. Landing explained
how the heads of powerful households would select some of the children under their
protection and sell them to slave traders for cotton: “People had many children, you
know, but not all the children were loved in the same way”, he concluded15.
37 Elderly men and women’s ability to narrate the past and bring it alive in front of their
listeners was one of the things that struck Alex Haley’s literary imagination, when he
visited The Gambia in the late 1960s. Though taking cue from Haley’s experience, the
initiatives in the field of African American tourism which have developed in The
Gambia of the last decade transform the complex history of Atlantic slavery and
enslavement in simplified narratives ready to be consumed. Like mythical charters,
these narratives sustain the encounters between African American tourism and the
cultural heritage of country, without raising disturbing questions that could eventually
transform this controversial past into a battleground to claim contemporary rights.
"Have You Seen what they Gave Us?" Cultural Tourismfrom the Villagers' Point of View
38 Ferdinand De Jong (1999a, 2002) has traced the transformations of Jola initiation rituals
in the late twentieth century and has demonstrated their strategic use by the
communities of Lower Casamance to create a sense of belonging among members of the
urban and international diaspora. Until the 1950s and 1960s such rituals strengthened
the elders’ control over young men, who could neither get land to cultivate and build
nor marry before being initiated. Rituals guaranteed cultural continuity across the
generations (Mark 1992: 38).
39 In the following decades, the ceremonies gradually adapted to the changing living
conditions of Lower Casamance and coastal Gambia, as a result of the increased socio-
economic interdependence between rural and urban areas (Lambert 2002; Linares
2003). Whereas on the eve of colonisation, initiation rituals forged links of solidarity
among politically independent neighbouring communities that tried to resist the
intrusions of slave-dealers by enclosing in remote areas, today the same rituals create
feelings of local identity among community members dispersed outside the village. The
Medina ceremony resonated with these recent transformations. Although adapted, it
was based on the current wording of other Jola initiation rituals that are organised
during the summer holidays when migrants and their families return home. In the
1950s and 1960s, initiates were required to remain in the sacred grove for several
months. Progressively, their seclusion has been reduced to a few weeks16.
40 Medina villagers further simplified the event for their African American guests. The
boys spent only a night in the village grove. They were not shown the village shrine,
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
400
which is today a controversial aspect of the initiation ritual, since the majority of the
villagers is Muslim. The night in the grove was an exhausting experience both for the
boys, as they were not accustomed to sleeping outside in the bush, and for their
initiators, who complained among themselves of the boys’ lack of courage and their
demands for comforts that the village could not provide. The next day, the return of
the group to the village was welcomed by the firing of guns, as is customary in such
festive occasions. The young men who had escorted the young initiates in the bush
danced as they accompanied them back to the main square where under the shade of a
big tree they met the girls, who had been hosted in local compounds and dressed up for
the occasion. The closing ceremony took place in the presence of the whole
community. Speeches followed the dances and performances of traditional characters,
like the Kumpo mask17.
41 The travel agent who organised the tour was the first to speak. He stressed the friendly
links that his agency had developed with Medina villagers. He admonished the students
to keep alive the memories of their adventure. Then the Imam and the village chief
expressed their gratitude to their African American brothers and sisters. “Jola culture—
continued the village chief—is deep and what you have seen is but a fragment of it. You
must return so as to deepen your knowledge.”
42 In this way, he re-emphasised the division between the visited and visitors, and claimed
the active role for the former in the encounter. The Medina community could not really
choose whether to accept or refuse the tourists—not being in the economic position of
doing so—but it could try to control the encounter, deciding what to display and what
to preserve from the intrusion of foreign guests. The village chief invited the tourists to
continue in their efforts by coming back and learning more local traditions. The
initiates were given certificates of attendance that highlighted their new African
names. For the students this was just a piece of paper they could show to relatives and
friends—a signpost of their restored link with their ancestral land to be hung on the
wall at home. So commented the sixteen year old Thomas. He had not really enjoyed his
night in the forest. For the villagers, the same certificate expressed the hope of creating
enduring transnational relations. It implied future requests of aid in terms of
development for the community and for its families, who had adopted the young
tourists within their ranks. Behind the apparent courteousness, and the rhetoric of
reciprocal brotherhood, both groups were disillusioned with the encounter. The
African American students left the village with the conviction they had been deprived
of real access to local culture. Indeed, the village chief’s words reinforced their feeling
of having undergone a fake initiation. The villagers complained of a lack of immediate
and concrete material reward. Surely the tourists’ money had provided a week of fun
for the whole community, but if they were to organise the same initiative for a
Gambian patron—either a politician or a member of the elite—they undoubtedly would
have gained more than the seventy dollars and a pile of old clothes left by the travel
agent before the group’s departure for their hotels on the coast. “Have you seen what
they gave us?” protested the lead dancer as soon as the students left. “Old clothes and
seventy US dollars. I called all these people to dance from the surrounding villages. How
am I going to compensate them? This money is so little”18.
*
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
401
“You visit the country as a tourist. We are so friendly with foreigners. You travelaround, you learn our ways of doing, and when you are back home, you can use theknowledge and the photographs you got to entertain your friends or even to gainprofit by selling the materials. This is not fair. This is just exploitation”19.
43 I came across this remark in 2008 as I was travelling towards eastern Gambia on local
transports. The young man sitting near me thought I was one of the independent
tourists, who venture out of the hotel resorts towards the countryside. He had just
visited his family and was going back to the village where he worked as a
schoolteacher. Since the 1970s, government and tourist agencies have been marketing
The Gambia as the “smiling coast of Africa”, but behind the friendly attitude that local
people display towards the tourists, the words of this young man betray deep feelings
of exclusion. His bitterness brought back to my mind the closing of the initiation
ceremony for the African American tourists I attended eight years before in Medina.
The old clothes that the students presented to the villagers as if they were a precious
gift, just before departing, and the seventy dollars which were given to compensate the
dancers, exposed the socio-economic chasm that divided the hosts from the African
American tourists who were temporarily their guests.
44 Bayo Holsey’s (2004: 167) invites to read the contemporary tourist reappraisals of the
Atlantic slavery’s legacy, which take places in West Africa, in light of the unequal
power structure of global capitalism, which relegates countries like The Gambia to
positions of permanent economic and social marginality. I have tried to follow such
suggestion by analysing both the Albreda Museum and the Medina ceremony against
the background of the changing and intersecting routes of the African diaspora. The
two initiatives link the forced displacement(s) of the past to the return travels of
African Americans to West Africa. Both overlook not only the internal slave dealing and
slave trade but also a more recent and crucial dimension of the African diaspora, that is
West Africans’ emigration to Europe and North America (Akyeampong 2000: 183).
45 Every year, a number of middle-aged and young African Americans tourists visit The
Gambia to perform what they see as deeply moving pilgrimages in search of their
ancestral African roots (Ebron 1999; Timothy & Teye 2004). Conversely, every week, in
the early hours of the morning, Gambians queue in front of the American Embassy,
which is located in one of the upper class residential areas in the outskirts of the capital
city. They hope to get a visa to cross the Atlantic for educational and economic reasons
or in search of political asylum. Due to restrictions of the USA immigration policy this
has become increasingly difficult to achieve, especially for those who either do not
belong to the political and economic elite or who are not sufficiently supported by
family members already abroad.
46 On the one hand, there is the appeal of an homecoming, which results in the occasional,
though intense, experience of visiting the Albreda Museum, Juffureh and the historical
sites related to the Atlantic traffic in slaves so as to experience the emotions of
discovery that Haley so romantically described in his narrative. On the other, there is
the attraction that since the 1980s international migration has been exerting on young
and less young sections of the population. Both processes intersect in ways, whose
assessment surpasses the scope of this essay. International tourism in general, as well
as the return of successful emigrants for holidays who indeed are a specific category of
visitors, fuels local imagination of places elsewhere, which the majority of Gambians
will never experience. As a matter of fact, till the early 1990s, encounters with North
European visitors offered the opportunity to emigrate to a number of youth, who got
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
402
visa and financial support thanks to friendly relationships with tourists20. Currently,
tourist areas are well guarded both by police and private vigilantes. Young men and
women, who seek to get in contact with tourists without having the proper
authorisations, are sent away. At times, police arrests them with the justification that
their idle behaviour compromises the positive image of the country. The effort to turn
tourism into a local resource goes on, however. Establishing and cultivating
international connections is essential not only to sustain migratory projects but also to
provide the material, moral and social assistance to make up for the lack of
government patronage and overcome the fact of living in a country, whose record of
human rights violations has dramatically increased after the military coup21. Medina
villagers made such an attempt without being successful. Within a few years, relations
between the village and the North American travel agency broke down and, to my
knowledge, none of the villagers have yet travelled to the USA as a result of the
friendships formed by this experience. Moreover, the initiative, which was organised
on a private base, could not compete with government-driven ones.
47 In 2000, during the millennium edition of the Roots Homecoming Festival, the government
itself took up the idea of initiating African American visitors into Jola culture, which
deprived Medina of whatever chance remained to offer something original and unique
in the tourist market.
BIBLIOGRAPHY
AKYEAMPONG, E.
2000 “Africans in the Diaspora: The Diaspora and Africa”, African Affairs 99: 183-215.
AUSTEN, R.
2001 “The Slave Trade as History and Memory: Confrontations of Slaving Voyage Documents and
Communal Traditions”, The William and Mary Quarterly 58 (1): 229-244.
BAH, A. & GOODWIN, H.
2003 Improving Access for the Informal Sector to Tourism in The Gambia, PPT Working Paper No. 15
(Economic and Social Research Unit, UK Department for international Development).
BARRY, B.
1998 Senegambia and the Atlantic Slave Trade: Senegambia before the Colonial Conquest (Cambridge:
Cambridge University Press).
BAUM, R.
1999 Shrines of the Slave Trade: Diola Religion and Society in Precolonial Senegambia (New York: Oxford
University Press).
BELLAGAMBA, A.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
403
2005 “Slavery and Emancipation in the Colonial Archives: British Officials, Slave Owners, and
Slaves in the Protectorate of The Gambia (1890-1936)”, Canadian Journal of African Studies 39 (1):
5-41.
2006 “Before It is Too Late: Constructing an Archive of Oral Sources and a National Museum in
Independent Gambia”, Africa Today 52 (4): 29-54.
2009 “After Abolition. Metaphors of Slavery in the Political History of The Gambia”, in B. ROSSI
(ed.), Reconfiguring Slavery: West African Trajectories (Liverpool: Liverpool University Press) (in
print).
BERTRAND-BOCANDÉ, E.
1849 “Notes sur la Guinée portugaise ou Sénégambie méridionale”, Part 1, Bullettin de la Société de
Géographie 3 (11) : 265-350 ; Part II, 3 (12) : 57-93.
BRUNER, E.
1996 “Tourism in Ghana: The Representation of Slavery and the Return of the Black Diaspora”,
American Anthropologist 98 (2): 290-304.
2005 Culture on Tour: Ethnographies of Travel (Chicago: University of Chicago Press).
BUZINDE, C. & ALMEIDA SANTOS, C.
2008 “Representations of Slavery”, Annals of Tourism Research 35 (2): 469-488.
CEESAY, H.
2003 The Roots Festival: a Reconstruction of Memories, the Promotion of Cultural Exchange and Cultural
Tourism, unpublished.
CURTIN, P.
1975 Economic Change in Precolonial Africa. Senegambia in the Era of the Slave Trade (Madison:
University of Wisconsin Press).
DE JONG, F.
1999a “The Production of Translocality: Initiation in the Sacred Grove in Southern Senegal”, in R.
FARDON, W. VAN BINSBERGEN & R. VAN DIJK (eds.), Modernity on a Shoestring: Dimensions of Globalisation,
Consumption and Development in Africa and Beyond (Leiden-London: EIDOS): 315-340.
1999b “Trajectories of a Mask Performance. The Case of the Senegalese Kumpo”, Cahiers d’Études
africaines XXXIX (1), 153: 49-71.
2002 “Politicians of the Sacred Grove: Citizenship and Ethnicity in Southern Senegal”, Africa 72
(2): 203-220.
DIEKE, P. U. C.
1994 “The Political Economy of Tourism in The Gambia”, Review of African Political Economy 21 (62):
611-626.
DORSCH, H.
2004 “Griots, Roots and Identity in the African Diaspora”, in W. KOROT, K. TOLOIYAN & C. ALFONSO
(eds.), Diaspora, Identity and Religion. New Directions in Theory and Research (London: Routledge) :
102-116.
EBRON, P.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
404
1997 “Traffic in Men”, in M. GROSZ-NGATE & O. H. KOKOLE (eds.), Gendered Encounters. Challenging
Cultural Boundaries and Social Hierarchies in Africa (New York-London: Routledge): 223-243.
1999 “Tourists as Pilgrims: Commercial Fashioning of Transatlantic Politics”, American Ethnologist
26 (4): 910-932.
FOUCHER, V.
2005 “La Guerre des Dieux ? Religions et séparatisme en Basse Casamance”, Canadian Journal of
Africa Studies 39 : 361-388.
GALLOWAY, W.
1976a A Nutshell History of James Island (Banjul: the Vice President’s Office).
1976b James Island: A Background with Historical Notes on Juffure, Albreda, San Domingo and Dog Island
(Banjul: the Vice President’s Office).
1980 The Jola (Banjul: Oral History and Antiquities Division).
1981 Fort Bullen (Banjul: National Museum of The Gambia, Museum Bullettin 1).
GAUGUE, A.
1997 Les États africains et leurs musées. La mise en scène de la Nation (Paris : L’Harmattan “Géographie
et cultures”).
GRAY, J. M.
1966 [1940] History of The Gambia (London: Frank & Cass & CO, LTD).
HALEY, A.
1973 “Black History, oral History and Genealogy”, The Oral History Review 1: 1-25.
1976 Roots (Garden City, New york: Doubleday).
HARRELL-BOND, D. L.
1979 “Tourism in The Gambia”, Review of African Political Economy 6 (14): 78-90.
HASTY, J.
2002 “Rites of Passage, Routes of Redemption: Emancipation Tourism and the Wealth of Culture”,
Africa Today 49 (3): 47-76.
HOLSEY, B.
2004 “Transatlantic Dreaming: Slavery, Tourism, and Diasporic Encounters”, in F. MARKOWITZS &
H. STEFANSSON (eds.), Homecomings: Unsettling Paths of Return (New York-Oxford: Lexington Books):
166-182.
HOWE, S.
1998 Afrocentrism: Mythical Pasts and Imagined Homes (London-New York: Verso).
HUGHES, A. & PERFECT, D.
2006 A Political History of The Gambia, 1816-1994 (Rochester: Rochester University Press).
JANSON, M.
2006 “We don’t Despair, since we Know that Islam is the Truth”. New Expressions of Religiosity in Young
Adherents of the Tabligh Jamaat in The Gambia, Unpublished Paper presented at the conference
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
405
Youth and the Global South: Religion, Politics and the Making of Youth in Africa, Asia and the Middle East,
Dakar, 13-15 October 2006.
KLEIN, M. A.
1972 “Social and Economic Factors in the Muslim Revolution in Senegambia”, Journal of African
History 13 (3): 419-441.
1977 “Servitude Among the Wolof and Sereer of Senegambia”, in I. KOPYTOFF & S. MIERS (eds.),
Slavery in Africa (Madison: University of Wisconsin Press): 335-363.
1998 Slavery and Colonial Rule in French West Africa (Cambridge: Cambridge University Press).
2001 “The Slave Trade and Decentralized Societies”, Journal of African History 42: 49-65.
LAMBERT, M.
1998 “Violence and the War of Words: Ethnicity v. Nationalism in the Casam- ance”, Africa 68 (4):
585-602.
2002 Longing for Exile. Migration and the Making of a Translocal Community in Senegal (Portsmouth, NH:
Heinemann).
LINARES, O.
1987 “Deferring to Trade in Slaves: the Jola of Casamance, Senegal in Historical Perspective”,
History in Africa 14: 113-139.
2003 “Going to the City... and Coming Back? Turnaround Migration among the Jola of Senegal”,
Africa 73: 113-132.
MACGONAGLE, E.
2006 “From Dungeon to Dance Parties: Contested Histories of Ghana’s Slave Forts”, Journal of
Contemporary African Studies 24 (2): 249-260.
MCCASKIE, T.
2007 “The Life and Afterlife of Yaa Asantewaa”, Africa 77 (2): 151-179.
MAHONEY, F.
1995 Stories of Senegambia (Banjul, Kanifing: Ministry of Education).
MARK, P.
1985 A Cultural, Economic and Religious History of the Basse Casamance since 1500 (Stuttgart: Steiner).
1992 The Wild Bull and the Sacred Forest: Form, Meaning, and Change in Senegambian Initiation Masks
(Cambridge: Cambridge University Press).
MEAGHER, A. & SAMUEL, A.
1998 Historic Sites of The Gambia. An Official Guide to the Monuments and Sites of The Gambia (Banjul,
The Gambia: National Council for Arts and Culture and Roc International).
MITCHELL, J. & FAAL, J.
2007 “Holiday Package Tourism and the Poor in The Gambia”, Development Southern Africa 24 (3):
445-464.
MOORE, F.
1738 Travels into the Inland Parts of Africa (London: Edward Cave).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
406
NEIJTS, M.-L.
2005 Roots Tourism in The Gambia. Resident Perceptions of Visiting Africans from the Diaspora, Master
Dissertation, Amsterdam, The Free University.
NUGENT, P.
2007 “Cyclical History in The Gambia/Casamance Borderlands: Refuge, Settlement and Islam
from c. 1880 to the Present”, Journal of African history 48: 221-243.
SCHRAMM, K.
2007 “Slave Route Projects: Tracing the Heritage of Slavery in Ghana”, in F. DE JONG & M.
ROWLANDS (eds.), Reclaiming Heritage. Alternative Imaginaries of Memory in West Africa (California:
Walnut Creek): 71-98.
SHARPLEY, R., SHARPLEY, J. & ADAMS, J.
1996 “Travel Advice or Travel Embargo? The Impacts and Implications of Official Travel Advice”,
Tourism Management 17 (1): 1-7.
TIMOTHY, D. J. & TEYE, V. B.
2004 “American Children of the African Diaspora: Journey to the Motherland”, in T. COLES & D. J.
TIMOTHY (eds.), Tourism, Diasporas and Space (London- New York: Routledge): 111-123.
VANSINA, J.
1994 Living with Africa (Madison: University of Wisconsin Press).
WEBB, P.
1994 “Guests of the Crown: Convicts and Liberated Slaves on McCarthy Island, The Gambia”, The
Geographical Journal 160 (2): 136-142.
WRIGHT, D.
1981 “Up-rooting Kunta Kinte. On the Perils of Relying on Encyclopedic Informants”, History in
Africa 8: 205-127.
1991 “Requiem for the Use of Oral Tradition to Reconstruct the Precolonial History of the Lower
Gambia”, History in Africa 18: 399-408.
2000 History, Memory, and Fiction: Criticism and Commodification of Alex Haley’s Roots, unpublished
paper.
2004 The World and a Very Small Place in Africa: a History of Globalization in Niumi, The Gambia
(Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe).
NOTES
1. HALEY himself (1973) described his discovery of Juffureh, beginning with the stories of his
grandmother about an ancestor who came from Africa, and ending up with his travel to The
Gambia and his meeting with Kebba Fofana, the Juffureh elderly man that narrated to him the
history of the Kinte family. WRIGHT (2004) briefly illustrates the relationship which developed
between the African American novelist and Juffureh villagers. WRIGHT (1981) is also the author of
a critical analysis of the sources that Haley used to write Roots.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
407
2. Tourism began at the time of independence, with around 300 visitors in 1965. During the
1970s, the government established a number of Tourist Development Areas along the Atlantic
coastline, where hotels and other facilities were constructed thanks to technical and financial
support from United Nations Development Programme (UNDP) and the International
Development Association (IDA) (DIEKE 1994: 617). In 1993, the flow of visitors reached the peak of
90,000 international arrivals to abruptly decline in 1994 and 1995 as a consequence of the
bloodless military coup that on July 22 1994 ended the First Republic of the Gambia. After the
democratic transition of September 1996, figures rose again to reach the average estimate of
100,000 annual visitors. In 2001, the government established the Gambia Tourism Authority
(GTA), which is a public enterprise to regulate and promote the tourism industry. In 2003,
tourism was estimated to account for around the 7.8% of Gambian GDP (BAH & GOODWIN 2003: 10).
For information on more recent developments see MITCHELL & FAAL (2007).
3. official data do not allow disentangling the number of African American tourists from the
general statistic of international visitors. Ethnography shows that they are mainly middle-class
and middle-aged. As a matter of fact, and in spite of government efforts to diversify the tourist
offer in the past decade, the Gambia largely remains a sun-sand-beach destination for British,
German and Northern European tourists (BAH & GOODWIN 2003).
4. For almost two centuries Albreda was a trading post for slaves used by French and mulatto
merchants. The British took possession of it in the 19th century. For details see GRAY (1966) and
WRIGHT (2004).
5. I have repeatedly carried out fieldwork in The Gambia since 1992. The issue of slavery and its
historical and social memory has been at the core of my recent ethnographic and historical
research within the framework of MEBAO (Missione Etnologica in Bénin e Africa Occidentale;
www.mebao.org), a project co-financed by the Italian Ministry of Foreign Affairs and the
Department of Human Sciences for Education “Riccardo Massa” at the University of Milan-
Bicocca. I hereby thank the Italian Ministry of Foreign Affairs and the Italian Embassy in Dakar
for their support over many years.
6. The names of the locality and of the participants in the initiative have been changed so as to
protect their privacy.
7. See GRAY (1966) and CURTIN (1975) for historical details on European presence along the River
Gambia.
8. I described Gambian cultural policies and their intersections with the tourist market elsewhere
(BELLAGAMBA 2006). HUGHES and PERFECT (2006) offer detailed analyses of the socio-political
consequences of the 1970s and 1980s economic crisis.
9. The Roots Homecoming Festival has its own website <http//:rootsgambia.gm>.
10. Janjanbureh is another famous historical site, located on MacCarthy Island, about 300
kilometers from the coast in the middle of the River Gambia. The British acquired the island in
1823 and transformed it into an outpost of their colonial presence along the river. By the late 19th
century, Janjanbureh was a flourishing commercial settlement, where run-away slaves as well as
people escaping raids on the mainland found refuge. Popular memory remembers the locality of
Jonk- akunda, which is in front of MacCarthy island on the north bank, as a place where slaves
where kept before being sent to other areas. Actually, Jonkakunda hosted a British trader and his
mulatto family in the second half of the 19th century (GRAY 1966: 277-278).
11. Not far from the coast, the President’s hometown of Kanilai, which has been developed into
an attractively modern settlement with excellent facilities, has become a reference point for Jola
communities and cultural groups of The Gambia and Lower Casamance. During the Roots Festival,
Kanilai hosts several cultural initiatives that attract visitors from the whole sub-region as well as
visitors from outside the African continent.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
408
12. This interpretation relies heavily on the first ethnographic reports written by British officials
during the late nineteenth and early twentieth centuries, and ignores the role of Jola as slave
raiders in the economic networks generated by the Atlantic slave trade before the nineteenth
century. LINARES (1987) has uncovered historical evidence of the gradual involvement of the
ancestors of the contemporary Jola in the slave trade from the fifteenth century onwards. BAUM
(1999) has explored the place of slavery in the ritual and religious life of some Jola communities
of Lower Casamance, while the testimony of BERTRAND-BOCANDÉ (1849) mentions the incorporation
of slaves in the Jola communities of the Lower Cas- amance during the second half of the
nineteenth century.
13. Conversation with J.-P., 26 april 2000.
14. Through an analyses of history textbooks, M.-L. NEIJTS (2005) made a preliminary assessment
of the ways in which educated Gambians construct their historical knowledge of Atlantic slavery.
15. Interview with L. J., 10 May 2000.
16. Jola communities of Lower Casamance perform male initiation rituals every 25 years (DE JONG
1999a, 2002). The ceremony requires that the initiates spend a period of training in the village
sacred grove, which is a space outside the village purposely left uncultivated. Sacred groves are
accessible only to initiated men, and even today what happens inside is considered to be secret to
the rest of the community.
17. Kumpo is a Jola mask made of grass: today it is one of the traditional characters of Jola
ceremonies, but as DE JONG (1999b) shows, Kumpo was created during the 1930s by young men who
returned to their villages after having worked in other areas of the Senegambia.
18. Conversation with I. S., 26 April 2000.
19. Conversation with A. K., Basse, The Gambia, January 2008.
20. The issue of beach-brokers (locally called “bumsters”) has been widely commented upon by
the literature on Gambian tourism. Romantic adventures and marriages with north European
ladies have been one of the routes to international migration, particularly for young males. See,
for instance, DIEKE (1994) and EBRON (1997) who discusses such phenomenon from a gender point
of view.
21. Emigration has become a discussed topic within Gambian society. Young people’s exit has
been interpreted as a consequence of the country’s deteriorating political and economic
conditions since the coup, as well as of their exposure to Western culture and life-style as a
consequence of international tourism. See, for instance, “Searching for Greener Pastures”, The
Daily Observer (Banjul), 28 December 2007 (Posted to the web 28 December 2007) or “Nerves: an
Apotheosis of a whole Generation”, Gainako On-Line Newspaper (Posted December 21 st, 2006). As
JANSON (2006) has shown, religious education is one of the strategies of upward social mobility
open to young men who do not have the chance to emigrate.
ABSTRACTS
In the late 1960s, the African American journalist and novelist Alex Haley Identified the small
rural village of Juffureh at the mouth of the River Gambia as the place where slave traders
kidnapped his ancestor Kunta Kinte so as to sell him as a slave on the other side of the Atlantic.
Within a few years, the publication of the novel, Roots, in 1976 and the production of a TV series
with the same title brought the small Republic of The Gambia to the attention of the
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
409
international community and inaugurated a tradition of encounters between Gambians and
African American tourists. This article addresses the public memorialization of the Atlantic slave
trade and the use of such heritage as a tourist resource in contemporary The Gambia by
illustrating two initiatives of the late 1990s both aimed at marketing the land of Roots to a global
audience of African American tourists. The first was the establishment of a slavery museum in
the locality of Albreda, near Juffureh. The second was an initiation ceremony that a small Jola
community in the proximity of the capital city of Banjul organised for a group of African
American College students in 2000.
À la fin des années 1960, le journaliste et romancier africain- américain, Alex Haley, a identifié le
petit village rural de Juffureh, situé à l'embouchure du fleuve Gambie, comme l'endroit où les
commerçants d'esclaves ont enlevé son ancêtre Kunta Kinte afin de le vendre, comme esclave, de
l'autre côté de l'Atlantique. Quelques années plus tard, en 1976, la publication du roman Racines
et la production d'une série télévisée portant le même titre ont attiré l'attention de la
communauté internationale sur la petite République de Gambie, et ont inauguré une tradition de
rencontres entre Gambiens et touristes africains-américains. Cet article traite de la
commémoration de la traite atlantique des esclaves et de l'utilisation d'un tel héritage comme
ressource touristique dans la Gambie d'aujourd'hui. Ce thème est illustré par deux initiatives
commerciales entreprises à la fin des années 1990, toutes deux destinées à « vendre » la patrie de
Racines à un public de touristes africains-américains. La première a été la création d'un musée de
l'esclavage dans la localité d'Albreda, près de Juffureh ; la seconde, une cérémonie initiatique
organisée, en 2000, par la petite communauté jola, près de la capitale Banjul, pour un groupe
d'étudiants africains-américains.
INDEX
Mots-clés: Gambie, Albreda, Banjul, Juffureh, touristes africains- américains, roman Racines,
esclavage, commerce d'esclaves
Keywords: Gambia, Albreda, Banjul, Juffureh, African American tourists, novel Roots, slavery,
trade slave
AUTHOR
ALICE BELLAGAMBA
Dipartimento di Scienze Umane per Formazione “Riccardo Massa”, Université degli Studi di
Milano Bicocca, Milan.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
410
“Find their Level”. AfricanAmerican Roots Tourism in SierraLeone and Ghana« Trouver sa place » — Tourisme de racines africaines-américaines en Sierra
Leone et au Ghana
Adia Benton and Kwame Zulu Shabazz
“Just as a tree without roots is dead, a people
without history or cultural roots also becomes a
dead people [...]. You take a tree, you can tell
what kind of tree it is by looking at the leaves. If
the leaves are gone, you can look at the bark [...].
But when you find a tree with the leaves gone and
the bark gone, everything gone, you call that a
what? A stump. And you can’t identify a stump as
easily as you can identify a tree.”
Malcolm X (1967)
“I heard the truth was in my roots, but I haven’t
seen a tree all day [...].
What about the leaves on trees with broken
branches?
Where will they go after they’ve done their
dances in the wind?
Will they cry or simply die?”
Fertile Ground (2000)
1 In many “developing” and post-conflict African nations, cultural tourism has been
touted as a vital source of foreign exchange revenue for jumpstarting national
development. This trend has led to a scramble in Africa by African state officials
seeking to “package” their nations in order to attract foreign capital1. In both Ghana
and Sierra Leone, marketing logic has become pervasive amongst political elites who
have sought to attract the patronage of diasporan “returnees”—descendants of the
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
411
Middle Passage2 who travel to Africa in search of cultural and historical “roots”. The
planning and execution of national “packaging” often circumvents the ordinary citizen;
thus, the official agenda of these nation-states is sometimes at odds with the
aspirations of local Ghanaians, Sierra Leoneans and pan-African sojourners alike.
Moreover, this trend has contributed to considerable conceptual slippage and,
consequently, vociferous debates over the meaning of and criteria for asserting
Africanness. In other instances, these conjunctures have transformed and enhanced
received notions of African identity.
2 As African American anthropologists3, “privileged” citizens of a hyper-developed
superpower, and members of a marginalized racial group, we, the authors, share a deep
commitment to social justice and race consciousness4. In the US, race is a pervasive
signifier of economic, social and political asymmetries. But in Ghana and Sierra Leone,
while race is important, distinctions such as class and ethnicity are much more salient5.
Our African interlocutors often attempt to fit us into categories that are meaningful to
them:
“Where [in Africa] are you from?”“Are you Ghanaian/Sierra Leonean?”“What is your tribe?”“Are you a pure African?”“Where is your village?”“Who are your ancestors?”“Are your parents African/Ghanaian/Sierra Leonean?”“Do you have a Ghanaian/Sierra Leonean passport?”“Are you a slave?”“You are a Big Man/Woman”6
“Are you a white person/stranger?”
3 These engagements remind us that as scholars using anthropologically informed rituals
of observation and participation, we, too, are the subjects of observation, critique, and
local theorizing. This hermeneutical circle (Apter 1992: 213) informs our self-
perceptions as engaged scholars who, hopefully, advance research agendas that can
facilitate and enhance cross-cultural dialogue, understanding and collaboration.
4 In this essay, we compare a developing nation (Ghana) and a postconflict nation (Sierra
Leone) to deepen and complicate our understandings of an emerging pan-African
phenomenon—African roots tourism—and its attendant possibilities, limitations, and
ambiguities. We consider how these complimentary and conflicting interests, beliefs,
and practices converge to shape novel modes of pilgrimage, nationhood, and
transnational dialogue. In the sections that follow, we work toward two general
objectives: first, we analyze the context wherein Africanness has been deployed as an
instructive model of counter-globalism7, the considerable geopolitical stakes involved
in these deployments, along with the countervailing forces of conservativism,
reformism and radical transformation that are inherent therein. And, second, we offer
a corrective to scholarly overemphasis on divergence and dissonance between Africans
and African Americans by providing equally instructive examples of affinity and
cooperation.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
412
Roots as a Postmodern Problematic
5 The metaphor of roots as imagined ancestral homeland has been a source of intense
sociopolitical struggle (Malcolm X 1967; Thelwell 2003) and considerable scholarly
scrutiny (Brown 2005; Bruner 1996; Campbell 2006; Clarke 1992; Clarke 2004; Ebron
1999; Finley 2001; Gaines 1999, 2006; Hartman 2002, 2007; Hasty 2002; Holsey 2008; Lake
1995; Matory 1999; Osei-Tutu 2002). Much of the scholarly scepticism is informed by
postmodern thought and falls under the rubric of anti-essentialism (Appiah 1993;
Gilroy 1993). At the core of postmodern critiques of roots-as-identity is a conviction
that sodalities based on race or geography are at best, exclusivist and, at worst, racist.
Moreover, according to these critics, the “roots” metaphor indexes subjectivities that
presuppose discrete, bounded, and timeless notions of personhood. Accordingly, these
scholars argue, “rooted” identities typically lack particularity and ignore the interplay
of historical and political contingencies, promulgating un-nuanced generalizations of
self and others.
6 A related critique is that the roots-as-identity trope reduces “the homeland” to an
originary site with no socio-historical dynamic of its own— aside from its role in
diffusing peoples and cultures to other places. Homelands, in other words, are
relegated to the past and to a site elsewhere, while its diasporas are located in the
present. Challenging the notion that the arrows of historical change and spatial
dynamism are unidirectional, Matory (1999) shows how the diaspora, Brazilian free
blacks and recaptives8 in Lagos, Nigeria, was the chief architect of its homeland. This
ironic example shows that discourses and practices that fix Africa in a remote and
timeless past are, from an empirical standpoint, untenable9.
The Dialectics of Brutality and Dignity
7 The idea and pursuit of African roots are dialectical manifestations of both brutal
ascriptions and defiant self-fashionings. Or, more accurately, brutality and defiance
demarcate the limits within which these dialectical struggles are staged. During the
transatlantic slave trade, perhaps over one hundred million Africans were killed or
captured by European slave-traders and their African collaborators. Scholars estimate
that the number of Africans who landed in the Americas—those who survived capture
and the subsequent Middle Passage—falls between nine and twenty million (Curtin
1969; Inikori 1976; Inikori & Engerman 1992; Lovejoy 1983). The triangular circulation
of Africans, African technologies, African resources, rum, guns, steel, sugar, salt, gold,
textiles, and so on, linked the two hemispheres in new and enduring ways; moreover,
this horrific event has created global consequences—social, political, economic and
cultural—that are being reckoned with today.
8 One such consequence is the idea that there was place called “Africa” inhabited by an
inferior race of people called “Africans” (Campbell 2006: 10-11). In the New World, the
enslaved victims of this “enterprise” gradually, and to varying degrees, came to see
themselves as “Africans”, as their direct knowledge of their ancestral lands declined
over time and space.
9 Oral histories, historical “memory”, print media, rumor, linguistic and cultural self-
segregation, and interaction between African creoles10 and newly arrived enslaved
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
413
Africans are just a few factors guaranteeing the ongoing, dynamic interface of these re-
imagined self-identities. Sierra Leone, in particular, is a key site for understanding this
interface, given its early history as a site selected for the return of liberated slaves, and
later, for proselytization/ civilization of native-born Africans by African diasporans.
10 Analogous processes in Africa and Afro-western Europe gradually matured to
complement this emerging diasporic sentiment: “Africanness” became a source of
solidarity against Euro-colonialism. These processes coalesced, albeit imperfectly, while
maintaining their respective internal complexities, to foster among some Africans and
African diasporans a sense of universal struggle against black subordination. With this
in mind, we turn to what we feel is a contemporary example of this phenomenon—
African roots tourism.
11 Although derivative of these past processes, we do not claim that the contemporary
discourses and practices we analyze are perennial reproductions of the past. Rather, we
emphasize that Africanness—what Africa is and what it means to be African—is
constantly deployed, contested, and revaluated within and outside the imagined, elastic
boundaries of its referent—Africa. Nor do we claim that these discourses and practices
are examples of “globalization gone wild” (Bruner 2001). Rather, we assert that African
roots tourism is a product of a complex array of self-interested, if unequally
empowered, actors, transnational solidarity networks (pan-Africanist, Black
Nationalist, Afrocentrist), technologies (Internet, cell phones, commercial jetliners,
polymerase chain reaction) and structural enablers/constraints (global capital, non-
governmental agencies, civil society) of varying scale (local, regional, continental, and
global). In the subsequent sections, we highlight the role that two particular nations—
Ghana and Sierra Leone—play in this contemporary discourse and practice around
Africanness.
Sierra Leone: Back to Africa
12 Settled in the late 1790s by a few hundred “Black Poor” from England and freed blacks
who fought with the British during the American War of Independence, Sierra Leone
has long been significant for “generations of African Americans struggling to make
sense of their relationship to Africa” (Campbell 2006: 16). After the British abolished
the capture and sale of African people as slaves in 1807, the British navy intercepted
slave ships, and sent the “human cargo” to live in Sierra Leone. Today, the descendants
of these tens of thousands of “recaptives” call themselves Krio, and count various
groups—Yoruba, Igbo, Kongo—among their ancestors.
13 The circulation of black people among continents continued to characterize Sierra
Leone throughout the nineteenth and twentieth centuries. During the 1810s African
Americans began traveling to Sierra Leone, seeking to save souls and civilize the
fledgling nation. And, reversing this traffic, nativeborn Sierra Leoneans seeking
Western education, journeyed to Western Europe and the US11. Some scholars have
argued that, during the 19th century, Freetown served as the birthplace for “political
nationalism” and conscious Africanism (Hair 1967: 526). One pivotal figure that
embodied this transnational movement and the origin of pan-African ideals is Edward
Wilmot Blyden. Born on the Caribbean island of St Thomas in 1832 to Igbo parents,
Blyden emigrated to Liberia in 1851, and later settled in Sierra Leone in 1871. While in
West Africa, he vociferously opposed European repression and paternalism. In 1872,
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
414
only a year after he settled in Freetown, he established The Negro newspaper. Regarding
the name of the newspaper, Blyden wrote:
“It has been called the ‘Negro’ (if any explanation is necessary) because it isintended to represent and defend the interest of that peculiar type of humanityknown as the Negro with all its affiliated and collected branches whether on thiscontinent or elsewhere. ‘West African’ was considered definite enough, but tooexclusive for the comprehensive intention entertained by the promoters of thescheme, viz: to recognize and greet the brotherhood of the race wherever found”(Frenkel 1974: 284-285).
14 Although Blyden contested (and lost) presidential elections in Liberia, he lived in Sierra
Leone for most of his life, eventually dying there in 1912. Blyden’s ideas are widely
considered to be the precursor to negritude and pan-African thought; at all stages of
his work he championed racial pride among African peoples, a deep love for Africa, and
a belief in African renaissance (Frenkel 1974).
Athens of West Africa
15 Into the 20th century, Sierra Leone, and Freetown, in particular, was a beacon for
African renaissance. The city’s Fourah Bay College attracted students from all over
West Africa, and contributed to Freetown’s reputation as the “Athens of West Africa”.
Despite a gloried history of resistance and anti-imperialism, Sierra Leone, unlike in
other parts of West Africa, had an anti-colonial movement limited in its scope and
popular appeal, even as it resulted in the withdrawal of British colonial rule in 1961
(Braithwaite 1962). Three decades of relative peace were followed by a rebel insurgency
in 1991 which sought to re-balance the effects of decades of post-colonial graft and
uneven distribution of resources.
Post-conflict Reconstruction through Tourism
16 Five years ago, Sierra Leone emerged from that ten-year civil war that displaced nearly
half of its five million people. Characterized by most Western and African media as a
rebel war without a cause, the country has struggled to rebuild its economy, its
infrastructure, and a collective sense of stability. In addition to extracting natural
resources like diamonds, gold and bauxite, the government and foreign investors have
focused on reviving Sierra Leone’s nearly defunct tourist industry. As the government
grapples with developing the infrastructure necessary to entice Europeans to
Freetown’s beaches, or the hills of Kabala, investors and outsiders have touted the
“value of roots” and its potential for infusing foreign currency into Sierra Leone’s
economy (African Investor 2007: 80). Sierra Leone claims a “direct” connection to African
Americans in the southeastern US, citing anthropological evidence of southern blacks’
descent from the rice-growing Mende people of Sierra Leone (ibid.). With the growing
popularity of genetic ancestry testing among black Americans, and with 30-40% of DNA
tests indicating Mende and Temne ancestry, Sierra Leone expects an increased number
of African American roots travelers (Bolnick et al. 2007)12.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
415
Direct Roots and Homecomings
17 More recently, new agendas on both sides of the Atlantic motivated a third wave of
homecomings. Sierra Leoneans and African Americans have clamored for
demonstrable, specific, and direct links between Sierra Leone and the US, reflecting a
desire for interaction and collaboration. Joseph Opala, an American anthropologist who
has worked in Sierra Leone since the 1970s, described his role in mediating the mutual
interest and curiosity among Sierra Leoneans and African Americans with links to
Sierra Leone: “My greatest pleasure [...] was sharing my historical findings with Sierra
Leoneans [...] when I first announced that had I traced some of the slaves taken away
from Sierra Leone to a particular place in America, people were ecstatic. Sierra
Leoneans never dreamed of finding their lost family, and the response was so strong I
was taken aback. Suddenly, every newspaper and radio station in the country wanted
to interview me, and many schools and community groups wanted me to speak.
Everywhere I went the questions tumbled out: How did you trace the slaves? Where
were they taken? Why were they taken there? What are their descendants like today?”
18 The first set of the connections were made through “Gullah homecomings”, with the
first in 1989, and a second one in 1997. The Gullah people are the African Americans
who live in coastal South Carolina and Georgia today, the descendants of the rice-
growing Africans brought from Sierra Leone and other parts of the Rice Coast13. They
live in what is called South Carolina’s low country, on the southern coast of the state,
and on the sea islands off the coast of South Carolina and Georgia. Though linguists and
anthropologists have questioned the extent to which the linguistic and cultural links
between Africa and North America have been preserved, the group is known for having
preserved more of their African language and culture than any other black community
in the US.
19 According to Opala, who, aside from Lorenzo Dow Turner14, helped to make these
connections more widely known, each homecoming has been more specific than the
last, reflecting the increasing knowledge produced about the connection between
Gullah and West African culture by scholars working in the Atlantic region. The first
reunion, or homecoming, which occurred in 1989, involved Gullah leaders interested in
their links to Sierra Leone, but with no known personal connection to that country. The
Moran Family Homecoming in 1997 involved a family from coastal Georgia that had
preserved a song in Mende from a specific village, passing it down for two hundred
years. But what would eventually be called Priscilla’s Homecoming (2005)15 was the
most specific. Records collected in Sierra Leone and the US linked a US family to a girl
named Priscilla, who was enslaved and transported to the US from Bunce Island, Sierra
Leone, in 1756.
20 In July 2003, having learned of this link from Opala, the government of Sierra Leone
sent an invitation letter to Thomalind Martin Polite asking her to participate in a
“homecoming” ceremony in the country:
“There is every reason to believe that your ancestor, Priscilla, came from ourcountry and that Sierra Leone is your ancestral home [...]. [We] can assure you thatyour visit will be well publicized here [...] and that thousands of our people will beanxious to greet you, their long-lost family come home from South Carolina.”
21 Polite was, indeed, welcomed with great fanfare and a series of official ceremonies.
During her visit, she also traveled to Bunce Island. Observers posted their travelogues
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
416
online16, along with a series of multimedia tools for use by the interested public. A film
about Polite’s journey to Sierra Leone is currently in production.
Ghana: The "Black Mecca"
22 During the post-Reconstruction era, which many scholars assert was the nadir of white
racial terror in the US, Chief Alfred Sam, a Gold Coast (Ghana) businessman, devised a
plan to resettle several hundred “Negroes” at Salt Pond, in what is now the Central
Region of Ghana. In 1914, Chief Sam set sail from Norfolk, Virginia with sixty black
American emigrants, mostly from the Midwestern state of Oklahoma17. The
propagandist for Chief Sam’s ambitious program was Reverend Orishatuke Faduma, a
Sierra Leonean scholar-activist of Yoruba descent. Faduma expressed his unwavering
support for black repatriation and believed that black North Americans’ desire to
“return” to Africa was not simply a reaction to white oppression: “There was always a
feeling among Negroes in the New World to return to Africa, their mother land”
(Langley 1973: 71). For reasons ranging from poor organization and planning to strong
opposition from British colonial officials, Chief Sam’s “Back-to-Africa” scheme was a
complete failure. He, nevertheless, inspired or, at least, foretold other “repatriation”
efforts—including those of the Jamaican Marcus Garvey, who carried out a similar
scheme on a much grander scale18.
23 Less than fifty years later, Ghana has become the “Black Mecca” for African American
sojourners to Africa, a distinction it has held since it won its independence from Britain
in 195719. At that time, Kwame Nkrumah, Ghana’s first head of State, encouraged
American and Caribbean blacks to relocate to Ghana and contribute their resources,
professional training, and technical experience to the development of Africa. Hundreds
of African Americans heeded his call and took up residence in Ghana. Some of these
“returnees” played an important role in the early years of Ghana’s nation building
project (Gaines 1999, 2006). After Nkrumah was overthrown in 1966, virtually all the
African Americans in Ghana either left voluntarily or were expelled by the military
regime for “national security” reasons.
24 Ironically, the New Patriotic Party (NPP), which had expressed little interest in
Nkrumah’s pan-Africanist agenda, now promotes deepening relationships between
African Americans and Ghanaians. Moving to put their unique stamp on this effort, the
regime set up the Ministry of Tourism and Diaspora Relations, which is tasked with,
among other things, strengthening the familial bonds between these two groups.
Unlike in the Nkrumah era, none of the recent programs encourage African Americans
to resettle in Ghana. Instead, they focus primarily on African Americans as sources of
tourist revenue rather than as potential citizens20.
"Ghana@50: Lets All Celebrate!"
25 Ghana is celebrated by its “development partners”, and self-promoted by Ghanaian
elites, as a model African nation. On 6 March 2007, the Ghanaian government embarked
upon an ambitious program of celebrations to commemorate the 50th anniversary of its
independence and to further solidify its status as the “gateway to Africa”. The official
theme for the events was “Championing African Excellence”. The celebratory mood was
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
417
encouraged by a theme song which had as its refrain, “Ghana@50: Lets All Celebrate!”
Yet, the purpose, intent and even the necessity of celebrating Ghana’s Golden Jubilee
was debated throughout the nation (Akyeampong & Aikins 2008). One widely publicized
debate21 became so acrimonious that the immediate past president of Ghana, Jerry
Rawlings, refused to participate in officially sponsored commemoration celebrations
(Obeng 2007: 15). Rawlings criticized the incumbent New Patriotic Party (NPP) on the
following counts: it was using the celebrations to mask their “witchhunting”22,
malfeasance and incompetence; the celebrations did not properly acknowledge the
contributions of his regime, the National Democratic Convention (NDC); and the
impoverished status of the “average” Ghanaian made the celebration a sham. The NPP
countered that their (NPP) regime had ushered in unprecedented levels of peace,
stability and prosperity and the celebrations should be observed in the spirit of
national unity and reconciliation. Public debate often followed party lines, but the
events were generally well attended, despite numerous complaints about poor
organization. Although there were divergent opinions about the utility, objectives and
appropriateness of the celebrations, most conceded that fifty years of independence
was an important moment to reflect on the nation’s postcolonial accomplishments,
failures, and future aims.
26 The commemorative events included lectures by intellectuals, politicians and
traditional authorities; beach parties, parades and cultural performances; and gospel,
hiplife (Ghanian rap/hiphop music), reggae and highlife concerts. In addition, the
government developed specific programs to promote and attract roots tourism, with a
special emphasis on black North American cultural tourists: the Emancipation Day23
observance of the 200th anniversary of the abolishment of the slave trade by Britain;
PANAFEST24, a biennial event that promotes global black unity through the celebration of
pan-African culture and heritage; and the Joseph Project, a one-time event spearheaded
by Jake Obetsebi-Lamptey, then the Minister of Tourism and Diasporan Relations aimed
at reconciling the emotional, social and material gulf between Ghanaians and black/
African diasporans.
"We Are not Tourists": Reconciling Foreignness,Capitalism and Affective Ties to "Home"
27 Roots travelers find many different routes to the “Motherland”. Paulla Ebron has
described how corporate entities like Heineken and McDonalds co-opted the tropes of
“roots”, “return” and “pilgrimage” in pursuit of profit. She suggests, however, that
these instances of corporate capitalism are not necessarily antithetical to the aims of
“authentic” pan-African identity construction. These identity constructions, she
argues, are not the same as in the previous era of black American radicalism; nor are
they entirely new. Whereas the black revolutionaries of the 1960s offered radical
critiques of imperialism, capitalism and structural racism, contemporary African roots
pilgrims are as likely to rely on more conservative tropes of individualism and personal
responsibility. The relatively conservative posture of some modern-day African roots
travelers makes the marriage between global capital and pan-African desire viable—a
prospect that would have been untenable forty years ago.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
418
28 Saidiya Hartman tracks a different but related trajectory for black diasporan
pilgrimages to Africa that gradually shifts from the idealism of the 1960s to a more
sober outlook in the 1990s:
“In the sixties it was still possible to believe that the past could be left behindbecause it appeared as though the future, finally, had arrived; whereas in my agethe impress of racism and colonialism seemed nearly indestructible. Mine was notthe age of romance. The Eden of Ghana had vanished long before I ever arrived”(Hartman 2007: 37)
29 She adds that “unlike the scores of black tourists who, motivated by Alex Haley’s Roots,
[she] had traveled to Ghana and other parts of West Africa to reclaim their African
patrimony. For [her], the rupture was the story” (ibid.: 42). We are wary of analyses
which suggest that motivations for return can be easily schematized or dismissed as
“romanticism”; Ebron and Hartman capture nicely the shifting ground on which
diasporan African desires for return are constantly reshaped.
30 Some black Americans travel to Africa with Afrocentric tour groups that cater to their
cultural-political agendas. The Ghana Roots Culture and Repatriation Tour, for
example, is a diasporan African grassroots initiative sponsored by the Africa for the
Africans Tours and Investments Group (AFTA)25. AFTA targets and attracts a broad range
of clientele including medical doctors, Afrocentric scholars, blue collar workers,
entrepreneurs and retirees. The travelers are generally working—to middle-class,
college-educated and earn, on average, $35,000-$80,00026. The AFTA tours are expensive
by Ghanaian standards; a ten-day excursion in 2008 cost $2,950. For travelers from the
“western” world, the relative strength of western currency can be of considerable
economic advantage in “developing” nations. But these excursions can represent a
significant financial sacrifice for many middle and working class black Americans.
31 The organization aims to foster deep, enduring ties between continental and diasporan
Africans by promoting pan-African (black) nationalism, African investment, and
“repatriation” to the “motherland”. The program’s brochure states: “Our mission is to
reconnect our people with the motherland. Our main tool [...] is through tours.
Organized tours have proven to be the most effective way to dispel the myths and
negative propaganda that keeps Africa [and its diaspora] divided.” The “divide”
between African Americans and Africans has received modest public notoriety due to a
spate of articles appearing in US newspapers and magazines from the early 1990s on
(Boorstein 2001; Polgreen 20o5; Rimer & Arenson 2004; Roberts 2005; Washington 1992;
Zachary 2001). If the frequent, negative media portrayal of Africans and African
Americans are any indication, this perspective about negative propaganda is
warranted27. Nevertheless, it is a mistake to reduce all instances of divergence to
propaganda; some of these differences result from the peculiar agendas and outlooks of
the respective communities.
32 While in Ghana, the AFTA coordinators outlined an ambitious itinerary that had many
participants struggling to keep up: a two-day conference designed to encourage
investment in Africa; a video screening aimed at black/African consciousness raising;
excursions to several slave castles and forts dotting Ghana’s coastline and to Fihankra28,
a diasporan African township in the Eastern Region’s Akwamu Traditional Area. During
the conference, participants discussed strategies to liberate Africa and Africans in the
diaspora, acquiring land, slavery reparations and repatriation. Many African Americans
expressed a desire to return “home” and help Africa29.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
419
33 A Ghanaian presenter, Kwame Osei, asked black diasporans to “think of themselves as
Africans”. He complained that “non-Africans are dominating our economy”, and that
they [the non-Africans] were “not interested in emancipation” but, “exploitation”. Osei
urged his predominantly African American audience to “use your expertise to take
back Africa”30. AFTA literature echoes this sentiment: “The investment portion of the
tour is designed to promote a self-sufficient Africa by connecting the skills and
resources of Africans in the Diaspora with projects, investment opportunities and like-
minded brothers and sisters on the continent.” The organizers invoke a sense of
urgency: “In order for Africans to thrive and survive the war being waged against us
globally, we must build a home base of power in Africa. We are at a critical stage in our
existence; its Repatriation and Pan-Africanism or perish.” Here, the organizers deploy
warfare idiom with great effect, communicating the urgent need for collective black/
African struggle, at once physical, mental, and spiritual.
34 The Daily Graphic, the paper of record in Ghana, published an article entitled, “Reject
the Leadership Tourists” (Abbas 2007: 15). The article warns against supporting
presidential aspirants who are “out of touch with the people” and lack a substantive
relationship with their constituents. The article shows that the word “tourist” may
have, for Ghanaians, the same negative connotation—that of fleetingness, or lack of
intimacy with local realities and local people—for black diasporan sojourners to Africa.
As a prominent female member of the black American expatriate community in Ghana
put it, African American roots travelers have all have made a conscious decision to
identify both politically and culturally with Africa, whereas the “typical” tourist might
not.
35 Jasmyne Cannick, like many other roots travelers we talked to, expressed a sentiment
that supports this claim. In an interview on National Public Radio about her May 2007
trip to Sierra Leone with actor, Isaiah Washington31, Jasmyne remarked:
“Well, anytime you travel to the Motherland, you have to go with a purpose.Isaiah’s purpose in going was to check on the school that he’s building in one ofSierra Leone’s villages, Njalakendema. My reason for going [...] [is] because I wantedto go back home, and get in touch with my people. And that was the most liberatingexperience I’ve ever had in my entire life.”
36 Yemi a thirty-something year-old dreadlocked African American attorney from Atlanta,
Georgia, describes some challenges she faced trying to reconcile Ghanaian ascriptions
of her foreignness with her own feelings of belonging during her trip to Ghana with the
AFTA tour group:
“I think that probably the thing that surprised me most in my experience here isthat there were a lot of Ghanaians that perceived me as more like a European, aregular tourist. I didn’t necessarily expect them to embrace me as if I were familyper se, at least not all of them across the board, but I was surprised that they wouldgo as so far as to view me the same as the European or Caucasian American [...]despite the fact that before I opened my mouth, I looked like any other African orRastafarian [chuckles] walking the streets.”
37 Yemi was especially disappointed when Ghanaians called her “oburoni” (usually
translated as “white person” or foreigner)32. The feeling of being treated as a foreigner
and, as several African American sojourners put it, like “a walking dollar bill”, is a
common sentiment among African Americans I (Shabazz) have interviewed. Some
deeply resent this perceived treatment, while others express a sense of humor about it.
And, of course, some African Americans concede that they can understand the local
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
420
Ghanaian perspective. Traveling on private buses, walking around town with cameras
and bulging backpacks, and toting bottled water, all mark one as a “tourist”, despite
protestations to the contrary.
38 Officials from the Sierra Leone tourism agency and the World Bank do little to
contradict the idea that they are deeply invested in attracting African American
dollars. They, too, highlight the potentially lucrative role of roots tourism in their
development portfolios. According to an article on African tourism in the African
Investor magazine (2007: 80): “Approximately 36 million Americans have African
descent, 43% of whom have some college or bachelor’s degree. ‘Niche marketing
numbers don’t get any better than this’, says the World Bank report. The World Bank
believes about fifteen million African Americans could be appropriately targeted with
an information campaign on Bunce Island and motivated to visit”.
39 African Americans interviewed in Ghana frequently cite racial oppression and de-facto
second-class citizenship in the US as key motivations for traveling to Africa. They often
told me (Shabazz) that they came to Ghana with the hopes of making or reinforcing a
spiritual “connection” with Africa and, possibly, “repatriating” at a later date. And as
these two women’s accounts convey, the sense of unofficial exile and the concomitant
reaction against US white racism is not the whole story—they also describe a deeply felt
affinity with Africa and Africans.
Fihankra: a Way Back Home
40 In 1994, the Ghana House of Chiefs, many other traditional authorities from Ghana,
Nigeria, Togo and Ivory Coast, and participants from the African diaspora, assembled to
atone for the role of African chiefs in the transatlantic slave trade. The most important
symbol of this atonement process was the purification of an animal skin and carved
wooden stool. The stool is emblematic of chiefly authority among many ethnic groups
in southern Ghana, most notably the Akan. Likewise, a ritually prepared animal skin
has a consonant function for many of Ghana’s northern groups.
41 The purification rites culminated with the appointment of Nana Kwadwo Oluwale
Akpan, a diasporan African from Detroit, Michigan, as the custodian of the stool and
skin. In 1997, Nana Akpan was nominated and appointed the Fihankrahene (chief of
Fihankra), the sacred caretaker of 30,000 acres of stool-land33 ceded to the group by the
Akwamu traditional rulers and elders34. The allotment of land was a vital component of
atonement and of the “reintegration” of diasporan Africans into African society. Lastly,
Nana Akpan was designated as the first African American member of the Ghana House
of Chiefs.
The Afro-politics of Style
42 Each year, Fihankra receives hundreds of African diasporan roots travelers hoping to
live and/or invest in Africa. When the 40-strong AFTA group traveled to the Akwamu
traditional area to see the Fihankra site, most members of the group displayed
“coiffure politics”35 or adhered to a loosely defined set of sartorial expressions
paramount to an Afrocentric ethos: “natural” hair, or hair that has not been
straightened with chemicals or hot metal combs; African jewelry, especially beads,
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
421
cowrie shells or the ankh, the ancient Egyptian symbol of life; and brightly colored
African shirts or t-shirts with Afrocentric messages:
“Advantages of Melanin”“Black to Our Roots”“Sankofa”36
“Son of a Field Negro”“Bring Back Black”
43 Or the names and images of (exclusively male) iconic figures:
“Fred Hampton”37
“Nat Turner”38
“Huey Newton” 39
“Malcolm X”“Kwame Nkrumah”
44 Nana Akpan, the African American Fihankrahene (paramount chief of the Fihankra
township), delivered a brief, informal speech to AFTA and held a question-and-answer
session. The Fihankra community, he stressed, is reserved for blacks “born in the
Diaspora as a direct result of the transatlantic slave trade”; a “historical community”
with a “historical purpose”. He also explained that the community began with a
“slavery apology ceremony” and that Fihankra aims to “contribute to reconstructing
Africa” and “promote the reintegration of Africa with its diaspora”. This reintegration
would be spearheaded by diasporan Africans who had “acquired specific skills”. Nana
Akpan also announced an upcoming conference with the theme “A way back home”, to
be sponsored by the Fihankra movement. Stressing that Africa is “home”, he urged the
group to not view themselves as “regular tourists”40. Fihankra is by any standards in
innovative experiment; it draws upon black diasporan and continental African notions
of morality and restitution to establish a neo-“traditional” institution which aims to
bridge the political, economic and socio-cultural divide between these two respective
groups.
Jasmyne Goes to Sierra Leone... and Other Blog Tales
45 This section focuses on data collected from weblogs that featured discussion about
African Americans’ travel to Sierra Leone during my (Benton) eighteen months’
fieldwork there. The interchange between Africans and African Americans through
internet technologies highlights another way that these groups engage in dialogue and
how they assert, contest, and generally, discuss Africanness in public forums. During
my fieldwork, I (Benton) regularly read the weblog of Jasmyne Cannick, an African
American journalist based in Los Angeles. Her blog focuses primarily issues of race,
gender and sexuality in American culture, and her unabashed accounts of being a
lesbian of African descent are read by dozens of people daily.
46 In late May 2007, Jasmyne alerted her readers that she had been invited by actor Isaiah
Washington to accompany him on and document an upcoming trip to Sierra Leone. At
the time, Isaiah Washington was building a primary school in Bo District, because of his
genetic ties to the area; his maternal, or mitochondrial DNA, had matched a Mende
sample in a commercial DNA database. During her trip with Washington, Jasmyne
uploaded pictures of the sites she visited, including pictures of her trip to Bunce Island
slave castle. Her comments focused on her “return”. She urged others of African
descent to do the same. Her narrative also reveals an explicit desire to help Sierra
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
422
Leoneans to improve their life conditions, and a deeply felt affinity for the people she
encountered on her trip:
“It’s taken me a week to get it together to write about my trip partly because I amstill playing catch up but mostly because I am still processing everything I saw anddid over there and all of the wonderful people that I met.I realize now what is important and what we all need to be fighting for are povertyand not just poverty in America, poverty around the world, more importantly inAfrica, where much of the continent is still underdeveloped and still very muchexploited, and sometimes by our own.Going to Sierra Leone changed my life and my vision of the world and I am gratefulfor the opportunity. I will never take food, clean running water, paved roads,electricity, and shelter for granted again in my life, nor will I be wasteful in myhabits.”
47 In addition to expressing her affinity with the “wonderful people” she met while she
was in Sierra Leone, she implies, too, her place as American and African. She wants to
live and work in solidarity with the people she met, while she also acknowledges
greater consciousness of the daily hardships that many Sierra Leoneans face. Although
many other African American travelers (my mother expressed similar feelings about
Sierra Leone and Ghana, for example) express this sentiment, the weblog—as a forum
for discussion and dissent—affords us the opportunity to gauge the responses of others
to her story about her journey. Most striking were the ways that (self-identified)
Africans who read her blog, reacted to Jasmyne’s visit to Sierra Leone:
“I had goosebumps reading this! I am so happy you had such a once in a lifetimeexperience to go to Africa [...]. Being an African myself, I agree a lot of AfricanAmericans should try to go to Africa and visit. A lot of perspectives and prejuidices[sic] will be changed. There is so much good one can do with a little effort and doingaway with some taken for granted luxuries we have here in the USA.”
48 Another “native African” reader, John Akoli, wrote:
“Great thread, as a native African myself, it is always good to read how AfricanAmerican’s [sic] feel when they go to the continent. Mr. Washington is doing greatthings, and hopefully God will bless him to continue to do so.”
49 The two “African” responses to Jasmyne’s trip demonstrate the beginnings of the
breadth of potential African-African diasporan relations as imagined by Africans, and
which are built on this notion of roots travel. Implied in the two statements here is
that, first, there are misconceptions among African Americans about Africa, and,
second, that visiting Africa is one way to debunk these misconceptions and resulting
prejudices. In so doing, they suggest that these misconceptions and prejudices arise
from lack of knowledge, knowledge which would usually be grounded in the experience
of “being there”. The authors of these statements, therefore, tell us that in completing
a journey to Africa, we see things “as they are”. Roots travelers, then, become
conscious of the uneven distribution of resources among the world’s people and how
everyone is somehow implicated in these economic structures (“the continent is [...]
very much exploited, and sometimes by our own”). Overall, the authors demonstrate
that there are Africans who acknowledge their desire—if not obligation—for
constructive, productive engagements with African Americans. And when African
Americans make positive, affirming journeys to the continent, they somehow
demonstrate, too, their commitment to fulfilling similar desires and obligations in the
long term.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
423
50 These types of responses to African American roots-related and philanthropic sojourns
were not unique to Jasmyne’s weblog. One of the (few) tourist sites encouraging travel
to Sierra Leone41, featured in its weblog a story about DNA pilgrims, who appear to make
up the bulk of roots travelers to Sierra Leone. Okolo, a Sierra Leonean who recently
moved back to Sierra Leone from the US and the moderator for the site, recounts the
story of Isaiah Washington’s DNA connection to Sierra Leone, as well as news about
Oprah Winfrey’s own test—which revealed a genetic connection to the Kpelle of Liberia.
At the end of her piece, Okolo notes, “Anyway, what does this mean for Sierra Leone
and other African countries? It means great opportunities for greater cooperation
between Africans their brothers and sisters42 scattered around the globe. This is one to
follow with great interest as we will hear more stories such as those mentioned above
in the coming years and will probably play a huge part in Africa’s tourism industry in
years to come”.
51 Again, Okolo’s reference to “brothers and sisters” suggest kin-like connectedness
between Sierra Leoneans and Americans of African descent. It also indicates the
potential for constructive collaboration between the two groups that is rooted in this
sense of relatedness. In Okolo’s narrative, the potential for enhanced collaboration
between Sierra Leoneans and African Americans, however, is mostly realized through
tourism (likely because this is a site dedicated to promoting tourism in Sierra Leone)—
and philanthropic efforts. Such a distinction is noteworthy for this discussion, since it
seems that African Americans, are again recognized in terms of what they contribute
materially during their visits to the country. Tourism appears to be an end in and of
itself.
52 Okolo’s entry about Isaiah Washington’s philanthropic efforts elicited nine reader
comments. Six comments came from African Americans who had submitted a DNA
sample for ancestry testing and “discovered” genetic links to Mende or Temne people,
groups that are linked to present-day Sierra Leone. Two of the remaining three
commenters were Sierra Leoneans who wholeheartedly agreed with the pan-African
solidarity message advanced by Okolo. One of these commentators, “Iverson”, noted:
“I am very happy to hear all this good news about my brothers and sisters comingback to their homeland. We need to aware that we are all one from our sharedhistory. I hope that one day all african desendants [sic] will be united as in onenation. Africans You [sic] need to open you your eyes and push away youroppressor. We wanna go home we have been on trail for too long. Every Africanshould be proud to be an african. I love Sierra Leone till I die.”
53 In addition to acknowledging his diehard nationalism and love for Sierra Leone, Iverson
also recognizes a “shared history” of Africans on the continent and elsewhere. He also
points to Africa as the site of return or homecoming for African Americans. More
interestingly, his statement is aspirational in tone; Iverson expresses hope for unity
between the groups. In his pan-African vision, he urges people of African descent to be
proud of their roots, and use it as common ground for race and roots consciousness
(“open your eyes”) and overcoming oppressive race regimes (“push away your
oppressor”). The remaining commenter, a Sierra Leonean living in the state of
Maryland in the US, voiced a different opinion about the utility of African-African
American alliances for improving the conditions experienced by the two groups. He
suggested that Sierra Leoneans “clean their own backyard” before pursuing a
relationship with Africans in the diaspora.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
424
54 These data do not reflect a scientific, randomized study of African-African diaspora
relations. They do, however, hint at the range and types of dialogue that can and do
exist about what constitutes an African, and who should engage in African struggles. By
engaging in these conversations, the members of these groups participate in an
instructive public dialogue in which they assert claims about the challenge and value of
African ancestry in effecting social change on the continent and in the African
diaspora.
Jumping to Forget (and remember) Slavery
55 As suggested in the other sections, slavery and its commemoration attracts African
roots tourism to both Ghana and Sierra Leone. And for obvious reasons: the capture
and enslavement of Africans in the West is a key marker in the identity of African
Americans. The extent to which slavery should be discussed or commemorated in
national development agendas, however, varies within and between Ghana and Sierra
Leone.
56 In her weblog account of her trip to Bunce Island slave castle in Sierra Leone, Jasmyne
tells her readers: “[...] it’s a life changing experience to walk in the footsteps of your
ancestors as they did when they were slaves and to see what they saw [...]”43. For many
African American sojourners to Africa, reverence for their enslaved ancestors who
survived the Middle Passage is commemorated through various sacred rituals.
Demonstrating this reverence through libations and prayers offered to the ancestors,
for example, is an essential component of the Afrocentric diasporan socio-political
consciousness. Those who perform these libations believe that the sacred umbilical
chord with Africa is maintained and actualized through the ancestors.
57 But for many Ghanaian Christians, especially evangelicals, ancestor veneration is
antithetical to religious faith. Nana, a Ghanaian graduate student at the university of
Ghana, on several occasions told me (Shabazz) that the “ancestors are dead and gone,
they can do nothing for you, and it is only through Jesus that we should offer prayers
because it is through him that we receive salvation”. Similarly, Mensa Otabil, a popular
evangelical minister in Ghana, opines that African Americans are looking backward
while Ghanaians are looking forward. He is critical of what he believes is the tendency
of African Americans to romanticize African cultural traditions. “As an African, I
consider our inability to renew our culture and move it from the definitions of our
ancestors to be a major problem. Anyone who tells me to go back to my ancestors does
not realize that I am already with my ancestors and I am trying to progress beyond
their legacy!” (van Gorder 2008).
58 The legacy of slavery is pivotal for roots travelers to Ghana who want to reconnect with
Africa. These travelers routinely visit monuments marking the slave trade, monuments
that are being marketed by Ghanaian officials for precisely that purpose. For Ghanaians
who look to the future with the same intensity, travelers’ efforts to make sense of what
happened and to honor their ancestors is a potential drag (Hartman 2002; Hasty 2002;
Holsey 2008).
59 A British-Ghanaian colleague opined that African Americans are “recolonizing Ghana
just as they did in Sierra Leone and Liberia”. She suggested that this “recolonization”
was not simply a material one, but also an ideational one. In her view, African
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
425
Americans’ ideas are hegemonic in African-African American dialogue and, in these
discussions, African Americans “only want to talk about slavery”. The colleague added,
for emphasis, that “there is more to Ghana than slavery!”. Thus, while some black
Americans hold the opinion that slavery is not discussed enough in Ghana, some
Ghanaians feel as if black Americans are preoccupied with the past, with little or no
concern for or knowledge about contemporary Ghanaian challenges. This is probably
what a Ghanaian acquaintance had in mind when he said (in a tone somewhere
between exasperation and disdain) that Ghana had “too much culture”. Both the
official and everyday preoccupation with cultural identity was, in his view, emotionally
taxing and unproductive. Only the most intransigent ideologue would disagree that
slavery is the lone event in Ghana’s history; but what remains unresolved is how to
strike a balance between the desires and interests that diasporan and continental
Africans express.
60 In Sierra Leone, monuments focusing on the slave trade form the cornerstone of efforts
attempting to attract roots travel to the still-rebuilding country. There is likely less
resistance among Sierra Leoneans to discussing the legacy of slavery, given its role in
the founding of the nation, and given, at the very least, to early (ca. 1947) national
commitment to commemorating African enslavement in the nation’s history44. In an
effort to rejuvenate an artifact that symbolically links Africans and Americans of
African descent, Joseph Opala has recently turned his focus creating a computer
reconstruction of Bunce Island, the site of West Africa’s Rice Coast’s largest slave castle
(Casale 2005). After failed efforts by the US Park Service effort to rehabilitate the castle,
now an endangered monument, a range of donors has supported this project. Wealthy
African Americans, like Isaiah Washington, for example, have donated money toward
this computer reconstruction, demonstrating the significance of these markers of the
past among African Americans.
61 Still, to suggest that African Americans or other African diasporans are solely focused
on slavery would be misguided. To the contrary, many diasporan Africans who travel to
Africa understand that they are making a connection to people whose identities are not
necessarily “bound up” with slavery and the denigration associated with the practice.
DNA ancestry technology provides—at least symbolically—yet another “pre-slavery” link
between African Americans and the African continent. As the African American wife
said to her Nigerian scientist husband:
“The great promise of genetic ancestry tracing to me as an African American is notjust to know that I am from Africa—this is rather clear to me. The difference is Iwant to know what part of Africa I am from. The question is—is it possible to re-establish the link, sense of who you are, where your family is from? Can we find ourfamily, the family we have been separated from? We are looking for the magicbullet [...]. Can DNA testing do this? It will be sufficient to know that my family isfrom Nigeria, Ghana etc. I just want to know the immediate beginning of my familyhistory. Slavery robs us of so much—our culture, our heritage. The question is, cangenetics fill this void? I see genetics as a tool to narrow down the possibilities”(Rotimi 2003).
62 The costs of these tests, which were once prohibitive, now range from as little as $189
to more than one thousand dollars. The tests are commercially available through for-
profit agencies like African Ancestry and through nonprofit research efforts like the
National Genographic Project. The tests are increasingly popular; African Ancestry cites
that their business doubled every year for the first four years of operation (Bolnick et
al. 2007). Profits for this company and others continue to grow, and additional
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
426
companies with access to genetic material from African populations have materialized.
The rapid uptake of these genetic ancestry services suggest that African Americans are
trying to find (seemingly) incontrovertible evidence of personal and family histories
and African membership prior to slavery45.
Afromance and the Art of Intimate "Readings"
63 One serious limitation of scholarship on African roots tourism is its preoccupation with
intra-racial discord. These accounts generally treat African diasporic and African
continental communities as discrete homogenous wholes that are then cast in
dichotomous pairings. Besides the fact that this schema begs the important question of
internal dynamism and diversity within each of the contrastive pairs (Skinner 1993),
there are few accounts of the ample instances of race-conscious African Americans and
Africans who successfully “read” each other—learning and refining the intimate
counter-global concept and practice of what we call, for lack of a better term, “Afro-
conjugal dialogue”. In this section, we highlight a compelling example of this dialogic
enterprise.
64 I (Shabazz) first met Joseph and Shelly while with a friend who was shopping for gifts in
Ghana’s capital, Accra. After exchanging greetings, I learned that Shelly was a
“homegirl”. She was from Compton, California, a few miles from my hometown,
Inglewood. Compton’s residents, like Inglewood’s, are mostly poor and working class
African and Hispanic Americans and undocumented immigrants from Central and
South America. These groups fiercely compete for jobs, housing, education, health care,
and a decent quality of life. In the US media, Compton is almost exclusively known for
crime, poverty, drugs, violent gangs and other perceived social “pathologies”46; tourists
are warned to avoid Compton47.
65 Shelly’s husband, Joseph, is a “Northerner”, someone from any of the three regions of
Northern Ghana—Upper East, Upper West, and Northern. Joseph is a native of Bawku48,
an important town in Ghana’s Upper East Region. In precolonial times, Northern Ghana
was ravaged by the transatlantic slave trade; a hugely disproportionate number of
enslaved Africans were taken from the region. During the colonial era, the British kept
the Northern territories in a perpetual state of underdevelopment because
66 Northerners were viewed as a ready source of unskilled labor. Schools and other
markers of “development” arrived in the region relatively late. Today, a
disproportionate number of Northerners subsist on mostly unproductive farms. These
conditions have pushed many Northerners to seek an improved quality of life in
southern Ghana where they are often socially stigmatized, politically marginalized, and
hired for the most onerous physical tasks.
Afromantic Visions
67 Joseph recounted how he and his wife, Shelly, first met. Joseph was on a lunch break
from the stall where he sells African crafts to tourists. He noticed Shelly sleeping on a
tour bus parked in front of the restaurant where he was sitting. According to Joseph, it
was love at first sight:
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
427
"Joseph: The first day I met her [...] I went to the shop and I told my mom ‘you knowwhat? I found my heart desire, and I found my love, and I found my wife’. And mymom was like, ‘do you have a fiancee? You don’t have any. Then how come youfound your love?’”Kwame: [laughs]..."J [laughing]: [his mom continued] ‘where she from?’ Then I said, you will meet her.If you want to meet her, we [Joseph and Shelly] just meet. So she [Joseph’s mother]will like to see her and see whether its true. Because when I am here [in my stall] alot of people come to me, come to my way—blacks, whites, there are interested inme, they like me. They like my—they like the way I talk, you know? I always dealwith them. I always [inaudible] to sell things for them [...] they didn’t touch myheart, you know? Before you see somebody you love the person will [...] their spiritwill talk, you know? And their spirit doesn’t go with my spirit so I don’t give mymind to them.”
68 When Joseph told his parents he was marrying an African American, his mother said
"do you know her well, do you think you can deal with her because their life is quite
different than we, you know? Things [...] the way they talk, the way they do [...]
everything is different”. To that, Joseph responded, "Well [...] she is the one God chose
for me. I think we are going to understand each other”.
69 Shelly explained that Joseph was her "pure thought”, her adolescent vision of her
dream companion. Normative American notions of family life and adulthood
circumvented these thoughts, she felt. Sons and daughters are sent off to college before
they have fully developed into responsible adults. She said that whereas as American
families are career-centered, African families are marriage-centered. The American
system forestalls one’s ability to mature into a proper spouse.
70 Joseph’s grandfather had a dream about Joseph’s future wife. His grandfather told him
that he "would meet his wife very soon” and that she would be “fair”.
“J: So I thought it was oburoni [white person] and I’m like ‘me, I don’t want to marryoburoni. You know, I told him, and like’ [...]. And he is laughing at me and says ‘why Idon’t want to marry oburoni?’ I say ‘no, oburoni is different, their everything isdifferent’. And he says ‘oh, you are going to meet someone who you like’ [...]. I cameback to Accra [...] two months exactly and I met her [looking at his wife]—twomonths.”
71 I asked Shelly if there have been any challenges, cultural or otherwise, that have made
their union difficult.
“S: When I look at him, he looks like me. And we think about some of the same stuffso much that [...]. Our Spirit is higher than any religion, any language, any color, orany culture, or any distance. You know, like I say ‘my Spirit is African’. You knowwhat I’m sayin? And just because I happen to be born somewhere else it doesn’tstop me from being who I am, you know. Because if I was born on a plane, [...] youwould still call me a person, I would still be a human being, you wouldn’t [...] defineme by my location [...] we go beyond any tangible, any physical, any material, anynational definitions. Like our Spirit is higher than that. We have a mission that’sbeen ordained and called by God so we see each other in a higher light [...].”“The only [challenge] is [...] I wouldn’t even say it’s a problem. We’re just learninghow to communicate and that’s important for the marriage, learning how tocommunicate non-verbally and verbally, you know? Its important because when westep out, we are one. So we are learning cues from each other. I’m learning how toread him when he tell me don’t buy it and I really want it, and [repeating] he saydon’t buy it and I really want it, so I gotta learn how to read him.”
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
428
72 Shelly’s suggestion of learning to read is evocative. Collective suffering, skin
pigmentation, and uncritical renderings of heritage will not suffice to create enduring,
mutually satisfying relationships. Positive relationships between Africans and African
Americans—fraternal, conjugal or otherwise—require serious work. The trope of
“reading” bears a resemblance to the anthropological process of becoming culturally,
linguistically, and socially competent as a field researcher. The ability to “read” seems
to us an essential part of the pan-African dialogue.
*
“Whether we knew it or not [...] the Afro-American struggle is inextricably linked tothe struggle in Africa and vice versa” (Kwame Nkrumah cited in Thelwell 2003).
73 The concept of African roots tourism is deployed for seemingly inchoate ends: African
officials are seeking foreign capital; local Ghanaians/Sierra Leoneans desire tangible
evidence of “development”; and African American pilgrims are pursuing a spiritual and
cultural “connection” with the “Motherland”49. Despite African American ambivalence
about the bourgeois connotations of touring, tourism creates the possibility for African
and African Americans to establish meaningful social, political, cultural, and emotional
ties. Further, as AFTA leaders assert, tourism can be an “effective way to dispel the
myths and negative propaganda that keeps Africa divided”. Much of the fledgling
scholarship on African roots tourism is lost in a tangle of rhetoric while failing to see
the possibilities, not to mention the enormous political stakes: global asymmetries that
perpetuate poor quality of life for too many continental and diasporan Africans (Ake
2003; Chinweizu 1987a, 1987b; Clarke 1992; Ferguson 2006; Rodney 1994; Williams 1987;
Zeleza 2003: 183-184).
74 Over ten years ago Obiagele Lake (1995) lamented that scholars generally depict
Africans as having ideas about identity and things that matter that are wholly
antithetical to their African American counterparts’ (Hartman 2002; Lake 1995). We
agree. Hasty (2002) does grant a modest concession in this direction, but leaves the
impression that Africans and African Americans have little or no common ground.
African American ideas are presented as idealistic and not grounded in the everyday
reality of Africans, while their African counterparts are presumably only concerned
with their immediate material needs. This Manichean contrast between diasporan
idealism and African realities, is, in our estimation, exaggerated. This characterization
does not fully capture the richness of African and black diasporan encounters50. When
African Americans travel to Africa it is inevitable that some Africans and some African
Americans will be disenchanted and disappointed. We do not deny inevitability of
cross-cultural discordance, but we do think it is important to devote analytical
attention to the full range of pan-African encounters. Many are positive and mutually
affirming. Some even develop into “Afromances”.
75 A second issue is that when people claim a historical rootedness in particular locales,
their claims are often emotional. Are emotional ties incompatible with clear-thinking
scholarship? Normative ideas among social scientists would have us believe so. As
anthropologists, we have few tools for analyzing emotion that do not exoticize the
subjects of our inquiries (Hooks 2001; Mead 2001)51. This raises a more controversial
point. We believe that the highly emotive nature of roots-related field research makes
cross-racial communication difficult. Many African American roots travelers and, to a
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
429
lesser degree, their race-conscious African counterparts, are dismissive of mainstream
scholarship in general, and white scholars in particular. While we make no judgment
on this issue, it is important to note its existence. This is not to say, however, that
Blackness/Africanness is a prerequisite for “getting it right”. There are black
intellectuals who pathologize black populations (e.g. Patterson 2006), some to the
extent of reducing Africa to a site of “ignorance, squalor, and disease” (Crouch 1995: 81;
Richburg 1998). We will leave the final word with one of our many articulate
interlocutors, Shelly:
“The city of Compton is called the hub [...] because it connects L.A. (Los Angeles),Watts, Lynwood, Long Beach, Paramont, Cerritos [...]. You know, it connects thesecities. And so, Ghana being the hub for the African spirituality worldwide. For theBrazilian African to come and be able to say ‘oh, I’m African’. I can come here to get[...] grounded in my African spirituality. I don’t necessarily have get my DNA tracedback and go back to the middle of the Congo to say ‘this is where I’m from’ becausewe just want to show you the natural law. You mixed up all they way around, butthat doesn’t even matter because the base of you is African so come and find yourown level. And I think Ghana is gonna be the place where [black] people gone come—all over the world [...] to come and find their level.”
BIBLIOGRAPHY
ABBAS, A. N.
2007 “Reject the Leadership Tourist”, Daily Graphic (Accra): September 5: 15.
AFRICAN INVESTOR
2007 “Taking the Plunge”, <http://www.africa-investor.com/article.asp7ifc1676>.
AKE, C.
2003 [1996] Democracy and Development in Africa (Ibadan-Abuja: Spectrum Books).
AKYEAMPONG, E. K.
2000 “Africans in the Diaspora: The Diaspora and Africa”, African Affairs 99: 183-215.
AKYEAMPONG, E. K. & AIKINS, A. D.-G.
2008 “Ghana at Fifty: Reflections on Independence and After”, Transition 98: 24-34.
APPIAH, A.
1993 “Fallacies of Eurocentrism and Afrocentrism”, <http://www.aei.org/news/newsID.17961/
news_detail.asp>.
APTER, A.
1992 Black Critics and Kings: The Hermeneutics of Power in Yoruba Society (Chicago: University of
Chicago press).
ARIE, I.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
430
2006 I Am Not My Hair (Detroit, MI: Motown Records).
BAKER, L. D.
1998 From Savage to Negro: Anthropology and the Construction of Race, 18961954 (Berkeley: University
of California Press).
BENTON, A.
2006 “Down with Pan-Africanism and Black Nationalism? New Genetic Technologies and the
Black Quest for Nation, Ethnicity and Family”, unpublished ms.
BOLNICK, D. A. ET AL.
2007 “Genetics: The Science and Business of Genetic Ancestry Testing”, Science 318 (5849):
399-400.
BOORSTEIN, M.
2001 “Black Americans, Immigrant Africans Eye Common Ground”, Los Angeles Times, <http://
8.12.42.31/2001/dec/23/news/mn-17415>.
BRAITHWAITE, E. R.
1962 A Kind of Homecoming (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall).
BROWN, S.
2005 [2003] Fighting for Us: Maulana Karenga, the Us Organization, and Black Cultural Nationalism (New
York-London: New York University Press).
BRUNER, E.
1996 “Tourism in Ghana: The Representation of Slavery and the Return of the Black Diaspora”,
American Anthropologist 98 (2): 290-304.
2001 “The Maasai and the Lion King: Authenticity, Nationalism, and Globalization in African
Tourism”, American Ethnologist 28 (4): 881-908.
CAMPBELL, J. T.
2006 Middle Passages: African American Journeys to Africa, 1787-2005 (New York: Penguin Press).
CARNEY, J. A.
2001 Black Rice: The African Origins of Rice Cultivation in the Americas (Cambridge, MA: Harvard
University Press).
CASALE, J.
2005 “Scholar Follows Centuries-Old Trail from Sierra Leone”, Daily NewsRecord, December 1.
CHINWEIZU
1987a Decolonising the African Mind (Lagos: Pero Press).
1987b [1975] The West and the Rest of Us: White Predators Black Slavers and the African Elite (Lagos:
Pero Press).
CLARKE, J. H.
1992 [1991] Notes for an African World Revolution: Africans at the Crossroads (Trenton, NJ: Africa
World Press).
CLARKE, K. M.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
431
2004 Mapping Yoruba Networks: Power and Agency in the Making of Transnational Communities
(Durham, NC: Duke University Press).
COATES, T.-N. P.
2006 “Ghana’s New Money”, <http://www.time.com/time/magazine/article/
0,9171,1229122,00.html>.
COMMANDER, M. D.
2007 “Ghana at Fifty: Moving Toward Kwame Nkrumah’s Pan-African Dream”, American Quarterly
59 (2): 421-441.
CROUCH, S.
1995 “The Afrocentric Hustle”, Journal of Blacks in Higher Education 10: 77-82.
CURTIN, P. D.
1969 The Atlantic Slave Trade: A Census (Madison, WI: University of Wisconsin Press).
DUSTER, T.
2006 “Deep Roots and Tangled Branches”, The Chronicle of Higher Education 52 (February 3): B13.
EBRON, P.
1999 “Tourists as Pilgrims: Commercial Fashioning of Transatlantic Politics”, American Ethnologist
26 (4): 910-932.
FERGUSON, J.
2006 Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order (Durham, NC.-London: Duke University
Press).
FERTILE GROUND
2000 Broken Branches (Baltimore, MD: Blackout Studios).
FINLEY, C.
2001 “The Door of (No) Return”, Common-Place 1 (4), <http://www.common-place.org/vol-01/
no-04/finley/>.
FRENKEL, M. Y.
1974 “Edward Blyden and the Concept of African Personality”, African Affairs 73 (292): 277-289.
GAINES, K. K.
1999 “African-American Expatriates in Ghana and the Black Radical Tradition”, Souls 1 (Fall):
75-101.
2006 American Africans in Ghana: Black Expatriates and the Civil Rights Era (Chapel Hill: University of
North Carolina Press).
GHANAWEB
2006 “Trial of Nana Konadu Resumes Dec. 12”, <http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/
NewsArchive/artikel.php?ID=112714>.
GILROY, P.
1993 The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness (Cambridge, MA: Harvard University
Press).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
432
GINZBURG, R.
1988 [1962] 100 Years of Lynchings (Baltimore, MD: Black Classic Press).
VAN GORDER, C.
2008 “Beyond the Rivers of Africa: The Afrocentric Pentecostalism of Mensa Otabil”, Cyberjournal
for Pentecostal-Charismatic Research, <http://www.pctii.org/cyberj/cyberj17/Gorder.html>.
HAIR, P. E. H.
1967 “Africanism: The Freetown Contribution”, The Journal of Modern African Studies 5 (4): 521-539.
HARTMAN, S.
2002 “The Time of Slavery”, South Atlantic Quarterly 101 (4): 757-777.
2007 Lose Your Mother: A Journey Along the Atlantic Slave Route (New York: Farrar, Straus & Giroux).
HASTY, J.
2002 “Rites of Passage, Routes of Redemption; Emancipation Tourism and the Wealth of Culture”,
Africa Today 49 (3): 47-76.
HOLSEY, B.
2008 Routes of Remembrance (Chicago: University of Chicago Press).
HOOKS, B.
2001 [2000] All About Love: New Visions (New York: Harper Collins).
HUNTER-GAULT, C.
2006 New News out of Africa: Uncovering Africa’s Renaissance (New York: Oxford University Press).
INIKORI, J. E.
1976 “Measuring the Atlantic Slave Trade: A Rejoinder”, Journal of African History 17: 607-627.
INIKORI, J. E. & ENGERMAN, S. L.
1992 The Atlantic Slave Trade: Effects on Economies, Societies and Peoples in Africa, the Americas, and
Europe (Durham, NC: Duke University Press).
LAKE, O.
1995 “Toward a Pan-African Identity: Diaspora African Repatriates in Ghana”, Anthropological
Quarterly 68 (1): 21-36.
LANGLEY, J. A.
1973 Pan-Africanism and Nationalism in West Africa, 1900-1945; a Study in Ideology and Social Classes
(Oxford: Clarendon Press).
LOVEJOY, P. E.
1983 Transformations in Slavery: A History of Slavery in Africa (Cambridge-New York: Cambridge
University Press).
MALCOLM X
1967 Malcolm X on Afro-American History (New York: Merit).
MATORY, J. L.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
433
1999 “The English Professors of Brazil: On the Diasporic Roots of the Yoruba Nation”, Comparative
Studies in Society and History 41 (1): 72-73.
MEAD, M.
2001 [1928] Coming of Age in Samoa (New York: Perennial).
MERCER, K.
1990 “Black Hair-Style Politics”, in R. FERGUSON, M. GEVER, ET AL. (eds.), Out There: Marginalization
and Contemporary Culture (Cambridge, MA: MIT Press): 247-264.
MINTZ, S. W. & PRICE, R.
1992 The Birth of African-American Culture: An Anthropological Perspective (Boston: Beacon Press).
MOORE, S. F.
1996 Anthropology and Africa: Changing Perspectives on a Changing Scene (Charlottesville: University
of Virginia Press).
MUDIMBE, V. Y.
1988 The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge (Bloomington-
Indianapolis: Indiana University Press).
OBENG, K. W.
2007 “Us $20 Million Indece Celebrations Budget Sparks Controversy”, African Agenda 10 (2):
14-16.
OSEI-TUTU, B.
2002 “The African American Factor in the Commodification of Ghana’s Slave Castles”, Transactions
of the Historical Society of Ghana, New Series (6): 115-133.
PATTERSON, O.
2006 “A Poverty of the Mind”, New York Times,
<http://www.nytimes.com/2006/03/26/opinion/26patterson.html>.
PERBI, A.
2006 “Servitude and Chieftaincy in Ghana: The Historical Evidence”, in I. K. ODOTEI & A. K.
AWEDOBA (eds.), Chieftancy in Ghana: Culture, Governance and Development (Legon, Ghana: Sub-
Saharan Publishers): 353-378.
PIERRE, J.
2009 “Beyond Heritage Tourism: Race and the Politics of African-Diasporic Interaction
(Forthcoming)”, Social Text.
POLGREEN, L.
2005 “Ghana’s Uneasy Embrace of Slavery’s Diaspora”, New York Times, <http://
www.nytimes.com/2005/12/27/international/africa/27ghana.html>.
RICHBURG, K. B.
1998 [1997] Out of America: A Black Man Confronts Africa (San Diego, CA-New York: Harvest).
RIGBY, P.
1996 African Images: Racism and the End of Anthropology (Oxford: Berg).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
434
RIMER, S. & ARENSON, K. W.
2004 “Top Colleges Take More Blacks, but Which Ones?”, New York Times, <http://
query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F03E6DD1E39F937A157
55C0A9629C8B63&scp=2&sq=rimer%20&%20arenson&st=cse>.
ROBERTS, S.
2005 “More Africans Enter Us Than in Days of Slavery”, New York Times, <http://
www.nytimes.com/2005/02/21/nyregion/21africa.html>.
RODNEY, W.
1994 [1989] How Europe Underdeveloped Africa (Nairobi: East African Educational Publishers).
ROSADO, S. D.
2003 “No Nubian Knots or Nappy Locks: Discussing the Politics of Hair among Women of African
Decent in the Diaspora. A Report on Research in Progress”, Transforming Anthropology 11 (2):
60-63.
ROTIMI, C.
2003 “Genetic Ancestry Tracing and the African Identity: A Double-Edged Sword?”, Developing
World Ethics 3 (2): 151-158.
SKINNER, E. P.
1993 [1982] “The Dialectic Between Diasporas and Homelands”, in J. E. HARRIS (ed.), Global
Dimensions of the African Diaspora (Washington, D.C.: Howard University Press): 11-49.
THELWELL, M. E.
2003 Ready for the Revolution: The Life and Struggles of Stokely Carmichael [Kwame Ture] (New York:
Scribner).
THORNTON, J. K.
1998 Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400-1800 (Cambridge-New York:
Cambridge University Press).
WASHINGTON, E. B.
1992 “Cousins: African Americans in Ghana”, Essence, Cited in Relations between Africans and
African Americans: “Misconceptions, Myths and Realities, Godfrey Mwakikagile”, <http://
www.africananews.com/pros/articles/godfrey-relationsbetweenafricansandafricanamericans-
pdf6x9.pdf>.
WEST, R.
1970 Back to Africa: A History of Sierra Leone and Liberia (London: Cape).
WILLIAMS, C.
1987 The Destruction of Black Civilization: Great Issues of a Race from 4500 B.C. To 2000 A.D. (Chicago:
Third World Press).
WILLIAMS, S. T.
2004 Blue Rage, Black Redemption: A Memoir (New York-London-Toronto-Sydney: Damamli
Publishing Company).
YANKAH, K.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
435
1995 Speaking for the Chief: Okyeame and the Politics of Akan Royal Oratory (Bloomington-indianapolis:
indiana University Press).
ZACHARY, G. P.
2001 “Tangled Roots: For African Americans in Ghana, the Grass Isn’t Always Greener”, Wall Street
Journal, Reprinted in Relations between Africans and African Americans: Misconceptions, Myths
and Realities by Godfrey Mwakikagile, <http://www.africananews.com/pros/articles/godfrey-
relations betweenafricansandafricanamericans-pdf6x9.pdf>.
ZELEZA, P. T.
2003 Rethinking Africa’s Globalization, vol. 1, the Intellectual Challenges (Trenton, NJ-Asmara-Eritrea:
Africa World Press).
NOTES
1. Tourism is currently Ghana’s fourth largest foreign exchange earner behind gold, cocoa, and
timber (in that order). Sierra Leone’s tourist industry is not as robust as Ghana’s. The Sierra
Leone Tourist Board is actively promoting their new tourism industry; yet, there are no data
showing the effects of their efforts. They do note that the war has hampered the tourist
industry’s growth; thus, it is unlikely they are witnessing significant foreign exchange earnings
comparable to Ghana’s.
2. The rise of president-elect Barack Obama foregrounds a demographic revolution: for the first
time in history, voluntary emigration from Africa to the New World has outstripped the forced
emigration of their enslaved African ancestors (ROBERTS 2005)—African American and African
diaspora(n) ain’t what they used to be. For an excellent historical overview of this sea change and
the global context that has enabled it, see AKYEAMPONG (2000). For a localized ethnographic
analysis of this phenomenon, see MATORY (1999). While we acknowledge the importance of these
transformations, we maintain that the “traditional” usage of African American and African
diaspora(n) is still an analytically significant distinction (for example, although Obama has
embraced the ethnonym “African American”, most neo-African Americans self-identify as
“Africanour” usage of these two terms to the descendants of the Middle Passage.
3. Many black/African cultural nationalists believe that anthropology can only be a tool of
oppression. Many scholars agree that anthropology was in the past intimately linked to
colonialism (see especially RIGBY (1996) and MUDIMBE (1988). See MOORE (1996) for a dissenting
view. But to its credit, anthropology has also advanced the Weberian principle of Verstehen, an
empathic portrayal of difference, and the Boasian notion thave found to be imminently useful.
4. As advocates of race consciousness, we believe that so long as white supremacy exists we can
best combat it collectively as black/African people. We reject the mainstream scholarly and
journalistic proclivity to either pathologize blackness/ Africanness or, erase it altogether by
reducing it, to borrow MALCOLM X’s (1967) felicitous phrasing, “racism in reverse”. There are,
however, important differences in our outlooks. Shabazz, for instance, self-identifies as a black
nationalist, while Benton does not.
5. For a provocative analysis of why race matters in Ghana, see PIERRE (2009).
6. i.e., a person of high social standing, a wealthy person.
7. In using “counter-globalism”, we do not suggest that all Africans or African American roots
travelers are consciously reacting to globalization. Although some within these respective groups
do explicitly shape culturalist responses to global capital and its attendant potentialities and
woes, our point is that global consequences and implications do not necessarily require that
itinerant black diasporan and local African actors possess explicit knowledge of these outcomes.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
436
8. Africans redeemed from slave vessels by the British Navy following the abolishment of the
slave trade (1807) in the United Kingdom.
9. That is not to say that we should dismiss self-presentations that evoke timelessness; rather, we
should be attentive to the purposes and meanings for which these identity constructions are
formulated and asserted.
10. i.e., enslaved Africans born in the Americas. The nightmarish journey across the Atlantic,
generations of creolization in the North America and African blood spilt (metaphorically and
literally) on North American soil would eventually lead to a rival notion of self-hood—African
American (MINTZ & PRICE 1992).
11. It is important to note that movement among West African states was also common during
these periods (THORNTON 1998).
12. Ghana’s official government website <www.touringghana.com> outlines a ten-point plan, the
Joseph Project, to deepen ties between “homelanders” and “diasporans”. Point ten involves
developing a genetic database that would “establish for every returnee/pilgrim interested, a
personal report on his/her antecedents” that would facilitate “visits to the villages of the[ir]
ancestors”. There are problems with using DNA as a definitive “answer” to questions about
ancestry. For a more detailed discussion of the science informing these tests, and some of the
historical questions these tests raise, see BENTON (2006) and DUSTER (2006).
13. The rice coast (or grain coast) complex consisted of Liberia, Sierra Leone, Guinea Conakry,
Guinea Bissau, Senegal and Gambia (CARNEY 2001).
14. Turner (b. August 21, 1890 - d. 1972) was an African American linguist who was the first to
suggest and document similarities between West African languages and Gullah dialect.
15. Among the sponsors for Priscilla’s Homecoming were: Sierra Leone’s Ministry of Foreign
Affairs, Ministry of Tourism and Culture, and the National Tourist Board, the uS Embassy, and the
Catholic Archdiocese of Sierra Leone. There were also numerous sponsors in South Carolina and
Rhode Island.
16. To see the travelogue and information about Polite’s journey, visit the following websites:
<http://www.yale.edu/glc/priscilla/index.htm> and <http://www.africana heritage.com/
Priscillas_Homecoming.asp>. Both websites focus on the Priscilla’s life and how the connection
between Thomalind Polite and the young girl was made. They also highlight, to varying extents,
the events that took place during the reunion.
17. While it is well-known that some white Americans supported and even spearheaded “back to
Africa” movements, the movement was also a threat to the racial status quo and, therefore,
posed great danger for blacks. A newspaper editorial written in 1912, “African Recruiter
Lynching”, explained the deadly consequences: “We do not know the circumstances surrounding
the death of this Negro other than the one fact that he was working among his own people
endeavoring to get a sufficient number of them to go to Africa [...] [W]hite farmers in the
community, who were depending on these Negroes to gather their crops, became angered and
decided to nip the movement in the bud by lynching the leader [...] the pitiful part about it is that
this lynching, as all others, will go unnoticed by the state and government authorities” (GINZBURG
1988).
18. Marcus Garvey was likely acquainted with Chief Alfred Sam. Garvey’s mentor, Duse Mohamed
Ali, was publicly skeptical of Chief Sam’s Back-to-Africa scheme (LANGLEY 1973).
19. Ghana receives over 10,000 African American visitors annually, more than any other African
nation.
20. Obetsebi-Lamptey explained to a mostly African American audience in Ghana: “We’re not
saying everybody should get up and relocate back in Africa. No, you built the country over there
—you built the wealth over there. Why should you give it up? You should use that wealth over
there and bring some of it back here to use it to build up here” (COMMANDER 2007).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
437
21. Even I (Benton), based in Sierra Leone during the celebration, heard the debates among
Ghanaians on BBC Africa, and participated in discussions with Sierra Leoneans. Ghanaians in
Sierra Leone openly displayed their interest in the celebrations. For example, I attended a four-
day workshop led by a Ghanaian physician who, on each day, wore a suit sewn with as many
different 50-year celebration commemorative fabric patterns. Each morning, the Sierra Leonean
participants would comment on his outfit and discuss the celebrations, as reported on the BBC.
22. From Rawlings’s point of view, the accusation of “witch-hunting” is the most damning—his
wife is currently on trial for “willfully causing financial loss to the state”, a criminal offense
under Ghanaian law (GHANAWEB 2006).
23. Emancipation Day is an annual event in Ghana, but targets diasporan pilgrims rather than
Ghanaian citizens. In Sierra Leone it is considered, by some Sierra Leoneans, a part of Sierra
Leone’s history worthy of celebration. The UK wanted to allot 22 million pounds to
commemorate the bicentennial, but Freetown’s mayor felt the money would be better spent
helping those who experienced the greatest loss because of the slave trade, i.e. Africans living on
the west coast of Africa. City officials suggested changing the British street names in downtown
Freetown to reflect African contributions to abolition of the slave trade.
24. Pan-African Historical Theatre Festival.
25. <http://africafortheafricans.org/index.php>.
26. I thank Bomani Tyehimba, co-founder of AFTA, for these statistics.
27. Traveling throughout Africa, I (Benton) was asked whether I am a “nigga” from the “ghetto”
or if I ever fear for my life (because there are so many guns and so much gang violence in
America); in the US, upon hearing about my work in Africa, I often hear comments about how
“hard it must be” to “see so much poverty and death”. HUNTER-GAULT (2006) writes against these
negative stereotypes about Africans, but she is in the minority.
28. Fihankra is an Akan adinkra symbol meaning the safety/stability/unity of the home.
29. Currently, there is no reliable estimate of African American expatriates living in Ghana, but
unofficial estimates range from 1,000-5,000. The number is probably closer to 1,000.
30. Osei’s outlook is more militant than Ghanaian officials or the “typical” Ghanaian. I (Shabazz)
think, however, that it is important that Osei’s views are given voice. Black radical thought in
Ghana is rarely, if ever, the subject of scholarly analysis and critique and such race-conscious
Ghanaians are the obvious allies of African American roots tourists. Ghanaian sentiments about
pan-African cooperation need not be informed by “black militancy”, however; otherwise
apolitical university students have, on several occasions, complained to me that African
Americans “don’t do enough to help Africa”.
31. Isaiah Washington one of the best-known celebrities who has a DNA ancestry link to Sierra
Leone, and in particular, to the Mende ethnic group. He is also one of the few who have initiated
several visible projects there, and continues to contribute to social service initiatives, and
publicize these contributions.
32. Numerous articles discuss the oburoni (sometimes spelled obruni) controversy (COATES 2006;
HARTMAN 2007; HASTY 2002). During the Ghana@50 celebrations the Ghanaian government
launched a campaign to “educate” Ghanaians on African American distaste for the term. The
campaign encouraged Ghanaians to greet African Americans with the phrase akwaaba (Akan,
“welcome”) anyemi (Ga, “sibling”). Aside from a press conference and several akwaaba anyemi
banners scattered throughout Accra, there was little effort to reinforce the program. This and
the reshuffling at the Ministry of Tourism and Diasporan Relations, meant that the “welcome
sibling” campaign was shortlived and forgettable (although well-intended).
33. Land controlled by a traditional ruler.
34. According to the Ghanaian historian Akosua PERBI (2006), the Akwamu were prolific slave
traders: “Of all the southern states of Ghana, the Akwamu state earned the greatest notoriety for
slave raiding and kidnapping.”
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
438
35. One enduring legacy of white supremacy and black subordination in the US are subtle and
sometimes not-so-subtle messages about aesthetic preferences for “white” phenotypes, including
“straight” hair. The African American rhythm and blues singer, Indie Arie, and the Senegalese
rapper, Akon, scored a hit single on the topic. The lyrics capture the essence of coiffure politics
nicely: “Good hair means curls and waves/Bad hair means you look like a slave/At the turn of the
century/It’s time for us to redefine who we be/You can shave it off like a South African beauty/
Or get in on lock like Bob Marley/You can rock it straight like Oprah Winfrey/ If its not what’s on
your head/It’s what’s underneath” (ARIE 2006).
36. Lit. “return, go, take”. Sankofa (often anglicized as “Sankofa”) is an Akan adinkra symbol
frequently glossed as “return to your (African cultural) roots”.
37. Fred Hampton was the young, charismatic chairman of the Black Panther Party’s Illinois
chapter. In 1969, an African American US government informant drugged Hampton; the Chicago
police department and US federal agents killed Hampton while he was sleeping.
38. Nat Turner, in 1831, led the largest slave revolt in antebellum Southern United States.
39. Huey Newton and Bobby Seale co-founded the Black Panther Party in 1966, in Oakland,
California.
40. During the write-up of this essay, Nana Kwadwo Akpan died unexpectedly in Togo. Fihankra
officials have canceled the “A way back home” conference.
41. <visitsierraleone.org>.
42. During our dissertation field research in Ghana and Sierra Leone, we often heard Ghanaians
and Sierra Leoneans refer to both strangers and friends of the same approximate generation as
“brother” or “sister”. These kinship idioms were deployed for a variety of purposes ranging from
accentuating friendships, to defusing potentially violent conflicts, to negotiating fees or prices.
Black Americans, especially during the 1960’s, frequently addressed each other as “brother” or
“sister”. As MALCOLM X (1967) explained, “We’ve got to change our own minds about each other.
We have to see each other with new eyes. We have to see each other as brothers and sisters. We
have to come together with warmth so we can develop unity and harmony that’s necessary to get
this problem solved ourselves” (WILLIAMS 2004: 88). Black consciousness movements and the
racism that these movements reacted against have popularized the notion that black/ African
people, wherever in the world they might reside, are siblings or cousins. critics insist that, in the
latter instance, these imagined familial ties occlude the many differences, often declared to be
unbridgeable, within and between these respective groups.
43. <www.jasmynecannick.com>.
44. It is not clear whose agenda was advanced through declaring Bunce Island a national
monument. It could have been that people in the so-called “hinterlands” were not aware of or
interested in preserving this national monument, while colonial or, even Krio, authorities
interests were best served.
45. The “jumping over” trope is key in black diasporan understanding of the role of slavery in
their history. Black cultural nationalists, for instance, emphasize the centrality of slavery but in
other instances avoid it all together. On its face, this practice seems contradictory, but when one
teases out the effects of such discourses/practices, both, if leveraged effectively, can be
“strategies” for dealing with slavery. The seemingly romantic Afrocentric version of “jumping”
slavery is best exemplified by the black royalty—“when we were kings and queens”— narratives.
These black royalty narratives, if taken at face value, seem a historical and fanciful. But, in fact,
they point to a deeper truth. These narratives function as indirect social criticism (AKYEAMPONG
2000: 194; YANKAH 1995: 5152): a veiled declaration that black/African people are far better than
their current condition of racial subordination. MALCOLM X (1967) argued that the white man’s
focus on slavery was a clever ploy to obscure the “true” history and identity of the Black man.
Yet he also routinely invoked a polemical and ludic interpretation of plantation politics. And Lee
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
439
D. BAKER (1998) points out how Herskovits, Frazier and Civil Rights strategists dueled over to
whether or not to “jump over” the specter of slavery.
46. Besides this pervasive pathologization, Compton is sometimes exoticized as the home of
Gangsta Rap.
47. For me (Shabazz), however, Compton is a place of endearment and scholarly growth. It is
where my academic career took root. I made my first foray in Afrocentric scholarship as an
undergraduate at Compton Community College.
48. Bawku as of late has featured prominently in Ghanaian print and broadcast media as a site of
ethnic conflict.
49. These are merely starting points for interrogating complex social relations, not stable
categories of divergent interests. Some continental Africans are passionate about “connecting”
with their African American “cousins” and there are African Americans roots tourists who
exclusively seek profit-generating ventures in Africa.
50. It is remarkable that these respective groups still reach out to one another at all given that
the vast majority of African Americans have lived for generations in the US while constantly
being fed negative media images of Africa. The same media generally depicts African Americans
as unintelligent or “natural athletes or entertainers”, or worse, pathologically violent.
51. It would, of course, be unwise to reduce Mead’s work to a simple matter of what Andrew
APTER (1992: 244) has called, in a different context, “exotic alterity”. Moreover, Mead, to her
credit, explicitly states the political aim of her cultural project: a critical social commentary on
gender, sexuality and conjugal norms in the “west”.
ABSTRACTS
In many "developing" and post-conflict African nations, cultural tourism has been touted as a
vital source of foreign exchange revenue for jumpstarting national development. This trend has
led to a scramble in Africa by African state officials seeking to "package" their nations in order to
attract the patronage of Diasporan "returnees"— descendants of the Middle Passage who travel
to Africa in search of cultural and historical "roots". This situation is further complicated by the
fact that the planning and execution of national "packaging" frequently bypasses the ordinary
citizen. Thus the official agenda of these nation states is sometimes at odds with the aspirations
of local citizens and pan-African sojourners. Moreover, this trend has contributed to
considerable conceptual slippage and, consequently, vociferous debates over the meaning of and
criteria for asserting Africanness. In other instances, these conjunctures have transformed and
enhanced received notions of African identity. An ethnographic comparison of a developing
nation (Ghana) and a post-conflict nation (Sierra Leone) can both deepen and complicate our
understandings of this emerging pan-African phenomenon and its attendant possibilities and
limitations. We consider how these complimentary and conflicting interests, beliefs, and
practices converge to shape novel modes of pilgrimage, nationhood, transnational dialogue, and
globalization.
Dans beaucoup de « pays en vole de développement » et dans les nations africaines sortant d'un
conflit armé, on a vanté les mérites du tourisme culturel comme une source essentielle de revenu
pour faire redémarrer le développement national. Cette tendance a entraîné une ruée chez les
fonctionnaires africains pour vendre une certaine image de leur pays dans le but d'attirer la
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
440
clientèle « de la diaspora » : les descendants du Middle Passage qui voyagent en Afrique à la
recherche de « leurs racines » culturelles et historiques. Cette nouvelle situation est encore
compliquée par le fait que l'organisation et la réalisation d'un programme de promotion
nationale négligent fréquemment le citoyen ordinaire. Ainsi, le programme de ces États-nations
est parfois en désaccord avec les aspirations des habitants locaux et des touristes pan-africains.
De plus, cette tendance a contribué à un dérapage conceptuel considérable, et a eu, pour
conséquence, des débats véhéments sur le sens et sur les critères de l'africanité. Dans d'autres
cas, cette situation a transformé et durci les idées reçues sur l'identité africaine. Une
comparaison ethnographique d'un pays en développement, le Ghana, avec un pays sortant d'un
conflit armé, le Sierra Leone, peut approfondir et diversifier la compréhension de ce phénomène
panafricain émergent ainsi que de ses possibilités afférentes comme de ses limites. Nous
examinons comment ces intérêts complémentaires et contradictoires, ces croyances et ces
pratiques convergent pour former de nouveaux modes de pèlerinage, de nationalité, de dialogue
transnational et de mondialisation.
INDEX
Mots-clés: Ghana, Sierra Leone, diaspora africaine, identité, pan-africanisme, post-conflit,
racines, tourisme, transnationalisme
Keywords: Ghana, Sierra Leone, African Diaspora, African-centered, Identity, pan-Africanism,
post-conflict, roots, tourism, transnationalism
AUTHORS
ADIA BENTON
Department of Anthropology, Harvard University.
KWAME ZULU SHABAZZ
Department of Anthropology, Harvard University.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
441
Les déçus de TombouctouTimbuktu as a Disappointing Location
Marco Aime
1 Dans l’imaginaire occidental, la ville de Tombouctou appartient à l’espace
géographique, alors que pour les musulmans elle appartient à l’espace religieux. Quoi
qu’il en soit, Tombouctou semble être toujours la victime ou le protagoniste du regard
d’autrui. Surestimée comme centre islamique, déchue sur le plan commercial,
Tombouctou renaît au XIXe siècle dans l’imaginaire des explorateurs à mi-chemin entre
romantisme et nouvelles ambitions. Elle devient une destination héroïque, un terrain
de jeu pour les orgueils nationaux, en quelque sorte l’horizon de l’action et de la force
humaines sur la nature. Dès lors que Tombouctou est surtout associée au désert,
parvenir à Tombouctou, pour les Européens, signifie en premier lieu vaincre le Sahara.
2 La course à Tombouctou prit ainsi la forme d’un défi qui ne pouvait se terminer qu’avec
la « conquête » d’une ville désagrégée telle qu’elle apparut aux yeux de René Caillié.
Comme Ali Mazrui (1969 : 666-667) le souligne en effet, si d’un côté les explorateurs en
soulevant le rideau de ténèbres — qui, pensait-on, enveloppait l’Afrique —
contribuaient à rendre le continent moins obscur et mieux connu de leurs
contemporains, ils modifiaient et mystifiaient par ailleurs la connaissance de l’Afrique,
en n’offrant que des informations partielles et sélectionnées. Dans bien des cas
l’objectivité de l’explorateur était plus ou moins influencée par la recherche d’une
dimension héroïque, qui parfois déformait leur perception. Il était en effet beaucoup
plus audacieux de rencontrer des sauvages, des difficultés formidables et des coins
oubliés ou inconnus que des populations cordiales et familières. La Tombouctou des
explorateurs est la victime de cette vision héroïque et romantique.
3 Si, sur la carte et sur le terrain, Tombouctou appartient sans nul doute à l’Afrique,
l’imaginaire occidental semble l’avoir souvent poussée vers l’Orient. Pas un Orient
géographique, mais l’Orient comme monde exotique, comme produit d’un orientalisme
qui, comme Edward Said (1999 : 31) l’affirme, « correspondait plus à la culture dans
laquelle il s’était développé qu’à son objet de recherche, lui-même une création
occidentale ». Plus qu’à l’univers sombre auquel semblait appartenir l’Afrique « noire »,
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
442
Tombouctou, pour les Européens, était associée au monde arabe des Mille et Une Nuits,
un monde imbibé d’histoire, de sensualité et de perdition.
4 La Tombouctou des livres naît de toutes ces visions différentes, la Tombouctou des
écrivains qui admettent la décadence, mais qui entrevoient sous les cendres de la ville
la puissance de l’histoire. La Tombouctou des touristes vit encore de cet imaginaire,
jamais dissipé.
5 Pourtant, dès les toutes premières années de la colonisation, les Français s’aperçurent
que cette ville était un fardeau. Ayant désormais perdu toute importance et étant
éloignée de tout, elle ne pouvait cependant être abandonnée à cause du poids de son
mythe. Il fallait donc la maintenir en vie. Mais comment ? Dans un climat plus
conservateur que revitalisant, Tombouctou était vue comme une œuvre d’art et, en tant
que telle, elle devait être protégée et préservée plus dans son imaginaire mythique que
dans la vie quotidienne de ses habitants. C’est précisément l’attitude dont beaucoup
d’habitants de Tombouctou se plaignent, surtout à propos de l’activité de l’Unesco, qui
a inscrit la ville sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité en 1998.
6 Ainsi est née la Tombouctou des touristes, lesquels sont souvent déçus par la ville, mais
qui peuvent toujours affirmer qu’ils s’y sont rendus parce que ce lieu a colonisé notre
imaginaire, celui des Occidentaux, à tel point que Tombouctou a encore suffisamment
de force pour donner naissance à des suggestions de post ou pseudo-explorateurs. On
s’en aperçoit en lisant les propos que les touristes écrivent sur le livre d’or du musée de
la ville. La belle analyse qu’en a faite Elisa Bellato (2008 : 31-40) met en évidence les
jugements positifs, parfois même enthousiastes des touristes, jugements liés à
l’histoire, au charme du temps passé. Mais ces déclarations ressemblent beaucoup à
celles des nombreux voyageurs du passé, de Dubois à Morand et à Mardoché qui, d’une
façon ou d’une autre, refusaient d’accepter l’écroulement du mythe, son évidence.
7 Sur le dépliant distribué par l’Office du tourisme on peut lire ces mots de René Caillié
(1965 : 300) qui, le 20 avril 1828, arrive à Tombouctou : « En entrant dans cette cité
mystérieuse, objet des recherches des nations civilisées de l’Europe, je fus saisi d’un
sentiment inexprimable de satisfaction ; je n’avais jamais éprouvé une sensation
pareille et ma joie était extrême. » Naturellement le marketing touristique ne pouvait
reprendre à son compte ce que Caillié lui-même écrit quelques phrases plus loin :
« Je ne la trouvai ni aussi grande ni aussi peuplée que je m’y étais attendu ; soncommerce est bien moins considérable que ne le publie la renommée ; on n’y voitpas, comme à Jenné, ce grand concours d’étrangers venant de toutes les parties duSoudan. Je ne rencontrai dans les rues de Tombouctou que les chameaux quiarrivaient de Cabra, chargés des marchandises apportées par la flotille [...]. En unmot tout respirait la plus grande tristesse. J’étais surpris du peu d’activité, je diraismême de l’inertie qui régnait dans la ville. Quelques marchands de noix de colatscriaient leur marchandise comme à Jenné » (ibid. : 302-303).
8 C’est d’ailleurs la même déception qu’avait ressentie le Pasha Jouder, commandant des
troupes marocaines lorsqu’en 1591, celles-ci conquirent le royaume du Songhay.
Parvenu à Gao, capitale du royaume, il s’attendait en effet à y trouver des monceaux
d’or, mais il finit par écrire dépité que « la maison d’un ânier de Marrakech est plus
somptueuse que le palais de l’Askia ». De même, en 1860, le rabbin Mardoché, venu du
Maroc à la recherche de bonnes affaires, écrivit-il :
« Au premier regard Tombouctou n’offre qu’un horrible tas de maisons de terre malbâties. Dans toutes les directions, on ne voit que d’immenses étendues de sable quibougent, d’un blanc qui tend au jaune et arides comme tout. Le ciel, à l’horizon, est
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
443
d’un rouge pâle. Dans la nature tout est triste, le plus grand silence y règne, onn’entend pas chanter un seul oiseau. Cependant, il y a un je-ne-sais-quoid’extraordinaire à voir une grande ville bâtie au milieu des sables et on admire lesefforts des constructeurs » (cité dans Oliel 1998 : 38).
9 Une trentaine d’années plus tard, en 1896, Félix Dubois (1897 : 226), en la voyant de
loin, se laisse davantage éblouir par son illusion que par la réalité qui s’offre à lui : « [...]
trône sur l’horizon avec une attitude majestueuse, comme une reine. Elle est
véritablement la ville imaginée, la Tombouctou des légendes séculaires d’Europe. »
Cette fois encore l’enthousiasme ne dure pas très longtemps :
« Nous sommes parvenus à l’entrée de la ville. Et voilà que disparaîtl’impressionnante vision, tout à coup, comme un décor dans les dessous d’unthéâtre [...]. Il semble que l’on entre dans une ville qui vient de passer tous lesdrames accumulés d’un siège, d’une prise et d’une destruction [...]. Je nem’attendais certes pas à trouver ici un pendant à Athènes, Rome ou Le Caire. Lessables du désert prêtent évidemment aux conceptions architecturales desmatériaux insuffisants. Mais des huttes en paille ! Peu nombreuses, il est vrai, maisen pleine ville ! [...]. Ce n’est pas seulement l’illusion extérieure, le mirage évanoui,qui exaspère cette déception. Il y a aussi l’effondrement de tout le prestige que lenom de Tombouctou évoque à l’esprit d’un Européen » (ibid. : 231-232).
10 De toute façon la force du mythe est supérieure à celle de la réalité, à laquelle Dubois
semble d’ailleurs ne pas se résigner. En effet, quelques pages plus loin son
découragement s’est évanoui et il écrit :
« Le désespérant spectacle de l’arrivée, que ma mémoire avait conservé, et que jecroyais ineffaçable, s’estompa, se dissipa peu à peu. Un secret planait décidémentsur Tombouctou la Mystérieuse. J’eus des yeux qui virent. Une vision toutedifférente surgit doucement, se précisa. Enfin m’apparut très nettement la villegrande, riche et lettrée des légendes » (ibid. : 238).
11 Encore une trentaine d’années passent et en 1928 un autre écrivain-voyageur, Paul
Morand (1928 : 108-109), ajoute sa note sombre :
« Où sont-ils les dômes rutilants, les sacs de poudre d’or et l’ivoire des caravanesdont les livres parlent ? [...]. Paysage atone, décoloré par un soleil atteint par ladémence. Tombouctou, qui fut autrefois une ville de plus de cent mille âmes, n’estqu’un village de cinq mille habitants. Envahie par le désert, enflée de poudre,pénétrée par le sable, roulée en cornet par les nuits froides, dilatée par la chaleur,fendue par les sautes de température, bâtie avec des matériaux périssables, elletombe en ruine et n’a plus d’importance stratégique ni pouvoir. »
12 Pourtant personne ne peut se résigner à la chute d’un mythe, et Morand de poursuivre :
« Cependant l’impression que Tombouctou laisse est très forte. C’est la fin dumonde nègre, de la beauté des corps, des pâturages gras, de la joie de vivre, dubruit, des éclats de rire : ici l’islam commence avec son intolérance, sa sérénitésilencieuse, sa décrépitude. Pas une culture, pas une irrigation, pas une route, pasune œuvre d’art » (ibid.).
13 « Pas une route, pas une œuvre d’art. » Même si elles sont moins teintées de drame
existentiel, les réactions de nombre de touristes qui se rendent à Tombouctou sont elles
aussi souvent placées sous le signe du découragement. « Quelle déception... il n’y a
rien ! », il m’est souvent arrivé d’entendre s’exclamer ainsi amis et compagnons de
voyage. « Il n’y a rien », voilà le problème : le problème est l’absence. L’absence de
quoi ? « Le touriste est un visiteur pressé qui préfère les monuments aux gens » écrit
Tzvetan Todorov (1989 : 302). À Tombouctou les monuments ne manquent pas, mais ils
ne répondent pas à nos attentes.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
444
14 Qui se rend au Mali normalement ? Ce n’est pas un touriste néophyte, mais un individu
qui a fait un choix raisonné, qui souvent s’est préparé pour le voyage qu’il va
entreprendre. Et c’est précisément cette préparation qui donne naissance à la
Tombouctou « mythique », celle qui dans l’esprit de beaucoup de voyageurs s’oppose à
la Tombouctou « réelle ». Tombouctou évoque l’éloignement, les mondes disparus, les
lieux presque impossibles à atteindre, aux limites du monde. Et à quoi peut s’attendre
le touriste dans une ville qui, d’un côté, est devenue si mythique, et de l’autre est
soumise à l’incroyable oubli dans lequel l’ethnocentrisme occidental l’a laissée tomber,
en l’ignorant dans les livres d’histoire ? Palais, statues, monuments, œuvres d’art, or
sont en abondance. À l’inverse, « il n’y a rien ». « Tombouctou en soi-même ne vaut pas
le voyage, même pas une déviation, c’est seulement pour dire qu’on y a été » écrit le
journaliste français Jean-Pierre Dubarry (2000 : 83).
15 On se trouve face à une ville de terre, où même les bâtiments les plus anciens, comme
les mosquées de Sankore et de Djinguereber (XIIIe-XIVe siècles), ressemblent aux
édifices bâtis il y a seulement quelques années. C’est là que l’idée du « il n’y a rien » se
déclenche. Rien qui nous fasse comprendre que la grande histoire est passée par ici.
Voilà le manque. Tombouctou n’est pas un village perdu dans la brousse, Tombouctou
est une ville, une dimension que l’Occidental perçoit comme la sienne, qu’il sent
appartenir à son histoire. Une ville avec un passé très important, mais qui ne
correspond pas à ce qu’on en attend. Tombouctou ressemble à un miroir déformant :
elle réfléchit notre image, bien sûr, mais avec des traits et des formes différents et,
comme tous les miroirs, elle l’inverse.
16 Le touriste, ici, recherche l’histoire, l’ancien, et il les recherche à travers une image
visible, une réalité que l’on peut toucher. En effet, le tourisme des patrimoines culturels
s’alimente à la nostalgie pour le passé et grâce au désir d’expériences de paysages et de
formes culturelles (Simonicca 1998 : 156).
17 Comme l’écrit Eric Leed (1991 : 168) à propos de l’Égypte, destination de tourisme
historique par excellence : « Les icônes, comme les pyramides, offrent une réserve
d’images inconscientes de ce qui est éloigné dans le temps et dans l’espace, et qui
peuvent être activées et devenir conscientes au moment de l’arrivée du touriste sur
place. » Notre façon de lire un paysage urbain est donc interprétée historiquement,
conditionnée par la présence de signes forts, sans équivoque. Les monuments sont des
symboliques actives qui ont pris une ampleur excessive, au cours du dernier siècle, avec
la diffusion des modèles visuels de masse. Le monument acquiert une valeur
sémantique, qui est le lieu, lui-même chargé de signifier la totalité d’un tissu
monumental, social et civil (Fusco 1982 : 753-755).
18 « Nous vivons à une époque qui met en scène l’histoire, qui en fait un spectacle et, en ce
sens, déréalise la réalité », écrit Marc Augé (1999 : 24), et la visualisation de l’histoire
devient davantage une attraction pour touristes qu’une occasion de réfléchir. Bien
souvent, les monuments et les œuvres d’art constituent des points de repère
nécessaires pour se déplacer d’un lieu à un autre. Ainsi des touristes peuvent visiter un
lieu plus parce qu’il est incontournable, que par intérêt proprement dit. Exception faite
des spécialistes et des vrais passionnés, ce qui attire les touristes c’est la grande
rapidité de la jouissance que procure le monument. En effet, les monuments répondent
parfaitement à l’obligation de « réduction ». Ce sont des signaux qui déterminent l’idée
d’une ville et des instruments de communication qui ont pour effet d’unifier les
caractéristiques topographiques, architecturales et anthropologiques du lieu (Fusco
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
445
1982 : 757). On a calculé, par exemple, que Pise reçoit environ deux millions de touristes
chaque année, lesquels ne passent en moyenne que deux heures dans cette ville.
19 Les expériences « culturelles » du touriste se fondent souvent sur un imaginaire
alimenté par une tradition qui nous a appris à lire l’histoire à travers les œuvres d’art
et les monuments. Il y a quelque temps, j’ai lu des contributions d’historiens italiens,
voilées de polémique, traitant de l’ouverture de nouveaux programmes scolaires
orientés vers les autres cultures. Le poids du politically correct les empêchait d’exprimer
franchement une échelle des valeurs, mais un sentiment évident de malaise se faisait
jour à l’idée de comparer la culture de la Renaissance à la culture africaine ou
polynésienne par exemple. À Tombouctou, les monuments, ce que nous appelons
monuments, sont effectivement absents. Et c’est précisément ce type de monuments
qui nous donne le sentiment que là, une « vraie » civilisation a surgi.
20 Selon l’opinion courante, l’œuvre d’art est universelle et c’est pourquoi l’on recherche
l’extase de l’admiration devant un chef d’œuvre. Face à l’art, on devient tous
universalistes, mais il peut sembler étrange que le touriste qui se rend au Mali — qui
n’est donc pas un voyageur de masse, mais quelqu’un qui a choisi en fait une
destination particulière précisément à cause de son altérité — soit déçu par
Tombouctou. Le « tourisme ethnique » est choisi surtout par ceux qui cherchent
« l’autre », pour en apprécier la diversité, et donc par des relativistes potentiels. Mais
ce relativisme semble disparaître face à l’idée d’œuvre d’art. La politique culturelle de
l’Unesco, qui a placé Tombouctou sous son patronage, apporte sa contribution à ce
phénomène (Bellato 2004 : 26-30). Cet organisme entreprend, d’un côté, une sorte
d’institutionnalisation des expressions culturelles, qu’il s’agisse de monuments ou de
populations vivantes, les soi-disant « paysages culturels » ou « évolutifs ». De l’autre,
parce qu’il unifie sous l’expression « patrimoine culturel de l’humanité » des œuvres
appartenant à des cultures et à des catégories différentes, l’Unesco contribue à
développer l’idée que tout ce qui est art nous appartient.
21 Tout ceci est devenu évident en mars 2001, quand les talibans d’Afghanistan
proclamèrent leur intention de détruire les statues des Bouddhas de Bamiyan. Le
monde entier s’indigna alors de ce geste fou. Il fallut pour cela les statues des
Bouddhas. En effet, il y avait bien longtemps que les talibans foulaient aux pieds les
droits de l’Homme les plus élémentaires, mais cela n’était pas suffisant. Ils interdisaient
aux femmes, non seulement de fréquenter l’université, mais aussi de recevoir des
visites et d’être soignées par des médecins de sexe masculin. Ils avaient réduit les
femmes à des fantômes sans forme, ne pouvant se déplacer qu’à certains moments de la
journée, accompagnées et voilées : mais tout cela n’était pas encore suffisant. Ils
contraignaient également les hommes glabres à se justifier du refus de porter la barbe
et déclaraient qu’il était criminel de rire et de chanter dans la rue. Ils avaient même
interdit les chaînes de télévision pour empêcher tout contact avec l’extérieur. Tout cela
n’avait pourtant pas suffi à provoquer l’indignation des masses occidentales et surtout
des mass media. Des millions de vies de femmes et d’hommes détruites ne parvenaient
pas à mobiliser les caméras de télévision. Il fallut qu’ils en viennent à détruire les
statues pour déclencher l’indignation contre ce régime intégriste et intraitable.
22 Les statues semblent en effet être dotées d’un prix et d’une valeur historique qui nous
touche davantage que les hommes eux-mêmes. Pourquoi sommes-nous davantage émus
devant un monument endommagé que face à des tragédies humaines ? Le délire
iconoclaste des « étudiants islamiques » était bien un signe de barbarie, cela n’est pas
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
446
douteux, mais il n’est pas sûr que la destruction des Bouddhas ait été la pire expression
de leur fanatisme. Nous ne nous sommes rendu compte de leur fureur destructrice que
lorsqu’ils ont osé violer le temple sacré de l’art, ce symbole universel. Car c’est bien
l’art qui nous unit quand l’humanité nous rend différents voire hostiles. Par le biais de
l’art, nous avons matérialisé l’histoire, nous l’avons rendue visible et utile pour
conserver la mémoire. Mais, avec le temps, les objets d’art, ces objets de vénération,
sont peu a peu vidés de leur substance et réduits à des simulacres de valeur universelle
et absolue, celle de l’art. Nous avons divinisé l’art au point de le rendre impartial,
surhumain. Nous sommes plus enclins à défendre les Bouddhas que les bouddhistes.
23 Dans un article du quotidien La Stampa, Fabrizio Rondolino (2001 : 24) mettait en
évidence le fait que dresser une statue ou n’importe quel autre monument a toujours
une valeur politique et symbolique très forte : « Il peut s’agir d’un pouvoir despotique
qui s’autocélébre ou d’une nation qui commémore ses héros et ses martyrs ou d’une
religion qui montre aux fidèles (et aux infidèles) sa propre puissance et sa propre
miséricorde. L’histoire politique et religieuse est constellée de statues : dans bien des
cas il s’agit d’œuvres d’art, mais la raison pour laquelle elles ont été dressées est
politique. » À propos des Bouddhas, Jean-Loup Amselle (2005 : 24) insiste sur le fait que
les Hazaras shiites revendiquent l’héritage de ces statues, dont l’origine leur permet
d’affirmer leur identité culturelle.
24 Produire des signes dans l’espace comporte inévitablement l’emploi de la force et donc
une violence sur la nature de sorte que les édifices sont des moyens conceptuels
employés par les différentes sociétés pour offrir une image d’elles-mêmes en tant
qu’organismes stables et pérennes (Remotti 1993 : 47). Mais aux yeux du touriste, les
objets historiques perdent leur valeur politique et deviennent un patrimoine universel.
Nous pouvons admirer la mosquée d’Ispahan ou la Place Rouge pour leur beauté,
indépendamment des idéologies ou de la foi à l’origine de leur érection. L’oubli ou
l’exclusion volontaire du contexte social et culturel à l’intérieur duquel les œuvres d’art
ont été créées à l’origine, ne donne pas seulement lieu à des définitions qui suivent des
critères plus familiers et habituels, il favorise aussi les conditions qui permettent aux
spectateurs de participer à une expérience purement esthétique (Price 1992 : 159). Paul
Morand (1928 : 118) tomba également dans ce piège ethnocentriste : « Qui dirait que les
Malinkés ont régné ici au XIVe siècle, les Touaregs au XVe, les Songhay au XVIIe, les
Marocains aux XVIIe et XVIII e, les Peuhls et les Toucouleurs au XIXe ? Qu’est-ce qui
reste ? Du sable, couleur de la poussière de l’Écriture. » Nous observons l’histoire, nous
ne la pensons pas.
25 Cependant Tombouctou offre une occasion importante de réfléchir sur notre idée
d’histoire. En réfléchissant sur le passé de cette ville et en repensant à son histoire
apprise dans les manuels scolaires, on éprouve un sentiment de confusion. Au Centre
Ahmed Baba ou dans les autres bibliothèques familiales, au sein desquelles des milliers
de manuscrits remontant jusqu’au XVIIIe siècle sont conservés, on peut toucher de la
main (encore une fois la nécessaire réification) l’incroyable vivacité intellectuelle qui a
animé l’histoire de cette ville à l’époque que nous appelons Moyen-Âge. On se rend
compte également de la façon dont toute cette partie de l’histoire, toute cette vivacité
sont d’habitude ignorées par les textes scolaires. Les touristes en général aiment les
manuscrits, parce qu’ils font partie de la catégorie des « biens culturels » partagés. Ils
suscitent l’émotion de l’histoire, celle que nous éprouvons devant les monuments,
devant ce qui est ancien et qu’on peut en même temps toucher. Mais ils sont écrits en
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
447
arabe et par conséquent sont inaccessibles à la plupart des touristes occidentaux. On les
admire alors pour leur beauté et pour leur valeur intrinsèque liée à leur ancienneté1.
Encore une idée typiquement occidentale. Tombouctou nous offre la possibilité de
« déplacer le centre du monde », comme l’a écrit l’écrivain kenyan Ngugi wa Thiong’o
(2000). À l’inverse, nous déplaçons le monde de façon à ce que le centre soit encore une
fois où nous voulons qu’il reste.
26 Sally Price (1992 : 38-39) soutient que, dans la perspective privilégiée par le Blanc
européen ou américain, le mélange des races comporte nécessairement l’idée d’un acte
de tolérance, de gentillesse et de charité, cette idée impliquant que l’« égalité »
accordée aux non-Occidentaux (et à leur art) ne représente pas une conséquence
naturelle de l’égalité humaine, mais plutôt le produit de l’indulgence de l’Occident. Les
traditions européenne et américaine sont, par définition, les seules capables de
permettre une appréciation éclairée des différentes cultures. Les Occidentaux
deviennent ainsi les seuls à avoir le droit d’offrir des billets d’invitation destinés à
participer au spectacle de la Fraternité humaine.
27 Tombouctou ne répond même pas aux nécessités du tourisme « ethnique », ce qui
contribue à décevoir ultérieurement beaucoup de touristes. Ici il n’y a pas d’ethnie. Il
n’y a pas un peuple identifiable à ses vêtements, ses traditions, telle que la littérature
touristique nous le propose d’habitude. Les Dogons, pour rester au Mali, sont un cas
exemplaire de tourisme ethnique. Chez les Dogons, on cherche vraiment l’autre,
l’exotique. Il y a l’animisme tandis qu’à Tombouctou il y a l’islam ; chez les Dogons il y a
le village, à Tombouctou une ville ; tradition orale d’un côté, écriture de l’autre. Local et
universel continuent de s’opposer. On se rend chez les Dogons parce qu’on sait qu’ils
sont différents et bien connotés, qu’ils ont des caractéristiques déterminées, qu’ils sont
différents de nous d’une façon qui nous séduit. On se rend chez eux pour faire
l’expérience d’un monde « perdu », « primitif » ou, même, « non contaminé », pour
utiliser des adjectifs chers à la presse touristique. Avec leur architecture, leurs danses,
leur cosmogonie, les Dogons nous mènent dans un secteur de notre imaginaire où il n’y
a pas d’histoire, mais de la « tradition ». Et nous n’attendons pas de la tradition qu’elle
nous fournisse des monuments et des œuvres d’art, mais des objets ethniques, des
danses, des cérémonies rituelles. Tombouctou au contraire, même si elle se trouve
également au Mali, est une ville, concept qui la rend déjà moins « autre » à nos yeux.
Elle a une histoire marquée par l’islam, celle-là même qui a produit la mosquée des
Omeyyades à Damas, celle d’Ispahan en Iran, les palais de Grenade et de Séville et qui
n’a pas laissé de traces si massives et si visibles ici. Et Tombouctou, à l’inverse des
Dogons, apparaît floue du point de vue ethnique. C’est une ville où tout le monde est
étranger. On peut le lire sur les visages des gens.
28 Combien de profils différents, combien de nuances de peau, de langues, de vêtements
voyons-nous quand nous nous promenons dans la ville ? Les traces de son passé sont là,
elles défilent devant nos yeux et nous ne les voyons pas, parce que notre perspective
est en fin de compte prédéterminée et qu’elle crée des attentes déjà prêtes et
confectionnées. Là on attend le primitif, ici l’histoire faite d’or et de richesses. La vraie
richesse de Tombouctou est dans ses gens, dans leurs visages, dans leur caractère. Mais
ceci est une autre façon de lire l’histoire.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
448
BIBLIOGRAPHIE
AMSELLE, J.-L.
2005 L’art de la friche. Essai sur l’art africain contemporain, Paris, Flammarion.
AUGÉ, M.
1999 Disneyland e altri nonluoghi, Torino, Bollati Boringhieri.
BELLATO, E.
2004 « Mister Unesco, I Suppose », Africa e Mediterraneo, 47-48 (13), agosto : 26-30.
2008 « Carta canta... Uno sguardo agli scritti lasciati dai turisti nel livre d’or del museo
municipale di Timbuctu (Mali) », La Ricerca Folklorica, 56 : 31-40.
CAILLIÉ, R.
1965 [1830] Journal d’un voyage à Tombouctou et à Jenné dans l’Afrique centrale, t. II, Paris, Anthropos.
DUBARRY, J.-P.
2000 « Tombouctou : réflexion sur l’importance et le traitement touristique des mythes », Acta
Geographica, 172 (124) : 81-86.
DUBOIS, F.
1897 Tombouctou la mystérieuse, Paris, Flammarion.
FUSCO, M. A.
1982 « Il “luogo comune” paesaggistico », in C. DE SETA (dir.), Storia d’Italia. Il paesaggio, Torino,
Einaudi : 751-801.
LEED, E.
1991 La mente del viaggiatore, Bologna, il Mulino.
MAZRUI, A. A.
1969 « European Exploration and Africa’s Self-Discovery », The Journal of Modern African Studies, 7
(4): 661-676.
MORAND, P.
1928 Paris-Tombouctou, Flammarion, Paris.
OLIEL, J.
1998 De Jérusalem à Tombouctou, Paris, Olbia.
PRICE, S.
1992 I primitivi traditi, Torino, Einaudi.
REMOTTI, F.
1993 Luoghi e corpi. Antropologia dello spazio, del tempo e del potere, Torino, Bollati Boringhieri.
RONDOLINO, F.
2001 « In difesa dei talebani », La Stampa, 14 marzo : 24.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
449
SAID, E.
1999 Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, Milano, Feltrinelli.
SIMONICCA, A.
1998 Antropologia del turismo, Roma, carocci.
WA THIONG’O, N.
2000 Spostare il centro del mondo, Roma, Meltemi.
TODOROV, T.
1989 Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine, Paris, Éditions du Seuil.
NOTES
1. Voir également l’article de BOULAY sur la cité de Chinguetti, dans ce numéro.
RÉSUMÉS
Cet article se propose d'étudier la construction du mythe de Tombouctou dans l'imaginaire
collectif occidental, entre découverte géographique et représentation mythique du lieu. Il
montre ensuite comment cet imaginaire conditionne les touristes qui visitent aujourd'hui cette
ville du Mali. Les récits du Moyen-Âge jusqu'à ceux des explorateurs et voyageurs européens des
XIXe et XX e siècles, font de Tombouctou un lieu de plus en plus mythique. L'article explique
pourquoi les voyageurs qui se rendent pour la première fois à Tombouctou sont souvent très
déçus.
This paper aims at studying the construction of the myth of Timbuktu in the western collective
imagination, between geographical discovery and mythical representation of a place. Then it is
shown how this imagination influences the tourists that reach Timbuktu today. Through the
period lasting from the Middle Age chronicles to the European narratives of the travellers of XIXe
and XXe centuries, Timbuktu has been shaped as a mythical place. This paper explains the
reasons why the modern tourists are often disappointed when they first see Timbuktu.
INDEX
Mots-clés : Mali, Tombouctou, exploration, imaginaire collectif, lieu mythique, touristes, voyage
Keywords : Mali, Timbuktu, exploration, collective imagination, mythical place, tourists, travel
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
450
AUTEUR
MARCO AIME
Département d’histoire moderne et contemporaine (DISMEC), Université de Genova, Italie.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
451
Désillusions et stigmates del’exotisme. Quotidiens d’immersionculturelle et touristique au SénégalThe Disillusions and Scars of the Exotic. Everyday Cultural and Touristic
Immersion in Senegal
Hélène Quashie
1 Les contextes de semi-résidence touristique et d’expatriation au Sénégal favorisent
l’analyse d’interactions quotidiennes entre des groupes minoritaires de ressortissants
européens/occidentaux et leurs voisins locaux. Ces rapports sociaux particuliers ont
jusqu’ici peu intéressé l’anthropologie (Doquet 2005), qui s’est davantage concentrée
sur l’étude des relations entre touristes et populations visitées dans des contextes de
courts séjours, ainsi que sur les enjeux sociopolitiques ou recompositions identitaires
locales qui accompagnent l’industrie de l’évasion touristique1. Les catégories de
touristes auxquelles nous avons choisi de nous intéresser effectuent de longs séjours
qui s’inscrivent dans des contextes de mobilité et d’interculturalité relativement
inédits vis-à-vis des cadres d’analyse classiques du phénomène touristique. Leurs
discours et représentations sociales devraient largement différer de ceux des touristes
de passage, moins impliqués dans les réalités locales qu’ils côtoient. Or, cette
cohabitation avec l’Autre ne favorise pas d’adaptation réciproque mais renforce
davantage l’élaboration de frontières et de stéréotypes sociaux, assez proches dans
leurs fondements de ceux que l’on retrouve dans des contextes touristiques plus
classiques (Quashie 2009).
2 La promotion de voyages à destination du continent africain (effectuée
majoritairement depuis les pays occidentaux) s’appuie sur des images spécifiques,
inspirées et soutenues par l’ethnologisation de cette région du monde.
3 Fréquemment présentée comme anhistorique, elle fait l’objet de nombreux fantasmes
alimentant les imaginaires sociaux occidentaux. Par exemple, le mythe de la « non-
civilisation », aisément décelable dans les discours de promotion touristique, invite le
visiteur à pénétrer dans un monde « primitif » animé par une faune exotique, des
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
452
danses traditionnelles « typiques », au milieu de paysages semi-désertiques ou
tropicaux (Echtner & Prasad 2003). Or, cette notion de primitivité exotique repose sur
un principe d’ambivalence caractéristique : sa valorisation (se) nourrit de nombreuses
idées reçues très médiatisées situées aux antipodes du rêve et de l’enchantement
touristiques (corruption, domination masculine, archaïsme technique, démographie
galopante, économie informelle, sous-industrialisation, pauvreté, illettrisme, guerres
civiles irrationnelles, etc. [Courade 2006]).
4 Au cœur de cet espace d’interlocution sociopolitique ambigu entre l’Occident et le
continent africain, le Sénégal est devenu l’un des pays les plus touristiques de la région
ouest-africaine2. La promotion et la vente de cette destination sont assurées par des
investisseurs privés européens : l’État sénégalais ne perçoit que les taxes relatives aux
transports aériens et aux complexes hôteliers. L’offre touristique repose
principalement sur des séjours proposés par des agences de voyages et tour-opérateurs
internationaux dans les établissements de la Petite Côte3, et des circuits itinérants au
sein des régions littorales. Ce « tourisme de masse », soutenu par la régularité des vols
charters, allie donc plaisirs balnéaires et culturels, principe qui a peu à peu donné
naissance à des pratiques « alternatives » de tourisme de découverte, élaborées par des
voyagistes spécialisés mais de moindre envergure.
5 Ces différentes promotions touristiques du rêve et du dépaysement mettent en valeur
des imaginaires socioculturels semblables et récurrents : elles entretiennent par
exemple, toutes sans exception, une importante fascination pour le « monde rural
africain », renforçant ainsi l’image du Sénégal comme « Porte de l’Afrique ». Ce slogan,
repris par de nombreux voyagistes européens ainsi que par le ministère du Tourisme
sénégalais, construit l’idée d’un carrefour entre l’Occident et le continent africain. En
effet, la destination Sénégal n’utilise pas d’arguments « culturels », elle n’évoque pas
d’aspects « traditionnels » spécifiques, comme ce peut être le cas du Burkina Faso, du
Mali ou du Cameroun, auxquels la muséographie européenne/ occidentale fait plus
largement référence. Les expéditions coloniales et enquêtes ethnographiques4 n’ont pas
ou peu retenu d’éléments « culturels » distinctifs propres au Sénégal, susceptibles
d’être utilisés par les discours touristiques. Ce pays n’est pas connu en Occident pour
ses « trésors » ethnologiques, mais davantage pour la position politique qu’y occupait
l’administration coloniale (la ville de Saint-Louis était capitale de l’Afrique occidentale
française), ses joueurs de football recrutés dans de nombreux clubs européens, la
densité de ses réseaux transnationaux mourides, ou encore le nombre important de ses
étudiants dans les universités françaises. La destination Sénégal garantit donc un choc
culturel « aseptisé », et se vend davantage grâce à la promotion de son environnement
littoral que par le biais d’attributs « typiques » évoquant généralement la « culture
africaine ». L’enchantement touristique fondé sur la notion de « primitivité »
n’apparaît donc au Sénégal que de manière relative, lors d’excursions dans des
concessions villageoises rurales à quelques kilomètres des localités littorales, et surtout
par le biais de circuits itinérants dans les régions de Basse-Casamance, Kédougou ou
Saint-Louis, qui n’attirent qu’environ 30 % des visiteurs du pays. Ces séjours
provoquent le ravissement unanime des visiteurs mais peu de questionnements quant
aux attentes et perceptions de l’Autre-visiteur/ visité. Voués au loisir des touristes et
non à leur implication dans la réalité sociale qu’ils côtoient, les programmes des tour-
opérateurs aussi bien que ceux des voyagistes défenseurs d’un « tourisme plus
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
453
respectueux » organisent en effet une « rencontre » avec l’Autre de courte durée selon
des modalités stéréotypées (Quashie 2009).
6 La valorisation touristique du littoral sénégalais favorise davantage le retour d’un
certain nombre de visiteurs dans ses régions de la Petite Côte et du Saloum. Enchantés
par leur premier séjour souvent hôtelier, ces touristes deviennent « semi-résidents »5,
voire « résidents permanents », et organisent pour certains une frange du tourisme
interne sénégalais.
7 Nous nous sommes interrogée sur ces contextes touristiques au sein desquels des
vacanciers effectuent de longs séjours récurrents, au contact direct des « populations
locales ». Que se passe-t-il lors de ces rencontres ; quelles sont les modalités de ces
interactions ? Nous analyserons les représentations6 et pratiques sociales de ces
touristes et des individus qu’ils côtoient au sein de la société sénégalaise, afin de
comprendre plus précisément les imaginaires sociaux utilisés, produits ou entretenus
au sein de ces contextes spécifiques d’interculturalité. Bien qu’ils ne soient pas
préconstruits par des structures de voyage, ils ne semblent pas favoriser pour autant
une connaissance réciproque de l’Autre mais constituent le support de nombreux
stéréotypes. Nous nous intéresserons donc plus précisément à l’ambivalence
conflictuelle des rapports sociaux que cette « rencontre culturelle » instaure, aux
réseaux d’élaboration et d’entretien de représentations sociales qui lui sont spécifiques,
ainsi qu’à leur contexte sociopolitique et identitaire.
La Riviera de la « Porte de l'Afrique » : du rêvebalnéaire aux impasses de l'interculturalité
Exotisme littoral et idéal-type de l'Autre
8 Les touristes qui séjournent au Sénégal proviennent principalement de pays
occidentaux (prédominance de la clientèle française, puis par ordre d’importance :
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
454
belge, suisse, et nord-américaine). Le taux de retour de ces vacanciers est très faible
(environ 2 %)7. Les visiteurs ayant participé à un circuit de découverte sont très peu
nombreux à revenir au Sénégal, si ce n’est pour s’intéresser quelques années plus tard
aux « progrès » socio-économiques du pays. De même, les adeptes de séjours balnéaires
« all inclusive » testent successivement ces formules dans les « pays tropicaux » où sont
implantés chaînes hôtelières et tour-opérateurs internationaux.
9 La catégorie « touristes semi-résidents » recouvre donc initialement des clients et
habitués (français et belges pour la plupart) des complexes balnéaires de la Petite Côte
et du Saloum, souhaitant s’organiser en dehors de ce contexte hôtelier jugé trop
contraignant. Nombre d’entre eux louent en effet, pour une durée minimale de trois
mois, des villas ou appartements appartenant à certaines chaînes hôtelières (résidences
de vacances) et autres entrepreneurs européens, ou encore mis à disposition via
Internet par des particuliers européens durant leur absence. Beaucoup profitent
également de très longs séjours dans leur résidence secondaire en bord de mer. Le
faible coût des investissements fonciers8 et les réseaux d’interconnaissance que tissent
les individus semi-résidents au cours de leurs séjours ont en effet accru le nombre de
propriétés privées dans certaines localités. Il existe ainsi des quartiers résidentiels
entièrement habités par des touristes semi- résidents européens, à proximité de
complexes hôteliers balnéaires (Saly, Nianing, et la Somone pour les principaux de la
Petite Côte, Palmarin, Ndangane et Toubacouta dans le Saloum). Ces localités
connaissent une spéculation foncière importante, car de nombreuses parcelles du
littoral de la Petite Côte et du Saloum ont été vendues pour favoriser ce type de
villégiature.
10 Ces touristes reviennent au Sénégal pour son littoral et ses loisirs, son climat, sa
tranquillité. Ils y associent également l’image d’une « population locale » sympathique,
accueillante et spontanée, grâce aux rapports conviviaux qu’ils ont entretenus avec des
professionnels du tourisme lors de leur(s) séjour(s) hôtelier(s). Ce tourisme de semi-
résidence amène par ailleurs de nombreux résidents locaux à se proposer comme
gardiens, employés domestiques, jardiniers, ouvriers, électriciens, ou toute autre
profession jugée utile auprès de leurs voisins européens9. Ces nouveaux emplois
permettent de pallier la faible rentabilité actuelle des principaux secteurs économiques
régionaux, l’agriculture et la pêche.
11 Le développement touristique de ces bourgades rurales semble pouvoir combler
idéalement les attentes de ses protagonistes. Or, les relations qui se nouent entre semi-
résidents européens et habitants locaux sont en grande majorité d’ordre conflictuel.
L’important différentiel socio-économique qui caractérise leurs niveaux de vie rend en
effet inévitables certains types d’antagonismes. Mais cette réalité ne suffit pas à
expliquer ces conflits qui reposent également sur la confrontation de stéréotypes qui
lui préexistent.
12 Nous avons par exemple noté que de nombreux touristes ayant participé à des
excursions « culturelles » (lors de séjours balnéaires) et des circuits itinérants
ponctuent le récit exalté de leur voyage avec une analyse critique et récurrente de faits
sociaux estimés handicapants pour le « progrès » du pays (Quashie 2009). L’ambivalence
de ces discours traduit le principe de « fascination répulsive » (Jewsiewicki 1991 : 27)
qui caractérise généralement l’ensemble des représentations européennes/occidentales
ayant pour objet « l’Afrique ». Ce principe apparaît de manière plus étayée encore dans
les discours des touristes semi-résidents, et participe par exemple à la stigmatisation de
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
455
la religion islamique, ou du statut de la femme et de sa condition sociale (entendue par
bon nombre d’entre eux comme inégale à celle de l’homme et socialement exploitée).
Les représentations sociales négatives que cristallisent ces sujets de débats condamnent
l’existence de mœurs jugées à contre-courant de la mondialisation et de sa modernité.
La pratique de la polygamie soulève ainsi des questions très polémiques, symbole aux
yeux de ces touristes d’un mode de vie « non civilisé ». La démographie (favorisée en
partie par la polygamie) est également au centre de ces jugements critiques, qui
laissent entrevoir la « population sénégalaise » comme globalement responsable d’une
situation économique de sous-développement. Ces discours convoquent de vieux
clichés occidentaux (improductivité, paresse, tendance à la corruption, manque de
rigueur et d’anticipation), fréquemment ramenés au statut de qualités intrinsèques des
individus « africains », pour justifier une absence de progrès économique et social.
13 Ces représentations spécifiques rencontrent des imaginaires sociaux locaux dont elles
ignorent souvent l’existence. Les ressortissants d’origine occidentale présents au
Sénégal sont désignés par le terme « toubab » (« le Blanc »)10. La référence phénotypique
qu’il implique n’est localement jamais jugée péjorative, mais comme au sein de tant
d’autres sociétés, les individus sont systématiquement associés au milieu social dont ils
sont issus et peuvent être stigmatisés en conséquence. La dénomination générique
« toubab » est socialement très répandue. Également utilisée dans différents pays de la
sous-région ouest-africaine, elle recouvre une catégorie sociale qui n’est pas spécifique
au Sénégal (Doquet 2005). Une fois traduit, ce terme choque bon nombre d’individus
occidentaux, dont l’éthique et le sens aigu du « politiquement correct » n’inclut pas la
désignation de l’Autre par son apparence physique. Une grande majorité de semi-
résidents et résidents permanents refuse donc d’être interpellée ainsi, décelant dans le
mot « toubab » une connotation raciste. Cependant, cette analyse est simplificatrice, car
les étiquettes apposées aux individus non sénégalais se réfèrent à des imaginaires
sociaux qui transcendent la simple évocation de traits phénotypiques, ce qu’ignore la
plupart des (semi)-résidents européens. Ainsi, certains peuvent être interpellés par le
terme « toubab » en pleine rue (et s’en offusquer) en raison de leur tenue vestimentaire,
notée par ailleurs comme particulièrement récurrente auprès des touristes et expatriés
occidentaux (jupe transparente, chemise ouverte, short court, chaussures de plage). Il
s’agit d’un ensemble d’attitudes qui fait écho à leur méconnaissance des significations
et codes sociaux locaux qui y sont associés.
14 D’une manière générale, les stéréotypes suggérés par le terme « toubab » (qui ne sont
pas propres aux représentations élaborées par la société sénégalaise)11 renvoient aux
perceptions suivantes : l’individu occidental court toujours après le temps, ne croit pas
en Dieu, ne sait pas s’habiller avec élégance, est irrespectueux envers sa famille. Cet
idéal-type construit le portrait inverse de celui qui est attribué à l’individu africain, issu
d’un imaginaire social occidental réapproprié en partie localement12. Un autre
ensemble de représentations sociales complète cet idéal-type à partir de références
afro- centristes et postcoloniales inscrites dans un rapport social de type dominant/
dominé : l’individu occidental résume « l’Afrique » à la « brousse », possède des idées
très arrêtées, nie la valeur des savoirs qu’il ne maîtrise pas, et prétend détenir le
modèle du progrès et de la civilisation. Il est également pressenti comme
« naturellement » paternaliste, en raison de son besoin constant de changer l’Autre à
son image et de l’éduquer sans évaluer ni comprendre son contexte culturel et socio-
économique.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
456
15 Les individus occidentaux sont donc inscrits dans une catégorie sociale spécifique. Au
Sénégal, ils représentent d’une part les principaux acteurs du secteur touristique
(investisseurs, voyagistes et visiteurs), qui produisent une image du Sénégal pour
l’extérieur. D’autre part, une large part de leurs références linguistiques et sociales est
ancrée dans la société sénégalaise13. Celle-ci a bâti son statut sociopolitique, à la fois vis-
à-vis de l’Occident et du reste de la région ouest-africaine, grâce à une cohabitation
importante avec l’administration coloniale présente du XVe siècle jusque dans les
années 1960. Cette micro-société en effet ne s’est pas limitée à ses fonctions
administratives et militaires, mais a donné naissance à une importante communauté
métisse urbaine : les Quatre communes (Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque, dont les
résidents locaux avaient le statut de citoyens français ainsi que les privilèges afférents)
sont des milieux urbains qui ont longtemps entretenu de nombreuses représentations
et pratiques sociales relatives à l’individu occidental et à son mode de vie.
Regards croisés sur les voies du désenchantement
16 Le secteur touristique est un bon observatoire des attitudes et perceptions, adaptées ou
inspirées de stéréotypes sociaux généraux. Nous avons relevé quelques exemples de
situations récurrentes opposant invariablement semi- résidents européens et habitants
locaux, et qui mettent en péril l’établissement d’un lien social et d’une confiance
réciproque14.
17 Les conflits relatifs à des questions financières (escroqueries, vols, détournements) sont
très réguliers et mettent en lumière les caractéristiques d’un rapport social particulier.
Certains facteurs contribuent à les renforcer : localement, la nationalité européenne
des vacanciers apparaît en soi comme un signe extérieur de richesse, au même titre que
leur(s) villa, véhicule, type d’alimentation, mobilier et domestiques. Ces critères
apparents désignent les avantages d’un niveau de vie estimé très élevé (même si ces
touristes semi-résidents sont de simples retraités issus de la classe moyenne), par
simple comparaison avec le cadre de vie des habitants de ces zones rurales. De plus, les
touristes semi-résidents refusent toute pratique des langues locales qu’ils jugent
inutiles. Ils méconnaissent ainsi les subtilités qui leur permettraient de saisir davantage
les réalités sociales de leur environnement. Enfin, bon nombre d’entre eux avouent
accorder très facilement, et dès leur arrivée, une confiance presque aveugle à leurs
voisins sénégalais : ils leur semblent être d’une nature très prévenante et hospitalière
(« ils sont très souriants, paraissent parfois presque naïfs mais toujours prêts à rendre
service »). Ce contexte accentue alors la résonance des plaintes des semi- résidents au
sujet de tromperies diverses orchestrées par leurs voisins locaux. Or, elles reflètent
simplement la confrontation infinie de multiples représentations sociales, fournies et
entretenues par cet environnement socioéconomique particulier.
18 Les touristes semi-résidents se plaignent également des sollicitations financières
régulières dont ils font l’objet, c’est-à-dire des sommes bien précises que leur réclament
des habitants locaux pour régler une ordonnance (en général ancienne et expirée), une
urgence médicale pour un enfant malade, les dépenses d’une cérémonie familiale
(surtout des funérailles), etc. Grâce aux discours humanitaires des ONG, très nombreuses
dans le milieu rural sénégalais, ces sujets sont localement connus pour être « très
sensibles » auprès des individus occidentaux. L’idée selon laquelle acquérir un niveau
de vie proche des normes occidentales procure bien-être et épanouissement est
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
457
également relayée par les idéologies développementalistes. La plupart des habitants
locaux sont donc en attente de la compassion des touristes semi-résidents : le « toubab »
possède assurément les moyens de pourvoir à leurs besoins, il est même de son ressort
de le faire car il ne connaît pas le dénuement matériel mais un mode de vie raffiné. La
notion de richesse matérielle est aussi associée à celle du savoir. En milieu rural
notamment, le « toubab » » apparaît très instruit car il a l’habitude de tout observer
minutieusement et possède des moyens technologiques invraisemblables. Par
extension, ces représentations sociales font de lui « celui qui aide » : il donne ce que des
individus africains, même aisés, n’offriraient pas. Du point de vue des résidents locaux,
leurs sollicitations financières semblent logiques et justes, de surcroît en échange des
services et renseignements qu’ils fournissent aux touristes semi-résidents pour leur
installation. Bon nombre de ces derniers associent cependant la récurrence de ces
sollicitations à de la mendicité, et par extension à une caractéristique générale de la
« population sénégalaise ».
19 Cependant, leurs activités et comportements au sein de leur localité d’accueil n’offrent
pas toujours de limites très claires entre des actions qui relèveraient d’une « aide au
développement » et les autres. En effet, les touristes semi-résidents font souvent appel
à une conception misérabiliste du don et de la pauvreté, qui implique un engagement
personnel et nécessaire auprès de populations regardées comme victimes. Ils adoptent
une approche à caractère humanitaire lorsqu’ils se rendent par exemple dans des
concessions villageoises isolées de l’arrière-pays pour « soulager » ponctuellement les
habitants de leur pauvreté. Beaucoup de touristes semi-résidents restent attachés au
mythe du « paradis perdu », construit par les excursions touristiques des séjours
hôteliers, qui idéalisent le mode de vie dans ces concessions. La pauvreté et le
dénuement des habitants émeuvent facilement leurs visiteurs : la plupart des semi-
résidents cherchent donc à leur venir en aide par des dons de médicaments, de
vêtements, de fournitures scolaires, la construction de puits ou forages, de cases de
santé, etc. Mais l’application de cette éthique reste ambivalente : elle se rapproche
davantage du principe don/contre-don lorsqu’ils adhèrent ou créent des associations
caritatives dont la finalité repose sur une « intégration » et une socialisation dans leurs
localités d’accueil. Les touristes semi-résidents considèrent en effet leurs voisins
immédiats moins démunis et paradoxalement trop demandeurs : les activités tertiaires
développées grâce au tourisme dans ces bourgades rurales sont moins pénibles à leurs
yeux que l’agriculture, activité de « survie » principale des concessions villageoises. Ils
n’envisagent pas que les habitants de celles-ci puissent avoir des réactions semblables
et un recours à des sollicitations financières, s’ils habitaient à proximité. De plus, dans
ces concessions, les touristes semi-résidents ont affaire à des individus avec lesquels ils
peuvent très peu communiquer, au contraire des bourgades touristiques dont une plus
grande partie des habitants a été scolarisée et parle français. La distinction qu’ils
opèrent entre différents types de dons et de « populations locales » n’est pas évidente
pour leurs voisins locaux, qui leur attribuent donc souvent l’étiquette stigmatisante de
« portefeuilles ambulants ».
20 Ces incompréhensions réciproques accentuent les fantasmes et représentations de
« l’authenticité africaine » que possèdent les touristes semi- résidents. Ils effectuent
par conséquent une distinction très manichéenne entre les « bons » et les « mauvais »
Sénégalais : ceux qui sont très pauvres, c’est-à-dire les humbles, et ceux qui osent
réclamer de l’aide sans en avoir réellement besoin, c’est-à-dire les individus paresseux,
impolis et ingrats. Ils appliquent ce type de raisonnement lorsque par exemple,
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
458
contrairement aux autres touristes, ils découvrent leurs dons de vieux vêtements en
vente dans les marchés hebdomadaires proches de leur localité, de même que les piles
de cahiers achetés (en surnombre) aux écoliers. Ces constats les scandalisent,
considérant que leur soutien matériel devrait être salué et constituer une source
constante de gratitude et de remerciements. Or, les normes locales ne reconnaissent
pas l’existence du don gratuit, sauf dans les sociétés dont sont issus les individus
« toubabs ». De plus, cette conception occidentale du don évoque une générosité louable,
mais également un défaut de lucidité notoire. L’individu occidental est en effet
couramment dépeint comme naïf, ce qui lui vaut un certain nombre de désagréments
lorsqu’il s’installe localement. Par extension, s’il conteste cette image de généreux
donateur, il devient celui qui ignore les notions de « communauté » et de « solidarité ».
Les touristes semi-résidents peuvent donc faire l’objet d’un ensemble de
représentations contradictoires et situationnelles, permettant de distinguer localement
les « bons » et les « mauvais » toubabs en fonction de leurs engagement et soutien
financiers vis-à-vis du développement des infrastructures, des fêtes et cérémonies
familiales, villageoises, au sein de leurs localités d’accueil. Les images et logiques
sociales locales convoquées dans les rapports sociaux établis avec des touristes semi-
résidents sont par ailleurs inspirées de l’imaginaire occidental lié au mode de vie
« africain » : elles reflètent des valeurs et idéologies issues de conceptions judéo-
chrétiennes et humanitaires. Or, le contexte local de « vie en communauté » implique
davantage une méfiance systématique de l’Autre, constitutive de tout rapport social :
on ne donne à autrui qu’un accès très limité à ce qu’il peut connaître de soi.
21 Nombre d’incompréhensions relatives à la notion de don se retrouvent également dans
les relations que les touristes semi-résidents entretiennent avec leurs domestiques. Le
recours à des logiques humanitaires face à des individus matériellement plus démunis,
entretient, auprès de ces derniers, complexe et sentiment d’infériorisation. Le
caractère paternaliste de cette conception éthique qui convoque, entretient et renforce
différents stéréotypes du « sous-développement » et des modes de vie qu’il engendre
altère en effet tout principe de confiance réciproque. Ainsi, lorsque des touristes semi-
résidents donnent à leurs domestiques un salaire supérieur à la moyenne locale, offrent
régulièrement des denrées, vêtements et médicaments pour leurs familles, ils ne
s’attendent pas à ce que leurs domestiques en demandent davantage ou tentent parfois
de les voler. Ignorant que donner sans obligation de retour n’existe pas localement et
ne peut spontanément engendrer des pratiques de reconnaissance et de valorisation
sociale, ces touristes semi- résidents ne se figurent pas non plus que ce qu’ils appellent
« solidarité à l’africaine » correspond en réalité à un tissu d’obligations et d’échanges
sociaux bien structuré. En outre, ils utilisent souvent ces relations avec leurs
domestiques comme porte d’entrée sur leur société d’accueil, à laquelle ils tentent de
s’adapter. En essayant de se lier d’amitié avec leurs domestiques ou en leur confiant
d’importantes responsabilités, les semi-résidents leur confèrent donc également un
pouvoir qui inverse celui du rapport classique de dépendance professionnelle et
salariale, et les exposent à des relations sociales dont les contours deviennent
rapidement ambigus.
22 Un imaginaire très exotique (Le Bihan 2007) associé à la femme et à l’homme africains
est également très présent dans les discours des touristes semi-résidents, et les unions
mixtes font également l’objet de tensions sociales. Plus une localité accueille de
touristes, plus ce phénomène attire des jeunes femmes (issues des environs ou de ces
mêmes localités) qui recherchent la compagnie d’hommes européens (situations que
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
459
l’on retrouve dans de nombreux pays touristiques du Sud). Elles sont souvent
localement considérées au même titre que des prostituées, bien qu’il soit rare de
rencontrer des familles qui refuseraient un « riche » gendre européen. Ces jeunes
femmes entendent devenir les épouses de ces touristes semi-résidents, qui sont, pour la
plupart, d’environ trente ans leurs aînés. Une partie d’entre eux seulement sont
officiellement célibataires, mais il est fréquent que les hommes mariés, attirés par la
jeunesse et l’image exotique de ces femmes, divorcent pour s’investir dans ces
relations. La majorité de ces unions mixtes se termine cependant par des ruptures et
des déceptions : on voit souvent ces jeunes femmes, alors accusées de trahison et de
duplicité, obtenir la propriété de la villa du couple et demander une séparation, ou
encore profiter de facilités administratives pour partir vivre en Europe. De nombreux
touristes semi-résidents de la localité de Ndangane ont ainsi vendu leur villa suite à des
désunions. D’autres, après avoir été déçus une première fois ou témoins des déboires de
leurs amis, vivent en concubinage ou ne se marient qu’à la mosquée, si leur épouse est
d’obédience musulmane, ce qui ne les engage pas sur le plan légal. Mais ce refus
d’adopter les représentations et les obligations sociales locales relatives au mariage ne
facilite pas non plus leurs relations avec le reste de leur communauté d’accueil.
23 La majorité des touristes semi-résidents investis dans des relations mixtes les
envisagent cependant d’une autre façon : les complexes hôteliers ont donné naissance à
un tourisme sexuel (y compris des réseaux de pédophilie), désormais très important
dans beaucoup de quartiers résidentiels européens. Des hommes seuls y louent pour ces
raisons une villa durant plusieurs mois : les quartiers de Saly Niakh-Niakhal ou de la
Somone en sont des exemples frappants. De plus en plus de femmes européennes
également, célibataires et d’âge mûr15, utilisent ce type de villégiature pour rencontrer
des jeunes hommes sénégalais dans le but d’agrémenter leur séjour, ou s’investissent
dans des unions plus durables aboutissant souvent à des déceptions et à l’expatriation
du jeune homme.
24 Les habitants locaux les plus âgés reconnaissent dans beaucoup de ces unions mixtes
des jeux d’intérêt orchestrés par la jeunesse de leur bourgade : ils craignent cependant
les risques qu’elles comportent (transmission du SIDA ou autres MST, abandon et
désengagement du partenaire européen, etc.) peuvant être très préjudiciables à ces
jeunes. Leurs aînés rejettent en outre les démonstrations publiques d’affection qu’elles
occasionnent, et qui illustreraient l’indécence souvent associée aux comportements
d’individus occidentaux, ou encore leur obsession pour une liberté individuelle et
« moderne ».
25 Un autre point de tension qualifie localement les attitudes de ces derniers comme
dénuées de pudeur. il arrive par exemple que des résidents locaux se reconnaissent
distinctivement sur des cartes postales et sur des blogs électroniques sur internet,
conçus à partir de photos prises par des touristes et des semi-résidents européens. Ils
savent également qu’un certain nombre d’entre elles sont parfois rachetées par des
journalistes, ou encore font l’objet de concours. La pratique de la photographie (surtout
dans le cas du portrait) est souvent localement perçue comme dénigrante, car ces
photos sont réalisées de manière impromptue, ou sans que le « photographe » n’en
demande la permission. La plupart des résidents locaux refusent en outre d’être
associés, par le biais de ces photos, à l’image d’un « pays sous- développé », éloigné de
toute modernité. Certains ont en effet voyagé en Europe ou ont régulièrement
fréquenté des Occidentaux : ils ont ainsi eu connaissance des questions générales que
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
460
ces derniers se posent quant aux activités et aux mœurs du « milieu rural africain ». Or,
les interprétations caricaturales qu’ils ont pu entendre à ce sujet méconnaissant les
réalités sociales dont elles parlent, contribuent à accentuer cette distance établie avec
les résidents et les touristes européens.
26 L’administration sénégalaise fait également l’objet de nombreux reproches de la part
des touristes semi-résidents. Ces critiques sont source d’amertume et soumises à une
importante généralisation contribuant à la construction de « caractéristiques typiques
de la population sénégalaise » (les représentants de l’État seraient à leurs yeux
représentatifs des « mentalités » des citoyens). Selon la majorité d’entre eux, l’accès à
leurs titres fonciers ou encore l’immatriculation locale de leurs véhicules sont des
parcours semés d’obstacles et de pots-de-vin. Leurs relations avec les forces de police
(surtout pour la circulation routière) reposent également sur des tensions récurrentes.
Par conséquent, beaucoup de touristes semi-résidents proposent facilement de l’argent
à leurs interlocuteurs dans le but de parvenir plus rapidement à leurs fins, et
s’enferment ainsi dans un cercle vicieux de corruption. Ils considèrent ces pratiques
comme courantes et quotidiennes au sein d’une « société africaine », pour laquelle,
selon eux, donner de l’argent à des fonctionnaires permet de contourner les lenteurs
institutionnelles et appartient aux « us et coutumes » locaux. La question stéréotypée
et très médiatisée de la « corruption en Afrique » constitue le support des
représentations de ces semi-résidents. Or, une minorité d’entre eux ne suit pas ce
raisonnement et obtient pourtant dans un délai raisonnable les documents demandés.
Il est en effet localement connu que lorsque le « toubab » veut démontrer la supériorité
de son savoir et la qualité de son éthique, jugeant par la même occasion ses
interlocuteurs incapables d’être à sa hauteur, il court le risque de se retrouver
financièrement spolié et abusé, en raison du caractère paternaliste de ses propres
représentations.
27 L’analyse des pratiques sociales et des discours de touristes semi- résidents permet de
saisir les invariants de représentations étant à la source de certaines tensions locales.
D’une manière générale, nombre d’entre eux estiment que la « population sénégalaise »
est composée d’individus de « nature » irrespectueuse, calculatrice, hypocrite,
mendiante, raciste et inconstante, porteuse d’une « mentalité » difficile à comprendre
et en partie immorale. Les constats des touristes semi-résidents s’appuient également
sur l’incapacité supposée de leurs interlocuteurs à s’investir dans des échanges
« intellectuels ». N’ayant eu souvent accès qu’à une faible scolarisation et appartenant à
des classes sociales économiquement faibles, les habitants sénégalais des localités
touristiques de la Petite Côte et du Saloum apparaissent à leurs voisins européens « peu
éveillés » et « superficiels », incapables de réflexion et de conceptualisation. Plus
globalement, la « population sénégalaise » ne présenterait, pour la plupart des semi-
résidents, aucun intérêt, curiosité ou envie d’échanger, et serait incapable de concevoir
les bienfaits d’un enrichissement culturel réciproque. L’idéal de cette quête de l’Autre
n’entre pas en adéquation avec la conception de la « rencontre » selon cet Autre, ni
avec le contexte social dans lequel elle s’établit. Certains touristes semi-résidents
tentent de ne pas généraliser ces jugements de valeur au sujet de leurs voisins locaux
en choisissant d’entretenir des relations avec des Sénégalais dakarois, appartenant à
des classes sociales plus aisées (avocats, médecins et enseignants). Mais guidée par des
perceptions trop stéréotypées de leur environnement social, la majorité d’entre eux
préfère fréquenter un réseau d’individus européens très dense, ce qui durcit certaines
de leurs représentations et construit une frontière imperméable face à leur société
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
461
d’accueil. Beaucoup justifient cette attitude communautariste en affirmant qu’elle
répond à un rejet de leurs « efforts d’intégration » de la part de leurs voisins locaux, et
que ceux-ci n’entretiendraient des rapports sociaux avec eux dans le seul but de
profiter de leurs ressources économiques plus élevées.
28 Or, en s’intéressant aux points de vue de ces derniers, il apparaît davantage que
conserver une certaine ségrégation sociale et spatiale avec ces touristes semi-résidents
permet de pallier un certain complexe social. La plupart des résidents locaux
comparent en effet leur mode de vie à celui de leurs voisins européens et craignent
souvent de les inviter chez eux : leur environnement ne leur semble ni assez propre ni
assez confortable pour ces hôtes. Une règle locale largement partagée suggère
également qu’un individu doit fréquenter des personnes appartenant à sa classe socio-
économique : se lier avec des résidents européens supposerait des conditions préalables
d’égalité sociale justement inexistantes. Par extension, ce contexte de cohabitation,
soulignant d’importantes disparités d’ordre matériel et de nombreuses confrontations
relationnelles, amène certains groupes de résidents locaux à croire que leurs voisins
européens sont convaincus de leur supériorité technologique et intellectuelle. Les
premiers avancent souvent ce type d’analyse en expliquant, par exemple, que de
nombreux semi-résidents ne retiennent pas les prénoms de leur voisinage dont les
sonorités leur sont trop « peu familières », ou encore refusent d’essayer d’apprendre la
langue de leur localité, ou à défaut le wolof. Les touristes semi-résidents leur signifient
en retour que seule la langue française est reconnue, de manière administrative et
juridique, officielle au Sénégal. Ils considèrent en outre sa maîtrise comme l’un des
meilleurs outils de développement local, dont ils suivent souvent de près
l’appropriation par les enfants de leur voisinage sans hésiter à réprimander leurs
parents. Ces attitudes confirment l’image locale et stéréotypée selon laquelle l’individu
occidental fait preuve de condescendance face à tout ce qui lui est inconnu, réduisant
notamment les émanations du continent africain à l’expression d’un « retard » constant
et d’un primitivisme, dont la seule valorisation apparaît dans les activités touristiques.
29 La naissance de relations durables et de confiance s’établit localement selon des règles
précises, dans la durée et la récurrence du contact avec l’Autre. Certains éléments,
comme la connaissance de son statut au sein de son environnement social propre et
quotidien, sont entre autres nécessaires, de même que l’établissement d’une distinction
entre le sentiment de compassion qu’inspire l’Autre et la volonté de faire sa
connaissance. Or, la frontière sociale établie entre semi-résidents et habitants locaux
entrave toute adéquation avec les manières d’être et de faire de l’Autre. Dans ce
contexte, la téranga16 sénégalaise ne possède plus qu’une valeur de politesse et, malgré
leurs longs séjours récurrents, les touristes semi-résidents demeurent, dans le regard
de leur localité d’accueil, des « individus de passage » avant tout intéressés par leurs
loisirs balnéaires. Le phénomène de semi-résidence favorise en outre un
environnement socio-économique alimentant et créant un certain nombre de
frustrations et de stigmates, apposés aux types-idéaux sociaux que ceux-ci convoquent.
Cependant, nos enquêtes, concernant notamment le tourisme interne, nous ont permis
de constater que le quotidien de ressortissants européens/occidentaux expatriés ou
résidents permanents au Sénégal (bien que moins dépendant d’un contexte de rapports
socio-économiques inégaux) est également le théâtre d’antagonismes semblables à ceux
précédemment évoqués.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
462
Mises en scène quotidiennes du principe de« fascination répulsive »
Production d'une magie touristique, sublimation de la désillusion
30 Malgré leurs doléances récurrentes, de nombreux touristes semi-résidents séjournent
dans les bourgades littorales de la Petite Côte et du Saloum, et affirment apprécier la
spontanéité de leurs habitants. Ces derniers par exemple les saluent chaque jour
nommément, ce qu’ils ne connaissent pas en Europe dans des quartiers urbains ou péri-
urbains. Ce simple contact suffit à évoquer la « chaleur humaine africaine » qu’ils
imaginaient avant leur installation et à maintenir un idéal de vie, tant que leurs
contacts avec cet Autre restent cependant limités.
31 Parmi les touristes semi-résidents, certains organisent ou reprennent à leur compte des
activités touristiques (gérance de campements ou de maisons d’hôtes, restaurants,
clubs de sports, etc.). Il s’agit le plus souvent de familles et de couples (mixtes parfois),
qui deviennent résidents permanents au Sénégal, et s’investissent dans un tourisme de
proximité balnéaire et culturel. Une partie de ces établissements regroupe des
commerces informels ou ne déclarant pas toujours le chiffre exact de leurs revenus,
notamment ceux tenus par des retraités percevant ainsi un complément intéressant de
leur pension européenne. La possibilité d’une reconversion professionnelle loin d’un
environnement social quotidien, l’expérience d’une « aventure » dans un cadre de vie
culturellement différent, l’ennui et le manque de divertissements des localités rurales
(ou encore le blanchiment d’argent) constituent les principales raisons d’être de ces
réceptifs de voyage. Leur promotion touristique s’appuie sur la diffusion d’images
balnéaires alternatives à celles du « tourisme de masse » et du béton des complexes
hôteliers. Elles mettent davantage en valeur le charme insolite d’un littoral « sauvage »,
inscrit dans des traditions culturelles « ethniques »17. Ce tourisme de proximité vend
donc un milieu rural enchanteur, exotisé par une pointe de mysticité.
32 La bourgade de Palmarin, par exemple, devient une destination très prisée : elle
comporte une dizaine de campements dont la simplicité attire de petits groupes de
touristes, amateurs de lieux peu fréquentés. L’un de ces campements, tenu par un
résident suisse, vend cette destination grâce à d’importantes références aux
« traditions sérères » (combats de lutte, divinations, libations aux esprits et ancêtres,
etc.). Cet établissement est composé de grandes cases (chambres de la clientèle), au
milieu d’un jardin luxuriant possédant un « arbre sacré ». Celui-ci a été « sacralisé » par
des habitants d’une localité voisine après la construction du campement pour le
« protéger », grâce à l’esprit de l’ancêtre sérère très connu dont il porte le nom. Les
habitants de Palmarin ignorent cette réalité et croient que cet arbre fait l’objet de
libations et de prières prises en charge par l’une des familles du village, à l’instar de
plusieurs autres « bois sacrés »18. Selon le propriétaire, son « arbre sacré » lui aurait
permis de deviner durant deux années consécutives l’arrivée de la pluie et les meilleurs
endroits pour les semences. Un certain nombre d’anecdotes semblables sont racontées
aux touristes et exposées sur le site Internet du campement. Celui-ci propose en outre
des prestations de lutte sérère (produit culturel intéressant en raison de l’ensemble des
« rituels » qui précèdent les affrontements sportifs), et des mises en scène de
« cérémonies sérères » (fiançailles, mariages, baptêmes, etc.). Ces dernières sont des
théâtres circonstanciés que quelques habitants de Palmarin reproduisent sous formes
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
463
de séquences revues et corrigées pour ne pas en révéler les « secrets ». Or, selon le
propriétaire du campement, les pratiques animistes sérères devraient être présentées
au grand public et dépasser les tabous les entourant, idée qui provoque un certain
nombre de polémiques avec des notables du village et ne favorise pas non plus
l’« intégration » locale de ce résident. La majorité des gérants hôteliers européens de
Palmarin pensent cependant que ces croyances sont entretenues par une population
superstitieuse éloignée des courants de la modernité. Leurs discours utilisent le
stéréotype selon lequel l’individu africain s’accomplit grâce à ses émotions et ses
intuitions, par opposition à l’individu occidental symbolisant la rationalité. Certains
reprennent souvent les mots de L. S. Senghor (1956) « L’émotion est nègre, comme la
raison est hellène », qui, dans une perspective afrocentriste de revalorisation, ont
finalement accentué certaines représentations occidentales exprimant l’infériorité de
l’individu africain. Un autre campement de Palmarin, tenu par un résident français,
possède des chambres adossées à des baobabs, projet a priori inimaginable pour la
communauté villageoise. Le baobab en « pays sérère » fait l’objet de sacrifices, par
conséquent de certains tabous, et servait anciennement de tombe aux griots. Ce
campement se situe en outre à proximité d’un « bois sacré » très respecté localement,
où les habitants ont souhaité faire des sacrifices avant l’installation de l’établissement.
Cette confrontation d’une activité touristique aux règles de la culture locale fournit des
anecdotes très utiles à la promotion du campement et alimente toutes sortes de
rumeurs qui attisent la curiosité de sa clientèle.
33 Les résidents européens gérants d’activités touristiques sont perçus dans leurs localités
respectives comme un soutien potentiel de la vie économique locale. Ils font aussi
l’objet de sollicitations financières, puisque leurs activités commerciales génèrent, aux
yeux de leurs communautés d’accueil, des devises conséquentes. La question de
l’emploi est aussi l’objet de tensions récurrentes. Bien que les postulants locaux n’aient
souvent pas le niveau ou l’expérience requis pour travailler dans ces établissements,
leur insistance soutient l’idée selon laquelle ces emplois sont une juste contrepartie de
l’installation de ces hôtels et campements dans leur environnement local. En outre, ces
derniers emploient de nombreux Sénégalais formés aux métiers de l’hôtellerie sur la
Petite Côte ou à Dakar, ainsi que des expatriés européens pour certains postes de
direction. Des emplois tels que jardinier, réceptionniste ou piroguier sont donc parfois
confiés à des habitants natifs de ces bourgades touristiques. Les relations que les
gérants hôteliers entretiennent avec ces employés ont également pour objectif de leur
permettre de mieux s’intégrer à leur environnement social local, selon le modèle
pourtant problématique des relations avec leurs domestiques. Les gérants hôteliers
n’apprennent en effet aucune des langues locales qu’ils jugent inutiles, ce qui ne facilite
ni l’entente ni le dialogue avec leurs communautés d’accueil.
34 Ils se voient en outre régulièrement reprocher l’introduction de problèmes de mœurs
(relations parfois pédophiles, abus d’alcool, etc.) au cœur de ces localités.
35 N’étant pas dans les meilleurs termes avec les habitants de ces dernières, ces gérants
d’établissements touristiques observent majoritairement une ségrégation relationnelle
et spatiale, ajoutant aux points soulevés ci-dessus des raisons identiques à celles
évoquées par les touristes semi-résidents. Ils sont en revanche très investis dans des
associations de développement ou d’appui financier et logistique, aide qu’ils
considèrent comme la compensation attendue de leur implantation commerciale et le
moyen d’atténuer les plaintes dont ils peuvent faire l’objet. Ils sont en outre très fiers
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
464
de pouvoir contribuer à « l’évolution » de leur village d’adoption pour lequel ils
souhaitent un progrès collectif. Leurs idées s’opposent cependant à celles de la majorité
des résidents locaux qui définissent davantage le « développement » comme le soutien
et la réussite d’activités et de projets individuels. Dans ce contexte social marqué par
des antagonismes conséquents, les clientèles touristiques de ces établissements
représentent souvent une « bouffée d’air frais » pour leurs gérants/propriétaires. Ces
activités commerciales limitent leur isolement social : ils reconnaissent partager avec
ces touristes des représentations, des valeurs, des sensibilités et des imaginaires
similaires dans leur expérience de résidence et de découverte du Sénégal. Leur clientèle
regroupe le plus souvent des professionnels expatriés d’origine européenne installés à
Dakar ou à Saint-Louis, désirant changer de décor, fuir le vacarme et la pollution
urbaine, et se détendre dans les régions du « vrai » Sénégal. Sont également intéressés
quelques touristes individuels qui préparent leur voyage via Internet, ainsi que la
clientèle des structures spécialisées dans le tourisme de découverte. Beaucoup d’entre
elles possèdent un « réceptif » ou leur siège installé dans la capitale et sollicitent
principalement leur réseau de connaissances européennes investies dans le tourisme
pour organiser leurs circuits et leurs excursions. Elles recherchent fréquemment des
établissements qui ne sont pas fréquentés par le « tourisme de masse » et qui adoptent
un style « local », « authentique » et original.
Tourisme et expatriation : mise en réseaux d'images exotiques,
pérennité d'une frontière sociale
36 La clientèle de ces « réceptifs », exclusivement européenne/occidentale, est aussi facile
à intéresser que celle du tourisme international, grâce à cette attraction combinée de la
ruralité africaine et des loisirs littoraux. La plupart des représentations au sujet de la
« société sénégalaise », dénotées dans les discours d’individus européens adeptes de ce
tourisme de proximité, présentent de nombreuses convergences avec les images et les
perceptions de visiteurs issus du tourisme international et de (semi-) résidents
européens. Pour ces individus expatriés au Sénégal19, vivre en ville renforce leur
idéalisation du « milieu rural africain » : ils considèrent ces populations (qu’ils
cataloguent pour partie comme animistes) plus intéressantes, « humaines », aimables
et accueillantes. Leurs escapades touristiques sont également un remède ponctuel
contre le stress de la grande ville, qu’ils caractérisent par l’anarchie de ses
infrastructures et par l’agressivité de ses habitants. Nombre de ces résidents européens
considèrent en effet que les modes de vie sénégalais urbains s’organisent selon un
« mauvais principe d’imitation de l’Occident » (manque d’esthétique des villes,
mauvaise influence de la « modernité » sur la « culture originelle », « interpénétration
dégénérescente des cultures », etc.). La fascination qu’exerce sur eux le monde rural
repose donc elle aussi sur les images et stéréotypes d’une « authenticité africaine »
préexistants à ce contexte touristique et qu’il entretient. Découvrir « les profondeurs »
du pays et la « vie des villages » représente pour certains une source d’indices utiles à
leur adaptation quotidienne en milieu urbain. Ils déclarent par exemple mieux
comprendre la « valeur locale » accordée au travail et trouver une explication à ce
qu’ils définissent comme une logique improductive du temps que leurs collègues
sénégalais privilégieraient en contexte professionnel. La « lenteur » du rythme de vie
villageois qu’ils constatent leur permet de déduire qu’il se reproduit simplement en
ville à l’identique, oubliant qu’une grande partie des professionnels qu’ils y côtoient
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
465
(notamment dans la capitale) ont rarement vécu en milieu rural. Les stéréotypes
concernant le manque de rigueur et la paresse intrinsèques des individus « africains »
sont ici aussi entretenus et renforcés par cette autre mise en tourisme de la ruralité
sénégalaise.
37 Dans leur quotidien, la grande majorité de ces expatriés européens n’apprend aucune
des langues nationales, considérant la communication en français plus facile et plus
avantageuse pour l’« avancée » du pays. Ainsi, le wolof, qui est la langue la plus utilisée
en ville, leur paraît un dialecte impossible à maîtriser mais surtout d’aucune utilité. La
pratique de la religion musulmane et l’inégalité des genres qu’elle instaurerait sont
également à leurs yeux synonymes d’entraves au développement. Ils se plaignent plus
généralement des nombreuses sollicitations financières dont ils font l’objet, ou encore
de la lenteur des institutions, de leur manque de démocratisation et de modernisation.
Enfin, beaucoup caractérisent les individus sénégalais par leur superficialité, leur
manque d’intégrité, leur laxisme, leur incapacité à agir par anticipation, leur manque
de curiosité et d’intérêt pour l’Autre, leur haute aptitude au racisme et à la corruption,
etc. Leurs discours dépeignent un ensemble de causes négatives et endogènes qui
entretiendrait l’état de sous-développement du pays sur les plans matériel et
socioculturel, plus évident encore, selon eux, au sein du quotidien urbain. Ces
représentations sociales, précédemment rencontrées auprès de touristes et de semi-
résidents, ne constituent donc pas une conséquence directe du développement du
secteur touristique au Sénégal, bien qu’elles l’aient totalement investi.
38 Les points de repères sociaux des expatriés européens apparaissent souvent très
stéréotypés. Ils attribuent eux aussi régulièrement ce fameux rôle de « guide local » à
leurs domestiques (avec les difficultés précédemment citées), et estiment plus
intéressante la fréquentation d’individus locaux appartenant à des classes sociales peu
aisées, qu’ils supposent plus représentatives des « vraies réalités de la vie africaine ».
Dans le cas contraire, les individus avec lesquels ces résidents européens se lient ont
souvent la particularité de savoir se détacher, par le biais de discours et attitudes
spécifiques, des réflexes locaux et normes sociales que leurs interlocuteurs occidentaux
jugent traditionalistes. De même, ces derniers choisissent souvent de fréquenter des
expatriés africains non sénégalais qui leur fournissent un autre type de regard
distancié sur cette société d’accueil. Les résidents européens semblent effectivement
plus à l’aise pour échanger avec des individus ayant du recul sur leur environnement
local, et qui paraissent, par conséquent, plus aptes à s’adapter à leurs analyses critiques
et à leur aparté social. Savoir manipuler les normes locales est un gage d’intelligence
aux yeux de bon nombre d’expatriés : ils regardent en effet les « sociétés africaines »
comme particulièrement contraignantes vis-à-vis de la liberté et de l’épanouissement
individuels. Ces attitudes ne leur permettent pas cependant de maîtriser les subtilités
des codes qui régissent leur quotidien local, mais ils partagent, confrontent et
confortent leurs images de la société sénégalaise au sein de larges réseaux de
ressortissants occidentaux. Ils adoptent alors, les uns vis-à-vis des autres, un jeu de
concurrence, cherchant à se distinguer comme de fins analystes des rouages de leur
société d’accueil, et se perçoivent par conséquent beaucoup plus ouverts et habiles que
leurs compatriotes issus du tourisme international.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
466
Postcolonialité et discours de « l'entre-soi », miroirs d'un
phénomène local d'attraction-répulsion sociale
39 L’ensemble de nos analyses démontre la récurrence d’un antagonisme latent entre
ressortissants européens/occidentaux et résidents locaux. Certains contextes politique,
historique et économique ont posé des cadres qui permettent d’appréhender
aujourd’hui les relations que ces catégories d’individus entretiennent. La première
continue d’appartenir à la classe aisée de la société sénégalaise : touristes semi-
résidents et expatriés possèdent des revenus beaucoup plus importants que la moyenne
locale, occupent des postes de direction dans nombre d’entreprises locales et
multinationales, enfin beaucoup bénéficient des avantages économiques du statut
d’expatrié. Ce principe de migration du Nord vers le Sud, ainsi que l’économie de loisirs
qu’il entraîne, permet l’acquisition d’une qualité de vie très recherchée, favorise
certaines frustrations sociales mais aussi de nombreuses critiques ouvertes du « sous-
développement ». Dans ce contexte, ces critiques représentent le point le plus sensible
qui entrave les rapports entre résidents européens et locaux. Les analyses des premiers
génèrent localement, en milieux rural et urbain, un principe de repli et de protection
identitaire, ainsi que des discours faisant preuve d’une hostilité souvent d’ordre
politique, marqués par des références postcoloniales et afrocentristes. L’individu
occidental redevient alors « l’ancien colon » : ses propos sont jugés condescendants et
on attend davantage de lui qu’il se repente. Sa critique est estimée facile dans un
rapport dominant/dominé où il détient la meilleure place : l’utilisation moralisatrice
du souvenir de la colonisation est récurrente face à des individus considérés comme
non investis dans les réalités sociales locales. Leurs leçons et définitions de ce que
devrait être le progrès économique, politique, social et culturel du pays sont par
conséquent fortement rejetées.
40 Pourtant, au-delà de ces considérations identitaires, le marqueur de distinction sociale
cristallisé par le terme « toubab » est initialement le produit d’un préjugé favorable.
Dans les milieux professionnels par exemple, il évoque avant tout l’image d’un expert,
nécessairement plus compétent qu’un individu local qui possède une fonction et une
formation identiques. Les niveaux socio-économique et technologique modernes
associés au mode de vie de l’individu occidental lui confèrent cette valorisation
implicite. La période de la colonisation, les modes de loisirs touristiques, ainsi que le
recours à l’expertise européenne au sein d’entreprises et d’instituts locaux, ont
fortement accentué l’ambivalence des représentations sociales associées à l’individu
occidental. Celui-ci mobilise également des références fortes en termes d’ascension
sociale, de chance et d’épanouissement personnel. Ces images admiratives ont produit
l’idéal-type du « toubab » » au sein de la société sénégalaise20. Dans ce contexte, l’emploi
du mot « toubab » » suggère souvent une critique dévalorisante de la part du locuteur, le
reproche d’avoir renié des valeurs et comportements « africains » adaptés à un
environnement local spécifique. Mais il évoque tout autant un sentiment d’envie et
d’admiration de manières d’être et de vivre « plus modernes ». Cet idéal-type est
généralement associé à des individus locaux imitant ou se rapprochant des
comportements associés à l'individu occidental : ils parlent davantage français que
wolof (ou toute autre langue locale), « gomment » leur « accent africain », refusent de
manger du riz quotidiennement au profit de plats cuisinés européens, inscrivent leurs
enfants dans des écoles privées qui suivent le programme d’enseignement français,
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
467
mangent à table et plus rarement « au bol » ou à la main, portent souvent des tenues
vestimentaires occidentales, font preuve de retenue extrême dans leurs rapports avec
autrui, ou encore vivent en famille au sens le plus restreint du terme. Être un « toubab »
lorsque l’on est sénégalais s’applique donc à un ensemble de situations très diversifiées
de la vie courante, et notamment celles qui ont trait aux activités de loisirs. En effet,
bien que rarement prise en compte dans les statistiques, une certaine frange de la
population urbaine locale21 (à laquelle on peut rattacher des individus expatriés
d’origine africaine) participe aux mobilités du tourisme interne. Ces vacanciers locaux
ont une idée précise de ce que leurs homologues occidentaux viennent chercher au
Sénégal (du « brut », de « l’exotique » et du « folklore »), mais leurs pratiques
impliquent essentiellement des déplacements pour des visites familiales, et, en
proportion croissante, la location de villas dans des résidences de vacances ou celles de
particuliers sur la Petite Côte et à Saint-Louis, durant de longs week-ends et au cours de
l’hivernage. Ces pratiques touristiques contribuent donc à l’entretien d’un processus de
distinction sociale fondé sur les représentations locales du mode de vie occidental.
Celui-ci produit également des discours « auto-critiques » que l’on retrouve
fréquemment dans des conversations quotidiennes, notamment au sujet du manque
constant d’entretien des infrastructures, de l’insalubrité généralisée, de l’indiscipline,
l’assistanat et la passivité récurrents d’une « mentalité sénégalaise » essentiellement
attachée à des relations d’intérêts, etc. Ces discours mettent en avant différents points
compris localement comme des handicaps au fameux « progrès » socio-économique du
pays, pour certains identiques dans leur constat et leur analyse à ceux produits par des
touristes et expatriés occidentaux. Ils appartiennent cependant à des discours de
« l’entre-soi » et sont rarement prononcés devant ces derniers, car ils reflètent les
fondements de profonds enjeux identitaires et politiques.
41 Le principal reproche formulé à l’encontre des ressortissants occidentaux concerne
donc leur manque d’adaptation aux modes de vie locaux, y compris en contexte
touristique. On attend d’eux qu’ils apprennent à observer et à comprendre la façon
dont la société sénégalaise fonctionne et la manière dont ses protagonistes
interagissent les uns avec les autres. De nombreuses caractéristiques du portrait local
de l’individu occidental se réfèrent en effet à ses difficultés à accepter l’Autre au-delà
de la valeur exotique et primitive qu’il lui confère, raison principale pour laquelle il fait
l’objet de stéréotypes bien ancrés. La définition suivante, recueillie lors d’un entretien,
résume assez bien l’ensemble des représentations sociales locales construites à son
égard : « Le toubab est celui qui vient vers moi mais qui ne sait pas qui je suis. Il n’essaie
pas de le savoir et ni de se mettre à ma place car pour lui nous sommes trop
différents. » Cependant, lorsqu’un touriste semi-résident ou un expatrié européen
parvient à recadrer ses perceptions de « l’Afrique » et adopte certaines règles locales
fondamentales (l’art de la plaisanterie est en ce sens très utile, notamment s’il utilise à
bon escient quelques termes linguistiques locaux), il obtient la reconnaissance d’un
statut social valorisant. On lui octroie par exemple des responsabilités au sein de sa
localité ou de son quartier, pour lesquels il est un intermédiaire et un confident des
plus précieux contribuant à résoudre des litiges importants (problèmes d’héritage, de
mariage, de grossesse illégitime, etc). Cependant, la plupart des ressortissants
occidentaux possédant cette volonté de s’adapter imitent fréquemment les codes
sociaux locaux sans réellement les comprendre. L’une de leurs particularités est de ne
pas savoir se situer dans la société sénégalaise : ils fréquentent souvent, par exemple,
des individus étiquetés localement comme marginaux mais qu’ils n’identifient pas
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
468
nécessairement comme tels (dissidents mourides Baye Fall, ou individus en conflit et en
rupture avec leurs familles), pensant au contraire faire preuve « d’intégration » sociale.
Ils méconnaissent en réalité l’importante référence locale qu’ils personnifient.
Identifiés comme appartenant à une communauté socioculturelle « étrangère », les
modes de vie et les imaginaires sociaux occidentaux sont pourtant bien étiquetés et
localement décryptés, notamment grâce à l’histoire de la colonisation, aux phénomènes
d’immigration et aux médias. L’individu occidental appartient davantage à cette société
sénégalaise qu’il en est un élément exogène : il y occupe de fait une place
incontournable, mais il n’en a généralement pas conscience, souvent convaincu d’être
affublé de clichés péjoratifs à l’instar de tout étranger dans une société d’accueil. Ceci
résulte en partie de l’ambivalence des représentations locales qui caractérisent la
figure sociale de l’Autre occidental. Sa définition est à la fois issue d’une valorisation
postcolonialiste de la « culture africaine » qui la discrédite et d’une réappropriation de
ses références sociales et identitaires. Elle met ainsi en scène les schèmes spécifiques
d’une « fascination répulsive » locale, produit d’une confrontation directe avec celle qui
gouverne les imaginaires sociaux occidentaux. L’ambiguïté de ce rapport social, peu
analysée dans les deux sens de l’interaction, se révélant particulièrement saillante dans
le cadre du tourisme de longs séjours et de l’expatriation, n’est-elle pas également
constitutive de tout contexte d’interlocution entre le continent africain et l’Occident ?
BIBLIOGRAPHIE
COURADE, G. (dir.)
2006 L’Afrique des idées reçues, Paris, Belin.
DOQUET, A.
2005 « Tous les Toubabs ne se ressemblent pas. Les particularités nationales des étrangers vues
par les guides touristiques maliens », in GEMDEV & UNIVERSITÉ DU MALI, Mali-France. Regards sur une
histoire partagée, Bamako, Éditions Donniya ; Paris, Karthala.
DOQUET, A. & LE MENESTREL, S.
2006 « Introduction : Tourisme culturel, réseaux et recompositions sociales », Autrepart, 40 : 3-14.
DUVAL, M.
2000 « Deux catégories de l’altérité : entre fascination et répulsion », Ethnologies comparées,
Frontières, Revue électronique du CERCE.
ECHTNER, C. & PRASAD, P.
2003 « The Context of Third World Tourism Marketing », Annals of Tourism Research, 30: 660-682.
JEWSIEWICKI, B.
1991 « Le primitivisme, le colonialisme, les antiquités “nègres” et la question nationale », Cahiers
d’Études africaines, XXXI (1-2), 121-122 : 191-213.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
469
LE BIHAN, Y.
2007 Construction sociale et stigmatisation de la « femme noire ». Imaginaires coloniaux et sélection
matrimoniale, Paris, L’Harmattan.
MASURIER, D.
1998 Hôtes et touristes au Sénégal : imaginaires et relations touristiques de l’exotisme, Paris-Montréal,
L’Harmattan.
QUASHIE, H.
2009 (à paraître) « Quête muséographique de l’Autre. Les enjeux symboliques de pratiques
touristiques à vocation “culturelle” au Sénégal », Articulo, revue de sciences humaines, hors série, 2.
SECA, J.-M.
2001 Les représentations sociales, Paris, Armand Colin.
SENGHOR, L. S.
1964 « Ce que l’homme noir apporte », Liberté 1, Négritude et humanisme, Paris, Éditions du Seuil :
24.
NOTES
1. Nous parlerons dans cet article de contextes de rencontres touristiques qui n’entrent pas
directement en adéquation avec les définitions classiques du « tourisme culturel », souvent
présenté comme une catégorie spécifique de pratiques émergentes (tourisme éthique,
respectueux, équitable, solidaire, etc.). En effet, selon A. DOQUET et S. LE MENESTREL (2006 : 4),
« malgré ses contours imprécis, [le tourisme culturel] revêt [tout simplement] un sens dès lors
qu’il est utilisé par les différents protagonistes du monde qu’il désigne [...] ». Nous décrirons donc
des pratiques touristiques qui répondent davantage à une volonté des acteurs qu’elles
concernent de les qualifier de « culturelles » (rencontre et cohabitation avec l’Autre, découverte
et dépaysement touristique en milieu rural, etc.).
2. Notre travail de thèse repose sur des enquêtes qualitatives réalisées au cours de quatre séjours
longs de 5 à 11 mois au Sénégal (2005-2008).
3. Les plages facilement aménageables de cette partie du littoral et la faiblesse de ses courants
marins en font une région touristique privilégiée, par opposition à la Grande Côte plus
dangereuse (Dakar-Saint-Louis). La station de Saly, aménagée par l’État sénégalais sur la Petite
Côte, a été ouverte en 1981.
4. Les plus récentes marquent particulièrement les imaginaires sociaux actuels. Voir par exemple
les expositions du Musée du quai Branly qui ne font état que de deux ou trois éléments
« culturels » appartenant à une « ethnie sénégalaise ».
5. L’Organisation mondiale du tourisme et la Commission statistique de l’Organisation des
Nations-Unies ont défini en 2000 le phénomène touristique par « les activités déployées par les
personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en dehors de leur
environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins
de loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l’exercice d’une activité rémunérée dans le lieu
visité ». Ainsi, les individus européens dont il est question dans le texte appartiennent à la
catégorie générale des « touristes ». La plupart sont en couple (tranche d’âge 45-75 ans) et issus
de catégories socio-professionnelles très hétérogènes : ils résident au Sénégal entre trois et neuf
mois consécutifs car ils ne sont plus en activité ou seulement partiellement.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
470
6. Le concept de représentation sociale fait référence à des réserves de savoirs pratiques, de
traditions et d’idéologies qui construisent des opinions, images, attitudes, préjugés, stéréotypes,
et croyances. Ils constituent un assemblage de références activées selon les finalités et les
intérêts des acteurs sociaux qui s’en servent (SECA 2001). Les représentations sociales sont en
outre des entités élaborées dans des rapports entre groupes sociaux, attachées à des positions ou
à des statuts inscrits dans une logique de jugements et d’actions. Par conséquent, l’objet d’une
représentation sociale renvoie à un enjeu, source de divergences, d’influence et de
questionnements. Son étude permet de discerner des dynamiques sociales, évoluant autour de
principes d’opposition et d’influences d’acteurs ou d’institutions, antagonistes ou dominants
dans la définition de la réalité sociale concernée.
7. Les recensements statistiques du ministère du Tourisme sénégalais s’appuient sur les fiches de
débarquement et d’embarquement que chaque individu doit remplir à son arrivée ou sortie du
territoire. Elles ne sont pas exclusivement destinées aux touristes, et ne sont pas non plus
dépouillées et analysées régulièrement. Nous nous sommes donc appuyé sur les chiffres fournis
lors de réunions et entretiens non directifs effectués avec des responsables du ministère,
notamment auprès de sa Direction des études et de la planification. Le chiffre avancé dans le
texte a en outre été corroboré par les estimations des voyagistes avec lesquels nous avons
travaillé.
8. Les résidences de particuliers sont également exemptées d’impôts, leurs travaux sont peu
coûteux, et leur agencement et usage dépendent du goût de leur propriétaire, faute de
réglementation (absence de taxes pour les piscines ou d’interdiction de mise en location
touristique).
9. Tous les touristes semi-résidents ont au moins une employée femme de ménage, cuisinière et
lingère, ainsi qu’un gardien ou un aide-jardinier.
10. La nationalité et l’origine françaises de l’enquêtrice, son statut de semi-résidente à Dakar
depuis 2003 dans le cadre de stages et travaux universitaires (master- doctorat) et son
appartenance à une famille franco-sénégalaise d’origine béninoise/ togolaise, nous ont très
souvent confrontée aux stéréotypes locaux concernant les ressortissants occidentaux et permis
d’élargir nos champs d’investigation. Nos analyses s’appuient également sur des données issues
de cinq entretiens non directifs, ainsi que d’entretiens informels auprès d’individus de
nationalité sénégalaise en milieux rural et urbain, et d’individus expatriés d’origine africaine à
Dakar.
11. Les représentations sociales généralisantes des guides maliens à l’égard de leurs clients
occidentaux que présente Anne DOQUET (2005 : 247-249) se retrouvent dans les entretiens que
nous avons menés avec une population d’enquêtés plus élargie.
12. Selon les stéréotypes de cet imaginaire social, l’individu africain, par opposition à son double
occidental, serait lent, peu rigoureux, mystique, superstitieux, attaché au paraître, festif,
toujours souriant, et dépendant de ses relations sociales.
13. Nous avons réalisé à Dakar 45 entretiens non directifs auprès d’individus de nationalité
sénégalaise (25-60 ans), issus des milieux professionnels de l’enseignement, l’informatique, des
ressources humaines, du bâtiment, de la fonction publique, du marketing et du commerce.
14. Nous avons réalisé différentes enquêtes dans les localités de Saly, Somone, Nianing, Warang,
Mbour, Palmarin, Fadiouth, Ndangane et Toubacouta, où nous avons effectué des entretiens
informels, de l’observation directe, ainsi que 46 entretiens non directifs et semi-directifs auprès
de touristes semi-résidents et habitants locaux (pêcheurs, commerçants, prêtres, chefs de
quartiers, guides, jeunes, mères de famille, chefs de villages).
15. Voir également l’article de C. SALOMON (dans ce numéro).
16. Le terme wolof « téranga » se traduit par accueil et/ou hospitalité. Érigé en valeur sociale
nationale, il est également devenu l’un des éléments-clés des slogans publicitaires touristiques :
« Le Sénégal, Porte de l’Afrique » y est souvent désigné comme le « Pays de la téranga ».
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
471
17. Les localités touristiques de la Petite Côte et du Saloum sont situées dans ce qui est présenté
comme le « pays sérère », dont les populations, à dominance catholique, sont réputées, entre
autres, avoir recours à des pratiques religieuses rituelles dites « animistes ».
18. Les prières et les libations effectuées dans le secret auprès des bois sacrés sont à la charge
d’un représentant local issu d’une lignée maternelle précise, dont les habitants du village n’ont
pas forcément connaissance.
19. Nos séjours réguliers au Sénégal depuis 2003 nous ont permis d’analyser certaines situations
et représentations sociales concernant des résidents européens expatriés. Ceux-ci vivent
généralement au Sénégal entre trois et vingt ans consécutifs. Nous avons complété des notes
d’observation directe et entretiens informels par 37 entretiens non directifs réalisés à Dakar
auprès d’individus européens qui participent à ce type de tourisme : stagiaires et étudiants (25-30
ans), agents de développement en activité et à la retraite (30-65 ans), enseignants (35-50 ans),
médecins (45-70 ans) et cadres de multinationales (30-45 ans).
20. Ici encore, ce phénomène n’est pas propre au Sénégal. Nos entretiens avec des individus
expatriés d’origine africaine nous ont permis de connaître l’existence d’une telle catégorisation
sociale dans d’autres pays de la sous-région ouest- africaine.
21. Il s’agit surtout d’individus appartenant à la tranche d’âge 30-50 ans et souvent issus des
secteurs d’activité suivants : enseignement privé, santé, fonction publique (cadres), ressources
humaines, marketing, professions libérales.
RÉSUMÉS
Les contextes de semi-résidence touristique et d'expatriation au Sénégal favorisent l'étude
d'interactions quotidiennes entre des groupes sociaux minoritaires de ressortissants européens/
occidentaux et leurs voisins locaux. Cette cohabitation avec l'Autre semble renforcer
l'élaboration de frontières et stéréotypes, assez proches dans leurs fondements de ceux que l'on
retrouve dans des contextes touristiques plus classiques. L'analyse des rapports sociaux que cette
« rencontre culturelle » instaure et de son environnement sociopolitique et identitaire révèle
l'existence de regards et représentations croisés particulièrement conflictuels et ambigus.
Frames of semi-residential tourism and expatriation in Senegal set daily interactions between
social minorities of Westerners and their national neighbours. This living together seems to
maintain and strengthen social boundaries and stereotypes, which are grounded as those of more
classic tourist contexts. Analysing the social interactions this specific cultural encounter stages
within its historical and political environment highlights very ambiguous and conflicting
positions.
INDEX
Mots-clés : Sénégal, altérité, expatriation, tourisme balnéaire, tourisme culturel, tourisme de
semi-résidence, stigmatisation sociale
Keywords : Senegal, alterity, expatriation, seaside tourism, cultural tourism, semi-residential
tourism, social stigmates
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
472
AUTEUR
HÉLÈNE QUASHIE
Centre d’études africaines, EHESS, Paris.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
473
Tourisme d’oasis Les miragesnaturels et culturels d’unerencontre ?Tourism in Oasis, Natural and Cultural Mirages of an Encounter?
Vincent Battesti
« Les Oasis ! le Sud ! Le Désert !
Mots magiques, mots prestigieux, évocateurs de
pays mystérieux que l’imagination nimbe de
beautés sublimes et enchanteresses.
Il n’est pas un de nous que ces mots n’aient fait
rêver, qui n’ait ressenti, à leur appel, un choc ou
un éblouissement » (Lehuraux 1934).
Les oasis de Siwa (Égypte) et du Jérid (Tunisie),terrains d'une rencontre culturelle ?
1 Aborder la question du tourisme dans les oasis sahariennes, ce n’est pas traiter de
l’envahissement de populations isolées par des hordes de touristes troublant leur
pureté originelle. D’une part, les effectifs de ce tourisme oasien sont relativement
faibles et sans commune mesure avec la fréquentation (plus habituelle) des stations
balnéaires de ces mêmes pays et, d’autre part, il faut retenir de l’évidente insularité des
oasis l’idée qu’elles sont des relais et des carrefours dans le désert1, donc des points de
rencontre2.
2 Une définition des oasis est de les donner comme l’association d’une agglomération
humaine et d’une zone cultivée (souvent une palmeraie) en milieu désertique. Sa
palmeraie est un espace irrigué fortement anthropisé qui supporte une agriculture
classiquement intensive et en polyculture. Les oasis cumulent une biodiversité élevée et
d’intenses pressions sur leurs ressources naturelles. Le Sahara connaît actuellement un
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
474
essor rapide du tourisme, « encore mal contrôlé et peu encadré » diront certains (PNUE
2006).
3 Du point de vue de la méthode, j’aborde la question du tourisme en oasis par
l’anthropologie sociale. Il est un risque, propre et bien connu de l’ethnologie du
tourisme, d’immiscer un jugement moral dans l’étude scientifique de ces pratiques
(Nash 1996), ce qu’on essaiera d’éviter ici. Le dénigrement qu’il introduit est une
manière de clamer « les touristes, ce sont les autres ! » et cela... de concert avec les
touristes. La place de l’ethnologue est ambiguë dans l’écriture comme sur le terrain, car
sa présence même en oasis vient certifier pour de nombreux touristes qu’ils sont bien
sur le terrain « éloigné » digne d’une quête d’authenticité (Mitchell 1995). Une autre
difficulté de cette étude est que je n’y décline pas les pratiques touristiques en fonction
des identités de mes acteurs (origines sociales par exemple) : je m’en tiendrai à la
description d’un registre de pratiques (forcément idéal typique).
4 Ce texte s’articule sur deux terrains oasiens : l’un en Tunisie dans la région arabophone
du Jérid et l’autre en Égypte, dans l’oasis berbérophone de Siwa. Le Jérid, au sud-ouest
de la Tunisie, est l’une des deux grandes régions de palmeraies du pays avec le Nefzawa
(situé plus à l’est). Les deux principales agglomérations du Jérid, Tozeur et Nefta,
possèdent une palmeraie attachée à leur centre urbain formant de grands périmètres
irrigués (presque un millier d’hectares de palmeraies chacune) d’une agriculture qui fit
leur renommée. Outre leur importance passée comme centres religieux et intellectuels,
le commerce a sans doute été leur grande raison d’être du temps des routes
transsahariennes. Elles tentent aujourd’hui une percée touristique aux résultats encore
mitigés (plus réussie à Tozeur3) : les plans nationaux de développement ont rendu
prioritaire le « tourisme saharien », les villes côtières atteignant la saturation.
5 La situation est différente à Siwa, région égyptienne beaucoup plus ramassée et d’accès
plus difficile. Administrativement, l’oasis dépend du gouvernorat de Marsa Matrouh,
ville la plus proche à 300 km de là sur la côte méditerranéenne. Siwa est moins intégrée
au tissu national que le Jérid, cela à tout point de vue (administratif, politique,
économique, culturel ou linguistique). Siwa peut être perçue comme un endroit
éloigné, relégué (elle fut longtemps un lieu d’exil politique pour les Égyptiens et les
fonctionnaires en poste à Siwa éprouvent toujours cette impression d’exil), la région est
en revanche estimée par ses habitants, indéniablement, comme une centralité vraie,
presque um ed-dûnya4 : des dizaines de touristes américains, français, italiens, japonais,
coréens, belges... n’y viennent-ils d’ailleurs pas ?
6 Carrefours, les oasis d’Afrique du Nord ne virent cesser le commerce transsaharien
qu’avec les conquêtes militaires coloniales — responsables de ce déclin pour J. Bisson
(1995 : 18-19)5 — ; les premiers touristes sahariens succédèrent immédiatement aux
troupes armées. Tourisme d’aventure, naturaliste, puis culturel aujourd’hui.
L’inclination contemporaine en oasis est au tourisme « culturel » : il devient un idéal à
atteindre (et difficile à définir), même s’il pourrait paraître minoritaire en le chiffrant.
Est-il pertinent d’ailleurs de le chiffrer ? Il n’y a pas des « touristes culturels » et
d’autres qui ne le seraient point, mais une propension chez les uns et les autres à plus
ou moins pratiquer certains aspects de ce nouvel éthos6 et c’est aussi affaire toute
« bourdieusienne » de distinction sociale (Bourdieu 1979). Une proposition de cet
article est de prendre acte de ce tourisme7, sans penser son avènement comme une
révolution éclipsant ses formes antérieures. Les ressources naturelles et paysagères —
envisagées également dans leur acception matérielle — ne suffisent-elles plus à
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
475
contenter seules le tourisme contemporain ? Les qualités culturelles attribuées à la
population d’un territoire seront une possible nouvelle quête, une possible nouvelle
ressource.
7 Avec les années 1990, le tourisme culturel s’est en effet affermi et a pris de l’ampleur.
La « station hypermoderne invitant au dépaysement total par une atmosphère
architecturale et récréative stéréotypée, dans laquelle la touche autochtone n’apparaît
plus qu’artificiellement, est peu appréciée » par une part croissante de la clientèle
curieuse de connaissances et avide d’insolite (Wackermann 1999). Le lieu doit offrir une
palette d’attractions socioculturelles et témoigner d’une véritable identité culturelle.
L’exigence de pittoresque se porte aujourd’hui sur la dimension humaine : rencontrer
des « locaux ». Ce peut être pensé certes comme une nouvelle étape de l’histoire de
l’économie touristique, ses acteurs ne réforment cependant pas leurs pratiques. Cela
suggère finalement plus une variation des pratiques qu’une nouvelle ère du tourisme.
Le « tourisme culturel » n’offre que l’opportunité de nouvelles pratiques touristiques :
la palette de possibilités, de ressources va (aujourd’hui) en s’élargissant. En travaillant
sur divers types de relations à l’environnement dans les oasis du Jérid, j’avais déjà
constaté que nous n’avions pas un modèle de pratiques qui effaçait définitivement le
précédent : non seulement ces modèles coexistent, mais les acteurs ne sont pas
cantonnés à l’un ou l’autre. Diverses « ressources socioécologiques »8, qui combinent
ressources d’idées et ressources naturelles (Battesti 2004, 2005), sont mobilisées de
façon préférentielle par une catégorie d’acteurs (dont déjà celle des touristes). Cette
mobilisation des ressources est toujours fonction des situations rencontrées par ces
acteurs et de leurs compétences (au sens de Berry-Chikhaoui & Deboulet 2000) à les
mobiliser. Cette approche est possible pour la question du tourisme en oasis et aiderait
à comprendre la coexistence d’une variété de pratiques parmi les acteurs du tourisme
et la variété des pratiques d’un acteur donné.
Les pratiques touristiques aujourd'hui en oasis
8 L’accès aux oasis demande un détour par le désert dont la fréquentation n’est jamais
innocente pour un touriste occidental ; on connaît les valeurs associées habituellement
au désert : vide, transcendance, ascétisme, références bibliques... Une forme précoce de
tourisme saharien9 s’est tournée vers le défi que représentaient à ses yeux les grands
horizons désertiques10. Les oasis ne sont alors que des relais de verdure, des îles ou des
ports dans l’océan minéral (et les dromadaires, les vaisseaux d’une mer de sable)11 :
l’imagerie maritime est classique. La fréquentation des oasis par les touristes n’est
cependant pas anecdotique12 bien que le statut de ces espaces soit plus ambigu : à la fois
image dans la littérature ou la peinture occidentales du farniente oriental et fruit du
labeur de générations d’êtres humains. Le paysage oasien est une ressource esthétique
mille fois exploitée depuis les temps coloniaux (cartes postales, couvertures de romans,
catalogues d’expositions coloniales, bandes dessinées, films) sous la forme épurée d’un
paysage archétypé et évanescent. Le paysage oasien, comme objet du désir touristique,
a donc une histoire créée également ex situ.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
476
Carte postale « Dans la palmeraie » (1937)
Source : Dans la palmeraie, Gabès Tunisie, Éditeur Ch. Berenger, 1937 (coll. de l’auteur).
9 Le tourisme oasien n’a pas tardé à s’intéresser, au-delà du pittoresque que la nature lui
offrait, à la ressource culturelle des oasis, en particulier depuis l’engouement
orientaliste. Les paysages oasiens sont alors non seulement le support d’une
appréciation esthétique particulière (la contemplation), mais le mode de vie lui-même
des habitants est appréhendé comme composante du cadre exotique et digne
d’observation — ce qui est très bien rendu par les cartes postales coloniales aux titres
génériques de « scène de vie » ou « scène pittoresque ». Il est cependant certain que
tous les commentaires des voyageurs dès la fin du XIXe siècle (Said 1997) s’expriment
depuis un point de vue singulier : l’idée d’être éloigné des populations observées d’une
distance telle qu’un contact ou une communication avec les indigènes ne représente
guère d’intérêt. Le tourisme s’inscrit alors éminemment dans ces dualismes
observateur/observé, dominant/dominé. Les « zoos humains » (Blancel et al. 2002) de la
fin du XIXe et du début du XXe siècle nous incitent à croire que son ressort ne réside pas
que dans la distance géographique parcourue par l’un et le localisme de l’autre13.
L’attention se porte sur la culture locale, mais comme faisant partie intégrante,
« naturelle », du paysage. Ceci est parfaitement cohérent avec la doxa occidentale, selon
laquelle la modernité (dont le touriste se sent débiteur) tire l’Homme hors de
l’« emprise » de la nature pour l’engager à son « contrôle »... laissant les prémodernes
dans la nature. C’est la qualité accordée à cet état naturel qui varie entre deux pôles,
selon les acteurs, les époques et les situations : archaïsme (appréciation négative) et
harmonie (appréciation positive). Ce n’est pas vraiment l’intérêt porté au « culturel »
qui fait la spécificité du tourisme culturel, mais le passage du « pittoresque » à
« l’authentique » ou de l’ethnocentrisme au relativisme culturel.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
477
Affiche « Un mois au Sahara et au Hoggar » (1931)
Source : Un mois au Sahara et au Hoggar, Itinéraire de circuit touristique automobile, Automobile Clubd’Alger (1931) (coll. de l’auteur).
10 En oasis, la donne touristique change au cours du XXe siècle : marquant au Jérid le
passage du tourisme d’une upper-class au tourisme de masse populaire, le prestige du
Grand Hôtel de l’Oasis à Tozeur (construit en 1922) cède aujourd’hui à l’éclat
ostentatoire d’une « zone touristique » dédiée aux hôtels des chaînes de vacances —
avec notamment les Club Méditerranée, Fram et Palm Beach — et à un aéroport
international. L’intérêt des États sahariens pour leurs oasis s’amorce à partir des
années 1990 (Hosni 2000). À Siwa, le manque d’infrastructures et surtout l’absence d’un
accès asphalté à l’oasis garantira longtemps au tourisme un caractère aventurier ou à
tout le moins exigeant14 : « Siwa, il faut la mériter pour la voir » me disait sur site une
touriste anglaise qui aura fait ses dix heures d’autocar depuis Le Caire. Siwa semble
sauter (pour l’instant) ce qui paraissait ailleurs l’étape inévitable du tourisme de masse
pour développer une forme récente (et mal définie) d’écotourisme. Sa clientèle, pour le
dire vite, est majoritairement constituée de « backpackers » dont le penchant pour un
tourisme culturel est plutôt revendiqué et qu’ils tendent à décrire comme la recherche
d’une rencontre authentique avec la population et la culture locales (Mitchell 1995). Il y
a déjà une pointe de distinction dans la destination même : une oasis berbère à 800 km
de route du Caire des pyramides, capitale d’une Égypte arabophone.
11 L’oasis est l’espace d’une rencontre, peut-être l’espace aussi de conflits entre des
acteurs locaux et des acteurs exogènes. La présence des touristes en oasis est souvent
courte15, mais leur renouvellement rend leur figure presque permanente malgré les
fluctuations saisonnières. Nous verrons rapidement les représentations que touristes et
locaux cultivent d’un même espace ; l’espace est étroit, les idées et les pratiques se
chevauchent. Le jardin d’oasis se résume-t-il à quelques palmiers et un peu d’eau dans
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
478
le désert ou bien est-il (aussi) une rencontre souterraine de conflits et de négociations
sur des ressources que sont l’eau, la terre, le travail et peut-être également les idées ?
Toutefois, ce qui est à l’œuvre et ce qui est observable dans les oasis est forcément de
l’ordre des pratiques dont les plus emblématiques sont celles qui ont trait à l’espace.
L'espace des pratiques
12 Les touristes utilisent souvent les oasis comme points de départ d’excursions vers le
désert (où 80 % des touristes à Siwa se rendent)16. Le désert est de caractère steppique
et aride au Jérid, le désert est de sable au sud et de roches au nord à Siwa. Il est dans
tous les cas extérieur à l’expérience spatiale des locaux, sinon qu’il limite l’oasis. D’une
façon fort classique, les sédentaires berbères de Siwa ou arabes du Jérid ne fréquentent
pas le désert, le considèrent avec dédain, pays vide et hostile, pays des Arabes pour les
uns ou des Bédouins pour les autres. Il n’y a que les oasiens qui exercent le métier de
guide, qui s’y intéressent pour y organiser des incursions pour les touristes. L’éventuel
partage de connaissances, de savoirs « culturels » entre oasiens et touristes ne pourra
prendre appui que sur l’espace de l’oasis, même si ce n’est pas le paysage qui semble
mériter une vraie attention a priori des touristes.
13 Si l’on considère la capacité à se situer, à trouver son chemin, à décrire la qualité des
lieux ou à citer des toponymes, les touristes ont une connaissance spatiale de l’oasis
moins riche que celle des locaux (Battesti 2005, 2006b). Cependant, il faut, d’une part,
nuancer cela par catégorie d’acteurs locaux (à commencer par la claire dissemblance
des pratiques masculines et féminines au Jérid et à Siwa) et, d’autre part, considérer
que touristes et oasiens ne se déplacent pas tout à fait dans le même univers cognitif
(sinon que tous s’accordent sur ce que l’oasis ne couvre que les espaces habités et
cultivés : l’anthropique).
14 Les touristes sont rares à se risquer seuls (entre eux) sur les chemins des palmeraies qui
leur semblent, sans guide, aussi peu abordables que l’intérieur des quartiers à l’écart
des grandes artères urbaines (peur de se perdre, de l’inconnu, d’une altérité sans
interprète), une gêne exploitée à Tozeur et Nefta par les conducteurs de calèches tirées
par des chevaux et à Siwa par les enfants qui conduisent, plus humblement, leur kareta
(carriole) tirée par un âne. Quelles sont les valeurs véhiculées par ces attelages ?
Renvoient-ils à une idée de tradition (bien que l’usage des charrettes en oasis ait moins
de cinquante ans et des grandes calèches moins de vingt), participent-ils d’un exotisme,
d’un dépaysement ou bien plus simplement d’une activité « appropriée » dans le cadre
d’un voyage touristique ? Le caractère ambigu, incertain de sa valeur « patrimoniale
locale » explique peut- être que les touristes qui empruntent le plus à un éthos
« tourisme culturel » ont plus de difficulté à se laisser conduire. Les entretiens
soulignent que ce transport renvoie trop au spectacle de rapports sociaux inégalitaires
(un transport trop princier ?) à l’opposé du traitement égalitariste désiré par eux dans
leur rencontre avec le « local ». Cela dit, à Siwa ou au Jérid, les conducteurs savent en
insistant lever les réticences. Les touristes monnayent alors un trajet sûr dans la
palmeraie, ceux que l’ambiguïté du véhicule rend les plus mal à l’aise (« est-ce
“normal” de me laisser véhiculer ainsi ? », « est- ce juste bon “pour les touristes” ? »)
iront souvent s’asseoir à l’avant, à côté du conducteur pour tenter de communiquer
avec lui et atténuer la tension ou la gène ressentie.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
479
La promenade des touristes en calèche selon un parcours immuable à travers la « foret » depalmiers
Source : Septembre 1995, Nefta (Tunisie) (cliché de l’auteur).
15 Le moyen de locomotion pour visiter l’oasis conditionne évidemment les parcours,
pratiques et expériences spatiales du touriste. Ce terroir devient pour un temps un
objet de consommation olfactif, sonore et surtout visuel. Les parcours se cantonnent à
des trajets bien définis. L’ensemble de l’espace agricole de l’oasis n’est pas valorisé
comme potentiel de promenade (ni par les touristes, ni par ceux qui les conduisent) :
une sélection est opérée ; toutes les palmeraies ne sont pas non plus visitées, en
particulier les récentes. Ces palmeraies nouvelles sont d’abord moins « visibles », car
elles ne sont pas incorporées aux bourgades comme les anciennes et par ailleurs elles
ne sont pas revendiquées comme partie de « l’identité du Jérid » ou de « l’identité de
Siwa » qui puisse être valorisable à destination de touristes. Le terroir à voir est d’une
autre qualité, bien distinguée également dans les catégories spatiales des agriculteurs
locaux du Jérid ou de Siwa, c’est l’ancien, les vieilles palmeraies. Pourquoi ? Pour les
touristes, la question est à peine pertinente : évidemment parce que le « vrai » paysage
oasien est celui qui prévalait avant qu’une modernité ne l’abîme, également « pour
comprendre comment on vivait auparavant ». Les entretiens avec les touristes tendent
presque tous à soutenir l’idée qu’il est dommage de voir disparaître l’ancien modèle de
vie rurale (oasienne en l’occurrence), car il est un témoignage d’authenticité ou
d’harmonie avec son environnement. Rares sont les discours à s’écarter de cette
antienne, lui conférant la qualité de véritable doxa. On a perdu cette harmonie chez soi
en se faisant moderne et l’on ne se déplace pas à l’étranger jusque dans de lointaines
oasis pour voir de nouveau la modernité triompher, à coup de tracteurs, de tomates
primeurs au goutte- à-goutte ou de quartiers nouveaux en parpaings.
16 La dichotomie traditionnel/moderne est une catégorisation consacrée des acteurs
locaux et touristiques. Nous suivrons donc cette faille qui divise le monde en deux17.
Après l’identification de ce qui sous-tend la praxis des acteurs et de la spécificité d’un
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
480
tourisme culturel, nous aborderons les changements opérés dans les oasis par et pour le
tourisme (et spécifiquement le culturel) au niveau de la « tradition locale ».
Les évolutions de l'émotion esthétique : le regard et laquête d'une authenticité
17 Pour cerner la quête d’un voyage touristique dans les oasis, peut-être faut-il distinguer
un tourisme national et international. Cependant l’observation laisse croire à l’absence
d’écart notable entre les pratiques et les discours des uns et des autres : les touristes
nationaux, qui viennent de la capitale ou des grandes cités (Tunis et Sfax par exemple
en Tunisie, Le Caire et Alexandrie par exemple en Égypte), adoptent la même palette de
comportements en situation de visite touristique que les touristes internationaux,
européens en général. On pourrait se figurer un code de pratique mondialisé. Quel est
donc le propos ou l’intention de cet éthos commun ? Je dirais la découverte de
nouvelles situations et, quitte à placer le tourisme sous le signe de l’entertainment, la
découverte de nouvelles émotions. Ce qui trahit le plus la déception d’un touriste est un
laconique « Ouais... ça ressemble quand même pas mal à [...] » du déjà-vu.
18 Les émotions esthétiques évoluent cependant : en deux mots, même si cela n'est jamais
aussi net qu'objectivé par l'écrit, on privilégie aujourd'hui moins le pittoresque que
l'authenticité, en Tunisie comme en Égypte. Si une quête de pittoresque se satisfait
d’une récréation ou recréation du local18, la quête de l’authentique exige un accès direct
et vrai à la « culture locale » et son praticien se récrie s’il sent l’artifice19. On devine une
ligne de fracture entre tourisme classique et culturel ; on ne peut cependant évoquer
l’un sans l’autre, car la posture « tourisme culturel », d’une part, ne vient finalement
que se surajouter à celle du « tourisme traditionnel » et, d'autre part, n'existe que pour
s'en démarquer (ou s'y opposer). Le phénomène du tourisme culturel ne se comprend
qu'à l'intérieur de ce dialogisme. Les touristes qui s'en réclament aimeraient
idéalement ne pas être pris pour des touristes et l'opposition entre les catégories
« tourisme culturel » et « tourisme de masse » reprend parfaitement celle soulignée par
Jean-Didier Urbain (1993) entre voyageur et touriste. L'objet du désir touristique est
abstrait et toujours vague : une « autre culture » ; c'est souvent une fois sur place que
l'on ajuste (ou pas) son regard en donnant corps à un ensemble d'images
« préexistantes ». Des touristes kabyles algériens viennent voir ce qu’est cette
mythique Siwa, le phare oriental de la tamazgha, l’espace géographique berbère nord-
africain : ils y vérifient que leur langue leur permet, après quelques ajustements, de
communiquer avec la société indigène, si loin de chez eux et jusque-là, en Égypte, au
pied de temples pharaoniques. Des touristes européens viennent vérifier une
représentation préalablement formée des oasis, celle d’un « Tintin au pays de l’or noir »
qui en fixa les couleurs et une forme épurée : quelques dattiers verts et une flaque d’eau
bleue entourés d’une immensité de sables jaunes. Est-ce cela l’oasis ? La palmeraie est
réelle dans les catalogues des agences de tourisme avant de l’être par l’expérience.
L’image, le signe et ses connotations, précède le vécu local de nos touristes et est
transportée dans les sacs de voyage. Pour que les voyageurs au Jérid retrouvent dans le
paysage qui les environne la reproduction de l’oasis déjà vue, un ajustement est
nécessaire : en général, la question porte sur la « nature naturelle » de la palmeraie
(Battesti 2005). L’oasis devrait être une vaste forêt sauvage de palmiers qui procure aux
habitants de ces contrées heureuses eau et fruits à volonté. Les agences de voyages et
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
481
les guides locaux complaisants peuvent d’ailleurs entretenir ce glissement d’une
acception géographique à une acception figurée de petit éden terrestre20.
19 Cette représentation d’une vie primitive mais heureuse qui évacue la qualité première
de la palmeraie donnée par ses habitants (un terroir intensivement travaillé, cultivé)
est renforcée par la pratique spatiale habituelle des touristes : le circuit en calèche
n’offre, au-dessus des palissades de palmes qui protègent chaque jardin, que le
spectacle de la luxuriance des dattiers. Les touristes ne se voient que rarement invités à
passer le seuil d’un jardin, toujours propriété privée. Quand bien même, la compétence
à la lecture des cartes, bien partagée entre touristes, n’est pas celle à la lecture de
l’espace oasien, de ses jardins dont les limites et les marques de propriétés, les signes
d’appropriation ou de déprise agricole ne sont pas toujours identifiables ou même
apparents au béotien, aussi « culturel » soit le tourisme dont il se revendique. À Siwa, le
responsable du syndicat d’initiative sait par expérience qu’aux touristes qui lui
demandent « où est l’oasis ? » — même s’il leur dit encore parfois, sans grand succès,
qu’ils y sont déjà —, il doit répondre « Fatnas » pour les contenter. C’est un lieu-dit, une
presqu’île entourée des eaux salées de la sebkha et irriguée par une source antique. Les
jardins y sont transformés en cafés fleuris et proposent la vue idéale pour le sunset (en
anglais dans le texte) : « Les jardins sont beaux, il y a des sources, des fruitiers, des
dattiers, une vraie oasis »21. Le lieu est maintenant orthographié Fantasy Island sur les
plans touristiques (presque une anagramme). Est alors oublié ou ignoré le savoir-faire,
forgé par l’expérience de nombreuses générations, et la somme considérable de travail
que représente le fonctionnement des oasis d’Afrique du Nord.
20 Le succès d’une oasis à « nature naturelle » s’explique en partie par une histoire du
paysage européanocentrée : « La genèse de la campagne comme cadre social idyllique
résulte du long processus de disparition progressive du prolétariat rural [...] à partir de
la deuxième moitié du XIXe siècle » (Chamboredon 1985 : 141). La campagne ne peut
être perçue comme un espace naturel qu’avec l’accomplissement d’un mécanisme de
neutralisation (par dépolitisation et homogénéisation) qui efface les oppositions
sociales et les contradictions historiques incarnées dans l’organisation spatiale et les
pratiques. Ensuite et alors, la « nature dé-socialisée » peut apparaître comme « le lieu
d’une vie soumise aux rythmes naturels, l’asile d’une civilisation traditionnelle, le cadre
d’un contact direct avec une transcendance (esthétique ou religieuse) » (ibid. : 142). Du
moment où les touristes européens des oasis ne voient pas davantage là que chez eux
l’évidence (pour un regard local) de l’iniquité sociale de la répartition des ressources
(terre, eau, main- d’œuvre) inscrite dans le paysage de la palmeraie, ces terres agricoles
peuvent sans heurts se changer en nature et « paysage naturalisé ». Ce quiproquo
s’amplifie encore avec le tourisme culturel pour lequel les « indigènes » sont a priori en
harmonie (écologique et spirituelle) avec la nature.
21 Un second point concernant les émotions esthétiques : le regard. Porté sur ce qui nous
entoure, source d’informations, d’émotions, il n’est qu’un des cinq sens dont l’humain
est habituellement pourvu, mais « la vue domine » cependant dans la hiérarchie
contemporaine et occidentale des sens et dans la balance établie entre eux, cela à plus
d’un titre. Non seulement ce regard des touristes est un « regard équipé » (la vision du
terroir et l’esthétique de la nature sont toutes différentes de la norme oasienne locale),
mais la pondération est très largement en sa faveur dans l’évaluation esthétique. On est
touriste pour venir « voir », pour contempler, pour enregistrer des témoignages visuels
(mémoire, photographie ou vidéo). L’idée du panorama, d’un paysage observé depuis
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
482
un point élevé demeure l’illustration « idéale typique » du rapport à son
environnement dans les pratiques touristiques. « Le processus fondamental des temps
modernes, c’est la conquête du monde en tant qu’image » (Heidegger 1946) et le
tourisme en est sûrement un accomplissement. L’arrêt touristique sur les « points de
vue » est une réification de la mise à distance, de la conquête et de l’appréciation du
monde : pas un touriste n’y échappe. Au Jérid, à Tozeur, c’est le petit promontoire du
Belvédère22 qui offre ce point de vue, une butte de terres issues du curage des sources
(aujourd’hui taries pour cause de surexploitation), à Nefta, c’est le sommet de la
corbeille des sources où se sont installés des cafés pour les touristes ; l’entreprise
Aéroasis propose aussi des excursions aériennes en montgolfière au départ de Tozeur23.
À Siwa, ce sont les inselbergs qui offrent la possibilité de dominer du regard l’oasis. La
pratique touristique contemporaine veut que les jardins (ou la palmeraie, quand les
jardins ne sont pas vus comme tels) s’apprécient bien mieux regardés de loin : à la fois
parce que cette distance tranquillise l’inquiétude de la promiscuité d’une altérité mal
définie (qui sont ces oasiens qui me regardent comme un(e) touriste ?) et parce qu’il
s’agit d’un acquis de la modernité permettant une forme de maîtrise de son
environnement.
22 Au XVIIIe siècle en Europe (Mantion 1995), les traités savants sur les jardins mettent les
jardins potagers ou « utiles » à l’écart des « beaux jardins ». Le beau jardin, pour se
rapprocher des beaux-arts, se limite à l’architecture et pour combler le « bon goût » ne
doit solliciter que la vue, devenue alors le sens « le plus subtil », en délaissant l’odorat,
le goût, le toucher, l’ouïe. Le regard est le premier instrument d’une exploitation de son
environnent. Ce qui sera corrigé, avec le tourisme culturel, n’est pas la prééminence du
sens de la vue, mais son dessein : on passe de la domination (exploitation) à la
protection. On peut parler de « correction », car l’affiliation entre les deux modes reste
étroite : d’une part, le regard conserve son rôle de mise à distance entre sujet et objet
et, d’autre part, ces deux modes24 demeurent deux figures du contrôle où l’homme se
place comme maître de la nature, où nature et société sont soumis à une séparation
radicale.
Confrontation des émotions esthétiques locales et touristiques
23 L’espace de l’oasis est vécu tout différemment par les oasiens. J’illustrerai cette
divergence par le désintérêt local pour la contemplation solitaire et dominante des
points de vue à Siwa à l’avantage d’une sociabilité de jardin ; par la perception locale au
Jérid du jardin, de l’intérieur, en montrant que sa dimension anthropique est
parfaitement assimilée dans les pratiques et finalement les émotions esthétiques (la
balance des sens est différente, favorisant les sens de la proximité).
24 Lors d’une enquête de terrain à Siwa, je notais deux étonnements croisés : celui
d’Abdou, un guide touristique siwi, pour la curieuse propension des touristes à aimer et
même rechercher des points de vue depuis les hauteurs et le mien à ne jamais voir les
gens de Siwa grimper au sommet des reliefs de l’oasis (Battesti 2006b). Les inselbergs des
anciens villages de Siwa et d’Aghurmi et ceux non bâtis de Dakrur ou d’Adrar Amellal
permettent des vues panoramiques sur la région. Si ces « montagnes » (« adrar » en
tasiwit) ont bien valeur locale de repères géographiques avec des toponymes connus de
la plupart, il n’y a bien que les Européens pour y grimper. « Les touristes aiment bien
regarder d’en haut. Les gens de Siwa, pour quoi le feraient-ils ? Moi, ce que je vois de là-
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
483
haut, je le connais déjà d’en bas »25. De fait, c’est au niveau du sol et en se déplaçant que
mes interlocuteurs isiwan éprouvent ce plaisir largement partagé à nommer les
espaces : non depuis une position dominante, mais d’en bas, par le parcours. C’est une
opposition contemporaine sur les points de vues entre touristes et Isiwan26.
25 Apprécier le jardin des palmeraies anciennes au Jérid, c’est consommer et
communiquer ensemble. Le jardin est un centre où les constructions de l’espace
entourent le jardinier, un centre intime et pourtant partagé. Des réunions masculines
s’y tiennent, occasions de transgressions verbales certes (politique, police, sexualité),
mais aussi d’échanges des savoirs. Les normes esthétiques se communiquent, les
connaissances se transmettent : on écoute, on se souvient de récits, des histoires
locales. Une partie de l’existence collective se joue là (Battesti & Puig 1999). Au
contraire, l’oasis représente pour le touriste un décor, un paysage exotique et
dépaysant qui lui est absolument extérieur. La seule approche en surplomb ne suffit
cependant plus à une partie des touristes. La recherche d’« authenticité » l’engage à lire
non seulement la palmeraie comme une « nature naturelle » (à sous-évaluer son
caractère anthropique), mais aussi à lire les sociétés oasiennes comme immergées dans
cette nature (une nature enchantée). Par ailleurs, la volonté est ostensible chez les
touristes en oasis de préserver ce qui fait cette différence perçue entre soi et cet
« autre » et, équipés d’un relativisme culturel, de mieux comprendre cette altérité.
Cette démarche qui veut saisir ce qu’il y a de plus « authentique » dans la société locale
rencontrée, en resserrant l’attention sur ce qui semble « traditionnel » ou ancien (de
vieille tradition), induit une réduction folkloriste.
Sortir des sentiers battus touristiques : trouver le traditionnel
26 Tous les touristes emprunts d’une posture culturelle évaluent positivement
l’expérience d’un « vrai » mariage, d’une « vraie » fête musicale des jeunes travailleurs
enivrés sous les palmiers, d’une « vraie » séance de désenvoûte- ment (l’appréciation
s’exprime en termes d’émotions et de connaissances). Le partage entre touristes se
marquera par le zèle variable de chacun à quitter « les sentiers battus », à se mettre
dans une position d’inconfort, à affronter cette angoisse existentielle ressentie quand
on délaisse le confort d’une « attitude naturelle » où domine l’évidence que l’on partage
les mêmes normes avec les autres, l’évidence d’une culture partagée sur l’essentiel. Ce
qui est probablement mis en jeu, c’est sa « sécurité ontologique » (Giddens 1994), ce
sentiment d’être dans une relation sûre avec soi et avec le monde. Cette « prise de
risque » confère alors le goût d’une petite aventure dont on est le héros. Quel est
l’enjeu ? Du vrai, de l’authentique. « L’authenticité » s’impose comme le maître mot de
la quête touristique contemporaine qui ne se satisfait pas d’une offre de nouveaux
paysages, mais réclame aussi la possibilité de penser à des manières de vivre
alternatives. Ces alternatives, pour être lisibles, doivent correspondre à des
présupposés dont certains revivifient des définitions fondatrices ; d’abord la rupture
entre modernité (des touristes) et tradition (du local), puis la rupture entre société et
nature chez le touriste et l’imbrication incestueuse des deux mondes chez l’indigène. Il
importe peu, à vrai dire, que cela corresponde à des éléments locaux de discours ou de
pratiques : on vient d’abord vérifier ce que l’on sait déjà : que la modernité n’a pas
encore et va peut-être venir perturber (vision enchantée) ou est venue perturber
(vision désenchantée) la vie oasienne. Les tenants de l’option désenchantée se
retrouvent massivement chez les Européens prompts au tourisme culturel : un
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
484
scepticisme leur est nécessaire pour distinguer ce qui est authentique de ce qui ne l’est
pas ; la pacotille est réservée ou plutôt délaissée au tourisme de masse (fausse dune,
faux désert, faux berbères, fausse palmeraie, fausse tente berbère, faux repas local, faux
amis, fausse ambiance, fausse... authenticité).
27 L’idée partagée qui prévaut est que le choc modernité/tradition détruit une harmonie
originelle. Un court article sur Tozeur paru dans le Monde diplomatique (Llena 2004) est
exemplaire à cet égard d’un type d’assignation identitaire à rester « authentique » : son
dernier paragraphe souligne que « malgré les préceptes fondamentaux de l’islam, une
partie de cette population déstructurée s’adonne à l’alcool pour oublier qu’elle a vendu
son âme et sa palmeraie. C’est d’ailleurs dans la palmeraie même que se regroupent les
buveurs, à l’abri des regards [...] ». Les oasiens du Jérid n’ont pas attendu le tourisme
pour boire joyeusement sous les palmiers ; par ailleurs on ne comprend guère pourquoi
la population locale, parfois certes épicurienne, devrait se plier à ce que l’auteur
considère relever du bon respect des codes religieux et des « préceptes fondamentaux
de l’islam ». Ces buveurs de qashem (sève de palmier fermentée) de la palmeraie,
souvent des hommes d’âge mûr, sont précisément les premiers à vilipender les buveurs
(de bière et de vin) de la ville, souvent des jeunes gens (probablement ceux visés par
l’article), désignés comme « clochards ». L’engagement critique d’un acteur du
tourisme culturel (une façon de connivence avec le « local authentique ») conduit à une
critique morale de la corruption des « peuples autochtones de la palmeraie » (ibid.)
provoquée par le tourisme international, un classique : pour le dire de façon plus
globalisée, la construction de l’altérité, à l’échelle planétaire, est indissociable de
l’assignation de places dans l’ordre mondial identitaire (Cunin & Hernandez 2007),
assignation plus ou moins autoritaire.
Transformer par et pour eux : interaction etrétroactions du tourisme avec la population locale
Tradition locale
28 La demande culturelle, émanant à l’évidence des touristes, est décodée in situ par
différents acteurs locaux, du petit entreprenariat individuel aux institutions
administratives dont les initiatives pour y répondre conduisent à créer et proposer une
tradition locale. Ces propositions sont présentes dans les discours (en particulier sur les
questions d’identité : être berbère ou non, par exemple), dans les pratiques
(notamment artisanales, musicales, culinaires, agricoles ou rituelles comme les
mariages) ou dans le cadre environnemental (transformation de l’architecture,
recréation d’un paysage urbain traditionnel, redéfinition fonctionnelle des jardins).
Elles viennent parfois devancer la demande à considérer que des institutions ou des
individus imaginent des produits qui « devraient » plaire à une attente culturelle
supposée, elle la devance toujours à considérer que l’attente a été formulée par un
touriste qui n’en sera pas le bénéficiaire (il sera déjà reparti, remplacé probablement
par un « semblable »). Dans le discours des acteurs locaux, cela se traduit par « ce que
les touristes veulent, c’est [...] », au choix et les plus cités sont « la nature », « les
coutumes », « la tranquillité ». Toute proposition de produits touristiques se conforme
sans doute à ce jeu marchand, mais la difficulté est accrue dans le cas du tourisme
culturel, puisque celui qui s’y prête souhaite généralement se distinguer du tourisme
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
485
vulgaire. Pour des touristes venus découvrir la vérité nue et authentique en terres
qu’ils aimeraient vierges, ce n’est pas un maigre paradoxe que de se voir proposer un
produit préparé à l’avance et à leur intention. Curieusement, cela n’est pas que source
d’insatisfaction.
Interface
29 Dans les interactions interindividuelles, en discutant avec des enfants et adolescents de
la région qui ne manquent pas d’aller à leur rencontre, en échangeant avec des
professionnels et occasionnels de l’interface touristique, les touristes transmettent
leurs idées et leurs pratiques de l’oasis. Les banals palmiers du quotidien ne seront plus
regardés de la même manière, ils deviennent une ressource exotique, les insignifiantes
dunes de sables se parent d’une chatoyante nouvelle aura de sens... Jusqu’alors, dans les
intérieurs locaux, sont accrochées de grandes reproductions de l’exotisme local : les
forêts de montagnes suisses enneigées. Le paysage est « toujours le produit d’un regard
“étranger” au lieu, dégagé en quelque sorte » ; un homme du lieu « serait vis-à-vis de
son “paysage” comme l’ignorant selon Socrate : ce qu’il ne voit pas (un paysage
justement), il ne sait même pas qu’il ne le voit pas. Il faudrait qu’on lui fasse voir (que
c’est un paysage) » (Lenclud 1995 : 14). Et les oasiens apprennent, pour certains, à voir
ce qu’ils ne voyaient pas, à rééquiper leur regard de nouvelles ressources, d’une
nouvelle grille de lecture de leur environnement naturel et culturel. Tous les oasiens ?
Au Jérid comme à Siwa, les autorités interdisent les « faux guides » et tout contact avec
les touristes au profit de ceux formés ou accrédités par l’État, mais surtout, et en
réalité, entre visiteurs et population locale, une interface fait tampon, largement
constituée de jeunes oasiens de sexe masculin (Battesti 2005 ; Puig 2000, 2003).
30 La pratique du tourisme dans sa version culturelle se caractérise par la recherche du
contact avec l’indigène. Les touristes s’y prêtant ne rencontreront évidemment que
ceux disposés à les rencontrer ou désignés implicitement pour jouer le rôle médiateur.
La séparation des sexes, classique en Afrique du Nord et au Proche-Orient, est
fortement marquée dans ces oasis : aux femmes l’espace domestique, aux hommes le
public et donc la gestion de l’altérité. Par ailleurs, les jeunes célibataires jouissent d’un
effet de classe d’âge qui les autorisent implicitement, au Jérid comme à Siwa, à
expérimenter la vie : une sorte de licence temporaire de licence (tout rentrera dans
l’ordre avec les fiançailles et le mariage). À Siwa, la structuration par l’âge est si forte
que cette classe de jeunes célibataires (zaggala) vivait jusqu’au début du XXe siècle hors
les murs de la cité et est toujours la classe laborieuse des palmeraies. Le contact avec les
étrangers, ces curieux touristes, inclut un risque (pour l’honneur, pour les bonnes
mœurs) auquel peuvent se frotter des jeunes qui apprennent la vie. Il ne sied pas, par
exemple, aux adultes isiwan d’être au café fréquenté par les touristes.
31 Affluence oblige, probablement, l’interface est plus institutionnalisée et structurée au
Jérid et se nomme elle-même beznêsa. Elle y est aussi plus contrainte par le paradoxe
d’attentes contraires. Cette interface ne conserve en son sein que les plus motivés d’une
classe d’âge à résoudre ses frustrations (sexuelles, pécuniaires, d’expatriation) par le
contact interculturel : l’Autre étranger est l’incarnation de ce qu’ils désirent, une vie
meilleure ne peut prendre corps et réalité dans ce temps et cet espace oasiens. L’oasis
médiatise pour eux la non-modernité, l’archaïsme et s’ils lui consacrent un regard, ce
n’est plus comme cadre de vie et de travail, mais comme objet touristique qui a rapport
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
486
à l’exotisme, au folklore. Le paradoxe est que l’attente est toute contraire pour la classe
de touristes qui rencontrera ces beznêsa : cette classe des touristes les plus motivés à la
rencontre interculturelle ne cherche pas à fuir l’oasis, ni son « archaïsme », mais à s’y
plonger pour trouver une « culture ancestrale » adaptée, communiant avec la nature. À
Siwa, la fréquentation touristique est plus faible, la surface d’échange également, mais
les jeunes garçons s’appuient aussi plus solidement sur ce qu’ils perçoivent comme leur
identité, ils vivent aussi dans une sécurité ontologique plus forte : l’évidence d’être à sa
place, ce qui laisse l’étranger finalement dans une position peu enviée. On est curieux
d’apprendre sur le monde, mais son centre reste Siwa et peu désirent s’exiler de leur
normalité oasienne, tandis que du coté tunisien les enjeux sont plus orientés sur les
échanges (ils ne s’appellent pas eux-mêmes beznês pour rien). Dans tous les cas, la
dimension marchande n’est jamais loin (artisanat local et service de visites guidées),
l’intérêt sexuel non plus (le Jérid et Siwa sont deux régions réputées pour leur pratique
de l’homosexualité — une forme de tourisme s’en arrange parfaitement).
32 Le prétexte de la rencontre reste cependant la culture : ou plutôt la tradition locale. Si
la notion est délicate à manier, c’est une catégorie doublement locale : reconnue par les
oasiens et les touristes. Au Jérid, cette tradition se dit ‘adât wa taqâlîd, les us et
coutumes, et renvoie à un ensemble de traits mis en avant pour expliquer la spécificité
culturelle du lieu, à un corpus hétéroclite de pratiques et de discours, mais qui ont pour
point commun une référence au temps long du bikri, l’autrefois, l’immuable passé. Les
faits de la tradition sont non datés, intemporels (Battesti 2000). Les oasiens de Siwa
allèguent aujourd’hui une identité culturelle dont ils commencent à réaliser la portée
singulière dans un contexte national et international (ils se découvrent « berbères »,
par exemple, en plus d’être isiwan). Le discours sur un âge d’or (où la tradition
s’imposait, stable et parfaite) est partout présent, mais quand c’est la modernité qui est
accusée d’avoir fait sombrer ces temps heureux et que ce sont des opérateurs de cette
modernité (acteurs étatiques et touristes) qui brandissent l’identité culturelle locale
comme susceptible de patrimonialisation, pour les oasiens, c’est ajouter à l’aliénation
de leurs ressources naturelles celle de leurs ressources culturelles.
Transformer l'espace pour accueillir un touriste en quête de culture
33 En général, l’exploitation des lieux par le tourisme culturel est moins technique
qu’idéologique, mais les transformations matérielles des oasis ne sont pas à négliger.
34 Nous passerons sur toute l’infrastructure hôtelière classique, plus importante au Jérid
qu’à Siwa, qui préexiste au tourisme culturel. Délaissant la cohorte des grands hôtels
climatisés avec piscines, un Tozeur Golf Oasis flambant neuf27 ou un improbable hôtel
cinq étoiles construit par l’armée dans son complexe olympique (sic) à Siwa, le tourisme
culturel saharien s’intéresse à la culture locale non pour sa seule qualité de décor28,
mais de corps vivant avec lequel interagir, sans le transformer, sans l’altérer pour
autant. Un sondage du Siwa Protected Area Management Unit29, résumé ici à grands
traits, confirme le souhait des touristes : que rien ne change dans l’oasis30, sa
préservation de mauvaises évolutions, la conservation de sa culture et sa nature, la
limitation de l’hôtellerie, l’interdiction d’aéroport, mais de meilleurs guides (en langues
européennes) pour mieux comprendre les commentaires sur la vie locale. La nature est
plébiscitée et la motivation du voyage est la culture (l’archéologie également)31. À
l’évidence, les touristes qui se déplacent jusqu’au Jérid ou à Siwa ne viennent pas
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
487
intentionnellement transformer le paysage oasien dans sa dimension matérielle,
puisqu’au contraire le premier souci est d’y trouver vivant un passé préservé.
L’éloignement géographique, la difficulté d’accès deviennent même des gages de
« préservation » naturelle et culturelle. L’oasis par définition est l’emblème du point
reculé, mais dans cette classe du tourisme saharien, plus l’accès est difficile (Siwa par
rapport au Jérid, par exemple), moins la fréquentation d’un tourisme de masse par
voyagiste est élevée et plus la place semble conforme à une pratique de tourisme
culturel.
« En bus, comptez 12 h de transport à partir du Caire [...]. Rien du tout sur les 300km qui séparent Marsa-Matrouh [...] de l’oasis. Ici, pas de grandes infrastructurestouristiques, pas de Hilton, pas de HSBC, pas de MacDonald’s, pas d’aéroport, maisdes palmiers, des dunes, et des ânes [...]. C’est encore un endroit préservé,littéralement au milieu de nulle part »32.
35 Préservation, éloignement : aussi « culturels » puissent être les touristes désireux
d’authenticité, ils transforment néanmoins le paysage oasien de façon directe et active
en répandant dans les oasis de nouvelles manières de penser sa relation à
l’environnement, de penser le monde, sa vie parfois aussi, mais de façon également
indirecte et passive par les infrastructures et services organisés pour les accueillir.
36 À Nefta, seconde agglomération et destination touristique du Jérid, l’ancienne
« corbeille des sources » — morte depuis que les forages étatiques ont drastiquement
fait baissé le niveau d’eau souterrain en permettant (provisoirement, on le sait)
d’accroître les surfaces cultivées —, a été remise en eaux. Ce n’est pas du ressort de la
préservation : l’ancien système d’adduction d’eau à l’air libre avait été enterré dans des
conduites en ciment dans les années 1970. C’est une re-création, évidemment pas à
l’identique, de l’ancien système pour le superposer aux modernes canalisations : un
simulacre. Un bassin ovoïde a été construit dans la corbeille (et surnommé besîn
lahthem, piscine œuf, par les habitants) et de nouveaux forages y ont été percés33 pour
réalimenter le lit sec des oueds. Le résultat escompté est un réenchantement visuel de
l’oasis visant la satisfaction esthétique des touristes : redonner au terroir de Nefta des
attributs de palmeraie oasienne, que l’eau coule à nouveau dans ses veines. On peut
parler d’une forme de patrimonia- lisation par la municipalité du terroir oasien à des
fins touristiques qui choisit un élément comme signifiant de la palmeraie d’oasis (il ne
l’est pas par nature ou de droit) et le reconstruit tel qu’il devrait être (et non pas tel
qu’il était). Ce choix s’est porté à Nefta sur son oued ; il aurait pu aussi bien se porter
sur le tafsîl, dessin complexe des planches de culture dans les jardins. D’autres cas sont
mieux documentés dans le domaine architectural.
37 Le bâti a l’avantage sur la palmeraie d’être la preuve d’un génie local et non pas d’une
nature providentielle. Il est donc largement sollicité par le tourisme et par les
promoteurs d’une identité locale à destination du tourisme. Al-Hadawif est
probablement la partie la plus admirable de la vieille ville de Tozeur34, mais d’autres
parties non moins anciennes (Zebda, par exemple) font appel à d’autres techniques que
ce type de décors géométriques de briquetage des façades extérieures des maisons
(Puig 2000). Le choix s’est arrêté sur cette brique jaune devenue le caractère
authentique de l’habitat traditionnel : l’ensemble du bâti est maintenant harmonisé, la
brique a été reproduite à une échelle quasi industrielle à en couvrir des murs qui ne la
connaissaient pas mais qui restaient visibles depuis l’avenue qu’empruntent les
touristes... La brique est bien (devenue) l’élément fondamental du décor de Tozeur. En
Tunisie comme en Égypte, les préceptes du marketing semblent acquis : définir l’identité
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
488
visuelle la plus simple possible. À Tozeur, un architecte parlait d’une « folklorisation de
l’espace » à l’aube de ce phénomène (Abachi 1991) pour noter plus tard le refus des
habitants de s’investir dans ce type d’expression de leur identité : « La volonté
municipale [“de revalorisation esthétique”] se heurte cependant au désir de se
singulariser chez les riverains » (ibid. 2000). À cela, un habitant de Siwa répondait :
« Pourquoi faire tous nos maisons de la même couleur bia’a [environnement] ? »
(Battesti 2006a).
38 Il s’agit bien d’un décor mis en place à Tozeur ; à Siwa également où ce que l’on appelle
« couleur environnement » est la couleur d’un habitat en désuétude. Deux décennies
ont suffi pour que Siwa soit témoin de changements radicaux dans l’organisation de son
habitat : les deux villages fortifiés sur des inselbergs (ksour) ne sont plus habités, leurs
habitations d’argile salée ont littéralement fondu et l’habitat nouveau s’est étalé à leur
pied en se ramifiant dans la palmeraie ou ses entours. Dans un premier temps,
l’ancienne technique à base de tlaght (l’argile salée) s’est maintenue, mais s’y est
rapidement substituée, à partir des années 1980, une architecture à base de moellons
pleins et blancs en gypse calcaire équarri (tiré du plateau proche), adaptée à un habitat
étalé, peu dispendieux et rapidement construit (en perdant en revanche les qualités
thermiques et acoustiques de l’argile). Cependant, de nouveaux promoteurs politiques
et commerciaux de la tradition, comme à Nefta ou à Tozeur, ont choisi l’ancienne
architecture de couleur argileuse pour identité visuelle de Siwa. Cela écarte d’une part
d’autres choix possibles d’« icône » de la culture de Siwa et, d’autre part, le choix que la
communauté locale semblait de facto avoir fait en faveur du gypse calcaire blanc. Le
gouvernement régional souhaite néanmoins imposer le cachet traditionnel, clairement
pour le tourisme : son habitation doit obligatoirement, sinon être construite en argile,
s’en couvrir pour harmoniser la couleur ocre « naturel » du paysage urbain35 pour
présenter l’image d’une tradition homogène, lisse et non évolutive.
39 Le choix est-il approprié aux attentes des praticiens d’un tourisme culturel ? Si le
gouvernorat souhaitait les anticiper, il est cependant malaisé de répondre à cette
question : le paysage oasien est à l’évidence façonné pour le tourisme, pour lui
complaire et le satisfaire (les Isiwan ou les Jeridi le disent clairement) ; ces
aménagements pourraient dans un sens satisfaire les touristes à la recherche d’une
« expérience culturelle », mais ceux-là sont ceux dont le maître mot est authenticité.
Autrement dit, cela peut fonctionner tant que ce réaménagement de l’espace pour le
tourisme, au Jérid ou à Siwa, reste du domaine du subterfuge réussi, que les touristes
n’en ont pas conscience. La frontière est étroite entre un parc d’attraction — fut-il un
espace oasien — et une réalité culturelle remaniée pour être authentique. Par ailleurs,
les habitants ne sont pas toujours prompts à jouer les figurants d’une machine
marketing.
« Ils veulent que l’on retourne dans des maisons comme avant : ce ne sont pas euxqui se lèvent la nuit quand il pleut pour aller réparer les fuites d’eau ! » (Omar,Siwa, 20 mars 2005).
Comment s'en arrangent les oasiens
40 Quand l’objet du désir touristique est le paysage oasien, il suffit finalement de trouver
un bon point de vue. Quand l’objet du désir touristique est la culture de l’autre, cela se
complique, car il faut alors « interagir » avec cet autre. Comment ces « autres »
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
489
s’accommodent-ils de la quête culturelle du tourisme contemporain, comment
l’interprètent-ils ?
41 En introduction, je souligne qu’on ne peut opposer des « touristes culturels » à des
touristes qui ne le seraient pas : il s’agit surtout d’un zèle à mettre en œuvre un type de
registre de pratiques touristiques. Cette nuance est bien comprise des petits opérateurs
informels touristiques, plus encore au Jérid qu’à Siwa. Un de mes jeunes informateurs à
Tozeur avait pour compliment préféré à l’adresse de touristes qui manifestaient un tant
soit peu de velléités à sortir des sentiers battus : « Ah, vous au moins, vous n’êtes pas
comme les autres, vous n’êtes pas des Bidochon ! » Sans être certain qu’il ait lu les
albums de Christian Binet36, il maîtrise au moins cette compétence à manipuler le
registre de la critique d’une forme de tourisme, disons-le, qui va flatter ses
interlocuteurs. À partir de là, il n’est pas étonnant d’entendre des jeunes Jeridi engager
de jolies touristes à apprécier la traditionnelle hospitalité berbère en allant boire le
traditionnel vin de palme la nuit dans les jardins traditionnels... Se laissera convaincre
qui voudra. Le motif « berbère » ne vient pas là par hasard : il est recherché par une
catégorie de touristes et les beznêsa jugent qu’il est dans leur intérêt de les satisfaire
(Battesti 2005). Les oasiens s’arrangeant du désir des touristes, une véritable contagion
de berbérité (artisanat, excursions, restauration, etc.) s’est emparée du Jérid depuis une
quinzaine d’années. Le caractère porteur (en direction des touristes) du marché de la
revendication identitaire berbère s’est confirmé. Bien sûr, il se cantonne aux franges de
la société parcourue par le tourisme, mais le fait est indéniable37. Cet accommodement
avec la réalité sociale est en parfaite contradiction au Jérid avec une identité oasienne
contemporaine revendiquant au contraire l’arabité prestigieuse qui la relie à la
révélation et l’éloigne de l’ignorance.
42 Dans le domaine des aménagements d’initiative locale, au Jérid et à Siwa, une idée fut
d’aménager des jardins pour en faire des lieux d’accueil alternatifs aux hôtels pour une
petite clientèle touristique souhaitant sortir du circuit classique. À l’initiative de
propriétaires locaux au Jérid, de vieux jardins se sont convertis en jardins-cafés dans la
palmeraie ancienne. Le tourisme réussit (mais dans une direction différente) là où les
services de l’agriculture avait failli dans leurs nombreuses tentatives de réforme
moder- nisatrice des vieux jardins : davantage de fleurs, de plus grands espaces
consacrés au « non travail », voire disparition de la fonction productive. L’hébergement
sommaire, à Siwa en particulier, est affaire de deux ou trois jours tout au plus (pour ce
que j’en sais) : vivre dans un jardin devient vite problématique pour un touriste (se
nourrir, se laver...) et l’intermédiaire local porte toujours son choix sur des jardins un
peu à l’abandon (garant de tranquillité), voire complètement désolés. Un compromis
plus réussi (en termes de satisfaction pour les touristes, mais aussi pour les autorités
locales) est celui engagé dans un jardin de palmeraie ancienne à Nefta : de type
classique, dense et productif, bien entretenu, le jardin contient également quelques
ruches et deux cabanes aménagées aux vérandas de roseaux agrémentées de
nombreuses fleurs (roses, jasmins...). Ce cadre très agréable a poussé un Français du
secteur touristique à leur proposer de réfléchir à l’accueil de clients. Ce premier contact
professionnel fut l’occasion de décoder les attentes d’un tourisme culturel. Ils
ajoutèrent vite eux-mêmes une fonction de « camping » et commencèrent alors à
accueillir quelques groupes (Battesti 2005). De nombreuses tentatives plus ou moins
fructueuses ont depuis vu le jour à Nefta en particulier.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
490
43 À Siwa, quelques exemples comme l’hôtel Taziri Resort ou l’Ecolodge de la société EQI38
(inspiration du premier), tous deux conçus hors de Siwa, tentent de concilier ressources
locales et attentes culturelles du tourisme en participant à l’élaboration de ce que doit
être le style traditionnel. Ces arrangements sont délicats et manier ces concepts
requiert une compétence. Voyons le cas d’un habitant de Siwa, employé et petit
entrepreneur du secteur touristique, très souvent engagé dans des interactions avec les
touristes. Il envisage d’établir un restaurant de cuisine traditionnelle dans un jardin de
palmeraie. Pour le bâtiment, « je veux faire traditionnel, mais pas comme ici, car ça
coûte beaucoup d’argent. Je vais tout faire en bois de palmier et d’olivier ». Il m’en
montre des modèles en feuilletant un magazine anglais illustré de maisons/chalets/
bungalows nordiques en pin. Je cherche à comprendre en lui faisant observer que « ce
n’est pas très “traditionnel” de Siwa », ce à quoi il me répond : « Si, [puisque] je
n’utiliserai que du bois » (Battesti 2006a). Il associe le registre « traditionnel » au
« naturel » (qu’il a très bien identifiés comme demandes dans les discours touristiques).
Si je décode bien de mon côté les attentes d’un tourisme culturel à Siwa, il faudrait que
le style architectural retenu possède une référence évidente au local, qu’il soit perçu
comme... « authentique ».
Satisfaction
44 Inventée (comme toute tradition) et proposée comme un lien vers l’autre, vers
l’étranger non oasien, de façon sincère et/ou intéressée (tentation de l’émigration ou
du commerce sexuel), cette tradition locale vient toujours finalement se présenter
comme une interface et cela à double titre. En effet, la tradition locale, arguons qu’elle
est un objet nouveau inventé (et coproduit ?) pour les besoins de cette connexion entre
demande culturelle touristique et société locale, a souvent pour contrecoup (sans être
autrement fonctionnaliste) de satisfaire assez la demande pour ainsi protéger l’accès à
la société locale : vous en savez assez et de manière satisfaisante pour ne pas chercher
plus loin que l’image lisse et idéale que nous vous en proposons. Les observations
ethnographiques répétées (en particulier à Siwa) laissent en effet penser que
l’approche cognitive habituelle de la « culture locale » par les touristes est établie à
partir de quelques informations élémentaires sur les lieux (communiquées de bouche à
oreille avant le départ), de plus générales lues pendant le trajet et sur place avec les
guides de voyages (Lonely Planet ou Le guide du routard) et d’autres émanant d’ouvrages
plus spécialisés lus sur place. Bref, même dans l’optique d’un tourisme culturel, les
informations sur la société locale sont principalement textuelles et en tout cas ne tirent
pas leur origine d’interactions directes avec des informateurs locaux. Notons qu’à Siwa,
l’ouvrage spécialisé largement mobilisé est celui d’un Siwi, Fathi Malim. Ce best seller
local intitulé Oasis Siwa : from the Inside, Traditions, Customs & Magic39 est apprécié de ses
lecteurs : véritable guide from the inside, il présente une tradition, aussi inventée qu’elle
peut l’être dans certains ouvrages ethnographiques, intemporelle, dégagée des
contingences et lisse. On en sait suffisamment (et certaines anecdotes exotiques
stupéfient assez) pour ne pas avoir à s’enfoncer davantage dans la société locale. Ce qui
est vrai des interfaces humaines, délégation faite à quelques-uns de gérer le contact
avec les étrangers préservant le reste de la population, est vrai des interfaces
discursives : servant de tampon, la tradition ou la culture proposée doit être assez
rassasiante pour laisser la vie locale se dérouler, avec ses hauts et ses bas ; en
particulier dans des sociétés oasiennes très prudes sur la séparation des genres et
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
491
jalouses de leurs intimités domestiques. Par ailleurs, ce qui est recherché en priorité
par les touristes n’est pas toujours la réalité sociale vécue aujourd’hui dans l’oasis, mais
ce qui est « authentique » : ce que cette réalité devrait être si la modernité n’avait pas
tout sali ou les traits authentiques qui se maintiennent (pour l’œil averti) malgré cette
modernité. « Vous savez, la croyance dans les djinns est encore très forte à Siwa ! » 40.
Les deux auteurs locaux « d’interfaces discursives littéraires » sur Siwa, Malim et
Aldumairy, vont dans ce sens : le second écrit dans sa préface « As a native Siwan, I feel
the necessity to chronicle Siwa’s cultural and environmental heritage before the influx
of tourists brings more changes. In this book, I’ve collected useful and accurate
information from different fields for scholars, investors, tourists and local »
(Aldumairy 2005).
45 Les échanges sont cependant réels entre touristes et oasiens, mais les éventuelles
discussions centrées sur les sujets d’intérêt des touristes (en particulier la vie locale et
la différence culturelle : religion, statut des femmes, etc.) suivent un schéma souvent
figé. Cela peut prendre une forme quasi ritualisée avec des professionnels de l’interface
culturelle41. Si, fort classiquement, les discours n’innovent pas et conduisent plutôt les
deux parties à confirmer leurs propres vues, néanmoins une couche de la population
locale se sensibilise petit à petit à une pratique du relativisme culturel.
46 Cette interface discursive sur la tradition et la culture locales n’a pas seulement une
fonction de frontière, mais celle aussi d’être médiatrice, d’être l’écran des projections
des uns et des autres. Ces opérations pratiques de rencontres en oasis doivent peut-être
se mesurer à l’aune de la satisfaction de chacun. Qu’évoquer ? Ali le chauffeur d’un
petit hôtel et Anthony le client dans les dunes de sables autour de Siwa ne s’y trouvent
pas dans le même but, mais partagent quelque chose, différemment, qui les satisfait à
ce moment-là. Il en est de même pour Mohammed musicien d’une troupe
« improvisée » de jeunes jardiniers et ce médecin d’Aix-en-Provence durant une soirée
musicale dans la palmeraie : pour l’un malgré (ou grâce à) l’inadéquation certaine entre
sa technique habituelle de jeu (coupure, respiration, discussions) et le devoir d’un
service à la clientèle touristique, pour l’autre par l’écoute tolérante et curieuse en se
décentrant temporairement de son système de valeur, pour les deux en se positionnant
l’un par rapport à l’autre, se cherchant un peu, se méprenant certainement mais
qu’importe, ils auront trouvé le temps d’une interaction, un modus vivendi acceptable et
dont ils garderont le souvenir. « When the tourist arrives in Siwa, it is everything that
the guidebooks promised » (Raiti 2001: 41).
47 Satisfaction. Un Suisse peut écrire dans la Tribune de Genève (pages voyages), en
revenant des oasis du Jérid :
« Le soir même, un “louage” me mène au Café des Dunes, à 10 kilomètres de Nefta.C’est un petit camp berbère qui vend du Coca et loue des dromadaires. Un quartd’heure sur l’une de ces bestioles m’amène en haut d’une dune. Baigné par lalumière sanguine du soleil couchant, je goûte mes premiers instants de quiétude.Une minute plus tard, des bruits sourds approchent, et cinq véhicules tout-terrainvrombissent autour de moi. Clac les portières. Clic les appareils photos. Tchin,l’apéro est servi. Tout autour, les ventripotents fixent l’horizon trente secondesavec un air pénétré puis ne savent plus quoi faire. Ils se ruent dans leurs 4x4climatisés. Clac les portières. Vroum. Nuages de sable. Silence. Lejeune chamelierme regarde, l’air navré. Dégoûté, je me jure de quitter l’hôtel le lendemain, et departir pour le vrai Sahara » (Montjovent 1999 : 15).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
492
48 Ce texte met en scène son auteur comme le (bon) touriste culturel en sympathie avec le
local et contre les touristes « ventripotents ». Le besoin de connivence est ici évident
(encore une bonne signature de l’éthos du tourisme culturel) : lui, par le truchement du
relativisme, dépasse les « bêtes touristes » et a accès au vrai, à la compréhension du
local. Une certaine compréhension. Le héros de ce voyage passera une semaine seul
avec « un homme d’une cinquantaine d’années, le port altier et le visage noble, [qui]
semble séduit par mon enthousiasme pour le désert. Il s’appelle Ali Ben Sahaid, il est né
et a grandi dans cette immensité en gardant des troupeaux, et semble connaître chaque
dune par son petit nom. Le feeling passe bien », si bien que l’auteur restera persuadé
qu’il a affaire à un Berbère au Jérid : « Les nuits berbères sont magiques. Écouter Ali
parler arabe et chanter avec ses amis bergers rencontrés par hasard sous la Lune, boire
avec eux du lait de chamelle en contemplant les étoiles, allongé dans du sable tiède,
c’est ce qui se rapproche le plus de mon idée du bonheur. »
49 Un autre guide, de Siwa et donc cette fois un Berbère, pourrait lui répondre : « Bah, les
Européens aiment aller dans le désert, s’y asseoir, les espaces vides, ils n’ont pas ça chez
eux. Les Isiwan, pour eux, c’est vide. Il n’y a rien. Ils ont l’habitude. Mais les aganeb
[étrangers], non. Moi, j’aime bien le désert [maintenant]. Pareillement, ce qui m’a
choqué, c’est de voir les femmes se mettre en Bikini [...]. J’ai compris après que ça peut
être normal » (Battesti 2006b).
50 En résulte-t-il des conflits de représentations ? Puisque les acteurs sociaux ont la
capacité (plus ou moins bien partagée) d’apprendre à user de différents registres (lot
quotidien de toute vie sociale), la rencontre mène surtout à ceci : on ne se réforme pas
vraiment, on s’enrichit (éventuellement) de compétences nouvelles.
Préservation culturelle, préservation éco/biologique
« Pour que le tourisme ne devienne pas synonyme d’invasion, nous lançons ungrand appel à tous ceux qui visiteront Siwa. N’oubliez pas que vous êtes des invitésdans l’oasis. À vous de vous adapter et de respecter les coutumes locales [...] » (LeGuide du routard Égypte 2001 : 420).
51 Au-delà des conflits et des oppositions, dans les pratiques ou les discours, entre les
sociétés oasiennes et leurs touristes culturels, il se construit de toute évidence une
sorte de langage commun — une « novlangue »42, si l’on veut se garder d’être trop
angélique. L’un des points d’accord fondamentaux le plus saillant est que les « contenus
culturels » proposés ou recherchés de cette Afrique saharienne semblent dépasser la
simple « tradition » et chercher une actualisation de cette « harmonie authentique »
supposée entre une société locale et son environnement. La pente naturelle semble à ce
jour l’amalgame fait par tous des préoccupations qui tiennent de la préservation
identitaire (diversité culturelle) et d’autres de la préservation éco/biologique
(biodiversité). « Cette place accordée à la diversité et aux singularités des formes de vie
peut rejoindre une attitude culturaliste visant à maintenir la spécificité de peuples et
de traditions » (Lafaye & Thévenot 1993 : 520). La recherche elle-même fait cette
assimilation aujourd’hui : le « développement d’un tourisme naturel et patrimonial
peut permettre, en leur accordant une nouvelle valeur “marchande”, une protection de
la biodiversité, des systèmes de production traditionnels et de la qualité des
paysages »43.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
493
52 Du tourisme pour découvrir la nature des oasis nord-africaines au tourisme pour
atteindre désormais la nature essentielle des communautés oasiennes, la dimension
paysagère ou environnementale reste la constante, alimentée par les imaginaires
transnationaux. Le tourisme culturel tend à diversifier les ressources possibles à
exploiter dans les oasis, mais — et sans y voir là un motif d’insatisfaction des uns et des
autres — il modèle l’oasis à son attente et, à la soif d’authenticité des touristes qui
empruntent une pratique « culturelle », répond une offre, plus ou moins organisée,
mais toujours inscrite dans une forme de dialogue. Cependant, quand cette demande
touche à leur identité, le risque est peut-être pour les populations oasiennes d’avoir de
plus en plus de mal à former leur propre subjectivité en dehors de leur subjectivation
par et pour le tourisme, une problématique qui dépasse le cadre des oasis et même de
l’Afrique (Benabou 2007). Après tout, les oasis ont toujours été des carrefours.
BIBLIOGRAPHIE
ABACHI, F.
1991 Les banlieues perdues ou la ville enfouie : Tozeur, Thèse de doctorat, Tunis, Institut
technologique d’Art, d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis.
2000 « Tozeur refait ses façades : de la construction esthétique d’un espace public », Les Annales de
la recherche urbaine, Paysages en ville, 85 : 89-97.
ALDUMAIRY, A. el-A. A. el-R.
2005 Siwa, Past and Present, Alexandria, Yasso.
BATTESTI, V.
2000 « Les échelles temporelles des oasis du Jérid tunisien », Anthropos, International Review of
Anthropology and Linguistics, 95 (2): 419-432.
2004 « Les oasis du Jérid, des ressources naturelles et idéelles », in M. PICOUËT et al., Environnement
et sociétés rurales en mutation, Approches alternatives, Paris, Éditions IRD (« Latitude, 23 ») : 201-214.
2005 Jardins au désert, évolution des pratiques et savoirs oasiens. Jérid tunisien, Paris, Éditions IRD (« À
travers champs »).
2006a « De l’habitation aux pieds d’argile, des vicissitudes des matériaux et techniques de
construction à Siwa (Égypte) », Journal des Africanistes, Numéro spécial, Sahara : identités et
mutations sociales en objets, 76 (1) : 165-185.
2006b « “Pourquoi j’irais voir d’en haut ce que je connais déjà d’en bas ?” Comprendre l’usage des
espaces dans l’oasis de Siwa », Egypte-Monde arabe, Terrains d’Egypte, anthropologies contemporaines,
3 (3) : 139-179.
BATTESTI, V. & PUIG, N.
1999 « Le sens des lieux. Espaces et pratiques dans les palmeraies du Jérid (Sud- Ouest tunisien) »,
JATBA, Revue d’ethnobiologie, XLI (2) : 19-44.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
494
BENABOU, S.
2007 « Les dimensions socio-culturelles de la mise en écotourisme. Le cas de la réserve de
biosphère Nanda Devi (Himalaya indien) », in A. SELMI & V. HIRTZEL (dir.), Gouverner la nature, Paris,
L’Herne (« Cahiers d’anthropologie sociale ») : 109-121.
BERRY-CHIKHAOUI, I. & DEBOULET, A. (dir.)
2000 Les compétences des citadins dans le monde arabe. Penser, faire et transformer la ville, Paris,
Karthala ; Tours, URBAMA ; Tunis, IRMC.
BINET, C.
1981 Les Bidochon en vacances, Paris, Éditions Audié (« Les Bidochon, 2 »).
1984 Les Bidochon en voyage organisé, Paris, Éditions Audié (« Les Bidochon, 6 »).
BISSON, J.
1995 « Les marges sahariennes : lieux d’affrontement des spatialités », Cahier du Ceres, 12 (« série
Géographique ») : 13-28.
BLANCEL, N. ET AL. (dir.)
2002 Zoos humains. De la vénus hottentote aux reality shows, Paris, Éditions de La Découverte
(« Textes à l’appui »).
BOURDIEU, P.
1979 La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Édition de Minuit (« Le sens commun »).
BUSSON, H., FÈVRE, J. & HAUSER, H.
1910 Notre empire colonial, Paris, Félix Alcan éditeur (« Bibliothèque d’histoire contemporaine »).
CHAMBOREDON, J.-C.
1985 « La “naturalisation” de la campagne : une autre manière de cultiver les “simples” ? », in A.
CADORET (dir.), Protection de la nature, histoire et idéologie : de la nature à l’environnement, Paris,
L’Harmattan : 138-151.
CUNIN, É. & HERNANDEZ, V. A.
2007 « De l’anthropologie de l’autre à la reconnaissance d’une autre anthropologie », Journal des
anthropologues, 110-111 : 9-25.
DAKHLIA, J.
1990 L’oubli de la cité. La mémoire collective à l’épreuve du lignage dans le Jérid tunisien, Paris, Éditions
La Découverte (« Textes à l’appui, série Anthropologie »).
FAKHRY, A.
1990 Siwa Oasis, Cairo, American University in Cairo Press.
GIDDENS, A.
1994 Les conséquences de la modernité, Paris, L’Harmattan (« Théorie sociale contemporaine »).
HEIDEGGER, M.
1946 « Die Zeit des Weltbildes », Holzwege, Conférence du 9 juin 1938 à Fribourg, Francfort-sur-le-
Main, Vittorio Klostermann Verlag : 69-104. [en français : « L’époque des “conceptions du
monde” », in Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, 1962 : 99-146, trad. W. Brokmeier].
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
495
HOSNI, E.
2000 Strategy for Sustainable Tourism Development in the Sahara, Paris, UNESCO.
D’IETEREN, G.
1952 Vacances au Hoggar, un chameau et moi, Paris, Amiot-Dumont ; Chambéry, impr. réunies.
JOSSE, P. (dir.)
2001 Le Guide du routard Égypte, s. l. [Paris], Hachette Tourisme.
LACHENAL, P.
2007 Voir ailleurs si j’y suis... Essai sur la pratique touristique en Égypte, Rapport de stage, Grenoble,
Université Pierre Mendès France.
LAFAYE, C. & THÉVENOT, L.
1993 « Une justification écologique ? Conflits dans l’aménagement de la nature », Revue française
de sociologie, XXXIV (4) : 495-524.
LEHURAUX, L.
1934 Le Sahara, Ses oasis, Alger, Éditions Baconnier, tirage réservé à l’Office algérien d’action
économique et touristique (OFALAC).
LENCLUD, G.
1995 « L’ethnologie et le paysage. Questions sans réponses », in C. VOISENAT (dir.), Paysage au
pluriel : pour une approche ethnologique des paysages, Paris, Maison des sciences de l’Homme, Mission
du patrimoine ethnologique (« Ethnologie de la France, cahier 9 ») : 5-17.
LLENA, C.
2004 « Tozeur, ravagée par le tourisme », Le Monde diplomatique, 604, juillet : 19.
MALIM, F.
2001 Oasis Siwa : From the Inside, Traditions, Customs & Magic, à compte d’auteur.
2003 L’oasis de Siwa, vue de l’intérieur, traditions, coutumes et sorcellerie, Le Caire, à compte d’auteur,
Al Katan.
MANTION, J.-R.
1995 « La terre évaporée, Le jardin en reste(s) », JATBA, revue d’ethnobiologie, 37 (1) : 17-29.
MITCHELL, R.
1995 « Traditional Siwan Music Sold Here »: Authenticity and Tourism in Siwa, Master of Arts Thesis,
Cairo, American University in Cairo.
MONTJOVENT, P.
1999 « Et pourquoi pas le désert à dos de dromadaire ? », Tribune de Genève, 15 juillet (« pages
Escales »).
NASH, D.
1996 Anthropology of Tourism, Kidlington-Tarrytown (N.Y), Pergamon (« Tourism Social Science
series »).
PNUE (PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT)
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
496
2006 Tourisme et Déserts : guide pratique pour gérer les impacts environnementaux et sociaux du tourisme
dans les déserts, s. l., PNUE (World Tourism Organization. Tour Operators’ Initiative for
Sustainable Tourism).
PUIG, N.
2000 « Entre souqs et musées. Territoires touristiques et société oasienne à Tozeur en Tunisie »,
Espaces et sociétés, Tourisme en villes, 100 : 57-80.
2003 Bédouins sédentarisés et société citadine à Tozeur (Sud-Ouest tunisien), Paris, Karthala (« Hommes
et Sociétés ») ; Tunis, IRMC.
RAITI, L. A.
2001 Authenticity and Expectation: Tourism in Siwa Oasis, Master of Arts Thesis, Cairo, American
University in Cairo.
SAID, E. W.
1997 L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Éditions du Seuil (« La couleur des idées »).
URBAIN, J.-D.
1993 L’idiot du voyage. Histoires de touristes, Paris, Payot (« Petite bibliothèque Payot. Documents »).
WACKERMANN, G.
1999 « Tourisme », Encyclopædia universalis, DVD-Rom version 5, Paris.
NOTES
1. Certaines oasis ne doivent leur existence et leur pérennité qu’au commerce transsaharien.
2. En tant qu’ethnologue, je travaille sur les rencontres réelles et observables, laissant ici de côté
des formes de tourisme solidaire encore à l’état de projet.
3. Qui bénéficie également de sa promotion politique récente (en 1981) de siège du gouvernorat
(le Jérid était auparavant partie du gouvernorat de Gafsa).
4. Mère du monde : modeste façon par laquelle les Cairotes ou les Égyptiens surnomment Misr (Le
Caire ou l’Égypte).
5. Pour B USSON, FÈVRE et HAUSER (1910 : 116) : « Le commerce saharien [...] a d’ailleurs perdu
beaucoup de son importance depuis que l’occupation des oasis algéro-tunisiennes par la France
en a éliminé l’élément le plus rémunérateur, le trafic des nègres enlevés au Soudan. »
6. L’emploi du terme « éthos » renvoie surtout à son acception habituelle (du moins depuis Max
Weber) d’un ensemble de règles morales intériorisées par les individus ou les groupes.
L’acception qu’en donne BOURDIEU (1979) n’en est guère éloignée.
7. Le tourisme lié aux événements culturels (de festival par exemple) n’est pas abordé dans cet
article.
8. Les acteurs d’un environnement, quels qu’ils soient, perçoivent, conçoivent et pratiquent
(dans un même mouvement, sans préséance — recherchée — entre concept et pratique) l’espace
en même temps que leurs relations à cet espace avec lequel ils interagissent. Il n’existe
évidemment pas un type unique de relation : les acteurs pris dans des situations font appel à des
registres de relations (pratiques et cognitives) à l’environnement. Ces registres ne peuvent être
déconnectés de leur cadre spatial, temporel et physique avec lesquels ils sont forcément en
liaison — mais non en adéquation. Ces ensembles de ressources cognitives et de pratiques et de
ressources physiques et biologiques forment ce que l’on peut appeler des « ressources
socioécologiques », d’ordre idéel, naturel et pratique, mobilisées de manières différenciées pour
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
497
un même environnement selon les acteurs et les situations. Ces ressources ne sont donc pas
uniquement des ressources du lieu. L’accès et la mobilisation de ces ressources socioécologiques
ne sont pas équitablement partagés.
9. Les exemples de littératures sont nombreux, citons notamment Vacances au Hoggar, un chameau
et moi (D’IETEREN 1952).
10. Voir l’appel du désert traité par Jean-Didier URBAIN (1993 : 179).
11. C’est une déception pour de nombreux touristes de ne pas toujours trouver des dunes de
sable autour des oasis, les ergs ne couvrant qu’un septième du Sahara.
12. Les oasis servent aussi de prétexte à traverser le désert : les autorités algériennes et le PNUD
ont mis en œuvre « la route des ksour », itinéraire de tourisme culturel suivant la piste des
caravanes joignant les anciens ksour et oasis du Sahara. Ce projet sera prolongé en Tunisie et au
Maroc, puis vers la Libye et la Mauritanie.
13. À propos de zoos humains, le hasard veut que l’importation et l’exposition de huit Pygmées
baka du Cameroun dans le parc animalier de Champalle à Yvoir en Belgique (qui défraya la
chronique en juillet 2002) fussent organisées par l’association belge Oasis nature.
14. Quand ce tourisme était autorisé : longtemps la zone fut contrôlée par les militaires et
interdite aux étrangers.
15. Une moyenne d’un jour trois quart à Tozeur, de deux à trois jours à Siwa. Le nombre annuel
de visiteurs à Siwa est compris entre 6 000 et 7 000 ; à Tozeur, il est 60 fois supérieur : 400 000
visiteurs par an (Données 2008 en Tunisie du Commissariat régional au tourisme, région du Sud-
Ouest et 2006 en Égypte de l’Egyptian Tourism Authority Office in Siwa).
16. Enquête inédite des Services de l’environnement, Siwa, 2005.
17. La perplexité de nombreux ethnologues face à cette catégorie du « traditionnel » est connue
et largement légitime. Mon principal grief est qu’elle renvoie systématiquement à du « non
daté », laissant croire à l’immuabilité des faits sociaux, à la permanence de traits culturels alors
« naturalisés ».
18. Le pittoresque, après tout, est le caractère de ce qui est « digne d’être peint, attire l’attention,
charme ou amuse par un aspect original » (Petit Robert).
19. Et l’authentique, finalement, est ce qui est « conforme à son apparence », ce qui « exprime
une vérité profonde de l'individu et non des habitudes superficielles, des conventions » (ibid.).
20. Vérifié dans de nombreuses langues européennes.
21. Le responsable du syndicat d’initiative à Siwa, le 23 août 2002.
22. La municipalité de Tozeur a cependant transformé, il y a peu, le site en un improbable
« Temple de l’amour » (une sorte de parc de jeux).
23. « A hot-air balloon flight over the Sahara just as the sun is rising is one spectacle no one
should miss », Tunisia: Antonio, my ship of the desert, Telegraph, 05/ 02/2001 < http://
www.telegraph.co.uk/travel/africaandindianocean/tunisia/720893/Tunisia-Antonio%2C-my-
ship-of-the-desert.html>.
24. Deux modes que j’ai appelés ailleurs registres instrumental et relativiste (BATTESTI 2005).
25. Abdou, Siwa, 2 janvier 2005.
26. Il serait intéressant de savoir s’il en a été autrement quand les villages étaient encore groupés
en hauteur et que cette position sécuritaire leur permettait de surveiller les alentours.
27. Un nouveau dix-huit trous et bientôt trente-six trous à Tozeur, < http://
www.tozeuroasisgolf.com>, février 2008. À inscrire au compte de M. Chraïet, un maire débordant
d’initiatives architecturales pour le moins curieuses (car justement aucune ne peut pleinement
satisfaire la quête contemporaine « d’authenticité » des touristes), on notera également la
présence toute récente de dinosaures à l’échelle dans la palmeraie, devant le nouveau musée
Chak-Wak.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
498
28. Ce qui domine dans le récent développement de l’incentive, une forme de tourisme
d’entreprise, rapide et en groupe pour « motiver votre force de vente, dynamiser votre force de
frappe », <http://www.tunisie-receptif.com/incentives.html>, 20 avril 2008.
29. Communication personnelle de son directeur Ali Matrash, 2004.
30. Sauf sur la question des ordures laissées par les habitants dans la palmeraie : cela dépare dans
un cadre idyllique.
31. Siwa possède de nombreux vestiges d’intérêt archéologique qui motivent parfois le voyage.
32. Blog internet, 2007, Bécassine dans le désert : Siwa. < http://elsakhawaga.blogspot. com/
2007_10_01_archive.html>, 18 février 2008.
33. De même type que ceux qui ont asséché la corbeille de Nefta.
34. Et très largement plébiscitée depuis une petite dizaine d’années par des Européens, grands
investisseurs dans l’immobilier de ce quartier qu’on nomme dorénavant « médina », pour en
faire des résidences secondaires. Dans une certaine mesure, la comparaison avec ce qui se passe à
Marrakech ne serait pas illégitime.
35. La coercition est de mise puisque le raccordement à l’eau et l’électricité est désormais
conditionné au respect de ce décret (no 1219/2002 avec la déclaration de zone protégée de Siwa
en 2002 classée comme Desert & Civilizational Site Protectorate).
36. Les Bidochon en vacances (BINET 1981) et Les Bidochon en voyage organisé (BINET 1984) compilent
les critères d’un idéaltype du tourisme de masse, accordés aux Français en vacances. Pour le
tourisme culturel, les vacances « à la Bidochon » agissent comme un modèle repoussoir : bon
tourisme contre mauvais tourisme.
37. Pourquoi ? délicat de le dire en deux mots. Il s’agit clairement d’une demande touristique
(française et allemande en particulier) d’avoir à faire à des Berbères plutôt qu’à des Arabes et je
ne peux qu’y voir la rémanence d’un vieux clivage colonial français en Algérie. Le discours
colonial valorisait la composante berbère de l’Afrique du Nord (et sa latinité présumée) pour
légitimer son annexion à l’Europe (les Arabes ne devenant qu’une péripétie invasive).
38. L’Ecolodge d’Adrar Amellal à Siwa est un hôtel dépourvu de confort électrique, entièrement
construit en matériaux locaux et utilisant partiellement la technique locale ancienne du tlaght
(pisé en argile salée). Il est une forme de vitrine du savoir-faire de la société cairote EQI et ne vise
qu’une clientèle haut de gamme.
39. L’auteur vise spécifiquement une clientèle touristique. Il a fait traduire son livre de l’anglais
vers le français (MALIM 2003) trois ans plus tard. Les premiers mots de sa préface : « Je suis très
heureux d’écrire un livre sur ma région, l’oasis de Siwa. J’espère qu’il permettra aux lecteurs de
découvrir et de comprendre les coutumes, à la fois belles et uniques, du peuple siwi. L’ouvrage a
été rédigé simplement, de façon à permettre à des gens du monde entier de comprendre et
d’apprécier l’identité siwi. » Notons que d’autres ouvrages sont mobilisés, en particulier
l’incontournable et précieux travail d’Ahmed FAKHRY (1990), Siwa Oasis, ainsi qu’un nouveau livre
d’un autre auteur de Siwa, Siwa, Past and Present d’Abd el-Aziz Abd el-Rahman ALDUMAIRY (2005),
sans compter la littérature de voyage (parfois très riche en détails) et divers guides plus ou moins
précis.
40. Un touriste britannique en 2004.
41. Voir également les témoignages de guides au Caire dans LACHENAL (2007 : 72).
42. Le novlangue (newspeak en anglais) est la langue officielle de l’Océania inventée en 1949 par
George ORWELL pour son roman 1984. Il est une simplification lexicale et syntaxique de la langue
destinée à rendre impossible l’expression des idées subversives et à éviter toute formulation de
critique (et l’idée même de critique) de l’État.
43. Premier appel à contributions, janvier 2007, Colloque international Tourisme saharien et
développement durable, Enjeux et approches comparatives, Tozeur (Tunisie), du 9 au 11 novembre
2007, Université de Sousse, Faculté de Droit et des sciences économiques et politiques de Sousse,
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
499
UR Tourisme et développement & Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Institut de
recherche pour le développement, UMR 063 C3ED.
RÉSUMÉS
Ce texte s'articule sur deux terrains ethnographiques oasiens : en Tunisie dans la région
arabophone du Jérid et dans l'oasis berbérophone égyptienne de Siwa. L'inclination
contemporaine du tourisme est clairement au « culturel ». Moins qu'une opposition entre des
« touristes culturels » et des touristes qui ne le seraient point, il s'agit surtout d'un zèle chez les
uns et les autres à mettre en œuvre une nouvelle ressource, un nouveau registre de pratiques
touristiques. Les émotions esthétiques ont aussi évolué (du pittoresque à l'authenticité), avec
l'exigence d'un accès direct et vrai à la culture locale. Plus que le panorama en surplomb offert
depuis les inselbergs qui entourent Siwa ou les montgolfières à Tozeur, rien ne vaut désormais
d'assister à un « vrai » mariage, à une « vraie » fête des jeunes travailleurs enivrés sous les
palmiers. Quiproquo et simulacres laissent place cependant aussi à une satisfaction. Il se crée
peut-être une « novlangue » coproduite entre touristes et interface locale, amalgamant
préservation identitaire (diversité culturelle) et préservation éco/biologique (biodiversité).
This text focuses on two ethnographic oasian fieldworks: in Tunisia, the Arabic-speaking region
of the Jerid and in Egypt, the Berber-speaking oasis of Siwa. The tendency of contemporary
tourism is clearly "culturally" oriented. Less than an opposition between "cultural tourists" and
"un-cultural tourists", it is mainly a zeal among each other to implement a new resource, a new
register of tourism practices. Aesthetic emotions have also evolved (from picturesque to
authenticity), with the demand for direct and true access to the local culture. More than the
overlooking panorama offered from inselbergs around Siwa or balloons in Tozeur, nothing bears a
comparison with a "real" marriage, a "real" party of drunken young workers under the palm
trees. Misunderstandings and simulacra, however, leave also room for satisfaction. A "newspeak"
("novlangue") is perhaps invented, co-produced between tourists and local interface combining
identity preservation (cultural diversity) and biological/environmental preservation
(biodiversity).
INDEX
Mots-clés : Égypte, Tunisie, Jérid, Siwa, anthropologie, authenticité, culture, ethnologie, oasis,
patrimoine, tourisme culturel
Keywords : Egypt, Tunisia, Jerid, Siwa, anthropology, authenticity, culture, ethnology, oasis,
heritage, cultural tourism
AUTEUR
VINCENT BATTESTI
Écoanthropologie & Ethnobiologie (UMR 7206), Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
500
Le tourisme et les images exotiquesThe Tourism and the Exotic Images
Jean-Paul Colleyn et Frédérique Devillez
1 Le tourisme, la prise d’images documentaires et l’anthropologie sont historiquement
liés puisqu’ils font partie de l’expansion de l’Occident. Un fait paraît d’ailleurs
incontournable : ce sont toujours les mêmes qui visitent et les mêmes qui sont visités
(Crick 1989 ; Bruner 1989). Nelson Graburn (1983) a même qualifié l’anthropologie de
plus haute forme de tourisme. L’histoire du cinéma passe par une mise en images
systématique du monde, comme en témoignent les premières entreprises, celles des
frères Lumière, d’Edison, puis d’Albert Kahn qui envoyèrent des opérateurs dans les
quatre coins de la planète. Aujourd’hui, cette mise en images se poursuit, à mesure que
progresse la « touristication » du monde. Le tourisme n’a donné naissance à une
véritable industrie, qu’après la Seconde Guerre mondiale, avec les congés payés,
lorsque les classes moyennes européennes et américaines ont pu bénéficier des progrès
des transports. C’est un bon point d’entrée pour observer l’état du monde, car c’est un
fait « social total » dont l’étude touche à toutes les grandes questions de
l’anthropologie. Le tourisme n’est-il pas le thermomètre des relations Nord-Sud,
centre-périphérie, riches-pauvres ? Les relations entre touristes et « touristiqués »
sont-elle forcément inégales ? Les populations visitées sont-elles les victimes ou les
bénéficiaires de ces relations ? Le tourisme valorisant l’authenticité, les traditions se
réinventent-elles partiellement pour répondre à la demande touristique ? Le tourisme
ne révèle-t-il pas les ambiguïtés des notions d’identité, de « dépaysement » et de
traditions ?
2 L’histoire du tourisme, en tout cas, est une histoire du regard : regard dirigé vers
l’autre, regard retourné vers soi. C’est le sens de la programmation de films consacrés à
ce thème par l’édition 2008 du Cinéma du Réel, le festival du film documentaire de la
Bibliothèque publique d’information, qui s’est tenu au Centre Georges Pompidou, à
Paris. En choisissant de rassembler une centaine de films autour de la figure du
tourisme, ce festival nous invite à interroger notre regard et notre quête de
l’authenticité dans la relation instaurée à l’autre et au monde1. Il propose une lecture
des films présentés comme le résultat d’une réflexion des cinéastes sur le tourisme et le
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
502
regard qu’ils posent sur ce type de rencontre entre « étrangers ». « Le déni de la
situation de touriste est en effet le propre du touriste » (Bullot 2008 : 141). Qu’il
s’emploie à superposer par le voyage ce qu’il voit à ce qu’il imaginait voir, où qu’il rêve
de découvrir des territoires inexplorés, le touriste désire avant tout croire à une double
authenticité : celle de ce qu’il découvre et celle de la relation qu’il entretient au monde.
Or, la condition de l’explorateur contemporain, qu’il soit ethnographe, documentariste
ou simple voyageur, semble bien être celle de l’impossibilité d’accéder à cette
authenticité. Marc Augé (1997) a parlé à ce propos d’« impossible voyage ». Les films
montrés déclinent les modalités d’une renonciation progressive, en allant pour leurs
auteurs jusqu’à revendiquer le statut de touristes, voire à en jouer. Comment faire de
l’acte de voyager ou de filmer une expérience plutôt qu’une simple consommation du
monde ? Comment échapper à la mise en images comme reproduction de ce que nous
savons déjà ? (Neyrat et al. 2008 : 169).
3 Le tourisme a à voir avec l’image, l’imaginaire et l’imagerie. L’image qu’on donne du
monde lointain, l’imaginaire qu’il suscite, l’imagerie pittoresque où on le cantonne
souvent.
4 Les premières images du cinéma sont liées à l’exploration, car le cinéma voyage pour
ses spectateurs, ces « voyageurs immobiles des salles obscures », ce qui induit une
grammaire cinématographique cherchant à reproduire le mouvement (de Pastre 2008 :
167). La télévision prendra la succession de la salle Pleyel, raillée par Claude Lévi-
Strauss dans la première page de Tristes Tropiques. Le Cinéma du réel a montré plusieurs
films du premier « travelogue » et inventeur du terme : Burton Holmes (1870-1958).
Infatigable globe-trotter, il fit l’équivalent de six fois le tour du monde, prenant 30 000
photographies et des kilomètres de pellicule. Ses images illustraient ses conférences,
d’abord sous forme de diapositives, puis de films ; ses livres se vendaient comme des
petits pains2. Parfait gentleman aventurier, il annonce la galerie de conférenciers et de
vedettes de télévision, de Martin et Osa Johnson à Jean-Yves Cousteau, en passant par
Lowell Thomas. Bien que très respectueux des hommes qu’il rencontrait aux antipodes,
Holmes s’inscrivait dans la grande entreprise d’appropriation du monde de son époque,
comme en témoigne le titre de son autobiographie : The World is Mine (Holmes 1953).
5 Le gommage du contexte au profit du cliché primitiviste est présent dès l’origine : s’il
fallait argumenter sur le caractère illusoire de l’authenticité, il suffirait de répertorier
le nombre des premiers films « ethnographiques » qui ont été tournés dans les foires
coloniales ou les réserves indiennes (Jordan 1992). L’image fonctionne comme la
réserve, elle fige. Lors du tournage du dernier film qu’ils consacrèrent aux Mursi du sud
de l’Éthiopie, qu’ils fréquentent depuis 35 ans, le cinéaste Leslie Woodhead et
l’anthropologue David Turton furent surpris des changements intervenus. Les femmes
et les enfants qui les accueillirent arboraient une tenue étonnante : leur corps était
décoré de motifs étranges, en boue séchée coloriée, leurs oreilles et leurs bras étaient
parés de lourds ornements, les femmes portaient dans leur lèvre inférieure des
plateaux d’une taille impressionnante. Quelques touristes, chargés, eux, d’appareils, les
mitraillaient de photos en échange de quelques monnaies. Un aîné familier de
l’anthropologue et du cinéaste leur expliqua que bien sûr tout cela était très nouveau
pour les Mursi, mais que c’était ce qu’aimaient les touristes : ils ne veulent
photographier que les femmes et achètent tout ce qu’elles portent : bracelets, dents
d’hippopotame et même cloches de vaches. Les gains d’une seule « femme à plateau »
permettent de reconstituer le troupeau d’une famille appauvrie par la sécheresse et la
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
503
guerre. Turton, avec modestie — il a passé des années sur le terrain et a appris la langue
des Mursi —, concéda « face caméra », que l’anthropologue n’est lui aussi qu’une sorte
particulière de visiteur et qu’il contribue également aux changements qu’il déplore.
6 Le cinéma peut en revanche interroger le portrait d’une culture figée par la « mise en
réserve » : le film Safari au Xingu d’Yves Billon et Jean-François Schiano (1983) constate
l’ambiguïté d’une solution boiteuse entre une culture institutionnellement préservée
(et constamment soumise aux marchandages) et l’assimilation.
7 L’authenticité est un malentendu, une valeur que l’on pourrait identifier comme le
« mauvais objet », le tourisme dénié serait un mauvais tourisme, à la fois produit et
producteur d’une imagerie aux effets pervers. Toute une idéologie liée aux frustrations
du monde industriel veut faire croire à l’authenticité comme valeur suprême, comme
principal instrument d’une catharsis ou plus modestement d’une cure. Le touriste des
antipodes veut trouver l’autre ; s’il n’y trouve que soi, il ne peut cacher sa frustration ni
son sentiment de s’être fait rouler. Car, en vérité, lui-même n’aime pas les touristes et
s’efforce de s’en distinguer : il désire être seul face à une virginité culturelle, tout en
bénéficiant de « prestations » dignes de sa société d’origine. On retrouve le cercle
vicieux du marché de l’art « primitif » dénoncé par Resnais et Marker (1953) dans Les
Statues meurent aussi : le culte rendu à l’objet tue l’objet. Pour avoir quelque valeur, il ne
faut surtout pas que le masque ait été taillé « pour un blanc », « il faut qu’il ait dansé »,
qu’il ait été fait pour l’autre. Revenons à l’imagerie du monde riche : dans la sphère
publique, les images de la diversité culturelle proviennent surtout des explorateurs, des
promoteurs, des écrivains-voyageurs, des reporters, des photographes, des cinéastes et,
marginalement, des chercheurs, lesquels souvent portent sur l’exotisme de masse un
jugement négatif. Leurs travaux, toutefois, alimentent, qu’ils le veuillent ou non, toute
cette « idéologie touristique ». Pour le meilleur ou pour le pire, l’anthropologie, ou
plutôt, l’ethnologie, doit sa popularité aux images, d’abord à travers les supports
visuels — dans les musées et les expositions internationales du XIXe et du début du XXe
siècles, puis les livres et articles, dans la période qui va des années 1920 à la moitié des
années 1970, puis, à nouveau, aux moyens audiovisuels, avec la télévision (MacClancy &
McDonaugh 1996 : 17). Il faut aujourd’hui ajouter Internet, car le tourisme y est
omniprésent et alimente la nouvelle mise en images du monde. En évoquant de
manière pittoresque et sensationnelle les lieux et les peuples qu’elle propose à la
consommation, l’imagerie touristique façonne non seulement la demande touristique,
mais aussi l’offre, car dès le moment où ce créneau paraît plus lucratif que le secteur
économique primaire, les gens essaient comme ils le peuvent de se conformer à ce que
l’on attend d’eux. Les images reçues, comme on dit les « idées reçues », modèlent les
goûts et les attentes. L’authenticité étant une valeur particulièrement demandée, la
promotion touristique se charge de la mettre en avant et, au besoin, de la réinventer
(Amselle 2005 ; Doquet 2006 ; Salazar 2005).
8 Les documentaristes ne sont pas forcément formés à l’anthropologie ou à la sociologie,
mais les meilleurs d’entre eux sont de fins observateurs du social. Leurs intuitions ont
parfois précédé les recherches des spécialistes, tant sur le plan formel (la recherche de
nouvelles formes documentaires) que sur le plan théorique (le dépassement du
positivisme, les interactions sociales, les contextes d’énonciation de la parole, la place
de l’auteur dans la description). Toutefois, la plupart des programmes relèvent plutôt
des « travelogues », partageant le même imaginaire que les guides, les livres
touristiques, les cartes postales et la publicité. Les secteurs les plus « sérieux » du
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
504
paysage audiovisuel français n’échappent pas au tropisme racoleur. Voici, par exemple,
comment le Nouvel Observateur commente le programme « Mille et une vie : la
Nouvelle-Zélande »3 : « Parfois les Maoris acceptent de parler devant la caméra, et
l’entretien est magique [...]. Et tout le monde afflue là, en quête de révélation sublime
depuis le film de Peter Jackson Le Seigneur des anneaux »4. Ailleurs, le même magazine se
repaît de ce dont il se moque, commentant le reportage sur la virée de stars dans le
monde pauvre : « Avec Adriana Karembeu chez les Amharas, sur les Hauts-plateaux
d’Abyssinie. On croirait une poupée Barbie géante égarée au pays des minipouces [...]. À
l’image des précédentes éditions, ce numéro, conçu comme un voyage initiatique à la
découverte de l’autre et de soi [...] »5.
Un film-charnière
9 Dès 1987, le film Cannibal Tours, de Dennis O’Rourke avait pourtant jeté un pavé dans la
mare touristique, mais on sait qu’un travail de démystification doit toujours
recommencer. Le cinéaste accompagnait un groupe de touristes fortunés qui remontait
le fleuve Sepik et filmait leurs interactions avec les Papous. Le film intéressa vivement
les anthropologues car il était parfaitement contemporain de la critique postmoderne
de l’anthropologie classique par des auteurs venus des études littéraires et des cultural
studies. Cannibal Tours est, en effet, un film « dialogique » (il fait entendre une
multiplicité de voix, notamment « indigènes ») et « réflexif » (la place du cinéaste, loin
d’être masquée par un style objectivant, est clairement assumée). Jamais le film ne
verse dans l’« allochronisme » (qui rejette les « observés » dans un autre temps)
dénoncé par Johannes Fabian (1983) : au contraire, comme le note Hart Cohen (cité
dans Lutkehaus 1989 : 425), « le film contribue à une ethnographie visuelle de la
modernité »6. En même temps, O’Rourke est parfaitement conscient que son propre
projet rajoute un étage à l’entreprise voyeuriste incarnée par le tourisme. « Les
métaphores du processus de mise en images, la nature du regard et le contrôle sur le
choix et la diffusion des images [...] qui reflètent le pouvoir inégal propre aux relations
entre l’Occident et les autres sont devenus un leitmotiv dans l’œuvre de O’Rourke » 7
(Lutkehaus 1989 : 436). Peter Kubelka (Unsere afrikareise 1961-1966), avait déjà filé la
métaphore du cannibalisme et de la dévoration comme rapport entre touristes et
autochtones, en jouant du montage et des champs-contre-champs explicites et
absurdes et en montrant un touriste avide de sensations et de primitivisme. Bien que
n’étant pas anthropologue, Dennis O’Rourke, qui se définit comme un artiste, entend
nous faire réfléchir sur notre fascination pour le monde « primitif ». Dans le film, les
touristes, qui apparaissent comme paternalistes et franchement ethnocentriques,
semblent adorer — surtout l’un d’entre eux —, les histoires de sacrifices humains et de
cannibalisme. Le dernier jour de leur périple, ils organisent une petite party sur leur
bateau, se déguisent en Papous, s’affublent de peintures faciales, imitent les danses
guerrières et plaisantent à propos des étuis péniens qu’ils ont achetés comme
souvenirs. En revanche, la lucidité sociologique et le sens de la réversibilité du regard
des Papous interrogés impressionnent : « Certains de nos enfants qui ont été à l’école
nous disent : “Ce sont des gens riches qui viennent”. Et nous acquiesçons, ils doivent
être des fortunés. Leurs propres ancêtres ont fait de l’argent et maintenant, ils peuvent
voyager. Nous n’avons pas d’argent, donc nous restons au village. Nous ne voyons pas
d’autres pays. » Dans Kobarweng or where is your helicopter ?, de Johan Grimonprez (1992),
un néo-Guinéen surprend le cinéaste en lui demandant : « Où est ton hélicoptère ? » car
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
505
les souvenirs du monde extérieur sont marqués par la Seconde Guerre mondiale. Même
retournement dans The Moon, the Sea, the Mood, de Philipp Mayrhofer (2008), où une
épicière des îles Trobriand exprime son désir d’aller en Hollande, car les belles images
avec moulins à vent lui font penser que la nature doit y être très belle. Plus loin, le
chauffeur du réalisateur s’étonne du culte que les Européens vouent à Malinowski.
Les derniers « sauvages »
10 Il existe une sorte de « hit parade » des peuples « primitifs », au sens où ils font l’objet
d’un engouement particulier : il s’agit toujours de peuples présentés comme
irrédentistes, qui refusent l’assimilation et se battent pour préserver leurs « coutumes
ancestrales » : les Dogon, les Touaregs, les Maasaï, les « Bushmen », les Pygmées. La
version idéalisée d’une vie proche de la nature qui ne doit rien aux « horreurs » de la
production industrielle paraît plus attirante qu’un dossier décrivant une population qui
s’habille de fripes européennes, habite sous la tôle ondulée, produit un « artisanat
d’aéroport », recycle les surplus de contrebande et prépare son thé sur des réchauds
Butagaz dans des théières importées de Chine. Même au fond de la Papouasie-Nouvelle
Guinée, les hôtes de l’anthropologue Stéphane Breton se montrent fascinés par le
monde d’où il vient et par les transactions qu’il noue avec eux. Dans Eux et moi, Breton
(2001) évoque le dégoût qu’il a d’abord ressenti en se livrant au « petit commerce » avec
les Papous, toujours friands de trouver un acheteur pour leurs coquillages contre
quelques billets de banque. Jusqu’à ce qu’en faisant de ces marchandages et de son
trouble les sujets de son film, il se démarque de l’image d’Épinal de l’ethnologue aux
motivations certes scientifiques et nobles, mais incompréhensibles pour les
« ethnologisés ». Maintenant qu’ils peuvent faire du commerce ouvertement, ils
prennent place dans un système symbolique commun. En quelque sorte, Stéphane
Breton endosse son habit de touriste, assume l’ambiguïté de la relation et nous rend
sensible l’état d’étrangeté ressenti par l’anthropologue face au regard de celui qu’il
étudie.
Commerce en tout genre
11 Dans un monde fait de flux où de plus en plus de gens circulent, de leur plein gré ou
contraints et forcés, le tourisme est devenu un fait culturel et un secteur économique
majeurs : les lieux et leurs habitants sont devenus des objets de consommation. La
France est bien placée pour le savoir, en tant que pays le plus visité du monde, avec ses
78 millions de visiteurs en 20068. Nous nous inquiétons de la perte de pureté des
cultures que nous semblons persister à considérer comme exotiques, primitives ou
« premières », mais nos propres hauts lieux se sont mis en scène, nos villes se sont
découvert des centres historiques et nos régions vantent leurs spécialités locales. La
culture française en a-t-elle souffert ? Qui pourrait faire avec sûreté la distinction entre
ce qui est commercialement présenté comme français et ce qui serait
« authentiquement » français ? Les Français sont-ils devenus « folkloriques » sous
l’effet de la commercialisation de leur patrimoine ? Certainement en partie, mais le fait
ne semble pas trop les traumatiser, comme le montre l’ironie subtile de Marc Augé dans
la série Clichés (Augé et al. 1994). Les anthropologues se montrent pourtant préoccupés
par les effets corrupteurs du tourisme sur les sociétés qu’ils étudient, en particulier en
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
506
Afrique. Non seulement le tourisme les changerait en parcs d’attraction, mais il
modifierait la manière dont leurs membres se perçoivent eux-mêmes (Wang 2000). Il
faut dire que l’appétit des touristes ne connaît pas de bornes. Selon Beatriz Jaguaribe
(2007), au Brésil, des tournées touristiques sont organisées dans des favelas réputées
dangereuses pour attirer des touristes désireux d’éprouver physiquement les frissons
de l’aventure. Autre exemple extrême : le tourisme sexuel sous toutes ses formes, du
plus anodin petit arrangement entre amis à la pédophilie, en passant par les prostitués
des deux sexes, les gigolos et les beach boys. C’est un phénomène qui affecte aujourd’hui
le Kenya, la Gambie, le Sénégal et aussi les Antilles. Récemment, Laurent Cantet a traité
ce thème dans son film de fiction Vers le Sud (2006), avec l’actrice Charlotte Rampling.
Un sujet qui fâche
12 Prendre des images apparaît comme un des principaux plaisirs du voyage, et la misère
semble prendre une valeur esthétique prisée ; donnant à penser que la souffrance est
belle (Reinhardt et al. 2007). C’est même parfois un sujet qui fâche, car les « indigènes »
n’apprécient guère que les touristes les filment ou les photographient sans demander
leur avis (Bruner 1989).
13 Agarrando pueblo, de Luis Ospina et Carlos Mayolo (Colombie, 1978), montre dans un
premier temps le cynisme de deux « documentaristes » prêts à tout pour prendre des
images sensationnelles, susceptibles de satisfaire la soif occidentale de misère humaine.
Visiblement, le commerce de la pauvreté est rentable, car ces deux amoraux, sexy et
poseurs, fanfaronnent et passent allègrement du vol de prises de vue à la
consommation de drogues aux bras de jolies filles. Lorsqu’ils vont jusqu’à mettre en
scène deux comédiens payés pour jouer les misérables dans un taudis « emprunté » à
son propriétaire absent, coup de théâtre : le propriétaire débarque fou furieux et chasse
toute l’équipe à coups de menaces et d’injures. Mais en réalité, ce coup de théâtre est
lui-même mis en scène : l’homme finit par éclater de rire et le spectateur prend
conscience que le film entier est un coup monté. Les deux « documentaristes » sont les
réalisateurs et ils interviewent le « fou » sur cette expérience de cinéma. Finalement, ce
dernier échappe à tous les clichés : celui du pauvre et de l’offensé, mais aussi celui du
dénonciateur. Parfaitement conscient des enjeux du tournage, il expose avec beaucoup
d’ironie sa vision des choses, loin de tout manichéisme. Un film parodique, un mock-
documentary qui a le mérite de poser la question d’un tourniquet des regards et de la
guerre des images.
*
14 Une énorme production non critique continue de fabriquer de l’imagerie touristique
plus ou moins commerciale, mais de nombreux films, dans la foulée de Cannibal Tours,
interrogent le jeu de miroirs du « réel » et de ses images. Anthropologues et
documentaristes savent aujourd’hui que de la réalité surgit dans le spectacle et que le
spectacle crée du réel. Globalement, l’anthropologie visuelle a traité du tourisme en
prenant les films documentaires comme sources, bien plus qu’elle n’a contribué à la
fabrique des images, laissant la tâche aux documentaristes. Par ailleurs, la position des
anthropologues semble avoir évolué, passant de la dénonciation des mystifications de
la culture de masse à des études plus fines des pratiques touristiques, voire à une
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
507
défense d’un tourisme « équilibré », comme solution alternative aux impasses du
développement (Strecker 2000). Le rapport filmant-filmés a, lui aussi, évolué : les
seconds ont cessé d’être les sujets passifs d’un rapport de domination pour s’inscrire
dans des rapports négociés. Tandis que les auteurs s’interrogent sur la manière dont ils
exercent le pouvoir de mettre en images les « sujets » de leurs films, il arrive que ces
derniers revendiquent leur image et s’efforcent de la contrôler. Bien des groupes
humains sont devenus des prolétaires d’un nouveau type : avec les sécheresses
successives et la crise des matières premières, leurs bras sont devenus inutiles et ils
vendent la dernière chose qu’il leur reste : leur culture, dont ils se sont aperçu qu’elle
était monnayable. Ironie de l’histoire des idées : à l’heure où les anthropologues ont
enfin surmonté la conception essentialiste des cultures naguère quasiment considérées
comme des espèces naturelles, la « touristication » d’une part et les revendications des
minorités d’autre part, produisent de l’identité à tour de bras, comme nouvelle
stratégie de lutte ou d’adaptation au monde actuel. Sans doute faut-il distinguer un
essentialisme culturel « stratégique », émanant de groupes en lutte pour la défense de
leurs droits et un essentialisme naïf, émanant de réalisateurs à la recherche d’une
pureté perdue ou soucieux du sauvetage de patrimoines menacés. Si l’image risque
toujours de figer les cultures en voulant les préserver, un peu comme le disait Roland
Barthes de la photographie, elle peut aussi restituer les efforts de recomposition et
d’invention à l’œuvre sur les terres d’accueil du tourisme. Enfin les touristes eux-
mêmes évoluent et se montrent de plus en plus soucieux de marier l’éthique et le
tourisme, une idéologie nouvelle qui mobilise une nouvelle rhétorique (durable,
solidaire, culturel, écologique) déjà absorbée par les opérateurs économiques.
BIBLIOGRAPHIE
Filmographie
AUGÉ, M., DE CLIPPEL, C. & KAPNIST, E.
1994 Clichés (Disney sur Marne, Châteaux en Bavière, L’Affaire Waterloo, L’Ascension du Mont-Saint-
Michel), Vidéo couleur 4 X 13 min., Paris, Ina-Acmé-Film-La Sept/Arte.
BILLON, Y. & SCHIANO, J.-F.
1983 Safari au Xingu, 27 min., 16 mm couleur, France, distribution Zarafa films.
BRETON, S.
2001 Eux et moi, 63 min., vidéo couleur, France, production Les films d’Ici-Arte France.
BRODSKY, B.
1917-1918 Beautiful Japan, 133 min., 35 mm noir et blanc, USA, production The Benjamin Brodsky
Moving Pictures Company, distribution Human Studies Film Archive/National Anthropological
Archives, Smithsonian Institution.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
508
CANTET, L.
2006 Vers le sud, 1 h 55 min., 35 mm couleur, France, édition DVD ; Éditions Montparnasse.
GRIMONPREZ, J.
1992 Kobarweng or « Where is your Helicopter » ?, 25 min., vidéo couleur et noir et blanc, Belgique-
États-Unis, production Johan Grimonprez, distribution Zapomatik, coll. Centre Pompidou.
HOLMES, B.
1913 Burton Holmes in the Philippines, 10 min., 35 mm noir et blanc, USA, Burton Holmes Films.
1918 Sights of Suva, 10 min., 35 mm noir et blanc, USA, Burton Holmes Films.
1933 Darkest Africa, 5 min., 16 mm noir et blanc, USA, Burton Holmes Films.
JAGUARIBE, B.
2007 Overexposed Favelas: Urban Representations and Media Visibility, Communication orale à la
conférence Visual Democracy. University of Rio de Janeiro, Northwestern University.
KUBELKA, P.
1961-1966 Unsere afrikareise, 12 min., 16 mm couleur, Autriche, Coll. Centre Pompidou.
MAYROFHER, P.
2008 The Moon, the Sea, the Mood, 47 min., video couleur, France-Allemagne, production Sciapode-
Mayrofher.
O’ROURKE, D.
1987 Cannibal Tours, 72 min., 35 mm couleur, Australie, production Dennis O’Rourke,
CameraWork.
OSPINA, L. & MAYOLO, C.
1978 Agarrando pueblo (Les vampires de la misère), 28 min., 16 mm couleur et noir et blanc,
Colombie, production Satuple.
RÉALISATEUR INCONNU
1909 Gwalior, ville de l’inde anglaise, 5 min., 35 mm couleur, France, Pathé.
RESNAIS, A. & MARKER, C.
1953 Les statues meurent aussi, 30 min., noir et blanc, Paris, Tadié Cinéma, Présence Africaine.
WOODHEAD, L. & TURTON, D.
2001 Fire Will Eat Us, 75 min., vidéo couleur, Granada TV, Éthiopie, Disappearing Worlds.
Bibliographie
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES
2007 « Nouvelles ( ?) frontières du tourisme », numéro spécial, 170, décembre.
AMSELLE, J.-L.
2001 Branchements : anthropologie de l’universalité des cultures, Paris, Flammarion.
2005 L’art de la friche. Essai sur l’art africain contemporain, Paris, Flammarion.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
509
AUGÉ, M.
1997 L’Impossible Voyage. Le tourisme et ses images, Paris, Payot (« Rivages »). BRUNER, E. M.
1989 « Of Cannibal, Tourists and Ethnographers », Cultural Anthropology, 4 (4): 438-445.
BULLOT, E.
2008 « Du tourisme considéré comme un des Beaux-Arts », Catalogue du Cinéma du Réel, Paris, BPI :
141-145.
COHEN, E.
1984 « The Sociology of Tourism : Approaches, Issues, and Findings », Annual Review of Sociology,
10: 373-392.
COHEN, H.
1988 « Swinging through the Jungle. Review of Cannibal Tours », Filmnews, March.
CRICK, M.
1985 « Tracing the Anthropological Self: Quizzical Reflections on Field Work, Tourism and the
Ludic », Social Analysis, 17: 71-92.
1989 « Representations of International Tourism in the Social Sciences: Sun, Sex, Sights, Saving,
and Servility », Annual Review of Anthropology, 18: 307344.
DOQUET, A.
1999 Les Masques Dogon. Ethnologie savante et ethnologie autochtone, Paris, Karthala.
2006 « Construire l’authenticité mandingue : les balbutiements du tourisme dans le Mande », in
M. C. DIOP & J. BENOIST (dir.), L’Afrique des associations, Paris, Karthala : 51-63.
FABIAN, J.
1983 Time and the Other, New York, Columbia University Press.
GRABURN, N.
1983 « Anthropology of Tourism », Annals of Tourism Research, 10: 9-33.
HOLMES, B.
1953 The World is Mine, Hollywood, CA, Murray & Gee.
JORDAN, P.-L.
1992 Premier contact-premier regard, Marseille, Musées de Marseille-Images en manœuvres éd.
LÉVI-STRAUSS, C.
1984 [1955] Tristes Tropiques, Paris, Plon.
LUTKEHAUS, N. C.
1989 « “Excuse Me, Everything Is not All Right”: On Ethnography, Film, and Representation: An
Interview with Filmmaker Dennis O’Rourke », Cultural Anthropology, 4 (4): 422-437.
MACCLANCY, J. & MCDONAUGH, C.
1996 Popularizing Anthropology, London-New York, Routledge.
MBAYE DIENG, I. & BUGNICOURT, J.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
510
1982 Touristes-rois en Afrique, Paris, Karthala.
NEYRAT, C., AUBRON, H., LARDEAU, Y. & DUHAMEL-MULLER, M. P.
2008 « Fictions du voyage, du touriste, du guide et de la vue », Catalogue du Cinéma du Réel, Paris,
BPI : 169-172.
DE PASTRE, B.
2008 « De la carte postale animée à la déambulation cinématographique », Catalogue du Cinéma du
Réel, Paris, BPI : 167-168.
REINHARDT, M., EDWARDS, H. & DUGANNE, E.
2007 Beautiful Suffering: Photography and the Traffic in Pain, Chicago, university of Chicago Press.
SALAZAR, N. B.
2005 « Tourism and Globalization : “Local Tour Guiding” », Annals of Tourism Research, 32 (3):
628-646.
STRECKER, I. A.
2000 « The Genius Loci of Hamar », Northeast African Studies (« New Series »), 7 (3): 85-118.
WANG, N.
2000 Tourism and Modernity: A Sociological Analysis, Oxford, Pergamon Press.
NOTES
1. Le Cinéma du Réel a proposé de tracer un parallélisme entre cinéma et tourisme, à travers
l’histoire de la vision et du regard, en montrant plus de quatre-vingt films, tournés du début du
siècle à aujourd’hui sur tous les continents, avec une grande diversité de formats et de styles :
travelogues, films d’exploration, films ethnographiques, satires, et même faux documentaires,
docufictions, fictions et films d’artistes. Cette chronique n’est ni exhaustive, ni exclusive, car
nous avons ajouté quelques films marquants.
2. <www.burtonholmes.org/life/bio.html>.
3. Magazine télévisé « Faut pas rêver » du 11 juillet 2008.
4. Colette MAINGUY, TéléObs, juillet 2008.
5. Marjolaine JARRY, Nouvel Observateur, TéléObs, 7 juillet 2008.
6. Voir également à ce sujet COHEN (1984).
7. « Visual metaphors of processes of imaging, the nature of a gaze, and the control over the
choice and distribution of images (as in television programming) that represent unequal power
inherent in relationships between the West and Others have become a leitmotiv of O’Rourke’s
work. »
8. L’expansion.com, 7 février 2007.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
511
RÉSUMÉS
Le tourisme s'inscrit dans un contexte de rencontres inégales, car il participe de la conquête du
monde par les peuples nantis. Le cinéma, qui construit plutôt qu'il ne reflète une histoire de la
vision et du regard, accompagne ce processus. L'un et l'autre sont des objets d'études et de bons
postes d'observation pour les anthropologues dont les travaux alimentent, qu'ils le veuillent ou
non, l'imaginaire touristique, cinématographique ou non. Cette chronique soulève, à la lumière
des films programmés par la dernière édition du Cinéma du Réel (festival de la BPI, au Centre
Pompidou), quelques-unes des questions importantes soulevées par ces jeux de miroirs.
Tourism is part of an unbalanced exchange between rich and poor. Filmmakers contribute to a
history of the vision, the document the evolution of the way explorers, tourists, filmmakers
themselves and their hosts, consider each other. Starting from the film shown during the last
Cinema du Réel festival (Paris, Centre Pompidou), this paper explores some important questions
raised by exoticism, invented tradition, authenticity, and commodification.
INDEX
Keywords : tourism, exoticism, tradition, ethnographic films, documentary films, minorities
Mots-clés : tourisme, exotisme, tradition, films ethnographiques, films documentaires,
minorités
AUTEURS
JEAN-PAUL COLLEYN
Centre d’études africaines, EHESS, Paris.
FRÉDÉRIQUE DEVILLEZ
Centre d’études africaines, EHESS, Paris.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
512
De quelques dynamiquescontemporaines en anthropologiedu tourisme francophoneSome Contemporary Dynamics in the French Anthropology of Tourism
Sébastien Roux
1 Défendue par des chercheurs isolés, dévalorisée par l’apparente futilité de son objet et
handicapée par son incapacité à produire un cadre théorique pertinent, l’anthropologie
du tourisme s’est longtemps vue refuser les espaces éditoriaux les plus légitimes.
Certes, Anthropologie et Sociétés (2001) et Ethnologie française (2002) lui avaient déjà
consacré il y a quelques années un numéro spécial, mais ces initiatives étaient restées
isolées ou centrées sur des aires géographiques limitées. Et l’espace francophone
semblait jusqu’à présent peu préoccupé de dialoguer avec une réflexion qui peine
encore à s’affranchir des revues anglophones spécialisées (Annals ofTourism Research,
Tourist Studies, etc.). Mais ces cloisonnements se dissipent progressivement et les
sciences sociales se réapproprient un phénomène dont elles reconnaissent désormais
l’ampleur ; ce numéro spécial des Cahiers d’Études africaines en est une preuve
supplémentaire. Depuis 2006, la multiplication des espaces éditoriaux permet ainsi la
diffusion d’une recherche sur le tourisme au croisement de plusieurs traditions
disciplinaires : études du développement (Tiers Monde 2004), géopolitique (Hérodote
2007), sciences politiques (Politix 2007), etc. Plus directement orientées vers la
sociologie et l’anthropologie, les revues Autrepart (2006), Actes de la recherche en sciences
sociales (2007) et Civilisations (2008) ont également participé à ce tournant
épistémologique qui tend à réintégrer le tourisme comme objet légitime de la
connaissance scientifique. Or cette (re)découverte accompagne en réalité un
renouvellement théorique, une nouvelle manière d’interroger cet objet d’une
anthropologie de la mondialisation. Sans prétendre à l’exhaustivité, il s’agit de revenir
ici sur quelques articles choisis parmi ces trois dernières revues pour tenter d’aborder
quelques-unes des dynamiques qui traversent aujourd’hui ce champ en plein
renouvellement. En adoptant une perspective chronologique, on montrera ainsi
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
514
comment les publications se répondent et se complètent pour esquisser les bases d’une
nouvelle anthropologie du tourisme francophone.
Rompre avec le sens commun
2 Autrepart propose d’abord en décembre 2006 un numéro spécial coordonné par Anne
Doquet et Sara Le Menestrel. Les deux coordinatrices explicitent leur démarche en
introduction : « [...] depuis plusieurs années, les mouvements identitaires d’aujourd’hui
poussent les sciences humaines à mettre constamment en lien le local et le global, à
dépasser les frontières autrefois admises en leur accolant le préfixe “trans-” et à porter
leur attention sur les questions des réseaux. Constitué depuis toujours de mobilités et
de relations interculturelles, le tourisme, dont une importante branche se revendique
“culturelle”, apparaît comme un objet taillé pour cette perspective » (Doquet & Le
Menestrel 2006 : 4). Il s’agirait alors d’étudier le tourisme comme révélateur des
transformations sociales induites par la modernité. Le numéro parvient à dépasser la
reproduction d’une pensée aporétique sur le tourisme, en réfutant les oppositions
binaires habituellement mobilisées (eux/nous, visiteurs/visités, Nord/Sud, mobiles/
immobiles, dominants/dominés, etc.). Cette volonté de dépassement traverse le
numéro, à l’instar par exemple de l’article de Sandrine Gamblin. Refusant l’opposition
entre hosts et guests, l’auteure cherche à saisir « la rencontre touristique dans ce qu’elle
implique et signifie pour ces hommes en termes de choix de vie et de modalités
d’actions ». À partir des histoires de Goma’a, Sayd et Tala’at, trois Égyptiens suivis
pendant plus d'une décennie, l'auteure donne à voir la complexité d’une rencontre
touristique (Gamblin 2006 : 93). Pour les trois hommes dont on suit les trajectoires et
les parcours de vie, le tourisme apparaît comme une ressource plurielle : « Une
opportunité de réussite économique mais surtout [...] un espace interstitiel où
l’individu peut élaborer des stratégies d'action transversale et de négociation
identitaire dans une recherche de conciliation des valeurs d'ici et de là-bas ». Si la
rencontre touristique résulte d'un rapport de domination indéniable, elle ne s'y réduit
pas pour autant. Au contraire, elle apparaît productrice de sens et d’opportunités. Au
« touriste » ne s'oppose pas mécaniquement « le local », « l'indigène », « le visité » ; la
complexité des interactions et des jeux sociaux, explicitée par la démarche
ethnographique, appelle au contraire à une critique des catégories dont l'apparente
étanchéité participe en réalité à la production d'antagonismes raciaux et culturels.
Dans ce même numéro, la contribution d’Olivier Évrard poursuit cette critique d'un
sens commun en interrogeant le tourisme dit « domestique » à partir du cas
thaïlandais. Au Sud, les déplacements touristiques nationaux sont rarement intégrés
aux analyses anthropologiques et demeurent éclipsés par des mobilités internationales
qui semblent révélatrices de rapports de pouvoir plus explicites. Or Olivier Évrard
s'appuie sur ces pratiques encore mal étudiées pour nuancer une anthropologie du
tourisme dont il rappelle la dimension ethnocentrique. Et la figure d’un « Autre
touriste » émerge progressivement, un touriste aux désirs « asymétriques », distinct du
touriste occidental sans lui être différent. L'auteur écrit : « La façon dont le tourisme
[national] se développe [dans les pays du Sud] met incontestablement en jeu des
mécanismes sociologiques similaires à ceux observés en Occident. Néanmoins, ils
s’articulent dans des contextes historiques différents, selon des représentations et des
systèmes de valeurs spécifiques et avec des implications sociales ou politiques qui ne
sont pas forcément identiques à celles du tourisme international. Un regard comparé
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
515
met à jour moins des comportements différents que des désirs asymétriques [...]. Ces
asymétries ne renvoient pas à une “nature” distincte du tourisme en Occident et dans
les pays du Sud [...]. Elles expriment plutôt, sous la forme d’un jeu de miroir, les
inégalités économiques et les enjeux politiques de l’accès à la mobilité de loisir »
(Évrard 2006 : 165). L’article d’Olivier Évrard interroge ainsi les pratiques touristiques
comme pratiques socialement situées ; le tourisme domestique, pris dans le double jeu
des rapports de pouvoir mondialisés et nationaux, apparaît alors comme un objet
révélateur d’inégalités. À la fausse évidence culturelle — longtemps centrale dans les
réflexions anthropologiques sur le tourisme — l’auteur substitue une lecture plus
historique et sociale qui plaide pour un déplacement des problématiques sociologiques.
3 Le numéro d’Autrepart dont sont extraits ces deux articles revendique ainsi un
déplacement des questionnements et des problématiques. L'anthropologie du tourisme
tire son intérêt de la complexité de son objet. En rappelant la pluralité des pratiques et
la diversité des enjeux, ces recherches tentent de mettre à mal l'apparente simplicité
du tourisme et plaident pour l'investigation plus rigoureuse d'un objet trop longtemps
délaissé.
La rencontre en question
4 En décembre 2007, Actes de la recherche en sciences sociales propose à son tour un numéro
sur « les Nouvelles ( ?) frontières du tourisme ». Dès l’introduction, Franck Poupeau et
Bertrand Réau posent le cadre théorique en fonction duquel doivent s’organiser les
différentes contributions. La perspective retenue, principalement historique, vise à
« étudier les conditions sociales de l'économie du tourisme auquel participent
différents groupes sociaux : associations, États, organismes internationaux, opérateurs
privés, etc. ». La posture scientifique est assumée et, pour ces auteurs : « L’analyse des
conditions sociales invisibles qui produisent un déni du donnant-donnant
caractéristique du marché “parfait” permet de prendre en compte les mécanismes
d'euphémisation des rapports marchands et des relations de domination,
consubstantiels à un certain “enchantement du monde” touristique » (Réau & Poupeau
2007 : 10). La perspective est étroite et pourrait décevoir... La volonté théorique initiale
semble condamner l'analyse à une extension un peu vaine d’une lecture importée où le
dévoilement des logiques cachées se substituerait à la compréhension des relations
touristiques. Mais les contributions parviennent heureusement à s'écarter de cet
axiome introductif. L’article consacré aux « rencontres paradoxales du “tourisme
solidaire” » est à ce titre exemplaire (Chabloz 2007 : 32-47). À partir d’un terrain
conduit au Burkina Faso sur « la rencontre illusoire » entre « visiteurs français et
visités burkinabé », Nadège Chabloz interroge « les malentendus » de l’expérience
touristique. À partir d’un terrain intelligemment exploité, l’auteure aborde des
questionnements aujourd’hui incontournables en anthropologie du tourisme :
évolution des relations nouées, processus de commodification, production d’une forme
marchandisée d’authenticité, mise en scène et en récit, etc. La rencontre touristique
devient le révélateur d’une situation particulière traversée de rapports de force
inégaux, de représentations concurrentes et d’attentes impossibles toujours
contrariées. Cette approche ethnographique du malentendu impose nécessairement un
retour réflexif interrogeant la subjectivité du chercheur et l’inconfort de sa position.
L’ethnographie de Nadège Chabloz apporte ainsi une réflexion originale sur ces
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
516
tensions positionnelles exacerbées par l’anthropologie du tourisme et les techniques
d’enquête qu’elle requiert. Comment enquêter sur des pratiques touristiques lorsqu’on
est soi-même pris dans des jeux et des enjeux de racialisation, de classe ou de genre ?
L’enjeu est aujourd’hui central pour la connaissance du tourisme et traverse — de
manière plus ou moins assumée — la majorité des productions scientifiques actuelles.
Mais plutôt que d’avancer des prescriptions méthodologiques, l’auteure parvient plutôt
à situer le savoir qu’elle produit, renforçant encore davantage la pertinence de ses
analyses. Il s’agit moins de prétendre faire que de donner à voir, et les questions
soulevées par le processus d’enquête apparaissent comme un témoin supplémentaire
de la nécessité de renforcer le dialogue entre l’anthropologie du tourisme et les autres
sous-disciplines académiques davantage formalisées. Les dernières pages de ce numéro
d’Actes de la recherche en sciences sociales, signées Xavier Zunigo, méritent également une
attention particulière. Ina- boutie, incomplète, parfois exagérément simplifiée, cette
contribution illustre toutefois ces « Nouvelles frontières » que le numéro souhaitait
interroger. L’article est consacré à « [c]es centaines, voire [c]es milliers, de bénévoles
occidentaux se rendant à Calcutta pour travailler, quelques semaines ou plusieurs mois,
dans les centres d’accueil de malades, blessés ou mourants des Missionnaires de la
charité, l’ordre religieux fondé par Mère Teresa en 1950 » (Zunigo 2007 : 103). L’auteur
interroge le caractère « ambigu » d’un volontariat qui « peut être perçu comme une
pratique aussi bien humanitaire, caritative que touristique ». L’article propose ainsi une
réflexion originale sur les enjeux de la qualification touristique et le sens accordé à ces
mobilités de l’entre-deux. Cette contribution montre ainsi, à partir d’une situation
limite mais révélatrice, que les significations concurrentes accordées à la rencontre
touristique sont problématiques. Et si certaines questions sont malheureusement
absentes ou minorées (interrogation sur la portée morale et ethnique de l’engagement
et retour sur le processus d’enquête notamment), l’article de Xavier Zunigo, en
argumentant pour distinguer le tourisme d’une simple pratique de loisirs, soulève des
pistes prometteuses encore peu exploitées.
Tourisme et politique
5 Pour finir, Civilisations (2008), revue belge redynamisée au début des années 2000,
propose actuellement un numéro spécial sur le tourisme, coordonné de nouveau par
Anne Doquet accompagnée cette fois-ci d’Olivier Évrard. Le numéro développe une
analyse politique du tourisme et des logiques d’ordonnancement (ordering) qu’il
favorise. Parmi les différentes contributions, Saskia Cousin analyse les discours portés
sur le tourisme dit « culturel ». En étudiant ces activités moralement jugées bénéfiques,
l’auteure « propose une analyse historique de la construction en valeurs et en
discours » d’une forme différenciée de pratiques touristiques aujourd’hui encouragée
au niveau international. La perspective chronologique retenue permet à l’auteure
d’interroger la construction du culturel comme « cadre de légitimation »
internationalisé. Produites, la catégorie « culturelle » et les valeurs associées n’en sont
pas moins productrices ; distingué du tourisme de masse (i.e. populaire et mortifère), le
« bon » tourisme sert non seulement à hiérarchiser mais aussi à justifier. Et Saskia
Cousin d’écrire : « Le tourisme est présenté comme une mobilité idéale, une modalité
d’échange culturel et un outil de développement » ; étudiant plus particulièrement le
rôle de l’Unesco, elle explique : « [...] l’Unesco ne serait bientôt plus une instance de
légitimation du tourisme, mais le tourisme permettrait au contraire de légitimer
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
517
l’Unesco comme organisation transnationale » (Cousin 2008 : 54). Et derrière
l’apparente neutralité d’une forme de mobilité apparaît la dimension politique d’une
circulation organisée et pensée au nom de ses bénéfices moraux supposés ontologiques
(interconnaissance, échange, circulation, compréhension mutuelle, etc.). L’article de
David Goeury réfléchit également à ces processus d’ordonnancement qui révèlent la
dimension politique du tourisme. Sa contribution étudie l’un des deux postes frontières
qui séparent l’Inde et le Pakistan : Wagah Border, aujourd’hui promu par les deux
gouvernements rivaux comme attraction touristique. Depuis 2000, la fermeture
quotidienne du poste s’est transformée en une véritable cérémonie nationaliste attirant
un nombre croissant de visiteurs qui saluent à heures fixes la descente des drapeaux.
Or, pour David Goeury (2008 : 153) : « Ce tourisme de masse, même s’il se fait autour des
symboles de la nation, est un élément de pacification du lieu. Il permet de convertir un
espace de conflit en un espace de conciliation. » Le tourisme à Wagah est ainsi lu
comme un vecteur de communication, un outil dont le ritualisme guerrier favorise
paradoxalement « une première étape de la reconnaissance de l’Autre ». Les
contributions de Saskia Cousin et David Goeury, représentatives de la tonalité du
numéro, soulignent ainsi la dimension politique des phénomènes touristiques ; derrière
l’apparente futilité des pratiques de loisirs se dessinent en réalité des enjeux au cœur
des préoccupations contemporaines : mobilités, rapports de pouvoir, altérité,
circulation des phénomènes culturels, etc. La lecture du numéro montre
progressivement, par enquêtes successives, l’intérêt d’une anthropologie du tourisme
pour la compréhension des phénomènes liés à la « mondialisation ». L’étude des
échanges touristiques apparaît ainsi comme un terrain particulièrement favorable à
l’articulation entre le local et le global, une possibilité offerte d’étudier la réalité
concrète des transformations contemporaines.
*
6 De la critique des catégories de sens commun à la lecture du tourisme comme enjeu
politique, ces trois numéros spéciaux d’Autrepart, Actes de la recherche en sciences sociales
et Civilisations témoignent de la vivacité et du développement d’une pensée
contemporaine du tourisme. L’ambition théorique se développe au fur et à mesure des
parutions. La nécessité d’une justification se fait de moins en moins pressante et
l’analyse des phénomènes touristiques progresse parallèlement à sa reconnaissance. La
présentation croisée de ces numéros spéciaux est nécessairement limitée, mais il
importe d'insister sur leur cohérence et sur les nouvelles formes de dialogues qui se
sont instaurées parmi les spécialistes du sujet. En effet, le renouvellement théorique de
l'anthropologie du tourisme est aujourd'hui une entreprise collective menée par
quelques jeunes chercheurs spécialisés : Bertrand Réau, Saskia Cousin, Anne Doquet,
Olivier Évrard, etc. Les différentes parutions de numéros se répondent et le lecteur
averti trouvera une résonance entre les différentes publications mentionnées. Les
raisons de cette proximité — tant au niveau méthodologique qu’analytique ou éditorial
— tiennent certainement au faible intérêt que l’anthropologie du tourisme a longtemps
suscité dans l'espace académique, voire aux résistances qu'elle a dû affronter. Il est vrai
que certes, la dynamique actuelle qui traverse les sciences sociales, si elle est vive, n'en
demeure pas moins restreinte à quelques espaces limités où l’illégitimité de l’objet
« tourisme » ne contamine pas (trop ?) la science que l’on en fait1. Pour autant,
espérons que la multiplication récente des publications favorise une plus grande
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
518
diffusion des recherches sur le tourisme et suscite un intérêt dépassant les seuls
spécialistes du sujet ; la lecture de ces contributions différentes mais complémentaires
devrait plaider en ce sens.
BIBLIOGRAPHIE
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES
2007 « Les Nouvelles ( ?) frontières du tourisme », 170 (5), Paris, Éditions du Seuil.
ANTHROPOLOGIE ET SOCIÉTÉS
2001 « Tourisme et sociétés locales en Asie orientale », 25 (2).
AUTREPART
2006 « Tourisme culturel, réseaux et recompositions sociales », 40 (4), Paris, Armand Colin.
CHABLOZ, N.
2007 « Le malentendu. Les rencontres paradoxales du “tourisme solidaire” », Actes de la recherche
en sciences sociales, 170 (5) : 32-47.
CIVILISATIONS
2008 « Tourisme, mobilités et altérités contemporaines », 57 (1-2).
COUSIN, S.
2008 « L’Unesco et la doctrine du tourisme culturel », Civilisations, 57 (1-2) : 41-56.
DOQUET, A. & LE MENESTREL, S.
2006 « introduction : Tourisme culturel, réseaux et recompositions sociales », Autrepart, 40 : 3-14.
ETHNOLOGIE FRANÇAISE
2002 « Touristes, autochtones : qui est l’étranger ? », 32 (3), Paris, PUF.
ÉVRARD, O.
2006 « L’exotique et le domestique. Tourisme national dans les pays du Sud : réfléxions depuis la
Thaïlande », Autrepart, 40 : 151-167.
GAMBLIN, S.
2006 « Trois expériences égyptiennes de la rencontre touristique », Autrepart, 40 : 81-94.
GOEURY, D.
2008 « “Wagah Border” : mise en tourisme d’un rituel nationaliste à la frontière indo-
pakistanaise », Civilisations, 57 (1-2) : 139-154.
HÉRODOTE
2007 « Le tourisme : un théâtre géopolitique ? », 127.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
519
POLITIX
2007 « Pèlerinages », 77 (1), Paris, Armand Colin.
RÉAU, B. & POUPEAU, F.
2007 « L’enchantement du monde touristique », Actes de la recherche en sciences sociales, 170 (5) :
4-13.
TIERS MONDE
2004 « Les masques du tourisme », 178, avril-juin.
ZUNIGO, X.
2007 « “Visiter les pauvres”. Sur les ambiguïtés d’une pratique humanitaire et caritative à
Calcutta », Actes de la recherche en sciences sociales, 170 (5) : 102-109.
NOTES
1. Parmi ces initiatives, citons le séminaire que Saskia Cousin et Bertrand Réau coaniment depuis
2005 à l’EHESS — rejoints depuis septembre 2008 par Sylvain Pattieu — et qui constitue à l’heure
actuelle l’un des lieux les plus dynamiques de l'analyse sociologique et anthropologique du
tourisme.
RÉSUMÉS
L'anthropologie du tourisme francophone est longtemps restée à l'écart des publications les plus
réputées. La science du tourisme semblait contaminée par l'illégitimité de son objet et peinait à
s'affranchir des revues spécialisées — principalement anglophones — qui structuraient la
production scientifique. La publication récente de quelques numéros de revues généralistes
consacrées à l'anthropologie du tourisme témoigne toutefois de la vivacité d'un champ
d'investigation trop longtemps délaissé. En revenant sur la parution de trois revues
francophones (Autrepart, Actes de la recherche en sciences sociales et Civilisations), cette chronique
bibliographique esquisse quelques-unes des dynamiques qui traversent aujourd'hui l'analyse du
tourisme et souligne l'intérêt de la discipline pour la compréhension des phénomènes
contemporains.
The most reputable publications have long ignored the French anthropology of tourism. The
science of tourism appears to be contaminated by the subject's lack of legitimacy and has trouble
getting beyond the specialised—mostly Anglophone—publications, which lead the way in
scientific writing. However, the recent publication of articles on the anthropology of tourism in a
number of general interest publications, demonstrates that this long-neglected field is
flourishing. By examining three francophone journals (Autrepart, Actes de la recherche en sciences
sociales and Civilisations), this bibliographical record outlines a few of the trends that are currently
in vogue in tourism research, and stresses the importance of this discipline in understanding
contemporary phenomena.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
520
INDEX
Mots-clés : anthropologie, bibliographie, mondialisation, sociologie, tourisme
Keywords : anthropology, bibliography, globalization, sociology, tourism
AUTEUR
SÉBASTIEN ROUX
Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (CNRS-Inserm- EHESS-Université
Paris 13).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
521
L’anthropologie du tourisme etl’authenticité. Catégorie analytiqueou catégorie indigène ?Anthropology of Tourism and Authenticity. Analytical Category or Indigenous
Category?
Céline Cravatte
1 La catégorie d’authenticité apparaît de manière récurrente dans les travaux
d’anthropologie du tourisme. Cela n’est pas exclusivement propre au tourisme : elle est
aussi très présente dans les domaines de l’art ou de la consommation. Pourtant, les
anthropologues étudiant le tourisme ont tenté d’en faire un concept d’analyse à part
entière, rendant fréquemment floue la limite entre catégorie indigène (que nous
nommerons catégorie) et catégorie analytique (que nous nommerons notion). C’est
cette ambiguïté à propos de laquelle nous proposons ici une note de synthèse.
2 D’où vient cette ambiguïté ? Les anthropologues sont eux-mêmes des acteurs du
tourisme : le regard ethnologique a fortement contribué à former la catégorie
d’authenticité, en participant à l’idéalisation des sociétés « prémodernes » et les
anthropologues se sont souvent retrouvés en position de défendre ou de mettre en
cause la frontière entre leur activité et celle du touriste ; ils contribuent à informer le
regard touristique et prennent directement position à propos de cette préoccupation
d’authenticité. Le tourisme suscite donc des questionnements à propos des effets de
l’observation et de la production d’écrits anthropologiques. Par ailleurs, les chercheurs
qui ont tenté de bâtir une théorie générale du tourisme ont cherché à construire la
notion d’authenticité comme une caractéristique centrale du tourisme et le tourisme
comme un moyen d’éclairer la nature même de la modernité, puis de penser de
manière privilégiée les questions de la crise de la représentation et de la
postmodernité.
3 La notion d’authenticité, malgré les nombreux travaux qui l’ont mobilisée, n’est pas
stabilisée. Cela conduit certains auteurs à prôner son abandon en arguant qu’un même
concept utilisé dans plusieurs sens différents est un obstacle à la recherche plutôt qu’il
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
523
ne la stimule (Reisinger & Steiner 2006). Pourtant, la difficulté de stabilisation d’un
concept n’empêche pas sa portée heuristique ni sa richesse, ne serait-ce que parce
qu’elle oblige à expliciter les divergences.
4 Une autre option est de se détourner des débats à propos de la notion d’authenticité qui
seraient arrivés en bout de course, et de se contenter de voir en elle une catégorie à
analyser comme telle, si elle apparaît sur le terrain (Graburn à paraître). Pourtant, cette
catégorie « circule » justement parmi les différents acteurs du tourisme, dont les
anthropologues, et s’est transformée au cours du temps. Cette circonscription de
l’authenticité à une catégorie indigène élude le positionnement spécifique de
l’anthropologue. De plus, les tentatives de définitions successives de cette notion
peuvent éclairer celui qui cherche à étudier cette catégorie.
5 Nous revenons donc ici sur les tentatives de construction de la notion — ou des notions
d’authenticité — à partir d’un corpus de textes1 car elles impliquent des postures
différentes, parfois divergentes, qu’il est utile de clarifier. Ces textes étant souvent peu
connus du public francophone, nous les rapprochons d’études francophones portant
sur la notion d’authenticité dans d’autres domaines2. L’évolution de cette construction
marque aussi l’évolution de la manière dont les anthropologues ont progressivement
été conduits à penser leur positionnement dans le domaine du tourisme, mais aussi à
s’interroger sur leur discipline.
L'authenticité, une notion floue et fondatrice pourl'anthropologie du tourisme
6 D. MacCannell (1976 : 12) a introduit la notion d’authenticité dans les études
touristiques en l’associant à la modernité : « La modernité apparaît en premier lieu à
tout le monde comme elle est apparue à Levi-Strauss, comme des fragments
désorganisés, aliénants, inutiles, violents, superficiels, non planifiés, instables et
inauthentiques [...]. Les modernes pensent la réalité et l’authenticité comme étant
autre part : dans d’autres périodes historiques ou dans d’autres styles de vie plus purs
et plus simples »3. D. MacCannell se réfère également à E. Goffman (1973) qui montre
qu’il est nécessaire de mettre en scène la réalité en tenant un rôle : il ne s’agit pas
d’être, mais de contrôler les impressions des autres sur ce que l’on est pas en menant
un travail de mise en scène dans les interactions de la vie quotidienne. Pour D.
MacCannell, alors que dans les sociétés prémodernes, le maintien d’une distinction
normée entre le vrai et le faux est essentiel au fonctionnement d’une société fondée sur
les relations interpersonnelles, dans les sociétés modernes, suite à la multiplication des
rôles, la société est établie à travers des représentations de la réalité qui dépassent la
relation interpersonnelle. On assiste à un éloignement de la « vie réelle » caractérisant
la modernité, et en même temps à une fascination pour la « vie réelle » des autres, à
une tentative sans cesse renouvelée d’aller voir derrière les coulisses, cette tentative
s’incarnant dans le personnage du touriste4 (MacCannell 1976 : 92).
7 D. MacCannell prend à contre-pied une tradition d’opposition entre le vrai et le faux,
inaugurée par des écrits critiques sur le tourisme. Il remet en particulier en cause la
distinction fondamentale posée par O. J. Boorstin (1964) entre l’attitude touristique et
l’attitude intellectuelle : le touriste serait sans cesse trompé et se contenterait de
« pseudo-événements » et d’une connaissance faussée et superficielle de la réalité (et
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
524
donc inauthentique), alors que l’intellectuel dépasserait le tourisme et chercherait à
voir derrière les apparences, produisant ainsi une connaissance authentique5.
8 Pourtant, tout en érigeant l’authenticité comme une notion incontournable, il l’a tout
au plus illustrée et non définie, introduisant une source de confusion dans les études
touristiques entre un concept issu de la philosophie et une catégorie d’évaluation
utilisée par les touristes (Cohen 1988a : 373). De plus, si la recherche d’un ailleurs plus
authentique est prégnante dans les catégories touristiques, présupposer que tous les
touristes se sentent aliénés par la société moderne et sont en quête d’authenticité est
une hypothèse lourde, aussi lourde que de renvoyer systématiquement les touristes à
l’inauthenticité de leur expérience. Il y a ici un risque de généralisation non contrôlée
d’une préoccupation qui peut émaner de groupes sociaux spécifiques, auxquels les
anthropologues appartiennent. E. Cohen (1979) plaide pour des approches de moyenne
portée, et pour une phénoménologie de l’expérience touristique fondée sur une
approche plus empirique de la « quête » des touristes dont le cœur n’est pas
systématiquement « l’authenticité ». Il développe alors une typologie — plus théorique
qu’inductive — fondée sur le rapport que le touriste entretient avec sa société et avec la
manière dont il situe son centre électif. Il remet donc en partie en cause le projet de
fondation immédiate d’une théorie plus globale du tourisme censée nous informer sur
la nature de la société moderne. Pour T. Selwyn (1996)6, cette critique, fondée sur des
résultats de moyenne portée d’une approche ayant une portée théorique beaucoup plus
globale sur la nature même de notre société moderne ou postmoderne, est peu
pertinente. Ce dernier réaffirme qu’un intérêt principal des études sur le tourisme est
de poser des hypothèses sur la nature de la société moderne ou postmoderne. Cette
ambition de l’anthropologie du tourisme revendiquée par plusieurs chercheurs permet
de comprendre que l’authenticité n’y est pas traitée uniquement comme une notion
indigène, mais comme un concept d’analyse qui a été redéfini à plusieurs reprises.
9 Parmi ces amendements de la notion d’authenticité, la distinction entre « authenticité
chaude » et « authenticité froide » (ibid.) est centrale pour rétablir la frontière entre
anthropologues et touristes. Elle permet de penser l’originalité de l’expérience
touristique tout en maintenant conjointement une distinction ontologique entre
approche scientifique, débats de connaissances et approche touristique. L’authenticité
« chaude » est liée à la sensation de sortir de cette fragmentation propre à la société
moderne. L’authenticité « froide » appartient au registre de la connaissance ; elle se
réfère à la qualité des connaissances acquises par les touristes. Cette distinction a été
tardive. Dans l’ouvrage de D. MacCannell — et dans d’autres approches ultérieures — la
sensation d’authenticité, la qualité de la connaissance acquise, et la capacité de voir
derrière les coulisses ne sont pas distinguées.
L'authenticité chaude et/ou existentielle
10 Comment donner un contenu à ce concept « d’authenticité chaude » ? Nous nous
appuierons ici sur les travaux de T. Selwyn et de N. Wang. Cette « authenticité chaude »
se fonde sur des « mythes » touristiques, c’est-à- dire, au sens de Lévi-Strauss, des
histoires ayant pour fonction de prendre en charge des problèmes sociaux et
personnels de telle manière que ces problèmes semblent résolus (Selwyn 1996 : 3). T.
Selwyn décrit le mythe de l’autre authentique, de l’authentiquement social et le mythe
du soi authentique tels qu’ils apparaissent dans les brochures touristiques. Le mythe de
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
525
l’autre authentique, repose sur l’idée que l’« autre » visité appartient à un groupe
authentiquement social, un groupe prémoderne, prémarchand, holistique, harmonieux
et bienveillant. L’autre authentique est lié à la pureté et à la nostalgie de formes de vie
perdues dans nos sociétés. Ce mythe est prégnant dans certaines formes de tourisme et
est fréquemment analysé à travers l’étude de brochures et l’analyse de récits de voyage
(Girard 1996, 2001). Ce mythe de l’authenticité ne s’exprime pas uniquement dans le
domaine du tourisme. J.-P. Warnier (1996) analyse la demande de marchandise
authentique comme une manière de gérer la modernité et ses contradictions, qui
s’appuie sur la conviction que le vrai repose dans l’ailleurs. Pourtant, le mythe de
l’authentique présenté par T. Selwyn (1996) peut aussi n’être finalement pas déterminé
par un code spécifique fondé sur la nostalgie d’une période idéalisée. En effet, le mythe
du « soi authentique » observable dans les brochures met en scène un « soi » affranchi
de l’identification à un groupe, des contraintes morales et sociales. Paradoxalement,
alors que l’authentiquement social réclame une intégration forte dans un groupe
donné, le mythe du soi authentique consiste à être affranchi des contraintes sociales ; le
touriste, libéré des contraintes quotidiennes, peut prendre un authentique bon temps,
authentiquement hédoniste.
11 N. Wang, quant à lui, adopte une posture qui ne s’appuie pas a priori sur l’analyse des
mythes existants et de leur structuration, et a une portée plus large que l’analyse du
tourisme. Il définit « l’authenticité existentielle » comme « un état existentiel dans
lequel chacun serait fidèle à lui-même, qui agirait comme un antidote face à la perte du
“vrai soi” dans les rôles et les sphères publics de la société occidentale moderne »7
(Berger, cité dans Wang 1999 : 358), dont l’authenticité chaude est une forme parmi
d’autres. On se demande toutefois dans quelle mesure il est possible d’être vrai ou faux
avec soi-même. La réponse ne peut être proposée qu’en analysant l’idéal de
l’authenticité tel qu’il est constitué dans les sociétés modernes. Cet idéal peut être
caractérisé soit par la nostalgie (impression que d’autres formes de vie, qui
correspondent à notre passé, sont plus pures, plus spontanées, plus vraies), soit par le
romantisme (exaltation des sentiments, des sensations et de la spontanéité en
contrepoint de vies quotidiennes caractérisées par la rationalité moderne)8.
L’authenticité existentielle intra-personnelle implique une expérience corporelle de
l’authenticité ou la réalisation de soi en dehors de la routine quotidienne.
L’authenticité existentielle interpersonnelle est liée au sentiment d’appartenance à une
communauté9 ; les touristes recherchent un rapport authentique entre eux avant de
rechercher ce rapport avec les autres. Ce n’est donc plus nécessairement l’autre qui est
le lieu de la réalisation de cet authentiquement social — à travers le mythe de
l’authentiquement social — mais un groupe d’appartenance qui permet de ressentir
cette émotion communautaire, que ce soit la famille ou le groupe de touristes.
12 Ces constructions théoriques de l’authenticité chaude présentent l’intérêt de théoriser
ce qui est en jeu pour les touristes, et d’étudier la manière dont des mythes
identifiables et descriptibles structurent l’expérience touristique, sans confondre cette
recherche d’authenticité avec l’exigence de connaissances. Elles rappellent également
la dimension rituelle et extraordinaire de l’expérience touristique. Reprocher à
l’expérience touristique de se contenter d’accumuler des souvenirs et de ne pas assez
accéder à des connaissances d’ordre scientifique — à savoir de manquer l’authenticité
froide — consisterait à manquer la logique de l’expérience touristique (Girard 2001).
Pourtant, ces constructions ont davantage été utilisées pour décrire des mythes, des
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
526
états, que pour analyser leur genèse ou les conditions de félicité de l’authenticité. Cette
notion d’authenticité chaude est-elle complètement déconnectée de celle de
l’authenticité froide ? Quels peuvent être les liens entre ces deux formes
d’authenticité ?
Authenticité réelle, authenticité mise en scène
13 Lorsque D. MacCannell place le concept d’authenticité au centre de la quête du touriste
et de la modernité, il montre dans le même temps que les touristes peuvent être dupés
ou voir leurs espoirs déçus. Il leur est difficile d’accéder à l’arrière des coulisses ; il peut
y avoir un enfilement de façades, dont certaines se présentent comme des coulisses, et
sont mises en scènes à destination des touristes. Il s’agit alors « d’authenticité mise en
scène ».
14 Cette peur de la fraude et de la mise en scène hante d’ailleurs de très nombreux
touristes, et est elle-même une catégorie indigène. Des touristes craignent eux-mêmes
la destruction de l’authenticité d’un événement dès qu’il est fait « pour les touristes ».
Même si D. MacCannell refuse la séparation posée par les « intellectuels » entre la quête
du touriste et celle des intellectuels, il utilise ici un critère qui relève de la démarche
intellectuelle et de l’authenticité froide (au sens de T. Selwyn) et l’attribue aux
touristes. Une application de cette notion de « mise en scène de l’authenticité », est
proposée par E. Cohen (1989), à travers la notion d’« authenticité communicative ». Il
montre de quelle manière les petites agences de tourisme du Nord de la Thaïlande
construisent les tribus montagnardes comme « primitives et éloignées », en donnant
une impression de naturalité, de pureté, d’aventure, et le sentiment de pénétrer dans
des territoires inexplorés. Cette construction est réalisée par les prestataires de
tourisme et doit être d’autant plus subtile que les touristes — trekkeurs et routards —
fréquentant ces zones sont très suspicieux et à la recherche d’une expérience
alternative qui permette d’échapper aux mises en scènes touristiques classiques. On
observe donc dans ce cas une mise en scène reposant essentiellement sur la
mobilisation de discours, mais ne devant pas être identifiée par les touristes comme
une mise en scène.
15 Il devient alors possible de mettre en place une matrice croisant d’une part les
différents types de situations touristiques, d’autre part l’impression que les touristes en
retirent, pour montrer que les situations touristiques ne se réduisent pas toutes à une
situation d’authenticité mise en scène (Cohen 1988b : 26).
Matrice d’analyse des situations touristiques
Impressions que les touristes ont de la scène
Réelle Mise en scène
Nature de la situation Réelle Authentique (1)Déni de
l’authenticité (2)
Mise en scène Authenticité mise en scène (3) Artificielle (4)
Source : Cohen (1988b : 26), ma traduction.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
527
16 Cette matrice montre l’importance de l’interprétation de la situation de la part des
touristes ; elle permet de prendre en compte la diversité des réactions du public face à
une même situation, mais aussi invite à rechercher les signes qui font qu’une situation
peut être reconnue ou contestée comme « authentique » par des touristes. Par exemple,
certains touristes s’offusquent de la présence d’éléments « modernes » dans la
réalisation des danses, qui sont interprétés comme un signe de manque d’authenticité,
en référence à un passé idéalisé, et comme une dégradation (2). Ils s’appuient ainsi sur
des traits du « mythe de l’autre authentique » pour juger du caractère authentique ou
inauthentique de la situation. D’autres, en revanche, interprètent des scènes trop
conformes à une réalité historique figée et passéiste comme une situation artificielle ;
les éléments de la modernité seront pour eux des signes de l’authenticité de
l’événement (4).
17 Les touristes ayant réalisé un trek dans les ethnies montagnardes thaïlandaises vivent-
ils une expérience authentique ? Au sens de « l’authenticité chaude », oui, parce que
cette expérience présente les signes d’un mythe préexistant reconnus par ces touristes.
Pourtant, Selon E. Cohen, ils n’ont pas eu accès à une situation « réelle » mais à une
situation mise en scène (3). Quels sont les critères utilisés par l’anthropologue pour
déterminer la « nature » de la situation ? L’anthropologue, à la différence du touriste,
peut- il si aisément statuer sur cette nature ? Sans plaider pour une assimilation entre
touriste et anthropologue, nous tenons à rappeler la fragilité de cette frontière. En
même temps qu’ils analysent la manière dont se construit l’authenticité, les
anthropologues utilisant la grille ci-dessus mobilisent également leur propre catégorie
quant à l’authenticité de la scène, puisqu’ils prennent position sur la nature de la scène,
et comparent cette catégorie à celle des touristes, sans toujours expliciter la manière
dont elle est construite.
18 Par la suite, des chercheurs vont tenter de statuer sur l’authenticité d’une expérience
relevant de l’authenticité mise en scène, en ne faisant plus de la mise en scène un
caractère discriminant de l’authenticité de la situation.
Authenticité émergente, marchandisation et fauxauthentiques
19 Que se passe-t-il si une « authentique » mise en scène destinée au touriste devient un
événement « authentiquement social » pour les protagonistes de la représentation, ou
une pratique culturelle reconnue comme authentique par tous les protagonistes ? C’est
à cette question que s’attache le concept « d’authenticité émergente » : une
représentation pouvant être analysée comme fausse car créée uniquement en vue des
touristes (au sens de l’authenticité mise en scène), peut cependant devenir une
pratique reconnue comme authentique par les personnes habitant sur place (Cohen
1988a).
20 Ce concept d’authenticité émergente permet d’éclairer la notion de
« marchandisation » de la culture, dont les travaux successifs de sociologie du tourisme
ont montré le caractère non univoque (Graburn à paraître ; Selwyn 1996). Cette
question a en effet très tôt préoccupé les anthropologues, dérangés sur leur terrain par
l’arrivée de touristes, perçue comme un danger et redoutant, pourrait-on dire, la perte
d’une authenticité prémarchande et « prétouristes ». La mise en tourisme est un
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
528
mouvement de sélection des signes et de traits pertinents qui vont constituer le
répertoire à jouer face au touriste. La marchandisation conduit de son côté à conférer
une valeur marchande à des pratiques qui en étaient dépourvues auparavant ; cela
comporte le risque que l’apport de revenus devienne l’objectif principal de pratiques
qui remplissaient une autre fonction au préalable, et qu’elles soient modifiées pour
satisfaire les touristes et non plus pour remplir cette fonction initiale. Il y aurait donc
un détournement du sens conféré aux pratiques culturelles, à partir du moment où la
culture serait vendue « au kilo » (Greenwood 1977). Plusieurs anthropologues ont
dénoncé ce qui risquait de mener à une perte, c’est d’ailleurs ce qui les a conduits
initialement à s’intéresser au tourisme (Graburn 2002).
21 Pourtant, de nombreux articles ont montré que la marchandisation ne menait pas
nécessairement à une perte irrémédiable d’authenticité, mais pouvait être un moyen de
rendre plus vivace certaines pratiques aux yeux des autres. C’est la thèse de l’involution
culturelle que Mac Kean (1977) a développée pour Bali. Par exemple, la venue de
touristes pour les célébrations de la semaine sainte à Malte permet aux villageois de
renégocier leurs frontières sociales et cette célébration a acquis une nouvelle
signification. La marchandisation de l’événement n’a donc pas eu un effet radicalement
transformateur, ni destructeur, mais a doté cette célébration d’une nouvelle
signification pour les villageois (Boissevain 1996). Inversement, des groupes adoptent
les catégories ethnologiques pour se définir, ce qui peut les conduire à organiser les
événements culturels selon « un modèle figé qui pourtant n’était au départ que le rêve
d’un regard extérieur en quête d’un passé perdu » comme dans le cas des Dogons. Cette
adoption du regard ethnologique, qui permet de parler de « société ethnologisée »10,
devance même la mise en marché de ces danses à des fins touristiques, et tend à
annihiler la fonction sociale de ces danses (Doquet 1999 : 290).
22 T. Selwyn (1996 : 23), enfin, évoque les expériences « authentiquement sociales »
pourtant fondées sur des faux. C’est ainsi que le mémorial d’Hiroshima — reconstruit
pour les touristes sous sa forme à moitié détruite — peut provoquer une expérience
authentiquement sociale de renforcement d’un sentiment de souffrance marquant ainsi
le sentiment d’appartenance à un collectif. Il s’agit alors d’un « faux authentique »
(Brown 1996, 1999). Ces expériences touristiques sont « authentiquement sociales ». Il y
a là un glissement conceptuel. Autant les traits caractéristiques de « l’autre
authentique » et du « soi authentique » constituent des mythes particulièrement
prégnants aux contours spécifiés dans le tourisme, autant, dans ce dernier cas, il ne
s’agit plus d’un mythe mais d’une interprétation sociologique de ce qui se passe lors de
cette pratique touristique, à savoir une expérience « authentiquement sociale ».
23 Pourtant, décider qu’un événement devient « authentiquement social » nécessite
également de la part de l’anthropologue des critères de discrimination de ce qui est ou
n’est pas authentiquement social, qui ne sont pas vraiment explicités dans les articles
étudiés. Nous reposons ici la question des critères utilisés par l’anthropologue pour
statuer de l’authenticité sociale de la situation. La marchandisation est alors un
processus tellement équivoque que l’on se demande s’il est nécessaire de regrouper les
phénomènes observés sous la même catégorie d’analyse. La notion d’authenticité
émergente permet de penser le caractère évolutif de l’authenticité et l’impossibilité de
se référer à un original. Se pose alors la question de la manière dont des objets ou des
situations sont authentifiés.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
529
Les procédures d'authentification et leur analyse
24 Rappelons que la question de l’authenticité n’est pas seulement posée pour analyser la
quête des touristes, mais est également mobilisée par des groupes professionnels —
auxquels les anthropologues peuvent appartenir — qui discriminent le vrai et le faux et
chassent la fraude. « Il n’est pas d’authenticité sans procédure d’authentification »
(Heinich 1999). Ainsi, ce n’est plus l’authenticité, mais les procédures
d’authentification, l’identification des critères mobilisés dans ces procédures et les
groupes d’acteurs réussissant à imposer ces critères qui ont été constitués en objet
d’étude. J.-P. Warnier (1996) propose un sens très large aux procédures
d’authentification, qui sont plus ou moins institutionnalisées et peuvent aller du label
ou de l’expertise au bricolage personnel ou à différentes manières de singulariser des
biens (ré-étiquetage, récits entourant les marchandises). La notion même de procédure
d’authentification assouplit le cloisonnement analytique entre authenticité froide et
authenticité chaude. Pourtant, peut-on parler de « procédures » dans le cas de la
reconnaissance d’une authenticité chaude ou existentielle ? Il conviendrait sans doute
plus de parler des conditions de réalisation de cette authenticité existentielle11.
Pourtant, celles-ci sont liées à des opérations d’authentification, qu’elles soient
explicitées ou non. L’objet de l’anthropologue serait d’étudier l’articulation entre ces
différents types de reconnaissance de l’authenticité. Quels sont les groupes qui ont plus
ou moins de pouvoir dans la manière de sélectionner les traits pertinents à présenter
au touriste et donc de définir l’authenticité ? Comment la définition de ces traits
évolue-t-elle ? L’approche interactionniste située proposée plus haut ne s’interroge pas
sur la construction de ces critères d’authentification ni sur les conditions de félicité de
l’authenticité chaude.
25 La notion d’authentification ne présuppose pas a priori non plus un contenu ni une
structure mythique spécifique attribuée à l’authenticité. J.-P. Taylor (2001) propose de
distinguer deux acceptions souvent mélangées dans la notion d’authenticité, et
distingue la « mise en scène de l’authenticité », qui répond avant tout au désir d’un
ailleurs exprimé par une pensée caractéristique de la modernité, et la « sincérité » qui
porte sur la qualité de la relation entre touristes et prestataires et n’apparaît pas
comme « une qualité interne de la chose, du soi, ou de l’autre ». Certains opérateurs
utilisent cette deuxième notion pour « casser » la vision atemporelle de leur culture qui
peut être impliquée par le mythe de l’authenticité. Ce passage de l’authenticité à la
sincérité semble étroitement lié à l’évolution de l’anthropologie du tourisme, qui est
passée d’une étude des « impacts » exogènes sur des groupes humains a priori fragiles à
une logique ne considérant plus le tourisme comme exogène aux populations qui
contribuent à son développement.
26 Comme nous l’avons souligné, la notion d’authenticité n’est pas stabilisée et tous les
auteurs ne limitent pas, comme le fait J.-P. Taylor, la notion d’authenticité au mythe de
« l’autre authentique ». La qualité de la relation entre prestataire et touristes, nommée
« sincérité » peut être authentifiée (ou non), mise en scène ou réelle, reconnue ou
déniée, et reflète la peur de relations inauthentiques, au sens de D. MacCannell. Peut-on
dire pour autant qu’elle ne rentre pas dans la notion plus générale de l’authenticité et
qu’il faudrait limiter l’authenticité au contenu du mythe de l’autre authentique, décrit
par T. Selwyn ? Il est en fait difficile de réduire cette notion à un mythe structurant
ayant un contenu précis et stabilisé (on peut sans doute y retrouver le « code » de
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
530
l’authenticité, faisant référence à une époque antérieure idéalisée, mais on peut aussi y
trouver la notion de singularité, de sincérité, voire d’intériorité). Ce qui est reconnu
comme « authentique » n’est pas non plus extensible à l’infini, mais évolue. Il est
d’ailleurs possible que le mythe de l’autre « authentique » et prémoderne devienne de
moins en moins prégnant et paraisse inauthentique et frelaté à ceux qui seront en
quête d’authentique sincérité.
27 La pensée de cette évolution sur le long terme des modes d’authentification conduit
également à se poser la question du rôle des logiques marchandes d’authentification et
de leur acceptabilité par les touristes. Par exemple, G. Hughes (1995) analyse deux
modalités de création de l’authenticité ; la première s’appuie sur la question de
« l’héritage », tel qu’il est perçu par certains habitants d’Écosse, afin de mettre en place
certains traits identitaires à présenter à l’extérieur ; la seconde, consiste à s’appuyer
sur une analyse des représentations préalables des consommateurs12. Ces modalités
différentes de construction de l’authenticité font appel à des groupes de professionnels
différents : ethnologues ou historiens dans un cas, experts du marché et des
représentations du consommateur dans l’autre.
28 N. Wang (1999) propose finalement d’analyser les catégories utilisées par les touristes,
en étudiant la manière dont ceux-ci recoupent les différents paradigmes théoriques de
l’authenticité, l’authenticité objective, l’authenticité constructiviste, l’authenticité telle
qu’analysée par les tenants du postmodernisme13 et l’authenticité existentielle. Les
anthropologues interrogent l’évolution du paysage intellectuel des faiseurs de
tourisme, ainsi que les critères d’évaluation des faiseurs de musées ; ils montrent que
ces critères se déplacent de la question de la justesse scientifique vers l’efficacité
émotionnelle et commerciale (Selwyn 1996). Il y aurait un effondrement des frontières,
et donc une indifférenciation entre histoire et commémoration, schèmes narratifs et
populations, expérience touristique et éducation (Urry 1990).
Que devient l'authenticité ? Est-il possible de produiredes critères distinguant authentique etinauthentique ?
29 Revenons à une vision plus théorique et globale, et au projet originel de D. MacCannell.
Que devient alors l’authenticité, toujours analysée comme un révélateur de la société
moderne ? Comment analyser cette transformation de la recherche d’authenticité, et le
relatif brouillage de la catégorie d’authenticité ?
30 Plusieurs auteurs resituent la question de l’authenticité dans une perspective plus
large. J.-P. Warnier (1994) propose de comprendre pourquoi les utopies de notre société
se concentrent sur le développement d’une culture matérielle de l’authenticité. T.
Selwyn (1996) montre que les fondements de la quête d’authenticité ont été en partie
sapés par l’avènement de la pensée postmoderne. Cette pensée a en effet remis en cause
la distinction entre pensée touristique et pensée anthropologique qu’elle présente
comme des narrations indifférenciées. L. Boltanski et E. Chiappello (1999) interrogent la
potentialité critique de nos sociétés modernes liée à la notion d’authenticité face à
l’extension du « nouvel esprit du capitalisme ».
31 Arrêtons-nous sur les postures normatives des deux derniers auteurs. T. Selwyn
affirme, en s’appuyant sur la distinction entre authenticités chaude et froide, qu’il est
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
531
essentiel de garder intacte la frontière entre les discours de commémoration et les
analyses scientifiques, entre authenticités chaude et froide. Autrement dit, les
ethnologues doivent faire reconnaître leurs propres procédures qui permettent de
produire les discours, et ce, pour trois raisons principales. Tout d’abord, ils doivent
maintenir la possibilité de production du savoir comme différente de celle de la
production de formes de gratifications narratives. Ils doivent ensuite exercer une
pensée critique à propos de processus de prises de décisions qui risqueraient de se
fonder plus sur les « mythes touristiques » que sur une description claire et
dépassionnée des faits. Enfin, ils doivent éviter de prendre le risque de ne laisser
d’autres possibilités de réaction aux populations réceptrices que de fonder d’autres
schèmes narratifs qui ne pourraient pas se faire reconnaître comme plus ou moins
légitimes que d’autres (Selwyn 1996 : 36). Cela signifie que les anthropologues, dans la
mesure où il est fait appel à eux, sont en même temps analyseurs de la production des
critères d’authenticité, mais peuvent aussi rester eux-mêmes producteurs et garants de
certains de ces critères d’authenticité. Pourtant, dans les articles que nous avons
étudiés, nous avons vu que ces critères n’étaient pas toujours clairement définis, qu’il
s’agisse de critères permettant de déterminer la nature de la situation ou le caractère
authentiquement social d’une expérience.
32 L. Boltanski et E. Chiappello montrent qu’il subsiste une potentialité critique dans la
méfiance des consommateurs face aux biens singuliers et authentiques produits suite à
des procédures de codification. Le caractère standardisé des biens vendus engendre
également l’inauthenticité puisque ces biens perdent leur singularité, qui est aussi une
caractéristique de l’authenticité. Le marché codifie les caractéristiques authentiques
dans une visée de reproduction, selon des combinatoires qui permettent la mise en
avant de la différence. Cette codification risque néanmoins dès lors de jeter le soupçon
sur l’authenticité de ce qui est produit (Boltanski & Chiapello 1999 : 529-546).
N’oublions pas que l’authenticité renvoie à des temps préindustriels et prémarchands
idéalisés. « Dans le bien authentique, le plaisir [...] dépend aussi du dévoilement de
significations et de qualités cachées au cours d’une relation singulière. Or la
codification, sur laquelle repose la reproduction, tend à limiter la diversité des
significations qui peuvent être extraites du bien. Dès lors, une fois reconnues les
significations intentionnellement introduites par l’intermédiaire du codage, le bien
tend à perdre de son intérêt » (ibid. : 539). À nouveau, cette affirmation demande une
étude empirique plus poussée des doutes que peut émettre le touriste, et de ce qui met
en danger la reconnaissance de l’authenticité. Pourtant, la notion d’authenticité
émergente remet en cause et brouille l’idée de marchandisation de l’authenticité.
*
33 Cette note critique recense donc les différentes acceptions de la notion d’authenticité.
Elle montre comment l’utilisation de cette notion questionne et réaffirme la frontière
entre l’authenticité de l’anthropologue et celle des touristes : les anthropologues ont pu
dénier l’authenticité de l’expérience touristique, ou ont étendu à l’ensemble du
tourisme un postulat de quête d’authenticité pour penser la société moderne ; ils ont
limité cette préoccupation à certaines catégories de touristes dans une perspective
phénoménologique ; ils ont proposé de distinguer l’authenticité chaude (du touriste) de
celle froide (du scientifique), pour établir une frontière entre les deux démarches ; ils
ont analysé le caractère mis en scène de l’authenticité (en s’octroyant le pouvoir de
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
532
déterminer le caractère réel de la scène) tout en reconnaissant que de cette mise en
scène naît une authenticité émergente « authentiquement sociale » (en déterminant
eux-mêmes ce qui était « authentiquement social ») ; ils ont enfin décrit les procédures
d’authentification à l’œuvre en questionnant la place de leurs procédures
professionnelles. Ce panorama des différentes approches invite donc à se poser
certaines questions avant de mobiliser la notion d’authenticité ou d’étudier la catégorie
d’authenticité.
34 La notion d’authenticité, telle que définie par des travaux d’anthropologie du tourisme,
s’appuie sur une catégorie très présente chez les acteurs du tourisme14. Elle a été
construite comme une notion par ces travaux afin de poser la question de la modernité
et la manière dont y émerge une réaction à son « inauthenticité » perçue. Cette
approche anthropologique relève de postulats lourds : pour quels acteurs cette
perception d’inauthenticité estelle elle-même avérée ? Peut-on définir de manière
générique le tourisme comme une quête d’authenticité (que celle-ci soit chaude,
existentielle, mise en scène ou émergente) ?
35 Comment caractériser la catégorie d’authenticité ? Des anthropologues ont ainsi défini
l’authenticité comme un mythe structuré propre à la société moderne, pouvant
prendre plusieurs formes : le mythe de l’autre authentique — impliquant
l’établissement de la vérité et de la pureté dans un lieu différent de notre société auquel
le regard ethnologique a contribué — et le mythe du soi authentique — s’appuyant sur
la libération romantique des contraintes. Le tourisme peut-être analysé comme un lieu
— parmi d’autres — de production et d’actualisation d’utopies. L’utopie de
l’authenticité a un contenu spécifique. Pourtant, les définitions successives de
l’authenticité ne se sont pas limitées à un contenu figé : à partir du moment où l’on
s’intéresse aux procédures d’authentification, on observe que la définition du contenu
même de l’authenticité devient plus labile, sans pour autant perdre l’idée qu’il faille
aller ailleurs pour chercher le pur et le vrai. Définit-on l’authenticité par le contenu
d’un mythe (dans ce cas, on peut opposer authenticité et sincérité) ou par le résultat de
procédure d’authentification ?
36 Nous nous sommes par ailleurs appuyée sur une distinction analytique qui refonde la
distinction entre l’authenticité chaude recherchée par le touriste et l’authenticité
froide, rappelant que l’anthropologue avait ses propres critères d’authentification ; la
question de la manière dont ces procédures d’authentification sont imbriquées — ou
parfois confondues — avec les conditions de félicité de l’authenticité chaude semble
centrale pour la définition du rôle que l’anthropologie peut avoir à jouer. Peut-on
parler de « procédure » d’authentification alors qu’il conviendrait parfois de se
demander quelles sont les conditions de félicité de ces situations d’authenticité chaude
ou existentielle ? Ces situations relèvent certes de la reconnaissance de signes, mais
cette reconnaissance est peu procédurale et laisse d’ailleurs une large place à l’émotion.
À propos des procédures d’authentification, quels sont les critères qui permettent à
l’anthropologue de statuer sur le caractère authentique ou non de la nature d’une
situation et sur son caractère « authentiquement social » ?
37 Il reste encore un sérieux fossé entre une pensée globale théorique de la notion
d’authenticité et l’étude empirique de la production des instances — plus ou moins
formelle — d’authentification des expériences touristiques et des précautions à prendre
lors de l’utilisation de cette notion ou de l’étude de cettes catégorie.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
533
BIBLIOGRAPHIE
BERGER, P.
1973 « “Sincerity” and “Authenticity” in Modern Society », Public Interest, 31: 469-485.
BOISSEVAIN, J.
1996 « Ritual, Tourism and Cultural Commoditization in Malta », in T. SELWYN (ed.), The Tourist
Image: Myths and Myth Making in Tourism, London, Johm Wiley & Sons Ltd.: 105-117.
BOLTANSKI, L. & CHIAPELLO, E.
1999 Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.
BOORSTIN, O. J.
1964 The Image: A Guide to Pseudo-event in America, New York, Harper and Row.
BROWN, D.
1996 « Genuine Fakes », in T. SELWYN (ed.), op. cit.: 33-47.
1999 « Des faux authentiques. Tourisme versus pèlerinage », Terrain, 33 : 41-56.
BURGELIN, O.
1967 « Le tourisme jugé », Revue Communications, 10 : 65-95.
COHEN, E.
1979 « A Phenomenology of Tourist Experience », Sociology, 13: 179-201.
1988a « Authenticity and Commoditization in Tourism », Annals of Tourism Research, 15: 371-386.
1988b « Traditions in Qualitative Sociology in Tourism », Annals of Tourism Research, 15 (1): 29-46.
1989 « “Primitive and Remote” Hill Tribe Trekking in Thailand », Annals of Tourism Research, 16:
30-61.
2002 « Book review: “Tourism and Modernity: A Sociological Analysis”, Ning Wang », Journal of
Retailing and Consumer Services, 9: 56-58.
DOQUET, A.
1999 Les masques dogon. Ethnologie savante et ethnologie autochtone, Paris, Karthala.
GIRARD, A.
1996 Expériences touristiques et régime du patrimoine culturel-naturel : éléments pour une sociologie
critique du tourisme, Thèse de doctorat, Aix-en-Provence, université de Aix-Marseille 1.
2001 « Comprendre l’expérience touristique : une reconstruction critique de l’esthétique
touristique », Les Cahiers de l’IRSA, 5 : 99-125.
GOFFMAN, E.
1973 La mise en scène de la vie quotidienne, 1. La présentation de soi, 2. Les relations en public, Paris, Les
Éditions de Minuit.
GRABURN, N.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
534
2002 « The Ethnographic Tourist », in G. M. S. DANN (ed.), Tourist as a Metaphor of the Social World
(New York): 19-39.
à paraître « The Place of the Study of Tourism in Contemporary Anthropology », in B. MARGARITA
(ed.), Existe uma Antropologia do Turismo ? Tendências Contemporâneas, Rio de Janeiro, Papyrus Press.
GREENWOOD, D. J.
1977 « Culture by the Pound : An Anthropological Perspective on Tourism as Cultural
Commoditization », in V. SMITH (ed.), Hosts and Guests, Philadelphia, University of Pennsylvania
Press: 129-137.
HEINICH, N.
1999 « Art contemporain et fabrication de l’inauthentique », Terrain, 33 : 5-16.
HUGHES, G.
1995 « Authenticity in Tourism », Annals of Tourism Research, 22 (4): 780-803.
MACCANNELL, D.
1976 The Tourist, A New Theory of the Leisure Class, Berkeley-Los Angeles- London, University of
California Press.
MAC KEAN, P. F.
1977 « Towards a Theoretical Analysis of Tourism: Economic Dualism and Cultural Involution in
Bali », in V. SMITH (ed.), Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism, Philadelphia, University of
Pennsylvania Press: 93-107.
REISINGER, Y. & STEINER, C. J.
2006 « Reconceptualizing Object Authenticity », Annals of Tourism Research, 33 (1): 65-86.
SELWYN, T.
1996 « Introduction », in T. SELWYN (ed.), op. cit.: 1-31.
TAYLOR, J.-P.
2001 « Authenticity and Sincerity in Tourism », Annals of Tourism Research, 28 (1): 7-26.
URRY, J.
1990 The Touristic Gaze, London, Sage.
WANG, N.
1999 « Rethinking Authenticity in Tourism Experience », Annals of Tourism Research, 26 (2):
249-370.
WARNIER, J.-P. (dir.)
1994 Le paradoxe de la marchandise authentique. Imaginaire et consommation de masse, Paris,
L’Harmattan.
1996 « Introduction : Les processus et procédures d’authentification de la culture matérielle », in
J.-P. WARNIER (dir.), Authentifier la marchandise. Anthropologie critique de la quête d’authenticité, Paris-
Montréal, L’Harmattan : 9-38.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
535
NOTES
1. Les textes que nous présentons ici sont essentiellement des articles théoriques de référence à
propos de l’authenticité, fréquemment cités, pour l’essentiel tirés de la revue Annals of Tourism
Research. Nous avons ensuite pris connaissance des références citées dans ces articles fondateurs,
et sélectionné par la suite les textes qui apportaient des éléments de rupture.
2. Nous avons rapproché ces textes des travaux de J.-P. WARNIER (1996) sur la marchandise
authentique, de L. BOLTANSKI et E. CHIAPELLO (1999) sur la récupération de l’authenticité par l’esprit
du capitalisme, et des travaux de N. HEINICH (1999) sur l’art. Ces auteurs ont travaillé sur cette
notion d’authenticité, mais n’ont pas appuyé leurs travaux sur ceux de l’anthropologie du
tourisme et ne sont pas cités par ces travaux.
3. Ma traduction.
4. Cette caractérisation de la vie prémoderne peut évidemment poser problème.
5. Pourtant, les intellectuels ne sont pas les seuls à dénoncer ce caractère artificiel du tourisme.
Cette critique radicale consignée par écrit est également largement reprise par les touristes eux-
mêmes (BURGELIN 1967). D’ailleurs, Burgelin propose une interprétation de la fonction du discours
critique porté sur l’activité touristique : il permet d’intégrer la pratique touristique à la culture
des participants, car la bourgeoisie moderne est caractérisée par une rationalité qui peut
difficilement rendre compte d’un certain nombre d’aspects du tourisme : son caractère collectif,
alors même que les touristes interrogés valorisent l’expérience esthétique individuelle, son coût
qui en fait une dépense à faible rendement, sa dimension rituelle et sacrée.
6. De fait, E. COHEN (2002 : 56) lui-même écrira, plus tard, que « la nature de la relation entre le
tourisme et la modernité occidentale est le problème théorique fondamental de la sociologie du
tourisme auxquels les paradigmes coexistants du champs ont proposé des réponses largement
variées ».
7. Ma traduction.
8. On retrouve ici les caractéristiques de « l’autre authentique » et du « soi authentique ».
9. N. Wang s’inscrit dans une démarche compréhensive des expériences des touristes.
10. À ce sujet, voir également l’article d’Elina CAROLI (dans ce numéro).
11. La mise en place de procédures explicites d’authentification peut mettre en péril la
reconnaissance de l’authenticité. Comme le souligne Nathalie HEINICH (1999 : 5) dans le domaine
de l’art : « L’authenticité est, paradoxalement, d’autant plus suspecte qu’elle est prouvée,
signifiée, exprimée, organisée, encadrée : toutes formes de “construction sociale” qui, quoique
moins radicalement destructrices que les fabrications au sens fort, ne peuvent que jeter le
soupçon, tant la notion d’authenticité exige pour fonctionner une certaine forme d’innocence, de
transparence, d’immédiateté. C’est dire qu’elle est un terrain de choix pour le chercheur en
sciences sociales, qui, dans une perspective constructiviste, viserait à établir qu’elle n’est pas une
qualité substantielle appartenant à l’objet, mais un effet du regard porté sur l’objet. »
12. Il s’agit ici d’une construction institutionnelle de l’authenticité, et non de l’étude de la
création en situation de l’authenticité.
13. Urry affirme que, dans le cadre de la postmodernité, les touristes sont plus intéressés par le
jeu et la reconnaissance de stéréotypes préexistants qui informent leur regard. Dans l’approche
postmoderne, les touristes ne sont plus en quête d’authenticité, mais dans une recherche de
plaisir et de jeu ; alors que l’approche constructiviste remet en question le concept de
l’authenticité mais essaie de le sauver, les postmodernes l’enterrent. La notion d’authenticité n’a
plus de sens et la catégorie même d’authenticité n’est plus utilisée par les touristes
postmodernes.
14. Encore que, concernant le code de l’authenticité, il s’agit essentiellement de groupes sociaux
spécifiques : les classes moyennes urbanisées.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
536
RÉSUMÉS
Cette note critique présente un panorama rétrospectif de la manière dont la notion
d'authenticité a été conceptualisée et utilisée par des anthropologues observant des phénomènes
touristiques. Elle analyse en particulier l'ambiguïté de cette notion qui est en même temps un
concept mobilisé par les chercheurs et une catégorie indigène utilisée par les touristes. Elle
interroge les liens entre les procédures d'authentification mises en œuvre par les anthropologues
et les conditions de reconnaissances par les touristes de l'authenticité d'une relation, d'une
situation ou d'une expérience.
This paper gives a retrospective view of the way in which the notion of authenticity has been
constructed and employed by anthropologists observing tourism phenomena. Particular
emphasis is given to analysing the ambiguity of this notion, evoked as a research concept and
also used by tourists. The links between processes of authentication used by anthropologists and
the attempts by tourists to authenticate relationships, situations and experiences are also
examined.
INDEX
Mots-clés : authenticité, authenticité chaude, authenticité émergente, authenticité existentielle,
authenticité froide, authenticité mise en scène, procédure d'authentification, sincérité
Keywords : authenticity, hot authenticity, emergent authenticity, existential authenticity, cold
authenticity, staged authenticity, authentication process, sincerity
AUTEUR
CÉLINE CRAVATTE
Printemps, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-Quentin-en-Yvelines.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
537
Aime, Marco. – TimbuctuElina Caroli
RÉFÉRENCE
AIME, Marco. – Timbuctu. Torino, Bollati Boringhieri (« Incipit »), 2008, 190 p.
1 Timbuctu (Tombouctou en italien) est paru en avril 2008 dans la collection Incipit de la
maison d’éditions turinoise Bollati Boringhieri. La collection, récente et éclectique,
compte quelques ouvrages d’anthropologues (parmi lesquels, en 2007 et 2008, deux
livres de Marc Augé). Écrits par des anthropologues, ils ne sont pas toujours pour
autant des œuvres d’anthropologie. C’est le cas de Casablanca1, le deuxième livre de
M. Augé (2008) paru dans Incipit, constitué d’un « montage de souvenirs » personnels.
Ce constat vaut également pour le livre de Marco Aime, s’agissant de l’œuvre d’un
voyageur qui a cependant l’érudition, l’expérience et le regard d’un ethnologue, et
parce que, ici aussi, le récit est construit par le biais d’un montage, jamais prévisible à
l’avance, d’histoires, de rencontres, d’images.
2 L’anthropologue italien, passionné de voyages, s’était déjà adonné par le passé à la
rédaction de livres au croisement du récit de voyage et du carnet de terrain, en
montrant, par sa démarche, à quel point la ligne de démarcation entre les ethnologues
d’une part et les voyageurs d’autre part, peut être subtile2. Même, en raison du rapport
actuel de la discipline avec le temps, l’espace et les Autres, il arrive que l’ethnologue ne
soit pas si différent d’un observateur attentif à la vie de tous les jours (comme dans Il
primo libro di antropologia3, paru en même temps que Timbuctu).
3 Ainsi, dans la note au lecteur, Marco Aime prévient que son livre « naît du regard d’un
simple voyageur vivant son expérience dans le quotidien des terres qu’il a la chance de
visiter »4(p. 5). Le premier chapitre (« Promenade tombouctienne », en français dans le
texte), s’ouvre sur la description de l’arrivée par avion à Bamako, et de la continuation
du voyage sur les pistes maliennes, rendues poussiéreuses par l’harmattan, et sur le
Niger, jusqu’à l’arrivée à Tombouctou. Dès le début, l’auteur nous présente une image
représentative d’un des concepts-clés du livre : « On va à Tombouctou parce qu’elle est
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
539
éloignée et qu’on la croit isolée et on trouve une file de blancs qui attendent de se
connecter avec leurs maisons » devant un hôtel possédant un accès à Internet (p. 12).
4 Dans ce premier chapitre, Marco Aime nous présente la ville contemporaine, ce que
Tombouctou est aujourd’hui ou peut être aux yeux d’un voyageur capable de découvrir
la vraie ville au-delà du mythe. Il s’agirait donc, selon l’auteur, d’un voyageur qui ne se
contente pas de visiter les lieux incontournables (les trois mosquées et les maisons des
explorateurs, dans le chapitre « Petits guides, grands explorateurs ») et qui refuse aussi
les idées reçues et les stéréotypes sur Tombouctou – et sur l’Afrique en général –
précédant le voyage. Marco Aime est un voyageur identique aux autres : sa première
visite de la ville, nous dit-il, remonte à 1984 (p. 159). Il s’amuse à nous dévoiler les
mystères (pp. 23-24) de « Tombouctou la mystérieuse » et à contrer de la sorte cet
imaginaire occidental qui, en donnant divers noms à la ville (voir le chapitre « Les
noms de Tombouctou »), a façonné la vision non seulement des étrangers mais
également celle des habitants. Il cite le cas d’habitants qui répètent sournoisement que
« Tombouctou est au bout du monde », en se moquant de la sorte du point de vue
occidental. À l’inverse, les Tombouctiens, lorsqu’ils vont à Bamako, affirment aller « en
brousse ». Et pourtant le feed back va plus en profondeur, pénétrant dans les différentes
couches de la société tombouctienne et, le plus souvent, l’utilité l’emporte sur l’ironie :
l’Office du tourisme utilise les devises forgées par les voyageurs et les explorateurs du
passé ; les guides doivent tenir compte des attentes et des désirs des touristes. Surtout,
lors des formations organisées par le ministère du Travail, il est demandé aux futurs
guides de s’habiller de façon traditionnelle. Le guide rencontré par l’auteur porte une
chemise en bogolan avec des dessins typiques dogon. « Comme si un gondolier
s’habillait en Tyrolien », commente Aime (p. 68).
5 Enfin, c’est ce que les touristes désirent. Ce qu’ils convoitent le plus c’est le tampon de
Tombouctou sur le passeport, au point qu’à l’Office du tourisme il est possible d’acheter
un diplôme qui atteste qu’on est vraiment allé à Tombouctou. Vanité du touriste, qui,
comme les spécialistes nous le disent depuis longtemps, vit l’expérience du voyage
projeté en avant, sur le temps du retour chez soi et chez les siens, sur le temps du récit
et de l’exposition de fétiches et de photos. Mais cette attitude est accentuée chez le
touriste à Tombouctou, car, comme pour les explorateurs du passé, la valeur de ce
voyage résiderait d’abord dans le mythe construit autour de l’inaccessibilité de ce lieu.
6 Or, à l’instar de maints voyageurs du passé, les touristes sont aujourd’hui souvent déçus
par Tombouctou5. Enfin, cette ville « ne vaut pas le voyage, même pas un détour, si ce
n’est pour dire qu’on y est allé », affirme le journaliste Jean-Pierre Dubarry (p. 86). Face
à cette ville de terre, l’idée d’ensemble qui surgit, c’est qu’il n’y a rien. Tombouctou
n’est pas un village de la brousse africaine ; c’est une ville où pourtant les édifices les
plus anciens ne diffèrent pas des plus récents (p. 86). C’est sans doute pour cette raison
qu’aujourd’hui on mise beaucoup sur les manuscrits, véritable richesse de Tombouctou,
même si, affirme l’auteur, personne ne semble s’intéresser à leur contenu. Dans la
rhétorique onusienne dominante, ils sont devenus des monuments à sauvegarder et à
valoriser pour leur simple valeur esthétique. Enfin, Tombouctou ne représente même
pas une Afrique pensée a priori en termes d’animisme ou d’ethnies.
7 Tombouctou, de par sa réalité complexe et déroutante (par rapport aux stéréotypes
occidentaux sur l’Afrique) permet à Marco Aime, tout en écrivant ce livre comme un
voyageur, de se pencher sur des questions importantes de l’anthropologie. En
racontant Tombouctou, il analyse aussi bien le voyage et le tourisme, que le rapport
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
540
entre mythe et réalité et les relations entre étrangers et autochtones. Surtout, il
analyse le regard occidental et, par ce biais, en nous dévoilant l’ampleur de la
différence tombouctienne par rapport à notre idée de l’Afrique, il nous parle du rapport
de l’Occident à l’Afrique en général.
8 Timbuctu est un livre sur le jeu de miroirs complexe instauré entre les touristes (les
Occidentaux, d’après Aime) et les autochtones (un ensemble plus hétérogène, dont
l’élément commun serait, dans le discours de l’auteur, l’opposition constante au nous) ;
c’est un livre sur des images renvoyées sur d’autres images, jusqu’à ne plus savoir où,
dans quel continent, se trouverait la matrice de ces représentations. Il s’agit d’un
thème cher à Marco Aime qu’il avait déjà abordé à propos des Dogons, renommés
auprès des Occidentaux pour leur cosmogonie, fameux chez leurs voisins pour leurs
oignons6. Si l’ethnotourisme pratiqué sur la falaise de Bandiagara ne semble pas
possible à Tombouctou (p. 93), puisque cette ville, avec son brassage, est un défi vivant
à l’Afrique des ethnies, le jeu de miroirs est cependant toujours à l’œuvre. Ville
multiethnique, musulmane, de l’écrit (« c’est la plus grande bibliothèque d’Afrique »,
affirme Aime p. 97), elle demeure toutefois victime d’un regard en quête d’authenticité
et de primitivisme. Un regard foncièrement ethnocentrique.
9 Le chapitre concernant le rapport de Tombouctou à l’islam (« Ibn Battuta indigné »),
montre que Tombouctou est « victime ou protagoniste du regard d’autrui », non
seulement des Occidentaux mais également du monde musulman. Les chroniques
arabes témoignent également d’un découpage, dans la riche histoire tombouctienne, de
moments figés, privilégiés parce qu’ils confortent l’image d’une ville islamisée depuis
toujours. Une observation qui aide à mieux comprendre les infiltrations
fondamentalistes ayant lieu à Tombouctou, dans un contexte contemporain de forte
réislamisation de pays d’Afrique occidentale tels que le Mali.
10 Pourtant, puisque le livre est foncièrement consacré à dévoiler l’etnocentrisme
implicite présent dans notre (en tant qu’Occidentaux) récit de la ville, quelle est la
puissance de ce récit ? Marco Aime ne peut pas s’empêcher, lui non plus, de renvoyer
sans cesse Tombouctou à l’Occident. La ville est, de la sorte, un « Occident inversé »
(p. 31) mais aussi « une espèce de vaisseau spatial, atterri ici par hasard. Une île ayant
apparemment peu en commun avec la réalité qui l’entoure » (p. 121). Si « tout ici est le
fruit d’un brassage » (p. 122), l’idée reçue de l’Afrique des ethnies que l’auteur voulait
pourtant contrer, ne parvient-elle pas de la sorte par l’emporter ? Le récit de Marco
Aime débute par la poussière de l’harmattan, les vieilles autos de Bamako, la lumière
sale (pp. 9-10), les petites filles sales, ici où « la nuit est vraiment noire » (p. 11) et le
matin est « presque fatigué » (p. 12). Tombouctou est d’une « couleur poussière »
monotone (pp. 12-13) ; les hommes semblent bouger au ralenti (p. 14), alors que les
touristes sont toujours pressés (p. 20) et les changements, même les plus anodins,
toujours importés de l’Occident (p. 13).
11 Enfin, même dans le discours de l’auteur, Tombouctou n’est visible qu’à travers le
« voile de l’Occident » qui l’entoure (p. 65). Ainsi, la poussière consiste en définitive,
dans les dernières pages du livre, à connoter Tombouctou (pp. 165, 185) et, depuis une
place sableuse, la dernière pensée de l’auteur est destinée à l’Europe.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
541
NOTES
1. Marc Augé, Casablanca, Torino, Bollati Boringhieri, 2008.
2. Voir également dans ce numéro le compte rendu sur l’ouvrage de T. Barthélemy & M.
Couroucli (dir.), Ethnographes et voyageurs. Les défis de l’écriture.
3. Marco Aime, Il primo libro di antropologia, Torino, Einaudi, 2008.
4. Les citations entre guillemets sont traduites par moi de l’italien.
5. Voir l’article de Marco Aime « Les déçus de Tombouctou » dans ce numéro.
6. Marco Aime, Diario dogon, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, p. 12.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
542
Barthélemy, Tiphaine & Couroucli,Maria (dir.). – Ethnographes etvoyageursJean Copans
RÉFÉRENCE
BARTHELEMY, Tiphaine & COUROUCLI, Maria (dir.). – Ethnographes et voyageurs. Les défis de
l’écriture. Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques (« Le regard
de l’ethnologue », 17), 2008, 286 p.
1 Le titre de ce recueil collectif de quinze contributions, précédées d’une introduction
par les éditeurs, semble faire écho directement à l’esprit postmoderne qui traverse
l’anthropologie, notamment américaine, depuis près d’un quart de siècle et qui pour
certains de ses protagonistes rapproche l’anthropologie de la littérature,
singulièrement de la littérature de voyage. Donc rien de nouveau semble-t-il, à ceci
près que nous aurions enfin en langue française une introduction indigène à la
question. Pourtant cette assimilation est abusive, d’autant que la prudence s’impose :
les écrivains voyageurs seraient des ethnographes publiés dans une collection
d’ethnologie. On sait combien le jeu entre les appellations plus ou moins synonymes de
la discipline fait rage en France pour des raisons de clivages institutionnels anciens : il
paraît donc préférable d’abandonner dès le premier instant, avant même d’ouvrir les
pages de cet ouvrage, l’empathie postmoderne qui aurait pu nous saisir. Et bien nous en
prend dans ce cas, car au mieux un tiers du recueil pourrait trouver cette confrontation
utile.
2 Les deux tiers des auteurs examinés sont certes du XXe siècle qui est bien le siècle de
l’ethnographie-ethnologie-anthropologie de terrain mais seulement un tiers d’entre
eux sont des ethnologues professionnels, les deux autres tiers sont ou bien des
voyageurs-explorateurs ou bien des écrivains. La question semble par conséquent
ramener au dilemme classique : qu’est-ce qui est ethnologique chez les récits des
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
543
voyageurs non ethnologues et, inversement, peut-on retrouver des récits de voyages
enfouis dans les monographies ou études ethnologiques ? L’introduction évoque dans
son titre les mises en texte des terrains et des voyages mais malheureusement, elle ne
propose aucune théorie générale qui pourrait s’appliquer au corpus sélectionné. Le
lecteur est même surpris de trouver comme perception méthodologique dans un grand
nombre de contributions ce qu’on pourrait appeler la critique littéraire « de papa » du
style « l’Homme et l’Œuvre ». Il y a fort peu de réflexions sur l’écriture proprement dite
comme médium de la description et/ou de l’explication. Et surtout, puisqu’il s’agit d’un
ouvrage de science humaine ou sociale, la sociologie (ou l’anthropologie) de la
connaissance culturelle ou scientifique, la sociologie politique des rapports
internationaux de la production des récits de voyage, indépendamment de leur nature,
ne font pas du tout partie de l’arsenal analytique utilisé sauf pour G. Toffin et J.-
P. Jardel. Cette conception des choses se révèle d’ailleurs par la faible connaissance de
l’histoire de nos disciplines chez la quasi-totalité des auteurs, faible connaissance qui
fait place d’ailleurs parfois à des erreurs ou à des ignorances inquiétantes. Certes,
l’objectivisme est de mise puisque seulement un tiers des auteurs évoque ses propres
travaux ou situations. Un seul auteur semble d’ailleurs capable de resituer le contexte
spécifique de la démarche ethnologique institutionnelle (en l’occurrence l’ethnologie
française par rapport à l’anthropologie américaine), Gérard Toffin. Le hasard (?) veut
que ce texte soit le premier du recueil et qu’il fasse provisoirement illusion sur la
nature des textes suivants, bien moins précis sur ce point.
3 Avant d’en revenir au fond, détaillons plus précisément le contenu de la quinzaine
d’études. Ou du moins, essayons, car la table des matières ne comporte que le titre des
contributions et pas le nom des auteurs ! Dans le même ordre d’esprit signalons le
mode de légendage des illustrations qui nécessite des verres grossissants dans le
meilleur des cas. L’ouvrage est donc composé de trois parties équilibrées :
« L’anthropologie contemporaine entre argumentation et narration », « Lectures
anthropologiques des récits de voyage » et « Écriture anthropologique et écriture de
voyage. Passerelles ». Première surprise : l’anthropologie remplace les précautions
ethnologiques des éditeurs, même si les œuvres analysées ne relèvent pas toutes de
l’anthropologie. G. Toffin compare M. Leiris, C. Levi-Strauss et M. Mead. Il est le seul à
noter (p. 31) l’avance des anthropologues américains en matière de réflexivité de
l’expérience professionnelle (notamment universitaire proprement dite), mais
manifestement l’auteur n’est pas au courant des recherches sur le contexte des
recherches de terrain des deux Français.
4 G. Bedoucha est probablement la seule à avoir pris le thème du recueil au sérieux. Elle
nous présente une comparaison du fameux ouvrage du voyageur, Wilfrid Thesiger, Les
Arabes des marais, et la seule monographie ethnologique disponible sur cette même
population, rédigée par un anthropologue irakien,
5 S. M. Salim, qui date à peu près de la même époque de la fin des années 1950début 1960.
Cette comparaison menée sur certains points terme à terme lui permet de conclure que
le récit empathique de Thesiger comporte souvent des notations ethnologiques en
situation, méthode que refuse Salim, très peu réflexif ou auto-réflexif. Il lui semble qu’il
est mieux de savoir comment l’auteur s’est « débrouillé » sur le terrain, y compris au
plan tout à fait personnel, que de croire en un savoir distancié pseudo-objectif. Un peu
de méthodologie-Thesiger ne ferait pas de mal à l’ethnologie. Certes, mais comme la
monographie ethnologique retenue (une commande administrative qui plus est) n’est
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
544
pas une grande œuvre et que le voyageur en revanche est l’un des plus grands du siècle
dernier, ces conclusions tombent d’elles-mêmes car les œuvres ne sont que
formellement comparables. Sergio Dalla Benardina nous offre une étude quelque peu
« surréaliste » puisqu’il examine les stéréotypes anthropologiques d’un corpus
d’œuvres missionnaires des XIXe et XXe siècles, constitué de manière aléatoire et qu’il
considère son approche comme aussi idéologique que celle des œuvres étudiées. Un
essayisme philosopheux de ce genre, sans rigueur, n’avait pas sa place dans ce recueil.
Le dernier texte de la première partie est tout aussi problématique.
6 M. Baussant étudie la réinvention d’une tradition en France. Il s’agit de pèlerinages
catholiques (mariaux) repris par la communauté pied-noire après son expulsion
d’Algérie en 1962. L’approche est personnelle puisque la famille de l’auteure et elle-
même sont partie prenante de cette adaptation. Mais on ne voit pas le rapport
qu’observations et relectures personnelles, expériences intimes et objectivation des
mémoires peuvent présenter avec une comparaison entre voyages ethnologiques et
récits de voyage, puisque l’auteure n’incarne aucune des deux facettes du récit et de la
description. Notre déception est donc forte à la fin de cette partie.
7 La deuxième partie nous fait carrément remonter dans le temps jusqu’au XVIIIe siècle.
Malgré l’intitulé « Lectures anthropologiques », les contributions réunies sous ce titre
restent au niveau de la simple analyse d’histoires de vie et de récits de voyage. Charles
de la Condamine en Amérique du Sud, les Libanais dans les récits français des années
1830-1850, le premier voyage d’observation quasi coloniale en Corée en 1888-1889, Ella
Maillart dans l’Union soviétique des années 1930 (c’est son premier voyage), et enfin
L. Durrell et H. Miller dans la Grèce de l’avant-guerre ne font pas l’objet de lectures
particulièrement ethnologiques ni anthropologiques, d’autant que l’aspect historique
des voyages est vu de manière sommaire et de seconde main. Trois des auteurs sont
d’ailleurs des historiens et les deux autres sont les éditeurs du recueil lui-même. Ces
cinq contributions n’aident en rien à mieux saisir la problématique de départ qui
semble de plus en plus oubliée.
8 La dernière section reprend la thématique comparatiste de la première. Le texte le plus
intéressant est probablement celui de Jean-Pierre Jardel qui remet un peu en cause la
mythologie lévi-straussienne alors qu’aucun des autres auteurs évoquant Tristes
tropiques (puisqu’il s’agit évidemment de lui) n’a osé le faire. La comparaison offerte ici
porte sur un article du voyageur peintre Jean-Baptiste Wilkinson paru dans le mensuel
l’Illustration de 1931 et le passage de Tristes Tropiques qui relatent, à dix ans d’intervalle,
et chacun à leur façon, une escale à la Martinique (1931 et 1941). Pour aller vite,
Wilkinson c’est l’idéologie coloniale en plein, mais les silences de Lévi-Strauss sur la
réalité locale, par peur de tomber dans l’exotisme de pacotille, sont tout aussi parlants.
En fait, Jardel va jusqu’à suggérer que Lévi-Strauss aurait repris Wilkinson en creux
(l’ordre de sujets, l’itinéraire de visite, etc.). Il note évidemment que Lévi-Strauss écrit
près de quinze ans plus tard. Mais en fait on ne sait rien de cette écriture et s’il y a eu
des notes prises à l’époque. Peut-être que l’édition de la Pléiade comporte des
informations nouvelles sur ce point mais Jardel n’avait pu la consulter puisqu’elle est
parue postérieurement et l’auteur du compte rendu se trouve dans la même situation1.
Mais voici une analyse, qui comme celle de G. Bedoucha, va assez profondément dans le
texte, suffisamment en tout cas pour attirer l’attention de l’ethnologue comme lecteur
et éventuellement comme auteur. J.-P. Martinon examine les origines culturelles de
l’ethnologue, du voyageur, de l’écrivant-écrivain. Ses remarques sont probablement les
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
545
plus pertinentes mais sa démonstration primesautière et rapide nous laisse sur notre
faim, au milieu de tant d’analyses du recueil qui tournent le dos à ce type d’approche
(même chez les deux éditeurs). De plus, Martinon reste très franco-centré, marque
indélébile de tous les auteurs à une exception près. Après cet intermède ethnologique,
nous retombons dans l’analyse voyagiste de seconde main. A. Demeulenaere évoque
R. Caillé (« l’inventeur » de Tombouctou) et J.-M. Le Clézio (L’Africain) : il sous-estime
très fortement l’originalité du premier (presque considéré comme un vulgaire voyageur
de Nouvelles Frontières) et surestime l’africanité voyageuse du second. Les deux
dernières contributions ne portent pas plus sur des anthropologues puisque l’une porte
sur un grand écrivain et voyageur portugais contemporain, M. Torga, et que la dernière
décrit l’univers des librairies et cafés « arabisants » du Quartier latin et les regards
exotiques internes que cette tradition diasporique et urbanistique porte en elle2.
9 Si l’on en revient à l’introduction des éditeurs, que je n’ai pas encore évoquée, on ne
peut qu’être surpris du caractère extrêmement hétéroclite du recueil et du fait qu’au
mieux un petit tiers des contributions répond véritablement à la question.
Probablement la divergence de fond est plus profonde que le simple hasard de ceux qui
rédigent leur texte après un colloque. Malgré des références aux ouvrages français les
plus récents en matière de réflexivité (A. Bensa, C. Ghasarian, O. Leservoisier) les
éditeurs restent dans le ghetto français de cette réflexivité qui n’est que très
secondairement une sociologie du travail ethnologique de terrain et encore moins une
anthropologie de la connaissance anthropologique (la bibliothèque maîtrisée par le
chercheur, les modes d’écriture depuis le terrain jusqu’à l’ouvrage publié, les cultures
professionnelles et sociales personnelles). Deux exemples pour conclure :
Fieldnotes3analyse les modes concrets de l’écriture sur, pendant le terrain ainsi que leurs
rapports avec l’après-terrain. Barthélémy et Couroucli, dans un réflexe bien français (et
hélas lévi-straussien) prennent d’emblée les anthropologues pour des écrivains ce qu’ils
ne sont qu’éventuellement et pour des voyageurs, ce qu’ils ne sont pas tout le temps.
Africanising Anthropology4 de L. Schumaker (2001) nous démontre, grâce à une longue
enquête de terrain d’histoire de la connaissance que les anthropologues du Rhodes-
Livingstone Institute des années 1940-1960 avaient en quelque sorte coproduit leurs
travaux avec les enquêteurs et interprètes noirs africains. À ce niveau, on s’aperçoit
que les anthropologues transmettent aussi autre chose que leur propre point de vue.
10 Bref l’écriture anthropologique peut être comparée à celle des voyageurs mais, pour ce
faire efficacement, il faut déjà maîtriser les rapports scripturaux des anthropologues
avec leurs informateurs et interprètes d’une part et leurs collègues de l’autre. Faute de
cette sociologie préalable « les défis de l’écriture » restent incompréhensibles et la
lecture critique des contextes de l’anthropologie impossible. Tant les étudiants
d’anthropologie que les chercheurs des autres disciplines (si nombreux encore une fois
dans cet ouvrage) ont besoin d’une perspective pragmatique de la discipline. L’analyse
réflexive n’a rien d’une psychologie ni d’une littérature (ou encore moins d’une
épistémologie) : pour être efficace elle a besoin d’un détour sociologique qui a
totalement échappé à la plupart des auteurs de cet ouvrage5.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
546
NOTES
1. Notons toutefois les remarques de Jardel portant sur l’introduction de l’anthropologue à
l’ouvrage de Don C. Talayesva, Soleil Hopi, Paris, Plon (« Terre Humaine »), 1984. Un analyste
littéraire, D. Brumble, a pourtant bien démontré (plus tard il est vrai, D. Brumble, Les
autobiographies des Indiens d’Amérique, Puf, 1993) le tripatouillage « ethnologique » dont ces
souvenirs avaient fait l’objet, tripatouillage dont Lévi-Strauss ne dit rien. La réflexivité
méthodologique et scripturale est en fait un état d’esprit qui lui est tout à fait étranger.
2. Les travaux de Maud Leonhardt Santini sont remarquables mais comme le disait plus ou moins
un auteur célèbre : « Qu’allait-elle faire dans cette galère ? » Il en est de même pour la recherche
de M. Baussant, citée plus haut.
3. R. Sanjek (ed.), Fieldnotes : the Makings of Anthropology, Ithaca-London, Cornell University Press,
1990.
4. L. Schumaker, Africanising Anthropology : Fieldwork, Networks, and the Making of Cultural Knowledge
in Central Africa, Durham (NC), Duke University Press, 2001.
5. Pour un tour complet de la question, voir D. Céfaï (dir.), L’enquête de terrain, La découverte,
2003.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
547
Campbell, James T. – Middle PassagesCristina D’Alessandro-Scarpari
RÉFÉRENCE
CAMPBELL, James T. – Middle Passages. African American Journeys to Africa 1787-2005. New
York, Penguin, 2006, 514 p.
« Of the twelve million or so Africans who survived the Middle Passage, about a halfmillion were imported into the territory of what is now the United States. Theirdescendants today number well over thirty million. Yet one could count thenumber of African Americans who could trace their origins back to an individualAfrican » (p. 408).
1 Ouvrage original à plusieurs titres, Middle Passages est d’abord un défi, une expérience
réussie. Pour commencer, le sujet n’est pas des plus communs, ce qui en fait une
référence incontournable et quasiment unique dans son domaine. En effet, il analyse un
certain nombre de voyages d’Afro-américains sur le continent africain : volontairement
ou forcés par les événements et pour les raisons les plus diverses, selon les époques et
les motivations, ces Américains aux origines africaines ont accompli à rebours le middle
passage fait par leurs ancêtres, c’est-à-dire la traversée atlantique qui leur a permis de
quitter les États-Unis et d’atteindre l’Afrique. Par le biais des histoires des individus et
des groupes, l’auteur parvient à dresser le portrait d’une double géographie : celle des
représentations croisées, des visions et des imaginaires du soi et de l’ici par l’autre et
l’ailleurs et vice versa. Voici donc émerger les images des États-Unis progressivement
construites dans le temps par les Afro-américains, c’est-à-dire comment ils voyaient
leur patrie, cette image étant intrinsèquement et profondément liée à la vision qu’ils
avaient forgée en eux de leur continent d’origine : l’Afrique lointaine et sans doute
différente, dans le bien ou dans le mal, de la réalité dans laquelle ils se trouvaient à
vivre.
2 Mais cet ouvrage de James T. Campbell est aussi original par la méthode et le style
d’écriture adoptés. Issu de longues années de recherches bibliographiques et
archivistiques, ce texte est un produit du monde académique : écrit par un historien,
professeur de civilisation américaine et d’études africaines à la Brown University de
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
548
Providence dans le Rhode Island, cet ouvrage a été néanmoins publié dans la « History
of American Life Series ». Il s’agit d’une collection de la maison d’éditions américaine
Penguin qui a comme finalité de rendre accessible à un public vaste et hétérogène de
lecteurs américains (ou anglophones) moyens, les travaux les plus récents et novateurs
qui portent sur leur histoire. Selon le comité scientifique de la collection, composé des
plus éminents historiens de l’histoire américaine, cela veut dire choisir des textes qui
présentent des analyses et des prises de position explicites et publier des travaux sur
les sujets les plus divers, à condition qu’ils abordent les questions les plus prégnantes
du passé des États-Unis. C’est l’horizon intellectuel dans lequel se situe Middle Passages,
qui raconte l’histoire des individus et des groupes ayant rendu possibles ou accompli
ces itinéraires entre les États-Unis et l’Afrique et ceci faisant en retracent l’évolution et
l’historique.
3 En ouverture d’ouvrage, on découvre ainsi que des milliers d’Afro-américains sont allés
en Afrique depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. Certains s’y sont installés de
façon permanente, notamment ceux qui ont été envoyés au Liberia au XIXe siècle pour
y fonder des établissements dans le but de « rapatrier » en Afrique des esclaves libérés.
D’autres pensaient le faire, mais ont été contraints à partir à cause de situations
d’instabilité politique : c’est le cas de ceux qui sont partis au Ghana à la veille de
l’indépendance ou immédiatement après, en faisant pleine confiance au leader Kwame
Nkrumah et qui ont dû s’enfuir lorsque son régime a été renversé par un coup d’État.
Enfin, un certain nombre y est allé simplement pour voir ce monde d’où étaient partis
leurs ancêtres, cette terre dans laquelle s’enfonçaient leurs racines.
4 Malgré des sensibilités et des expériences différentes, des centaines parmi eux ont écrit
des mémoires ou des lettres, des articles ou autres textes sur leurs voyages : c’est sur
ces documents que cet ouvrage se fonde. En effet, ces voyages mettent en exergue la
présence prégnante de l’Afrique dans la vie politique, intellectuelle et dans l’imaginaire
des Afro-américains depuis longue date, car l’Afrique a été historiquement le terrain
majeur à travers lequel les Afro-américains ont négocié leur relation avec la société
américaine.
5 Mais quand et comment tout commence ? Les plus anciennes histoires de ces retours
aux sources, sur lesquelles s’ouvre l’ouvrage, sont de façon assez surprenante celles qui
remontent à la première période de l’esclavage et aux esclaves qui ont pu retourner en
Afrique. Campbell propose ainsi l’histoire exemplaire d’Ajuba Souleiman Diallo, capturé
en Gambie en 1730, libéré et rapatrié chez lui des années plus tard après un long périple
qui l’a amené aussi en Angleterre devant la reine.
6 S’il faut admettre que ce type d’histoire est très rare en son genre, bien plus
nombreuses ont été celles qui ouvrent un autre chapitre de l’histoire américaine : les
rapatriements d’Afro-américains censés, au moins symboliquement, laver la honte de
l’esclavage qui pesait sur l’histoire de la nation, et chargés de répandre sur le continent
noir les lumières de la foi. Cette épopée donne lieu à la création de la colonie de Sierra
Leone en 1787, suivie par celle du Liberia. Ces premières expériences témoignent, au-
delà du grand nombre de vies sacrifiées pour la cause, des échecs, des difficultés
pratiques et intellectuelles de toutes sortes que ces colons rencontraient, puisque ces
Afro-américains, qui avaient bénéficié d’une éducation scolaire, du contact avec la
religion et la société civile, n’étaient pas des Africains. Ils n’avaient rien en commun
avec les hommes qu’ils rencontraient et qu’ils voulaient amener sur le droit chemin.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
549
7 Mais les modalités selon lesquelles ces colonies ont été créées peuvent également
expliquer certains problèmes rencontrés successivement par les États africains
indépendants : « Si on considère l’histoire postérieure du Liberia, on pourrait aussi
s’interroger sur l’opportunité de peupler un pays avec des colons dont le modèle social
principal était celui des plantations du Sud »1 (p. 63). Pendant les années 1850, lorsque
se mettent en place au Liberia les productions de sucre et de café, non seulement le
paysage de brousse commence à ressembler fortement à celui du Sud, mais, comme au
Sud, le concubinage se diffuse, avec son corollaire d’abus physiques et de maltraitance
des travailleurs africains. Et pour avoir une idée de ce que ces installations
représentaient en termes d’individus, il suffit de dire qu’entre 1848 et 1854, plus de 40
bateaux ont quitté les côtes américaines en direction du Liberia (qui était déjà un État
indépendant à l’époque), en transportant plus de 4 000 colons !
8 À la fin du XIXe siècle, aux colons s’ajoutent les religieux. Le nombre de missionnaires
américains envoyés en Afrique pour évangéliser le continent devint progressivement
consistant et, déjà pendant cette période, les Afro-américains étaient nombreux,
surtout à l’intérieur des Églises baptistes. Leurs aventures ont été relatées et suivies aux
États-Unis par le biais des revues spécialisées, des pamphlets, mais aussi des mémoires
et autobiographies publiés en grand nombre à l’époque. « L’imaginaire afro-américain
de l’Afrique a toujours été complexe et conflictuel, mais rarement les tensions ont été si
apparentes. L’Afrique était-elle un refuge du racisme américain ou plutôt un terrain
d’expérience sur lequel les Afro-américains pouvaient prouver leur courage et mériter
leur acceptation au sein de la société américaine ? » (p. 144).
9 Après avoir relaté l’histoire de quelques missionnaires quasiment inconnus au grand
public, James T. Campbell consacre une partie importante de son ouvrage aux Afro-
américains célèbres, en commençant par l’expérience emblématique de Langston
Hugues. Non satisfait d’explorer le continent dans son imagination, l’écrivain quitte les
États-Unis en 1923 pour l’Afrique de l’Ouest. Hugues racontera son expérience africaine
dans plusieurs textes et à des moments différents de son existence, mais il répétera
souvent sa déception et sa désillusion face au continent noir : il se sentait étranger sur
cette terre et il éprouvait la douleur d’être un Américain et de savoir que son
expérience était limitée par son identité, car il ne pouvait pas vivre l’Afrique comme un
Africain. Il faudra attendre décembre 1960 avant que Hugues retourne en Afrique : lors
de son deuxième voyage, il se concentre moins sur les sensations que le continent
engendre en lui, que dans l’observation de ce qui l’entoure. Il est ainsi frappé par la
pauvreté, la corruption et l’autoritarisme émergeant et il est particulièrement secoué
par le chaos qui règne à Lagos.
10 W. E. B. Du Bois, dont la personnalité conflictuelle n’est pas un mystère, développe au
contraire un rapport plus positif avec le continent africain, même s’il avoue que son
intérêt pour l’Afrique ne découle pas au début de l’expérience directe, mais seulement
de la lecture et de la réflexion. Il a tellement désiré vivre en Afrique qu’en 1961, Du Bois
et sa femme quittent les États-Unis pour aller s’installer définitivement au Ghana, où il
va décéder à l’âge de 95 ans.
11 Les écrivains sur lesquels Campbell porte son attention par la suite sont des figures qui
se sont rendues en Afrique après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le colonialisme
traversait sa phase terminale. Richard Wright et Era Bell Thompson (la première
femme à avoir une place de choix dans l’ouvrage) ouvrent cette section. Wright
produisit une analyse lucide et implacable des ravages du colonialisme : les Africains
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
550
ont été privés non seulement de leurs terres, mais surtout de leur identité. « Ce qui
mettait le plus en furie Wright, néanmoins, ce n’était pas la persistance des traditions,
ni les ravages de la modernité, mais les mélanges par lesquels les Africains combinaient
des éléments des deux dans leurs vies quotidiennes. Wright dénicha partout des signes
de ce que les scientifiques appellent aujourd’hui l’hybridité, la combinaison d’éléments
appartenant à différentes cultures et systèmes de valeurs dans des formes nouvelles et
syncrétiques » (pp. 306-307). Le seul palliatif possible que l’écrivain concevait pour
améliorer la situation était, de façon surprenante, la militarisation du quotidien des
individus : la seule option capable de discipliner les instincts.
12 Ce panorama qui fait le tour de la question sur une période de plus de deux siècles se
termine avec une section qui s’occupe de journalistes américains envoyés en Afrique
pour relater les pages les plus dramatiques de l’histoire africaine de ces dernières
années, notamment le génocide rwandais et les troubles à Mogadiscio : les Afro-
américains étaient assez nombreux. « Aussi souvent que dans le passé, les difficultés
quotidiennes des Noirs américains ont été exportées sur les terrains africains. Les
dernières décennies du XXe siècle témoignent d’une renaissance de l’intérêt des Afro-
américains pour le continent, un sentiment renouvelé d’identification, exprimé par
tous les biais à partir de la mode jusqu’aux prénoms choisis par les familles pour leurs
enfants » (p. 370). Cela est dû au moins en partie au succès avec lequel a été
immédiatement accueillie la publication du roman (et de la série qui en a été tirée)
d’Alex Haley Roots, mais également à la diffusion des théories et des idées
afrocentristes : si la civilisation occidentale a des racines africaines, alors on peut
revendiquer avec orgueil des origines africaines, celles des ancêtres, même s’ils ont été
capturés et amenés en Amérique comme esclaves. C’est une confirmation du fait que les
liens entre les Amériques et l’Afrique n’ont jamais été rompus et qu’ils restent forts et
vivants, malgré le temps qui passe et les générations qui se succèdent : ces relations
sont émotionnelles, mais aussi intellectuelles, tout autant que réelles et directes dans
bien des cas.
13 Ce sentiment explique le développement rapide d’une industrie touristique vouée à
ramener en Afrique les Afro-américains, à leur faire découvrir la terre des ancêtres, à
leur faire ressentir le pathos du retour aux sources. Même si la plupart de ces touristes
ne sont pas en mesure de tracer leurs origines jusqu’à une région et encore moins à un
point précis du continent africain (comme en témoigne la citation d’ouverture), tous les
« paquets » proposés par les agences de voyage prévoient une escale à Gorée ou à Cape
Coast, lieux emblématiques où les descendants des esclaves peuvent reproduire ce
moment où tout commença. Campbell remarque que, pour les Américians, ces lieux
peuvent incarner le début du voyage, mais qu’il n’en a probablement pas été ainsi pour
les esclaves qui y ont transité, pour lesquels ils n’étaient que des points de passage d’un
voyage qui avait commencé des jours, des semaines, voire des mois plus tôt, parfois des
centaines de kilomètres plus à l’intérieur des terres.
14 Pour conclure, l’auteur offre une synthèse efficace de ce qu’a représenté l’Afrique pour
les Afro-américains, depuis les toutes premières aventures : elle a toujours été un
endroit où on pouvait faire œuvre charitable tout en gagnant de l’argent, un lieu où on
pouvait servir la cause de l’égalité des hommes tout en construisant sa propre fortune.
Même si peu nombreux ont été ceux qui ont pu réaliser leurs rêves à l’aide de ces
schémas simplistes, il est trop simple et aisé, nous dit Campbell, de condamner ces
individus ou de les considérer naïfs et opportunistes.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
551
15 Nous souhaitons ainsi souligner pour conclure un des enseignements majeurs de ce
livre. On a, en effet, souvent souligné que l’Afrique a été un terrain d’expérience pour
les puissances coloniales européennes, un espace traité comme terrain vierge où on
pouvait exporter la civilisation occidentale et créer ex nihilo un monde nouveau et une
société différente. Campbell nous donne, néanmoins, aussi l’occasion d’affirmer et de
réfléchir sur le fait que, même siles États-Unis n’ont officiellement jamais eu des
colonies en Afrique, ils ont exercé un pouvoir colonial sur le continent ou au moins sur
quelques régions. Comme les autres États européens ont fait de l’Afrique leur alter ego,
la terre où se réfugier, le cauchemar ou le rêve, l’Ailleurs fondateur de l’Ici, le lien
relationnel qui permet de connaître le chez soi et de s’en sortir lorsqu’il ne répond plus
aux attentes ou lorsqu’on a simplement envie de la différence oude la diversité, donc de
l’exotisme, les États-Unis ont fait du Liberia, de la Sierra Leone ou du Ghana des
« colonies » d’une certaine manière.
16 Si Edward Saïd a si bien montré que l’Occident n’existe que par la création de l’Orient,
on pourrait ajouter que l’Occident se construit par sa relation à l’Afrique et à l’Ailleurs
africain.
NOTES
1. Cette citation et celles qui suivent sont des traductions françaises du texte original anglais,
assurées par l’auteure de la recension.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
552
Cauvin Verner, Corinne. – Au désertJulien Bondaz
RÉFÉRENCE
CAUVIN VERNER, Corinne. – Au désert. Une anthropologie du tourisme dans le Sud marocain.
Paris, L’Harmattan, 2007, 317 p.
1 Ce livre, préfacé par Alban Bensa, est issu d’une thèse de doctorat effectuée sous la
direction de Marc Augé puis de François Pouillon qui l’a conduite en soutenance en juin
2005 à l’École des hautes études en sciences sociales. Il est révélateur de l’émergence de
nouveaux terrains et de nouvelles pratiques en anthropologie, et particulièrement en
anthropologie du tourisme, double originalité revendiquée à la fois sur le plan
théorique et sur le plan méthodologique. Sur le plan théorique, dans l’introduction,
Corinne Cauvin Verner situe l’enjeu de sa recherche à l’articulation d’une
« anthropologie en miroir » devant rendre compte de la manipulation réciproque
d’énoncés identitaires par les touristes et par leurs guides et d’une anthropologie
historique rendue nécessaire par l’analyse du tourisme en tant que facteur de
changement social. Sur le plan méthodologique, elle donne à voir ce que l’on serait
tenté de désigner comme une ethnologue « embarquée » participant aux côtés de
touristes européens à différentes randonnées dans le désert du Sud marocain (région de
Zagora).
2 La seconde partie introductive présente ainsi le « journal d’une randonnée », et décrit
les multiples interactions au sein d’un groupe de touristes depuis son départ d’Orly
jusque sur les pistes sahariennes, et retour. Mais le récit de cette randonnée est aussi
celui des rencontres entre les touristes et leurs guides marocains, de leurs attentes et
de leurs déceptions réciproques. Il est enfin celui des relations de l’ethnologue avec ses
compatriotes1, de sa place négociée de touriste pas comme les autres, de son
questionnement quotidien. Si le titre de la conclusion est trompeur, puisqu’elle propose
moins un « retour sur la méthode » qu’une synthèse théorique, un autre passage du
livre paraît précieux du point de vue méthodologique et fait écho au problème de
l’insertion de la chercheuse au sein des groupes de touristes. La fin du chapitre IX
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
553
propose en effet le récit d’« adoption » de l’ethnologue par un groupe tribal, les Nwâjî,
ses différentes procédures et difficultés (pp. 201-209).
3 Le livre est composé de quatre parties qui posent chacune la question de la rencontre
entre les touristes et les guides sous un angle différent. Rencontre des imaginaires tout
d’abord : la première partie est essentiellement historique et témoigne en particulier
d’une large connaissance de la littérature coloniale (œuvres littéraires et ouvrages
ethnographiques). C. Cauvin Verner montre par ailleurs comment les images du désert
se sont construites de manière parallèle, et met en regard, par exemple, les textes
religieux (la Bible et le Coran essentiellement). Une définition négociée du désert est
ainsi mise en lumière, entre vide introuvable et espace périphérique, entre préjugés
sociologiques et système de représentations pluriel.
4 Rencontre d’identités objectifiées ensuite : la deuxième partie du livre est consacrée
aux multiples manières de fabriquer de l’authenticité, à travers la mise en place, par les
guides, d’une identité bricolée et plurielle, à la fois tribale (Nwâjî), politique (Sahraouis)
ou labellisée (Touareg), mais aussi au moyen de décors adaptés aux annonces des
agences de voyage et aux brochures touristiques (l’erg ou le bivouac par exemple), ou
par l’intermédiaire d’objets artisanaux mis en scène dans des lieux marchands
diversifiés (les bazars, les coopératives de tapis ou les boutiques intégrées aux circuits
de randonnée). Là encore, ce sont des négociations symboliques qui permettent
d’attribuer une valeur d’authenticité aux personnes, aux espaces et aux objets, invitant
à repenser l’opposition entre tradition et modernité et à réfléchir plutôt en termes de
« dynamique de compromis » (p. 140). Par exemple, si les guides se déguisent en
Touaregs au moyen de gandouras bleues et de chèches noirs, c’est pour défendre une
« authenticité nomade » non seulement au regard des touristes – d’ailleurs souvent
déçus par ce qui leur semble être une décadence du nomadisme – mais aussi en vue
d’une reconnaissance de leur identité culturelle sur un plan national. En refusant
d’analyser le tourisme à travers des oppositions simplistes ou des accusations
d’acculturation, C. Cauvin Verner met ainsi en relief la façon dont les relations entre
touristes et guides s’inscrivent également dans des relations sociales locales et des
enjeux politiques nationaux.
5 Dans la troisième partie, il s’agit de passer d’un « point de vue symbolique » sur le
tourisme à un « point de vue économique et social » (p. 171). Les transformations
économiques sont à replacer dans un contexte plus large afin de mieux cerner la
diversité des contraintes qui permettent de les expliquer : en ce sens, le tourisme
semble moins avoir un impact sur l’économie locale que le contrôle accru des
frontières, les politiques de pacification ou l’abolition de l’esclavage. Quant à son
impact politique, il est à la fois local et national : les critères tribaux entrent en ligne de
compte pour le recrutement des guides et l’émergence du tourisme permet de
réaffirmer une certaine dissidence politique. Enfin, les multiples modifications de la vie
quotidienne (alimentation, mobilier, relations familiales) donnent à voir aussi bien des
capacités d’invention que des stratégies de déviation.
6 Ce sont ces « stratégies déviationnistes » qui constituent pour finir le sujet de la
quatrième partie du livre, autour de deux axes : la sexualité avec les étrangères (les
« copines »)2 et la consommation d’alcool. Ces deux phénomènes, analysés avec pudeur
par C. Cauvin Verner, président à une classification binaire des guides, entre bons
guides et guides décadents (ou « mauvais sujets »), classification partagée par les
habitants de Zagora et par les touristes. Les récits de vie présentés, parfois
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
554
dramatiques, invitent cependant à ne pas généraliser : il s’agit à chaque fois, pour les
guides, de révéler les antagonismes de leur société, de jouer avec ce que Jean-Robert
Henry appelle une frontière symbolique3. Les randonnées sont des lieux de rencontres
paradoxaux, entre séduction et déception, fascination pour l’ailleurs et repliement sur
soi.
7 Basé sur des enquêtes menées de 1994 à 2004, l’ouvrage de C. Cauvin Verner mobilise de
nombreuses descriptions ethnographiques et des références multiples. Au sujet des
relations de séduction entre les touristes et les guides marocains, les points de
comparaison avec des situations proches en Tunisie ou à Jérusalem sont en particulier
les bienvenus. Si l’on peut regretter que les paroles de touristes ou de guides, que les
extraits d’entretiens, ne soient finalement pas très nombreux, la finesse des
observations et des propositions théoriques permet d’offrir une vision élargie du
phénomène touristique et de souligner l’imbrication de logiques concurrentes et de
définitions bricolées à l’œuvre dans la rencontre entre les touristes et les habitants des
sociétés visitées.
NOTES
1. Les touristes observés n’étaient cependant pas tous français, certains étaient notamment
allemands.
2. Voir à ce sujet l’article de C. Cauvin Verner, « Du tourisme culturel au tourisme sexuel : les
logiques du désir d’enchantement » (dans ce numéro).
3. J.-R. Henry, « Les frontaliers de l’espace franco-maghrébin », in F. Colonna & Z. Daoud (dir.),
Être marginal au Maghreb, Paris, CNRS Éditions, 1993, pp. 301-311.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
555
Guyot, Sylvain. – Rivages zoulousCristina D’Alessandro-Scarpari
RÉFÉRENCE
GUYOT, Sylvain. – Rivages zoulous. L’environnement au service du politique en Afrique du Sud.
Paris, IRD-Karthala, 2006, 263 p.
1 S’il est notoire que les conséquences actuelles de l’apartheid sont encore nombreuses et
importantes en Afrique du Sud de nos jours, cet ouvrage met en exergue combien cela
est vrai également concernant les questions environne-mentales. Comme le souligne en
effet Benoît Antheaume dans l’avant-propos de l’ouvrage : « Les héritages spatiaux des
dispositifs raciaux restent souvent en place et n’ont été que marginalement
remodelés » (p. 7). La société et l’espace sud-africains restent donc encore fortement
ségrégués, bien que cette ségrégation ne s’opère plus par les mêmes moyens que dans le
passé. L’émergence d’une classe moyenne noire capable de se réapproprier certains
espaces par des moyens politiques ou économiques vient certainement nuancer
quelque peu ces propos, mais les rivages zoulous du Kwa-Zulu-Natal qui nous
concernent ici restent encore majoritairement fréquentés par les Blancs, que ce soit
pour l’exploitation minière et portuaire ou encore pour le tourisme.
2 Œuvre d’un géographe, qui connaît bien ces terrains pour les avoir longuement
fréquentés et sillonnés, et dont la connaissance du terrain transparaît tout le long du
texte, l’ouvrage porte donc sur des conflits spatiaux particuliers : les conflits
environnementaux. Après une analyse des dynamiques conflictuelles (qui constituent
la partie la plus originale et passionnante du texte à nos yeux), l’auteur en présente par
la suite la genèse, pour terminer avec les tentatives de régulation.
3 Ce que l’on appelle ici « rivages zoulous », c’est-à-dire le littoral du pays zoulou, est
constitué, à l’exception de la ville portuaire et industrielle de Richards Bay, de stations
balnéaires anciennes de taille réduite et d’espaces protégés : il s’agit d’« un cadre
spatial encore très inerte » (p. 12) selon les mots de l’auteur, mais agité par un certain
nombre de conflits spatiaux entre les activités économiques et la protection de
l’environnement. Les politiques environnementales néolibérales mises en place par le
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
556
gouvernement sud-africain post-apartheid tentent de valoriser l’environnement par
son exploitation économique à l’aide de l’écotourisme, mais cela ne suffit certainement
pas à apaiser tous les conflits, vu par ailleurs que les résultats sont mitigés.
4 L’ouvrage fait plus particulièrement référence à trois localités de ce littoral, qui sont
exemplaires, pour les conflits environnementaux qu’elles cristallisent, des dynamiques
de la bande côtière dans son ensemble : St Lucia, Manguzi et Richards Bay.
5 St Lucia, au cœur du Greater St Lucia Wetland Park, est victime des stratégies issues des
logiques de conservation de la nature littorale héritées de l’époque coloniale. Dans
cette région pauvre, la concurrence spatiale pour l’appropriation du littoral, et
l’incompatibilité des différentes logiques d’exploitation de celui-ci, engendre des
conflits environnementaux. L’exploitation du titane n’est effectivement pas compatible
avec la conservation du littoral : une seule de ces deux options peut prévaloir. Dans ce
cas, la politique et le droit ont été utilisés pour régler les dynamiques conflictuelles par
voie d’autorité : une décision gouvernementale a imposé dès 1996 le développement
écotouristique de la région. Mais ce coup de force engendre-t-il une résolution réelle du
conflit ? On peut en douter, car l’exploitation touristique des plages reste une source
insuffisante de revenus, qui ne parvient pas à couvrir les besoins des populations
locales, pour lesquelles donc la protection de l’environnement constitue une perte.
6 Si les habitants subissent des contraintes ou des interdits au nom de la protection de
l’environnement, ils vont développer des stratégies de réaction qui risquent de relancer
le conflit. C’est ce qui s’est passé lors de l’extension du parc de St Lucia à la réserve
naturelle de Kosi Bay, où se situe la localité de Manguzi. La réalisation d’un campement
écotouristique à Banga Nek donne aux habitants l’espoir de pouvoir se partager au sein
de la communauté les retombées des bénéfices, mais celui-ci perd de l’argent et
l’écotourisme se révèle comme un mauvais investissement. Les conflits autour de
l’intégration de la réserve au parc de St Lucia restent donc nombreux et virulents.
7 Richards Bay représente une réalité fort différente des deux précédentes. C’est une ville
industrielle, dont l’activité économique a été propulsée par la construction du port en
1976 : il s’agit donc d’un centre urbain de création récente (qui n’était qu’un village de
pêcheurs avant la construction du port) pour lequel, malgré tout, la municipalité tente
de mettre en place un développement touristique de la plage, non sans dérives
écologistes. Mais, seulement une partie restreinte et bien identifiée de la population est
impliquée dans les conflits qui en découlent, les dynamiques conflictuelles étant donc
elles aussi ségrégatives : « Les conflits environnementaux ne semblent concerner
qu’une petite fraction aisée de la population qui en a fait un de ses chevaux de bataille
sans toutefois être capable de présenter un front uni » (pp. 56-57).
8 En Afrique du Sud, l’environnement génère donc encore de l’exclusion et de la
ségrégation (ce que l’auteur appelle « l’apartheid vert ») entre des groupes
majoritairement blancs qui défendent leurs lieux de vie ou de vacances, à l’aide de
moyens politiques, sociaux et institutionnels pour faire entendre leur voix et des
populations noires pauvres et marginales, déplacées à l’époque coloniale pour
permettre la création des parcs et des réserves, et aujourd’hui contraintes à vivre dans
des conditions difficiles. « L’apartheid vert […] implique la sanctuarisation de grands
espaces “naturels” à des fins de protection de l’environnement en mettant
préalablement à l’écart les populations autochtones qui s’y étaient établies » (p. 99). À
Kosi Bay par exemple, cette logique a engendré des conflits spatiaux entre
l’aménagement touristique de l’espace du parc et le monde rural pauvre qui l’avoisine
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
557
et qui est coupé non seulement de toute infrastructure indispensable, mais aussi de
l’accès aux ressources auxquelles les populations avaient toujours eu accès dans le
passé.
9 Si la protection de l’environnement engendre de tels résultats, on en arrive à se
questionner avec l’auteur sur la compatibilité entre le développement et les logiques de
protection : « Qu’est-ce que la protection de l’environnement sans un processus
d’amélioration du niveau de vie de la majorité démunie des habitants ? » (p. 77). Voici
un point crucial pour la planification des aires protégées en Afrique subsaharienne et
rarement explicité en ces termes : bien que les discours des acteurs occidentaux
soulignent toujours les retombées économiques apportées par l’écotourisme, dans les
faits, les communautés locales sont progressivement exclues de la jouissance de leurs
ressources (par les interdits qui accompagnent les politiques de conservation) et de la
décision concernant les espaces qui leur appartiennent. Les exemples de ce type sont
nombreux un peu partout en Afrique, et multiplient les conflits spatiaux, en autorisant
les chercheurs à parler d’échecs répétés des politiques environnementales sur le
continent africain. L’environnement n’est donc pas un enjeu de conflit en soi, mais
plutôt un révélateur, comme d’autres vraisemblablement, de ce type de dynamiques qui
mettent l’espace au centre de l’action.
10 En ce qui concerne plus spécifiquement l’Afrique du Sud, Sylvain Guyot souligne
qu’avec la fin de l’apartheid, le gouvernement qui l’a remplacé a mis en place de
nouveaux pouvoirs locaux, qui se sont superposés aux précédents sans pour autant
vraiment les remplacer, ce qui n’a fait qu’accroître les difficultés de gestion des
territoires et des conflits. En effet, le niveau provincial est censé faire appliquer les lois
édictées par l’État sud-africain, mais celui-ci ne dispose pas (quelques rares exceptions
mises à part) de moyens nécessaires pour ce faire. « Le niveau local “fait le grand écart”
entre des impératifs de développement local, et la montée des mécontentements liés à
la dégradation de la qualité environnementale concernant différents types de clientèles
urbaines. Finalement il y a une distorsion importante entre la loi et son application en
raison de l’absence d’autorité régulatrice dotée de pouvoirs et de moyens appropriés »
(p. 204). Le gouvernement ANC est donc responsable d’un découpage et d’une gestion
territoriale inadaptée et peu performante en même temps qu’il relaye les discours des
institutions économiques internationales (Banque Mondiale et FMI) sur le
développement durable, à l’aide de politiques environnementales de protection, qui
utilisent le tourisme pour légitimer leurs actes.
11 Le bilan amer que l’auteur dresse de l’application des discours sur la gouvernance
territoriale et le développement durable en Afrique du Sud, et plus particulièrement
dans les localités étudiées, parle d’illusions sur la participation des habitants aux
politiques environnementales. À Kosi Bay-Manguzi « la “bonne gouvernance” sert de
faire-valoir à des institutions voulant continuer à appliquer des politiques corrompues
et vouées à l’échec, tout en se donnant bonne conscience et en investissant dans une
communication politiquement correcte » (p. 209).
12 En ce qui concerne la participation des habitants, celle-ci pose en revanche dans ces
contextes les mêmes problèmes qu’on retrouve ailleurs. Au premier chef la
représentativité des acteurs : seuls les acteurs qui ont des enjeux ou des intérêts bien
précis dans les espaces concernés viennent s’exprimer. À cela s’ajoute le fait que les
développeurs ont des budgets limités et des contraintes qui découlent de l’interaction
avec les institutions concernées par les réalisations : leur marge de manœuvre est donc
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
558
limitée et bien souvent ils ne recherchent qu’une validation « par le bas », sans être
vraiment à l’écoute des besoins et des points de vue des habitants.
13 Cette étude contribue donc à faire réfléchir sur les spécificités du cas sud-africain,
strictement liées aux héritages de l’apartheid, mais aussi aux dynamiques et aux
problématiques communes aux États africains. « Les catégorisations de l’apartheid font
aussi partie des héritages difficiles à dépasser, que ce soit pour les habitants eux-
mêmes, enfermés dans leurs certitudes, ou pour les observateurs extérieurs qui ne
peuvent pas s’en défaire facilement » (p. 14). L’apartheid n’est-il donc pas bien souvent
davantage présent dans l’esprit du chercheur que dans la réalité, celui-ci étant
dépourvu d’autres schémas explicatifs aptes à le remplacer ?
14 Les rivages zoulous, convoités entre plusieurs groupes d’acteurs et des logiques
spatiales différentes, soumis à la protection de leur environnement ainsi qu’aux
stratégies de développement industriel et touristique, font donc l’objet d’une
compétition territoriale et sont en syntonie avec les dynamiques actuelles de la
mondialisation. En ce qui concerne le politique, les efforts de démocratisation sont
indéniables et, pour ce qui est de l’économique, les choix néo-libéraux sont clairs. Si au
présent, les discours sur le développement durable ne font que justifier les stratégies
des différents acteurs qui visent principalement à accroître leur propre profit, on peut
légitimement s’interroger sur le futur de ces rivages zoulous.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
559
Jennings, Eric T. – Curing theColonizersKatherine Luongo
REFERENCES
JENNINGS, Eric T. – Curing the Colonizers : Hydroterapy, Climatology, and French Colonial Spas.
Durham-London, Duke University Press, 2006, 271 p.
1 Eric Jennings’ book focuses on the birth and development of four French colonial spas
and the emergence of the French spa town of Vichy as a cosmopolitan “capital of the
colonizers” (p. 201). Analyzing the twinned imperial “sciences” of hydrology and
climatology, the book traces the myriad ways in which the colonial spa emerged as a
key locus of persistent colonial concerns about “degeneration and déracinement” (p. 24)
and “fragility and mortality” (p. 2) in the empire. According to Jennings, French
colonial spas, and the “sciences” undergirding them, were significant spaces of empire-
building because they operated “as potent reminders of home, as interfaces between
the metropole and the colony” which “crystallized power and civilization, modernity
and knowledge” (p. 213).
2 While historians of health and leisure in the British Empire have studied in detail the
famously salubrious hill towns of India and other colonial locations of broadly
medicalized respite, Jennings’ study is among the first to approach these intertwined
issues in the French colonial context. Jennings’ work also offers a range of useful
interventions into histories of empire, medicine, tourism and leisure more generally.
Taking a Foucauldian view of the relationship between medicine and power, the book
ably asserts “the centrality of European health to colonial medicine” (p. 4). It contrasts
evocative versus exotic tourism and poses spas as sites designed to “cultivate
difference” while tacitly appropriating local hydrotherapeutic practices (p. 5). Studying
spa centers, Jennings argues, illuminates “everyday colonial practices” and highlights
the negotiations of identity and power relations which informed them (pp. 5-6).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
560
3 Through five case studies of spas in Guadeloupe, Réunion Island, Madagascar, Tunisia,
and Vichy, Jennings provides a convincing analysis of how colonial spas offer a lens
into the “foundations of empire” (p. 2). Chapter one proposes a complex intellectual
history of the commingled “sciences” of climatology, hydrology, and mésologie in order
to demonstrate “the link between the production and practice of colonial knowledge in
the field of tropical hygiene” (p. 8). Chapter two addresses the bureaucratization of spa
therapies and visits, detailing the legislation developed to govern different types of
cures and the establishment of special commissions to organize “spa breaks” for
various categories of French expatriates. Continuing on the theme of bureaucracy,
chapter three explains how in the case of Guadeloupe, “a key concept had been coined:
the administration could cut costs by creating in Guadeloupe the kind of rest and
reinvigoration facilities that were becoming immensely popular in metropolitan
France” (pp. 70-71).
4 Focusing on the slave and maroon histories of Réunion, chapter four examines the
narratives of white “discovery”, and the subsequent rebranding as ineluctably French,
of springs long in use by blacks. The chapter further traces how the island’s spa centers
were believed to exert a “Frenchifying” effect on expatriates and creoles alike (p. 97).
Chapter five on Madagascar likewise focuses on the appropriation of local spa places
and practices and on how the island’s central spa town operated as a “laboratory” in
which French colonial “social, architectural, and cultural experimentation were the
order of the day” (p. 143). Chapter six about Tunisia expands on this theme, delving
deeply into the ways in which the colony’s primary spa center “served as a colonial
crucible, a site where science, identities, even modernities jostled with and were
conditioned by religions, rituals, and millennial legacies” (p. 177).
5 Finally, chapter seven investigates how Vichy emerged as an “informal imperial hub”
at the same moment that the status of being “colonial” became equated with bearing a
pathologized, medicalized, condition (p. 182). Profiling the various categories of
colonial curistes who flocked to Vichy, Jennings traces how “in sociological and
anthropological terms, Vichy ultimately became the metropolitan point of contact–a
crucial interface to the motherland for settlers, missionaries, soldiers, and
administrators whose years of expatriation in the colonies had uprooted’ them from
their original metropolitan networks […]” (p. 185).
6 Jennings’ book is a “historian’s history” in the best sense, organized clearly along
geographic and temporal lines, its contentions develops and supported by meticulous
archival research culled from numerous French metropolitan and former colonial
archives. Further, Jennings shows himself to be particularly adept at reading artifacts
of material culture from colonial-era advertisements (p. 66) to caramel tins (pp.
205-206). While the subject of colonial spas might at first glance appear a tad esoteric,
the depth and breadth of Jennings’ research together with his effective employ of
important interdisciplinary concepts like “space” and “imperial networks” renders this
work useful to regional and imperial scholars and to historians of leisure, science, and
medicine as well.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
561
Kane, Momar Désiré. – Io l’AfricaineAnthony Mangeon
RÉFÉRENCE
KANE, Momar Désiré. – Io l’Africaine. L’Afrique et ses représentations : de la périphérie du
monde au cœur de l’imaginaire occidental. Paris, L’Harmattan, (« L’Afrique au cœur des
lettres »), 2009, 304 p.
1 Au seuil des indépendances africaines, un jeune intellectuel africain, Samba Diallo,
confessait les bouleversements qu’avait provoqués en lui son « chemin d’Europe » :
« Il arrive que nous soyons capturés au bout de notre itinéraire, vaincus par notreaventure même. Il nous apparaît soudain que, tout au long de notre cheminement,nous n’avons pas cessé de nous métamorphoser, et que nous voilà devenus autres.Quelquefois, la métamorphose ne s’achève pas, elle nous installe dans l’hybride etnous y laisse. […] Je ne suis pas un pays des Diallobé distinct, face à un Occidentdistinct, et appréciant d’une tête froide ce que je puis lui prendre et ce qu’il faut queje laisse en contrepartie. Je suis devenu les deux. Il n’y a pas une tête lucide entredeux termes d’un choix. Il y a une nature étrange, en détresse de n’être pas deux »1.
2 À travers le parcours initiatique de son héros, le romancier sénégalais Cheikh Hamidou
Kane tentait alors de repenser les rapports de l’Afrique à l’Europe, dans un monde
soumis à une occidentalisation croissante : quelle place restait à la spiritualité africaine,
quand la domination européenne avait marqué le triomphe de la technique et semblait
incarner la supériorité de la science et de la rationalité sur les univers de la magie et de
la foi ? Sur quels fondements reposeraient désormais les identités modernes, nées à la
croisée des mondes africains, orientaux et occidentaux ?
3 Ce sont ces questions que Momar Désiré Kane, un jeune philosophe homonyme du
grand écrivain sénégalais, reprend à nouveaux frais dans un essai au titre étrange : Io
l’Africaine. On pense spontanément à Black Athena, cette vaste somme par laquelle
l’historien juif américain Martin Bernal se proposait d’expliciter, dans les années 1980,
les racines afro-asiatiques de la civilisation classique2. Mais s’il ne fait aucun doute que
l’humanité vit le jour en Afrique, faut-il pour autant racialiser ses origines en
défendant, avec l’historien Cheikh Anta Diop, une « antériorité des civilisations
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
562
nègres » et la filiation des cultures négro-africaines avec l’Égypte antique, dont il
suffirait alors de réactiver les mythes et les croyances pour atteindre à une identité
« authentiquement africaine » ? Telle est la thèse soutenue aujourd’hui par les
partisans de l’afrocentrisme, tous disciples de Diop ou de son épigone africain
américain, Molefi Kete Asante, avec lesquels Momar Kane tente ici de prendre ses
distances. Pour lui, l’afrocentrisme diopien comme la négritude de Léopold Sédar
Senghor doivent avant tout s’interpréter comme de simples « retournements du
stigmate »3, qui valorisent et racialisent en effet une différence ou une spécificité nègre
alors même que celle-ci n’est jamais qu’un produit de l’imagination occidentale, et de
son obsession à se définir par contraste et en opposition avec l’Afrique ou l’Orient. Or
dans cette autodéfinition du Même, qui rejette l’Autre à sa périphérie en plaçant dans
ses marges tout ce qu’il se refuse à assumer et à reconnaître en son sein propre (le
primitivisme, la sauvagerie, le monde de la pensée magique, superstitieuse et des
croyances), Kane identifie un curieux paradoxe : régulièrement, sinon de façon
constante, la littérature occidentale revient à l’Afrique comme à sa part manquante,
notre imaginaire semblant accomplir ainsi cette fonction éminemment nécessaire d’un
retour aux sources – pour ne pas dire aux origines. C’est cette « dimension
archéologique et commémorative de l’imaginaire » (p. 9), dans ses détours et retours en
Égypte, ou dans ses détournements et retournements du signe « Afrique », que
l’essayiste choisit d’explorer à travers plusieurs mythes et généalogies croisés.
4 Intitulée « L’Afrique dépossédée de son héritage », la première partie analyse en détail
le renversement jadis opéré par Platon : tout en célébrant et en utilisant abondamment
le fond philosophique égyptien, ce dernier réussit en effet cet « immense tour de
force » de « réduire la raison à la rationalité, au seul logos articulant pensée et discours
(la pensée discursive) » (p. 29). Mais « la raison est d’abord ruse », et un « mode
d’inscription interactive spécifique avec son environnement et son voisinage […]
surtout fait d’approximations, de tâtonnements et de projections » (pp. 37-38) que les
Grecs appelaient mètis.
5 Kane montre abondamment comment cette « mètis comme mode d’intelligence est à
l’œuvre dans toute production mythique » (p. 93), et que dans une large mesure, la
philosophie de Platon en est elle-même une brillante illustration, qui parvient à
dissimuler tout à la fois son inspiration égyptienne et cette dimension pratique voire
tactique de la rationalité. Souvent convaincant, le raisonnement de Kane devient aussi
parfois fantaisiste, à force d’aborder toutes choses en termes de raison suffisante.
L’auteur affirme par exemple que « la majeure partie des êtres vivants » possèdent
cette mètis qui les rend aptes à « la dissimulation, à donner le vrai pour le faux » (p. 37),
et qui sert « partout et toujours à satisfaire trois types de besoins : les besoins
biologiques, sociaux et spirituels » (ibid.). Mais quels peuvent bien être exactement les
besoins spirituels des êtres vivants autres que l’Homme ? Comment expliquer par
ailleurs que les animaux savent ruser et feindre, mais jamais ne sauraient tromper,
« mentir ou feindre de feindre » ainsi que le soulignait Jacques Derrida lui-même4 ?
Comment expliquer enfin qu’à rebours des Hommes, ils n’éprouvent pas le besoin de se
raconter des histoires ou comme le dit Kane, « de donner une explication à l’existence
du monde tel qu’il se donne à percevoir afin de le rendre habitable » (p. 93) ? C’est qu’il
faut bien envisager une autre et double fonction à la mètis dans l’ordre de la culture : il
s’agit, d’une part, de se pouvoir réinventer et redéfinir sans cesse soi-même selon les
circonstances, et notamment dans nos rapports à l’autre ; il s’agit, d’autre part, de
maîtriser précisément ces derniers comme de véritables rapports de pouvoir, qui font
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
563
que tout rapport à l’autre ne doit pas uniquement s’envisager de manière culturelle,
même sur le mode généreux d’une « pollenisation mutuelle », parce qu’il est et
demeure toujours et déjà un rapport politique. Kane montre bien comment la manière
dont Platon use de la mètis pour cerner la rationalité et la réserver prioritairement à la
pensée discursive des « philosophes », participe de fait d’un contexte historique bien
particulier – la difficulté à introduire du sens et de la permanence dans le chaos
démocratique, et la volonté compensatoire de « s’installer dans l’hypothèse d’un monde
meilleur » (p. 91) en offrant une « définition rationnelle de la cité » (p. 75). Ce constat
suscite cependant une autre interrogation : quel intérêt politique peut-on avoir
aujourd’hui à faire de Platon un épigone raté des « prêtres égyptiens ou des initiés
dogons » (p. 91) ou à comparer la cosmogonie des Dogons à celle des Égyptiens ?
L’artifice des rapprochements apparaît nettement quand la croyance égyptienne en la
puissance démiurgique du verbe est finalement arbitrairement associée à « la
conception de l’être » rapportée par Amadou Hampâté Bâ dans ses réflexions d’ordre
général sur les cultures africaines, notamment lorsqu’il rappelle que selon la tradition
malinkée « les personnes de la personne sont multiples dans la personne » (p. 97)5.
Donner une portée ontologique à une maxime qui, après tout, n’affirme rien d’autre
que le caractère labile et situationnel des identités me semble révélateur d’une certaine
pente ethnophilosophique chez Momar Kane, qui semble vouloir lui aussi abstraire,
coûte que coûte, une origine et une essence communes aux différentes cultures
africaines et plus largement humaines.
6 Cette démarche fait tout l’objet de la deuxième partie, intitulée « géopolitique de
l’imaginaire ». L’exploration et la confrontation de diverses mythologies et généalogies
(grecques, juives, africaines, égyptiennes) partent d’un parallèle entre les aventures
d’Io l’Africaine et d’Europe la Phénicienne : toutes deux sont transformées en génisses
par leur amant Zeus, qui leur évite ainsi le courroux d’Héra, et toutes deux donnent
naissance aux principales familles et figures héroïques qui peupleront la mythologie
gréco-latine. On trouve ainsi, dès le principe, une gémellité symbolique qui fonde
toutes les rivalités à suivre dans les préséances généalogiques. Les mythes sont
également le terrain d’une double mètis : ils témoignent constamment de luttes et d’un
usage incessant de la ruse pour éliminer l’adversaire et obtenir le pouvoir ; mais eux-
mêmes altèrent constamment la mémoire généalogique en dissimulant notamment,
selon l’auteur, « l’origine égyptienne de la civilisation grecque » (p. 111) – à force
d’accorder, par exemple, la primauté à la descendance de Danaos, ancêtres des Grecs en
même temps qu’il était fils d’Io et frère d’Égyptos et de Céphée (Éthiopie). Dans les
aventures mythologiques, le détour fréquent par l’Afrique (ou le passage en Égypte)
peut alors s’interpréter comme un « retour du refoulé de la pensée occidentale »
(p. 129) sur le mode d’une « relation agonistique à l’autre » qui rejette sa présence ou
son influence dès lors qu’il est question de construction identitaire. Kane découvre
également la présence de l’Égypte au fondement des trois monothéismes et de la
psychanalyse freudienne : « L’homme Moïse », qui permet à son peuple de sortir
d’Égypte pour retrouver la terre promise, est en effet né en Égypte et élevé par la fille
du pharaon ; les Arabes se disent eux-mêmes descendants d’Ismaël (p. 192), ce premier
fils qu’eut Abraham avec Hagar, une concubine offerte à son mari par Sarah elle-même
lorsqu’elle ne pouvait enfanter. Enfin, l’histoire du Christ implique elle aussi un retour
en Égypte avec l’épisode de la fuite initiale (p. 216), soit une ultime manière selon Kane
d’« assumer et de nier un héritage africain dans un même mouvement » (p. 159).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
564
7 En suivant « une pente qui repose précisément », de son propre aveu, « sur une
intuition » (p. 276), et qui lui permet de multiplier les audaces interprétatives, la
démarche de Kane n’en pose pas moins de sérieux problèmes. Ceux-ci tiennent d’abord,
avouons-le, à un tel déploiement d’érudition, mais suivant un cheminement si décousu,
que l’auteur finit par égarer souvent son lecteur tandis qu’il semble lui-même perdre de
vue la trame de son argumentation. Il faut par exemple – tel Thésée tirant le fil
d’Ariane – retrouver nous-mêmes le lien entre « les trois monothéismes » car la section
vouée à son exposition se consacre à une soudaine et longue digression sur la
biographie de « Soundjata Keïta, héros fondateur de l’Empire du Mali » (p. 171 sq) sur le
simple prétexte qu’à l’instar d’Œdipe, ce héros ouest-africain serait né perclus !
8 La troisième partie promet enfin de mettre en perspective – et en résonance avec notre
actualité – ces divers « retours en Afrique », comme l’indique son titre. Mais son
« parcours plus ou moins erratique dans ce grand bazar que constitue la pensée
occidentale » (p. 209) ne débouche que sur des séries d’évidences, en s’appuyant de
surcroît sur l’ethnologie la plus datée : on sait depuis Lévi-Strauss qu’il n’est pas de
solution de continuité entre la pensée dite « sauvage », qui fonctionne sur le mode de
l’analogie et du bricolage, et la pensée dite « scientifique ou rationnelle », qui repose
sur des principes logiques. Faut-il pour autant plaider pour « une absolue
“contemporanéité” de la mentalité primitive » (p. 210), au risque de réhabiliter les
thèses controversées de Lucien Lévy-Bruhl – que leur auteur avait pourtant de lui-
même fini par abjurer sur le soir de sa vie ? Kane veut ainsi « révéler la marque du
primitif en chacun de nous » (p. 275), y compris au cœur de la pensée occidentale qui l’a
« longtemps tenu pour son dehors » alors qu’« aujourd’hui plus que jamais, l’Occident a
besoin de sa part africaine » (p. 218). Même s’il n’est plus question ici de rallumer la
vieille lanterne d’un « supplément d’âme » qui nous ferait désormais défaut mais serait
à trouver du côté de l’« âme africaine », dont Maurice Delafosse et tant d’auteurs
coloniaux nous vantaient les mérites voici cent ans, un flou demeure. La « part
africaine » est en effet d’abord interprétée comme une résilience dans notre
« imaginaire européen », un « afrotropisme » qui nous hanterait d’autant plus que nous
avons refoulé la mémoire d’une « proximité et des fusions culturelles dont elle était
porteuse » (p. 237). Mais dans le même temps, cette « présence africaine » « servirait
aussi à mettre en question la civilisation occidentale elle-même dans son matérialisme
envahissant » (p. 275) ou pour le dire autrement, à « pousser le monde occidental à une
réévaluation de son rapport au monde ». L’élection de Barack Obama à la présidence
des États-Unis serait dès lors, pour l’auteur « le signe le plus concret d’un retour vers
l’Afrique au moment où le monde occidental semble prendre la mesure du danger que
représente la logique de domination de la nature dont elle s’est réclamée pendant des
siècles » (p. 218). On objectera aisément à Kane que cette « logique de domination »,
tout comme le rejet de l’autre voire le refoulement « des hommes et des femmes hors
des frontières de ce que l’on considère comme son territoire ou son terroir propre »
(p. 217), n’ont rien de spécifiquement occidental, et que ces dispositions sont hélas
aujourd’hui assez communément partagées dans le reste du monde. Mais une fois cette
concession faite par l’auteur, il n’en demeure pas moins un peu de frustration : on
aurait aimé, concrètement, textes et faits à l’appui, qu’il nous montre où et comment
cette « part manquante africaine » nourrit aujourd’hui plus que jamais notre
« imagination créatrice » (p. 241). Il y a bien quelques allusions furtives à Joseph Conrad
(Au cœur des ténèbres), Raymond Roussel (Impressions d’Afrique), à Michel Leiris (L’Afrique
fantôme) ou à Jean-Marie Gustave Le Clézio (L’Africain), mais les « retours littéraires en
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
565
Afrique », censés faire l’objet de la dernière partie, se réduisent finalement à des
analyses de seconde main quand Momar Kane cite et commente, pages 237 à 253, les
actes d’un colloque publié par les Cahiers de l’exotisme6ou encore, pages 282 à 285, les
textes rassemblés par Jean-François Durand et Jean Sévry dans les « cahiers de la
société internationale d’étude des littératures de l’ère coloniale »7– deux ouvrages
collectifs inégaux que la bibliographie finit d’ailleurs par confondre (pp. 294, 296) !
9 Pour conclure, je ferai quelques propositions n’engageant pas que moi, mais bien le
dialogue philosophique et littéraire entre l’Afrique et l’Europe qui intéresse tant Kane.
On peut certes aborder les cultures en termes psychologiques, voire mystiques, et ce fut
après tout le parti de nombreux ethnophilosophes africains et d’anthropologues
occidentaux ; mais alors le danger est grand d’unifier et de figer à outrance les
sensibilités dans une polarité statique. Kane n’échappe pas à ce travers, qui parle après
tant d’autres de « la pensée occidentale » comme si cette dernière était uniforme et
immuable, d’un siècle ou d’une culture à l’autre. Je suis personnellement d’avis que
« l’épistémè occidentale », si tant est qu’elle existe, est non seulement relationnelle (et
donc en interaction avec d’autres épistémai, qui l’influencent et qu’elle influence en
retour) mais de surcroît traversée de plusieurs régimes de pensée, dont l’articulation et
la concurrence font qu’on peut assurément découvrir autant de discontinuités, au sein
d’une même époque, que de continuations d’un âge à l’autre. Disons, pour aller vite,
qu’un régime conceptuel turbulent et naturaliste a, depuis Héraclite et Lucrèce jusqu’à
Bergson en passant par Herder et Spinoza, constamment contrarié ce que j’appellerais
le régime dominant de la philosophie, idéaliste et en quête de permanence, lequel court
depuis Platon et va jusqu’à Husserl en passant par Descartes. Diverses tentatives ont été
faites d’articuler ensemble ces deux régimes, d’indexer par exemple la primauté
donnée à la rationalité sur la préséance accordée aux affects, ou de penser l’interaction
entre des universaux (la conscience comme intentionnalité, le langage comme
médiation, etc.) et des particularismes (les situations historiques, culturelles et
sociales) dans la constitution des valeurs et partant, des visions du monde8. Cela m’a
conduit à affirmer que la pensée noire, telle qu’elle fut développée au XXe siècle par des
philosophes africains, antillais ou africains-américains, était peut-être davantage la
continuation d’une longue discontinuité, inscrite au cœur même de « la pensée
occidentale », qu’un horizon inconnu et tout à fait nouveau dans son dialogisme entre
Afrique et Europe. Je crois de fait que cette conviction anime également Momar Kane :
en se refusant à suivre ces grands totems que sont Cheikh Anta Diop et Léopold Sédar
Senghor dans leur racialisation et négrification d’un patrimoine ou d’une origine
commune, il plaide également et efficacement en faveur d’une histoire culturelle et
intellectuelle en partage. De même lorsqu’il affirme, page 283, que « la démarche
entreprise dans cet ouvrage nous dévoile une part discrète sinon cachée de la réalité
littéraire occidentale : il semble que l’on n’ait pas pris la mesure de l’influence directe
des cultures dominées sur la culture des dominants ». Kane ne dit alors rien de moins
que ce qu’affirmaient déjà de grands penseurs noirs américains comme William E. B.
Du Bois dans Les Âmes du Peuple Noir (1903) ou Alain Locke dans Le rôle du Nègre dans la
culture des Amériques (1943)9. À quoi bon greffer là-dessus une théorie de la conspiration
ou un complot du silence ? À déployer tant d’efforts pour montrer son égale maîtrise de
l’antiquité grecque et de l’antiquité égyptienne, Kane révèle surtout un désir
mimétique à l’encontre de ces figures tutélaires ou pères spirituels que représentent
pour lui Senghor, Diop et l’Ogotemmêli de Griaule. On souhaite donc à cet esprit vif,
cultivé et d’une insatiable curiosité de rompre vite et tôt avec la faconde métaphysique
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
566
des grands maîtres de la parole. Une nouvelle réhabilitation dans le passé, et
notamment dans l’antiquité, n’est pas plus utile à l’Afrique contemporaine que l’Europe
n’a besoin de voir refonder son « grand récit » des origines par une énième explication
totalisante. Momar Kane propose d’ailleurs, dans sa belle conclusion, de « substituer le
cousinage à plaisanterie à l’ethnocentrisme » (p. 290)10 : voilà un programme ambitieux
et fécond pour dépasser les susceptibilités épidermiques. Mais la première chose à
faire, pour mieux donner l’exemple, c’est de rompre avec l’esprit de sérieux.
NOTES
1. Cheikh Hamidou Kane, L’aventure ambiguë, Paris, UGE (« 10/18 »), 1995 [1961], pp. 125, 164.
2. Martin Bernal, Black Athena, les racines afro-asiatiques de la civilisation classique, 1. L’invention de la
Grèce antique, 1789-1985 ; 2. Les sources écrites et archéologiques, Paris, Presses Universitaires de
France, 1996 [1987].
3. Sur cette notion, voir Jean-Loup Amselle, L’Occident décroché, essai sur les postcolonialismes, Paris,
Stock, 2008.
4. Jacques Derrida, L’Animal que donc je suis, Paris, Galilée, 2006, pp. 55, 111.
5. Le proverbe cité est en réalité bambara, et non pas malinké, même si ces deux langues et
cultures se rattachent semblablement au groupe mandé (voir Ahmadou Hampâté Bâ, Aspects de la
civilisation africaine, Paris, Présence Africaine, 1972, p. 11).
6. Afriques Imaginées, 2001.
7. Littérature et colonies, Pondichéry, Kailash, 2003.
8. Voir notamment ma thèse de doctorat en lettres modernes : Anthony Mangeon, Lumières
Noires, Discours Marron : indiscipline et transformations du savoir chez les écrivains noirs américains et
africains ; itinéraires croisés d’Alain LeRoy Locke, V. Y. Mudimbe, et de leurs contemporains, Université de
Cergy-Pontoise, 2004 ; ainsi que les travaux du philosophe africain Kwasi Wiredu, en particulier
Cultural Universals and Particulars, An African Perspective, Bloomington, Indiana University Press,
1996.
9. W. E. B. Du Bois, Les Âmes du Peuple Noir, Paris, La Découverte, 2007 ; Alain Locke, Le rôle du
Nègre dans la culture des Amériques, Paris, L’Harmattan (« Autrement Mêmes »), 2009.
10. Le cousinage à plaisanterie, nous dit l’auteur, est « un lien sacré entre deux ethnies qui
furent voisines et qu’opposaient des conflits. Il permet de surseoir aux relations de pouvoir et de
préséance. Ainsi ni l’âge, ni le sexe, ni le statut social n’empêche de se dire des grossièretés, de se
taquiner, sans que cela prête à conséquence » (p. 290).
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
567
Kibicho, Wanjohi. – Tourisme en paysmaasaï (Kenya)Julien Bondaz
RÉFÉRENCE
KIBICHO, Wanjohi. – Tourisme en pays maasaï (Kenya) : de la destruction sociale au
développement durable. Paris, L’Harmattan, 2007, 264 p.
1 Si le titre du livre de Wanjohi Kibicho est affirmatif, c’est sous une forme interrogative
qu’il apparaît dans l’introduction : « Tourisme en pays maasaï au Kenya : de la
destruction sociale au développement durable ? ». Il s’agit en effet pour l’auteur de
questionner et de motiver le passage d’un tourisme de masse analysé en termes de
destruction socioculturelle à un tourisme communautaire et à une planification
durable. W. Kibicho substitue par ailleurs à l’opposition Nord/Sud souvent sollicitée
dans les théories du tourisme international une opposition entre citadins occidentaux
ou kenyans (touristes, experts, entrepreneurs…) et communauté locale. Cette seconde
opposition était d’ailleurs mise en avant dans le titre de sa thèse en géographie,
aménagement et urbanisme : Tourisme et parcs nationaux au Kenya : la ville contre la société
rurale locale ?1, dirigée par Jean-Michel Dewailly, et dont le présent ouvrage est tiré.
2 Une telle substitution cependant paraît avoir certaines limites, que ce soit quand
l’auteur définit le tourisme comme un phénomène strictement urbain, faisant
l’économie d’une approche sociologique des groupes de touristes de safari, ou quand il
proclame que « le tourisme est devenu une nouvelle forme de colonialisme » (p. 226).
Par ailleurs, cette opposition entre citadins et ruraux peut parfois avoir pour défaut de
perpétuer une analyse du phénomène touristique formulée trop exclusivement en
termes d’opposition, de confrontation et de domination.
3 Cependant, en choisissant de s’intéresser à un territoire particulier et à une destination
touristique précise, le Parc national d’Amboseli, situé en pays maasaï à la frontière du
Kenya et de la Tanzanie, W. Kibicho, lui-même originaire de cette région, offre une
approche fine et documentée des problèmes posés par l’essor du tourisme international
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
568
à un niveau local. En particulier, l’éclairage historique proposé met bien en évidence le
double mouvement qui s’opère au Kenya pendant la période coloniale : la mise en place
d’aires protégées à partir de la fin du XIXe siècle (chapitre I) et la constitution de deux
réserves maasaï en 1904, réduites à une seule sept ans plus tard (chapitre V).
4 À travers ce parallélisme, c’est la construction artificielle d’un espace naturel et
sauvage qui est révélée, l’auteur montrant comment les pasteurs maasaï sont exclus de
leurs terres pendant la période coloniale, puis de l’économie du tourisme après
l’indépendance du Kenya en 1963. On assiste ainsi, dans la région d’Amboseli, à la
constitution de ce que W. Kibicho appelle un « musée vivant », regroupant à la fois la
faune sauvage, en particulier les fameux « Big Five » (lions, léopards, éléphants,
rhinocéros et buffles), et des paysages attractifs, le parc naturel étant situé au pied du
mont Kilimandjaro. Depuis la réforme des group ranches, mise en œuvre au début des
années 1970, une redéfinition des territoires a conduit à accentuer la sédentarisation
des pasteurs maasaï, la privatisation des terres et les changements économiques et
sociaux – avec, par exemple, en certains endroits, le remplacement du pastoralisme par
l’agriculture, ou l’apparition de conflits récurrents liés aux saccages causés par les
éléphants du parc. La région est désormais « utilisée de multiples manières par des
groupes sociaux qui se superposent » (p. 210).
5 Mais c’est en termes de produit et de marketing (chapitre VII), et non pas en termes
sociologiques, que l’auteur choisit d’analyser cette multiplicité d’usages et d’activités.
Une telle approche a pour inconvénient de ne pas rendre compte de l’impact du
tourisme sur certains aspects culturels de lasociété maasaï2 pourtant présentés
synthétiquement dans le chapitre central du livre (chapitre V) : peu de choses par
exemple sur les changements concernant l’organisation sociale, les diverses
cérémonies évoquées, ou encore l’artisanat – ce qui tend parfois à donner une image
quelque peu figée de la société maasaï.
6 Cette approche a cependant pour avantage certain de poser les bases d’une réflexion
solide sur le développement durable de la région d’Amboseli et sur l’avenir du parc
national. W. Kibicho souligne ainsi de manière perspicace et concrète les problèmes
auxquels conduit la recherche d’une articulation équilibrée entre logique de la
conservation et logique du développement. En ce sens, cet ouvrage clair et bien
structuré témoigne avec sérieux des défis du Kenya contemporain, entre nécessité de
capter les flux et les ressources du tourisme international et besoin d’associer au
développement économique et à la protection de l’environnement les communautés
locales.
NOTES
1. Wanjohi Kibicho, Tourisme et parcs nationaux au Kenya : la ville contre la société rurale locale ?,
Thèse de doctorat, Lyon, Université Lyon 2, 2005.
2. À ce sujet, voir l’article de N. B. Salazar : « Imaged or Imagined ? Cultural Representations and
the “Tourismification” of Peoples and Places », dans ce numéro.
Cahiers d’études africaines, 193-194 | 2009
569