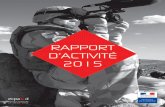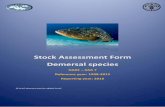Rapport de stage - Archimer
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Rapport de stage - Archimer
Institut polytechnique UniLaSalle 19, rue Pierre Waguet 60 000 Beauvais
Spécialité Géotechnique et risques naturels
Centre de Bretagne 1 625 route de Sainte-Anne
29 280 Plouzané
Service Géosciences Marines/Cartographie
Rapport de stage technique Promotion 082 Maître de stage : Benoît LOUBRIEU Tuteur de stage : Bassam BARAKAT
Année 2020/2021
Rapport de stage
Cartographie – Compilation et analyse numériques de données bathymétriques sur la dorsale Atlantique Nord centrale
Priscille VIELLEFON
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 3
Résumé Aujourd’hui, seuls 15% des fonds des océans du globe sont cartographiés à haute résolution,
d’environ 100 mètres. L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer) participe à la collecte de données de profondeur des fonds marins haute résolution, les « données bathymétriques », en déployant ses navires océanographiques équipés de sondeurs-multifaisceaux. Le stage au sein du service de cartographie marine de l’Ifremer a permis dans un premier temps de traiter des données bathymétriques brutes acquises sur la dorsale de l’océan Atlantique Nord central entre 1991 et 2018, et de les compiler pour créer des modèles numériques de terrain. Ces modèles constituent de véritables supports de recherche en géosciences. Ils sont diffusés aux chercheurs en interne et en externe de l’Ifremer, alimentent des projets de recherche internationaux. Dans un second temps, c’est un travail d’analyse qui a été effectué en collaboration avec les chercheurs : l’étude des structures abyssales de la dorsale Atlantique entre 14°N et 35°N pour mieux comprendre la tectonique des plaques, ainsi que la cartographie structurale d’une zone d’exploration de sulfures polymétalliques.
Abstract Today, only 15% of the global ocean floor has been mapped at a high resolution of around 100
meters. The French Research Institute for the Exploitation of the Sea (Ifremer) participates in the acquisition of high-resolution seafloor depth data called "bathymetric data", by deploying its oceanographic vessels equipped with multibeam echo sounders. This internship within the ocean mapping service of Ifremer allowed, firstly, the processing of raw bathymetric data, acquired between 1991 and 2018 over the central North Atlantic mid-ocean ridge, and to compile them in digital terrain models. These models are necessary to improve geologic investigations, and they are available to scientists in Ifremer and elsewhere. The models also contribute to international bathymetric models and research projects. In a second step, data analyses were carried out in collaboration with Ifremer researchers : a study of the abyssal hill structures of the mid-Atlantic ridge between 14°N and 35°N was carried out in order to better understand the plate tectonic movements and a structural geology map was created for a polymetallic sulphides exploration zone.
Mots clés
Key Words
- Cartographie marine - Données bathymétriques - Dorsale - Ifremer - Océan Atlantique Nord central - Sondeur-multifaisceaux - Structures abyssales - Sulfures polymétalliques - Tectonique des plaques - Traitement de données
- Abyssal hill structures - Bathymetric data - Central North Atlantic mid-ocean ridge - Data process - Digital terrain model - Ifremer - Multibeam echo sounder - Ocean mapping - Plate tectonic movements - Polymetallic sulphides
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 5
Remerciements Je tiens à remercier tous les collaborateurs de l’Ifremer qui m’ont permis de réaliser mon stage,
expérience professionnelle à la fois très enrichissante et épanouissante. Je remercie particulièrement M. Benoît Loubrieu, mon maître de stage, pour son accueil, sa
pédagogie, ses conseils et son accompagnement tout au long du stage. J’adresse mes remerciements à M. Florian Besson, qui m’a orientée vers le service de
cartographie de l’Ifremer lors de ma recherche de stage et pour le temps qu’il m’a accordé pendant le stage pour répondre à mes questions.
Je tiens à remercier vivement M. Walter Roest grâce à qui j’ai pu approfondir un sujet de recherche et qui m’a donné de nombreux conseils rigoureux et astucieux.
Je remercie également l’ensemble des membres de l’équipe du service de cartographie de
l’Ifremer, pour l’ambiance de travail chaleureuse, les témoignages d’expérience professionnelle qu’ils
ont partagés, et pour leur aide logistique pendant le stage.
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 7
Table des matières Table des illustrations …………………………………………………………………………………………………………... 9 Liste des tableaux ……………………………………………………………………………………………………………….. 10 Liste des abréviations, symboles et unités …………………………………………………………………………… 11 Glossaire …………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Introduction ………………………………………………………………………………………………………………………… 15
1 Prestations du service cartographie : la diffusion de données en géosciences ................. 17
1.1 L’archivage des données de l’Ifremer ........................................................................ 17
1.2 La contribution aux projets de compilation de données bathymétriques ................ 17
1.3 La cartographie au service de l’exploration des fonds marins................................... 18
2 Organisation générale du stage et compétences acquises ................................................ 19
2.1 La répartition du temps en quatre tâches ................................................................. 19
2.2 Les compétences acquises ......................................................................................... 20
3 Géologie de la dorsale Atlantique, potentielle réserve minérale ...................................... 21
3.1 L’océan Atlantique encore peu connu ....................................................................... 21
3.2 L’exploration des sulfures sur le site hydrothermal du permis français .................... 21
3.3 Cartographie structurale du site hydrothermal ......................................................... 22
4 Tâches effectuées : les travaux d’appui à la recherche ..................................................... 25
4.1 Première tâche : traitement et compilation de données bathymétriques ................ 25
4.1.1 Le sondeur multifaisceaux, outil d’acquisition de données bathymétriques ....... 25
4.1.2 GLobe, le logiciel de traitement de données bathymétriques de l’Ifremer.......... 26
4.1.3 Protocole de traitement des données bathymétriques ........................................ 27
4.1.3.1 La correction du biais ..................................................................................... 27
4.1.3.2 Le filtrage, élimination des sondes incohérentes .......................................... 28
4.1.3.3 Interpolation et lissage du modèle numérique de terrain ............................. 30
4.1.4 La compilation des campagnes ............................................................................. 30
4.2 Deuxième tâche : analyse des structures abyssales .................................................. 31
4.2.1 Le relief des fonds marins, un indicateur des mouvements tectoniques ............. 31
4.2.2 Démarche d’analyse des structures abyssales ...................................................... 32
4.2.2.1 Choix des structures de référence à analyser ................................................ 32
4.2.2.2 Identification des structures sur ArcGis ......................................................... 32
4.2.2.3 Statistiques sur les orientations des structures ............................................. 33
4.2.2.4 Présentation des résultats : comparaison avec les données de MORVEL ..... 34
4.2.3 Conclusion de l’analyse ......................................................................................... 37
Conclusion…………………………………………………………………………………………………………………………….39 Liste des références………………………………………………………………………………………………………………41 Annexes………………………………………………………………………………………………………………………………..45
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 9
Table des illustrations
Figure 1 : Diagramme de Gantt, répartition du temps et des tâches effectuées pendant le stage. Les
nombres en blanc indique la durée, en jours ouvrés, de la tâche. Certaines activités ont été effectuées conjointement, afin de gagner en rigueur, praticité et efficacité. Source personnelle .......................................................................................................................... 19
Figure 2 : Les sites hydrothermaux. a) Localisation des sites hydrothermaux dans le monde. Près de 150 sites hydrothermaux ont déjà été identifiés. (« Sulfures »,). b) Fumeur hydrothermal, accumulation de sulfures dans le Pacifique (« Sulfures »,) ................................................. 22
Figure 3 : Carte géologique structurale de la grappe 4 (contour noir) du permis français d'exploration des sulfures. En s’éloignant de l’axe de la dorsale, la croûte océanique est de plus en plus ancienne. Le segment AB représente le trait de coupe (Figure 4). Le MNT de fond a une résolution d’environ 100 m, alors que la grappe 4 a été cartographiée à une résolution de 30 m. Source personnelle .................................................................................................... 23
Figure 4 : Coupe géologique simplifiée orientée O-E de la dorsale Atlantique Nord centrale, dans la grappe 4 du permis d'exploration français des sulfures. La topographie a été obtenue sur ArcGis. Le trait de coupe est visible sur la carte géologique structurale (Figure 3). Source personnelle .......................................................................................................................... 24
Figure 5 : Schéma de fonctionnement du sondeur multifaisceaux(« Sondeurs multifaisceaux pour les fonds marins »,) ................................................................................................................... 25
Figure 6 : Itinéraire de l'Atalante (en rouge) pendant la campagne Seadma entre 22°N et 23°N, 45°W et 44°W. D’après GLobe, source personnelle .......................................................................... 26
Figure 7 : Fonctionnalités du logiciel GLobe. D’après GLobe, source personnelle ................................ 27 Figure 8 : Comparaison des MNT avant (a) et après (b) l’application de la correction de biais de tangage.
a) Les profils d’aller et de retour du bateau ne se superposent pas. Par conséquent, les lignes de crêtes sont discontinues sur le MNT (lignes blanches). b) Une correction de 5° sur le tangage est appliquée au MNT : les profils d’aller et retour du bateau se superposent et les crêtes s’alignent (ligne blanche). D’après GLobe, source personnelle ................................ 28
Figure 9 : Identification des sondes incohérentes par filtrage automatique par triangulation, vues dans le Swath Editor de GLobe. Les sondes cohérentes relevant le fond marin sont représentées en vert, et les sondes aberrantes en rouge. a) Profil des sondes relevant des émissions de fluides (en rouge) sur un cratère dans la zone Seadma. b) Profil des sondes pendant un transit trop rapide du bateau. Les sondes relèvent des trous d’artefacts sur le fond marin. D’après GLobe, source personnelle ..................................................................................... 29
Figure 10 : Filtrage manuel des sondes incohérentes. a) Le filtrage automatique par triangulation a laissé des artefacts sur le MNT. b) La couche STDEV permet de visualiser les zones d’artefacts, elle affiche les forts écarts-types (en rouge). c) Les sondes incohérentes sont invalidées à la main (en rouge) dans le Swath Editor. Les sondes représentant le fond marin sont conservées (en vert). d) Le MNT manuellement filtré ne présente plus d’artefacts. D’après GLobe, source personnelle ..................................................................................... 29
Figure 11 : Compilation des campagnes pour la zone Seadma. a) Ordre de superposition des MNT de la campagne la plus récente à la plus ancienne. b) Les couches CDI (en couleurs) permettent de voir à quelle campagne appartient le jeu de données bathymétriques (métadonnées). c) MNT final de compilation des campagnes traitées dans la zone Seadma, vu sur GLobe. D’après GLobe et base de données Ifremer/SISMER, source personnelle .......................... 30
Figure 12 : Coupe schématique d'une ride médio-océanique (Olive et al., 2015) ................................ 31 Figure 13 : Modèle de configuration actuelle des plaques tectoniques. NA : Amérique du Nord ; SA :
Amérique du Sud ; NB : Nubia. La limite de plaque entre NA et SA est peu connue (zone en pointillés). Les isochrones sont représentés par des points de couleurs différentes. A noter qu’il est impossible d’identifier fiablement les isochrones magnétiques dans la zone équatoriale. D’après (DeMets et Merkouriev, 2019) ........................................................... 32
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 10
Figure 14 : Représentation des reliefs sur ArcMap (campagne Seadma). a) Expositions des pentes classées par orientation. La flèche blanche indique une ligne de crête. b) Exposition des pentes supérieures à 15°. Source personnelle .................................................................... 33
Figure 15 : Exemple des histogrammes pour les secteurs Faranaut01. La courbe bleue correspond aux expositions des pentes supérieures à 15° pour le secteur à l'Est de la dorsale médio-Atlantique, la courbe orange, pour le secteur à l'Ouest. Les pointillées rouges indiquent le pic des expositions Est dans le secteur à l’Ouest de la dorsale, et les pointillées noirs les bornes de l’intervalle de 45° autour de ce pic. Le tableau compare les moyennes des expositions calculées selon les intervalles de valeurs choisis. Source personnelle ............. 33
Figure 16 : Graphique représentant les moyennes des expositions des flancs des collines abyssales sur les 45° autour du pic, à l’Ouest (orange) et à l’Est (bleu) de la dorsale en fonction de la latitude des secteurs. Afin de comparer les directions des exposition Ouest et Est sur le même graphique, 180 degrés ont été soustraits des valeurs d’exposition Ouest. Les gros points indiquent les expositions moyennes des failles normales, et les petits points, des flancs opposés. Les directions des failles transformantes utilisées dans le modèle de MORVEL sont indiquées par les points verts. Source personnelle ...................................... 35
Figure 17 : Graphique représentant les expositions moyennes des flancs des collines abyssales sur les 45° autour du pic à l’Ouest (orange) et à l’Est (bleu) de la dorsale en fonction de la latitude des secteurs. Afin de comparer les directions des expositions Ouest et Est sur le même graphique, 180 degrés ont été soustraits des valeurs d’exposition Ouest. Les gros points indiquent les expositions moyennes des failles normales, et les petits points, des flancs opposés. La zone en gris indique la potentielle zone de transition entre les plaques américaines. Source personnelle ......................................................................................... 36
Figure 18 : Graphique représentant les expositions des failles normales (points rouges) et les directions des failles transformantes (points verts) du modèle de MORVEL en fonction de la latitude. Les points rouges sont obtenus en calculant la moyenne des expositions moyennes des failles normales à l’Ouest et à l’Est de la dorsale (gros points oranges et bleus sur les Figure 16 et Figure 17). Les marges d’erreur d’un degré sont représentées par des segments verticaux et les courbes de tendance en lignes pointillées. Source personnelle ................ 37
Liste des tableaux Tableau 1 : Compétences acquises pendant le stage. Source personnelle ........................................... 20 Tableau 2 : Propriétés des sondeurs multifaisceaux utilisés sur les navires Ifremer (en jaune, les
sondeurs utilisés pour les relevés bathymétriques traités dans le cadre de ce stage) d’après (« Sondeurs multifaisceaux pour les fonds marins ») .......................................................... 26
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 11
Liste des abréviations, symboles et unités
AIFM : Autorité internationale des fonds marins BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière CTDI : Cartographie, Traitement de Données et Instrumentation E : Est EMODnet : European Marine Observation and Data network GEBCO : General bBthymetric Chart of the Oceans GMRT : global multi-resolution topography Ifremer : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer km : kilomètre m : mètre MNT : modèle numérique de terrain MORVEL : mid oceanic ridge velocities, modèle de tectonique des plaques selon lequel le globe
terrestre est constitué de 25 plaques tectoniques N : Nord O : Ouest ONU : Organisation des Nations Unies S : Sud SISMER : systèmes d’information scientifiques pour la mer SMF : soudeur multifaisceaux STDEV : standard deviation (écart-type) Unesco : United Nations educational, scientific and cultural organization
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 13
Glossaire
abysse : fond océanique de plus de 2 000 mètres de profondeur, 8 anomalie magnétique : enregistrement du champ magnétique terrestre dans une roche, contemporain à sa
formation, 24 ArcGis : logiciel de cartographie, système d'information géographique, 15 bathymétrique : relatif au mesurage, par sondages, des profondeurs d'eau, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25 cap : dérive du bateau, 20 colline abyssale : haut relief formé par le basculement des blocs lors de la formation des failles normales, de part
et d'autre d'une dorsale , 6, 25, 27, 28, 29 Coratt : sur le logiciel GLobe, outil permettant de sélectionner les faisceaux sur lesquels une correction de biais
est appliquée, 20 DEPTH : profondeur, 19 dorsale : chaîne de reliefs sous-marins où la croûte océanique est produite, limite entre deux plaques
tectoniques, 11 dtm : extension des fichiers raster dans le logiciel GLobe, 19 EMODnet Bathymetry : projet de compilation de données bathymétriques européen, 9 faille cisaillante : voir "faille transformante", 28, 30 faille normale : faille dont la direction est perpendiculaire à la direction d'un mouvement extensif, parallèle à la
dorsale, 6, 24, 25, 27, 28, 29, 30 faille transformante : faille dont la direction est grossièrement perpendiculaire à l'axe de la dorsale, due à des
contraintes cisaillantes, 6, 24, 26, 27, 28, 30 fauchée : ensemble des directions de propagation d'une onde acoustique de sondeur multifaisceaux, 17 fluide hydrothermal : eau de mer chargée en minéraux dissous, 14 GLobe : logiciel de traitement des données bathymétriques élaboré par l'Ifremer, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 25 grappe : secteur de permis d'exploration délivré par l'AIFM, 5, 14, 15, 16, 17 isochrone : ligne reliant les points de même âge géologique , 25 mbg : extension des fichiers contenant la donnée bathymétrique dans le logiciel GLobe, 19 merge : outil de fusion des MNT dans GLobe, 22 métadonnée : source et provenance de la donnée, 5, 20, 22, 23 modèle numérique de terrain : représentation d'une surface créée à partir de données d'altitude ou de
profondeur, 19 nodule polymétallique : concrétion noirâtre se composant de fines couches concentriques d’oxydes de fer et
manganèse qui entourent un nucléus., 10 nvi : fichier d'itinéraire du bateau dans GLobe, 19 pitch : voir "tangage", 20 raster : modèle de données spatiales qui représentent l'espace sous la forme d'un tableau de cellules de même
taille organisées en lignes et colonnes, 19 réflectivité : capacité d'un substrat à réfléchir une onde sonore, 15, 18 ride médio-océanique : voir "dorsale", 24 roche basaltique : roche volcanique constituant la croûte océanique, 14 roll : voir "roulis", 20 roulis : oscillation latérale d'un navire alternativement sur babord et tribord , 20 Seabed 2030 : projet international de réalisation de la carte bathymétrique mondiale complète avant 2030, 5, 9 site hydrothermal : site où l'eau de mer pénètre dans les failles du fond marin, et se charge en minéraux, 14 sonde : hauteur d'eau mesurée sous la surface et rapportée au zéro des cartes marines, 18 sulfure : composé résultant de l'union du soufre avec un autre corps, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17 swath : voir "fauchée", 17 Swath Editor : outil de GLobe permettant de visualiser les profils de sondes, 20 tangage : oscillation longitudinale d'un navire, alternativement de la poupe à la proue, 20 triangulation : méthode permettant de déterminer la position d’un point dans un espace à trois dimensions à
l’aide d’au moins trois autres points fixes dont on connaît la position exacte, 5, 21, 22 zone économique exclusive : espace maritime sur lequel un État côtier exerce des droits souverains en matière
d'exploration et d'usage des ressources, s'étendant à moins de 200 miles de ses côtes, 10
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 15
Introduction La connaissance des fonds marins est, aujourd’hui encore, très limitée. Les obstacles
techniques et l’étendue du domaine marin ne permettent pas à l’Homme d’accéder facilement aux abysses. C’est l’acquisition de données satellitaires qui permet de fournir une cartographie mondiale de profondeur des océans, à résolution kilométrique (« Les satellites »,). Elle est globale, mais imprécise. Pour une cartographie plus précise, il est nécessaire de déployer en mer des navires océanographiques, équipés de sondeurs acoustiques, qui apportent des données bathymétriques directes, à résolution de quelques dizaines de mètres. Aujourd’hui, seuls 15 % de la surface des océans sont couverts par ce type de données (« GMRT Story Map »,).
L’Ifremer, l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer, a trois grands objectifs : gérer durablement les ressources marines, protéger et restaurer les mers et océans, partager les données scientifiques sur des supports numériques (L’Ifremer, 2019). S’inscrivant dans le troisième objectif, c’est le service de cartographie (CTDI) de l’unité Géosciences Marines de l’Ifremer qui est un acteur majeur de l’acquisition, du traitement et de la diffusion de données bathymétriques.
Le stage, d’une durée de trois mois, a été effectué au sein de ce service. Il a été encadré par des ingénieurs cartographes et des chercheurs de l’Ifremer. L’objectif a consisté à fournir des documents cartographiques numériques nécessaires à la Recherche, à partir de données bathymétriques de l’océan Atlantique Nord central. Le stage s’est divisé en trois grandes activités : d’abord, le traitement et la compilation de données bathymétriques brutes, puis l’analyse de structures géologiques et enfin une cartographie de type géo-morphologique détaillée d’une zone d’intérêt.
Les activités réalisées pendant le stage ont permis de renforcer des compétences techniques, mais aussi d’approfondir des connaissances scientifiques en géosciences. Plus particulièrement, c’est le segment de la dorsale de l’océan Atlantique Nord central, situé entre l’archipel des Açores et la latitude 10°N, qui a été étudié (annexe A).
Dans une première partie de ce rapport sont brièvement présentées les prestations du service
cartographique de l’Ifremer, dans une deuxième partie, l’organisation générale et les apports pédagogiques offerts par le stage. Le contexte géologique de la zone étudiée est approfondi dans la troisième partie du document, suivie de la description détaillée de deux tâches effectuées pendant le stage.
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 17
1 Prestations du service cartographie : la diffusion de données en géosciences
Le service de Cartographie, Traitement de Données et Instrumentation (CTDI) de l’unité « Géosciences Marines » de l’Ifremer apporte son expertise technique en cartographie des fonds marins, géomatique, électronique et mécanique aux unités de Recherche. Le service CDTI est premièrement chargé de la préparation des campagnes en mer et de l’acquisition des données à bord des navires. Il développe ensuite des outils informatiques de traitement et d’analyse de données en collaboration avec d’autres unités. Enfin, il assure la diffusion des données auprès des chercheurs en géosciences de l’Ifremer, et contribue à de nombreux projets nationaux, européens et internationaux de cartographie des fonds marins du globe.
Trois aspects de la diffusion des données effectués par le service CTDI sont ici présentés.
1.1 L’archivage des données de l’Ifremer
Suite à l’acquisition et au traitement des données, le service CTDI de l’unité « Géosciences
Marines » alimente le portail de données marines géré par le SISMER (Systèmes d’Information Scientifiques pour la Mer), au sein de l’Ifremer. Le SISMER, créé en 1990, est en charge de cataloguer, d’archiver, de contrôler, de valider et de référencer toutes les données scientifiques de l’Ifremer (données satellitaires, géologiques, sismiques, bathymétriques, physiques, chimiques, halieutiques et biologiques) (« SISMER - Portail des données marines »,). Il effectue les contrôles qualité des données selon les normes des instances nationales et internationales, met à jour les inventaires et les catalogues de campagnes en mer. Il diffuse les données aussi bien auprès des chercheurs de l’Ifremer que des autres instituts de recherche français et internationaux. En externe, le SISMER effectue des partages de données avec le service géologique national français (BRGM), soutient les politiques publiques et environnementales, représente l’Ifremer auprès des instances pour la gestion des données océanographiques. Il participe, entre autres, à la Commission Océanographique Intergouvernementale de l’Unesco ainsi qu’au Conseil International pour l’Exploitation de la Mer.
Tout particulièrement, le service CTDI produit des données bathymétriques contrôlées qui approvisionnent les bases de données du SISMER.
1.2 La contribution aux projets de compilation de données bathymétriques
L’Ifremer dispose de données bathymétriques de sondeurs multifaisceaux traitées par le service
CTDI. Il contribue à la réalisation de projets de compilation de données bathymétriques internationaux, comme Seabed 2030, et européens, comme EMODnet Bathymetry.
Actuellement, moins de 20% des mers et océans du globe sont couverts par des données
bathymétriques (« GMRT Story Map »,). Pourtant, le projet Seabed 2030 vise à produire une carte mondiale haute résolution de la totalité des fonds marins avant 2030. Il a été initié en 2017 par les organisations à but non lucratif Nippon Foundation et GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans). La Nippon Foundation finance 18,5 millions de dollars les dix premières années du projet. Sur le long terme, cette cartographie planétaire permettra d’améliorer les connaissances des grands fonds, de renforcer la gestion durable des ressources sous-marines, de prévenir les risques naturels et de mieux répartir les richesses entre les pays (Taira et al., 2016).
La cartographie complète de la planète durerait plus de mille ans si un seul navire océanographique devait l’effectuer. Pour mener à bien le projet en moins de quinze ans, les fondateurs ont créé quatre centres de coordination et d’assemblage de données régionales (RDACC). Chacun d’entre eux supervise l’avancée du projet pour une zone géographique qui lui est attribuée (annexe B) (« The Nippon Foundation, GEBCO Seabed 2030 Mission Statement », 2017).
Les Instituts de recherche des pays, dont l’Ifremer, soumettent indépendamment leurs données bathymétriques à ces différents centres de coordination.
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 18
EMODnet (European Marine Observation and Data network) est un réseau d’organisations scientifiques supporté par les politiques maritimes de l’Union Européenne. Il rassemble des agents d’observation de la mer qui diffusent des données en libre accès, auprès des scientifiques, industries publiques et privées, politiciens ou tout autre utilisateur. L’activité de EMODnet concerne sept thèmes différents : la bathymétrie, la géologie, les habitats marins, la chimie, la biologie, la physique et l’impact des activités humaines en mer. L’organisation a une importance dans les décisions politiques maritimes et industrielles. Elle exerce une influence sur la législation de la gestion européenne de l’environnement, de la pêche, des transports, et de la défense (« What is EMODnet », 2013). Les données bathymétriques que fournit l’Ifremer à EMODnet sont enregistrées dans le portail européen d’information (annexe B).
L’Ifremer est un partenaire majeur des initiatives EMODnet et contribue pleinement au projet EMODnet Bathymetry dont l’objectif est un inventaire de données bathymétriques dans les mers européennes. Il joue également un rôle d’expert en gestion et traitement de données.
1.3 La cartographie au service de l’exploration des fonds marins
Le service de cartographie de l’Ifremer travaille étroitement avec les équipes scientifiques en
géosciences marines. Un exemple est le soutien apporté aux chercheurs dans les projets d’exploration des ressources minérales sous-marines, notamment des nodules polymétalliques et des sulfures.
L’Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM) de l’ONU régit la répartition des zones
d’exploration marines entre les pays du monde. Elle contrôle aussi la juridiction et l’organisation des projets miniers en dehors des zones économiques exclusives. Pour qu’un pays ait des droits de prospection et d’exploration sur les eaux internationales, il doit obtenir un permis d’exploration valable quinze ans, délivré par l’AIFM (« Home | International Seabed Authority »,).
Au nom de l’Etat français, l’Ifremer a, en 2001, obtenu une première autorisation d’exploration des nodules dans l’océan Pacifique Nord, sur une aire de 75 000 km². Les conditions économiques et environnementales n’ont pas permis d’entamer une exploitation minière de la zone de permis français. Cependant, l’Ifremer reconduit actuellement le projet d’exploration des nodules pour une nouvelle durée de cinq ans, depuis 2016.
Un deuxième permis d’exploration des sulfures a été accordé par l’AIFM à l’Ifremer en 2014. Les secteurs du permis se situent sur la dorsale Atlantique Nord (annexe A). A l’issu des quinze années de prospection sur ces zones, l’Ifremer pourra alors évaluer le potentiel minier et économique de ce minerai, et proposer un éventuel projet d’exploitation à la France.
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 19
2 Organisation générale du stage et compétences acquises
2.1 La répartition du temps en quatre tâches
D’une durée de trois mois, le stage a permis de réaliser quatre grandes tâches techniques liées
les unes aux autres et requises par l’équipe de l’Ifremer (Figure 1). Chacune d’entre elles a été répartie en plusieurs sessions :
• L’appréhension des consignes et des conseils techniques donnés par les membres de l’équipe l’Ifremer ont permis de comprendre quels étaient les objectifs attendus.
• Une phase d’exploration en autonomie de l’outil technique a été nécessaire afin de s’approprier les fonctionnalités des logiciels GLobe (logiciel Ifremer de traitement de données), Excel, ArcGisPro, Word et de choisir la façon dont les fichiers générés seraient organisés.
• L’exécution de la tâche a été supervisée par les tuteurs de stage. Des points réguliers, tous les deux à quatre jours si nécessaire, ont été utiles pour éclaircir les éventuelles incompréhensions et prévoir la suite du travail à effectuer.
• En parallèle de l’exécution de la tâche, des recherches bibliographiques ont apporté des connaissances théoriques complémentaires sur le sujet de travail : les sites internet, articles scientifiques et documents de l’Ifremer ont été consultés.
Figure 1 : Diagramme de Gantt, répartition du temps et des tâches effectuées pendant le stage. Les nombres en
blanc indique la durée, en jours ouvrés, de la tâche. Certaines activités ont été effectuées conjointement, afin de gagner en rigueur, praticité et efficacité. Source personnelle
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 20
2.2 Les compétences acquises
Le stage a permis d’approfondir et d’acquérir les compétences présentées dans le tableau suivant (Tableau 1).
Tableau 1 : Compétences acquises pendant le stage. Source personnelle
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 21
3 Géologie de la dorsale Atlantique, potentielle réserve minérale
3.1 L’océan Atlantique encore peu connu L’océan Atlantique couvre une superficie actuelle de 106 000 000 km² (Larousse,). Sa formation
a d’abord débuté par l’ouverture de l’océan Atlantique Nord, au début du Jurassique, il y a 180 Ma, suivie de celle de l’océan Atlantique Sud, 50 Ma plus tard (annexe C) (« Global Tectonics »,). Si, au XXème siècle, la recherche s’est concentrée sur la compréhension des mouvements tectoniques globaux et de la formation des océans à petite échelle, aujourd’hui, elle cherche à explorer les ressources minérales marines dans des périmètres plus restreints. L’Ifremer possède un permis d’exploration sur plusieurs secteurs de la dorsale Atlantique, appelés « grappes » (voir 1.3) (annexe A).
3.2 L’exploration des sulfures sur le site hydrothermal du permis français
Située dans l’océan Atlantique Nord central, la grappe 4 du permis d’exploration des sulfures obtenue en 2014 par l’Ifremer est délimitée par les latitudes 22°40’N au Sud et 23°40’ au Nord, et par les longitudes 45°25’O à l’Ouest et 44°20’O à l’Est. Elle est exactement localisée sur un site hydrothermal de l’axe de la dorsale Atlantique (annexe A). Bien que difficilement accessibles aux Hommes, les systèmes hydrothermaux sont de potentiels gisements de métaux (Figure 2). Ils pourraient fournir, en grande quantité, du cuivre, du zinc, du plomb, du fer, de l’argent et de l’or (« Minerals: Polymetallic Sulphides | International Seabed Authority »,).
Sur les sites hydrothermaux des dorsales, l’eau de mer et les composés chimiques métalliques
contenus dans les roches basaltiques subissent des échanges de matière. L’eau de mer, salée et froide, s’infiltre dans les failles et les fissures de la roche (« Sulfures »,).
Elle se réchauffe à l’approche de la chambre magmatique constituée de lave en fusion. Ses propriétés physico-chimiques sont alors modifiées par les variations de pression et de température. De nombreuses réactions chimiques ont lieu, comme l’acidification de l’eau. La solubilité et le transport des composés métalliques par l’eau salée augmentent considérablement : un nouveau fluide est formé, le fluide hydrothermal. Ce fluide hydrothermal entre ensuite en contact avec les roches plus profondes et s’enrichit davantage en métaux. Par des mouvements convectifs, il remonte à la surface, sur l’axe d’accrétion de la dorsale. Au contact de l’eau froide environnante (environ 2°C), les métaux qu’il contient précipitent, puis s’accumulent en amas, ou bien se dispersent dans le panache hydrothermal.
Un amas stable de sulfures sur le fond marin forme des petits monts et des fumeurs (Figure 2) pouvant totaliser plusieurs millions de tonnes de métaux. Les accumulations sulfurées se forment aussi dans les cratères des volcans sous-marins (« Sulfures »,).
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 22
Figure 2 : Les sites hydrothermaux. a) Localisation des sites hydrothermaux dans le monde. Près de 150 sites
hydrothermaux ont déjà été identifiés. (« Sulfures »,). b) Fumeur hydrothermal, accumulation de sulfures dans le Pacifique (« Sulfures »,)
3.3 Cartographie structurale du site hydrothermal La prospection des sites hydrothermaux a un véritable intérêt pour envisager
l’exploitation des sulfures polymétalliques. La prospection consiste à établir, dans un premier temps, une cartographie structurale détaillée des grappes de la zone de permis. Une carte géologique structurale de la grappe 4 du permis d’exploration des sulfures a été faite pendant le stage1, à partir des données bathymétriques traitées et compilées de la zone Seadma (voir 4.1) (
Figure 3). Elle a été effectuée sur ArcGis, en utilisant les outils d’ombrage, de mesurage de pente et les données de réflectivité de la zone.
Les critères morphologiques de la cartographie de la grappe ont été établis à partir de ceux proposés dans l’article scientifique concernant la cartographie structurale de la zone hydrothermale Menez-Gwen (Klischies et al., 2019) (annexe C). La résolution du MNT (modèle numérique de terrain) à 30 m ayant servi à la cartographie de la grappe est trop faible pour permettre d’identifier des fumeurs, d’une dizaine de centimètres de diamètre.
Cependant, le MNT apporte des informations sur la localisation des structures remarquables à plus petite échelle, comme les cratères de volcans, recelant potentiellement des fumeurs de sulfures.
1 Les données bathymétriques ne permettent pas d’identifier le type de roches, ni leur composition.
Seules les structures et la topographie de la zone y sont visibles. Les prélèvements de roches dans les océans sont difficiles à mettre en œuvre. Aucune carte géologique à grande échelle sur la grappe 4 du permis d’exploration français n’a à ce jour été publiée.
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 23
Figure 3 : Carte géologique structurale de la grappe 4 (contour noir) du permis français d'exploration des sulfures. En s’éloignant de l’axe de la dorsale, la croûte océanique est de plus en plus ancienne. Le segment AB représente le trait de
coupe (Figure 4). Le MNT de fond a une résolution d’environ 100 m, alors que la grappe 4 a été cartographiée à une résolution de 30 m. Source personnelle
A B
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 24
Figure 4 : Coupe géologique simplifiée orientée O-E de la dorsale Atlantique Nord centrale, dans la grappe 4 du
permis d'exploration français des sulfures. La topographie a été obtenue sur ArcGis. Le trait de coupe est visible sur la carte géologique structurale (Figure 3). Source personnelle
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 25
4 Tâches effectuées : les travaux d’appui à la recherche
4.1 Première tâche : traitement et compilation de données bathymétriques
Le premier mois du stage a été consacré au traitement de données bathymétriques brutes. Les
jeux de données concernent les relevés bathymétriques de huit campagnes océanographiques effectuées par l’Ifremer entre 1991 et 2018 (annexe D), dans trois zones contigües situées sur la dorsale Atlantique. L’objectif final était de fournir pour chacune des zones un modèle numérique de terrain bathymétrique propre et exploitable.
4.1.1 Le sondeur multifaisceaux, outil d’acquisition de données bathymétriques
Pendant les campagnes océanographiques en mer, les données bathymétriques sont
enregistrées à l’aide d’un sondeur acoustique multifaisceaux (SMF). L’antenne du sondeur est fixée et placée sous la coque du navire. Le sondeur émet puis
réceptionne les ondes acoustiques réfléchies sur le fond marin, par cycles d’acquisition successifs. Connaissant la vitesse du son dans l’eau ainsi que le temps parcouru par l’onde entre son émission et sa réception, il est possible de calculer la distance aller-retour parcourue par le son, et donc d’évaluer la profondeur des fonds marins. Les ondes sonores sont propagées selon n directions (appelées « faisceaux »), qui constituent une fauchée (ou « swath ») à large ouverture angulaire, perpendiculaire à l’axe du navire (Figure 5). Plus leur fréquence est élevée, meilleure est la résolution de l’acquisition, mais plus la profondeur atteinte par l’onde est faible. La cartographie des fonds des grandes profondeurs est donc exécutée avec de faibles fréquences (Tableau 2).
Figure 5 : Schéma de fonctionnement du sondeur multifaisceaux(« Sondeurs multifaisceaux pour les
fonds marins »,)
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 26
Tableau 2 : Propriétés des sondeurs multifaisceaux utilisés sur les navires Ifremer (en jaune, les sondeurs utilisés pour les relevés bathymétriques traités dans le cadre de ce stage). D’après (« Sondeurs multifaisceaux pour les fonds marins »)
Navire Sondeur Constructeur Fréquence Profondeur
maximale atteinte
Largeur de la fauchée
Nombre de faisceaux
Atalante
SIMRAD EM 12 DUAL
(avant 2009) Kongsberg 12 kHz 11 000 m 7*P 162
SIMRAD EM122
(après 2009) Kongsberg 12 kHz 12 000 m
5,5*P, 140° (20 km max)
288
SIMRAD EM710
(après 2009) Kongsberg
70 à 110 kHz
1 500 m 5,5*P, 140° (2 km max)
256
Pourquoi Pas ?
Seabat 7150
Reson 12 kHz 12 000 m 5*P
(16 km max) 880
Reson 24 kHz 5 000 m 5*P
(16 km max) 880
Seabat 7111 Reson 100 kHz 800 m 150°
(1 km max) 301
P : hauteur d’eau
A chaque faisceau est associée une « sonde », qui apporte une mesure de profondeur ou de
réflectivité (amplitude du signal rétrodiffusé sur le fond). En opération, pour cartographier une zone de façon optimale, le bateau océanographique suit un itinéraire défini : le navire se déplace selon des profils de plusieurs dizaines de kilomètres, perpendiculaires à l’axe de la dorsale, en effectuant des aller-retours parallèles. Pour une insonification complète du fond, les bords des fauchées doivent se recouvrir.
Figure 6 : Itinéraire de l'Atalante (en rouge) pendant la campagne Seadma entre 22°N et 23°N, 45°W et 44°W.
D’après GLobe, source personnelle
4.1.2 GLobe, le logiciel de traitement de données bathymétriques de l’Ifremer Les données bathymétriques brutes sont, après les campagnes en mer, traitées à l’aide du
logiciel GLobe (GLobal Oceanographic Bathymetry Explorer). Développé en langage Java en interne par l’Ifremer, cet outil est gratuit et en libre accès (« GLOBE »). Il est conçu pour visualiser des données bathymétriques géolocalisées pouvant se superposer sur un fond de globe terrestre (Figure 7), leur appliquer une correction et un filtrage et générer des modèles numériques de terrain.
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 27
Figure 7 : Fonctionnalités du logiciel GLobe. D’après GLobe, source personnelle
Au sein de l’Ifremer, les données brutes sont archivées dans la base de données SISMER. Sur
GLobe, les formats de fichiers les plus souvent utilisés sont les suivants : nvi (correspondant à l’itinéraire du bateau selon sa position dans le temps), mbg (contenant les données bathymétriques) et dtm (format Ifremer des MNT). Les MNTs sont multicouches. Les fichiers dtm contiennent les couches raster suivantes, les plus utilisées :
- DEPTH, la profondeur : la valeur attribuée à chaque pixel est la moyenne des profondeurs relevées par les sondes présentes dans la résolution.
- STDEV, l’écart-type : il correspond à l’écart-type des valeurs de profondeur des sondes présentes dans le pixel.
- CDI : identifiant de la source des données et lien vers les métadonnées.
4.1.3 Protocole de traitement des données bathymétriques
Les données brutes sont projetées sous forme d’un MNT en latitude/longitude avec une
résolution de 1/16 min (environ 120 m). Cette résolution est cohérente avec la densité des données acquises. Les huit campagnes sont traitées indépendamment les unes des autres, selon la même démarche qui se déroule en trois étapes : d’abord la correction du biais, puis les filtrages et enfin l’interpolation et le lissage. Les campagnes sont ensuite compilées par zone (annexe E).
4.1.3.1 La correction du biais
En mer, les données de bathymétrie acquises peuvent être biaisées par des facteurs extérieurs
dus aux conditions variables de la navigation, ou à un paramétrage inadapté des sondeurs. Le roulis (« roll »), le tangage (« pitch ») ainsi que la dérive du bateau (« cap ») engendrent des erreurs non négligeables au cours de l’enregistrement des données : le MNT brut peut contenir des artefacts qu’il est nécessaire de corriger. La première étape du traitement consiste à choisir un paramétrage adapté de correction des artefacts, commun à la totalité du MNT (Figure 8). Pour cela, l’outil Swath Editor du logiciel GLobe est utilisé.
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 28
Figure 8 : Comparaison des MNT avant (a) et après (b) l’application de la correction de biais de tangage. a) Les
profils d’aller et de retour du bateau ne se superposent pas. Par conséquent, les lignes de crêtes sont discontinues sur le MNT (lignes blanches). b) Une correction de 5° sur le tangage est appliquée au MNT : les profils d’aller et retour du bateau se
superposent et les crêtes s’alignent (ligne blanche). D’après GLobe, source personnelle
La difficulté de cette étape est de choisir la meilleure correction possible à appliquer à
l’intégralité du MNT. Celle-ci doit permettre d’améliorer nettement la qualité du MNT, même si, parfois, dans certaines zones très localisées, elle peut détériorer la donnée. Pour certaines campagnes, des asymétries de correction ont été remarquées entre les côtés bâbord et tribord du bateau : une correction appliquée sur le MNT peut améliorer significativement la qualité des données sur les sondes tribord, mais détériorer grandement les données des sondes bâbord, et vice versa. Pour pallier cette difficulté, l’outil Coratt est conçu pour sélectionner les faisceaux sur lesquels la correction de biais est affectée.
4.1.3.2 Le filtrage, élimination des sondes incohérentes
La seconde étape est le filtrage des sondes (annexe E). Pendant le cycle d’acquisition des
données, certaines sondes apportent une donnée de profondeur incohérente. Les incohérences s’expliquent par plusieurs raisons : les sondes situées sur les bords de la fauchée sont moins fiables que les autres, les dégagements de fluides le long de la dorsale (gaz, émissions volcaniques…) sont interprétés par les sondes comme étant le fond marin, ou bien encore une vitesse de navigation inadaptée peut également affecter la qualité des valeurs bathymétriques relevées. Cependant, les sondes relevant des dégagements de fluides apportent une information importante sur la potentielle localisation des sites hydrothermaux (voir 3.2).
Un premier filtrage par triangulation est appliqué sur l’ensemble du fichier mbg. Il invalide
automatiquement les sondes qui portent des valeurs aberrantes en comparaison de leurs voisines, selon le paramétrage choisi (Figure 9).
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 29
Figure 9 : Identification des sondes incohérentes par filtrage automatique par triangulation, vues dans le Swath
Editor de GLobe. Les sondes cohérentes relevant le fond marin sont représentées en vert, et les sondes aberrantes en rouge. a) Profil des sondes relevant des émissions de fluides (en rouge) sur un cratère dans la zone Seadma. b) Profil des sondes
pendant un transit trop rapide du bateau. Les sondes relèvent des trous d’artefacts sur le fond marin. D’après GLobe, source personnelle
Si le filtrage par triangulation n’est pas satisfaisant, alors il est possible d’invalider
manuellement les amas de sondes, grâce à l’outil Swath Editor (Figure 10).
Figure 10 : Filtrage manuel des sondes incohérentes. a) Le filtrage automatique par triangulation a laissé des
artefacts sur le MNT. b) La couche STDEV permet de visualiser les zones d’artefacts, elle affiche les forts écarts-types (en rouge). c) Les sondes incohérentes sont invalidées à la main (en rouge) dans le Swath Editor. Les sondes représentant le fond
marin sont conservées (en vert). d) Le MNT manuellement filtré ne présente plus d’artefacts. D’après GLobe, source personnelle
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 30
4.1.3.3 Interpolation et lissage du modèle numérique de terrain Le MNT obtenu après correction et filtrage peut être ensuite complété par ses métadonnées
(traçabilité de la donnée brute) grâce à l’ajout d’une couche dite « CDI », qui donne un identifiant de la source de données. Il est interpolé afin de combler certains manques de données, puis lissé par moyennage des pixels avec leurs voisins pour corriger des artéfacts résiduels (annexe E).
4.1.4 La compilation des campagnes
La fusion des MNT de chaque campagne est exécutée grâce aux outils « merge » du logiciel
GLobe. Lorsque les MNT se superposent, l’outil « merge simple » attribue, à chaque pixel du MNT final, la moyenne des profondeurs des sondes des MNT des campagnes. L’outil « merge fill missing values » permet d’établir un ordre de priorité pour privilégier la fiabilité des données d’une campagne par rapport à une autre dans le MNT de compilation. Finalement, c’est une compilation avec un ordre de priorité sur les campagnes les plus récentes par rapport aux plus anciennes qui a été choisie (annexe E). Les sondeurs utilisés le plus récemment sont plus performants, leurs données sont plus propres. Pour compléter les données de l’Ifremer, un MNT GMRT2 a été rajouté en arrière-plan des campagnes traitées. Le MNT final obtenu est présenté dans l’annexe E.
Figure 11 : Compilation des campagnes pour la zone Seadma. a) Ordre de superposition des MNT de la campagne
la plus récente à la plus ancienne. b) Les couches CDI (en couleurs) permettent de voir à quelle campagne appartient le jeu de données bathymétriques (métadonnées). c) MNT final de compilation des campagnes traitées dans la zone Seadma, vu sur
GLobe. D’après GLobe et base de données Ifremer/SISMER, source personnelle
2 MNT GMRT (Global Multi-Resolution Topography) : MNT provenant de la synthèse des données
bathymétriques mondiales initiée en 1992 par les scientifiques et les organisations scientifiques internationales.
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 31
4.2 Deuxième tâche : analyse des structures abyssales
Une tâche d’analyse a été effectuée, à partir des données bathymétriques préalablement
traitées sur GLobe. Elle consistait à produire des documents de présentation des données, en soutien d’un chercheur ayant deux objectifs d’investigation : d’une part, comprendre la direction des mouvements extensifs récents associés à la dorsale Atlantique, d’autre part, identifier plus précisément la limite entre les plaques Amérique du Nord et Amérique du Sud.
4.2.1 Le relief des fonds marins, un indicateur des mouvements tectoniques
Le relief d’une zone est le résultat de nombreuses déformations subies par un substrat. Sur une
dorsale océanique, il est le témoin des mouvements tectoniques. En s’intéressant aux structures topographiques de la dorsale médio-Atlantique et en mesurant leur axe, il est possible d’émettre des hypothèses pour comprendre la fabrique actuelle et future des fonds océaniques.
Le long de l’axe d’une dorsale médio-océanique, les plaques tectoniques se séparent et la
croûte océanique est produite par l’ascension du magma. De part et d’autre de l’axe de la dorsale, la croûte subit des contraintes. Deux types de failles se forment alors. Les failles normales, dues aux mouvements divergents, ont une direction grossièrement perpendiculaire à la direction de la force extensive, donc parallèle à la ride médio-océanique (Figure 12). Les failles transformantes, engendrées par les cisaillements, sont parallèles à la direction du mouvement divergent entre deux plaques et ont théoriquement une direction perpendiculaire à celle de l’axe de la dorsale et des failles normales.
Or, en réalité, les observations sur le terrain diffèrent. Les failles transformantes ne sont pas exactement parallèles à la direction du mouvement extensif. Le premier objectif de ce projet est donc d’utiliser les directions des failles normales pour estimer les directions des mouvements extensifs récents le long de la dorsale Atlantique Nord-centrale sur différentes latitudes, et de les comparer avec la direction des failles transformantes.
Figure 12 : Coupe schématique d'une ride médio-océanique (Olive et al., 2015)
Actuellement, la dorsale Atlantique Nord centrale sépare la plaque Nubia (africaine) des
plaques Amérique du Nord entre 15°N et 36°N et Amérique du Sud entre 15°N et 55°S (Figure 13). Si l’axe de la ride médio-océanique Atlantique est bien défini, celui de la limite des plaques séparant les deux plaques américaines n’a jamais pu être précisément localisé. L’activité sismique y est très faible
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 32
(DeMets et al., 2010) (annexe F), les données bathymétriques sont peu nombreuses, et les anomalies magnétiques associées aux roches équatoriales, trop infimes, ne peuvent pas être interprétées avec précision (DeMets et Merkouriev, 2019) (Figure 13).
Les directions d’extension de la croûte océanique entre Nubia et Amérique du Nord, et Nubia et Amérique du Sud diffèrent. La zone de variation de ces directions peut marquer le point triple entre les trois plaques. Celui-ci se situe, selon toutes les hypothèses scientifiques, entre 20°N et 10°N. Les études les plus récentes citées par DeMets et Merkouriev (2019) placent ce point triple près de la zone de fracture « Fifteen Twenty » à 15°28’ (annexe F). Selon les études précédentes, le point triple peut se trouver à 20°N, aux alentours de 13°N ou encore à 13°45’. Roest et Collette (1986) proposent la latitude de 16°N pour la position actuelle du point triple. Il est probable que la limite des plaques soit diffuse. Le deuxième objectif du projet est de comparer les directions des mouvements extensifs entre Nubia et les deux plaques américaines pour apporter plus d’information sur la position de ce point triple.
Figure 13 : Modèle de configuration actuelle des plaques tectoniques. NA : Amérique du Nord ; SA : Amérique du
Sud ; NB : Nubia. La limite de plaque entre NA et SA est peu connue (zone en pointillés). Les isochrones sont représentés par des points de couleurs différentes. A noter qu’il est impossible d’identifier fiablement les isochrones magnétiques dans la
zone équatoriale. D’après (DeMets et Merkouriev, 2019)
4.2.2 Démarche d’analyse des structures abyssales
4.2.2.1 Choix des structures de référence à analyser
Le basculement des blocs lors de la formation des failles normales forment des reliefs linéaires,
appelés collines abyssales (Figure 12, « abyssal hills »). Leurs flancs indiquent de façon relativement fiable l’axe des failles normales. Ce sont donc les flancs des collines abyssales qui servent de témoins pour cette étude et qui sont extraits des jeux de données bathymétriques.
4.2.2.2 Identification des structures sur ArcGis
Les données bathymétriques des campagnes précédemment traitées sur GLobe sont exportées
vers ArcMap. Afin d’identifier la direction des flancs des collines abyssales, plusieurs outils de Spatial Analyst > Surface sont testés. L’outil « exposition » est retenu. Il indique, pour chaque pixel du MNT, l’exposition de la pente du fond marin. Lorsque deux expositions, différentes de 180 ° (± 45°), sont juxtaposées, elles indiquent une crête.
Pour extraire l’axe des flancs des collines sur le raster, il est nécessaire de ne conserver que l’exposition des pixels qui représentent le plus significativement la direction des reliefs : seules les expositions des pentes supérieures à 15° sont retenues. Ainsi, les expositions des pentes subhorizontales, peu significatives de la direction des collines abyssales, sont éliminées (Figure 14).
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 33
Figure 14 : Représentation des reliefs sur ArcMap (campagne Seadma). a) Expositions des pentes classées par
orientation. La flèche blanche indique une ligne de crête. b) Exposition des pentes supérieures à 15°. Source personnelle
Sur ArcMap, onze secteurs sont extraits des MNT, répartis de part et d’autre de la dorsale sur
six latitudes distinctes (annexe G). Ils sont tous choisis dans des zones stables, où les structures sont linéaires, en évitant les zones de fracture et de failles transformantes. La table attributaire des expositions des pentes supérieures à 15° du secteur est ensuite exportée vers un tableur (fichier Excel) pour faire des statistiques sur le nombre de pixels associés à chaque degré d’exposition (1° à 360°).
4.2.2.3 Statistiques sur les orientations des structures
Pour chacun des secteurs, un histogramme est créé (annexe G). La courbe bleue indique le
pourcentage de pixels dans le secteur situé à l’Est de la dorsale en fonction de l’exposition des pentes supérieures à 15°, la courbe orange montre cette information pour le secteur à l’Ouest de la dorsale.
Figure 15 : Exemple des histogrammes pour les secteurs Faranaut01. La courbe bleue correspond aux expositions des pentes supérieures à 15° pour le secteur à l'Est de la dorsale médio-Atlantique, la courbe orange, pour le secteur à
l'Ouest. Les pointillées rouges indiquent le pic des expositions Est dans le secteur à l’Ouest de la dorsale, et les pointillées noirs les bornes de l’intervalle de 45° autour de ce pic. Le tableau compare les moyennes des expositions calculées selon les
intervalles de valeurs choisis. Source personnelle
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 34
Sur les histogrammes, toutes les courbes affichent deux pics, différents d’environ 180°. L’un, compris entre 1 et 180°, indique les expositions Est des pentes, l’autre, entre 181 et 360°, les expositions Ouest des pentes. Les pics des histogrammes permettent donc d’identifier qu’il existe, pour chaque latitude, deux expositions de pentes prédominantes. Ainsi, il est possible d’en déduire la direction principale des collines abyssales, qui sont orientées de ± 90° par rapport aux expositions prédominantes des flancs.
De façon systématique sur les histogrammes, le pic des expositions Est est toujours plus
important à l’Ouest (courbe orange) qu’à l’Est de la dorsale (courbe bleue). De même, le pic des expositions Ouest à l’Est de la dorsale est toujours supérieur à celui du secteur situé à l’Ouest de la dorsale. Cela suggère que la majorité des plus fortes pentes est associée aux failles normales de la dorsale.
Dans chaque secteur, les moyennes des expositions Ouest et Est sont indépendamment
calculées sous Excel. Il est remarquable que, dans certains cas, la valeur de la moyenne des expositions ne correspond pas du tout à l’abscisse du pic. Par exemple, pour le secteur FaranautO1 (Figure 15), situé à l’Ouest de la dorsale (courbe orange), la moyenne des expositions Est calculée sur les 180 premiers degrés est de 114°. Or, cette valeur est très différente de celle de l’exposition du pic à 102°. La distribution des valeurs n’étant pas toujours symétrique, les valeurs de part et d’autre du pic influent beaucoup sur la moyenne. La moyenne n’est donc pas représentative de l’exposition du pic.
Le pic est considéré comme étant ce qui représente de façon la plus cohérente les expositions prédominantes des flancs des collines abyssales. Il est nécessaire d’obtenir une moyenne des expositions des flancs qui concorde avec le pic. Pour cela, une nouvelle moyenne des expositions est calculée sur 45° seulement, incluant les 22° de part et d’autre de l’exposition du pic. Cette moyenne est désormais très proche de la valeur d’exposition du pic (Figure 15).
Les moyennes des expositions des flancs des collines abyssales sont comparées sur les
différentes latitudes (annexe G). La moyenne calculée sur les 45° autour du pic des expositions peut varier de plusieurs degrés par rapport à la moyenne des expositions sur les 180°, mais elle paraît plus fiable dans le cadre de l’étude car elle ne prend en compte que les expositions prédominantes des flancs des collines. C’est cette moyenne qui est utilisée dans le reste de l’étude.
4.2.2.4 Présentation des résultats : comparaison avec les données de MORVEL
Les résultats de l’étude sont présentés dans les deux graphiques ci-dessous (Figure 16 et Figure
17). Les données associées à l’exposition des failles normales sont considérées plus fiables, et sont représentées par les gros points. Les données des pentes opposées aux failles normales sont représentées par les petits points.
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 35
Le premier graphique cherche à répondre au premier objectif : comparer les directions des mouvements extensifs à celles des failles transformantes utilisées dans le modèle de MORVEL3 (Figure 16).
Figure 16 : Graphique représentant les moyennes des expositions des flancs des collines abyssales sur les 45°
autour du pic, à l’Ouest (orange) et à l’Est (bleu) de la dorsale en fonction de la latitude des secteurs. Afin de comparer les directions des exposition Ouest et Est sur le même graphique, 180 degrés ont été soustraits des valeurs d’exposition Ouest.
Les gros points indiquent les expositions moyennes des failles normales, et les petits points, des flancs opposés. Les directions des failles transformantes utilisées dans le modèle de MORVEL sont indiquées par les points verts. Source personnelle
Il est visible que :
- Entre les latitudes 22°N et 35°N : les moyennes d’exposition des failles normales (gros points)
sont similaires entre l’Ouest (points oranges) et l’Est (points bleus) de la dorsale. Elles sont aussi
invariantes (environ 100°) avec la latitude.
- Les directions des failles transformantes varient avec la latitude. Leurs valeurs ont tendance à
augmenter du Sud au Nord (à 22°N, la direction de la faille transformante est de 99°, et à 35°30’,
elle est de 104°).
Les expositions des flancs des collines abyssales, différentes d’environ 90° de l’axe des failles
normales, indiquent aussi les directions des mouvements extensifs de part et d’autre de la dorsale. Les observations faites sur le graphique suggèrent donc que la direction des failles
transformantes peut être différente de quelques degrés de celle des mouvements extensifs de la dorsale. Autour de 22°N et 23°N, les directions des failles transformantes et des mouvements d’extension semblent toutefois être très proches (environ 100°). Mais le nombre de données du graphique est insuffisant pour comprendre comment la direction des failles cisaillantes est reliée avec celle des directions extensives.
3 MORVEL : (Mid Oceanic Ridge Velocities). Modèle de tectonique des plaques proposé en 2010
notamment par Demets, selon lequel le globe terrestre est constitué de 25 plaques tectoniques, 14 grandes plaques et 9 micro-plaques (DeMets et al., 2010), (« Nubia-N. America transform fault information »,)
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 36
La Figure 17 présente plusieurs éléments pour aborder le deuxième objectif de l’étude concernant la délimitation des plaques en Atlantique :
Figure 17 : Graphique représentant les expositions moyennes des flancs des collines abyssales sur les 45° autour du
pic à l’Ouest (orange) et à l’Est (bleu) de la dorsale en fonction de la latitude des secteurs. Afin de comparer les directions des expositions Ouest et Est sur le même graphique, 180 degrés ont été soustraits des valeurs d’exposition Ouest. Les gros points
indiquent les expositions moyennes des failles normales, et les petits points, des flancs opposés. La zone en gris indique la potentielle zone de transition entre les plaques américaines. Source personnelle
- Au Nord de 22°N : les moyennes d’exposition des failles normales sont similaires entre les
flancs Ouest (gros points oranges) et Est (gros points bleus) de la dorsale. Elles sont aussi
invariantes (environ 100°) avec la latitude.
- Entre 14°N et 18°N : d’une part, les moyennes d’exposition des failles normales entre l’Ouest
et l’Est de la dorsale peuvent varier de plusieurs degrés (par exemple, à 18°N, l’exposition
moyenne des failles normales est de 103° à l’Ouest de la dorsale, et de 95° à l’Est). D’autre part,
sur un même côté de la dorsale, les valeurs des expositions moyennes des failles normales
croissent avec la latitude. Par exemple, l’exposition moyenne à 14°N est E-O (90° à l’Ouest et
92° à l’Est de la dorsale). Elle tend à être davantage SSE-NNO plus au Nord (103° à l’Ouest de la
dorsale et 95° à l’Est à 18°N). Cette tendance est plus marquée à l’Ouest qu’à l’Est de la dorsale.
Sachant que l’exposition moyenne des failles normales est un indicateur de la direction des
mouvements extensifs, les observations confirment qu’au Nord de 22°N, les directions de mouvements sont uniformes sur toutes les latitudes de part de d’autre de la dorsale. Cela soutient l’hypothèse qu’il n’existe pas de point triple au Nord de 22°N.
En revanche, entre 14°N et 18°N, les données montrent que les directions d’extension ne sont pas du tout uniformes. Cela peut suggérer une zone de transition entre deux plaques ou bien une zone de forte déformation.
Les résultats de l’étude convergent avec les hypothèses de DeMets et Merkouriev (2019) et de
celles des investigations antérieures : au Sud de 20°N peut se situer le point triple. Cependant, il est impossible de déterminer la localisation précise du point triple avec les seules
données du graphique. L’étendue des données et la quantité de données disponibles par degré de latitude sont insuffisants pour observer précisément la variation de direction d’extension entre 20°N et 10°N.
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 37
4.2.3 Conclusion de l’analyse
L’étude des directions d’exposition des failles normales a été menée à cause du constat que les directions des failles transformantes n’étaient pas systématiquement parallèles à celles d’extension. En fait, les directions de mouvements des plaques dans l’océan Atlantique Nord central prédites par le modèle planétaire MORVEL ne coïncident pas avec les directions observées (Figure 18, prédiction MORVEL en vert). Chuck DeMets, auteur principal du modèle MORVEL, a été directement consulté pendant le stage afin de tester à nouveau le modèle, cette fois en utilisant les expositions des failles normales au lieu des failles transformantes (Figure 18, prédiction en rouge). Le modèle utilisant les failles normales est capable de mieux prédire les observations, comme le montre la Figure 18.
En revanche le nombre réduit d’observations au sud de 18°N ne permet pas d’en dire plus sur la position de la limite des plaques entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. Il serait nécessaire d’obtenir des données plus étendues vers le Sud.
Figure 18 : Graphique représentant les expositions des failles normales (points rouges) et les directions des failles
transformantes (points verts) du modèle de MORVEL en fonction de la latitude. Les points rouges sont obtenus en calculant la moyenne des expositions moyennes des failles normales à l’Ouest et à l’Est de la dorsale (gros points oranges et bleus sur les Figure 16 et Figure 17). Les marges d’erreur d’un degré sont représentées par des segments verticaux et les courbes de
tendance en lignes pointillées. Source personnelle
L’étude effectuée est un travail préliminaire scientifique qui mérite d’être plus approfondi, au
vu des résultats présentés. Afin de poursuivre les travaux, il faudrait avoir des données de sondeur multifaisceaux plus étendues vers le Sud pour observer plus amplement les tendances des directions. Il serait également préférable de pouvoir ajouter des secteurs d’étude, et de les élargir transversalement à l’axe de la dorsale.
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 39
Conclusion Le stage au sein du service de cartographie de l’Ifremer a permis d’appréhender le domaine de
la recherche en géosciences marines et les nombreuses applications. Des compétences techniques et
organisationnelles ont été développées pendant l’exécution du traitement de données
bathymétriques qui se déroule en trois étapes sur le logiciel Globe. A partir des modèles numériques
de terrain obtenus, deux études préliminaires de recherche concernant la dorsale Atlantique Nord ont
pu être effectuées. Ces travaux ont permis de mettre en œuvre une démarche rigoureuse
d’investigation scientifique et d’approfondir des connaissances théoriques et de terrain, sur la
tectonique des plaques et l’identification des structures de la zone d’exploration de sulfures.
Les modèles numériques de terrain de la dorsale Atlantique Nord générés pendant le stage
seront inclus dans la base de données SISMER de l’Ifremer, en libre accès aux chercheurs. Ils
complèteront également les projets de compilation de données bathymétriques internationaux.
L’étude de directions des mouvements tectoniques a quant à elle questionné la précision à grande
échelle du modèle tectonique planétaire MORVEL. La cartographie de la grappe 4 de permis
d’exploration des sulfures a amorcé l’identification des structures recelant potentiellement des
ressources minérales hydrothermales. Elle contribuera à l’évaluation du potentiel minier de la zone
avant l’échéance de permis d’exploration de la zone en 2029.
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 41
Liste des références
DEMETS, C., GORDON, R.G., ET ARGUS, D.F. 2010. Geologically current plate motions. Geophysical Journal
International, volume 181, n°1. p. 1-80. Date de consultation : 01/09/2020. Disponible sur : <https://academic.oup.com/gji/article-lookup/doi/10.1111/j.1365-246X.2009.04491.x>
DEMETS, C., ET MERKOURIEV, S. 2019. High-resolution reconstructions of South America plate motion relative to Africa, Antarctica and North America: 34 Ma to present. Geophysical Journal
International, volume 217, n° 3. p. 1821-1853. Date de consultation : 01/09/2020. Disponible sur : <https://academic.oup.com/gji/article/217/3/1821/5322167>
Global Tectonics. [en ligne]. Date de consultation : 24/09/2020. Disponible sur : <http://www.serg.unicam.it/Geo.html>
GLOBE. In Flotte océanographique française opérée par l’Ifremer [en ligne]. Date de consultation : 11/09/2020. Disponible sur : <https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Logiciels-de-la-flotte/Analyse-et-traitement-de-l-information/GLOBE>
GMRT Story Map. [en ligne]. Date de consultation : 21/09/2020. Disponible sur : <https://www.gmrt.org/about/storymap.php>
Home | International Seabed Authority. In International Seabed Authority : Home [en ligne]. Date de consultation : 22/09/2020. Disponible sur : <https://www.isa.org.jm/>
KLISCHIES, M., PETERSEN, S., ET DEVEY, C.W. 2019. Geological mapping of the Menez Gwen segment at 37°50′N on the Mid-Atlantic Ridge: Implications for accretion mechanisms and associated hydrothermal activity at slow-spreading mid-ocean ridges. Marine Geology, volume 412, p. 107-122. Date de consultation : 25/09/2020. Disponible sur : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0025322719300350>
LAROUSSE, É. Encyclopédie Larousse en ligne - océan Atlantique [en ligne]. Date de consultation : 24/09/2020. Disponible sur : <https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/océan_Atlantique/106561>
Les satellites. In À la découverte des grands fonds [en ligne]. Date de consultation : 21/09/2020. Disponible sur : <https://wwz.ifremer.fr/grands_fonds/Les-moyens/Les-equipements/Les-satellites>
Minerals: Polymetallic Sulphides | International Seabed Authority. [en ligne]. Date de consultation : 25/09/2020. Disponible sur : <https://www.isa.org.jm/exploration-contracts/polymetallic-sulphides>
Nubia-N. America transform fault information. [en ligne]. Date de consultation : 24/09/2020. Disponible sur : <http://geoscience.wisc.edu/~chuck/MORVEL/n_atl_tfs.html>
ROEST, W.R., ET COLLETTE, B.J. 1986. The Fifteen Twenty Fracture Zone and the North American–South
American plate boundary. Journal of the Geological Society, volume 143, n° 5. p. 833-843. Date de consultation : 11/09/2020. Disponible sur : <http://jgs.lyellcollection.org/lookup/doi/10.1144/gsjgs.143.5.0833>
SISMER - Portail des données marines. [en ligne]. Date de consultation : 21/09/2020. Disponible sur : <https://data.ifremer.fr/SISMER>
Sondeurs multifaisceaux pour les fonds marins. In Flotte océanographique française opérée par l’Ifremer [en ligne]. Date de consultation : 11/09/2020. Disponible sur :
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 42
<https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Outils-des-navires/Equipements-des-navires/Equipements-acoustiques/Sondeurs-multifaisceaux-pour-les-fonds-marins>
Sulfures. In Géosciences Marines [en ligne]. Date de consultation : 25/09/2020. Disponible sur : <https://wwz.ifremer.fr/gm/Comprendre/Soutien-a-la-puissance-publique/Ressources-minerales-grand-fond/Sulfures>
TAIRA, A., MAYER, L., WRIGHT, D., JAKOBSSON, M., MCLEAN, C., ET JAKOBSSON, I. Panel moderators at the Future for Future Ocean Floor Mapping, Monaco, June 15–17, 2016, provided the summaries in section 3.0. p. 44
The Nippon Foundation, GEBCO Seabed 2030 Mission Statement. 2017. In GEBCO - The General Bathymetric Chart of the Oceans [en ligne]. Date de consultation : 21/09/2020. Disponible sur : <https://seabed2030.gebco.net/data_centers/documents/seabed2030_brochure.pdf>
What is EMODnet. 2013. In Central Portal [en ligne]. Date de consultation : 22/09/2020. Disponible sur : <https://www.emodnet.eu/en/what-emodnet>
P. VIELLEFON 082 Cartographie - compilation et analyse numériques de données bathymétriques 45
Annexes
53
Carte des projets de compilation de données bathymétriques impliquant l’Ifremer. a) Localisation des
centres de coordination et d'assemblage de données régionales SEABED 2030, et répartition de leur zone à
cartographier. A Londres est basé le centre d’assemblage de données mondiales. D’après (« The Nippon
Foundation, GEBCO Seabed 2030 Mission Statement », 2017). b) Couverture des données bathymétriques
de l'EMODnet Bathymetry en 2018. Chaque polygone coloré représente la couverture de données
cartographiée pendant une campagne océanographique. La zone grisée n'a pas encore été cartographiée.
La zone maritime européenne s’étend entre les latitudes 15°N et 90°N et les longitudes 36°W et 43°E.
D’après (« EMODnet Bathymetry Viewing and Download service »,)
Reconstitution de l’ouverture de l’océan Atlantique de -180 Ma à aujourd’hui. D’après (« Plate Tectonic Reconstructions »,)
Morphologie et critères d’identification des structures pour la cartographie de la grappe 4 du permis français. Les images sont issues des
données bathymétriques et de l’ombrage sur ArcGis. Source personnelle
Propriétés et objectifs des campagnes en mer opérées par l'Ifremer et traitées dans Globe. D’après (« Catalogue des campagnes à la mer »)
Nom de la campagne
Année Date/lieu
début Date/lieu fin
Noms bateau et propriétaire
Objectifs
Fara-Seadma 1
1991 12/07/1991
(Dakar)
07/08/1991 (Fort-de-France)
l’Atalante (Ifremer)
Identifier, d'une manière géophysique (magnétisme, gravimétrie et bathymétrie), les segments de la dorsale Atlantique actuels et passés entre 20 et 24N, Préparer une
campagne d'échantillonnage systématique à l'axe et hors axe.
Farasigma 1991 01/06/1991 (Fort-de-France)
07/07/1991 (Cadiz)
l’Atalante (Ifremer)
Obtenir une couverture bathymétrique quasi-complète de la zone axiale de la dorsale médio-atlantique entre 40N et 33N, Obtenir des données de magnétisme et de
gravimétrie. Prélever quatre échantillons de basalte.
Faranaut/15 N
1992 15/03/1992 (Fort-de-France)
14/04/1992 (Fort-de-France)
l’Atalante (Ifremer)
Etudier l'intersection de l'Est de l'axe de la dorsale avec la zone de fracture 15.20'N et de la section de la vallée axiale de la dorsale située à 30 km au nord de l'intersection
Ouest de la dorsale avec la zone de fracture 15.20'N.
Dormasis 1992 22/04/1992
(Las Palmas)
14/05/1992 (Fort-de-France)
l’Atalante (Ifremer)
Etudier l’existence d'interfaces sismiques dans la croûte et à la transition croûte-manteau.
Sudaçores 1998 26/07/1998
(Ponta Delgada)
25/08/1998 (Ponta
Delgada)
l’Atalante (Ifremer)
Préciser l'évolution de la morphologie de la dorsale et de son alimentation magmatique au cours des 10 derniers millions d'années.
Bicose 2014 10/01/2014
(Las Palmas)
11/02/2014 (Pointe-à-
Pitre)
Pourquoi pas ? (Ifremer)
Cartographier, explorer, décrire et rechercher des sites hydrothermaux. Effectuer des analyses physico-chimiques in situ sur fluides prélevés (fluides chauds et habitats).
Etudier l’écologie des communautés, la biologie des populations de crevettes. Etudier les symbioses, les cycles de vie de la crevette et l’adaptation au stress de la crevette.
Etudier la microbiologie des piézophiles.
Leve-SMF 2016 29/01/2016 (A
Coruña)
17/02/2016 (Pointe-à-
Pitre)
l’Atalante (Ifremer)
Effectuer des levés SMF et des tests de détection de panaches hydrothermaux sur les sites de Snake Pit et TAG et rechercher une activité hydrothermale dans la zone du
permis d'exploration français des sulfures. Effectuer des levés bathymétriques. Capter des microplastiques.
Hermine 2017 16/03/2017
(Ponta Delgada)
27/04/2017 (Mindelo)
Pourquoi pas ? (Ifremer)
Explorer la zone du permis Français au nom de la France. Etudier les sites et les panaches hydrothermaux.
Transect 2018 09/07/2018
(Horta) 05/08/2018
(Horta) l’Atalante (Ifremer)
Effectuer des plongées ROV VICTOR sur la dorsale Atlantique et des levés SMF (en transit et lors des station).
Suivi de traitement des données bathymétriques sur GLobe et de compilation des campagnes par zones. Source personnelle
Coordonnées projetées en WGS 1984 World
Mercator
Sources : base de données Ifremer/SISMER
Description détaillée de la démarche entreprise pour traiter indépendamment chaque campagne. Les conversions en dtm sont utiles pour
visualiser le résultat des traitements appliqués aux fichiers dtm. Source personnelle
Vue dans le logiciel GLobe des trois modèles numériques de terrain obtenus après le traitement et la compilation des données bathymétriques
sur les trois zones de la dorsale Atlantique Nord centrale. D’après GLobe, source personnelle
73
Hypothèse actuelle sur la localisation de la limite entre les deux plaques américaines. NA : Amérique du Nord ; SA : Amérique du Sud ; NB : Nubia. a) Planisphère représentant les épicentres des séismes entre 1967 et 2007, de magnitude égale ou supérieure à 3.5 (noir) et 5.5 (rouge) à moins de 40 km de profondeur (geological…) b) Planisphère de la configuration actuelle des plaques tectoniques. La limite de plaque entre NA et SA est peu connue (estimée entre la zone en pointillés). Les isochrones sont représentés par des points de couleurs différentes. D’après (DeMets et Merkouriev, 2019)
77
Localisation des onze secteurs situés à l’Ouest (oranges) et à l’Est (bleus) de la dorsale Atlantique, extraits
des MNT sur ArcMap. Source personnelle
Coordonnées projetées en WGS 1984 World
Mercator
Sources : base de données Ifremer/SISMER
Répartition des expositions des pentes supérieures à 15° le long de la dorsale Atlantique Nord. Source personnelle
Sources : base de données Ifremer/SISMER
Répartition des expositions des pentes supérieures à 15° le long de la dorsale Atlantique Nord. Source personnelle
Sources : base de données Ifremer/SISMER
Répartition des expositions des pentes supérieures à 15° le long de la dorsale Atlantique Nord. Source personnelle
Sources : base de données Ifremer/SISMER
81
Présentation des moyennes d’exposition des flancs des collines abyssales dans les onze secteurs
d’étude. Les chiffres en gras sont les expositions des failles normales. Source personnelle
Est (de 1° à 180°) Est autour du pic Ouest (de 181° à 360°) Ouest autour du pic
DormasisSO1 29,64 43,56 105 99 281 277
SeadmaO4 22,39 45,52 98 101 277 279
FaranautO1 18,71 46,53 114 103 266 278
FaranautO2 15,78 46,86 96 96 269 270
FaranautO3 14,23 45,19 90 90 272 270
Est (de 1° à 180°) Est autour du pic Ouest (de 181° à 360°) Ouest autour du pic
DormasisNE1 34,21 36,86 108 107 283 280
DormasisSE1 29,39 42,26 100 103 286 279
SeadmaE4 22,26 44,61 97 99 278 280
FaranautE1 18,62 46,10 106 103 277 275
FaranautE2 15,75 46,43 96 92 268 272
FaranautE3 14,22 44,84 93 92 271 272
Secteur à l'Ouest
de la dorsale Latitude (°N) Longitude (°W)
Moyenne des expositions
Secteur à l'Est de
la dorsale Latitude (°N) Longitude (°W)
Moyenne des expositions
Coordonnées projetées en WGS 1984 World Mercator
Sources : base de données
Ifremer/SISMER
D.EVE321 / Version : 3.4 Page 12 sur 12
ANNEXE 1 – GRILLE D’AUTOEVALUATION DE LA PRESENTATION DU DOCUMENT Le document est agrafé ou relié (pas de pochettes transparentes). oui non
Les normes sont respectées (exemple en annexe du document EVE124) : oui non
- Page de titre comportant : oui non
O Titre oui non
O Auteur (Prénom NOM) oui non
O Nom, adresse et logo UniLaSalle oui non
O Nom et adresse de l’organisme hébergeant le stage oui non
O Type de document (« rapport de stage ») oui non
O Spécialité oui non
O Année de scolarité oui non
O Promotion oui non
O Nom, prénom et qualité du maître de stage et du tuteur de stage oui non
- En-tête et/ou pied de page avec a minima le titre du rapport, le nom de l’élève et son n° de promotion oui non
- Marges suffisantes oui non
Le document est exempt de fautes d’orthographe. oui non
La syntaxe est correcte. oui non
La rédaction est de style écrit et non oral. oui non
L’expression est précise. oui non
La pagination commence dès la page de titre (cette dernière est comptée mais non numérotée). oui non
La pagination est continue, annexes et illustrations comprises. oui non
Le sommaire des tableaux est distinct de celui des autres illustrations. oui non
Les abréviations, symboles et unités sont définis dès qu’ils apparaissent pour la première fois dans le texte. (Ils peuvent être définis dans le texte, mais, s'ils sont nombreux, il est préférable de les définir à part, dans une liste).
oui non
Les abréviations ou symboles sont ceux que recommande la norme ISO 1000 (disponible au centre de documentation) ou par des normes nationales ou des spécifications d'organismes compétents.
oui non
Les termes qui demandent explication sont définis dans un glossaire. oui non
Le texte commence par une introduction, il est suivi du développement divisé en plusieurs parties, éventuellement sous-parties, et se termine par une conclusion.
oui non
Chaque illustration comporte une légende précise, horizontale et non encadrée, avec mention de la source. oui non
Chaque illustration comporte, le cas échéant, en plus de la légende : échelle, orientation, grille, datum et système de projection.
oui non
Les références des figures issues de la littérature sont annoncées dans la légende en mettant entre parenthèses le nom de l’auteur en majuscules suivi d'une virgule et de l’année de publication [Exemple : (PHILIPPE, 1994)].
oui non
Les références sont annoncées dans le texte en mettant entre parenthèses le nom de l’auteur en majuscules suivi d'une virgule et de l’année de publication [Exemple : (PHILIPPE, 1994)].
oui non
Les citations courtes (comportant moins de quatre lignes) sont incorporées au texte et placées entre guillemets. oui non
La liste de références bibliographiques contient les éléments nécessaires et respecte les normes figurant dans le document EVE124.
oui non
Les documents éventuellement mis en annexe contiennent des informations qui ne sont pas essentielles à la compréhension du texte principal.
oui non
Toute annexe est annoncée dans le texte principal. oui non
Les pages des annexes sont numérotées ; leur pagination doit continuer celle du texte principal. oui non
Chaque annexe est séparée des autres par une page de garde, sur laquelle est donné en grande police sa lettre majuscule d’identification et son titre.
oui non